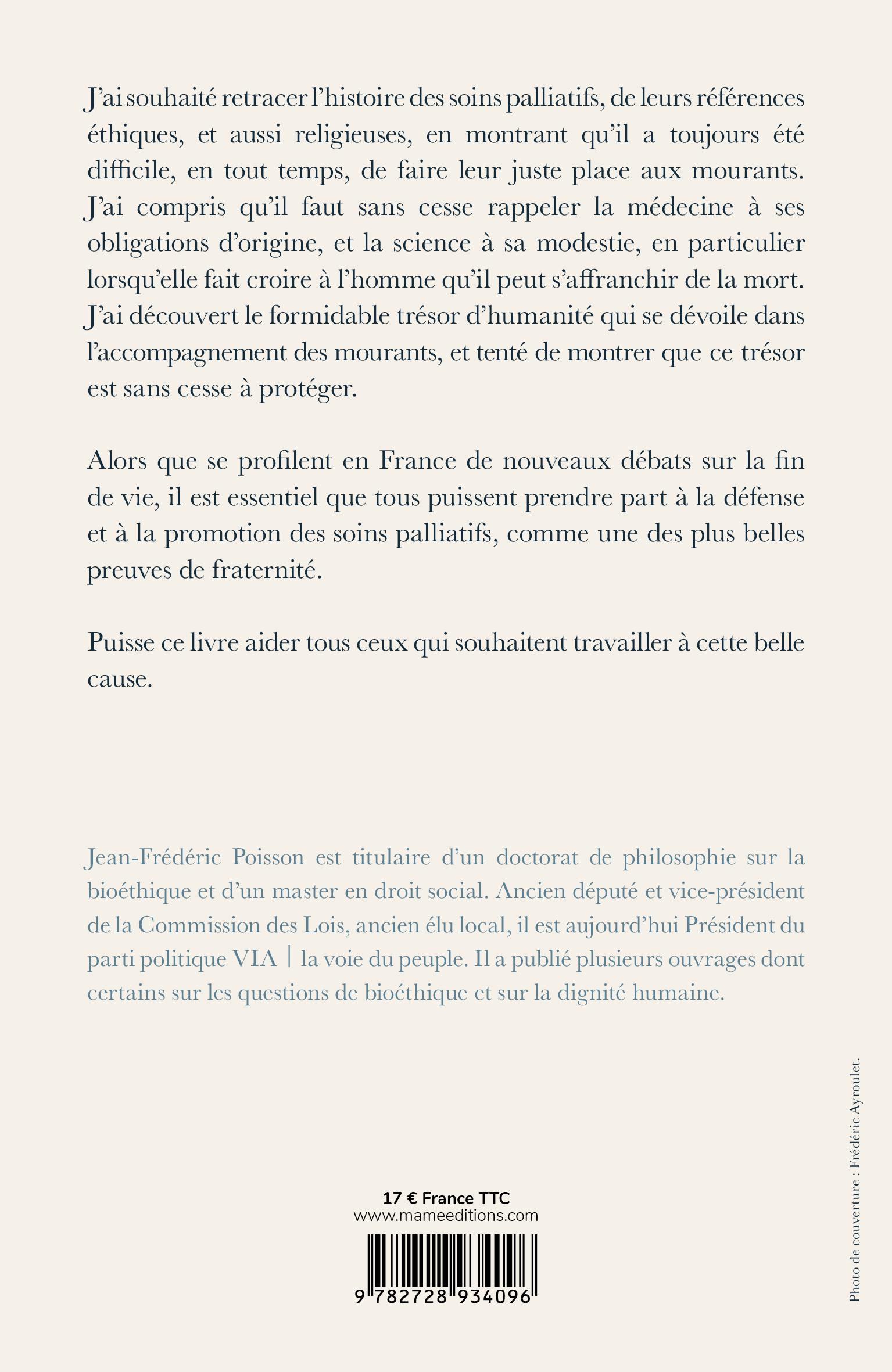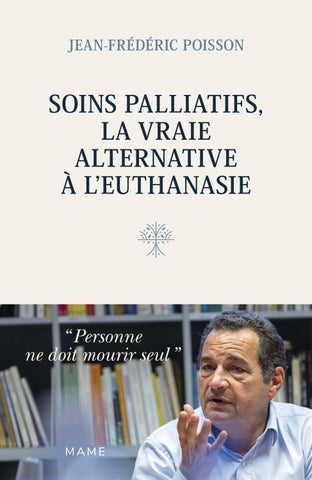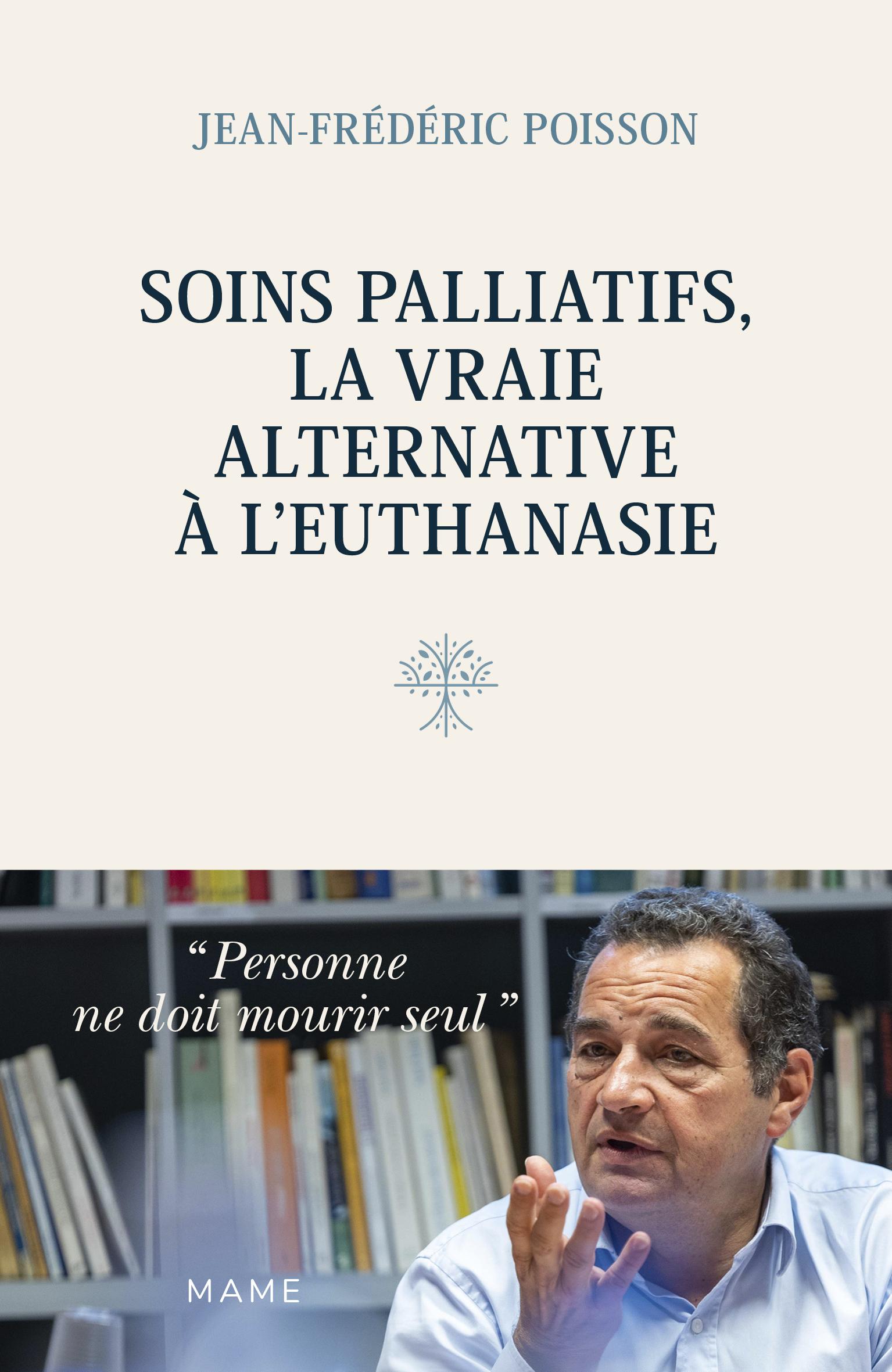
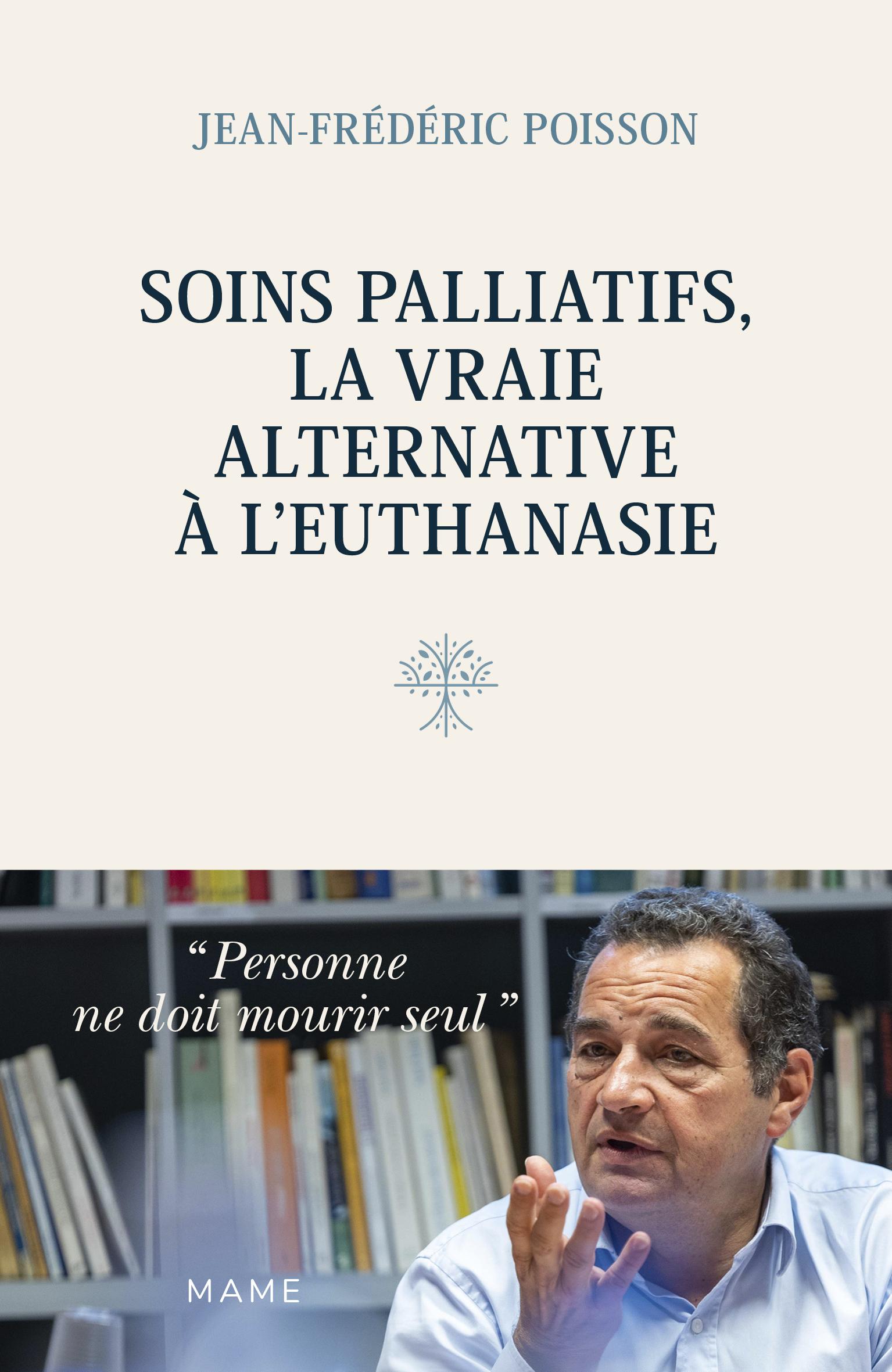
SOINS PALLIATIFS, LA VRAIE ALTERNATIVE À L’EUTHANASIE
Remerciements à Alexia, Benoît, Francis, Thierry, Anne, Hubert pour leur précieux concours à ce travail. À Frédéric D., in memoriam.
Direction : Guillaume Arnaud
Responsable éditoriale : Sophie Cluzel
Composition : Pixellence
Direction de fabrication : Thierry Dubus
Fabrication : Sabine Marioni
Mame, Paris, 2023
www.mameeditions.com
ISBN : 9782728934096
MDS : 182010N1
Tous droits réservés pour tous pays.
JEAN-FRÉDÉRIC POISSON SOINS PALLIATIFS LA VRAIE ALTERNATIVE À L’EUTHANASIE
PERSONNE NE DOIT MOURIR SEUL
Comment répondre à l’insupportable angoisse de mourir dans l’isolement et la souffrance qui habite aujourd’hui un si grand nombre d’hommes et de femmes ? Si le « mal mourir » est à ce point répandu en France, quelle doit être la « bonne mort » ?
Pour beaucoup de médecins, de familles, d’accompagnants, la pratique des soins palliatifs est la réponse à cette angoisse, respectant et accompagnant la dignité du mourant, la souffrance des familles et le temps qui reste à vivre. Pourquoi cette évidence peine-t-elle tant à s’imposer ?
En entamant la rédaction de ce livre, je croyais que la difficulté à faire accepter l’idée selon laquelle chacun d’entre nous est digne jusqu’au dernier instant de sa vie était due à la « modernité », cette modernité qui fait de l’homme performant et conscient la seule référence valable de l’humanité.
Je croyais aussi que les soins palliatifs peinaient à s’implanter dans notre offre de santé publique parce qu’ils évoluent dans une époque qui refuse de voir la mort en face, et de l’intégrer pleinement dans le cours de la vie.
Pourtant ces résistances ne sont pas propres à notre époque. J’ai donc souhaité retracer l’histoire des soins palliatifs et de leurs références éthiques, et aussi religieuses, en montrant qu’il a toujours été difficile, en tout temps, de faire leur juste place aux mourants. J’ai compris qu’il faut sans cesse rappeler la médecine à ses obligations d’origine, et la science à sa modestie, en particulier lorsqu’elle fait croire à l’homme qu’il peut s’affranchir de la mort. J’ai découvert le formidable trésor d’humanité qui se dévoile dans l’accompagnement des mourants, et tenté de montrer que ce trésor est sans cesse à protéger.
Comme les mauvais feuilletons interminables, ou les marronniers de la presse, l’euthanasie revient sur le devant de la scène politique. À l’automne 2022, on annonçait l’imminence d’une conférence citoyenne sur ce sujet, qui sera suivie, n’en doutons pas, par le dépôt d’un projet de loi visant à légaliser l’euthanasie. Ajoutons que cette légalisation a fait l’objet d’une promesse formelle du candidat Emmanuel Macron lors de la campagne ayant abouti à sa réélection au printemps 2022. Non pas que l’habitude de ces gouvernements successifs à tenir leurs promesses nous rendent absolument certains que celle-ci sera tenue plus que les autres, mais cette fois-ci le danger se précise. Au point, d’ailleurs, que le président de la commission des lois de l’Assemblée nationale est allé jusqu’à déclarer, dans les colonnes du journal La Croix en date du 24 septembre 2022, que la légalisation de l’euthanasie serait proposée au Parlement, quelles que soient les conclusions du débat national. Se profile donc sous nos yeux un scénario identique à celui que nous avons déjà connu par deux fois : en 2015, au moment de la première révision des lois de
bioéthique, et en 2018, au moment de la loi sur la PMA. En ces deux occasions, un débat national a été lancé. En ces deux occasions, les restitutions de ces débats ont été purement et simplement ignorées par les pouvoirs publics. Elles avaient le redoutable défaut d’aller contre les intentions gouvernementales et de montrer une opposition manifeste aux principes de ces projets.
Personne ne peut présumer des conclusions de ce nouveau « grand débat » sur l’euthanasie, mais l’orientation principale est déjà connue : le Gouvernement veut légaliser l’euthanasie.
Ajoutons qu’au moment des débats parlementaires sur la loi Claeys-Leonetti, en 2015-2016, un des principaux arguments avancés en faveur de son soutien consistait à dire qu’elle constituerait, par son caractère complet et sage, un véritable garde-fou contre d’éventuelles et ultérieures intentions euthanasiques. En guise de démonstration pratique, les deux rapporteurs avaient contribué énergiquement à rejeter un amendement visant à légaliser l’euthanasie. Cet amendement était porté par une petite centaine de députés de la majorité de gauche de l’époque, avec à leur tête monsieur Touraine, membre influent de la majorité macroniste de la législature suivante. Il avait été repoussé par l’Assemblée nationale, grâce à la mobilisation de l’opposition de droite de l’époque. Il n’en serait sans doute pas de même aujourd’hui, comme invitent à le penser deux événements récents : le vote, en 2021, par l’Assemblée nationale d’une proposition de loi visant à légaliser l’euthanasie, et l’adoption par le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) d’un avis considérant comme possible cette même
légalisation1. Symboliquement, il est vrai, ces deux faits sont autant de « premières » : à ce titre ils donnent l’impression de « changer la donne ». En réalité, ils ne font que confirmer ce que nous évoquions plus haut et que le CCNE mentionne lui-même dans son avis : la pression croissante de l’opinion publique en faveur d’une modification sensible de la législation sur la fin de vie, dans le sens d’une légalisation de l’euthanasie. À vrai dire le Comité d’éthique se contente désormais de dire le temps qu’il fait. « Il ne serait pas éthique d’envisager une évolution de la législation si les mesures de santé publique recommandées dans le domaine des soins palliatifs ne sont pas prises en compte », est-il mentionné dans l’introduction. Et encore : « à l’instar de ses travaux passés relatifs à la fin de vie, le CCNE met l’accent dans cet avis sur deux principes fondamentaux : le devoir de solidarité envers les personnes les plus fragiles, et le respect de l’autonomie de la personne. La conciliation de ces deux principes demeure la ligne directrice du présent avis en toutes ses composantes ». Autrement dit, et pour traduire la rhétorique du Conseil : du moment que les conditions de procédure et quelques préalables présentables sur le plan éthique sont réunis, on trouvera le moyen d’un compromis éthique aboutissant à légaliser le suicide assisté. Si ce n’est pas de l’éthique, ça…
Quant au Parlement, certains remarqueront qu’étant issu de la population nationale, il ne peut guère qu’être à son image ; d’autres feront remarquer que la conscience dont les parlementaires devraient être dépositaires les rend, en principe, moins sensibles aux fluctuations et aux passions de l’opinion publique.
En tous cas, ces deux événements ne font que s’inscrire dans ce que nous avons mentionné plus haut : la lente et continue dégradation du respect de la dignité humaine dans nos sociétés.
Pourquoi changer la loi ? On entend bien que les mêmes arguments, toujours formulés de manière identique, presque au mot près, refont surface, avec le même manque de percussion, du reste. Le journaliste B. Poulet en donne un bon résumé dans un article de l’automne 2022 : « Accepter le suicide assisté, c’est reconnaître la réalité du monde contemporain et des transformations qu’il a connues. Les progrès spectaculaires de la médecine ont changé les conditions de la mort. En permettant à de plus en plus de gens de vivre vieux, voire très vieux, parfois “trop” vieux, elle a ouvert la voie aux longues agonies. La médecine est capable de prolonger indéfiniment des vies qui n’en sont plus.
La définition même de la mort est devenue incertaine »2. L’une de ces opinions suffit-elle à bouleverser l’ordre juridique et moral de notre société en brisant l’interdit de tuer ? Sans doute pas.
D’autant plus que les dernières avancées législatives sont encore récentes, et il est prudent de ne pas changer une loi dont la durée d’application est courte et les effets inconnus. Or, la loi Claeys-Leonetti n’a été promulguée que le 2 février 2016. La peinture est d’autant plus fraîche que deux ans après, la Haute Autorité de santé reconnaissait dans un rapport officiel que cette loi était mal connue et mal appliquée, tant des patients et de leurs familles que du personnel de santé. Quatre ans plus tard, aujourd’hui, la loi aurait-elle fait des progrès substantiels
en termes de compréhension par l’opinion publique ? Peut-on considérer qu’elle serait mieux appliquée aujourd’hui, six ans après promoulgation ? Rien ne permet de le dire, et aucun rapport officiel ne fait aujourd’hui le bilan de six ans de mise en pratique de cette législation. Aucun des éléments qui attesterait de l’inefficacité ou de l’incomplétude de cette loi n’est avancé pour justifier qu’elle soit révisée.
D’autre part, on voit bien que la loi, quelles qu’aient été ses intentions, n’a rien empêché ni contenu. Rien n’a été fait pour enrayer la mécanique euthanasique qui se déploie dans notre pays depuis longtemps. Ni la pédagogie de la loi, censée reléguer l’euthanasie dite « active » au rang des solutions du passé, et la rendre inutile aux yeux de ceux qui pouvaient en être tentés ; ni le renforcement des soins palliatifs, authentique possibilité face à la pratique de l’euthanasie, et seule manière de réellement accompagner les malades en fin de vie jusqu’à leurs derniers instants. On peut même considérer, à bon droit, que l’accumulation de circonstances défavorables n’a fait que renforcer, dans l’opinion publique, la nécessité d’une législation sur l’euthanasie. À quoi avons-nous assisté depuis l’entrée en vigueur de la loi de février 2016 ?
La déstabilisation progressive de notre système de santé, public comme privé, dont la crise sanitaire de 2020 a constitué une sorte de point d’orgue, confirme que la préoccupation du respect de la dignité humaine en matière sanitaire n’est plus prioritaire dans l’esprit des pouvoirs publics. L’avancée à marche forcée vers la marchandisation de l’être humain, la création officielle d’un marché de la procréation provoquée par l’adoption de la loi sur la PMA pour toutes les femmes contribuent encore
à accentuer – si c’était possible – la dévalorisation de l’être humain dans les esprits contemporains. Mentionnons aussi les débats nourris qui se déroulent encore, début 2023, sur les manquements graves constatés dans la gestion de la crise de la covid. Le plus grave est sans doute celui du Rivotril, qu’on a détourné pour l’utiliser comme agent d’une euthanasie déguisée. Le mépris des exigences de sécurité sanitaire les plus élémentaires fait peser un doute très lourd sur la question de savoir ce qui, d’une part, du contentement des grands fournisseurs de vaccins ou, d’autre part, d’une gestion saine, raisonnable et vérace d’une pandémie, a constitué pendantcette période la priorité du Gouvernement. Et l’on ne peut s’empêcher de faire le lien entre les contraintes économiques pesant sur les institutions de santé, et la volonté d’accélérer la rotation des patients dans les services pour en accroître la rentabilité. C’est le thème : « Dépêchez-vous de mourir, on a besoin du lit. » Évidemment, la pratique euthanasique coûte beaucoup moins cher que l’accompagnement de fin de vie. Et par les temps qui courent, alors que la dimension budgétaire l’emporte sur absolument toutes les autres considérations, il n’est pas étonnant d’entendre et argument.
Cependant, la vérité fait aussi son chemin : plus lentement que le mensonge et la manipulation, au point parfois de rendre insatiables les impatients. Le nombre de personnes qui souhaiteraient avoir accès à des soins palliatifs en cas de besoin n’a jamais été aussi important. Pour y répondre, des initiatives privées, de nature associative, ont développé des services de soins palliatifs à domicile. Leur succès éthique, médical et social est spectaculaire. Il n’y a donc pas d’urgence sauf la double nécessité de revitaliser notre système de santé et de renforcer la culture du
respect de la dignité humaine. L’euthanasie et sa légalisation ne s’approchent en aucune manière de ces deux objectifs : elles s’en éloignent même énergiquement.
En revanche, le progressisme institutionnel déroule son agenda, sans encombre. La marche du monde actuel nous donne à voir un plan en quatre étapes, que l’on pourrait résumer ainsi : 1/ on anesthésie les peuples ; 2/ on leur fait peur ; 3/ on constate qu’ils n’aiment plus la vie et que parfois même ils ont envie de mourir ; 4/ on les aide à cela.
Vous trouvez ce résumé brutal ? Il l’est sans doute. Quoi qu’il en soit, la dévalorisation continue, constante et organisée de la vie humaine n’ouvre pas seulement la porte à toutes les maltraitances, et tous les esclavages imaginables. Elle rend possibles toutes les dominations, tous les autoritarismes, tous les dévoiements du bien commun. En 2022, comme en 2015, les arguments permettant de justifier la valeur et le sens des soins palliatifs n’ont pas perdu une once de gravité. Cette pratique et sa philosophie s’imposent dans le monde actuel comme dans celui d’il y a huit ans. Alors que la crise sanitaire, puis maintenant la guerre, placent chaque personne en situation de grande fragilité, le rappel des principes les plus élémentaires du respect intégral de la dignité humaine revêt un caractère d’urgence inégalé. Ce rappel est pratique, efficace, et plein de sens. Il nous le répète, inlassablement et dans une sorte d’indifférence quasi générale : chacun doit être accompagné pour vivre les derniers instants de sa vie, en raison de leur inestimable valeur. Ces derniers instants peuvent permettre à la société entière, par délégation aux accompagnants, de pratiquer une dernière fois une solidarité aimante et effective. Le bilan terrifiant des
pays qui ont légalisé l’euthanasie devrait faire réfléchir ceux qui veulent y recourir. Les témoignages des personnes à qui on a demandé « d’assister les demandes de suicide » sont plus que dissuasifs. La légalisation de l’euthanasie est un échec humain. Au milieu de ce nouveau débat « sociétal », notre devoir consiste à faire connaître et se répandre la pratique si noble des soins palliatifs, comme seule réponse possible à la logique suicidaire de l’euthanasie. C’est ce que nous invite à dire les témoignages de personnes, patients ou non, qui ont été tentées par le recours à l’euthanasie avant que les circonstances ne leur permettent de comprendre quelle déraison il y a à vouloir choisir sa mort et son moment, et que la seule bonne mort souhaitable est celle à laquelle on se prépare, en étant accompagné comme il se doit. Tout particulièrement dans les derniers instants de la vie, « chaque instant est précieux », dit un patient qui a finalement renoncé à l’euthanasie3. « Personne ne doit mourir seul » est ainsi un mot d’ordre utile pour l’ensemble du corps social. « En creux, la légalisation de l’euthanasie nous dit : ‘Tu es digne tant que tu es autonome. Quand tu es vieux ou fragile, la question de la mort doit se poser.’ À l’inverse, la loi actuelle envoie le message que ces personnes représentent quelque chose pour la société et qu’il est important de les accompagner »4.
Puisse ce livre aider tous ceux qui souhaitent travailler à cette belle cause et être accueilli par eux comme une expression de gratitude.
3 Le Figaro, 14/10/22. 4 Dr Claire Fourcade, présidente de la SFAP, interviewée par Le Figaro, 12/09/22.PREMIÈRE PARTIE
LES SOINS PALLIATIFS, LA SOCIÉTÉ MODERNE ET LA MORT
CE SCANDALE SI PARADOXAL DE LA MORT
Le monde moderne vit un curieux paradoxe : jamais la mort n’a autant été mise en scène, autant filmée et diffusée, montrée, parfois jusqu’à l’obscénité. Et pourtant elle ne nous a sans doute jamais été plus étrangère.
Avec son corps (et non malgré lui), l’homme entretient l’illusion de sa propre immortalité. Il touche les cimes. Il s’émerveille de percevoir, avec l’aide de ses sens, les harmonies subtiles des œuvres d’art ou des paysages naturels. Il goûte, en plus des plaisirs du corps, aux joies spirituelles de l’amour. Ces différentes dimensions de la vie de l’esprit le placent comme hors du temps, lui font goûter un monde dont il sait, même confusément, qu’il ne faudrait jamais en partir. L’homme est le seul animal à savoir qu’il va mourir, mais aussi le seul à être convaincu qu’il ne le devrait pas. La mort ne va pas de soi : il faut lui trouver des raisons à proportion de la terreur qu’elle cause.
Face à ce scandale de la souffrance et de la mort, l’humanité a tout tenté pour en trouver l’origine : le hasard, la faute de l’homme, la faute de Dieu, une création mal faite… Autant de causes successivement ou simultanément avancées par les hommes pour tenter d’expliquer l’inexplicable : pourquoi fautil donc être malade, souffrir et mourir ?
Les anciens concevaient la mort comme une sorte d’illusion, que l’éternel retour des événements et des choses permettait de considérer avec calme. Certains modernes ont inventé la théorie de la « méchanceté » de Dieu, tordant la raison au point de donner à Dieu un pouvoir de « mal faire » incompatible avec sa toute-puissance : « Si la vie est inventée par Dieu, qui d’autre que lui pourrait avoir suffisamment de puissance pour la faire mortelle ? »
D’autres hommes modernes ne sont pas parvenus à se faire à l’idée de la mort dans un monde voulu par Dieu. Ils ont donc tenté de l’évacuer, faisant en sorte que l’inexplicable de la mort soit dépourvu de toute forme de signification. Ils ont ainsi consacré le hasard comme le maître du temps et de la création, et non plus Dieu ou n’importe quelle autre divinité qui pourrait donner sens et obligation à quiconque.
En dépit de tous les progrès accomplis par l’humanité, la mort n’est pas mieux connue ni mieux appréhendée par notre époque que par les précédentes. Elle est encore inapprivoisée, incompréhensible, inintelligible : « Le soleil ni la mort ne se peuvent regarder fixement », écrit La Rochefoucauld5 : la mort éblouit, elle aveugle tant qu’il faut regarder ailleurs pour tâcher de la
comprendre. Elle reste cependant, comme le soleil pour nos sens, trop difficile à recevoir pour notre intelligence. Comme si elle n’était au fond saisissable que de manière détournée, indirectement. La modernité, son cortège d’orgueils et de promesses illusoires n’y ont rien changé. L’homme est mortel – il le restera – et l’invitation de Montaigne à « philosopher pour apprendre à mourir6 » est encore d’actualité.
On pourrait même dire que la véritable ambition moderne (le triomphe définitif de la raison humaine sur la nature) a aggravé l’incompréhension de l’homme à l’égard de la mort, et par conséquent rendu plus difficile la position individuelle et collective à adopter face à elle.
Malgré une si longue fréquentation, nous considérons encore la mort comme un scandale – à raison, certainement. Elle l’est d’autant plus lorsqu’elle frappe ceux qui « ne devraient pas » mourir, par exemple les plus jeunes. Elle nous est si peu familière que nous considérons comme seule « acceptable » la mort qui vient nous chercher dans la vieillesse, au milieu du sommeil, et sans douleur : le langage commun appelle cela « mourir de sa belle mort ».
Dans un monde principalement marqué par la difficulté à répartir l’abondance des richesses créées, la mort sociale est vécue comme un avant-goût de la mort véritable. S’ils ne meurent pas physiquement, atteints par l’isolement, authentique mort relationnelle, beaucoup de nos contemporains subissent des traumatismes qui ne tuent « que » leur capacité à prendre part activement et visiblement à la vie collective, à la construction
de la cité, etc. Il ne s’agit pas ici de morts au sens clinique, mais de morts comme en fait la solitude définitive. Il est proprement inhumain d’être un ermite contraint.
L’incompréhension moderne face au scandale de la mort est encore plus marquée lorsque s’y adjoint une forme de déchéance. S’ajoute alors à la douleur de la séparation, à l’impossibilité de se confronter à sa propre fin, le caractère insupportable de la souffrance continue et du « déchérissement7 » de soi. Alors la dépréciation de sa propre image persuade le patient en fin de vie comme son entourage que plus rien de lui ne permet d’être réellement reconnu et considéré comme une personne. Cette dépersonnalisation est d’autant plus cruellement ressentie qu’elle est vécue deux fois : dans le corps et dans l’esprit. Non, décidément l’homme n’est pas fait pour mourir. Pas seulement à cause des larmes, de la crainte, de l’angoisse, de l’effroi que suscite l’inconnu qui se présente à lui à ce moment. Tout simplement, l’homme ne devrait pas mourir : c’est notre sentiment à tous, à la fois terriblement confus et unanimement partagé.
Ainsi, la mort demeure pour nous tous un mystère, dans ses raisons, mais aussi dans ses modalités. Sa compréhension fait appel à des concepts dont on sent qu’ils sont insuffisants – comme lorsqu’on évoque les seules dimensions physicochimiques –, ou au contraire trop vastes pour notre raison. S’il n’est en effet pas nécessaire de croire pour penser l’immortalité de l’âme, il faut la foi pour imaginer la vie éternelle. La réalité de
7 Le mot « déchérissement » n’existe pas, mais il nous semble particulièrement adapté à la circonstance et plus parlant que le terme « dépréciation ».
la mort, l’inutilité de la souffrance et son caractère scandaleux demeurent pour l’intelligence humaine réduite à ses propres forces une bizarrerie sans égale. Personne n’en est revenu pour enseigner ce qu’elle est (hormis pour les chrétiens Jésus-Christ lui-même). Et si elle soulage, comme l’ont écrit Baudelaire et un nombre considérable de poètes ou de romanciers, ce n’est que de l’insupportable lassitude causée par la souffrance ou la misère. Elle est pour eux comme une sorte de risque à prendre : rien ne pouvant être pire que ce qu’ils connaissent, le soulagement qu’elle apporte en vaut bien un autre et présente l’avantage insigne d’être acquis une fois pour toutes.
Alors envisagée comme un passage, la mort n’en demeure pas moins imprécise. Comme si elle n’était rien en elle-même, rien d’autre qu’une sorte de mauvais moment à passer, un état proprement transitoire, l’instant dans lequel, disaient les anciens, l’âme et le corps se séparent. Cette séparation est certaine, inéluctable. Elle est crainte, incomprise et redoutée.
L’INCOMPRÉHENSIBLE LÉGÈRETÉ MODERNE FACE À LA MORT
Jamais les enfants n’auront été si facilement confrontés à la mort, jouée et rejouée à l’envi dans des jeux vidéo où chaque participant dispose de « plusieurs vies », ré-activables d’un simple clic. Tout concourt à faire de la mort une sorte d’événement virtuel, banal, auquel on assiste en pur spectateur, et que l’on ne médite plus guère. Au mieux on la commente dans une actualité qui ne met jamais en scène que la mort médiatisée, donc forcément spectaculaire, de quelqu’un d’autre. Tandis que
l’enseignement « classique » de la littérature, de la poésie, de la mythologie et de l’instruction religieuse déserte les salles de classe, les paroisses recrutent des bénévoles pour accompagner au cimetière, les jours de Toussaint, les familles venues rendre visite à leurs défunts, parfois sans trop savoir pourquoi. J’ai entendu un matin de 11 Novembre un grand adolescent, jeune sapeur-pompier qui participait à la commémoration de l’armistice de 1918, dire : « C’est la première fois que je viens dans un cimetière. »
Quelquefois même la mort est une cause d’étonnement. Les réactions au décès de l’athlète Florence Joyner, championne olympique d’athlétisme en 1988 à Séoul, sont emblématiques. Les performances et la fulgurante progression de l’athlète avaient alors beaucoup intrigué les observateurs. Un matin de 1998, on l’avait retrouvée morte chez elle à l’âge de trente-neuf ans. Les médias s’étaient étonnés de ce décès, ravivant les interrogations précédentes : « Rien d’étonnant à ce qu’une athlète qui a probablement eu recours au dopage connaisse une mort précoce. »
Comme si la mort d’une personne riche, célèbre et apparemment en pleine forme, en phase avec le modèle dominant actuel, était impossible. Comme si la condition humaine ne consistait justement pas aussi à croiser un jour la mort de manière inattendue. Au sentiment d’injustice et d’incompréhension provoqué par une disparition dans des circonstances accidentelles, la modernité vient presque ajouter l’idée d’une mort « impossible ». Une championne parvenue au sommet de sa gloire aux Jeux olympiques de Séoul a nécessairement payé la note de ses relations imprudentes à la « médecine » sportive, puisqu’on ne peut tout simplement pas mourir de sa « bonne mort », à trente-neuf ans, pas si jeune, même d’une asphyxie provoquée par une crise d’épilepsie.
Notre temps marqué par la performance, le culte de l’exploit sportif, et qui repousse sans cesse les limites de la condition humaine, vit dans un refus presque pathologique de la fragilité des hommes.
Ce rejet se voit dans la formidable ambiguïté de notre relation au progrès scientifique. Adulé au-delà du raisonnable lorsqu’il ouvre de nouvelles perspectives, il est immédiatement soumis à toutes formes de procès, dans lesquels la raison a peu de place, dès lors que la technologie humaine fait défaut : il est impossible que la science faillisse, puisque c’est la science. A fortiori depuis que la technologie a donné l’illusion à l’homme qu’il pouvait répliquer le mouvement naturel sans erreurs et sans limites. Par conséquent l’homme doit pouvoir échapper à sa condition. Au fond, ce n’est sans doute qu’une question de temps…
Tout de même, au-delà du drame atroce vécu par le peuple japonais en mars 2011, après le tsunami qui a frappé Fukushima il est devenu impensable – et presque impoli –de considérer que les Japonais avaient effectivement pris toutes les précautions possibles compte tenu des informations en leur possession, en construisant la centrale nucléaire dont la destruction inquiète le monde entier. C’est oublier que, si l’homme s’est entendu inviter, dans la Genèse8, à dominer la nature et à la soumettre, et si Descartes a répété cette invitation à se rendre « comme maître et possesseur de la nature9 », rien n’a jamais été plus patent que le contraste 8
entre l’incroyable maîtrise technologique dont l’humanité fait preuve et la résistance de la nature à être dominée. Quoi qu’en pensent certains futuristes, savants ou non, il est impossible que l’homme domine un jour assez la nature pour s’affranchir de la mort, en tout cas sur cette terre.
Mais ce rejet de la fragilité humaine prend également des formes sociales inquiétantes, et brutales. La société contemporaine n’aime pas la faiblesse. Elle n’aime pas les lents, les mous, les dépressifs, les pauvres, les sans domicile fixe, les handicapés, les détenus, les « autres »… Pour preuve, la difficulté à faire comprendre l’obligation morale collective de donner aux détenus – dont, rappelons-le, la vocation demeure de vivre à terme non pas en prison mais en société – des conditions de détention dignes d’une personne humaine.
Notre belle société fournit ainsi beaucoup d’efforts pour écarter toutes ces catégories de personnes de sa vue. A contrario une énergie démesurée doit être dépensée chaque jour par ceux qui bataillent pour tenter de les maintenir connectés, malgré tout, à la vie sociale. L’individualisme dominant conduit presque inconsciemment à considérer que celui qui me sollicite en raison même de sa faiblesse me dérange, de manière d’autant plus insupportable qu’il est réputé ne rien pouvoir m’apporter. Ainsi, nous ne comprenons plus spontanément que les plus fragiles d’entre nous ont besoin de notre aide, que nous sommes obligés de la leur donner, et que dans cet échange chacun trouve de la richesse.
Notre société n’aime pas non plus les vieux, les dépendants, ni les mourants. Elle les cache, et manifeste par là son incapacité à les traiter correctement. Il n’est donc pas étonnant que
nous éprouvions collectivement de si grandes difficultés à saisir les enjeux du devoir de solidarité intergénérationnelle, en particulier celui qui consiste à faire reposer sur les enfants une partie des dépenses engagées par la collectivité pour la prise en charge de leurs parents âgés, dépendants ou pas.
LA DÉPERSONNALISATION DES SOINS
Le souci et le soin des personnes âgées ou mourantes prennent place dans ce contexte psychologique et sociologique, mais également de profonde mutation des pratiques médicales. Il y a déjà près de 30 ans, le journaliste Hervé Hamon avait publié une enquête10 très complète – et pour tout dire inquiétante – sur l’état de la médecine. Son livre rendait compte de la mentalité de l’époque, alertant sur une dérive grave de la pratique médicale : celle-ci oubliait peu à peu les malades en tant que personnes et les remplaçait par des individus vus tour à tour comme des « cas » (scientifiques ou cliniques), des sources de recettes ou de dépenses, ou des objets d’un métier, sans doute noble entre tous, mais un métier avant tout. Hervé
Hamon écrit : « C’est probablement à l’hôpital que le corps est le moins perçu comme un corps habité. À l’hôpital moderne, haut de gamme, au “grand” hôpital. La différence est sensible entre le C.H.U. et l’hôpital général : il ne s’agit pas uniquement du calibre architectural (le gigantisme n’est pas le monopole des établissements universitaires), il s’agit surtout du calibre technologique. C’est une usine à corps, un hôpital ; un corps
tronçonné, découpé en cible, palpé, mais comme un matériau, pénétré, mais comme un labyrinthe, tenu à distance par des machines, des caméras, des bilans. Avant un scanner, il n’est pas exceptionnel que le radiologue annonce dans son microphone : “Faites entrer l’épaule.” Ou le foie, ou la rate. Seul Tex Avery, peut-être, se permettrait de montrer un foie en vadrouille, déambulant dans les couloirs à la recherche du secteur biopsie11. » Le constat d’Hervé Hamon était sévère et alarmant. Peut-être même exagéré, si j’en crois les réactions des médecins avec qui j’avais eu l’occasion d’échanger à ce sujet. Mais qui pourrait nier aujourd’hui que les conditions d’accueil des malades dans les hôpitaux posent problème ? Qui peut se dire satisfait du « système » de prise en charge des pensionnaires au sein des établissements d’hébergement pour personnes âgées ? Qui peut raisonnablement soutenir que le principe de placer le patient « au centre de l’organisation des soins » est respecté partout et intégralement mis en pratique ? Comment expliquer que les cours d’éthique médicale lors des études de médecine ne sont que rarement dispensés dans des conditions satisfaisantes, et que trop peu d’élèves dans les écoles d’infirmiers entendent parler de la charte éthique du personnel soignant ?
L’organisation et la dispensation des soins – tout comme l’accueil des personnes fragiles voire dépendantes, a fortiori celui des personnes en fin de vie – ont été rattrapées par la société de la performance. Qu’elle soit celle des organisations en tant que telles, celle des comptes de gestion, celle de la technologie, celle du souci du patient, la « performance » (certainement envisagée 11
dans le mauvais sens du terme) a contribué à éloigner les malades des soignants. Faut-il chercher ailleurs la raison principale de la lassitude éprouvée de plus en plus fréquemment par une bonne partie du personnel soignant, dont le travail a été vidé de son sens, de sa finalité, de sa raison d’être ? En l’espèce, il serait illusoire de croire que le « burn-out12 » subi par beaucoup est seulement dû aux contraintes de l’organisation. Le fait d’avoir perdu de vue la finalité de son travail est au quotidien certainement tout aussi épuisant que les difficultés ou la dureté du travail en elles-mêmes.
FIN DE VIE, ISOLEMENT, PERTE DE SENS
Au-delà des habitudes et des modèles portés par la société, la proximité de la mort d’autrui renvoie chacun d’entre nous à sa propre mort. Et si « philosopher c’est apprendre à mourir », il n’est pas certain que l’on puisse jamais apprendre à affronter « correctement » la mort de nos proches.
Dans les années 1970, nombre d’intellectuels13 partagèrent ce constat préoccupant : la mort devient un sujet qui embarrasse et que l’on fuit. Ils critiquèrent une société qui évacue la mort, le mourant et le mort, ou qui ne sait plus leur accorder
12 On désigne par « burn-out » un état d’épuisement professionnel général, à la fois psychique, émotionnel et mental, dans lequel les « batteries sont vides », le sujet n’étant plus capable de récupérer sur de courtes durées. Le psychanalyste américain Herbert J. Freudenberger, inventeur de la notion, écrit à ce sujet : « En tant que psychanalyste et praticien, je me suis rendu compte que les gens sont parfois victimes d’incendie, tout comme les immeubles. Sous la tension produite par la vie dans notre monde complexe, leurs ressources internes en viennent à se consumer comme sous l’action des flammes, ne laissant qu’un vide immense à l’intérieur, même si l’enveloppe externe semble plus ou moins intacte. »
13 Michel Vovelle, Louis-Vincent Thomas, Philippe Ariès, Jean Ziegler, Edgar Morin, Jean Baudrillard, pour n’en citer que quelques-uns.
ni place, ni rôle, ni statut. Leurs études s’attachèrent à montrer les différences essentielles qui distinguent les sociétés traditionnelles des sociétés contemporaines.
Dans les premières, la mort demeure un rite social fondateur. Elle est le moment particulier au cours duquel les vivants rejouent la solidarité qui les relie. La personne du mort ainsi que la ritualisation de ses funérailles sont l’occasion pour ceux qui restent de dire que la mort leur échappe, qu’ils sont unis dans la même condition mortelle, et de rappeler que l’événement efface, au moins pendant un temps, les maux qui pouvaient diviser les vivants : il les rend futiles. Or, écrit Michel Vovelle, « la mutation capitale qui affecte notre société occidentale contemporaine est celle qui nous a fait passer d’un rapport socialisé aux morts à une relation individualisée à la mort 14 ».
Deux raisons principales peuvent être avancées pour tenter d’expliquer cette évolution. La première porte sur la médicalisation progressive de la mort, s’illustrant par le fait que la proportion des personnes qui meurent à l’hôpital, et dans une solitude fréquente, est désormais largement dominante. Nous reviendrons sur cette évolution plus loin.
La seconde raison tient directement à l’essor du relativisme philosophique, devenu la pensée dominante des sociétés contemporaines. Lorsque plus rien n’est collectivement sûr, ni solidement fondé ni universellement partagé, les personnes sont censées faire leur affaire de leur conception de la vie et de la manière de conduire celle-ci. Si les libertés étaient
à l’évidence moindres dans les sociétés traditionnelles que dans la nôtre, du moins cet état était-il la contrepartie d’un cadre social partagé, solide, et peu susceptible de laisser plonger nos contemporains dans une « ultramoderne solitude », comme chante Alain Souchon. Les sociétés où nous vivons, réputées complètement libres, invitent chacun à trouver luimême les racines de sa propre vie, de sorte que le risque est élevé d’être également seul demain face à sa propre mort. Dans un tel contexte, il n’est pas étonnant que la mort ellemême n’échappe pas à ce qui est devenu la première marque de société postmoderne : la remise en question de tout, l’interrogation sur tout, la volonté de s’affranchir de tout. Devenue absurde du fait de l’affaiblissement de l’attachement religieux, la mort n’est plus porteuse de collectif ni de ritualisation particulière. Rendue difficile à percevoir du fait de l’essor des sciences, n’étant plus clairement située au-delà de limites qui fluctuent sans cesse – ou du moins qui donnent cette impression – elle n’est même plus une « valeur sûre ». Comment pourrait-elle prétendre alors fonder quoi que ce soit de solide ou d’obligeant ? Quand la vie elle-même, qu’elle soit personnelle ou sociale, n’offre d’autre point d’ancrage que ce que chacun d’entre nous veut bien en décider, comment la mort pourrait-elle être regardée autrement ou obtenir un autre statut ? Pour reprendre l’interrogation d’un sociologue décrivant ce phénomène, la question moderne n’est plus tant
« Pourquoi est-il mort ? » ni « De quoi est-il mort ? » mais :
« En quoi est-il mort ? » Les débats autour de la mort cérébrale et du prélèvement d’organes vitaux sur des cadavres « à peine morts » sont des illustrations parmi d’autres de cette remise en
cause de la mort comme limite certaine à l’existence. À titre d’exemple récent, la France a appris que les médecins avaient prélevé des organes sur les victimes de l’attentat de Nice en 2016, sans prévenir les familles. Il était normal que cette pratique provoquât l’indignation de ces dernières, étonnées que de tels actes, irrespectueux de la dignité des cadavres, puissent avoir cours dans nos établissements de santé.
On chercherait vainement des occasions collectives d’échanger sur les questions liées au sens de la vie. Les sociétés modernes ont privatisé les conceptions morales et la manière de les vivre. Elles ont enjoint la sphère publique de garder une attitude de stricte neutralité sur ces questions personnelles. Or, en individualisant le rapport à la vie, on a évidemment individualisé le rapport à la mort. De ce fait, les mourants d’ aujourd’hui se trouvent considérablement plus isolés, plus fragiles, plus oubliés que ne l’étaient ceux d’hier. Ces derniers vivaient dans des corps sociaux aux relations connues, identifiées, vécues dans un territoire de référence, et dans un monde où la notion de « vie privée » avait paradoxalement moins de surface, mais était davantage respectée qu’ aujourd’hui. Ceux d’ aujourd’hui sont sommés de régler seuls pendant toute leur vie des questions que les corps sociaux réglaient pour eux auparavant : ils sont également seuls au moment de leur mort.
Au fond, l’ambivalence de l’opinion publique à l’égard de la politisation des débats sur la fin de vie15 relève d’une même
logique « privatiste », qui refuse que la fin de la vie puisse être une question « politique », un objet d’affrontement idéologique – comment ne pas acquiescer à cela ? Et derrière ce refus il y a la volonté de ne pas se voir voler ce moment si particulier de la mort de ses proches et de la sienne propre : un peu d’illusion moderne, au fond, sur le caractère purement privé de la mort, sur cette impression d’une sphère, d’un moment particulier qui n’appartient qu’à ceux dont la proximité familiale ou amicale justifie la présence et l’action. Cette privatisation est d’ailleurs paradoxale : plus institutionnelle, plus technique, elle laisse souvent livrés à eux-mêmes ceux qui doivent l’affronter, et les conduit à se retourner, démunis, vers le corps social, alors chargé d’assumer les aspects techniques des funérailles. Ainsi, il est difficile de convaincre que la société doit s’intéresser à ce moment particulier, qui ne peut pas se réduire à un échange intrafamilial, et qui ne peut davantage être considéré comme relevant de seules convictions privées. Il y a enfin cette volonté de considérer la mort comme un moment totalement dénué de conséquences sur la collectivité : cette idée selon laquelle « ma mort n’appartient qu’à moi ». Quelle illusion !
LES SOINS PALLIATIFS COMME RÉPONSE
Incontestablement, le mouvement des soins palliatifs est une réponse à cette question, comme à beaucoup d’autres posées par la pratique ou les concepts du monde moderne.
En un temps où il est si difficile de mourir, la pratique des soins palliatifs fait son chemin sans bruit, sans esbroufe. L’enthousiasme, le dévouement, l’énergie mise en œuvre
chaque jour par tous ceux qui accompagnent les patients en fin de vie suscitent une admiration unanime. Les témoignages reconnaissants des familles, qui ont traversé grâce à ces bénévoles et ces soignants la difficile période de fin de vie d’un des leurs, sont innombrables. À chaque fois que le budget de la santé publique est débattu devant le Parlement, des amendements sont déposés pour que la pratique des soins palliatifs se développe plus vite, plus largement, avec des moyens accrus. Pour autant, cette pratique progresse dans un monde qui peine à reconnaître l’inestimable valeur de l’être humain et l’ensemble des honneurs, des soins, de l’attention à porter aux plus fragiles d’entre nous à la fin de leur existence. La tendance du monde contemporain n’est malheureusement pas à la prise en compte, pourtant impérative, primordiale, de la faiblesse humaine, et cela se constate dans de très nombreux aspects de la vie sociale. Dans le domaine de la santé, beaucoup d’observateurs critiquent l’orientation actuelle de la médecine qui fait passer – presque contre son gré – les contraintes de l’organisation des établissements de santé avant l’élémentaire humanité des soins et le respect des patients. Dans toutes les questions qui touchent au respect de la vie commençante, il est devenu quasiment impossible de faire entendre que l’être humain doit être considéré comme digne de respect à partir de sa conception et non à partir du moment où on le reconnaît comme tel. Et si le philosophe handicapé Alexandre Jollien peut écrire un Éloge de la faiblesse16, suscitant l’admiration de tous, il n’est pas certain, c’est le moins qu’on puisse dire, que tous ses lau-
dateurs aient tiré de cet ouvrage les conclusions pratiques auxquelles il invite.
Ainsi, à l’heure où nous considérons trop facilement l’être humain comme un instrument au service de l’accroissement des profits et du triomphe de la technique et de la science, les soins palliatifs engagent une véritable révolution, on pourrait même dire une « révolution permanente ». En effet, et l’histoire de l’attention portée aux mourants le montre, c’est presque toujours contre les tendances lourdes de la société que se sont développées les pratiques visant à accorder un soin spécial à ceux qui ne « rapportent rien », à ceux dont l’état ne coïncide pas avec l’image dominante que le monde se fait de la personne humaine, à ceux que l’on n’a pas envie de voir, ou que l’on veut cacher, à ceux qui nous renvoient l’image d’une faiblesse incompatible avec la tentation de toute-puissance qui habite l’homme débridé. À l’époque du zapping, de la méfiance, de l’individualisme, de la peur de l’engagement, de la peur de l’autre tout simplement, la pratique des soins palliatifs promeut la confiance, l’attention particulière et presque illimitée à autrui, et la valeur toute spéciale du temps gratuitement consacré à une personne qui en a simplement besoin. Alors que nous subissons un militantisme effréné, très souvent mensonger, en faveur de la légalisation de l’euthanasie et d’un prétendu droit de « choisir sa mort », les soins palliatifs proclament que le droit de l’homme à bénéficier jusqu’à la fin de ses jours d’une relation attentive et amicale, « sympathique » au sens le plus fort du terme, est très supérieur à tout autre droit.
À l’heure où s’impose une volonté mécanique de réduire drastiquement les dépenses de santé et la durée de prise en
charge des patients, les soins palliatifs opposent la valeur du temps, inestimable lorsqu’il est celui des derniers instants de la vie, même s’il est en apparence improductif. Ainsi, dans la discrétion qui les caractérise, les praticiens de soins palliatifs continuent de donner vie à cette « révolution permanente » en réaffirmant cette conviction qui peine à s’imposer à tous les âges de l’humanité : « Il n’est de richesse que d’homme. »
Dès lors, la question des soins palliatifs dépasse très largement celle de leur organisation, de la formation de ceux qui les dispensent, et de l’information vers l’ensemble des citoyens afin que tous ceux qui le souhaitent puissent en bénéficier.
Bien au-delà des modalités de « gestion » ou des questions de santé ou de finances publiques, les soins palliatifs tentent de répondre aux aspirations les plus profondes de l’être humain, en contre-point des tendances dominantes de la société moderne. En particulier lorsque les êtres humains redécouvrent, à l’occasion d’une fin de vie difficile, des réalités et des valeurs que le cours de la vie quotidienne les avait peut-être conduits à oublier. Au fond, la pratique des soins palliatifs, comme tous les comportements humains, est d’abord une question de philosophie, pour ne pas dire, plus précisément, une question éthique et politique.
Beaucoup de nos contemporains connaissent, au moins de nom, cet accompagnement de fin de vie dispensé par le personnel soignant et souvent par des bénévoles. Ils savent, même confusément, qu’un ensemble de valeurs inspirées soit par une foi, soit par une morale naturelle est à l’œuvre pour le bien de tous. Bien sûr on peut supposer que les soins palliatifs sont tout à fait compatibles avec les exigences de l’éthique communé-
ment admise. Et nous développons collectivement à l’égard de ces soins une forme de sympathie reconnaissante pleinement méritée, à défaut de pouvoir dire précisément ce que sont les bases éthiques fondatrices de cette pratique.
Or, celles-ci sont si importantes, si fondatrices pour la société moderne, qu’elles méritent amplement d’être explicitées. Elles sont un socle de principes forts, intangibles, incontournables. Et là encore ce n’est pas le moindre des paradoxes de constater que ce monde moderne, qui a tant d’estime pour les principes en œuvre auprès des patients en fin de vie, en tire si peu d’enseignement sur le plan de l’organisation générale de la société. C’est sans doute que nous n’avons collectivement pas vu aussi clairement qu’il le faudrait la portée universelle de ces principes mis en œuvre en de telles circonstances, et qui sont suffisamment vastes et solides pour irriguer l’ensemble des relations humaines et sociales. C’est d’ailleurs le propre des principes « révolutionnaires », raison pour laquelle il est important de les identifier et d’en préciser la portée.
Comment les soins palliatifs ont-ils progressivement vu le jour ? Quels sont les principes simples sur lesquels sont fondées leurs pratiques ? Quels rapports cette question doit-elle entretenir avec le champ politique ? Ce sont les trois questions auxquelles les pages qui suivent tentent d’apporter une réponse.