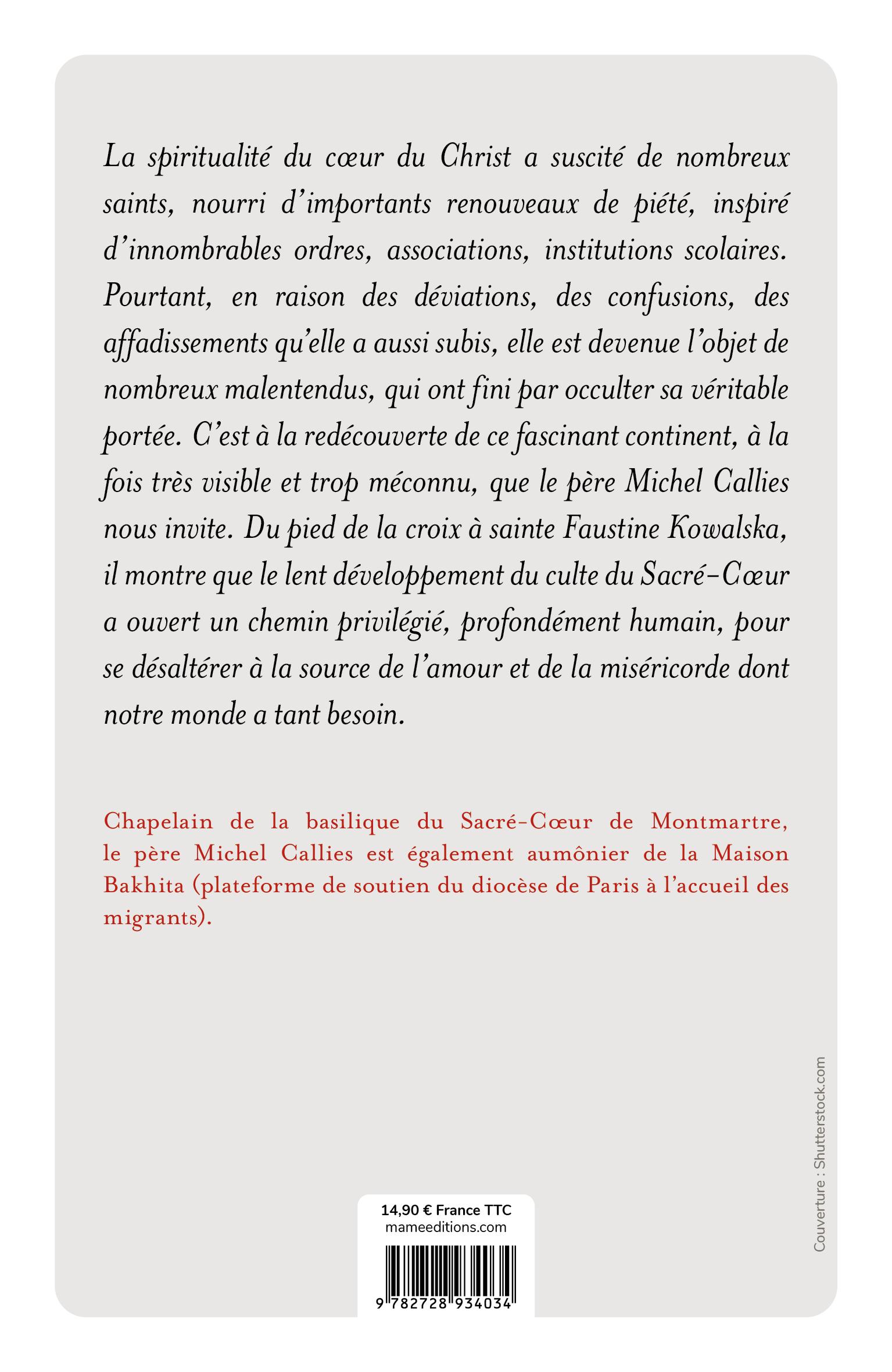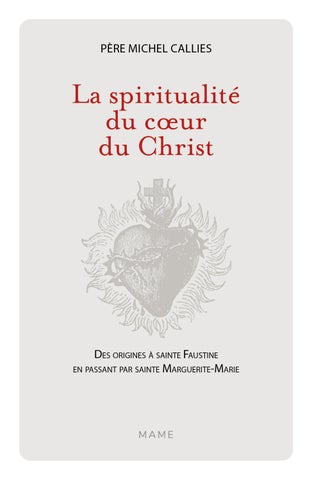La spiritualité du cœur du Christ
D es origines à sainte F austine en passant par sainte m arguerite - m arie
Préface du père Stéphane Esclef
Recteur de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre
Nihil obstat, le 15 novembre 2022
P. Patrice Sicard, Cens. dep.
Imprimatur, le 15 novembre 2022
Mgr Patrick Chauvet, Vic. Ep.
Direction : Guillaume Arnaud
Direction éditoriale : Sophie Cluzel
Direction artistique : Armelle Riva
Direction de fabrication : Thierry Dubus
Fabrication : Juliette Darrière
Mise en pages : Pixellence
© Mame, Paris, 2023
www.mameeditions.com
ISBN : 978-2-7289-3403-4
MDS : MM34034
Tous droits réservés pour tous pays.
Préface
En écrivant cet ouvrage, le père Michel Callies a voulu nous partager la profonde expérience personnelle qu’il a faite en tant que chapelain de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Il nous propose ainsi un voyage aux sources de l’amour, cet amour exprimé dans l’offrande de la vie du Christ et dans ce cœur qui a tant aimé les hommes, dans ce côté transpercé d’où coulent des fleuves d’eaux vives qui ne se tariront pas. En effet, plus que jamais, notre monde fragilisé et blessé par les guerres et les pandémies est invité à se laisser aimer, guérir et consoler par la miséricorde qui coule du cœur du Christ.
Le père Michel Callies a souhaité, à travers ces pages, nous montrer que la dévotion au cœur du Christ est un trésor pour ceux qui veulent s’en approcher. Il nous montre aussi que cette dévotion n’est pas désuète mais bien évangélique. Même si la solennité du Sacré-Cœur est finalement assez récente au regard des 2 000 ans de l’histoire du salut, le regard porté sur la plaie ouverte du Crucifié n’est pas une nouveauté apparue, brusquement, par la volonté des hommes : elle s’enracine dans l’Écriture sainte et se déploie dans la tradition de l’Église. Dans les premiers temps du christianisme, les Pères de l’Église et le peuple chrétien ont voulu exprimer l’amour infini du
Rédempteur en montrant que, dans la blessure faite à son côté (Jn 19, 33-34), se trouvait l’ouverture de la source cachée d’où découlent toutes les grâces – et cela n’est pas sans nous rappeler le prophète Isaïe (Is 12, 3) qui nous invite à puiser, avec joie, aux sources du Salut. Le thème de la miséricorde divine trouve aujourd’hui toute sa place dans cette tradition.
Cet ouvrage nous permet enfin d’entrevoir combien notre histoire a été marquée par cette spiritualité, de comprendre à quel point notre génération bénéficie encore de son héritage, à travers le culte de la miséricorde divine mais aussi la redécouverte de l’adoration eucharistique.
Merci au père Michel Callies de nous entraîner dans cet élan dont notre monde a tant besoin. À travers le cœur du Christ crucifié, une fournaise de charité et de miséricorde se manifeste : elle nous renvoie à l’amour infini du Père vers son Fils et du Fils vers son Père, et l’Esprit Saint nous rend capables d’y participer.
Et cet amour, jamais, ne disparaîtra (cf. 1 Co 13, 8).
Père Stéphane Esclef, Recteur de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, sanctuaire de l’adoration eucharistique et de la miséricorde divine.
Introduction
La spiritualité du cœur du Christ est un de ces grands courants qui traverse et ponctue l’histoire du christianisme. Elle a connu des fortunes diverses, des déviations, des confusions, des affadissements, mais aussi des développements extraordinaires : elle a suscité de nombreux saints, elle a nourri de grands renouveaux de piété, elle a été l’occasion de confidences de la part du Sauveur à des âmes privilégiées, elle nourrit une famille d’ordres, d’associations, de congrégations, de mouvements, d’institutions, de collèges, sans doute la plus féconde de l’histoire de l’Église.
Le culte au cœur du Christ est actuellement assez méconnu, c’est-à-dire mal compris, et souvent méprisé.
On s’imagine volontiers qu’il s’agit d’une « dévotion » parmi d’autres, une invention tardive qui a connu son heure de gloire au xviiie puis au xixe siècle, et qui est amenée maintenant à céder la place à d’autres courants spirituels plus au goût du jour.
Or le magistère et spécialement les papes nous ont signifié à de nombreuses reprises l’importance centrale de cette spiritualité : « En cette forme de dévotion, ne trouve-t-on pas le résumé de toute la religion, et, par le fait même, la règle de la perfection, celle qui conduit
le plus facilement les intelligences à la connaissance approfondie du Christ Seigneur, entraîne le plus fortement les esprits à son amour et le plus efficacement à son initiation1. » « Le Cœur de notre Sauveur reflète d’une certaine manière l’image de la divine Personne du Verbe et de sa double nature humaine et divine, et en lui nous pouvons considérer non seulement le symbole, mais comme la somme de tout le mystère de notre rédemption2. »
Mais avant de faire défiler les siècles et les écoles de spiritualité depuis l’ère patristique jusqu’à sainte Marguerite-Marie, il faut souligner que la méditation des saints sur le cœur du Christ a toujours été présente dans la Tradition vivante de l’Église. Comme nous tâcherons de le montrer, il est faux de déclarer que l’idée même du cœur de Jésus était inconnue au premier millénaire – néanmoins il ne suffit pas de regrouper quelques citations des Pères pour établir la continuité de cette spiritualité3.
C’est sur le seul donné révélé transmis par la Tradition qu’est fondée cette spiritualité, et non point sur des
1. Pie XI, encyclique Miserentissimus Redemptor, 8 mai 1929.
2. Pie XII, encyclique Haurietis Aquas, mai 1956, n° 43.
3. L’appellation du Sacré-Cœur (avec un trait d’union) a commencé à être employée de façon fréquente au tout début du xviiie siècle. Auparavant, il n’en existe, à notre connaissance, aucune trace. C’est pourquoi nous parlerons de préférence du « Cœur du Christ » et du « Sacré Cœur », sans trait d’union. Pour la même raison, nous éviterons autant que possible d’employer les termes « dévotion » et « culte », car ils ont subi au cours des âges des changements de sens importants. Quand nous les emploierons, ils le seront dans le sens suivant : le culte désigne un hommage officiel et public rendu par l’Église, la dévotion est une « consécration » personnelle, un attachement sincère et fervent au cœur du Christ.
apparitions ou sur quelque fait extraordinaire. Les textes de l’Écriture et l’enseignement du Magistère au cours des siècles nous permettent de « puiser de l’eau avec joie aux sources du Salut » (Isaïe 12, 3), c’est-à-dire de mieux comprendre l’importance et de recueillir plus facilement les fruits de cette spiritualité.
Il est évident que l’Écriture ne fait nulle part mention d’une vénération envers le cœur physique du Verbe incarné comme symbole1 de sa charité infinie. Il ne faut pas s’en étonner : le thème de l’amour de Dieu pour nous, objet principal de cette spiritualité, lui, y est largement développé. « Nous trouvons dans le Sacré-Cœur, remarque Léon XIII dans l’encyclique Annuum Sacrum, le symbole et l’image exacte de l’infinie charité de Jésus Christ qui nous pousse à y répondre par notre propre amour. »
Il suffit de rappeler l’alliance de Dieu avec son peuple, fondée sur le précepte de l’amour donné dans la Loi. En rapport étroit avec cette idée, l’Ancien Testament nous parle du cœur de Dieu et des sentiments qu’il éprouve : « Le cœur de Dieu est sage et grande est sa force2 », « Je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur3 », « L’encens que vous avez offert au Seigneur lui
1. Le signe conduit directement à la chose : la fumée est signe du feu. Le symbole lui, n’est pas extérieur à ce qu’il symbolise mais en est un élément dans le sens où il contient cette réalité. Il la révèle, la manifeste et est « plein d’elle ». Dit d’une autre manière, le signe est du côté de l’image, le symbole est plus proche de l’icône.
2. Jb 9, 4.
3. Jr 3, 15.
est remonté au cœur1 », « Mes entrailles s’émeuvent pour Ephraïm et pour lui déborde ma tendresse2 ».
Ainsi le « cœur » de Dieu désigne-t-il la tendresse et la miséricorde dont le Seigneur déborde pour son peuple parce qu’Il l’aime intensément et passionnément :
« Une femme peut-elle cesser de chérir le fruit de ses entrailles : moi, jamais3 », « Ému d’une immense pitié, je te rassemblerai [...] je t’avais caché ma face, mais dans un amour éternel, j’ai pitié de toi4 ».
Bien sûr, aucun de ces textes ne peut fonder, au sens strict, une spiritualité du cœur mais, comme tout
l’Ancien Testament, ils nous préparent à la plénitude de la révélation de l’Amour. Pour l’Ancien Testament, le cœur est le centre de la vie religieuse et morale, et représente un symbole fort. Il est la source et le centre de notre vie profonde : c’est l’intériorité d’un être intelligent. C’est pourquoi Dieu ne s’arrête pas à l’extérieur, à la surface de l’homme, mais il en scrute le cœur, il lui parle au cœur5, pour atteindre le sanctuaire intime de ses pensées et de son vouloir.
Quand nous en venons au Nouveau Testament, le cœur du Verbe incarné exprime les dispositions de l’âme du Christ, ses sentiments intérieurs d’amour pour son Père et pour les hommes6.
1. Jr 44, 21.
2. Jr 31, 20.
3. Is 69, 14.
4. Is 54, 6-8.
5. 1 S 16, 7 ; Jr 17, 10 ; Os 2, 16, etc.
6. Pie XII, encyclique Haurietis Aquas, n° 21.
Le signe du « cœur » est donc simplement un canal pour nous conduire à Jésus de manière plus effective et plus profonde. Cependant, le signe doit demeurer signe et ne pas se substituer à sa signification : c’est dans cette mesure qu’il joue un rôle exact et qu’il peut être accepté par tous.
La spiritualité du cœur du Sauveur n’est donc évidemment pas le culte de l’organe de chair du Christ isolé de sa personne, mais elle est, sous le signe de celui-ci, le culte de cette personne même, humaine et divine, et plus précisément le culte de l’amour du Christ – amour éternel et infini, amour humain de volonté, amour sensible également, « triple amour dont le divin Rédempteur ne cesse d’aimer le Père éternel et tous les hommes1 ».
Bien que les évangélistes et les autres écrivains inspirés ne nous décrivent nulle part le cœur du Sauveur, le Nouveau Testament nous montre le mystère de l’amour divin culminant dans l’Incarnation rédemptrice, et c’est là finalement le point central de la spiritualité du Cœur2.
L’Église, gardienne des paroles du Seigneur, en est aussi son interprète authentique. L’Esprit Saint nous dévoile progressivement des aspects nouveaux de la révélation, aspects pleinement intégrés dès l’origine mais qui n’étaient pas encore mis en lumière. C’est ainsi que,
1. Ibid ., n° 27.
2. Le langage révélé emploie comme termes pour désigner « le cœur » au sens large leb, lebab, beten , my’im , kereb en hébreu, kardia
portée par les textes sacrés, et tout particulièrement par celui qui relate la scène de la transfixion, la spiritualité du cœur connaîtra de longs et riches développements tout au long de l’histoire et nourrira la sensibilité et l’intelligence de la chrétienté.
C’est cette richesse que nous allons essayer de découvrir puisque l’intérêt porté par les pasteurs et les fidèles à la plaie du côté et au cœur du Christ ne s’est jamais relâché depuis les temps primitifs.
Nous considérerons d’abord les Pères de l’Église qui lisent, prient, commentent l’Écriture : dans cette méditation, ils opèrent entre différents textes des rapprochements d’où jaillissent les premiers éléments de cette spiritualité. Deux passages retiennent particulièrement l’attention : d’une part, la scène de la transfixion et de l’effet du coup de lance porté par le soldat (Jn 19, 33), et, d’autre part, le texte de la promesse de l’eau vive (« De son sein couleront des fleuves d’eau vive », Jn 7, 37). Dans la scène du calvaire, les Pères ont perçu cette blessure comme étant une ouverture par laquelle se répandent des torrents de grâces, grâces qui s’expriment par la symbolique du sang et de l’eau : c’est l’aspect théologique et, disons, « objectif », de cette spiritualité, qui va être privilégié jusqu’à la synthèse augustinienne. Ce sera l’objet de notre premier chapitre.
Tandis que, du vie au xie siècle, la dévotion se développe progressivement, dans les siècles suivants elle s’enrichit très vite d’éléments spirituels grâce à de nombreuses dévotions personnelles et à de multiples
« révélations privées » : c’est l’âge d’or des mystiques. Ce renouveau se réalise à partir de deux impulsions : d’une part, l’importance donnée à l’humanité du Christ, et, d’autre part, le culte de l’eucharistie. Il ne s’agit plus de la plaie du côté, mais du cœur proprement dit, source de grâces, bien sûr, mais surtout refuge du pécheur et siège des sentiments personnels et intimes du Sauveur. On prend ainsi distance avec « l’âge théologique » pour entrer dans une période plus mystique, dévotionnelle, et aussi ascétique : ce sera notre deuxième chapitre. Enfin, dans un troisième chapitre, nous envisagerons le rapprochement de ces deux courants originaux, différents, certes, mais complémentaires, qui sera effectif au xviie siècle. Ce mouvement engendre l’épanouissement de ce que l’on a appelé postérieurement le culte du Sacré-Cœur de Jésus. Par la façon dont il sut établir sa théorie des « états » du Verbe incarné sur l’adoration eucharistique, le cardinal de Bérulle et, à sa suite, l’école française, fut le véritable initiateur de la forme « moderne » de cette spiritualité. Olier, lui, institua une fête de « l’intérieur de Jésus », et saint Jean Eudes, par sa puissante synthèse et son action missionnaire, fut à l’origine du culte public au cœur de Jésus. Mais il faut laisser à sainte Marguerite-Marie Alacoque, la visitandine de Paray-le-Monial, le mérite de lui avoir donné sa dimension populaire en mettant tout spécialement l’accent sur l’amour du Christ pour les hommes et la réparation, c’est-à-dire l’union avec le Christ souffrant.
CHAPITRE PREMIER
Les prémices : des origines à saint Augustin
Les Pères de l’Église, dans les commentaires de l’Écriture, sont à la fois théologiens, spirituels, exégètes, moralistes. C’est là que nous allons trouver les premières traces de la spiritualité du Sacré Cœur, à partir de leur lecture de deux passages de l’évangile selon saint Jean, le chapitre 7, verset 37b à 38, et le chapitre 19, verset 34.
L’EAU VIVE SORT-ELLE DU SEIN DU CROYANT OU DU CÔTÉ DU CHRIST ?
En ce qui concerne le premier texte, se pose une question de ponctuation qui implique deux interprétations différentes. La version des meilleurs manuscrits anciens, qui a servi aux théologiens d’Alexandrie, porte le texte suivant : « Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive. Celui qui croit en moi, comme dit l’Écriture, des fleuves d’eau vive jailliront de son sein. »
D’après cette version, l’eau vive semble sortir du sein du croyant. C’est celle qui est adoptée par la plupart des commentateurs de cette période, à la suite d’Origène. En effet, quand celui-ci parle du « cœur » du Sauveur,
il le présente comme étant l’Hegemonikon, la source profonde de l’intelligence où le vrai gnostique, l’homme spirituel (pneumatikos) qui a reçu des grâces mystiques, vient puiser la sagesse. Cela apparaît très nettement dans son commentaire de Jean 13, 23-25, conservé seulement dans la tradition latine de Rufin : « Seigneur, qui es-tu ? En cela, il est certain que Jean a reposé sensiblement sur cette source originelle qu’est le cœur du Christ, y cherchant et scrutant les trésors de la sagesse cachés dans le Christ Jésus. Et à mon avis, il ne semble pas inapproprié de prendre le sein du Christ comme lieu des enseignements saints1. »
Ce passage semble parler à première vue du cœur du Christ mais les historiens et les spécialistes ont longuement discuté sur le sens précis du terme grec rendu par les mots latins « principale cordis Jesu ». Si certains n’ont pas hésité à traduire par « Jean se reposait tout près du cœur de Jésus », d’autres sont catégoriques : s’il est souvent question du cœur de Jésus chez Origène, ce n’est jamais qu’au sens métaphorique, pour désigner le lieu des secrets divins, des mystères de science et de sagesse que le Sauveur veut bien révéler à ses privilégiés.
Quelles qu’en soient les interprétations, ce passage reflète bien l’esprit de la dévotion telle qu’elle va se développer quelque dix siècles plus tard. Celui-ci est d’ailleurs parfaitement exprimé dans le préambule d’Origène à son commentaire : « Il faut donc oser dire que les
Évangiles sont les premiers de toutes les Écritures, et que les prémices des Évangiles, c’est l’évangile de Jean. Et de cet Évangile, nul ne peut avoir l’intelligence s’il n’a pas reposé sur la poitrine de Jésus et s’il n’a reçu, de Jésus, Marie pour être aussi sa mère. » L’effet de l’amour du Maître est de communiquer ses secrets à ses amis.
Cette interprétation assez spiritualiste du chapitre 7 de l’évangile selon saint Jean va exercer une forte influence sur Athanase, mais aussi sur Ambroise et Augustin. On ne la rencontrera que parcimonieusement, mais elle ne disparaîtra jamais totalement. Ainsi, parce qu’Origène a fait de saint Jean le modèle de l’homme illuminé par la vraie Gnose pour s’être abreuvé auprès du Christ, le Moyen Âge pourra faire de lui « l’apôtre du culte du SacréCœur », assurant à cette doctrine un regain de faveur.
Pour être complet, il faut préciser qu’Origène mentionne aussi l’autre tradition, celle qui fait jaillir le sang et l’eau du côté du Christ : « Le Christ fut cloué à la croix, et il fit jaillir de son sein les fleuves du Nouveau Testament, car s’il n’avait pas été transpercé, si l’eau et le sang n’avaient coulé de la blessure de son côté, nous devrions endurer à jamais les affres de la soif de la parole de Dieu1. » C’est pourquoi tous ceux qui méprisent la parole de Dieu ne pourront jamais boire à la source véritable car ils n’écoutent pas celui qui se tient dans le temple et qui crie : « Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi2. »
1. Origène , Homélie XI sur l’Exode
2. Origène , Homélie XVIII sur Jérémie.
LE ROCHER, LA SOURCE, LE FLEUVE
La deuxième interprétation, dite « éphésienne », est plus vénérable encore puisqu’elle remonte à l’entourage même de saint Jean. Elle remonte aux commentateurs les plus anciens : Justin, Irénée, Hippolyte, la Lettre de l’Église de Lyon. Elle place le point après « en moi » : « Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive, celui qui croit en moi. Selon le mot de l’Écriture, de son sein couleront des fleuves d’eau vive1. »
L’eau vive sort donc du sein du Christ. Cette ponctuation est grammaticalement la plus certaine. En effet, nulle part l’Écriture sainte ne fait allusion à des fleuves d’eau vive qui sortiraient du cœur du croyant. En revanche, lorsque Jésus se compare à un rocher frappé ou fendu d’où s’écoule de l’eau vive, il fait écho à de nombreux passages de l’Ancien Testament : « Dieu dit à Moïse : voici, je me tiendrai là, devant toi, sur le rocher […]. Tu frapperas le rocher, l’eau en jaillira et le peuple aura de quoi boire », « Proclamer ceci [...] jusqu’aux extrémités de la terre [...] : du rocher, il a fait jaillir pour eux de l’eau, il a fendu le rocher et les eaux ont coulé »2. C’est d’ailleurs ce que note saint Paul quand il écrit : « Tous [nos Pères] ont bu ou même breuvage spirituel : ils buvaient en effet à un rocher spirituel […] et ce rocher était le Christ3. »
1. Aujourd’hui, cette ponctuation est la plus commune. Pie XII l’a adoptée dans l’encyclique Haurietis aquas
2. Ex 17, 6 et Nb 20, 9. Nous citons ces textes car les Pères, comme nous le verrons plus loin, y font largement allusion (ainsi qu’à Is 48, 21).
3. 1 Co 10, 4.
Jésus ne pensait-il pas aussi à la fameuse prophétie d’Ézéchiel qui parlait d’un fleuve qui sortait par le côté droit du Temple restauré, ou encore à celle de Zacharie qui faisait allusion aux eaux vives sortant de Jérusalem1, lui-même se comparant au saint Temple de Dieu d’où jaillit l’eau vive de la grâce pour la régénération de l’humanité ?
Le parallélisme entre le rocher et le Christ est très fréquent chez les Pères. Il explique aussi la fréquente représentation, dans les catacombes, de Moïse, le sauvé des eaux, frappant le rocher : pour les premiers chrétiens, cela signifiait la crucifixion et les grâces qui en découlaient. Il faut préciser que la primitive Église se faisait scrupule de représenter la scène du calvaire. C’est pourquoi, au fur et à mesure que l’usage du crucifix se généralisa, le thème du rocher s’effaça peu à peu.
On peut dire que ce thème nous fournit, en connexion aussi avec celui du Temple, le premier élément de la spiritualité du cœur du Christ. Citons saint Justin (mort en 165) : « Nous autres, chrétiens, nous sommes le véritable Israël né du Christ car nous avons été taillés dans son cœur comme des pierres arrachées au rocher2. » Un peu avant, à propos du martyre, il déclarait : « C’est pour nous une joie de marcher à la mort pour le nom du Rocher Glorieux qui dispense l’eau vive dans le cœur de ceux qui, par lui, aiment le Père de toutes choses et
1. Ez 47, 1 et Za 14, 8.
2. Justin, Dialogue avec Tryphon , 135, 5.
qui étanche la soif de ceux qui veulent boire aux eaux de la vie1. »
Pour saint Cyprien (mort en 258), dans un passage très puissant et très beau d’une épître, le Christ apparaît bien comme le rocher spirituel : « Le prophète a prédit que, chez les païens, dans les lieux qui auparavant étaient arides, des fleuves jailliraient et abreuveraient la race élue de Dieu […]. Ceci s’est accompli dans l’Évangile quand le Christ qui est la Pierre a été ouvert par le coup de lance dans la Passion2. »
Ce « fleuve » qui jaillit et qui vient régénérer l’humanité, les Pères l’ont largement commenté. Le premier à l’avoir fait est Hippolyte de Rome (mort en 235), qui se sert des quatre fleuves du paradis terrestre, figures des quatre Évangiles, pour montrer que les eaux vives coulent bien de la poitrine du Christ : « Un fleuve d’eau intarissable coule désormais ; il se divise en quatre courants qui arrosent la terre tout entière. Ceci se réalise dans l’Église, car le Christ est ce fleuve : il est annoncé dans le monde entier par l’Évangile quadriforme, et répandu par toute la terre, il sanctifie tous ceux qui croient en lui. C’est pourquoi, le prophète l’a prédit, des fleuves couleront de son sein3. »
Saint Irénée (mort en 200) s’inscrit dans cette perspective quand il voit dans l’Église le corps du Christ
répandant sur la terre les eaux vives de l’Esprit : « Or l’Esprit Saint habite en chacun de nous ; c’est lui l’eau
1. Justin, Dialogue avec Tryphon , 114, 5.
2. Cyprien de Carthage , Épître 63, 8.
3. Hippolyte de Rome , Commentaire sur Daniel , 1, 17.
vive que le Seigneur accorde à tous ceux qui croient sincèrement en lui1. » Ou encore : « Là où se trouve l’Église, il y a l’Esprit de Dieu, et là où se trouve l’Esprit de Dieu, il y a l’Église et toute grâce. Or l’Esprit est vérité, c’est pourquoi ceux qui n’y participent pas ne trouvent pas au sein maternel une nourriture vivifiante et ne reçoivent rien de la source très pure qui procède du corps du Christ2. »
L’EAU, LE SANG
Nous avons vu la blessure du côté comme source de l’Évangile, le Christ comme rocher d’où sourd l’eau vive, mais le thème le plus abondamment abordé par les Pères est sans conteste la blessure comme origine de l’Église. Par une symbolique très riche de l’eau et du sang, nous sont indiqués les éléments d’une spiritualité de l’amour du Sauveur pour nous à travers le don de l’Église, des sacrements, de la grâce… Nous les synthétiserons à la fin de ce chapitre. Contentons-nous pour l’instant de citer quelques textes.
La naissance de l’Église comme thème théologique nous est rapportée par la Tradition depuis Origène en Orient et Tertullien en Occident. Un des plus anciens témoignages nous est donné par saint Polycarpe dans son Commentaire sur la Genèse : « À cause de celle qui était sortie de son côté, c’est-à-dire à cause d’Ève sa femme, Adam fut expulsé du paradis terrestre. Par le mystère de 1. Irénée de Lyon, Contre les hérésies, 5, 18, 2. 2. Ibid ., 3, 24, 1.
son côté ouvert d’où sortirent l’eau du baptême et le sang du martyre, l’Église retrouva le paradis1. » De même, à propos de la croix, loi du chrétien, Justin, contemporain de Tertullien, nous dit : « C’est pourquoi le Christ fut transpercé, et de son côté, s’écoula le breuvage de sang et d’eau. C’est de lui que s’est formée la sainte Église, et c’est lui qui conserve dans l’Église la sainte loi de la Passion. » Il écrit ailleurs : « C’est du sein du Christ (ex utero Christi) que découle l’Église pleine de la gloire du Père, et elle emporte toute souillure et fait revivre les champs asséchés2. »
L’eau de la régénération divine a coulé du côté percé du Christ, mêlée au sang purificateur de son sacrifice. Saint Ambroise (mort en 397) insiste sur cet exorcisme de l’eau : « C’est dans l’eau que la chair est plongée pour que tout le péché de la chair soit lavé [...]. En effet sans l’invocation de la Croix du Sauveur, l’eau n’est d’aucune utilité pour le salut futur ; [...] apprends par là que l’eau ne purifie pas sans l’Esprit3. » Saint Grégoire de Nysse (mort vers 395) ne dit pas autre chose quand il affirme : « Que j’accoure auprès de toi, qui es la source, pour aspirer la boisson divine que tu fais jaillir comme d’une source pour les assoiffés. Cette eau jaillit de ton côté ouvert par la lance et, pour celui qui en goûtera, elle deviendra jaillissante pour la vie éternelle4. »
Mais l’eau, si elle est fécondante, est aussi susceptible de tuer. Comme toute la création, l’eau a été contaminée par les conséquences du péché, et doit elle-même être purifiée avant de devenir purificatrice. C’est un des sens de la citation d’Ambroise ci-dessus, et aussi celui de ce passage du Traité du Saint-Esprit de Basile de Césarée (mort en 379) : « Le baptême comporte une figure de la mort et une figure de la vie ; l’image de la mort est accomplie par l’eau, et quant à la vie, c’est l’Esprit qui nous en fournit le premier don. […] L’eau, d’une part, offre l’image de la mort en recevant le corps comme dans un tombeau, l’Esprit, d’autre part [...], fait passer de la mort du péché à la vie originelle1. »
L’eau est aussi souvent assimilée à l’Esprit. Pour saint Cyrille de Jérusalem (mort en 387), « le don de l’Esprit est appelé une eau » – et s’ensuit un long développement sur cette correspondance2. Basile de Césarée, Irénée, Augustin et beaucoup d’autres regardent « cet Esprit qui a été désigné par le Seigneur sous le nom d’eau3 ». Apollinaire de Hiérapolis (mort vers 180), parlant du sang de la mort rédemptrice du Sauveur et de la rénovation par l’Esprit Saint, affirme : « C’est le Christ qui a laissé transpercer son côté, c’est lui qui a laissé jaillir de la blessure de son côté les deux fleuves qui purifient toutes choses : l’eau et le sang, c’est-à-dire le Logos et le Pneuma, la Parole et l’Esprit4. »
1. Basile de Césarée , Le Saint-Esprit , 15, 35.
2. Basile de Césarée , Catéchèse prébaptismale sur le Saint-Esprit , 16.
3. Augustin, Commentaire de la première épître de saint Jean , 6, 11.
4. Apollinaire de Hiérapolis, Sur Pâques, fragment 4.
Exorcisée, l’eau est tout à fait claire et transparente pour refléter Dieu, elle est toute prête à laver les souillures intérieures. Le chrétien est englouti en elle pour surgir à une vie nouvelle, comme la colombe qui, après les eaux du déluge, vint annoncer à la terre l’apaisement du ciel : « Ainsi la colombe de l’Esprit Saint vole sur la terre ; c’est-à-dire notre chair, cette chair sortant du bain, lavée de ses anciens péchés. Elle apporte la paix de Dieu, en messagère du ciel où se tient l’Église dont l’arche est la figure1. »
Le sang, quant à lui, représente dans la perspective biblique la vie de toute chair (Gn 9, 4). Or, comme toute vie appartient à Dieu, il est interdit de le verser – sauf à le faire en offrande à Dieu, ou en tant que don de soi que Dieu puisse agréer.
Les Pères, dans leurs commentaires qui restent très proches de l’Écriture, voient en lui un double symbolisme : – il y a d’abord le symbolisme expiatoire. Le sacrifice sanglant d’un animal étant un sacrifice expiatoire que l’homme faisait pour prouver son désir de purification, le sang du Fils de l’homme, le sang versé par amour, sera le signe du rachat de toutes nos fautes ; – il en résulte un symbolisme vital de régénération. Tout sang versé par amour de Dieu, à l’image de celui du Christ, participe à la fécondité du sang rédempteur. C’est la soif du sang, la soif de donner sa vie pour
l’expiation du péché et de prouver jusqu’où va l’amour. C’est la soif du témoignage, du martyre, qui vient féconder le sol de la chrétienté.
Cette symbolique du sang et de l’eau a pris des formes diverses que Cyrille de Jérusalem, dans une catéchèse, nous rappelle de façon magnifique : « Car dans les Évangiles, double est l’efficacité du baptême qui sauve : l’une est donnée par l’eau aux illuminés, la seconde [...] est donnée aux saints martyrs par leur propre sang : ainsi du côté du Sauveur sont sortis du sang et de l’eau pour fortifier la grâce de la confession pour le Christ, aussi bien dans l’illumination [du baptisé] qu’au temps du martyre. Autre raison du côté du Christ, la femme faite du côté de l’homme a été à l’origine de la faute ; en compensation, Jésus, venu apporter semblablement aux hommes et aux femmes le bienfait du pardon, eut le côté percé en faveur de la femme, afin de détruire la faute1. »
Jean Chrysostome (mort en 407), dans une de ses catéchèses, a regroupé dans une belle synthèse quelques éléments de cette spiritualité naissante. Il est question en effet du côté transpercé, de l’Église, des sacrements, spécialement du baptême et des mystères, de la symbolique du sang et de l’eau, d’Adam et d’Ève : « Vois d’où il a commencé à couler [le sang] et d’où il a pris sa source : il descend de la croix, du côté du Seigneur [...]. Cette eau était le symbole du baptême, et le sang celui des
mystères. C’est donc le soldat qui lui ouvrit le côté ; il a percé la muraille du temple saint […]. Or l’Église est née de ces deux sacrements : par ce bain de la renaissance et de la rénovation dans l’Esprit, par le baptême donc et par les mystères. Or les signes de baptême et des mystères sont issus du côté. Par conséquent le Christ a formé l’Église à partir de son côté comme il a formé Ève à partir du côté d’Adam. » Et la comparaison continue entre la chair prise dans le côté d’Adam pour former la femme et le sang et l’eau donnés par le Christ pour former l’Église : de la même façon que c’est pendant
« l’extase de son sommeil » qu’est ôtée la côte d’Adam, c’est « après sa mort » que le Christ nous donne le sang et l’eau. Et Cyrille de conclure : « Vous avez vu comment le Christ s’est uni son épouse ? »1
SAINT AUGUSTIN
Saint Augustin nous intéresse à double titre : d’une part, il réalise une synthèse de la première méditation de l’Église sur la blessure du Crucifié en assumant la pensée de l’école d’Origène et de la tradition éphésienne et, d’autre part, il porte un regard nouveau qui va permettre à cette spiritualité de se développer selon un axe inédit.
Chaque fois que l’évêque d’Hippone est amené à commenter l’ouverture du côté du Christ par la lance du centurion, il s’y arrête assez longuement. L’affirmation selon laquelle de l’ouverture de ce flanc naît l’Église, du
jaillissement du sang et de l’eau, ses sacrements, est toujours présente. Comme le font ses prédécesseurs, il relie cette scène à la naissance d’Ève : « Adam dort afin que naisse Ève : le Christ meurt afin que naisse l’Église. Ève est tirée du côté de celui qui dormait, le Christ est, après sa mort, transpercé par la lance afin que découlent les sacrements qui édifient l’Église1. »
Augustin se demande pourquoi Adam dormait à ce moment-là : est-ce pour qu’il ne sente rien ? Non, car « qui donc a le sommeil assez profond pour ne pas se réveiller si on lui arrache un os ? ». Le vrai motif est qu’Adam endormi préfigurait le Christ endormi sur la croix2. En la matière, Cyrille de Jérusalem, Ambroise, Jean Chrysostome, et aussi Tertullien, ont affirmé la même chose, en des mots presque identiques : « Si Adam était la figure du Christ, le sommeil d’Adam fut une figure du sommeil du Christ qui s’endormit dans la mort, afin que, par une semblable blessure de son côté, fût formée l’Église, véritable mère des vivants3. »
Autre thème traditionnel repris par Augustin dans sa lecture, celui de l’arche de Noé : « La porte que l’arche reçut sur le côté, c’est assurément la blessure qu’ouvrit la lance dans le côté du Crucifié : par là certainement entrent ceux qui viennent à lui, car de là découlèrent les sacrements par lesquels les croyants sont initiés4. »
1. Augustin, Sur l’évangile de Jean , 9, 10.
2. Augustin, Commentaire sur les psaumes, 56, 11.
3. Tertullien, De l’âme, 43.
4. Augustin, La Cité de Dieu , 15, 26, 1. Il faut noter qu’Augustin voit les deux faits se superposer de façon très étroite. La comparaison, de ce fait, prend une force plus intense.
Cette comparaison est remarquable non pas par ellemême, puisqu’elle est très commune, mais par l’idée qu’elle évoque : de même que la porte de l’arche a été aménagée pour sauver les animaux du déluge, de même le côté du Christ a été ouvert pour nous sauver du péché.
Par les sacrements, les fidèles entrent dans l’Église : « La porte ouverte sur le flanc de l’arche est cette blessure quand la lance a perforé le côté du Crucifié. »
Cette intuition que l’on rencontre ici pour la première fois, semble-t-il, dans l’histoire de la spiritualité, est renforcée par un autre texte dans lequel les sacrements sont vus comme étant enfermés dans le Christ et tout prêts à en jaillir : « L’évangéliste n’a pas dit que le soldat frappa ou blessa le côté du Christ ou quelque chose de semblable, mais il a dit qu’il l’ouvrit. Ainsi nous fut donc ouverte, d’une certaine manière, la porte de la vie par laquelle sont sortis les sacrements de l’Église sans lesquels il est impossible d’entrer dans la seule vie qui mérite ce nom1. » Cette lecture novatrice trouvera un grand épanouissement au Moyen Âge car elle sera le thème principal des mystiques qui entreront dans la plaie pour remonter au cœur.
Quels sont, plus précisément, ces sacrements qu’Augustin discerne dans ce sang et cette eau ? Comme toute la Tradition avant lui, il les y pressent tous2, mais il en développe particulièrement deux : « Ce sang a été
1. Augustin, Sur l’évangile de Jean , 120, 2.
2. Augustin, Commentaire de la première épître de saint Jean , 6, 11.
répandu en rémission des péchés, cette eau se mêle à la coupe pour le salut : l’un nous donne le baptême, l’autre l’eucharistie1. »
Augustin n’a pas pour autant abandonné la tradition d’Origène, et il garde une dévotion spéciale envers saint Jean : « Celui qui, ayant l’habitude de reposer pendant le repas sur la poitrine du Seigneur Lui-même, y a bu avec plus d’abondance et de familiarité le secret de sa divinité », signifiant par là « qu’il buvait dans l’intime de son cœur des secrets plus hauts » 2 .
D’une certaine manière, d’ailleurs, Augustin va aller plus loin que son prédécesseur, puisqu’il va affirmer que saint Jean, en se penchant sur la poitrine du Seigneur, « reçut la grâce tout à fait spéciale de pouvoir dire sur le Fils de Dieu des choses telles que l’esprit des petits peut bien en être aiguillonné mais sans en être satisfait : ils ne peuvent pas le comprendre, n’étant pas parvenus à l’intelligence des adultes ; mais il apporte à tous ceux qui sont plus mûrs et parvenus intérieurement à l’âge adulte une nourriture spirituelle qui les fortifie et les exerce3 ».
BILAN
Les apôtres, au début de l’Église, ont prêché un Sauveur mort et ressuscité, et ont appelé à la conversion et à la pénitence. Mais Paul, et surtout Jean, insistaient déjà sur l’amour rédempteur du Christ. Les premières hérésies surgirent très vite dans l’Église primitive, qui fut
1. Augustin, Sur l’évangile de Jean , 120, 2.
2. Origène , De l’accord des évangiles, 1, c. 4, n. 7.
3. Augustin, Sur l’évangile de Jean , 18, 1.
déchirée par les disputes christologiques et trinitaires. L’époque n’était pas encore propice à une réflexion sur la blessure du côté. De plus, il fallait que les chrétiens apprennent à considérer l’humanité concrète du Fils et à contempler ses plaies. Dans ces conditions, peut-on parler d’une spiritualité qui a pour objet le Cœur du Sauveur dans l’Église primitive ? Les textes que nous venons de convoquer ne sont-ils que des spéculations n’ayant aucune utilité pratique, ou peut-on déjà parler à leur sujet d’un culte rendu au cœur du Christ ?
Selon toute évidence, il ne s’agit pas d’un culte organisé à la blessure du côté. Il s’agit encore moins d’y voir le signe que le cœur du Crucifié était déjà considéré pour lui-même. Mais, plus simplement, d’y discerner des éléments qui vont peu à peu s’agréger pour donner naissance à un riche courant spirituel. Si le mystère de l’amour divin est le point central de cette spiritualité, alors nous pouvons y intégrer la réflexion des Pères, car ils considérèrent que son côté transpercé était le signe de son amour rédempteur envers nous. C’est le fruit de la méditation, de la « rumination », de la parole de Dieu par des pasteurs proches de leur peuple. Comment croire que, même si nous n’avons pas trace d’une dévotion systématique au cœur de Jésus, l’ensemble du peuple chrétien n’ait pas prié à la suite de ces pasteurs sur les thèmes qu’ils leur proposaient, surtout à une époque où rien ne séparait encore la vie spirituelle de la réflexion théologique ? Ce que nous appelons théologie, exégèse, spiritualité et piété ne faisaient qu’un.
Et, très vite, l’histoire du « peuple de Dieu », par de petits indices, va nous apporter la preuve de sa sensibilité à la blessure du côté.
C’est le cas, pour commencer, du martyre de l’Église de Lyon. On y perçoit, en effet, la force du martyre qui provient directement du Christ. Blandine, sous les cornes du taureau, ne poursuit-elle pas « son entretien intérieur avec le Christ », son cœur-à-cœur intime avec le Sauveur crucifié ? Quant au diacre Sanctus, Eusèbe nous rapporte qu’« il demeure ferme et inébranlable, [qu’]il ne fléchit pas dans sa profession de foi ; car de la source céleste, comme une rosée bienfaisante et fortifiante, descendait sur lui l’eau vive qui s’écoule du flanc du Christ1 ».
De son côté, la liturgie, qui est l’expression de la piété officielle et universelle de l’Église, va vite inclure des éléments liés à la transfixion dans ses hymnes, ses cantiques et ses invocations. La plus célèbre des invocations est sans conteste celle d’Ambroise. Docteur de l’Église, il a joué un rôle de pasteur essentiel dans l’histoire du christianisme. S’il n’est pas au niveau intellectuel d’un Augustin, il tient une place irremplaçable en tant que premier organisateur du chant hymnique dans lequel il associe le chœur des fidèles. Par cette innovation, il fournit une base populaire et mémorisable à la formation théologique et à la piété des fidèles. Lors du siège par les soldats ariens de la basilique porcienne de Milan,
où il s’était réfugié avec ses ouailles, Ambroise soutint leur courage par la pratique du chant choral :
Abreuve-toi auprès du Christ car Il est le Rocher dont les eaux s’écoulent.
Abreuve-toi auprès du Christ car Il est la source de vie.
Abreuve-toi auprès du Christ car Il est le fleuve dont le torrent réjouit la Cité de Dieu.
Abreuve-toi auprès du Christ car Il est la Paix.
Abreuve-toi auprès du Christ car des fleuves d’eau vive jaillissent de son sein1.
On trouve des traces de cette même spiritualité chez le poète Prudence, contemporain d’Ambroise, dans une de ses hymnes pour toutes les heures :
Ô miracle inouï de la blessure dans cette mort étonnante d’un côté coula l’onde du sang et, de l’autre, de l’eau, car l’eau donne le baptême, alors que la couronne vient du sang2.
Quelques années plus tard, vers 568, saint Venance Fortunat composa une hymne pour les vêpres de la Passion qui fut chantée lors de la procession solennelle ramenant un morceau de la Sainte Croix de Byzance à Poitiers :
Blessé en outre, par la cruelle pointe de la lance, c’est pour nous laver de notre péché qu’Il ruissela d’eau et de sang3.
1. Ambroise de Milan, Commentaire des psaumes, 1, 33.
2. Prudence , Livre d’heures, Hymne pour toutes les heures, strophe 29.
3. Venance Fortunat, Hymne en l’honneur de la Croix pour les vêpres de la Passion , strophe 3.
L’humble prière des premiers chrétiens affectionnait aussi cette pensée. N’ont-ils pas dessiné sur les murs de la catacombe de Priscille, à Rome, les paroles de l’Apôtre : « Que celui qui a soif vienne », ou la phrase : « Racheté par la blessure du Christ » ? Enfin, la tradition apostolique d’Hippolyte nous fait part d’un détail révélateur : les chrétiens aimaient se souvenir de la blessure du Crucifié à la neuvième heure.
Cette sensibilité à l’égard du côté blessé, si elle n’est pas systématique, est donc indubitable.
La double interprétation de Jean 7, 37 nous conduit ainsi dans deux mondes différents bien que complémentaires. La tradition éphésienne est plus ardente, plus tangible, plus humaine mais aussi plus rude, car il faut la replacer dans les luttes décisives livrées pour faire reconnaître la réalité de la nature humaine du Christ crucifié et mort en croix. Le côté comme source de l’Évangile, comme source de l’Esprit, de l’Église et des sacrements, et le Christ comme Rocher d’où sourd l’eau vive du Salut, en sont les principaux thèmes. La tradition alexandrine, quant à elle, malgré sa tendance au gnosticisme qui affleure chez Origène (« Qu’est-ce, en effet, que voir Dieu par le cœur sinon le comprendre et le connaître par l’esprit1 »), voit dans le Christ la source de toute connaissance de Dieu. Les thèmes centraux en sont la rédemption, la vie communiquée par la Passion du Christ, et la connaissance apaisant la soif des hommes.
Malgré la diversité des thèmes embrassés par ces deux courants, on peut identifier cinq lignes de force principales à cette spiritualité naissante. Elle est, tout d’abord, essentiellement christocentrique : c’est à partir du Christ, et du Christ en croix, tel que nous le révèle l’Écriture, que sont issues ses différentes thématiques. C’est le côté du Seigneur percé par la lance qui en est la source : de Dieu le Père il est peu question, du moins explicitement, et le Saint-Esprit est toujours perçu comme étant relatif au Christ – mais il ne s’agit là aucunement d’une forme de hiérarchisation des trois personnes de la Trinité. Sous le signe du côté blessé, les mystères de la rédemption douloureuse et des biens messianiques nous sont communiqués.
La deuxième ligne de force concerne le côté objectif de la méditation sur le côté transpercé : les sentiments intimes du Crucifié ou du croyant n’y ont encore aucune place mais cela n’empêche pas pour autant les Pères d’affirmer, continuellement et avec force, que Jésus Christ a assumé la nature humaine puisqu’il « a tout assumé pour tout sanctifier1 ». C’est de sa blessure que découlent les fleuves de grâces, qui sont la figure des sacrements et la source de l’Église, cette Mère des vivants, cette seconde Ève tirée du côté du second Adam. Cette théologie implique une double relation entre le Christ et l’Église : celle de la naissance d’une part, celle des épousailles d’autre part, où le Christ
s’attache indissolublement à son épouse. Au croyant, le Crucifié ouvre son côté pour lui donner l’Église, afin de recevoir par elle la réponse de l’homme sauvé. Ce thème sera merveilleusement illustré par la « légende » du centurion Longin qui se développera dans les siècles futurs1. Le côté percé du Crucifié est un symbole très puissant de l’amour rédempteur du Sauveur pour son épouse, l’Église, qu’il sanctifie par son sang représentant l’eucharistie, et par de l’eau représentant le sacrement du baptême.
Le troisième point se rapporte à la passivité du croyant envers les grâces qui viennent du Christ : le fidèle ne se porte pas près du Christ, ne se place pas près de la plaie, n’y entre pas pour s’y réfugier. Il est désaltéré, abreuvé : il reçoit des grâces qui coulent, se répandent, descendent, sortent, jaillissent du sein du Christ. Même le courant inspiré par l’exégèse d’Origène, qui suppose le geste actif de se pencher vers la poitrine du Sauveur, ne parle pas d’aller chercher la « connaissance » mais simplement de la recevoir à la suite d’un contact plus étroit avec lui.
Quatrième point, la plaie du côté est distinguée des autres plaies, dont les Pères parlent peu. Il n’en sera pas toujours de même dans l’histoire de la dévotion.
1. Selon un évangile apocryphe, ce serait Longin qui aurait porté le coup de lance. Qui est-il ? Un soldat aveugle qui aurait été guéri par les gouttes de sang et d’eau jaillies du côté du Christ, ou le centurion chargé de surveiller son exécution et qui se serait écrié : « Il est vraiment le Fils de Dieu. » Dans les deux cas, il se serait donc converti. Originaire d’lsaurie, il aurait subi le martyre à Césarée de Cappadoce. La découverte de son corps par les Croisés à Antioche, en 1093, lui a assuré une grande popularité dans la littérature religieuse médiévale.
Là encore, le regard des pasteurs de l’Église primitive se porte sur l’essentiel de façon remarquable, sur le Christ en croix et sur ce qui symbolise son amour rédempteur. Enfin, soulignons la révérence toute particulière envers l’apôtre Jean qui eut le privilège de boire à la source d’eau vive. Il devient ainsi le modèle de l’homme choisi qui se désaltère auprès de Jésus : « Jean, qui eut le bonheur de reposer sur la poitrine du Seigneur, fut rempli de l’Esprit Saint, car il puisa directement au Cœur de la Sagesse qui créa toutes choses, une intelligence qui dépasse celle de toutes les créatures1. »
II