constellations

Découvrir le ciel au fil des saisons
Une carte du ciel offerte





 Pierre Kohler et Florence Sabatier
Pierre Kohler et Florence Sabatier
Mystérieuses
constellations


Découvrir le ciel au fil des saisons

Observer le ciel
SE DIRIGER DANS LE CIEL
Malgré notre première impression, les étoiles ne sont pas fixes dans le ciel. Chaque nuit, parce que la Terre tourne, elles glissent lentement (l’équivalent du diamètre de la Lune toutes les 2 minutes). Par conséquent, le ciel du matin n’est plus celui du soir et grâce à cela, nous pouvons voir dans une même nuit les trois quarts de la voûte étoilée.
La Terre tourne aussi autour du Soleil, en un mouvement plus lent mais perceptible d’un jour à l’autre. Si l’on prend un repère lointain (arbre, pylône, maison…) on constate que les étoiles se lèvent 4 minutes plus tôt que la veille. Comme l’heure de nos montres est basée sur le retour quotidien du Soleil dans le ciel, et non sur celui des étoiles, il faut à chaque rotation effectuer un petit rattrapage, qui correspond à ces 4 minutes.
C’est pourquoi, jour après jour, les constellations se déplacent : à la même heure, quelques semaines plus tard, elles seront remplacées par de nouvelles, tandis que d’autres auront disparu. Pour une même heure, le ciel de janvier est totalement différent de celui du mois de juillet…


En résumé
Du fait de la rotation de notre planète, le ciel change tout au long de la nuit, et du fait de sa révolution autour du Soleil, il change aussi au fil des mois.
LA NAISSANCE des CONSTELLATIONS
C’est la nécessité de créer un calendrier pour rythmer la vie quotidienne qui a conduit à observer le ciel avec précision. Une astronomie « utilitaire » apparaît ainsi en Mésopotamie (l’actuelle Irak), il y a presque 4 000 ans, puis en Égypte. Ces observations restaient liées à des croyances religieuses et à l’astrologie, car on pensait que les astres influaient sur notre vie.
Les premières constellations se sont imposées tout naturellement, en reliant par des lignes imaginaires les étoiles les plus brillantes. On traçait ainsi dans le ciel des figures bien reconnaissables. Les plus anciennes, au nombre de 12, sont celles du Zodiaque, placées dans la bande de ciel parcourue tout au long de l’année par le Soleil, la Lune et les planètes. Ces figures rappellent aux Hommes leur activité de bergers, de paysans ou de chasseurs, en évoquant toutes des animaux (sauf la Balance). Le Zodiaque (du grec zôon, animal) est ainsi le « cercle des animaux ».
Ce premier ensemble d’une douzaine de constellations s’est étoffé grâce aux Grecs, qui, vers 250 avant notre ère, ont introduit dans le ciel les héros de leur mythologie (Hercule, Orion, Cassiopée…). L’astronome Ptolémée, dans son ouvrage, Almageste , publié au milieu du IIe siècle de notre ère, fait l’inventaire de 48 figures renfermant un millier d’étoiles.
Lorsqu’aux XVIIe et XVIIIe siècles, les astronomes occidentaux se sont lancés dans les grands voyages d’exploration du monde, ils ont pu observer le ciel austral. Des constellations supplémentaires se sont ajoutées. Leurs noms (Burin, Compas, Règle) manquaient toutefois de fantaisie…
Finalement, les astronomes du monde entier ont adopté en 1930 une carte du ciel découpée en 88 constellations officielles.
CIRCULER PARMI LES CONSTELLATIONS



Pour naviguer entre les constellations, il faut commencer par celles qui ont des formes caractéristiques, comme la Grande Ourse, formée du Grand Chariot (en forme de casserole), Cassiopée, Orion, Pégase ou le Lion. Elles permettent ensuite de localiser des constellations moins spectaculaires, qu’elles encadrent ou côtoient, comme Hercule ou le Dragon.
Commençons par les deux étoiles du bout du Grand Chariot, appelées les Gardes, qui forment l’avant de la casserole et qui donnent la direction de l’étoile Polaire. Si l’on reporte 5 fois leur distance vers le haut, on tombe sur elle et on arrive donc à la constellation de la Petite Ourse. Si l’on prolonge ces mêmes Gardes de 6 fois vers le bas, on aboutit à la constellation du Lion. La poignée de la casserole, elle, mène à la brillante étoile Arcturus (constellation du Bouvier) lorsqu’on trace un arc de cercle de deux fois sa longueur. Au-delà, elle aboutit à Spica (principale étoile de la Vierge).
En hiver, on peut se repérer à partir d’Orion. Les trois étoiles de la ceinture pointent à gauche en direction de Sirius (constellation du Grand Chien), étoile impossible à manquer car c’est la plus brillante de toutes. Vers la droite, on aboutit à Aldébaran (constellation du Taureau) et du même coup au magnifique amas d’étoiles des Pléiades. La ligne qui relie les étoiles Bételgeuse et Rigel, placées respectivement en haut et en bas de la constellation d’Orion, pointe vers la constellation des Gémeaux et son duo d’étoiles Castor et Pollux.
Nous présentons dans ce livre 47 constellations sur les 88 officiellement cataloguées, dont une vingtaine d’incontournables ! Les autres ne sont observables que dans l’hémisphère sud.

LES SECRETS DE NOTRE OEIL
Notre œil, une merveille !
Notre œil est un extraordinaire instrument d’observation… que nous avons toujours avec nous ! Son rôle est de former une image de ce que nous regardons en la projetant sur une sorte d’écran appelé la rétine, qui en tapisse le fond. L’information lumineuse reçue par les cellules de la rétine est convertie en un message nerveux envoyé au cerveau.
La lumière pénètre dans l’œil par un orifice circulaire - la pupille - située au milieu de l’iris, cette zone qui donne à nos yeux leur couleur. Cette pupille s’ouvre et se ferme automatiquement pour contrôler la quantité de lumière entrant dans l’œil : presque fermée en plein soleil, elle s’ouvre au maximum la nuit, jusqu’à 7 ou 8 mm pour un jeune adulte. On perd ensuite 1 mm tous les 10 ans, et les personnes âgées ne voient plus autant d’étoiles qu’un enfant…
La rétine est tapissée de cellules sensibles à la lumière, dont il existe deux sortes : les cônes et les bâtonnets. Les cônes (6 à 7 millions) sont conçus pour recevoir la lumière du jour et percevoir les couleurs. Les bâtonnets (plus de 100 millions) nous intéressent ici, car ils sont adaptés à la vision de nuit. Cent fois plus sensibles que les cônes, ils sont en revanche moins précis et ne distinguent pas les couleurs ! Un paysage vu au clair de lune est en noir et blanc.
Les performances de l’oeil
Dans de bonnes conditions, un œil normal verra séparément deux points espacés de 1 mm à 3,5 m de distance, ou de 1 m à 3,5 km. Cela correspond à 100 km sur la Lune ! Il existe aussi deux occasions offertes par le ciel de tester notre acuité visuelle. D’abord grâce aux étoiles Mizar et Alcor de la Grande Ourse, que seuls les myopes (sans lunettes) ne voient pas distinctement séparées. Ensuite, avec l’amas des Pléiades (constellation du Taureau), où l’on peut essayer de compter le nombre d’étoiles que l’on distingue pour tester sa vision.
Pourquoi des pupilles différentes ?
Comme pour la plupart des animaux diurnes, la pupille des humains est ronde, mais ce n’est pas toujours le cas. Elle peut aussi être verticale comme un I majuscule (comme chez les vipères, les crocodiles et les chats) ou horizontale comme un long tiret (comme chez les chèvres, les moutons, et les chevaux).
C’est l’évolution qui a sélectionné les formes de pupilles, selon le mode de vie (diurne ou nocturne), et le mode de prédation de chaque espèce.
Une pupille circulaire comme la nôtre est adaptée à la vision de jour, mais convient moins aux conditions nocturnes. Les pupilles en fente dépendent du statut de l’animal dans son environnement, selon qu’il est un prédateur ou une proie possible. Chez les prédateurs nocturnes, elles sont verticales pour mieux apprécier la distance avant de bondir tandis que chez les proies herbivores diurnes, elles sont horizontales pour bénéficier d’une vue panoramique et anticiper le danger.
La vision « décalée »
Le point de départ du nerf optique, au fond de nos yeux, est une zone riche en cônes, mais pauvre en bâtonnets. C’est donc la zone la moins sensible pour l’observation de nuit. Pour bien voir un astre peu lumineux, ou bien séparer deux petites étoiles très rapprochées, il faut donc que leur image se forme sur une autre partie de la rétine.
La méthode est très simple : faire comme si on regardait juste à côté, et, comme par miracle, l’image apparaîtra ! Cette astuce de la vision décalée est à mettre en pratique à chaque fois que l’on voudra distinguer un astre de faible éclat, comme une nébuleuse ou une galaxie. Retenons bien : il ne faut surtout pas les fixer !

Conseil
Améliorer sa vue nocturne

Notre vision de nuit peut s’améliorer en ménageant nos yeux grâce à une bonne hygiène de vie. Premier conseil, bien que difficile à appliquer aujourd’hui : éviter de trop regarder les écrans (téléphone, ordinateur, télévision), dont la lumière bleue et la faible distance affaiblissent la vue.

Autre conseil : boire de l’eau, car la déshydratation entraîne une sécheresse des yeux, pénalisante pour voir dans le noir. Des yeux humides et détendus voient plus efficacement. Pour améliorer la vision nocturne, il est aussi conseillé de manger des baies rouges et bleues (cassis, myrtilles), même en confiture, car elles sont riches en carotène qui améliore le réseau sanguin de la rétine.

CONSEILS POUR BIEN VOIR LE CIEL
En observant les étoiles à l’œil nu, on peut s’émerveiller devant leur foisonnement, distinguer leurs nuances de couleurs ou leurs variations d’éclat, et s’entraîner à reconnaître les constellations et autres curiosités célestes. Pour regarder le ciel dans les meilleures conditions, il faut suivre quelques conseils. Comme une randonnée pédestre, une balade dans les étoiles nécessite un peu de préparation. Nous voilà donc partis pour une petite « rando céleste » !

1. CHOISIR LA PÉRIODE D’OBSERVATION
Il faut éliminer d’avance la semaine qui précède et celle qui suit la pleine lune. Dès qu’elle cesse d’être en croissant, sa luminosité se diffuse dans le ciel (surtout s’il est humide) en effaçant les étoiles les moins brillantes. On aime bien notre amie la Lune, sur laquelle il y a aussi des choses intéressantes à observer, mais l’intense clair de lune et la pâle lumière des étoiles ne font pas bon ménage ! On lui réservera donc une période d’observation rien que pour elle.
Les soirées de ciel dégagé qui suivent une bonne averse sont à privilégier, car la pluie « lessive » l’atmosphère, en précipitant au sol les poussières en suspension dans l’air.
La période estivale est plus confortable pour observer le ciel, et pourtant les nuits d’hiver sont préférables. D’abord parce que l’air froid est plus stable, ensuite parce que la plus grande durée de la nuit permet d’observer plus tôt en soirée. Dans tous les cas, l’idéal est d’attendre deux heures après le coucher du soleil pour disposer d’un ciel suffisamment sombre.
2. CHOISIR son environnement
Il s’agit de trouver un endroit aussi éloigné que possible des lumières parasites. Les villes sont donc à éviter, au profit d’un espace moins lumineux, loin des lampadaires ou même des habitations éclairées. Pour avoir une vue aussi large que possible, nous devrons trouver un endroit bien dégagé, sans arbres hauts : au milieu d’un champ, sur une plage, ou sur une colline. L’idéal serait d’avoir un horizon libre sur 360°.
L’observation en ville reste possible, à condition d’éviter toute source de lumière vive. Le ciel le plus propice est celui de la montagne, où la pollution lumineuse est moins importante, voire inexistante, et l’air plus sec.
3. PRéPARER SA VISION
Il est essentiel de rester dans l’obscurité pour que nos yeux s’adaptent à la nuit, et que les pupilles se dilatent au maximum. Il faut patienter au moins un quart d’heure et si possible une demi-heure. Après cela, nous pourrons discerner les astres les moins lumineux, tels que les amas d’étoiles, les nébuleuses, tout comme la lumière zodiacale ou une comète de passage.
ATTENTION
Cette adaptation à la vision nocturne disparaît au moindre éblouissement. Il ne faut surtout pas d’éclairage violent pendant l’observation, et ne pas retourner vers une zone éclairée : il faudrait alors tout recommencer ! Il est important d’éviter de regarder directement les sources de lumière, qui forceront les pupilles à se contracter et diminueront la vision nocturne.
À SAVOIR
Les constellations se déforment
Au sein de leurs constellations, les étoiles ne bougent quasiment pas les unes par rapport aux autres, sur des dizaines de milliers d’années. Prenons l’exemple de la Grande Ourse : elle avait déjà la silhouette d’une casserole à l’époque des pharaons de l’Égypte ancienne, et elle ne se déformera pas avant 100 000 ans… Chaque étoile a son propre mouvement et sa propre vitesse, imperceptibles pour nous.
Combien d’étoiles ?
La quantité d’étoiles qu’on peut voir dans le ciel dépend de l’acuité visuelle de l’observateur, mais aussi de la qualité du ciel. Dans des conditions idéales, avec un horizon bien dégagé et un fond de ciel bien noir, on peut théoriquement voir 3 500 étoiles par hémisphère, mais en pratique, on n’en perçoit « seulement » 2 000 à 2 500, un nombre qui varie d’une nuit à une autre selon la qualité du ciel. Encore ne les verrons-nous que si nous observons d’un endroit situé en altitude, hors de toute pollution lumineuse, et dans la période encadrant la nouvelle lune. Cela fait beaucoup de conditions…
L’éclat des astres
C’est un mathématicien grec nommé Hipparque qui (vers 140 avant notre ère) a classé pour la première fois les étoiles d’après leur éclat. Il leur a attribué des « grandeurs » allant de 1 à 6, de la plus brillante à la plus faible. C’est donc une échelle inversée, où plus un astre est lumineux, plus sa grandeur est petite ! Cette échelle a été utilisée pendant 17 siècles, avant d’être perfectionnée par l’astronome Norman Pogson en 1856. Il a repris les grandeurs fixées par Hipparque, devenues des « magnitudes ». Pour chaque magnitude d’écart, l’éclat est multiplié (ou divisé) par 2,5. On peut ainsi évaluer l’éclat d’astres plus lumineux que les étoiles, comme les planètes, la Lune ou les étoiles, dont la magnitude peut être négative. Les étoiles - à trois exceptions près - ont des magnitudes positives : Véga, une des étoiles les plus brillantes du ciel d’été, sert de point de référence avec une magnitude de 0.
L’étoile Polaire se positionne à +2, et les étoiles à la limite de l’observation pour l’œil nu sont à 6. Ces valeurs sont appelées « magnitudes visuelles », en abrégé Mv : c’est l’éclat de l’étoile vue par un œil humain. Il y a aussi des « magnitudes photo », un peu différentes. Ces luminosités sont précisées dans le tableau ci-dessous pour les plus brillantes.
1 - Sirius (constellation Grand chien) Mv -1,5

2 - Arcturus (Bouvier) Mv -0,1
3 - Véga (Lyre) Mv +0,1
4 - Rigel (Orion) Mv 0,1
5 - Procyon (Petit chien) Mv 0,4
6 - Bételgeuse (Orion) Mv 0,6
MESURER le CIEL
Pour déterminer l’emplacement d’une curiosité céleste, on prend souvent une étoile pour repère et on évalue l’écart qui sépare les deux. Ces distances sont estimées en degrés d’angle. Difficile ? Pas du tout ! Il suffit de retenir quelques comparaisons simples. Le diamètre de la Lune correspond à une largeur d’un demi-degré. Autrement dit, 1° = 2 pleines lunes côte à côte. Par ailleurs, la largeur de notre pouce bras tendu vers le ciel équivaut à 2°, et l’intervalle entre les extrémités du pouce et de l’index équivaut à 5°. La longueur de la casserole de la Grande Ourse mesure donc 25°.
les six étoiles les plus brillantes visibles dans le ciel du nord
Les constellations
Les constellations sont comme un patchwork dont les différentes pièces ont des tailles très variées. La plus étendue est celle de l’Hydre, mais ce n’est pourtant pas la plus intéressante. Elle est suivie de très près par celle de la Vierge et celle de la Grande Ourse, qui sont beaucoup plus célèbres. À elles trois, elles couvrent presque 10 % de la superficie du ciel. La Baleine et Hercule arrivent juste derrière.
Quant à la plus petite des constellations (pour la partie du ciel observable de l’hémisphère nord), celle du Petit Cheval, elle n’occupe que 0,2 % de la voûte céleste ! Et celle de la Flèche n’est guère plus grande… Pour donner une idée de la différence de superficie entre ces extrêmes, il faut retenir que la constellation de la Grande Ourse est 18 fois plus vaste que celle du Petit Cheval.
De même, les constellations n’ont pas toutes la même concentration d’étoiles, et les plus étendues dans le ciel ne sont pas forcément les plus denses. Une petite constellation comme la Lyre, en raison de sa position en pleine Voie lactée, qui fourmille d’étoiles, offrira un spectacle plus attrayant que celle du Dragon, bien plus vaste mais déployée sur un fond de ciel plutôt vide. À surface égale dans le ciel, deux constellations peuvent ainsi être très différentes dans leur intérêt d’observation.
Pourquoi cette découpe en constellations ?




À l’origine, les constellations sont des étoiles très brillantes que les humains ont reliées les unes aux autres en imaginant des figures issues de leur quotidien, de mythes ou de légendes : un animal (Dauphin par exemple), un objet (Balance), un personnage (Hercule), etc. Au fil des siècles, les Anciens ont ainsi juxtaposé plusieurs dizaines de figures. Puis on a tracé une frontière entre elles, de manière à mieux localiser parmi les étoiles des astres mobiles ou temporaires, comme les astéroïdes, les comètes, ou les supernovæ. Cette frontière est elle aussi invisible mais on la découvre sur les cartes du ciel, formée d’une succession de lignes qui se coupent à angles droits.
La juxtaposition de toutes ces pièces forme finalement l’immense puzzle des constellations, chacune d’entre elles offrant une petite trentaine d’étoiles visibles à l’œil nu.
Mais ce n’est là qu’une moyenne car en pratique, pas moins de 25 constellations en présentent davantage, tandis que 4 autres (La Flèche, Petit Lion, Petit Chien et Dauphin) en comptent moins de 10.



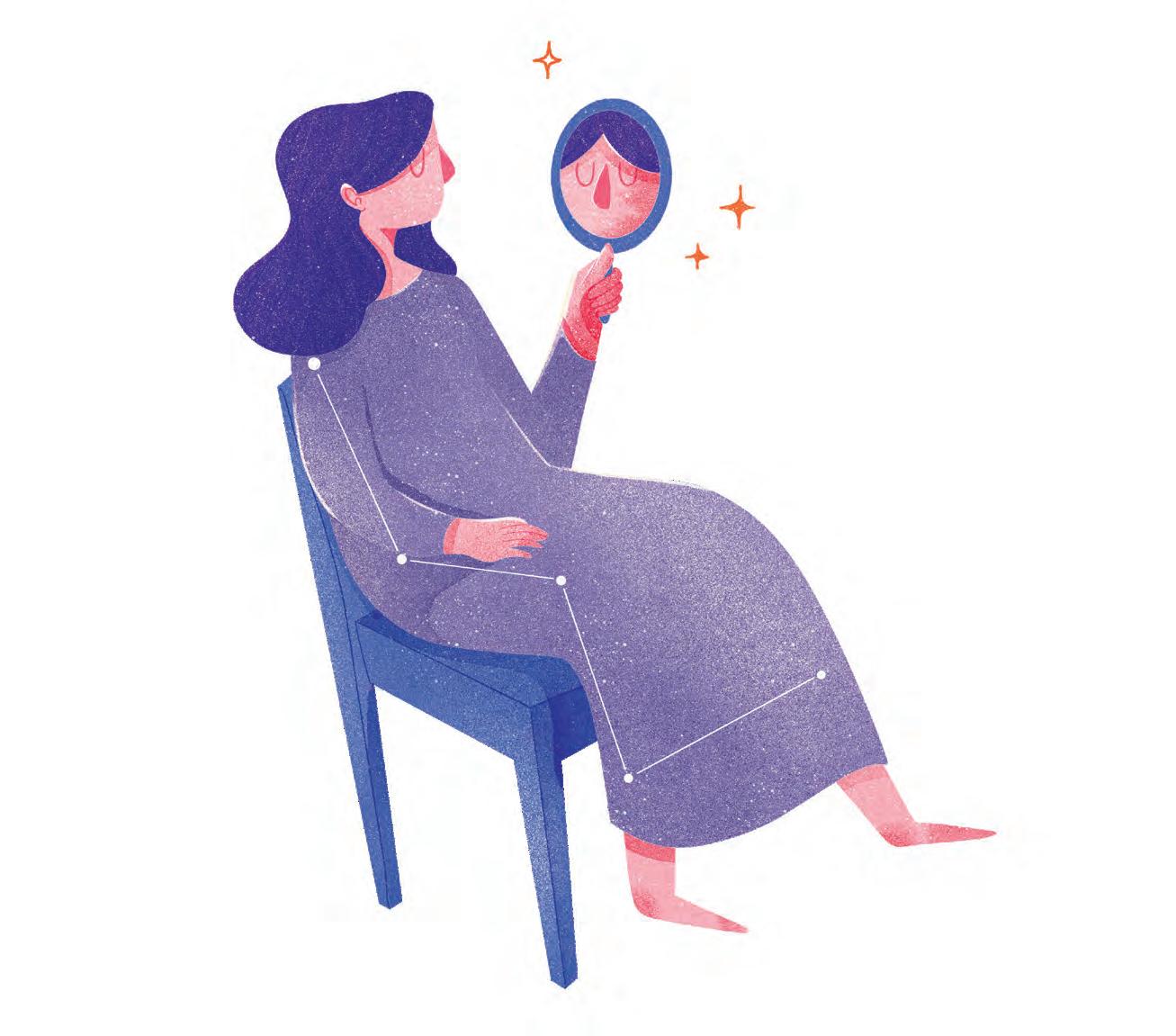


Mystérieuses constellations



Partons à la découverte du ciel, ses étoiles, et surtout, ses constellations ! D’où viennent-elles, sont-elles toutes inspirées de la mythologie, comment a-t-on décidé de leur nom ou leur forme ?

Dans ce livre documentaire, plus de 40 constellations sont expliquées et illustrées, ainsi que d’autres phénomènes célestes visibles à l’œil nu comme les planètes, la Lune, les comètes…
La carte du ciel détachable, à la fin du livre, permet d’apprendre à observer étoiles et constellations, à tout moment de l’année !
