









Quand le voyageur pénètre pour la première fois en Ubaye, il peut être frappé par la présence d’infrastructures militaires parfois imposantes, qui subsistent encore aux abords de la frontière, que ce soit à Tournoux, à Saint Ours ou vers le col de Larche ainsi qu’au delà de Saint-Paul-sur-Ubaye au niveau du pont du Châtelet.
Ces ouvrages sont les témoins d’une histoire militaire encore méconnue.
Au delà de ce qui est visible, il existe bien d’autres constructions, toujours intactes, sur les lignes successives de défense, souvent cachées par la végétation.
Le présent ouvrage réalisé par Philippe Lachal, membre de l’Amicale Ubayenne des Chasseurs Alpins, historien amateur et émérite, amoureux depuis des lustres de notre vallée en résidant régulièrement été comme hiver à Vars, nous invite à parfaire notre connaissance de cet aspect bien particulier de notre histoire militaire.
Philippe Lachal s’est donc intéressé à ce patrimoine en consultant une importante bibliographie, en recueillant des données sur les sites Internet mais surtout en se rendant sur le terrain dans les zones concernées et en prenant de nombreuses photographies. Ce magnifique livre est le fruit de son travail.
Il comprend trois parties : la Haute Ubaye, l’Ubayette, c’est à dire la vallée de Larche, et la zone de Restefond. C’est une oeuvre complète, mais restant concise, agrémentée de détails techniques, de cartes et de photos, remarquable et réellement passionnante.
Ainsi le lecteur comprendra alors l’importance de ces installations utilisées en juin 1940 lors de la défense de nos frontières face à l’envahisseur italien. Elles ont largement contribué à l’invincibilité de l’Armée des Alpes. Grâce à elles et à une utilisation judicieuse, Alpins, Artilleurs, Sapeurs du génie ont pu remplir complètement leur mission alors qu’au même moment dans le reste du pays, la défaite était largement consommée.
Mais encore, comme le raconte si bien Philippe Lachal, en 1944 et 1945, les derniers Allemands présents vont à leur tour se servir de ces redoutables installations pour nous « donner du fil à retordre » avant la victoire finale.
Cet excellent travail, dont l’objectif est de mieux faire connaître les trésors de notre patrimoine militaire, complète harmonieusement les récents ouvrages édités par la Sabença de la Valéia de l’Ubaye et écrits par le colonel Bernard Morel et Gérard Lesueur sur les forts de Tournoux et de Roche la Croix.
Ainsi s’écrit une page souvent ignorée de l’histoire de notre vallée, grâce à la passion de l’auteur qui entraîne non seulement la satisfaction du lecteur, mais encore attirera l’attention de toutes celles et de tous ceux qui sont en charge du devoir de mémoire.
Initialement cet ouvrage a été conçu comme un triptyque en trois parties distinctes : Haute Ubaye, Ubayette, et Restefond Haute Tinée, indépendantes les uns des autres. C’est délibérément qu’il a été choisi de ne pas refondre le document ; ceci explique quelques légères différences dans la présentation entre les trois parties ainsi que certaines redites et quelques doublons, notamment dans les illustrations. L’auteur formule pour ses lecteurs le souhait que ces redondances n’en apportent que plus de clarté dans l’exposé des événements et facilitent ainsi la lecture de chacune des trois parties sans avoir à se reporter aux précédentes ou aux suivantes.
Dans le texte, les toponymes utilisés sont ceux en usage actuellement (IGN). Toutefois, quand ils ont pu être vérifiés sur des documents originaux, les toponymes de l’époque, leurs synonymes ou leur orthographe différente ont été signalés entre parenthèses. L’orthographe de l’époque, différente de l’actuelle, a parfois été adoptée dans la relation événementielle.
Les altitudes citées sont celles des données IGN actuelles qui peuvent différer quelque peu de celles indiquées par les cartes de l’époque.
Les échelles et proportions des schémas et cartes de l’auteur ne sont données qu’à titre indicatif et sont approximatives.
Sauf mention contraire, les photos sont de l’auteur.
"Tout groupe humain, famille, cité ou nation, oublieux de ses ancêtres et insoucieux de son histoire quelque modeste qu'elle soit, n'est qu'un troupeau passant et paissant".
à Christine, mon épouse, pour son efficace collaboration, sa patience et son soutien inconditionnels,
à à m mees s ffiillss, , B Beennooîît t e et t P Piieerrrree, , q quui i m m' ' o onnt t a accccoommppaaggnnéé, , e ennffaannttss, , ssaanns s rreecchhiiggnneerr, , d daanns s m mees s rraannddoos s u ubbaayyeennnnees s e et t o onnt t a aiinnssi i d dééccoouuvveerrt t lla a " "ffoorrttiiff" " ,, à à V Véérroonniiqquue e e et t S Siimmoon n m mees s v vaaiillllaanntts s c ceennsseeuurrss, , à à H Huubbeerrt t T Taasssseell, , P Prrééssiiddeennt t d de e ll''AAmmiiccaalle e U Ubbaayyeennnne e d dees s C Chhaasssseeuurrs s A Allppiinnss, , p poouur r ssoon n a appppuui i iinnddééffeeccttiibbllee, , ssees s c coonnsseeiills s é éccllaaiirréés s e et t p poouur r a avvooiir r é étté é m moon n a aiigguuiilllloon n a affiin n q quue e ssooiit t m meenné é à à b biieen n c ce e p prroojjeett, ,
a auux x A Ammiiccaalliisstteess, , e et t e en n p paarrttiiccuulliieer r à à J Jaaccqquuees s D Daannggoon n ((ddééccééddéé) ) p poouur r ssees s p phhoottooss, , à à P Paattrriicce e B Baagguue e p poouur r lla a ssppoonnttaannééiitté é d de e ssoon n ssoouuttiieenn, , à à B Beerrttrraannd d H Huubbeerrt t p poouur r llees s d dooccuummeenntts s ffoouurrnniiss, , à à J Jooëël l N Néérroot t p poouur r m m' ' a avvooiir r a appppoorrtté é ssoon n e exxppéérriieenncce e d d' ' a auutteeuurr, ,
à à B Beerrnnaarrd d M Moorreell, , P Prrééssiiddeennt t d de e ll''AAssssoocciiaattiioon n U Ubbaayyeennnne e d dees s F Foorrttiiffiiccaattiioonnss, , p poouur r llees s p prréécciieeuux x rreennsseeiiggnneemmeenntts s e et t p pllaanns s q quu''iil l m m' ' a a ttrraannssmmiiss, , e et t à à D Daanniieel l D Duubbooiiss, , T Trrééssoorriieer r d de e ll''AAssssoocciiaattiioonn, , p poouur r a avvooiir r é étté é m moon n c ciicceerroonne e à à P Pllaatte e L Loommbbaarrdde e
à à M Maaddaamme e M Maarriie e D Daanniieelllle e A Alllliixx, , m maaiirre e d de e S Saaiinnt t P Paauul l ssuur r U Ubbaayye e p poouur r ll' ' a accccuueeiil l q quu' ' e elllle e m m' ' a a ttoouujjoouurrs s rréésseerrvvéé, , à à ttoouus s c ceeuux x q quui i m m' ' o onnt t a appppoorrtté é ttéémmooiiggnnaaggeess, , rreennsseeiiggnneemmeenntts s e et t d dooccuummeenntts s e et t à à c ceeuux x q quui i m m' ' o onnt t a auuttoorriissé é d dees s e emmpprruunntts s d daanns s lleeuurrs s p puubblliiccaattiioonns s..
D Dééddiié é à à ttoouus s llees s ''''bbeerrggeerrs s d dees s p piieerrrreess''' ' q quui i ffoonnt t v viivvrre e n noottrre e p paattrriimmooiinne e ffoorrttiiffiiéé. .
Chapitre I - Ligne Maginot alpine en Haute Ubaye. Casemates Pamart, tourelles STG et pilules briançonnaises p. 13
Situation géostratégique
Construction des ouvrages et unités affectées en juin 1940
Le PO de Plate Lombarde
Les PA de la Haute Vallée
Autres travaux
Description des ouvrages et de leurs vestiges actuels
Le PA de Maurin
Les PA de Fouillouse PA du Châtelet PA de Fouillouse Haut
Le PO de Plate Lombarde
Chapitre II - Les événements du conflit 1939-1945 dans la haute vallée de l’Ubaye p. 64
Déclarations de guerre et évacuation
Offensive italienne
Opération « M »
1er jour : 22 juin 1940
2e jour : 23 juin 1940
La matinée
L’après midi
3e jour : 24 juin 1940
Armistice (25 juin 1940)
Bilan des opérations en Haute Ubaye
Occupation de la haute vallée de l’Ubaye
Libération(s)1944 45
Juin août 1944 : actions du Maquis
Août novembre 1944 : libération ratée et évacuation
Hiver 1944 45 : le no man’s land
Avril 1945 : enfin la libération
Retour de la population dans la Haute Vallée
Chapitre I Situation géostratégique p. 95
Un passage privilégié depuis l’antiquité
Première organisation défensive : les places fortes de Vauban
Deuxième organisation défensive : le verrou du Fort de Tournoux
Troisième organisation défensive : le système Séré de Rivières
Quatrième organisation défensive : la ligne Maginot alpine
Chapitre II Le dispositif défensif français en juin 1940 p. 99
Ligne Principale de Résistance
Ligne des Avant Postes
Soutien d’artillerie
Chapitre III L’ordre de bataille italien en juin 1940 p. 122
Chapitre IV Les combats de juin 1940 p. 127
Evacuation et destructions défensives (10 11 juin)
Patrouilles et escarmouches (12 16 juin)
Tirs d’artillerie et premiers engagements localisés (17 21 juin)
Offensive italienne : l’opération ‘‘M’’ (Maddalena) (22 25 juin)
Chapitre V Armistice et occupation p.141
Armistice : incidents à Larche
Bilan des combats
Occupation italienne
Occupation allemande
Chapitre VI Résistance et libération p. 148
Résistance
De novembre 1942 à juin 1944
6 13 juin 1944 : l’Ubaye zone franche éphémère
13 juin 14 août 1944 : dispersion des Résistants 15 août 4 septembre 1944 : débarquement en Provence et tentative sur Larche
7 11 septembre 1944 : tentative de reconquête de la ‘‘tête de col’’ : « l’affaire du col de Larche »
Hiver 1944 1945
Libération (avril 1945) - Principes de l’Opération ‘‘Laure’’ (dégagement du col de Larche)
Opérations préliminaires Dégagement du col
L’Ubayette sinistrée
Chapitre I Situation géostratégique p. 187
Le massif de Restefond : une barrière naturelle
Face à la Triplice : système Séré de Rivières
Ligne Maginot : complément du barrage de Larche
Route de la Bonette Restefond
Chapitre II Fortifications du Restefond : vestiges actuels p. 200
Fortifications Séré de Rivières
Batterie et Postes de Cuguret
Fortin ou Casernement de Restefond
Blockhaus ou Fortin de la cime de Pelousette
Position des Fourches (Batteries et Blockhaus ; Camp) Blockhaus de Las Planas ou de la Tête de Vinaigre
Ligne Maginot
PO ou abri actif du col de Restefond Ouvrage de Restefond
PO des Granges Communes
PO du col de la Moutière Abris alpins de la Moutière
AP du col des Fourches
-
AP du Pra
AP de Saint Dalmas le Selvage
PA des Sagnes
PA de la cime de Pelousette
PA du Lauzarouotte (rocher du Prêtre)
PA de Las Planas
PC du col de Colombart
Chapitre III Les combats de 1940 - 1945 dans la zone de Restefond p. 275
Le dispositif défensif français en juin 1940
L’ordre de bataille italien en juin 1940
Les combats de juin 1940
De l’armistice à la Libération
Glossaire p. 297
On fait grand cas aujourd’hui du ‘‘devoir de mémoire’’. Il est toutefois regrettable que bien souvent cette mémoire soit sélective et ne retienne que les faits et épisodes les plus spectaculaires et les plus médiatiques de l’Histoire. Pourtant, il y a bien d’autres événements, d’autres lieux, d’autres faits moins sensationnels ou moins célèbres mais qui sont tout aussi dignes d’intérêt historique et de souvenance ; eux, risquent de sombrer irrémédiablement dans l’oubli.
Parmi les jeunes générations, et même pour les moins jeunes nés juste après 1945, qui se souvient encore de la déclaration de guerre italienne le 10 juin 1940, alors que la France était déjà quasiment battue par l’Allemagne nazie ?
Qui sait que l’un des axes principaux de l’attaque italienne était le col de Larche et la région Ubaye Restefond dans un vaste mouvement en tenaille destiné à s’emparer de Marseille et de tout le Sud Est ?
Qui se souvient que les soldats français, du 22 au 25 juin 1940, se sont battus dans le secteur Ubaye à 1 contre 9 ?
Qui se rappelle que l’Armée Française résista victorieusement dans cette Bataille des Alpes ?
Qui sait qu’il existait une ligne Maginot des Alpes dont le barrage Larche Restefond était l’un des maillons les plus importants ?
Qui sait qu’en Ubaye - Restefond la Ligne des Avant-Postes ne fut même pas entamée ?
Qui sait que seuls quelques hameaux et bergeries furent occupés par les Italiens ?
Qui sait que, dès 1942, au moment de l’invasion de la zone libre, la Résistance commença à s’organiser en Ubaye autour d’anciens cadres militaires démobilisés en 1940 ?
Qui sait que la Vallée d’Ubaye tenta de se libérer elle même, seule, en juin 1944, mais que toute une zone frontalière resta un no man’s land durant tout l’hiver 44 45 ?
Qui sait que la Haute Ubaye, l’Ubayette et le Restefond n’ont été libérés que fin avril 1945, c’est à dire à la fin de la guerre, presque aussi tard que les poches de l’Atlantique, elles bien connues ?
Qui sait que l’Ubayette paya un très lourd tribut pour ce conflit : victimes civiles, otages fusillés, nombreux villages et hameaux abandonnés, pillés, détruits, rasés durant l’hiver 1944 45, dont certains n’ont jamais été reconstruits ?
Qui sait aussi que cette région est un véritable condensé de l’histoire de la fortification de Vauban à Maginot, en passant par Berwick, Haxo, Séré de Rivières, et le Baron Berge ?
Qui sait les épreuves endurées par les bâtisseurs et les garnisons de ces fortifications d’altitude, certaines érigées à plus de 2 500 m ?
Qui connaît les fresques de ces artistes inconnus qui ornent encore certains cantonnements, ces graffiti et ces marquages témoins du passé ?
Malheureusement, aujourd’hui, les vestiges de ce qui fit les heures riches d’Histoire de ces vallées et sommets sont, pour la plupart, laissés à l’abandon. Le soleil, la pluie, le vent, la neige, le gel,… et encore plus l’indifférence des Hommes font leur œuvre.
Alors, cet opuscule aura atteint son but s’il peut inciter le lecteur à visiter ces lieux de mémoire dans une nature grandiose,… pendant qu’il en est encore temps : avant que la muraille ne retombe en poussière, avant que ses bâtisseurs et défenseurs ne sombrent définitivement dans l’éternité de l’oubli.
Vars et Saint Priest, septembre 2001 septembre 2005.


Si la fortification des Alpes édifiée dans l’entre deux guerres n’a jamais été désignée en France particulièrement d’un nom spécifique, les Italiens, eux, l’ont très vite désignée « Maginot alpine » et il ne faut pas oublier que le premier ouvrage mis en construction, le 4 septembre 1928, avant même la décision entérinant ce qui sera appelé plus tard ligne Maginot (Loi du 30 janvier 1930), est celui de Rimplas (Alpes Maritimes).
Dans le secteur fortifié Dauphiné (SFD), la vallée de l’Ubaye constitue une voie d’invasion aisée à partir de l’Italie. Depuis la plaine du Pô, par la vallée de la Stura et le colle della Maddalena (col de Larche, 1 991 m), elle donne accès non seulement à Barcelonnette, mais aussi au bassin de la Durance et au Queyras par le col de Vars, ainsi qu’à l’arrière pays niçois par le col de Restefond. Aussi, les préconisations de la CDF puis de la CORF ont elles conduit à la constitution d’un barrage défensif puissant : col de Larche Restefond. La voie éventuelle de pénétration principale est constituée par la RN 100 qui, du col de Larche, suit le cours de l’Ubayette jusqu’à son confluent avec l’Ubaye un peu en amont du Fort de Tournoux. En conséquence, la Ligne Principale de Résistance du barrage défensif de Larche comporte une série d’ouvrages modernes : Roche la Croix (mixte artillerie infanterie), Saint Ours Haut (mixte) et ses deux ouvrages annexes de Fontvive et Nord Est de Saint Ours (abris actifs du type Sud Est), Serre la Plate (observatoire d’artillerie), Saint Ours Bas (infanterie) et Plate Lombarde (infanterie). En avant, se trouvent les positions d’avant postes (AP) de Viraysse et de Larche et divers points d’appui (PA) : Ferme du Colombier, 1893, 2018, Fontcrèze. En arrière de la Ligne Principale de Résistance, les anciens forts et batteries Séré de Rivières complètent le dispositif (Tournoux, Roche la Croix supérieur, Vallon Claous ou Claus). Par ailleurs, le barrage du Restefond, puissant même inachevé, vise à éviter le débordement et l’enveloppement du barrage de Larche par le sud. Au nord de ce barrage, il en va tout autrement. En effet, si la haute vallée de l’Ubaye, de Saint Paul à Maurin, est desservie sur 15 km par un chemin vicinal ordinaire (VO) carrossable jusqu’à Combrémond (ou Combe Brémond ou Combe Rémond), au delà ce ne sont plus que sentiers muletiers ou pédestres. Les seules voies de pénétration depuis l’Italie sont des cols de haute altitude que ne franchissent que ces sentiers : col de Stroppia (ou Stropia) (2 865 m), col de la Gypière (ou Gippiera) (2 927 m), col de Marinet (2 787 m), col de Mary (ou de Maurin) (2 641 m), col du Roure (ou de Chabrière) (2 829 m), col de l’Autaret (2 880 m), col de Longet (2 660 m). Au nord de la conque, où l’Ubaye prend sa source, délimitée par la montagne du Cristillan, la Tête de Longet et la Tête des Toillies, s’étend le Queyras. Compte tenu de ces caractéristiques géographiques, les concepteurs de la Maginot alpine ont considéré que l’environnement montagneux ne nécessitait pas l’implantation d’ouvrages défensifs importants. Ainsi, au nord du Petit Ouvrage (PO) de Plate Lombarde, seuls de simples Points d’Appui (PA) furent établis.

Le PA de Maurin (ou plus exactement « les », car il y a plusieurs positions situées de part et d’autre de l’Ubaye) correspond en quelque sorte à un avant poste. Quelques kilomètres en aval, entre Saint Antoine et Serennes d’une part, et au nord de Fouillouse (ou Fouillouze) d’autre part, les PA de Fouillouse prolongent la Ligne Principale de Résistance au nord ouest du PO de Plate Lombarde qui est l’ouvrage le plus septentrional du barrage de Larche (voir carte). Ces trois PA et le PO sont fortement couverts par l’artillerie. Jusqu’au 24 mai 1940, l’artillerie du secteur Ubaye Ubayette commandée par le lieutenant colonel Thouvard ne dispose que du 2e Groupe du 162e RAP. Après cette date, trois groupes viennent le renforcer en provenance des II/114e RALCA, V/293e RALD et I/93e RAM ; l’ensemble passe alors sous le commandement du lieutenant colonel Bresse du 293e RALD. Le quartier de Saint Paul, en juin 1940, est soutenu en appui direct par la tourelle à éclipse de 2 x 75 Mle 33 du Bloc 5 de Roche la Croix qui peut prendre sous ses feux le col du Vallonnet (ou de la Plate Lombarde) entre le col de Stroppia et Fouillouse, et par les 14 pièces du groupement A1 commandé par le chef d’escadron Terrier : les deux 75 Mle 97 de Vallon Claous, les 2 x 75 sous casemate de Bourges de la Batterie des Caurres, deux batteries de 105 Long Mle 13, l’une à l’est de Serennes au lieu dit Pra Viral près du Castelet (2 pièces) et l’autre près de Saint Paul (4 pièces), deux 65 M également à Serennes (Castelet) et deux autres positionnés à la Barge, le tout renforcé au soir du 24 juin 1940 par un 155 Court Schneider Mle 17 (15e batterie du 293e RALD) aux Graves du Châtelet, et par un 155 installé au moment des hostilités près du Riou Mounal à Saint Paul. Ces pièces prennent en enfilade la haute vallée et battent les pentes des montagnes qui la dominent. Enfin, diverses SES (Sections d’Eclaireurs Skieurs) sont les éléments d’observation, de patrouille et d’intervention sur les hauts entre le col de Stroppia et celui de Longet. En juin 1940 sont affectées dans le secteur : refuge du Chambeyron, SES III/299e RIA (lieutenant Rigot) ; vallon de Chillol, SES bis 73e BAF (sergent de Jeoffre) et col de Longet, SES I/299e RIA (lieutenant Tardy).
Insignes des principales unités du secteur Ubaye Ubayette en juin 1940.












La construction des ouvrages de la haute vallée de l’Ubaye a été effectuée par la Main d’Oeuvre Militaire (MOM). Les ouvrages réalisés par la MOM ont souvent été qualifiés de ‘‘fortifications de pacotille’’. Ce ne fut pas toujours le cas, et même bien au contraire en ce qui concerne les Alpes, si l’on s’en réfère au jugement porté par Ph. Truttmann : « Sur les Alpes, il en alla heureusement tout autrement. Selon une tradition remontant à la création de l’Armée des Alpes, dans les années 1890, les troupes alpines participaient chaque année à l’infrastructure défensive de leur théâtre d’opération. Aussi leur emploi fut il tout naturellement planifié et intégré aux programmes de construction, en complément normal des entreprises civiles et non comme un succédané à bon marché. C’est à ces unités que l’on doit, sous la direction de la CORF et du Génie des XIVe et XVe Corps, non seulement la réalisation des ouvrages d’avant postes et de routes, mais également celle d’une partie des ouvrages CORF eux mêmes (abris actifs, petits ouvrages, équipements divers). Après la mobilisation, au lieu de se disperser en tous sens, on confia à la main d’œuvre militaire la construction de quelques dizaines de casemates d’intervalle de la position de résistance et de la 2e position.
L’unité de direction technique permit de standardiser créneaux et entrées, et de les doter de trémies d’embrasure, de portes blindées et d’équipements solides et convenables (même pour les blockhaus construits pendant les hostilités) conférant aux réalisations une certaine robustesse et une homogénéité remarquable. L’accent mis sur la qualité et non sur la quantité, on obtint en fin de compte que tous les travaux exécutés par main d’œuvre militaire soient un complément et un renforcement non négligeable des ouvrages CORF au lieu d’une charge, voire d’une gêne, comme ce fut le cas dans le Nord Est.
Le sérieux des ouvrages MOM des fronts des Alpes tranche avec le décousu, l’anarchie et le peu de valeur de la majorité des réalisations ‘‘complémentaires’’ du Nord Est : cela tient pour beaucoup à l’attachement passionné des alpins pour ‘‘leur’’ futur théâtre d’opérations. » (La Muraille de France, p. 449).
Il faut toutefois souligner aussi que, autant du fait du montant limité des crédits alloués que des difficultés dues à l’altitude pour la construction d’une part et le transport et l’installation des cuirassements d’autre part, des solutions « de circonstance sinon de fortune » durent être adoptées : casemates Pamart datant de la première guerre mondiale, cloches observatoires allégées et en plusieurs éléments, tourelles blindées STG démontables, petits blocs bétonnés pour arme automatique (FM ou mitrailleuse) dénommés pilules briançonnaises, abris en tôle cintrée dite tôle métro,…
Ce petit ouvrage CORF construit par la MOM (11e BCA et 4e génie) est établi à 2 200 m d’altitude, au sud est du hameau de Fouillouse, au débouché du col du Vallonnet par le vallon de Plate Lombarde. Les documents d’époque (plans et descriptifs du génie) le dénomment : « Ouvrage de Fouillouze ».
Les fouilles débutent en 1931 et le gros œuvre, tel que décrit par l’Instruction n° 363 2/4 S du 5 avril 1932 et la Note de la CORF n° 200/FA du 3 mai 1933, est terminé en juin 1935 (voir plaque gravée sur le socle de la table d’orientation). L’ouvrage comporte cinq blocs : un bloc entrée, un bloc cheminée/aération, un bloc observatoire et deux blocs équipés de casemate Pamart, datant de la première guerre mondiale, avec embrasures modifiées pour recevoir des FM 24/29 en lieu et place des mitrailleuses Hotchkiss de 8 mm. Un petit casernement de surface est édifié à quelques dizaines de mètres du bloc entrée. Un état d’avancement des travaux daté du 26 avril 1938 montre que de nombreux aménagements intérieurs ne sont toujours pas en place (notamment la centrale électrogène et les installations électriques, ameublements divers, fourneau de cuisine, etc.). Le chef de bataillon Vidal conclut toutefois à la possibilité d’occupation de l’ouvrage en l’état, les galeries pouvant servir d’abris et les blocs être armés rapidement. Par ailleurs, ce document mentionne un « ouvrage annexe pour FM au pied des Rochers de Saint Ours » (certainement de type pilule briançonnaise) non réalisé à cette date,… et qui ne le sera jamais ! Malgré ces retards, en juin 1940, l’ouvrage est totalement opérationnel avec une garnison d’une cinquantaine d’hommes de la 1/83e BAF sous le commandement du lieutenant Deloy.
En 1938 1939, ce sont trois compagnies du 73e BAF (11e BCA) qui permutent régulièrement entre Maurin, le Châtelet et Fouillouse pour édifier les petites fortifications de ces points d’appui. Des éléments du 4e génie apportent leur soutien technique pour les tâches les plus spécialisées (relevés topographiques, piquetage et traçage, coffrage du béton, etc.) et assurent la direction des travaux.
Après la formation du 83e BAF (à partir du 73e), au moment de la déclaration de guerre italienne en juin 1940, ce sont les sections de la 1re compagnie de ce bataillon qui sont affectées aux PA du Châtelet et de Fouillouse Haut et la 2e compagnie du I/299e RIA au PA de Maurin.
Les PC de compagnie sont à Maljasset pour le PA de Maurin et à la ferme de Champ Rond pour les PA du Châtelet et de Fouillouse Haut ; le PC de bataillon (commandant Achard), à Saint Paul. Quant au PC artillerie du groupement A1, il se situe à Serennes (maison Tiran).
Pour être complet, il faut signaler que le 15e BCA est intervenu aussi pour effectuer des travaux de viabilité dans ce secteur, notamment l’aménagement de la route de Fouillouse pour le transport du matériel lourd et des blindages destinés au PO de Plate Lombarde. En témoigne encore aujourd’hui un rocher gravé (dans la dernière épingle à cheveux avant le hameau) qui représente l’insigne du bataillon : cor de chasse au centre duquel se trouve le chiffre 15. Ainsi, le 15e BCA a bien mérité le surnom que lui donnaient les chasseurs eux mêmes : « Bataillon de Cantonniers Ambulants ».
L’insigne du 15e BCA gravé sur un rocher au bord de la route de Fouillouse.


En 1940, comme encore de nos jours, Maurin n’est pas véritablement un village ; ce toponyme regroupe en fait les hameaux de Combrémond, Maljasset, la Barge et la Blachière. C’est l’église (et son cimetière adjacent), située entre Combrémond et Maljasset, qui a toujours été appelée église de Maurin



Deux vues du hameau de Maljasset en 1938.
Le PA de Maurin est un vaste ensemble de petites fortifications MOM établi de part et d’autre de l’Ubaye au niveau du hameau de Maljasset, auquel il convient de rattacher la position des 65 M à la Barge, où se trouve aussi la section de réserve du PA. Il serait donc plus exact de parler des PA de Maurin (Maljasset la Barge).
A Maljasset, le PA est tenu en 1940 par la 2e compagnie du I/299e RIA commandée par le lieutenant Berthet dont le PC se trouve dans une maison du hameau. Il est constitué d’un groupe de fortifications rive gauche de l’Ubaye (section Velluet), d’un autre groupe rive droite (section Belloc) et de divers emplacements de combat, trous individuels et abris sous rondins, au centre du dispositif (section Dubouchet). Un vaste réseau de barbelés délimite la position qui dessine grossièrement un trapèze de plus de 18 ha (500 x 500 x 250 m).
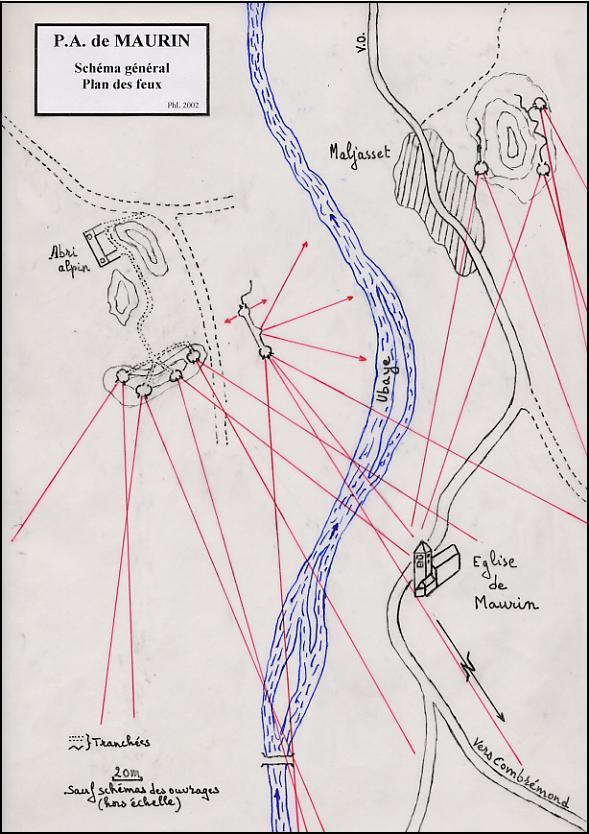
Rive gauche de l’Ubaye, on reconnaît tout d’abord un abri à personnel en béton et tôle métro (marquage au sol dans l’angle nord ouest sur trois lignes : ‘‘9 9 39 4ème Génie Réservistes’’). Des abris du même type se retrouvent dans les différents PA du secteur Ubaye Ubayette (le Châtelet ; Fouillouse Haut ; 1893 et 2018 du ravin de Rouchouze à Larche). Ils comportent une entrée latérale à chaque extrémité (plus rarement axiale aux deux extrémités ou bien à une seule) entièrement en béton coffré et, entre ces deux accès, une salle unique de 8,50 m x 2,70 m environ (soit 8 éléments tôle métro assemblés) parfois cette salle est séparée en deux pièces par une cloison légère avec murs bahuts en béton d’une cinquantaine de cm de haut servant de bases à la voûte en tôle cintrée. L’ensemble, recouvert de béton, de pierraille et de terre, peut résister aux obus d’un calibre de l’ordre du 75. Une cheminée d’aération verticale débouche dans chacune des entrées et, selon le type de ces abris, la ou les salles en sont équipées ou non. Ces abris sont aussi adaptés au terrain (dimensions, architecture et emplacement des entrées, etc.) ainsi qu’aux nécessités de la défense : par exemple, puits latéral bétonné au PA 1893 ou adjonction de deux locaux annexes avec créneau mitrailleuse au PA 2018 de Larche.

PA de Maurin. Maljasset. Rive gauche. Entrées de l’abri à personnel et gros plan de l’une des cheminées d’aération.
Partant de cet abri, on distingue toujours nettement une tranchée protégée par des murettes de pierres sèches qui se dirige en zigzag vers le nord. Elle parvient à une centaine de mètres à une petite éminence rocheuse et rocailleuse où elle se distribue à 4 emplacements fortifiés, alignés ouest/est, sur une quarantaine de mètres.

PA de Maurin. Maljasset. Rive gauche. Eminence fortifiée au nord-est de la position avec, à l’arrière-plan, l’église de Maurin.

Le plus occidental est un bloc bétonné de type pilule briançonnaise pour mitrailleuse dont le créneau de tir est exactement axé sur le clocher de l’église de Maurin. Le second est quasiment identique, mais avec une entrée protégée par tôle métro. Les deux derniers, dont il ne subsiste que les excavations dans la rocaille, devaient selon toute vraisemblance être des emplacements pour FM sous tôle métro ou sous rondins.






Enfin, en se dirigeant vers l’Ubaye, sur un terrain pratiquement plat, on devine à peine au ras du sol les créneaux de tir du plus curieux des ouvrages du site. Il s’agit d’une galerie de plus de 20 m de long, orientée sud/nord, se terminant en baïonnette pour desservir à son extrémité un bloc bétonné à deux créneaux pour FM. Les murs de cette galerie sont en pierres (en partie sèches et en partie jointoyées) et le toit en béton coffré ; une planche de coffrage a d’ailleurs cédé en formant une saillie de béton particulièrement dangereuse pour les crânes ! L’entrée de la galerie présente un élargissement avec de part et d’autre un petit créneau de tir en flanquement (arme individuelle). A mi longueur de la galerie, un autre élargissement, coté ouest, constitue une chambre de combat et présente trois petits créneaux du même type.

PA de Maurin. Maljasset. Rive gauche. Ouvrage souterrain au centre de la position.
Entrée : murs de pierres sèches et de pierres jointoyées, dalle de plafond en béton coffré, petit créneau de tir de flanquement.




Couloir de circulation : murs de pierres jointoyées, dalle de plafond en béton coffré.

Vues extérieure et intérieure de l’élargissement latéral de la galerie constituant une chambre de combat avec trois petits créneaux de tir de flanquement ; dalle de plafond en béton coffré et murs de pierres sèches et de pierres jointoyées.

PA de Maurin. Maljasset. Rive gauche. Ouvrage souterrain au centre de la position. Bloc bétonné terminal à deux créneaux de tir FM et petite console de béton sous les créneaux.
Rive droite, les éléments fortifiés se trouvent admirablement camouflés dans la petite barre rocheuse qui surplombe le hameau. Un premier bloc bétonné de type pilule briançonnaise pour mitrailleuse se situe juste au dessus des maisons. Son entrée est protégée de rondins recouverts de pierraille. La tranchée qui y conduit présente un diverticule latéral qui pouvait être un emplacement de tir en flanquement. Au dessus de ce bloc et de l’autre côté de la crête de la barre rocheuse, une autre tranchée mène, d’une part à un bloc bétonné identique pour mitrailleuse mais dont l’entrée est protégée par une tôle métro, et d’autre part, au dessus et légèrement en arrière de ce dernier, à un emplacement pour FM sous tôle métro. Le bloc pour mitrailleuse présente des marquages (graffiti) intéressants : une date, sans doute de construction (20.10.1939) ; une inscription en partie horizontale et en partie verticale comportant deux fois ‘‘Vive la France’’ et ‘‘ROCHE 7/5/45, ROBERT 1945 FTPF’’ ; enfin une série d’indications correspondant apparemment à des références chiffrées de hausse pour les tirs : ‘‘H 1000 N 26 L 100 ; H 800 L 70 N 35 ; H 500 L 40 N 47’’.



PA de Maurin. Maljasset. Rive droite. Juste au dessus du hameau, vestiges de tranchée protégée par une murette de pierres sèches, aboutissant à un bloc bétonné pour mitrailleuse dont ci dessous l’embrasure du créneau de tir.

Enfin, il n’a pu être retrouvé trace sur le terrain de l’emplacement pour FM sous tôle métro que H. Béraud dans ‘‘La Bataille des Alpes’’ (p. 102) situe au sud du hameau de Maljasset.



Le plan des feux des diverses armes automatiques du PA tel qu’il peut être restitué (voir schéma général) montre une densité qui explique certainement en bonne partie l’extraordinaire résistance de la position face aux attaques répétées et acharnées des Italiens. Ces derniers ne purent contourner la position ni par les pentes de Girardin ni par celles de la Tunette sous la Tête de Miéjour, se retrouvant systématiquement rejetés dans le thalweg où les attendait le feu nourri des défenseurs du PA. La seule infiltration qui aurait pu prendre la position à revers aura lieu le 24 juin 1940 vers 21 h 30 par le vallon de Teste, mais les 65 M de la Barge régleront rapidement le problème.

En effet, à la Barge, se trouve en appui direct la section du sous lieutenant Restelli (5/162e RAP) avec 2 x 65 M. Les deux pièces sont installées à l’endroit le plus étroit de la vallée, en face des rochers de la Queue, dans les halliers des prés de la Via, sur la berge du Béal Gros, un peu en contrebas de la route. Les murets de pierres sèches qui protégeaient les pièces et une petite soute à munitions également en pierres sèches et recouverte d’une tôle cintrée sont toujours visibles. Un peu en arrière et en dessous de la position, un abri à personnel (pierres sèches et tôle métro) servait au campement des artilleurs. Un autre abri (béton et tôle métro) se situe rive gauche de l’Ubaye au pied des premières pentes menant au vallon de Teste (section de réserve du PA de Maurin).

PA de Maurin. La Barge. Appui direct d’artillerie : 2 x 65 M.

Emplacement des pièces : murettes de pierres sèches et soute à munitions (pierres sèches et tôle métro).
En arrière de l’emplacement des pièces : abri à personnel (pierres sèches et tôle métro). Abri à personnel sur la rive gauche de l’Ubaye (section de réserve).

Enfin, on trouve encore sur le terrain, notamment dans le périmètre du PA à Maljasset, des éclats d’obus, en particulier des 65 M de la Barge qui ‘‘épouillèrent’’ la position (voir plus loin) et dont certains ont laissé traces sur la façade et le clocher de l’église de Maurin et endommagé quelques tombeaux du cimetière.
Bien que formant un continuum défensif, les PA de Fouillouse sont deux entités bien distinctes : le Châtelet, parfois désigné Fouillouse Bas, et Fouillouse Haut. Le premier se situe au lieu dit du même nom (ou Chastelet ou Castelet) au niveau de l’embranchement sur la D 25 de la route qui mène à Fouillouse, le second au nord/nord est de ce hameau au lieu dit Serre de Las Aigas au dessus des ‘‘Vistes’’. Ces points d’appui ont été construits tardivement (1938 1940) par la MOM comme en témoignent les nombreux marquages et inscriptions encore bien visibles aujourd’hui au PA du Châtelet (alors que curieusement le PA de Fouillouse Haut n’en présente aucun).
Ce PA est établi au niveau d’un verrou glaciaire qui barre la vallée de l’Ubaye, un peu en amont de Serennes. La rivière y a creusé une profonde et étroite entaille que

franchit la route de Fouillouse par un pont qui la surplombe de 120 m (1). Ce verrou doit son nom de Châtelet à une première fortification (caserne pour 100 hommes avec citerne et four) qui fut édifiée à son sommet dès 1693 par l’ingénieur Richerand sous les ordres de Villars comme redoute avancée du Camp retranché de Tournoux. Elle est ensuite abandonnée à la paix de 1697 qui donne l’Ubaye à la Savoie après la guerre de la Ligue d’Augsbourg. L’Ubaye reconquise au cours de la guerre de Succession d’Espagne, la redoute est rétablie en 1708. Si c’est l’ingénieur de Langrune qui est chargé de cette mission pour l’ensemble des redoutes avancées, ce sera le maréchal Berwick, Commandant de l’Armée des Alpes, qui laissera son nom attaché à ces fortifications (cf. celle située près des Gleizolles). Le castelet est à nouveau enlevé par l’adversaire en 1710 avant de redevenir français, avec l’ensemble de l’Ubaye, à la paix d’Utrecht en 1713.
A gauche, la brèche de l’Ubaye au-dessus de laquelle sera construit le pont en 1882. Au sommet du verrou glaciaire, les ruines encore imposantes de la Redoute.

A droite, le collet du Châtelet où passe le chemin muletier de Saint Paul à Maurin.
(1) Le projet de tracé de la nouvelle route de Fouillouse, et donc du pont, date du 14 août 1875. Ce projet, avec un pont en bois, est approuvé par le conseil municipal en 1878. Le 14 juillet 1879, décision est prise finalement pour un pont en pierre. Après accord des autorités militaires en raison du caractère stratégique de cette voie, l’autorisation préfectorale est délivrée le 21 juillet 1879. Le pont est terminé en 1882 mais ne pourra être utilisé que deux ans plus tard après percement du tunnel qui lui fait suite (28 m de long). Enfin, la route ne sera rendue carrossable qu’en 1888. L’une des cartes postales en illustration, datée de 1902, montre donc ce pont quelques années seulement après sa construction et sa mise en service.
Le Pont du Châtelet. Vues du début du XXe siècle et actuelle prises de l’aval.



Ce verrou, jadis fortifié, ne pouvait donc que retenir l’attention par la suite dans les années 1920 1930 lorsque la question de la défense de la Haute Ubaye se trouva de nouveau posée. Sa position est idéale pour dresser une barrière fortifiée commandant d’une part le CD 25 descendant de Maurin en longeant l’Ubaye, et d’autre part le débouché de la route de Fouillouse et son pont vertigineux. Ainsi, de 1938 à début 1940, la MOM s’activa à édifier des positions de campagne renforcées de petites fortifications bétonnées, complétant les ouvrages Maginot du barrage de Larche.
Le point d’appui du Châtelet est formé d’une série quasi linéaire est/ouest de petits ouvrages bétonnés barrant la vallée au niveau du verrou rocheux et s’étageant dans son ensemble entre 1 600 et 1 678 m d’altitude. Entouré d’un réseau de barbelés dont aucun vestige ne subsiste, le PA couvrait une superficie approximative de 10 ha et s’étendait dans ses plus grandes dimensions sur 450 m de large pour 250 m de profondeur.

* A hauteur du verrou lui même, l’ouvrage le plus à l’ouest, sur une crête rocheuse qui lui fait vis à vis, est une petite casemate entièrement en béton coffré. Elle comporte un créneau mitrailleuse et un second d’observation en direction amont de la vallée ainsi qu’un créneau FM d’action de flanc et une goulotte à grenades (et/ou d’évacuation des douilles ?), côté est.




Entrée,
Créneau
PA du Châtelet. Casemate mitrailleuse.
Entrée.
Embrasure mitrailleuse et créneau d’observation.
A l’intérieur, le créneau d’observation porte gravée dans le béton la date de 1939 ; on peut également y voir des fers à béton recourbés fixés dans le mur près de l’entrée pour servir de patères, et des cornières pour supporter deux étagères.


Le toit bétonné et pentu de son entrée présente une inscription en lettres élancées et élégantes :


* Le second élément du PA se trouve juste au bord de la Route Départementale 25 à l’endroit où elle franchit le verrou glaciaire (collet du Châtelet). Les plans du génie dénomment bizarrement cet ouvrage « Blockhaus de Maurin ».

Il s’agit d’une galerie en partie en béton coffré, en partie en pierres jointoyées, d’une dizaine de mètres de long qui aboutit à une tourelle STG démontable (ou tourelle par éléments ou tourelle Dufieux) modèle 35/37. Dans sa portion terminale proche de la tourelle, la galerie présente une niche avec une ouverture supérieure en biais (niche à munitions avec trémie d’approvisionnement ? ). Cette niche et son ouverture ne figurent pas sur les plans du Génie. Cet ouvrage a été recouvert d’un monticule de terre et de pierres qui le fait ressembler à un tumulus. La tourelle, certes dépourvue de ses mécanismes et organes annexes, est encore aujourd’hui en assez bon état de conservation. Il s’agit d’un modèle 1937 puisqu’il porte le n° T 564 alors que les modèles 35 se terminent au n° 495.
PA du Châtelet.
Vue générale du Bloc Tourelle STG Nord-Ouest.







Extrait de ‘‘Il était une fois la Ligne Maginot’’ (p. 58) de Jean Bernard Wahl chez Jérôme Do Bentzinger éditeur.

L’entrée de l’ouvrage comporte au linteau une inscription, encore assez bien lisible, précisant la date de construction et les unités qui y ont participé.


* En poursuivant vers l’est, en contrebas de la route et en amont du verrou, on découvre dans une prairie un rocher aménagé pour un emplacement FM. L’entrée en est toujours bien visible, alors que le créneau de tir a été totalement envahi par la végétation. Il semble que l’aménagement de rochers en positions protégées pour arme automatique ait été une spécialité locale. En effet, on trouve un rocher aménagé de la même façon mais beaucoup plus vaste (pour 3 hommes : 1 caporal, 1 observateur et 1 tireur FM) entre l’AP de Larche et les ruines de la ferme du Colombier. Le nom donné à ce rocher près de Larche est particulièrement évocateur : ‘‘Le Truc’’ ! Le rocher aménagé du Châtelet présente, inscrits au plafond de la chambre de tir, deux noms : Jaussaud Henri et Perra Marcel.



* Toujours plus à l’est, sur une éminence surplombant le confluent avec l’Ubaye du torrent du Vallon descendant du col de Serenne, une seconde tourelle STG 35/37 (n° T 565), elle aussi encore en assez bon état, complète le dispositif. Cette tourelle est desservie par une galerie bétonnée d’une vingtaine de mètres faisant un angle de 160° environ au milieu de sa longueur ; cette galerie aboutit à une salle de 8 m2 environ d’où une chatière ouvre sur un étroit passage donnant accès au puits issue de secours. Avant cette salle, une galerie s’embranche perpendiculairement à la galerie principale pour conduire à l’entrée de l’ouvrage dont le linteau porte une magnifique inscription. Enfin, la galerie bétonnée présente, un peu en arrière de la tourelle STG, une niche latérale pour le stockage de munitions.






* Au sommet du verrou lui même, on retrouve les ruines de la redoute qui lui a donné son nom et deux excavations en partie comblées qui semblent avoir été des abris sous rondins, ainsi que les traces de tranchées qui y conduisaient. L’une domine le collet du Châtelet, l’autre prend en enfilade le pont de la route de Fouillouse. Enfin, il faut signaler que les roches affleurant au sommet, rabotées et lissées par le glacier, portent de très nombreuses inscriptions laissées par les troupes à diverses époques.

Le Châtelet : ruines de la Redoute du XVIIe siècle qui a donné son nom au site.



* Sur la face sud ouest (aval) du verrou, falaise assez escarpée, deux abris tôle métro bétonnés ont été aménagés en contre pente. L’un est situé à mi hauteur sur un terre plein terrassé, côté pont. Il comporte à son extrémité est, dans le mur pignon, un créneau de tir prenant en enfilade le pont ainsi que le débouché du tunnel qui lui succède. L’entrée à cette extrémité est protégée par un court mur latéral en béton.

L’autre abri, au bord de la route, à une cinquantaine de mètres du carrefour de la D 25, présente dans son entrée orientale une fresque, encore en assez bon état, reproduisant l’insigne du 83e BAF (1re compagnie 1re section) combiné à celui de la ligne Maginot avec sa devise ‘‘on ne passe pas’’ et la date 1939 1940.



PA Le Châtelet : abri au bord de la route de Fouillouse. Fresque représentant l’insigne du 83e BAF combiné à celui de la ligne Maginot (au dessous de la date 1939 1940) avec la devise ‘‘on ne passe pas’’.

Le PA de Fouillouse Haut est situé sur le Serre de Las Aigas sorte de promontoire en plateau incliné avec une succession de terrasses, orienté sud est/nord ouest et dominant le hameau de Fouillouse. Il s’étage entre 2 000 et 2 080 m d’altitude en un quadrilatère irrégulier de 12 ha environ (450 m sur 350 m dans ses plus grandes dimensions) délimité par un réseau dense de barbelés dont on trouve aujourd’hui encore de nombreux vestiges sur le terrain. Le système défensif couvre : au sud est, le plateau de Plate Lombarde jusqu’au col du Vallonnet et le chemin qui y conduit depuis Fouillouse ; à l’est, le sentier pédestre qui, en longeant les éboulis au pied du massif de la Souvagea, descend du refuge du Chambeyron et au delà, du col de la Gypière ; au nord, il prend en enfilade le bois de Preina et la combe du Nid d’Aigle (ou combe du Cézil) jusqu’à la hauteur de Saint Antoine sur l’Ubaye ; à l’ouest enfin, il peut battre de ses feux d’infanterie la vallée de l’Ubaye depuis le PA du Châtelet jusqu’à Serennes.

* Au centre du PA se trouvent deux abris tôle métro bétonnés du même type que ceux du Châtelet. L’un d’eux est aujourd’hui utilisé comme station sismologique par l’IPSN (il en est de même d’ailleurs de l’abri actif Nord Est de Saint Ours). Ils sont construits à contre pente, en utilisant pour ce faire les terrasses naturelles du site. Ces mêmes terrasses ainsi que le rebord du promontoire ont été mises à profit pour défiler le réseau de tranchées, encore bien visible, qui les relie entre eux et aux quatre petits blocs bétonnés pour armes automatiques. Le long de ce réseau de tranchées, des emplacements de combat (observation et tir) ont été creusés et certains aménagés sous rondins.
* Le bloc défensif principal se trouve à une trentaine de mètres de l’abri actuellement occupé par la station sismologique. L’ancien sentier de Petite Randonnée du Tour de l’Ubaye passe juste devant son créneau de tir.






Il s’agit d’un abri bétonné tôle métro à 5 éléments (5 m x 3,50 m de dimensions extérieures) avec entrée axiale, prolongé d’une chambre de tir pour mitrailleuse en béton coffré. Le créneau prend en enfilade le bois de Preina et la combe du Nid d’Aigle. Juste à coté du bloc, se situe un point géodésique d’altitude 2 056 m. Par ailleurs, deux emplacements de combat ont été creusés à proximité de ce bloc et y sont reliés par des tranchées.

* En arrière du même abri, une autre tranchée conduit, vers le sud ouest, à une cinquantaine de mètres, aux vestiges très informes d’un petit bloc béton et tôle métro, détruit, qui apparemment défendait l’accès nord ouest du PA. A trente mètres de là, au sud, une excavation signale un emplacement de combat, à ciel ouvert ou sous rondins, qui couvrait la combe des Vistes et la vallée entre le Châtelet et Serennes.


* A l’extrémité nord est du PA, près du carrefour des sentiers actuels menant au refuge du Chambeyron d’une part et descendant sur le Châtelet d’autre part, un petit bloc circulaire bétonné avec parement de camouflage en pierres sèches, présente un créneau de tir pour FM orienté vers la lisière nord est du bois de Preina. Il s’agit là d’une de ces fameuses ‘‘pilules briançonnaises’’. La tranchée qui y conduit dessert plusieurs emplacements de combat en levées de terre dont certains étaient abrités sous rondins.
Bloc FM 1.

* Sur la tranchée qui relie les deux abris bétonnés tôle métro, à peu près en son milieu, s’embranche une autre tranchée d’abord orientée nord sud puis remontant en zigzag vers l’est pour aboutir, au rebord sud est du plateau, à un petit bloc bétonné circulaire quasi identique à celui décrit précédemment (2,40 m de diamètre extérieur). Toutefois, celui ci a perdu presque en totalité son parement de pierres. En outre, il présente deux créneaux de tir : l’un dirigé sud est vers le sentier menant à Fouillouse et au delà vers Plate Lombarde, l’autre orienté plein est couvrant le flanc du PA et le débouché du sentier du refuge du Chambeyron. La tranchée décrite ci dessus, avant d’atteindre le bloc bétonné, dessert deux emplacements de combat à ciel ouvert, l’un en pierres sèches, l’autre creusé dans le roc. Ces emplacements protègent le coté sud est du PA directement au dessus de Fouillouse.



Extrait de ‘‘La Bataille des Alpes’’ par H. Béraud, Editions Heimdal, p. 30.
Croquis d’un petit bloc bétonné pour arme automatique de type « pilule briançonnaise ».

* L’accès au PA de Fouillouse Haut se fait, soit par le sentier qui descend à l’est vers le hameau, soit par celui à l’ouest qui, par la Meire, permet de rejoindre la route un peu au dessus de la ferme de Champ Rond et, de là, de rallier le Châtelet. Ce dernier sentier a été soigneusement terrassé et empierré : des vestiges de soutènements en pierres sèches peuvent encore aujourd’hui être observés. Enfin, au point où ce sentier pénètre dans le périmètre du PA, un poste de garde protégé par des levées de terre a été aménagé sous un petit aplomb rocheux, maintenant écroulé mais toujours reconnaissable.

* Le réseau de barbelés est établi assez loin des blocs. Ainsi, du coté du sentier venant du refuge du Chambeyron, une centaine de mètres sépare ce réseau des deux petits blocs circulaires. Cette considération a son importance pour les événements décrits plus loin lors des combats. Enfin, on distingue encore très nettement sur le sentier du refuge les vestiges de l’ancien canal d’irrigation (bords du canal en pierres levées).


C’est en arrivant par le sentier qui descend du col du Vallonnet que l’on a la vue la plus saisissante sur l’ouvrage : les casemates Pamart ont un aspect si particulier que certains surnomment ce sentier ‘‘l’allée des têtes d’éléphant’’ ! Cet ouvrage est aujourd’hui sauvegardé par l’Association des Fortifications de l’Ubaye mais n’est pas ouvert au public ; seules des visites exceptionnelles sont organisées par l’Association.



Le périmètre défensif de l’ouvrage couvrait environ 4 ha. Si les barbelés et queues de cochon ont été enlevés pour la plupart, de nombreux ardillons sont par contre restés en place et la visite des dessus requiert une vigilance particulière.


Le Bloc 1 Entrée présente la façade classique de celle d’un Petit Ouvrage : porte blindée pour personnel avec fente de tir obturable défendue par deux créneaux FM ; une goulotte à grenades ; une prise d’air. Une partie du support d’antenne radio et la pénétration du câble dans le bloc sont encore visibles.

Le Bloc Cheminée/aération se situe juste en arrière du Bloc Entrée. Sur les plans du génie, il est curieusement numéroté 6 alors que l’ouvrage ne comporte que 5 blocs et c’est d’ailleurs ce nombre qui est repris dans les descriptifs. Il sert à l’évacuation de l’air vicié, à l’échappement des groupes électrogènes et de cheminée pour la cuisine et la chaudière. Il peut accessoirement être utilisé comme sortie de secours.
Les Blocs 2 et 3 Casemates Pamart sont les blocs actifs de l’ouvrage. Ils battent les débouchés des cols du Vallonnet et de Stroppia, ainsi que le vallon des Aoupets qui peut être une voie de pénétration depuis le col de la Gypière par le Pas de la Couletta. Les casemates Pamart sont des cuirassements à deux embrasures conçus et réalisés en 1916 1917 pour le renforcement des forts de Verdun. Ils peuvent résister à un coup isolé de 200 mm.
Quelques exemplaires non utilisés à l’époque et restés sur parc sont récupérés comme solution économique pour quelques ouvrages Maginot du Sud Est. L’armement initialement prévu pour ces casemates est la mitrailleuse Hotchkiss de 8 mm. La mitrailleuse est mise en place par l’extérieur à l’aide d’une sorte de chèvre dont les trois pieds viennent se loger dans des trous forés dans la calotte blindée et obturés en temps ordinaire chacun par une petite plaque métallique (qui, ici, sont toujours en place). Le renflement du cuirassement entre les deux créneaux, qui ressemble à la racine d’une trompe d’éléphant, recouvre le réceptacle de récupération des douilles des mitrailleuses. En fait, dans les fortifications du Sud Est, l’armement, et donc les créneaux, ont été modifiés. Initialement, les plans du génie avaient prévu pour Plate Lombarde une mitrailleuse gauche (créneau extérieur) pour le bloc 2, une mitrailleuse droite (créneau extérieur) pour le bloc 3 et des FM pour les deux créneaux intérieurs. En fait, on constate que les quatre créneaux ont été modifiés en créneaux GFM 1929 type A pouvant recevoir les équipements et armements correspondants, notamment le FM 24/29.
Croquis extrait de ‘‘La Muraille de France’’, par Ph. Truttmann, p. 244. Gérard Klopp Editeur, 1996.

Blocs

Remarquer l’importance de l’enchâssement du cuirassement dans le béton et la présence des plaques métalliques obturant les trous forés pour l’installation de la chèvre permettant la mise en place des mitrailleuses (en fait, à Plate Lombarde, ce sont des FM qui armaient ces casemates)

Le Bloc 4 Observatoire est équipé d’une cloche allégée (10 cm de blindage au lieu de 20) en 2 éléments vissés l’un sur l’autre, de type n° 2, à 3 créneaux de type GFM « A » pouvant recevoir le bloc jumelle D (x 8). Le côté de cette cloche opposé à l’ennemi s’adosse à un important épaulement de béton destiné au renforcement de la résistance au déchaussement de la cloche en cas de coup direct frontal.




L’issue de secours, ou du moins ce qui figure comme tel sur les plans du génie, constitue en fait une véritable seconde entrée de l’ouvrage. Elle se trouve défilée sur le côté ouest de l’ouvrage en dessous du Bloc 4 Observatoire à la cote 2190. Elle est constituée par une galerie bétonnée aboutissant à une porte blindée ; cette galerie est précédée d’un court boyau protégé par des murs de soutènement latéraux puis couvert d’un auvent de rondins recouvert de zinc et de terre. Après la porte blindée, la galerie se poursuit jusqu’au Bloc 4 puis aboutit à la galerie principale.
Les patrouilles utilisaient cette sortie pour partir en mission ; dans le mur de la galerie, un peu avant la porte blindée en venant de l’extérieur, sont fixés des fers à béton recourbés servant de patères pour accrocher les capotes.



Une table d’orientation se situe près du bloc 4. Son socle porte une plaque gravée de l’inscription : ‘‘ 11eme B.C.A. 4eme GENIE JUIN 1935 ’’

Du casernement extérieur, de type classique en bois, ne subsistent que les fondations et les sanitaires en béton.

L’intérieur de l’ouvrage est resté très sain et en assez bon état du fait des mesures d’entretien, de maintenance et de prévention du pillage mises en œuvre par l’Association des Fortifications de l’Ubaye.


La galerie principale sert de caserne avec les classiques couchettes en béton, sur trois niveaux, pour 44 hommes. Chaque niveau est chauffé, soit directement par les tuyaux du chauffage central, soit, à intervalles réguliers, par des radiateurs à ailettes. Les autres locaux de vie sont constitués par une cuisine, une réserve à vivres, une citerne alimentée par une source.
Les locaux sanitaires comportent : latrines, infirmerie, douches pour gazés et poste de secours.
Les locaux techniques sont constitués par l’usine (2 groupes CLM 108 de 25 CV chacun avec génératrice de 23 KVA) avec magasin à gas oil et citernes à eau, une salle des filtres, plusieurs emplacements de ventilation, un local TSF et téléphone (sous l’entrée) et un central téléphonique.




Filtres.
Groupes CLM 108.
Ventilation.
Les locaux de combats, outre les puits et blocs avec ventilation, récupérateurs et refroidisseurs de douilles, regroupent : poste de commandement et magasins pour charges, artifices, munitions et cartouches.




Bloc
Divers équipements en excellent état sont toujours en place : coffres blindés à documents, répartiteur téléphonique, batteries de filtres, etc.
La déclaration de guerre à l’Allemagne, le 3 septembre 1939, surprend les alpins en pleine construction des points d’appui dont certains ouvrages ne seront terminés que début 1940. Ensuite, pendant le temps d’expectative de la drôle de guerre, le calme est mis à profit pour installer les lignes téléphoniques reliant les ouvrages de la Haute Vallée et peaufiner les dernières défenses. En dehors de ces travaux, les troupes, outre les patrouilles des SES sur les cols frontière, s’occupent comme elles peuvent et améliorent l’ordinaire en piégeant les marmottes ou en tirant le chamois.
Le 10 juin 1940, le tonnerre éclate sur les Alpes : l’Italie « se muove in guerra » et poignarde la France dans le dos le jour même où la Bataille de France est quasiment perdue face à l’Allemagne. La nouvelle est connue dès 18 h par la TSF. Pour la population de Maurin et des divers hameaux de la haute vallée de l’Ubaye (Saint Antoine, la Barge, Maljasset, Combrémond,…) ainsi que des villages de Fouillouse, Serennes et Saint Paul, elle est synonyme d’évacuation immédiate. Les habitants n’ont qu’un délai de quatre heures pour réunir barda et bétail puis descendre par leurs propres moyens, c’est à dire à pied, jusqu’à Saint Paul distant pour certains de 15 km. Bien sûr, les troupes des PA ne peuvent qu’assister avec amertume à ce triste spectacle d’exode. De Saint Paul, la population est évacuée en camions à partir de 4 h du matin sur un premier centre de repli à la Motte du Caire (Basses Alpes), puis par la suite par le train vers la Lozère. Les troupeaux de moutons et de vaches sont, eux, conduits vers Allos, Colmars et Beauvezer.
Sur le plan militaire, le secteur Ubaye commandé par le colonel Dessaux est divisé en deux sous secteurs : Jausiers (lieutenant colonel Soyer) et Ubaye Ubayette (lieutenant colonel de Dinechin). Sont affectés à ce dernier sous secteur le 83e BAF et le I/299e RIA soutenus par l’artillerie déjà citée. Le chef de bataillon Achard commande le quartier de Saint Paul. Du 10 au 22 juin 1940, finalement peu de choses se passent sur la Haute Ubaye où seuls parviennent les échos des opérations des SES ou les tirs d’artillerie sur le secteur de Larche au sud, ou en Queyras au nord. Quelques escarmouches entre la SES du I/299eRIA à la bergerie de Longet et des tirs des 75 de Vallon Claous sur des infiltrations italiennes au vallon de Chillol sont les seuls faits qui méritent d’être signalés


L’opération ‘‘M’’(M comme Maddalena du nom italien du col de Larche) a pour but de s’emparer rapidement de la vallée de l’Ubaye pour descendre ensuite celle de la Durance et rejoindre à Marseille les forces de l’opération ‘‘R’’ (R comme Riviera) qui se seront emparées des Alpes méridionales et du littoral méditerranéen.
Du coté français, de l’Ubaye au Restefond, le secteur dépendant de la 64e DI, aux ordres du colonel Dessaux, regroupe 4 bataillons et 7 SES ainsi qu’une centaine de pièces d’artillerie. En face, les Italiens ont concentré le IIe CA (général Bettini) qui aligne 5 divisions et un groupement alpin avec en réserve une division et un groupement motorisé. L’Ubaye voit ainsi en face d’elle la plus forte concentration de troupes italiennes de l’ensemble du front des Alpes. Le rapport de force pour l’infanterie est de 9 contre 1 : 37 bataillons italiens contre 4 français.
Le plan de l’opération ‘‘M’’ prévoit d’occuper d’abord la haute Ubaye et la vallée de Maurin (attaque de l’aile droite au jour J, le 22 juin), puis de pousser ensuite au centre sur Larche et Meyronnes (jour J + 1) en agissant, en aile gauche, au sud, sur Jausiers pour atteindre Tournoux et la Condamine.
Le PA de Maurin en avant poste, les PA de Fouillouse et le PO de Plate Lombarde en position de résistance sont donc directement menacés par l’offensive, non seulement de l’aile droite italienne mais également par le centre de l’attaque, qui, en débordant Viraysse et Plate Lombarde, pourrait déboucher sur Fouillouse et Saint Paul.
Le 22 juin au matin, la IVe GaF, le 2e Raggruppamento Alpino (Varaïta Pô) et les 1er et 2e Alpini de la 4e division alpine « Cuneense » (général Ferrero) entrent en action du col de Longet à celui de Stroppia. Les SES de la tête de l’Ubaye (groupe de la SES I/299e RIA commandé par l’aspirant Moro et éléments de la SES bis 73e BAF) se replient depuis les hauts pour protéger au plus près le PA de Maurin. Les Italiens en profitent et, passant par le col de Longet, s’installent au nord sur leur premier objectif : la montagne de Cristillan. Plus au sud, le bataillon « Saluzzo » (2e Alpini) franchit avec difficulté le col de l’Autaret très enneigé et parvient à la bergerie du lac de Parouart tandis que le bataillon « Borgo San Dalmazzo » descendant du col de Mary parvient en vue de la vallée vers la mijournée. Ce bataillon est d’abord freiné dans son élan par la SES bis 73e BAF puis fixé jusqu’au soir par le petit groupe de combat du sergent Bramati installé à l'abri de rochers vers la croix du Passour. La pression des assaillants se fait forte sur le PA de Maurin tenu par la 2e compagnie du I/299e RIA. Aussi, dans la soirée, le commandement du secteur autorise t il le chef de bataillon Achard à replier son avant poste (le PA de Maurin) sur la Ligne Principale de Résistance, c’est à dire les PA de Fouillouse, à huit kilomètres en arrière. Ce repli n’aura pas lieu car le lieutenant Berthet commandant le PA, qui a jusqu’alors arrêté toutes les infiltrations, se fait fort de tenir sa position.


Une partie de la réserve du quartier (1re compagnie du I/299e RIA) est engagée pour sécuriser la route entre le pont Voûté (pont du Sapin) et la Blachière en surveillant particulièrement le vallon d’Aval et le vallon de Chauvet. Une autre partie de cette réserve, la 3e compagnie du I/299e RIA, stationnée au col de Mirandol, est envoyée en renfort à Viraysse qui a connu la défaillance des artilleurs, servants de ses mortiers de 150 de tranchée, que le colonel Dessaux vient de renvoyer vertement sur leur position en les menaçant de faire intervenir sur eux les jumelages de mitrailleuses de l’ouvrage de Saint Ours Haut si de tels faits devaient se reproduire. Cette compagnie reçoit le 23 juin mission d’assurer la couverture depuis le Roir Alp mais elle ne la remplit que partiellement en se repliant le soir même sur Saint Ours Haut. Ce n’est que le lendemain, 24 juin, qu’elle parviendra à Viraysse dans une action menée en commun avec la SES 83e BAF du lieutenant Costa de Beauregard.
Dans la partie sud du dispositif, le 1er Alpini s’est aussi lancé à l’attaque dès le matin. A 5 h, le caporal chef Arnaldo au Bloc 3 du PO de Plate Lombarde sonne l’alarme : 200 italiens viennent de déboucher du col de Stroppia et « descendent en zigzag comme en pays conquis ; le col est noir de monde ». L’artillerie est immédiatement prévenue et, lorsque l’ennemi atteint le fond du Vallonnet, l’enfer se déclenche. Une pluie d’obus s’abat, venant tout à la fois de la tourelle de Roche la Croix et de la batterie de 105 de Serennes : encagement à obus percutants, fusants et obus à balles au milieu, le tout accompagné des rafales des FM du PO… C’est aussitôt la débandade ! Vers 17 h, une seconde tentative subira le même sort et sera repoussée. Au cours de cette journée, l’artillerie tire plus de 300 coups sur la zone.
Dans le même temps, le bataillon italien « Dronero » qui a franchi le col de la Gypière a atteint rapidement le refuge du Chambeyron et menace très directement le PA de Fouillouse Haut. Lorsqu’il arrive à hauteur de l’ancien canal d’irrigation, les pièces d’artillerie de Vallon Claous, de Saint Paul et de Serennes les prennent sous un feu nourri. Leur commandant blessé, les Italiens tentent de se replier. Une partie reflue vers le refuge de Chambeyron, une autre essaye de s’échapper par les éboulis de la Souvagea et vient s’abriter dans la combe du Nid d’Aigle. Certains brandissent des mouchoirs blancs et se rendent au PA de Fouillouse Haut. Ces prisonniers sont d’abord dirigés vers le PC de compagnie à la ferme de Champ Rond, puis par l’ancien chemin de Fouillouse, ils sont conduits à Serennes. Au cours de leur interrogatoire, ils avouent candidement que leurs officiers les avaient assurés qu’il n’y aurait aucune résistance en face d’eux et qu’ils coucheraient le soir même à Barcelonnette ! Par prudence, la SES III/299e RIA et une section de la 3e compagnie de réserve patrouillent dans le bois de l’Eyssilloun et le vallon de la Baragne, au sud ouest de Fouillouse, et s’assurent qu’aucune infiltration ne s’y est produite pendant la journée. Durant toute la nuit, le canon continue à tonner sur la haute vallée de l’Ubaye « au point que le village de Serennes en est tout illuminé ».
*
La météo est extrêmement mauvaise : brouillard, pluie, neige et froid. Pourtant les directives du général Pintor commandant la 1re armata face au Secteur Ubaye Ubayette sont ambitieuses : « pousser à fond l’action dans la vallée de l’Ubaye en direction de Gap avec une double diversion : au nord vers Guillestre et au sud de Barcelonnette vers Draguignan ». Le mouvement des ailes doit précéder celui du centre et l’envahisseur procédera par submersion en lançant un maximum de troupes par tous les points de passages possibles, y compris les cols et itinéraires montagneux les plus difficiles. L’action a débuté au sud (Restefond les Fourches) dès 3 h du matin. Au nord, la division « Cuneense » reprend l’offensive à 5 h avec pour premier objectif Saint Paul et doit, pour y parvenir, s’emparer d’abord du PA de Maurin qui résiste toujours.
A Maurin, les 14e et 15e compagnies du bataillon « Borgo San Dalmazzo » attaquent vivement de front le point d’appui pendant toute la matinée tandis qu’une compagnie du bataillon « Saluzzo » tente de déborder la section Velluet qui en tient la partie nord, mais sans résultats appréciables, ce qui indispose fortement le commandant du 2e Alpini, le colonnello Baucherio.
Dans la zone de Fouillouse, la partie du « Dronero » qui s’était repliée la veille au refuge du Chambeyron s’est regroupée et attaque en direction de la vallée, freinée par deux groupes de la SES III/299e RIA. Toutefois, à la faveur du brouillard épais, les alpini finissent par atteindre, sans être repérés, les barbelés qui ceinturent le PA de Fouillouse Haut (on se souvient que ces barbelés sont éloignés d’une bonne centaine de mètres des petits ouvrages). Brusquement, vers 9 h 30, le brouillard se déchire et les défenseurs aperçoivent immédiatement les assaillants à quelques dizaines de mètres. Un feu nourri d’armes automatiques les rejette aussitôt derrière le rebord de terrain que suit le sentier. A l’abri de cette légère crête, ils évitent le PA, le contournent par le nord et progressent vers le bois de Preina et l’Ubaye. Cependant, comme la veille, l’artillerie les prend violemment à partie et leur progression devient alors très difficile.
L’après midi
A Maurin, les Italiens sont soutenus à partir de 12 h 30 par deux batteries de montagne du groupe « Pinerolo » (4e RAM) qui ont réussi à franchir le col de Mary, mais sans grand effet.
Vers 14 h, le général Ferrero (division « Cuneense ») pousse lui même en avant ses chefs de bataillon, car « étant donné la situation militaire et politique, il faut concentrer tous les efforts sur Saint Paul ». A la fin de la journée, seules deux sections de la 23e compagnie du « Saluzzo » auront réussi à contourner le PA par le nord

et à suivre les hauts de la rive droite de l’Ubaye. Elles s’installent alors sur les pentes du col de Girardin à la cote 2346. Cependant, le brouillard épais et le temps exécrable les empêchent de réaliser l’action projetée sur les 65 de la Barge. La situation pour les défenseurs pourrait à ce moment être critique, car dans la matinée la rumeur a couru d’une infiltration importante par le vallon de Chillol qui aurait coupé la route entre le pont Voûté et la Blachière. Si ces faits étaient avérés, l’avant poste de Maurin serait coupé de la position de résistance (Châtelet Fouillouse Haut) et ne pourrait plus être ravitaillé en munitions et renforts. Inquiets, le commandant Blanchard et le capitaine Lépine du PC de Saint Paul montent à Serennes en début d’après midi et gagnent ensuite Saint Antoine avec deux douaniers volontaires. A Saint Antoine, une patrouille est formée qui reconnaît ensuite la route jusqu’à la Barge : la voie est toujours libre. En effet, ce sont des éléments de la SES bis 73e BAF qui ont pu contenir le « Pieve di Teco » dans le vallon de Chillol, appuyés efficacement par l’artillerie qui arrose copieusement les deux cols (Pas Nord et Pas Sud de Chillol) qui donnent accès aux lacs du Marinet et au delà aux cols frontière. Epuisés, les hommes de la SES bis 73e BAF sont repliés à Saint Antoine pour prendre un peu de repos mais qui sera de courte durée.
Au-dessus de Fouillouse, le bataillon « Ceva » (1er Alpini) vient prêter main forte aux éléments infiltrés la veille et le matin. Un violent et très précis barrage d’artillerie le disperse rapidement. Il se replie immédiatement sur la frontière par le col de la Gypière.
Le « Dronero », quant à lui, est quand même parvenu dans le bois de Preina et la combe du Nid d’Aigle à 400 m environ de la route de Maurin entre le Châtelet et Saint Antoine. Il lui faut encore traverser l’Ubaye, alors qu’il est sans cesse harcelé par l’artillerie (batteries de Serennes, Saint Paul et Vallon Claous) et qu’à la moindre éclaircie les mitrailleuses et FM des PA du Châtelet et de Fouillouse Haut les prennent à partie. En milieu d’après midi, un grand flottement se dessine chez les Italiens. Certains alpini

cherchent le salut dans un repli, qui ressemble plus à une fuite, par le Pas de la Souvagea, d’autres complètement assommés par deux jours de martèlement d’obus et d’armes automatiques préfèrent se rendre. Ils sont recueillis par le groupe de combat de Saint Antoine qui, pour leur faire franchir l’Ubaye grossie par trois jours de pluie et de neige, doit leur tendre une longue échelle. Tard dans la soirée, les restes du « Dronero » reçoivent l’ordre de se replier sur le col de la Gypière, compte tenu des énormes difficultés de ravitaillement en vivres et munitions et pour les évacuations sanitaires. Une section reste en couverture au niveau du lac Premier entre le refuge du Chambeyron et le col. Pour ces deux jours de combats, 72 prisonniers auront été faits dans la zone Fouillouse Saint Antoine.

Le général Bettini (II° corpo d’armata), ce soir là, ordonne de reprendre l’attaque le lendemain « aux premières lueurs de l’aube pour atteindre les objectifs précédemment fixés »… et il insiste pour qu’elle soit menée énergiquement !

* 3e jour : 24 juin Sur Maurin, les opérations reprennent dès 1 h 30 avec un tir nourri de mortiers installés dans la carrière de marbre. La 15e compagnie du « Borgo San Dalmazzo » déborde alors la position tenue par la section Velluet sur la rive gauche de l’Ubaye. Les sections de la 23e compagnie du « Saluzzo », installées la veille à 2346 sur les pentes du col de Girardin, attaquent rive droite. La 14e compagnie du « Borgo San Dalmazzo » agit, elle, frontalement. Les Italiens finissent par parvenir jusqu’aux barbelés et des infiltrations se produisent un peu partout dans le périmètre même du PA. Le sergent Beneton est tué à son poste de combat. Après bien des hésitations, car il craint pour la sécurité de ses hommes, le lieutenant Berthet ordonne aux 65 de la Barge un tir de fusants sur ses propres positions. Cette action osée d’épouillage repousse pour un temps les assaillants. Les murs de l’église et quelques tombeaux du cimetière adjacent portent encore des traces des éclats d’obus. La SES bis 73e BAF remonte de Saint Antoine jusqu’aux premières lignes et contribue à donner un peu d’air aux défenseurs du PA en contre attaquant par le sentier de la Barge au col de Girardin. Elle déloge les Italiens installés depuis la veille dans la barre rocheuse des pentes de Girardin. Cependant un second alpin est tué dans le PA : l’agent de liaison Gourdon. En fin de matinée, la tentative d’encerclement a échoué. Par ailleurs, la 13e compagnie du « Borgo San Dalmazzo » qui tente de déborder vers la Blachière, au sud du PA, est stoppée par une zone minée. Dans l’après midi, malgré les risques sur la route coiffée par les Italiens et leur pression toujours maintenue sur le PA, un véhicule de l’atelier de réparation de Briançon parvient sans encombre jusqu’à la section de 65 de la Barge pour y changer un tube. D’ailleurs, au dessus de la route, au vallon de Chillol, les alpini du « Pieve di Teco » pris dans une violente tempête de neige et toujours sous le feu de l’artillerie du quartier, sont finalement repoussés dans la région des lacs de Marinet, tandis qu’une cinquantaine de prisonniers sont capturés sur le plateau de Chauvet par la section Delajoud du I/299e RIA. Sur Fouillouse, le Châtelet et Serennes, les opérations auraient dû reprendre à 5 h 30. Mais le 1er Alpini a ordonné au « Dronero » et au « Ceva » durement éprouvés de n’envoyer que des éléments d’observation et de sécurité ainsi que d’essayer de récupérer les blessés et égarés des deux jours précédents. Seuls quelques petits groupes errent encore dans le bois de Preina et finissent d’être dispersés par l’artillerie. Partout un matériel important et varié a été abandonné et jonche le terrain.
Avant que ne survienne l’heure du cessez le feu, les Italiens veulent à tout prix gagner du terrain, en particulier à Maurin. Ils réussissent à nouveau à s’infiltrer dans le PA en fin d’après midi et, vers 21 h 30, après avoir progressé sous la Gélinasse par le col de Miéjour et le vallon de Teste, parviennent sur la rive gauche à moins de 300 m de la position des 65 de la Barge. Le sous lieutenant Restelli qui commande la section fait alors pivoter ses pièces et déboucher à zéro ; l’ennemi est repoussé avec l’aide, une fois encore, de la SES bis 73e BAF. Quelques Italiens sont capturés. Au centre du PA, la section de l’adjudant Dubouchet se maintient au niveau de l’église de Maurin, tandis que, au sud sur la rive droite, la section Belloc au niveau de Maljasset contient toujours l’adversaire. Les assaillants sont ainsi fixés quasiment hors du périmètre avec le soutien des batteries du quartier (Serennes et Saint Paul). Cependant la situation reste critique et de l’aveu même du maréchal des logis chef Saillard, chef de pièce à la section de 65 de la Barge : « les deux dernières heures [avant l’armistice] nous ont paru interminables ». A la fin des combats, les défenseurs du PA qui aura tenu ont à déplorer 2 tués et 2 blessés.
Le secteur Fouillouse - Châtelet est, lui, beaucoup plus calme. On note seulement l’installation dans l’après midi d’un 155 Court aux Graves du Châtelet qui arrose alors efficacement le col de Mary où une colonne muletière est décimée, ainsi que la zone des lacs de Marinet où s’est abrité le « Pieve di Teco ». Une centaine d’obus est également tirée sur l’Italie en contre batterie d’une pièce italienne installée entre Saretto et Chiappera. Les dernières heures avant l’armistice sont en effet marquées par un véritable feu d’artifice, les artilleurs mettant un point d’honneur à vider leurs caissons.
A 0 h 35, le canon se tait sur les Alpes. Cependant l’ordre officiel du cessez le feu ne parviendra au PC du 2e Alpini que le 25 juin à 5 h 30. Par la suite, dans la matinée, une délégation d’officiers italiens descend du col de Mary et se présente au PA de Maurin. L’adjudant Dubouchet les conduit au lieutenant Berthet et constate, non sans amertume et regret, vu l’issue des combats, que « c’était pour manger un peu, car leur ravitaillement n’avait pas passé la montagne ».

En Haute Ubaye, les gains de terrain réalisés par les Italiens sont négligeables. Certes, ils se sont emparés de quelques bergeries (Hubac du Longet, Le Gâ,… ) dans la très haute vallée ainsi que du hameau de Combrémond, mais ont été arrêtés au niveau de l’église de Maurin. Au dessus de Fouillouse, ils n’ont pu gagner que la zone montagneuse et déserte qui s’étend du col de la Gypière au refuge de Chambeyron. Les défenseurs du quartier de Saint Paul ont fait plus de 120 prisonniers. Ils ont à déplorer 2 morts au combat (le sergent Beneton et l’agent de liaison Gourdon au PA de Maurin) et deux blessés. Une tragique méprise a fait un troisième mort : le sergent chef Barbet qui, dans la nuit du 23 au 24 juin, en ravitaillant le PA de Fouillouse Haut par très mauvais temps n’a pas répondu aux sommations d’une sentinelle. Quant aux pertes italiennes, elles furent élevées, surtout autour de Fouillouse où toute la journée du 25 juin des caravanes de mulets évacuèrent les blessés et les morts ; ces derniers sont chargés par trois sur les bâts, deux en long et un en travers, pour être dirigés rapidement sur l’Italie après un premier dépôt au refuge du Chambeyron. L’évacuation des cadavres et des blessés se fera avec une telle célérité que les opérations seront déjà terminées lorsque le service sanitaire français proposera son aide à son homologue italien. Le brigadier des douanes Audiffred qui se rendit sur les lieux put constater que le terrain était jonché d’effets militaires, vareuses, manteaux et capotes déchirés, de pansements, de fusils, de grenades et de munitions : « c’était lamentable à voir ».
Pour l’ensemble du secteur Ubaye Ubayette, les Italiens eurent 127 morts, 1 526 blessés ou « congelati » et 399 prisonniers ou disparus (les Français, 4 morts et 5 blessés, soit un rapport de 9 à 2 052 pour la totalité des effectifs mis hors de combat).
Le 25 juin, le colonel Dessaux adresse à ses troupes l’ordre général n°5 confirmant le cessez le feu, mais dont les mots, compte tenu du bilan final, prennent une particulière résonance :
« Officiers, sous officiers, Caporaux et brigadiers Alpins, Canonniers et Sapeurs de l’Ubaye, l’ordre nous est donné de cesser le feu.
Nous l’exécutons les dents serrées, mais sans honte parce que l’ennemi qui nous fait face n’y est pour rien.
Depuis le 17 juin, nous sommes attaqués par CINQ Divisions Italiennes : DIX contre UN.
L’ennemi n’a pas entamé nos avant-postes. Nous lui avons fait 400 prisonniers sans lui en laisser un seul.
L’honneur est sauf, vous pouvez garder la tête haute. »

Dans la haute vallée de l’Ubaye, les Italiens organisent leur mini zone d’occupation entre la frontière et la ligne verte du cessez le feu qui passe au col Tronchet, puis par Pra Fournier, le Colombier, l’église de Maurin, les Planchettes, sur la rive droite de l’Ubaye, et se poursuit rive gauche par les Pierres Chazalettes, le Pas de la Souvagea, le Béal de Fouillouse, Plate Lombarde, Viraysse, les Challanches, jusqu’à Larche. Une ligne violette à 50 km à l’ouest de cette ligne verte délimite la zone qui doit être démilitarisée dans un délai de dix jours. Les PA sont donc évacués avec armes et bagages les 29 et 30 juin. Les troupes gagnent à pied par étapes les centres de démobilisation où les unités de réserve (299e RIA et 83e BAF) sont démobilisées et celles d’active (73e BAF) dissoutes le 31 juillet. Sur la ligne verte, les Italiens installent quelques petits postes avec mitrailleuses. Le Poste de Commandement est placé au cours de l’été à Combrémond à la maison Argentin dont un mur s’orne rapidement, en une longue inscription noire sur fond blanc, de la devise de la GaF : « DEI SACRI CONFINI GUARDIA SICURA ». Les Italiens semblent vouloir s’installer durablement, y compris pour l’hiver. La viabilité du col de Mary est améliorée par un empierrement de grandes dalles, aujourd’hui encore visible, et en arrière du col, un important ensemble de constructions près de Chiappera regroupe central téléphonique (une ligne a été tirée jusqu’à Maurin), logements pour troupes et officiers, cuisine, dépôts de vivres et matériels, écuries,… A Combrémond, la construction d’un four à pain est entreprise et des stocks de bois de chauffage (plus de cent stères) et de farine sont apportés d’Italie. La carrière de marbre de Maurin est totalement pillée : tout le matériel récupérable est démonté et transporté en Italie ; ce qui ne peut l’être est systématiquement saccagé et détruit.
Dans le même temps, la population évacuée des villages de la vallée (Saint Paul, Serennes, Fouillouse et Maurin) regagne ses habitations. Les premiers, par leurs propres moyens, dès début juillet ; les autres, par convoi de camions organisé par les autorités gouvernementales, le 20 juillet. Les troupeaux, eux aussi, sont ramenés du Haut Verdon sans trop de pertes et en état satisfaisant. D’une façon générale, la population des hameaux occupés (Combrémond principalement) n’aura pas à se plaindre de la présence et de l’attitude des occupants italiens.
Au 15 octobre d’ailleurs, les Italiens n’occuperont plus de façon permanente la Haute Vallée. La mauvaise saison arrivant, ils repassent en Italie et y ramènent les stocks de bois et de farine précédemment apportés à Combrémond. Des patrouilles de la GaF viendront ensuite régulièrement, hiver comme été, à peu près une fois par mois, jusqu’en septembre 1943 (capitulation italienne), puis ce seront des éléments allemands et italiens qui s’y rendront. La dernière patrouille sera vue le 20 septembre 1944 avant que la zone ne se retrouve dans le no man’s land de l’hiver 1944 1945. Les Allemands établiront, après l’armistice italien du 3 septembre 1943, des postes de douanes pour surveiller les cols surtout vis à vis de leurs ‘‘alliés’’ italiens, d’abord à Saint Paul (maison Politon), puis en 1944 à Serennes et Fouillouse.

Au moment du débarquement du 6 juin 1944, le message de la BBC « Méfiez vous du toréador » est l’ordre pour les maquis de l’Ubaye de passer à l’action. Responsables civils et militaires de la Résistance veulent transformer la vallée en un réduit fermé, véritable zone franche libérée, à partir de laquelle des actions plus élargies et conséquentes seraient menées. Le plan est ambitieux. Malheureusement, les effectifs FFI et FTP sont bien faibles et l’entente ne règne guère entre les deux. En outre, se pose le problème d’un armement très hétéroclite (français, italien, anglais et américain) et de son approvisionnement en munitions. Enfin, les explosifs dont ils disposent sont très insuffisants pour créer des obstacles importants ou des destructions conséquentes. Malgré tout, divers ‘‘bouchons’’ sont installés ; en ce qui concerne la Haute Vallée, à la Rochaille (RN 100 entre les Gleizolles et Meyronnes), au Pas de la Reyssole et au pont de la Fortune (près de Saint Paul), au Pas de Grégoire (entre la Condamine et Jausiers) et au pont du Mélezen (entre Saint Paul et le col de Vars, par les groupes Galetti du Maquis d’Eygliers et Sabiani du Maquis de Guillestre). La réaction de la Wehrmacht est prompte et vigoureuse : le 10 juin, venant de Vars, les Allemands attaquent de vive force le bouchon du Mélezen. Les maquisards sont obligés de se replier. L’unité allemande (dont le n° reste inconnu comme le signale le rapport de gendarmerie 748/2 du 20 septembre 1947) opère alors des représailles dans la région de Saint Paul. Ils enferment les hommes dans une pièce du presbytère et les femmes dans une pièce de l’immeuble Brémond. Ils pillent ensuite systématiquement les maisons et incendient deux d’entre elles : celle de Casimir Arnaud, apparemment sans raison précise, et celle de Honoré Raynaud pensant qu’il s’agit de celle de Paul Reynaud, l’ancien Président du Conseil. Le 12 juin, les femmes sont relâchées tandis qu’une quinzaine d’hommes dont le curé, malade, sont pris comme otages. Ils sont conduits à la Gestapo de Gap pour y être interrogés. Parmi eux se trouvent : Joseph Bagnis, Pierre Rayne, Jacques Goletto, Louis Pascal, Joseph Foucheriq, Jean Signoret, Joseph Imbert, François Degioanni, Pierre Raina, Jean Dao, Jean Garcin, Jean Imbert, Louis Vexellman. Ils seront relâchés quatre jours plus tard sans avoir subi de violences. Le hameau des Prads est également pillé et le lendemain ce seront ceux des Gleizolles et de Tournoux ; dans ce dernier, un homme sera fusillé (Alfred Audiffred dit France). Ces 12 et 13 juin, de violents accrochages ont lieu sur les autres bouchons, notamment au Pas de la Reyssole et au Pas de Grégoire. Plusieurs maquisards sont tués et d’autres blessés : le Maquis doit décrocher et se replier sur l’Italie auprès des Partigiani. L’accueil de ces derniers est si mitigé que le commandement décide le retour en France dès le 15. Trois jours plus tard, le 18 juin, le maquis de l’Ubaye se disperse et ses 250 hommes vont vivre dans les cabanes et les bergeries d’altitude jusqu’au mois d’août.
En juillet, puis début août, la Milice viendra dans la région de Saint Paul pour réquisitionner des mulets.
A la suite du débarquement en Provence, le 15 août, un message d’Alger précise le plan de blocage par les maquis des principaux cols alpins dont celui de Larche. Le 16 août, le message de la BBC « Voir Naples et mourir » donne l’ordre de passer à l’action. Dans un premier temps, il faut regrouper les hommes éparpillés dans la montagne depuis la mi juin. Le 22 août, les 250 FFI de l’Ubaye commandés par le capitaine Delanef (ancien chef de la SES 15e BCA) occupent l’AP de Larche, articulés en 5 compagnies (d’une cinquantaine d’hommes chacune) dont une compagnie lourde comprenant des gendarmes (sous lieutenant Woerhlé) et renforcée des 63 Polonais de l’ancienne garnison de Larche ralliés depuis la veille. Face à la réaction ennemie qui ne saurait tarder, le but de l’opération, sous les ordres du chef de bataillon Bureau pour l’ensemble FFI et FTP, n’est pas de tenir mais de livrer un combat retardateur sur trois lignes successives : Larche, puis Saint Ours Roche la Croix, et enfin Tournoux. En effet, la VIIth US Army remonte la vallée du Rhône et, en Italie, les Allemands pour couvrir leur flanc ouest ont réagi avec promptitude en envoyant sur l’Italie du Nord la 90e PanzergrenadierDivision (de l’ex Afrika Korps) et des troupes de montagne avec mission de constituer sur les versants français de larges ‘‘têtes de col’’. Le KampfGruppe Von Behr (PanzergrenadierRegiment 200, HochgebirgsBataillon 3 et un groupe blindé d’artillerie) atteint le col de Larche dans la matinée du 23 août et rejette les FFI sur la deuxième position. Dès le 24 août, cette deuxième position est débordée par les Allemands à la suite notamment de la brusque débandade d’un détachement FTP. Le soir, le KampfGruppe a atteint son objectif : « les hauteurs à l’est de la Condamine ». Le 25 août, infiltrations allemandes au dessus de Saint Ours par le quartier de Bouchiers, le col de Mirandol et celui du Vallonnet, en direction de Fouillouse et de Saint Paul : au cours d’un accrochage dans ce secteur, les FFI perdent un tué et deux blessés. Il semble que ce soit aussi lors de ces actions que le clocher de l’église de Fouillouse ait été mitraillé : les impacts de balles sur la façade est du clocher et sur les cloches sont toujours très nettement visibles. Le 26 août, la troisième position (Tournoux), sous la menace directe de l’ennemi, est partiellement évacuée. Le 28, la Condamine est violemment bombardée et incendiée, et il en est de même la nuit suivante. Le 29, les parachutistes américains du 550th Team de la 1st Air Borne Task Force atteignent Barcelonnette et, à partir du 31, tiennent le secteur jusqu’à Jausiers. Coté Durance, le 24 août au soir, la 45th Division US a détaché la Troop A (Captain Piddington) du 117th Cavalry Reconnaissance Squadron pour s’assurer de la vallée et son 1er Peloton a reçu mission de pousser par Guillestre jusqu’au col de Vars. Cependant, le 31 août, afin de mieux couvrir le flanc droit de la VIIth US Army et en particulier de reprendre Briançon (conquise puis perdue), la 2e DIM (général Dody) et le 2e GTM, de l’armée B qui deviendra officiellement le 25 septembre la 1re armée française (général de Lattre), relèvent les Américains dans la vallée de la Durance et en Briançonnais. Ainsi, le général Guillaume, qui commande l’ensemble des GTM, a la joie de pouvoir venir embrasser sa vieille maman à Guillestre, son pays natal. La jonction est faite entre les Français et les Américains de la 1st Air Borne Task Force, le 1er septembre à Saint Paul.
Après la libération de Briançon les 5 6 septembre, une opération est programmée pour le 7 pour reprendre Larche. Elle doit être menée sous les ordres du colonel Molle (2e DIM) par le colonel Leblanc (1er GTM) avec un bataillon de tirailleurs, un tabor marocain, divers éléments américains stationnés à Jausiers (colonel Sachs), les FFI de l’Ubaye (commandant Bureau) et plusieurs bataillons FTP. En face, les Gebirgsjäger de la 5e Division (troupes de montagne) ont relevé les Panzergrenadiere du Regiment 200 à la fin du mois d’août. Le mauvais temps fait reporter l’action de quarante huit heures. Cependant, dès le 8 septembre, commencent des opérations préliminaires qui ont pour objectif, à partir de Saint Paul, de s’assurer de la maîtrise du col de Mirandol (2 433 m).





Elles sont confiées au 14e bataillon FTP des Hautes Alpes qui compte 8 officiers et 17 sous officiers,... pour seulement 69 hommes de troupe. L’attaque est un cuisant échec qui coûte 3 tués. Par contre, les goumiers, encadrés sans doute en nombre moindre mais plus efficacement, occupent le plateau de Bouchiers (2 566 m) et enlèvent l’observatoire de la Tête de l’Homme (2 504 m) où les Allemands ont 2 tués et 3 prisonniers. Le lendemain 9 septembre, le sous lieutenant du Penhoat du 12e tabor s’empare du col de Mirandol et s’y maintient en situation précaire. En effet, sa demande de renforts ne peut être satisfaite car les tabors sont très dispersés dans la montagne en un front très étendu en raison de l’extrême mobilité de leurs adversaires (troupes de montagne) et de l’obligation de protéger les populations de la vallée. En début d’après midi, de malheureux coups longs d’une batterie de mortiers installée au pont des Bonis tuent et blessent des goumiers. Un certain flottement s’en suit qui empire à la tombée de la nuit lorsque des allemands déguisés en goumiers s’infiltrent dans leurs rangs ; c’est alors la débandade. Au col de Mirandol, les Allemands bondissent et franchissent le col de vive force en tirant de toutes leurs armes. Le sous lieutenant du Penhoat et plusieurs de ses goumiers sont tués. Leurs corps ne seront retrouvés qu’en juin 1945 (stèle au monument aux Morts de l’église de Saint Paul). Sous la pression de l’ennemi, le 10 septembre, les éléments en place au plateau de Bouchiers et à la Tête de l’Homme rompent le combat et se replient sur Saint Paul. Les mulets, encore bâtés, ont été abandonnés. Ainsi harnachés, certains erreront dans la montagne pendant près de 15 jours jusqu’à ce que les Allemands les capturent ou les tuent. Le bilan de cette opération ratée (parfois appelée ‘‘affaire du col de Larche’’) est lourd : 9 morts, 27 blessés et 3 disparus. L’hiver approchant, le 12e tabor se replie sur le col de Vars. Pendant les semaines qui suivent, les Allemands, depuis Larche, canonnent sporadiquement Saint Paul (en particulier les Prads où se trouve une section marocaine) et Serennes où une habitante (Mme Louise Hellion) est tuée sur le pas de sa porte, le 19 septembre. Compte tenu de cette situation, au mois d’octobre un ordre d’évacuation fait partir une partie de la population de Saint Paul, des Prads et de Pont de l’Estrech. Les habitants de Serennes qui hébergent ceux de Fouillouse tentent de rester chez eux ainsi que ceux de Maurin qui se croient à l’abri. Cette situation dure plusieurs jours, mais la canonnade allemande devenant de plus en plus fréquente, un nouvel ordre d’évacuation immédiate est donné. Le curé de Serennes (M. Rayne), le maire (M. Pellet) et le brigadier des douanes Audiffred montent au col de Vars et tentent de négocier avec le colonel commandant le secteur pour que les populations puissent rester chez elles. L’autorité militaire ne se laisse pas fléchir et ils n’obtiennent qu’un délai de quarante huit heures pour que les funérailles de la boulangère, Mme Joseph Arnaud, qui vient de décéder de maladie, puissent avoir lieu. Ainsi, le 13 novembre, après l’enterrement, recommence le triste spectacle d’exode de 1940, mais aggravé par la neige, le vent et le froid : « Chacun est parti, comme il a pu, avec moutons, vaches, mulets, même en charrette pour les personnes âgées et les enfants. Les autres marchaient à pied. La montée du col de Vars n’était pas gaie. Les obus claquaient de tous cotés. Par chance, il n’y eut pas de malheur » (témoignage de Mme André de Maurin cité par H. Béraud). Ceux qui possédaient des carrioles et charrettes purent emporter linge, effets et mobilier. Un dépôt provisoire avait été établi à la mairie de Vars. D’autres durent abandonner leurs biens dans des maisons qui seront bientôt pillées. Les habitants furent repliés sur le Lauzet et Seyne les Alpes. Le gros bétail put rester dans ces communes d’accueil. Les troupeaux de moutons, eux, furent, sur instruction des autorités civiles, dirigés vers Sisteron où les pâturages promis comme suffisants ne fournirent qu’une herbe rare et maigre consommée en moins de 15 jours. Ils durent ensuite descendre vers Manosque où les pâturages n’étaient guère meilleurs ; aussi, durant l’hiver, la mortalité fut élevée et les quelques bêtes amaigries qui survécurent ne purent être vendues qu’à bas prix.
Les goumiers, qui ont cantonné de Vars à Saint Paul de septembre à octobre, sont remplacés fin octobre par le bataillon FTP Ravel (Ardèche) qui occupe alors le col et le ‘‘Fort 2101’’ (Batterie de Vallon Claous). Un accrochage avec les Allemands a lieu le 1er novembre à Saint Paul : Fernand Giry et Guy Marion sont tués. Leurs corps sont ramenés et enterrés provisoirement au cimetière de Vars (actuellement plaques commémoratives au monument aux Morts du cimetière).
Après l’évacuation des populations, la haute vallée de l’Ubaye, de Saint Paul à Maurin, se trouve dans un no man’s land qui s’étend entre la frontière et la ‘‘tête de col’’ de Larche d’une part, tenues par les Allemands, et, d’autre part, une ligne Jausiers Tournoux Vallon Claous col de Vars tenue par les Américains et les Français. Durant cet hiver, ce no man’s land n’est parcouru que par les patrouilles des deux camps,… et les pillards. Régulièrement, les obus que s’échangent les adversaires au cours de sporadiques duels d’artillerie le survolent. Les conditions hivernales sont très dures pour les troupes cantonnées dans le secteur, comme en témoigne remarquablement, par ses dessins et aquarelles, Maurice Passemard dans son livre « Haute lutte » publié en 1989 par le SHAT (Service Historique de l’Armée de Terre).
Début 1945, une patrouille italienne incendie le hameau de Combrémond. Fréquemment, d’autres patrouilles italo allemandes franchissent le col du Vallonnet et gagnent par Fouillouse les villages de Serennes et de Saint Paul. Elles y passent la nuit, pillent ce qui leur plaît et s’en retournent au matin. Curieusement, et sans qu’aucune explication n’ait pu en être donnée, une partie du butin est abandonnée au col du Vallonnet, y pourrit sur place et sera retrouvée là, en piteux état, en avril 1945. Au début du printemps, les Allemands venus par Fouillouse minent et tentent de détruire les ponts du Châtelet sur la route de Fouillouse et du Riou Mounal à Saint Paul ; ils ne parviennent qu’à les endommager. Une patrouille de FFI arrivant de la Condamine ne peut qu’apercevoir de loin les sapeurs qui se replient.
Les adversaires mettent aussi à profit l’hiver pour se réorganiser. Ainsi, en Valle Stura (vallée du versant italien du col de Larche), se constitue le KampfGruppe germano italien « Maddalena » intégrant diverses unités allemandes et le 3e Granatieri « Littorio » dont le 1er bataillon tient le col de Larche. Cet ensemble est appuyé par un groupe d’artillerie de montagne et une unité de reconnaissance. Cette dernière unité, le Fusilier Bataillon 34 du Kavalier Regiment 6 est d’abord stationnée à Vinadio puis montera en ligne pour tenir la ‘‘tête de col’’ à la fin du mois de mars. Du coté français, la nouvelle armée d’amalgame se constitue. L’Ubaye est d’abord défendue par le II/99e RIA (Loire) et le II/69e RAA (détaché de la 4e DMM), puis, à la mi février, par le 5e régiment de dragons (27e division alpine) qui relève le II/99e. Le Détachement d’Armée des Alpes est créé le 1er mars 1945 et placé sous le commandement du général Doyen. Le front est réorganisé en trois secteurs : Nord, Centre et Sud. Le Secteur Centre, qui comprend l’Ubaye, est placé sous les ordres du colonel Francou, avec PC à Embrun. En Ubaye, le 5e dragons occupe toujours les lignes avancées et le I/141e RIA (Ubaye Vaucluse) finit de se constituer à partir du 159e RIA. Deux groupes de 75 (de 3 batteries chacun) du 69e RAA et un groupe mixte de 105 et 155 C du 1er RA (1re DFL) assurent le support d’artillerie, soit un total de 36 pièces. Le chef d’escadron Lepage du I/69e RAA commande le sous secteur Ubaye.

A la fin du mois de mars, les opérations de libération des Alpes sont envisagées. Le dégagement de Larche est planifié du 22 au 26 avril. Dès le 9 avril, le I/159e RIA réoccupe sans coup férir le quartier de Saint Paul et constate l’état de pillage indescriptible des maisons de Saint Paul, Serennes et des autres hameaux : placards et tiroirs vidés au milieu des pièces, mobilier saccagé, literie éventrée, photos de famille ayant servi de cibles,… L’église de Saint Paul a particulièrement souffert : excréments un peu partout, statues mutilées par des coups de feu, grand lustre brisé, autel et tabernacle saccagés, tombes profanées,… La rumeur publique accuse de ces exactions les FTP du 1er bataillon du régiment « La Marseillaise » qui ont séjourné en Ubaye en septembre 1944 (un rapport de patrouille de fin octobre signale déjà les faits) ; mais les patrouilles des deux camps ont dû, très certainement, au moins ‘‘se servir’’, si ce n’est perpétrer des actes de vandalisme, durant l’hiver où maisons et église sont restées ouvertes à tous vents. Après cette réoccupation militaire de la vallée, en vue de l’attaque sur Larche, il faut disposer d’observatoires bien situés. Le 15 avril, le lieutenant Hotton à la tête de la SES I/159e RIA, parti de Saint Paul, réussit à gagner de vitesse une section allemande et à s’emparer avant elle du plateau de Bouchiers (2 566 m). Redoutant de passer en cour martiale, l’aspirant allemand qui s’est ainsi fait ‘‘piquer’’ la place, déserte la nuit même et se constitue prisonnier auprès de l’équipage d’une camionnette de ravitaillement près de Saint Paul. Déserteur mais non pas traître, il ne dévoilera rien du dispositif germano italien. Une base de départ pour l’attaque sur Larche est alors préparée au dessus de Saint Paul dans le bois du Clot Boneti avec des matériaux récupérés aux granges des Meyres de Bouchiers et ceinturée d’un champ de mines de protection contre toute surprise. Le plan de l’attaque prévoit une action axiale sur Roche la Croix Saint Ours avec un mouvement d’enveloppement par les ailes, nord et sud, confié à des SES qui doivent se rejoindre à Larche et couper ainsi les arrières des défenseurs vers l’Italie. Le quartier de Saint Paul est concerné par l’action de l’aile Nord et, en partie, par l’attaque axiale.
Le 21 avril à 23 h, le groupement SES Nord du capitaine Silvani quitte Saint Paul (1 450 m) guidé par J. H. Reynaud. La progression est très difficile ; traversée de deux torrents avec de l’eau glacée jusqu’aux genoux, puis à partir de 2 000 m, une couche de neige atteignant par endroits 80 centimètres : les éclaireurs lourdement chargés s’enfoncent parfois jusqu’à la taille. Ils réussissent toutefois à passer inaperçus des guetteurs allemands de la Tête de l’Eyssilloun (2 896 m), mais ce n’est qu’à 7 h qu’ils atteignent le col du Vallonnet (2 524 m). Le contact est établi avec un groupe de protection du II/159e RIA (aspirant Collières) installé depuis 3 h du matin dans des conditions effroyables à la Tête de Plate Lombarde (2 609 m). L’observation de l’itinéraire qui va ensuite être suivi montre que les Baraquements de Viraysse semblent inoccupés. La SES 5/XV du lieutenant Canal prend la tête et fait la trace dans une neige molle et très pénible. Le groupe redescend ainsi dans le vallon du Riou du Pinet (Riou de la Peyrouse) à 2 210 m pour remonter par les Baraquements de Viraysse (qui sont en effet trouvés vides de tout occupant) jusqu’au col de Mallemort (2 558 m), où il ne parvient qu’à 9 h 30. A cette heure là, il devrait déjà être sur ses bases de départ, à proximité de Larche, pour l’attaque prévue à 10 h. Ainsi, le groupe Silvani (SES Nord) a une heure de retard sur l’horaire prévu. Le groupe Sud du lieutenant Delécraz est prévenu par radio et décide d’attendre pour lancer l’attaque. Les SES Nord descendent alors de Mallemort, d’une part par le Riou Tort (SES 5/XV lieutenant Canal), d’autre part par le ravin de Rouchouze (SES I/159e RIA lieutenant Hotton). Le plateau de Pré la Font est nettoyé au passage et 7 prisonniers y sont faits. A 11 h, les SES Nord apparaissent au dessus du village.

Le lieutenant Delécraz, au sud, lance alors son groupe à l’attaque. La surprise est totale et Larche est rapidement nettoyé. La SES I/159e RIA du groupement Nord part ensuite, avec ses prisonniers, pour investir la ferme du Colombier. Elle est accueillie par des rafales de MG. Pour briser cette résistance, un tir d’artillerie est demandé. Malheureusement, ce tir est mal ajusté et les coups trop longs pleuvent pendant plus de cinq minutes sur les éclaireurs jusqu’à ce que le lieutenant Delécraz s’aperçoive de l’erreur et commande par radio : « Halte au feu ! Cessez le tir ! ». Le bilan est lourd : un mort dans la SES (le caporal chef Aubert), 4 prisonniers tués et plusieurs blessés allemands et français dont le lieutenant Hotton. La SES Waintrop (3/XV) prend la relève et réduit la ferme fortifiée. Vers 20 h, le groupement de SES du capitaine Silvani, à la suite de la mauvaise interprétation d’un ordre radio repart, avec blessés et prisonniers, vers Saint Paul par le même itinéraire accidenté et difficile que celui emprunté la nuit précédente. Les éclaireurs parviennent à Saint Paul à 2 h du matin, totalement harassés. Outre le succès militaire remporté à Larche, il faut souligner l’exploit de volonté que représente ce périple aller retour, dans un tel délai et de telles conditions, sur le plan moral et physique.
Par ailleurs, l’attaque centrale sur le barrage Roche la Croix Saint Ours doit démarrer pour partie du plateau de Bouchiers en direction de Meyronnes et de Saint Ours. Un peloton formé par les 1re et 3e sections de la 3e compagnie du I/159e RIA (75 hommes environ commandés par le lieutenant Leuba) part de Saint Paul et, après 4 h de marche très difficile, atteint le plateau de Bouchiers. Un bivouac est établi un peu en dessous du sommet, coté Ubaye, dans des trous creusés dans la neige. Départ à 3 h, et au sommet les deux sections se séparent pour suivre chacune leur itinéraire d’approche. Quand cesse la préparation d’artillerie déclenchée à 6 h 40, la 1re section reconnaît la cabane et l’ouvrage Maginot de Serre la Plate (observatoire d’artillerie) qui s’avèrent vides. Elle renforce ensuite le peloton de l’adjudant chef Laurent du IV/5e régiment de dragons en difficulté devant la Grange de Gascon que la 3e section prend à revers. La ferme fortifiée est finalement enlevée, mais non sans pertes. Le peloton Leuba évite alors Meyronnes (qui sera brillamment conquis par l’escadron Guyot du I/5e RD) et va s’installer sur une crête rocheuse au dessus de Saint Ours. Le lendemain, 23 avril, à 5 h, avec prudence mais presque sans coup férir, il coiffe et occupe le village ainsi que l’ouvrage mixte de Saint Ours Haut. En fin de journée, avec le succès des opérations au centre et au sud du dispositif, la vallée de l’Ubayette sera de nouveau conquise et libérée. Coté Ubaye, quelques soldats allemands et italiens isolés errent encore dans la Haute Vallée. Ainsi, le 25 avril, les cinq cavaliers allemands du poste d’observation de la Tête de l’Eyssilloun qui n’ont pas mangé depuis deux jours viennent se rendre au groupe de combat du II/159e RIA qui stationne à Fouillouse, non sans s’être assurés au préalable qu’il ne s’agissait pas de troupes de couleur (« Schwarzen ») ! Certaines des unités qui viennent de libérer la région de Larche resteront encore une quinzaine de jours sur place, cantonnées principalement autour de Saint Paul.
Le bilan des pertes pour l’opération de reprise de Larche (22 24 avril) s’établit à 15 tués et 38 blessés côté français pour 34 morts et 150 prisonniers côté ennemi.
Ce n’est que fin mai 1945 que les habitants furent autorisés à revenir chez eux. D’abord, une seule personne par famille pour nettoyer les maisons pillées, puis, huit jours plus tard, l’ensemble de la population. Tous avaient hâte de reprendre les travaux des champs et de reconstruire ce qui avait été démoli ou incendié. En Ubaye et Ubayette, contrairement à la plupart des vallées alpines, il faut signaler que l’importance des champs de mines, leur dispersion et leur localisation souvent très approximative en l’absence de plans rendirent les travaux agricoles, y compris le pâturage dans les alpages d’estive, difficiles et dangereux. Plusieurs accidents seront à déplorer. La vie habituelle ne reprit donc que lentement et prudemment. Par mesure de sécurité pour les troupeaux, les barrages de barbelés furent, petit à petit, démantelés et laissés en tas sur place ou récupérés.
Les paroissiens de Saint-Paul avaient, quant à eux, fait le vœu, le 11 juin 1944, d’élever une statue à leur saint patron en implorant sa protection. La statue votive érigée à l’entrée du village fut bénie en présence de toute la population à l’issue de la messe dominicale du 5 septembre 1948.
Les ouvrages de la Haute Vallée ne furent ni réoccupés ni entretenus. Laissés à l’abandon, plus ou moins pillés, ils ne servirent au mieux que de cibles et d’objectifs lors des exercices et manœuvres des troupes cantonnées alentour à Jausiers et Barcelonnette. Le temps qui passa et les intempéries firent leur œuvre et les dégradèrent lentement. Certains servent encore d’abri aux bergers. Le PO de Plate Lombarde a pu toutefois être, depuis peu, sauvegardé par l’Association des Fortifications de l’Ubaye, après avoir été, comme les ouvrages de Saint Ours et de Roche la Croix, concédés au SIVOM de la vallée de l’Ubaye.

De nos jours, la haute vallée de l’Ubaye, malheureusement quelque peu dépeuplée, est un paradis pour les touristes, randonneurs et amateurs d’escalade ou de flore et de faune alpines. Ici et là, les petits ouvrages plus ou moins ruinés, les traces et stigmates des combats et de l’exil des habitants pendant de longs mois sont encore visibles pour qui sait ouvrir les yeux et regarder avec son cœur. Mais qui a encore à l’esprit cette tranche d’histoire ? Alors, passant, en admirant en toute liberté les sites enchanteurs et les paysages merveilleux de la Haute Vallée, souviens toi, ne serait ce qu’un instant, que ces moments de pur bonheur, tu les dois, au moins en partie, au courage et aux sacrifices de ces combattants et de ces habitants de la Haute Ubaye.

La vallée de l’Ubayette, prolongeant celle de l’Ubaye à l’est vers l’Italie, a de tout temps constitué la voie naturelle de passage vers le Piémont par le col de Larche (1 991 m) ou colle de la Maddalena pour les Italiens (également appelé autrefois col de l’Argentière du nom de la première bourgade côté italien : Argentera).
Selon une tradition incertaine (et très improbable), les troupes d’Annibal et ses éléphants auraient franchi les Alpes, entre autres, par le col de Larche. A cette même époque, de façon beaucoup plus certaine, il semble que ce soit le général romain Turnus, envoyé par Rome en 219 avant J.C., qui ait donné son nom au site de Tournoux, idéalement placé du point de vue militaire, pour contrôler les voies de communication, au confluent de l’Ubaye et de l’Ubayette.
Dès lors, la zone Ubaye Ubayette et le col de Larche conserveront une importance stratégique et militaire indéniable et verront successivement les invasions des Lombards (défaits aux Gleizolles en 571) ou des Sarrasins (chassés de la région en 972), le passage des troupes de François Ier en route pour Marignan (1515), puis les guerres de Religion, la poursuite des Vaudois et la guerre de la Ligue d’Augsbourg.
En septembre 1692, Louis XIV dépêche Vauban en Ubaye pour mettre en place une première organisation de défense vis à vis des possibilités de franchissement des passages alpins. La construction des premières places fortes, selon le tracé de la frontière de l’époque, est lancée : Mont Dauphin, Saint Vincent les Forts, Seyne, Colmars et Entrevaux. En Haute Ubaye, Catinat décide la construction de redoutes que Richerand, son ingénieur, faute de crédits ne peut réaliser qu’en terre et fascines (vestiges près de Tournoux). Les redoutes en maçonnerie ne seront construites que plus tard (1707 1709) sous les ordres de Berwick qui a notamment laissé son nom attaché à celle située près des Gleizolles.
Les troupes franchiront encore bien souvent par la suite le col de Larche : en 1744 lors de la guerre de Succession d’Autriche, puis celles de Kellerman en 1792 93 et enfin celles de Bonaparte lors des campagnes d’Italie.
Par la suite, en 1826, la nécessité de fortifier la haute vallée de l’Ubaye est clairement affirmée, mais ce n’est qu’à la suite de l’inspection du Général Haxo en 1836 que l’édification du Fort de Tournoux est décidée. Ce projet qui est une pleine application des principes de Montalembert rencontre bien des difficultés : dénivelé du terrain, instabilité du sol, restriction de crédits,… La construction commencée en 1843 ne s’achèvera qu’en 1865 et le fort continuera à être modifié jusqu'en 1936.
Le Fort de Tournoux : hier et aujourd’hui.





5e Batterie du 154e RAP à Tournoux. Insigne métallique et fresque de la devise peinte sur un mur du mess des officiers du Fort Moyen.


Avant même son achèvement, la crise de l’obus torpille, en 1858, remet en cause l’aménagement du Fort de Tournoux. Mais, ce sont surtout les enseignements de la guerre de 1870, les progrès de l’artillerie rayée, et la formation de la Triplice (Allemagne, Autriche et Italie) en 1882 qui démontrent la nécessité de compléter en profondeur les défenses du passage de Larche et de la haute vallée de l’Ubaye. Ainsi, le général Séré de Rivières préconise la réalisation de nombreux ouvrages selon le système qui porte son nom et qui seront construits sur les hauteurs dans ce secteur entre 1879 et 1895 : au dessus du Fort de Tournoux, la Batterie des Caurres (1879 1883) et le Fortin du Serre de l’Aut (1890 1893)
- commandant le passage du col de Larche et situées de part et d’autre de l’Ubayette : sur la rive droite, les Batteries de Mallemort et de Viraysse (1885 1888), cette dernière complétée de son casernement (1887 1890) ; sur la rive gauche, les Redoutes et Batteries de Roche la Croix inférieure et supérieure (1884 1890) contrôlant les débouchés de la vallée de Maurin et du col de Vars, la Batterie de Vallon Claous (1880-1885) en aval de Tournoux, la Batterie de Cuguret (1885 1888), puis un second verrou au niveau de Saint Vincent les Forts (Redoute de Chaudon, Batteries du Châtelard, de la Tour et du col Bas) de nombreuses tours de guet, observatoires, relais optiques, abris et petites fortifications s’ajoutent à cet ensemble. Enfin, le système de la Haute Ubaye est renforcé entre 1896 et 1904 par celui de la Haute Tinée avec le Casernement ou Fortin de Restefond, la position du mont des Fourches (3 Batteries et 3 Blockhaus), le Fortin de la cime de Pelousette, celui de Las Planas ou Tête de Vinaigre et enfin le Camp des Fourches.
Après la première guerre mondiale, la défense des Alpes doit à nouveau être revue face à la montée du nationalisme italien et en raison des revendications territoriales de Mussolini. La vulnérabilité du massif alpin s’est accrue du fait de l’amélioration des voies de communication et de la motorisation des armées. Ainsi le rapport du 12 février 1929 de la Commission de Défense des Frontières (CDF) préconise de protéger la Route des Alpes et d’interdire toute pénétration en créant des zones fortifiées aux points de passage les plus aisés pour l’ennemi potentiel ; ces zones fortifiées s’appuieront sur les massifs montagneux impraticables, au moins par les troupes motorisées, en raison de l’altitude, massifs montagneux qui seront, eux, défendus par des éléments d’intervalle, spécialisés, légers et mobiles (les SES, Sections d’Eclaireurs Skieurs).
En Ubaye, la CDF puis la CORF (Commission d’Organisation des Régions Fortifiées) prévoient un important barrage fortifié face au col de Larche et, pour éviter son contournement par le sud (reprenant en cela certains principes retenus antérieurement dans le système Séré de Rivières), un centre de résistance au Restefond, position charnière entre la défense de l’Ubaye et celle de la Tinée. Aussi parle t on le plus souvent du barrage fortifié de Larche Restefond.
Dans la zone de Larche, le barrage est constitué de gros et petits ouvrages (GO et PO) complétés d’avant postes (AP) et de points d’appui (PA). Le verrou principal se situe au niveau de Meyronnes Saint Ours, de part et d’autre de l’Ubayette et de la RN 100, à une dizaine de kilomètres du col de Larche.

En juin 1940, le barrage fortifié Maginot est l’épine dorsale du dispositif défensif français au col de Larche. Il verrouille la vallée de l’Ubayette à hauteur de Meyronnes avec les gros ouvrages de Roche la Croix et du Haut de Saint Ours, le petit ouvrage du Bas de Saint Ours, les abris du Nord Est de Saint Ours et de Fontvive, et l’ouvrage observatoire d’artillerie de Serre la Plate. Cette ligne d’ouvrages représente la Ligne Principale de Résistance, prolongée au nord par le PO de Plate Lombarde (puis par les PA de Fouillouse Haut et du Châtelet) et au sud par les ouvrages du secteur de Restefond. En avant de la Ligne Principale de Résistance se situe la Ligne des Avant Postes (Larche Viraysse) avec au delà, jusqu’à la frontière, des éléments de surveillance, d’observation et de retardement (SES).
Sur le plan de l’organisation en juin 1940, dans le cadre du XIVe CA et plus particulièrement du secteur fortifié Dauphiné (SFD) et de la 64e DI, la vallée de l’Ubayette constitue le quartier Ubayette (ou Meyronnes, où est établi le PC du commandant Gaudillot 83e BAF) du sous secteur Ubaye Ubayette (lieutenant colonel de Dinechin, PC Batterie XII au Fort de Tournoux) rattaché au secteur Ubaye (colonel Dessaux). Les troupes affectées à ce quartier sont des troupes de forteresse (83e BAF), des artilleurs (114e RALH, 162e RAP et 293e RALD), des éléments du génie (4/440 pionniers et compagnie 2/216 génie), du train (compagnies muletières et d’autocars) et des transmissions.











Dominant la rive gauche de l’Ubayette, c’est un ouvrage d’artillerie construit entre 1931 et 1936 sur l’emplacement de l’ancienne redoute Séré de Rivières (1884 1889) qui est alors en grande partie rasée. Il est complété en surface par deux casernements et un bâtiment infirmerie de temps de paix. Il est relié à la vallée de l’Ubayette par un téléphérique dont la recette inférieure est implantée près du confluent avec l’Ubaye et qui est prolongé entre la recette supérieure et l’ouvrage par une voie de 60 sur une longueur de 800 m.
Il compte six blocs de combat pour un équipage de 161 hommes dont 6 officiers et 28 sous officiers commandés par un capitaine :
B1 entrée mixte avec plan incliné (treuil), deux FM 24/29
B2 deux FM 24/29 et un mortier de 50 Mle 35
B3 idem B2
B4 une cloche d’observation VDP et une cloche GFM
B5 à trois niveaux dont deux comportent l’armement :
Étage supérieur : une tourelle éclipsable pour jumelage de 75 Mle 33, deux mortiers de 75 Mle 31 et un FM
Étage intermédiaire : deux mortiers de 81 Mle 32
B6 destiné à recevoir des projecteurs (non installés), équipé d’une cloche d’observation et d’un mortier de 50 Mle 35
L’usine est équipée de 3 groupes CLM de 75 CV chacun et d’un groupe auxiliaire de 8 CV.
Par ailleurs, l’ouvrage est le PC artillerie du quartier Ubayette pour le groupe A2 commandé par le capitaine Fabre du 162e RAP.
L’ouvrage de Roche la Croix a pour rôle principal l’interdiction de la route du col de Larche et des cols frontière (du col de la Gypière au vallon du Lauzanier) et le flanquement des ouvrages de Saint Ours.
Position de Résistance Roche la Croix Saint-Ours.




Vue


Situé rive droite de l’Ubayette, en vis à vis de l’ouvrage de Roche la Croix, il en assure le flanquement et contribue à l’interdiction de la route du col de Larche. C’est un ouvrage mixte infanterie artillerie construit entre 1930 et 1936. Il comporte cinq blocs pour un équipage de 232 hommes dont 11 officiers, commandé par un capitaine : B1 entrée mixte à pont à bascule par en dessous et plan incliné avec une cloche GFM, une cloche lance grenades Mle 34 (unique en Ubaye) dont le mortier de 50 n’était pas en place en 1940 en raison de l’expérimentation en cours d’une nouvelle embrasure de sommet dite ‘‘en diabolo’’, et un créneau pour jumelage de mitrailleuses Reibel de 7, 5 mm

- B2 armé de deux mortiers de 81 Mle 32, un mortier de 75 Mle 31, un mortier de 50 et un jumelage de mitrailleuses Reibel B3 et B4 avec une cloche GFM chacun B5 présente trois niveaux dont deux abritent l’armement
Étage supérieur : trois JM + deux FM + une cloche GFM
Étage intermédiaire : deux mortiers de 81 Mle 32 + un mortier de 50
L’usine est équipée de deux diesels Renault de 77 CV chacun et d’un moteur auxiliaire de 8 CV de type 1 P5 65.
L’ouvrage est complété en surface d’un casernement de temps de paix.




Bloc B5.
Selon la menace du colonel Dessaux, les jumelages de mitrailleuses de ce bloc auraient dû se charger de renvoyer sur leurs positions les servants des 150 T de Viraysse en cas d’un nouvel abandon de leurs pièces.
Il s’agit de deux abris dits Nord Est de Saint Ours et Nord Ouest de Fontvive. Ces deux ouvrages sont identiques, de type abri caverne du Sud Est (infanterie), avec deux blocs entrée et un bloc cheminée/aération (B1 entrée avec une cloche GFM et un créneau FM, B2 entrée avec un créneau FM). Pour chaque abri, l’effectif est de 57 hommes.


Pour compléter l’interdiction de la route du col de Larche, près de celle ci, au fond de la vallée, se situe un petit ouvrage d’infanterie constitué d’une casemate bétonnée à deux niveaux. C’est un ouvrage à bloc unique, avec entrée par passerelle amovible, fortement armé : trois cloches JM, deux cloches GFM, six créneaux FM et un mortier de 50. L’effectif est de 66 hommes commandés par le lieutenant Jubelin. A proximité se trouve le casernement de temps de paix.

Le Petit Ouvrage (PO) d’infanterie de Saint Ours Bas, près de l’Ubayette, au bord de la RN 100, contrôle le fond de la vallée et prend en enfilade la route du col de Larche.




Cet ouvrage implanté un peu en aval et au dessus de Meyronnes dans le bois de la Rochaille a été construit entre 1931 et 1938. Il comporte un Bloc Entrée (un FM + cheminée/aération) et un Bloc Observatoire d’artillerie. Ce dernier est équipé d’une cloche d’observation modèle allégé (10 cm de blindage au lieu de 20) en éléments vissés les uns sur les autres, de type 2, à 3 créneaux de type GFM « A » recevant le bloc jumelle D (x 8). Il bénéficie de plus d’un équipement infrarouge pour vision nocturne très en avance pour l’époque. Placé exactement dans l’axe de la vallée de l’Ubayette avec vue directe jusqu’au col de Larche, il assure le réglage des tirs non seulement des ouvrages de Roche la Croix et du Haut de Saint Ours mais aussi du groupe d’artillerie A2 (quartier Ubayette ou Meyronnes) et de diverses batteries du groupe A3 d’action d’ensemble. Autour de l’ouvrage, les vestiges du réseau de barbelés sont encore bien visibles. A proximité, se trouve également une citerne en béton ainsi qu’une table d’orientation.



:
l’égide de l’Association des Fortifications de l’Ubaye.
La Ligne des Avant Postes, à environ 5 kilomètres en avant des ouvrages Maginot de la Ligne Principale de Résistance, s’articule selon un axe Larche Viraysse perpendiculaire à l’axe de pénétration de l’ennemi potentiel par les cols de Larche, des Monges et de Sautron. Cette ligne comporte deux avant postes proprement dits (AP) à Larche et à Viraysse et une série de points d’appui (PA). Elle est tenue principalement par la 2e compagnie du 83e BAF commandée par le capitaine Guérin puis le capitaine Bertrand Comiteau dont le PC est à l’ouvrage d’avant poste de Larche.

Rive gauche de l’Ubayette, deux PA ont été organisés : ce sont en fait des fortifications de campagne en terre et rondins. L’un se situe à 200 m environ du village de Larche près de la rivière d’où son nom de PA de l’Ubayette ; il est tenu par l’adjudant Simi avec une vingtaine d’hommes de la 1re section de la 2e compagnie du 83e BAF. L’autre a été établi sur la crête de Fontcrèze dans le bois de la Lauze, face à Malboisset ; il doit servir comme ‘‘ouvrage’’ de repli à une partie de la 2e section du sergent chef Coupez qui occupe initialement avec ses 25 hommes une position avancée (tranchées protégées de barbelés) devant Maison Méane.


Cet AP est constitué par un ouvrage bétonné construit par la MOM entre 1931 et 1935 situé sur une éminence dominant le village de Larche sur la rive droite de l’Ubayette . Il comporte six petits blocs :
B1 entrée à 4 créneaux FM
B2 et B3 (identiques) mitrailleuse Hotchkiss et créneau FM
B4 créneaux FM et entrée/sortie de secours
B5 observatoire + créneau FM + sortie de secours
B 6 cheminée/aération

Armement total : deux mitrailleuses et quatre FM.
En surface, non relié par souterrain, il est complété entre les blocs B2 et B3 d’un abri béton et tôle métro à très large embrasure (date de construction au linteau : 7. 7. 39) pour un canon ‘‘antichar’’ : en fait un 47 de marine sur affût crinoline tirant des obus pleins en plomb chemisés d’acier avec une portée de 500 m !
En arrière de l’entrée de cet ouvrage, se trouvent un petit casernement de temps de paix et un emplacement bétonné en cuve rectangulaire pour deux mortiers
En juin 1940, cet AP est tenu par 34 hommes de la 1re section de la 2e compagnie du 83e BAF. Il est commandé par le sergent chef Henri Dunand qui remplace le lieutenant Thullier appelé à l’état major.
Ouvrage d’avant poste de Larche.
Casemate du canon de 47.
La pièce prend en enfilade la route du col de Larche. L’embrasure de la casemate présente au linteau, côté intérieur, un cartouche portant gravé sur trois lignes : 7.7.39 / 73e BAF / V.A. G.M. et une dernière ligne illisible.




Au dessus de l’AP, au nord ouest, en direction de la ferme du Colombier, se trouve un curieux rocher, qui mérite bien son nom, aménagé pour abriter trois hommes : un caporal, un tireur FM et un observateur. Il constitue le PA de la Ferme du Colombier. La ferme elle même n’est pas fortifiée. Par contre, les occupants germano italiens en feront un point de résistance coriace à la libération en avril 1945.
Le
Le
Ce PA désigné par sa cote d’altitude se situe au nord de Larche et domine le ravin de Rouchouse (ou Rouchouze) face à Tête Dure. Il consiste en un abri béton et tôle métro pour personnel (inachevé), complété de deux emplacements (terre et rondins) pour mitrailleuse Hotchkiss. Le groupe d’une vingtaine d’hommes de la 3e section de la 2e compagnie du 83e BAF, commandé par l’adjudant chef Nectoux, dispose également de trois FM.
Ce PA est désigné comme le précédent par sa cote d’altitude, mais il est aussi appelé PA des trois mélèzes. Situé sur les premiers contreforts de la Tête de Viraysse, il domine l’angle droit que forme le ravin de Rouchouze lorsque le torrent qui coule initialement est/ouest oblique brusquement pour s’orienter nord/sud. A ce niveau, au fond du ravin, un barrage de mines et de barbelés a été érigé. Le PA est constitué d’un abri pour personnel en béton et tôle métro avec deux appendices bétonnés recevant chacun une mitrailleuse Hotchkiss et dont les créneaux de tir prennent respectivement en enfilade chacun des axes évoqués précédemment. Des emplacements FM extérieurs sont protégés par des murettes de pierres sèches. La vingtaine d’hommes (3e section également) commandés par le sergent chef Griennay occupe une position d’une importance majeure au débouché des cols de Sautron et des Monges. Ils peuvent battre avec leurs deux mitrailleuses et leurs trois FM les deux axes du torrent, le barrage barbelé miné qu’il domine, et, face à eux, sur les pentes de Tête Dure, le plateau de Pré la Font.

 Viraysse Col de Sautron
Viraysse Col de Sautron


L’ancienne batterie Séré de Rivières construite entre 1885 et 1888 au sommet de la Tête de Viraysse à 2 772 m d’altitude a été érigée en avant poste. Du fait de son altitude, il est classiquement admis qu’elle serait très difficile à attaquer. En tout cas, comme cette position commande le torrent de Rouchouze et la vallée de l’Ubayette (Larche) d’une part, et le Riou du Pinet (Riou de la Peyrouse) qui débouche sur Meyronnes d’autre part, son maintien est donc vital pour tenir la Ligne des Avant Postes. C’est également un observatoire de tout premier ordre sur les cols frontière et le seul qui ait une vue directe sur l’Italie. Cependant, malgré l’importance clé de cet AP, les troupes qui lui sont affectées sont très réduites : la SES bis 83e BAF, des observateurs d’artillerie (114e RAL) et les servants de 4 mortiers de 150 de tranchée (II/162e RAP) installés à quelques dizaines de mètres des bâtiments de l’ancienne batterie ; au total une quarantaine d’hommes aux ordres du lieutenant Duittoz (162e RAP). La SES bis 83e BAF commandée par le sergent chef Augier (en remplacement du sous lieutenant Grimaldi) est la seule SES qui ait reçu une mission statique de résistance ferme sur ses positions. Pour une telle mission, l’ancienne batterie a pour inconvénient majeur de ne présenter que peu de possibilités de défense depuis l’intérieur (quasi absence d’ouvertures pouvant servir de créneaux de tir). Pour tirer sur l’assaillant, il faut monter sur les superstructures, à condition que celles ci ne soient pas déjà sous le feu de l’ennemi et neutralisées par un tir plongeant venant en particulier des rochers du sommet de la Meyna qui surplombent la batterie de plus de 300 m !















La Batterie de Viraysse prévue par le génie au Plan de Défense 1872 1890 (Système Séré de Rivières) s’intègre à l’ensemble fortifié dit organisation défensive de l’Ubaye. C’est un ouvrage de surveillance, ouvrage détaché de la position de Tournoux.
Les travaux de terrassement commencent en 1884 avec l’arasement du sommet de la Tête de Viraysse ; on construit ensuite la « Route stratégique », piste d’abord chariotable et plus tard carrossable, remontant depuis Saint Ours le Riou de la Peyrouse (Riou du Pinet aujourd’hui) puis le vallon de Viraysse (dans certains virages, le pavement de dalles de schiste et les murs de soutènement en pierres sèches sont toujours visibles). Une carrière est ouverte à gauche de la piste un peu avant le col de Viraysse pour en extraire les pierres de taille nécessaires à la construction de l’enceinte et des bâtiments (dans la carrière, nombreuses inscriptions gravées dans le rocher).
Les plans initiaux prévoient que la batterie ne sera occupée qu’à la belle saison par une garnison réduite à un officier et 16 hommes. Cette première construction est réalisée entre 1885 et 1889. En 1892, le général baron Berge préconise l’occupation permanente des ouvrages alpins, y compris des postes les plus élevés. En conséquence, en 1893 1894, les bâtiments de la batterie sont agrandis avec la création de deux grandes casemates et de divers locaux de service, permettant d’héberger ainsi une cinquantaine d’hommes. Par ailleurs, entre 1887 et 1889, la batterie avait déjà été complétée par une caserne dite « Baraquements de Viraysse » située en contre bas, un peu en dessous du débouché du col de Mallemort, à 2 500 m d’altitude.
La batterie se présente comme une enceinte maçonnée polygonale avec trois protubérances rectangulaires, sans fossé (sauf à l’entrée : haha, avec pont levis). L’entrée, avec grille défensive, ouverte sur le coté d’un bastionnet crénelé, donne accès à une cour bordée par la façade de la casemate centrale initiale qui a été ensuite remaniée et qui comporte : logements pour officier et sous officiers, cuisine avec four à pain et fourneau à réservoir n° 0bis Vaillant daté 1893, deux citernes, magasin à vivres, magasin à poudre, soutes à munitions,… Dans la cour, latrines Goux (une place) en acier galvanisé, à fosse mobile, surnommées ‘‘omnibus’’. De la casemate centrale, voûtée en berceau surbaissé, part un couloir escalier en baïonnette qui conduit aux deux grandes casemates logements pour la troupe qui ont été rajoutées, de forme rectangulaire, couvertes d’une dalle de béton sur poutres d’acier. Les casemates supportent le terre plein de la batterie qui est à ciel ouvert, et auquel on accède soit par un plan incliné passant devant la façade des casemates soit par un petit escalier à voûte bétonnée. Ces dessus comportent un abri de piquet Entre le col de Mallemort et la Batterie, le sentier dit du vaguemestre évite les lacets de la piste, en suivant la crête nord ouest de la Tête de Viraysse à travers les rochers ; on y voit encore les vestiges d’un garde fou constitué de piquets métalliques et d’un petit filin d’acier et ceux du balisage d’hiver avec des poteaux de type télégraphique (de 3 m de haut environ) tendus de 3 hauteurs de fil de fer permettant ainsi le repérage et le guidage selon la hauteur de neige.
Armement : en 1914, il aurait été constitué de 6 x 95 Lahitolle alors que selon d’autres sources (Histoire militaire de la Vallée de l’Ubaye, ‘‘Orages sur l’Ubaye’’, conférence faite aux Officiers en mars 1938 par le colonel Dessaux commandant de la Vallée), il aurait été « probablement de 2 x 95 ».
Casernement construit de 1887 à 1890 en complément de la Batterie de la Tête de Viraysse, son nom de « Baraquements » lui viendrait du caractère épisodique et saisonnier de son affectation, car destiné à héberger des unités mobiles (muletières) de chasseurs alpins ou d’infanterie alpine. Il permettait de loger un fort détachement (environ 150 hommes) et son train de mulets.
Il se présente comme une vaste enceinte rectangulaire cantonnée sur deux angles opposés par deux petits bâtiments rectangulaires jouant le rôle de caponnières ou de bastionnets. Cinq bâtiments adossés à l’enceinte bordent une grande cour centrale. Ils sont en rez de chaussée et couverts d’un toit d’ardoises à deux pans. Seul l’un d’entre eux présente trois niveaux : sous sol, rez de chaussée et étage en comble habitable. L’approvisionnement en eau est assuré par une citerne dans l’un des bâtiments et le captage d’une source au fond du vallon de Viraysse (dans l’éboulis entre les Baraquements et le col de Viraysse). L’entrée est « protégée » du couloir d’avalanche par une levée du terrain au flanc de laquelle se trouve un petit abri. A proximité, on distingue également deux terre pleins parfaitement aplanis, l’un circulaire, l’autre rectangulaire.
On peut voir aussi, à gauche de la piste en descendant vers Saint Ours, à la hauteur de l’embranchement du sentier qui part vers le col du Vallonnet, les vestiges d’un emplacement d’artillerie qui commandait les débouchés dans le vallon de Viraysse. On y distingue encore les ruines d’un bâtiment (murs arasés à 30 cm du sol, nombreux débris d’ardoises de schiste,…), et une plate forme terrassée avec un trou d’observateur à paroi étayée de pierres sèches.

Pour le quartier Ubayette, le soutien d’artillerie, composante essentielle de la ligne de défense complétant les ouvrages, est assuré, d’une part par le groupe A2 adapté au quartier Meyronnes, et d’autre part par le groupe A3 d’action d’ensemble. Les artilleurs de ces groupes appartiennent au II/162e RAP, II/114e RALH (RALCA) et V/293e RA (RALD).
Il regroupe 19 pièces : 2 x 75 Mle 33 (Tourelle) 2 x 75 Mle 31 Ouvrage de Roche la Croix 2 x 81 Mle 32 4 x 81 Mle 32 Ouvrage du Haut de Saint Ours 1 x 75 Mle 31 4 x 75 Mle 97 à Fontvive 4 x 105 L Mle 13 à Meyronnes
PC artillerie du groupe A2 à Roche la Croix, capitaine Fabre du 162e RAP. N.B. : le 47 de marine de l’AP de Larche n’est pas comptabilisé.
Il regroupe 36 pièces : 6 x 155 L Mle 77 de Bange, aux Caurres (4) et à Roche la Croix (2 à la Charbonnière près du Fort Supérieur) 12 x 155 C Schneider Mle 17, aux Gleizolles, à Saint Ours, à Roche la Croix (Ancien camp) et à Tournoux 12 x 105 : huit 105 L Mle 13 aux Gleizolles et au Châtelard, quatre 105 C Saint Chamond aux Gleizolles 2 x 95 sur affût de côte à Tournoux (Batterie XII) 4 x 150 T à Viraysse
PC artillerie du groupe A3 au Fort Moyen de Tournoux, capitaine Rigaud du 293e RALD.
L’artillerie bénéficie de nombreux observatoires très bien situés : Viraysse, Serre la Plate, la Duyère, Roir Alp,… En outre de nombreux objectifs et zones sensibles ont été répertoriés et leurs coordonnées mémorisées et codées ; ainsi, il suffira que les observateurs donnent un simple code pour qu’un tir extrêmement précis s’abatte quelques secondes plus tard sur l’objectif désigné. Les transmissions sont donc essentielles. Cent soixante deux kilomètres de lignes téléphoniques ont été tirés et enterrés pour le secteur Ubaye Ubayette. Peu de lignes seront touchées par les tirs d’artillerie ennemis ; seul l’AP de Viraysse se retrouvera sourd et muet, pendant plus de vingt quatre heures, les 22 23 juin, après la destruction du câble téléphonique enterré et surtout du fait d’une erreur de clé dans le système de cryptage des messages radio.
Face à l’armée des Alpes, les Italiens ont concentré des troupes en nombre constituant le groupe d’armées Ouest ; commandé par le Prince Umberto de Savoie, il comprend, du mont Blanc au mont Viso, la 4e armata (général Guzzoni) et, de l’Ubaye à la Méditerranée, la 1re armata (général Pintor). La 7e armata, en réserve, ne sera pas engagée.
La tension commence à monter sur la frontière des Alpes au mois de mai 1940 : les unités alpines piémontaises sont renforcées ou relevées par des unités du centre et du sud de l’Italie et, surtout, les GaF, qui n’hésitaient pas à fraterniser avec les SES lorsqu’ils se rencontraient lors de patrouilles aux cols frontière, sont remplacés ou renforcés par des Légions de Chemises Noires qui accueillent maintenant les chasseurs alpins tout autrement, aux cris de « Savoia a noi, Corsica a noi, Nizza a noi !!!! ».
Le 10 juin, du haut du balcon du palais Venezia, Mussolini avec grandiloquence annonce l’entrée en guerre de l’Italie. La ‘‘Bataille de France’’ contre les Allemands est déjà perdue et le gouvernement français se replie vers Tours. Le Duce s’engage ainsi dans la guerre ‘‘à la vingt cinquième heure’’ en supputant que quelques gains de terrain même minimes et supposés faciles lui permettront de participer aux négociations de paix aux côtés des Allemands et de voir ses revendications territoriales satisfaites à bon compte.
Dans un premier temps, toutefois, on constate le fait bien singulier que l’assaillant se met sur la défensive, conformément à une directive du Stato Maggiore Regio Esercito (SMRE, état major de l’armée royale) en date du 7 juin : « En cas d’hostilités, aucune action ne doit être entreprise au delà des frontières. Nos troupes et notre artillerie ne doivent pas ouvrir le feu les premières sur des troupes ou des positions françaises, mais doivent se limiter à réagir contre des actions adverses. » De même du côté français, le 10 juin, le gouvernement et le Haut Commandement, persuadés que l’Italie n’engagera pas les hostilités, notifient l’interdiction réitérée de ne prendre en aucun cas l’initiative. Ainsi, du 10 au 14 juin les actions de part et d’autre restent très limitées.
Le 14 juin, sous la pression de Mussolini, l’ordre 1601 du SMRE fait passer les troupes italiennes de la défensive à une ‘‘attitude pré offensive’’ en stipulant de mener « de petites actions offensives destinées non seulement à accrocher les forces adverses et à maintenir élevé l’esprit agressif de nos troupes, mais aussi à nous donner des positions, au delà de la frontière, susceptibles de faciliter le débouché d’offensives de plus grand style ».
Le lendemain, 15 juin, le Duce convoque le maréchal Badoglio et lui ordonne de déclencher l’attaque générale le 18 juin. Badoglio rappelle qu’il faut 25 jours pour passer de la défensive à l’offensive et qu’il lui paraît inopportun d’attaquer un pays déjà vaincu. Ce à quoi Mussolini rétorque que « la décision d’attaquer la France est une question politique et [qu’il est] le seul à en avoir la décision et la responsabilité ». Passant outre à ces réserves, Mussolini s’adresse alors directement au maréchal Graziani, chef d’état major général, en concédant toutefois que l’offensive se limite à deux opérations localisées (Petit Saint Bernard et Larche) et qu’elle soit repoussée au 26 juin.
Cependant, dès le 16 juin, compte tenu de l’évolution extrêmement rapide sur le front côté allemand, l’état major italien ordonne au groupe d’armées Ouest de prendre résolument l’offensive avec un délai maximum de dix jours pour déclencher les opérations suivantes :
Opération ‘‘B’’ : Petit Saint Bernard Opération ‘‘M’’ : col de la Maddalena (Larche) Opération ‘‘R’’ : Riviera.
L’Opération ‘‘B’’ est confiée à la 4e armata avec pour objectifs la Tarentaise et la Maurienne et la jonction avec les Allemands à Chambéry d’une part, Briançon puis Grenoble par le Lautaret d’autre part, et enfin jonction avec l’Opération ‘‘M’’ par la haute Durance et le Queyras jusqu’à Mont Dauphin.
Les Opérations ‘‘M’’ et ‘‘R’’ sont confiées à la 1re armata. Il s’agit d’une manœuvre en tenaille : l’Opération ‘‘M’’, menée par le IIe corpo d’armata, doit, après avoir franchi le col de Larche, s’emparer de la vallée de l’Ubaye puis celle de la moyenne Durance ; l’Opération ‘‘R’’ doit, elle, avancer sur Nice puis suivre la côte. L’objectif final des deux opérations est de refermer la tenaille sur Marseille. La manœuvre est classique visant à « déborder par les ailes et prendre à revers le système fortifié français » et à « exploiter avec décision le succès en profondeur ».
Face au secteur Ubaye, se trouve donc massé le IIe corpo d’armata (général Bettini) qui doit mener l’Opération ‘‘M’’. Il comprend le 2e Raggrupamento Alpini (Varaïta Pô) renforcé d’éléments de la GaF (Queyras et tête de l’Ubaye), la 4e division alpine « Cuneense » (1er et 2e RI Alpini, 4e RAM ; général Ferrero) (Haute Ubaye), la 36e division d’infanterie « Forli » (43e, 44e et 343e RI, 36e RA ; général Perugi) (Ubayette : cols de Sautron et des Monges), la 33e division d’infanterie « Acqui » (17e, 18e et 317e RI, 33e RA ; général Sartoris) renforcée du XXIIIe CCNN (Chemises Noires) (Ubayette : col de Larche), la 5e division alpine « Pusteria » (7e et 11e RI Alpini, 5e RAM ; général Amedeo de Cia) (face au massif Restefond Les Fourches, du vallon du Lauzanier au col du Fer), avec de plus, en deuxième échelon, la 4e division d’infanterie « Livorno » (33e et 34e RI, 28e RA « Monviso » ; général Gioda) et enfin la 16e division alpine « Pistoia » (général Mario Priore) en réserve à Bersezio avec un groupement motorisé. Soit en première vague, 5 divisions regroupant 37 bataillons avec 302 pièces d’artillerie : sur tout le front des Alpes, c’est la masse d’attaque la plus importante. En face, l’armée des Alpes ne dispose dans le secteur Ubaye que de l’équivalent de 4 bataillons dont deux de forteresse (pour la plupart de série B, c’est à dire de réserve), de 7 SES et de 100 canons. Le rapport des forces est donc de 9 à 1 pour l’infanterie et de 3 à 1 pour l’artillerie.
Le plan d’attaque du général Bettini est le suivant : occuper à l’aile droite dans un premier temps (Jour J : 22 juin) la Haute Ubaye et la « conque » de Maurin pousser ensuite (Jour J + 1 : 23 juin) d’une part au centre sur Larche et Meyronnes en débordant les défenses de Viraysse et de Tête Dure (?!), agir d’autre part à l’aile gauche en direction de Jausiers (du vallon du Lauzanier au col du Fer) pour faciliter la poursuite de l’attaque au centre sur Tournoux et la Condamine, puis continuer ensuite sur Barcelonnette.
Cette manœuvre est, là aussi, très classique : poussée par le centre et enveloppement par les ailes. Mais, il faut dans un premier temps, du 17 au 21 juin, mettre en place le dispositif pour passer à l’offensive, c’est à dire porter vers l’avant l’artillerie, les
services (dépôts et transmissions en particulier) et les grandes unités. Cette mise en place se fait lentement et avec beaucoup de difficultés dans des zones en contre pente, pratiquement dépourvues de véritables voies de communication et encore recouvertes de neige. Aussi, durant cette période, n’y aura t il sur le front de l’Ubaye que quelques escarmouches et de rares duels d’artillerie.
Au moment de l’offensive, dans la zone Ubayette col de Larche, environ 250 défenseurs français des troupes d’intervalle (hors troupes de forteresse dans les ouvrages Maginot) vont se trouver confrontés à 5 régiments assaillants provenant de 3 divisions différentes, soit, selon Jacques Boell, un rapport de 1 à 50 !


Larche avant la guerre 1939-45.


Ce sont trois périodes que l’on distingue de la déclaration de guerre (10 juin 1940) à l’armistice (25 juin à 0 h 35) : du 10 au 16 juin : attente sur la défensive de part et d’autre avec renforcement des patrouilles de surveillance et d’observation du 17 au 21 juin : mise en place des dispositifs offensifs italiens, premiers engagements localisés et tirs d’artillerie du 21 au 25 juin 0 h 35 : offensives italiennes énergiques (tentative de submersion), résistance française ferme sur la Ligne des Avant Postes.
Le 10 juin dans l’après midi, l’Italie déclare la guerre, les hostilités devant commencer à 0 h. La nouvelle est diffusée par la TSF à 18 h. L’ordre est immédiatement donné pour l’évacuation dès 23 h des civils des vallées de l’Ubaye et de l’Ubayette. Les habitants des villages et hameaux de l’Ubayette (Maison Méane, Malboisset, Larche, Certamussat, Fontvive, Saint Ours, Meyronnes) doivent ainsi gagner par leurs propres moyens les Gleizolles où, à partir de 4 h du matin, des camions les embarquent pour les conduire dans un premier temps à la Motte du Caire (Basses Alpes, actuelles Alpes de Haute Provence) ; puis ils seront évacués vers la Lozère par le train. Les troupeaux sont conduits par les hommes non mobilisés vers Allos, Colmars, puis Beauvezer.
A minuit, une violente explosion retentit à proximité de Larche. Serait ce déjà l’attaque italienne ? Non, c’est le génie qui vient de faire sauter le dispositif de destruction 96bis au pont du Rif Fort (Riou Tort). Le lendemain vers 13 h, une seconde explosion plus lointaine : cette fois, ce sont les virages en encorbellement de la route nationale entre Meyronnes et Certamussat qui viennent de sauter (dispositif 93).
Ces destructions précipitées semblent bien prématurées. Non seulement elles obligent la population de Larche et des hameaux voisins à abandonner mobilier, cheptel, carrioles et voitures lors de l’évacuation, mais surtout elles nécessiteront aussi dans les jours qui suivront de retracer une piste muletière en fond de vallée afin de pouvoir continuer à assurer le ravitaillement des avant postes !!!
Dans le dispositif défensif français du col de Larche, la SES 83e BAF est le seul élément de surveillance, d’observation et de retardement entre la Ligne des Avant Postes et la frontière, depuis la Tête de Sautron au nord jusqu’au rocher des Trois Evêques au sud. Cette SES compte 25 hommes commandés par le lieutenant Costa de Beauregard, secondé par son adjoint Boncourt. Elle s’articule théoriquement en trois groupes de combat, chacun commandé par un sergent (Buloz, Audizio et Reynaud). En fait, cette structure de la SES 83e BAF peut être qualifiée d’allégée puisqu’une SES type regroupe une quarantaine d’hommes (3 groupes de combat et un groupe de commandement renforcé) et d’éclatée puisque, bien souvent, elle opérera fragmentée en 5 groupes de combat.
La SES a pris son cantonnement au chalet alpin de Maison Méane depuis l’hiver 39 40. De nombreuses patrouilles lui ont permis d’acquérir une parfaite connaissance de son terrain d’action dont sommets et crêtes, brèches et cols, ravins et pierriers n’ont plus de secrets pour elle. Fin mai 1940, quand la tension est devenue de plus en plus sensible, le poste avancé de Maison Méane a été renforcé par la 2e section de la 2e compagnie du 83e BAF de l’adjudant chef Coupez avec une vingtaine d’hommes ; par ailleurs, une partie de la SES, le groupe du sergent Buloz, a reçu une mission de guet permanent à Tête Dure, ainsi que de surveillance et de verrouillage depuis le col Rémy jusqu’au Bec du Lièvre.
Reconnaissance en territoire italien et baptême du feu (12-13juin)
Soir du 12 juin : depuis quarante huit heures la guerre est déclarée et il ne s’est rien passé ! Pour le lieutenant Costa, il ne saurait être question de rester passif et de ne pas agir : prendre l’initiative permet de mieux se défendre surtout si l’on mène des opérations éclairs, reconnaissances et coups de mains, de façon répétée et disséminée, laissant croire à l’ennemi que l’on est présent partout. Transgressant allègrement les ordres, il décide de pousser une reconnaissance sur le sol italien pour essayer de voir ce que peut cacher la passivité du pseudo assaillant.
La nuit de ce 12 juin 1940 est claire. Le petit groupe de six éclaireurs que conduit le lieutenant Costa s’élève rapidement dans le vallon de l’Oronaye, contourne le lac par la droite et grimpe ensuite les pierriers du pic de la Signora dont le piton terminal marque la frontière. L’activité italienne sur les crêtes, cimes et cols frontière a été ces derniers jours particulièrement intense comme si l’ennemi en se montrant voulait faire démonstration de sa force. Aussi, les dernières centaines de mètres avant d’atteindre le piton sont elles franchies dans le silence le plus absolu et avec une prudence et une circonspection extrêmes. Personne au sommet… et on ne décèle aucune présence alentour ! Les éclaireurs localisent sans difficulté dans l’obscurité, 300 mètres en dessous d’eux, les baraquements de la frontière au col de Larche et un peu à leur gauche le lac de la Maddalena. En suivant d’abord la ligne de crête, puis en descendant un épaulement plongeant vers le col, les voilà en territoire italien ! L’aube qui commence à poindre facilite l’observation mais peut aussi contribuer à faire repérer le petit groupe. Cependant, aucune activité ni aucune position ennemies ne sont visibles sur ce versant. Le lieutenant Costa décide alors de pousser plus loin la reconnaissance. Pendant une heure la progression va se faire en traversée, en silence absolu, de rocher en rocher, de ravine en pierrier, de pli en replat, de buisson en touffe d’herbe haute. Le groupe a ainsi pénétré d’un bon kilomètre en Italie. Le jour se lève ; il serait téméraire et dangereux de continuer plus avant. Pendant 1 h ½, tapis derrière les blocs rocheux et les buissons de rhododendrons d’un ressaut au-dessous de la cime de Peyrassin, les chasseurs vont observer à loisir l’activité ennemie : circulation sur la route et les chemins de montagne,
positions notamment sur la crête de Ventassus, en face d’eux, qui domine côté français le vallon du Lauzanier, etc.
A 9 h, le signal du retour est donné et c’est avec la même discrétion qu’à l’aller que le groupe regagne le piton qui marque la frontière. Tout se passe bien jusque là, mais au moment de franchir la crête et de redescendre côté français, un poste italien situé sur le versant opposé du col les repère et ouvre un feu nourri à l’arme automatique. Les éclaireurs s’abritent en bondissant de rocher en rocher au milieu des balles qui ricochent et miaulent en tous sens et plongent au plus vite sur l’autre versant. Heureusement personne n’est atteint et le groupe rejoint au complet et sans plus de problème son cantonnement de Maison Méane.
Depuis longtemps les postes avancés et les patrouilles ont repéré une position italienne sur l’arête sud du col, dominant ce dernier de 150 mètres environ, à la cote 2108, au Serre de la Pare. Toutefois l’organisation ennemie aux alentours était jusqu’alors mal connue. La reconnaissance de la nuit du 12 juin a permis de repérer un autre poste situé sur la même crête à environ 1 kilomètre du premier et le dominant d’environ 250 mètres, au Serre de Ventassus. Fort de ces renseignements, le lieutenant Costa a tous les éléments pour réaliser le projet qui le démange : capturer ou détruire le point d’appui italien de 2108. Toujours en transgression flagrante des ordres qui sont de ne pas ‘‘asticoter’’ l’ennemi, l’opération est montée pour la nuit du 13 au 14 juin. Le plan d’attaque est le suivant : par le versant est du vallon du Lauzanier grimper droit vers la crête entre le Serre de Ventassus et 2108 ; en dessous de celle ci : séparation en deux groupes, un groupe s’installant sur la crête pour, d’une part, assurer la protection vers le haut en direction du Serre de Ventassus, et apporter, d’autre part, une base d’appui feu au deuxième groupe qui ayant effectué une traversée légèrement en dessous de la crête attaquera, en débouchant un peu au dessus de 2108. Pour ce coup de main, compte tenu de la mission statique permanente du groupe Buloz à Tête Dure, moins d’une vingtaine d’Alpins sont disponibles.
Un peu après minuit, le petit détachement qui vient de remonter l’Ubayette franchit le pont Rouge et aborde avec vigilance, un peu avant la mare du Lauzarouote, la cabane qui serait bien propice à une embuscade. Personne, en fait, et tout est calme. Prenant plein est, les chasseurs grimpent droit vers la crête, d’abord par un pierrier puis une ravine fort abrupte. Parvenus à environ 2 200 m d’altitude, séparation des deux groupes : le groupe d’attaque du sergent Audizio part en traversée vers 2108, le groupe de protection et d’appui du sergent Reynaud continue vers la crête avec le lieutenant Costa.
La crête est libre et le groupe s’y installe : trois hommes en protection vers le haut en direction du Serre de Ventassus ; le reste descend en direction de 2108 et, à environ 300 mètres, le lieutenant répartit ses hommes en base de feux et leur assigne des cibles précises. En effet dans la clarté blafarde de l’aube, on distingue maintenant fort bien les détails du point d’appui italien : des emplacements de combat protégés par des murettes de pierres sèches, vides pour l’instant de tout occupant, quelques tentes où doivent dormir une quarantaine d’alpini, le tout sous la surveillance nonchalante d’une sentinelle isolée qui fait les cent pas avec insouciance, loin de se douter qu’elle est ainsi épiée. Quelle cible merveilleuse… même si tirer sur des hommes endormis n’est pas spécialement glorieux ! Mais, il faut jouer la surprise.
Le jour commence maintenant à se lever et toujours personne en vue au point où le groupe d’assaut devrait déboucher ! Après plusieurs dizaines de minutes d’attente, Costa finit par s’impatienter et hésite entre partir à la recherche du groupe et rester à sa place dans le dispositif. C’est alors que Audizio, retardé avec son groupe par le franchissement de couloirs piégeux, débouche pile sur la position italienne. Ils sont immédiatement aperçus par la
sentinelle qui donne aussitôt l’alerte en hurlant. Le groupe de soutien ouvre alors le feu. Le vacarme des armes se déchaîne, staccato des FM, claquements des mousquetons,… entrecoupé de brefs silences immédiatement rompus par de nouvelles rafales. Malgré un tir bien ajusté, les Italiens réussissent à gagner leurs emplacements de combat et ripostent vigoureusement. Bien que serrés de près, ils tiennent en respect le groupe d’assaut qui ne peut plus progresser. De plus, le poste du Serre de Ventassus a été alerté par le bruit de l’accrochage et ses occupants se ruent au secours de 2108. Ils sont arrêtés net dans leur élan par le petit groupe de protection resté embusqué dans les rochers sur la crête.
De toute évidence le combat ne peut plus que demeurer statique et s’éterniser. Le lieutenant Costa considère alors l’action comme suffisante vu l’effet recherché et ordonne par coureur au sergent Audizio de décrocher. Le groupe d’appui feu redouble son tir pour faciliter et protéger la manœuvre qui s’effectue méthodiquement avec ordre et précision. A quasi épuisement de munitions, il décroche à son tour. Les Italiens sous ce feu nourri ripostent comme ils peuvent, c’est à dire assez mal, si bien que le repli s’effectue sans trop d’encombres.
Vers 8 h, le 14 juin, la SES a regagné son cantonnement de Maison Méane sans aucune perte. Cependant, dans la précipitation du repli sous le feu de l’ennemi, l’un des fusiliers mitrailleurs a perdu son arme qui ne pourra être récupérée que le surlendemain. Entre temps, la section empruntera un FM au groupe Buloz, qui en empruntera un, lui même, au sergent Dunand de l’ouvrage d’avant poste de Larche ; l’arme lui sera restituée 48 heures plus tard.
Du côté italien, le bilan de cette escarmouche, outre l’effet psychologique, sera de 5 tués dont le sous lieutenant Beppino Nasetta, considéré comme le premier soldat italien tué sur le Front Occidental (monument à la cote 2108 et rue portant son nom à Cuneo).
Dans la journée du 13 juin, dans un tout autre secteur, à la côte de l’Alp, près de la frontière, une patrouille conduite par l’adjudant Coupez essuie des tirs de mitrailleuse, sans dommage.
Du 14 au 16 juin, sous une pluie battante, la SES 83e BAF et la section Coupez continuent à patrouiller mais l’observation est gênée par le très mauvais temps. Aucun accrochage n’est à signaler.
Après 3 jours de pluie, à l’aube du 17 juin, le ciel se dégage peu à peu. L’observation va redevenir possible et sera la bienvenue puisque la demande d’armistice de la France est maintenant officielle et que les Italiens en profitent pour venir tâter le dispositif défensif français ; de plus, ils ont pu aussi modifier leur organisation à la faveur du mauvais temps. Le lieutenant Costa a conduit un petit groupe sur la crête des Bals, parallèle à la frontière et qui la domine, permettant ainsi une observation précieuse sur le versant italien du col de Larche. Il constate que, si l’ennemi a renforcé le poste 2108 avec des mitrailleuses (bien mal camouflées d’ailleurs), le secteur semble très calme. Puis, soudain, incrédule, il voit une colonne ennemie de plusieurs dizaines d’hommes descendre tranquillement en file indienne la Route Nationale 100 depuis le col en direction de Maison Méane à deux kilomètres de là. Immédiatement, le groupe fonce tout droit au plus court pour aller renforcer le reste de la section demeurée au cantonnement. Mais la distance est telle entre la crête des Bals et le hameau qu’il s’attend à arriver en plein combat ; aussi est-ce à sa grande surprise qu’il atteint Maison Méane sans avoir entendu le moindre coup de feu et y trouve le reste de la section



parfaitement calme et paisible, vaquant aux tâches du service ordinaire. Le sous officier qui commande explique alors : « Dès que nous avons eu repéré la colonne, nous étions en alerte et j’ai donné l’ordre de ne pas tirer pour ne pas nous révéler. Les Italiens se sont arrêtés à 700 mètres environ du hameau. Ils ont observé, hésité, puis apparemment persuadés que les maisons et baraques étaient vides et inoccupées, sont repartis vers l’Ubayette, l’ont traversée et sont remontés par la rive gauche vers le Lauzanier. »
L’observation, tant à partir des pentes de Tête Dure que du bloc observatoire de l’ouvrage d’avant poste de Larche, montre que l’ennemi s’installe en toute quiétude à la cabane du pont Rouge à l’entrée du vallon du Lauzanier. Une fumée bleutée s’élève de la cheminée (peut être font ils chauffer leur café ?!) tandis que nombre de soldats italiens commencent tranquillement à faire leur lessive dans l’Ubayette !!! Comportement pour le moins désinvolte pour une troupe au contact de l’ennemi ! Bien sûr, la cabane du pont Rouge est l’un de ces objectifs repérés et codés pour l’artillerie ; ses coordonnées sont immédiatement transmises à Roche la Croix dont les pointeurs vont se faire un plaisir de « sucrer le café des Italiens » (sic). Lentement la tourelle se soulève et à 15 h 10 précises la première salve du jumelage de 75 retentit ; les salves qui suivent sont tout de suite encadrantes et c’est la panique chez les Italiens : les uns se ruent hors de la cabane en tirant… des fusées d’alerte, d’autres s’y précipitent pour y chercher un abri illusoire. Costa a entre temps poussé ses éclaireurs à portée de tir ; les FM de la SES complètent la mise en déroute de l’ennemi qui laisse sur le terrain une dizaine de morts ; une mitrailleuse est détruite à 2108 par les tirs de l’artillerie. Au total, la tourelle de Roche la Croix aura tiré 66 coups de 75 sur l’objectif. En représailles, les Italiens canonnent les tranchées de Maison Méane.
L’observatoire d’artillerie de Viraysse commandé par le lieutenant Duittoz du 162e RAP (commandant d’ailleurs l’ensemble de l’AP de Viraysse) signale en fin d’après midi l’installation d’une batterie italienne à environ 1 km au sud est du lac de la Madeleine. Les tirs en vue de sa destruction sont confiés à l’artillerie divisionnaire (groupe A3 d’action d’ensemble). Ce sont les deux 155 L Mle 77 de Bange positionnés à la Charbonnière près du Fort supérieur de Roche la Croix qui doivent intervenir. Malheureusement, dès le premier coup, un grave incident survient : les pièces ont été installées sur des plates formes confectionnées avec des troncs de mélèzes ; sans doute mal arrimé, le premier canon qui tire bascule de la plate forme sous l’effet du recul ! Le relais est alors pris par les 155 C Schneider de la 13e batterie du 293e RALD en position à Saint Ours. L’observatoire de Viraysse peut juger de l’efficacité des 20 coups tirés qui musèlent la batterie italienne.
Le lendemain 18 juin, après avoir été correctement replacé, le 155 L de la Charbonnière tire 12 nouveaux coups sur ce même objectif.
Dans Histoires vécues en Ubaye, l’abbé Sébastien Signoret raconte un incident qui aurait pu avoir de terribles conséquences et qui se situe vraisemblablement dans la nuit du 17 au 18 juin : « une nuit, une patrouille [italienne] s’avançant plus près de l’ouvrage [PA 2018] mit tout le monde sur le qui vive ; d’accord avec l’adjudant qui commandait la position 1893, près le village de Larche, il fut décidé d’éclairer le terrain avec des fusées blanches, afin de reconnaître la position de la patrouille ennemie ; aussitôt dit, aussitôt fait, deux fusées blanches jaillirent simultanément de 2018 et de 1893… Ce sont les seules qui furent tirées et elles faillirent provoquer la perte des positions, voici pourquoi : la lueur des deux fusées fut aperçue par le guetteur de Roche la Croix, il signala le fait au capitaine Fabre, commandant
l’artillerie du secteur. Celui ci, étonné, téléphona aux deux positions pour savoir si réellement des fusées blanches avaient été tirées ; les réponses affirmatives l’étonnèrent fort et il demanda : Etes vous dans l’intention d’abandonner vos positions ? Il lui fut répondu que non. Pourquoi alors avoir tiré des fusées blanches, signal que les positions sont intenables et vont être abandonnées ? Je dois alors ouvrir le feu sur vos emplacements et les démolir.
Un des commandants de ces positions nous disait : ‘‘Notre ignorance des signaux, qu’on ne nous avait jamais communiqués et qu’on ne nous communiquera pas par la suite, faillit nous être fatale ; sans la présence d’esprit de cet officier, beaucoup de mes camarades ne serait plus de ce monde…’’ Par la suite, on ne se servit plus jamais de signaux. »
Le lendemain, 18 juin, la SES est au repos dans son cantonnement de Maison Méane lorsqu’un guetteur signale vers midi un détachement italien descendant la rive gauche de l’Ubayette en direction du hameau. Le lieutenant Costa rassemble rapidement un groupe qui se porte au devant de l’ennemi. Une embuscade est montée à environ 400 mètres en amont de la tranchée de la rive gauche de l’Ubayette. A 12 h 35, le dispositif est à peine mis en place que la dizaine d’Italiens qui constituent la patrouille ennemie débouche tranquillement sur le sentier. Quelques rafales de FM tirées au dessus et devant le détachement font effet immédiatement : tous lèvent les bras et se rendent aux premières sommations. Douze Italiens sont ainsi capturés dont un sergent et un caporal. Un alpini est assez grièvement blessé et le tireur FM, un gapençais nommé Roux, s’en excuse un peu piteux et confus auprès de son sergent : « j’ai pas fait exprès, ça doit être un ricochet » !
Le groupe de la SES reste en surveillance au cas où une autre colonne italienne surviendrait. En fait, le détachement capturé était bien totalement isolé, voire même peut être quelque peu perdu. Il pourrait bien s’agir d’ailleurs d’une partie des Italiens dispersés la veille par les tirs de la tourelle de Roche la Croix. En tout cas, pour la deuxième fois en 48 h, les reconnaissances italiennes dans la vallée de l’Ubayette auront connu un beau fiasco!
Dans l’après midi, nouveau bombardement italien sur les tranchées de Maison Méane.
Le 19 juin, au lever du jour, une patrouille italienne de 6 hommes s’infiltre dans le ravin de Rouchouze et parvient au contact du PA des trois mélèzes (2018). Les hommes du sergent chef Griennay font bonne garde et la fixent aisément. Puis, sous les tirs conjugués de 2018 et de 1893, elle est contrainte de se replier. L’activité italienne sur les crêtes et aux cols frontière est particulièrement importante. Toutefois, le mauvais temps rend la visibilité très mauvaise et l’activité de l’artillerie reste nulle.
Devant les signes avant coureurs d’une offensive imminente, dans la nuit du 19 au 20 juin, le génie détruit le pont de Maison Méane sur la RN 100.
Le lendemain 20 juin, à 8 h, c’est le pont de la douane à Larche qui saute à son tour. Dans la matinée, un tir de 155 disperse des travailleurs italiens venus remettre en état le dispositif de la cote 2108. En fin de journée, l’artillerie italienne prend violemment à partie Viraysse qui subit un bombardement intense : des éclats de 305 sont même identifiés. Les dégâts ne sont que matériels mais importants : angle nord est de la batterie détruit ainsi qu’une grande partie du cantonnement des Baraquements de Viraysse en arrière de la position, en dessous du col de Mallemort. Par ailleurs, le câble téléphonique est sectionné mais auparavant Viraysse a pu signaler des détachements ennemis au col de Sautron qui sont immédiatement (19 h 50) dispersés par un tir de 105. Le câble sera provisoirement réparé. A
partir de 20 h, et pendant une heure, violent bombardement italien sur Maison Méane ainsi que des tirs sur Meyronnes. Une heure plus tard, l’artillerie française (groupe A3 d’action d’ensemble) exécute des tirs de représailles sur Chiappera, Saretto, Bersezio et Grangie. La tourelle de Roche la Croix détruit deux observatoires italiens vers le col de Portiola et la Tête des Parties. Ces actions font cesser le tir ennemi. Enfin, les comptes rendus de la 2e compagnie du 83e BAF signalent que, vers midi, un avion allemand aurait survolé la position de Larche, salué, sans dommages, par la rafale d’un FM en position anti aérienne à proximité de l’ouvrage d’avant poste.
Le 21 juin débute, dès l’aube, par un violent bombardement de l’artillerie italienne sur Viraysse, 2018, 1893, Larche, Maison Méane. Puis les Italiens commencent à tâter les défenses françaises vers Tête Dure dans le secteur de l’Oronaye. Après avoir pénétré en territoire français et remonté le vallon, des sections d’alpini tentent de s’installer au col de la Gypière de l’Oronaye et de menacer ainsi l’AP de Viraysse par le sud. Le feu nourri et puissant du groupe Buloz embusqué au rocher Peyron et au Bec du Lièvre les font renoncer à leur projet et les maintient à distance malgré les tirs (lointains) de mitrailleuses et un bombardement de mortiers de 81. Ce coup d’arrêt est fort important, car la vieille batterie aura déjà beaucoup à faire pour se défendre au nord, sur sa gauche, du large débouché du col de Sautron et de face, de celui des Monges. En fin de matinée (10 h 50), une colonne ennemie montant du lac de la Madeleine est dispersée par les 155 de la 13e batterie du 293e RALD (capitaine Maire) installés à Saint Ours (tirs observés de Viraysse par le maréchal des logis Ragris du 162e RAP). Au cours de la journée, l’ennemi renforce sa présence sur tous les cols ; des infiltrations sont observées vers le Lauzanier par le col de Larche et les Pas de l’Enclause et de l’Enclausette. Enfin le soir, à 19 h et 20 h, tir des 155 C Schneider Mle 17 de l’Ancien Camp (Roche la Croix) sur le versant sud de la crête de Ventassus (vers la cote 2108), puis des 105 L Mle 13 de Meyronnes sur les observatoires du col de Portiola.
L’attaque (22juin)
Conformément au plan, l’opération ‘‘M’’ commence par l’attaque à l’aile droite sur la Haute Ubaye (vallée de Maurin) et Viraysse.
Après une forte préparation d’artillerie, dés l’aube, les Italiens se sont lancés à l’attaque au nord, sur la haute vallée de l’Ubaye, du col de Stroppia au col de Longet.
En Ubayette, c’est à 8 h que commence le pilonnage de Viraysse, Maison Méane, et Larche avec des calibres allant du 75 au 305 et qui va durer presque 4 heures, jusqu’à 11 h 25 ; Viraysse est plus particulièrement visé et le sommet est rapidement recouvert d’un panache de fumée. Facilement repérables et repérés depuis longtemps par les artilleurs italiens, les Baraquements situés en contre bas de l’ancienne batterie, en dessous du col de Mallemort, déjà touchés le 20 juin, sont à nouveau atteints et incendiés dès les premiers tirs. Ceci ne contribue pas à maintenir le moral des artilleurs des 150 de tranchée qui y avaient entreposé effets personnels et matériel. De plus, les emplacements de ces vénérables ‘‘crapouillots’’, entre le col de Viraysse et la batterie, ont été aménagés dans la pierraille et la protection des servants est problématique. Le violent bombardement est suivi par l’attaque de la 44e Fanteria de la division « Forli » qui débouche du col de Sautron et progresse dans les pentes est et sud est de la Tête de Viraysse. En outre, les Italiens passés par les cols de Portiola et de la Portiolette se sont emparés du sommet de la Meyna et y ont installé des mitrailleuses. Pris quasi à revers, les servants des 150 T abandonnent leurs positions et se replient sur Saint Ours. Les Italiens tentent de contourner Viraysse par le nord pour se diriger
ensuite, d’une part vers Plate Lombarde et Fouillouse et, d’autre part par le Riou du Pinet (Riou de la Peyrouse) vers Saint Ours et Meyronnes. Ils sont contenus pour l’instant dans le Vallonnet par des tirs d’artillerie efficaces.
Enfin, le bombardement a détruit le câble téléphonique déjà sectionné le 20 juin. Il n’y a plus pour communiquer avec l’arrière que le poste de radio (ER 12) des observateurs d’artillerie du 114e RAL. Son antenne est sans arrêt détruite par les bombardements et la clé de chiffrage des messages comporte une erreur ; toute communication est impossible : Viraysse ne répond plus !
Combats retardateurs à Tête Dure
Dés le début de leur bombardement d’artillerie, les Italiens retirent en arrière du col de Larche les troupes qu’ils y avaient massées. L’attaque par le col sera sans doute pour plus tard. Toutefois, des tirs concentrés de destruction visent les PA 1893 et 2018 et Maison Méane, où l’alpin Guchamide est blessé dans la matinée. Dans le secteur de Tête Dure, une batterie de 65 prend d’abord à partie le groupe Buloz avec un tir très bien ajusté (heureusement personne n’est touché) ; puis, dans la matinée, la 43e Fanteria de la division « Forli » déferle par le col des Monges vers le ravin de Rouchouze et sur Tête Dure vers le col Rémy.
Laissant seulement un petit groupe en position à Maison Méane, Costa se précipite avec le reste de sa SES à la rescousse du groupe Buloz durement accroché à Tête Dure. Avec leurs 3 FM et leurs mousquetons, la quinzaine d’éclaireurs embusqués sur la crête entre le col Rémy et le Bec du Lièvre vont pendant de longues heures repousser avec succès les assauts italiens sur Tête Dure et en direction du Riou de Rouchouze. Cependant, petit à petit, l’ennemi s’infiltre de tous côtés et une menace d’encerclement commence à se dessiner.
A 16 h, estimant avoir rempli sa mission retardatrice, le lieutenant Costa donne l’ordre à ses deux groupes de décrocher. Tout en combattant, les hommes parviennent à force de marches et contre marches, zigzags, bonds en avant et retours en arrière, à gagner d’abord le bois des Challanches, non sans avoir été pris à partie heureusement sans dégâts par les artilleurs de Roche la Croix qui les prennent pour l’ennemi ; puis, quasiment à court de munitions, ils s’engouffrent dans le ravin de Combal seul passage encore libre pour regagner Larche. Les éclaireurs de la SES ne sont pas au bout de leur peine car, lorsqu’ils débouchent au dessus du village, les gendarmes les accueillent à coups de mousqueton ! La méprise est vite dissipée et, heureusement, il n’y a pas de blessé. Recrus de fatigue et affamés, les chasseurs regagnent leur cantonnement de Maison Méane, et après seize heures de combats et de crapahutage ininterrompus sombrent sans même manger dans un sommeil qu’ils souhaiteraient réparateur.
Pendant toute la journée, l’artillerie du secteur Ubaye Ubayette riposte par des tirs de contre batterie sur les régions Saretto Chiappera et Nord de Sautron.
Le colonel Dessaux, averti de la défaillance des artilleurs des 150 de tranchée, les a vertement fait renvoyer vers leurs emplacements en les assurant que « les jumelages de mitrailleuses de l’ouvrage de Saint Ours Haut se chargeraient d’éviter une seconde défaillance ». Le commandant Gaudillot a, quant à lui, ordonné à la 3e compagnie (capitaine Rollet) du I/299 tenue en réserve au col de Mirandol de se porter en renfort de Viraysse. Cependant, fort inquiet du silence de Viraysse et particulièrement conscient de l’importance primordiale de la position, il souhaite être renseigné de façon précise sur la situation et pouvoir la maîtriser avec des effectifs suffisants. Pour cela, une seule solution possible : y envoyer la SES de Costa, même si elle est exténuée et fourbue par ses derniers combats. Costa sollicité par téléphone met son monde en route, bon gré mal gré, vers 22 h 30. Le temps est exécrable : pluie, neige et tourmente en altitude. La SES doit dans un premier temps gagner le col de Mallemort à 2 558 m soit un dénivelé de près de 1000 mètres. En
passant à l’ouvrage de Larche, une bonne surprise attend les éclaireurs affamés : à la demande du commandant Gaudillot, le sergent chef Dunand commandant l’ouvrage a fait préparer un énorme repas : « Je fis sortir à la porte de l’ouvrage la gigantesque marmite de poule au riz que nous avions fait cuire dans la journée grâce aux malheureuses volailles du village abandonnées depuis plusieurs jours. Les éclaireurs prenaient le riz à poignées, avalaient deux quarts de pinard et repartaient en dévorant chacun leur demi poule. »
En arrivant au col de Mallemort, en pleine nuit et dans la tourmente, Costa ne peut se faire qu’une idée assez confuse de la situation. Il serait très imprudent de monter jusqu’à Viraysse en pleine nuit sans connaître les positions ennemies et de risquer en plus une méprise de la part des défenseurs ; de plus, des infiltrations italiennes par le ravin du Pinet (Riou de la Peyrouse) sont toujours à craindre. En conséquence, pour le reste de la nuit, la SES s’installe en PA fermé sur une éminence rocheuse, un peu à l’ouest du col de Mallemort, d’où elle peut surveiller à la fois les pentes nord et ouest de Viraysse et le ravin du Pinet.
Toute la nuit, l’artillerie du groupe A3 d’action d’ensemble effectue des tirs de harcèlement sur les points de passage obligé (cols des Monges, de Sautron, de Larche, …).
Cette journée sera la plus difficile pour les défenseurs ; bombardements d’artillerie et attaques d’infanterie vont se succéder sans relâche.
Les divisions « Forli » et « Acqui » reprennent leur attaque le 23 juin, dés 5 h du matin, par un violent bombardement qui dure jusqu’à 9 h. Le pilonnage vise les tranchées de Maison Méane et le hameau, les avant postes de Larche et de Viraysse, et les PA repérés de 1893 et 2018. De nombreux emplacements non occupés sont également bombardés : pierriers, tranchées d’adduction d’eau, bassins de captage, bergeries, etc. A Larche, les cheminées d’aération de l’ouvrage d’avant poste sont démolies et le baraquement extérieur à demi détruit. A Maison Méane, il y a deux morts : les alpins Hubert Bonnard et Pierre Bonniol. Ce sont deux muletiers, cantonnés à Certamussat et venus conduire du ravitaillement, qui ont été pris sous le bombardement. Vers 7 h, ils se sont abrités dans un trou d’obus, mais le destin a voulu que, fait rarissime, un second obus tombe exactement au même endroit. Le groupe Coupez a également deux blessés (Marcel Gilly et Aimé Crarre).
Maison Méane / Fontcrèze / Malboisset
L’attaque italienne au centre, c’est à dire par le col de Larche, est déclenchée à 9 h quand cessent les tirs d’artillerie. Les 17e et 18e Fanteria de la division « Acqui » appuyées par la XXIIIe CCNN (Légion d’assaut de Chemises Noires) attaquent le long de la RN 100 et de part et d’autre de l’Ubayette. Malgré le barrage d’artillerie et les tirs de mortiers (sur le ravin de la Ruine Blanche en particulier) ainsi que ceux des mitrailleuses de l’AP de Larche, l’ennemi atteint vers 10 h le réseau de barbelés autour de Maison Méane. Il commence à déborder le dispositif avancé. L’alpin Franc parti de l’ouvrage de Larche a déjà apporté l’ordre de repli à la section de l’adjudant chef Coupez. Bien que débordée, la section se replie en ordre en trois groupes par des chemins reconnus et en tiraillant pour couvrir sa retraite. Un groupe doit gagner une position près du Rif Fort (Riou Tort) ; les deux autres groupes, sous le commandement respectif de l’adjudant chef Coupez et du sergent Meyzencq, doivent rejoindre le PA de Fontcrèze, ‘‘ouvrage’’ de rondins recouverts de terre. Lorsqu’ils parviennent à proximité, des coups de feu les accueillent : les Italiens les ont devancés !!! Meyzencq connaît bien les dispositions de l’abri adossé à la montagne. Il escalade donc la pente pour se retrouver au dessus, dévale en courant le toit recouvert de terre, s’allonge au sol et avançant tête, buste et bras au bord du toit balance ses grenades par les meurtrières. Aux résultats : aucun survivant italien ! Pour cet exploit, Meyzencq recevra la médaille militaire.
Le hameau de Maison Méane, en flammes mais occupé par l’ennemi (17e Fanteria), est soumis à partir de 12 h 15 à un tir de concentration de 6 batteries françaises. Le XXIIIe bataillon de Chemises Noires de Mantoue atteint Malboisset ; il s’y trouve aussitôt bloqué par les tirs des mitrailleuses des blocs 2 et 3 de l’AP de Larche.
A Fontcrèze, les deux groupes repliés qui ont repris le PA ont été immédiatement ré attaqués par un ennemi très supérieur en nombre. Ils doivent abandonner la position. Cependant, à la suite d’une violente contre attaque et d’une lutte de 3 h, ils parviennent à la reconquérir. Au cours de ce combat, l’alpin Cliquant est blessé. Les Italiens de leur côté ont subi des pertes sérieuses. Pour l’ensemble de cette action, l’adjudant chef Coupez sera cité à l’ordre de l’Armée et proposé pour la médaille militaire : « Détaché comme commandant de la ligne de surveillance des avant postes, a rempli brillamment sa mission. Malgré l’ordre d’évacuation donné, a attendu le dernier moment pour se replier après avoir infligé le maximum de pertes à l’ennemi, bien que largement débordé aux deux ailes. Est revenu aussitôt prendre une nouvelle position sur la ligne de feu, n’a pu l’occuper qu’en attaquant l’ennemi qui s’y était déjà installé. »
Toute la journée, l’artillerie du quartier et celle d’action d’ensemble interviennent sur les indications des observateurs, notamment de l’AP de Larche. Les tirs à obus fusants sur les objectifs repérés et codés au préalable sont particulièrement efficaces.
Peu après que l’artillerie italienne a cessé ses tirs, les guetteurs du PA 1893 repèrent deux italiens en face d’eux dans les pentes de Tête Dure (un peu en dessous de 2018 et un peu au dessus d’eux). Il semble qu’il s’agisse d’un officier et d’un soldat chargés de faire le relevé des résultats des bombardements de la veille et du matin même. Ils opèrent en toute tranquillité, n’ayant de toute évidence pas repéré le créneau de mitrailleuse de 1893, en face et légèrement en dessous d’eux, à environ 600 à 700 m. L’adjudant chef Nectoux de 1893 et le sergent Griennay de 2018 se concertent et décident d’agir. Pour voir la réaction des deux soldats italiens, l’adjudant chef Nectoux ordonne à l’alpin Robert Barucci de tirer une rafale de FM tout près d’eux. Les deux Italiens réagissent immédiatement en tentant de fuir. L’ordre est donné dans l’instant à Barucci de leur tirer dessus. A la première rafale les deux sont atteints : le soldat tombe immobile, affalé sur un genévrier ; l’officier rampe quelques mètres et s’abrite derrière un rocher mais il reste en vue des hommes de 1893. Nectoux ordonne alors un tir coup par coup au dessus de l’officier pour qu’il soit fixé. Au bout de près d’une demi heure, l’officier finit par agiter sa carte d’état major en signe de reddition. Il serait intéressant de ramener cet officier prisonnier, car il pourrait certainement fournir de précieux renseignements. Les alpins Barucci et Basset se portent alors volontaires pour aller le capturer. Les armes automatiques de 2018 et 1893, mitrailleuses et FM, les couvriront pendant cette mission. Les deux hommes descendent jusqu’au torrent de Rouchouze et le traversent, puis remontent les pentes de Tête Dure. Ils capturent sans problème l’officier qui s’avère être un capitaine d’artillerie ; il est sérieusement blessé : une balle lui a fracassé le genou et une autre lui a pénétré l’aine. Le soldat, quant à lui, est mort. Basset charge sur son dos le capitaine blessé après avoir donné son fusil à Barucci déjà lesté de son FM et de trois chargeurs. C’est dans cet équipage que les deux hommes avec leur prisonnier regagnent 1893, péniblement, mais sans encombre. Le 14 juillet, les deux hommes seront décorés de la croix de guerre par le commandant Gaudillot à Chauffayer.
Durant le reste de la journée, les tirs de fusants de la tourelle de 75 de Roche la Croix et des 105 L et 155 C du groupe A3 suffisent à interdire le ravin de Rouchouze. Cependant, à la nuit tombée, des infiltrations se produisent mais l’attaque est repoussée par les feux d’infanterie (mitrailleuses et FM) et les grenades VB de 1893 et 2018.
Durant la nuit, 300 coups de canon de calibres divers sont tirés sur les passages obligés des Italiens (cols principalement) et sur Maison Méane qu’ils occupent.
Dès l’aube du 23 juin, malgré le brouillard et la chute ininterrompue d’un mélange de pluie et de neige, dans un froid glacial, la SES de Costa pousse des reconnaissances prudentes aux alentours du col de Mallemort. Le Roir Alp, le ravin du Pinet, le vallon de Viraysse et la crête nord ouest qui s’élève du col de Mallemort au sommet s’avèrent totalement libres de toute présence ennemie. Ainsi, la vieille batterie érigée en avant poste n’est pas totalement encerclée. Cependant, elle continue à être harcelée non seulement par l’artillerie, mais aussi, par des tirs d’armes automatiques depuis les rochers de la Meyna, et de mortiers depuis les pentes est et sud est, que les Italiens ont réussi à investir malgré les conditions météo épouvantables. De petits groupes ennemis ne cessent de tenter de parvenir au sommet et de coiffer la position. La situation est donc sérieuse mais loin d’être désespérée. D’ailleurs, les défenseurs et l’artillerie (notamment les tirs de Roche la Croix) arrivent à maintenir les assaillants à distance et, avec l’aide de la SES, les servants des 150 de tranchée, arrivant tout penauds de Saint Ours, peuvent même réintégrer leurs emplacements de combat.
Le reste de la journée, la SES le passe, en couverture du vieux fort, blottie dans les rochers près du col de Mallemort et le long de la crête nord ouest qui le relie au sommet de la Tête de Viraysse. Pluie et neige ne cessent de tomber et le vent de souffler en rafales. Un des éclaireurs (Faure) témoigne que chaque salve de la tourelle de Roche la Croix « déclenchait une violente tempête de neige qui gelait immédiatement sur les rochers. Notre vareuse était raide et nous n’avons jamais eu aussi froid que sur ces rochers de Mallemort ».
Au soir une section de la 3e compagnie du I/299 envoyée en renfort parvient au col de Mallemort et va occuper la crête du Roir Alp.
Ce 23 juin, l’artillerie aura consommé plus de 2 000 coups en Ubayette. Une de ses actions peut être plus particulièrement soulignée : le PC artillerie sur renseignement concernant une demande de renforts motorisés par les Italiens tente de couper la route près du pont de la Maddalena à environ 2 km au delà du col de Larche. La section de 155 L de la Charbonnière tire 24 coups sur l’objectif. Selon les informations recueillies après l’armistice, la destruction de la route fut réussie et coupa tout ravitaillement vers le col de Larche.
Le temps reste exécrable : froid, brume, pluie et même neige en altitude. Cependant l’attaque ennemie reprend avec vigueur.
Les défenseurs de Viraysse vont encore passer une nuit blanche puisque les Italiens reprennent leurs attaques vers minuit ; c’est à la grenade qu’elles sont repoussées.
Bien que n’étant qu’en couverture, la section du I/299 cède à la panique, abandonne ses positions au Roir Alp et se replie au village de Saint Ours découvrant ainsi dangereusement la SES de Costa et la partie nord ouest de la position. Le colonel Dessaux fait renvoyer la section vers Viraysse avec la même énergie que celle qu’il avait montrée à l’encontre des servants des crapouillots.
Toute la matinée du 24 juin, la 44e Fanteria de la division « Forli » attaque de front avec ses IIe et IIIe bataillons tandis que son Ier bataillon tente de déborder par les pentes sud est. La progression de l’ennemi se fait à la faveur d’un brouillard particulièrement épais.
En fin de matinée, le capitaine Rollet arrive en renfort avec deux sections de la 3e compagnie du I/299 ; l’une réoccupe le Roir Alp, l’autre renforce la défense de la ‘‘redoute’’.
Ayant profité au maximum du brouillard, l’ennemi parvient vers 15 h à atteindre les superstructures de l’ancienne batterie. Une sortie résolue des défenseurs le repousse à coup de grenades et de FM dans les pentes où il est pris à partie d’abord par les 150 T puis, alors que le brouillard se lève brusquement, par l’artillerie du secteur.
Les hommes de la SES de Costa connaissent une journée particulièrement dure : trempés jusqu’aux os, transis de froid ; plusieurs cas d’évanouissement se produisent dus au froid et à la fatigue.
A la fin de la journée, malgré tout, la situation peut être considérée comme rétablie définitivement puisque les Italiens ont lâché pied autour de Viraysse et se replient.
Sur tout le front central, le bombardement de l’artillerie italienne reprend durant une heure avant le lever du soleil. Toutefois, les tirs de contre batterie et l’arrosage systématique des positions occupées la veille par la 18e Fanteria de la division « Acqui » à Maison Méane et par la XXIIIe CCNN à Malboisset les obligent à s’y terrer. Par contre, sur la rive gauche de l’Ubayette, un bataillon entier de la 17e Fanteria attaque en force le PA de Fontcrèze déjà durement bousculé la vieille. Devant le nombre des assaillants, le petit groupe de défenseurs doit abandonner la position et se replier. Quasiment exténués, ils gagnent Certamussat sous le couvert des bois couvrant les pentes escarpées de la rive gauche de l’Ubayette. Après avoir pris quelque repos, ils repartent pour contenir les Italiens qui ont continué sur leur lancée au delà de Fontcrèze . Ils parviennent à les bloquer vers 19 h au niveau de la crête de Rofre , soit à plus d’un kilomètre en aval de l’AP de Larche qui aurait pu être tourné ; il était temps ! Non content de ce succès défensif, le groupe contre attaque vigoureusement et réoccupe le PA de Fontcrèze. Ainsi à l’armistice qui interviendra à 0 h 35, la Ligne des Avant Postes et de leurs Points d’Appui sera totalement rétablie.
Ravin de Rouchouze : coup d’arrêt et effondrement italien
Vers 11 h, le Ier bataillon de la 44e Fanteria de la division « Forli », après avoir débordé les contre forts sud est de Viraysse à la faveur du brouillard, avance dans le ravin de Rouchouze. Il est appuyé par deux pelotons de mitrailleuses. Ces unités paraissent bien décidées à bousculer les PA 2018 et 1893 pour ensuite tourner et prendre à revers l’ouvrage de Larche. A la faveur de la brume et d’une pluie continuelle, les Italiens s’infiltrent des deux côtés du torrent et jusque sur le petit plateau de Pré la Font sur les pentes nord ouest de Tête Dure. Au moment d’une éclaircie, quelques hommes sont aperçus par les guetteurs de 2018 et de 1893, un peu en avant du barrage de barbelés et de mines. Suspectant une attaque d’envergure, 2018 envoie, pour expliquer la situation, un coureur à l’ouvrage de Larche qui n’a pas de vues directes sur cette zone. Le sergent Henri Dunand commandant l’ouvrage contacte alors le PC artillerie A2 de Roche la Croix. Cependant la zone concernée ne peut être atteinte par le jumelage de 75 de la tourelle ; ce sont donc les 155 C de Meyronnes qui interviennent. Dès l’arrivée des premiers obus, les Italiens se dévoilent en tentant de se replier. Toutes les armes automatiques des deux PA, mitrailleuses et FM, les prennent aussitôt à partie. Ils tentent alors de s’abriter sous la barre rocheuse au dessous de Viraysse et se trouvent, avant d’y parvenir, sous le feu de la tourelle de Roche la Croix. L’enfer se déchaîne : tirs de barrage à la barre rocheuse ; tirs d’arrêt à obus fusants devant le barrage de barbelés et de mines ; tirs régressifs sur 600 m de profondeur à obus à balles. Chaque fois que les Fanti du 44e cherchent à avancer, les rafales des PA les en dissuadent ; chaque fois qu’ils tentent de se replier, la tourelle de 75 les bombarde à cadence rapide. Une pluie glaciale se remet à tomber et plusieurs heures vont ainsi s’écouler, les Italiens se terrant dans le fond du vallon harcelés par les tirs sporadiques des 155. Finalement un grand nombre d’entre eux finissent par trouver refuge dans une sorte d'anfractuosité rocheuse, prise toutefois sous le feu de la mitrailleuse servie par l’adjudant-chef Nectoux qui commande 1893. Au bout d’un long moment, en fin de compte, des drapeaux blancs s’agitent. Les Italiens se montrent, mais, en si grand nombre, que l’adjudant chef lance à Robert Barucci, tireur FM : « Ce doit être une ruse, tire dans le tas ! » et aussitôt après la première rafale : « Arrête ! Ils jettent leurs armes ! ». Une dizaine d’hommes sans armes se dirigent alors vers 2018 : ce sont des officiers. Le sergent Griennay va à leur rencontre. Ce sont ensuite plus de 300 hommes
valides et quelques dizaines de blessés auxquels les officiers font déposer leurs armes sur place. Une longue colonne se constitue, passe près de 2018 puis gagne 1893 sous surveillance des armes automatiques. Là, Nectoux fait mettre les prisonniers en ligne pour la fouille, mais devant leur nombre et leur air abattu voire hébété, seuls quelques uns sont fouillés et quelques grenades trouvées. Puis, en file indienne, Nectoux en tête et Barucci le FM sous le bras en serre file, ils descendent en direction de Certamussat . Presque aussitôt, les prisonniers sont pris en charge par d’autres alpins venus à la rencontre de la colonne (sans doute depuis la ferme du Colombier) et sont convoyés jusqu’à l’ouvrage de Larche. Le capitaine Bertrand Comiteau et le sergent chef Henri Dunand témoignent tous deux que les Italiens étaient hagards, affamés et transis de froid. Ils se rappellent aussi leur peur rétrospective en constatant que beaucoup d’entre eux étaient encore armés de leur pistolet ou porteurs de grenades ; ils sont rapidement désarmés, mais s’ils n’avaient pas été autant démoralisés, ils auraient pu s’emparer aisément de l’ouvrage de Larche, se trouvant en nombre dans un rapport de 1 à 10. Ensuite l’évacuation des prisonniers va être bien compliquée. En effet, voyant cette importante colonne descendre sur Larche, l’observatoire de Roche la Croix (Serre la Plate) a cru à une importante infiltration ennemie ; d’autant que, voyant cette colonne, un gradé du poste de secours de Larche s’est replié à vélo et a annoncé au PC de bataillon à Meyronnes que les avant postes avaient succombé à une attaque ennemie ! La méprise sera longue à être dissipée. Alors, les prisonniers sont dirigés vers l’arrière par paquets de cinquante, chaque groupe ‘‘surveillé’’ par un alpin. Ils sont ensuite pris en charge par l’ultime réserve qu’a pu réunir le lieutenant colonel de Dinechin, commandant le sous secteur Ubaye Ubayette : les estafettes et les plantons de la compagnie de commandement ! L’effondrement de ce bataillon a été obtenu en grande partie grâce à l’action de l’artillerie qui a anéanti le moral de cette troupe déjà fort éprouvée par le mauvais temps et l’absence totale de ravitaillement. Ainsi, au moment de la reddition, les alpins durent ‘‘engueuler’’ vertement les Fanti pour les obliger à porter leurs blessés, car, le bombardement français continuant, ils avaient une ‘‘trouille’’ bleue du froissement impressionnant des obus français passant bas au dessus de leurs têtes et exprimaient ainsi une véritable terreur des tirs de fusants auxquels ils venaient d’être soumis ; l’un des prisonniers pleurait à chaudes larmes et, indiquant la direction de Roche la Croix, ne cessait de répéter : « la méssante ! la méssante ! » ; enfin, deux jours après l’armistice, un commandant italien reconnaissait, en désignant toujours Roche la Croix : « Questa batteria, campione ! ».
Au cours de la journée, devant la tournure des événements et en raison de l’extrême fatigue et des pertes subies, le commandement italien décide de faire relever progressivement la division « Forli » par la division « Pistoïa » jusqu’alors tenue en réserve à Bersezio.
L’annonce du cessez le feu est faite vers 19 h. L’armistice interviendra à 0 h 35. Ordre est donné de jalonner les lignes françaises de drapeaux tricolores : à Larche, c’est celui de la gendarmerie qui est hissé au mât du bâtiment des Douanes, à l’entrée est du village, rive droite du torrent de Rouchouze.
Commence alors un véritable feu d’artifice : les artilleurs des deux bords mettent un point d’honneur à vider coffres, caissons et soutes ! A ces tirs s’ajoutent les embrasements des feux de Bengale, des fusées éclairantes et des signaux de toutes couleurs. Toute la vallée de l’Ubayette s’en trouve illuminée !
Les dispositions de l’armistice prévoient que la ligne verte délimitant la zone que les Italiens occuperont sera celle atteinte par les troupes au moment du cessez le feu ; d’où l’ordre qui avait été donné de baliser les lignes françaises avec des drapeaux.
Tôt le matin du 25 juin, le sergent chef Dunand à l’ouvrage de Larche est réveillé en sursaut par un de ses hommes qui l’alerte : « Chef ! Les Italiens entrent à Larche ! ». D’abord incrédule et n’en croyant pas ses oreilles, il doit rapidement en croire ses yeux en voyant en effet de très nombreux Italiens (peut être plus de 200) pénétrer dans le village, rive droite du torrent de Rouchouze. Sur instruction du colonel Dessaux, qui a été immédiatement averti, le sergent Dunand et deux hommes armés descendent en vitesse au village. Ils y trouvent une compagnie de la 17e Fanteria de la division « Acqui » qui a formé les faisceaux et dont les hommes se sont éparpillés dans le village, un bon nombre occupés à piller l’épicerie Palluel ! Apostrophant sèchement un lieutenant et un capitaine, Dunand réussit à ce que les marchandises réintègrent l’épicerie devant laquelle il place une sentinelle. Pendant ce temps, une violente altercation oppose un groupe d’Italiens et l’adjudant Simi d’origine corse Sur ces entrefaites, survient un colonello à la dégaine d’opérette (selon les dires unanimes des témoins de la scène). Cette apparition loufoque déchaîne encore plus les sarcasmes de Simi qui se met à parler en dialecte corse. Le colonello ne le comprend pas plus que le français mais finit par déclarer tranquillement en italien : « Ami, vous êtes corse, alors maintenant vous êtes italien, siamo tutti fratelli ! ». La réaction de Simi est si violente que les témoins s’interposent craignant qu’il n’abatte le colonello d’un coup de mousqueton ! Quand le calme est un peu revenu, le colonello exhibe deux rapports d’une compagnie qui prétend avoir conquis Larche de haute lutte, ce que les Français contestent aussitôt véhémentement et avec juste raison en montrant le drapeau français flottant au mât du bâtiment des Douanes. Mais chacun reste sur ses positions ; aussi, le sergent Dunand remonte t il à l’ouvrage pour rendre compte à ses supérieurs. Les ordres que donne alors le colonel Dessaux sont sans ambiguïté : « Descendez au village avec un groupe de combat complet et des grenades. Vous allez dire à ces messieurs que moi, colonel Dessaux, Commandant de la Vallée, je leur donne cinq minutes pour évacuer le village de Larche et un quart d’heure pour rejoindre Maison Méane. Passé ce délai, j’ouvre le feu ! » Le sergent réunit rapidement le groupe de combat et redescend au pas de course au village. Las ! Plus personne ! Il avise dans une ruelle un alpin qui musarde tranquillement. Interrogé sur ce qui s’est passé, ce dernier raconte : « Ben, on s’est bien marré ! Simi a piqué une crise ; il a pris son pistolet lance fusées et il a dit au colonel italien : ‘‘Il est 9 h moins cinq ; si à 9 h vous êtes encore là, je tire la fusée rouge et l’artillerie bombarde Larche !’’. Alors, voilà, ils sont partis !!! » Finalement, l’adjudant Simi n’avait fait qu’anticiper les ordres supérieurs !

Le lendemain 26 juin, à nouveau, cinq Italiens (3 officiers et 2 soldats) pénètrent dans le village et s’installent dans l’école qui servait de mess. Ils s’y attablent sans vergogne pour se désaltérer ! Le sergent Dunand qui s’est précipité au village partage finalement avec eux une menthe à l’eau (il ne reste que des bouteilles de sirop) puis les raccompagne. En effet, ils veulent remonter par le ravin de Rouchouze jusqu’à leurs lignes mais craignent d’être pris à partie par les postes français ; chemin faisant, le sergent Dunand est intrigué par l’un des soldats : grand, blond, allure de seigneur, s’exprimant en excellent français et ne parlant ni ne comprenant l’italien ; il prétend qu’il a été élevé à Paris et que ses parents ne s’exprimaient qu’en français. Pour le sergent Dunand il ne fait aucun doute que cet homme est en fait un officier allemand ; interrogé sur cette hypothèse, ce dernier ne voudra jamais en convenir et trouvera même cette idée ridicule « avec un petit rire qui sonnait faux ».
Le 25 juin après midi, les Français découvrent dans le ravin de Rouchouze, là où les Italiens se sont rendus la veille, une quantité incroyable d’effets et d’armes abandonnés : FM et mitrailleuses légères, mortiers de 45, caisses d’obus et de grenades, sacs de cartouches, musettes de masque, casques, fusils, baïonnettes, etc. Ils se servent largement en ‘‘souvenirs’’ et constatent qu’« aucun casque piémontais ne peut aller à une tête de Dauphinois ou de Provençal » !!! Des tentatives pour brûler un monceau d’équipements divers se soldent par des échecs répétés, faute de matières combustibles (bois ou papier) bien sèches : il restera des souvenirs pour les copains des arrières qui monteront visiter les lieux les jours qui suivront. C’est ainsi d’ailleurs que les alpins Allier et Archer de la 2e compagnie sont tués le 29 juin par l’éclatement d’un engin non explosé entre Larche et 1893.
Ce même 25 juin, les Italiens sont autorisés à venir relever leurs morts. Enfin, à Roche la Croix, au cours du service, l’alpin Monnier de l’équipage d’infanterie glisse sur les superstructures de l’ouvrage et se tue après une chute de 300 m en bas de la falaise rocheuse.
Le 26 juin, en fin de matinée, une cérémonie a lieu à Larche pour l’inhumation des alpins Bonnard et Bonniol et de l’artilleur italien tué en face de 1893. Deux piquets, l’un italien, l’autre français, rendent les honneurs.
A l’issue de 14 jours de combat, le bilan chiffré s’établit ainsi :
Le 25 juin, le colonel Dessaux adresse à ses troupes l’ordre général n° 5 confirmant le cessez le feu, mais dont les mots, compte tenu du bilan final, prennent une particulière résonance :

« Officiers, sous-officiers, Caporaux et brigadiers Alpins, Canonniers et Sapeurs de l’Ubaye, l’ordre nous est donné de cesser le feu.
Nous l’exécutons les dents serrées, mais sans honte parce que l’ennemi qui nous fait face n’y est pour rien.
Depuis le 17 juin, nous sommes attaqués par CINQ Divisions Italiennes : DIX contre UN.
L’ennemi n’a pas entamé nos avant postes. Nous lui avons fait 400 prisonniers sans lui en laisser un seul.
L’honneur est sauf, vous pouvez garder la tête haute. »
Les dernières lignes du Rapport d’Opérations de la 2e compagnie du 83e BAF rédigées par le capitaine Bertrand Comiteau sont quant à elles significatives de la défense opiniâtre de Larche :
« Tout le monde a fait son devoir là où il avait à l’accomplir. La deuxième section a fait preuve d’un héroïsme surhumain. La troisième section est digne des plus grands éloges. La première section, moins éprouvée, a assuré le ravitaillement et les services d’une façon remarquable et ceci a beaucoup contribué à l’excellente tenue de la troupe. »
A Larche, comme sur toute la Ligne des Avant Postes, la promesse de la devise de la ligne Maginot aura été tenue : « On ne passe pas »

Extrait du ‘‘Petit Dauphinois’’. Fin juin 1940.

Une ligne dite verte délimite la zone d’occupation. Cette ligne est celle atteinte au moment du cessez le feu. Comme dans tout le secteur Ubaye, en Ubayette, les gains de terrain des Italiens sont minimes : ils occupent les hameaux de Maison Méane et Malboisset, et les vallons du Lauzanier et de l’Oronaye (la ligne verte passe en effet par le col de Viraysse, les Challanches, la crête des Bals puis celle d’Abriès).
Une ligne dite violette, 50 km à l’ouest de la ligne verte, délimite la zone qui doit être démilitarisée dans les 10 jours. Les ouvrages sont donc évacués les 29 et 30 juin (les pièces essentielles pour l’armement et le fonctionnement sont discrètement et soigneusement cachées). Ensuite les troupes françaises gagnent à pied par étapes successives les centres de démobilisation (Chauffayer pour le 83e BAF) où les unités de réserve sont démobilisées et celles d’active dissoutes le 31 juillet.
Dans la vallée, le retour de la population se fait vers le 20 juillet, puis celui des troupeaux à la fin de ce mois. La population revient même à Maison Méane qui est en zone d’occupation italienne. Pendant le temps d’occupation, les Italiens reconstruisent ce qui a été démoli pendant les combats par l’artillerie tant italienne que française. Les travaux sont effectués par une entreprise de Vinadio.
Les troupes venues du Mezzogiorno qui ont combattu sont reparties et celles d’occupation sont piémontaises. A Maison Méane et Malboisset, ces soldats se conduisent très correctement vis à vis de la population. On ne notera aucun incident.
Quand les Allemands, à la suite du débarquement allié en Afrique du Nord, envahissent la zone non occupée, le 11 novembre 1942, les Italiens en profitent : ils occupent alors une zone bien au delà des limites fixées lors de l’armistice, créant une zone tampon de plusieurs kilomètres de large le long de la frontière, depuis le lac de Genève jusqu’à la Méditerranée. De ce fait, le village de Larche et toute la vallée de l’Ubayette (ainsi que la haute vallée de l’Ubaye) se trouvent occupées par les Italiens.
Le 29 novembre 1942, l’armée d’armistice est dissoute ; se met alors sur pied l’Organisation de Résistance de l’Armée (ORA) que l’on retrouvera dans les combats pour la libération en 1944 45, et un certain nombre de cadres qui ont combattu en juin 1940 dans le secteur Ubaye (Cusenier, Lécuyer, Costa de Beauregard, Bureau, Delécraz, Restelli, …) rejoignent divers mouvements de la Résistance (ORA, AS, FTP, Groupes Francs,…).
Une décision allemande, le 19 février 1943, permet aux occupants de créer des zones ‘‘réservées’’, c’est à dire interdites. Cette décision est appliquée pour Combrémond et Maison Méane.

Le 24 juillet 1943, à l’issue d’une réunion qui dure 10 heures, le Grand Conseil Fasciste vote la destitution de Mussolini. Dès la nouvelle connue, tous les Italiens de l’armée d’occupation qui le peuvent essaient de rentrer en Italie avec armes et bagages. Les Italiens se démobilisent d’eux mêmes ; le seul mot d’ordre est : « a la casa ! » (à la maison !). Cependant, le 7e Alpini rentre au pays en bon ordre et rejoint Cuneo avant qu’à Maison Méane, la GaF n’ait établi des coupures pour interdire le col de Larche !
Ainsi, après le départ des Italiens,… et avant l’arrivée des Allemands, Maison Méane va être libre à peine 8 jours. L’administration française s’y ré installe.
Mais les Allemands remplacent rapidement les Italiens, entre le 31 juillet et le 10 août 1943. Leur première préoccupation est avant tout de se saisir des Italiens ‘‘retardataires’’ dans leur retour au pays. Les postes de douane (allemands) sont rétablis et les douaniers français doivent collaborer avec les douaniers allemands pour arrêter les Italiens. Ainsi, au bout de 9 mois d’occupation ‘‘tranquille’’ par les Italiens, Larche et toute la vallée de l’Ubayette se trouvent occupés par les Allemands. Les nouveaux occupants commencent par instituer le couvre feu de 21 h à 6 h du matin et leur présence sera plus pesante pour les populations que celle des Italiens. En particulier, l’activité des gardes frontière allemands, bien qu’il s’agisse le plus souvent d’hommes âgés et las de la guerre, va mettre un sérieux coup d’arrêt à la contrebande qui permettait aux habitants des hameaux de la vallée d’améliorer le quotidien ! Mais les événements se précipitent : le 3 septembre, les Italiens signent un armistice secret avec les Alliés, puis leur reddition le 8. Dès le 9 septembre, l’occupation allemande se durcit, tant vis à vis de la population française que des Italiens encore présents en France. A Gap, il y a 7 tués et une quarantaine de blessés italiens et une dizaine de morts côté allemand dans les combats qui opposent les anciens alliés. Le 12 septembre, le Duce est libéré par les commandos SS de Skorzeny ; le 15, Mussolini annonce son retour au pouvoir alors que le même jour la peine de mort est décrétée pour tout Italien porteur d’une arme en territoire occupé par les Allemands. Le 23 septembre, Mussolini proclame la République Sociale Italienne (RSI) à Salo dans le nord de l’Italie. Le 13 octobre, le gouvernement italien de Badoglio déclare la guerre à l’Allemagne aux côtés des Alliés. Ainsi, les Italiens, parmi ceux qui ont le caractère le mieux trempé, vont réagir dans deux directions opposées : les uns vont se rallier à la RSI et en former les nouvelles unités militaires sous instruction puis commandement allemands ; les autres forment les premières brigades de partigiani et récupèrent armes, munitions et matériel abandonnés dans la débandade, soit le long des routes, soit dans les ouvrages de défense à la frontière.
Cependant, pour le Haut Commandement allemand, les Alpes occidentales, en cette fin d’année 1943, n’ont pas dans l’immédiat d’importance stratégique. Aussi, les Gebirgsjäger venus de Besançon lors de la reddition italienne sont rapidement remplacés par des troupes de deuxième ordre : 157e division de réserve et divers détachements de services, stationnés dans les villes et bourgades principales et gardant les axes essentiels. On note en particulier la présence d’« Osttrupen » (littéralement « troupes de l’Est ») aux attitudes parfois opposées : ‘‘mongols’’ qui feront preuve d’une sauvage barbarie dans le secteur de Briançon ; polonais ‘‘malgré eux’’ qui changeront de camp en 1944. Côté italien, ce sont les Brigades Noires néo fascistes qui garderont les principaux passages.
Dans les Basses Alpes, dès novembre 1942, s’ébauchent les premiers réseaux de Résistance ; puis, avec l’instauration du STO en février 1943, les maquis apparaissent. Ils s’y développent ensuite mais les mouvements et réseaux sont multiples et imbriqués, parfois concurrents entre eux voire antagonistes sur les plans idéologique et politique. Toutefois, dès juin 1943, dans le secteur Ubaye, MUR et ORA s’unissent : c’est une véritable fusion FFI avant l’heure. Cependant, l’Ubayette ne connaîtra pas d’actions particulières de guérilla ou de sabotage jusqu’en juin 1944. Néanmoins, divers événements liés à la Résistance concernent la région de Larche et la vallée de l’Ubayette.
Plusieurs actions ont pour objectif de se ravitailler en armes et munitions dans les anciennes lignes et fortifications frontalières italiennes abandonnées ou auprès des partigiani.
Fin 1943, sur instruction du commandant Bureau, responsable militaire de la Résistance en Ubaye, Jean Isaia et un groupe de gendarmes vont récupérer, dans les anciennes installations italiennes du col de Sautron, 3 mitrailleuses et 5 000 cartouches ; ils en constituent un dépôt d’armes dans les rochers de Viraysse.
Au printemps 1944, Jean Lippmann (alias Lorrain) à la tête d’un groupe du maquis de Laverq va de Faucon (près de Barcelonnette) au col des Monges par le Pas de Grégoire, le bois de la Silve (certains y rebroussent chemin tellement le sentier est escarpé) et Certamussat. Au col, à 2 540 m d’altitude, par un froid sibérien, les résistants italiens leur remettent 4 mitrailleuses Fiat et une grande quantité de munitions. Le petit groupe attend ensuite la nuit tombée pour prendre le chemin de retour, faisant halte pour une partie de la nuit à l’ouvrage de Roche la Croix qui, bien qu’inoccupé par les Allemands, aurait pu se révéler être un piège. Les armes ont été camouflées au passage dans une cache rocheuse au bord de l’Ubayette. Le lendemain deux contrebandiers sont abattus alors qu’ils tentent le passage dans cette zone où l’alerte a été donnée depuis la veille par l’expédition du groupe de maquisards.
Enfin, sans doute sur renseignement ou dénonciation, le 1er mars 1944, les Allemands fouillent systématiquement toutes les maisons des villages et hameaux de la vallée de l’Ubayette, à la recherche d’armes cachées. A Larche, Etienne Vinay et son fils sont arrêtés et déportés.
Après plusieurs contacts, de février à mai 1944, entre la Résistance française et les Partisans italiens, des délégations se rencontrent au col de Sautron dans la nuit du 11 au 12 mai pour une réunion préliminaire. Le 22 mai est négocié, au moulin Chabre à Barcelonnette, un accord militaire signé par J. Lécuyer (‘‘Sapin’’) et Duccio Galimberti ; puis, le 30 mai, à Saretto, un accord politique est scellé entre D. Livio Bianco et Max Juvénal. Le premier de ces accords, connu sous le nom de Pacte de Barcelonnette, prévoit entre autres une assistance mutuelle pour le recueil, par l’un ou par l’autre, des résistants bousculés par l’ennemi ; il sera plus ou moins appliqué, comme on le verra plus loin, dans le sens France Italie en juin et juillet 1944. Il jouera également, un peu dans les mêmes conditions difficultueuses, en sens inverse dans la région de la haute Tinée (secteur d’Isola).
Deux réunions des responsables départementaux à Barcelonnette, en avril et mai 1944, ont fixé la mission des FFI de l’Ubaye en cas de débarquement allié : « Se rendre maître le plus tôt possible de la vallée, afin de disposer d’une zone de liberté absolue où seront parachutés personnel et matériel. Amorcer ainsi la constitution d’une zone franche appelée à s’étendre par la suite ». Cette mission implique des combats en véritable bataille rangée, aussi certains (l’état major FTP en particulier) n’y sont pas favorables et préconisent la guérilla avant tout.
Le 3 juin, le message d’alerte « Le gendarme ne dort que d’un œil » est diffusé par la BBC, suivi le 5 juin à 21 h 15 du message « Méfiez vous du toréador » signifiant que l’action doit commencer le lendemain 6 juin à minuit.
Divers bouchons vont être mis en place pour isoler la région de Barcelonnette : en aval, dans les secteurs Lauzet (Pas de la Tour) la Bréole Ubaye et sur les routes de la Cayolle et d’Allos ; en amont, au Melezen (route de Vars), au Pas de la Reyssole et pour l’Ubayette à la Rochaille.
L’action est déclenchée dans la nuit du 6 au 7 juin et se déroulera en trois épisodes : du 7 au 9 juin, attaque des garnisons allemandes par les FFI (combats du Sauze, de Jausiers et de la Chaup) les 9 et 10 juin, réactions ennemies (combats du Pas de la Tour et tentative de sortie de la garnison du Sauze) du 11 au 13 juin, combats retardateurs puis repli et dispersion (combats du Pas de la Reyssole et du Pas de Grégoire).
La première opération qui concerne l’Ubayette est donc d’abord la mise en place du bouchon de la Rochaille (entre les Gleizolles et Meyronnes) par les lieutenants FFI Jubelin et Restelli dans la nuit du 6 au 7 juin ; dès le 8 juin, le commandant allemand de la garnison de Larche réquisitionne la population de la vallée de l’Ubayette pour rétablir la route. De peur d’atteindre les civils requis, les Résistants n’ouvrent pas le feu. Ce 8 juin (ou le 10 selon les sources), Pierre Barrely avec 15 hommes et 6 mulets récupèrent des armes et des munitions au col des Monges et au col de Sautron. Dans la vallée de l’Ubaye, Barcelonnette et Jausiers ainsi que leurs environs sont ‘‘libérés’’.
Colonel Henri Zeller (alias Joseph, alias Faisceau)
Responsable national ORA ; se voit confier par le COMAC en avril 1944 la coordination FFI entre les régions R1 et R2.
Colonel Louis Cusenier (alias Josse)
Adjoint du colonel Zeller ; en avril 1944, commandant ORA de la Zone Alpine.
Georges Bonnaire (alias Jean Bernard, alias colonel Noël)
Officier de liaison FTP auprès de l’EM régional FFI en juin 1944 ; devient le 12 août Responsable départemental FFI pour les Basses Alpes, à la suite du conflit qui oppose AS et ORA (‘‘Levallois’’ et ‘‘Sapin’’). *******
Responsables Régionaux FFI Région R2 (à partir de mai 1944)
Robert Rossi (alias Levallois)
Chef régional
Capitaine Jacques Lécuyer (alias Sapin)
Chef d’état major
Capitaine Ceccaldi (alias Bob)
Adjoint au chef d’état major
Max Juvénal (alias Maxence)
Responsable politique
En mai 1944, une réunion du CDL admet et reconnaît un commandement militaire unique :
Chef départemental : capitaine François-Xavier Chaumont (alias Christophe) (ORA)
Chef d’état-major : capitaine Max Morin (alias Latour) (AS).
Le 5 juillet, à la réunion du CDL à Laragne, Morin est pressenti comme nouveau chef départemental FFI.
Le 4 août, lors d’une réunion du CDL au col St Jean, c’est ‘‘Noël’’ qui est pressenti. Morin fait alors signer une pétition en sa faveur à tous les chefs des secteurs et des districts AS.
Le 12 août, le colonel ‘‘Noël’’ est confirmé comme chef départemental FFI. *******
Dans la vallée de l’Ubaye, les organisations de Résistance seront toujours assez indépendantes des structures des différents mouvements. Toutefois, très tôt, dés juin 1943, l’union en Ubaye des MUR et de l’ORA, préfigure la fusion FFI.
En juin 1944, la structure du secteur FFI repose sur : Commandant de secteur : René Chabre
Adjoint au commandant de Secteur : Emile Aubert Commandant militaire : commandant Bureau Adjoint au commandant militaire : capitaine Delanef Chef des services civils : Louis Blanchard.
Le Chef de la R2 française et le Commandant Militaire du Deuxième Secteur Piémontais,
En présence du délégué du Comité de Libération Nationale du Piémont, du délégué de la R2 en Piémont, du représentant du Troisième Secteur Piémontais, de l’adjoint au Chef de la R2, dans le cadre des accords établis par le délégué du Comité Militaire de Libération Nationale du Piémont avec les représentants militaires de la R2, pris acte de l’identité des buts poursuivis par les respectives formations, de la fraternité d’armes existant entre les patriotes français et italiens, ont décidé d’établir une étroite collaboration sur le plan opératif dans le but d’obtenir les meilleurs résultats dans la lutte contre les nazis.
En conséquence, le Commandant Militaire du Deuxième Secteur Piémontais, et le délégué de la R2 en Piémont, mettront au point :
1) un plan des destructions à effectuer sur les cols routiers en nos pays dans la zone ;
2) un plan visant à l’élimination des garnisons allemandes dans la zone ;
3) des liaisons continuées de façon à réaliser une entr’aide d’une coïncidence en les lignes d’action dans le futur.
D’ores et déjà est prévue une étroite collaboration entre les respectives forces de la résistance dans la phase insurrectionnelle qui devra assurer la conquête des libertés démocratiques.
(Signé) Jacques LECUYER Duccio GALIMBERTILe Chef de la R2 des Mouvements Unis de Résistance et le Délégué du Comité de Libération Nationale du Piémont ;
A la suite des cordiales conversations eues dans un cadre de mutuelle compréhension ; Expriment, au nom des organisations qu’ils représentent, la satisfaction pour le retrouvement d’une base d’entente commune ; Déclarent qu’entre les peuples français et italien il n’y a aucune raison de ressentiment et de heurt pour le récent passé politique et militaire, qui engage la responsabilité des respectifs gouvernements, et non pas celle des mêmes peuples, tous les deux victimes de régimes d’oppression et de corruption ; Affirment la pleine solidarité et fraternité franco italienne dans la lutte contre le fascisme et le nazisme, et contre les forces de la réaction, comme nécessaire phase préliminaire de l’instauration des libertés démocratiques et de la justice sociale, dans une libre communauté européenne ; Reconnaissent qu’aussi pour l’Italie, ainsi que pour la France, la meilleure forme de gouvernement pour assurer le maintien des libertés démocratiques et de la justice sociale, est celle républicaine ; S’accordent pour engager les forces des respectives organisations dans la poursuite des buts comme çi dessus définis, dans un esprit de pleine entente et sur un plan de reconstruction européenne.
(Signé) Max JUVENAL Livio BIANCONDLA : Les signataires italiens font partie des formations « Giustizia e Liberta » (gauche non marxiste). On notera les nombreux italianismes dans la rédaction du texte qui aurait été écrit par les Italiens directement en français.
Le samedi 10 juin, le colonel Cusenier et le commandant Bureau mettent sur pied un plan d’action combinée avec les maquis italiens sur Larche. Les partigiani doivent procéder à une attaque frontale sur le col et le village et à deux actions d’enveloppement par le nord par les cols des Monges et de Sautron. Du côté français, il s’agira d’une attaque de front en remontant la vallée avec une action en tenaille, au nord par le plateau de Mallemort et au sud sur la rive gauche de l’Ubayette par le bois de la Lauze. Malgré cette volonté de garder l’initiative, l’inquiétude du commandement FFI est grande car les événements dans la vallée de l’Ubaye ne sont pas des plus favorables ; l’ennemi réagit vivement et les maquisards ont toutes les peines à tenir sur leurs bouchons.
Finalement, l’action sur Larche n’aura pas lieu. Bien au contraire, le lundi 12 juin, devant la mauvaise tournure des combats, un projet de repli sur l’Italie est proposé et approuvé au cas où l’ultime bouchon au nord, au Pas de Grégoire, serait enlevé par l’ennemi.
Le lendemain, mardi 13 juin, le commandant Bureau donne à 17 h l’ordre de décrochage pour la tombée de la nuit. Ce dernier avec les hommes de son PC gagne la région de Ferrières en Italie où ils arrivent le 15 juin à 14 h. Il tente ensuite une reconnaissance vers Pietraporzio dans la Valle Stura, mais les Allemands de Larche ont passé le col et contrôlent Argentera, Bersezio et l’amont de la Valle Stura. En outre, l’accueil des maquisards italiens est peu enthousiaste et le podestat demande même que les FFI retournent en France ! Le samedi 18 juin, après avoir erré près de quarante huit heures entre Bersezio et le col du Fer, le commandant Bureau et ses compagnons regagnent Bayasse. Il établit son nouveau PC à la bergerie des Sanguinières.
La vallée de l’Ubaye est occupée en force par les Allemands jusqu’au 19 juin, puis le gros de leurs forces est dirigé vers d’autres théâtres d’opérations, notamment vers le Vercors. L’ensemble des Résistants, environ 250 hommes, se dispersent donc dans la montagne et vont vivre dans les chalets d’altitude et les bergeries d’alpage. Le 22 juin, une réunion des principaux responsables au PC des Sanguinières décide de maintenir la dispersion, de modifier le stationnement des groupes et de préparer de nouveaux plans d’action. Les liaisons se multiplient avec les partisans italiens. Ainsi, le commandant Bureau est conduit par le gendarme Sauveplane de Jausiers à Maurin ; de là, il gagne Acceglio en Haute Maïra où il est reçu par Picco, l’officier de liaison des maquis italiens qui avait été détaché à Barcelonnette du 6 au 9 juin. Il se rend le 26 à Campiglione pour être de retour à Acceglio le 28. Il a ensuite contact du 29 juin au 1er juillet avec la Brigade Garibaldi (Parti Communiste Italien) de Mario. Les 2 et 3 juillet, contact, cette fois ci côté français, avec J.P. Cuin, sous préfet de Barcelonnette. Du 5 au 10 juillet, Bureau séjourne à nouveau dans la région d’Acceglio, puis visite le maquis de Picco à Ussolo à deux reprises. L’impression qu’il retire de ces contacts est que, si la population est favorable, les maquis italiens sont quant à eux « indisciplinés, mal armés et fanfarons »
Emile Aubert de son côté a chargé le lieutenant Tanet de prendre contact avec les partigiani pour obtenir des armes et munitions (il en reste encore beaucoup abandonnées dans les fortifications frontalières). Ainsi, le 27 juillet, le lieutenant Tanet et le gendarme Vaux prennent livraison auprès des maquisards italiens de 4 mitrailleuses Fiat, de 2 mortiers de 81 et de leurs munitions ; le tout est transporté d’Italie en France par une trentaine de mulets.
A partir du 29 juillet, le PC des FFI de l’Ubaye est transféré à Enchastrayes. Le début du mois d’août est consacré à la réorganisation avec la création du bataillon FFI de l’Ubaye composé de cinq compagnies, chacune de 50 à 60 hommes, réparties en quatre compagnies de voltigeurs et une compagnie de mitrailleurs.
Dans la première quinzaine d’août, dans la Valle Stura, une importante concentration de troupes italo germaniques se rassemble dans le secteur de Borgo San Dalmazzo.
Le 13 août, Emile Aubert conduit au PC d’Enchastrayes auprès du commandant Bureau, trois britanniques qui viennent d’être parachutés à Seyne-les-Alpes : le major Hamilton, le capitaine ‘‘John’’ (Halsey) et l’aspirant ‘‘Rudolph’’ (Fernandez), qui ont avec eux 800 kg d’explosifs pour la vallée de l’Ubaye. Le plan des destructions et obstructions est établi : route de Vars au Melezen, RN 100 au Pas de Grégoire, route de Larche à la Rochaille. Le jour même du débarquement en Provence, le 15 août, un message arrive d’Alger à 14 h indiquant que le col de Larche fait partie du plan de blocage des passages alpins (avec le Mont Cenis, le Montgenèvre et le Petit Saint Bernard) ; la phrase code pour destruction et blocage prolongé, à effectuer sous quarante huit heures, sera « Voir Naples et mourir ». C’est en fait dès la nuit du 14 au 15 août que ‘‘John’’ et ‘‘Rudolph’’ ont fait sauter la route de la Rochaille sous la protection d’un groupe de FFI. En l’absence du lieutenant Cogordan du service du génie qui connaît les emplacements des fourneaux, deux d’entre eux seulement ont pu être trouvés. Le résultat du dynamitage est donc très moyen : deux brèches qui ne se rejoignent pas et qui pourraient donc être très rapidement réparées !
L’état major FFI de l’Ubaye a soumis son plan d’action sur Larche à Alger. Le 16 août, à 13 h 40, passe à la BBC le message « Voir Naples et mourir » et, à 21 h, Alger envoie son accord pour l’opération de Larche à exécuter rapidement. Les moyens dont disposent les FFIU pour attaquer la garnison allemande de Larche sont insuffisants pour envisager un combat frontal. Aussi est ce par d’autres moyens, la ruse et la négociation, que la reddition va être recherchée. Ainsi, du fait que la garnison allemande de 108 hommes est composée pour plus de moitié de Polonais, l’agent ‘‘Pauline’’ (parachutée le 7 juillet au Vercors et arrivée au PC d’Enchastrayes le 1er août avec le major écossais Gunn alias ‘‘Bambus’’) va être mise à contribution ; ‘‘Pauline’’, Christine Granville (de son vrai nom Krystina Skarbek), est en effet d’origine polonaise ; elle est l’agent de liaison de Francis Cammaerts (‘‘Roger’’), chef du réseau Buckmaster ‘‘Jockey’’ du SOE anglais pour le Sud Est. Le gendarme Macari tentera aussi d’entrer en relation avec les Polonais. L’explosion de la Rochaille, la nuit du 14 au 15 août, n’a pas attiré l’attention des Allemands comme le signale le 15 après midi le sergent Gaston resté en surveillance sur place. Aucune patrouille n’a alors poussé jusque là. Après s’être enfin rendu compte de la destruction, le 17 août, les Allemands réquisitionnent les habitants de Meyronnes et le service des Ponts et Chaussées pour réparer, sous peine de représailles, la route et les lignes téléphoniques qui ont aussi été sabotées. A 14 h, les maquisards simulent une attaque ; les travailleurs requis ont été avertis et s’éparpillent, laissant ainsi le champ libre à la 1re compagnie FFIU du lieutenant Derbez pour mieux ajuster les gardes allemands ; ceux ci ont rapidement un blessé grave et se replient sur Larche.
Le lendemain 18 août, l’officier commandant la garnison de Larche exige une entrevue avec le sous préfet J. P. Cuin et l’envoi d’un médecin pour soigner le blessé de la veille. Le sous préfet fait croire qu’il se rend à la convocation, mais téléphone de la Condamine que les maquisards l’ont (prétendument) bloqué en route et qu’il ne peut parvenir à Larche. Le médecin lieutenant Hureaux de l’Ecole d’Apprentissage de Jausiers, remplit quant à lui la mission médicale et ramène le blessé à l’hôpital de Barcelonnette. L’après midi, le capitaine Ceccaldi (‘‘Bob’’), adjoint du capitaine Jacques Lécuyer (‘‘Sapin’’) chef de la région R2, apporte au PC de Barcelonnette un document destiné à être porté à la garnison de Larche comme ultimatum pour obtenir sa reddition. La mission risquée de porter ce document à Larche est confiée à un maquisard qui doit se racheter d’une coupable défaillance. Cette mission est couronnée de succès puisque le samedi 19 août le lieutenant allemand accepte en fin d’après midi de recevoir des officiers de l’armée régulière.

A 19 h, le sous préfet Cuin, le capitaine ‘‘John’’ et le capitaine Ceccaldi, qui a revêtu pour la circonstance un vieil uniforme de chasseur alpin, rencontrent l’officier allemand à Meyronnes. Il semble que ce soit alors, pendant ce temps là, que se situe l’intervention de ‘‘Pauline’’ qui va s’adresser aux Polonais dans leur langue. En attendant le résultat de ces interventions et négociations, par précaution, le commandant Bureau fait mettre en disposition de combat une centaine de FFI à la Rochaille, prêts à l’attaque au cas où les pourparlers échoueraient.
Dans la nuit du 19 au 20 août, vers 2 h du matin, 63 Polonais (48 selon d’autres sources) désertent avec armes et bagages, après avoir même saboté les armes lourdes restées sur place en enlevant les culasses. Ils rejoignent les lignes FFI à la Rochaille. Peu après, arrive également ‘‘John’’ avec l’officier allemand qui a finalement accepté la reddition. Le reste de la garnison suit dans la matinée du 20 août, sous la conduite du capitaine Ceccaldi. Seuls sept Allemands passent en Italie et vont rejoindre les unités importantes qui se massent en Valle Stura.
Le village de Larche est ensuite évacué de ses habitants pour vingt quatre heures, car ‘‘John’’ avait demandé un appui d’aviation au cas où il aurait fallu attaquer Larche de vive force si les négociations avaient échoué. Il est trop tard pour décommander l’intervention, aussi de grandes croix de Lorraine sont elles confectionnées avec des draps blancs dans les prairies avoisinantes. Ce samedi 20 août, dans l’après midi, la 2e compagnie des FFIU du lieutenant Devaux monte tenir Larche.
Dimanche 21 août, la position de Larche et ses possibilités de défense sont étudiées en détail par le commandant Bureau, le capitaine Delanef son adjoint, et le lieutenant Cogordan du génie. Un plan de défense est élaboré, mais, sans appui d’artillerie, il ne saurait être question de résistance à outrance. En fait, il s’agira plutôt d’un combat de retardement sur plusieurs lignes successives : première position de résistance à Larche, deuxième position à hauteur de Roche la Croix Saint Ours, troisième à hauteur de Tournoux. Les FFI de l’Ubaye n’étant que 250 environ, il est aussi décidé de faire appel à des résistants extérieurs à la vallée. Les FFIU tiendront la première position de résistance.
Les Américains, qui sont à Guillestre, devraient en toute logique envoyer rapidement une colonne sur le col de Larche pour s’opposer à la menace d’attaque de flanc que représente la concentration de troupes ennemies dans la Valle Stura. En effet, les Allemands, pour couvrir leur flanc ouest vis à vis de la VIIth US Army qui remonte la vallée du Rhône, ont réagi promptement ; envoyées rapidement sur l’Italie du Nord, la 90e PanzergrenadierDivision (de l’ex Afrika Korps) et des troupes de montagne ont reçu pour mission de constituer sur les versants français de larges ‘‘têtes de col’’.
Ce 21 août, vers 20 h, le lieutenant Spada, officier de liaison des maquis italiens, vient prévenir l’état major des FFI de l’Ubaye de l’imminence d’une opération d’envergure sur l’axe Cuneo Larche. C’est le KampfGruppe von Behr (PanzergrenadierRegiment 200, HochgebirgsBattalion 3 et un groupe blindé d’artillerie) qui monte vers le col de Larche.
Le 22 août, une reconnaissance sur le versant italien permet d’apprendre par des réfugiés italiens que les Allemands seraient à Bersezio, à 10 km du col. Dès 10 h, les 5 compagnies des FFIU se mettent en position et s’y organisent. Un groupe de surveillance de la 2e compagnie se positionne au col avec un poste de guet, côté italien, à Argentera. Le gros de cette 2e compagnie commandée par le lieutenant Devaux barre en avant poste (4 FM) la RN 100 à hauteur de Malboisset. La 1re compagnie du lieutenant Derbez (4 FM) se tient aux lisières du village de Larche. La 5e compagnie lourde du lieutenant de gendarmerie Woerhlé, qui a intégré les Polonais ralliés, se trouve à l’ancien ouvrage d’avant poste avec 6 mitrailleuses, 1 FM et 3 mortiers de 81, ces derniers sous les ordres du lieutenant Restelli. La
3
compagnie du lieutenant Sarrès (4 FM) occupe les anciens PA de 1893 et de 2018 et couvre le plateau de Mallemort. La 4e compagnie du capitaine vétérinaire Rapillard (4 FM aussi) s’est établie dans le bois de la Lauze, rive gauche de l’Ubayette. Le capitaine Delanef, qui commande le dispositif, donne l’ordre d’évacuer aux habitants de Larche à partir de 15 h, puis à ceux des hameaux et villages de l’Ubayette. Une partie de la population de ces derniers obtempère et se replie avec celle de Larche sur Jausiers. A Larche, seules deux personnes âgées refusent d’être évacuées : le couple Calandre. On ne reverra jamais Mme Calandre et le cadavre de son mari, décapité, sera découvert l’hiver suivant à la Rochaille ; on ne saura jamais ce qui a pu se passer. A partir de 18 h, le poste de guet d’Argentera ne répond plus au téléphone et vers 20 h, quelques réfugiés italiens franchissent le col et sont dirigés sur Jausiers. A 22 h, le commandant Bureau assure le capitaine Delanef qu’une colonne américaine devrait arriver sous quarante huit heures.
Le 23 août, l’attaque allemande débute vers 9 h 30 par un assaut d’infanterie sur le col qui dévale ensuite le versant français. La compagnie Devaux aux avant postes décroche à 10 h et, conformément au plan préétabli, se replie sur la troisième position (Tournoux). L’artillerie allemande se met en batterie un peu au sud du col et ouvre le feu à 11 h. Le combat est immédiatement intense : les forces ennemies sont estimées à un bataillon d’infanterie et à une batterie de 6 canons de 75. L’ouvrage et les compagnies FFIU ripostent de toutes leurs pièces. Cependant, dès 14 h, plusieurs armes lourdes de l’ouvrage doivent cesser le feu à la suite d’avaries. A 16 h, la situation devient sérieuse : les Allemands progressent dans leur attaque frontale, puis à la nuit tombante ils commencent à déborder par les flancs en profitant du terrain (ravines et bois). La position devient alors intenable. Avec l’accord du commandant Bureau, le capitaine Delanef ordonne le repli à la faveur de l’obscurité, à partir de 21 h 30. Sauf quelques éléments retardateurs qui rallieront un peu plus tard, les 5 compagnies FFIU atteignent Meyronnes vers minuit et vont ensuite établir la troisième position à Tournoux. Des volontaires de ces compagnies constituent une section franche qui reste à Meyronnes sur la deuxième position. Un message du colonel ‘‘Noël’’ à Bureau assure ce dernier de l’arrivée de la colonne américaine dés le lendemain. Il faut donc tenir ferme sur la deuxième position, même si cette colonne devait tarder un peu à arriver.
La deuxième position de Saint Ours Meyronnes est tenue par des maquis extérieurs à la vallée qui viennent principalement de Castellane (AS et FTP) et une compagnie FFIU, la 6e, arrivée du Lauzet où elle a été formée par le commandant Prost à qui est confié le commandement de la position. Cette deuxième position est un dispositif linéaire, dont les ailes (Saint Ours et Roche la Croix) présentent un terrain et un relief propices à la défense, mais dont le centre, en fond de vallée, est la partie désavantageuse et la plus sensible. Cette partie difficile est tenue par la 6e compagnie et la section franche. La 6e compagnie est armée d’une mitrailleuse légère et d’un FM et s’installe en surplomb de la RN 100 à hauteur de Fontvive et Meyronnes. La section franche se positionne un peu au dessous de l’ouvrage de Saint Ours Bas avec 2 mortiers de 81 et 1 FM de protection. Les ouvrages de Saint Ours Haut et Bas dont les organes essentiels ont été sabotés et pillés depuis longtemps ne peuvent être utilisés pour la défense. Une équipe de destruction est chargée de mettre à feu un fourneau de mines installé à l’emplacement de l’ancien ‘‘dispositif 93’’ entre Meyronnes et Certamussat.
Le 24 août, à 6 h du matin, deux jeeps avec un officier américain (lieutenant Frank envoyé par le lieutenant colonel David P. Faulkner commandant le 2e bataillon du 142e régiment de la 36e DI US) arrivent au PC de Bureau à la Condamine ; ce dernier monte jusqu’à Saint Ours avec les Américains pour leur expliquer la situation. Les jeeps repartent ensuite sur Guillestre, les Américains promettant l’arrivée rapide d’une colonne.

Du fait de l’avancée ennemie, les populations civiles restées sur place s’enfuient dans la montagne : les habitants de Saint Ours vers le col de Mirandol (quand ils essayeront de revenir chez eux quelques jours plus tard, les Allemands les ‘‘déporteront’’ en Italie à Sambuco) et ceux de Certamussat dans le quartier de la Duyère où ils vécurent très chichement pendant près d’un mois avant de redescendre sur Jausiers puis d’être accueillis comme réfugiés à Méolans.
A 9 h 15, l’attaque ennemie commence, comme la veille à Larche, par un assaut frontal d’infanterie. A 9 h 30, le dispositif 93 saute et l’ennemi débouche de Certamussat. A 10 h, la bataille à coups d’armes automatiques fait rage et, à 10 h 10, l’artillerie allemande ouvre le feu. Les Allemands progressent vers Meyronnes ; les deux mortiers ne peuvent intervenir à la suite de la défectuosité des munitions et la mitrailleuse légère de la 6e compagnie est mise hors de combat vers 11 h 30.
Malgré la pénurie de munitions qui menace, les FFIU continuent de résister en fond de vallée ; c’est alors, vers 11 h 40, que pour des raisons qui resteront obscures les éléments FTP qui tiennent l’aile gauche décrochent brusquement. Aussitôt les FFIU se trouvent attaqués de flanc et même de dos. Le centre et l’aile droite du dispositif vont encore résister pendant presque une heure alors qu’ils sont largement tournés. A 12 h 30, ils décrochent et au prix de lourdes pertes atteignent, vers 14 h, la Rochaille, où ensuite des camions les évacuent vers la troisième position à Tournoux.
Sur ces entrefaites, un officier américain revenu au PC de Bureau l’informe que la colonne ne viendra pas ; elle a reçu une autre mission. A 14 h 30, à la Rochaille, Bureau accompagné de l’officier américain et d’un officier anglais, vient se rendre compte de la situation et tenter de convaincre Delanef de résister encore sur la deuxième position ; ils sont alors pris sous le feu des mitrailleuses allemandes : il est grand temps de se replier ! Le lieutenant Restelli reste un peu en arrière et fait à nouveau sauter la route à la Rochaille. La jeep de l’officier américain repart ensuite vers Vars tandis que les compagnies FFIU sont regroupées à Barcelonnette, puis dirigées dans la nuit sur Seyne les Alpes. Seule la 2e compagnie reste à monter la garde sur la position de Tournoux.
Le 25 août, à 10 h, la 2e compagnie rejoint Barcelonnette ; seuls quelques éléments restent en surveillance à Tournoux et au Châtelard. Le commandant Bureau et le capitaine Delanef installent leur PC à Barcelonnette. Les Allemands ne franchissent pas la coupure de la Rochaille et ne poursuivent pas leur attaque. En fin de journée cependant une patrouille allemande, apparemment égarée, est repérée alors qu’elle descend vers Jausiers par les Sagnes ; aussitôt accrochée par un groupe de FFI de l’Ubaye, elle est refoulée. Le groupement FFI de Saint Auban relève alors les FFIU et installe des barrages tout autour de Jausiers.
En fait, le KampfGruppe a atteint l’objectif que lui avait fixé le Haut Commandement : « les hauteurs à l’est de la Condamine » ; il s’est en outre infiltré par le plateau de Bouchiers, le col de Mirandol et celui du Vallonnet, en direction de Fouillouse et de Saint Paul. Des éléments du groupe Tito (maquis FTP de Seyne en surveillance au Châtelet) sont pris à partie par une patrouille allemande sur la route entre Saint Paul et la Condamine et perdent un tué (René Pellegrin alias Tarzan) et deux blessés.
A 21 h, deux autos mitrailleuses et deux jeeps américaines arrivent à Barcelonnette, puis patrouillent entre la Condamine et Jausiers. Il s’agit de la 2e section de la compagnie A du 117th Cavalry Reconnaissance Squadron (Captain Piddington).
Le 26 août, tôt le matin, se tient une réunion à la sous préfecture pour faire le point sur la situation. Les Allemands apparemment n’ont pas l’intention de poursuivre plus avant dans la vallée de l’Ubaye. Le nouveau plan consiste donc à contrôler et garder le front de Tournoux à Saint Etienne de Tinée, le commandant de secteur estimant que, pour éviter
toute surprise, la défense de l’Ubaye doit comporter aussi celle du massif du Restefond. Ce plan sera d’ailleurs approuvé, quinze jours plus tard, par le commandement américain qui se mettra en place dans la région. A 10 h, le commandant Martinot à la tête d’un commando de 150 hommes extérieur à la vallée prend position au Villard et à Tournoux, renforcé par un petit groupe de la SAP de Seyne.
Le dispositif des FFI de l’Ubaye qui se met en place est alors le suivant :
1re compagnie : Cuguret Lans les Gréoux les Sagnes ; interdiction du vallon des Sagnes
2e compagnie : de Bayasse jusqu’à Saint Dalmas le Selvage par la Moutière ; interdiction du vallon de Sestrière
3e compagnie : Bayasse avec surveillance de la frontière ; interdiction de la Haute Tinée
-
4e compagnie : les Fourches - Las Planas ; interdiction des cols de Pouriac, du Fer et du Pas de la Cavale
5e compagnie : cantonnement d’alerte à la Maure les Molanès près de Barcelonnette
6e compagnie : le Lauzet ; assurer la défense de la coupure du Pas de la Tour.
Les autos mitrailleuses et jeeps américaines poussent les patrouilles jusqu’aux Gleizolles. Leur présence suffit à tenir en respect les Allemands qui, de toute évidence, ont pour seule mission d’éviter toute tentative de pénétration en Italie par le col de Larche. La route de Saint Paul, bien que sous le feu de l’ennemi, est encore libre ; aucun pont n’a sauté. Dans la nuit, la Condamine est bombardée par l’artillerie allemande.
Le 27 août, le commandant Bureau rencontre à la Condamine le capitaine André qui commande un maquis au col de Vars, venu avec un officier américain par la route stratégique de Vallon Claous. Les autos mitrailleuses et jeeps patrouillent toujours jusqu’aux Gleizolles et même vers Roche la Croix. Entre 17 h et 18 h, nouveau violent bombardement sur la Condamine par obus de 75 et de 105 (l’artillerie allemande s’est donc renforcée) ; une partie du village est incendiée et, à 1 h du matin, l’ordre d’évacuer est donné aux derniers habitants qui n’ont pas fui dans la journée.
Le 28 août, à 8 h, la Condamine est complètement évacuée. Les Allemands continuent à occuper systématiquement le terrain et poussent des reconnaissances tous azimuts, en particulier vers le Restefond et la Haute Tinée (Pas des Terres Rouges, col du Quartier d’Août, col de Pouriac, col du Fer). Leur ligne passe par Serre la Plate la Rochaille Roche la Croix Crête d’Abriès. Après le bombardement de la nuit, le commando Martinot se replie sur le Châtelard et le Villard. Quelques habitants de Maison Méane qui ont fui les combats le 23 août en se réfugiant dans la montagne réussissent à gagner Jausiers en descendant par les pentes escarpées et vertigineuses de la Côte d’Abriès. Ils donnent de précieux renseignements sur les positions ennemies. Le lieutenant Jubelin, déguisé en berger, ira le 30 août vérifier sur place ces renseignements. Dans la soirée les deux autos mitrailleuses et les deux jeeps américaines rejoignent leur unité. Durant la nuit, après un violent bombardement d’artillerie, les Allemands viennent à la Condamine où ils incendient une partie du village et posent des mines un peu partout.
Le 29 août, le secteur reste relativement calme. Seules de sourdes explosions sont entendues dans la matinée vers Tournoux : les Allemands ont fait sauter les ponts, celui sur l’Ubaye aux Baraquements et ceux sur l’Ubayette et sur l’Ubaye de part et d’autre des Gleizolles. Dans l’après midi, venant du sud, le 550th Team de la 1st Air Borne Task Force (ABTF) arrive à Barcelonnette. A minuit, les Allemands reviennent à nouveau à la Condamine et mettent le feu au village dont toute la partie située sur la rive gauche du torrent du Parpaillon flambe.
Le 30 août, l’ennemi se montre mordant dans le secteur de la Condamine où il y a plusieurs accrochages. La compagnie de Saint Auban envoie une section de voltigeurs renforcer le commando Martinot vers le Châtelard.
Le 31 août, les Américains relèvent progressivement les FFI dans la vallée de l’Ubaye. Commencée à 11 h au Châtelard et au Villard, la relève est terminée vers 16 h à Jausiers avec l’installation de l’artillerie au ravin des Poux et la mise en place des tanks destroyers à Plan la Croix. Le colonel Sachs, commandant américain du secteur, demande pour son PC un officier de liaison FFI. Le secteur Ubaye est alors complètement passé sous commandement américain.
Le 1er septembre, opérations de nettoyage dans le vallon des Sagnes.
Le 2 septembre, le colonel ‘‘Noël’’, Responsable départemental FFI, donne au commandant Bureau une nouvelle mission : « Le commandant Bureau, Chef du Secteur Ubaye, est chargé de mission auprès de l’EM américain du Secteur (colonel Sachs). Cette mission consistera à coordonner les opérations des troupes américaines et celles des unités FFI. Le commandant Bureau restera de façon permanente auprès de l’EM américain jusqu’au départ de celui ci pour un autre secteur d’opération. Il prendra toutes dispositions utiles pour se faire suppléer provisoirement dans son commandement de secteur. Signé : Noël ». Le commandant Bureau nomme en conséquence le capitaine Delanef ‘‘commandant des troupes FFI du secteur Ubaye’’. C’est donc ce dernier qui règle dans les jours qui suivent les mouvements de relève dans le secteur.
Ce 2 septembre, le lieutenant Jubelin est de retour de sa mission d’observation. Il a repéré 3 batteries allemandes : une au ravin du Pinet à l’est du pont de la RN 100, une autre près de Certamussat entre la route et l’Ubayette, une dernière à Malboisset au carrefour de l’ancienne route de Maison Méane et du chemin du Lauzanier. Il apporte aussi de précieuses précisions sur les effectifs, les mouvements de troupes et leur ravitaillement.
Du 3 au 5 septembre, divers mouvements de relève ont lieu et plusieurs accrochages se déroulent dans la zone les Sagnes Restefond Haute Tinée.
7 - 11 septembre : tentative de reconquête de la ‘‘tête de col’’ : « l’affaire du col de Larche »
Après la libération de Briançon les 5 6 septembre, une opération est programmée pour le 7 pour reprendre Larche. Elle doit être menée sous les ordres du colonel Molle (2e DIM) par le colonel Leblanc (1er GTM) avec un bataillon de tirailleurs, un tabor marocain, divers éléments américains stationnés à Jausiers (colonel Sachs), les FFI de l’Ubaye (commandant Bureau) et plusieurs bataillons FTP ; en face, les Gebirgsjäger de la 5e division (troupes de montagne) ont relevé les Panzergrenadiere du Regiment 200 à la fin du mois d’août. Ces derniers ont laissé un graffiti à la peinture noire, toujours visible, sur le Bloc 2 de l’ouvrage de Saint Ours Haut, lui donnant sans qu’on sache trop pourquoi le surnom de « Bunker Atemnot » (Bunker ‘‘Suffocation’’).
Saint-Ours Haut. Bloc B2.



Intention : amener sur les crêtes Saint Ours Viraysse des éléments susceptibles de couper toute circulation dans la vallée Meyronnes Larche. Agir à la faveur des circonstances. Demander aux Américains de Jausiers de se porter sur Larche par le col du Quartier d’Août de façon à compléter l’encerclement des Allemands qui tiennent la vallée. Commandement et moyens : confier l’opération au colonel Blanc, disposant du Tabor Leboiteux, du Bataillon Latourette et des FFI, appuyés par toute l’artillerie disponible, groupe de montagne et groupe Girard (tout ou partie).
Schéma : 1) Par le col de Vars, occuper la vallée de Saint Paul à Grande Serenne, en se couvrant face au Sud (Pas de la Reyssole) et face à l’Est (Castelet).
2) Partant de cette vallée, accéder aux : a) Col de Mirandol (3/4ème RTM) b) Col du Vallonnet par Fouillouse (Tabor Leboiteux)
3) Agir ensuite en direction de Meyronnes Larche, suivant les renseignements recueillis.
Artillerie :
a) Montagne : marchera avec le Tabor et recherchera des positions vers Fouillouse de manière à pouvoir tirer dans la région de Viraysse Larche et au delà. b) Groupe Girard : prendra dès que possible à partie les objectifs de la région Meyronnes Roche la Croix Larche. Positions à rechercher sur l’axe de Vars Saint Paul. Le col ne peut être dépassé avant l’occupation par nos troupes de la crête de Mirandol.
Horaire général :
a) Nuit du 6 au 7 septembre : occupation de Saint Paul et Grande Serenne. Mise en place des bouchons de la vallée.
b) Nuit du 7 au 8 septembre : occupation des cols du Vallonnet et Mirandol.
c) A partir du 8 septembre, 7 heures : action combinée sur Larche en liaison avec les Américains.
Signé : MOLLE
Commandant l’Infanterie de la 2e DIM

Le colonel Sachs a chargé le commandant Bureau de concevoir la manœuvre pour les FFI et les Américains en précisant que, s’il donnera tous les appuis d’artillerie demandés, il ne peut mettre à disposition qu’une unité de fusiliers. Le schéma proposé par le commandant Bureau, le capitaine Delanef et le lieutenant Jubelin est approuvé sans réserves. La manœuvre consiste à prendre en tenaille la ‘‘tête de col’’ par une action menée du sud vers le nord et à attaquer Larche à partir des Sagnes par les cols de la Petite Cavale et du Quartier d’Août. En fait, le mauvais temps fait reporter l’action de 48 h. L’action principale est donc prévue pour le 10 septembre en liaison avec celle des tabors au nord de l’Ubayette.


Branche nord de la tenaille : dès le 8 septembre, commencent des opérations préliminaires qui ont pour objectif, à partir de Saint Paul, le col de Mirandol (2 433 m). Elles sont confiées au 14e bataillon FTP des Hautes Alpes qui compte 8 officiers et 17 sous officiers... pour seulement 69 hommes de troupe. L’attaque est un cuisant échec qui coûte 3 tués. Par contre, les goumiers, encadrés sans doute en nombre moindre mais plus efficacement, occupent le plateau de Bouchiers (2 566 m) et enlèvent l’observatoire de la Tête de l’Homme (2 504 m) où les Allemands ont 2 tués et 3 prisonniers. Le lendemain 9 septembre, le lieutenant du Penhoat du 12e tabor s’empare du col de Mirandol et s’y maintient en situation précaire. Sa demande de renforts ne peut être satisfaite car les tabors sont très dispersés dans la montagne sur un front très étendu en raison de l’extrême mobilité de leurs adversaires (troupes de montagne) et de l’obligation de protéger les populations de la vallée. En début d’après midi, de malheureux coups longs d’une batterie de mortiers installée au pont des Bonis tuent et blessent des goumiers. Un certain flottement s’ensuit qui empire à la tombée de la nuit lorsque des Allemands déguisés en goumiers s’infiltrent dans leurs rangs ; c’est alors la débandade. Au col de Mirandol, les Allemands bondissent et franchissent le col de vive force en tirant de toutes leurs armes. Le lieutenant du Penhoat et plusieurs de ses goumiers sont tués. Leurs corps ne seront retrouvés qu’en juin 1945 (stèle au monument aux


Morts de l’église de Saint Paul). Sous la pression de l’ennemi, le 10 septembre, les éléments en place au plateau de Bouchiers et à la Tête de l’Homme rompent le combat et se replient sur Saint Paul. Les mulets, encore bâtés, ont été abandonnés. Ainsi harnachés, certains erreront dans la montagne pendant près de 15 jours jusqu’à ce que les Allemands les capturent ou les tuent.
Branche sud de la tenaille : le 9 septembre, des opérations préliminaires sont également menées dans le secteur sud : la 1re compagnie du lieutenant Derbez accroche une patrouille allemande au Pas des Terres Rouges faisant un prisonnier et plusieurs tués ; la 3e compagnie du lieutenant Sarrès, partie du col des Fourches, détruit sans pertes le poste de surveillance allemand de la Petite Cavale, y faisant 7 tués et 3 prisonniers dont 1 officier et ramenant 2 MG et 1 poste radio. La compagnie de Saint Auban se met en place à Cuguret en vue de l’action du lendemain. Le 10 septembre, cette compagnie, partie de Cuguret à 3 h du matin, s’empare du col de Siguret à 7 h 30. Elle y perçoit les bruits des combats vers Mirandol et le plateau de Bouchiers. Restée en position sur la crête et le col jusqu’à 19 h, elle redescend ensuite à Cuguret, mission accomplie. Près de Jausiers, malgré le mauvais temps, l’artillerie américaine a pu régler ses tirs sur Saint Ours. De son côté, les 24 hommes de la compagnie du lieutenant Derbez partis à 1 h 30 du matin des Sagnes atteignent la crête d’Abriès à 7 h.
Vers 11 h, le groupe Kneip de cette compagnie tend une embuscade à une patrouille allemande qui monte vers la crête et lui inflige 2 tués et ramène 2 prisonniers. Le lieutenant Derbez tient la crête jusqu’à la nuit puis redescend aux Sagnes, mission terminée. La 3e compagnie du lieutenant Sarrès, partie du secteur de Restefond (fortin de la cime de Pelousette), coiffe, quant à elle, la crête de la Petite Cavale vers midi après de violents combats (15 Allemands tués ; 3 prisonniers, 3 MG et 1 poste de radio capturés ; un FFI tué : Pierre JEAN). A 16 h, une nouvelle action est conduite par le sergent chef Mielle avec un groupe de cette 3e compagnie pour nettoyer le secteur ; quatre nouveaux prisonniers sont faits. De son côté, l’unité américaine dont l’objectif est le col du Quartier d’Août a progressé péniblement depuis le Pas de la Petite Cavale. Arrivés à la Bosse du Lauzanier, les Américains dominent le col du Quartier d’Août et pourraient aisément s’emparer du poste allemand qui s’y trouve. Cependant leur attaque est hésitante et, devant la résistance qui leur est opposée, ils renoncent rapidement et se replient. A 17 h, la 3e compagnie est relevée par d’autres éléments américains venus de Pelousette.
Décrochage et constat d’échec : finalement, en raison du froid intense et de l’impossibilité de tenir les positions avec un armement et un équipement restreint et rudimentaire, l’ordre général de décrochage est donné à 20 h. Le 11 septembre, les états majors ne peuvent que constater l’échec de l’opération, tant au nord (Mirandol) qu’au sud (col du Quartier d’Août). L’affaire a échoué faute de simultanéité des actions nord et sud et parce que l’attaque des Américains, non entraînés au combat en montagne, a pratiquement été inexistante. Le bilan de cette opération ratée (parfois appelée « affaire du col de Larche ») est lourd : 9 morts, 27 blessés et 3 disparus. La ligne de front se trouve donc figée pour l’hiver qui approche ; elle passe par : col de Vars Vallon Claous Tournoux la Condamine Cuguret les Sagnes Restefond les Fourches Las Planas.
Le 17 septembre, le commandement américain (colonel Sachs) reprend totalement à son compte l’autorité sur ce secteur. Le 24 septembre, les premières relèves sont effectuées avec l’arrivée d’une compagnie de tirailleurs sénégalais et du 3e bataillon du régiment bas alpin. Le 15 octobre, les FFI de l’Ubaye sont officiellement dissous tandis que la nouvelle armée d’amalgame s’organise progressivement.
Le bilan de l’été pour le secteur Ubaye Ubayette est particulièrement lourd : 14 fusillés, 22 morts au combat, 49 blessés, 3 déportés et 3 officiers arrêtés puis libérés.
Le 9 novembre, les Allemands incendient Meyronnes et abandonnent le village le 12.
A Tournoux, face à l’Ubayette réoccupée par les Allemands, la position est d’abord tenue par le 1er RTA, puis à partir du 27 novembre (et jusqu’en mars 1945) par l’ex GMO ‘‘Revanche’’ de l’AS Loire, 1re compagnie du bataillon ‘‘Maury’’ qui deviendra par la suite, en décembre, la 6e compagnie du 2e bataillon du 99e RIA.
Trois opérations menées en Ubayette pendant cet hiver par la 6e compagnie du II/99e RIA méritent d’être signalées :
Le 18 décembre 1944, une reconnaissance de deux sections en direction de Roche la Croix est accrochée à 9 h du matin à l’Ancien Camp ; une demi douzaine d’adversaires est touchée, mais le sous-lieutenant Wehrung est tué d’une balle qui lui traverse le casque. Le capitaine Frondeville ordonne alors le décrochage et fait protéger le repli par un tir d’artillerie.
Le 13 février 1945, une opération est menée pour tâter la valeur des adversaires qui occupent Saint Ours et Fontvive. A 9 h 10, un violent accrochage se déroule à la lisière est de Meyronnes. En explorant une maison, deux caporaux sont blessés par mines ; le caporal chef Boehler est plus particulièrement touché, il a un pied arraché. Garrotté, il est évacué vers l’arrière avec beaucoup de difficultés ; les brancardiers, après avoir rampé la plupart du temps, n’atteignent les Gleizolles que vers 15 h, puis il leur faut encore une heure et demi de marche pour parvenir à Tournoux. L’ambulance le prend là en charge, mais malheureusement le caporal chef décédera le soir à l’hôpital de Barcelonnette.
Le lendemain, 14 février, à 7 h du matin, 21 soldats italiens (dont 2 sous officiers) du I/3e Granatieri de la division « Littorio » se rendent à la garnison de Tournoux. Ils disent avoir déserté de Roche la Croix en emportant les culasses des armes lourdes. Il ne resterait plus sur place qu’une douzaine d’Italiens et trois Allemands. Le capitaine Maury tente de s’emparer de l’ouvrage en y envoyant 4 sections vers 12 h 30 après avoir tenté vainement d’obtenir un appui d’artillerie. La réaction de l’ennemi qui a eu le temps de s’organiser est rapide et violente ; sa riposte est si efficace que les alpins sont obligés de se replier avec un blessé.
Sur un plan plus général, les adversaires mettent à profit l’hiver pour se réorganiser. Ainsi, en Valle Stura (vallée du versant italien du col de Larche), se constitue le KampfGruppe germano italien « Maddalena », commandé par l’Oberstleutnant Freiherr von Ruffin, intégrant diverses unités allemandes et le 3e Granatieri « Littorio » dont le 1er bataillon tient le col de Larche. Cet ensemble est appuyé par un groupe d’artillerie de montagne et une unité de reconnaissance. Cette dernière unité, le Füsilier Bataillon 34 du Kavallerie Regiment 6 est d’abord stationnée à Vinadio puis montera en ligne pour tenir la ‘‘tête de col’’ à la fin du mois de mars. Du coté français, la nouvelle armée d’amalgame se constitue. L’Ubaye est d’abord défendue par le II/99e RIA (Loire) et le II/69e RAA (détaché de la 4e DMM), puis à la mi février, par le 5e régiment de dragons (27e division d’infanterie alpine) qui relève le II/99e . Le Détachement d’Armée des Alpes est créé le 1er mars 1945 et placé sous le commandement du général Doyen. Le front est alors réorganisé en trois secteurs : Nord, Centre et Sud. Le secteur Centre, qui comprend l’Ubaye, est placé sous les ordres du colonel Francou, avec PC à Embrun. En Ubaye, le 5e dragons occupe toujours les lignes avancées et le I/141e RIA (Ubaye Vaucluse) finit de se constituer à partir du 159e RIA. Deux groupes de 3 batteries de 75 du 69e RAA et un groupe mixte de 105 et 155 C du 1er RAC (1re DFL) assurent le support d’artillerie, soit un total de 36 pièces. Le chef d’escadron Lepage du II/69e RAA commande le sous secteur Ubaye.
Principes de l’Opération ‘‘Laure’’ (dégagement du col de Larche)
La mission que le général Devers, commandant du Ve groupe d’armées US, confie au Détachement d’Armée des Alpes (DAA) est la couverture, face à l’est, de l’axe MarseilleBesançon. Dans ce cadre, le DAA agit en liaison avec le XVe groupe d’armées US en Italie du Nord. Ainsi, dès la fin du mois de mars, des opérations pour la libération des Alpes sont envisagées et, le 6 avril, l'autorisation est accordée de poursuivre les actions si nécessaire sur le territoire italien, jusqu’à Cuneo pour le secteur Ubaye Ubayette. Après un report de date, le dégagement du col de Larche est finalement planifié du 22 au 26 avril sous le nom de code ‘‘Opération Laure’’. La manœuvre montée par le chef d’escadron Lepage est une manœuvre classique de montagne : tandis qu’une action frontale fixe l’ennemi de face, un effort particulier tentera de faire tomber les ouvrages de Roche la Croix, pilier sud du barrage ennemi ; cet effort sera appuyé par une grosse partie de l’artillerie et par une action enveloppante exécutée sur les postes ennemis de la Duyère ; enfin, deux mouvements de débordement en tenaille, confiés à des SES, viseront à couper les arrières de l’ennemi à hauteur du village de Larche. Le 24e BCA sera maintenu en réserve à Chorges.
La manœuvre sera exécutée par trois groupements :
Groupement Sud commandé par le chef de bataillon Le Henry : s’emparer de Roche la Croix et en débordant par le sud enlever et tenir les crêtes de la Duyère.
Groupement Nord commandé par le chef d’escadron de la Ferté : fixer les ouvrages de Saint Ours Haut et Bas puis s’en emparer après la chute de Roche la Croix.
Groupement de SES commandé par le capitaine Silvani : prendre le village de Larche et couper l’ennemi de ses liaisons arrières vers le col ; pour ce faire, un groupe Nord partira de Saint Paul et passera par les cols du Vallonnet et de Mallemort, un groupe Sud partira des Sagnes et passera par le col du Quartier d’Août et le vallon du Pis.
Dès le 9 avril, le I/159e RIA réoccupe sans coup férir le quartier de Saint Paul et constate l’état de pillage indescriptible des maisons de Saint Paul, Serennes et des autres hameaux : placards et tiroirs vidés au milieu des pièces, mobilier saccagé, literie éventrée, photos de famille ayant servi de cibles,… L’église de Saint Paul a particulièrement souffert : excréments un peu partout, statues mutilées par des coups de feu, grand lustre brisé, autel et tabernacle saccagés, tombes profanées,… La rumeur publique accuse de ces exactions les FTP du 1er bataillon du régiment « La Marseillaise » qui ont séjourné en Ubaye en septembre 1944 (un rapport de patrouille de fin octobre signale déjà les faits) ; mais les patrouilles des deux camps ont dû, très certainement, au moins ‘‘se servir’’, si ce n’est perpétrer des actes de vandalisme, durant l’hiver où maisons et église sont restées ouvertes à tous vents. Après cette réoccupation militaire de la vallée, en vue de l’attaque sur Larche, il faut disposer d’observatoires bien situés. Le 15 avril, le lieutenant Hotton à la tête de la SES I/159e RIA, parti de Saint Paul, réussit à gagner de vitesse une section allemande et à s’emparer avant elle du plateau de Bouchiers (2 566 m). Redoutant de passer en cour martiale, l’aspirant allemand qui s’est ainsi fait ‘‘piquer’’ la place, déserte la nuit même et se constitue prisonnier auprès de l’équipage d’une camionnette de ravitaillement près de Saint Paul. Déserteur mais non pas traître, il ne dévoilera rien du dispositif germano italien. Une base de départ pour l’attaque sur Larche est alors préparée au dessus de Saint Paul dans le bois du Clot Boneti avec des matériaux récupérés aux granges des Meyres de Bouchiers et ceinturée d’un champ de mines de protection contre toute surprise.
DETACHEMENT D’ARMEE DES ALPES
ETAT-MAJOR 3e BUREAU
N° 122 / 3
P.C., LE 17 MARS 1945 ………………………………………………………………….…
III Enfin, pour rendre plus facile l’accomplissement de la mission de couverture confiée au Détachement d’Armée des Alpes et libérer les parcelles du sol national encore tenues par l’ennemi, il y a lieu de préparer dès maintenant des opérations ayant pour but de rejeter au-delà de la chaîne principale des Alpes les éléments qui se sont maintenus sur leur versant ouest.
Ces opérations seront entreprises dès que les moyens nécessaires pour les conduire à bien pourront être réunis. Ces opérations viseront :
Pour le secteur centre : à dégager le col de Larche
Les commandants de secteur commenceront dès maintenant l’étude de ces opérations. Ils en indiqueront les grandes lignes ainsi que les moyens de toutes sortes calculés avec soin qui leur apparaîtront strictement nécessaires pour les mener à bien. Ces études devront parvenir au Commandant du Détachement d’Armée des Alpes pour le 1er avril au plus tard.
Le Général de C.A. Doyen Commandant le D.A.ALP. Signé : DOYEN
N° 307 / 3
I La situation générale exige que le Détachement d’Armée des Alpes prenne dès maintenant partout une attitude nettement offensive. L’activité déployée devra s’exercer sans arrêt et de manière croissante.
II Pour maintenir l’ennemi dans l’incertitude de notre dispositif, de nos effectifs et de nos intentions sur tout le front, l’activité des patrouilles devra redoubler. Les SES devront exécuter des raids offensifs à la frontière et au-delà de la frontière, enlever des postes et ramener des prisonniers.
Dans toute la mesure du possible, les observatoires gênant nos mouvements dans les vallées devront être enlevés.
III Les opérations prévues dans mon Instruction n° 122 / 3 du 17 mars 1945 pour conquérir les positions de départ indispensables sur les grands axes routiers pénétrant en Italie, en vue du franchissement ultérieur de la frontière, seront exécutées aux dates ci-après :
le 13 avril : dégagement du col de Larche, enlèvement des ouvrages fortifiés de Roche la Croix, Saint-Ours bas, Saint-Ours haut, exploitation en refoulant l’ennemi au delà de la frontière.
IV Les Commandants de secteur me feront parvenir d’urgence les ordres donnés par eux en exécution de cette instruction.
Signé : DOYEN





GroupeNord(capitaineSilvani)
SES I/159e RIA lieutenant Hotton
SES 4/XV aspirant Tavernier
SES 5/XV lieutenant Canal

GroupeSud(lieutenantDelécraz)
SES 1/XV adjudant-chef Michelon
SES 3/XV aspirant Waintrop


SES 24e BCA lieutenant Rolachon
RAA (type Montagne) qui a été mis à disposition de la 27e DIA par la 4e division marocaine de montagne : 6 batteries de 4 x 75 M

69
RAC (de la 1re DFL devenue 1re division d’infanterie motorisée) : 1 groupe mixte : 6 x 105 et 6 x 155 C
Wing 340. Chasseurs-bombardiers Air Cobras. Groupe II/9 ‘‘Auvergne’’
La ‘‘tête de col’’ est tenue par le 3e Schwadron du Füsilier Bataillon 34 du Kavallerie Regiment 6 (34e Infanterie Division) renforcé d’éléments du 4e Schwadron (armes lourdes) et par le 1er bataillon du 3e Granatieri de la division « Littorio », appuyés par une batterie de trois 75 de montagne à la ferme du Colombier. Cet ensemble est placé sous le commandement de l’Oberleutnant Asshauer qui a établi son PC à Larche près du Grand Hôtel. Le groupe d’artillerie « Vicenza », qui se trouvait en soutien, stationné près du col de Larche, a fait mouvement le 14 avril vers le Queyras, à la suite de l’attaque déclenchée sur le col Agnel par le II/141e RIA ; il va faire lourdement défaut pour s’opposer à l’opération de dégagement du col de Larche.
Alors que les groupements d’attaque cheminent encore dans la montagne, la préparation d’artillerie débute à 6 h 40, le 22 avril, et s’abat tant sur la ligne Saint Ours Roche la Croix que sur Larche. Elle va durer plus de 3 h, la dernière salve d’obus tombant sur Larche à 10 h. Toutefois, comme on le verra plus loin, un contre temps malencontreux dans la mise en place du groupement sud qui doit attaquer Roche la Croix obligera à reprendre toute la manœuvre coordonnée artillerie infanterie sur cette zone entre 13 h 30 et 15 h. Durant toute la journée, les 75 du 69e RAA et les 105 et 155 du 1er RAC (1re DFL) vont tirer 8 000 coups. Outre la préparation de l’assaut sur les positions fortifiées occupées par l’ennemi, l’artillerie effectue également des tirs de contre batterie sur les 75 de la ferme du Colombier et sur une batterie de 149 vers Grangie, qui ne pourront tirer en tout et pour tout que 160 coups.
Le soutien aérien est assuré par les Air Cobras du Wing 340 (groupe II/9 ‘‘Auvergne’’ basé au Vallon près d’Aix en Provence). Deux missions particulièrement couronnées de succès méritent d’être signalées : le matin du 22 avril, bombardement de Larche par 3 Air Cobras munis de 2 bombes chacun ; le PC allemand installé dans une villa ‘‘mexicaine’’ est touché de plein fouet, chance ou performance extraordinaire compte tenu de l’encaissement de la vallée ! L’Oberleutnant Asshauer est indemne, car sorti quelques instants auparavant de son PC pour observer la progression des SES signalées par l’un de ses postes avancés. Par contre, presque tous les Allemands présents dans le PC sont tués ; de plus, les centraux téléphonique et radio sont détruits. Ainsi, le commandement germano italien se trouve totalement paralysé. en fin d’après midi le 23 avril, une action conjointe avec l’artillerie aboutit à la destruction d’une batterie de 149 localisée près de Grangie.

Ce sont au total une trentaine de sorties qui seront effectuées le 22 avril au bénéfice du DAA pour l’opération de Larche et 22 sorties le 23 avril. Des bombes lâchées sur Roche la Croix, ainsi que des obus de l’artillerie, toucheront les casernements de surface et la coupole blindée de la tourelle du Bloc B5… qui en sera à peine éraillée superficiellement !

Roche la Croix.

La coupole blindée de la tourelle du Bloc 5 n’a été qu’à peine éraillée par les bombes et les obus.
Le Groupement de SES est divisé en un groupe Nord et un groupe Sud. Le groupe Nord, commandé par le capitaine Silvani, est constitué de la SES 4/XV de l’aspirant Tavernier, de la SES 5/XV du lieutenant Canal et de la SES I/159e RIA du lieutenant Hotton. Le 21 avril à 23 h, ce groupe quitte Saint Paul (1 450 m) guidé par J. H. Reynaud. La progression est très difficile à partir de Fouillouse en direction du col du Vallonnet ; traversée de deux torrents avec de l’eau glacée jusqu’aux genoux, puis à partir de 2 000 m, la couche de neige atteint par endroits 80 centimètres : les éclaireurs lourdement
chargés s’enfoncent parfois jusqu’à la taille. Ils réussissent toutefois à passer inaperçus des guetteurs allemands de la Tête de l’Eyssilloun (2 896 m), mais ce n’est qu’à 7 h qu’ils atteignent le col du Vallonnet (2 524 m). Le contact est établi avec un groupe de protection du II/159e RIA (aspirant Collières) installé depuis 3 h du matin dans des conditions effroyables à la Tête de Plate Lombarde (2 609 m). L’observation de l’itinéraire qui va ensuite être suivi montre que les Baraquements de Viraysse semblent inoccupés. La SES 5/XV du lieutenant Canal prend la tête et fait la trace dans une neige molle et très pénible. Le groupe redescend ainsi dans le vallon du Riou du Pinet (Riou de la Peyrouse) à 2 210 m pour remonter par les Baraquements de Viraysse (qui sont en effet trouvés vides de tout occupant) jusqu’au col de Mallemort (2 558 m), où il ne parvient qu’à 9 h 30. A cette heure là, il devrait être déjà sur ses bases de départ, à proximité de Larche, pour l’attaque prévue à 10 h. Ainsi, le groupe Silvani (SES Nord) a une heure de retard sur l’horaire prévu. Le groupe Sud du lieutenant Delécraz est prévenu par radio et décide d’attendre pour lancer l’attaque. Les SES du groupe Nord descendent alors de Mallemort, d’une part par le Riou Tort (SES 5/XV lieutenant Canal), d’autre part par le ravin de Rouchouze (SES I/159e RIA lieutenant Hotton). Le plateau de Pré la Font est nettoyé au passage et 7 prisonniers y sont faits. A 11 h, les SES Nord apparaissent au dessus du village.
Le groupe Sud, commandé par le lieutenant Delécraz (ancien commandant de l’ouvrage d’avant poste des Fourches en 1940. Voir Haute Tinée), se compose de la SES 1/XV de l’adjudant chef Michelon, de la SES 3/XV de l’aspirant Waintrop et de la SES 24e BCA du lieutenant Rolachon. Les SES partent de Jausiers le 21 avril vers 16 h et arrivent aux Sagnes à 22 h ; le groupe d’éclaireurs, après une longue pause, en repart à 23 h. Les skis sont laissés sur place en raison du faible enneigement en altitude. La température très basse de la nuit rend la neige dure et croûteuse assez propice à la marche, bien que par endroits les éclaireurs s’y enfoncent jusqu’à la taille. De plus, une descente à ski sur le versant nord, dans la quasi obscurité, avec de nombreuses barres rocheuses à franchir sur les 1000 m de dénivelé très pentu, serait extrêmement dangereuse. Le col du Quartier d’Août est atteint vers 2 h du matin, puis le sommet de la Tête de Parassac (2 777 m) à 3 h. C’est ensuite la longue descente du vallon de Parassac puis du ravin du Pis, dans un froid sibérien avec un temps bouché et un vent violent. A 6 h, la RN 100 et le col de Larche sont en vue. Les dernières pentes dénudées sont rapidement franchies par les 120 éclaireurs qui se mettent à couvert dans les bois de la rive gauche de l’Ubayette, en face de Maison Méane. Pause casse croûte pendant laquelle se déclenche la préparation d’artillerie ; à 7 h 30, départ pour prendre les positions de combat autour de Larche. La SES 1/XV (adjudant chef Michelon) reconnaît les hameaux de Maison Méane et de Malboisset, trouvés vides, coupe la ligne téléphonique du col et se tapit à l’est du village, échelonnée depuis le mur du cimetière jusque sur la rive gauche de l’Ubayette. La SES 24e BCA (lieutenant Rolachon) se poste à l’ouest, le long de l’Ubayette, un peu en aval du village, tandis que la SES 3/XV (aspirant Waintrop) assure la couverture du dispositif à hauteur de Malboisset tant vers le col que vers le Lauzanier. Il est 10 heures. Les derniers des 500 obus de la préparation d’artillerie s’abattent sur Larche ; puis c’est le calme. Ce devrait être l’heure H… mais le groupe Nord n’est pas au rendez vous ! Le lieutenant Delécraz vient d’être prévenu par radio du retard. Il reste donc en place et peut observer à loisir les réactions de l’ennemi quand cesse le bombardement : « L’adversaire, Allemands et Italiens, apparaît peu à peu. Une vingtaine d’hommes sortent des abris ou de derrière les pierriers ou des ruisseaux et se précipitent à leurs emplacements de combat. Nous les voyons parfaitement. Comme rien ne se passe, petit à petit, ils abandonnent leurs postes de combat, allument pipes et cigarettes et se promènent tranquillement dans les champs et dans le village… Nous profitons du délai accordé pour repérer les traces de passage et sentiers aux abords et dans le village, car village et abords ont été signalés comme abondamment minés » Lorsque la SES I/159e RIA du lieutenant Hotton apparaît, à 11 h, dans les pentes au dessus du village, le
lieutenant Delécraz toujours en observation voit subitement « un adversaire qui lâche une rafale de mitraillette et s’enfuit donnant l’alerte. Les autres courent vers leurs emplacements de combat. Nous ouvrons le feu de toutes les armes…»
L’attaque est rondement menée : assaillis de quatre côtés à la fois, les défenseurs se trouvent rapidement débordés ; après une faible réaction, ils se rendent en agitant des mouchoirs blancs. Le village et l’ouvrage d’avant poste sont aussitôt investis : 24 prisonniers sont rassemblés et une dizaine de morts dénombrés. La surprise a été si totale que les éclaireurs n’ont qu’un blessé léger, le radio de la SES 24e BCA touché aux jambes. Larche est alors organisé en hérisson défensif qui isole de leurs arrières les défenseurs ennemis du verrou Roche la Croix Saint Ours. L’Oberleutnant Asshauer a pu s’échapper. A la nuit tombée, à la faveur de l’obscurité, il parvient à traverser la ligne de sentinelles et de guetteurs et à rejoindre au col de Larche le I/3e Granatieri. Le lieutenant Delécraz installe, quant à lui, son PC à l’ouvrage de Larche. La SES I/159e RIA du lieutenant Hotton part ensuite, accompagnée des prisonniers faits au Pré la Font, pour reconnaître, au dessus de l’ouvrage, le Truc et la ferme du Colombier. Le rocher aménagé est vide ; par contre, les ruines de la ferme sont encore occupées par l’ennemi : des rafales d’armes automatiques parties des soupiraux accueillent les éclaireurs. Une manœuvre d’encerclement est rapidement montée sous la protection d’un FM. L’ennemi se défend avec énergie ; aussi, pour éviter toute perte inutile, le lieutenant Hotton demande t il un soutien d’artillerie pour neutraliser la ferme. La SES se replie donc au dessus de la ferme, à environ 600 mètres et en retrait vers l’ancien PA 1893 ; elle s’abrite dans les replis de terrain. Soudain le tir d’artillerie s’abat… en plein sur la SES ; un véritable tir de concentration sur un rayon de 100 mètres ! Prévu pour 10 minutes, le tir cesse au bout de 6, car le lieutenant Delécraz s’est rapidement aperçu de l’erreur et a commandé par radio « Halte au feu ! Cessez le tir ! ». Cependant, le bilan est lourd : le caporal chef Aubert est mortellement atteint, le lieutenant Hotton est blessé ; parmi les prisonniers il y a 4 morts et 2 blessés. La SES 3/XV Waintrop prend alors la relève. Sous les ordres de l’aspirant Luigi, la SES I/159e RIA se replie. Elle est alors prise à partie, ainsi que l’ouvrage de Larche, par une batterie italienne de 149. L’aviation d’observation (des Fieseler Storch de prise) la repère rapidement près de Grangie. Des tirs de contre batterie la font aussitôt taire. Vers 20 h, le groupe de SES du capitaine Silvani, à la suite de la mauvaise interprétation d’un ordre radio repart, avec blessés et prisonniers, vers Saint Paul par le même itinéraire accidenté et difficile que celui emprunté la nuit précédente. Les éclaireurs parviennent à Saint Paul à 2 h du matin, totalement harassés. Outre le succès militaire remporté à Larche, il faut souligner l’exploit de volonté que représente ce périple aller retour, dans un tel délai et de telles conditions, tant sur le plan moral que physique. Le général Doyen, commandant du DAA, présent dans le secteur, fait envoyer immédiatement une section de la 1re compagnie du I/159e RIA pour renforcer le groupe SES Sud qui reste alors seul pour tenir Larche. Elle s’installe entre Certamussat et Larche.
Durant cette journée, le Maggiore Gigliotti, commandant le I/3e Granatieri, stationné au col, à moins de 6 kilomètres, n’a pas beaucoup réagi. Il est en effet persuadé que l’attaque sur Larche n’est qu’une diversion. Il pense que l’effort principal des Français portera en fait sur le col de Pouriac pour pouvoir ainsi couper les défenseurs de la ‘‘tête de col’’ de leurs arrières à hauteur de Bersezio.
Le groupement Nord, commandé par le chef d’escadron de la Ferté (5e RD), est constitué par 2 sections de la 3e compagnie et 3 sections de la 4e compagnie du I/159e RIA, les escadrons I et III/5e RD et un peloton du IV/5e RD.
L’attaque centrale sur le barrage Roche la Croix Saint Ours doit démarrer en partie du plateau de Bouchiers en direction de Meyronnes et de Saint Ours. Un peloton formé par les
1re et 3e sections de la 3e compagnie du I/159e RIA (75 hommes environ commandés par le lieutenant Leuba) part de Saint Paul et, après 4 h de marche très difficile, atteint le plateau de Bouchiers. Un bivouac est établi un peu en dessous du sommet, coté Ubaye, dans des trous creusés dans la neige. Départ à 3 h, et au sommet les deux sections se séparent pour suivre chacune leur itinéraire d’approche. Quand cesse la préparation d’artillerie déclenchée à 6 h 40, la 1re section (sous lieutenant Genot) reconnaît la cabane et l’ouvrage Maginot de Serre la Plate (observatoire d’artillerie) qui s’avèrent vides. L’objectif suivant est la Grange de Gascon, chalet d’alpage fortifié tenu par l’ennemi. La 3e section (aspirant Brunner) doit la prendre à revers tandis que la 1re doit mener l’assaut frontal avec le peloton de l’adjudant chef Laurent du IV/5e RD. Alors que la préparation d’artillerie gronde toujours, une première MG tire sur les assaillants : les dragons Pinat et Rigoudy sont tués. Les FM 24/29 des sections fixent aussitôt les 3 MG des deux ‘‘blockhaus’’ (l’un ‘‘en dur’’ à l’intérieur même du chalet, l’autre sous rondins à proximité). Mais ce n’est qu’après 3 h de fusillade que l’assaut peut être donné, appuyé par les 2 mortiers de 81 du peloton de dragons. Le groupe du sergent Troux arrive à déborder le nid de résistance ; un Allemand sort alors de son abri pour mieux assurer ses tirs. Le sergent Chagnard l’apercevant ‘‘le joue à l’apéritif’’ avec l’aspirant Brunner et le blesse grièvement d’un coup de fusil. L’assaut final est donné sur l’abri intérieur par le groupe de l’aspirant Brunner entraîné par le lieutenant Leuba. La porte métallique est enfoncée ; les occupants se rendent et sortent un par un. C’est alors qu’un Allemand pointe son pistolet ; l’alpin Comtet qui a vu son geste menaçant en direction de l’aspirant Brunner lui passe sa baïonnette au travers du corps. Le sergent Landry a de son côté neutralisé l’abri en rondins et délogé les Italiens qui l’occupaient. Il s’y trouve 3 blessés graves. L’assaut final a permis de faire 27 prisonniers, sans aucune perte du côté français. Les prisonniers refusant d’indiquer l’emplacement des champs de mines, l’aspirant Brunner les fait disposer en quinconce et leur ordonne d’avancer. Les Italiens cèdent alors et indiquent la position des mines. Quant aux prisonniers allemands, ils doivent se coltiner les 3 mitrailleuses et leurs munitions. C’est dans cet équipage que le groupe Leuba prend position sur une petite crête au dessus du village de Saint Ours, après avoir évité Meyronnes par les hauts.
Dans le même temps, l’escadron Guyot (I/5e RD) a progressé le long de l’Ubayette . Il a atteint les ruines de Meyronnes grâce à l’appui particulièrement efficace des réglages d’artillerie de son officier de liaison qui ont permis de museler MG et mortiers qui tentaient de s’opposer à sa progression.
Cependant, du fait du retard pris par le groupement Sud dans l’attaque de Roche la Croix, le groupement Nord se trouve découvert sur son flanc droit et doit s’arrêter de progresser. Ce n’est que dans l’après midi, vers 15 h, que l’attaque reprend. L’escadron Challan Belval (III/5e RD) s’approche de l’abri de Fontvive et se trouve alors pris sous le feu d’une MG d’un petit bloc situé un peu plus haut vers Saint Ours. Elle devra être réduite par l’artillerie. De son côté, l’escadron Guyot continue à avancer depuis Meyronnes vers l’ouvrage de Saint Ours Bas qui est atteint vers 18 h. A 20 h, alors que la nuit tombe, l’assaut n’a pu être donné : la troupe est harassée par le portage des munitions ; l’action est donc reportée au lendemain. Le peloton Leuba, quant à lui, s’est abrité pour la nuit dans les rochers de la crête qu’il occupe depuis le début de l’après midi, au dessus de Saint Ours. Entre temps, l’observatoire du plateau de Bouchiers a repéré des camions italiens descendant des renforts depuis le col ; les camions ont été immédiatement détruits par une volée de 75 et de 105.
Le groupement Sud, aux ordres du commandant Le Henry (I/159e RIA), comprend la 6e compagnie du II/99e RIA renforcée par une section de la 4e compagnie du I/159e RIA, la 1re compagnie du I/159e RIA et l’escadron II/5e RD pour l’attaque frontale sur Roche la Croix et enfin deux sections du I/141e RIA pour s’emparer de la Tête de Siguret et des postes de la Duyère.
Parties dans la nuit de l’ancienne batterie de Cuguret, les deux sections du I/141e RIA arrivent au col de Siguret au petit matin après avoir cheminé dans une neige profonde ; elles se trouvent alors clouées sur place par les groupes allemands installés à la Tête de Siguret et aux postes de la Duyère. Elles piétinent toute la journée sans avancer et ne parviennent pas à s’emparer de leur objectif, la crête de la Duyère.
A 6 h 40, au moment où débute le pilonnage de l’artillerie, la 6e compagnie du II/99e RIA du capitaine de Frondeville commence à grimper dans le bois de la Silve. C’est la section Lebreton de la 4e compagnie du I/159e RIA qui progresse en tête sur le chemin stratégique qui mène à l’ouvrage de Roche la Croix. Même avec les détecteurs de mines du génie et les rubans de balisage au bord du chemin, aux dires des assaillants, le passage ainsi tracé reste malgré tout « Balisé SGDG » (Balisé Sans Garantie Du… Génie !). A défaut de détecteurs, dans les bois, ce sont les alpins eux mêmes qui sondent le sol à la baïonnette. Le terrain est truffé de ces engins mortels et rapidement les explosions retentissent un peu partout dans la forêt. C’est la section Mauris de la 1re compagnie du I/159e RIA progressant à l’aile droite du dispositif qui connaît les premiers morts. L’alpin Baratier est déchiqueté. En voulant porter secours au soldat Lapierre qui était à ses côtés et qui est fortement commotionné, le médecin lieutenant Bongard et l’infirmier Viard sautent à leur tour sur une mine qu’ils n’ont pas vue. Malgré ce terrain piégeux, après un léger remaniement du dispositif, la progression reprend jusqu’au bord du ravin de Séguret, à 200 m à vol d’oiseau face à l’entrée de l’ouvrage. Les créneaux et embrasures de l’ouvrage sont orientés vers l’est, vers l’Italie, alors que les germano italiens doivent défendre à front inversé vers l’ouest. Le Feldwebel Hentschel a fait installer les armes lourdes (MG et mortiers) dans des trous creusés dans les rochers et dans le pavillon des officiers du casernement de surface. Malgré le bombardement préparatoire de l’artillerie, les défenseurs tirent de toutes leurs armes et stoppent l’assaut. Le caporal mitrailleur Alirand de la 6e compagnie du II/99e RIA est tué à son poste de combat ; un autre soldat est blessé. Aucune progression n’est plus possible et, vers 13 h, la situation paraît bloquée sinon compromise. En fait, ce qui s’est passé, c’est que l’escadron Collonges (II/5e RD) n’est pas en place ! Mal orientée par son guide dans la nuit, cette unité qui devait contourner l’ouvrage par les hauts et prendre la batterie haute pour finalement revenir à revers sur la position, s’est trompée d’itinéraire. Elle a plus de 2 h de retard. Toute la manœuvre combinée artillerie infanterie est à reprendre !
Le commandant Le Henry donne de nouveaux ordres, et re déploie son dispositif en renforçant l’escadron Collonges avec 2 sections de la 1re compagnie du I/159e RIA. Une nouvelle préparation d’artillerie se déchaîne de 13 h 30 à 15 h. Au cours du bombardement, un coup court percute le sommet des mélèzes et fait fusant : le sergent chef Cartouche, chef de la section de mitrailleuse de la 1re compagnie, est tué et plusieurs alpins sont blessés. A 15 h, un peloton de l’escadron Collonges finit par enlever la batterie haute de Roche la Croix en y faisant 2 prisonniers ; les 5 autres occupants réussissent à s’échapper. A partir de cette position dominante, la manœuvre de contournement par le sud et de prise à revers par l’est de l’ouvrage de Roche la Croix peut être menée à bien. A 16 h 30, une nouvelle concentration de 75 est déclenchée ; elle permet, vers 17 h 30, au Peloton Ogier de parvenir dans le fossé jusqu’à la grille défensive, à moins de 50 m des blocs de l’ouvrage. La fumée des obus au phosphore qui s’insinue partout commence à faire suffoquer les défenseurs ; c’est alors qu’à la demande de plusieurs de ses hommes, le Stabswachtmeister (adjudant chef) Hugler qui commande la position se résigne à sortir en agitant un drapeau blanc : « car d’une part les munitions commencent à manquer, d’autre part, certains hommes choqués par le violent bombardement d’artillerie, ne sont plus en état de combattre. Un mouchoir blanc dans la main, je quitte ma position et vais au devant des français. Je rends compte à l’officier français venu à ma rencontre que je cesse le feu et que l’ouvrage se rend. Comme pertes, je n’ai heureusement qu’un tué et plusieurs blessés légers…»
Attaque de Roche la Croix. Illustration de M. Passemard extraite de ‘‘Haute Lutte’’.

Le même site près de soixante ans plus tard.

Les dragons du peloton Ogier coiffent immédiatement les blocs principaux et les bâtiments de surface. Le capitaine Simonin, adjoint du commandant Le Henry qui l’a envoyé pour recevoir la reddition, témoigne : « Quand je me suis présenté devant l’entrée, la porte a été ouverte et leur chef m’a rendu les honneurs en faisant faire tête droite sur place à tout le personnel, rassemblé en ligne sur trois rangs dans la cour. Cette discipline m’a impressionné. Ensuite, j’ai envoyé une fusée pour faire savoir que la garnison s’était bien rendue. Le commandant Le Henry arrive peu après, suivi de son état major réduit…» Le succès de l’opération inspirera cette réflexion au colonel Valette d’Osia, commandant l’infanterie divisionnaire de la 27e DIA : « On avait vu des dragons prendre une flotte en Hollande, mais c’est la première fois qu’ils prennent un fort en montagne ! »
La journée du 22 avril se solde par des pertes françaises relativement faibles : 7 tués et 26 blessés.
A 5 h du matin, le groupe Leuba reprend sa progression vers Saint Ours. Tout est calme et tranquille. L’ennemi s’est éclipsé du village qui est traversé sans encombre. A l’approche de l’ouvrage de Saint-Ours Haut, une MG tire depuis un petit bloc bétonné camouflé sous un tas de pierraille. L’artillerie la neutralise sans difficulté. L’abri Nord Est de Saint Ours est rapidement occupé puis les blocs de Saint Ours Haut sont coiffés et les dessous aussitôt reconnus : l’ouvrage est vide !
Pendant ce temps, les dragons de l’escadron Challan Belval (III/5e RD) se sont emparés sans coup férir de l’ouvrage annexe de Fontvive et font leur jonction avec les alpins du groupe Leuba aux ouvrages de Saint Ours Haut et Nord Est.
Le seul point de résistance qui subsiste est donc l’ouvrage de Saint Ours Bas. Ce sont 3 sections de la 4e compagnie du I/159e RIA qui ont passé la nuit dans les ruines de Meyronnes qui reçoivent mission de s’en emparer. La manœuvre élaborée par le commandant de la 4e compagnie, le lieutenant Bonaldi, est simple : un groupe d’assaut (sous lieutenant Bourgin avec 9 volontaires) profitera de tirs d’obus fumigènes pour déborder par le nord, tandis que la section du lieutenant Séjourné, installée en base de feux au sud, neutralisera toutes les embrasures et créneaux de l’ouvrage. La section restante (section Deschamps) restera en réserve. A 7 h, le tir d’artillerie commence et les alpins avancent derrière l’écran de fumigènes. L’adversaire réagit violemment par un tir nourri qui n’empêche pas cependant le lieutenant Séjouné de gagner sa base de feux entre la route et l’Ubayette, à 150 m au sud de la casemate. Le lieutenant Bonaldi qui accompagne cette section surprend deux Italiens embusqués avec un FM sous un ponceau de la route. Sous la menace, l’un d’eux doit aller tenter de convaincre les défenseurs de se rendre. Il revient en demandant un délai de réflexion jusqu’à 8 h ; il est 7 h 45. La réponse du lieutenant Bonaldi est sans équivoque : reddition immédiate sans conditions, sinon l’attaque et les tirs d’artillerie reprendront. L’Italien repart et revient presque immédiatement avec une quinzaine de ses compatriotes ; il prétend qu’il ne reste que deux Allemands qui ne veulent pas se rendre. Pendant ces négociations, le groupe d’assaut du sous lieutenant Bourgin s’est approché par le cheminement prévu et a contourné l’ouvrage par le nord. Le tir de la section Séjourné reprend sur les cloches de la casemate ; la riposte est toujours vive, les Italiens ont donc menti. Profitant de la confusion de la situation et de la fumée des tirs, le sous lieutenant Bourgin et 4 volontaires traversent au pas de charge le glacis dénudé qui entoure l’ouvrage, parviennent sur les dessus et grenadent les ouvertures. Au même moment, les servants du bazooka font sauter la porte blindée de deux coups directs tirés à moins de 25 m. Un Allemand est blessé, un Italien agonise et huit autres se rendent. Les Français n’ont aucune perte à déplorer et font au total 27 prisonniers.
Porte blindée que les hommes de la section du sous lieutenant Bourgin firent sauter au bazooka. Noter au dessus de la porte la ‘‘sortie neige’’, prisme vertical en tôle équipé d’échelons et fermé à son sommet par deux volets métalliques. Assaut sur Saint Ours Bas.

Très nombreux impacts sur l’une des cloches GFM qui a été criblée de balles.

Avec la chute de Saint Ours Bas, le verrou Roche la Croix Saint Ours qui fermait la ‘‘tête de col’’ vient de sauter ; de plus, le secteur de Roche la Croix est totalement sécurisé en début d’après midi avec la jonction, au dessus de Roche la Croix Supérieur, de l’escadron Collonges et des sections du I/141e RIA qui ont fini par s’emparer des postes de la Duyère et des crêtes par une action en tenaille.
A 7 h, la SES Waintrop se lance à l’assaut de la ferme du Colombier où quelques irréductibles opposent toujours une défense acharnée et farouche. L’éclaireur Gauthier est tué au cours de l’action ; il faut un grenadage en règle des soupiraux pour que les huit irréductibles finissent par se rendre. Dans la cave, les éclaireurs découvrent un véritable arsenal (3 mortiers, des armes diverses et de nombreuses munitions) et des vivres et boissons en quantité. Ces derniers font leurs délices, après qu’ils les ont fait goûter à leurs prisonniers par précaution. Un peu à l’écart de la ferme, ils trouvent les 3 canons de 75 et leurs munitions, abandonnés la veille par leurs servants qui ont pu s’échapper vers le col. Les prisonniers qui ont été rassemblés à l’ouvrage de Larche vont être conduits ensuite vers la Condamine. Alors que l’adjudant Barkats (SES 3/XV) prépare leur départ, les canons italiens harcèlent à nouveau l’ouvrage. L’adjudant chef de la colonne muletière qui s’apprêtait à convoyer les prisonniers est tué devant le bloc entrée.
Journées des 24 et 25 avril
Le 24 avril, le harcèlement de l’ouvrage de Larche par l’artillerie italienne continue. Le caporal Honoré est blessé et l’adjudant Allué tué. Deux sections du génie de la 1re DFL commencent le déminage, dégage la route et comble les brèches. La section Lebreton de la 4e compagnie du I/159e RIA va réoccuper la batterie de Viraysse. Quelques isolés germano italiens qui errent dans la montagne se font prendre les uns après les autres. Les derniers à se rendre sont les cinq cavaliers du poste d’observation de la Tête de l’Eyssilloun qui se rendent à un groupe de la 2e compagnie du I/159e RIA à Fouillouse, après s’être assurés qu’il n’y a pas de « Schwarzen » (noirs) parmi eux ! Les soldats français pendant ces jours de combat échangeront systématiquement leurs souliers (le plus souvent civils) éculés et inadaptés contre les excellentes chaussures de montagne de leurs prisonniers allemands et italiens. Durant ces deux jours, la troupe s’étonne de rester l’arme au pied et que les ordres de poursuivre l’ennemi en Italie ne viennent toujours pas.
De l’autre côté du col, l’Oberleutnant Asshauer a regroupé les éléments épars de son 3e Schwadron qui se trouve à nouveau opérationnel après avoir été renforcé du 2e Schwadron arrivé, un peu tard, du Petit Saint Bernard. Le col est toujours tenu par le I/3e Granatieri.
Journée du 26 avril : franchissement du col Comme prévu par l’état major, ce n’est que le 26 avril, à 9 h, que le 24e BCA sous la protection d’un groupe placé à Tête Dure s’élance vers le col dans le blizzard, la neige et la grêle. L’artillerie arrose copieusement les sommets, le col et la Haute Stura. L’attaque, en fait, tombe dans le vide. A la faveur du mauvais temps et de l’obscurité, les Italiens se sont discrètement retirés durant la nuit. En effet, sur instructions du Führer, afin de gagner l’Alpenfestung (le Réduit Alpin) les armées germano italiennes du Piémont doivent rejoindre au plus vite Turin. Le retrait de la 34e Infanterie Division a débuté le 25 avril, celui de la 5e Gebirgsdivision le lendemain. Les troupes allemandes se retirent en bon ordre ; par contre, les unités italiennes sont bientôt en véritable débandade. A 40 kilomètres du col, l’Oberleutnant Asshauer reçoit l’ordre de désarmer les Italiens du I/3e Granatieri.
Le bilan de l’opération de dégagement du col de Larche s’établit à 15 tués et 38 blessés côté français, pour 34 tués et plusieurs dizaines de blessés ainsi que 150 prisonniers côté ennemi. Comme en 1940, c’est en Ubaye que le succès aura été le plus grand aux moindres frais.
Dès le 20 avril, le général Doyen avait proposé dans une lettre adressée au général Devers : « de rompre le front ennemi dans la région de Vinadio en attaquant sur les axes Isola Vinadio et col de Larche Vinadio et d’exploiter le succès obtenu en me portant rapidement dans la région de Borgo San Dalmazzo où je couperai toutes les communications de toutes les forces concentrées dans la région du col de Tende ».
Du fait du succès de Larche, le plan initial qui prévoyait l’action de la 1re DFL avec la 27e DIA en direction de Suse se trouve modifié : la 1re DFL débouchera en Valle Stura par le col de la Lombarde tandis que la 27e DIA déboulera dans la même vallée par le col de Larche. Le 24 avril, ce nouveau plan d’opérations est approuvé, mais devra être réalisé avec les seules ressources du DAA.
Pour franchir le col de la Lombarde, le génie divisionnaire de la 1re DFL et les légionnaires du 1er bataillon de la 13e DBLE vont réussir l’exploit d’ouvrir en quarante huit heures une voie à coups de bulldozers dans une neige épaisse par endroits de 4 à 5 m !
Le 26 avril, alors que le 24e BCA tient le col de Larche, les premiers éléments de la Légion atteignent la Stura di Demonte à Pratolungo. La 7e compagnie du bataillon de marche 11, après avoir franchi le col de la Lombarde de nuit, rejoint les légionnaires à Pratolungo au matin du 27 avril. Ce même jour, le I/159e RIA franchit à son tour le col de Larche et l’une de ses patrouilles fait liaison avec la 1re DFL le 28 avril. Le 29 avril, les premiers camions peuvent franchir le col de Larche, où il a fallu réparer 13 coupures de route ! Les mines continuent à y faire des ravages ; encore 7 blessés et un tué : le lieutenant Séjourné qui s’était illustré à la prise de l’ouvrage de Saint Ours Bas. Les premiers véhicules descendent aussi ce jour là par le col de la Lombarde qui, jusqu’alors, n’avait pu être emprunté que par le ‘‘Royal Brêle’’, c’est à dire les convois muletiers.
Les Américains ordonnent alors l’arrêt impératif de l’avance des troupes françaises et leur retour en France !!! Il s’agit en fait de l’application des clauses de l’armistice de 1944 avec le maréchal Badoglio qui prévoient que les Anglais et les Américains ainsi que leurs contingents alliés sont seuls habilités à occuper l’Italie. Ces clauses ont été établies pour éviter toute velléité d’annexions de la part de la France et toute vengeance de sa part du coup de poignard dans le dos de juin 1940. Ces raisons sont bien sûr totalement incomprises par l’ensemble du DAA pour lequel la déception est grande, du haut en bas de la hiérarchie. Dans ce contexte, la capitulation officielle des forces germano italiennes d’Italie, le 2 mai, passe inaperçue.
Du 30 avril au 4 mai, les groupements de SES Silvani et Delécraz effectuent des patrouilles profondes en Italie, en Haute Maïra et en Valle Stura. Au cours de ces patrouilles, Emile Donneaud de Larche (SES 1/XV) a la joie de retrouver à Sambuco sa mère et sa sœur ainsi que plusieurs habitants de Maison Méane ; les Allemands les y avaient ‘‘déportés’’ en août 1944.
Le 6 mai, le I/159e RIA est relevé en Italie par le 24e BCA. La nouvelle de la reddition allemande est répandue, en Ubayette, le 7 mai, à 18 h 30, par l’ambulance qui remonte du PC de Jausiers.
Le 8 mai, pour fêter la Victoire, devant le PC du secteur Centre à Embrun, les cors de la fanfare du 24e BCA jouent pour la première fois une nouvelle marche : « Col de Larche » !
Quelques semaines après la fin de la guerre, la population est autorisée à revenir dans la vallée. D’abord une seule personne par famille, puis l’ensemble de la population. Devant l’ampleur des dégâts beaucoup décident de quitter la vallée.
Malgré tout, petit à petit, la vie reprend, en particulier les travaux agricoles ; mais les mines sont encore nombreuses et le génie n’a déminé que la Route Nationale et ses abords immédiats. Malgré les consignes de prudence données par les autorités, les accidents seront nombreux : Vincent Fabre sera amputé des deux jambes, un berger sera tué au Lauzanier ainsi qu’un autre à Viraysse. La population civile du secteur Ubaye Ubayette paye un lourd tribut à la guerre : 14 fusillés, 22 résistants tués au combat et 48 blessés, 5 déportés, 1 500 habitants sinistrés, 8 localités pillées, 8 villages et hameaux totalement détruits…
La vallée de l’Ubayette est la plus touchée par les destructions puisqu’il s’y trouve la quasi totalité des 8 villages et hameaux totalement détruits : Maison Méane, Malboisset, Larche, Certamussat, Fontvive, Saint Ours, Meyronnes et la Condamine. Deux d’entre eux ne seront pas reconstruits : Fontvive dont rien ne subsiste aujourd’hui et Certamussat dont le cimetière demeure et où a été reconstruit un seul bâtiment, une copropriété où chaque famille avait son pied à terre, aujourd’hui pratiquement à l’abandon. La reconstruction partielle des autres villages (par exemple, seul un tiers du village de Larche sera reconstruit) demandera plus de dix ans. Bien souvent, cette reconstruction s’avèrera inadaptée. Enfin, l’autorisation des transferts de sinistres contribuera aussi à accentuer encore l’exode de la population et bien peu de commerces rouvriront. L’agriculture s’est peu à peu marginalisée et seul le tourisme aujourd’hui maintient un peu d’animation dans la vallée qui reste toutefois un passage privilégié entre la France et l’Italie.

Aujourd’hui, à proximité de deux grands parcs naturels (Mercantour et Queyras), l’Ubayette, après le vacarme des combats, a retrouvé le calme et le silence des montagnes. Les ouvrages Maginot de Roche la Croix et de Saint Ours (Haut et Bas) ont été pris en charge par la Communauté de Communes de la Vallée de l’Ubaye et se visitent sous l’égide de l’Association des Fortifications de l’Ubaye. D’autres sites sont maintenant privés (Batterie de Mallemort et de Viraysse, Baraquements de Viraysse ; les postes de la Duyère ont été achetés par… des Belges de Lier, etc.). Les ouvrages d’avant poste de Larche et la vieille batterie de Viraysse tombent lentement en ruines et servent de refuge à quelques marmottes et chamois.
Les randonneurs tout au plaisir de goûter le calme et la plénitude des paysages de montagne sont loin de se douter des vicissitudes que l’agreste vallée a connues naguère. Les deux plaques souvenir, apposées à Larche, l’une sur la façade de la mairie, l’autre sur le mur du cimetière sont là pour entretenir la mémoire des sacrifices consentis par les habitants de la vallée :


Le massif du Restefond s’étire, du sud ouest au nord est, comme une barrière naturelle entre la vallée de l’Ubaye et celle de la Haute Tinée. Du Caïre Brun à l’Empeloutier et de la Tête de Sanguinière au rocher des Trois Evêques, les sommets culminent au dessus de 2 800 m. Les rares passages, nord sud ou est ouest, sont des cols à plus de 2 500 m d’altitude. Bien qu’un rocher à proximité du col de la Moutière soit dénommé « Pierre d’Annibal », il est certain que jamais le conquérant carthaginois ne franchit les Alpes en ces lieux. Après l’occupation romaine puis l’éclatement de l’Empire carolingien, cette région située aux confins de la Savoie, du Dauphiné et de la Provence se trouve ballottée au gré de l’histoire entre ces trois entités. Au Traité d’Utrecht (1713) rattachant la Vallée de l’Ubaye à la France, le massif devient zone frontalière entre le royaume de France et le duché de Savoie. Une pierre gravée en témoigne encore aujourd’hui au col de la Moutière ; ornée de la fleur de lys et de la croix de Savoie, elle porte les dates de 1761 (rectification de la frontière après le traité de Turin du 24 mars 1760) et de 1823 (Restauration sarde).
Avec le rattachement de Nice et de la Savoie à la France en 1860, puis la proclamation du royaume d’Italie en 1861, le massif du Restefond devient alors, à l’est, frontalier entre la France et l’Italie. A la suite de la guerre de 1870, la France et l’Italie se trouvent alors, pour des raisons différentes, dans des situations identiques en matière d’organisation militaire. La France vaincue réorganise complètement sa défense aux frontières et l’Italie, dont l’unité est enfin réalisée, restructure, elle aussi, son armée.
En mai 1874, le général Séré de Rivières fait paraître son « Exposé du système défensif de la France » qu’il vient de présenter quelques mois auparavant au Comité de Défense qui en a adopté les propositions, et en particulier pour les Alpes : « Les débouchés des vallées sont partout formés par de formidables étranglements, aussi faciles à défendre que difficiles à forcer. Dans ces conditions, pourquoi confierait on à des forces actives qui seront bien plus utiles ailleurs le soin de barrer les débouchés […] alors que l’on peut obtenir ce résultat au moyen d’ouvrages permanents ? » Se trouve ainsi posé le principe des forts d’arrêt. Dans le même temps, l’augmentation de portée qu’apporte l’apparition de l’artillerie rayée amène Séré de Rivières et ses successeurs à ajouter un système de forts assurant la maîtrise des hauteurs au devant de ces barrages des vallées.
Ces dispositions trouvent leur pleine justification avec l’adhésion en 1882 de l’Italie à l’alliance austro germanique de 1879 constituant ainsi la Triplice Alleanza ou Triplice. Anticipant ce traité signé secrètement le 20 mai 1882, le Comité de Défense avait demandé en avril la construction de nouvelles fortifications sur la frontière alpine. L’accent fut mis alors sur les forts de surveillance et de protection sur les hauts. En outre, la doctrine évolue d’une conception strictement défensive à un concept plus offensif lorsque le Conseil Supérieur de la Guerre promulge le 30 juin 1882 les premières dispositions relatives à des troupes alpines spécifiques ; mais, ce n’est que le 10 juillet 1888 que seront officiellement créées les troupes alpines formées sur la base de bataillons de chasseurs et de batteries d’artillerie de montagne, stationnées au plus près de la frontière. Les relations franco italiennes continuant à se dégrader (dénonciation du traité commercial par l’Italie le 15 décembre 1886, arrivée au pouvoir de Crispi en avril 1887,… ), l’esprit offensif prédomine alors dans l’organisation militaire alpine. Ainsi, pour coller à la frontière, le général baron Berge, commandant de l’armée des Alpes à partir de 1889, décide de construire, en tête des vallées, des camps et des postes (baraques en pierre) qui seront prêts à être occupés soit pour arrêter à temps toutes les tentatives adverses, soit pour servir d’appui à des entreprises offensives, limitées, qu’il a judicieusement conçues et étudiées. Dès l’hiver 1892 1893, des détachements occupent en permanence les postes déjà construits puis le système s’étend et chaque bataillon a son camp et ses postes d’hiver. Par ailleurs, le général Berge se préoccupe des communications, routes et voies ferrées. Un peu partout dans les Alpes, la main d’oeuvre militaire entreprend de rendre carrossables les chemins de liaison entre les vallées. Ainsi naît tout un système de rocades, un peu analogue au système des navettes de Berwick de 1709 permettant de déplacer rapidement les troupes selon l’axe nord sud des Alpes. A partir de 1894, devant le renforcement de l’armée italienne et en raison des importantes évolutions de l’artillerie (crise de l’obus torpille entre 1880 et 1885), la doctrine revient à des notions plus défensives avec le renforcement des fortifications et leur multiplication (couverture et croisement des feux).
Des fortifications sont alors construites dans le secteur de Restefond jusqu’à cette date considéré comme infranchissable par des troupes ennemies : en effet les Italiens ont considérablement renforcé leur potentiel militaire près de la frontière en Valle Stura et nettement amélioré la viabilité des sentiers menant aux cols de ce secteur (cols du Fer, de Pouriac,… ).
Les fortifications Séré de Rivières du Restefond entrent ainsi dans la constitution d’un ensemble fortifié dit ‘‘organisation défensive de l’Ubaye’’ couvrant la Haute Ubaye et la Haute Tinée. Cet ensemble fortifié comporte :
Position de TOURNOUX et ses ouvrages détachés :
Batterie des Caurres (1879 1884 ; 1890 1897)
Fortin et Poste du Serre de l’Aut (1890 1893 ; 1893 1895)
Batterie et Postes de Vallon Claous (1881 1887)

Batterie et Postes de Cuguret (1885 1888 ; 1891 1893)
Batterie et Redoute de Roche la Croix (inf.) (1884 1889)
Batterie supérieure de Roche la Croix (1884 1894)
Postes de la Duyère (1892 1893)
Blockhaus de Roir Alp (1909-1910 )
Batterie de Mallemort (1884 1886)
Batterie (1885 1889 ; 1893 1894) et Casernement (1887 1889) de Viraysse Tunnel du Parpaillon (1891 1897)
Massif de RESTEFOND :
Casernement défensif ou Fortin de Restefond (1901 1906 ; 1912 1913)
Position du mont des Fourches : 3 Batteries et 3 Blockhaus (1897 98 ; 1898 99 ; 1898 1900)
Camp des Fourches (1900 1910)
Blockhaus de la cime de Pelousette (1899 1902) Blockhaus de Las Planas (1902 1903)
Enfin, un réseau très élaboré de transmission optique couvre les Alpes de Nice à Lyon.
L’Italie lors de la première guerre mondiale inverse ses alliances et combat aux côtés des Alliés. Les fortifications des Alpes deviennent dès lors inutiles, mais le répit ne sera que de courte durée puisque, avec la montée du fascisme en Italie dans les années 1920, se trouve à nouveau posée la question de la défense de la frontière des Alpes. La CDF puis la CORF décide la construction d’une ligne de fortifications en deçà de la frontière ; le 12 février 1929, la CORF présente un projet pour le Sud Est étalé sur dix ans. Le 5 décembre 1929, Maginot, qui vient de remplacer Painlevé au ministère de la Guerre, dépose un projet de loi relatif aux frontières du Nord Est et des Alpes. Il obtient aisément un vote favorable le 14 janvier 1930, ce qui lui vaudra de donner son nom à l’oeuvre qui avait longuement été élaborée et préparée avant lui par son prédécesseur. Les premiers travaux ont d’ailleurs commencé dés septembre 1928 dans les Alpes du sud, à Rimplas, sans attendre que ne soient entérinés par l’Assemblée les projets des Commissions.
Dans ces projets, le massif du Restefond vient compléter au sud le barrage de Larche ; les fortifications du massif ont donc pour objectif de s’opposer au contournement du barrage de Larche par le sud qui permettrait à l’ennemi débouchant de la Haute Tinée de s’emparer de la haute vallée de l’Ubaye en la prenant à revers. Cependant en raison des restrictions de budget, du fait des retards dus aux remaniements incessants des projets et enfin en raison de la difficulté des chantiers en haute altitude, les projets initiaux seront loin d’être réalisés au déclenchement des hostilités en juin 1940.
Le massif du Restefond aurait dû comporter deux gros ouvrages mixtes artillerie infanterie : les Sagnes et Restefond. En fait l’ouvrage des Sagnes fut différé et le nombre de blocs de celui de Restefond fortement réduit. Ainsi, en juin 1940, les fortifications du massif du Restefond comporteront :
Un gros ouvrage mixte artillerie infanterie Ouvrage de Restefond (inachevé)
Des petits ouvrages (PO) et abris actifs
Petit ouvrage ou abri actif du col de Restefond Petit ouvrage du col de la Moutière Petit ouvrage des Granges Communes (inachevé)
Des ouvrages d’avant poste (AP)
AP des Fourches et Bloc de Ventabren
AP du Pra
AP de Saint Dalmas le Selvage
Des points d’appui (PA), abris et postes de commandement
PA des Sagnes
PA de Pelousette (Blockhaus Séré de Rivières)
PA de Las Planas (inachevé)
PA du Lauzarouotte (rocher du Prêtre)
PC du col de Colombart
Abris alpins de la Moutière
Le Fortin et le Casernement de Restefond ainsi que le Camp des Fourches (Séré de Rivières) sont bien sûr également réutilisés.
A la déclaration de guerre en 1939, pas plus qu’en juin 1940 lorsque l’Italie entre dans le conflit, la plupart de ces ouvrages ne sont terminés. De nombreux éléments de cuirassement et de blindage non montés gisent encore aujourd’hui à proximité de certains ouvrages (près des anciennes écuries du Casernement de Restefond et au col de Restefond). Ironie de l’histoire, certains portent, très lisible, le nom des aciéries… allemandes qui les ont produits : Thyssen !
Matériel non monté abandonné au Casernement de Restefond.











Il convient de prendre conscience des énormes difficultés auxquelles furent confrontés les constructeurs de ces fortifications dont la plupart sont situées à une altitude de plus de 2 500 m et pour lesquelles les chantiers ne pouvaient être menés que pendant 2 à 4 mois de l’année, avec les moyens de ces époques : 1890 1910 puis 1930 1940.
Il faut souligner aussi que, si les ouvrages les plus élevés n’étaient occupés qu’à la belle saison, le Casernement de Restefond et le Camp des Fourches ont, dès leur construction, été occupés par la troupe en permanence toute l’année. De grandes manœuvres étaient régulièrement organisées dans cette région, comme celles de 1931 au cours desquelles le général Jacquemot mourut foudroyé (monument au bord de la route entre le col des Granges Communes et le Camp des Fourches).
Monument au général Jacquemot en 1938 et aujourd’hui.


Enfin, il faut se souvenir des difficultés de déplacement dans cet environnement puisque le chemin de Jausiers au col de Restefond dont la viabilité avait été améliorée entre 1880 et 1909 ne fut rendu carrossable aux véhicules automobiles qu’en 1932. Le Camp des Fourches ne restera relié au col de Restefond au nord et à Bousiéyas au sud que par une mauvaise piste et ce n’est qu’en 1950 qu’une véritable route sera ouverte définitivement entre Jausiers et Saint Etienne de Tinée.
Cette route reprend en partie le tracé de l’une des rocades stratégiques alpines créées en 1709 par le maréchal de Berwick qui permettait à cette époque de rejoindre par le col de la Moutière, soit le col de la Cayolle par Bayasse, soit la vallée de la Tinée par Sestrière et Saint Dalmas le Selvage. A la suite du rattachement de la Savoie et du comté de Nice à la France (1860), le gouvernement de Napoléon III lance le projet d’une route impériale Nice Barcelonnette par les vallées du Var et de la Tinée (Décret du 8 août 1860). Cependant, avec la Triplice (1882), la nécessité de fortifier la frontière italienne apparaît. Le système Séré de Rivières concerne dès lors la région Ubaye Tinée. Ainsi, partisans (meilleure desserte des installations militaires) et adversaires (pénétration ennemie facilitée) de ce projet vont longuement s’affronter. A quoi s’ajoutent les difficultés dues au relief montagnard. Ceci et cela expliquent la lenteur de sa réalisation.
Sur le versant Nord, pour la portion Jausiers Casernement de Restefond, l’armée élargit et améliore les anciens chemins à partir de 1880. On distingue encore très nettement le tracé assez différent de celui de la route actuelle (notamment au franchissement du verrou après Halte 2000 et pour la portion terminale qui, de la Cabane Noire, passe par Roche Madeleine puis coupe les lacets de la route actuelle). Cette piste franchira le col par la suite et sera prolongée par un sentier muletier jusqu’au Camp des Fourches au moment de sa construction (1909 1910) ; elle ne sera d’ailleurs rendue réellement praticable aux véhicules automobiles qu’à la fin de 1932 lors des travaux pour les ouvrages Maginot et seulement jusqu’aux cols de Restefond puis de Raspaillon. Il s’agit bien sûr d’une route militaire stratégique, non ouverte à la circulation publique. Juste avant la déclaration de la seconde guerre mondiale, la partie carrossable rejoint le Camp des Fourches.
Sur le versant Sud, un premier tronçon atteint Saint Etienne de Tinée en 1896, puis Saint Dalmas le Selvage fin 1913, et, après l’interruption des travaux pendant la première guerre mondiale, Bousiéyas seulement en 1937. Le Camp des Fourches n’est alors relié à Bousiéyas que par une piste construite en 1913, la ‘‘ Piste du Haut’’.
Lorsque le deuxième conflit mondial éclate, la route n’est donc pas terminée. La jonction définitive (Bousiéyas Camp des Fourches) n’est réalisée qu’après la guerre (travaux effectués par le 7e régiment du génie et le 11e BCA entre le 21 juillet et le 15 septembre 1950 ; stèle près du Camp des Fourches) et la route inaugurée le 22 septembre 1950. Le tracé empruntait alors le versant nord de la cime des Trois Serrières, en franchissant le col de Restefond (2 680 m), d’où son nom.
Dans la décennie qui suit de gigantesques travaux sont entrepris pour en améliorer le tracé, notamment pour faciliter le déneigement, par le contournement de la cime des Trois Serrières par le sud en passant entre celle-ci et la cime de la Bonette à 2 715 m. A l’instigation du Dr J. B. Guiran, conseiller municipal de Nice, l’idée fut alors lancée (le 4 août
1959) de battre le record européen d’altitude pour une route, détenu alors par l’Iseran. Le contournement de la cime de la Bonette permit d’atteindre 2 802 m et de battre le record d’un peu plus de 30 m ! Ce nouveau tracé fut inauguré le 1er octobre 1961 (c’est à dire plus d’un siècle après le décret instituant « Route Impériale » la liaison Nice Ubaye) et dénommé officiellement : Route de la Bonette Restefond. Toutefois la route connut encore bien des vicissitudes. Pour la partie nord (Jausiers Restefond) elle reste domaine militaire, mais l’Armée décide d’en céder la gestion en 1976. Le département des Alpes de Haute Provence considérant la charge trop lourde refuse de l’inclure dans son réseau routier. C’est la commune de Jausiers qui accepte alors de l’intégrer à sa voirie communale. Une Association de défense de la route de la Bonette est créée pour aider la commune de Jausiers, et alerter et sensibiliser les élus et le public. Grâce à ces actions conjointes, en 1986 un syndicat intercommunal est constitué par les 15 communes situées de part et d’autre du col et gère l’entretien et la promotion de la route et du site. Depuis, le Conseil Régional PACA concourt aux travaux de restauration et d’entretien ; la route est enfin intégrée au réseau départemental côté Alpes Maritimes (D 64), et reste gérée par la commune de Jausiers côté Alpes de Haute Provence. Finalement, cette partie est définitivement cédée à la commune de Jausiers par décision du ministre de la Défense en date du 20 septembre 2004.
Au bord de l’ancienne piste, côté Jausiers, monolithe gravé. Insigne (cor de chasse) du 14e BCA, 6e Cie, 1905.



Extrait de la carte Michelin de 1932.
Le GC 29 s’arrête à Saint-Dalmas et ne se prolonge du Pont Haut à Vens que par un chemin de viabilité incertaine.
Extrait de la carte Michelin de 1937.
Le GC 29 qui desservait Saint Dalmas a été prolongé du Pont Haut jusqu’à Le Pra (GC 29 A ).
On notera que les cartes n’indiquent aucune des installations militaires anciennes de cette zone (Fortin de Restefond, Pelousette, Camp des Fourches, Las Planas) alors que se trouvent indiquées les positions Séré de Rivières du secteur de Larche (Roche la Croix, Mallemort, Viraysse).

NB : pour les deux cartes, le col indiqué « Col de Pelouse » est en fait le col de Raspaillon encore appelé col des Granges Communes.





Cette batterie et ses annexes ne font pas partie à proprement parler des fortifications du massif du Restefond puisqu’elles se situent au dessus de Jausiers sur les contreforts de la Tête de Siguret. Cependant la batterie se trouve intégrée en juin 1940 dans le dispositif défensif du Restefond.
La route d’accès est tracée dès 1884 et la batterie construite de 1885 à 1888. Un premier poste optique est ajouté en 1889. En 1891, la batterie est remaniée et complétée d’un casernement extérieur. En 1892 1893, plusieurs postes extérieurs sont ajoutés dont l’un sert de second poste optique.
L’armement initial est de 4 x 95 Lahitolle sur terre plein puis, après remaniement, de 2 x 95 sous casemate. Ces deux pièces (95 S et P) seront toujours en service en juin 1940 et constitueront le groupement B1 d’appui direct, adapté au quartier des Sagnes, commandé par le lieutenant Ravet du 162e RAP. Ces pièces prennent sous leurs feux le vallon des Sagnes et le débouché routier du Restefond sur Jausiers.

Vue intérieure de l’enceinte lors d’un ravitaillement.





Entre 1901 et 1912, plusieurs centaines d’ouvriers s’activent à 2 500 m d’altitude pour construire cet ensemble à raison de 2 à 4 mois chaque année. Le fortin, à enceinte crénelée et flanquée (créneaux et meurtrières de fusillade), est érigé en premier (1901 1906). Une plaque sur la façade sud est ornée du cor, emblème des chasseurs, et rappelle que ce sont les 14e, 28e, et 30e bataillons de chasseurs à pied et un détachement du 4e génie qui ont participé à la construction de 1901 à 1905, dates figurant de part et d’autre du cor. Ce fortin comporte, autour d’une cour rectangulaire, trois bâtiments, chacun pour une compagnie, l'un avec four à pain et magasins, le quatrième côté étant fermé par une courtine. A côté de l’entrée, se trouve l’édifice carré du corps de garde. En 1912-1913, plusieurs bâtiments extérieurs indépendants viennent le compléter : quatre écuries, une infirmerie, une cuisine ainsi qu’un pavillon officiers sur deux niveaux. Un marquage au dessus d’une embrasure du fortin signale une reprise de maçonnerie en 1928. Plusieurs pièces de logement du fortin ont été décorées par la suite de petites fresques représentant l’insigne SES du 11e BCA et de frises de chasseurs alpins en diverses postures et attitudes.
En 2003, deux bâtiments menaçant ruines et devenus dangereux (pavillon officiers et cuisine) ont été rasés, ainsi que deux écuries un peu auparavant.
A partir de 1931, l’activité devient importante avec les travaux des ouvrages Maginot entrepris au Restefond, au col de la Moutière et aux Granges Communes. Un téléphérique est même installé entre la Prégonde (1 600 m) et le Casernement. Cinq cents hommes du 5e RTM participent aux travaux.

A la déclaration de guerre, la construction de ces ouvrages sera loin d’être terminée, ce qui explique la présence, sur le terre plein devant les écuries (et, il y a encore peu, dans ces dernières, avant leur réutilisation par l’armée) de nombreux matériels de cuirassements abandonnés (cloches, trémies, plates formes,…). On trouve également des cuirassements non utilisés abandonnés au col de Restefond.

En juin 1940, le casernement de Restefond sert de PC au lieutenant colonel Soyer commandant le sous secteur Jausiers (voir ordre de bataille français).

Soixante ans séparent ces deux vues du Fortin et du Pavillon Officiers.


Parement de briques des ouvertures, portes et fenêtres, côté cour intérieure.



Décoration intérieure : insigne SES 11e BCA et frise de chasseurs alpins.




Construit de 1899 à 1902, c’est la position la plus septentrionale du système Séré de Rivières du secteur Restefond et la plus haute en altitude dans ce secteur (2 757 m).

Il s’agit d’un casernement défensif à simple rez-de-chaussée avec deux ailes s’articulant selon un angle très ouvert sur un bastionnet central flanquant la façade. Le bâtiment est adossé à une masse couvrante en pierres sèches. Prévu pour 2 officiers, 4 sous officiers et 100 hommes, avec cuisine (fourneau en fonte signé François Vaillant fabricant à Vadonville dans la Meuse et daté de 1903), citerne, dépôts et magasins à munitions, le casernement aux murs percés de créneaux de fusillade donne accès, par un escalier central fermé par des trappes, à une banquette de tir en terrasse.
On relève plusieurs marquages laissés par les troupes qui ont construit ou occupé l’ouvrage. Une pierre gravée du mur extérieur est de la terrasse porte l’indication ‘‘30e Bataillon Alpin’’ et une autre dans la façade sud du fortin ‘‘157e Rt d’Infie’’. Le mur nord de la terrasse présente côté intérieur un cartouche ainsi libellé :
A 11e BCA Gap Htes Alpes 12 9 1932 LAD
Au même endroit, un autre cartouche gît au sol, éclaté et très abîmé, de sorte que les mentions qu’il portait sont totalement illisibles, sauf ‘‘4e Génie’’.
Occupée régulièrement jusqu’en 1914, cette position servira, en 1940, de point d’appui, tenu par des éléments de la 2e compagnie du 73e BAF, armés de FM et de mortiers.



Le système de protection des frontières selon les principes Séré de Rivières conduit, pour la Haute Tinée, à la réalisation d’un masque défensif tourné vers l’est protégeant les cols de Restefond et des Granges Communes et articulé autour du mont des Fourches (2 341 m). Il englobe, outre le mont des Fourches, le Blockhaus ou Fortin de la cime de Pelousette au nord, et celui de Las Planas (ou de la Tête de Vinaigre) au sud ; il sera complété par le Camp des Fourches.
La Position des Fourches vue de la cime de Pelousette.
A partir de 1889, trois batteries sont installées au mont des Fourches. Sur l’emplacement de celle située le plus près du col sera établi l’AP du col des Fourches (ligne Maginot). On distingue encore parfaitement les deux autres : l’une domine le Salso Moreno sur le rebord nord est du mont des Fourches, l’autre dont les terrasses présentent des murs de soutènement en pierres sèches est positionnée au sommet. Puis trois blockhaus, un au nord (n° 1, au lieu dit Ventabren) pour 25 hommes (1897 98) (ruines), un à l’est (n° 2) (1898 99)

également pour 25 hommes (en ruines aussi) avec un escalier extérieur conduisant à une terrasse aménagée sur un bloc rocheux surplombant (ces deux blockhaus sont des constructions rustiques avec murs en maçonnerie, toit de bois et de zinc recouvert de terre, à pièce unique équipée de lits de camp ordinaires) ; enfin le Blockhaus n° 3 pour 50 hommes (1898 1900, remanié en 1903 1905) qui, au sud ouest, à 2 312 m d’altitude, découpe toujours sur le ciel sa silhouette aux allures féodales. Au linteau de la porte, la date de début de sa construction : 1898. Les murs sont percés de créneaux de fusillade. De part et d’autre d’un couloir central, il se compose de deux travées, l’une pour 22 places sur lits de camp à deux étages, l’autre pour 28. Il inclut aussi une cuisine et une chambre d’officier. Cette dernière donne accès à une cage de bastionnement équipée d’échelons métalliques pour atteindre le toit aménagé en terrasse protégée par merlons et créneaux. A l’angle opposé, se situe l’échauguette métallique (sans doute la dernière qui existe en France !) qui contribue fortement à donner sa silhouette si caractéristique à cette fortification.
Blockhaus n° 1 des Fourches : plan et vue des ruines.










On peut voir également au sommet du mont des Fourches les vestiges d’une petite construction maçonnée, avec meurtrières, qui semble avoir été un poste d’observation. On distingue aussi encore quelques traces des bases des pylônes du téléphérique installé vers 1930 pour relier le Pra au Camp des Fourches.


Le portique du téléphérique et ce qu’il en reste aujourd’hui.


La même vue panoramique aujourd’hui.

Si l’emplacement du camp à 2 260 m d’altitude a été utilisé en bivouac d’été dès les années 1890, ce vaste ensemble, véritable « village militaire » au plan très géométrique, a fini d’être édifié en 1909 1910. Il se compose de 26 baraques principales et d’une esplanade pour dresser des tentes en été. Il permettait le logement et la subsistance d’un bataillon de chasseurs alpins à 4 compagnies de 150 hommes. Dés sa construction, il fut occupé en permanence été comme hiver (en hiver, effectif réduit, la communication entre les baraques se faisant sous la neige épaisse par de petites galeries en planches surnommées « le métro »).

Dans les petites baraques aux allures de chalets, pour une même surface habitable, étaient logés soit 10 hommes de troupes, soit 4 sous officiers, soit 2 officiers. Certaines pièces présentent une décoration de fresques naguère magnifiques mais qui ne cessent, année après année, de se dégrader puisque les bâtiments sont ouverts à tous vents et ne font l’objet d’aucune mesure de sauvegarde. L’incurie des autorités responsables aura ainsi laissé disparaître un patrimoine pictural exceptionnel, témoignage s’il en était des conditions de vie de plusieurs générations de soldats sur ce site. De plus, ici comme ailleurs, malheureusement, le vandalisme imbécile a fait ses ravages. Toutefois, on peut encore admirer (tant qu’il en est encore temps) de véritables chefs d’œuvre (baraque m du plan) : jongleuse à la lune ; revue nègre ; scènes de skieurs, militaires et civils, in situ avec à l’arrière plan le camp et son téléphérique parfaitement reconnaissables ; frises de chasseurs alpins dans divers exercices (escalade, ski, marche en cordée sur glacier,…) ; etc.
A la sortie nord du camp, se trouvait le captage qui alimentait le camp en eau.
Sur cette carte postale ancienne, n’apparaît pas encore le bâtiment à un étage (mess / poste de commandement) qui ne sera construit qu’en 1907.
Vue générale du Camp des Fourches hier (1938) et aujourd’hui (2004).

Sur la photo ancienne, on distingue les câbles arrivant à la recette du téléphérique Cette recette a été détruite en 2005 pour élargir la route !

Vue générale du Camp des Fourches hier (1938) et aujourd’hui (2004).


Plan du Camp des Fourches.





En 1938, l’entrée du mess s’orne d’un thermomètre surmonté de l’insigne de la SES 11e BCA.

Le mess et poste de commandement dont l’intérieur est orné de fresques. L’étage abritait un poste de transmission optique.



Jongleuse acrobate (dite‘‘ à la lune’’).


Certaines fresques sont traitées sous forme d’affiche. Mésaventure de skieurs civils et… militaires. Remarquer en haut du dessin de droite la représentation schématique du Camp et de son téléphérique.


L’artiste a même représenté dans la frise le bâtiment poste de commandement / mess sur lequel flotte le drapeau tricolore.

Frise de chasseurs alpins.






NB : état des fresques en 1998, depuis elles n’ont cessé de se dégrader !

Au cours de la construction du camp, un sentier muletier fut ouvert pour rejoindre vers le nord le col de Restefond, mais vers le sud ce n’est qu’en 1913 que la ‘‘Piste du Haut’’ remplacera le sentier de Bousiéyas. En raison de ces difficultés de circulation, vers 1930, un téléphérique reliera le camp au Pra via le mont des Fourches (la recette d’arrivée était le premier bâtiment à gauche de la route en venant de Bousiéyas, coté bb’ sur le plan, qui a été détruit en 2005 pour élargir la route). Si la piste fut rendue carrossable côté Restefond juste avant la déclaration de la seconde guerre mondiale, côté sud la partie carrossable venant du Pra atteignit Bousiéyas en 1937…et s’y arrêta. Ce n’est qu’en septembre 1950 (stèle près du camp) qu’une véritable route fut ouverte et traversa alors selon le tracé actuel le Camp des Fourches. Ces travaux furent menés du 21 juillet au 15 septembre 1950 par le 11e BCA et le 7e régiment du génie.
Il constitue l’extrémité méridionale du masque défensif Séré de Rivières du secteur de Restefond. Il s’agit d’un petit bloc défensif pour 25 hommes construit à 2 394 m d’altitude en 1902 1903, petit bâtiment, en rez de chaussée, présentant des créneaux de fusillade ; une belle charpente soutient le toit en terrasse auquel on accède par un escalier protégé. L’ensemble est adossé, côté est, c’est à dire côté ennemi, à une masse couvrante polygonale, doublée d’un mur banquette en pierres sèches. A proximité, citerne de récupération des eaux pluviales et plus loin, en léger contre bas, les latrines. Un point d’appui y fut installé en 1939 40.

Escalier protégé donnant accès au toit terrasse autrefois crénelé.




Un édicule pour le moins curieux qui surplombe la vallée avec une vue magnifique :… les latrines !



Cet « abri de type Sud Est » (une galerie parallèle aux courbes de niveaux reliée à l’extérieur par deux tronçons de galerie débouchant aux blocs d’entrée et complétée d’un bloc cheminée/issue de secours) est établi à contre pente de l’arête nord ouest de la cime des Trois Serrières, à 2 690 m d’altitude. Une galerie traverse cette arête et dessert un bloc actif complémentaire (B3) battant les pentes nord et l’ancienne route descendant vers les Granges Communes (col de Raspaillon). Le PO de Granges Communes croise ses feux (créneau FM du bloc B2) avec ce bloc. Les blocs entrée B1 et B2 se trouvent au bord de la route. B1(nord ouest) est aussi un bloc actif, car il présente une cloche GFM et un jumelage de mitrailleuses défendant les arrières du gros ouvrage de Restefond.
Du fait de cette configuration, ce PO est désigné le plus souvent comme « Abri actif du col de Restefond ». Il comporte aussi un bloc cheminée/issue de secours (B4).

Armement : Bloc B1 : un JM + un FM + une cloche GFM
Bloc B2 : un FM
Bloc B3 : un JM + un FM + une cloche GFM
Commencé en 1931, le gros œuvre sera terminé en 1934, mais l’ouvrage ne sera fini qu’en 1937 et même équipé de son armement qu’en 1938. En juin 1940, l’abri est le PC du 73e BAF (commandant Lebeau) pour le quartier Restefond ; l’ouvrage commandé par le sous lieutenant Simonet a un équipage de 82 hommes.
Noter







A proximité du col de Restefond, un œil attentif et averti peut encore distinguer les vestiges d’emplacements de batteries d’artillerie implantées en 1940 :
Près du faux col de Restefond, un peu en dessous de l’embranchement de la piste descendant vers le col de la Moutière, en contre bas de la route, se situait en juin 1940 les batteries d’artillerie K 33 et K 35 (2 X 2 X 65 M) du lieutenant Testut, dont les emplacements sont toujours facilement reconnaissables. Ces batteries prévues au mont des Fourches n’avaient pu y être installés du fait de l’enneigement encore très important.
Entre la route de la Bonette et la piste descendant au col de la Moutière, on peut toujours déceler terrasses et abris marquant les emplacements des batteries K 36 et K 37.
Dépendant du groupe d’action d’ensemble B4 (chef d’escadron Perroy du 162e RAP), la batterie K 36 est constituée de 4 canons de 155 L Mle 1897 sous le commandement du lieutenant Giraud. Compte tenu de l’enneigement, les canons ne pourront être installés aux emplacements prévus, mais seront mis en batterie près du Casernement (trois sur quatre seulement en état de tirer). Durant les hostilités, la batterie K 36 intervient : à raison de 12 coups, le 20 juin ; 20 coups, le 22 juin ; 14 coups, le 23 juin ; 52 coups, le 24 juin (dont une trentaine sur le versant italien du col de Larche sur Grangie pour couper la route et sur Bersezio où se trouve le PC du IIe CA italien où 11 tués seront dénombrés à la suite du bombardement) ; soit un total de 98 coups.
Dépendant, elle aussi, du groupe d’action d’ensemble B4, la batterie K 37 regroupe sous les ordres du lieutenant Cadillac 4 canons de 155 C Saint Chamond. Au cours des hostilités, elle tire : 40 coups, le 21 juin 1940 ; 24 coups, le 23 juin ; 143 coups, le 24 juin ; soit un total de 207 coups.
Bien qu’inachevé, c’est l’ouvrage le plus important et le plus imposant de la position de Restefond. Il s’agit d’un gros ouvrage mixte artillerie infanterie s’étageant entre 2 710 et 2 735 m d’altitude : il est donc l’ouvrage le plus élevé de la ligne Maginot alpine.
Le premier projet présenté à la CORF le 9 novembre 1929 va connaître de nombreuses vicissitudes et sera repris et modifié successivement en décembre 1930, en novembre 1932, puis en 1934 et encore en 1937. Le projet ainsi remanié fin 1937 aurait dû comporter 8 blocs dont un (B7) reporté en programme complémentaire. A la déclaration de guerre, l’ouvrage est en fait loin d’être terminé : c’est encore un véritable chantier où se croisent soldats et ouvriers terminant à la hâte les équipements les plus indispensables. Les blocs comme les souterrains restent largement inachevés. En juin 1940, c’est le capitaine Gilotte qui assure le commandement d’un équipage de 10 officiers et 216 hommes.
Bloc B1 Entrée (non construit)
Seule la fouille du bloc était terminée et l’entrée actuelle au bord de la route n’a été réalisée que dans les années 1950. Le bloc prévu aurait comporté un fossé diamant avec pont levis, un garage pour 2 camions, 2 caponnières pour FM, une cloche GFM et une cloche lance-grenades.
En 1939 40, il existait aussi une entrée provisoire utilisée pour le creusement des souterrains. Elle fut obstruée par le génie après la guerre par pétardage.
Bloc B2 Artillerie (non construit, fouille terminée)
Prévu pour une cloche GFM et deux mortiers de 81 mm battant le ravin de Granges Communes. Une galerie partant de ce bloc aurait abouti à l’issue de secours de l’ouvrage (non réalisée).
Bloc B3 Bloc d’infanterie Nord (terminé)
Ce bloc comporte une cloche JM et une cloche GFM.
Bloc B4 Bloc d’infanterie
Comme B3, cloche JM et cloche GFM mais aussi une cloche observatoire pour l’artillerie de l’ouvrage (observatoire O 19) située entre les deux citées précédemment.
Les blocs B4 et B3 présentent également chacun, en superstructure, un champignon blindé d’aération.
Initialement prévus avec des mitrailleuses d’action frontale sous casemate, ces blocs furent équipés de cloches cuirassées plus discrètes car la route prolongée en 1937 jusqu’à Bousiéyas pouvait être une voie de pénétration ennemie importante et en vue directe. Ils battent donc les pentes qui montent de la haute Tinée.
Bloc
Il aurait dû être armé de 2 canons obusiers de 75 mm modèle 32 et d’un mortier de 75 mm modèle 31 (armement identique à celui de B6). Tourné vers le sud est en direction de Las Planas et de Saint Dalmas le Selvage, il aurait couvert la position vers le sud conjointement avec l’ouvrage de Rimplas.
Bloc B6 Bloc d’artillerie Sud (terminé)
Judicieusement défilé légèrement à contre pente de la crête de la cime des Trois Serrières (il est positionné en action frontale et non en flanquement ce qui justifie par ailleurs une épaisseur de béton des façades supérieure à la normale), il présente le même armement que celui prévu à B5 : deux canons obusiers 75/32 orientés vers les cols frontière, et un mortier 75/31 axé sur le col des Fourches, le Salso Moreno et le Pas de la Cavale. Deux créneaux FM et une goulotte lance grenades assurent la défense rapprochée ; une issue de secours débouche dans le fossé diamant. Le bloc est desservi par un monte charge ; son PC se situe sous la chambre de tir du mortier 75/31. La superstructure comporte deux champignons d’aération blindés.
Bloc B7 Bloc Artillerie sous tourelle (reporté en programme complémentaire)
Ce bloc sommital fut ajouté dans la révision du projet de 1932. Il aurait dû être équipé d’une vieille tourelle de 75 mm modèle 1905 non utilisée pendant la guerre de 1914 1918 et restée sur parc depuis lors. Ce bloc est ajourné par le général Mittelhauser (note du 28 octobre 1937) tant par mesure d’économies que du fait de son efficacité très relative puisque la portée de l’armement prévu ne permettrait pas de battre convenablement les cols frontière de Pouriac et du Fer, ni de contrebattre l’artillerie italienne dans la zone du col de Larche. Le bloc aurait dû comporter également une cloche GFM.
Bloc B8 Cheminée/Aération/Issue de secours
Ce bloc, situé en arrière de la crête, entre B1 et B6, comporte l’issue de secours à défaut de celle non réalisée.
Bien que fort loin d’être terminé, l’ensemble reste impressionnant pour un ouvrage alpin construit à une telle altitude : la galerie principale restée incomplète mesure 130 m de long, le total des souterrains 668 m et les puits des blocs 64 m en hauteur cumulée ! On retrouve les divers locaux classiques d’un gros ouvrage dont la centrale qui était équipée de 3 groupes principaux CLM type 408 de 45 KVA et d’un groupe auxiliaire de 3 KVA. La galerie devant desservir B5 n’a pas été bétonnée et s’y trouvent toujours cintres et étais de bois restés sur place. L’extrémité sud est de la galerie principale où s’embranche la galerie desservant B6 aurait dû être prolongée vers B7.
Sur l’arête sommitale, deux éléments retiennent aussi l’attention : un vaste réservoir bétonné à ciel ouvert, à peu près à l’emplacement prévu de B7, et les restes du treuil utilisé pour les travaux ainsi que ceux de la centrale à béton.
Extrait
Ce plan montre l’ensemble des blocs tels qu’ils avaient été prévus.

Depuis la cime de la Bonette, vue panoramique sur l’ouvrage de Restefond et l’abri du col de Restefond.














Ce PO est positionné au col de Raspaillon (ou col des Granges Communes), à 2 513 m d’altitude. Il s’agit d’un petit ouvrage d’infanterie qui assure la défense nord est du centre de résistance de Restefond. Le projet initial de décembre 1930 prévoit 3 blocs. Les travaux commencent dès l’été 1931, mais en 1934 un nouveau schéma ne comprend plus que 2 blocs, avec les casemates d’action frontale remplacées par des cloches pour jumelage de mitrailleuses, d’où un projet restreint à : un Bloc B1 à la fois entrée et casemate de flanquement armée d’une arme mixte (canon de 25 mm + jumelage de mitrailleuses) et de deux mortiers de 81 mm destinée à battre les pentes du ravin des Granges Communes en avant des positions du Restefond. Ce bloc n’est pas encore construit en juin 1940 et ce n’est qu’en 1956 que sera réalisée l’entrée simple que l’on voit aujourd’hui un Bloc B2 d’action frontale armé de 2 cloches JM et de 2 cloches GFM dont une modifiée en observatoire (O 20) au profit de l’ouvrage de Restefond. Il bat les pentes de la haute Tinée comme les blocs 3 et 4 de l’ouvrage de Restefond. L’arrière du bloc dispose d’une issue de secours et de deux créneaux FM de défense rapprochée dont l’un croise ses feux avec le bloc mitrailleuse B3 de l’abri du col de Restefond.
La partie souterraine de l’ouvrage est principalement constituée d’un vaste abri caverne bétonné dans lequel les différents locaux techniques ou de vie sont délimités par des cloisons en maçonnerie légère. Un certain nombre d’équipements sont encore en place (lits, tables rabattables, plates formes des cloches, etc.). La mini usine comportait deux groupes. A l’extrémité des galeries opposée à l’entrée, se trouve l’ensemble ventilation chauffage avec prise d’air extérieure débouchant en avant du Bloc 2.
L’approvisionnement en eau se faisait à partir d’un captage situé prés de l’ancienne route à peu près à mi distance entre le Bloc B3 de l’abri du col de Restefond et le PO de Granges Communes. Le long de cette ancienne route, on retrouve les regards permettant d’accéder aux vannes des canalisations d’adduction.
En juin 1940, le PO des Granges Communes a un équipage de 2 officiers et 30 hommes, commandé par le lieutenant Boileau.
Bloc B1 Entrée (construit en 1956). N.B. : on pourrait s’étonner que des blocs complémentaires à certains ouvrages Maginot aient encore été construits dans les années 1950 (Granges Communes, Restefond). En fait, jusqu’aux années 1970, bon nombre d’ouvrages Maginot constituèrent, dans le cadre de l’OTAN et le contexte de la Guerre Froide, des abris NBC (Nucléaire Bactériologique Chimique).










Ce PO situé à 2 446 m d’altitude assure la défense sud ouest du centre de résistance de Restefond. Petit ouvrage d’infanterie, il a surtout pour mission d’éviter le contournement du massif du Restefond, qui, depuis la Tinée par le vallon de Sestrière, permettrait à l’ennemi d’atteindre directement Barcelonnette par les gorges du Bachelard (route du col de la Cayolle). Il est commandé en juin 1940 par le lieutenant Taxil (73e BAF).
Cet ouvrage CORF (mais réalisé en grande partie par la MOM) était prévu initialement à 4 blocs dont l’un fut ajourné faute de crédits suffisants. Les travaux débutent en 1931 ; le gros œuvre est terminé en 1934 et l’armement mis en place en 1938. Il est relié au col de Restefond par une piste de 3,5 km. Par ailleurs, la piste venant de Saint Dalmas le Selvage par le vallon de Sestrière (aujourd’hui goudronnée) franchit le col pour ensuite rejoindre par le vallon de la Moutière la route du col de la Cayolle à Bayasse.
Le Bloc 1 Entrée, défendu par deux créneaux FM, comporte un local de déchargement des mulets et le local radio ; à l’extérieur les supports de l’antenne radio sont toujours en place, ainsi que la sortie neige constituée par un prisme vertical en tôle fermé à son sommet par deux volets métalliques et équipé intérieurement d’échelons. Ce dispositif permettait le libre accès même avec une couche de neige de plusieurs mètres et la plupart des ouvrages situés en haute altitude en bénéficiait, aussi bien pour l’entrée principale que pour l’issue de secours.
Le Bloc 2 est une casemate d’action frontale armée d’un jumelage de mitrailleuses avec un créneau FM agissant en flanquement. Ses feux interdisent le débouché du vallon de Sestrière.
Le Bloc 3 occupe une position sommitale avec une cloche GFM. Un petit bloc issue de secours/aération est positionné en arrière du Bloc 2. Enfin, à quelques centaines de mètres dans le vallon de Sagnas se trouve un bloc isolé qui abrite une source captée approvisionnant une citerne ; l’adduction de l’eau jusqu’au PO se faisait grâce à une pompe mue par un moteur (dont on voit encore l’emplacement) puisque le captage se situe plus bas que l’ouvrage
A proximité de l’ouvrage, on distingue également les vestiges (fondations) de divers baraquements et installations ayant servi pour sa construction. A quelques dizaines de mètres de l’entrée, se situe une dalle rocheuse gravée commémorative des FFIU (1944 ; Maquis de Sainte Tulle - Corbières, villages proches de Manosque).
Outre la pierre gravée servant de borne frontière déjà signalée près de l’embranchement sur la route de l’ancienne piste militaire (aujourd’hui sentier GR 56) allant au col de Colombart, on peut voir à quelques dizaines de mètres, sur un replat rocheux, les vestiges d’un ancien mur de défense en pierres sèches avec emplacements de combat percés de créneaux de fusillade.
Sur le coté gauche de la piste en descendant vers le vallon de la Moutière, après la traversée du torrent, d’autres vestiges de baraquements sont visibles.

Enfin, à proximité du col, en juin 1940, se trouve implantée une grande partie de l’artillerie du quartier Rougna (Groupe B3).

Depuis la cime de la Bonette, vue plongeante sur le PO du col de la Moutière. Sur la gauche de la photo, vallon de Sestrière ; sur la droite, vallon de la Moutière. Noter l'importance du terrassement pour dégager le champ de tir du JM du Bloc B2












En empruntant la piste du vallon de la Moutière, à 800 m du col environ, à la hauteur d’un énorme bloc de rocher dénommé la « Pierre d’Annibal », une piste prend sur la gauche et conduit, 200 m plus loin, à un vaste abri construit au pied du versant ouest de la Tête Ronde. Il s’agit d’une réalisation spécifique, très originale, due à la MOM (4e génie, 5e et 6e RTM, 28e RTT) entre 1931 et 1936, à 2 335 m d’altitude. Le projet d’ouvrage est prévu par la CDF dès 1929 puis maintenu par la CORF en 1931.
C’est une construction de près de 50 m de long en deux parties (d’où la dénomination officielle d’abris au pluriel) : une partie rectiligne de 40 m puis 8 m en léger angle rentrant à 165°. Adossée à une falaise rocheuse, elle est constituée de tôles cintrées (ou tôle métro) reposant sur des murs bahuts de béton et recouvertes de béton, terre et rocaille à l’épreuve des tirs d’artillerie de moyen calibre. Le mur latéral, opposé à la falaise, présente une pente de 45° environ ; il est recouvert de rocaille avec un ajustement méticuleux des pierres qui donne à l’ensemble un caractère architectural très particulier. Chaque issue est fermée par une épaisse porte blindée. La construction est surmontée de 6 petits blocs d’aération bétonnés et d’un autre pour l’évacuation des fumées (cuisine). Cet abri avait vocation de casernement pour deux sections mobiles. Les locaux dont l’aménagement est simplifié à l’extrême sont constitués par des pièces pour le logement de la troupe et des officiers, une cambuse et une cuisine.
A proximité immédiate de l’abri, au nord, un petit édicule regroupe 3 latrines. A 100 m environ, au sud, se situe un captage dont l’adduction d’eau aboutit à une bâche près de la cuisine.





La partie principale de l’abri présente trois entrées protégées par de courts murs de flanquement bétonnés ; au dessus de l’une d’elles, se trouve une plaque de béton gravée en partie abîmée dont la première ligne n’est plus lisible (probablement : ABRIS DE LA MOUTIERE) mais où on peut encore lire sur trois lignes : 4eme REG DU GENIE 28eme RTT 1934 ; la partie en léger retour a une entrée du même type, au linteau de laquelle un cartouche porte une magnifique reproduction de l’insigne du 28e RTT (croissant et fennec). Une autre des entrées était surmontée de l’insigne (aujourd’hui disparu) du 4e génie.
Groupe de soldats en tenue de travaux devant l’une des entrées surmontée de l’insigne du 4e génie (août 1938).

(1ère ligne illisible)
Insigne du 28e RTT.
4eme REG DU GENIE 28eme RTT 1934. Cartouches au-dessus des portes d’entrée de l’abri.

L’une des portes blindées porte un très intéressant graffiti ainsi rédigé : « Ici est arrivée la patrouille de 8 homme (sic) commandée par le Lieutenant Ignesti Bataillon de Marche 14/15 1re compagnie 2e section le 16/1/45 » signé caporal chef Brignon dit ? (illisible) suivi des noms des hommes de la patrouille : Ignesti P. Lieutenant, Brignon R. Cap.chef, Petrucci P. (ou T. ?), Moisan B., Oray J., Azevedo J., Targes A. On notera que ne sont inscrits que 7 noms, mais, un peu à part, on trouve aussi inscrit : « par 3 m de neige Petrucci Thomas le 16/1/45 ».

On peut également y voir, croquées au fusain, des têtes de tirailleurs dont l’un semble tenter de poignarder un Hitler curieusement coiffé d’un turban (!?).



L’intérêt de l’abri, outre sa construction assez particulière, réside principalement dans les nombreux marquages dans le béton (linteaux ou cartouches sur les murs) donnant des dates, des noms et unités des constructeurs ou encore des vœux et souhaits aux successeurs, plus ou moins lisibles. Dans la première entrée en venant de la piste de la Moutière, on trouve un premier cartouche rectangulaire :
LA CONSTRUCTION DE CES ABRIS A ETE FAITE PAR LE DETACHEMENT DU 4e GENIE EN COLLABORATION DES DETACHEMENTS DES 5e 6e RTM 11e 15e BCA 93 RAM 2 RAD 99 RIA
La deuxième entrée ne comporte pas moins de trois marquages :
CETTE GALERIE A ETE TOUS MES MEILLEURS PERCEE ET CONSTRUITE SOUHAITS ET VŒUX
PAR LE CAPORAL CHEF MARTIN POUR MON SUCCESSEUR LES SAPEURS BLANC QUANT(?) POUR 1934 DU 4e GENIE WT 1933
LES COFFRAGES ET LES TRAVAUX DE MENUISERIE ONT ETE EXECUTES SOUS LA DIRECTION DU SAPEUR BOSSA 3e CGNIE 4e GENIE
Les deux dernières entrées en présente chacune une :
TOUS MES MEILLEURS SOUHAITS ET VŒUX POUR MON SUCCECEUR POUR 1935 VT
En gris, des mots aujourd’hui illisibles ; l’orthographe est fidèlement reproduite.
CES ABRIS ONT ETE CONSTRUITS
PAR LE DETACHEMENT DES 2e . 3e . 10e Cies DU 4eme GENIE JUIN SEPTEMBRE 1933
A l’extérieur, devant l’abri, une magnifique table d’orientation gravée est malheureusement déjà fort abîmée par les intempéries et continue inexorablement de l’être. La surface de la table a particulièrement souffert, mais, par contre, les tranches de ses côtés portent diverses mentions assez bien lisibles, mais pour combien de temps encore ?

Sur la tranche côté abri, la devise : 4eme GENIE PREMIER PARTOUT.
Sur la tranche côté col de la Moutière :
Sur la tranche côté vallon :
CONSTRUITS PAR (ILLISIBLE) DES DETTS DU 4e GENIE JUIN SEPT. 1934

Sur la tranche côté col de la cime Plate : PELLE PIOCHE OU RAME VOILA NOS ARMES
Autour de l’abri, plusieurs bornes gravées dont certaines malheureusement en très mauvais état portent les noms et numéros des unités qui ont participé aux travaux et précisent leurs dates. La borne nord, côté col de la Moutière, porte les inscriptions suivantes :
Schéma développé de la borne nord.
Une borne au sud est aujourd’hui presque illisible ; on distingue encore la mention : PISTE DU 4e GENIE ET DU 28e RTT. En dessous, il semble que figuraient les noms de deux cols, peut être ceux de la Moutière et de la cime Plate.

Une troisième borne, très détériorée indique l’emplacement du coude de la canalisation d’adduction d’eau (coude à 6 mètres).
Depuis la piste remontant en direction du col, on devine encore, dans les alpages en contre bas, les allées dallées et les emplacements circulaires, délimités par des cailloux, des tentes du personnel pour le cantonnement pendant les travaux et pour la période estivale.
Ces emplacements sont disposés autour d’une source dégagée sous un rocher qui porte une dalle gravée : 28 RTT CM2 1934. Un peu à l’écart, git sur le sol une autre dalle gravée : 28e RTT 1933, signée PRAT.


Un peu plus loin, un énorme bloc rocheux dénommé « Pierre d’Annibal » porte à son sommet une petite dalle gravée très abîmée (on devine encore la mention d’une compagnie du génie). On trouve enfin un peu plus haut vers le col, sur le coté gauche de la piste, avant un petit torrent, une dalle portant outre les mentions : 4e GENIE VALEUR ET DICIPLINE (sic), les indications : BAYASSE 40’ et RESTEFOND 1H

Cet ouvrage d’avant poste est construit par la MOM, à 2 261 m d’altitude, entre 1931 et 1935, selon un plan original (c’est à dire ne correspondant pas à un plan CORF) . Il est intéressant de comparer sa conception architecturale à celle de l’AP de Larche ; les similitudes sont flagrantes. L’ouvrage se situe à l’emplacement d’une ancienne batterie de 1897, sur la pente nord ouest du mont des Fourches juste à la baisse du col du même nom. Il domine le vallon de Salso Moreno et contrôle les cols de Pouriac et du Pas de la Cavale. L’ouvrage comporte six blocs dont l’un (B6) était initialement un bloc détaché. Il est commandé en juin 1940 par le lieutenant Delécraz (effectif : 1 officier et 42 hommes).
Plan et vue générale de l’AP du col des Fourches.


Le Bloc B1 abrite l’entrée de l’ouvrage complétée d’un emplacement pour mortier. A proximité, presque accolée, se situe aussi une soute (magasin) en tôle cintrée et béton.
Les Blocs B2 et B3, à l’extrémité nord est des galeries, armés chacun d’une mitrailleuse, battent directement de leurs feux les pentes descendant du col vers le Salso Moreno.



Le Bloc B4 pour FM, présente deux créneaux de tir, l’un défendant l’arrière de la position et le bloc entrée, l’autre croisant ses feux avec B6 situé de l’autre côté du col. Il présente aussi une issue de secours équipée d’une porte blindée et un curieux créneau trapézoïdal orienté vers le haut en direction de la cime de Pelousette (signalisation optique ? ).
Le Bloc B5 est à deux niveaux : l’un actif pour FM avec plusieurs créneaux de défense arrière et de flanquement ainsi qu’une issue de secours identique à celle de B4, l’autre au dessus du précédent muni de deux longues fentes d’observation constituant l’observatoire de l’ouvrage. A proximité, légèrement au dessus, se trouve l’ancienne table d’orientation.
Vue depuis le Bloc B6.
Le Bloc B6 est placé sur le versant opposé de la baisse du col. Prévu initialement comme un bloc détaché complémentaire, il ne fut relié au reste de l’ouvrage que tardivement, en septembre 1939, par une galerie de 70 m de long passant sous le col et aboutissant à proximité de B3. Deux créneaux FM (dont l’un croise ses feux avec B2 et B3) défendent en flanquement le col lui même.



Bloc B6.
L’aménagement intérieur de l’ouvrage est, comme dans tout avant poste, rustique voire rudimentaire. Il reste quelques ventilateurs à bras ; l’accès aux blocs par puits bétonnés se fait par des échelons métalliques scellés en diagonale dans les angles ; on trouve les classiques couchettes en béton dans des élargissements des galeries et, ce qui est plus particulier, vers B2, un petit local équipé de couchettes en bois, avec tablettes rabattables, chaque emplacement de couchage portant sur le mur un numéro inscrit à la peinture jaune.
Autour des blocs, divers vestiges du réseau de barbelés sont encore en place : cornières, queues de cochon, ardillons,… Certaines photos d’époque montrent que les blocs étaient pour certains, partiellement au moins, camouflés par un revêtement de pierraille qui a disparu avec le temps.

Enfin la position est complétée au nord (à proximité des vestiges du petit blockhaus Séré de Rivières) par un bloc détaché assurant la protection du versant nord du col (dit Bloc de Ventabren en raison du toponyme du lieu de son implantation ou Bloc Nord). Son architecture est très particulière : il s’agit d’un petit bloc pour FM dont l’entrée a été prolongée d’un bref couloir où a été aménagée une embrasure de tir pour un second FM. De l’extérieur, le bloc paraît composé de deux chambres de tir grossièrement disposées en V. Autre curiosité : le toit est hérissé de ‘‘queues de cochon’’ aux pointes acérées. Ce toit porte également une magnifique inscription : 1ere Cie 2eme Son 73 BAF 1939.



Situé à quelques centaines de mètres de la sortie du hameau du Pra en direction de Bousiéyas, cet ouvrage d’avant poste domine le cours de la Tinée dont il barre la haute vallée, au pied du mont des Fourches. Il a été construit par la MOM entre 1931 et 1935, selon un plan original ne correspondant pas à un schéma CORF, mais il rappelle toutefois la configuration générale d’un petit ouvrage. Il se compose de 5 blocs bétonnés reliés par des galeries et des emplacements de combat extérieurs à ciel ouvert également bétonnés. En juin 1940, il est commandé par le lieutenant Josserand (effectif : 1 officier et 32 hommes).
Le Bloc B1 Entrée est en fait une galerie en courbe, percée de plusieurs créneaux FM. La partie souterraine de l’ouvrage est ensuite essentiellement constituée d’une large galerie séparée en deux principaux locaux de vie successifs et sur laquelle s’embranchent de courtes galeries secondaires desservant les blocs.
Bloc B1.
Les Blocs B2 et B3 sont des casemates pour mitrailleuse, d’action frontale principalement mais avec un créneau de flanquement également.
Au centre : Bloc B3 (fortement déchaussé) à deux créneaux mitrailleuse. Remarquer les vestiges du revêtement de camouflage en « galettes » de béton. A gauche, B5. A droite, B4 avec, en dessous, l’un des créneaux de la galerie qui y conduit




Le Bloc B4 est équipé de plusieurs créneaux FM et d’une fort curieuse fente d’observation fermée par un étroit volet métallique. Il constitue aussi l’issue de secours qui donne accès à un emplacement de combat extérieur, bétonné, à ciel ouvert. La galerie qui conduit à ce bloc est percée de deux créneaux.
Le Bloc B5, situé entre B2 et B3, est un observatoire pouvant servir de bloc actif qui a la particularité de présenter une embrasure frontale ressemblant à un créneau de tir mais aussi des embrasures latérales… trapézoïdales ! Ces embrasures pouvaient être obturées par des volets métalliques. Un créneau de tir défend l’arrière du bloc.

Bloc B4, vue intérieure.
Bloc B5, vue latérale.
Les blocs étaient recouverts d’un très particulier revêtement de béton en « galettes » sur treillis métallique dont il ne subsiste que quelques vestiges. Ce revêtement servait au camouflage, l’herbe poussant entre les galettes de béton.



Enfin, les seuls équipements encore en place, outre les trémies des créneaux et leurs volets d’obturation, sont des groupes de ventilation à bras.
Au dessus de B2, se situe un curieux emplacement de combat extérieur, en forme de croissant, bétonné, à ciel ouvert, auquel on accède par quelques marches descendantes et qui comporte dans sa paroi antérieure une longue niche (emplacement de mortier ?). En arrière de l’ouvrage, subsiste une table d’orientation circulaire dépourvue aujourd’hui de tout marquage.
Situé sur la route menant au col de la Moutière au lieu dit ‘‘Bec de la Caïre’’ (cinquième épingle à cheveux après Saint Dalmas), il barre l’entrée du vallon de Sestrière et interdit l’accès au vallon de Gialorgues. Cet ouvrage fait partie des avant-postes créés en complément des ouvrages de la CORF. Il a sans doute été construit entre 1931 et 1935 par la MOM. En 1940, il marque la charnière entre le XIVe CA (SFD et 64e DI) au nord et le XVe CA (SFAM et 65e DI) au sud. Son effectif est de 1 officier et 37 hommes.

Un petit Bloc Entrée (ouvrant curieusement coté ennemi !) est aujourd’hui à demi enterré et impraticable, simple émergence de béton encadrant une porte blindée. Cette issue est positionnée perpendiculairement à la galerie principale quasiment rectiligne conduisant à gauche au Bloc B1, et à droite à B3 puis après un léger coude à B2. Au niveau de B3 d’une part, et un peu avant B2 d’autre part, deux galeries secondaires presque perpendiculaires à la galerie principale donnent accès aux Blocs B4 et B5. Ces deux galeries secondaires sont reliées par une galerie transversale où se trouvent encore des couchettes métalliques rabattables fixées à la paroi. Dans la galerie principale, on peut aussi voir une bâche à eau et un petit groupe de ventilation.

Couchettes métalliques rabattables. Groupe de ventilation.
Le Bloc B1 comporte une chambre à trois créneaux FM et un second local à vaste embrasure fermée par une murette de béton en arc de cercle (emplacement de mortier). Les trois consoles de béton, supports des FM, portent, marqués au pochoir à la peinture noire, des repères et respectivement les nombres 24, 42, et 72. Sur un des murs, près du début de la galerie, se trouve un cartouche portant, gravée sur sept lignes, l’inscription : « LE 10 MAI 1935 141 RIA 11Cie (?) BALMA JEAN FIN JUIN 1935 ». Dans l’encadrement de l’embrasure, un marquage dans le béton qui a éclaté n’est plus lisible qu’en partie « …avez Guiral Roger Classe 1938 ».



Le Bloc B2, à l’opposé de B1 à l’autre extrémité de la galerie principale, est un bloc de combat comportant une issue extérieure. On y accède de la galerie par un puits bétonné muni d’échelons métalliques. Ce bloc présente trois créneaux FM et deux autres postes de combat en flanquement à fente de tir étroite, avec système de suspension de l’arme (?) et goulotte (?). De part et d’autre de ce bloc, se situent des emplacements de combat circulaires à ciel ouvert (mortier). Ces emplacements sont limités en avant par une murette bétonnée semi circulaire et ont des soutes à munitions attenantes. L’accès à ces emplacements se fait par des tranchées bétonnées couvertes par des tôles ondulées épaisses recouvertes de béton et de terre, dont certaines sont encore en place.

Le Bloc B4 et les emplacements de combat extérieurs avec tranchées couvertes et soutes à munitions. Sur la photo du bas à gauche, au premier plan, l’observatoire B3 devant la façade du casernement de surface.





Le Bloc B3 est l’observatoire de l’ouvrage. Le puits d’accès est équipé d’une double série d’échelons. A l’extérieur, il est constitué d’un cône de béton couronné d’un très curieux cuirassement en éléments emboîtés les uns sur les autres et dont seul le dernier émerge percé de trois étroites fentes. L’observatoire ressort de quelques dizaines de centimètres du sol, quasiment accolé à la façade du petit casernement extérieur. Il s’agit vraisemblablement d’une guérite observatoire démontable type STG à 6 éléments tronconiques blindés dont il manque la calotte (cf. La Muraille de France, Ph. Truttmann, p. 481).
Le casernement extérieur consiste en trois abris (tôle métro et béton) accolés côte à côte et dont la façade de chacun (axiale) présente une cheminée maçonnée extérieure, une porte et une fenêtre. Il est complété d’un petit appentis sur le côté ouest.



Les Blocs B4 et B5 pour mitrailleuses d’action frontale.
A proximité du casernement, un peu en arrière et entre celui ci et le Bloc B1, on trouve l’ancien captage d’eau aujourd’hui à sec, un épaulement en béton et les vestiges d’installations ayant servi pour les travaux de construction.

Pour interdire à l’ennemi le vallon du torrent d’Abriés qui débouche dans la vallée de l’Ubaye à hauteur de Jausiers, la CORF projette le 12 février 1929 un gros ouvrage aux Sagnes. Il aurait dû être armé de deux mortiers de 81 et de deux mortiers de 75, battant les vallons des Granges Communes et de Pelouse. De report en ajournement, rien n’est encore entrepris à la mobilisation en 1939. La MOM construit alors rapidement un point d’appui (PA) qui restera inachevé. Ce PA sera toutefois le PC du capitaine Bureau commandant le quartier les Sagnes en juin 1940.

Le PA est établi dans une petite prairie à peu près plate, un peu au dessus du confluent du torrent du Caïre avec le lac des Sagnes. C’est aujourd’hui une propriété privée. L’ensemble des petites fortifications était centré sur une construction (cabane) qui est maintenant en partie restaurée. Les éléments encore reconnaissables sont : un abri alpin classique (béton et tôle cintrée), identique à ceux des PA de Fouillouse par exemple deux pilules briançonnaises pour FM à deux embrasures (l’une pour le tir, l’autre pour l’observation), défendant le PA en flanquement deux tourelles STG (Nos T 606 et T 607), identiques à celles du PA du Châtelet en Ubaye, commandant respectivement les débouchés des vallons de Pelouse et des Granges Communes les vestiges (excavation) d’un abri et de sa tranchée d’accès.
Si l’on en juge par les restes de barbelés épars sur le terrain, l’enceinte du PA devait être très étendue ; elle devait englober une construction (dont ne subsistent que les fondations) qui se situe à la cote 1999 soit près de 70 m au dessus de l’ensemble précédemment décrit.







En 1939 40, le vieux fortin Séré de Rivières de la cime de Pelousette est érigé, tel quel, en point d’appui. Il abrite un groupe de combat armé de FM et de mortiers de 60.
Afin d’empêcher toute infiltration entre les AP du Pra et de Saint Dalmas, et aussi dans le but de protéger le PC du col de Colombart, deux points d’appui sont construits tardivement par la MOM entre ces avant postes : l’un au Lauzarouotte, l’autre à Las Planas. Au moment de la déclaration des hostilités, ces PA ne seront pas achevés.
Le PA du Lauzarouotte est situé à l’endroit où la piste venant de Bousiéyas se divise pour se diriger, d’une part vers le col de la Colombière, et d’autre part vers celui de Colombart. A 2 120 m d’altitude, il fait face au col du Fer et au plateau où se situent les maisons forestières de Tortisse.

Il est constitué par : - un abri alpin béton et tôle métro d’une architecture différente de celle des abris de la Haute Ubaye : entrée bétonnée donnant accès à gauche à un bloc en béton de 4 m x 4 m (trou de cheminée en toiture) et à droite à un abri en tôle cintrée (13 éléments). Le temps a manqué pour remblayer et terminer l’ensemble ! deux pilules briançonnaises pour FM : celle située vers le sommet de la crête présente un créneau à redents particulièrement profond pour traverser l’arête sommitale (actuellement presque totalement comblé) ; la seconde n’est pratiquement plus enchâssée dans la crête du fait du déroctage important qui a été effectué pour construire la cabane de berger récente ; de nombreux trous individuels de combat tout le long de la crête (au moins 9 peuvent être encore distingués) dont l’un nettement plus important pourrait avoir été un poste sous rondins à deux embrasures. A proximité du PA, le sentier (GR 5 56) qui coupe les lacets de l’ancienne piste militaire allant vers le col de la Colombière traverse les vestiges d’un campement d’été que l’on reconnaît aisément aux cercles de pierres marquant l’emplacement des tentes (même disposition qu’à la Moutière).
Pour faciliter le transport des matériels et matériaux de construction, le génie avait installé un téléphérique de campagne entre Bousiéyas et le rocher du Prêtre. De larges pistes militaires devaient rejoindre les cols de la Colombière et de Colombart ; celle du col de Colombart est restée inachevée et s’interrompt un peu avant le ravin du Jas des Mélèzes.

A gauche : emplacement d’une tente marabout (cercle périphérique de pierres ; entrée





;
plate centrale embase du mât). A droite : exemple de camp d’été (au-dessous de Pelousette, juillet 1938).
Un peu en dessous du blockhaus Séré de Rivières, des travaux d’aménagement importants à une telle altitude (2 390 m) avaient commencé mais furent interrompus par le déclenchement des hostilités. On reconnaît ainsi un abri alpin classique dont seule une entrée bétonnée et les murs bahuts de béton ont été coulés ainsi que les fondations de la seconde entrée. Une petite citerne à ciel ouvert avait aussi été construite. Plusieurs emplacements individuels de combat ont été creusés de part et d’autre du sommet, dont l’un maçonné présente l’empreinte dans le béton d’une platine de fixation et un marquage devenu illisible avec le temps (seul le chiffe 3 est encore reconnaissable).



Au col de Colombart, entre le col de la Moutière, le col de Restefond et Bousiéyas, est installé le PC du quartier Rougna dans des installations spartiates et en partie inachevées. Un abri tôle métro se trouve sous la pointe de Colombart, deux autres sous le col de l’Alpe et enfin un dernier abri tôle métro sous le col de Colombart lui même, un peu en dessous de la piste venant du col de la Moutière. Cette piste était dénommée ‘‘CHEMIN DU 15e’’, comme en atteste une plaque gravée apposée sur la paroi rocheuse bordant la piste, inaugurée par le commandant Cusenier, chef de corps du 15e BCA, en septembre 1939. Sur les replats en dessous du col de l'Alpe, on peut voir encore plusieurs emplacements de tente soigneusement aplanis et dallés de lauzes.


La zone de Restefond constitue le sous secteur Jausiers dépendant du secteur Ubaye commandé par le colonel Dessaux rattaché au XIVe CA de l’armée des Alpes et plus particulièrement au SFD et à la 64e DI.
Le sous secteur Jausiers placé sous le commandement du lieutenant colonel Soyer (PC Casernement de Restefond) s’étend des crêtes d’Abriès au nord est de Jausiers au vallon de Gialorgues au sud ouest de Saint Dalmas. Il est subdivisé en 3 quartiers : - Quartier des Sagnes avec la 1re compagnie du 73e BAF tenant les vallons des Sagnes et de Pelouse (PC au point d’appui des Sagnes : capitaine Bureau).

Quartier Restefond, du Pas de la Cavale à la cime de la Bonette, l’ensemble du 73e BAF étant aux ordres du commandant Lebeau (PC au col de Restefond)
Quartier Rougna tenu par le 2e bataillon du 299e RIA de la cime de la Bonette à Saint Dalmas sous les ordres du commandant Chamussy (PC au col de Colombart).
L’articulation se fait au sud avec le XVe CA, d’une part entre la SES du II/299e RIA aux maisons forestières de Tortisse et une SES du 3e RIA qui tient les lacs de Vens, d’autre part avec des détachements mixtes (une section du II/299e RIA du XIVe CA et une du 74e BAF du XVe CA) à la Braïsse et à la Cayolle.

La Ligne Principale de Résistance s’établit de Saint Ours Roche la Croix à Rimplas en passant par les ouvrages de Restefond.
La Ligne des Avant Postes va du col de Larche à Isola en passant par le secteur les Sagnes les Fourches tenu par la 1re compagnie du 73e BAF (capitaine Barret) avec l’ouvrage d’AP des Fourches, le secteur les Fourches le Pra tenu par la 2e compagnie du 73e BAF (capitaine Vitoux) avec l’ouvrage d’AP du Pra, et enfin Saint Dalmas et son AP avec le secteur Saint Dalmas Pont Haut tenu par une section du 203e RIA (lieutenant Monnier).
Par ailleurs, outre les troupes occupant les ouvrages, avant postes et points d’appui (73e BAF et 299e RIA), le sous secteur compte deux SES chargées de la surveillance et de l’intervention au devant des lignes : SES 73e BAF du sous lieutenant Poitrey pour le secteur Restefond Salso Moreno et SES II/299e RIA du lieutenant Lonjaret pour les Fourches le Pra.
L’artillerie comprend 4 groupements d’appui direct ou d’action d’ensemble : Groupement B1 avec les 2 pièces de 95 S et P de la Batterie de Cuguret, adapté au quartier des Sagnes (lieutenant Ravet 162e RAP) Groupement B2 (capitaine Martin 162e RAP) avec 5 pièces (2 x 75/32 et 1 x 75/31 de l’ouvrage de Restefond ; 2 x 65 M au faux col de Restefond), adapté au quartier Restefond
Groupement B3 (chef d’escadron de Laffon 93e RAM) avec 16 pièces (2 x 65 M au faux col de Restefond ; 2 x 75 Mle 1897 au col de la Moutière ; 12 x 75 M à Mauvaise Côte et à la Bergerie au sud de Restefond), adapté au quartier Rougna Groupement B4 d’action d’ensemble (chef d’escadron Perroy 162e RAP) avec 8 pièces (4 x 155 L Mle 1897 au Casernement de Restefond ; 4 x 155 C au col de Restefond).



De nombreux observatoires spécifiques pour l’artillerie ont été aménagés et équipés, auxquels s’ajoutent ceux de l’infanterie qui ont reçu des schémas de désignation d’objectifs préétablis très précis et complets.
Les liaisons ont été particulièrement soignées avec, pour le secteur Ubaye, un réseau téléphonique enterré de 162 km reliant 98 appareils en plus des moyens propres des ouvrages et pas moins de 18 appareils radio (toutefois le chiffrage des messages radio créera quelques problèmes). Le tout était complété en cas de nécessité (et si la météo le permettait !) par la signalisation optique (fusées et lampes).
Travaux à Pelousette. Creusement d’une tranchée et pose d’un câble téléphonique. Un kilomètre en quatre jours. 23 26 juillet 1938.




Face au secteur Ubaye, la concentration des troupes italiennes est particulièrement dense. Le IIe CA (général Bettini) aligne 5 divisions et un groupement alpin avec en réserve une division et un groupement motorisé, le tout soutenu par 302 pièces d’artillerie, face à 4 bataillons, 7 SES et 100 canons du coté français. L’Ubaye Restefond voit ainsi en face d’elle la plus forte concentration de troupes italiennes de l’ensemble du front des Alpes. Le rapport de force pour l’infanterie est de 9 contre 1 : 37 bataillons italiens contre 4 français.
Le plan de l’opération ‘‘M’’ (‘‘M’’ comme Maddalena, nom italien du col de Larche) prévoit d’occuper d’abord la tête de l’Ubaye et la vallée de Maurin (attaque de l’aile droite au jour J, le 22 juin), puis de pousser ensuite au centre sur Larche et Meyronnes (jour J + 1) en agissant aussi, en aile gauche, au sud par le massif du Restefond, sur Jausiers pour atteindre Tournoux et la Condamine.
Le plan d’attaque du général Bettini est le suivant : occuper à l’aile droite dans un premier temps (Jour J : 22 juin) la Haute Ubaye et la « conque » de Maurin pousser ensuite (Jour J + 1 : 23 juin) d’une part au centre sur Larche et Meyronnes en débordant les défenses de Viraysse et de Tête Dure, d’autre part agir à l’aile gauche en direction de Jausiers (du vallon du Lauzanier au col du Fer) pour faciliter la poursuite de l’attaque au centre sur Tournoux et la Condamine, puis continuer ensuite sur Barcelonnette.
Cette manœuvre est très classique : poussée par le centre et enveloppement par les ailes. Mais, il faut dans un premier temps, du 17 au 21 juin, mettre en place le dispositif pour passer à l’offensive, c’est à dire porter vers l’avant l’artillerie, les services (dépôts et transmissions en particulier) et les grandes unités. Cette mise en place se fait lentement et avec beaucoup de difficultés dans des zones en contre pente, pratiquement dépourvues de véritables voies de communication et encore recouvertes de neige.
La zone de Restefond est donc directement visée par la branche sud de cette opération en tenaille. C’est certainement une des zones les plus difficiles pour mener des actions offensives, compte tenu de l’altitude et des conditions climatiques de ce mois de juin 1940. Elle va cependant subir l’attaque du 17e RI de la 33e division « Acqui » (général Sartoris) par le Pas de l’Enclausette et le col du Quartier d’Août sur les Sagnes, attaque appuyée par une partie du 7e Alpini de la 5e DIA « Pusteria » (général Amedeo de Cia) par le Pas de l’Enchastraye ; le reste de ce 7e Alpini a pour objectif direct le Restefond par les cols de Pouriac et du Pas de la Cavale. Au sud, le 11e Alpini de la même division doit passer par le Pas de Gorgeon Long, le col du Fer et le Pas du Vallonnet. Comme partout dans les Alpes, l’offensive italienne vise la ‘‘submersion’’ de l’adversaire en tentant de passer même par les passages et les cols les plus difficilement praticables. Avec un rapport de forces de 4 contre 1 pour la zone de Restefond, l’opération aurait pu se révéler efficace si ce n’avait été les conditions météorologiques épouvantables et surtout l’erreur tactique invraisemblable du haut commandement italien s’entêtant à attaquer par les thalwegs et non par les hauts.
Dans le secteur Haute Tinée Restefond, un soutien d’artillerie rapproché fera par ailleurs défaut aux assaillants italiens (le 5e RAM de la division « Pusteria » aura toutes les difficultés à amener ses pièces en position), alors même que les bombardements d’artillerie à longue portée se révéleront relativement inefficaces. Par contre, les tirs de l’artillerie française se montreront particulièrement meurtriers, à courte comme à longue portée.
On peut distinguer trois périodes successives pour les opérations qui se sont déroulées de la déclaration de guerre italienne le 10 juin 1940 à l’armistice le 25 juin: du 10 juin au 16 juin : attente et observation du 17 au 21 juin : escarmouches et duels d’artillerie du 22 au 25 juin : attaques poussées et vives jusqu’à l’heure de l’armistice (0 h 35) avec un véritable feu d’artifice final par l’artillerie française durant les dernières heures.
Il faut tout d’abord rappeler qu’en ce printemps 1940 l’enneigement en altitude est encore très important. Ainsi, la route du col de Restefond, coté Jausiers, n’a pu être déneigée le 1er juin que jusqu’à l’ouvrage de Restefond ; les crêtes et les PO des Granges Communes et du col de la Moutière sont recouverts de plusieurs mètres de neige. Dans ces conditions, dans la nuit du 10 au 11 juin, les 12 pièces de 75 M du 1er groupe du 93e RAM s’installent avec beaucoup de difficultés en arrière du col de la Moutière (Mauvaise Côte et Bergerie de Restefond).
Ce 10 juin, les habitants de la Haute Tinée doivent évacuer leurs villages et hameaux. Ils formulent alors le vœu d’élever une statue à la vierge si les villages sont préservés de la destruction (vœu qui sera honoré avec l’édification de l’oratoire de Notre Dame du Très Haut à la Bonette en 1963). Dans des conditions particulièrement pénibles et difficiles, ils gagnent à pied la vallée du Var, car les militaires ont coupé la route en amont de Saint Sauveur. Puis, par camions, ils sont conduits à Saint André des Alpes dans la vallée du Verdon où ils resteront un peu plus d’un mois.
Dans le secteur de Restefond, la période d’attente qui suit ne sera marquée que par un accrochage, le 16 juin, au col du Fer, où la SES II/299e RIA du lieutenant Lonjaret, violemment prise à partie, doit se replier vers le Pra.
Le 17 juin, à 15 h 10, les premiers obus sont tirés par la tourelle de Roche la Croix. A 18 h 30, un rassemblement ennemi d’environ un bataillon est repéré vers le col du Fer et commence à pénétrer en territoire français. Aussitôt, le groupe B2 fait donner les 75/32 de Restefond vers les maisons forestières de Tortisse et les lacs de Vens. L’ennemi se disperse et se retire pendant la nuit.
Le secteur reste calme ensuite jusqu’au 21 juin. Ce jour là, à 8 h 45, le lieutenant Costa du 162e RAP à l’observatoire des Fourches repère deux compagnies italiennes qui, étant passées par le col de Pouriac et à l’ouest de Pel Brun cheminent vers le Lauzanier par le Pas de la Cavale. Elles sont ralenties et contenues par des éléments de la SES 73e BAF. Les 75 de Restefond interviennent immédiatement avec des tirs de barrage (182 coups) sur une ligne Pas de la Cavale lac d’Agnel sommet de Combe Alta. Ils sont accompagnés par des tirs de harcèlement de la batterie K 37 (40 coups de 155 C) et ceux des 2 x 65 M de la batterie K 33 du lieutenant Testut (12 coups). Les Italiens arrivent toutefois à se maintenir au niveau du Pas de la Cavale
L’opération ‘‘M’’ est déclenchée mais ne concerne ce premier jour que la branche nord de la tenaille sur Maurin (Haute Ubaye) et le centre de l’attaque sur Larche. Au Restefond, pour cette journée, on ne note que l’intervention de la batterie K 36 qui tire 20 coups de ses 155 L en direction du col de Larche.
C’est le 23 juin, tôt le matin (3 h 30), que l’attaque de la branche sud est déclenchée sur le Restefond. Dès 2 h 15, les Fourches subissent des tirs d’artillerie assez mal réglés qui sont aussitôt contrebattus ; des tirs d’interdiction sont aussi effectués sur les débouchés des cols de Pouriac et du Fer. Cependant, le brouillard très épais est mis à profit par les Italiens pour s’infiltrer, par le col de Pouriac et le Pas de Gorgeon Long, dans le Salso Moreno vers les Fourches et, par le Pas de la Cavale, dans le vallon du Lauzanier vers les Sagnes. A 6 h 30, la SES 73e BAF du sous lieutenant Poitrey est au contact et ouvre le feu. Le barrage de l’artillerie italienne s’allonge mais ne cesse qu’à 8 h 15, après 6 heures de bombardement. Toutefois de nombreux obus italiens (un tiers selon certaines sources) n’éclatent pas. Sabotage, mauvaise qualité des munitions ou incompétence des artilleurs, on ne le saura jamais.
A ce moment là, une brève déchirure dans le brouillard permet au Bloc B2 de l’AP des Fourches d’ouvrir le feu brièvement sur quelques Italiens infiltrés dans le ravin du torrent de Pouriac avant que le brouillard ne se referme. A 9 h, une éclaircie subite montre alors que l’ennemi s’est largement infiltré dans le Salso Moreno jusqu’au bas des pentes du col des Fourches et qu’une forte colonne progresse vers le Pas de la Cavale. Tous les blocs de l’AP se mettent à tirer. L’ennemi est aussi pris de flanc par les FM de la SES Poitrey depuis les pentes des Roubines Nègres et ceux d’une section de la compagnie Vitoux depuis les rochers du Castel de la Tour. De plus, le soldat Jean Brun, resté caché dans une cabane du vallon de Salso Moreno sur ordre du lieutenant Delécraz, mitraille l’ennemi à revers. L’artillerie de Restefond intervient également (155 L et 65 M). Les Italiens refluent et se terrent dans les ravines. La SES 73e BAF reçoit l’ordre de décrocher et passe en réserve aux Fourches. Vers 11 h 30, le bombardement italien reprend pour protéger le repli ; finalement, à 13 h 30, le feu cesse sur le secteur des Fourches. En milieu d’après midi, vers 16 h, des blessés italiens repérés près des granges de Salso Moreno sont secourus par le médecin lieutenant Duverne et les hommes du lieutenant Delécraz ramènent du vallon 16 prisonniers (dont deux blessés) et un sous lieutenant avec le fanion de la 141e compagnie du bataillon « Bolzano » (11e Alpini) qui avait pour mission de prendre d’assaut le « Fort des Fourches ».
Les Sagnes
Vers 17 h, deux compagnies environ du bataillon « Feltre » sont aperçues se dirigeant vers le PA des Sagnes par la Bosse du Lauzanier et le vallon de Pelouse, après être passées par le Pas de la Petite Cavale à la faveur du brouillard et de la neige. Immédiatement fixées par deux groupes de combat de la 2e compagnie du 73e BAF et les mortiers du PA de la cime de Pelousette, elles sont harcelées par l’artillerie de Restefond dont un coup de mortier 75/31 pulvérise la bergerie du vallon de Pelouse où s’étaient réfugiés quelques alpini. A la nuit, les Italiens sont arrêtés dans leur élan alors que la pluie et la neige redoublent en tourmente.
24 25 juin (0 h 35)
Le 24 juin, à 4 h du matin, les 7e et 11e Alpini reprennent leur action avec mission de foncer sur Jausiers sans aucune autre préoccupation. Mais la météo est exécrable (pluie, neige, brouillard et froid) et rend la progression très difficile et épuisante.
Le 7e Alpini renforcé d’éléments de la milice confinaire (GaF) avance sur les Sagnes. Dans la matinée, une colonne du bataillon « Belluno » venant du Lauzanier par le col du Quartier d’Août est engagée par les mitrailleuses du PA des Sagnes, puis stoppée par l’artillerie. A partir de 9 h 30, toute observation devient impossible.







L’artillerie continue malgré tout ses tirs de harcèlement, si bien qu’à la nuit les assaillants ont regagné la crête et s’abritent tant bien que mal derrière celle ci.
Entre temps, les premiers éléments du 11e Alpini (deux compagnies du bataillon « Trento »), passent très difficilement le col de la Vigne (désignation italienne de l’Encrène, col à 2 760 m, entre la Tête de l’Enchastraye et le rocher des Trois Evêques) ; par des pentes fort raides, enneigées et verglacées, avec crampons et piolets, en y taillant des marches, ils ne font leur jonction avec le 7e au lac du Lauzanier que fort tard dans la journée.
Après l’échec italien, cuisant, de la veille, le secteur est relativement calme. Seuls quelques tirs de l’artillerie italienne harcèlent l’avant poste, auxquels les canons de Restefond répondent.
Après avoir tiré un véritable bouquet final à partir de 20 h 30, car les artilleurs ont tenu à vider avec entrain leurs caissons, le canon se tait sur les Alpes à 0 h 35.
Le sous secteur Jausiers n’a subi aucune perte et aucun ouvrage n’a cédé.
Le 30 juin, les troupes françaises sont regroupées dans la vallée de l’Ubaye et la plupart des unités sont dissoutes le 1er août. Les ouvrages se retrouvent en zone démilitarisée et sont désarmés.
Les habitants de la vallée de la Haute Tinée regagnent leurs villages courant juillet
Les Italiens, qui n’ont pu faire aucun gain de terrain appréciable dans le secteur de Restefond, n’occuperont aucun village ni hameau. Ce secteur se situe toutefois dans la zone démilitarisée. Les ouvrages sont donc évacués après que les pièces essentielles des moteurs et des armes ont été démontées et cachées.
L’ancien commandant du quartier des Sagnes, le capitaine Bureau, reprend les armes en 1942 comme chef militaire (ORA) de la Résistance en Ubaye. Il a d’ailleurs caché depuis deux ans du matériel et des armes et réuni autour de lui des anciens cadres des unités de la vallée de l’Ubaye.
Après la fusion des mouvements MUR et ORA, René Chabre est désigné comme chef de la Résistance en Ubaye et le commandant Bureau devient son chef d’état major. Le recrutement progresse rapidement et l’instruction des volontaires et maquisards est confiée au capitaine Delanef (ancien chef de la SES 15e BCA en 1940) secondé par le lieutenant Busy Debat (alias Devaux). Des expéditions sont organisées pour récupérer armes et munitions. Ainsi en octobre 1943, une trentaine de volontaires menés par Delanef rapportent des fortifications italiennes de la région du col de Panieris (2 683 m) quarante armes individuelles et une quantité importante de munitions et d’explosifs. Une autre expédition sous la direction du commandant Bureau ramène du col de Sautron trois mitrailleuses et 5 000 cartouches qui sont cachées dans les rochers de Viraysse. On récupère aussi au col de Colombart des caisses de munitions, notamment de grenades VB, qui y avaient été cachées à l’armistice.
En janvier 1944, Delanef est arrêté à Gap par la Milice. Il réussira cependant à s’évader en juillet 1944 après avoir été remis à la police française par les autorités allemandes.
Entre le 6 juin (jour du débarquement en Normandie) et le 13 juin 1944, la Résistance tente de libérer seule la vallée de l’Ubaye et de l’instaurer en zone franche capable de se défendre en toute autonomie dans l’attente du second débarquement en Méditerranée. De fait, devant la vigoureuse réaction allemande, l’inquiétude du commandement FFI ne cesse de grandir. Le lundi 12 juin, à 21 h, devant la mauvaise tournure des combats, un projet de repli sur l’Italie est proposé. Le lendemain, mardi 13 juin, le commandant Bureau donne à 17 h l’ordre de décrochage pour la tombée de la nuit. Ce dernier avec les hommes de son PC passe par le col de Fours pour rejoindre Bayasse puis il gagne la région de Ferrières en Italie où ils arrivent le 15 juin à 14 h en étant passé par la Moutière, le col de Colombart, le Pra, les maisons forestières de Tortisse, le col du Fer et le vallon de Forneris. Il tente ensuite une reconnaissance vers Pietraporzio dans la Valle Stura, mais les Allemands de Larche qui ont passé le col contrôlent Argentera, Bersezio et l’amont de la Valle Stura. En outre, l’accueil des maquisards italiens est peu enthousiaste et le podestat demande même que les FFI retournent en France ! Le samedi 18 juin, après avoir erré près de quarante huit heures entre Bersezio et le col du Fer, le commandant Bureau et ses compagnons regagnent Bayasse. Il établit son nouveau PC à la bergerie des Sanguinières. L’ensemble des Résistants, environ 250 hommes, se dispersent donc dans la montagne et vont vivre dans les chalets d’altitude et les bergeries d’alpage. Le 22 juin, une réunion des principaux responsables au PC des Sanguinières décide de maintenir la dispersion, de modifier le stationnement des groupes, de reconstituer les stocks et de préparer de nouveaux plans d’action. A partir du 29 juillet, le PC des FFI de l’Ubaye est transféré à Enchastrayes. Le début du mois d’août est alors consacré à la réorganisation avec la création du bataillon FFI de l’Ubaye (FFIU) composé de cinq compagnies, chacune de 50 à 60 hommes, et réparties en quatre compagnies de voltigeurs et une compagnie de mitrailleurs.
Au moment du débarquement de Provence, une première tentative de dégagement du col de Larche par la Résistance semble d’abord réussir entre le 15 et 20 août avec la reddition des 63 Polonais de la garnison de Larche ; cependant la contre attaque allemande par le KampfGruppe von Behr est violente. Les Résistants doivent se replier, le long de la RN 100, depuis Larche jusqu’à la Condamine. Les compagnies FFIU, qui viennent de durement combattre pendant deux jours, sont ensuite regroupées à Barcelonnette, puis dirigées dans la nuit sur Seyne les Alpes. Seule la 2e compagnie reste à monter la garde sur la position de Tournoux.
Le 25 août, à 10 h, la 2e compagnie rejoint Barcelonnette ; seuls quelques éléments restent en surveillance à Tournoux et au Châtelard. Le commandant Bureau et le capitaine Delanef installent leur PC à Barcelonnette. Les Allemands ne franchissent pas la coupure de la Rochaille sur la RN 100 et ne poursuivent pas leur attaque. En fin de journée cependant une patrouille allemande, apparemment égarée, est repérée alors qu’elle descend vers Jausiers par les Sagnes ; aussitôt accrochée par un groupe de FFI de l’Ubaye, elle est refoulée. Le groupement FFI de Saint Auban relève alors les FFIU et installe des barrages tout autour de Jausiers.
Ce 25 août, à 21 h, deux autos mitrailleuses et deux jeeps américaines arrivent à Barcelonnette, puis patrouillent entre la Condamine et Jausiers. Il s’agit de la 2e section de la compagnie A du 117th Cavalry Reconnaissance Squadron du capitaine Piddington.
Le 26 août, tôt le matin, se tient une réunion à la sous préfecture pour faire le point sur la situation. Les Allemands apparemment n’ont pas l’intention de poursuivre plus avant dans la vallée de l’Ubaye. Le nouveau plan consiste donc à contrôler et garder le front de Tournoux à Saint Etienne de Tinée, le capitaine Bureau, commandant du secteur, estimant que, pour éviter toute surprise, la défense de l’Ubaye doit comporter aussi celle du massif du Restefond. Ce plan sera d’ailleurs approuvé, quinze jours plus tard, par le commandement américain qui se mettra en place dans la région.
Le dispositif des FFI de l’Ubaye qui se met en place est alors le suivant : 1re compagnie : Cuguret Lans les Gréoux les Sagnes ; interdiction du vallon des Sagnes
2e compagnie : de Bayasse jusqu’à Saint Dalmas le Selvage par la Moutière ; interdiction du vallon de Sestrière 3e compagnie : Bayasse avec surveillance de la frontière ; interdiction de la Haute Tinée
4e compagnie : les Fourches Las Planas ; interdiction des cols de Pouriac, du Fer et du Pas de La Cavale 5e compagnie : Cantonnement d’alerte à la Maure les Molanès près de Barcelonnette
6e compagnie : le Lauzet ; assurer la défense de la coupure du Pas de la Tour.
Les autos mitrailleuses et jeeps américaines poussent des patrouilles jusqu’aux Gleizolles. Leur présence suffit à tenir en respect les Allemands qui, de toute évidence, ont pour seule mission d’éviter toute tentative de pénétration en Italie par le col de Larche. Dans la nuit, la Condamine est bombardée par l’artillerie allemande et l’est à nouveau le lendemain 27 août.
Le 28 août, à 8 h, la Condamine est complètement évacuée. Les Allemands continuent à occuper systématiquement le terrain et poussent des reconnaissances tous azimuts, en particulier vers le Restefond et la Haute Tinée (Pas des Terres Rouges, col du Quartier d’Août, col de Pouriac, col du Fer). Leur ligne passe par Serre la Plate la Rochaille Roche la Croix crête d’Abriès. Quelques habitants de Maison Méane qui ont fui les combats le 23 août en se réfugiant dans la montagne réussissent à gagner Jausiers en descendant par les pentes escarpées et vertigineuses de la Côte d’Abriès. Ils donnent de précieux renseignements sur les positions ennemies. Dans la soirée, les deux autos mitrailleuses et les deux jeeps américaines rejoignent leur unité. Durant la nuit, après un violent bombardement d’artillerie, les Allemands viennent à la Condamine où ils incendient une partie du village et posent des mines un peu partout.
Sur le plan de l’organisation des forces combattantes de l’intérieur, ce 28 août, le colonel Lanusse est désigné par le général de division aérienne Cochet (délégué militaire pour le théâtre d’opérations Sud) comme Commandant du groupe de subdivisions des Alpes Maritimes et des Basses Alpes. Il est chargé du commandement FFI de ces deux subdivisions, constituant le groupement alpin Sud. Il a pour mission d’assurer, en liaison avec les troupes américaines de la 1st Air Borne Task Force (ABTF), « la couverture du flanc droit des armées alliées sur les Alpes ». Il doit profiter de toutes circonstances favorables pour progresser vers les cols et si possible s’en emparer puis s’y maintenir. Toutefois, il doit « éviter de courir des risques excessifs et en aucun cas lancer ses troupes à l’attaque de défenses solidement organisées » (lettre n° 192 DMO/CHEM du 28/08/1944 signée du Gal Cochet). Il s’agit en fait avant tout de procéder à la constitution d’unités cohérentes, formées, disciplinées et équipées. Dès le 3 septembre le commandant Lécuyer décide de former 7 bataillons organisés selon les
traditions des anciens bataillons alpins d’avant 1940. Les Américains intégreront ces nouvelles unités dans le front de défense à partir du 16 octobre.
Le 29 août, le secteur reste relativement calme. Seules de sourdes explosions sont entendues dans la matinée vers Tournoux : les Allemands ont fait sauter les ponts, celui sur l’Ubaye aux Baraquements et ceux sur l’Ubayette et sur l’Ubaye de part et d’autre des Gleizolles. Dans l’après midi, venant du sud, le 550th Team de la 1st ABTF arrive à Barcelonnette. A minuit, les Allemands reviennent à nouveau à la Condamine et mettent le feu au village dont toute la partie située sur la rive gauche du torrent du Parpaillon flambe.
Le 30 août, l’ennemi se montre mordant dans le secteur de la Condamine où il y a plusieurs accrochages.
Le 31 août, les Américains relèvent progressivement les FFI dans la vallée de l’Ubaye. Commencée à 11 h au Châtelard et au Villard, la relève est terminée vers 16 h à Jausiers. Le colonel Sachs, commandant américain du secteur, demande pour son PC un officier de liaison FFI. Le secteur Ubaye est alors complètement passé sous commandement américain.

Le 1er septembre, opérations de nettoyage dans le vallon des Sagnes.
Le 2 septembre, le colonel ‘‘Noël’’, Responsable départemental FFI, donne au commandant Bureau une nouvelle mission : « Le commandant Bureau, Chef du Secteur Ubaye, est chargé de mission auprès de l’EM américain du Secteur (Colonel Sachs). Cette mission consistera à coordonner les opérations des troupes américaines et celles des unités FFI. Le commandant Bureau restera de façon permanente auprès de l’EM américain jusqu’au départ de celui ci pour un autre secteur d’opération. Il prendra toutes dispositions utiles pour se faire suppléer provisoirement dans son commandement de secteur. Signé : Noël. » Le commandant Bureau nomme en conséquence le capitaine Delanef « commandant des troupes FFI du secteur Ubaye ». C’est donc ce dernier qui règle dans les jours qui suivent les mouvements de relève dans le secteur.
Du 3 au 5 septembre, ces divers mouvements de relève ont lieu et plusieurs accrochages se déroulent dans la zone les Sagnes Restefond Haute Tinée.
En Haute Tinée, les incursions des chasseurs allemands du 4e bataillon de haute montagne sont fréquentes (Isola le 2 septembre, le Bourguet le 9, …).
Les rapports du Docteur Jouglard, commandant les FFI de Saint Etienne de Tinée, envoyés à ceux d’Ubaye sont alarmants. Il ne peut compter que sur une cinquantaine d’hommes mal armés et son adjoint (Ventrebert) a dû se réfugier aux Fourches avec une dizaine de ses hommes après une embuscade, le 2 septembre, au pont Haut où il a eu deux tués (Vial et Hemery ; stèle au pont Haut). Les FFI d’Ubaye décident d’envoyer une compagnie à Saint Dalmas et de l’y maintenir ; ils font parvenir aussi au Docteur Jouglard 30 fusils et 2 mortiers. A Isola, qui a été occupée par les Italiens en 1940, les rapports sont très tendus avec les Partigiani qui s’y trouvent maintenant. Des mesures d’éloignement de ces derniers devront finalement être prises.
Le 5 septembre, les Américains prenant conscience de l’importance du massif du Restefond envoient un mortier et une mitrailleuse lourde aux Fourches et, à Pelousette, ils renforcent également la 4e compagnie FFIU d’un de leur propre détachement avec une mitrailleuse lourde. Cette 4e compagnie surprend ce jour là une patrouille allemande dans le Salso Moreno et fait deux prisonniers.
Au 6 septembre, la nouvelle implantation des unités, avec le Restefond comme centre de gravité du dispositif, est alors la suivante : Etat major : PC avancé à Restefond ; PC arrière à Barcelonnette
1re compagnie FFIU (Derbez) ; 59 hommes ; les Sanières
2e compagnie (Devaux) ; 53 hommes ; Bousiéyas
3e compagnie (Sarrès) ; 52 hommes ; Restefond
4e compagnie (Rapillard) ; 52 hommes ; les Fourches - 5e compagnie (Woerhlé) ; 60 hommes ; Las Planas - Rocher du Prêtre
6e compagnie (Isaia) ; 58 hommes ; le Sauze
7e compagnie (Rossi) ; 55 hommes ; Enchastrayes
19e compagnie FTP ; 90 hommes ; Lans les Sagnes Compagnie Saint Auban (Haxotte) ; 112 hommes ; Gueyniers Cuguret. Détachement de 30 hommes du Maquis de Sainte Tulle Corbières (Manosque) à Bayasse la Moutière.
«
Une opération pour la reprise du col de Larche toujours tenu par les Allemands est planifiée par la 1re DFL pour le 7 septembre. Le colonel Molle, commandant l’infanterie de la 2e DIM, qui a prévu une action frontale sur Meyronnes avec une tenaille dont la branche nord partira de Saint Paul sur Ubaye, demande « aux Américains de Jausiers de se porter sur Larche par le col du Quartier d’Août de façon à compléter l’encerclement des Allemands » (branche sud de la tenaille). Le colonel américain Sachs, commandant du secteur, confie au capitaine Bureau la rédaction des ordres à la fois pour les FFI et les Américains. L’action est finalement retardée de quarante huit heures en raison du mauvais temps. Le 9 septembre, les opérations sud débutent par une reconnaissance sur les postes allemands des Pas de Terre Rouge et de la Petite Cavale. Le lieutenant Derbez (1re compagnie) accroche une patrouille au Pas de Terre Rouge et fait un prisonnier. Le lieutenant Sarrès (3e compagnie) attaque par surprise le Pas de la Petite Cavale : les Allemands ont 3 tués et 7 prisonniers sont faits. Le lendemain, 10 septembre, la 3e compagnie au prix d’un tué (Pierre JEAN) les en déloge complètement (12 tués et 3 prisonniers). La compagnie Saint Auban atteint le Siguret tandis que la 1re compagnie du lieutenant Derbez progresse sur la crête d’Abriés où deux Allemands sont tués et deux faits prisonniers. Les paras américains attaquent, quant à eux, sans grand mordant, le col du Quartier d’Août dont ils ne parviennent pas à s’emparer. Finalement, l’opération sur Larche s’avère un échec complet, principalement par manque de simultanéité des actions des branches nord et sud de la tenaille mais aussi par la défaillance de certaines unités.
Le 11 septembre est occupé par diverses relèves après ces combats ; les 12 et 13, la routine : patrouilles et tirs d’artillerie !

Dans la nuit du 14 au 15 septembre, vers 22 h 15, un guetteur au Bloc de Ventabren (ou Bloc Nord) signale des lueurs suspectes dans les Roubines Nègres. Un tir de mortier de 60 dans leur direction déclenche immédiatement une riposte allemande d’armes automatiques et de mortiers. Un deuxième groupe d’assaillants se dévoile à moins de 300 m et couvre un troisième groupe qui tente de s’infiltrer sous la Pelousette et de prendre le bloc à revers. De 23 h à 0 h 15, l’artillerie allemande pilonne le camp et les blocs de l’ouvrage. A 0 h 20, l’ennemi donne l’assaut sur le Bloc Nord et le Bloc B6 : les combats vont durer 4 heures. L’artillerie américaine puis une sortie des défenseurs de B6 avec leurs FM repoussent les Allemands vers le Salso Moreno. Ces derniers font une dernière tentative sans plus de succès de 5 h 20 à 6 h et finalement se retirent. Les patrouilles FFIU envoyées reconnaître le terrain après l’accrochage le trouvent vide, bien qu’il soit indubitable que les assaillants ont eu des pertes. A trois reprises, durant cette nuit, le Bloc Nord a failli être pris, ce qui aurait rendu la position des Fourches difficilement tenable.
La nuit suivante (15 au 16 septembre) à 21 h, deux groupes ennemis d’une dizaine d’hommes chacun, appuyés par une mitrailleuse lourde, essaient de nouveau de prendre par surprise le Bloc Nord. Ils sont repoussés par des tirs de mortier de 60 et l’intervention des canons américains de 105. Le capitaine Delanef envoie alors en renfort un groupe de mitrailleuses légères s’installer au Castel de la Tour afin de couvrir l’intervalle entre le Bloc Nord et le Camp.
Au petit matin du 16 septembre, à 4 h 30, une patrouille allemande est à nouveau accrochée près de B6 mais doit se replier devant un feu nourri d’armes automatiques.
L’insistance des Allemands laisse présager une attaque de plus grande envergure et montre, s’il le fallait encore, le caractère extrêmement sensible de ce secteur du Restefond.
Le commandement américain reprend alors à son compte l’ensemble du secteur. Deux lignes de défense sont ainsi définies : une première : Siguret Crête d’Abriès Pelousette les Fourches Bousiéyas Rocher du Prêtre Las Planas (c’est, grosso modo, la Ligne des Avant Postes de 1940 !) une seconde : Grand Bois les Sagnes Granges Communes Restefond la Moutière (c’est quasiment la Ligne Principale de Résistance de 1940 !).
Dans ces lignes de défense, les FFIU ne garderont que : dans la première ligne, le sous secteur Jausiers les Sagnes et la partie supérieure du sous secteur Bousiéyas Las Planas dans la seconde, un poste d’observation au Mourre Haut, deux compagnies à Restefond (une équipe d’ouvrage et une de réserve) et le sous secteur Bousiéyas Las Planas qui cependant sera placé sous le commandement du capitaine américain du Camp des Fourches. En fait les ouvrages de Restefond ne serviront que d’abris en l’absence de toute munition d’artillerie.
L’implantation des unités dans cette nouvelle organisation est la suivante : Sous secteur de Jausiers :
1re compagnie FFIU (Derbez) ; 59 hommes ; Sanières Cuguret
19e compagnie FTP ; 90 hommes ; les Sagnes Compagnie Saint Auban ; 112 hommes ; Gueyniers Cuguret Sous secteur de Restefond
2e compagnie FFIU (Devaux) ; 53 hommes ; Restefond (équipage)
3e compagnie (Sarrès) ; 52 hommes ; Bousiéyas Las Planas
4e compagnie (Rapillard) ; 53 hommes ; Restefond (réserve)
5e compagnie (Woerhlé) ; 60 hommes ; Las Planas Rocher du Prêtre
7e compagnie (Rossi) ; 55 hommes ; Bousiéyas Maquis de Manosque (Sainte Tulle Corbières) ; 30 hommes ; Bayasse - la Moutière (ce sont eux qui graveront la pierre devant l’ouvrage du col de la Moutière).
Durant cette période, quelques accrochages sont à signaler. Le 20, une patrouille du secteur Bousiéyas (3e compagnie FFIU) fait un prisonnier dans la région du Pra. Le 21, la section Kneip de la 1re compagnie (Derbez) est accrochée à la Tête de Cuguret et doit déplorer 4 blessés dont deux graves. Le même jour, une patrouille allemande attaque par surprise le point d’appui des Sagnes mal gardé par la 19e compagnie FTP : elle fait trois blessés et s’empare d’une mitrailleuse Maxim. A partir du 24 septembre, la relève commence et les résistants sont progressivement remplacés par des tirailleurs sénégalais et par les 1er et 3e bataillons du régiment bas alpin. Le harcèlement des troupes allemandes continue : le 28, l’aspirant Charles Rapiné du 1er bataillon bas alpin est mortellement blessé dans le secteur des Sagnes (panneau commémoratif à côté du cimetière du hameau en ruines de l’Ubac sur le chemin des Sagnes). Dans le cadre de la réorganisation des forces combattantes, les FFIU sont dissous et démobilisés à la date du 15 octobre.
En Tinée, à la demande du commandant de l’ABTF, le Commandant de groupe de subdivisions des Alpes Maritimes et des Basses Alpes (colonel Lanusse) renforce l’effectif des unités FFI en ligne (ordres d’opérations n°s 1 et 1 bis des 16 et 22 octobre ainsi que l’ordre particulier du 16/10/1944). Ainsi le groupe de bataillons n° 1 a son PC à Saint Etienne de Tinée (commandant de L’Estang) et le bataillon Esterel 9 est en ligne de Bousiéyas à Auron et le Bourguet.
Avec l’arrivée de la mauvaise saison, les positions d’altitude sont peu à peu évacuées. Les Américains quittent le Camp des Fourches dans la nuit du 8 au 9 octobre après une forte chute de neige en y abandonnant du matériel (2 mortiers de 120, 2 de 81, 2 de 60, 2 mitrailleuses lourdes, 4 mitrailleuses légères, 450 coups de mortiers et 2 jeeps). Le 23 octobre, une patrouille du bataillon Esterel tombe dans une embuscade allemande au Pra. Sur l’effectif total de la patrouille (un officier, 2 sous officiers et 8 hommes), seul un homme blessé parvient à rejoindre Saint Etienne de Tinée. Dès le lendemain, Bousiéyas est évacué. Vers le 15 novembre, l’enneigement devenant important, l’ennemi quitte les postes qu’il occupait sur les crêtes. L’activité du front devient alors quasiment nulle en Haute Tinée.
Du 16 au 21 novembre, le 1er ABTF est relevé par la 44e brigade anti aérienne américaine. Le dispositif FFI en Haute Tinée est remanié entre le 1er et le 10 décembre. Le groupe de bataillons n° 2 (capitaine de vaisseau Guien) remplace le n° 1 ; le bataillon Esterel 12 occupe le front de Saint Dalmas le Selvage au Bourguet. Une nouvelle réorganisation a lieu, non sans quelques difficultés, entre fin décembre 1944 et fin janvier 1945. Il s’agit de regrouper les bataillons existants et de les fondre de façon à former trois bataillons dont l’effectif se rapprochera de celui fixé par le tableau des effectifs du bataillon de marche. Des SES sont également constituées. Ainsi, en janvier, c’est le bataillon 24/XV qui est positionné en Haute Tinée ; puis le bataillon 20/XV, du Camp des Fourches au Bourguet à la mi février, les SES prenant position à Saint Dalmas au début de mars.


L’hiver va s’écouler au rythme des patrouilles (comme celle du lieutenant Ignesti de la 2e section de la 1re compagnie du bataillon de marche 14/XV, le 16 janvier 1945, aux abris alpins de la Moutière, comme en témoigne le graffiti qui y est encore visible) et de quelques duels sporadiques d’artillerie.
En Haute Tinée, durant cet hiver, les conditions de vie pour les rares habitants de Saint Etienne, de Saint Dalmas et des hameaux environnants, restés sur place, seront particulièrement difficiles, car la ligne électrique a été coupée par des éclats d’obus en aval d’Isola et l’unique route de la vallée est souvent bombardée.
En avril 1945, la zone de Restefond est très indirectement concernée par l’opération ‘‘Laure’’ pour le dégagement du col de Larche. En effet, dans la nuit du 21 au 22 avril, le lieutenant Delécraz (ancien commandant de l’AP des Fourches en 1940) à la tête d’un groupe de SES (SES 24e BCA du lieutenant Rolachon, SES 3/XV de l’aspirant Waintrop, SES 1/XV de l’adjudant chef Michelon) passe par les Sagnes pour gagner, par le col du Quartier d’Août peu enneigé, le ravin du Pis ; il constitue la branche sud de l’attaque en tenaille sur le village de Larche qui réussira pleinement.
La victoire, le 8 mai, interviendra sans que le Restefond soit concerné par de nouvelles actions puisque les combats se sont rapidement déplacés vers l’Italie avec notamment l’extraordinaire exploit du génie de la DFL et de la 13e DBLE pour ouvrir la piste du col de la Lombarde entre Isola et Vinadio. Mais, ceci est une autre histoire…
S’il fallait une conclusion à cette évocation des hommes et des fortifications dans le conflit 1939-1945 en Haute Ubaye, Ubayette, et Restefond - Haute Tinée, il n’en serait qu’une seule…
Extrait de « Haute Lutte » de M. Passemard. SHAT 1989.

TOI, MON COPAIN.
Sur nos pitons nous avons tout l’hiver Tenu le front qui nous était confié. La neige avait effacé la frontière. Seul, le soleil levant nous l’indiquait
On avait faim ! On manquait de cartouches ! On affrontait l’ennemi chaque nuit ! On déployait une énergie farouche Pour conserver un village détruit.
Tant que la neige a recouvert les cimes Nous n’avons fait que de maigres progrès Mais on mourait pour une avance infime… Pour un rocher dominant un névé.
Puis, en Avril, l’offensive dernière Nous a jetés, droit vers l’est, tout là-bas. Tu as roulé soudain dans la poussière… C’était pour toi le tout dernier combat.
Dix jours plus tard, la paix régnait sur terre Et l’ordre noir n’était plus l’ordre roi ! C’était la joie ! La nôtre un peu amère… Car tu dormais sous une croix de bois.
De ces combats, on ne se souvient guère Ni ceux d’en haut ni, bien sûr, ceux d’en bas. Seuls, nous, les yeux levés vers la frontière, Nous les copains, nous, on ne t’oublie pas !
ABTF : Air Borne Task Force
AP : Avant Poste
AS : Armée Secrète
B : Bloc (d’une fortification)
BAF : Bataillon Alpin de Forteresse
BBC : British Broadcasting Corporation (Radio anglaise)
BCA : Bataillon de Chasseurs Alpins
BLE : Bataillon de Légion Etrangère
C : Court (canon) ou de Côte (affût de canon, notamment pour le 95 Lahitolle ; voir plus loin S et P)
CA : Corps d’Armée
CCNN : Camicie Nere (Chemises Noires : milice de volontaires fascistes italiens)
CDF : Commission de Défense des Frontières
CDL : Comité Départemental de Libération
COMAC : Comité Militaire de l’Armée Clandestine (du CNR : Conseil National de la Résistance)
CORF : Commission d’Organisation des Régions Fortifiées
DA : Division Alpine
DAA ou DAAlp : Détachement d’Armée des Alpes
DBAF : Demi Brigade Alpine de Forteresse
DBLE : Demi-Brigade de Légion Etrangère
DFL : Division Française Libre
DI : Division d’Infanterie
DIA : Division d’Infanterie Alpine
DIM : Division d’Infanterie Marocaine ou Division d’Infanterie Motorisée selon le cas
EM : Etat-Major
FFI : Forces Françaises de l’Intérieur
FM : Fusil-Mitrailleur
FTP : Francs Tireurs Partisans
GaF : Guardia alla Frontiera
GFM : Guetteur et Fusil-Mitrailleur
GMO : Groupe Mobile d’Opérations
Goumier : Troupier des unités marocaines
GTM : Groupement de Tabors Marocains
JM : Jumelage de Mitrailleuses
L : Long (canon)
M : Montagne. (Ex : 65 M signifie canon de 65 de montagne)
MG : en allemand, MaschinenGewehr ; mitrailleuse
Mle : Modèle, suivi de l’année (Mle 97 : Modèle 1897)
MOM : Main d’Oeuvre Militaire
MUR : Mouvements Unis de Résistance
N° des Unités : N° de compagnies ou de batteries en chiffres arabes. Ex : 2/83e BAF
N° de bataillons d’infanterie, ou d’escadrons, ou de groupes d’artillerie en chiffres romains. Ex : II/299e RIA, III/5e RD, V/293e RALD
Cas particulier : la désignation « n/XV » (parfois notée à tort n/15) est appliquée à des unités dépendant du groupement alpin sud de FFI créé le 11 novembre 1944 (note n° 1593/3 TS du 10/11/1944 du général de Lattre). Ces unités FFI des départements des Hautes Alpes, des Basses Alpes et des Alpes Maritimes sont initialement rattachées à la 4e DMM et à la 1re DFL puis au Détachement d’Armée des Alpes. XV fait référence au XVe Corps d’armée et n en chiffres arabes (contrairement à la règle énoncée ci dessus) désigne le numéro du bataillon.
ORA : Organisation de Résistance de l’Armée
PA : Point d’Appui
PC : Poste de Commandement
PO : Petit Ouvrage (Système Maginot)
R1 : Région militaire clandestine de Lyon
R2 : Région militaire clandestine de Marseille
RA : Régiment d’Artillerie
RAA : Régiment d’Artillerie d’Afrique
RAL : Régiment d’Artillerie Lourde
RALCA : Régiment d’Artillerie Lourde de Corps d’Armée
RALD : Régiment d’Artillerie Lourde Divisionnaire
RALH : Régiment d’Artillerie Lourde Hippomobile
RAM : Régiment d’Artillerie de Montagne
RAP : Régiment d’Artillerie de Position
RD : Régiment de Dragons
RI : Régiment d’Infanterie
RIA : Régiment d’Infanterie Alpine
RTA : Régiment de Tirailleurs Algériens
RTM : Régiment de Tirailleurs Marocains
RTT : Régiment de Tirailleurs Tunisiens
SAP : Section Atterrissage Parachutage
SES : Section d’Eclaireurs Skieurs
S et P : pour le 95 Lahitolle, affût de Siège et Place (a contrario de l’affût de Côte)
SFAM : Secteur Fortifié des Alpes-Maritimes
SFD : Secteur Fortifié du Dauphiné
SOE : Special Operation Executive (en anglais)
STG : Section Technique du Génie
STO : Service du Travail Obligatoire
T : de Tranchée (mortier)
Tabor : Equivalent d’un bataillon dans les troupes d'origine marocaine
TSF : Transmission Sans Fil (désignait aussi les émissions radiophoniques)
VB : Vivien Bessière, désignation de la grenade à fusil
VDP : Vision Directe et Périscopique
XV : voir N° des Unités
La campagne du Détachement d’Armée des Alpes (mars avril mai 1945). Général A. Doyen. Arthaud 1948.
Histoire de la Première Armée Française Rhin et Danube. Général de Lattre. Plon. 1949.
Avec le 15e BCA. Notes de guerre. Edouard Vincent.
Eclaireurs skieurs au combat. Jacques Boell. Arthaud. 1962.
La guerre franco-italienne juin 1940. H. Azeau. Presses de la Cité.
Journal de marche de la résistance en Ubaye. Amicale des Maquisards et Résistants Secteur Ubaye. 1978.
La Bataille des Alpes. 10-25 juin 1940. Général Etienne Plan et Eric Lefevre. Charles Lavauzelle. 1982.
Bataille des Alpes. Album Mémorial. Henri Béraud. Editions Heimdal. 1987.
Guide de la ligne Maginot. Alain Hohnadel et Michel Truttmann. Editions Heimdal. 1988.
159e Régiment d’Infanterie Alpine. Historique du Régiment de la Neige. Marcel Guillamo. Imprimerie Louis Jean. 1988.
De l’armistice à la libération dans les Alpes de Haute Provence. La Résistance. Jean Garcin. S.E. Imprimerie Bernard Vial. 2e édition. 1990.
La seconde guerre mondiale dans les Hautes Alpes et l’Ubaye. Henri Béraud. Société d’études des Hautes Alpes.1990.
Histoires vécues en Ubaye (1939-1945). Sabença de la Valéia. 1990.
La Ligne Maginot en Haute Ubaye : Forts de Roche-La-Croix et du Haut de SaintOurs. B. Morel et G. Lesueur. Association des Fortifications de l’Ubaye. Communauté de Communes de la Vallée de l’Ubaye. Barcelonnette. Sabença de la Valéia. 1991.
Le fort de Tournoux. Son histoire, sa construction. B. Morel. Association des Fortifications de l’Ubaye. Communauté de Communes de la Vallée de l’Ubaye. Barcelonnette. Sabença de la Valéia. 1993.
Citadelles d’altitude. Patrick Gendey et Pascal Kober. Editions Didier Richard. 1995.
La Muraille de France ou la ligne Maginot. Philippe Truttmann. Gérard Klopp éditeur. 4e édition.1996.
Il était une fois la ligne Maginot. Nord Lorraine Alsace. Jean Bernard Wahl. Jérôme Do Bentzinger Editeur. 1999.
Hommes et ouvrages de la ligne Maginot. Tome I, II et III. Jean Yves Mary et Alain Hohnadel avec le concours de Jacques Sicard. L’Encyclopédie de l’Armée Française sous la direction de François Vauvillier. Histoire et Collections. 2000, 2001 et 2003.
Les Alliés et la Résistance. Un combat côte à côte pour libérer le sud-est de la France. Arthur Layton Funk. Traduit de l’américain par Christine Alicot. Edisud. 2001
Le temps du refus (1940 1945). La Résistance dans le Guillestrois/Queyras. R. Meyer Moyne, M. C. Olivero, J. Feuillasier, E. Moyne. Edition Groupe Calade. Juin 2004.
Militaria. Histoire et collections. Hors série nos 14 et 15. 1994.
La chevauchée de l’Armée de Lattre, par Yves Buffetaut.
Les Cahiers des Troupes de Montagne.
N° 6. Automne 1996 (septembre 1996).
Sur la route des Forts (2e Partie). Dossier coordonné par Jean Pierre Martin, p. 56 à 76.
N° 21. Eté 2000 (juin 2000).
Les sections d’éclaireurs skieurs au combat en juin 1940, par Laurent Demouzon, p. 10 à 17.
Ubaye juin 1940 : une victoire des Alpins et de l’Artillerie, par le Général (cr) Maurice Barret, p. 35 à 54.
39/45 Magazine. N° 160. Octobre 1999.
Le toit de la ligne Maginot : les ouvrages de Restefond, par Alain Hohnadel, p. 52 à 62.
Gazette des uniformes. Hors série N°10. 4e trimestre 2000.
La Bataille des Alpes 1939/1940, sous la direction de Henri et Yves Béraud. Fortifications et Patrimoine. Association Le Mur. Année 2000.
Un aperçu de la fortification en haute montagne : le site de Restefond, par David Comte, p. 63 à 70.
Les fortifications de l’Ubaye de Vauban à Maginot. Itinéraires du patrimoine. Textes de Ph. Truttmann Inventaire général SPADEM. Edité par Association pour le patrimoine de Provence.1993.
Le site de la Bonette. Association pour la route de la Bonette. 1998.
Patrimoine d’une vallée. Ubaye. Edition (annuelle) par le service Patrimoine de la Communauté de Communes de la Vallée de l’Ubaye (CCVU). Editions 1999 à 2001.
Cartes IGN actuelles.
Cartes Michelin 1932 et 1937.
Documents Génie. Direction de Grenoble. Chefferie de Gap. 1938.
Documents Génie. Direction de travaux de Nice. Arrondissement de Fortifications de Nice. 1938.
Journal des opérations dans la vallée de l’Ubaye (n° 7743 B/V 3 du 28 juin 1940).
Colonel Dessaux (commandant la Vallée de l’Ubaye).
Journal des opérations du 83e BAF du 11 au 25 juin 1940.
Résumé des opérations de l’artillerie de la vallée Ubaye jusqu’au 25 juin 1940.
Lieutenant Colonel Bresse (commandant le 293e RALD et l’Artillerie de la Vallée).
Insignes anciens ou actuels des principales unités qui sont intervenues dans la zone Ubaye Ubayette Restefond Haute Tinée pendant le conflit 1939 1945.


































