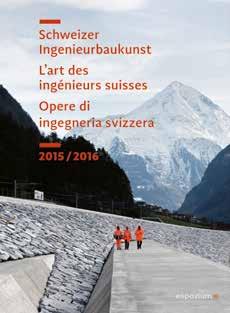7 minute read
LIVRES
from Temps
by espazium.ch
THÉORISER LA VIE DES LIEUX
Jean-Baptiste Lestra Vingt ans après leur livraison, le paysagiste Denis Delbaere revient sur les lieux de ses projets pour constater leur transformation sous l’action du temps. Loin de s’en désoler, il révèle comment, à travers ce qu’il nomme ces altérations, les dynamiques du terrain initial reconfigurent l’espace aménagé.
Le jardin de la Conque à Saint-Rémy-du-Nord (F) après le chantier en 1998 (en haut), et en 2013 (en bas). (denis delbaere) C’est à une expérience singulière que nous convie Denis Delbaere, paysagiste-concepteur et enseignant chercheur à l’École nationale supérieure d’architecture et de paysage de Lille. Dans son dernier ouvrage, il s’est livré à un formidable exercice d’introspection en revisitant ses propres projets 20 ans après leur aménagement. Il s’agit d’une dizaine d’espaces publics paysagers réalisés dans la région lilloise au tournant des années 2000 qu’il relate dans le détail, par le dessin avant / après et dans une écriture dense et précise, pleine de drôlerie, pour mesurer l’« incroyable écart » qui s’est creusé entre ses intentions de départ et ce que ces lieux sont devenus. Sans concession, il revient à la source des décisions prises, des erreurs commises, des ambiguïtés non levées. L’autocritique est implacable, rien ne nous est épargné des désillusions, rancœurs, remords qui secouent le créateur à la vue de son œuvre malmenée par le temps. De nombreux passages sont poignants et restituent dans un style très littéraire les affres d’un maître d’œuvre en proie à une relation toxique avec ses maîtres d’ouvrage. C’est un véritable cri du cœur et l’honnêteté de la démarche force le respect.
Si l’auteur met dans la balance sa propre légitimité de concepteur, c’est pour aller plus loin : emporté dans son élan, il fustige l’utopie paysagiste et dénonce la faillite des politiques françaises d’aménagement de l’espace public avec un catastrophisme joyeux, parfois déroutant. Tout y passe. C’est qu’au-delà du jeu de massacre, Denis Delbaere a une visée conceptuelle plus ambitieuse : celle de théoriser la vie des lieux. Le chercheur prend le dessus sur le praticien. Les études de cas lui servent à formuler une grammaire des « altérations » que subit l’espace public dès qu’il est livré. Même si elle peine à faire système, cette syntaxe est passionnante par tous les mécanismes qu’elle soulève et explique, sur un sujet où tout reste à faire. Derrière l’aléatoire et le malentendu généralisé qui entourent le projet d’espace public, l’auteur perçoit la présence d’un « métaprojet » qui dépasse les intentions du concepteur pris dans un système d’acteurs, une « écologie du projet » qu’il s’agirait d’analyser dans toutes ses dimensions. Tel serait le rôle d’une véritable critique de l’espace public, enfin tournée vers le plus grand nombre, qu’il appelle de ses vœux pour faire émerger les enjeux de la ville à venir.
Cette lecture revigorante est transposable aux autres domaines de la construction et de l’aménagement. De quelque point de vue qu’on l’aborde, le livre de Denis Delbaere ne peut laisser indifférent, au moins par la question brûlante qu’il instille au fil des pages : comment continuer à aménager des espaces publics après l’avoir lu ?
Jean-Baptiste Lestra est architecte-paysagiste et enseignant à l’ENSP Versailles-Marseille.
altérations paysagères, pour une théorie critique de l’espace public Denis Delbaere, Éditions Parenthèses, Collection : La Nécessité du paysage, 2021
REDÉCOUVRIR JACQUES SIMON, AGITATEUR DU PAYSAGE
Stéphanie Sonnette Paysagiste, dessinateur, photographe, éditeur, artiste, les auteurs du dernier numéro des Carnets du paysage révèlent les multiples facettes de Jacques Simon (1929-2015), figure atypique du monde du paysage qui fut l’un des principaux animateurs du renouveau de la pensée et de la pratique paysagères en France depuis les années 1950.

Quatre numéros de la collection Aménagement des espaces libres, éditée par Jacques Simon, 20 numéros parus entre 1974 et 1988.

Page extraite du numéro 1 de la collection, 500 croquis, (1974), rééd. 1981 Après des études aux Beaux-Arts de Montréal et à l’École nationale supérieure d’horticulture de Versailles, Jacques Simon, fils de pépiniériste forestier, fait ses premières armes avec les grands chantiers de la reconstruction, dans les ZUP, à Reims, à Provins. Sa pratique, déjà, est atypique : il travaille sans plans ni coupes, mais avec des croquis qui décrivent des ambiances, des parcours entre les nouveaux immeubles, et intervient parfois directement sur site avec des engins de chantier, sans dessin préparatoire. À la recherche du geste simple, radical et efficace, qui installe tout de suite un nouveau paysage, il mène des chantiers éclair, avec peu de moyens, utilisant les terres excavées des bâtiments et des voiries, terrassées en monticules, revêtues d’une peau de terre végétale enherbée puis plantées.
Sa connaissance et son goût des arbres, son attention aux climats, aux sols, aux ressources, aux techniques de plantations, Jacques Simon les diffuse dans des ouvrages (Mes arbres d’ornement, 1958, L’art de connaître les arbres, 1964) et les exploite dans ses projets. Il plante « dense, monospécifique, jeune et tordu pour former des masses végétales en quelques années, suffisamment charpentées pour rivaliser avec le cadre bâti massif avec lequel elles doivent composer » (Denis Delbaere). Il conçoit également lui-même les mobiliers, les aires de jeux pour les enfants.
Militant, soucieux de partager ses connaissances, d’informer les professionnels et de mettre en lien les entreprises, les maîtres d’ouvrage, les habitants et les concepteurs, Jacques Simon envisage le paysage comme une question citoyenne, un sujet de société qui doit être débattu avec le grand public. C’est par le biais de son activité éditoriale qu’il trouve à diffuser ses idées, ses outils et ses positions critiques dans des formats et selon des codes qui empruntent à la contre-culture de l’époque : dessins, collages, photographies commentées, bulles, photomontages. Il tient d’abord, dès la sortie de ses études en 1960, la rubrique « espaces verts » de la revue Urbanisme, puis prend la direction de la revue Espaces verts, qui sera plus tard dotée d’un supplément sous forme de chemise A4 paysage contenant une cinquantaine de feuillets non reliés : « Aménagement des espaces libres ». Vingt numéros de cet objet singulier, de ce « bricolage éditorial » (Isabelle Jégo) paraîtront entre 1975 et 1983. Simon y aborde différents sujets : « Paysages et loisirs », « Jardins privés et lotissements », « Espaces et jeux » ou « Clôtures » de manière didactique et critique. Produits artisanalement, ses fascicules, comme ses projets de paysage, visent la plus grande efficacité avec le minimum de moyens.
Son activité d’édition n’est pas plus dissociable de sa pratique de concepteur que son approche artistique. À partir des années 1970, et de manière quasi exclusive à partir des années 1990, Jacques Simon se tournera vers ce qu’il appelle l’« articulture », dessinant dans les champs avec des tracteurs, des moissonneuses batteuses, à la manière du land art.
Inventif, libre et imprévisible, Jacques Simon laisse une œuvre et une pensée particulièrement stimulantes pour notre époque austère et normative.
carnets du paysage n° 38 Actes Sud, École nationale supérieure du paysage, printemps 2021
VIVRE AVEC LES CRUES POLITIQUE DES RYTHMES
Dans un monde de plus en plus saturé, de signes, de normes, d’objets et de sollicitations qui tous contribuent à nos aliénations quotidiennes, le manifeste défend l’idée que la réponse à cette saturation réside dans la capacité à retrouver la maîtrise politique de nos rythmes, qu’ils soient individuels ou collectifs. Dans cet ouvrage illustré par les photographies de Christian Lutz, les auteurs explorent la part fondamentalement spatiale et territoriale du temps et les dynamiques temporelles des formes spatiales afin de formuler les grandes lignes d’une rythmologie. PATRIMOINE VAUDOIS
Après un premier opus consacré à la période 1920-1975, ce nouvel ouvrage recense 350 opérations réalisées dans le canton de Vaud entre 1975 et 2000, avec l’ambition de sensibiliser le grand public et les différents milieux professionnels à la valeur d’un patrimoine encore trop souvent méconnu. Nouvelles constructions et interventions sur le bâti existant y côtoient des aménagements d’espaces publics et les ensembles bâtis de l’EPFL à Écublens, l’UNIL à Dorigny et le CHUV au Bugnon.
Dans cet ouvrage plus que jamais d’actualité, le paysagiste Frédéric L. M. Rossano revisite l’histoire culturelle des crues et propose de nouvelles stratégies, moins défensives et plus résilientes, pour aménager et habiter les paysages inondables, à travers l’analyse des projets les plus innovants d’Europe : les polders néerlandais, l’estuaire du Rhin et de la Meuse et la troisième correction du Rhône en Suisse.
la part de l’eau, vivre avec les crues en temps de changement climatique Frédéric L. M. Rossano, Éditions de La Villette, Paris, coédité avec nai010 Publishers, Rotterdam (pour la version anglaise), 2021 manifeste pour une politique des rythmes Manola Antonioli, Guillaume Drevon, Luc Gwiazdzinski, Vincent Kaufmann, Luca Pattaroni, EPFL Press, Lausanne, 2020 architecture du canton de vaud 1975-2000 Bruno Marchand, Pauline Schroeter, EPFL Press, Lausanne, 2021
LA MAGIE DU BOIS!
T. 021 926 85 85
St-Légier
C HARPEN TIER / BA TIS SEU R
T. 021 926 85 95
Mts-Pully
CHA RPENT IE R / B AT I SS EUR
T. 024 486 85 85
Orbe Cinq sociétés, une même identité pour un service
• plus proche • plus fiable • plus flexible • plus complet

T. 021 637 85 85
Rolle
M E N U I S I E R / C R E A T E U R
T. 021 908 06 80
Maracon