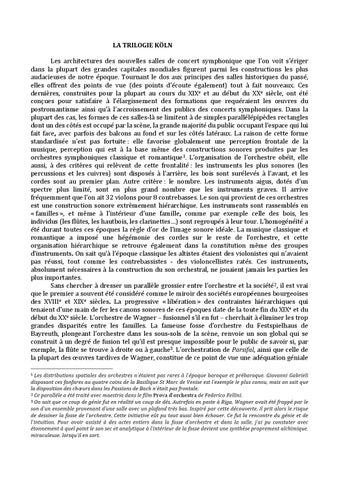LA TRILOGIE KÖLN Les architectures des nouvelles salles de concert symphonique que l’on voit s’ériger dans la plupart des grandes capitales mondiales figurent parmi les constructions les plus audacieuses de notre époque. Tournant le dos aux principes des salles historiques du passé, elles offrent des points de vue (des points d’écoute également) tout à fait nouveaux. Ces dernières, construites pour la plupart au cours du XIXe et au début du XXe siècle, ont été conçues pour satisfaire à l’élargissement des formations que requéraient les œuvres du postromantisme ainsi qu’à l’accroissement des publics des concerts symphoniques. Dans la plupart des cas, les formes de ces salles-là se limitent à de simples parallélépipèdes rectangles dont un des côtés est occupé par la scène, la grande majorité du public occupant l’espace qui lui fait face, avec parfois des balcons au fond et sur les côtés latéraux. La raison de cette forme standardisée n’est pas fortuite : elle favorise globalement une perception frontale de la musique, perception qui est à la base même des constructions sonores produites par les orchestres symphoniques classique et romantique1. L’organisation de l’orchestre obéit, elle aussi, à des critères qui relèvent de cette frontalité : les instruments les plus sonores (les percussions et les cuivres) sont disposés à l’arrière, les bois sont surélevés à l’avant, et les cordes sont au premier plan. Autre critère : le nombre. Les instruments aigus, dotés d’un spectre plus limité, sont en plus grand nombre que les instruments graves. Il arrive fréquemment que l’on ait 32 violons pour 8 contrebasses. Le son qui provient de ces orchestres est une construction sonore extrêmement hiérarchique. Les instruments sont rassemblés en « familles », et même à l’intérieur d’une famille, comme par exemple celle des bois, les individus (les flûtes, les hautbois, les clarinettes…) sont regroupés à leur tour. L’homogénéité a été durant toutes ces époques la règle d’or de l’image sonore idéale. La musique classique et romantique a imposé une hégémonie des cordes sur le reste de l’orchestre, et cette organisation hiérarchique se retrouve également dans la constitution même des groupes d’instruments. On sait qu’à l’époque classique les altistes étaient des violonistes qui n’avaient pas réussi, tout comme les contrebassistes - des violoncellistes ratés. Ces instruments, absolument nécessaires à la construction du son orchestral, ne jouaient jamais les parties les plus importantes. Sans chercher à dresser un parallèle grossier entre l’orchestre et la société2, il est vrai que le premier a souvent été considéré comme le miroir des sociétés européennes bourgeoises des XVIIIe et XIXe siècles. La progressive « libération » des contraintes hiérarchiques qui tenaient d’une main de fer les canons sonores de ces époques date de la toute fin du XIXe et du début du XXe siècle. L’orchestre de Wagner – fusionnel s’il en fut – cherchait à éliminer les trop grandes disparités entre les familles. La fameuse fosse d’orchestre du Festspielhaus de Bayreuth, plongeant l’orchestre dans les sous-sols de la scène, renvoie un son global qui se construit à un degré de fusion tel qu’il est presque impossible pour le public de savoir si, par exemple, la flûte se trouve à droite ou à gauche3. L’orchestration de Parsifal, ainsi que celle de la plupart des œuvres tardives de Wagner, constitue de ce point de vue une adéquation géniale 1 Les distributions spatiales des orchestres n’étaient pas rares à l’époque baroque et prébaroque. Giovanni Gabrieli
disposant ces fanfares au quatre coins de la Basilique St Marc de Venise est l’exemple le plus connu, mais on sait que la disposition des chœurs dans les Passions de Bach n’était pas frontale. 2 Ce parallèle a été traité avec maestria dans le film Prova d'orchestra de Federico Fellini. 3 On sait que ce coup de génie fut en réalité un coup de dés. Autrefois en poste à Riga, Wagner avait été frappé par le son d’un ensemble provenant d’une salle avec un plafond très bas. Inspiré par cette découverte, il prit alors le risque de dessiner la fosse de l’orchestre. Cette initiative eût pu tout aussi bien échouer. Ce fut la rencontre du génie et de l’intuition. Pour avoir assisté à des actes entiers dans la fosse d’orchestre et dans la salle, j’ai pu constater avec étonnement à quel point le son sec et analytique à l’intérieur de la fosse devient une synthèse proprement alchimique, miraculeuse, lorsqu’il en sort.