Association professionnelle pour tous les kinésithérapeutes
Exclusif
À LA UNE
Kinésithérapie en santé mentale et psychomotricité

EXXTRA
Littérature spécialisée
LITTÉRATURE SPÉCIALISÉE
AXXON EN ACTION
Les exercices de marche supervisée en traitement de la claudication intermittente
Soins à distance : la vidéoconsultation en kinésithérapie

Qui êtes-vous ?
EXXPERT
Activité physique pour les enfants et les adolescents atteints de TDAH

Le rôle du kinésithérapeute dans le secteur de la santé mentale et de la psychiatrie : déclaration stratégique de l’IOPTMH
Comment prendre des décisions pour sa santé quand on n’a pas/plus l’esprit clair ?
Interventions thérapeutiques basées sur la musique pour les personnes atteintes de démence
AXXON EXCLUSIF PUBLICATION DE L’ASBL AXXON DÉCEMBRE 2022 TRIMESTRIEL – ANNÉE 13 – N° 56 –IMPERIASTRAAT 16 – 1930 ZAVENTEM BUREAU DE DÉPÔT: BRUXELLES X NUMÉRO D’AGRÉMENT: P910666 ÉDITEUR RESPONSABLE: PETER BRUYNOOGHE – IMPERIASTRAAT 16 –1930 ZAVENTEM RÉDACTION & COPYWRITING: SÉBASTIEN KOSZULAP & HELENA D.MILONAS – REDACTION@AXXON.BE TRADUCTION: EMILY VAN COOLPUT CONCEPT ET RÉALISATION: C3CREATIES IMPRESSION: SYMETA-HYBRID ADRESSE DE CORRESPONDANCE AXXON: IMPERIASTRAAT 16 – 1930 ZAVENTEM – TÉL : 02 709 70 80 – WWW.AXXON.BE NUMÉRO DE COMPTE POUR LES COTISATIONS: BE18 3631 0868 1365 Vous recevez cette revue en fonction du nom et de l’adresse qui se trouvent dans notre base de données. Suite à la mise en application de la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée, vous avez la possibilité et le droit de modifier vos données. Les articles/publicités paraissent sous la responsabilité des auteurs/firmes. AXXON se réserve le droit de refuser des textes et/ou publicités qui pourraient nuire à la profession. © Tout texte ou partie de texte ne peut être copié/photocopié sans l’autorisation écrite de l’éditeur, quelle qu’en soit l’utilisation.
Cardiovascular and Pulmonary Physical


Evidence to Practice - Sixth edition
Therapy
Obtenez des bases solides en réadaptation cardiovasculaire et pulmonaire ! Cardiovascular and Pulmonary Physical Therapy : Evidence and Practice, 6th Edition offre une approche équilibrée et holistique de l’ensemble de la kinésithérapie cardio-pulmonaire. De l’évaluation aux interventions, ce livre vous guide dans la prise en charge des patients souffrant d’affections aiguës et chroniques. Des études de cas illustrent les pratiques EBP et la recherche scientifique améliore votre prise de décision clinique. Comprenant désormais une version eBook améliorée, ce texte détaille les meilleures pratiques les plus récentes pour vous aider à obtenir les meilleurs résultats en kinésithérapie.
Auteurs : Elizabeth Dean, Donna Frownfelter
Editeur : Elsevier – Health Sciences Division
Date de publication : Mars 2022 Nombre de pages : 832 ISBN : 9780323624718
Crise de l’énergie : mais laquelle ?
Nous subissons en ce moment une crise de l’énergie dont l’ampleur dépasse tout ce que l’on a pu vivre à ce niveau jusqu’à présent. Les médias ne parlent que de cela et nos politiciens, ne sachant plus quoi inventer pour soulager la population, rejettent la responsabilité sur l’Europe, à qui ils confient la tâche de prendre les mesures appropriées.
L’AXXON Exclusif de ce trimestre aborde, entre autre, la problématique de la kinésithérapie en santé mentale. Mais qu’en est-il, dans ce contexte, de la santé mentale du praticien ? N’est-ce pas lui aussi qu’il va falloir penser à soutenir ?
En attendant que des moyens soient mis en œuvre pour « limiter les dégâts », nos patients, vous, moi, sommes logés à la même enseigne : nous nous demandons comment faire pour honorer nos factures à court, moyen et long terme.
Dans un communiqué de presse diffusé en septembre, AXXON a une fois de plus clairement expliqué que la différence de statut (conventionné/déconventionné) crée une réelle discrimination. Si j’ai choisi de rester conventionné, je suis obligé de respecter les tarifs en vigueur déterminés par l’INAMI : je ne peux donc en aucun cas adapter mes honoraires afin d’y répercuter l’impact de l’inflation et de l’augmentation du coût de la vie.
Le kinésithérapeute déconventionné peut, s’il le souhaite, majorer ses tarifs pour compenser ces effets négatifs.
AXXON demande clairement la création d’une « prime énergétique » suffisamment conséquente pour que le kinésithérapeute ne doive pas faire ce choix. Tant les kinésithérapeutes conventionnés que les déconventionnés y trouveraient leur compte, ce qui est la volonté de l’association professionnelle.
En parlant d’énergie, AXXON se démène sans compter pour que chaque kinésithérapeute puisse avoir une meilleure qualité de vie. Malgré cela, nous ne pouvons nous satisfaire des résultats actuels ! Nous ne baissons pour autant pas les bras et maintenons nos efforts pour que la kinésithérapie soit reconnue à sa juste valeur.
En définitive, face à une telle situation, la question de savoir pourquoi rester conventionné deviendra de plus en plus légitime. Parce que j’ai une éthique, une morale, une philosophie qui me retient de faire payer encore plus mon patient ?
Afin de répondre au mieux à notre mission de représentation, j’en appelle à vous, membres d’AXXON : aidez-nous à convaincre vos consœurs et confrères nonmembres de l’importance de soutenir l’association professionnelle. Seul, on va peut-être plus vite, mais c’est ensemble que l’on ira beaucoup plus loin. Nous avons besoin de l’énergie de tous pour nous assurer un meilleur avenir.

Les exercices de marche supervisée en traitement de la claudication intermittente
Les directives nationales et internationales recommandent des exercices de marche supervisée en combinaison avec un accompagnement du mode de vie comme traitement de première intention chez les personnes victimes d’une maladie artérielle périphérique stable (stade 1 ou 2) et symptomatique des membres inférieurs.
Aux Pays-Bas, cette mesure figure depuis 2014 dans les recommandations de la société nationale de kinésithérapie KNGF et fait partie intégrante des soins remboursés depuis 2017. Nos voisins du nord ont aussi entretemps élargi cette approche de soins échelonnés ou stepped care (consistant à épuiser les possibilités des traitements conservateurs avant de passer aux techniques plus invasives) à plusieurs autres maladies chroniques non transmissibles1
En 2017, une étude pilote sous l’article 56 a été préparée avec l’appui d’ebpracticenet asbl et le soutien financier du SPF Santé publique. Réalisée sous la direction de nos collègues Fons de Schutter et Bruno Zwaenepoel, elle a reçu en 2018 le feu vert pour élaborer un plan d’implémentation et mettre sur pied un réseau de kinésithérapeutes spécialisés (en étroite collaboration avec les PaysBas). En tant que principal point de contact de ce groupe de malades, les médecins de famille ont également été impliqués de près dans ces travaux qui ont été déployés dans deux régions de Flandre.
Après des débuts difficiles, les premiers résultats positifs – encore limités – ont pu être recueillis en mai 2019, avec à la clé un prolongement du financement jusqu’à fin 2020 dans l’espoir de parvenir à un meilleur taux d’inclusion. À ce stade, le principal obstacle réside dans la méconnaissance de la trajectoire de
soins aussi bien parmi les généralistes prescripteurs que parmi les chirurgiens vasculaires, les patients et même les kinésithérapeutes.
La mise au point du site internet www.claudicatiocare.be a été achevée au cours de la première année du projet. Dans un premier temps, les kinésithérapeutes ont été formés par des médecins et kinésithérapeutes venus des Pays-Bas et une large campagne d’information a été lancée à l’intention de l’ensemble des stakeholders. Malheureusement, la pandémie du COVID-19 n’a pas permis à l’initiative d’atteindre vraiment sa vitesse de croisière. La période de traitement mise en avant est de 3 mois minimum et d’1 an maximum, en partie parce que modifier le mode de vie (arrêt tabagique, adaptation des habitudes alimentaires, etc.) prend du temps mais représente vraiment une facette essentielle de la prise en charge.
Le rapport final du projet a été déposé en juin 2021, mais il n’a jusqu’ici pas encore été présenté au Comité de l’assurance.
À l’automne 2021, le réseau EBP et AXXON ont tous deux introduit, avec le soutien des organismes assureurs, une proposition de projet de déploiement national auprès de la taskforce “Soins efficients”, sous la rubrique “Initiatives prioritaires”. Bien que des signaux positifs aient circulé dans un premier temps, il n’y a jusqu’ici rien de concret.
Comme AXXON accorde une grande importance à ce projet et que plusieurs autres stakeholders s’y sont déclarés favorables lors de contacts informels, nous avons introduit en septembre 2022 une nouvelle fiche en vue de pouvoir le poursuivre dans le cadre de l’article 56. AXXON estime que, sur la base des conclusions positives de l’étude pilote et des résultats obtenus aux Pays-Bas, un déploiement national de la directive est justifié et indiqué.
Si le projet est approuvé, les patients pourront être traités sous des pseudocodes de nomenclature dès 2023. Grâce à l’enregistrement, il sera ainsi possible d’introduire une proposition d’étude auprès du KCE pour son programme de recherche 2024. Cette étude du KCE pourrait inclure une analyse du rapport coûtefficacité de l’approche conservatrice (exercices de marche supervisée) en comparaison avec celui du traitement chirurgical (pose de stents/ réalisation d’un pontage). Bien que l’accompagnement vers un mode de vie sain fasse partie intégrante du traitement conservateur, AXXON est d’avis qu’il devrait aussi être proposé aux personnes suivies dans le bras chirurgical de l’étude. Plusieurs études réalisées à l’étranger ont en effet démontré que l’impact de la chirurgie s’estompe rapidement en l’absence d’évolution du mode de vie.
Références
1. chronischzorgnet.nl

«
AXXON estime qu’un déploiement national de la directive est justifié et indiqué.BRUYNOOGHE, LUK DIELEMAN
Soins à distance : la vidéoconsultation en kinésithérapie
Les nouveaux développements dans le domaine de la kinésithérapie, la contribution du kinésithérapeute à l’innovation (technologique) dans les soins et l’utilisation de celle-ci à bon escient sont étroitement liés à la demande croissante et changeante ainsi qu’à notre vision de la santé. Un recours judicieux aux technologies de santé (e-santé et, plus spécifiquement, soins « mixtes ») permet aux kinésithérapeutes d’améliorer la qualité et/ou l’efficience de leur prise en charge. Il peut intervenir en complément ou en substitut au traitement de kinésithérapie classique, mais aussi s’inscrire dans une autre forme d’offre (soins à distance).
La vidéoconsultation est un mode de communication bidirectionnel et interactif qui intervient en remplacement d’un contact en face à face pour permettre à un (ou plusieurs) prestataire(s) de soins et à un patient d’échanger autour d’un problème de santé par le biais d’une transmission audio et vidéo.
Les technologies de santé et la consultation numérique peuvent être utilisées lorsque la demande de soins et l’environnement du patient s’y prêtent. Ce sera au kinésithérapeute et au patient de poser ensemble un choix mûrement réfléchi quant à l’opportunité et aux modalités concrètes de cette approche.
La proposition ci-après a été soumise par AXXON au groupe de travail “Télérevalidation” de l’INAMI, mais
doit encore être examinée par un groupe de travail mixte impliquant des représentants du Conseil Technique et de la Commission de convention. Il sera aussi nécessaire de tenir compte des propositions touchant à la nouvelle nomenclature.
AXXON part ici du principe d’un mode de traitement hybride combinant thérapie manuelle et vidéoconsultations.
La prise de contact (“intake”) avec le patient se déroulera toujours en face à face, soit à son domicile, soit au cabinet du kinésithérapeute. Dans un second temps, on pourra alterner consultations au cabinet (thérapie manuelle) et vidéoconsultations (soins numériques) dans le cadre d’un accord clair entre le patient et le kinésithérapeute. Cette alternance doit pouvoir se dérouler
d’une manière optimale, en veillant à garantir d’une part la sécurité du thérapeute et du patient et d’autre part une prise en charge clinique efficiente. Il revient donc au kinésithérapeute de décider, avec le consentement éclairé du patient, de mettre en place cette approche mixte.
Sous certaines conditions (voir plus loin), une vidéoconsultation peut être validée au même titre qu’une consultation au cabinet, avec des modalités de remboursement comparables. Une vidéoconsultation ne peut toutefois donner lieu à la facturation d’aucun supplément. Les consultations par téléphone ne présentent, à notre sens, aucune plus-value dans le domaine de la kinésithérapie.
Modalités :
1. Première consultation (prise de contact) + premier traitement : TOUJOURS en face à face.
2. Fréquence :
a. Pathologies courantes : maximum 50 % des consultations par vidéoconsultation (9/18).
b. Pathologies Fa/Fb : maximum 50 % des consultations par vidéoconsultation, celles-ci ainsi que les consultations physiques étant planifiées à parts égales chaque semaine. Lorsque les séances sont prévues à raison d’une fois par semaine, on alternera consultation physique une semaine et vidéoconsultation la semaine suivante.
c. Pathologies E : dans certaines situations pathologiques bien définies, on pourra appliquer le même principe que pour les pathologies Fa/Fb.
d. La durée d’une vidéoconsultation doit toujours être identique à celle d’un traitement comparable effectué au cabinet.
3. La possibilité d’avoir recours à la vidéoconsultation ne doit PAS figurer explicitement sur l’ordonnance. C’est le kinésithérapeute qui règle cet aspect avec le patient lors de la première consultation, en veillant à s’assurer de la capacité physique, mentale et financière de ce dernier à utiliser des outils numériques.
4. Certaines pathologies ne peuvent pas être traitées par vidéoconsultation (ex. : drainage lymphatique, thérapie respiratoire, etc.). Il sera peut-être nécessaire d’en dresser la liste.
5. La vidéoconsultation doit toujours transiter par une plateforme garantissant un chiffrement de bout en bout.
6. Un financement distinct doit être prévu pour l’accompagnement et le suivi des patients atteints de certaines maladies chroniques (diabète de type I ou II, obésité, insuffisance coronarienne, insuffisance rénale, risque accru de chute), car ces personnes bénéficient d’un télémonitoring en sus de la téléconsultation. Certains paramètres (cliniques) (ex. : enregistrement des PROMs et des PREMs) sont communiqués au kinésithérapeute à intervalles réguliers pour lui permettre d’adapter le programme d’exercices et/ou d’entraînement. On pourrait prévoir pour ce monitoring un forfait hebdomadaire.
Le principal avantage de la vidéoconsultation et du télémonitoring réside dans l’autonomie accrue qu’ils offrent au patient, avec la possibilité de suivre son traitement chez lui au moment qui lui convient le mieux.

Les données de la littérature donnent à penser que la kinésithérapie mixte représente une approche efficace avec un rapport coût-efficacité favorable.
L’implémentation de la kinésithérapie mixte pourrait contribuer à abaisser le coût des soins en améliorant l’autogestion du patient.
Dans un contexte où le nombre de patients nécessitant des soins de kinésithérapie est en augmentation (et où, vieillissement et progression des maladies chroniques aidant, cette tendance n’est vraisemblablement pas près de s’inverser), cette approche thérapeutique peut contribuer à soulager la pression qui pèse sur les soins de santé.
Activité physique pour les enfants et les adolescents atteints de TDAH
Bien que l’on suppose souvent que les enfants et les adolescents atteints d’un Trouble du Déficit de l’Attention avec ou sans Hyperactivité (TDAH) sont plus actifs physiquement, la recherche montre que ceux-ci sont 21 % moins susceptibles de respecter les lignes directrices en matière d’exercice (60 minutes d’activité physique modérée à intense par jour) par rapport à leurs pairs au développement typique (Mercurio et al., 2019).

Le TDAH est un trouble du développement fréquent (prévalence +/- 5 %), qui se caractérise par une comorbidité élevée, en particulier dans le spectre des autres troubles du développement (spectre autistique, troubles de l’apprentissage, TDC, etc.). En outre, les enfants et adolescents atteints de TDAH présentent un risque plus élevé de troubles métaboliques, de surpoids et d’obésité (Chen et al., 2018) et conservent une prévalence remarquablement élevée de problèmes moteurs dans cette population (Kaiser et al., 2015). Enfin, le TDAH est associé à un risque plus élevé de problèmes de santé mentale (dépression, toxicomanie, etc.).
Ces dernières années, les interventions non pharmacologiques pour les enfants et les adolescents atteints de TDAH ont suscité un intérêt croissant. L’activité physique semble être une alternative prometteuse à cet égard, notamment en tant qu’intervention complémentaire, s’inscrivant dans un plan de traitement holistique.
Des recherches antérieures montrent à la fois les effets aigus de l’activité physique et les effets - à plus long terme - d’une activité physique régulière. Dans cette contribution, nous nous concentrerons uniquement sur ce dernier point. Plusieurs études indiquent que l’activité physique régulière peut avoir une influence sur les principaux symptômes du TDAH (inattention, hyperactivité, fonctions
exécutives), mais les résultats de ces études ne sont pas toujours cohérents. Cela peut s’expliquer (partiellement) par des lacunes méthodologiques. Cependant, Seiffer et al. (2022) ont récemment publié une importante méta-analyse d’études contrôlées randomisées qui ont examiné l’efficacité d’une intervention en matière d’activité physique chez les enfants et les adolescents atteints de TDAH. Dans cette contribution, nous discutons des résultats.
La force de l’étude de Seiffer et al. (2022) réside tout d’abord dans le fait qu’ils n’ont inclu que des essais contrôlés randomisés (ECR) avec des enfants et des adolescents ayant un diagnostic confirmé de TDAH. Les interventions en matière d’activité
physique appliquées ont eu lieu au moins 2 fois par semaine, pendant au moins 4 semaines et, dans toutes les études, l’accent a été mis sur une activité physique modérée à intense. Un dernier point important est que les auteurs n’ont retenu que les études dans lesquelles les résultats ont été mesurés à l’aide d’instruments de mesure validés. Dans la méta-analyse de Seiffer et al (2022), un total de 11 ECR ont été inclus (total n = 448 ; 6-18 ans ; 24% de filles).
L’analyse primaire montre un effet positif important des interventions d’activité physique sur les symptômes principaux du TDAH par rapport aux conditions de contrôle (g = 0,33). De plus, un effet modéré des interventions d’activité physique a été trouvé sur la déficience fonctionnelle dans le contexte social par rapport aux conditions de contrôle (g = -0.46).

Une analyse de sous-groupe, comparant les résultats des études avec un groupe de contrôle actif (pharmacothérapie) ou passif, a montré un effet modéré
pour le groupe d’intervention actif par rapport à un groupe de contrôle passif (g = -0.40). La comparaison entre une intervention d’activité physique et un groupe témoin actif (pharmacothérapie) a donné lieu à un effet moyen non significatif, en faveur de la pharmacothérapie. Les interventions proposées en tant que traitement supplémentaire ont eu un effet modéré (g = -0,48) et les interventions autonomes ont eu un petit effet non significatif (g = -0,15).
Seul l’âge était un facteur prédictif significatif de l’effet de l’activité physique sur les principaux symptômes du TDAH ; aucune différence n’a été constatée pour le sexe ou le statut pharmaceutique. Il est frappant et intéressant de constater que l’âge est négativement associé à la taille de l’effet, ce qui signifie que les interventions en matière d’activité physique étaient plus efficaces pour les sujets plus âgés.
Dans les lignes directrices actuelles pour le traitement du TDAH, les interventions psychosociales et la
pharmacothérapie sont recommandées. De ce point de vue, nous aimerions placer les conclusions de cette méta-analyse sur les interventions en matière d’activité physique aux côtés des conclusions sur l’efficacité de ces interventions recommandées. Les méta-analyses sur l’effet des traitements psychosociaux du TDAH montrent qu’ils ont un faible effet sur les principaux symptômes du TDAH et un effet modéré sur les problèmes fonctionnels dans le contexte social (y compris les problèmes avec les pairs). Avec un faible effet des interventions d’activité physique par rapport à toutes les conditions de contrôle (y compris la pharmacothérapie) et un effet modéré par rapport aux conditions de contrôle passives, il semble que l’activité physique (d’intensité modérée à intense et proposée pendant une durée suffisamment longue) entraîne des effets similaires sur les principaux symptômes du TDAH que les interventions psychosociales. L’effet modéré des interventions en matière d’activité physique sur le fonctionnement psychosocial est également conforme aux interventions psychosociales.
La méta-analyse de Seiffer et al (2022) n’a montré aucune différence significative d’effet dans une comparaison directe entre la pharmacothérapie et l’activité physique. Il convient toutefois de noter qu’il ne s’agit que de deux études, qui ont toutes deux utilisé une intervention d’activité physique d’intensité élevée à maximale en tant qu’intervention autonome. Étant donné que la pharmacothérapie a un effet modéré à important sur les
principaux symptômes du TDAH, il semble actuellement que l’activité physique soit inférieure à la pharmacothérapie au niveau de l’impact sur les principaux symptômes du TDAH. Enfin, il est important de noter que dans les études sur l’activité physique, le taux d’abandon moyen était de 9%. Cela semble acceptable, surtout si on le compare à un abandon moyen de 20% pour la pharmacothérapie et de 3-34% pour les interventions psychosociales.
La méta-analyse de Seiffer et al. (2022) fournit des preuves préliminaires des effets faibles à modérés des interventions en matière d’activité physique (proposées régulièrement, modérées à intensives) sur les principaux symptômes du TDAH et la déficience fonctionnelle dans un contexte social. Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires, nous ne pouvons que recommander vivement de toujours envisager l’intégration des interventions en matière d’activité physique dans un plan de traitement holistique pour un patient donné. En partie parce que l’activité physique peut également avoir un effet positif sur les difficultés supplémentaires des enfants atteints de TDAH et conduit à l’amélioration des capacités motrices (Sun et al., 2022 ; Vysniauske et al., 2020). Le kinésithérapeute a un rôle à jouer qu’il ne faut pas sous-estimer, entre autres parce que la recherche montre que les interventions en matière d’activité physique effectuées sous la supervision d’un professionnel offrent les meilleurs résultats.

En raison de la grande hétérogénéité des interventions proposées (fréquence, intensité, durée et type), il n’est actuellement pas possible de fournir des lignes directrices concrètes pour tous ces paramètres. Dans cette métaanalyse, nous n’avons examiné que les interventions réalisées à une intensité modérée à intense. Des recherches antérieures ont montré que les interventions en matière d’activité physique doivent être au moins à un niveau d’intensité modérée pour montrer des effets positifs sur les mécanismes sous-jacents du TDAH (de Greeff et al., 2018) et d’autres problèmes psychologiques (Carter et al. 2016). Actuellement, il y a un manque de recherche et de preuves pour l’utilisation d’interventions de faible intensité. De plus, cette étude est une description des effets des interventions qui ont été proposées 2 à 3 fois par semaine, pendant une durée minimale de 4 semaines. Cependant, le temps consacré à l’intervention variait considérablement, de 10 à 60 minutes. Les plus grandes différences ont été constatées dans le type d’activité physique (de l’équitation, du HIIT, de l’entraînement d’endurance à l’exergaming). Il n’est pas encore clair à ce jour si la nature de l’activité influence l’efficacité.
Références
Carter, T., Morres, I. D., Meade, O., & Callaghan, P. (2016). The effect of exercise on depressive symptoms in adolescents: A systematic review and meta-analysis. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 55(7), 580– 590. https://doi.org/10.1016/j.jaac.2016.04.016
Chen, Q., Hartman, C. A., Haavik, J., Harro, J., Klungsøyr, K., Hegvik, T. A., ... & Larsson, H. (2018). Common psychiatric and metabolic comorbidity of adult attention-deficit/hyperactivity disorder: A population-based cross-sectional study. PloS one, 13(9), e0204516.
de Greeff, J. W., Bosker, R. J., Oosterlaan, J., Visscher, C., & Hartman, E. (2018). Effects of physical activity on executive functions, attention and academic performance in preadolescent children: A meta-analysis. The Journal of Science and Medicine in Sport, 21(5), 501–507. https://doi.org/10.1016/j. jsams.2017.09.595
Kaiser, M. L., Schoemaker, M. M., Albaret, J. M., & Geuze, R. H. (2015). What is the evidence of impaired motor skills and motor control among children with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)? Systematic review of the literature. Research in Developmental Disabilities, 36, 338357.
Mercurio, L. Y., Amanullah, S., Gill, N., & Gjelsvik, A. (2019). Children with ADHD engage in less physical activity. Journal of Attention Disorders, 25(8): 1187–1195. https://doi.org/10.1177/1087054719887789
Seiffer, B., Hautzinger, M., Ulrich, R., & Wolf, S. (2022). The efficacy of physical activity for children with attention deficit hyperactivity disorder: A metaAnalysis of randomized controlled trials. Journal of Attention Disorders, 26(5), 656-673.
Sun, W., Yu, M., & Zhou, X. (2022). Effects of physical exercise on attention deficit and other major symptoms in children with ADHD: A meta-analysis. Psychiatry Research, 114509.
Vysniauske, R., Verburgh, L., Oosterlaan, J., & Molendijk, M. L. (2020). The effects of physical exercise on functional outcomes in the treatment of ADHD: a meta-analysis. Journal of Attention Disorders, 24(5), 644-654.

Le rôle du kinésithérapeute dans le secteur de la santé mentale et de la psychiatrie : déclaration stratégique de l’IOPTMH
L’International Organization of Physical Therapy in Mental Health (IOPTMH) propose une déclaration de consensus sur le rôle du kinésithérapeute dans le secteur des soins de santé mentale, élaborée par son Comité Exécutif avec l’aide de kinésithérapeutes possédant une expertise spécifique dans ce domaine. La réalité concrète de la pratique peut toutefois – bien évidemment – différer d’un pays ou d’une région à l’autre.
Les kinésithérapeutes actifs dans le secteur de la santé mentale doivent disposer de connaissances et d’aptitudes spécifiques pour évaluer, traiter et référer efficacement les personnes atteintes de troubles psychologiques ou psychiatriques (Probst & Skjaerven, 2017). Ces professionnels représentent un groupe encore relativement jeune mais de plus en plus nombreux dans le segment des soins de santé mentale et un nombre croissant de preuves viennent aujourd’hui étayer l’efficacité de l’activité physique pour améliorer la santé aussi bien physique que psychologique des personnes atteintes d’une maladie de l’esprit (Stubbs & Rosenbaum, 2018). Il arrive toutefois encore souvent que les kinésithérapeutes et les autres professionnels des soins soient mal informés de l’intérêt de notre discipline dans ce domaine. Il est donc important qu’une
prise de conscience se fasse quant à la portée de la kinésithérapie dans le secteur des soins de santé mentale et à ses probables bénéfices pour les patients. Le champ d’application de la kinésithérapie dans le domaine de la santé mentale et de la psychiatrie est dynamique et répond aux besoins des patients et de la société.
Le besoin de soins de kinésithérapie dans le secteur de la santé mentale et de la psychiatrie La santé mentale représente au sein de la société une cause de préoccupation croissante qui, en l’absence d’une prévention et d’une gestion plus intensives, ne fera que s’amplifier encore dans le futur (WHO, 2018). Une mauvaise santé mentale est associée à une prévalence accrue de maladies cardiovasculaires, d’hypertension, de diabète et de troubles respiratoires en raison d’un

mode de vie sédentaire, d’un manque d’activité physique, d’une alimentation malsaine, de problèmes de tabagisme/d’abus de substances, mais aussi de l’effet des médicaments psychotropes.
L’activité physique est, à côté du traitement médicamenteux et de la psychothérapie, l’une des clés du traitement global des personnes victimes de problèmes de santé mentale. Il existe des preuves convaincantes que l’activité physique protège contre la dépression et que la kinésithérapie améliore la santé physique et psychologique des patients atteints de graves troubles de santé mentale (Schuch et. al, 2018). Dans certains pays, la kinésithérapie demeure toutefois un service sous-exploité dans le secteur des soins de santé mentale (Probst & Skjaerven, 2017).
Le champ d’application
La kinésithérapie en santé mentale peut offrir une valeur ajoutée dans la prévention et le traitement des maladies de l’esprit. L’accent est mis sur l’activité et la participation au travers de l’exercice physique, de la relaxation et de la conscience du corps, qui relient entre eux les besoins physiques et psychologiques de l’individu. Le kinésithérapeute a recours à des approches aussi bien physiques que psychologiques pour parvenir à des modifications du mode de vie à la fois pertinentes et durables. Ces stratégies permettent aux patients de gagner en autonomie et en indépendance et de gérer eux-mêmes leur santé et leur bien-être.
Les kinésithérapeutes peuvent être mobilisés aussi bien au sein des structures de soins de santé mentale et des institutions psychiatriques qu’à l’extérieur de celles-ci. Ils sont en mesure de déterminer quand une problématique psychologique ou psychiatrique sort de leur champ de compétences et quand il est nécessaire de référer le patient à des soins de santé mentale spécifiques.
Les kinésithérapeutes ont la responsabilité de conscientiser la population aux problèmes de santé mentale et de réduire la stigmatisation qui les entoure. Ils apportent à l’équipe interdisciplinaire une expertise spécifique de la qualité des facultés motrices du patient.
Éléments-clés
La kinésithérapie en santé mentale fait appel à des approches basées sur la psychologie (ex. : thérapie cognitivo-comportementale, thérapie d’acceptation et d’engagement, auto-disposition, techniques motivationnelles) pour étayer le traitement de différents troubles dans tous les groupes d’âge (Rovner, 2017). Il s’agit d’une approche non pharmacologique, non invasive, sûre et associée à un faible risque d’effets secondaires. Les stratégies et objectifs thérapeutiques reposent sur le
modèle biopsychosocial de la Classification Internationale du Fonctionnement, du Handicap et de la Santé (CIF). Au-delà d’un fonctionnement optimal, la kinésithérapie met ici l’accent sur l’activité et la participation, en tenant compte des interactions entre variables individuelles et environnementales qui sont susceptibles de déboucher sur des problèmes de santé mentale.
Les éléments-clés du traitement sont :
Activité physique et condition physique. Prise de conscience sensorielle du corps. Régulation du stress et relaxation. Proximité / Contact physique / Massage. Éducation (mode de vie, douleur).
Éléments spécifiques pour les enfants. Éléments spécifiques pour les personnes âgées.
DÉCOUVREZ LA DÉCLARATION DE L’IOPTMH DANS SON INTÉGRALITÉ SUR LE SITE WEB
D’AXXON
Références
Probst, M., & Skjaerven, L.H. (2017). Physiotherapy in Mental Health and Psychiatry: a scientific and clinical based approach. London: Elsevier.
Rovner, G. (2017). Activephysio: acceptance and commitment therapy (ACT) for the physical therapist in the area of chronic pain. In: Probst, M., & Skjaerven, L.H. Physiotherapy in mental health and psychiatry: a scientific and clinical based approach. London: Elsevier.
Schuch, F.B., Vancampfort, D., Firth, J., Rosenbaum, S., Ward, P.B., Silva, E.S., … Stubbs, B. (2018). Physical Activity and Incident Depression: A Meta-Analysis of Prospective Cohort Studies. Am J Psychiatry. 1;175(7):631-648.
Simons, J. (2018). Physical therapy in mental health with children and adolescents. In: Probst, M. & Skjaerven, L. Physical therapy in Mental Health and psychiatry: a scientific and clinical based approach. London: Elsevier.
Stubbs, B. & Rosenbaum, S. (2018). Exercise-Based Interventions for Mental Illness. London: Elsevier.
World Health Organisation, WHO. (2018). Fact sheet: mental health strengthening our response. Retrieved from https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mentalhealthstrengthening-our-response
Comment prendre des décisions pour sa santé quand on n’a pas/plus l’esprit clair ?
Il est parfois difficile pour les soignants d’évaluer si un patient est apte à prendre une décision d’ordre médical et de définir de quel soutien il a besoin. C’est pourquoi il est nécessaire de les former à ces questions. Les initiatives visant à permettre au patient d’exprimer à l’avance ses préférences et ses souhaits peuvent également jouer un rôle important à cet égard.
Pour la plupart d’entre nous, il va de soi qu’il nous revient de prendre nous-mêmes les décisions qui concernent notre propre santé. Mais pour certaines personnes, dont la capacité décisionnelle est altérée – par exemple en cas de maladie mentale ou de démence – la situation n’est pas claire. Un rapport du Centre fédéral d’Expertise des Soins de santé (KCE) rappelle que la capacité décisionnelle est rarement une donnée binaire « en noir ou blanc » mais une réalité fluctuante en fonction du moment, du contexte et du type de décision à prendre. Les personnes concernées doivent être soutenues de manière à pouvoir continuer autant que possible à prendre de manière autonome les décisions qui concernent leur santé et leurs soins.
Un sujet sensible
Prendre soi-même les décisions qui concernent sa propre santé et les soins que l’on souhaite recevoir, cela nous semble évident. Il suffit de constater l’intensité des réactions à la question de l’obligation vaccinale contre le Covid pour se convaincre de la sensibilité du sujet.
Pourtant, les décisions en matière de soins peuvent être particulièrement difficiles pour certaines personnes, parce que leur capacité décisionnelle est réduite (de manière temporaire ou permanente), par exemple à cause d’une maladie mentale ou d’une démence. Comment les soignants peuvent-ils faire face à de telles
situations ? Quels sont les droits de ces personnes ? Comment les protéger tout en leur laissant encore une autonomie de choix et en respectant leurs volontés ?
La loi ne dit pas comment faire
La question à l’origine du rapport publié aujourd’hui par le Centre fédéral d’Expertise des Soins de santé (KCE) avait été posée simultanément par le monde académique et par la Vlaams Patiëntenplatform, organisation coupole flamande des associations de patients. En effet, depuis 2002, la Belgique dispose d’une loi sur les droits des patients qui repose sur le principe que, sauf preuve du contraire, toute personne adulte est en mesure de prendre une décision relative à ses soins de santé. Mais la loi ne dit pas comment faire…. Quand et comment faut-il procéder à une évaluation de la capacité décisionnelle ? Qui devrait être chargé de cette évaluation ? Et qui devrait y être impliqué ? Est-il possible de définir des critères standardisés pour déterminer cette compétence ? Ce ne sont là que quelques-unes des nombreuses questions pratiques qui se posent dans l’application concrète de ce principe. Pour y apporter des (pistes de) réponses, les chercheurs du KCE ont analysé le cadre législatif belge et la littérature internationale, mais ils ont également interrogé des patients et des soignants afin de cerner au plus près les besoins concrets et les expériences des personnes concernées.

Jamais « noir ou blanc »
Que faut-il retenir de cette recherche ? Tout d’abord que la capacité décisionnelle est rarement une donnée binaire « en noir ou blanc », avec des personnes « totalement capables » ou « totalement incapables » de prendre une décision éclairée, mais une réalité fluctuante en fonction du moment, du contexte et du type de décision à prendre. Les patients atteints de démence (débutante) ou de maladie mentale ne devraient donc pas automatiquement être considérés comme inaptes à prendre des décisions.
Soutenir autant que possible
Au contraire, c’est précisément dans ces périodes « entre gris clair et gris foncé » que ces personnes doivent être soutenues de manière à pouvoir continuer autant que possible et aussi longtemps que possible à prendre de manière autonome les décisions qui concernent leur santé et leurs soins. Il faut pour cela savoir trouver le délicat équilibre entre autonomie et protection du patient, en évitant le piège du paternalisme (même bien intentionné). Les soignants ont besoin d’être accompagnés pour y arriver ; cela peut se faire via des guides de bonne pratique, des outils d’aide à la décision, des programmes de formation spécifiques, etc.
Deux processus de concertation importants ont été épinglés par les chercheurs comme essentiels : la « prise de décision partagée » et la « planification préalable ou anticipée des soins » (PAS). En lien avec cette dernière, il faut saluer la toute récente campagne du SPF Santé publique intitulée « Parlons de nos vieux jours ». La PAS peut également servir de base à l’élaboration d’un « plan de crise » avec les personnes confrontées à une maladie mentale qui présente un risque de rechute ou de détérioration.
Créer un climat propice à l’accompagnement
L’introduction de procédures ou de guides de bonne pratique ne doit toutefois pas déboucher sur une « procédure standardisée » d’évaluation de la capacité décisionnelle. Chaque personne a en effet ses spécificités individuelles, son bagage et son contexte propres. C’est pourquoi ces procédures devraient avant tout offrir des repères aux soignants afin de leur permettre de parvenir à une approche plus structurée tout en laissant la place à la relation interindividuelle.
Soutenir la capacité décisionnelle d’une personne ne peut toutefois se faire que si une série de conditions connexes d’ordre organisationnel sont également mises en place, notamment pour permettre aux professionnels de disposer d’un temps suffisant pour rendre la prise de décision accompagnée possible.
Rôle
central des personnes de confiance
Les chercheurs ont également souligné le rôle important des personnes de confiance dans l’accompagnement et le soutien des personnes dont la capacité décisionnelle est réduite. Elles aussi doivent pouvoir trouver facilement des informations pertinentes, fiables et faciles à comprendre sur les possibilités existantes.
Une attention particulière doit être accordée aux personnes socialement isolées, qui n’ont ni famille ni amis. Pour ces personnes, aucune forme de soutien – juridique ou autre – n’est prévue.

De nombreuses questions restent ouvertes sur ce sujet complexe mais le rapport du KCE propose quelques pistes d’amélioration pour faire progresser un peu le soutien à ces personnes vulnérables.
Références
Vinck Imgard, Benahmed Nadia, Dauvrin Marie, Desomer Anja, Cornelis Justien, Jonckheer Pascale, Mistiaen Patriek. Évaluation et soutien de la capacité décisionnelle des personnes atteintes de démence ou de maladie mentale. Health Services Research (HSR). Bruxelles. Centre Fédéral d’Expertise des Soins de Santé (KCE). 2022. KCE Reports 349. D/2021/10.273/54.
Interventions thérapeutiques basées sur la musique pour les personnes atteintes de démence
Quels sont les effets des interventions thérapeutiques basées sur la musique sur le bien-être émotionnel (y compris la qualité de vie), l’humeur, le comportement, le fonctionnement social et la cognition des personnes atteintes de démence ? C’est la question développée dans cette revue.
Contexte
Les personnes atteintes de démence développent progressivement des problèmes de mémoire, de pensée, de langage et d’activités quotidiennes. La démence s’accompagne souvent de problèmes émotionnels et comportementaux. La maladie a un impact sur la qualité de vie. Aux stades avancés de la démence, il peut être difficile de communiquer avec les mots, mais même lorsque les personnes atteintes de démence ne peuvent plus parler, elles peuvent souvent encore fredonner avec la musique ou jouer de la musique. Les traitements basés sur la musique pourraient donc être particulièrement adaptés aux personnes atteintes de démence. Les musicothérapeutes sont spécialement formés à utiliser la musique pour atteindre certains objectifs de traitement. D’autres professionnels peuvent également être formés à proposer des traitements similaires. Cette revue Cochrane évalue les effets des interventions basées sur la musique.
Critères de sélection des études
Cette revue Cochrane a inclus des études randomisées sur l’effet des interventions thérapeutiques basées sur la musique (avec au moins 5 sessions) pour les personnes atteintes de démence. Les groupes témoins ont bénéficié soit des soins habituels, soit d’autres activités telles
que la cuisine, les puzzles ou la peinture. La dernière recherche a eu lieu en juin 2017.
Résumé des résultats
La revue a inclus 22 études portant sur 1.097 participants atteints de démence. Le degré de démence variait, mais tous les participants vivaient dans un établissement de soins résidentiel. Sept études ont évalué des interventions basées sur la musique proposées à des individus, tandis que les autres études ont évalué des interventions de groupe. La plupart des études ont utilisé à la fois des éléments actifs, incitant les participants à jouer euxmêmes de la musique ou à chanter, parfois avec des mouvements tels que frapper des mains ou danser, et des éléments musicaux réceptifs, qui consistaient à écouter de la musique.
Immédiatement après le traitement, les auteurs ont observé une diminution des sentiments dépressifs (le score moyen dans le groupe d’intervention avait diminué de 0,27 écart-type (ET), IC à 95% de 0,45 à 0,09 ; certitude modérée, 11 RCT, 503 participants) et des problèmes de comportement (diminution moyenne de 0,23 ET, IC à 95% de 0,46 à 0,01 ; certitude modérée, 10 RCT, 442 participants). Il y avait peu ou pas de différence sur l’agitation ou l’agressivité (diminution moyenne de 0,07 ET, IC à 95 % : -0,24 à
+0,10, certitude modérée, 14 RCT, 626 participants). Les auteurs ont trouvé un effet positif possible sur le bien-être émotionnel et l’anxiété, mais pas sur la cognition (faible certitude). L’effet sur le comportement social est incertain (très faible certitude).
La certitude quant à l’effet à plus long terme, au moins 4 semaines après le traitement, est faible à très faible. De plus, les résultats suggèrent peu ou pas de différence pour toutes les mesures de résultats. Aucune des études n’a signalé d’effets secondaires.
Conclusion
Les interventions thérapeutiques basées sur la musique pour les personnes atteintes de démence réduisent probablement les sentiments dépressifs et améliorent peut-être les problèmes de comportement en fin de traitement. La musique peut améliorer le bienêtre émotionnel, la qualité de vie et réduire éventuellement l’anxiété, mais est susceptible d’avoir peu ou pas d’effet sur l’agitation, l’agressivité ou la cognition. Nous ne sommes pas certains des effets sur le comportement social et sur le long terme.
Implications pour la pratique
Les interventions basées sur la musique semblent utiles pour les personnes atteintes de démence.
Références
1. Centre Belge pour l’Evidence Based Medicine (Cebam), Cochrane Belgique
2. CHU Brugmann
van der Steen JT, Smaling HJA, van der Wouden JC, Bruinsma MS, Scholten RJPM, Vink AC. Music-based therapeutic interventions for people with dementia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 7. Art. No.: CD003477. DOI: 10.1002/14651858. CD003477.pub4. Accessed 28 September 2022.

Consultez le texte intégral de cette revue Cochrane via la Cebam Digital Library for Health : www.cebam.be/fr/cdlh
Cochrane Corner En collaboration avec le CEBAM, Cochrane Belgique : www.cebam.be
La CDLH est une bibliothèque médicale électronique qui vous donne accès à de l’information scientifique objective et indépendante en soins de santé via internet. Vous y trouverez de multiples sources d’information.
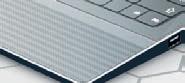






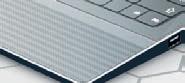





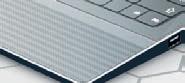






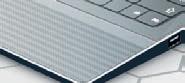






UN AVANTAGE D’UNE VALEUR






DE 100 € !
guides de pratique clinique nationaux et internationaux, revues systématiques, revues médicales internationales, résumés et critiques de la littérature, traités EBM, banque de données de 3000 ouvrages médicaux de référence, etc.






































