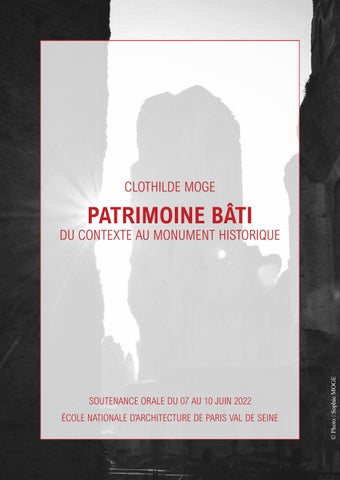bâti Du contexte au monument historique soutenance orale Du 07 au 10 juin 2022 École nationale D’architecture De paris val De seine clothilDe moGe MOGESophie:Photo©
Patrimoine
vers l’influence De l’ ailleurs corps anthropien et corps Bâti
sommaireprÉfaceintroDuction
comprenDre les enjeux Du contexte
paGe 07
paGe 17
paGe 29 paGe 22 paGe 18 paGe 20 paGe 12 paGe 10 paGe 08
le concept nomaDe Duconclusionpatrimoine
Du lieu oriGinaire D’un intÉrêt l’impact De la photoGraphie thÉories De la conservation DÉfinition Du contexte
02/30
paGe 27
paGe 26
paGe 06
iBiBlioGraphieconoGraphie
paGe 04
Je limiterai dès lors ma réflexion aux raccords possibles avec le passé, c’est-à-dire la continuité entre ce qui a été, ce qui est, et ce qui sera. Comme l’exemple d’une préoccupation contemporaine telle que l’adaptabilité, la portée historique et la stature d’un monument ne sont pas uniquement reléguées au passé mais elles conservent une réelle fonction nécessaire aux futures conceptions. Par quels autres procédés les éléments patrimoniaux peuvent alors servir à l’exercice actuel de l’architecture ? Comment concilier l’histoire et l’état d’un lieu à travers le projet architectural ? Ces questions ont pu émerger grâce à la découverte, à l’écoute et aux discussions à l’entour de nouveaux savoirs. Elles révèlent au fil de leur déploiement, d’autres notions issues du passé qui sont en effet réemployées, parfois modifiées ou greffées aux innovations dans l’architecture. Les principes fondamentaux inculqués tout au long du cursus de l’enseignement, restent indissociables à l’exercice du projet en école ou en agence, et marquent au fur et à mesure la base de notre singulière identité.
À l’ère où les modes de vies ont largement dépassés les schémas traditionnels, il nous est essentiel en futurs architectes de prendre en considération leur moindre changement. L’adaptabilité est certainement le principe le plus apte à faire face aux préoccupations contemporaines. Les solutions à ces variations ne sont pourtant pas inédites. La trame et le module déjà utilisés pour les monuments de l’Antiquité, puis réinterprétés à la Renaissance, sont aujourd’hui des outils indispensables pour répondre à la diversité des scénarios d’usages au sein d’un même corps. On rappellera notamment l’importance de certains traités tels que De architectura de Vitruve, De re aedificatoria écrit quinze siècles plus tard par Leone Battista Alberti, ou encore les quatre livres de l’architecture d'Andrea Palladio publiés vers 1570. Ces trois exemples théorisent les principes fondamentaux enseignés en école d’architecture et forgent notre apprentissage d’un vocabulaire nécessaire à l’existence du bâti. Nous savons grâce à cela que le système de la trame et du module ne répond pas uniquement à une ordonnance adaptable et malléable. Il résout par ailleurs des questions actuelles comme l’écologie, l’esthétique, l’économie, la technique etc. Ces champs d’intervention ne seront cependant pas tous évoqués au cœur de mon propos. Ma volonté de décrire les conceptions qui nous précède permet de comprendre à travers l'exemple énoncé, l’importance du patrimoine dans la société actuelle, et notamment le choix de mon futur domaine d’étude.
prÉface
04/30
Cette période d’articulation entre la licence et le master me permet de faire le bilan d’une thématique bien précise, apparue à plusieurs reprises lors des enseignements, de voyages et d’expériences au sein des agences d’architecture. C’est vers cet attrait de plus en plus fort pour les édifices, et les marques du bâti ancien élevés au rang de monument historique que nous détaillerons les spécificités de la dénomination : patrimoine. Ce mot était au sens étymologique du terme latin patrimonium, rattaché au père. Il s’est élargi depuis à travers différents domaines, dépassant ainsi la structure familiale. Le patrimoine bâti se lie néanmoins à un sentiment d’appartenance à un territoire, parce qu’il marque une identité locale et dessine le visage de son paysage. Nous voyagerons à travers différents lieux. Des sauts d’échelles vont alors s’opérer tout au long du discours, du point de départ d’un attachement régionaliste au dépassement des frontières nationales. S’intéresser au patrimoine, c’est se rendre curieux de ses héritages, ses origines profondes et sa propre influence sur l’extérieur. Les plus passionnés adoptent des intérêts bien moins passagers : les théoriciens prennent position aux discours de la conservation, les architectes spécialisés jusqu’à intervenir in-situ, sans oublier les médiateurs culturels – intermédiaires entre l’œuvre et le grand public. Quel que soit la considération de chacun, ce sont bien nos actions et l’usage que l’on administre au monument qui lui confère son statut puis son destin quant à sa conservation.
06/30
La prise de conscience patrimoniale commencera par la définition du contexte, nous pourrions dire aussi le berceau du monument dit “ historique ”. Cette première partie sera l’occasion de comprendre théoriquement le choix d’une localisation donnée, mais surtout les influences réciproques entre l’environnement et son bâti. Le deuxième temps du discours se focalisera sur des exemples vécus par le maître d’ouvrage en charge d’une opération précise. Ce moment révélera le concept nomade du patrimoine vers des architectures mineures. L’attention portée aux édifices alentours, faisant partie du contexte sera enfin valorisée.
Découvrir le patrimoine suppose toutefois de dépasser les frontières d’un attachement local. Tandis que les missions de l'architecte consistent à analyser le bâti des fins d’interventions concrètes, nous prendrons un tout autre rôle : celui du voyageur. La découverte et l’observation à plus grande échelle construisent au fur et à mesure notre culture, permettent en outre de lire un monument à travers un œil continuellement nouveau. Notre regard est tel, car les temporalités changent à mesure que le temps se déroule. L’expérience du voyage est aussi l’occasion de s’enrichir humainement. Si l’on questionne encore aujourd’hui l’utilité du patrimoine, nous l’éluciderons dans un point de vu singulier sous la forme du bilan de trois années d’études aussi enrichissantes que déterminantes.
introDuction
comprenDre les enjeux Du contexte
“ Rien de mieux à cet égard que de prendre la notion de patrimoine dans son volet paysager, et même environnemental. C’est ainsi qu’est en train de se forger une notion de patrimoine bâti assimilée à celle de paysage urbain historique. ” - Alfonso Álvarez Mora, ‘‘ Le concept de patrimoine bâti, alibi des modèles urbains soumis à la rente foncière en Europe ’’, Espaces et sociétés, 2013, p.28.
Orientées vers une définition moins globale, certaines de ces manifestations révèlent toutefois la capacité d’un projet architectural ou urbain à (re)façonner l’ambiance d’une ville ou d’un territoire. Prenons l’exemple de Paris : ville qui abrite l’école d’architecture de Val-de-Seine, mais avant tout capitale siècle.
Figure (gauche) : Dessin de l’Usine SUDAC, Paris / Figure 1 (à droite) : l’ENSAPVS, Paris, Frédéric Borel
L’intérêt pour un domaine plus précis encore que le mot générique « patrimoine » n’a jamais fait l’objet d’un choix hâtif. La voie de la professionnalisation vers une spécialité définie n’est pas non plus le fruit d’une seule expérience. Pourquoi d’ailleurs devrions-nous jamais reconsidérer nos préoccupations? Car celles-ci évoluent grâce à nos découvertes, l’apprentissage que l’on reçoit à mesure que l’on acquiert l’expérience du vécu. Pour cela, il semble indispensable de comprendre un édifice architectural en ayant analysé son contexte, c’est-à-dire l’environnement que l’on découvre en parallèle du sujet principal.
comprenDre les enjeux Du contexte 1891 - 1994 2007-
Le propos de l’architecte et urbaniste espagnol résonne au sein d’un argument en faveur du territoire historique, à l’intérieur duquel se compose un dialogue harmonieux entre deux éléments conjoints. Le bâti et le contexte forment à cet effet l’identité d’un paysage doté de ‘scènes urbaines’, où la vision d’un espace évoluera au cours du temps. Alfonso Álvarez Mora définit encore ces ensembles scéniques comme des ‘singularités’ d’un même environnement. Cette première approche permet donc de comprendre le contexte comme un ensemble de circonstances qui influence le caractère d’une situation.
08/30
DÉfinition Du contexte
L’enseignement “Atlas des transformations de Paris” a notamment permis de comprendre les critères qui ont motivé ce grand bouleversement haussmannien. Le traumatisme de la révolution française a suscité de la part de Napoléon III, la réflexion nouvelle et radicale du plan d’aménagement de la ville. Le paysage historique est alors condamné à laisser place à un tracé organisé, destiné à éviter de pareilles rébellions. En un simple aparté, cela montre l’envergure du contexte, indissociable des autres catégories auxquels il fait référence, formé lui-même par ses conditions économiques, sociales, politiques, esthétiques, culturelles, historiques etc.
Pourtant, des préfigurations se formaient déjà, trente années avant cette date indélébile de 1789, symbole de la suppression de l’ancien régime. L’ouvrage des embellissements de Paris (1749) composé par Voltaire, sous-tend qu’ “ il faut des marchés publics, des fontaines qui donnent en effet de l’eau, des carrefours réguliers, des salles de spectacle ; il faut élargir les rues étroites et infectes, découvrir les monuments qu’on ne voit point, et en élever qu’on puisse voir. ”
Figure 2: Percement de l’avenue de l’Opéra et boulevard Henri IV, vers 1870, Paris, photo Charles Marville.
comprenDre les enjeux Du contexte
Notions sur l’intervention de l’existant, vues en semestre 5 (2020-2021), cour d’introduction dispensé par Marie Gaimard
C’est d’ailleurs via la découverte de ces trois textes fondamentaux qu’est née une plus grande considération vis-à-vis du patrimoine bâti. Proposé à la lecture par Marie Gaimard, l’ouvrage Conserver ou Restaurer : Les Dilemmes du patrimoine écrit en 1893 par Camillo Boito, architecte et écrivain italien confirme notre part de responsabilité en tant que futur architectes : de positionner notre manière de penser le projet depuis un contexte mental et tangible.
Tandis que la notion du contexte connaît des traductions subjectives dues à une expression pluridimensionnelle du patrimoine culturel liée à nos facultés à la fois mentales et tangibles, son rôle dans l’analyse et le projet d’architecture questionne des préoccupations d’ordre éthique. Quelle approche patrimoniale est donc mieux adaptée aux enjeux du contexte, aussi changeant soit-il ?
comprenDre les enjeux Du contexte
10/30
À cette question, l’importance du patrimoine architectural en tant qu’héritage du passé agit véritablement sur notre présent au moyen de son existence physique parmi les ‘scènes urbaines’ actuelles. La raison de son existence est aussi primordiale car elle porte avant tout le poids du souvenir transmis d’une génération à l’autre. Il est probable qu'il en ait été de même lors de l’édification du bâti, à l’époque précédent l’instant où on le fut nommé ‘monument’. On imagine d’ailleurs les contraintes qui furent autrefois présentés à l’entreprise de sa construction quant aux enjeux du contexte spatial visé. Henri Lefebvre admet dans La Production de l’espace (1974, pp.15-32) que “ Rien ni personne ne peut éviter l’épreuve de l’espace […] Plus et mieux : un groupe, une classe ou fraction de classe, ne se constituent et ne se reconnaissent comme ‘sujets’ qu’en engendrant (produisant) un espace”.
thÉories De la conservation
Ces arguments repris, complétés, appliqués par l’Empereur et le baron Hausmann signent la modernisation de la capitale. Cependant une dialectique entre ancien et moderne divisera les consciences. Le ‘triptyque’ des théories à l’égard du patrimoine qui confronte les pensées élogieuses de Viollet-leDuc, Ruskin et Boito justifie enfin les enjeux du contexte.
“ Si tu veux créer quelque chose de nouveau, cherche ce qui est ancien. ” - Aulis Blomstedt (1957).
comprenDre les enjeux Du contexte
Après avoir révélé l’importance de l’observation scénique et du respect des constructions futures envers leur héritage, le chemin alléguant le contexte amène à questionner spécifiquement la notion de continuité, sans négliger encore le devoir de l’ajustement. En effet, le patrimoine bâti se soumet comme toutes entités aux lois de l’existence, rendant impossible toute condition naturelle infiniment immuable. L’oubli et l’altérable sont probablement les risques les plus récurrents entendus lors de l’enseignement autour de la transformation de l’existant. Les solutions pour y pallier s’organisent au dépend de plusieurs partis-pris. Deux choix s’offrent d’ores et déjà à l’intervenant : considérer ou faire fit du contexte. Face à un tel dilemme, pourrait-on hypothétiquement décontextualiser le monument sans qu’il n’en perde sa valeur patrimoniale ? La dialectique entre ancien et moderne peut-elle être sauvegardée ? Afin d’appréhender véritablement les enjeux du contexte pour le patrimoine, il faut pouvoir l’en priver.
Si l’environnement étudié ne peut être ignoré ou détourné, les enjeux administrés à l’emprise du bâti se dotent d’une notion prépondérante : l’ajustement.
comprenDre les enjeux Du contexte
Ceux-ci jouent un rôle crucial en tant qu’inventaires des monuments, répertoires et aides mémoires aux émulations architecturales. Aussi nécessaires pour le patrimoine, ils garantissent en outre le témoignage de l’évolution du travail des artistes et des savants. Cependant la deuxième moitié du XIXème siècle raréfie la démarche artistique par le dessin, remplacée au fil du temps par la démarche scientifique de la photographie. De nos jours, il ne paraît plus concevable de découvrir un site, visiter un lieu sans avoir le réflexe de figer le souvenir d’y être allé, en le stockant ensuite le plus souvent dans des disques dont la capacité de stockage est curieusement nommée ‘mémoire’. La photographie a finalement entamée la perte de confiance progressive que l’on pouvait accorder à une image mentale racontée ou esquissée.
l’impact De la photoGraphie
La photographie apparaît alors comme cette autre matière qui appelle aux manifestations passées. Le bâtiment isolé n’est plus inenvisageable. Il existe parce que la société a su décontextualiser l’objet au moyen de la capture d'une scène à jamais figée dans le temps. Françoise Choay décrit cette invention dans l’allégorie du patrimoine (2007) comme un tournant crucial pour la considération d’un édifice historique. Car au-delà de la photographie – une preuve inébranlable de l’expérience du vécu – existait auparavant les écrits, les dessins, et dans le cas des plus brillantes : écrits et dessins rassemblés en un carnet de voyage. On peux citer les exemples les plus stupéfiant tels que les observations voisinant les inventions de Léonard de Vinci, ou encore les carnets d'Eugène Delacroix, Louis-Pierre Baltard, Le Corbusier, Jacques Hittorff, Viollet-le-Duc, Victor Hugo, Lajoüe et bien d'autres.
Extraits de mon carnet de voyage, Porto, Portugal.
12/30
comprenDre les enjeux Du contexte
comprenDre les enjeux Du contexte
Figure 3 (à gauche): Typologies, Les lumières de Paris, vers 1870, Paris, photo Charles Marville.
plus signe que métamorphosés en images, en répliques, sans poids, dans lesquelles se rassemble leur valeur utilitaire. Toute construction, quelle que soit sa destination, peut être promue monument par les nouvelles techniques de ‘communication’. ’’ - Françoise Choay, l’allégorie du patrimoine, (2007) pp.18-19
Ces retranscriptions du réel bâti sont dotées d’une sensibilité dont certes le contexte n’est plus que parole, maîtrise de l’appareil ou du pinceau, mais cette poésie subjective n’est-elle pas la preuve irréfutable de l’importance du patrimoine ?
À ces mots, nous avons pu constater que la ville ancienne - faisant contexte - et son architecture peuvent être reconnues ou non comme une projection littéraire, conceptuelle ou donc photographique de preuves patrimoniales. Celles-ci fonctionnent en fait comme un recueil contrecarrant les symptômes de la dissolution matérielle ou mnésique.
‘‘architectural.Ilsnefont
14/30
‘‘ L’architecte a une responsabilité effrayante, il ne peut construire sans détruire.’’- Eric Rohmer (1994).
Ce qui paraît être ci-contre le résultat d’un recueil photographique capable de stimuler la mémoire, ressemble toutefois à un travail catalogueur autour des typologies. La compilation ainsi faite présente deux volontés secondaires. La première consiste à rassembler les éléments en amont de leur disparition absolue afin de n’en oublier ni les formes ni la catégorie à laquelle ils appartiennent. La deuxième logique concerne plutôt une méthode profitable en aval, née de la révolution industrielle. La standardisation procréée au XIXème siècle permet alors de reproduire à l’infini un objet à l’identique à partir d’une norme de référence. Le résultat amène cependant à reconsidérer l’authenticité de l’objet originel, jusqu’à questionner son application globale dans l’ordre patrimonial. Pourtant, certaines actions menées au profit du patrimoine, utilisent le recueil photographique comme une trace essentielle à la constitution de familles typologiques , chronologiques ou stylistiques. L’expression plastique et l’exercice du projet on permis de comprendre ce double usage, l’une à l’échelle échantillonnaire et l’autre à l’échelle
comprenDre les enjeux Du contexte
Figures 4, 5, 6 (de gauche à droite): Les centrales CPDE de Paris, receuil typologique réalisé durant le projet L3 surélévation.
Dessin en élévation de l’ancien transformateur EDF - CPDE de Paris 19ème,rue Armand Carel. Projet L3 surélévation.
Parmi ces divers enseignements, on retiendra notamment les actes de spolia, de tabula-rasa, d’hybridation, de désertification (…) qui ne semblent pas accorder d’importance à une quelconque considération patrimoniale. La matière seule subsiste comme support d’interprétation.
comprenDre les enjeux Du contexte 16/30
hyBriDation
L’exercice du recueil photographique démontre le rôle du contexte reconnu comme le berceau d’un édifice architectural. Cette vision métaphorique, analogique à la vie de l’homme, intervient à l’instar d'une synthèse entre voyages, lectures et apprentissage théorique et pratique de l’architecture. L’analogie ainsi faite émerge peu à peu, dès lors que l’on parvient à comprendre les préceptes architecturaux dans un univers sensible et singulier. À cette métaphore, l’histoire et le temps lieront l’existant et son nouveau-né jusqu’à formuler un récit où les deux deviendront interdépendants. Malgré l’impression d’un développement logique et stable, l’acte de l’extraction du bâti à sa terre-mère peut être à tout moment envisagé sous diverses éventualités. Que ce soit par la destruction, la dissimulation, le déplacement, la photographie, ou la muséification, ces modes opératoires que l’on a pris soin d’étudier en cursus de licence, posent la question de respect accordé à la continuité patrimoniale. Quels sont finalement les éléments prioritaires à la conservation ?
‘‘ Nous avons pris acte que la ville ancienne est morte comme processus de transformation. Il ne se produit plus selon ses propres processus de conception, formation, création ; mais a survécu comme matière aujourd’hui différente de nos normes actuelles.’’ - Alexandre Gady (2010)
spolia
taBula rasa
le concept nomaDe Du patrimoine
le concept nomaDe Du patrimoine
18/30
En effet, l’analogie de la naissance d’un édifice à celle de l’Homme démontre les influences qui existent au départ de notre terre natale. Le rapport au contexte, à l’adaptabilité et à la continuité est encore très présent. Il nous amène à transposer ces notions vers le réel, dans la mesure où l’apprentissage théorique devient le support de compréhension de tout ce qui nous entoure. À partir de cette base pédagogique, les décisions prises quant aux intervention patrimoniales, deviennent davantage intelligibles. Nous faisons en parallèle ces mêmes choix : rester et honorer d’une part les traditions d’une ville et d’une communauté ou d’une autre part, se détacher voire transposer nos habitudes vers un nouveau territoire. Par ailleurs, la dernière solution suggère de s’approprier un nouveau sentiment d’appartenance à un lieu. Mais est-on capable de renier complètement nos origines ? Le patrimoine participe pourtant à l’identité d’un contexte réel, il faut donc pouvoir s'en acclimater si l’on veut prétendre à s’intégrer au sein d’un environnement choisi.
Arbre sacré signalant l’entrée d’un village indigène amazonien, exposition visitée au MAXXI, 2022, Rome, Sebastião Salgado.
Tout ce qui régit le contexte mais qui ne peut être entièrement évoqué dans cette introspection, converge à un moment donné vers l’attention anthropologique. Il est difficile de ne pas parler d’émotions, de sentiment et de quelque histoire personnelle lorsque que l’on mentionne l’architecture dans sa dimension patrimoniale. Ces éléments moins tangibles favorisent pourtant la continuité entre le bâtiment et les circonstances locales. C’est grâce à cette optique et l’attention portée au contexte patrimonial, qu’il est possible dès à présent d’opérer un glissement de l’apprentissage à majorité théorique vers une appropriation de plus en plus personnelle et praticable. Apprécier enfin les discernements entre chaque notion constitue un réel atout dans la découverte et la redécouverte concrète des territoires.
Notre corps garde automatiquement une mémoire plus ou moins lucide des évènements passés, des lieux visités, et de tout ce qui a pu marquer nos sens. Par exemple, il m’est impossible d’effacer mes souvenirs passés, parce qu’ils ont façonnés à tour de rôle la personne que je suis maintenant. Les bons comme les mauvais moments construisent notre personnalité. La plupart des édifices ont subi ces deux ambiances respectives. Si l’on se consacre aux analyses purement esthétiques de l’homme et du bâti, le constat produit révèle encore des analogies plus précises. Par la simple lecture du corps (humain ou bâti), les cicatrices peuvent être en apparence jugées comme un défaut à masquer. Cependant je ne considérerai jamais mes propres cicatrices comme tel. C’est pourquoi il est important de comprendre la mémoire d’un patrimoine pour comprendre le patrimoine. Ces cicatrices riches et belles d’histoires, ne demandent selon moi, à être ni oubliées ni valorisées.
corps anthropien et corps Bâti
“ Monument du latin monumentum, issu du verbe monere (se souvenir). On appellera monument tout artefact ou ensemble d’artefacts délibérément conçus et réalisés par une communauté humaine, quelle qu’en soient la nature et les dimensions, afin de rappeler à la mémoire vivante, organique et affective de ses membres, des personnes, des évènements, des croyances, des rites ou des règles sociales constitutifs de son identité ” Françoise Choay, le patrimoine en question , in Esprit, 2009/11 novembre, pp.194-222.
Figure 7 (droite) : Philippe Vasset, Une vie en l’air, couverture du livre, 2018, Librairie Arthème Fayard.
le concept nomaDe Du patrimoine
Figure (grande) : Photographie des rails de l’aérotrain, 2021, Chevilly (45).
Du lieu oriGinaire D’un intÉrêt
Figure 8 (à gauche): Aérotrain Jean Bertin, 1970, Chevilly (45). / Figure 9 (à droite): Projet SpaceTrain, 2018, Chevilly (45).
Ce qui devait n’être qu’une piste d’essai en 1970, n’est dorénavant plus du tout dissociable du contexte qui l’entoure. Son statut a changé, tout comme la Tour Eiffel à Paris, destinée à une existence éphémère, devenue paradoxalement le symbole hautement célèbre de la capitale nationale. Cette longue ligne droite de 18km placée au milieu d’une étendue dépourvue de relief se garde d’être un signe perturbateur. L’invention de l’aérotrain, “train sur coussin d’air” devait “remplacer la notion du temps par celle du temps de transport” (Christelle Didier, ‘‘ L’aérotrain ou la tragédie de Jean Bertin ’’, 1998). Perturbant visuellement pour d’autres, mais mentalement pour ma part, ce vestige d’ingénierie donne lieu à une réflexion contingente : Et si le projet final de Jean Bertin avait pu être réalisé ?
le concept nomaDe Du patrimoine
Je me souviens de quelques questions, celles que l’on posaient à un parent : “ À quoi ça sert ? Pourquoi les gens dessinent dessus ? Si elles ne sont plus utiles, pourquoi nous les gardons ? ”. Avec la prise de recul des années passées, ces réflexions ne semblent plus si innocentes qu’elles le laissent supposer de la part d’un enfant.
Situées au nord d’Orléans dans le territoire de mon enfance, des rails peu banales s’érigent en plein cœur du paysage beauceron. Elles m’apparaissait avant tout comme le symbole d'une frontière entre la commune et ses lieux-dits.
« C’est au-delà, l’ensemble du tissus urbain qui se recompose et modifie le paysage au point d’ôter à la notion de ville l’idée de la frontière que, depuis le geste de Romulus traçant le sillon circulaire à l’intérieur duquel devait s’édifier Rome, nous associons presque nécessairement à l’idée d’espace urbain. » - Marc Augé, Pour une anthropologie des mondes contemporains (1994) p.165
20/30
Depuis la connaissance des dilemmes de l’intervention sur l’existant, évoqués par Camillo Boito et par nombre de passionnés aux questions de la conservation, je n’imagine plus mon paysage natal soustrait de ces rails de béton en forme de T inversé. Parce qu’ils supportaient autrefois l’invention d’un transport révolutionnaire, qui aurait considérablement modifié l’articulation entre métropoles et grandes villes de proximité.
Ma première expérience en stage a admis une phase conceptuelle, davantage plastique, dans le but de questionner la conservation des rails de l’aérotrain Saran-Ruan. Relier un édifice à un environnement identitaire témoigne une fois de plus l’importance du patrimoine dans sa fonction mémorielle. On peut encore rappeler la définition que donne Françoise Choay pour une construction élevée au rang de monument. L’exercice montre par ailleurs les potentialités d’une reconversion qui aurait pu a un moment rendre hommage à l’histoire d’un génie trop en avance sur son époque. Ces reconsidérations deviennent en somme toute pertinentes, notamment pour les monuments disparus que l’on regrette encore à travers leur photographie. Les Halles Baltard sont malheureusement inscrites à cette liste, comme bien d’autres monuments historiques.
Figure 12 : Photographie intérieure des anciennes Halles, issue de l’émission ‘‘Laissez-vous guider’’ animée par Lorànt Deutsch et Stéphane Bern, France 2.
Figure 13 : Photographie aérienne du chantier de la Canopée des Halles, 2012-2016, Paris, Ingérop.
Figure 11 : Photographie aérienne du Chantier des Halles, 1973, Paris, Archives de Paris.
Figure 10 : Photographie aérienne des anciennes Halles de Baltard, 1956, Paris, magazine LIFE, Thomas McAvoy
le concept nomaDe Du patrimoine
Nous pouvons donc dire que les rails de l’aérotrain n’ont pris ni la voie de la destruction, ni celle de la magnificence. Voici sans doute la définition propre de l’architecture vacante : une manifestation matérielle laissée comme telle qui n’est pas encore parvenu à l’engendrement de la ruine. Cet aérotrain qui devait relier Orléans-Paris en 20min est mis en hommage sous diverses manières : exposition, reconsidération d’un projet, urbex, association, film etc. Mais il est surtout devenu un support d’expression politique et artistique.
L’aboutissement de trois années de licence permet en outre de faire le bilan des expériences effectuées lors des stages. Là encore, les projets qui sollicitaient une attention patrimoniale m’ont plus intrigué. Le stage de chantier effectué auprès de Nicolas Chevalier m’a offert l’opportunité de visiter l’Hôtel de France et de Guise installé face au Château Royal de Blois, monument historique classé depuis 1845. Les discussions entre le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage ont fait l’objet d’une réflexion méticuleuse autour du projet de rénovation intégrale du bâti. Étant donné la proximité avec ce véritable chef d’œuvre de l’histoire des châteaux de la Loire, les contraintes esthétiques et matérielles devaient être scrupuleusement respectées.
Figure 15 et 16 (ci-dessous) : Photographies intérieurs de l’Hôtel de France et de Guise après restauration, Blois.
Plan R+1 visité, Hôtel de France et de Guise avant restauration, 2018, Blois.
22/30
vers l’influence De l’ ailleurs
le concept nomaDe Du patrimoine
Figure 14 : Photographie extérieure de l’Hôtel de France et de Guise après restauration, Blois.
le concept nomaDe Du patrimoine
« La tâche de l’architecture est de s’intégrer dans ce qui existe, d’introduire de nouveaux éléments d’emphase et dépasser l’environnement premier. » « Formuler un continuum, pas une copie. » - Oswald Mathias Ungers
Ma première participation à l'élaboration du permis de construire, réalisé avec le soutient de mon maître de stage de première pratique Nicolas Salaün, a consisté au montage de l’avant-projet d’une habitation en secteur historique. J’ai pu enfin aborder les étapes suivant le respect des contraintes demandées par les ABF (Architectes des Bâtiments de France), y compris la loi sur les 500m (rayon de 500m autour du monument). Cette loi est d’ailleurs citée au cours d'une conférence soutenue par Alexandre Gady, historien et professeur d’histoire de l'art à l’école de Chaillot. Instauré en 1943, ce nouveau périmètre va alors sortir le monument de son isolement dit “splendide”. L’histoire, la législation, la technique et les différents domaines liés à la mise en valeur et la conservation du patrimoine sont devenus progressivement sources d’intérêt pour la suite de mes études. Ma mission en tant qu’assistant architecte a donc été fortement marqué par ce programme de surélévation, et de réagencement complet des plans existants.
> Plan Coupe AA EDL échelle 100 Les présents plans sont exclusivement destinés demande de Permis de Construire sont des plans exécution indicatif et elles sont vérifier les entreprises propriété reproductions > Indice > PC12 RUE DES MEUNIERS -0.02 +12,07 +5,28 +9,36 +9,00 LIMITE PARCELLAIRE Cuisine R 1 ±0,00 42 44 COUPE AA EXISTANT 04 17 > Plan Coupe AA Projet échelle 100 Les présents plans sont exclusivement destinés demande de Permis de Construire sont pas des plans exécution ne indicatif et elles sont vérifier par les entreprises propriété reproductions interdites Ce document peut être utilisé > Indice > PC12 RUE DES MEUNIERS -0.02 +6,36 +9,16 +12,07 +9,00 0,70 2,99 +8,67 LIMITE PARCELLAIRE Cuisine WC Escaliers R+1 Combles SdB Escaliers R 2 ±0,00 42 44 COUPE AA PROJET 05 17 > Plan Façades Sud Existant et Projet échelle 100 Les présents plans sont exclusivement destinés demande de Permis Construire Ils sont des plans exécution peuvent être directement utilisés réaliser construction Les côtes sont données titre indicatif elles sont vérifier les entreprises propriété propriété artistique communiqué personnel reproductions peut pour usage que pour lequel communiqué > Indice > PC 12 RUE DES MEUNIERS PITHIVIERS 11 MARS 2021 +12,07 ±0,00 +3,00 petits châssis 78 55 verrière 250 Ardoises créées dito existant 78 55 78 55 147 250 78 55 LIMITE PARCELLAIRE LIMITE PARCELLAIRE +12,07 +7,59 ±0,00 Conservationt volets teinte gris RAL 7016 Ardoises existantes conservées LIMITE PARCELLAIRE LIMITE PARCELLAIRE FACADE SUD PROJET 1 FACADE100 SUD EXISTANT 1 100 07 17 Réhabilitation d’une habitation en secteur historique à Pithiviers, extraits du rapport de stage de première pratique, 2022.
Photographies du voyage à Rome, Italie, février 2022.
Autrement dit, cette phase d’exploration permet de dépasser les visions types ‘carte postale’ et favorise par conséquent l’appréciation du patrimoine bâti et paysager. Il ne suffit pas de voir des images d’un édifice pour prétendre le connaître entièrement, l’expérience du vécu est nécessaire pour la compréhension de son environnement, son échelle, ses détails, ses ambiances lumineuses...
24/30
le concept nomaDe Du patrimoine
Ma formation à la licence d’architecture a été sans équivoque renforcée par les découvertes extérieures. L’ENSAPVS valorise d’ailleurs le voyage dans le cadre de courts séjours. Il s’agit d'un exercice à part entière conférant un tout autre enrichissement pédagogique. Malgré l’annulation de ces quelques jours d'excursion à Milan prévues initialement au printemps 2020, j’ai réalisé cette année mon grand souhait de découvrir la ville de Rome. Les voyages que j’ai pu faire jusqu’à présent ont tous fait l’objet d’un enrichissement personnel, ouvrant la voie à de nouveaux regards. C’est à partir des expériences annexes à l’enseignement académique que chaque étudiant se démarque au fur et à mesure au profit d’une approche architecturale singulière. Sa manière de penser et de dessiner le projet peut tout à fait être influencée par ces autres connaissances acquises hors les murs de l’École.
Enfin, on citera à travers ce dernier propos les évènements imprévisibles que le voyage peut nous offrir : les escales imprévues, les échanges entre deux cultures, ou encore les discussions entre passionnés, professionnels ou médiateurs.
Le moment de la découverte architecturale n’est donc pas moins celle d’une rencontre entre les différents acteurs du patrimoine, c’est à dire celle d’un enrichissement social. Comment participer alors à un projet sollicitant l’artisanat d’art sans en avoir étudié de plus près les spécificités intrinsèques ? Le cursus de licence a été véritablement une matière complémentaire lors des visites d’une architecture régionale, d’une histoire étrangère qui s’est parfois déployée en France, ou de monuments emblématiques de quelques récits connus.
Les journées européennes du patrimoine permettent à cette occasion de rencontrer l’architecture, son histoire et tout les éléments conjoints. Ces portes ouvertes m’ont par ailleurs encouragées en 2020 à redécouvrir ma ville d’origine et ses secrets d’histoire dévoilés par les habitants. L’édition précédente était consacrée à la découverte de l’agence Canal Architecture présentée par Patrick Rubin, un choix qui n’avait pas son hasard puisque qu’il rend compte des dialogues possibles en rapport au “ construire réversible ”.
Figure 17 : Découverte des métiers de bâtisseurs (4 visites en 7ans), Chantier médiéval de Guédelon, Bourgogne.
le concept nomaDe Du patrimoine
conclusion
Finalement, l’enseignement, les expériences professionnelles, et les voyages interviennent de manière complémentaires, l’un enrichissant l’autre. Cette mouvance réalise d’autre part le constat que l’édifice influence un contexte autant que l’espace lui est déterminant. Les échelles du monument et de l’urbain demandent alors à être perpétuellement examinés afin qu’ils puissent toujours s’intégrer au cadre de vie contemporain.
Tournage de “ Laissez-vous guider ” avec Stéphane Bern et Lorànt Deutsch, avril 2022, Château du Clos Lucé, Amboise.
Si les prises de conscience patrimoniales soulèvent autant de questionnements qu’elles en élucident, nous pouvons alors nous convaincre du pouvoir circulaire d’un héritage bâti. Le monument historique a en effet prouvé à plusieurs reprises son utilité dans l’exercice actuel de l’architecture. Malgré la disparition physique de quelques grandes constructions, la démarche patrimoniale matérielle ou immatérielle se charge de perpétuer son souvenir. L’importance du contexte au monument historique est enfin éclairé grâce à de multiples sources culturelles. De même, le grand nombre d’ouvrages de nos bibliothèques, la notion de patrimoine au cœur de débats fondamentaux, la médiatisation, deviennent des éléments essentiels à l’analyse et à la conciliation entre l’intervention moderne et l’existant.
26/30
CHOAY, Françoise, Le patrimoine en questions, Esprit, vol. , no.11, 2009, pp.194-222.
articles :
livres :
CHOAY Françoise, L’allégorie du patrimoine, Paris, Éditions du seuil, 2007.
COSTA Heloïsa Helena, « Préserver le patrimoine urbain : pourquoi, pour qui, comment ? Introduction. », in Culture & Musées, no.11, 2008, pp.113-115.
DIDIER Christelle, « L’aérotrain ou la tragédie de Jean Bertin », in DIDIER Christelle, GIREAUXGENEAU Annie, HÉRIARD DUBREUIL Bertrand, Éthique Industrielle, textes pour un débat, DeBoeck Université, 1998, p.323-337.
Brochures :
Acte des colloques de la direction du patrimoine, De l’utilité du patrimoine, Paris, La documentation française, 1992.
BARRÈS Renaud, essai d’une théorie de restauration active du patrimoine moderne et contemporain, Montpellier, Éditions de l’Espérou, 2000.
Acte du colloque régional 15-16 septembre 2014, Rénover, Réutiliser, Reconvertir le patrimoine, Paris, Somogy éditions d’art, 2015.
BENSARD Eva, FLOUQUET Sophie, Notre patrimoine de proximité, un héritage à reconquérir, Paris, Dexia Éditions, 2004.
Á LVARE z M ORA , Alfonso. « Le concept de patrimoine bâti, alibi des modèles urbains soumis à la rente foncière en Europe », Espaces et sociétés, vol. 152-153, no. 1-2, 2013, p.28.
AUGÉ Marc, Pour une anthropologie des mondes contemporains, Paris, Flammarion, 2010.
DARMON Olivier, Habiter les ruines, transformer, réinventer, Gallimard, 2016.
sites internet :
confÉrence :
GADY Alexandre, La ville ancienne dans la ville moderne : contrainte ou opportunité ?, Paris, Cité de l’architecture et du patrimoine, L’École de Chaillot en partenariat avec la MAF (mutuelle des architectes français), les cours publics 2009-2010, jeudi 6 mai 2010.
28/30
INSTITUT DE FRANCE, Léonard de Vinci. Les carnets de l’Institut, Paris, 2020.
BiBlioGraphie
Source : https://www.ingerop.fr/fr/activite/la-canopee-des-halles
Source : https://www.lantenne.com/La-start-up-SpaceTrain-met-sur-les-rails-un-nouveau-projet-dFigureaerotrain_a41425.html10:
Source : https://www.fayard.fr/litterature-francaise/une-vie-en-lair-9782213710099
Figure 2 : Percement de l’avenue de l’Opéra et boulevard Henri IV, vers 1870, Paris, Charles Marville. p.9 Source : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b1200033h/f1.item
Photographie aérienne des anciennes Halles de Baltard, 1956, Paris, magazine LIFE, Thomas McAvoy. p.21
Figure 8 : Aérotrain Jean Bertin, Chevilly, 1970. p.20
Figures 4,5,6 : Les centrales CPDE de Paris, Paris. p.15
Figure 9 : La navette de © SpaceTrain, 2018, Saran-Ruan . p.20
Source : conservation-du-patrimoine/https://archives.paris.fr/r/231/le-demenagement-des-halles-amenagement-oppositions-et-
Figure 1 : Ecole nationale supérieure de Paris Val de Seine, 2017, Paris, Frédéric Borel. p.8 Source : https://frederic-borel-architecte.com/fr/equipements/projet/val-de-seine
Figure 12 : Photographie intérieure des anciennes Halles, issue de l’émission “laissez-vous guider” animée par Lorànt Deutsch et Stéphane Bern, France 2. p.21
Figure 7 : VASSET Philippe, Une vie en l’air, 2018, Librairie Arthème Fayard. p.19
Source : https://www.laboiteverte.fr/lumieres-de-paris-1870-charles-marville/
Source : https://www.unjourdeplusaparis.com/paris-reportage/photos-halles-paris
Figure 13 : Photographie aérienne de la Canopée des Halles, 20212-2016, Paris, Ingérop. p.21
iconoGraphie :
Figure 3 : Les lumières de Paris en 1970 par Charles Marvill, vers 1870, Paris, Charles Marville. p.13
Source : https://www.ville-rail-transports.com/aerotrain-jean-bertin/
Figure 11 : Photographie aérienne du Chantier des Halles, 1973, Paris, Archives de Paris, 1514W99. p.21
Source : Comission du Vieux Paris. Compte-rendu de la séance du 27 octobre 2009. Textes et photos DHAAP.
Source : http://www.paris-autrement.paris/les-halles-du-ventre-de-paris-a-la-canopee/
Figure 14 : Photographie extérieure de l’Hôtel de France et de Guise après restauration, Blois, p.22
Source : https://www.hotel-france-guise.com/fr/hotel-a-blois-en-centre-ville
iconoGraphie 30/30
Source : https://www.hotel-france-guise.com/fr/hotel-a-blois-en-centre-ville
Figure 15 : Photographie d’une chambre de l’Hôtel de France et de Guise après restauration, Blois, p.22
Source : https://www.hotel-france-guise.com/fr/hotel-a-blois-en-centre-ville
Source : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gu%C3%A9delon_2017.jpg?uselang=fr
Figure 17 : Chantier médiéval du Château de Guédelon, 2017, Yonne, Bourgogne, p.25
Figure 16 : Photographie du hall d’entrée de l’Hôtel de France et de Guise après restauration, Blois, p.22