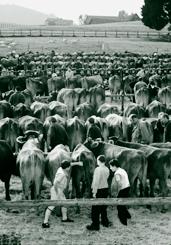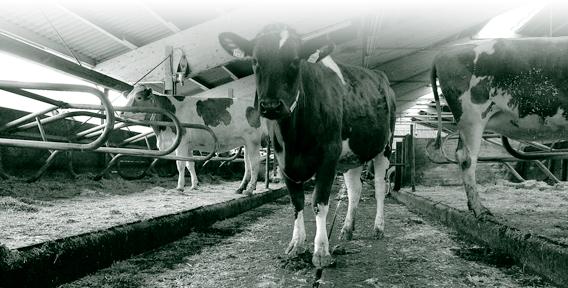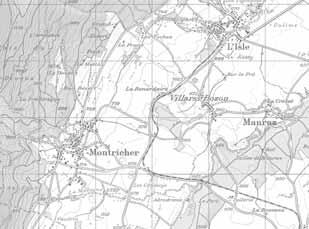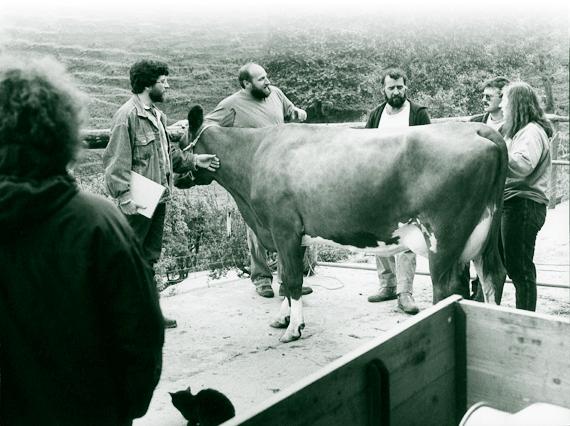1.1 Economie
Pour pouvoir fournir les prestations que l’on attend d’elle, l’agriculture doit disposer d’une base économique suffisante. La présentation des incidences économiques de la politique agricole constitue de ce fait une partie importante du rapport. Elle fournit notamment des informations sur les résultats économiques des exploitations agricoles, l’évolution des structures, les interactions avec les autres secteurs de l’économie ainsi que sur les conditions prédominant sur les différents marchés.
Ensuite on présente la place économique de l’agriculture en tant que pan de l’économie nationale, on fournit des informations sur la production, la consommation, le commerce extérieur, les prix à la production et à la consommation sur les différents marchés, de même que sur la situation économique des exploitations individuelles et du secteur dans son ensemble.

■■■■■■■■■■■■■■■■■
9 1.1 ECONOMIE 1
■ Exploitations
1.1.1 L’agriculture, partie intégrante de l’économie
Evolutions structurelles
L’analyse des structures dans l’agriculture se concentre sur le nombre d’exploitations et leur taille ainsi que sur le nombre de personnes qu’elles emploient. Les paragraphes qui suivent donnent des indications sur les changements intervenus concernant ces deux caractéristiques structurelles.
Durant la décennie 1990 à 2000, la réduction du nombre des exploitations était due pour moitié au recul des mini-exploitations d’une superficie ne dépassant pas 3 ha. Les exploitations de 3 à 20 ha ont également été en nette diminution. En revanche, celles supérieures à 20 ha ont vu leur nombre s’accroître. Pendant la dernière décennie, l’augmentation la plus importante, en chiffres absolus, est celle du nombre d’exploitations appartenant à la classe de grandeur 30–50 ha (+2’210).
Au cours de la période quinquennale 2000 à 2007, le taux de diminution annuel a nettement faibli par rapport aux années nonante pour les très petites exploitations, alors qu’il a légèrement progressé pour les exploitations de 3 à 10 ha et de 10 à 20 ha. Durant la même période, les exploitations de 20 à 25 ha ont été par contre en légère diminution, ce qui est nouveau. En ce qui concerne le seuil de croissance, il a progressé, passant de 20 à 25 ha. Cela signifie que, depuis 2000, le nombre d’exploitations ne dépassant pas 25 ha a diminué et le nombre de celles comptant plus de 25 ha a augmenté. Pendant ces sept années, la diminution la plus importante, en chiffres absolus, est celle du nombre d’exploitations appartenant à la classe de grandeur 3–10 ha (–4’000).

■■■■■■■■■■■■■■■■■
10 1.1 ECONOMIE 1
Tableau 1, page A2
Evolution du nombre d’exploitations, par classe de grandeur et par région
L’évolution du nombre d’exploitations par région entre 1990 et 2000 montre, en chiffres absolus, une baisse plus forte en plaine (environ 10’000) que dans la région des collines (5’500) et celle de montagne (6’500). Mais en termes relatifs, le taux de diminution annuel a été le plus élevé dans la région de montagne. Depuis l’an 2000, on constate une baisse du taux de diminution dans toutes les régions, par comparaison avec les années nonante.
Evolution du nombre d’exploitations à plein temps et à temps partiel, par région
ParamètreNombre d’exploitationsVariation annuelle en %
Exploitations à plein temps
Région de plaine30 13923 53620 947–2,4–1,7 Région des collines17 45213 79312 620–2,3–1,3
Région de montagne16 65111 91011 467–3,3–0,5
Total64 24249 23945 034–2,6–1,3
Exploitations à temps partiel
Région de plaine11 4518 0766 490–3,4–3,1
Région des collines7 0895 1644 341–3,1–2,4
Région de montagne10 0338 0585 899–2,2–4,4
Total28 57321 29816 730–2,9–3,4
Source: OFS
ParamètreNombre d’exploitationsVariation annuelle en % 1990200020071990–20002000–2007 Classe de grandeur 0–3 ha19 8198 3716 577–8,3–3,4 3–10 ha27 09218 54214 148–3,7–3,8 10–20 ha31 63024 98420 876–2,3–2,5 20–25 ha6 6777 2446 9610,8–0,6 25–30 ha3 3644 4304 7342,81,0 30–50 ha3 5495 7596 7515,02,3 >50 ha6841 2071 7175,85,2 Région Région de plaine41 59031 61227 437–2,7–2,0 Région des collines24 54118 95716 961–2,5–1,6 Région de montagne26 68419 96817 366–2,9–2,0 Total92 81570 53761 764–2,7–1,9 Source: OFS
1990200020071990–20002000–2007
1. RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 1.1 ECONOMIE 11 1
Entre 2000 et 2007, le recul des exploitations à plein temps a été dans toutes les régions nettement plus faible que durant les années nonante. Il a été le plus bas (0,5% par an) dans les régions de montagne. Les exploitations à temps partiel ont subi une évolution contraire. Leur taux de recul est passé de 2,9 à 3,4%. Dans l’ensemble, entre 2000 et 2007, le nombre d’exploitations à plein temps a baissé d’environ 4’200 et celui des exploitations à temps partiel, de plus de 4’500.
La diminution du nombre d’exploitations agricoles a pour corollaire la réduction du nombre de personnes occupées dans l’agriculture.
Evolution de la main- d’œuvre
Dans les années nonante, le nombre des personnes actives dans l’agriculture a diminué de près de 50’000. La réduction a concerné exclusivement la main-d’œuvre familiale, alors que la main-d’œuvre non familiale a, en revanche, légèrement augmenté durant cette période.
Depuis l’année 2000, le nombre de personnes exerçant une activité dans l’agriculture a encore baissé (–30’000 personnes). A la différence des années nonante toutefois, cette diminution a aussi concerné la main-d’œuvre non familiale. Au total, le taux de recul a été légèrement plus élevé après l’an 2000 que pendant la décennie précédente. Il s’est élevé à 2,3%, ce qui représente 0,4% de plus que le taux de recul concernant les exploitations. C’est le contraire de ce qui s’est produit entre 1990 et 2000, où les exploitations ont diminué de 2,7% par année, et la main d’œuvre, de 2,2% seulement.
ParamètreMain-d’œuvreVariation annuelle en % 1990200020071990–20002000–2007 Main-d’œuvre familiale217 477165 977142 657–2,7–2,1 dont: chefs d’exploit.88 88974 72458 766–1,7–3,4 cheffes d’exploit.3 9262 3462 998–5,03,6 Main-d’œuvre non familiale36 08437 81630 3340,5–3,1 Total253 561203 793172 991–2,2–2,3 Source: OFS
■ Main-d’œuvre
1.1 ECONOMIE 1 12
Tableau 2, page A3
■ Valeur ajoutée brute
Paramètres économiques
Pendant l’exercice sous revue, l’économie suisse a réalisé une valeur ajoutée brute de 482,1 milliards de francs, soit une augmentation de 5,2% par rapport à l’année précédente. La part revenant au secteur primaire, dont les deux tiers au moins proviennent de l’agriculture, est restée faible (1,2%).
Evolution de la valeur ajoutée brute dans les trois secteurs économiques Indications en prix courants
Secteur20052006 1 2007 1 Part Variation 20072005/07 en mio. de fr.en %en %
dont l’agriculture
■ Commerce extérieur
L’année sous revue peut être qualifiée d’excellente pour le commerce extérieur suisse. Les importations, d’un montant de 193,1 milliards de francs, et les exportations, d’un montant de 206 milliards de francs, ont atteint de nouveaux records. Cela équivaut à une augmentation de respectivement 9% et 11,2% par rapport à 2006. La balance commerciale 2007 s’est clôturée par un excédent d’exportation de 13 milliards de francs. On avait par contre enregistré en 2000 un excédent d’importation de 3 milliards de francs.
Le commerce de produits agricoles a également augmenté. Par rapport à l’année précédente, les importations (11,3 milliards de francs) ont augmenté de 1,2 milliard de francs; les exportations (6,5 milliards de francs), ont augmenté du même montant.
Pour les produits agricoles, la balance commerciale 2007 s’est clôturée par un excédent d’importation de 4,8 milliards de francs, alors que cet excédent était de 5 milliards en 2000. La balance commerciale s’est donc améliorée de 0,2 milliard de francs. Durant l’exercice écoulé, 76,1% des importations agricoles (8,6 milliards de francs) provenaient de l’UE. 70,8% des exportations agricoles, représentant une valeur totale de 4,6 milliards de francs, étaient destinées à l’UE. Pour les produits agricoles, la balance commerciale 2007 avec l’UE s’est soldée par un excédent d’importation de 4 milliards de francs. En 2000, cet excédent d’importation était de 3,7 milliards de francs. La balance commerciale s’est détériorée de 0,3 milliard de francs.
8463
secondaire118 324 126 758 134 951
Secteur tertiaire312 067 325 954 341 511 70,89,4 Total435 870 458 153482 069 100,010,6 1 provisoire Source: OFS
Secteur primaire5 478 5 4415 6071,22,4
selon les CEA4 083 3
9170,8–4,1 Secteur
28,014,1
1. RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 1.1 ECONOMIE 1 13
En termes de valeurs, durant l’exercice écoulé, la Suisse a importé des produits agricoles principalement de France, mais aussi d’Allemagne et d’Italie. Presque deux tiers de l’ensemble des importations depuis l’UE provenaient de ces trois pays. En 2000, déjà, la situation n’était guère différente. En 2007, une bonne moitié des exportations vers l’UE, en termes de valeurs, était destinée à l’Allemagne, à la France et à l’Italie. En 2000, il s’agissait d’environ 60%.
La balance commerciale 2007 avec les pays de l’UE environnants s’est soldée par des excédents d’importation. Comparativement à 2000, l’excédent d’importation avec l’Allemagne a fortement augmenté. Avec l’Italie et les Pays-Bas, il a augmenté faiblement à moyennement. L’excédent d’importation avec la France, l’Autriche et l’Espagne a légèrement diminué. Avec les autres pays membres de l’UE, la balance commerciale suisse 2007 s’est soldée par un excédent d’exportation.

20002001200220032004200520062007 2000–07 en milliards de fr.en % Importations globales 139,4141,9130,2129,7138,8157,6177,1193,0 38,5 Produits agricoles8,58,68,58,98,99,410,111,332,9 dont de l’UE 15-25-27 1 6,06,26,36,76,97,17,88,643,3 dont de l’UE 27 2 6,26,46,67,06,97,17,88,638,7 Exportations globales 136,0138,5136,5135,4147,4166,0185,2206,0 51,5 Produits agricoles3,53,63,53,64,04,45,36,585,7 dont de l’UE 15-25-27 1 2,32,42,32,52,83,13,74,6100,0 dont de l’UE 27 2 2,42,52,52,62,83,13,74,691,7
Source:
1 2000-2003: UE15-25-27: 2004: UE15; 2005: UE 25; à partir de 2006: UE 27 2 UE 27: tous les pays actuellement membres de l’UE
DGD
14 1.1 ECONOMIE 1
Commerce extérieur de produits agricoles avec l'UE 2000/2007
Importations et exportations de produits agricoles et produits transformés par catégorie de produits 2000/2007
2000
Source: DGD Allemagne France Italie Autriche Espagne Pays-Bas autres pays EU15
autres pays EU27
754 976 1 240 1 929 388 1 588 699 1 870 263 1 267 430 1 751 160 233 320 351 61 479 254 590 133 747 367 1 059 552 714 1 263 1 073 2 000 2 500 1 5001 5002 000 1 000500 0 en mio. de fr. 5001 000 Importations 2000 Excédent d'importations ou d'exportations 2000 Exportations 2000 Importations 2007 Excédent d'importations ou d'exportations 2007 Exportations 2007
Source: DGD Tabac et divers
laitiers
alimentaires
d'agrément
pour animaux, déchets Céréales et préparations
graisses et huiles Plantes vivantes, fleurs Légumes Fruits Boissons Produits animaux, poissons 712 474 743 435 537 318 660 571 819 813 1 384 1 251 599 761 1 505 1 326 158 315 262 398 413 597 642 1 017 43 346 76 544 3 545 4 628 5 553 5 662 5 854 13 1 042 191 1 433 1 075 1 813 54 1 407 102 1 640 2 000 2 500 1 5001 5002 000 1 000500 5001 000 Importations
Excédent d'importations
d'exportations
Exportations
Importations 2007 Excédent d'importations ou d'exportations 2007 Exportations 2007 0 en mio. de fr. 15 1.1 ECONOMIE 1 1. RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE
(2000)
(2007)
Produits
Préparations
Produits
Aliments
Oléagineux,
2000
ou
2000
La Suisse est grande importatrice de denrées alimentaires. Elle a, durant le dernier exercice, importé surtout des boissons, des produits d’origine animale (poissons compris), des produits d’agrément (café, thé, épices), ainsi que des préparations alimentaires. La situation était déjà similaire en 2000. Les importations de boissons concernent le vin, à raison d’environ 64%, les spiritueux, à raison d’environ 10%, et les eaux minérales, à raison d’environ 10%. De toutes les importations figurant dans la catégorie «produits animaux», 40% environ peuvent être attribués au secteur de la viande, 30% au secteur des poissons et les 30% restants au secteur des préparations à base de viande et des conserves de viande.
En 2007, les produits d’agrément et les préparations alimentaires figuraient en tête des exportations, suivis par les boissons, les produits de la catégorie «tabac et divers» et les produits laitiers. Dans la catégorie «produits d’agrément» ont principalement été exportés du café (570 millions de francs) ainsi que du chocolat et d’autres préparations alimentaires contenant du cacao (774 millions de francs). La majeure partie des denrées alimentaires exportées concernait les préparations alimentaires, les extraits de café, les soupes et les sauces. Ces postes ont nettement augmenté en comparaison avec l’année 2000.
La balance commerciale par catégorie de produits montre en 2007 un excédent d’importation, surtout pour les produits d’origine animale, poisson compris, (–1’538 millions de francs) et les fruits (–1’029 millions de francs). L’excédent d’importation est moins élevé pour les boissons (–738 millions de francs). Par rapport à l’année 2000, on constate une nette réduction de l’excédent d’importation (504 millions de francs), en premier lieu pour les boissons.
Pour les produits de la catégorie «tabacs et divers», les produits laitiers, les produits d’agrément et les préparations alimentaires, on est parvenu en 2007 à des excédents d’exportation. Comparativement à 2000, les produits de la catégorie «tabacs et divers», les produits d’agrément et les préparations alimentaires ont augmenté, alors que l’excédent d’exportation pour les produits laitiers a baissé de 45 millions de francs (89 millions de francs).
■
d’autosuffisance Evolution du taux d'autosuffisance 199519961997199819992000200120022003200520042006 Part des calories exprimée en % Denrées alimentaires d'origine animale Total denrées alimentaires Denrées alimentaires végétales Source: USP 0 100 80 60 40 20 16 1.1 ECONOMIE 1
Taux
Selon la Constitution, l’agriculture suisse est chargée de fournir une contribution substantielle pour garantir l’approvisionnement de la population en denrées alimentaires. Par degré d’autosuffisance, on entend la part de la production indigène à la consommation totale du pays.
La production animale est le pilier principal de l’agriculture suisse, ce qui explique le taux d’autosuffisance plutôt élevé dans ce domaine. En 2006, la part indigène de produits d’origine animale s’est élevée à 93%, diminuant ainsi de 1% par rapport à 2005. Pour les produits d’origine végétale, cette part (40%) a baissé de 3%. Dans l’ensemble, en 2006, le degré d’autosuffisance, situé à 57%, a été de 3% inférieur à celui de l’année 2005. En comparaison à long terme, une légère tendance à la baisse se dessine.
19551960196519701975198019851990200019952005
Si l’on considère la production indigène (mesurée en calories) sur les cinquante dernières années, on constate qu’elle a pratiquement doublé. Cet accroissement considérable de la production a permis de maintenir le taux d’autosuffisance presque au même niveau, alors que, pendant la même période, la population a augmenté d’environ 50%. Depuis 1990, la production indigène totale a encore pu être augmentée de 6%. Alors que la production végétale a augmenté de 20% au cours des 15 dernières années, la production animale a baissé d’environ 5%.
L’indice des prix à la production a fortement baissé pour les produits agricoles entre 1990 et 2002. Après une légère augmentation durant l’année de sécheresse 2003 et le printemps 2004, l’indice a de nouveau affiché une tendance à la baisse. Après le creux de 2005, il a quelque peu augmenté au cours des deux dernières années (2006: 74,8 points d’indice; 2007: 75 points d’indice). Cela s’explique par la robustesse du marché du gros bétail et par l’augmentation du prix des produits maraîchers.
Tableau 13, page A13
■ Evolution de l’indice des prix
Evolution de la production indigène
Térajoules Total denrées alimentaires Denrées alimentaires d'origine animale Denrées alimentaires végétales Source: USP 0 25000 20000 15000 10000 5000 17 1.1 ECONOMIE 1. RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 1
Indice (1990/92 = 100)
Par rapport à l’indice des prix à la production, l’indice suisse des prix à la consommation n’a cessé d’augmenter pour le sous-groupe «denrées alimentaires et boissons» jusqu’en 2004. Depuis, il est resté presque stable, même si l’indice des prix à l’importation de denrées alimentaires a augmenté de 5% pendant ce temps. Pendant l’année sous revue, l’indice était de 111,3 points, et celui des prix à l’importation de denrées alimentaires, de 108,1 points.
Evolution de l'indice des prix à la production, à la consommation et à l'importation de denrées alimentaires ainsi que de l'indice des prix des moyens de production agricoles
Indice des prix des moyens de production agricole 1
Indice suisse des prix à la consommation, sous-groupe denrées alimentaires et boissons non alcoolisées
Indice des prix à la production, agriculture
Indice des prix à l'importation de denrées alimentaires 2
1 Base mai 1997 = 100. Le nouvel index porte à 100% sur des moyens de production. Dans l'ancien (base 1976), les facteurs de production travail et capital étaient inclus dans l'indice total avec un poids de 25%. Le poids des moyens de production était donc de 75%.
2 Base mai 2003 = 100. Pour cet indice, les données portant sur une période antérieure ne sont pas disponibles. Jusqu'en avril 2003, l'indice des prix à l'importation relatif au groupe «Denrées alimentaires» ne comprenait que les sous-groupes «Viande», «Autres denrées alimentaires» et «Boissons». Depuis la révision de mai 2003, d'autres sous-groupes ont été pris en compte. Ainsi, l'indice couvre désormais une part plus importante des denrées alimentaires importées.
Sources OFS, USP
Après une forte hausse au début des années nonante, l’indice des prix des moyens de production agricole a fléchi régulièrement et de façon continue jusqu’en 1999. Il a ensuite légèrement augmenté jusqu’en 2003, puis de façon plus prononcée jusqu’en 2006. Le taux de l’indice est ainsi un peu plus élevé qu’au début des années nonante. Durant l’année sous revue, l’indice des prix des moyens de production agricole a progressé de 1 point par rapport à 2006, passant à 107,4 points. L’indice peut être réparti entre les moyens de production d’origine agricole (semences, aliments pour animaux) et les autres moyens de production. L’indice partiel des moyens de production d’origine agricole a baissé dans l’intervalle précité; celui des autres moyens de production a augmenté.
70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 19901992 19931994199519961997199819992000200120032007 20042006 2005 2002 1.1 ECONOMIE 1 18
Dépenses de la Confédération
Le nouveau modèle comptable de la Confédération (NMC) a été introduit en 2007. Dans la présentation des comptes, le changement de système a notamment entraîné des modifications dans les dépenses par domaine d’activité. Elles ne peuvent donc plus être comparées avec celles des années précédentes.
Les dépenses totales de la Confédération se sont élevées à 53’965 milliards de francs en 2007. Cela correspond à une augmentation d’environ 1,6 milliard de francs, soit 3%, par rapport à l’année 2006. 3’601 millions ont été consacrés à l’agriculture et à l’alimentation, soit environ 44 millions de francs (1,2%) de moins qu’en 2006. Elles se situent en sixième position après la prévoyance sociale (16’945 millions de fr.), les finances et les impôts (9’753 millions de fr.), les transports (7’349 millions de fr.), la recherche et la formation (4’978 millions de fr.) et la défense nationale (4’327 millions de fr.).
La part de l’agriculture et de l’alimentation aux dépenses totales de la Confédération s’est élevée à 6,7% en 2007. Les deux années qui ont précédé, elle était de 7%.

■ Dépenses pour l’agriculture et l’alimentation Evolution des dépenses de la Confédération pour l'agriculture et l'alimentation 2004200520062007 en mio. de fr. en % chiffres absolus (mio. de fr.) en % des dépenses totales Source: Compte d'Etat 0 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0,0 1,0 10,0 8,0 9,0 6,0 7,0 4,0 5,0 2,0 3,0 3 7503 6083 6453 601 1.1 ECONOMIE 19 1
Les dépenses consacrées à la production et aux ventes ont également diminué pendant l’exercice écoulé. Elles ont diminué de 58 millions de francs par rapport à 2006.
Evolution des dépenses de la Confédération pour l’agriculture et l’alimentation Domaine2004200520062007
Remarque: L’introduction, en 2007, du nouveau modèle comptable de la Confédération (NMC), a entraîné un changement de système dans la présentation des comptes de la Confédération. En raison de cette rupture dans la structure, il n’est plus possible d’établir des comparaisons annuelles.
Source: Compte d’Etat
Pendant l’exercice écoulé, 40 millions de francs de plus qu’en 2006 ont été dépensés au titre des paiements directs. Cette augmentation est surtout imputable à une participation accrue aux programmes éthologiques facultatifs et aux reports de paiement de l’exercice comptable 2006.
Durant la période sous revue, les dépenses faites dans le domaine de l’amélioration des bases de production sont redescendues au niveau de 2005, après un pic en 2006 (dépenses supplémentaires en raison des intempéries 2005).
en mio. de
Production et ventes731677606548 Paiements directs2 4982 4642 5532 596
des bases de production202178201175 Autres dépenses319289285282 Total agriculture et alimentation3 7503 6083 6453 601
fr.
Amélioration
Tableau 51, page A58 1.1 ECONOMIE 1 20
L’année 2007 a été en partie marquée par des conditions météorologiques extrêmes. Une fin d’hiver douce et caractérisée par un manque de précipitations ainsi qu’un mois d’avril sec, suivis d’un printemps et d’un été très pluvieux ont conduit à un bilan très contrasté dans le domaine de la production végétale (44% de la valeur de la production totale). Selon le mode de production et la région, les rendements ont été très différents. La production animale (47% de la valeur de la production totale), en revanche, a dans l’ensemble profité des bonnes conditions de vente. Le reste de la production, comprenant les prestations de services agricoles (travaux spécialisés dans les domaines de la culture des champs et de l’élevage) et les activités accessoires non agricoles, est dans l’ensemble resté pratiquement inchangé (9% de la valeur de la production totale). La valeur de la production de l’ensemble du secteur a été de 10,6 milliards de francs.
Activités accessoires non agricoles 3%
Lait 21%
Bovins 12%
maraîchères et
9%
Volaille, œufs 4% Autres produits animaux 1%
La production de denrées alimentaires (produits animaux et produits végétaux) a augmenté de 7,0% par rapport à 2006, à savoir de 2,1% pour la production animale (104 mio. de fr.) et de 12,8% pour la production végétale (532 mio. de fr.). La forte augmentation en production végétale s’explique par une amélioration des rendements par rapport à 2006, notamment pour ce qui est des plantes fourragères.

■■■■■■■■■■■■■■■■■
1.1.2 Marchés
du secteur agricole en 2007
Ventilation
Porcs
Fruits
5%
Cultures
horticulture
Prestations de services agricoles
Source: OFS Autres
13%
6% Vin 4% Pommes de terre, betteraves sucrières 3% Céréales 4% Plantes fourragères 13%
produits végétaux 2%
1.1 ECONOMIE 21 1
Tableau 14, page A14
■ Production: les livraisons de lait à leur plus haut niveau

Lait et produits laitiers
Par rapport à l’année précédente, les livraisons de lait ont augmenté de 1,7% au cours de l’année sous revue. On constate une hausse dans la vente de lait et de produits laitiers ainsi qu’une augmentation de la production en ce qui concerne le fromage, le beurre, la poudre de lait et la crème en 2007. La tendance à la baisse en ce qui concerne les prix à la production du lait s’est confirmée.
Par rapport à l’année précédente, la production laitière totale a augmenté de 60’700 t pour passer à environ 4,02 millions de t, dont quelque 757’100 t ont servi à l’autoapprovisionnement ou à l’alimentation des animaux dans l’exploitation. Les livraisons de lait, y compris celles de lait en provenance de la zone franche de Genève et de la Principauté de Liechtenstein, se sont élevées à 3,26 millions de tonnes pendant l’année écoulée, ce qui représente une augmentation de près de 55’000 t. Pour l’année laitière 2007, le nombre de vaches moyen a été estimé à 692’000.
par mois en 2006 et 2007
Livraisons
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre par 1 000 t Livraisons de lait 2006 Livraisons de lait 2007 Source: TSM 220 230 250 240 270 260 280 290 300 310 320
de lait
1.1 ECONOMIE 1 22
Tableaux 3–12, pages A4–A12
Au cours de l’année écoulée, la quantité de lait livrée et commercialisée s’est élevée à 3,233 millions de tonnes (sans le lait en provenance de la zone franche de Genève ni de la Principauté de Liechtenstein). Elle a été transformée comme suit:
en fromage:1,427 mio de t(+1,71%) en beurre:0,452 mio de t(–2,59%) en lait de consommation: 0,447 mio de t(–0,67%) en crème:0,261 mio de t(+3,98%) en d’autres produits laitiers:0,646 mio de t(+5,73%)
La quantité totale de fromage produit a augmenté de 1,9% entre 2006 et 2007, pour s’établir à 176’279 t. C’est la production de fromage de chèvre et de brebis qui a enregistré proportionnellement la plus grande augmentation (+7,3%, pour atteindre les 995 t). Pour les fromages à pâte mi-dure, la hausse est de 5,2%, soit une quantité totale de 52’158 t; pour les fromages à pâte molle, de 2% (6’909 t) et pour le fromage frais, de 2% (41’382 t). Dans le domaine des fromages frais, il convient de souligner la forte progression de la production de mozzarella qui affiche une quantité totale de 16’191 t (+4,7%). Comme toujours, la majeure partie du fromage produit est du fromage à pâte dure (42%). La production pour l’année écoulée se monte à 74’836 t, ce qui représente une baisse de 0,4% par rapport à 2006.
La production de produits laitiers frais est demeurée stable par rapport à 2005 et 2006 (environ 750’000 t). La quantité de lait acidulé et des produits à base de lait acidulé a atteint, en 2007, 7’494 t, ce qui représente une hausse de 33,9% par rapport à 2006. La production de boissons à base de lait a progressé de 0,8% entre 2006 et 2007, pour atteindre 65’668 t, tandis que celle de yoghourt est demeurée stable.
Au cours de l’année écoulée, la production de crème a connu une nouvelle augmentation; cette dernière se monte à 2’362 t, soit 3,6% de plus que l’année précédente. Le beurre et la graisse butyrique ont également enregistré une hausse de leur production de 6,4%, pour atteindre 43’474 t, au même titre que la poudre de lait, qui s’élève à 50’834 t au cours de l’année écoulée (+5,1%).
1990/92 200520062007 par 1 000 t de lait Autres produits laitiers Crème Beurre Sources: TSM, USP Fromage Lait de consommation 0 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 ■ Transformation: production de fromage en hausse 1. RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 1.1 ECONOMIE 23 1
Transformation du lait commercialisé
■ Commerce extérieur: balance commerciale positive
La balance du commerce extérieur pour 2007 montre que la Suisse exporte davantage de fromage, de poudre de lait et de crème qu’elle n’en importe. Pour ce qui est des yoghourts et du beurre, les importations ont dépassé la quantité exportée.
Par rapport à l’année précédente, les exportations de fromage, y compris le séré, ont progressé d’environ 7% pour atteindre 54’321 t. Quant aux importations de fromage, elles se sont élevées à 37’329 t, ce qui représente une hausse de 11%. Comme c’était déjà le cas l’année précédente, les importations de yoghourts ont augmenté de façon considérable (+71%), pour atteindre 6’674 t. Pour ce qui est de la poudre de lait, on constate un recul aussi bien dans le domaine des exportations (–44,3%) que dans celui des importations (–21,6%).
Le 1er juin 2007, l’accord sur le fromage conclu dans le cadre des négociations bilatérales I entre la Suisse et l’UE est entré en vigueur après une période transitoire de cinq ans au cours de laquelle les entraves tarifaires au commerce ont progressivement été démantelées. Avec cette libéralisation complète du commerce du fromage, tous les droits de douane, les restrictions d’accès au marché et les subventions à l’exportation ont été supprimés. Depuis cette date, le commerce entre la Suisse et l’UE se fait sans droits de douane ni limitations de quantité pour toutes les sortes de fromages.
Immédiatement après la période transitoire de cinq ans entre 2002 et 2007, les échanges commerciaux entre la Suisse et l’UE ont sensiblement augmenté dans le domaine du fromage. Suite à la libéralisation totale du commerce du fromage, les exportations de fromage entre juin 2007 et mai 2008 ont considérablement augmenté par rapport à l’année qui a directement précédé la période transitoire de cinq ans (de juin 2001 à mai 2002), puisqu’elles sont passées de 5’244 t à 56’703 t. Les importations de fromage ont fortement progressé pendant cette période, passant de 7’859 t à 39’629 t. Les importations supplémentaires ont facilement pu être écoulées sur le marché suisse, étant donné que la consommation annuelle par habitant a augmenté de 2,3 à 20,7 kg entre 2001 et 2007.
C’est le fromage frais qui a connu la plus grande expansion au cours de la libéralisation du commerce du fromage entre la Suisse et l’UE; en effet, les exportations dans ce domaine sont passées d’environ 55 t à environ 1’733 t entre juin 2001 – mai 2002 et juin 2007 – mai 2008. Pour ce qui est du fromage à pâte molle, les exportations en direction de l’UE ont, en outre, pratiquement quintuplé. Les exportations de fromage à pâte dure ont, par contre, baissé d’environ 6’800 t. Pendant les périodes de référence mentionnées, les importations de fromage frais et de fromage à pâte mi-dure ont respectivement progressé de 47,9% et de 41,1%; il s’agit là des hausses les plus importantes.
1.1 ECONOMIE 1 24
■ Consommation de fromage en hausse
La consommation de lait et de produits laitiers par habitant est en légère progression. En 2007, la consommation de yoghourt et de beurre a respectivement augmenté de 1,1% et de 1,8%. Celle de séré, quant à elle, est restée stable.
Evolution de la consommation par habitant
La consommation de fromage par habitant a connu une hausse de 3,7% par rapport à l’année précédente. La consommation de fromages à pâte molle et à pâte dure a, quant à elle, enregistré une hausse de respectivement 5,6% et 8,9%. Pour le fromage frais, la hausse s’est montée à 2% et pour le fromage à pâte mi-dure, à 1,8%.
Au cours de l’année écoulée, la consommation de lait a connu un recul de 1,5% par rapport à 2006 et se situe à 77,7 kg. La vente de boissons à base de lait est demeurée, pour 2007, à 8,5 kg par habitant.

1990/92 200520062007 kg par habitant Fromage Yoghourts
Beurre Séré 0,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 14,0 16,0 18,0 20,0 1. RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 1.1 ECONOMIE 25 1
Source: USP
■ Prix à la production: baisse du prix du lait
Le prix moyen à la production pour le lait s’est élevé à 70.04 ct./kg pour 2007, ce qui représente une baisse de 1.79 centimes par rapport à l’année précédente. Au début de l’année 2007, le prix à la production pour le lait a été soumis à une certaine pression du fait de la réduction des aides destinées au soutien du prix du lait. La situation favorable que connaissait le marché du lait a été suivie – vers la fin 2007 – par la perspective d’une hausse des prix dès 2008. Les producteurs suisses de lait n’ont, toutefois, pu bénéficier de la hausse internationale des prix intervenue début 2007 sur le marché du lait qu’avec un certain retard.
Prix du lait en 2007, pour toute la Suisse et selon les régions 1
Ct./kgCHRégion IRégion IIRégion IIIRégion IVRégion V
Total70.0470.4570.1769.5169.8370.10
Lait industriel68.8068.8869.2968.3368.3966.46

Lait transformé en fromage70.6673.3169.7269.5970.2974.95
Par rapport à 2006, les différences régionales concernant le lait industriel et le lait transformé en fromage se sont légèrement estompées en 2007. La différence de prix entre régions a atteint 2.83 ct./kg pour le lait industriel et jusqu’à 5.36 ct. pour le lait transformé en fromage. En ce qui concerne les prix à la production pour le lait biologique, la différence régionale est passée de 4.93 ct./kg à 2.6 ct. en comparaison avec l’année précédente. En moyenne, le prix à la production pour le lait biologique était plus bas qu’une année auparavant, puisqu’il s’élevait à 78.31 ct./kg (–1.93 ct., soit –2,41%). En comparaison avec le lait industriel, le lait biologique a été vendu en moyenne 9.51 ct./kg de plus en 2007.
■ Prix à la consommation: nouveau recul
Les prix à la consommation pour le lait et pratiquement tous les produits laitiers ont connu un nouveau recul en 2007. Pour 1 kg de fromage Emmental surchoix, le consommateur a payé 19.04 frs en moyenne, ce qui représente une baisse de 17 ct. par rapport à 2006. Quant au Gruyère surchoix, il s’est vendu, en 2007, à 19.94 frs le kilo en moyenne. La baisse des prix à la consommation a aussi touché la crème de consommation et les yoghourts, en particulier la crème entière (conditionnée, ½ l) qui s’est vendue 34 centimes de moins, soit à 3.63 frs.
Lait biologique78.3180.4178.2878.1677.81 Non recensé
1Région I: Suisse romande; Région II: Berne, Suisse centrale; Région III: Suisse du Nord-Ouest; Région IV: Zurich/Suisse orientale; Région V: Suisse méridionaleSource: OFAG
26 1.1 ECONOMIE 1
Indices des prix à la consommation pour le lait et les produits laitiers
■
La marge brute totale pour le lait et les produits laitiers a atteint en avril 2007 son plus haut niveau, pour ne cesser de baisser ensuite jusqu’au mois d’octobre, puis finalement remonter légèrement en novembre et décembre 2007.
Evolution de la marge brute 2007
La marge brute pour le yoghourt a atteint en mars son plus bas niveau, ce qui s’explique par les ventes promotionnelles menées par deux distributeurs. En juin, prenait fin une vente promotionnelle de beurre de choix du mois précédent chez un grand distributeur; c’est la raison pour laquelle la marge brute pour le beurre a atteint son plus haut niveau. Le recul de la marge brute pour le beurre qui a suivi – entre juin et octobre – est dû à un renchérissement du prix de la matière première.
tendance à la baisse
Marge du marché:
Indice (déc. 2005 = 100) 94 98 96 100 102 104 106 2003200420052007 2006 Lait Fromage Beurre Source: OFS Crème Autres produits laitiers
Indice (2000 = 100) Lait et produits laitiers Fromage Beurre Yoghourts Source : OFAG 60 65 70 75 80 85 90 105 100 95 110 115 120 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 1. RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 1.1 ECONOMIE 27 1
Animaux et produits d’origine animale
La consommation de viande en 2007 a augmenté de 1,2%, grâce surtout à la bonne conjoncture et à la diminution de l’acuité de la problématique des épizooties (grippe aviaire et ESB). Cette consommation, qui n’avait plus atteint un tel niveau depuis 2002, s’est élevée à 51,95 kg de viande par habitant. Chaque personne a consommé en outre 8,29 kg en moyenne de poisson et de crustacés. Par rapport à l’année précédente, c’est la viande de volaille qui a enregistré la plus forte hausse (16,3%) et la viande de mouton, la plus forte baisse (5,1%).
L’année sous revue, caractérisée par des prix à la production élevés, a de nouveau été une année faste pour les engraisseurs de veaux. Le prix annuel des veaux, de 14,47 francs par kg PM a même été de 0,9% supérieur au prix moyen des années 1990 à 1992. Les prix à la production sur le marché de la viande de bœuf ont également augmenté pour atteindre le niveau de 2001. En ce qui concerne les taureaux et les vaches de la classe commerciale T3, leur prix a atteint en moyenne annuelle 8,73 et 6,77 par kg PM respectivement. L’offre suisse réduite, surtout en viande de vache pour la transformation, a été complétée par environ 16’000 t d’importations. Le marché de la volaille s’est complètement rétabli après la période d’incertitude causée par la grippe aviaire. La production indigène de volaille a été de près de 16% supérieure à celle de 2006.

1.1 ECONOMIE 1 28
Tableaux 3–12, pages A4–A12
■ Production: le cheptel de porcs est en diminution
En 2007, le cheptel bovin a légèrement augmenté (+0,3%); le nombre des exploitations élevant des bovins (43’700) a encore diminué entre-temps de 800 unités supplémentaires. C’est l’effectif des vaches mères qui a le plus augmenté. Il est actuellement de quelque 94’000 têtes. En Suisse, une vache sur sept est une vache mère. Durant les trois dernières années, un nombre à peu près égal de vaches ont été élevées pour la production de lait commercialisé. Le cheptel porcin a baissé de 3,8% pour s’établir à 1,573 mio. de têtes. L’effectif de truies d’élevage a diminué de près de 10’000 têtes pour totaliser actuellement 140’600 animaux. Ces deux évolutions sont le résultat de la baisse des prix sur le marché. L’élevage de chèvres et de chevaux est toujours plus prisé depuis 1990; les effectifs sont en constante augmentation. Par comparaison à 1990, l’élevage de chèvres a augmenté de 25% et celui de chevaux de pas moins de 48%. Le cheptel ovin s’est par contre stabilisé à près de 445’000 têtes au cours des trois dernières années. En raison de la grippe aviaire, les engraisseurs de volaille ont réduit leurs effectifs d’environ 10% en 2006. Pendant l’exercice sous revue, la consommation de viande de volaille a toutefois enregistré de façon imprévue une forte hausse. L’élevage de poulets de chair donc a repris: il dépasse de nouveau 5 millions de têtes. L’effectif de pondeuses s’est par contre abaissé à environ 2 mio. d’animaux. Plus de 50% des moutons et plus de 75% des chèvres sont élevés dans la région de montagne où ils se nourrissent de fourrage grossier. En revanche, 85% des porcs et de la volaille sont gardés dans des porcheries et des poulaillers situés dans la région de plaine. La majeure partie des bovins, de la volaille, des chèvres et des chevaux est élevée dans le canton de Berne. Le canton de Lucerne est celui qui compte le plus important effectif porcin et le canton du Valais celui d’ovins.
Evolution des effectifs
en 1 000en 1 000en 1 000en 1 000%
Bovins1 8581 5551 5671 571–15,81
–vaches dont le lait est commercialisé726568565564–22,09 –vaches traites, dont le lait n’est pas commercialisé515353512,61 –vaches mères14788794516,67
Porcs1 7761 6091 6351 573–9,59
Moutons35544645144425,92
Chèvres6174767925,14
Chevaux3855565848,25
Poulets de chair2 8785 0604 4815 00268,44
Poules pondeuses et poules d’élevage2 7952 1892 1472 030–24,08
Source: OFS
Espèce animale19902005200620071990–2005/07
1.1 ECONOMIE 1. RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 29 1
La production de viande de porc (241’902 t PM) a été pratiquement aussi élevée qu’en 2006. C’est la plus importante du point de vue quantitatif, suivie par celle de viande de bœuf (102’147 t). A l’exception de la viande de volaille, la production de toutes les autres catégories de viande a baissé. Ce sont la viande de cheval (–12,4%) et la viande de mouton (–6,3%) qui ont accusé la baisse la plus marquée. En revanche, le goût des consommateurs pour la volaille suisse s’est traduit par une augmentation de 16,1%, la plus importante production indigène enregistrée (34’579 t poids prêt à la vente) par comparaison aux années précédentes. Cela a permis de repeupler les poulaillers d’engraissement temporairement restés vides. Deux tendances essentielles ont été observées de 1990/92 jusqu’à l’année sous rapport. La production de viande de volaille a augmenté de 67% et celle de viande de porc et de bœuf a baissé de respectivement 9% et 22%. Durant cette même période, la production indigène de viande de cheval a diminué de 34%. Ce recul a été compensé par une augmentation des quantités importées. La production de viande de chèvre est, quant à elle, restée stable.
Les viandes de bœuf et de porc consommées ont été produites en Suisse à raison de respectivement 84,1% et 94,5%. La viande de veau (96%) représente la part la plus importante de production indigène. Par contre, seulement un kilo de viande de cheval sur douze, un kilo de viande de lapin sur cinq et un kilo de viande de volaille, de chèvre et de mouton sur deux sont issus de la production suisse. Durant l’année sous revue, la part indigène de toutes les catégories de viande provenant d’animaux de boucherie, à l’exception de la volaille, s’est montée à 88,8% et celle de la volaille, à 46,5%.
En 2007, la production d’œufs a reculé de 0,9% par rapport à l’année précédente, passant ainsi à 654 millions de pièces. En comparaison de la période 1990/92, elle s’est néanmoins accrue de 2,5%. L’approvisionnement du marché en oeufs suisses a été plutôt serré. C’est pourquoi il y a eu très peu d’œufs en stock en été. Des importations supplémentaires d’œufs en coquille ont donc été nécessaires. Par suite, la part de consommation d’œufs en coquille suisses est tombée à 70,4%. Il s’agit là de la plus faible valeur enregistrée depuis 1996.

Indice (1990/92 = 100) Viande de bœuf Viande de mouton Viande de volaille Sources: Proviande, USP Viande de veau Viande de chèvre Oeufs en coquille 60 70 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 Viande de porc Viande de cheval 1.1 ECONOMIE 1 30
Evolution de la production animale
1990/92200520062007
■ Bien-être des animaux: part des labels dans la production de viande suisse
Les labels sont un élément essentiel de la commercialisation visant des valeur ajoutée dans le domaine de la production de viande. Les programmes de label imposent avant tout des exigences élevées en matière de bien-être des animaux (sorties en plein air, surface nécessaire, etc.). Les programmes sont contrôlés et certifiés par des organes indépendants. La principale exigence imposée pour obtenir le label est souvent de remplir les critères stipulés dans les programmes d’encouragement fédéraux SST et/ou SRPA. La proportion des ventes de viande labellisée de production suisse a été déterminée en 2007 par la Protection Suisse des Animaux dans le cadre d’une enquête menée auprès des principaux détaillants. Près de la moitié de la viande est vendue dans le commerce de détail, tandis que l’autre moitié sert à fournir les restaurants et les cantines. Chez Migros, la proportion de viande labellisée de bœuf, de mouton et de volaille de production suisse se situe à 75%. Chez Coop, la viande labellisée représente 90% pour la volaille, 50% pour le porc et 25% pour le veau. En revanche, chez Volg, Carrefour et Denner, cette proportion est inférieure à 25%. Il ressort de précédentes enquêtes que pour l’ensemble de l’assortiment de viande du commerce de détail alimentaire, la part en termes de valeur s’élève à près de 1,5 milliard de francs (40% du chiffre d’affaires).
■ Commerce extérieur: niveau record d’importations
En 2007, les exportations de viande et de produits à base de viande ont reculé de 171 t pour s’établir à 1’914 t. Plus de 90% des exportations vont vers des pays de l’UE. La viande séchée de bœuf est le principal produit d’exportation, la quasi-totalité des 1’351 t exportées étant destinée à la France et à l’Allemagne. Les exportations de charcuterie ont grimpé de 32% pour atteindre 69 t et celles de viande en conserve et de préparations à base de viande de 102%, pour atteindre 186 t. La majeure partie de ces produits ont été exportés vers l’Allemagne, la France, l’Autriche, le Luxembourg et l’Italie. Le contingent exempt de droits de douane en vigueur depuis 1er janvier 2008, qui a été accordé par l’UE pour 1’900 t de charcuterie, offre des possibilités élargies d’exportations. Au cours de l’exercice sous revue, la valeur commerciale des exportations de viande suisse s’est montée à quelque 40 millions de francs. Elle a ainsi augmenté de 5 millions de francs par rapport à 2006.
En 2007, les entreprises suisses ont importé une quantité record de 119’336 t de viande, de produits à base de viande et d’abats correspondant à une valeur commerciale de 817 millions de francs. 81’600 t (68,4%) provenaient de pays de l’UE, 24’896 t (20,9%) d’Amérique du Sud, 6’935 t (5,8%) d’Océanie et 3’160 t (2,6%) d’Amérique du Nord. Compte tenu du recul de l’offre indigène, les quantités importées ont augmenté de 9,5% par rapport à 2006. Les principaux pays fournisseurs ont été l’Allemagne avec 36’210 t (30,3%), le Brésil avec 23’123 t (19,4%), la France avec 10’486 t (8,8%) et l’Italie avec 9’418 t (7,9%). En volume, la viande de volaille et de bœuf l’emportent, avec des importations de 50’076 t et 15’966 t respectivement. 63’500 t de poisson et de crustacés d’une valeur commerciale de 687 millions de francs ont été importées. Les principaux fournisseurs ont été le Danemark et le Vietnam, avec chacun près de 7’000 t.
1. RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 1.1 ECONOMIE 31 1
En 2007, 44% de la viande de bœuf et de la viande de veau ont été importés du Brésil, ce qui représente une diminution de 19% par rapport à l’année précédente. Suivent l’Allemagne (26%), l’Autriche (6,2%) et les Pays-Bas (4,9%). Le Brésil exporte avant tout des morceaux parés de la cuisse de bœuf, des aloyaux et du High-Quality-Beef. La perte de parts de marché subie par le Brésil est la conséquence de l’augmentation notable des importations de viande de vache en provenance de pays européens.
Les deux tiers de la viande de porc importée proviennent de l’Allemagne et près d’un cinquième de l’Autriche. Avec une part de 89%, l’Australie et la Nouvelle-Zélande sont les plus importants fournisseurs de viande de mouton et d’agneau. Quant à la viande de cheval, elle provient principalement du Canada (46%) et du Mexique (18%). On enregistre un fléchissement des importations en provenance des Etats-Unis qui étaient jusqu’à présent le principal fournisseur de viande de cheval de la Suisse. A la suite du débat politique à propos de l’interdiction d’abattre les chevaux aux Etats-Unis, divers abattoirs chevalins ont été fermés. Avec une part de marché de 34%, le Brésil est le principal fournisseur de viande de volaille. L’Allemagne fournit 21% et la France 12% de la viande de volaille étrangère. Les produits de charcuterie italiens sont toujours autant appréciés dans notre pays; quelque 2’700 t y sont vendues. De plus, environ 1’300 t de viande en conserve et de préparations à base de viande d’origine allemande, française et hongroise sont consommées dans les ménages suisses et dans la restauration.
3’311 ânes et chevaux ont été importés en Suisse en 2007, ce qui correspond à une augmentation de près de 750 animaux par rapport à 2006. Cette augmentation est le résultat du système du fur et à mesure, nouvelle méthode de répartition à la frontière qui a remplacé la mise en adjudication en ce qui concerne le contingent tarifaire des animaux de l’espèce équine. A la suite de cette simplification administrative, quelquesuns des chevaux importés provisoirement avant le 1er janvier 2007 ont été définitivement dédouanés. De nombreuses personnes ont retardé leurs importations de chevaux pour pouvoir bénéficier de dispositions moins strictes. Cette hausse des importations durant l’année sous revue doit donc être considérée comme exceptionnelle. Un cheval importé sur trois provient d’Allemagne et un sur quatre de France. Durant la même période, la Suisse a exporté 2’001 équidés. Grâce à la bonne demande, 1’717 ânes et chevaux ont pu être vendus à l’Allemagne, la France et l’Italie et 284 à d’autres pays. On n’avait jamais plus atteint ce chiffre d’exportation depuis plus de dix ans. 4’453 bœufs et vaches ont pu trouver acquéreur à l’étranger, surtout grâce aux aides à l’exportation. Les producteurs suisses ont acquis 970 animaux d’élevage de l’espèce bovine à l’étranger. La Suisse a exporté respectivement quelque 250 animaux de l’espèce ovine et caprine et 50 animaux de l’espèce porcine. Les importations se sont montées à près de 1’000 animaux de l’espèce porcine, 230 animaux de l’espèce ovine et 30 animaux de l’espèce caprine.
En raison de l’offre restreinte en œufs suisses, l’importation d’œufs en coquille a augmenté de 11,8% pour atteindre 32’329 t. Notre principal fournisseur a été l’Allemagne, suivie par les Pays-Bas et la France. Près de la moitié des œufs en coquille importés sont cassés en Suisse et utilisés en tant qu’ovoproduits dans l’industrie alimentaire et la restauration, l’autre moitié étant vendue dans le commerce de détail. Les exportations suisses se sont limitées à 5 t. De plus, 8’500 t d’ovo-produits liquides ou séchés ainsi que des ovalbumines ont été importés, dont les deux tiers en provenance des Pays-Bas. Les exportations se sont par contre élevées à seulement 38 t.
1.1 ECONOMIE 1 32
Dans le cadre du cycle d’Uruguay de l’OMC, la Suisse s’est engagée à faciliter l’accès au marché d’une quantité de viande déterminée en abaissant les droits de douane perçus sur les contingents. Depuis 1996, le contingent d’importation s’élève en tout à 22’500 t pour les viandes de bœuf, de veau, de mouton, de cheval et de chèvre. La Suisse a rempli chaque année ses engagements. Quant à la viande de porc et de volaille, le volume du contingent tarifaire a passé de 50’020 t en 1996 à 54’500 t en 2000 et s’est stabilisé à ce niveau depuis. En 2007, le contingent tarifaire a été utilisé à 99% (53’770 t). Depuis 1996, le contingent tarifaire d’animaux de l’espèce équine est fixé à 3’322 têtes. Il est utilisé en moyenne à raison de 89%. Durant l’exercice sous revue, il l’a été à plus de 99%.
La consommation de viande, qui s’est élevée à 401’037 t, a progressé de 2,2% par rapport à l’année précédente. La viande de porc (195’750 t) vient en tête, suivie par la viande de bœuf (82’577 t) et par la viande de volaille (74’292 t). La consommation de viande de volaille a augmenté de 17,5%. Celle de viande d’agneau et de viande de veau a par contre reculé de 4,2 et 2,4% respectivement. En outre, les Suisses ont consommé 63’969 t de poisson et de crustacés, dont près de 97% ont été importés de l’étranger.
Pendant l’année écoulée, la consommation par habitant de viande prête à la vente a augmenté de 1,2%, passant à 51,95 kg. Comme depuis plusieurs années déjà, la consommation de viande de porc vient en tête (25,36 kg), suivie par celle de viande de bœuf (10,70 kg) et de viande de volaille (9,62 kg). C’est la consommation par habitant de viande de volaille qui a le plus progressé (+16,3%). Pour toutes les autres catégories de viande, la consommation s’est stabilisée ou a reculé. En queue de peloton viennent la viande de mouton et la viande d’agneau dont la consommation a reculé de respectivement 5,1 et 3,3%. La consommation de viande de cheval n’a pas bougé (0,68 kg par habitant). Les œufs étant revenus au goût du jour, une reprise de la consommation (188 œufs par habitant), qui stagnait depuis des années déjà, a été constatée. La consommation accrue a entraîné une augmentation des quantités importées.

Evolution de
consommation
1990/92 200520062007 Indice (1990/92 = 100) Viande de bœuf Viande de porc Viande de chèvre Sources: Proviande, USP Viande de volaille Viande de veau Viande de mouton 70 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 Viande de cheval Oeufs en coquille 1. RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 1.1 ECONOMIE 33 1
■ Consommation de viande de volaille en hausse
la
de viande et d'œufs par habitant
■ Prix à la production: hausse du prix du bétail de boucherie
Durant l’exercice écoulé, les producteurs de bovins de boucherie ont réalisé de très bons prix. Cette évolution a été favorisée par la stabilité de la demande associée à la faiblesse de l’offre. En ce qui concerne les taureaux et les bœufs de qualité moyenne (classe commerciale T3), le prix du kilo de viande PM franco abattoir s’est établi à respectivement 8,73 fr. et 8,58 fr. en moyenne annuelle. Cela correspond à une hausse d’environ 30 ct. par rapport à l’année précédente et 70 ct. par rapport à 2005. Après une baisse du prix des porcs dans les années 2005 à 2006, le prix à la production est remonté à 4,04 fr. par kg PM «prix départ ferme», principalement en raison de la baisse de la production indigène. Après le creux de l’année 2004, le prix de l’agneau a constamment grimpé à cause du recul de l’offre indigène.
Les prix mensuels moyens à la production évoluent de manière saisonnière pour diverses catégories de viande. La saison des grillades stimule la consommation de viande de porc et les prix atteignent un pic en mai et en juin. L’offre réduite de veaux en automne et en hiver fait que les prix à la production sont les plus élevés à cette période. Avec l’accroissement de l’offre à partir de mars jusqu’en été, les prix baissent de nouveau. Aucune évolution saisonnière des prix de la viande de bœuf et de vache n’a été observée durant l’exercice sous revue. Vu que l’offre indigène est restée très réduite et a dû être constamment complétée par des importations supplémentaires, l’offre plus importante de l’automne n’a pas eu d’effets négatifs sur les prix à la production.
Prix mensuels de bétail de boucherie et de porcs en 2007

Fr./kg PM Veaux cl. commerciale T3 Agneaux cl. commerciale T3 Taureaux cl. commerciale T3 Vaches cl. commerciale T2/3 Porcs charnus, légers Source: USP 3.00 4.00 6.00 5.00 8.00 7.00 9.00 11.00 10.00 13.00 12.00 15.00 14.00 16.00 17.00 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 1.1 ECONOMIE 1 34
■ Hausse des prix à la consommation
La hausse des prix à la production des porcs et des bovins a entraîné une augmentation générale des prix à la consommation. Les consommateurs ont payé l’entrecôte près de 59 francs le kilo et la côtelette de porc près de 20 francs le kilo. Toutes catégories d’animaux confondues, les prix à la consommation ont été plus élevés durant l’exercice sous revue qu’au cours de la période 1990/92, même si certains prix à la production ont considérablement baissé depuis. C’est la viande de veau qui enregistre la hausse la plus marquée du prix à la consommation depuis 1990/92. On observe toutefois que la part réservée aux produits alimentaires et aux boissons non alcoolisées sur les dépenses totales des ménages est en recul depuis plusieurs années. Elle n’était plus que de 7,7% en 2005, date de la dernière année d’enquête.
■ Marge brute réalisée sur la viande
Par rapport à l’année précédente, la marge brute nominale de transformation-distribution réalisée sur la viande de bœuf fraîche a reculé de 3,3%. Les marges concernant la viande de veau et de poulet n’ont en revanche que peu rétréci. La marge concernant la viande d’agneau a même augmenté de 11,4%. Au total, la marge brute sur toutes les catégories de viande (bœuf, veau, porc et agneau), de même que sur les produits à base de viande et produits de charcuterie, a atteint la moyenne annuelle la plus basse qui ait été enregistrée depuis plusieurs années. Elle a été supérieure de quelque 10% à celle de la période de référence (février–avril 1999). Ceci est le signe d’une concurrence accrue. Il est intéressant d’observer l’évolution saisonnière de la marge brute sur la viande de porc. En effet, depuis plusieurs années, celle-ci est au plus bas de sa valeur durant les mois de juillet et d’août. La stimulation des ventes par des baisses de prix durant la période des vacances d’été peut constituer une explication.
Evolution
Indice (février-avril 1999 = 100) Porcs Bœuf Veau Agneau Viande fraîche, produits carnés et charcuterie Source: OFAG 150 155 135 140 145 130 125 120 115 110 105 100 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 1. RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 1.1 ECONOMIE 35 1
des marges brutes sur la viande en 2007
■ Conditions météorologiques: l’été en avril
Production végétale et produits végétaux

L’année 2007 a été extrêmement chaude. La première moitié de l’exercice a été marquée par des températures supérieures à la moyenne. Dans le sud de la Suisse, l’excédent de chaleur était d’environ 2°C. En altitude, il était légèrement plus faible. Les températures étaient estivales au mois d’avril. Les mois de mai et de juin étaient également de 1,5 à 3°C plus chauds que la moyenne pluriannuelle. C’est pourquoi, du mois d’avril jusqu’à l’été, la végétation était en avance de deux à trois semaines. En juillet et en août, les températures se sont normalisées, et le mois d’octobre était même légèrement plus froid que la moyenne pluriannuelle (1961–1990). Sur le plateau, il n’y a eu que deux courtes périodes hivernales avec de la neige (du 24 au 26 janvier et du 19 au 24 mars). L’année sous revue a été riche en précipitations dans la Suisse occidentale. La quantité de pluie, normale à l’Est, a été inférieure à la moyenne dans le Sud et en Engadine. Le mois d’avril a été extrêmement sec; en de nombreux endroits, il n’a pas plu pendant 25 jours d’affilée. Au mois de juillet, de nombreuses précipitations se sont abattues sur la Suisse centrale, alors qu’au Tessin, il est tombé moins de la moitié des quantités habituelles de pluie. Le mois d’août a également été particulièrement pluvieux. Par contre, après un mois de septembre normal, le mois d’octobre a été sec dans de nombreuses régions. L’ensoleillement annuel supérieur à la moyenne est dû avant tout au mois d’avril, qui a été particulièrement radieux. Pendant l’été, les écarts par rapport à la moyenne des heures d’ensoleillement ont été faibles. En août, néanmoins, l’ensoleillement était nettement inférieur à la norme dans certaines régions.
Les violentes précipitations des 8 et 9 août ont constitué un événement météorologique extrême qui a marqué l’année sous revue. En 48 heures, environ 140 mm de pluie sont tombés sur Wädenswil et Zurich. En de nombreux endroits (surtout à Berne et à Bâle), les pluies diluviennes ont conduit à de graves crues.
1.1 ECONOMIE 1 36
■ Production: diminution des superficies cultivées en courges à huile et en soja
Cultures des champs
La surface occupée par les terres ouvertes a diminué de 4’795 ha (2%). La surface de céréales panifiables a légèrement augmenté (2%), alors que celle consacrée à la culture des céréales fourragères a diminué de 12% par rapport à l’année précédente. Les betteraves sucrières (10%), le colza (8%), le maïs d’ensilage et le maïs vert (2%) ainsi que les cultures maraîchères de plein champ (1%) figurent parmi les cultures dont les surfaces ont augmenté au cours de l’année sous revue. Par contre, les surfaces ont diminué en ce qui concerne les courges à huile (–14%), le soja (–11%), les tournesols (–8%), les betteraves fourragères (–5%), les pommes de terre (–2%) et les légumineuses (–1%).
Composition des terres ouvertes 2007 (provisoire)
Total 279 671 ha
Maïs d'ensilage et maïs vert 15% 42 773 ha
Légumes de plein champ 3% 9 254 ha
Colza 7% 18 649 ha
Betteraves sucrières 7% 20 660 ha
Autres cultures 7% 19 018 ha
Céréales 56% 157 572 ha
Pommes de terre 4% 11 745 ha
Source: USP
Les rendements, faibles en 2006, sont remontés, sauf pour l’orge et le colza, qui n’ont pas tout à fait atteint le rendement de l’année précédente (–2%). Le rendement du blé a pu être augmenté de 5% par rapport à l’année précédente et celui des betteraves sucrières, de 12%. Pendant l’année en question, le rendement des pommes de terre, particulièrement faible l’année précédente (324 q/ha), a augmenté de 29%, dépassant les 400 q (417 q/ha) pour la première fois depuis 2000.
Evolution du rendement de produits des champs sélectionnés
Produits (rendements 2007 provisoire)
Blé d'automne (59,4 q/ha)
Pommes de terre (417,0 q/ha)
Colza (30,3 q/ha)
Orge (60,6 q/ha)
Betteraves sucrières (743,4 q/ha)
Source: USP
1990/92199920002001200220052007 2006 20032004
(1990/92
Indice
= 100)
70 140 130 120 110 100 90 80
1. RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 1.1 ECONOMIE 37 1
Tableaux 3–12, pages A4–A12
■ Mise en valeur: germination sur pied observée sur les céréales
La production de céréales panifiables n’a augmenté que de 1% par rapport à l’année précédente; les surfaces de production ont certes augmenté, mais on a noté une légère baisse de rendement. La production de céréales fourragères a pu être maintenue à son niveau malgré une forte réduction des surfaces. Pendant l’année précédente, la production de maïs-grain avait considérablement diminué. Malgré une nouvelle réduction des surfaces, la production a pu à nouveau augmenter (19%) durant l’année sous revue, grâce à un très bon rendement. La production d’avoine a continué à diminuer régulièrement, comme au cours des dernières années (–16%). La production de blé est en moyenne restée constante, mais une observation détaillée montre que la surface affectée à la culture de blé comme céréale panifiable a augmenté de 2% alors que la surface affectée à la culture de blé comme céréale fourragère a diminué de 26% par rapport à l’année précédente.
Les conditions météorologiques du printemps de l’année sous revue promettaient une bonne récolte de céréales. Le temps, humide au mois de juillet, a cependant rendu la récolte des céréales difficile et a donné lieu en de nombreux endroits à un pourcentage élevé de germination. La teneur en sucre des betteraves sucrières, très faible l’année précédente (16,4%), a atteint le taux très élevé de 17,8% pendant l’exercice sous revue. Malgré un temps humide pendant le semis, et sec en avril, la récolte des betteraves sucrières a atteint un niveau normal, avec un rendement moyen de 13,2 tonnes de sucre par hectare. Pendant l’année sous revue, au total 282’754 t de sucre ont été produites. La récolte des pommes de terre a atteint 99’300 t (rendement moyen: 417 q/ha), malgré une surface de culture réduite de 300 ha. Les bonnes conditions météorologiques au printemps ont conduit à un excès de l’offre en pommes de terre Charlotte sur le marché indigène. Bien que la qualité présentée permettait une consommation à l’état frais, de grandes quantités n’ont pas pu être écoulées. C’est la principale raison pour laquelle 116’000 t de pommes de terre ont été utilisées à l’état frais pour l’affouragement des animaux pendant l’exercice sous revue. Malgré les efforts de la branche pour respecter les priorités de mise en valeur, seule une petite quantité de pommes de terre (5’600 t) a été transformée en flocons et en farine. Dans certaines régions, les violents orages qui ont eu lieu peu avant la récolte du colza ont engendré des pertes de récolte importantes. La culture du colza et des tournesols a souffert des mauvaises conditions météorologiques et les rendements à la surface ont été moins élevés que la moyenne. Pour les tournesols, comme l’année précédente, la
Evolution de la production céréalière 1990/92 2005200620071 en 1 000 t Blé Triticale Source: USP 1 provisoire Seigle Avoine Epeautre Maïs-grain Orge 0 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 547 342 211 536 211 181 533 230 152 521 231 199
1.1 ECONOMIE 1 38
■ Commerce extérieur: augmentation du prix des matières premières
quantité cible n’a pas pu être entièrement attribuée. Les contrats conclus par les huileries, qui portaient sur environ 15’000 t, ont dû être revus à la baisse.
En raison de divers facteurs, les prix du marché agricole mondial ont commencé à augmenter dans des proportions imprévisibles pendant le deuxième semestre de l’année sous revue. Parallèlement à l’apparition récente de la spéculation boursière sur les produits agricoles, la demande croissante des pays émergents et des pays en développement, les pertes de récoltes considérables dues à des intempéries et l’utilisation de matières premières agricoles pour la fabrication de carburants biogènes ont influé sur l’évolution des prix. Pour le marché du sucre, en plus des événements advenus sur le marché international, des quantités de sucre bien plus importantes que les années précédentes ont été importées à un taux contingentaire préférentiel déjà pendant le premier semestre 2007. Le prix du sucre en Suisse risquait ainsi de chuter en dessous du prix pratiqué dans l’UE. L’accord de 1972 conclu par la Suisse avec la Communauté économique européenne (CEE) (Protocole n°2), selon lequel le prix du sucre devrait être pratiquement le même en Suisse et en UE («solution double zéro»), était menacé par l’augmentation des importations de sucre bon marché en provenance des pays en développement. Pour ne pas compromettre le Protocole n°2, les droits de douane préférentiels pour les pays en développement ont été suspendus entre le 1er septembre et le 31 décembre 2007. Cette modification ne concernait ni les pays les moins développés (PMD) ni les pays bénéficiant d’un accord bilatéral. Le contingent d’importation pour le sucre blanc en provenance de pays en développement a été arrêté à 10’000 t à partir du 1er janvier 2008 (contingent supplémentaire de 7’000 t pour le sucre brut), afin d’éviter à l’avenir la suppression à court terme des droits de douane préférentiels.
Importations de sucre (27.8.2006–22.2.2008) (lot ≥ 1 t, prix ≤ 80.–/100 kg)
NPF y compris CFG
SGP y compris CFG
PMA 25% y compris CFG
août 2006 oct. 2006 déc. 2006 février 2007 avril 2007 juin 2007 août 2007 oct. 2007 déc. 2007 février 2008 Quantité PeD SGP Quantité PeD NPF Quantité non PeD Sources: OFAG, DGD 0 45 40 35 30 25 20 15 10 5 en 1000 t fr. /100 kg 0 60 45 30 15 1. RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 1.1 ECONOMIE 39 1
■ Prix à la production: augmentation du prix du colza
Le prix des pommes de terre, élevé l’année précédente, a légèrement baissé. Pendant l’exercice écoulé, le prix à la production des pommes de terre est resté très élevé par rapport aux années 2004 et 2005. Le prix à la production moyen des années de référence 1990/92 n’était que de 82 centimes plus élevé.
Pour la première fois depuis 2003, le prix à la production moyen du colza a augmenté pendant l’année considérée. Cette tendance s’explique par l’augmentation du prix des huiles sur le marché mondial pendant le second semestre.
Evolution des prix à la production concernant les produits des champs
■ Prix à la consommation: le prix du sucre reste élevé
à la production 2006 Blé cl. 1, 52.37 fr./q
Le prix moyen du sucre n’a pas substantiellement diminué (–2 ct./kg) depuis sa hausse de l’année passée. La demande en sucre reste élevée sur les marchés mondiaux, surtout en raison de la production d’éthanol utilisé comme carburant. Le prix des pommes de terre a augmenté de 3% par rapport à l’année précédente. Les prix à la consommation de la farine blanche, du pain bis, du pain mi-blanc, des petits pains, des croissants, des spaghetti et de l’huile de tournesol ont fortement diminué en cours d’année, c’est pourquoi ils ne sont plus publiés sous la forme de prix annuels moyens.
1990/92199920002001200220042006 2005 2003 Variation en %
Betteraves sucrières,
Colza,
Prix
11.49 fr./q
75.55 fr./q
Orge, 41.87 fr./q Pommes de terre, 38.07 fr./q –70 0 –10 –20 –30 –40 –50 –60 40 1.1 ECONOMIE 1
Source: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
■ Production: développement dynamique des exploitations de moyenne et grande importance cultivant des légumes sous serre
Cultures spéciales
Une surface de 23’600 ha, soit de 2,2% de la SAU, a été affectée aux cultures pérennes, dont 14’847 ha de vignes, 6’602 ha de cultures fruitières et 302 ha de baies arbustives.
Les surfaces recensées (y compris les cultures successives) par la Centrale suisse de la culture maraîchère et des cultures spéciales (CCM) se sont élevées à 14’400 ha. Les augmentations de surfaces les plus importantes de ces dernières années concernent les asperges vertes et les asperges blanches ainsi que les légumes de transformation que sont les petits pois et les haricots.
En ce qui concerne les surfaces réservées à la culture des fruits, les tendances observées ces dernières années se sont confirmées. La surface affectée aux pommiers a encore diminué de quelques hectares, puisqu’elle est de 4’235 ha. En revanche, les surfaces occupées par les variétés Gala, Braeburn, Topaz et Pinova se sont encore accrues. Au cours des cinq dernières années, la part qu’elles occupent dans les surfaces affectées à la culture des pommes a augmenté de 9%, pour atteindre 28%. La surface de poiriers s’est élevée à 870 ha, en légère baisse par rapport à l’année précédente. Les fruits à noyau sont toujours très appréciés. La surface affectée à leur culture a augmenté de 39 ha par rapport à l’année précédente, atteignant 1’451 ha. Par contre, pour la première fois depuis plusieurs années, la surface affectée aux baies, 709 ha, a diminué de quelques hectares.
La surface viticole totale de la Suisse était de 14’847 ha et a légèrement diminué par rapport à l’année précédente (–38 ha). Cette surface était plantée de cépages blancs sur 6’303 ha (–61 ha) et de cépages rouges sur 8’543 ha (+23 ha). Le recul des plantations de cépages blancs observé au cours de ces dernières années s’est ralenti un peu plus en 2007. Il faut s’attendre à moyen terme à une consolidation de la répartition des cépages au niveau actuel de 43% pour les variétés blanches et 57% pour les variétés rouges.
Cultures maraîchères sous abri avec fondations permanentes 2007
Les cultures maraîchères sous abri avec fondations permanentes se trouvent surtout dans certaines régions de la Suisse centrale, de la vallée du Rhône et du Tessin.
en ha 0,11– 0,50 0,51– 1,00 1,01– 2,00 2,01– 3,00 3,01– 5,00 5,01– 10,07
41 1.1 ECONOMIE 1 1. RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE
Source: OFAG, GG25 ©2008 swisstopo Valeurs par commune
Cultures maraîchères sous abri avec fondations permanentes; évolution des surfaces par classes de taille des exploitations
La surface des serres maraîchères avec fondations permanentes est passée de 100 à 180 ha au cours des huit dernières années (+80%). Le nombre des exploitations possédant plus de 3 ha de serres maraîchères a particulièrement augmenté. En 2007, 11 exploitations appartenaient à cette classe de grandeur; elles comptaient en tout 54 ha. La part des grandes exploitations cultivant sous serre représentait 31% de la surface totale des serres. De plus, ces spécialistes de la culture sous serre ont consacré 385 ha à des cultures maraîchères de plein champ, ce qui représente 5% de la surface consacrée à ce type de culture.
Les récoltes de légumes se sont montées à 311’000 t (sans la transformation) et celles de fruits de table, à 146’000 t. Comparés à la moyenne des quatre dernières années, les rendements obtenus ont progressé de 2% pour les légumes et de 11% pour les fruits.

Les volumes du marché pour les variétés de légumes et de fruits pouvant être cultivés en Suisse ont atteint 522’000 t et 180’000 t, respectivement. Comparé à la moyenne des quatre dernières années, le volume du marché a augmenté de 2% pour les légumes et de 1% pour les fruits. La part des légumes suisses au volume du marché s’est élevée à environ 60% et celle des fruits, à 81%. Elle est supérieure de 1% à la moyenne des années 2003/06 en ce qui concerne les légumes. Pour les fruits, elle dépasse cette moyenne de 8%.
Durant l’année sous revue, la production de vin, 1,040 mio. hl, a de nouveau été inférieure à la moyenne. Ont été produits: 512’292 hl de vin blanc et 528’139 hl de vin rouge. Le volume s’est situé à environ 2,9% de plus que l’année précédente.
199920002001200220032004200520062007 prov. Surface (en ha) >3,01 1,01–3,00 0,11–1,00 Source: OFAG 0 200 150 100 50 42 1.1 ECONOMIE 1
■ Mise en valeur: récolte de fruits à cidre supérieure à la moyenne grâce à une météo idéale
D’après le principe de l’alternance, on s’attendait en 2007 à une récolte de fruits à cidre inférieure à la moyenne. Grâce à une situation idéale pendant la floraison et à des conditions météorologiques optimales pendant le développement des fruits, c’est une récolte supérieure à la moyenne qui a été engrangée, malgré des pertes de production en raison du feu bactérien, qui n’ont pas pu être chiffrées. La quantité de pommes à cidre transformée dans les cidreries s’est élevée à 123’662 t; celle de poires à cidre, à 39’162 t. Dans les limites du contingent tarifaire de fruits à cidre de 172 t par année, 168 t de poires à cidre ont été importées. La récolte a été supérieure –de 15% pour les pommes et de 68% pour les poires –à l’estimation préalable faite par l’USP en août 2007. Comparé à l’approvisionnement ordinaire, à la fin de l’année, le taux de couverture s’est élevé à 163% pour les pommes à cidre et à 166% pour les poires à cidre.
La tendance à la hausse que l’on enregistre depuis l’an 2000 pour les boissons non fermentées à base de jus de fruits s’est confirmée en 2007. En 2007, la quantité écoulée, 540’000 hl, était presque équivalente à celle de 1980, année durant laquelle les évaluations ont commencé. En ce qui concerne les boissons fermentés à base de jus de fruits, la quantité écoulée a pu être maintenue depuis quatre ans à son niveau, qui est bas (123’000 hl).
■ Commerce extérieur: grâce à la bonne récolte, les importations de fruits ont été particulièrement peu importantes
Les importations de légumes frais et de fruits frais pouvant être cultivés en Suisse se sont élevées à 212’000 t et à 38’000 t, respectivement, soit une hausse de 1% pour les légumes et de 22% pour les fruits par rapport à la moyenne des quatre dernières années. Les quantités de fruits et de légumes exportés ont été insignifiantes, comme au cours des années précédentes (400 t de légumes; 3’400 t de fruits).
En comparaison avec l’année précédente, les importations de vin ont augmenté de 108’325 hl, pour atteindre 1,875 mio. hl, dont 1,635 mio. hl ont été importés à l’intérieur du contingent tarifaire. L’importation de vin blanc, 341’058 hl au total, a augmenté à nouveau (+33’017 hl ou +10,7%). La part des importations de vins en bouteille s’est également accrue (+13,6%), de même que celle des importations de vins en vrac (+8,9%). Pour le vin rouge, les importations de vins en bouteille, 1,357 mio. hl de volume total, ont nettement augmenté (+11%); les importations de vins en vrac ont quant à elles diminué de 8’233 hl (–1,2%). Ces chiffres tiennent compte de toutes les importations de vin, y compris les vins industriels et les importations au taux hors contingent.
■ Consommation: la consommation de vin remonte
La consommation par habitant de légumes frais s’est chiffrée à 69 kg, celle de fruits de table (sans les fruits tropicaux) à 24 kg. Ces quantités correspondent à la moyenne pluriannuelle.
La consommation totale de vins s’est élevée à 2,798 mio. hl pendant l’exercice, ce qui représente une augmentation de 3,6% par rapport à l’année précédente (vins industriels et vins exportés ou réexportés inclus). La consommation de vins suisses (1,079 mio. hl) a augmenté de 5,6% et celle des vins étrangers (1,719 mio. hl), de 2,3%. Dans l’ensemble, la part de marché du vin suisse, qui avoisine les 38%, est restée stable.
1. RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 43 1.1 ECONOMIE 1
■ Prix: nouveau chiffre d’affaires record pour les légumes
En ce qui concerne les légumes, le chiffre d’affaires augmente continuellement depuis plusieurs années. En 2007, il a atteint pour la première fois les 866 mio. de francs, ce qui représente 9% de plus que la moyenne des quatre années précédentes. Le prix moyen des légumes (emballé, franco grande distribution) s’est élevé à 2.79 fr./kg contre 2.76 fr./kg l’année précédente et 2.61 fr./kg en moyenne pour les quatre dernières années.
Evolution
Légumes marge brute Légumes vente Légumes vente (linéaire)
Légumes prix de revient
Légumes prix de revient (linéaire)
Légumes marge brute (linéaire)
La marge brute pour les légumes est restée pratiquement stable en 2007. Elle a augmenté d’un centime, atteignant 1.60 fr./kg. Alors que le prix de revient augmentait de 1 ct./kg,le prix de vente final augmentait de 2 ct./kg. Le prix de revient moyen a représenté, en 2007, 40% du prix de vente final.
Evolution des prix et des marges brutes de fruits sélectionnés
Fruits marge brute
Fruits vente
Fruits vente (linéaire)
Fruits prix de revient
Fruits prix de revient (linéaire)
Fruits marge brute (linéaire)
La marge brute totale sur les fruits a de nouveau baissé (–24 ct./kg), après une nette augmentation en 2006. Alors que le prix de revient augmentait de 13 ct./kg, le prix de vente final baissait de 11 ct./kg. Le prix de revient moyen a représenté, en 2007, 43% du prix de vente final.
1.1 ECONOMIE 1 44
1993199419951996199719981999200020012002200320052007 2006 2004 en fr./kg Source:
0 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50
des prix et des marges brutes de légumes sélectionnés
OFAG
en fr./kg
0 5.00 4.50 3.50 4.00 3.00 2.00 1.50 2.50 1.00 0.50 1993199419951996199719981999200020012002200320052007 2006 2004
Source: OFAG
■ Deux systèmes d’indicateurs
Revenu et paramètres d’économie d’entreprise
Evolution du revenu des exploitations agricoles: moyenne de toutes les régions
La prestation brute a progressé de 6,1% en 2007 par rapport à la moyenne des années 2004/06. L’augmentation par rapport à 2006 est du même ordre (+7,0%). Cela est en partie dû à des prix à la production plus élevés pour les différents produits d’origine animale ou végétale (bovins, porcs, légumes) ainsi qu’à l’extension des surfaces affectées à la culture du colza et de betteraves sucrières; il est également dû à des récoltes plus importantes dans le domaine de la culture des champs (surtout pommes de terre et betteraves sucrières), dans celui de la culture fourragère et en arboriculture. Les paiements directs par exploitation ont augmenté de 7,1% par rapport aux trois années précédentes. Par rapport à 2006, l’augmentation a été de 4,4%. Cela s’explique par un accroissement de la surface des exploitations et l’octroi, pour la première fois, de paiements directs en faveur des vaches laitières (contributions destinées aux animaux consommant des fourrages grossiers).
En 2007, les charges réelles ont augmenté de 5,0% par rapport à la période 2004/06 et de 4,3% par rapport à 2006. Ont augmenté notamment le coût des aliments pour animaux du fait de l’extension de l’effectif bovin, ainsi que le coût des animaux achetés, le coût des travaux effectués par des tiers et le coût des bâtiments.
Le revenu agricole correspond à la différence entre la prestation brute et les coûts réels. Il rémunère, d’une part, le travail de 1,24 unité de main-d’œuvre familiale en moyenne et, d’autre part, les fonds propres investis dans l’exploitation, lesquels s’élèvent en moyenne à quelque 424’000 francs. En 2007, le revenu agricole a été de 9,4% supérieur à la moyenne des années 2004/06 et de 15,5% par rapport à celui de l’année précédente.
Tableaux 16–25, pages A16–A26
1990/922007 20052006 2004 fr. par exploitation Revenu extra-agricole Revenu agricole
Agroscope Reckenholz-Tänikon ART 0 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 16 264 62 822 1,39 UTAF Unités de travail annuel de la famille 23 417 61 143 1,24 21 557 60 472 1,25 22 172 54 274 1,24 22 939 52 915 1,24 1.1 ECONOMIE 1 52
Source:
Comparé à la période 2004/06, le revenu agricole a augmenté de 11,2% en région de plaine et de 9,2% dans la région des collines au cours de l’exercice sous revue; pour ce qui est de la région de montagne, la hausse est de 4,6%. Quant au revenu extraagricole, il est partout en hausse, progressant de 7,0% en région de plaine, de 4,3% dans la région des collines et de 4,0% dans la région de montagne. Ainsi, le revenu total a progressé de 10,2% dans la région de plaine, de 7,7% dans la région des collines et de 4,4% dans la région de montagne.
En 2007, la part des paiements directs à la prestation brute a atteint 15,9% dans les exploitations de plaine, 23,0% dans les exploitations de la région des collines et 35,9% en montagne. Elle a donc légèrement augmenté dans les régions de plaine et celle des collines par rapport à la période 2004/06, tandis qu’elle a un peu régressé dans la région de montagne.
Revenu selon les régionsUnité1990/9220042005200620072004/06–2007 % Région de plaine Surface agricole utileha16,6620,0720,6421,0221,223,1 Main-d’œuvre familialeUTAF1,361,211,191,191,17–2,2 Revenu agricolefr.73 79472 61562 69661 13272 83411,2 Revenu extra-agricolefr.16 42920 53221 53122 33922 9617,0 Revenu totalfr.90 22393 14684 22783 47195 79510,2 Région des collines Surface agricole utileha15,3018,5218,9218,8819,292,8 Main-d’œuvre familialeUTAF1,401,231,231,221,230,3 Revenu agricolefr.59 83854 74249 62748 11455 5209,2 Revenu extra-agricolefr.14 54422 16723 27723 00023 8044.3 Revenu totalfr.74 38276 90972 90471 11479 3247,7 Région de montagne Surface agricole utileha15,7618,6319,0919,6619,813,6 Main-d’œuvre familialeUTAF1,421,331,341,331,340,5 Revenu agricolefr.45 54146 10944 80743 98047 0464,6 Revenu extra-agricolefr.17 85322 64522 15123 87923 8014,0 Revenu totalfr.63 39468 75466 95867 85870 8484,4 Source: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
Revenu des exploitations agricoles selon les régions
1. RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 1.1 ECONOMIE 1 53
Tableaux 16–19, pages A16–A19
En termes de revenu, la situation laisse toutefois apparaître des écarts significatifs entre les 11 types d’exploitation (branches de production).
Revenu des exploitations agricoles selon le type 2005/07
Si l’on considère la moyenne des années 2005/07, ce sont les exploitations pratiquant les cultures spéciales et les grandes cultures, de même que certaines exploitations combinant les activités (lait commercialisé/grandes cultures, transformation), qui ont réalisé le revenu agricole le plus élevé. Celles-ci, ainsi que les exploitations «combinaison vaches mères», ont également affiché le revenu total le plus élevé. A l’opposé, les exploitations ayant enregistré le revenu agricole et le revenu total le plus bas appartiennent aux types «autre bétail bovin» et «chevaux/moutons/chèvres». Quant aux exploitations spécialisées «lait commercialisé», elles figurent entre les deux catégories précitées. Dans toutes les catégories de revenu, leurs résultats sont inférieurs à la moyenne.
Type d’exploitationSurface Main-d’œuvre RevenuRevenuRevenu agricole utilefamilialeagricoleextra-agricoletotal haUTAFfr.fr.fr. Moyenne de toutes les exploitations20,041,2456 11122 84378 954 Grandes cultures24,160,9662 40228 99191 393 Cultures spéciales12,961,2667 67521 49789 172 Lait commercialisé20,131,3253 86019 02972 888 Vaches mères19,651,1444 79733 47278 269 Autre bétail bovin16,91,2336 72128 47265 193 Chevaux/moutons/chèvres13,661,2430 61437 40868 022 Transformation11,991,1853 43628 94182 377 Combinaison lait commercialisé/ grandes cultures27,071,2771 05315 58286 635 Combinaison vaches mères24,041,0854 36530 65985 023 Combinaison transformation20,241,2668 25217 80386 055 Combinaison autres22,251,2258 59723 21681 812
Source:
Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
1.1 ECONOMIE 1 54
Tableaux 20a–20b, pages A20–A21
Le revenu du travail des exploitations agricoles (revenu agricole après déduction des intérêts sur les fonds propres investis dans l’exploitation) indemnise la main-d’œuvre familiale non salariée. Par rapport à la moyenne triennale 2004/06, le revenu du travail (médiane) par unité de main-d’œuvre familiale a augmenté de 6,7% en 2007. Par rapport à 2006, cela représente une hausse de 12,8%. Par rapport aux trois années précédentes et à l’année dernière, le revenu du travail a moins augmenté que le revenu agricole. Cela s’explique par une augmentation des intérêts sur le capital propre (relèvement des taux d’intérêt rémunérant les obligations de la Confédération) et une plus grande utilisation de capital propre.
Autre constat, le revenu du travail par unité de main-d’œuvre familiale varie fortement d’une région à l’autre. En moyenne, il est toutefois sensiblement plus élevé en région de plaine qu’en région de montagne. Les écarts entre les quartiles sont eux aussi importants. Ainsi, pour la période 2005/07, le revenu du travail par unité de maind’œuvre familiale du premier quartile a atteint 19,7% dans la région de plaine et celui du quatrième quartile 205,6% de la moyenne de toutes les exploitations de la région. Les écarts sont similaires dans la région des collines (15,9% et 196,0%) et encore plus marqués dans la région de montagne (8,5% et 209,4%).
Revenu du travail des exploitations agricoles 2005/07: selon les régions et les quartiles
Revenu du travail 1 en fr. par UTAF 2 MédianeValeurs moyennes
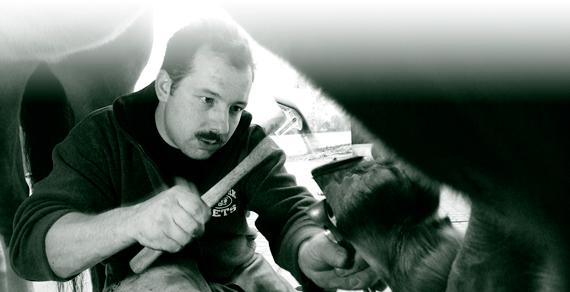
Région1er quartile2e quartile3e quartile4e quartile (0–25%)(25–50%)(50–75%)(75–100%)
1Intérêts sur les fonds propres au taux moyen des obligations de la Confédération: 2005: 2,11%; 2006: 2,50%; 2007: 2,91%
2Unités de travail annuel de la famille: base 280 journées de travail
Quelle: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
Région de plaine42 530 8 941 33 859 52 276 93 373 Région des collines32 170 5 365 25 257 39 576 66 186 Région de montagne25 966 2 292 19 459 32 543 56 810
Tableaux 21–24, pages A22–A25
1.1 ECONOMIE 1 55
■ Revenu du travail en 2007
Dans les régions de plaine et des collines, le 4e quartile des exploitations agricoles a dépassé en moyenne de 23’000 francs et de 2’000 francs, respectivement, le salaire annuel brut correspondant du reste de la population au cours de la période 2005/07. Dans la région de montagne, le 4e quartile a été inférieur de 2’000 francs au salaire comparatif durant cette période. En comparaison avec la période 2004/06, seule la région de plaine a amélioré quelque peu sa situation relative.
Salaire comparatif 2005/07 selon les régions
RégionSalaire comparatif 1 en fr. par année
Région de plaine69 907
Région des collines63 792
Région de montagne59 071
1Médiane des salaires annuels bruts de toutes les personnes employées dans les secteurs secondaire et tertiaire
Sources: OFS, Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
Il convient de noter que le train de vie des ménages agricoles n’est pas uniquement assuré par le revenu du travail. Leur revenu total, y compris le revenu extra-agricole, est sensiblement plus élevé que le revenu du travail.
La part des capitaux tiers à l’ensemble du capital (ratio d’endettement) renseigne sur le financement externe d’une exploitation. Considéré parallèlement à la constitution des fonds propres, ce paramètre permet de juger si les dettes d’une exploitation sont supportables. Une exploitation présentant un ratio d’endettement élevé et une diminution des fonds propres n’est pas viable à long terme.
Compte tenu de ces critères, les exploitations sont réparties en quatre groupes, selon leur stabilité financière.
Répartition des exploitations en quatre groupes, compte tenu de leur stabilité financière
Exploitations avec …
Formation de fonds propres
Ratio d’endettement faible (<50%)élevé (>50%)
positive... situation financière... autonomie financière sainerestreinte
négative... revenu insuffisant ... situation financière précaire
Source: De Rosa
1.1 ECONOMIE 1 56
■ Stabilité financière
L’appréciation de la stabilité financière des exploitations montre une situation similaire dans les trois régions; entre 38 et 42% des exploitations connaissent une situation financière saine, alors que celle-ci doit être qualifiée de plus problématique pour 35 à 37% d’entre elles (diminution des fonds propres). La moyenne triennale 2005/07 affiche donc dans toutes les régions un léger recul par rapport à 2004/06.
Appréciation de la stabilité financière 2005/07 selon les régions

Région de plaineRégion des collinesRégion de montagne Part des exploitations en % Situation financière précaire Revenu insuffisant Autonomie financière restreinte Situation financière saine Source: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART 0 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 17 19 23 41 18 19 25 38 15 20 23 42 1.1 ECONOMIE 1 57
■ Constitution de fonds propres, investissements et ratio d’endettement
Comparé à 2004/06, les investissements des exploitations de référence ART ont diminué de 6,3% en 2007. En revanche, la marge brute d’auto-financement (cashflow) a, elle, augmenté de 5,0%, d’où une hausse de 11,5% du rapport entre le cashflow et les investissements. La constitution de fonds propres (revenu total moins déduction de la consommation privée) était sensiblement plus élevée (35,4%) que pendant la période de référence et le ratio d’endettement a augmenté (+2,3%). Cela s’explique par le fait que les capitaux tiers ont crû plus fortement que les fonds propres. En ce qui concerne le capital étranger, ce sont notamment les crédits hypothécaires et les divers capitaux externes empruntés à moyen et à long terme qui ont augmenté.
Evolution des fonds propres, des investissements et du ratio d’endettement
1Investissements bruts (sans les prestations propres), moins les subventions et les désinvestissements 2Rapport entre cash-flow (fonds propres plus amortissements, plus/moins les variations des stocks et du cheptel) et investissements
Source: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
Paramètre1990/9220042005200620072004/06–2007 % Formation de fonds propresfr.19 51315 5909 4937 32514 62735,4 Investissements 1 fr.46 91451 26147 33646 52445 333–6,3 Rapport entre cash-flow et investissements 2 %9591889010011,5 Ratio d’endettement%43444345452,3
58 1.1 ECONOMIE 1
1.2Aspects sociaux
Le rapport social dans l’agriculture porte cette année sur les deux domaines suivants:

–revenu total et consommation privée des ménages agricoles; –étude relative à des questions sociales et sociétales.
Le présent Rapport agricole présente le revenu et la consommation des ménages agricoles sur la base du dépouillement centralisé des données comptables d’Agroscope Reckenholz-Tänikon ART. L’étude menée en 2007 a pour thème «Les jeunes agriculteurs et agricultrices et leur vision de l’avenir». Son but était d’obtenir un profil des jeunes agriculteurs et agricultrices (ci-après appelés jeunes agriculteurs pour des raisons de lisibilité) d’aujourd’hui et de savoir comment ils envisageaient l’avenir.
■■■■■■■■■■■■■■■■■
1.2 ASPECTS SOCIAUX 1 59
■ Revenu total et consommation privée
1.2.1Revenu et consommation
Le revenu et la consommation sont des paramètres importants permettant d’appréhender la situation sociale des familles d’agriculteurs. En ce qui concerne la dimension économique de la durabilité, le revenu est surtout un indicateur de la performance des exploitations. Quant à la dimension sociale, c’est avant tout le revenu total des ménages agricoles qui compte, raison pour laquelle le revenu non agricole des familles paysannes est pris en compte dans l’analyse. L’enquête porte sur l’évolution aussi bien du revenu total que de la consommation privée.
En moyenne des années 2005 à 2007, le revenu total, qui se compose des revenus agricole et non agricole, se situait entre 68’600 francs et 87’800 francs par ménage, selon la région. Dans la région de montagne, les ménages ont atteint environ 78% du revenu total de ceux de plaine. Permettant aux familles paysannes de réaliser en moyenne de 22’300 à 23’400 francs, l’activité non agricole est une source de revenu supplémentaire non négligeable. Sa part représente 25% du revenu total des ménages en plaine, 31% dans la région des collines et 34% en montagne. En chiffres absolus, le revenu non agricole a été le plus élevé dans la région de montagne, atteignant 23’400 francs.
Revenu total et consommation privée des exploitations par région 2005/07
en fr.
Région de plaineRégion des collinesRégion de montagne
Consommation privée
Revenu extra-agricole
Revenu agricole
Source: Dépouillement centralisé d'Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
La constitution de capital propre, part non consommée du revenu total, représente en moyenne quelque 13% du revenu total toutes régions confondues. La consommation privée est supérieure au revenu agricole. Comme le revenu total, elle est, en chiffres absolus, la plus élevée dans la région de plaine et la plus basse dans celle de montagne.
En 2007, le revenu total moyen par exploitation, d’environ 84’600 francs, a été inférieur à la moyenne des années 2004/06, où il se situait à 78’100 francs. La consommation privée par ménage a cependant progressé d’environ 2’600 francs par rapport à la période précitée, pour s’établir à près de 70’000 francs.
■■■■■■■■■■■■■■■■■
0 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 1.2 ASPECTS SOCIAUX 1 60
Revenu total et consommation privée par unité de consommation, en fonction des quartiles1 2005/07
1er quartile2ème quartile3ème quartile4ème quartileEnsemble des exploitations
Source: Dépouillement centralisé Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
Les ménages du premier quartile ont atteint 43% du revenu total par unité de consommation de ceux du quatrième quartile. La différence entre les deux quartiles est nettement plus faible en ce qui concerne la consommation privée: dans le premier quartile, elle a représenté 69% de celle des ménages du quatrième quartile.
Dans la période 2005/07, le revenu total par unité de consommation n’a pas suffi à couvrir la consommation des familles dont l’exploitation fait partie du premier quartile. La formation de capital propre a donc présenté un bilan négatif. Si ces exploitations grignotent le capital longtemps encore, elles devront tôt ou tard cesser leur activité. En revanche, dans les autres quartiles, les dépenses privées ont été inférieures au revenu total: elles ont représenté environ 95% du revenu total dans le deuxième quartile, 84% dans le troisième et 71% dans le quatrième.

En 2007, le revenu total par unité de consommation a été supérieur aux trois années précédentes, 2004 à 2006, et cela dans tous les quartiles. En 2007, la consommation privée a elle aussi progressé dans tous les quartiles par rapport à la moyenne des années 2004/06.
Une brève rétrospective révèle que, au cours des dix dernières années, sur une moyenne de trois ans, les ménages du 1er quartile ont atteint environ 43% du revenu total par unité de consommation des ménages appartenant au 4e quartile. Toujours pendant les dix dernières années, le revenu total par unité de consommation n’a pas été suffisant pour couvrir les besoin des familles du 1er quartile: il manquait à chaque fois environ 10%.
Revenu total par UC 2 (fr.)15 36619 48424 49235 77923 692 Consommation privée par UC (fr.)17 71718 55820 52525 55220 550
1 Quartiles selon le revenu du travail par unité de travail annuel de la famille
2 Unité de consommation = membre de la famille, âgé de 16 ans ou plus, participant toute l’année à la consommation de la famille
1. RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 1.2 ASPECTS SOCIAUX 1 61
■ 1.2 ASPECTS SOCIAUX 1 62
1.2.2Les jeunes agriculteurs et agricultrices et leur vision de l’avenir
En collaboration avec la station de recherche Agroscope Reckenholz-Tänikon ART, l’OFAG a réalisé une étude pour savoir comment les jeunes agriculteurs envisageaient leur avenir. Au cours des mois de janvier et février 2008, 2’000 jeunes agriculteurs, de 35 ans ou moins, choisis au hasard parmi les exploitants agricoles ayant droit aux paiements directs, ont été enquêtés par voie de questionnaire sur ce qu’ils pensaient de l’agriculture actuelle et de son avenir, de même que sur leurs conditions de vie et leur degré de satisfaction. Plus de la moitié ont répondu. Le questionnaire a été élaboré avec le concours de l’institut de sondages d’opinion ISOPUBLIC. Des discussions de groupes ont suivi au printemps 2008. Elles ont permis d’approfondir la réflexion et de se faire une idée plus précise de l’opinion des jeunes agriculteurs.
Les différents domaines thématiques – forces et faiblesses de l’agriculture suisse, l’agriculture idéale, l’avenir de l’agriculture, la viabilité des exploitations, le degré de satisfaction – ont été explorés, aussi bien au moyen du questionnaire que dans le cadre des discussions de groupe consécutives. Après une brève caractérisation de l’échantillon des agriculteurs enquêtés, nous présenterons une analyse plus approfondie des résultats du sondage, thème par thème.
Ci-après, la description de l’échantillon des 1’023 jeunes agriculteurs ayant participé à l’enquête par questionnaire.
Exploitants agricoles ayant répondu au questionnaire
PartPourcentage par représentée rapport à la population danstotale d’agriculteurs l’évaluation(pondération) %%
Taille de petite<1 UMOS 1 2825
l’exploitationmoyenne1–2,5 UMOS 1 5759 grande>2,5 UMOS 1 1616
Type de production végétale1210 l’exploitationélevage5555 exploitation combinée3435
1UMOS = unité de main-d’œuvre standard
■■■■■■■■■■■■■■■■■
Sexemasculin8795 feminin135
français2419 italien
collines2930 montagne3228
Langueallemand7179
52 Régionplaine4042
Source: Isopublic, OFAG Caractérisation de l’échantillon de jeunes agriculteurs
Situation familiale et professionnelle

Les trois quarts des personnes enquêtées sont mariées ou vivent en union libre stable, la moitié des partenaires d’exploitant(e)s agricoles étant d’origine paysanne. Les trois quarts des partenaires travaillent (également) dans l’exploitation agricole, de même que les trois quarts des parents ou des beaux-parents, mais il n’a pas été demandé à quelle fréquence ou à raison de combien d’heures. Chez 9% seulement des personnes sondées, aucun proche parent ne travaille à la ferme. Plus de 60% ont une activité complémentaire et dans 44% des exploitations, le ou la partenaire travaille (aussi) en dehors de l’exploitation. Dans 30% des cas, quel que soit le type d’exploitation, le revenu extra-agricole (du chef d’exploitation ou de son/de sa partenaire) constitue plus de la moitié du revenu total. Plus de 50% des ménages ont des enfants et dans 17%, trois enfants ou plus.
Formation
61% des chefs d’exploitation interrogés ont une formation agricole (formation initiale et éventuellement deuxième formation); 19% possèdent à la fois un diplôme professionnel en agriculture et dans une autre profession et 20% n’ont aucune formation agricole. 3% n’ont achevé aucune formation professionnelle (ni agricole, ni autre).
11% des partenaires d’agriculteurs/trices ont achevé une formation initiale dans le domaine agricole, et 5% ont suivi une deuxième formation en agriculture ou en économie familiale rurale.
Conditions d’exploitation
Trois sur cinq des exploitations agricoles conduites par ces jeunes agriculteurs sont de taille moyenne (soit 1 à 2,5 UMOS) et un peu plus de la moitié se sont spécialisées dans l’élevage. 8% des exploitations sont dirigées par des personnes d’origine non paysanne. Il s’agit le plus souvent de petites exploitations situées en région de montagne qui pratiquent rarement l’agriculture mixte. De même, les exploitations dirigées par des femmes sont plus souvent de petite taille (58% des femmes gèrent une exploitation de petite taille, contre 23% chez les hommes). De plus, ces exploitations sont plus fréquemment situées en région de montagne (46% en comparaison de 27% chez les hommes). 10% des personnes enquêtées sont à la tête d’une exploitation biologique. Ces exploitations sont plus rarement implantées en Romandie et dans la région de plaine. Les trois quarts pratiquent exclusivement l’élevage et les agriculteurs sont nettement plus souvent originaires d’une famille non paysanne.
Reprise de l’exploitation
Un cinquième des personnes interrogées ont repris l’exploitation il y plus de huit ans, un quart d’entre elles, il y a six à huit ans. Un peu plus de la moitié n’est chef d’exploitation que depuis cinq ans ou moins. 17% gèrent l’exploitation en tant que fermiers, 79% en tant que propriétaires et 3% en tant que communauté d’exploitation entre générations.
1. RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 1.2 ASPECTS SOCIAUX 1 63
Changements réalisés lors de la reprise d'une exploitation1 (n=810)
Des changements relatifs à l'exploitation ont-ils été entrepris ou sont-ils prévus dans la perspective de votre reprise de l'exploitation ou depuis que vous en avez repris la direction?
Transformation de bâtiments d'exploitation
Développement (exploitation intensive)
d'une branche de production
Transformation de la maison d'habitation
Amélioration de la mécanisation
Lancement d'une nouvelle branche de production
Abandon d'une branche de production
Spécialisation dans une ou plusieurs branches de production
Reconv. d'une exploit. à titre principal en une exploitation à titre accessoire
Nouvelle collaboration: communauté d'exploit. ou communauté part. d'exploit. Conversion au bio ou à d'autres formes de production (labels)
Nouvelle collaboration: coopérative pour l'utilisation
Les reprises d’exploitations donnent l’occasion de réaliser des transformations: près de 80% des personnes interrogées indiquent avoir entrepris des changements au moment de la reprise de l’exploitation ou par la suite. Dans plus de la moitié des cas, il s’agissait de transformations de bâtiments (maison d’habitation et/ou bâtiments d’exploitation). De plus, dans deux cinquièmes des cas, une branche de production a été développée, voire intensifiée; tout aussi souvent, l’agriculteur a investi pour améliorer la mécanisation. Enfin, dans trois cas sur dix, les agriculteurs se sont engagés dans une nouvelle branche de production. Les travaux de modernisation lors de reprise d’exploitations sont plus fréquents en Suisse alémanique et dans les exploitations de plus grandes dimensions. Ils sont entrepris en premier lieu pour s’adapter aux exigences du marché. Les raisons avancées ont été les suivantes: économie de travail ou allègement du travail (53%), préparation de l’exploitation à affronter les évolutions prévisibles (46%), amélioration du revenu (38%). Les transformations ont été aussi motivées par des préférences personnelles. 51% indiquent que les transformations entreprises ont servi à adapter l’exploitation en fonction de leurs goûts et aptitudes. Dans 21% des cas, la raison invoquée est que l’aménagement était indispensable pour continuer d’avoir droit aux paiements directs.
Autres
de
Abandon du mode de production biologique Source: Isopublic 1 Plusieurs mentions possibles 0 01020 51 42 40 40 31 24 16 13 10 9 8 6 1 30 en % 50 4060 1.2 ASPECTS SOCIAUX 1 64
machines agricoles
■ Discussions de groupe
Onze discussions de groupe ont eu lieu dans diverses régions géographiques et linguistiques afin d’approfondir et de concrétiser les résultats de l’enquête écrite: six entretiens ont eu lieu avec de jeunes agriculteurs choisis au hasard, trois autres dans des écoles d’agriculture avec de futurs chefs d’exploitation et deux avec des participantes à des cours donnés dans des écoles de paysannes.
Discussions de groupe
LieuRégionLangueDateParticipants
Morges VDPlainef11.03.0810 h
Lyss BEPlained27.03.087 h
Landquart GRMontagned02.04.0816 h, 1 f
Gränichen AGPlained08.04.087 h
Seuzach ZHPlained10.04.086 h
Stans NWMontagned15.04.087 h
Bellinzona TIPlainei17.04.088 h
Le Peu-Péquignot JUMontagnef22.04.088 h
Zweisimmen BEMontagned24.04.087 h
Langenthal BEPlained08.05.083 f
Riedholz SOPlained13.05.0810 f
h = homme, f = femme
■ Forces et faiblesses de l’agriculture d’aujourd’hui
La qualité et le respect de l’environnement sont cités par les jeunes agriculteurs comme les principales forces de l’agriculture dans leur réponse au questionnaire. La qualité des produits et le bien-être des animaux viennent en tête de liste du classement. Près de 90% des personnes enquêtées considèrent ces deux aspects comme les atouts majeurs de l’agriculture suisse. Suivent les aspects relatifs à l’environnement (entretien du paysage rural, normes environnementales élevées et production sans OGM) qui sont considérés comme des points forts par 67 à 81% des personnes enquêtées. La formation agricole (pour 70% des personnes interrogées), d’une part, et les exploitations de type familial (pour 63% des personnes interrogées), d’autre part, sont également jugées comme des aspects positifs, autrement dit comme une force.
En revanche, les aspects financiers (coût des moyens de production, compétitivité visà-vis de l’étranger, prix élevés à la production et baisse du revenu agricole) ainsi que les aspects administratifs (charge administrative, cadre légal) sont ressentis comme des faiblesses du système agricole suisse par plus de la moitié des personnes enquêtées (dans 55 et 82% des cas respectivement).
1. RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 1.2 ASPECTS SOCIAUX 1 65
Forces et faiblesses (n=1023)
Quels sont les points forts et les points faibles de l'agriculture suisse d'aujourd'hui dans les domaines mentionnés ci-après?
Produits de haute qualité
Bien-être des animaux
Entretien du paysage rural Normes environnementales élevées Agriculture sans OGM

Formation agricole Exploitations paysannes de type familial Conditions-cadre légales Situation du revenu agricole Prix élevés à la production
Compétitivité face à l'étranger Charge administrative Coût des moyens de production Source: Isopublic
Certaines différences dans l’appréciation des forces et des faiblesses s’expliquent par le mode de vie des personnes enquêtées: le type d’agriculture pratiquée dans leur propre exploitation est légèrement plus souvent considéré comme une force pour l’agriculture suisse. Le bien-être des animaux est ainsi cité plus souvent comme un point fort par les agriculteurs qui pratiquent l’élevage. L’importance des exploitations de type familial est aussi perçue nettement plus fréquemment que la moyenne comme une force, par les personnes d’origine paysanne, par les chefs d’exploitation qui ont un/e partenaire qui travaille avec eux et par les personnes qui gèrent l’exploitation avec leurs parents ou leurs beaux-parents.
D’autres différences encore s’expliquent par l’orientation de l’exploitation, sa situation financière et sa taille. Le manque de compétitivité face à l’étranger est ainsi désigné par la majorité des personnes sondées (63%) comme un point faible de l’agriculture suisse. La proportion des personnes de cet avis est un peu moins élevée chez les jeunes agriculteurs qui pratiquent l’élevage (56%) et chez ceux qui dirigent une petite exploitation (59%). Les chefs de petites exploitations jugent en outre que le coût des moyens de production a un impact moins fortement négatif que ne l’estime la moyenne des autres agriculteurs. Les exploitants de la région de montagne considèrent également les normes environnementales élevées et la production sans OGM comme des points forts (68 et 62% respectivement), mais pas dans des proportions aussi fortes que la moyenne des personnes enquêtées (76 et 67% pour chacun de ces deux aspects). Par ailleurs, les chefs d’exploitation de la région de montagne jugent moins souvent comme un point faible la charge administrative et le cadre légal imposés. En ce qui concerne la charge administrative, ce sont les femmes qui ont l’attitude la moins négative et en ce qui concerne le cadre légal, ce sont ceux qui gèrent leur exploitation selon les principes de l’agriculture biologique.
02040
60100
1.2 ASPECTS SOCIAUX 1 66
0
en % 80
faiblesse force ni l'un/ni l'autre pas d'indication
Le thème «Forces et faiblesses de l’agriculture suisse» a été approfondi dans le cadre de discussions de groupe. Que mettent concrètement les jeunes agriculteurs sous les termes de forces et de faiblesses de l’agriculture suisse? Il ressort clairement du sondage que la qualité, et non la quantité, est un point fort de l’agriculture suisse. La qualité des produits est toutefois une notion complexe et ne se limite donc pas au produit proprement dit. L’important à ce propos est l’image globale d’un produit agricole replacé dans son contexte, autrement dit le mode de production, l’origine, etc. Cette qualité est garantie grâce à des exigences légales élevées et des prescriptions strictes en matière d’élevage et de transformation des denrées alimentaires, même si celles-ci peuvent être parfois ressenties comme restrictives par certains jeunes agriculteurs. Pour les consommateurs, la qualité, qui n’est pas toujours apparente, est rendue «mesurable» par l’attribution de labels. Les jeunes agriculteurs pensent que la qualité est aujourd’hui tenue pour acquise. L’agriculture suisse se doit donc de continuer de la garantir. De l’avis des participants à la discussion, il est sans doute plus facile de pratiquer une production de haut niveau qualitatif dans les exploitations relativement petites de la Suisse que dans de grosses exploitations où l’on perd plus vite la vue d’ensemble. Du point de vue du critère de qualité, la production agricole paysanne a clairement un avantage sur la production agricole industrielle. Les «fabriques d’animaux» ne cadrent pas avec le concept de «qualité des produits», car le bien-être des animaux fait également partie de l’assurance qualité. «… prenez par exemple une petite exploitation suisse comptant 15 à 20 vaches et, à l’opposé, une grande exploitation de l’étranger avec une centaine de vaches. La gestion y est naturellement beaucoup plus compliquée qu’ici. Je connais chacune de mes vaches personnellement, elles font partie de ma vie. Dès que quelque chose cloche, je le vois immédiatement, alors que ceux des exploitations industrielles, n’ont pas cette proximité avec leurs animaux. La qualité du lait peut s’en ressentir plus facilement.»
Les jeunes agriculteurs considèrent comme un autre point fort le fait qu’ils peuvent être aussi présents dans la journée en tant que pères de famille, ce qui n’est pas possible à la majorité des autres pères qui en plus, travaillent en dehors de l’exploitation. En ce qui concerne «l’entretien du paysage rural», ils accordent une importance primordiale à un paysage rural soigné et attrayant («comme un petit coin de jardin»). Pour les paysans de montagne, un paysage rural entretenu c’est, par exemple, une prairie d’alpage fauchée ou un pâturage débarrassé de son rumex, qui invitent les touristes à s’attarder dans nos belles montagnes.
«La qualité suisse est tout de même légèrement meilleure!»
1.2 ASPECTS SOCIAUX 1 1. RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 67
«On ne récolte que ce qu’on sème.»
Les discussions de groupe ont été aussi l’occasion d’autocritiques. Les faiblesses de l’agriculture sont parfois aussi imputables aux agriculteurs eux-mêmes. Leur état d’esprit a une grande importance: des exploitants agricoles démotivés et des paysans «racornis» affaiblissent considérablement l’agriculture. La formation n’y change pas grand chose. On disait autrefois que les paysans les plus bêtes sont souvent les plus riches. Aujourd’hui, les jeunes agriculteurs sont tellement mis à contribution de toutes parts qu’il est vrai que seuls les plus «malins» devraient devenir paysans. Ceux qui ne sont pas qualifiés ont beaucoup de peine à satisfaire aux exigences élevées qui sont imposées aujourd’hui à l’agriculture. Les jeunes agriculteurs sont conscients que l’agriculture suisse pratiquée sur de petites superficies et caractérisée par des structures de petite échelle n’atteindra jamais les rendements de ces deux grands voisins, l’Allemagne et la France. Le prix actuel des denrées alimentaires est considéré comme particulièrement bas et donc comme un autre important point faible de l’agriculture. Les jeunes agriculteurs estiment que notre fromage d’alpage ou d’autres spécialités sont parfois vendus trop bon marché par rapport à leur qualité. Les clients sont de plus en plus disposés à payer davantage pour des produits de qualité, y compris à l’étranger. Cette nouvelle génération d’agriculteurs est consciente que «produire plus n’implique pas automatiquement une augmentation du revenu».
L’absence d’esprit de collaboration et de solidarité est également mentionnée en tant que point faible. L’agriculture n’est pas non plus un milieu épargné par la jalousie, la malveillance et la pression concurrentielle. Les jeunes agriculteurs reconnaissent que le manque ou l’insuffisance de communication entre paysans de montagne et paysans de plaine, entre producteurs laitiers, céréaliers et maraîchers, entre exploitants à titre principal et exploitants à titre accessoire constitue une autre faiblesse du système. De surcroît, dans l’agriculture, construire revient cher et comporte des risques: «On construit pour deux générations, mais les lois, elles, changent tous les vingt ans.»
Les principaux aspects choisis par les jeunes agriculteurs enquêtés comme étant représentatifs d’une agriculture idéale ne correspondent qu’en partie aux points forts de l’agriculture suisse. Les cinq principaux aspects cités sont un revenu équitable, une bonne image auprès de la population, la production de denrées alimentaires de haute qualité, la conservation d’exploitations paysannes de type familial et un auto-approvisionnement suffisant. Le critère cité en tête de liste dans le tableau d’une agriculture idéale – un revenu équitable – est néanmoins perçu comme l’un des points faibles (aspects financiers) de l’agriculture actuelle. Dans le profil «points forts/points faibles», tout comme dans la version idéale, la priorité est accordée aux aspects qualitatifs. En revanche, les aspects écologiques et environnementaux considérés comme des points forts de l’agriculture suisse, sont mentionnés en queue de liste dans le tableau d’une agriculture idéale. Une production respectueuse de l’environnement, considérée comme l’un des points forts de l’agriculture suisse, ne correspond donc pas au concept d’agriculture idéale des jeunes agriculteurs.
1.2 ASPECTS SOCIAUX 1 68
■ L’agriculture idéale
L'agriculture idéale1 (n=1023) Quelle est votre conception d'une agriculture suisse idéale?
Revenu équitable
Bonne image auprès de la population
Denrées alimentaires de haute qualité
Conservation des exploitations paysannes de type familial
Auto-approvisionnement suffisant
Occupation décentralisée du territoire
Agriculture particulièrement soucieuse du bien-être des animaux
Conservation de l'aspect traditionnel du paysage et des localités
Production rationnelle et concurrentielle
Production diversifiée
Normes environnementales élevées
Plantes utiles et espèces d'animaux de rente d'origine autochtone
Surfaces de compensation écologique
Espaces récréatifs publics
Forte compétitivité sur les marchés étrangers
La représentation de l’agriculture idéale varie toutefois selon les types d’exploitation. Ainsi, pour les agriculteurs qui observent les règles de l’agriculture biologique, les normes environnementales, la conservation de variétés et d’espèces locales, des modes de production particulièrement respectueux des animaux et des surfaces réservées au maintien et à la promotion de la diversité des espèces sont autant d’aspects auxquels ils attribuent une plus grande importance que la moyenne des paysans, alors qu’ils en accordent moins à une production rationnelle et compétitive. A l’inverse, ceux qui gèrent de grosses exploitations accordent par comparaison davantage d’importance à une production concurrentielle, de même qu’à la production de denrées alimentaires de haute qualité, alors qu’ils considèrent comme moins important l’aménagement d’espaces récréatifs publics. Les paysans de montagne accordent comparativement une plus grande valeur au maintien des exploitations de type familial, à une occupation décentralisée du territoire, à la conservation de l’aspect traditionnel du paysage et des localités ainsi qu’à la culture de variétés et d’espèces locales et considèrent qu’une production rationalisée a moins d’importance.
Autres
Source: Isopublic
0 02040 en % 80 60100 1.2 ASPECTS SOCIAUX 1 1. RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 69
1 Plusieurs mentions possibles
«L’agriculture doit être productive!»
Les diverses représentations d’une «agriculture idéale» sont également passées en revue dans le cadre des discussions de groupe. De l’avis des jeunes agriculteurs, il est primordial que l’agriculture soit productive. Pour eux, la vocation première de l’agriculture est de produire des denrées alimentaires. Le mandat qui lui est conféré par la Constitution fédérale, de contribuer à l’entretien du paysage cultural, par exemple sous la forme de jachères florales, est ressenti davantage comme une obligation que comme un exercice libre. Un de nos interlocuteurs explique pourquoi l’écologie et la protection de l’environnement suscitent le mécontentement des paysans: «Il est parfois choquant pour les paysans, de voir, par comparaison avec leurs propres revenus, ce que certains responsables de projets se mettent dans les poches dès qu’il s’agit de la protection de la moindre réserve naturelle ou du moindre microcosme écologique. Un biologiste se pointe sur le terrain, compte les papillons et les fleurs, et le tour est joué … Alors que dans le cas des paysans, toute aide financière est chichement mesurée, à condition qu’elle leur soit même accordée … Et pourtant, si la prairie présente une telle richesse écologique, c’est bien qu’elle a été entretenue des années durant par le paysan.»
L’entretien du paysage rural ne s’accorde pas toujours complètement avec la conception d’une «agriculture productive» telle que la souhaiteraient les jeunes agriculteurs. L’image qu’ils ont d’eux-mêmes en tant que paysans est avant tout celle de producteurs de denrées alimentaires de qualité. Produire des biocarburants ne correspond pas forcément à leur conception d’une agriculture idéale. De même, pour plusieurs de nos interlocuteurs, intensifier la production animale en vue de pouvoir nourrir la population mondiale, n’est pas non plus sans problème. Dans l’idéal, une exploitation agricole devrait pouvoir être autosuffisante et ne pas dépendre du revenu extérieur du ou de la partenaire.
Pour beaucoup d’entre eux, une agriculture non subventionnée, comme en NouvelleZélande, reste du domaine du rêve: les conditions générales de pratique de l’agriculture et la structure économique sont bien trop différentes. Le bon sens leur dit que l’agriculture suisse ne pourrait pas fonctionner sans les paiements directs: «Si on enlève les paiements directs sur certaines exploitations, on peut mettre la clé sous la porte.» Mais dans leur for intérieur, ils se sentent entravés dans leur liberté. S’identifiant à des entrepreneurs «producteurs», ils préfèreraient pouvoir renoncer au soutien de l’Etat et être rémunérés directement grâce à des prix équitables sur le marché: «I prodotti non vengono valorizzati.» Si on ne peut pas se passer des paiements directs, alors qu’ils soient accordés en priorité aux exploitations qui ont un l’avenir et moins à celles qui sont sur le déclin.
Ce serait également bien qu’il y ait «une certaine harmonie entre le métier, le revenu et la qualité de vie». Il devrait rester de la place et du temps pour la famille et les loisirs. Enfin, la production devrait être adaptée au contexte local: «Tenir davantage compte de l’environnement naturel et produire ce qui est approprié au terroir.» Les jeunes agriculteurs sont persuadés que la taille de l’exploitation n’est pas toujours un facteur déterminant dans l’agriculture. Les exploitations de petite taille ont également un sens, à condition qu’elles soient bien intégrées dans leur marché de production et qu’elles puissent se spécialiser.
1.2 ASPECTS SOCIAUX 1 70
«J’aimerais pouvoir vivre de mon métier.»
Il ressort du questionnaire écrit qu’un revenu équitable est placé au premier rang dans la conception que les jeunes agriculteurs ont d’une agriculture idéale. Qu’est-ce que cela signifie concrètement pour eux? Ils souhaitent disposer d’un revenu dont la famille puisse vivre «sans devoir tirer le diable par la queue». Ce revenu devrait suffire à assurer un standing de vie normal, comme pour la majorité des Suisse, vacances comprises: «Vivre de notre métier normalement.» Le rapport entre travail investi et salaire doit être proportionné, également en comparaison avec d’autres catégories professionnelles. «Je pense qu’il est également important qu’un revenu décent puisse aussi provenir d’un temps de travail raisonnable. Il y a en effet beaucoup d’agriculteurs qui ont certes un revenu convenable, mais qui s’échinent sans relâche du matin au soir.» Les jeunes agriculteurs ne sont pas tous du même avis lorsqu’il s’agit de savoir s’ils doivent comparer leur revenu avec celui d’un employé ou d’un indépendant. «Pouvoir en vivre et mettre de l’argent de côté.» Il ne suffit pas de pouvoir survivre. Le revenu agricole devrait aussi permettre de faire des investissements. Il est également important de pouvoir amortir les dettes. De plus, un revenu convenable devrait suffire, sans qu’un autre membre de l’exploitation soit obligé de travailler à l’extérieur.
La dépendance vis-à-vis des contribuables leur pose problème. Les recettes fiscales doivent être octroyées dans le cadre du budget agricole. L’agriculture doit donc pouvoir compter sur une certaine compréhension de la part du public. C’est pourquoi il est si important qu’elle bénéficie d’une bonne image auprès de la population. Une bonne renommée soutient les ventes de produits suisses dans le pays et à l’étranger. Par contre, les scandales alimentaires ou les scandales au sujet d’animaux de rente maltraités nuisent à l’image de l’agriculture. Cette image est particulièrement précieuse, parce que les paysans représentent une minorité dans la population. Une bonne image est véhiculée par des exploitations soignées et valorise le métier de paysan. «En tant que paysan, on aimerait aussi jouir d’une certaine considération dans le public.» De l’avis d’un interlocuteur, l’agriculture est seule responsable de l’image qu’elle donne: «L’image de l’agriculture dépend de nous, les agriculteurs, et de personne d’autre.» D’autres agriculteurs pensent par contre que les médias présentent souvent l’agriculture sous un jour défavorable.
Les jeunes exploitants agricoles enquêtés partent du principe que d’ici une dizaine d’années, les normes environnementales et l’orientation qualité, y compris un mode d’élevage respectueux des animaux, vont gagner en importance dans l’agriculture suisse. A leur avis, la rationalisation et la présence sur les marchés étrangers vont s’accroître. De même, une importance accrue sera accordée à l’entretien du paysage rural et aux surfaces de compensation écologique. Par contre, tout ce qui fait obstacle à une rationalisation ou à une spécialisation aurait plutôt tendance à perdre du terrain. Les jeunes agriculteurs pensent ainsi que la production diversifiée, la culture de variétés et d’espèces locales, de même que le taux d’autosuffisance, devraient plutôt diminuer. La préservation des sites et des paysages traditionnels et les exploitations agricoles familiales vont perdre aussi de l’importance. De plus, l’évolution du revenu agricole est jugée négative: plus de la moitié des personnes enquêtées pensent que leur revenu va diminuer.

1. RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 1.2 ASPECTS SOCIAUX 1 71
■ L’agriculture suisse du futur
Dans dix ans1 (n=1023)
Comment l'agriculture suisse se présentera-t-elle dans dix ans?
Normes environnementales
Production rationnelle et concurrentielle
Prod. soucieuse du bien-être des animaux
Présence sur les marchés étrangers Espaces récréatifs publics
Denrées alimentaires de haute qualité
Surfaces de compensation écologique Image auprès de la population
Production diversifiée Espèces et variétés d'origine autochtone
Auto-approvisionnement
Conservation de l'aspect traditionnel du paysage et des localités Revenu agricole
Occupation décentralisée du territoire Exploitations paysannes de type familial
En ce qui concerne l’appréciation de l’évolution future de l’agriculture, on constate peu de différences entre les opinions en fonction des types d’exploitations et des caractéristiques socio-démographiques. En région de montagne, le recul de l’autosuffisance et de la production diversifiée est jugé un peu moins négativement. Alors qu’en région de montagne l’évolution possible du revenu des femmes est jugé plus négativement que pour la moyenne des jeunes agriculteurs (70% contre 55%), par comparaison, ceux qui sont à la tête de grosses exploitations jugent moins négativement cette évolution (45%). Ceux qui gèrent de grosses exploitations s’attendent de surcroît à un accroissement de la rationalisation; par comparaison avec les exploitations de plus petite taille, ils pronostiquent aussi une plus forte présence de la Suisse sur les marchés étrangers.
«Il va falloir continuer à se battre.»
Les différentes visions du futur de l’agriculture sont analysées dans le cadre des discussions de groupe, de même que d’autres idées et attentes. Les conceptions rigides devront céder la place à des conceptions plus souples: «Se reconvertir s’il le faut, même si ça ne nous enchante pas.» Mais: «Ne pas jouer les moutons de Panurge!» Les jeunes agriculteurs pensent qu’à l’avenir il y aura tendanciellement moins d’exploitations agricoles, mais qu’elles seront plus grandes. «Moins de paysans et de plus grosses exploitations.» La question qui se pose est de savoir «si l’on peut s’agrandir ou pas.»
Dans l’agriculture, on avance des conceptions aussi différentes, voire opposées, que, d’un côté la spécialisation («on ne peut plus tout faire») et la production intensive et de l’autre, une production totalement extensive. «Plein gaz ou low-input.» Mais à la fois «bien-être animal» et «production rationalisée», à leurs yeux, il y a là une contra-
Source: Isopublic 1 Plusieurs mentions possibles 0 02040 en % 80 60100 augmente diminue ne change pas pas d'indication 1.2 ASPECTS SOCIAUX 1 72
diction. Il faut en outre faire de plus en plus preuve d’esprit d’innovation dans l’agriculture. Lorsque les exploitations deviennent toujours plus grandes, les agriculteurs atteignent vite leurs limites de capacité lorsqu’ils sont seuls. C’est pourquoi l’exploitation en association est de plus en plus souvent envisagée. Mais à quoi se fier à notre époque où rien ne dure?, se demandent-ils, inquiets. «L’incertitude, on ne sait pas ce qui va arriver.»
Les jeunes agriculteurs estiment toutefois que la commercialisation des produits agricoles sera un facteur déterminant pour l’avenir. Le renforcement possible des prescriptions sur la protection des animaux paraît difficilement concevable à quelquesuns des participants aux discussions de groupe, compte tenu du niveau déjà élevé de la protection actuelle des animaux («… nos animaux de ferme vont bientôt devoir être élevés comme des animaux domestiques,» ou encore: «Bientôt les vaches seront au salon et nous, à l’étable.»). D’autres considèrent par contre le bien-être des animaux comme un atout de l’agriculture suisse, du fait que la production de masse n’a de toute façon aucun avenir dans le pays. Etant donné la pression accrue de l’urbanisation –«Sur le Plateau, l’imperméabilisation des sols va certainement progresser et de nombreuses exploitations agricoles seront condamnées à disparaître» – la société souhaitera toujours davantage d’espaces naturels protégés ou de surfaces écologiques. Par conséquent, ce genre d’espaces devraient représenter un intérêt économique croissant. Néanmoins, l’idée d’utiliser comme surfaces de compensation écologiques de bonnes terres productives va clairement à l’encontre de l’identification des paysans à leur rôle de producteurs de denrées alimentaires.
La perspective d’un accord de libre-échange agricole avec l’UE et les négociations OMC en cours sont source d’angoisse pour certains d’entre eux et face à ces nouveaux défis, les réactions vont de l’optimisme à un pessimisme marqué. A l’avenir aussi, l’agriculture continuera de dépendre des décisions de l’économie et de la politique. Certains agriculteurs ont l’impression de n’être que des pions sur un échiquier. «On est ballotés de droite à gauche.» Beaucoup d’entre eux sont convaincus qu’à l’avenir aussi, les agriculteurs seront tributaires des paiements directs. Il leur paraît important que l’agriculture puisse continuer de bénéficier de crédits d’investissement avantageux. Ils prédisent une standardisation de l’agriculture, du goût et de la qualité. «Tutto standard, gusto standard, qualità standard!» Ils se demandent si une agriculture durable est un projet véritablement réaliste, lorsque l’on sait qu’à l’autre bout du monde on clone les vaches et on produit du maïs génétiquement modifié et si la Suisse doit continuer d’assumer un rôle de modèle pour les autres pays. Divers scénarios d’avenir sont envisageables. La tâche de l’agriculture ne sera pas plus facile, loin de là: «Le temps des vaches grasses est terminé!»
1. RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 1.2 ASPECTS SOCIAUX 1 73
■ Décalage entre pronostic et représentation idéale
La comparaison de cette image de l’agriculture dans dix ans avec le portrait d’une agriculture idéale esquissé par les jeunes exploitants agricoles met en évidence de profondes divergences. Dans leur vision de l’agriculture idéale du futur, les jeunes agriculteurs accordent ainsi une importance majeure à un revenu équitable. Or ils pronostiquent une diminution de ce revenu dans l’avenir. De surcroît, les jeunes agriculteurs ne donnent de loin pas aux aspects relatifs à la durabilité l’importance qui, selon leurs pronostics, leur reviendra à l’avenir. Les personnes enquêtées pronostiquent certes que la rationalisation de la production et la présence sur les marchés étrangers gagneront en importance. La rationalisation de la production n’est toutefois pas forcément bienvenue. Ses conséquences, telles qu’une production moins diversifiée, une baisse de l’autosuffisance, une occupation moins décentralisée du territoire ou le recul des exploitations de type familial vont à l’encontre du tableau d’une agriculture idéale évoqué par les jeunes agriculteurs.
Décalage entre pronostic et représentation idéale
Rang 1 PronosticIdéal
Normes environnementales155
Production rationnelle et compétitive147
Production respectueuse du bien-être des animaux139
Présence sur les marchés étrangers121
Espaces récréatifs publics112
Denrées alimentaires de haute qualité1013
Surfaces de compensation écologique93
Image auprès de la population814
Production diversifiée76
Variétés et espèces locales64 Autosuffisance511
Conservation de l’aspect traditionnel du paysage et des localités48
Revenu agricole315
Occupation décentralisée du territoire210
Exploitations paysannes de type familial112
1Attribution de points par ordre d’importance décroissant. Plus le nombre de points est faible, moins l’aspect en question a d’importance, en ce qui concerne respectivement l’évolution pronostiquée et l’agriculture idéale.
Dans le cadre des discussions de groupe, nous avons aussi cherché à savoir ce qui avait motivé les jeunes agriculteurs à choisir ce métier où idéal et réalité sont si éloignés l’un de l’autre. Selon les déclarations des participants au débat, le métier d’agriculteur est parmi les plus intéressants, en raison de la diversité des tâches et de l’indépendance, par comparaison avec d’autres professions. L’amour de ce métier est certainement la plus forte motivation à rester paysan, en dépit du fossé entre souhaits et réalité. «La motivation vient du plaisir à exercer ce métier.» Sans compter d’autres arguments, tels que: «être son propre chef», «travaux diversifiés», «travail en communion avec la nature et les animaux», etc. Ils se sentent «paysans corps et âme.» Obtenir un bon prix
«L’agriculture, c’est la qualité de vie.»
1.2 ASPECTS SOCIAUX 1 74
■ Conditions-cadre à venir
pour ses produits, c’est certainement motivant, mais le développement de l’exploitation accroît aussi la motivation. «Il faut aller de l’avant.» Et lorsque l’on a la chance d’avoir des enfants qui s’intéressent à l’agriculture, la motivation est encore plus forte. L’agriculture est propice à la vie familiale: on a un chez soi, des animaux et la nature toute proche, dans un paysage souvent splendide. Tout cela, c’est de la qualité de vie. De plus, le travail en famille apporte beaucoup de satisfactions et accroît le bien-être personnel. Les traditions vécues donnent aussi des impulsions pour aller de l’avant. Beaucoup d’agriculteurs n’ont pas la même notion des loisirs que le reste de la population. Pour eux, c’est ainsi partir un peu en vacances que d’aller au printemps avec la famille poser une clôture sur l’alpage pour préparer l’estivage. Pour les paysans, le contact avec la nature et les animaux occupe une place centrale. Et puis, lorsqu’on sait tout faire soi-même dans l’exploitation, entre autres assurer la maintenance des machines ou effectuer des travaux de menuiserie, cela procure un sentiment valorisant d’indépendance.
Les jeunes paysans interrogés brossent un tableau plutôt négatif des futures conditions-cadre imposées à l’agriculture. De leur point de vue, tous les éléments qui contribuent à compliquer l’exploitation agricole (exigences, prescriptions et coûts) s’accroissent, tandis que le soutien à l’exploitation agricole (prix à la production, fonds publics, cadre législatif de protection de l’agriculture) diminue.

Nouvelles conditions-cadre1 (n=1023)
Comment les conditions-cadre vont-elles évoluer au cours de la prochaine décennie?
Exigences relatives aux paiements directs Coûts Prescriptions relatives à la protection de l'environnement et des animaux Prescriptions générales Disp. liées à l'aménagement du territoire Mesures régionales Prix à la production Protection par le droit foncier Montant du budget agricole Mesures de protection douanière
Source: Isopublic 1 Plusieurs mentions possibles 0 02040 en % 80 60100 augmente diminue ne change pas pas d'indication 1. RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 1.2 ASPECTS SOCIAUX 1 75
Lors des discussions de groupe, la remarque a été faite que l’environnement personnel et professionnel a au moins autant d’importance que les conditions-cadre économiques et socio-politiques. «C’est extrêmement important de pouvoir travailler dans un bon environnement.» Ils entendent par là avant tout la collaboration avec le ou la partenaire, avec la famille ou au sein de la communauté (partielle) d’exploitation.
La grande majorité des participants aux discussions pensent que les paiements directs demeurent nécessaires en agriculture, même s’ils peuvent freiner la capacité d’innovation ou si certains d’entre eux ne se sentent pas bien dans leur peau de «quasiemployés de la Confédération». Il leur semble important que les contrôles soient effectués partout de la même façon et ils pensent qu’il y a encore des mesures à prendre pour que ce soit vraiment le cas. Seuls devraient recevoir des paiements directs ceux qui font leur travail correctement et respectent leurs obligations. «Aucune différence n’est faite entre ceux qui se donnent de la peine et ceux qui s’en moquent. Les fumistes reçoivent la même chose que les autres» , s’énervent quelques-uns. Ils ne trouvent rien à redire que l’on fasse une différence entre exploitation de plaine et exploitation de montagne. Cependant, l’octroi de paiements directs aux exploitations gérées à titre accessoire ne recueille pas toujours l’assentiment des agriculteurs qui exercent leur métier à titre principal. Du point de vue écologique, les contributions liées à la production animale sont certes plus problématique que les contributions à la surface parce qu’elle favorisent l’intensification de l’élevage, mais elles sont plus appréciées par les agriculteurs: «On ne peut pas régénérer les surfaces comme ça et avoir dix hectares de plus l’année d’après. Ce n’est pas extensible. Tandis que ton cheptel, tu peux toujours le renouveler et l’augmenter.»
La conversion liée à des lobbies d’intérêts de terrains agricoles en zones industrielles ou en terrains à bâtir inquiète les jeunes agriculteurs. «Les terres agricoles doivent rester à l’agriculture.» Mais les communes ont diverses conceptions et stratégies en la matière. De leur côté, les cultivateurs vendent eux aussi des terrains à bâtir pour acheter des terres agricoles et étendre leur exploitation. La pression sur les terres est forte, en particulier quand il s’agit de terrains bien situés.
La plupart sont d’avis que l’agriculture est un domaine où le libre marché ne fonctionne pas. Il faudrait pour cela qu’il y ait des règles, au mieux à l’échelle internationale. En tant que petit pays, pauvre en matières premières, la Suisse est tributaire de l’exportation de biens; les agriculteurs comprennent donc que les conditions régissant l’exportation sont importantes. Par contre, la plupart d’entre eux ne comprennent pas que l’agriculture doive être sacrifiée dans le cadre des négociations OMC en échange de relativement maigres concessions. Ce qui les préoccupe, c’est la perspective d’une baisse des prix, alors que les «standards élevés de qualité» vont être maintenus en Suisse. De l’avis des jeunes agriculteurs, il y a quelque chose qui ne joue plus. Beaucoup doutent par conséquent des bienfaits pour l’agriculture suisse d’un libreéchange avec l’UE. «C’est mauvais pour l’agriculture suisse,» parce que la baisse des coûts n’interviendra pas dans des proportions permettant de compenser les bas prix. Certaines spécialités suisses auront une opportunité sur les marchés étrangers, mais la plupart sont d’avis que ce sont d’autres qui profiteront de l’accord de libre-échange.
1.2 ASPECTS SOCIAUX 1 76
Aperçu de l’accord de libre-échange agricole avec l’UE OpportunitésRisques
–Produits de niche et spécialités
–Vendeurs sans intermédiaire, indépendants des grands distributeurs
–Confiance des consommateurs en la bonne qualité des produits (entre autres bios)
–Lait et produits laitiers
–Pénurie générale de denrées alimentaires
–La marque Suisse a du potentiel
–Chances d’exportation dans le segment des prix élevés
–L’ouverture des frontières aura de toute façon lieu, c’est pourquoi il vaut mieux agir que réagir
–Régions périphériques (région de montagne) avantagées par rapport au Plateau
–Prix plus bas à la production et donc revenu plus bas dans un contexte de coûts pratiquement inchangé
–Baisse du taux d’autosuffisance en raison de l’augmentation des exportations
–Sacrifice des paysans: ouverture des frontières à leurs dépens afin que le reste de l’économie puisse en profiter
–Lutte pour la répartition des fonds publics en raison de l’extrême diversité des structures d’exploitation
–Produits trop chers pour être concurrentiels
–Egalité des chances non assurée (p.ex. au niveau de la déclaration des produits)
–Pollution environnementale en raison des longs trajets de transport
–«Une aide au démarrage» ne suffit pas, pour être ensuite livrés au marché libre
–Conséquences incertaines
Sont indiqués les facteurs mentionnés dans les discussions de groupes, lesquels ne reflètent pas forcément l’opinion de la majorité.
■ Viabilité d’une exploitation
Les jeunes agriculteurs interrogés sont d’avis que les principaux critères de viabilité d’une exploitation sont une base financière solide et l’amour du métier. Les autres facteurs importants sont la flexibilité et une certaine capacité d’innovation, une charge de travail acceptable et un cadre familial propice. Les aspects relevant plutôt d’une optimisation de la gestion de l’exploitation, tels qu’un domaine agricole étendu, une spécialisation, un revenu d’appoint (activité secondaire), une rationalisation, voire une mécanisation accrue, et une diversification, ont été moins fréquemment nommés en moyenne. Par comparaison, les producteurs de la plaine attachent toutefois une plus grande importance à certains aspects plutôt «gestionnaires», tels la taille de l’exploitation, la spécialisation, la rationalisation et la mécanisation. A l’inverse, les agriculteurs de la zone de montagne placent le cadre familial plus haut que les agriculteurs de la plaine dans l’échelle des facteurs favorables à la viabilité.
Une solide base financière et une charge de travail appropriée sont deux souhaits qui semblent difficiles à réaliser pour les jeunes paysans. Lorsqu’on leur a demandé quel était leur plus gros souci, ils ont en effet mentionné en premier lieu le manque de moyens financiers et en troisième lieu (après le corset des charges et des législations), le fardeau de travail.
1. RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 1.2 ASPECTS SOCIAUX 1 77
Critères de viabilité1 (n=1023) Quelles conditions une exploitation doit-elle remplir pour être viable à l'avenir?
Base financière Plaisir à exercer le métier d'agriculteur Flexibilité/esprit d'innovation Charge de travail Environnement familial
1 Plusieurs mentions possibles
Confiance en l'avenir (n=1023) Etes-vous confiant(e) en l'avenir?
Avenir personnel
région de plaine région des collines région de montagne
Source: Isopublic
pas confiant(e) confiant(e) ni l'un ni l'autre pas d'indication
Source: Isopublic
Formation
Spécialisation Exercice
Rationalisation/mécanisation Diversification
Post-formation
Contrôles/Adaptations Taille de l'exploitation
d'une activité accessoire
0 02040
80 60100
en %
Avenir de l'exploitation Avenir de l'agriculture
0 02040
80 60100
en %
132858 417772 1 2135440 1.2 ASPECTS SOCIAUX 1 78
On obtient des résultats similaires à la question portant sur la confiance personnelle en l’avenir: 77% sont confiants et 17% indécis. En ce qui concerne l’avenir de l’exploitation, il y en a tout de même encore 58% qui sont confiants, contre 28% qui se montrent sceptiques. Le manque de confiance en l’avenir est encore plus marqué en ce qui concerne l’agriculture en général, avec 44% de personnes confiantes et 35% de personnes indécises. En résumé, moins de la moitié des personnes interrogées sont optimistes quant à l’avenir de l’agriculture suisse. Ce sont les femmes agricultrices qui se sont montrées les plus pessimistes en ce qui concerne la viabilité de leur exploitation: 19% considèrent leur exploitation comme non viable en comparaison avec la moyenne générale de 8%. Il en est de même des personnes sans formation agricole (16%) et des exploitants de petits domaines (21%). Etant donné que les exploitations de petite taille sont souvent gérées par des femmes ou des personnes sans formation agricole, il est permis de supposer que l’appréciation de la viabilité d’une exploitation se fait surtout en fonction du critère dimensionnel.
«Il y a du potentiel dans la collaboration entre exploitations.»
Lors des discussions de groupe, on s’est en particulier interrogé sur ce que signifiait concrètement une base financière solide pour les jeunes agriculteurs. Selon leurs déclarations, cela signifie d’une part que les coûts ne doivent pas être disproportionnés par rapport aux recettes et d’autre part, que l’exploitation ne soit pas surendettée. De leur point de vue, le taux d’endettement est un facteur déterminant: «lorsque le taux d’endettement est minimal, les chances de survie sont nettement plus grandes!» Il faut cependant disposer aussi d’argent liquide afin de ne pas être obligé de souscrire un crédit pour chaque acquisition. Il y a un problème lorsque les agriculteurs dépassent leur budget pour des acquisitions extraordinaires: «Il nous arrive aussi de nous accorder un peu de luxe.» Etre fortement endetté n’est pas nécessairement un problème lorsqu’on a de hauts revenus, mais il subsiste toujours un risque. Les innovations, en particulier, vont souvent de pair avec de gros investissements. Il faut donc prendre le temps de la réflexion, autrement dit: «Il faut investir en gardant la tête froide et non sur un coup de cœur.» Ou encore: «Il ne faut pas avoir la folie des grandeurs.» Le droit foncier rural impose des limites à l’endettement des exploitants agricoles (limite d’endettement). De plus, les banques aussi étudient aujourd’hui à la loupe les projets des paysans avant d’accorder un crédit, racontent les jeunes agriculteurs. Cependant, attendre sans rien faire ne permet pas d’aller de l’avant: «Comme souvent, il faut trouver la voie moyenne, celle du bon sens!»
L’amour de leur métier est pour eux – et donc pour la survie de leur exploitation – un élément moteur. «Je pense qu’il faut avoir une agriculture que l’on a du plaisir à pratiquer. Quand on a du plaisir à faire quelque chose, tout semble plus facile.» Ou encore: «… celui qui y croît à 100% et s’investit totalement, celui-là est sûr d’obtenir un résultat.»«… quand tu fais quelque chose qui ne te plaît pas, tu ne t’investis pas vraiment et dans l’agriculture, si tu n’y crois pas, tout ça n’a plus aucun sens.»

1. RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 1.2 ASPECTS SOCIAUX 1 79
La collaboration, par exemple dans le cadre d’une coopérative de machines agricole, ne va pas encore de soi dans l’agriculture. Les jeunes agriculteurs pensent toutefois qu’il s’agit d’une stratégie porteuse d’avenir. Elle permet non seulement de partager les coûts, mais aussi de faire l’acquisition en commun de machines plus performantes, de rationaliser davantage encore le travail. Mais beaucoup de paysans pensent autrement: «Chacun veut le beurre et l’argent du beurre.» Les jeunes agriculteurs ne se bercent pas d’illusions et sont conscients qu’il y a évidemment des difficultés à surmonter pour que la collaboration marche. On a toutefois le choix entre diverses possibilités: il n’est pas nécessaire de toujours former immédiatement une communauté d’exploitation, partielle ou totale. Un peu de tolérance permet de mettre de l’huile dans les rouages, d’élargir l’espace de liberté et par-dessus le marché, d’améliorer la performance économique.

Une bonne gestion est primordiale. Elle dépend des agriculteurs eux-mêmes. Il n’y a pas de taille optimale pour une exploitation; elle doit seulement être gérée correctement et quelle que soit l’exploitation, elle sera alors d’une façon ou d’une autre viable. «Ou alors il faut trouver la femme parfaite» dit un autre en plaisantant. La stratégie d’avenir la plus simple passe par l’agrandissement de l’exploitation qui permet de maintenir sa structure: «Exploiter tout un peu plus intensivement.» Les autres stratégies exigent plus d’esprit d’innovation et de flexibilité. Il est aussi demandé aux agriculteurs s’il ne devrait plus y avoir à l’avenir que des exploitations à plein temps, étant donné que ceux qui gèrent des exploitations à titre accessoire freinent l’évolution structurelle, voire l’extension des exploitations gérées à titre principal. «Pour qu’il y ait des gagnants, il faut des perdants.» Mais s’arrêteraient-ils d’eux-mêmes? Renonceraient-ils à ce qu’ils aiment, à ce qui fait leur vie? «Il faut que ce soit donnant donnant.» C’est pourquoi ils estiment que dans certaines circonstances la collaboration entre une exploitation à plein temps et une exploitation à temps partiel peut être une solution d’avenir, car les deux côtés en tirent profit.
Etre viable implique aussi d’être «transformable». Autrement dit, sortir des sentiers battus, être dynamique et novateur. C’est cela être viable. Il est important de rester présent sur le marché: «de sentir les tendances, de les anticiper.» Aujourd’hui pratiquement plus personne ne reste sa vie durant dans la même profession. Au bout d’un certain temps, la plupart souhaitent se recycler, aborder un nouveau domaine. Pourtant, un paysan reste le plus souvent paysan toute son existence, lorsqu’il aime son métier. Une condition importante pour survivre est aussi d’avoir une bonne formation, de pouvoir se perfectionner et de se tenir informé. La différence d’importance accordée à la formation initiale et à la post-formation entre la région de montagne et la région de plaine est expliquée par un «moindre besoin». En région de montagne, les travaux agricoles, en particulier les soins aux animaux, sont moins compliqués que dans les exploitations de plaine aux activités plus diversifiées. De plus, les enfants de paysans de montagne apprennent très tôt à s’occuper des animaux de la ferme: «Ils grandissent avec.» Bien sûr, un enfant ne peut pas apprendre par simple observation à manipuler des produits de pulvérisation, tels qu’ils sont utilisés dans les exploitations de grandes cultures intensives.
1.2 ASPECTS SOCIAUX 1 80
■ Degré de satisfaction
Selon les réponses au questionnaire d’enquête, les trois quarts au moins des jeunes agricultures sont satisfaits de leur existence et se sentent bien dans l’exploitation. Quatre sur dix souhaitent même que les choses restent comme elles sont. Ce qu’ils apprécient le plus dans leur vie d’agriculteur c’est l’autonomie dont ils jouissent, de même que le travail en lien avec la nature et les animaux, effectué dans le cadre de la communauté familiale. A ces déclarations positives sur leur existence font toutefois écho des réflexions moins enthousiastes sur le manque de temps disponible. La moitié d’entre eux avouent avoir trop peu de temps pour eux-mêmes, pour la famille et pour leur partenaire. Ce pourcentage est encore plus élevé (60%) en ce qui concerne le temps disponible pour des loisirs. Cette appréciation se confirme lorsqu’on les questionne sur ce qui constitue leur principale préoccupation: pour 11% d’entre eux, c’est la charge élevée de travail. Un aspect sur lequel les exploitants agricoles de Suisse romande et ceux qui sont à la tête d’un grand domaine insistent encore plus fortement.
Degré de satisfaction (n=1023)
Dans quelle mesure les énoncés suivants correspondent-ils à votre situation?
Je me sens bien dans mon exploitation
Je suis satisfait(e) de mon existence
Je participe à la vie sociale J'espère que les choses restent comme elles sont
J'ai suffisamment de temps pour moi
J'ai suffis. de temps pour ma famille
J'ai suffis. de temps p. mon/ma partenaire
J'ai suffis. de temps pour mes loisirs
Source: Isopublic 0 02040 en % 80 60100 ne correspond pas correspond non pertinent pas d'indication 417781 417772 2030482 3129382 5028211 4833182 4828195 5923152 1. RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 1.2 ASPECTS SOCIAUX 1 81
«Le paysan n’a lui aussi que deux mains. Pour lui aussi les journées n’ont que 24 heures.»
La charge de travail est thématisée au sein des discussions de groupe. De l’avis des jeunes agriculteurs, elle est parfois trop élevée dans l’agriculture: «En faire toujours plus, et encore plus, il arrive un moment où on est au bout du rouleau.» Selon eux, les surcharges de travail se produisent entre autres lors d’extension de l’exploitation et/ou d’engagement dans une activité secondaire. Bien souvent, il ne reste alors plus de temps pour la famille et pour la détente: «Si la semaine avait huit jours, on travaillerait huit jours dans l’exploitation.» En effet, il y a toujours quelque chose à faire dans une exploitation agricole. C’est dans la nature des choses. Aussi est-il indispensable de fixer des priorités: «C’est à moi de m’organiser.» Ce qu’il y a de bien dans le métier d’agriculteur, c’est justement qu’on peut organiser son travail à sa guise: «Moi, chacun d’entre nous en tant que paysan, peut répartir les tâches comme bon lui semble, décider de ce qu’il va faire, comment et à quel rythme.» «Rien n’est imposé, chacun est son propre maître.» Il est également important pour les jeunes agriculteurs de ne pas perdre le contact avec l’entourage à force de travailler. La charge de travail peut être extrêmement élevée durant les phases d’aménagement de l’exploitation, mais une fois achevée la transformation ou la nouvelle construction, on peut escompter une amélioration de la qualité du travail et donc de la qualité de vie. Grâce à la mécanisation, la charge physique n’est pas le problème. Il s’agit plutôt de la pression financière, de la «nécessité d’entreprendre»: «Il faut gérer, maintenir la rentabilité de l’entreprise et innover sans arrêt d’une façon ou d’une autre.»
Quand on vit toujours sous la pression du temps, la formation continue en souffre: «Je suis tellement épuisé par le travail que je n’ai plus envie de me perfectionner. Je suis submergé par les tâches administratives, je ne peux plus m’occuper de ma formation continue.» Une telle charge de travail est-elle supportable à la longue sans que la santé physique et psychique des paysans en pâtisse? «Certains peuvent soutenir ce rythme 50 ans et rester en pleine forme; d’autres doivent déclarer forfait au bout de dix ans parce ce n’est plus normal, surtout pour la famille. Il faut alors que quelque chose change.» Il est possible de réduire la charge de travail par une collaboration accrue. L’extension des exploitations ne peut plus être compensée par l’achat de machines plus performantes (et plus chères). Les jeunes agriculteurs souhaiteraient en outre que leur exploitation reste dans des dimensions leur permettant d’effectuer le travail avec la main-d’œuvre familiale. En effet, la plupart d’entre eux n’ont pas les moyens financiers d’embaucher des employés agricoles.
Dans l’agriculture on ne doit pas compter ses heures. Ce qui compte ce sont les heures passées dans la nature, avec les enfants, avec le ou la partenaire, soulignent les participants à la discussion. Pourtant, pour un agriculteur aussi, prendre des vacances devrait être normal: «Tout paysan devrait pouvoir partir de temps à autre, changer un peu d’horizon.» Pouvoir communiquer avec d’autres est aussi un facteur de bien-être dans l’agriculture: «Moi, pour le bien-être, ce que je fais beaucoup c’est parler avec mon épouse.» La vie à la ferme est encore plus belle quand on a une famille, dit une jeune agriculteur. «On joue beaucoup, on rigole beaucoup sur la ferme.» Les jeunes agriculteurs apprécient tout particulièrement de pouvoir jouer leur rôle de père: «Moi, je profite le maximum de mes enfants.» Et en hiver, lorsqu’il y a moins de travail, on a parfois du temps pour le sport ou d’autres activités.

1.2 ASPECTS SOCIAUX 1 82
■ Conclusion
Un autre aspect important de leur vie de famille est de faire aimer à leurs enfants le métier d’agriculteur: «C’est un truc important de montrer à nos enfants la nécessité de l’agriculture.» «Pour ceux qui viennent derrière, il est important de leur montrer que leur père n’est pas seulement un résigné qui trime 365 jours par an sans autre horizon que le bout de son champ, mais qu’il est aussi capable de penser, d’apprendre et d’enseigner à sa manière.» Par contre, les soucis financiers peuvent, eux, gâcher considérablement l’existence.
Pour les jeunes agriculteurs, la vocation première de leur métier est de produire des denrées alimentaires de haute qualité, tout en respectant l’environnement et le bienêtre des animaux, entre autres grâce à un mode de production écologique et à des produits de terroir. Ils pensent en revanche que la population surestime l’importance de l’entretien du paysage et de la biodiversité. Une agriculture selon leurs conceptions est avant tout productive. En d’autres termes, les bonnes terres devraient être utilisées pour la production de denrées alimentaires et non pour l’aménagement de prairies florales. L’entretien du paysage comme but en soi ne s’accorde pas avec la perception qu’ils ont d’eux-mêmes en tant que producteurs de denrées alimentaires. Comme la vocation première de l’agriculture, à savoir nourrir la population, a regagné en importance suite à la crise alimentaire et à la crise énergétique à l’échelle planétaire, ils se sentent quelque peu confortés dans leur opinion. Les agriculteurs enquêtés sont conscients qu’un éventuel accord de libre-échange agricole avec l’UE entraînerait à coup sûr de grands changements et des mutations structurelles accrues dans l’agriculture. Les uns se préparent activement à relever ces défis, d’autres les redoutent. Les jeunes agriculteurs estiment que dans tous les cas de figure les revenus ont peu de chance de s’améliorer dans l’agriculture au cours des prochaines années. Ils pensent que leur dépendance par rapport aux paiements directs réduit leur autonomie, mais ils reconnaissent la nécessité d’un soutien étatique. Ils continuent ainsi de dépendre des décisions du politique et doivent par conséquent bénéficier d’une bonne image auprès de la population. Il est vrai que certaines conceptions personnelles entrent en conflit avec les exigences imposées par la société à l’agriculture, mais la plupart des jeunes agriculteurs restent motivés par l’amour de leur métier. En reprenant l’exploitation parentale, ils ont opté sciemment pour l’agriculture. Cela dit, pour qu’une exploitation agricole soit viable, il ne suffit pas que les finances soient solides, il faut aussi que la charge de travail reste supportable pour l’agriculteur et sa famille. Les jeunes agriculteurs considèrent que la collaboration entre exploitations représente un important potentiel de développement, mais le sentiment d’autonomie et d’indépendance qui les caractérisent freine, voire empêche souvent, la réalisation d’associations. L’état d’esprit des jeunes agriculteurs est le plus souvent positif: en dépit de toutes les craintes et incertitudes exprimées, moins de 15% de ceux qui ont répondu au questionnaire ne sont pas confiants en ce qui concerne l’avenir de leur exploitation.
1. RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 1.2 ASPECTS SOCIAUX 1 83
1.2 ASPECTS SOCIAUX 1 84
Le présent rapport agricole présente en premier lieu des données de base sur l’utilisation du sol et sur les moyens de production. Il approfondit ensuite selon un programme préétabli pour chaque exercice sous revue, diverses thématiques faisant l’objet d’un suivi écologique (monitoring):
–phosphore et sol (2002, 2006, 2010)
–énergie et climat (2003, 2007, 2011)
–azote et eau, y compris produits phytosanitaires (2004, 2008, 2012)
–biodiversité et paysage (2005, 2009, 2013)
Les thèmes «azote et eau» sont traités ici pour la deuxième fois depuis 2004. Pour des informations de fond plus détaillées, en particulier sur l’azote, on se reportera donc au rapport agricole 2004.
En ce qui concerne l’azote, il est d’abord donné un aperçu des flux d’azote dans l’agriculture et l’environnement, suivi d’une comparaison internationale des chiffres clés. Suite au débat sur les objectifs agroécologiques, qui était axé sur les émissions d’ammoniac, la présente édition explore diverses facettes de la problématique en relation avec les valeurs cibles agroécologiques: formation des immissions d’ammoniac et d’ammonium, teneurs en nitrates de la nappe phréatique, excédent du bilan d’azote et efficience de l’azote. Des données issues du projet «Dépouillement centralisé des bilans écologiques d’exploitations agricoles» sont présentées pour la première fois. Enfin, il est donné un aperçu prospectif (modélisation) de l’évolution des émissions d’azote dans les années à venir.
Le chapitre consacré aux produits phytosanitaires passe en revue les réglementations en matière de protection de l’homme et de l’environnement, puis présente l’évolution de l’utilisation des produits phytosanitaires et la surveillance de leurs traces, dans les eaux souterraines de façon générale, et plus particulièrement, à l’exemple de l’atrazine.

■■■■■■■■■■■■■■■■■ 1.3Ecologie
■■■■■■■■■■■■■■■■■ 1.3.1Ecologie
et éthologie
1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 85
Utilisation des terres et moyens de production
Evolution du pourcentage de superficies cultivées selon un mode respectueux de l'environnement en % de la SAU Exploitation respectueuse de l'environnement 1 dont bio Source: OFAG 1 1993 à 1998: PI+bio; à partir de 1999: PER 1993199419951996199719981999200020012002 0 100 80 60 40 20 90 70 50 30 10 2007 2006 2005 2004 2003
des surfaces de compensation écologique1 19931994199519961997199819992000200120022003200520062007 2004 en 1 000 ha Région de montagne Région de plaine Source: OFAG 1 sans les arbres fruitiers haute-tige; les chiffres d'avant 1999 concernent seulement les surfaces de compensation écologique donnant droit aux contributions 0 140 120 100 80 60 40 20 Evolution du cheptel 19901996199719981999200020012002200520062007 2004 2003 par 1000 GVE 1 Autres Porcs Bovins Source: OFS 1 UGB: unité de gros bétail 0 1 500 1 250 1 000 750 500 250 1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 86
Evolution

Evolution de l'utilisation d'engrais minéraux en 1 000 t Azote (N)Phosphate (P2O5) Source: USP 19901992 1993199519971999200119941996199820002002 0 80 70 60 50 30 40 20 10 20032007 200420052006 Evolution de l'utilisation d'aliments concentrés en 1 000 t Autres produits CH Tourteaux d'oléagineux CH Céréales fourragères CH Transformation de produits importés Aliments fourragers importés Source: USP 19901992 19941996199820002002 1993199519971999200120032007 (prov.) 200420052006 0 2 000 1 750 1 500 1 250 1 000 750 500 250 1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 87

Evolution des ventes de produits phytosanitaires en t de substance active Fongicides, bactéricides, désinfectants de semences Herbicides Insecticides, acaricides Régulateurs de croissance Rodenticides Source: Société suisse des industries chimiques (SSIC) 1 Nouvelle enquête; données 2007 pas encore disponibles 19901992 19941996199820002002 19931995199719992001200320071 200420052006 0 2 500 2 000 1 500 1 000 500 1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 88
■ Activateur de la production de biomasse et risque pour l’environnement
Azote
L’azote est soumis à un cycle naturel de transformation permanente relativement compliqué. Des processus biogéochimiques le transforment en divers composés azotés qui sont déchargés, dans un rayon de quelques micromètres à plusieurs kilomètres et sur une échelle de temps de quelques secondes à plusieurs jours, dans l’atmosphère, les eaux, le sol et la biomasse. L’agriculture est engagée à double titre dans le cycle de l’azote: elle influe sur lui et il agit sur elle. L’azote a une importance primordiale dans l’agriculture. Il favorise la production de biomasse: du fait que l’azote est rarement présent dans le sol en tant que substance nutritive, l’apport d’azote est un facteur déterminant du rendement de la production végétale. Cependant, des émissions accrues d’azote en provenance de l’agriculture, de l’industrie et du trafic motorisé peuvent aussi avoir des effets négatifs sur la production agricole, en plus d’autres conséquences nuisibles.
Une partie de l’azote utilisé en agriculture parvient dans la substance organique de produits végétaux et animaux ou du sol. Une partie de cet azote est improductive et donc perdue pour la production agricole. Sous forme d’azote élémentaire (N2), ces émissions sont sans conséquence pour l’environnement. Cependant, si l’azote est perdu sous la forme d’ammoniac (NH3), de nitrate (NO3) ou de gaz hilarant (N2O), il peut dégrader l’air, l’eau, le sol et les associations végétales, et surtout les écosystèmes sensibles comme les forêts, les hauts-marais et les prairies maigres. Il en résulte une acidification et une fertilisation excessive du sol, une eutrophication des eaux de surface, une pollution de la nappe phréatique, une réduction de la couche d’ozone, un renforcement de l’effet de serre et une diminution de la biodiversité dans les écosystèmes sensibles. L’ammoniac contribue de surcroît à la formation d’aérosols secondaires dans l’atmosphère qui, sous la forme de particules fines (PM10), mettent en danger la santé humaine. Lors de combustion, il se produit des émissions de dioxyde d’azote (NO2) qui contribuent à la déposition d’azote et à la formation d’ozone près du sol. L’ozone est un gaz irritant qui peut porter atteinte à la santé des êtres humains et également des végétaux et des animaux, et faire ainsi baisser les rendements de la production végétale et animale.
■ L’ammoniac, les nitrates et le gaz hilarant proviennent en majeure partie de l’agriculture
L’agriculture n’est pas seule responsable de toutes les émissions d’azote nuisibles à l’environnement, mais elle est la principale émettrice d’ammoniac (plus de 90% des émissions), de nitrates (près de 75%) et de gaz hilarant (près de 80%). En ce qui concerne les émissions d’oxydes d’azote, d’autres sources, principalement le trafic, viennent au premier plan. Par contre, l’agriculture est responsable de moins de 10% des émissions d’oxyde d’azote.
La production totale de composés azotés susmentionnés nuisibles à l’environnement en provenance de l’agriculture est en baisse depuis 1994. La part de l’agriculture au total des émissions a toutefois augmenté durant cette même période, vu que les émissions d’oxyde d’azote ont plus fortement diminué que celles des composés azotés issus principalement de l’agriculture, par suite des prescriptions plus sévères relatives à la pureté l’air (ordonnance sur la protection de l’air).
1. RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 89
■ Le cycle de l’azote est complexe …
La représentation graphique du cycle de l’azote donne un aperçu des principaux flux d’azote dans l’agriculture ainsi que de celui de l’azote introduit dans le système agricole (élevage et culture fourragère) et de celui sortant de ce système. Du point de vue quantitatif – sachant que les données doivent être interprétées comme des valeurs moyennes approximatives portant sur plusieurs années – la somme de tous les apports s’élève à 155 kilotonnes N (30 kt N de fourrages importés +55 kt N d’engrais minéraux et d’engrais de recyclage +40 kt N de fixation biologique +30 kt N de dépôts atmosphériques). Cette valeur est bien supérieure à la somme de l’azote contenu dans les produits agricoles, à savoir 40 kilotonnes N (30 kt N dans les denrées alimentaires animales +10 kt N dans les denrées alimentaires végétales). L’efficience de l’azote dans l’agriculture est ainsi inférieure à 30%.
Représentation schématique du cycle de l’azote1
Atmosphère
Produits alimentaires d‘origineanimale
Production animale
Aliments fourragers acquis
Anthroposphère
Aliments pour animaux d‘origine animale
Aliments pour animauxd‘origine végétale
Engrais deferme
Pertes de récoltes
Production végétale
Autres sources d‘émissions: trafic motorisé, industrie, ...
Denrées alimentaires d‘origine végétale
Engrais minéraux Engrais de recyclage
Pédosphère Hydrosphère
AgricultureSecteur non agricole
Source: OFAG
La différence entre les apports et les exports se répartit sous forme d’excédent entre divers points du cycle de l’azote («excédent du bilan d’azote»). Si cet excédent ne peut pas être stocké, il est perdu. Le sol peut apparaître comme étant le plus grand réservoir potentiel d’azote. Cependant, étant donné qu’en raison du mode actuel prédominant d’exploitation agricole, on part du principe que l’ensemble de la réserve d’humus des sols agricoles ne varie pas beaucoup en l’espace de quelques années, le stockage correspond en moyenne à peu près au déstockage d’azote dans le sol. Il s’ensuit que du point de vue quantitatif, l’excédent d’azote correspond grosso modo à la somme des pertes d’azote. Les plus grandes quantités se perdent sous forme d’ammoniac (>35 kt N), de nitrates (>30 kt N), d’azote élémentaire (>20 kt N) et de gaz hilarant (>5 kt N).
1 L’agriculture (limite du système agricole représenté par la ligne en traitillés) figure au premier plan. En arrière plan, sont représentées les principales interactions entre l’agriculture et les diverses écosphères.
1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 90
■ … de nombreuses questions restent encore sans réponse
Il importe donc de mieux valoriser l’azote. Cependant, même à long terme, la production agricole ne sera pas possible sans occasionner des pertes d’azote préjudiciables à l’environnement. A divers niveaux – alimentation animale et sol, entre autres – se déroulent des processus biologiques au cours desquels les pertes d’azote sont inévitables. Cela dit, la production animale occasionne généralement des pertes d’azote plus élevées que la production végétale. Tandis qu’en culture des champs, le problème majeur est la lixiviation des nitrates qui s’infiltrent dans la nappe phréatique, en production animale, ce sont les émissions d’ammoniac dans l’air.
Il s’agit d’un cycle compliqué dans sa globalité. Etant donné qu’il y a un échange constant entre les diverses formes d’azote, il ne faut jamais considérer isolément un aspect partiel du problème des pertes d’azote. Ainsi, lorsque les émissions d’ammoniac sont réduites lors de l’épandage des engrais de ferme sans réduction appropriée de l’apport en engrais minéraux azotés, une quantité accrue d’azote s’infiltre dans le sol. Celui-ci peut être directement absorbé par les plantes, mais il peut aussi s’intégrer au processus de nitrification/dénitrification et être ainsi transformé en nitrate (NO3), gaz hilarant (N2O), dioxyde d’azote (NO2) ou azote élémentaire (N2). Cela peut entraîner, entre autres, la lixiviation de nitrates ou l’augmentation des gaz hilarants.
De nombreux processus peuvent se dérouler de façon très variable, ce qui détermine l’importance des émissions d’azote. Dans le domaine de l’agriculture, l’alimentation des animaux, le système de stabulation, le nettoyage des surfaces, le mode de production du fumier et du lisier, le taux de déjection d’éléments nutritifs par les animaux, le traitement des engrais de ferme (dilution, fermentation, compostage, etc.), la technique d’épandage des engrais, le choix des cultures, le type d’exploitation du sol et d’utilisation de la culture fourragère, la gestion des pâturages, la formation et la décomposition de l’humus des sols etc., sont autant de processus importants, dont certains aspects particuliers ne sont pas encore suffisamment élucidés. Effectuer des mesures dans les champs, à l’étable, dans la cour d’exercice et dans les entrepôts est à la fois coûteux et compliqué. On obtient de plus des résultats divergents en fonction de la situation initiale et des conditions cadre. Cela montre qu’en pratique, la marge d’incertitude concernant l’ampleur des pertes d’azote est considérable et que l’on ne peut apprécier qu’approximativement l’impact des mesures prises dans l’agriculture. Des travaux de recherche sur le sujet sont en cours ou prévus.
■ Utilisation de l’azote et émissions d’azote en comparaison internationale (moyenne)
Les trois graphiques suivants sur l’évolution des principaux aspects de la problématique de l’azote dans l’agriculture (bilan d’azote, utilisation d’engrais minéraux azotés et teneur en nitrate dans la nappe phréatique) indiquent la position de la Suisse en comparaison internationale. Pour de plus amples informations, on se reportera au rapport de l’OCDE (voir bibliographie en annexe).
1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 1. RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 91
Evolution du bilan d'azote de 1990–92 à 2002–04
–50–2550 025 en %
Source: OCDE actualisé
L’excédent du bilan d’azote (en t N) dans l’agriculture des pays de l’OCDE a diminué de 17% durant la période 1990–92 à 2002–04. La diminution en Suisse (environ 14%) est légèrement inférieure. Les pays qui ont enregistré une augmentation de cet excédent durant la période de référence ont en moyenne des excédents plus faibles en kg par hectare, tandis que les pays qui enregistrent les plus fortes diminutions sont en majorité ceux qui ont des excédents d’azote particulièrement élevés à l’hectare. En Suisse, l’excédent d’azote par hectare est inférieur à la moyenne OCDE.
Evolution de l'utilisation des engrais minéraux azotés: 1990–92 à 2002–04
–50–2550 025 en %
Source: OCDE élargi
Nouvelle-Zélande Portugal USA Pologne Suisse France Norvège OCDE Allemagne UE15 Autriche Pays-Bas 46 47 37 48 57 54 77 74 113 83 48 229 Moyenne 2002–04 [kgN/ha]
Nouvelle-Zélande Canada Espagne OCDE Allemagne France UE15 Suède Autriche Suisse Pays-Bas Rép. slovaque 26 27 37 23 106 79 66 57 31 36 152 34 Moyenne 2002–04 [kg/ha]
1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 92
■ Les objectifs intermédiaires agroécologiques concernant l’azote sont en partie atteints

L’utilisation d’engrais minéraux azotés (en t poids du produit de base) a augmenté de 3% dans les pays de l’OCDE durant la période étudiée, en particulier parce que divers grands pays, pour la plupart non européens, utilisent davantage d’engrais azotés qu’auparavant. L’utilisation en a même été multipliée par deux en Australie et en Nouvelle-Zélande. A cet égard, la Suisse qui a diminué d’environ 20% l’utilisation des engrais minéraux azotés est nettement mieux placée dans la comparaison des pays de l’OCDE.
Pourcentage des stations de mesure des eaux souterraines présentant un dépassement de la teneur en nitrates autorisée1
Source: OCDE
En ce qui concerne la comparaison des teneurs en nitrates dépassant celles tolérées dans l’eau potable, il y a lieu de relever que les programmes de mesure divergent d’un pays à l’autre, mais aussi les exigences relatives à la teneur en nitrates de l’eau potable. Tandis que dans l’UE la valeur-seuil tolérée pour les nitrates est de 50 mg/l, elle est de 10 mg/l aux Etats-Unis. En Suisse, le maximum toléré est de 40 mg/l. Une concentration maximale de nitrate de 25 mg/l dans les cours d’eau servant à l’alimentation en eau potable et dans les eaux souterraines servant d’eau potable ou que l’on prévoit d’utiliser à cet usage est en outre imposée. Bien que la fiabilité de ces estimations soit relative, il s’avère qu’en comparaison internationale, la Suisse présente relativement peu de dépassements des valeurs autorisées par la législation sur les denrées alimentaires concernant l’eau potable.
En 2002, dans son Message sur l’évolution future de la politique agricole (PA 2007), le Conseil fédéral avait fixé pour la première fois des objectifs intermédiaires à moyen terme. Trois sur sept concernaient l’azote:
–réduction de 23% des pertes d’azote dans l’environnement d’ici 2005 par rapport à l’année de référence 1994; –réduction de 9% des émissions d’ammoniac d’ici 2005 (année de référence 1990); –teneur en nitrate inférieure à 40 mg/l dans 90% des points de captage d’eau potable dont l’aire d’alimentation est utilisée par l’agriculture.
Danemark Pays-Bas Italie USA France Grande-Bretagne Autriche Allemagne Hongrie Tchéquie Suisse Norvège 101520 35 052530 en %
1 Pourcentage de stations de mesure situées dans des régions à dominante agricole qui présentent une teneur en nitrates supérieure aux valeurs nationales pour l'eau potable, moyenne 2002–04
1. RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 93
Valeurs de base agroécologiques, objectifs et évaluation de la concrétisation des objectifs
ObjectifUnité/BaseEtat futurEtat actuel AppréciationBut Etat actuel Appréciation Indicateurdu résultat PA 2011du résultat obtenuobtenu
Données selon texte du Message Nouvelle appréciation du 17 mars 2006 sur la PA 2011 juin 2008
Bilan d’azote Réduction des pertes d’azote préjudiciables à l’environnement Réduction
1Selon la méthode OSPAR.
2Les méthodes utilisées jusqu’ici pour le calcul des pertes d’azote préjudiciables à l’environnement et des émissions d’ammoniac doivent être revues. Les nouveaux résultats devront être disponibles d’ici fin 2008. Les valeurs de base, les valeurs effectives et les valeurs cibles doivent être recalculées.
Le Message concernant l’évolution future de la politique agricole (PA 2011) a défini les mesures agroécologiques à prendre en se fondant sur les objectifs concrétisés en 2002. Etant donné que la méthode de calcul des pertes d’azote se répercutant sur l’environnement a dû être adaptée, on ne disposait pas de chiffres fiables pour 2002 concernant cet indicateur. On a donc retenu comme premier objectif l’excédent d’azote (bilan d’azote selon OSPAR) comme valeur de remplacement et, par rapport à la valeur de référence de 123’000 t N pour 1994, on s’était également fixé comme objectif une réduction de 23% jusqu’en 2005. Selon le bilan présenté dans le Message sur la PA 2011, deux des trois objectifs concernant l’azote ont été atteints. En ce qui concerne les émissions d’ammoniac et les nitrates, dans l’état des connaissances actuelles, les objectifs fixés ont même été dépassés. En 2002, par contre, l’excédent d’azote s’élevait à 115’000 t et dépassait ainsi nettement la valeur-cible de 95’000 t. L’objectif initialement fixé concernant le bilan d’azote a été par conséquent repoussé de 2005 à 2015 et celui relatif à l’ammoniac a été renforcé (réduction de 23% par rapport à 1990 d’ici 2009). Aucun nouvel objectif n’a été défini en ce qui concerne les nitrates: la valeurcible appliquée a rendu difficile une interprétation de l’évolution des teneurs en nitrates dues à l’activité agricole dans la nappe phréatique. En effet, les captages d’eau potable à forte teneur en nitrates ne sont parfois plus utilisés et n’entrent donc pas dans la catégorie considérée.
Emissions d’ammoniac Réduction des émissions d’ammoniac Nitrate Teneur en nitrate de l’eau provenant de captages d’eau potable dont l’aire d’alimenta-
excédent
t N en émissions NH3 % des captages présentant moins de 40 mg NO3/l 1994 96 000 123 000 1990 53 300 1990 pas d’indication 2005 74 000 (–23%) 95 000 (–23%) 2005 48 500 (–9%) 2005 90 2002 pas d’indication 2 115 000 (–6,5%) 2002 43 700 (–18%) 2002/3 97 impossible2 non réalisé réalisé réalisé 20152 95 000 (–23%) 2009 41 000 (–23%) 220052 111 000 2005 pas d’indication 2 2005 93 pour 2005 impossible non réalisé pour 2005 impossible réalisé
des excédents d’azote
tion est utilisée par l’agriculture t pertes d’azote préjudiciables à l’environ. t
d’azote1
1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 94
■ Nécessité de fixer un nouvel objectif pour l’ammoniac
Une estimation récente (juin 2008) sur la base des données obtenues en 2005 et de nouvelles conclusions confirment l’appréciation faite dans le Message sur la PA 2011 concernant les objectifs relatifs au bilan d’azote (excédent effectif maximal de 111’000 t, objectif non atteint) et aux nitrates (93% des captages d’eau potable présentant une teneur en nitrates inférieure à 40 mg/l, objectif atteint). Il subsiste néanmoins des doutes quant à la prétendue réduction d’environ 20% des émissions d’ammoniac entre 1990 et 2002:
–Les séries chronologiques d’inégale longueur relatives aux données de mesure des immissions d’azote suisses dont on dispose actuellement ne parviennent pas à confirmer la diminution modélisée (cf. graphiques ci-après).
–L’Italie, la France, l’ancienne Allemagne de l’Ouest et l’Espagne, pays qui contribuent le plus après la Suisse au dépôt global d’azote en Suisse, n’ont enregistré dans l’ensemble aucune réduction des émissions d’ammoniac durant cette même période.

–Les nouvelles méthodes de garde des animaux (étables à stabulation libre, aires d’exercice, etc.) ont tendance à provoquer une augmentation des émissions d’ammoniac.
–La réduction calculée par modélisation des émissions d’ammoniac laissait attendre une diminution plus marquée de l’excédent d’azote durant cette période.
Il s’est avéré que le modèle Dynamo utilisé jusqu’ici pour effectuer l’évaluation pronostique des émissions d’ammoniac en provenance de l’agriculture n’a pas reproduit correctement divers processus partiels. Le modèle a donc été révisé en 2006. La nouvelle version, Agrammon, sera disponible vers la fin 2008. Les nouveaux calculs mettront en évidence l’évolution en matière d’émissions d’ammoniac en provenance de l’agriculture. En fonction des résultats de ces calculs, les déclarations faites dans les Messages sur la PA 2007 et la PA 2011 concernant la valeur de référence 1990 et la concrétisation des objectifs 2005 (voire 2002) seront révisées et, sur la base d’une estimation de l’effet des futures mesures, de nouveaux objectifs intermédiaires seront fixés pour la réduction d’émissions.
Ci-après sont présentés certains aspects en rapport avec les objectifs agroécologiques.
1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 95
Les émissions d’ammoniac et d’ammonium n’ont pas diminué
■ en µg/m 3
En Suisse, les mesures des émissions d’ammoniac (NH3) (saisie des données à un emplacement défini) sont disponibles en permanence à 16 emplacements depuis 2000. Les résultats de ces mesures ne font ressortir aucune tendance nette. Le réseau de mesure a été entre-temps considérablement étendu. Les données récoltées ces dernières années dans plus de 50 stations de mesure ne permettent toutefois pas de discerner une tendance à la diminution.
Suisse 2000–071
Près de la moitié en moyenne des émissions d’ammoniac libérées dans un rayon de quelques kilomètres de leur source sont déposées sous forme de divers composés d’azote. Le reste se transforme en ammonium, qui peut être transporté dans l’atmosphère sur de longues distances (des centaines de kilomètres), avant de retomber sur la surface terrestre sous forme de précipitations ou de poussières.

Concentration d'ammoniac en
Egalement en ce qui concerne la quantité de NH4 apportée par les précipitations, les stations de mesure de Dübendorf (agglomération), de Payerne, du Rigi et de Chaumont (campagne) n’enregistrent pas de tendance à la baisse dans la moyenne annuelle des charges: ni depuis 1997 aux stations du Rigi et de Chaumont ni depuis le début des mesures effectuées en 1990 à Dübendorf et Payerne. 20002001200220032004200520062007
Source: Forschungsstelle für Umweltbeobachtung fub
4,0 3,0 3,5 2,0 2,5 1,0 1,5 0,5 0 1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 96
1 Moyennes annuelles de 16 stations calculées pour chacune des 8 années
■ La teneur en nitrates de la nappe phréatique a de nouveau augmenté
Aux stations du réseau NABEL de Payerne (depuis 1994, avec interruptions) et du Rigi (depuis 2000), les sommes de NH3 (état gazeux) et de NH4 (aérosols) sont également calculées. A cet égard aussi, aucune tendance n’est perceptible. Fait intéressant, cette somme est également calculée ailleurs qu’en Suisse, ainsi dans deux stations de mesure situées au Danemark. Depuis le début des mesures, en 1990, jusqu’en 2005, on n’y a noté une diminution d’environ la moitié de la charge de polluants. Le Danemark a en fait déjà pris de nombreuses mesures pour réduire les émissions d’ammoniac. En 1990, la charge polluante y était à peu près aussi élevée qu’à Payerne.
Entre 1997 et 2002, les teneurs en nitrate en Suisse ont eu tendance à baisser, principalement dans les régions à vocation essentiellement agricole. Depuis, elles remontent. Ce sont les stations de mesures implantées dans des zones principalement réservées à l’exploitation herbagère et à l’élevage qui enregistrent l’augmentation la plus forte. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette augmentation. On sait qu’une année exceptionnelle – due à l’ampleur du renouvellement de la nappe phréatique et à la durée de stagnation de l’eau – peut avoir des répercussions sur plusieurs années. C’est ainsi qu’une explication émet l’hypothèse qu’en raison de l’été caniculaire de 2003, les plantes n’ont absorbé que peu de substances nutritives. Les nitrates se sont donc accumulés dans le sol, ont été lessivés par les précipitations automnales et hivernales 2003/04, puis se sont infiltrés dans la nappe phréatique. Certaines conversions dans le mode d’exploitation agricole, tel le changement du type de couverture végétale pendant l’hiver, ont pu aussi avoir exercé une influence. Il est intéressant de comparer avec ce qui s’est passé dans les pays voisins: dans le Bade-Würtemberg, la charge de nitrates dans la nappe phréatique qui avait augmenté en 2004 et 2005 est redescendue à sa valeur des années 2002/2003.
1990919293949596979899200001020304050607 en mg N/m 2 par an Rigi Dübendorf Payerne Chaumont
Charge en ammonium des eaux de pluie en Suisse 1990–2007
0 700 600 500 400 300 200 100 800 1. RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 97
Source: Réseau national d'observation des polluants atmosphériques (NABEL)
en mg/l
Concentration de nitrates dans les eaux souterraines en Suisse 1997–20061
1997199819992000200120022003200420052006
Utilisation principale du sol «culture des champs» (n=35)
Utilisation principale du sol «Economie herbagère & élevage» (n=42)
Source: OFEV
En 2006, 16% des stations de mesure du Réseau national d’observation de la qualité des eaux souterraines (NAQUA) implantées dans des zones principalement consacrées à la culture des champs ont enregistré des valeurs de nitrates de plus de 40 mg/l et 45%, des valeurs situées entre 25 et 40mg/l. En ce qui concerne les zones principalement consacrées à l’économie herbagère et à l’élevage, dans 6% des stations de mesure, les valeurs de nitrates étaient supérieures à 40 mg/l et dans 15%, elles se situaient entre 25 et 40 mg/l. Ce sont en majorité les stations de mesure situées sur le Plateau qui enregistrent des concentrations croissantes de nitrates. On n’observe que peu de changements dans les stations situées dans les Alpes, qui enregistrent des concentrations de nitrates le plus souvent proches de l’état naturel.
Répartition spatiale des teneurs en nitrates dans les eaux souterraines1
Modification de la teneur en nitrates 2003–2006 a augmenté est restée la même (±1 mg/l) a baissé
OFEV
0 25 20 15 10 5 30
1 Données provenant des stations de mesure NAQUA situées dans des régions à dominante agricole des cantons AG, BE, BS, GE, JU, NE, NW, SO, SZ, VD, ZH; médiane des valeurs moyennes annuelles de nitrate, par station de mesure
Teneur en nitrates 2006 <25 mg/l 25 mg/l–40 mg/l >40 mg/l Part de cultures <5% 5–20% 20–40% >40%
Source:
1 Valeurs pour 2006, y compris les modifications par rapport à 2003. Sont représentées les stations de mesure NAQUA avec la principale utilisation du sol grandes cultures.
1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 98
En ce qui concerne les émissions d’azote, la valeur la plus sûre pour estimer la tendance est l’excédent d’azote. A supposer que la réserve d’azote contenue dans le sol en moyenne de toutes les surfaces ne varie pratiquement pas d’une année à l’autre, l’excédent d’azote est vraisemblablement équivalent aux pertes d’azote qui se produisent à un point ou un autre du système (cf. paragraphe sur l’excédent du bilan d’azote). Pour le calcul des excédents d’azote selon la méthode OSPAR, l’ensemble de l’agriculture suisse est considérée comme une unique exploitation. Est considéré comme input, tout ce qui parvient dans l’agriculture de l’extérieur. Les aliments pour animaux et les engrais minéraux importés sont comptés dans l’input, mais pas les aliments pour animaux et les engrais de ferme indigènes vu qu’ils sont produits dans l’exploitation agricole. Est considéré comme «output» tout ce qui quitte l’exploitation agricole, autrement dit, les produits alimentaires d’origine animale et végétale. Les aliments produits dans l’exploitation pour nourrir les animaux restent dans le système «agriculture» et ne sont donc pas considérés comme output (cf. partie délimitée par un traitillé du graphique sur le cycle de l’azote).
Au début des années nonante, l’excédent d’azote a nettement diminué, pratiquement parallèlement à l’utilisation des engrais minéraux. A la fin de la dernière décennie, l’excédent a de nouveau augmenté légèrement jusqu’en 2003. Cette évolution s’explique surtout par les quantités croissantes d’aliments pour animaux importés (conséquence entre autres de l’interdiction des farines animales pour alimenter les animaux) et d’engrais minéraux (conséquence entre autres de l’interdiction de l’utilisation de boues d’épuration pour la fertilisation). Aucune tendance claire ne se dégage depuis 2003.
Evolution du bilan d'azote et des inputs d'azote selon la méthode OSPAR 1990919293 94 95969798992000010203040506 en 1000 t N
ART 0 120 100 80 60 40 20 140 Bilan d'azote Fixation et déposition d'azote Engrais minéraux Aliments pour animaux et semences importés Engrais à base de déchets et autres engrais ■ Evolution du bilan excédentaire d’azote et efficience de l’azote 1. RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 99
Source: Agroscope Reckenholz-Tänikon
Le calcul de l’efficacité de l’azote selon la méthode OSPAR consiste à comparer la somme de tous les inputs d’azote dans le système agricole à celle des charges d’azote dans les produits agricoles qui quittent le système agricole. Il est frappant de constater que selon ce calcul, l’output représente moins d’un tiers de l’input total. Depuis le début des années nonante, on observe, en dépit de variations annuelles, une nette augmentation de l’efficience de l’azote, d’environ 25% à près de 30%. La production agricole basée sur l’output d’azote a augmenté, tandis que l’input d’azote a diminué durant cette même période.
Le but du projet «Dépouillement centralisé des bilans écologiques d’exploitations agricoles» est de recenser systématiquement des chiffres-clés écologiques provenant d’exploitations représentatives de l’agriculture suisse et de les évaluer, un peu comme on le fait pour le dépouillement centralisé de données comptables. Le projet permet de tirer des conclusions précises sur l’impact écologique d’un certain nombre d’exploitations agricoles et de certains types d’exploitation. Vu que les quelque 200 exploitations disposent aussi de données comptables, cela permettra en outre d’effectuer des analyses écoéconomiques. Le présent chapitre présente les premiers chiffres disponibles concernant l’utilisation de l’azote dans les exploitations agricoles.
Les agriculteurs intégrés au projet ont enregistré par ordinateur des données relatives à l’input, tel l’effectif de bétail. Sur cette base ont été calculés des paramètres telle la quantité d’engrais de ferme, ce qui a permis de déterminer l’apport d’azote. L’utilisation d’engrais minéraux et d’autres types d’engrais (p.ex. compost) a été également recensée.
Il convient de noter que l’on ne dispose pour l’instant que d’un échantillon très petit d’exploitations, ce qui réduit fortement la pertinence des résultats. Du reste, les différences entre les divers types d’exploitations ne sont statistiquement pas significatives en raison de la petitesse des échantillons (cf. intervalle de confiance).
en 1 000 t N Inputs Efficience de l'azote Outputs Excédent d'azote Source: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 en % 30 25 20 15 10 5 0 9091929394959697989900010203040506
1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 100
Evolution des inputs, des outputs et de l'efficience de l'azote selon la méthode OSPAR
■ Input d’azote par hectare: évaluation par type d’exploitation
■ Peu de progrès en perspective en matière de réduction des émissions d’azote?
Production globale d'azote selon le type d'exploitation
Exploitation combinée «transformation» (n=9)
Combinaison lait commerc./ culture des champs (n=6)
Lait commercialisé (n=15)
Culture des champs (n=9)
Moyenne globale (n=56)1
Sur les 56 exploitations considérées, un peu plus de la moitié de l’apport d’azote provient d’engrais de ferme et le reste d’engrais minéraux et d’autres engrais de commerce. La proportion des engrais de ferme est plus élevée dans les exploitations pratiquant l’élevage, tandis que dans les exploitations de type «grandes cultures» (classification selon la typologie FAT99), largement plus de la moitié de l’apport d’azote a lieu sous forme d’engrais minéraux. L’engrais de ferme utilisé par ces exploitations est en partie acquis. Les exploitations combinées «lait commercialisé/culture des champs» utilisent tendanciellement plus d’azote à l’hectare que les autres exploitations. Bien qu’elles produisent nettement plus d’engrais de ferme, les exploitations de ce type n’utilisent pas beaucoup moins d’engrais minéraux que les exploitations du type «culture des champs». Il ressort de façon générale que les différences entre les divers types d’exploitations relativement à l’input total d’azote sont minimes. En revanche, l’importance des diverses sources d’azote est très différente d’un type d’exploitation à l’autre.
Il est intéressant de savoir quelle sera l’évolution probable concernant les émissions d’azote. A cet effet, l’OFAG a donné mandat à l’Institut pour les décisions environnementales de l’EPF Zurich de procéder à une évaluation jusqu’en 2013 des répercussions du train de mesures prévues dans la PA 2011 sur les émissions d’azote du secteur agricole. Les principaux indicateurs à calculer sont la fumure azotée, l’output d’azote, le potentiel de pertes d’azote (excédent total d’azote) et les pertes d’azote se répercutant sur l’environnement. Ces dernières comportent les émissions d’azote sous forme d’ammoniac, de nitrate et de gaz hilarant. Pour le calcul de la fraction N ammoniac, on a dû recourir, faute de meilleures bases, au modèle Dynamo actuellement en voie de révision. Les calculs sont faussés par une erreur non détectée et il n’est donc pas possible de se prononcer de manière fiable sur la quantité absolue des pertes d’azote se répercutant sur l’environnement. Il est néanmoins possible d’émettre des pronostics sur l’évolution escomptée concernant les diverses émissions azotées, étant donné qu’on a utilisé la même méthode durant des années et que de ce fait, le modèle reproduit toujours la même erreur.
 Source: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
1 La moyenne comprend d’autres exploitations évaluées, en plus des types d’exploitation ici représentés.
Lisier Engrais minéraux fumier Autres engrais
Source: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
1 La moyenne comprend d’autres exploitations évaluées, en plus des types d’exploitation ici représentés.
Lisier Engrais minéraux fumier Autres engrais
en kg N/ha 0150100250 50 200
1. RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 101
Modélisation des futures pertes d'azote influant sur l'environnement (provisoire)
Les résultats montrent que la mise en œuvre de la PA 2011 d’ici 2013 se traduira par une légère régression de l’utilisation d’azote dans l’agriculture. Etant donné que selon les résultats des modélisations, la production de biomasse végétale et animale recule aussi légèrement, il n’y aura qu’une diminution minime des excédents d’azote, en particulier des pertes d’azote préjudiciables à l’environnement. Les calculs sont toutefois fondés sur l’hypothèse que la technologie actuelle restera inchangée et qu’il ne sera pas pris de mesures spécifiques de réduction des émissions d’azote. En réalité, on s’attend à une baisse plus prononcée des émissions d’azote préjudiciables à l’environnement que ne le font apparaître les calculs, compte tenu que le programme d’utilisation durable des ressources naturelles (art. 77a, LAgr) a créé des incitations à prendre des mesures ciblées en vue de l’utilisation durable et efficace de l’azote, telles que l’emploi de rampes d’épandage à tuyaux flexibles, la couverture des fosses à purin encore à ciel ouvert ou le recours accru au pacage.
Les objectifs agroécologiques fixés en matière de bilan d’azote n’ont pas été atteints. La voie la plus prometteuse pour obtenir le recul visé des émissions d’azote passe par la réduction de l’input d’azote dans le système agricole, en maintenant autant que possible une production égale. Il faut viser à améliorer l’efficience de l’azote. Une utilisation plus parcimonieuse des engrais minéraux azotés combinée à un stockage et à un épandage d’engrais de ferme occasionnant moins de pertes d’azote peuvent y contribuer. L’art. 77a LAgr a créé des incitations en vue dune utilisation plus efficace de l’azote.
20002001200220032004200520062007200820092010201120122013 en 1000 t N Fumure azotée Prélèvements d'azote dans la biomasse Pertes potentielles d'azote Pertes d'azote préjudiciables à l'environnement Source: IER EPF 0 250 200 150 100 50 300 ■
l’azote 1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 102
Bilan concernant
Produits phytosanitaires
Les produits phytosanitaires servent surtout à assurer la récolte. En tant que substances actives ils peuvent cependant mettrent en danger la santé humaine et l’environnement. Le risque dépend essentiellement de facteurs tels que la toxicité, la mobilité et la persistance du produit, le mode d’application, les conditions météorologiques après l’application ou la proximité de cours et de plans d’eau.
Même lors d’utilisation précautionneuse de produits phytosanitaires, un certain pourcentage de la substance active ne demeure pas comme prévu sur la culture traitée, mais parvient à la surface du sol, dans le sol ou, par évaporation, dans l’atmosphère. Au mieux, les résidus de produits phytosanitaires sont retenus dans le sol où ils sont décomposés. D’infimes parties de résidus de substances actives ou de leurs produits de transformation peuvent s’infiltrer dans la nappe phréatique ou être transportés par les eaux de pluie à la surface des cours d’eau et des lacs.
Il convient de protéger les humains, les animaux et les plantes, leur biocénose et leur biotope, des effets nuisibles ou incommodants. Pour y parvenir dans le domaine des produits phytosanitaires, le Conseil fédéral a pris plusieurs mesures:
–Avant d’être commercialisés, les produits phytosanitaires doivent être agréés par les autorités. La procédure d’homologation comporte le contrôle et l’évaluation non seulement de l’efficacité, mais aussi de la sécurité du produit pour l’homme, les plantes cultivées et l’environnement. Pour que ce contrôle de sécurité puisse être effectué, des études de toxicologie, d’écotoxicité, de comportement environnemental des produits et des résidus doivent être présentées. Les exigences relatives au dossier d’enregistrement ainsi qu’à la méthode et aux critères d’évaluation sont harmonisées avec celles de l’UE. Lors de l’homologation, on détermine à quel usage le produit phytosanitaire est destiné et comment il doit être utilisé. Du côté de l’autorité suisse d’homologation, un programme consistant à contrôler les admissions d’anciens produits et substances actives en tenant compte du programme d’évaluation de l’UE est en cours de réalisation. Lorsque cette réévaluation met en évidence une sécurité insuffisante pour l’homme et l’environnement ou un manque d’efficacité, il s’ensuit des restrictions d’utilisation, voire le retrait du marché, des substances actives ou des produits incriminés.
–Dans le secteur agricole, les produits phytosanitaires ne peuvent être utilisés que par des personnes qui soit sont titulaires d’une autorisation, soit ont bénéficié d’une instruction dispensée par le titulaire d’une autorisation, soit qui interviennent sous la conduite d’une personne habilitée.
–L’utilisation de produits phytosanitaires doit respecter l’obligation générale de diligence. Dans certains cas, l’utilisation de produits phytosanitaires est interdite. Cette interdiction s’applique par exemple aux haies et bosquets champêtres ainsi qu’à une bande de trois mètres de large autour de leur périmètre, sauf lorsqu’il s’agit de traitements plante par plante de végétaux posant problème telle l’ambroisie, et uniquement dans la mesure où d’autres mesures, tel le fauchage, restent sans résultat. Est également interdite l’utilisation de produits phytosanitaires sur une bande de trois mètres le long des cours d’eau et des plans d’eau. Cette interdiction

1. RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 103
■ Réglementations générales de protection de l’homme et de l’environnement
■ Quantités moyennes de produits phytosanitaires plus basses que l’objectif agro-écologique intermédiaire initialement fixé
s’étend aussi à la zone de captage des eaux souterraines et des eaux de source (S1). En ce qui concerne la zone de protection rapprochée (S2), l’OFAG désigne les substances actives dont l’utilisation est proscrite en raison de leur mobilité et de leur dégradabilité.
–La preuve des prestations écologiques requises nécessite d’observer diverses conditions supplémentaires dans le cadre de l’utilisation des produits phytosanitaires, en ce qui concerne notamment l’équipement utilisé (tests réguliers, réservoir d’eau de rinçage), le moment de l’utilisation (mois où l’usage de produits phytosanitaires est interdit, seuils de tolérance) et le type de produits utilisés. Le long des cours et des plans d’eau, les produits phytosanitaires ne doivent pas être utilisés sur une bande tampon de 6 m de large.
–L’eau de rinçage utilisée pour le nettoyage de l’équipement ne doit pas être déversée dans les eaux usées. Les fabricants et les commerçants doivent reprendre aux acquéreurs les produits phytosanitaires qui ne sont plus utilisés et les éliminer dans les règles.
–En ce qui concerne les produits alimentaires et l’eau potable, des valeurs maximales en PPS ont été fixées. Des exigences sont également imposées concernant les teneurs maximales dans les cours d’eau et dans les eaux souterraines qui sont utilisées ou prévues d’être utilisées en tant qu’eau potable. Le dépassement de ces valeurs peut entraîner des adaptations de toute la chaîne des mesures, depuis des restrictions d’utilisation jusqu’au retrait de l’autorisation d’un produit phytosanitaire.
L’amélioration du contrôle des effets possibles de produits phytosanitaires sur l’homme et l’environnement nécessite des données plus précises sur leur utilisation. L’OFAG développe un indicateur à cet effet dans le cadre du monitoring agro-environnemental.
Dans son message sur la Politique agricole 2007, le Conseil fédéral avait fixé comme objectif à atteindre d’ici 2005 une réduction de 30% par rapport à 1990–92 des quantités de PPS utilisées. Les statistiques publiées annuellement par la Société suisse des industries chimiques (SSIC) sur les quantités de PPS vendues en Suisse et au Liechtenstein par ses entreprises affiliées ont servi de base de données à l’étude. Depuis 1989, on assiste à une diminution générale de la vente de substances actives de produits phytosanitaires. Après un recul rapide au départ, la tendance a nettement ralenti ces dernières années. De près de 2’500 t en 1989, la quantité de PPS est passée à 1’359 t en 2006. L’objectif agro-écologique a donc été atteint.
La diminution des quantités de PPS employées s’explique sans doute par une combinaison de divers facteurs, entre autres une utilisation tenant plus largement compte des seuils de tolérance, le remplacement d’anciennes substances actives par de nouvelles substances nécessitant l’emploi de quantités nettement plus réduites, un recul des terres ouvertes et des cultures pérennes d’exploitation intensive et une augmentation des surfaces exploitées dans le cadre de programmes de production extensive (céréales et colza).
1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 104
■ Dépassements des concentrations autorisées dans les eaux souterraines
En ce qui concerne la teneur en pesticides organiques dans les eaux souterraines utilisées ou prévues d’être utilisées comme eau potable, la quantité maximale autorisée est de 0,1 µg/l par substance active. La fixation d’autres valeurs sur la base de l’évaluation de substances actives dans le cadre de la procédure d’homologation demeure réservée.
Dans les eaux souterraines de bassins versants agricoles principalement réservés à la «culture des champs», on a détecté en 2006 dans environ 20 % des stations de mesure au moins une substance active présentant une concentration maximale supérieure à 0,1 µg/l. Pour la catégorie «autres surfaces agricoles permanentes» d’utilisation principale du sol, c’était le cas dans 8% des stations de mesure et pour la catégorie «pâturages d’estivage», dans 0%. A titre comparatif, en 2002/03, les stations de mesures des bassins versants catégoriés «zones urbanisées et voies de communication», ont également enregistré dans presque 20% des cas un dépassement de la valeur limite.
Répartition spatiale des teneurs en produits phytosanitaires (PPS)1
Aucun PPS détecté <0,01 µg/l
PPS détecté, au moins une substance 0,01–0,1 µg/l
PPS détecté, au moins une substance >0,1 µg/l
1 Valeurs pour 2006. Sont représentées les stations de mesure NAQUA avec la principale utilisation du sol grandes cultures.
Part de cultures
<5%
5–20%
20–40%
>40%
Source: OFEV
La plupart des dépassements de la valeur fixée à 0,1 µg/l sont imputables à l’atrazine et à son produit de dégradation, la deséthylatrazine. L’atrazine ne se dégrade que lentement. Une partie des résultats positifs concernant cette substance s’explique donc probablement par la présence de résidus provenant d’une utilisation antérieure à la période étudiée. L’utilisation d’atrazine le long des voies ferrées a été interdite à la fin des années 80. Dans le secteur agricole, on a d’abord imposé des restrictions d’emploi (utilisation interdite dans les régions karstiques et la zone de protection des eaux souterraines S2, utilisation restreinte en dehors des zones de protection), avec pour résultat une réduction des dépassements de la valeur autorisée dans les eaux souterraines. Dans les lacs de Baldegger et de Zurich, de même que dans le lac de Greifen, pour lesquels des données sont disponibles depuis respectivement 1988 et 1990, on enregistre une baisse des concentrations depuis les années nonante. L’autorisation de l’atrazine et de la simazine a été retirée début 2007. Ces deux PPS peuvent être encore vendus jusqu’à fin 2008 et les stocks restants être utilisés trois ans de plus. Ces
1. RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 105
■ Conclusions concernant les produits phytosanitaires
substances difficilement dégradables pourront être encore mises en évidence pendant plusieurs années dans les eaux souterraines.
L’exemple de l’atrazine montre qu’il existe des possibilités de réagir aux nouveaux problèmes détectés. La méthode d’évaluation et de gestion des risques présentés par les produits phytosanitaires fait l’objet de développements continus et l’autorité d’homologation a le devoir d’adapter ses stratégies et ses critères aux nouvelles connaissances. Il ne faut donc pas s’attendre à trouver prochainement en fortes concentrations dans les eaux souterraines les substances actives remplaçant l’atrazine en protection phytosanitaire. Une surveillance ciblée des produits phytosanitaires dans l’eau reste néanmoins nécessaire.
Comparaison des cinq triazines présentes dans les eaux souterraines 2003–061
Atrazin 2003
Atrazin 2004
Atrazin 2005
2006
Atrazine-déséthyle 2003
Atrazine-déséthyle 2004
Atrazine-déséthyle 2005
Atrazine-déséthyle 2006
Atrazine-desisopropyle 2003
Atrazine-desisopropyle 2004
Atrazine-desisopropyle 2005
Atrazine-desisopropyle 2006
Simazine 2003
Simazine 2004
Simazine 2005
Simazine 2006
Terbuthylazine 2003
Terbuthylazine 2004
Terbuthylazine 2005
Terbuthylazine 2006
Pourcentage de stations de mesure avec au moins 1 relevé ≤0,1 µg/l
Pourcentage de stations de mesure avec au moins 1 relevé >0,1 µg/l
1 Set de données consistantes provenant de 198 stations de mesure NAQUA située dans des régions à dominante agricole
Source: OFEV
L’objectif agro-écologique purement quantitatif concernant la réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires a été atteint. Les risques que les produits phytosanitaires font encourir à la santé de l’homme et de l’environnement sont pris en compte par une procédure exhaustive d’homologation et des prescriptions d’utilisation axées sur la pratique. De plus, un système de monitoring est actuellement mis au point. Il permettra de détecter rapidement les effets négatifs des produits phytosanitaires et d’introduire des mesures adéquates.
Atrazin
en % 0403060 1020 50
1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 106
1.3.2Ethologie
Participation aux programmes de garde d’animaux SRPA et SST
Dans le cadre des paiements directs qu’elle verse aux agriculteurs, la Confédération encourage la garde d’animaux de rente particulièrement respectueuse de l’espèce, au moyen de deux programmes éthologiques: «Sorties régulières en plein air» (SRPA) et «Systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux» (SST). Le programme SRPA comporte essentiellement des dispositions concernant les sorties au pâturage, dans l’aire d’exercice (parcours) ou, pour la volaille, dans l’aire à climat extérieur. Le programme SST, quant à lui, pose surtout des exigences qualitatives, notamment pour les locaux de stabulation à aires multiples qui offrent une liberté de mouvement aux animaux. La participation à ces programmes est facultative. Les pourcentages indiqués ci-après se réfèrent à l’ensemble des exploitations recevant des paiements directs et à l’ensemble des animaux de rente gardés dans celles-ci.
Depuis leur instauration en 1993 (SRPA) et en 1996 (SST), la participation à ces deux programmes a régulièrement progressé: ainsi, en 2007, quelque 38’800 exploitations adhéraient au programme SRPA et 18’500 exploitations au programme SST.

■■■■■■■■■■■■■■■■■
1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 107
Tableaux 38–39, pages A42–A43
Evolution de la participation aux programmes SRPA et SST
Entre 1996 et 2007, le pourcentage d’animaux de rente gardés selon les exigences SRPA a passé de 19 à 72%. Au cours de la même période, cette part a progressé de 9 à 42% pour le programme SST. Il s’agit de valeurs moyennes englobant les quatre catégories d’animaux concernées (bovins, autres herbivores, porcs et volaille).
Evolution de la participation au programme SRPA, par groupe
Si l’on différencie la participation au programme SRPA par groupe d’animaux de rente, on constate que la part des bovins et des autres herbivores a fortement augmenté entre 1996 et 2007, passant de 20% à 74% et 82%, respectivement. En ce qui concerne les porcs, la participation est passée de 5% à 62%.
Part d'UGB en % SRPASST Source: OFAG 1996199719981999 0 60 70 80 50 40 30 20 10 2001 2000 2002 200320042005 2006 2007
d'animaux Part d'UGB en % Source: OFAG Bovins Autres herbivores PorcsVolaille 199619971998199920012002 2000 0 70 80 90 50 60 40 30 20 10 20032004 2005 2007 2006 1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 108
Quant à la volaille de rente, la participation aux programmes a évolué de façon très différente selon qu’il s’agit de poules pondeuses ou de poulets de chair. Alors que le taux de participation pour les poules pondeuses a toujours augmenté jusqu’en 2007 (67% en 2007), il a cessé de croître en 1999 pour les poulets de chair en s’établissant à 42%. Depuis lors, ce taux a sans cesse reculé pour tomber à 7% en 2007. Cette évolution est imputable à la durée minimale d’engraissement qui a été fixée à 56 jours pour les poulets. Nettement plus longue que celle en vigueur dans le mode de production classique, cette durée d’engraissement a eu pour effet d’augmenter considérablement les frais de production et, partant, le prix sur le marché. La demande en poulets SRPA a reculé en conséquence.
Si l’on différencie la participation au programme SST par groupe d’animaux de rente, on constate que par comparaison au programme SRPA, la part des bovins et des autres herbivores a augmenté dans une proportion nettement moindre entre 1996 et 2007, passant de 10% à 37% et 31%, respectivement. Ceci est principalement dû au fait que les investissements sont la plupart du temps très élevés (étable à stabulation libre), si bien qu’ils ne sont généralement opérés que lorsqu’un investissement de remplacement est de toute manière nécessaire.
Pour ce qui est des porcs, le programme SST n’a été introduit qu’en 1997. La participation des exploitations a évolué de manière similaire à celle du programme SRPA pour la bonne raison que les principaux labels dans la branche porcine exigent des exploitants qu’ils adhèrent aux programmes SRPA et SST.
L’évolution extrêmement rapide de la participation au programme SST pour la volaille (2007: 84%) est en grande partie attribuable au succès commercial des labels qui préconisent les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des poules pondeuses et des poulets de chair.

d'animaux Part d'UGB en % Source: OFAG 1996199719981999200120022003 200420052007 2006 2000 0 80 90 50 60 70 40 30 20 10 Bovins Autres herbivores PorcsVolaille 1. RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 109
Evolution de la participation au programme SST, par groupe
■ Situation de départ
1.4Marchés agro-alimentaires internationaux

Pénurie de matières premières agricoles: phénomène passager ou défi à long terme?
En 2007, le prix de matières premières importantes comme le blé, les oléagineux et le lait a fortement augmenté; pendant le premier semestre 2008, celui du maïs et du riz a suivi le même chemin. Entre-temps, les prix ont baissé, à part ceux de la viande et du sucre. Ils restent cependant au-dessus du niveau d’avant la hausse (pour le détail de l’évolution des prix, voir chapitre 3.2 Comparaisons internationales). Les raisons de ce renchérissement sont multiples et leurs interactions, complexes. Ainsi, la croissance démographique, l’augmentation du pouvoir d’achat et la pénurie d’énergies fossiles ont gonflé la demande de matières premières agricoles; or les prix agricoles jusqu’ici peu élevés ont peu incité à élargir l’offre, que divers facteurs, comme la sécheresse en Australie ou les restrictions à l’exportation décrétées par plusieurs pays, ont encore contribué à resserrer.
■ Conséquences
La hausse du prix des matières premières agricoles renchérit les denrées alimentaires. Dans les pays développés, elle ne se répercute pas entièrement sur les prix à la consommation, étant donné que les matières premières ne représentent en moyenne qu’environ 20% du produit fini vendu au magasin. Dans l’UE, la hausse parfois très sensible du prix des matières premières entre avril 2007 et septembre 2008 a entraîné en moyenne une augmentation de près 8,1% des prix à la consommation, alors qu’elle n’a été que de 4,2% en Suisse. Cet écart s’explique par le niveau de protection différent du secteur agricole dans l’UE et en Suisse. Dans l’UE, le prix des matières premières agricoles a subi une hausse presque aussi forte que sur le marché mondial. En Suisse, les mesures douanières permettent de se dissocier du marché mondial et, par conséquent, le prix des matières premières agricoles est nettement au-dessus du niveau du marché mondial. Jusqu’ici, la hausse des prix sur le marché mondial a ainsi eu moins d’effet sur les prix à la production en Suisse.
1.4 MARCHÉS AGRO-ALIMENTAIRES INTERNATIONAUX 1 ■■■■■■■■■■■■■■■■■
110
■ Au cours des dernières années, la croissance de la demande de matières premières agricoles s’est accélérée
Dans les pays en développement, la hausse des prix a des répercussions nettement plus graves que dans les pays industrialisés. Les pays importateurs nets de denrées alimentaires sont particulièrement touchés. Pour les couches pauvres de la population, qui consacrent une grande partie de leur budget domestique à des dépenses alimentaires, les fortes augmentations des prix sont un problème vital.
Augmentation du prix des denrées alimentaires1 et part des dépenses réservées aux denrées alimentaires
La population mondiale a plus que doublé au cours des cinquante dernières années. Quant au pouvoir d’achat, il a augmenté de 50% depuis 1995. Cela s’est traduit par une hausse constante de la demande de matières premières agricoles. La croissance de la demande s’est accélérée ces dernières années, principalement en raison de la poussée économique d’Etats du Sud-Est asiatique fortement peuplés. Un nombre croissant de personnes peuvent ainsi mieux se nourrir et, en particulier, consommer plus de viande et de produits laitiers. Il s’ensuit un besoin accru de fourrages, vu que la production d’une calorie animale nécessite l’apport de 2 à 8 calories végétales. Près de 36% des céréales produites dans le monde servent aujourd’hui à alimenter le bétail. S’y ajoute depuis quelques années la demande de biomasse en tant que source d’énergie alternative. Quelques 20 millions d’hectares ont été plantés en 2007 pour la production d’éthanol en tant que substitut de l’essence et de biodiesel. Cela fait autant d’hectares de blé, de canne à sucre, d’oléagineux ou de maïs soustraits à la production directe de nourriture pour l’homme et les animaux. Etant donné que les déchets (entre autres les tourteaux de colza ou la drêche issue de la distillation du maïs) sont utilisés pour l’alimentation des animaux, une partie des calories tirées de la culture des plantes pour la production de biocarburants reste cependant indirectement conservée pour l’alimentation humaine.
1.4 MARCHÉS AGRO-ALIMENTAIRES INTERNATIONAUX 1
ChineAfrique du Sud EgypteHaïtiIndeEtats-UnisSuisse en % en % Augmentation du prix des denrées alimentaires Part réservée aux denrées alimentaires sur les dépenses des ménages Sources: OCDE, FAO 1 Variations de février 2007 à février 2008 0 60 50 40 30 20 10 0 60 50 40 30 20 10
111 1. RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE
L’évolution de l’offre et de la demande de céréales entre 1999/00 et 2007/08 montre que la production n’a dépassé la demande qu’en 2004/05 seulement. Durant cette période, les stocks ont fortement diminué. Au printemps 2007, ils ne représentaient plus que 16% de la consommation annuelle. Des réserves de cet ordre sont considérées au plan international comme le seuil minimal permettant d’assurer sans problème l’approvisionnement. Cela explique la nervosité des marchés lorsqu’on enregistre des pertes de production dans des zones de culture importantes, comme celles causées par la sécheresse dans le cas du blé australien durant la période de récolte 2007/08. L’Australie représentant une part d’environ 15% du marché mondial du blé, le prix a fortement réagi et a doublé en peu de temps. On a constaté une fois de plus l’inélasticité de l’offre et de la demande dans le secteur agricole. Selon les estimations concernant les céréales (sans le riz) pour 2008/09 on peut s’attendre de nouveau à un léger surplus de l’offre, de sorte que les stocks vont augmenter quelque peu.
Evolution de l'offre et de la demande et des stocks de céréales (sans le riz)
Pour le riz, le déficit de production des années 2001 à 2005 a entraîné une nette réduction des stocks. Depuis lors, ces derniers représentent moins de 20% de la consommation annuelle. On part du principe que l’offre suffira à couvrir la demande en 2008/09. On prévoit donc que les stocks resteront stables, à un niveau bas.
1.4 MARCHÉS AGRO-ALIMENTAIRES INTERNATIONAUX 1
1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 1 en mio de t en mio de t Stocks Production Consommation Source: USDA 1 2008/09: Estimation 1 400 1 800 1 700 1 600 1 500 0 500 400 300 200 100 441 416 399 336 272 329 312 265 269 287
112
■ L’offre n’a pas suivi la demande
Evolution de l'offre et de la demande et des stocks de riz
■ La demande de matières premières agricoles va continuer de croître
Notamment en raison du bas niveau des stocks, les marchés du blé, du maïs et du riz ont été marqués, en particulier pendant les premiers mois de l’année 2008, par une extrême volatilité des prix.
La hausse du prix du lait est elle aussi imputable à un déséquilibre entre l’offre et la demande. En effet, depuis 2004, la production ne suit plus la demande. Jusqu’au printemps 2007, il a été possible de compenser le sous-approvisionnement en beurre et lait en poudre en ayant recours aux réserves. Par la suite, le déséquilibre s’est répercuté de plein fouet sur les prix.
1.4 MARCHÉS AGRO-ALIMENTAIRES INTERNATIONAUX 1
1999/00 1998/99 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 1 en mio. de t en mio. de t StocksProductionConsommation Source: USDA 1 2008/09: Estimation 0 500 400 300 200 100 0 200 150 100 50 60 143 146 137 110 86 78 77 77 75 80 Population mondiale 20052020 Année 2050 en mio. Scénario élevé Scénario moyen Scénario bas Source: division de la population (ONU) 6 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000
113 1. RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE
■ Disponibilité limitée des ressources naturelles
Selon les estimations de la FAO, la demande de matières premières agricoles va augmenter de 50% d’ici 2030 et de jusqu’à 100% d’ici 2050. L’augmentation de la population mondiale – d’environ 6,6 milliards de personnes aujourd’hui à quelque 9,1 milliards en 2050 –reste un facteur essentiel de l’accroissement de la demande. Ces chiffres correspondent au scénario moyen de croissance démographique des autorités onusiennes. Celles-ci ont élaboré trois scénarios possibles (élevé, moyen, bas), qui se différencient en particulier en ce qui concerne les hypothèses de fécondité, c’est-à-dire le nombre d’enfants par femme (élevé = 2,35; moyen = 1,85; bas = 1,35). Chaque année, il faut nourrir 75 millions de personnes de plus. Cela représente presque l’équivalent de la population allemande. Il faut s’attendre de surcroît à la poursuite de l’augmentation du pouvoir d’achat dans les pays émergents à forte population et, par conséquent, à un accroissement particulièrement élevé de la demande en denrées alimentaires d’origine animale.
La demande de matières premières agricoles pour la production énergétique et industrielle devrait elle aussi continuer de progresser. L’OCDE et la FAO prévoient que la quantité de biocarburants aura presque triplé d’ici 2017, si la politique actuelle de promotion est maintenue. En ce qui concerne le pétrole, les possibilités de production ont plus ou moins atteint leurs limites. La principale énergie, moteur du développement économique mondial, est en train de tarir. Le transport de marchandises et le trafic individuel motorisé sont ainsi fortement dépendants du diesel et de l’essence. Or, un remplacement rapide et intégral de l’infrastructure de transport dépendante du pétrole n’est pas en vue à court ou à moyen terme. Les carburants issus de matières premières agricoles représentent une solution de rechange disponible assez rapidement sans qu’il soit besoin de rénover l’intégralité de l’infrastructure en place, comme ce serait le cas, par exemple, pour une mobilité basée sur l’hydrogène. Il est difficile de prévoir quelle évolution la demande suivra effectivement. On constate d’une part une résistance politique contre le développement inconsidéré de la production de carburants à partir de matières premières agricoles et d’autre part une volonté politique aux EtatsUnis comme dans l’UE de promouvoir activement la production d’éthanol et de biodiesel. Les lois du marché poussent aussi dans cette direction. La raréfaction et le renchérissement du pétrole vont vraisemblablement se poursuivre. Dans un tel contexte, les agrocarburants représentent une alternative attrayante.
Compte tenu du prix élevé des produits agricoles, la question se pose de savoir s’il convient de tenir compte de cette incitation et de produire davantage. A cet égard, le sol (surface agricole utile), l’eau, les éléments fertilisants et la lumière sont nécessaires pour produire du matériel végétal organique, qui est à la base de toutes les denrées alimentaires. Dans le cycle annuel, les plantes transforment par photosynthèse les substances initiales en matière organique, c’est-à-dire en matières premières utilisables à des fins humaines (p.ex. grains de céréales). Une caractéristique essentielle de la production agricole est sa dépendance des rythmes saisonniers. Si la récolte est mauvaise, on ne peut pas réagir tout de suite, mais seulement au moment du semis suivant.
1.4 MARCHÉS AGRO-ALIMENTAIRES INTERNATIONAUX 1
114
Répartition des terres émergées 2005
Infrastructures (urbanisation, trafic) 2% (360 mio. ha)
Surface improductive (p.ex. désert, montagnes) 28% (4 093 mio. ha)
Autres (p.ex. zones humides) 10% (1 500 mio. ha)
Surface agricole utile 33% (4 933 mio. ha)
Forêts 27% (3 952 mio. ha)
Source: FAOSTAT
Les terres émergées du globe s’étendent sur environ 14,8 mia. ha. De la biomasse se développe sur neuf milliards d’hectares; le reste de la surface est couvert par des infrastructures ou est improductif, comme la glace ou les montagnes. Sur ces 9 mia. ha, 4 mia. correspondent à de la forêt et 5 mia. sont exploités à des fins agricoles: 1,6 mia. est utilisé pour la culture des champs et les cultures spéciales; les 3,4 mia restants sont exploités, à des degrés d’intensité variés, comme herbages. Il peut s’agir également de réserves naturelles ou de surfaces momentanément inexploitées. Selon les dernières estimations, elles représentent entre 50 est 100 mio. d’ha., mais il s’agit dans la plupart des cas de surfaces à faible rendement.
Les possibilités de pratiquer la culture des champs sur la surface du globe sont limitées. Selon une étude IIASA/FAO réalisée en 2001, 3,3 milliards d’hectares au plus s’y prêtent. Sur cette surface, 800 millions d’hectares sont couverts par la forêt et 600 millions d’hectares ne se prêtent que partiellement à la culture des champs. Les surfaces disponibles pour l’extension de la production de matières premières sont donc limitées. La concurrence pour les surfaces peut d’ores et déjà être observée sur plusieurs fronts. Ainsi, en 2007, aux Etats-Unis, la surface de maïs a augmenté (+6 mio. ha) au détriment de celle affectée au soja (–5 mio. ha). Par contre, en 2008, ce sont les surfaces réservées au blé (+2 mio. ha) et au soja (+4 mio. ha) qui ont progressé, alors que celles affectées au maïs ont de nouveau diminué (–3 mio. ha). Les cultivateurs ont pris ces décisions en raison des rapports de prix. Si le prix du maïs a été très bon en 2006 par rapport à ceux du soja et du blé, cela a été le contraire en 2007. Cela montre qu’à l’exception des forêts et des zones protégées, les Etats-Unis ne disposent que de réserves très limitées en surfaces utilisables pour la production de matières premières agricoles. Les prix élevés se sont immédiatement répercutés sur la rente foncière: les fermages et les prix des terres agricoles ont connu une forte hausse dans les meilleures régions aux Etats-Unis et en Europe. Enfin, des pays comme le Japon, la Corée du Sud, la Chine ou les Etats du Proche-Orient et du Moyen-Orient s’efforcent d’acheter ou d’affermer des terres agricoles dans des pays tiers.

1.4 MARCHÉS AGRO-ALIMENTAIRES INTERNATIONAUX 1
115 1. RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE
Tout comme le sol, l’eau est indispensable à la production de matières premières agricoles. Ainsi, la production de 1 kilo de blé absorbe environ 1000 l d’eau et celle de 1 kilo de bœuf, jusqu’à 15’000 l. Un régime carné requiert nettement plus d’eau qu’un régime végétarien. Actuellement, quelque 70% de l’eau utilisée dans le monde servent à la production de matières premières agricoles. La situation est particulièrement critique dans les régions peu arrosées. Selon les estimations de l’ONU, environ 1,8 milliard de personnes subiront probablement une pénurie d’eau aiguë d’ici à 2025. La production durable est avant tout menacée dans les régions où l’on utilise les eaux souterraines pour l’irrigation intensive, les prélèvements dépassant le renouvellement annuel de la nappe. C’est notamment le cas dans le Nord de la Chine, au Penjab en Inde ou dans des régions du Proche-Orient et du Moyen-Orient. L’Arabie Saoudite a ainsi annoncé qu’elle abandonnerait la production de blé d’ici à 2016, car elle veut utiliser les nappes phréatiques à d’autres fins.
Les dernières 50 années ont connu une forte hausse des rendements aussi bien dans la production végétale que dans la production animale. Cependant, dans la production végétale, l’augmentation des rendements s’est quelque peu ralentie avec le temps. On peut même parfois observer un recul dans les régions où des rendements élevés sont depuis longtemps obtenus par une exploitation intensive. Globalement, l’intensification de la production agricole a eu pour résultat une augmentation, en dépit de la croissance démographique mondiale, du nombre de calories consommées par habitant et une diminution par rapport aux trente précédentes années de celui des personnes sous-alimentées. Néanmoins, l’augmentation des rendements à la surface peut aussi avoir des retombées négatives sur les ressources naturelles. Dans de nombreuses régions cultivées, la fertilité du sol diminue en raison d’assolements déséquilibrés; en même temps, l’utilisation de moyens de production modernes porte atteinte à l’eau et à l’air. L’Évaluation des écosystèmes pour le millénaire constate un recul pour presque toutes les ressources naturelles durant les trois dernières décennies. Ce phénomène s’accompagne d’une capacité réduite des écosystèmes à garantir les fonctions fondamentales de régulation des cycles des substances.
1.4 MARCHÉS AGRO-ALIMENTAIRES INTERNATIONAUX 1
Evolution des rendements en kg/ha 0 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 1962/66 1967/71 1972/76 1977/81 1982/86 1987/91 1992/96 1997/01 2002/06 Maïs Riz Blé Source: FAO Fèves de soja Sorgho ■ Nécessité d’augmenter durablement les rendements à la surface 116
■
Evaluation des écosystèmes pour le millénaire (EM)
L’EM a été lancée en 2000 par le Secrétaire général des Nations Unies d’alors, Kofi Annan, et avait pour objectifs l’analyse des répercussions de la dégradation des écosystèmes sur le bien-être des hommes et l’élaboration de bases scientifiques susceptibles de renforcer la capacité de gérer durablement les écosystèmes. Le rapport final a été publié en 2005. L’EM est notamment parvenue aux conclusions suivantes:
Au cours des 50 dernières années, l’homme a généré des modifications au niveau de la structure et du fonctionnement des écosystèmes plus importantes que sur aucune autre période comparable de l’histoire de l’humanité: Ainsi, entre 1950 et 1980, plus de terres ont été transformées en terres cultivées qu’entre 1700 et 1850. Depuis 1950, 20% des récifs coralliens et 35% des mangroves ont disparu. Le taux de dioxyde carbone dans l’atmosphère a augmenté de 32% depuis 1750 et la biodiversité diminue. Aujourd’hui, 10 à 30% des espèces animales sont ainsi menacées d’extinction.
Les modifications des écosystèmes ont certes contribué à une amélioration du bien-être des hommes et à la prospérité économique. Mais le prix payé est énorme: la nature peut de moins en moins remplir ses fonctions (services fournis par les écosystèmes). Actuellement, 60% environ des services fournis par les écosystèmes évalués dans le contexte de l’EM sont dégradés ou surexploités. En font partie les stocks de pêche et la fourniture d’eau douce, qui sont surexploités. La qualité de l’eau, par exemple, a diminué ainsi que la capacité naturelle de la nature à réagir face aux maladies des végétaux. Certains services fournis – par ex. la production de denrées alimentaires – ont par contre augmenté, au détriment cependant d’autres fonctions.
Le défi à venir consiste donc à obtenir des rendements élevés par des méthodes durables. Des investissements dans la recherche, la formation et la vulgarisation, de même que dans les infrastructures des régions rurales négligées jusqu’ici, sont indispensables à cette fin.
Le processus de photosynthèse impose une limitation à la croissance du rendement de la plante et les rendements à la surface dépendent de plus des conditions naturelles telles que la fertilité du sol, la disponibilité de l’eau, la température, l’altitude, la durée de la saison, l’insolation, etc. En outre, le temps qu’il fait dans une période de production est décisif pour la réussite ou l’échec d’une culture. C’est ce qui distingue la production agricole de la production industrielle.
La variabilité climatique, déjà accrue ces dernières années, augmentera probablement encore à l’avenir. C’est une mauvaise nouvelle pour la production des matières premières agricoles: en effet, les conditions tant trop humides que trop sèches peuvent conduire à une forte détérioration de la production. Dans la situation actuelle, caractérisée par des stocks réduits, les mauvaises nouvelles se traduisent par des hausses de prix, même avant la récolte. Les inondations dans l’Etat de l’Iowa, le grenier à blé des Etats-Unis, ont ainsi immédiatement entraîné une augmentation des prix du blé, du
1.4 MARCHÉS AGRO-ALIMENTAIRES INTERNATIONAUX 1
117 1. RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE
Marchés agricoles volatils dus au changement climatique et aux stocks limités
maïs et du soja. Le niveau de la hausse dépend de la perte de production supposée. En fonction du degré de certitude des spéculations sur la perte effective, les hausses se renforceront ou cesseront.
Biotechnologie verte
Des plantes utiles génétiquement modifiées sont cultivées depuis maintenant douze ans. En 2007, 23 pays ont pratiqué la culture de plantes génétiquement modifiées, notamment des variétés de soja et de maïs (essentiellement à des fins fourragères) ainsi que du coton sur une surface totale de 114 millions d’hectares, ce qui représente environ 9 % des surfaces cultivées dans le monde. En ce qui concerne l’utilité de ces plantes GM et les risques qu’elles présentent (productivité, impact sur le revenu, utilisation d’insecticides, d’herbicides et d’énergie, développement de résistances, prix des semences, diversité variétale, etc.), les avis divergent beaucoup. Les principaux pays utilisateurs de plantes GM sont les EtatsUnis d’Amérique, suivis de l’Argentine, du Brésil et du Canada.
Dans le contexte de la pénurie de matières premières, il importe surtout de savoir si la technologie du génie génétique peut contribuer à une augmentation des rendements ou à une meilleure tolérance des plantes au stress (eau, chaleur, etc.). Jusqu’ici, les caractéristiques principales des variétés génétiquement modifiées cultivées étaient la résistance aux insectes et la résistance aux herbicides. Elles contribuaient principalement à économiser du travail et des moyens de production. Ainsi, elles convenaient essentiellement à la culture de grandes surfaces dans des régions agricoles productives.
En ce qui concerne l’alimentation mondiale, il est déterminant de savoir si les pays en développement et si les petits producteurs autosuffisants pourront aussi profiter à l’avenir des progrès de la technologie génétique. Jusqu’ici les petits exploitants du Sud cultivent avant tout du coton résistant aux insectes (coton Bt) et très peu de plantes alimentaires génétiquement modifiées. Nous disposons à l’heure actuelle d’expériences avec du maïs résistant aux insectes (destiné à l’alimentation humaine) cultivé en Afrique du Sud. En outre, plusieurs variétés sont en cours de développement. On attend beaucoup des variétés de riz génétiquement modifiées qui sont résistantes aux maladies ou qui constituent une source de vitamine A («golden rice»).
Dans son World Development Report 2008, la Banque mondiale cite plusieurs raisons principales pour lesquelles les progrès enregistrés dans le domaine des plantes génétiquement modifiées sont moins importants dans les pays en développement que dans les pays industrialisés. En premier lieu, elle relève que la recherche et le développement sont davantage axés sur les besoins commerciaux des pays industrialisés que sur ceux des petits exploitants du Sud. En se fondant sur cette analyse, elle préconise de renforcer la recherche publique dans le domaine des OGM, aux plans national et international, et d’axer davantage cette recherche sur les besoins des petits paysans du Sud («pro-poor focus»). De plus, elle exige que des sommes plus importantes soient investies dans les institutions qui procèdent aux évaluations et qui délivrent les autorisations. L’Évaluation internationale des connaissances, des sciences et des technologies agricoles pour le développement (IAASTD) demande dans ses conclusions d’avril 2008 que les
1.4 MARCHÉS AGRO-ALIMENTAIRES INTERNATIONAUX 1
118
priorités en matière de recherche OGM ou de recherche en général soient davantage axées sur les processus participatifs à l’échelon local et sur la résolution des défis locaux. On s’assurerait ainsi que le génie génétique contribue à l’avenir à mieux maîtriser le problème de la pénurie de denrées alimentaires et celui des changements climatiques.
Dans les Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO pour l’année 2017, on part du principe, en se basant sur des modélisations, que les stocks de céréales stagneront au bas niveau actuel. La constellation de base comme celle qui a précédé la flambée de 2007 se maintiendra donc à plus long terme, devenant pour ainsi dire la norme. La demande étant relativement inélastique, on doit s’attendre à ce que les fluctuations de prix observées ces derniers temps puissent se produire en tout temps à l’avenir.
La spéculation devrait donc rester attractive. Des interventions politiques telles que les restrictions à l’exportation de riz au printemps 2008 peuvent aussi aggraver la volatilité des marchés agricoles. En dernier lieu, la spéculation et l’interventionnisme ne déclenchent pas de hausse des prix, mais renforcent des développements qui se produisent en raison des particularités des marchés agricoles (demande inélastique, limitation naturelle de l’offre, influence de la météo).
Spéculation

L’augmentation du prix des matières premières soulève une question qui fait l’objet de discussions au niveau international: la spéculation dans les bourses de marchandises à terme est-elle responsable de la flambée des prix et, si oui, dans quelle mesure? Les opinions à ce sujet sont extrêmement divergentes. Diverses institutions ont annoncé qu’elles allaient approfondir cette question (p.ex. la Commission européenne).
La voie commerciale habituelle pour les matières premières passe par le marché spot. Les affaires se concluent sur-le-champ et l’échange physique de marchandises entre le vendeur et l’acheteur a véritablement lieu.
Sur le marché à terme des marchandises, on achète des contrats dont le transfert a lieu à une date ultérieure (futures ou contrats à terme sur marchandises). Les contrats sont standardisés (quantité, qualité, lieu et date de l’exécution) et peuvent donc être négociés dans les bourses de marchandises à terme. Une affaire se conclut entre l’acheteur et le vendeur si le prix envisagé est le même. La transaction n’a toutefois pas lieu directement entre l’acheteur et le vendeur, mais via une chambre de compensation (clearing). Celle-ci cherche les opérateurs sur le marché dont les prix envisagés coïncident et réunit ensuite l’offre et la demande. Le partenaire commercial effectif de l’acheteur et du vendeur est donc la chambre de compensation. Pour l’acheteur, elle joue le rôle de vendeur et pour le vendeur, celui d’acheteur. Dans la plupart des cas, les transactions ne sont pas effectuées physiquement à l’échéance du contrat, mais sont compensées en bourse par une opération de contrepartie («dénouées»): si on a acheté un contrat, on en revend un portant sur la même quantité, et vice versa.
1.4 MARCHÉS AGRO-ALIMENTAIRES INTERNATIONAUX 1
119 1. RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE
On distingue trois catégories d’acteurs:
– Hedgers: opérateurs sur le marché, qui travaillent sur le marché spot avec de la marchandise (physiquement). Il s’agit d’agriculteurs, de commerçants, de transformateurs qui veulent assurer leur position sur le marché spot avec des futures.
– Spéculateurs: opérateurs se servant des marchés à terme pour placer du capital. Leur but est d’obtenir du gain en investissant dans des cours en train de monter ou de baisser. Ils assument sur le marché le rôle du preneur de risques. Ils permettent ainsi la protection des hedgers et assurent la liquidité des marchés. Ils réagissent immédiatement aux nouvelles informations et contribuent ainsi à ce que les prix sur le marché à terme puissent être utilisés comme pronostics de prix (c’est ce que l’on appelle la fonction «price discovery» des marchés à terme).
– Arbitragistes: intervenants qui tentent d’obtenir un gain sans prendre de risque en mettant à profit les différences de prix dans le temps et dans l’espace en combinant des affaires sur les marchés spot et à terme.
On constate que, depuis 2003, la composition des intervenants sur les marchés à terme des matières premières a changé. Les investisseurs institutionnels (par exemple les caisses de pension) ont ainsi commencé à investir considérablement dans les matières premières sur les marchés à terme des marchandises. L’augmentation massive de leur engagement sur ces marchés se fonde sur deux raisons:
–la baisse de l’attractivité des catégories d’investissements traditionnelles (les faibles cours des actions entre 2000 et 2002 et depuis 2007, couplés à l’inflation, croissante depuis 2007, rendent moins intéressants les placements sur les marchés des actions et des obligations)
–les bonnes perspectives de profit sur les marchés des matières premières en raison de l’excès de demande prévu à long terme sur le marché physique.
Etant donné que l’on s’attend à ce que le prix des matières premières continue d’augmenter, les investisseurs institutionnels interviennent sur les marchés à terme des marchandises essentiellement pour acheter des futures portant sur des indices de matières premières. Les indices de matières premières représentent l’évolution du prix d’un panier de matières premières sur le marché spot. Cette concentration sur les produits basés sur des indices a valu aux investisseurs institutionnels le nom de spéculateurs d’indice. En 2003, 13 mia. $ US étaient investis dans des indices de matières premières; en mars 2008, cette somme était déjà passée à environ 260 mia. $ US.
Une question soulève un débat animé à l’échelon international: savoir dans quelle mesure l’augmentation du volume des échanges et le fait que les investisseurs institutionnels investissent unilatéralement en tablant sur des prix élevés entraînent une augmentation des prix sur le marché physique des matières premières.
Actuellement, on peut constater ce qui suit :
–Le lien entre le changement des prix sur les marchés réels et le volume des contrats conclus sur les marchés à terme n’est pas confirmé statistiquement. Ainsi, le prix des matières premières agricoles pour lesquelles il n’existe pas de
1.4 MARCHÉS AGRO-ALIMENTAIRES INTERNATIONAUX 1
120
marché à terme (p.ex. le blé dur) ou qui ne font pas partie d’un indice important (p.ex. le Minneapolis wheat futures) a aussi augmenté de façon considérable.
–Les marchés à terme ne fonctionnent que grâce à l’engagement des spéculateurs. C’est grâce au fait qu’ils acceptent de prendre un risque financier que les hedgers, c’est-à-dire les intervenants sur les marchés physiques, peuvent garantir leurs prix.
–L’intervention des spéculateurs d’indice comme acheteurs sur le marché à terme n’entraîne pas de raréfaction physique de l’offre. Elle n’entraîne pas non plus de déséquilibre (excès de la demande); pour chaque contrat conclu, il doit y avoir une demande qui correspond à l’offre. Concrètement, cela signifie que, pour chaque contrat conclu, un spéculateur d’indice qui mise sur une augmentation des prix a en face de lui un spéculateur ou un hedger qui mise sur une diminution de ces derniers. Une analyse montre qu’au printemps 2008 les spéculateurs d’indice misaient avant tout sur une augmentation du prix des matières premières alors que les opérateurs du marché agissant plus près du marché physique (agriculteurs, producteurs d’énergie, industries alimentaires, etc.) misaient sur une baisse de ce prix.
–Les marchés physiques et les marchés à terme sont étroitement liés et s’influencent mutuellement. Les informations concernant l’offre et la demande sur les marchés physiques et les perspectives qui en découlent pèsent sur l’évolution des prix sur les marchés à terme. Inversement, les prix en résultant servent de base aux négociations de prix et, ainsi, pour la fixation à court terme des prix sur les marchés physiques. Ils influencent également les décisions d’investissements réels et par conséquent les prix à long terme sur les marchés physiques.

–Tant que les acteurs étrangers au marché s’attendent à une augmentation des prix et sont disposés à acheter des contrats à des prix supérieurs, les augmentations de prix se produiront – à condition qu’il y ait suffisamment de vendeurs qui misent sur une évolution contraire ou une stagnation des prix. Il n’y a en principe pas de limite aux augmentations de prix, alimentées par des informations selon lesquelles les matières premières se raréfient. Cependant, la balance peut pencher légèrement, soit en raison de l’évolution de l’économie réelle (baisse de la demande en matières premières, p.ex. à la suite d’un refroidissement conjoncturel; augmentation de l’offre en raison de bonnes récoltes), soit en raison de l’évolution des marchés financiers (p.ex. de meilleures perspectives sur les marchés des actions et des obligations, entraînant une augmentation des investissements dans ces marchés). En conséquence, les prix pourraient baisser à nouveau.
–Le degré de volatilité des prix sur les marchés à terme dépend notamment de la quantité d’argent que l’on peut y transférer ou en retirer en un temps donné. Actuellement, aux Etats-Unis, le nombre de contrats que les investisseurs non commerciaux (caisses de pension, etc.) qui investissent dans ces marchés via des indices de matières premières et par le biais d’un intermédiaire (swaps traders) peuvent acheter n’est pas limité. C’est pourquoi au cours des dernières années une quantité importante d’argent a afflué vers ces marchés en peu de temps. Toutefois, la question se pose maintenant de savoir s’il convient d’introduire des restrictions.
1.4 MARCHÉS AGRO-ALIMENTAIRES INTERNATIONAUX 1
121 1. RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE
■ Conclusion
–La situation effective de l’offre et de la demande sur les marchés physiques ainsi que les attentes à long terme concernant l’évolution de l’offre et de la demande restent décisives pour l’évolution des prix et son ampleur sur les deux marchés.
Les augmentations de prix observées depuis 2007 pour diverses productions végétales et pour le lait ont leur origine dans un déséquilibre structurel entre l’offre et la demande. Résultat: les stocks ont constamment baissé, tombant à un niveau critique. La demande étant relativement inélastique, les pertes dues à la récolte peuvent conduire dans une telle situation à des flambées de prix, accentuées par des placements spéculatifs ou par des décisions politiques.
Cette constellation de base se maintiendra probablement durant les dix prochaines années. Des flambées de prix sont possibles en tout temps. Comme pour le pétrole, on doit partir du principe que l’accès aux matières premières à un prix avantageux appartient au passé. Les meilleures terres agricoles dont l’exploitation est peu coûteuse sont déjà utilisées, en partie même de manière trop intensive. En outre, l’augmentation des prix de l’énergie et des matières premières renchérit les consommations intermédiaires de l’agriculture. La tendance à la hausse des prix se maintiendra donc selon toute vraisemblance. Il est difficile de prédire la force de cette tendance. La FAO part du principe que les plafonds ont été atteints au printemps 2008. Selon ses pronostics, les prix se stabiliseront à un niveau un peu plus bas pour les 10 années à venir. Ce pronostic repose toutefois sur un prix du pétrole de 100 dollars en 2017; de plus, il fait abstraction des fluctuations des récoltes dues aux variabilités climatiques. Il se peut donc qu’il soit même trop optimiste.
1.4 MARCHÉS AGRO-ALIMENTAIRES INTERNATIONAUX 1
122

■■■■■■■■■■■■■■■■■ 2. Mesures de politique agricole 123 2
Les mesures de politique agricole sont réparties entre trois domaines:
– Production et ventes: les mesures prises dans ce domaine visent à créer les conditions-cadre appropriées pour la production et la vente des denrées alimentaires. Les dépenses de la Confédération au titre de la production et des ventes sont en constante diminution. En 2007, elles se sont élevées à 548 millions de francs, soit plus d’un milliard de moins que dans les années 1990/92, avant la réforme agricole.
– Paiements directs: ces paiements sont considérés comme une rétribution des prestations en faveur de la collectivité, au rang desquelles figurent l’entretien du paysage, la sauvegarde des bases naturelles de l’existence, la contribution à une occupation décentralisée du territoire ainsi que des prestations écologiques particulières. Les prix payés pour les denrées alimentaires ne comprennent pas ces prestations car le marché correspondant est inexistant. Par le biais des paiements directs, l’Etat s’assure le concours de l’agriculture pour fournir des prestations d’intérêt général.
Amélioration des bases de production: il s’agit de mesures permettant à la Confédération de promouvoir et de soutenir une production de denrées alimentaires respectueuse de l’environnement, sûre et efficiente. Elles concernent l’amélioration des structures, les domaines de la recherche et de la vulgarisation, ainsi que ceux des matières auxiliaires et de la protection des végétaux et des variétés.
124 2. MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE 2
–
■ Moyens financiers 2007
2.1Production et ventes
Conformément à l’art. 7, LAgr, qui fixe les objectifs relatifs à la production et à la vente de produits agricoles, l’agriculture doit être en mesure d’assurer une production durable et peu coûteuse ainsi que de tirer des recettes aussi élevées que possible de la vente des produits. Pour qu’elle en ait les moyens, la Confédération peut prendre des mesures dans les domaines qualité, promotion des ventes et désignation, importation et exportation, économie laitière, production animale, production végétale et économie viti-vinicole.
En 2007, 548 millions de francs ont été consacrés à la promotion de la production et des ventes. Par rapport à l’année précédente, cela représente une diminution des dépenses d’environ 58 millions de francs, soit de 9,6%. Le montant nécessaire à la promotion des ventes s’élève cependant toujours à 54 millions de francs et il restera identique au cours des années à venir.

Dépenses pour la production et les ventes Comptes 2007Budget 2008
Poste des dépensesMontantPartMontantPart mio. de fr.%mio. de fr.%
Promotion des ventes549,9559,9
Economie laitière36666,835063,2
Production animale193,4213,8
Production végétale
(viticulture comprise)10919,912823,1
Total548100554100
Sources: Compte d’Etat, OFAG
■ Perspectives
Le transfert des moyens financiers du soutien au marché aux paiements directs fait progressivement diminuer l’enveloppe des moyens financiers alloués à la production et aux ventes. Lors des délibérations au sujet de la Politique agricole 2011, le Parlement a décidé de poursuivre ce processus.
■■■■■■■■■■■■■■■■■
2.1 PRODUCTION ET VENTES 125 2
Tableaux 26–30, pages A27–A29
2.1.1 Instruments transversaux
Interprofessions et organisations de producteurs
La loi fédérale sur l’agriculture (art. 8 et 9 LAgr) habilite le Conseil fédéral à rendre obligatoires pour les non-membres des mesures décidées en commun par les interprofessions et les organisations de producteurs, concernant l’amélioration de la qualité, la promotion des ventes et l’adaptation de l’offre à la demande. On parle alors d’extension des mesures collectives. Les entreprises qui bénéficient des mesures d’entraide, sans être membres de l’organisation de producteurs, sont tenues de participer financièrement. Cette disposition permet de lutter contre le comportement opportuniste du «resquilleur».
Dans le cadre de la PA 2011, le Parlement a approuvé les modifications de l’art. 9 LAgr:
–Ces modifications ont permis en premier lieu de préciser que la force obligatoire des mesures d’entraide peut être prolongée sur demande de l’organisation, après réexamen de la situation. La continuité des mesures est ainsi assurée.
–En second lieu, le Parlement a limité l’extension des mesures d’entraide visant à l’adaptation de la production et de l’offre aux exigences du marché à des situations extraordinaires ne relevant pas de problèmes structurels. Les organisations qui présentent une demande d’entraide doivent fournir dans leur dossier la preuve qu’elles se trouvent dans une telle situation. Les mesures d’entraide visant à une intervention durable sur le marché pour stabiliser les prix ou les quantités ne peuvent plus être soutenues par le Conseil fédéral.
La modification de la LAgr a entraîné les adaptations suivantes de l’ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, en vigueur à compter du 1er janvier 2008:
Les extensions avaient été jusqu’ici accordées par périodes de deux ans. Comme le Parlement n’avait pas a priori l’intention de limiter dans le temps l’extension d’une mesure d’entraide, il est possible d’accorder des extensions pour une durée supérieure à deux ans. Une extension de quatre ans au maximum est désormais prévue en ce qui concerne les mesures de promotion des ventes et d’amélioration de la qualité. Dans le cas de mesures touchant à la gestion de l’offre dans des situations extraordinaires, la validité de l’extension est maintenue à deux ans.
Une durée d’extension plus longue allégera le travail administratif des organisations concernées et des services de la Confédération. Les organisations auxquelles le Conseil fédéral a accordé une extension des mesures, doivent présenter chaque année au DFE un rapport sur la mise en œuvre des mesures et sur les résultats. Le Conseil fédéral peut révoquer à tout moment l’extension, lorsqu’un changement de situation l’exige ou que des abus sont constatés.
■■■■■■■■■■■■■■■■■
2.1 PRODUCTION ET VENTES 2 126
■ Extension des mesures d’entraide
En 2005, le Conseil fédéral a étendu aux non-membres les mesures convenues par trois organisations de producteurs et quatre interprofessions. Ces extensions étaient limitées au 31 décembre 2004. Six des organisations concernées (Interprofession du Gruyère, Fédération des producteurs suisses de lait, Union suisse des paysans, GalloSuisse, Emmentaler Switzerland, Interprofession du Vacherin fribourgeois) ont demandé au Conseil fédéral le renouvellement de leur extension. Conformément à la base légale, ces demandes ont été publiées dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) pour que les non-membres de ces organisations puissent donner leur avis dans le cadre de la procédure de consultation. Le Conseil fédéral a approuvé les six renouvellements en novembre 2007.
Les Producteurs suisses de bétail bovin (PSBB) ont présenté à l’OFAG une demande d’extension aux non-membres de l’organisation des mesures d’entraide pour l’éradication de la diarrhée virale bovine (DVB), ceci dans le but de les engager à cofinancer le programme d’éradication. La demande a été acceptée par le Conseil fédéral en été 2007. L’obligation de cofinancement est limitée à trois ans, de 2008 à 2010.

2.1 PRODUCTION ET VENTES 127 2
■ Extensions décidées par le Conseil fédéral en 2007
■ L’agriculture suisse veut s’affirmer sur le marché
Promotion des ventes
Face à la libéralisation des marchés internationaux, la Suisse doit renforcer sa position. A cet effet, il faut que la promotion des ventes atteigne un maximum d’efficacité. A la différence de pays comme l’Allemagne ou l’Autriche qui disposent d’une organisation centrale de marketing des produits agricoles, ce sont les interprofessions qui se chargent chacune dans leur domaine de la promotion des ventes. Les prestations de l’agriculture suisse en matière de publicité et communication sont dispersées dans le cadre de diverses campagnes promotionnelles. Il n’existe jusqu’à présent aucune campagne commune de promotion des produits agricoles suisses. La référence à l’origine suisse du produit est rendue différemment en fonction de l’interprofession qui organise la campagne promotionnelle.
L’agriculture suisse, si elle veut s’affirmer sur des marchés de plus en plus concurrentiels, doit également regrouper ses forces dans les domaines de la communication et de la publicité. Les chances de succès des produits suisses sont excellentes. Le label «Suisse» jouit partout d’une très bonne renommée. L’agriculture suisse peut compter sur la confiance des consommateurs. Ses produits se distinguent par une haute qualité, par leur sécurité et par la proximité («du champ à l’assiette»).
■ «Suisse. Naturellement.» uniformise la communication
En août 2007, le DFE a défini en collaboration avec «Suisse. Naturellement.» une nouvelle identité visuelle commune pour toutes les mesures de promotion des ventes de produits agricoles qui sont cofinancées par la Confédération. «Suisse. Naturellement.» uniformise la communication relative aux produits agricoles suisses. C’est le résultat d’un processus participatif, dans le cadre duquel les interprofessions et les associations concernées, de même que des spécialistes indépendants de la communication, ont apporté leur contribution.
Le label «Suisse» a une grande valeur qui est fondée sur la réputation et l’image positive du pays. Nous disposons là d’un atout que l’agriculture peut utiliser pour la prospection du marché, en Suisse et à l’étranger. Tandis que sur le plan du marché intérieur la qualité (prestation supérieure à celle de produits d’importation eu égard à l’écologie, au bien-être des animaux et à la sécurité des produits) et la proximité sont les principaux critères de la swissness, à l’étranger, il s’agit de tirer profit plus généralement des valeurs positives véhiculées par le label «Suisse». «Suisse. Naturellement.» résume de façon claire et percutante les valeurs véhiculées par le label «Suisse».
«Suisse. Naturellement.» se sert de l’outil de communication que représente Suisse Tourisme («La Suisse –Tout naturellement»). Sur le plan du contenu aussi, il existe une étroite parenté entre la Suisse pays de vacances et la Suisse des produits agricoles: de nombreux touristes goûtent à nos produits sur place avant de les consommer chez eux. Ils peuvent ainsi se remémorer leurs souvenirs de vacances en Suisse en dégustant un morceau de Gruyère ou d’Emmental. En ce sens, «Suisse. Naturellement.» contribue également à l’amélioration de la coordination, souhaitée par le Parlement, de la stratégie de marketing des instruments de promotion appuyés par la Confédération.
2.1 PRODUCTION ET VENTES 2 128
Le nouvel élément graphique confère à l’agriculture suisse une identité visuelle commune au niveau de la communication, sans que les différents produits agricoles et organisations doivent pour autant renoncer à communiquer leurs caractéristiques spécifiques en matière de garanties, de prestations ou de message. Ce nouvel élément graphique permet aux consommateurs de se repérer: un espace est réservé à l’apposition du signe de garantie (G), tel le bourgeon, et un autre à l’identification (I) de l’auteur du message publicitaire. Le champ en rouge portant l’indication «Suisse. Naturellement.» permet de mettre de l’ordre dans la multitude des images utilisées par les différents secteurs de production. Que ce soit une pub à la télé pour le fromage ou une affiche pour les pommes de terre, le champ rouge indiquera désormais toujours clairement l’origine de nos produits agricoles.
«Suisse. Naturellement.» ne crée aucun nouveau label, mais un nouvel élément graphique. Des marques de garantie telles que Suisse Garantie, le bourgeon (produits biologiques), la coccinelle (IP-Suisse) ou encore les marques privées de l’association suisse de promotion des AOC et IGP (appellation d’origine protégée ou indication géographique protégée) et la désignation de l’émetteur du message publicitaire peuvent être ainsi combinées.
«Suisse. Naturellement.» crée un émetteur standard en matière de publicité pour les produits agricoles suisses. Il manque toutefois encore une indication uniformisée de l’origine que l’on retrouverait également sur l’étiquette produit, au point de vente. A cet égard, les interprofessions et le commerce vont devoir trouver une solution.
■ «Suisse. Naturellement.», élément graphique commun
«Suisse. Naturellement.», élément graphique commun
IGSuisse. Naturellement.
2. MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE 2.1 PRODUCTION ET VENTES 129 2
Politique de la qualité et désignation
Deux nouvelles dénominations sont venues enrichir le registre des AOC et des IGP en 2007. Le 16 août, l’OFAG a rendu une décision sur opposition concernant la demande d’enregistrement de la Poire à Botzi en tant qu’AOC. La décision de l’office, qui rejetait toutes les oppositions, n’a fait l’objet d’aucun recours, si bien que la dénomination «Poire à Botzi» a pu être inscrite au registre. Le 15 octobre, le Tribunal fédéral (TF) a rendu une décision concernant la demande d’enregistrement de la dénomination «Raclette» en tant qu’AOC. Il a rejeté le recours du groupement qui lui avait été adressé à la suite de la décision de la Commission de recours du Département fédéral de l’économie (REKO/EVD) qui considérait que le terme «Raclette» ne pouvait pas être réservé aux producteurs valaisans de fromage à raclette. Dans son arrêt, le TF considère que le terme «raclette» a bien une origine valaisanne pour désigner un plat cuisiné mais que son utilisation pour désigner un fromage est trop récente pour que l’on puisse parler de dénomination traditionnelle. La dénomination «Raclette» ne pourra donc pas être enregistrée comme AOC et, selon la décision de la REKO/EVD du 27 juin 2006, c’est la dénomination «Raclette du Valais» qui est désormais inscrite au registre. Ces deux enregistrements portent à 23 le nombre de dénominations figurant au registre des AOC et des IGP (17 AOC et 6 IGP).
L’OFAG a publié le 16 juillet 2007 la mise à l’enquête du cahier des charges de la St. Galler Bratwurst en tant qu’IGP et une opposition a été formulée dans le délai légal de trois mois. Par ailleurs, une procédure de recours concernant l’enregistrement de la Damassine en tant qu’AOC est pendante au Tribunal administratif fédéral. Des décisions ont été rendues concernant les demandes de modification des cahiers des charges du Saucisson neuchâtelois et de la Saucisse neuchâteloise, du Saucisson vaudois, de la Saucisse aux choux vaudoise, du Berner Alpkäse et du Vacherin Mont-d’Or.
Une nouvelle demande d’enregistrement est parvenue à l’OFAG pour le Bündner Bergkäse en tant qu’AOC et la Société tessinoise d’économie alpestre a fait une demande de modification du cahier des charges du Formaggio d’alpe ticinese. Les dossiers actuellement en cours d’examen pour des demandes d’enregistrement concernent la Tomme vaudoise, le Büscion da cavra, le Jambon de la borne, le Boutefas et le Sauerkäse/Bloderkäse pour l’AOC et l’Absinthe, la Longeole, l’Appenzeller Mostbröckli, l’Appenzeller Pantli et l’Appenzeller Siedwurst pour l’IGP. Le Parlement n’étant pas entré en matière sur la révision partielle de la loi sur la forêt, le traitement de la demande d’enregistrement pour le Bois du Jura en tant qu’AOC est toujours dans l’attente d’une base légale.
2.1 PRODUCTION ET VENTES 2 130
■ Etat du registre AOC/IGP
Registre des AOC/IGP le 31 décembre 2007 nombrenombrett
Fromages
L’Etivaz AOC721366393OIC
Emmentaler AOC4 77421633 79830 897OIC
Gruyère AOC3 65425628 88328 600OIC
Sbrinz AOC107301 6081 572Procert
Tête de Moine AOC 29182 0642 222OIC
Formaggio d’alpe ticineseAOC 44180285OIC
Vacherin fribourgeois AOC----OIC
Vacherin Mont-d’Or1579543531OIC
Berner Alpkäse/HobelkäseAOC22388-1 430OIC
Raclette du Valais AOC----OIC

Produits carnés
Bündnerfleisch IGP169831 011Procert
Saucisse d’Ajoie IGP106260OIC
Viande séchée du Valais IGP21361435OIC
Saucisson neuchâtelois/ Saucisse neuchâteloise IGP1762128OIC
Saucisson vaudois IGP466501 040OIC Procert
Saucisse aux choux IGP 41612752OIC vaudoiseProcert
Spiritueux
Eau-de-vie de poire AOC26819 OIC du Valais
AbricotineAOC122OIC
Autres produits
Rheintaler Ribel AOC 613336Procert
Cardon épineux genevoisAOC416357Procert
Pain de seigle du Valais AOC3969738753OIC
Munder Safran AOC 190,000520,002OIC
Poire à Botzi AOC----OIC
Source: OFAG
Protection Exploitations agricoles Entreprises (transformation/ élaboration) Volume de production certifié en 2006 Volume de production certifié en 2007 Organisme de certification 93 000 litres d’alcool à 100% 93 547 litres d’alcool à 100% 592 litres d’alcool à 100% 2. MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE 2.1 PRODUCTION ET VENTES 131 2
Dénomination
■ Importation: modifications des bases légales et des dispositions d’exécution
Instruments du commerce extérieur
Le régime de l’autorisation pour les organisations de marché «fromage», «œufs et produits à base d’œufs» et «animaux de l’espèce chevaline» a été supprimé début 2008 dans le cadre du premier train d’ordonnances relatif à la PA 2011. Les contingents tarifaires concernant ces organisations de marché sont désormais répartis dans l’ordre des déclarations en douane (procédure dite du fur et à mesure à la frontière). Pour ce qui est du fromage, le commerce avec l’UE est libéralisé, de sorte qu’il ne reste plus qu’à répartir le contingent OMC relatif au fromage «Fontal». L’organisation du marché des céréales panifiables est un cas de figure particulier. Ce contingent est certes aussi attribué selon la procédure du fur et à mesure à la frontière, mais on ne peut pas renoncer au régime du permis en raison des réserves obligatoires. Réservesuisse est l’organe compétent pour la remise des autorisations. Comme pour les autres organisations de marché précédemment mentionnées, l’OFAG n’a pratiquement plus de charges administratives, c’est pourquoi les émoluments administratifs prélevés jusqu’ici ont été abolis. Pour connaître la répartition actuelle des contingents tarifaires attribués selon le système du fur et à mesure à la frontière, on se reportera à la page d’accueil de l’Administration fédérale des douanes www.ezv.admin.ch sous Informations pour les entreprises > Contingents tarifaires.
Dans l’optique d’une simplification des bases légales, les dispositions toujours en vigueur de l’ordonnance sur l’importation d’animaux de l’espèce chevaline (RS 916.322.1) et l’ordonnance sur la fixation de droits de douane et sur l’importation de céréales, de matières fourragères, de paille et de marchandises dont les déchets de transformation servent à l’alimentation des animaux (RS 916.112.211) ont été intégrées dans l’ordonnance sur les importations agricoles (OIAgr; RS 916.01). Les ordonnances jusqu’ici en vigueur ont été abrogées. Dès lors qu’en raison de réglementations périmées, d’autres ordonnances sur les produits ne comporteront plus que des dispositions relatives à l’importation, celles-ci seront également reprises dans l’OIAgr. C’est pourquoi il est prévu dans le second train d’ordonnances sur la PA 2011 de supprimer l’ordonnance sur l’importation de lait et de produits laitiers, d’huiles et de graisses comestibles, ainsi que de caséines et de caséinates (OILHGC; RS 916.355.1) tout comme l’ordonnance sur les pommes de terre (RS 916.113.11).
Dans le domaine des fruits et des légumes frais, il a été possible pour la première fois lors de l’attribution 2008 des parts de contingent, de céder des parts de contingent tarifaire en pour cent (dits «chiffres comparatifs») via la liaison Internet sécurisée AEV14online. En même temps, les quantités minimales et règles d’arrondi appliquées jusqu’ici lors de la répartition des parties de contingent tarifaire ont été supprimées. Cette mesure participe à réduire la charge administrative et à prévenir la génération abusive de droits d’importation.
2.1 PRODUCTION ET VENTES 2 132
En ce qui concerne les légumes et les fruits, on applique un système à deux phases. Pendant la phase libre, ces marchandises peuvent être importées en quantité illimitée dans le cadre du contingent. Durant la phase administrée, des libérations limitées de parties de contingent tarifaire sont possibles à des fins de couverture des besoins. Le passage d’une phase à l’autre est garanti, pour qu’au début de la phase administrée, les stocks de marchandises (réserves) restent limités. Depuis l’entrée en vigueur, le 1er mai 2007, de la nouvelle loi sur les douanes, c’est l’Administration fédérale des douanes qui est maintenant chargée de faire appliquer cette réglementation sur la constitution de stocks de réserve. Toute personne qui stocke des marchandises déclarables, est désormais tenue de transmettre une déclaration en douane particulière par Internet. La quantité en excédent peut être imputée via AEV14online à une part de contingent tarifaire déjà libérée. Sinon, il faut payer la différence entre le taux de contingent (TC) et le taux hors contingent (THC). Après une mise en application initiale relativement laborieuse, la nouvelle procédure a été simplifiée. Les changements de phase en 2008 montreront si le nouveau système est viable.

En ce qui concerne l’organisation du marché des fleurs coupées, les THC seront abaissés au niveau de ceux des TC dans un intervalle de dix ans. La première étape du démantèlement a été franchie le 1er janvier 2008. Compte tenu de la réduction progressive des droits de douane, les restrictions d’importation en fonction de la quantité perdent de plus en plus d’importance, jusqu’au moment où la réglementation d’importation ne sera plus nécessaire. Les modes de répartition actuels, en particulier l’attribution des parts de contingent tarifaire sur la base de contrats d’achat conclus avec des producteurs suisses et annoncés à l’OFAG (prestation en faveur de la production suisse) sont pour l’instant maintenus.
Dans le cadre de la réglementation du marché concernant les animaux de boucherie et la viande, les contingents tarifaires partiels de viande halal ont été augmentés en raison de l’accroissement des besoins.
Le rapport du Conseil fédéral du 16 janvier 2008 sur les mesures tarifaires contient une récapitulation détaillée de ces mesures et renseigne notamment sur l’attribution et l’utilisation des contingents tarifaires. La publication de la répartition des contingents tarifaires figure sur le site Internet de l’OFAG sous Thèmes/Importations et exportations.
D’autres modifications des réglementations d’importation sont prévues dans le second train d’ordonnances relatif à la PA 2011. Le Message relatif à la PA 2011 prévoit ainsi de poursuivre la réduction de la protection à la frontière, au moyen de l’assouplissement des droits de douane en ce qui concerne les céréales panifiables et au moyen d’une baisse du prix-seuil en ce qui concerne les aliments pour animaux. Les modes de répartition relatifs aux contingents tarifaires partiels de beurre et de lait en poudre sont changés. Enfin, il est prévu de modifier le mode de calcul du montant des garanties à fournir en cas d’adjudication dans le domaine de la viande.
2.1 PRODUCTION ET VENTES 2. MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE 133 2
■
Dans le cadre de l’Accord agricole bilatéral conclu en 1999, l’UE et la Suisse avaient décidé le passage progressif à un marché libre du fromage. Pendant la période transitoire, la Suisse a accordé à l’UE cinq contingents tarifaires préferentiels dans le cadre desquels du fromage pouvait être importé à droit zéro. Les quantités ont été augmentées chaque année à la demande de l’autre Partie au contrat. La Suisse a mis ces contingents tarifaires en adjudication. Au cours des dernières années précédant le passage au libre-échange, les quantités mises en adjudication étaient parfois si élevées que la demande n’a plus suivi, même après renouvellement de la mise en adjudication. Les prix d’adjudication ont baissé en proportion – pour descendre même, dans certains cas, jusqu’à l’offre minimale de un centime le kg. Les restrictions quantitatives ont été complètement supprimées en juin 2007. De son côté, l’UE a attribué les contingents à droit zéro accordés à la Suisse à l’autorité délivrant les permis d’importation, selon le système du fur et à mesure. A cet effet, les importateurs de l’UE ont dû présenter pendant un bref délai auprès d’un Etat membre une demande d’importation d’une quantité déterminée. Les demandes indiquant les quantités réclamées par les Etats membres étaient centralisées auprès de la Commission compétente de Bruxelles. Lorsque la quantité totale demandée dépassait le volume du contingent, les demandes des Etats membres étaient réduites et ceux-ci réduisaient à leur tour celles des importateurs. Pour bénéficier de la quantité attribuée, les importateurs devaient déposer une caution qui leur était ensuite remboursée dès lors qu’ils avaient utilisé 95% au moins de la quantité attribuée. Etant donné que pour des raisons de procédure, l’UE n’a pas été en mesure d’abolir le système de caution à la date prévue (juin 2007), mais a pu uniquement réduire massivement le montant de la caution et libéraliser les délais, la Suisse n’a pour sa part supprimé qu’à partir du début 2008 seulement le régime de l’autorisation et la perception d’émoluments sur l’importation de fromage. Depuis, le commerce se déroule sans entrave; en ce qui concerne les exportations, un certificat d’origine et la preuve que les produits proviennent d’une entreprise de fabrication autorisée au commerce intracommunautaire sont désormais suffisants. Les contrôles vétérinaires effectués par l’UE doivent également être supprimés en 2008.
Le développement du commerce global de fromage et de séré (tarif douanier 0406) montre que les quantités commercialisées entre l’UE et la Suisse ont augmenté, en particulier en 2007, année du passage au libre-échange total, alors que l’on n’avait pas pu distinguer de tendances claires durant la période transitoire. Les importations en provenance d’autres pays que ceux de l’UE sont négligeables, tandis que les exportations vers ces pays sont restées constantes.

134 2.1 PRODUCTION ET VENTES 2
Passage au libre-échange concernant le fromage et communautarisation du contingent tarifaire relatif à la charcuterie
Dans le cadre du Comité mixte (CM), organe de l’accord agricole conclu en 1999, l’UE et la Suisse ont décidé en 2007 de procéder à une première révision d’importance de l’accord. A cette occasion, les concessions douanières réciproques ont été également modifiées et actualisées. A la suite de l’adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie à l’UE, les préférences tarifaires accordées jusqu’ici à ces deux pays ont été transformées en contingents bilatéraux supplémentaires. Simultanément, les contingents tarifaires bilatéraux de produits de charcuterie accordés jusque-là par la Suisse à l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et la Hongrie ont été «communautarisés», c’est-à-dire qu’ils ont été convertis en un contingent à droit zéro augmenté à 3’715 t net et valable pour toute l’UE à partir de 2008. En décembre 2007, l’OFAG a mis en adjudication ce contingent à droit zéro, et ce, seulement après que la Commission de l’UE 27 eut promulgué le 27 novembre 2007 le «règlement (CE) n° 1399/2007 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire autonome et transitoire pour l’importation de saucisses et de certains produits à base de viande originaires de Suisse». Le contingent tarifaire attribué par l’UE est de 1’900 t par an. Il est réparti en quatre tranches trimestrielles de 25%, les quantités non demandées pouvant être reportées sur la tranche suivante par la Commission. Les quantités contingentaires sont réparties sur la base de licences d’importation, comme décrit précédemment en ce qui concerne l’ancienne procédure d’attribution des contingents de fromage. Les demandes d’octroi d’une licence d’importation auprès des services compétents peuvent être adressées au cours des sept premiers jours du mois précédant le trimestre concerné (sous-période). En même temps que la demande d’octroi, il faut déposer une garantie de 20 EUR par 100 kilogrammes en poids du produit. D’autres dispositions concernent les quantités minimales et maximales octroyées par demande, la preuve de l’importation ou de l’exportation d’au moins 25 t des marchandises en question durant la période de référence et la législation vétérinaire. L’épuisement du contingent n’est pas publié sur Internet. Selon l’information recueillie auprès de la Direction générale Agriculture et Développement rural de la Commission de l’UE, la quantité autorisée au 2 avril 2008 était de seulement 15 t pour les deux premiers trimestres. Des compléments d’information ainsi que la liste des autorités compétentes au sein de l’UE sont disponibles sur le site Internet de l’OFAG, thème «Exportations».
Evolution
en t Source: AFD Importations UE Importations autres pays Exportations UE Exportations autres pays 2001200220032004 0 40000 50000 30000 20000 10000 200520062007 2. MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE 2.1 PRODUCTION ET VENTES 135 2
du commerce de fromage 2001–07
Les importations et exportations de produits transformés ont dépassé pour la première fois un million de tonnes. Par rapport à l’année précédente, les exportations ont ainsi progressé de plus de 8% et les importations d’environ 2%. La croissance de 8% des exportations de produits transformés reflète le dynamisme de l’industrie d’exportation suisse durant la période sous revue. Bien que l’augmentation des exportations vers l’UE (4%) ait été relativement modeste, par comparaison aux 34% supplémentaires d’exportations hors UE, avec 81% des exportations suisses, celle-ci reste de loin le principal débouché extérieur de l’industrie suisse des denrées alimentaires.
Après déduction de 1% (blocage des crédits en raison des mesures d’économie), une somme de 79,2 millions de francs était à disposition pour la compensation de la différence entre les prix des matières premières. La montée en flèche du prix des matières premières sur les marchés mondiaux a réduit l’écart par rapport au niveau des prix suisses. Cette tendance a exercé un effet positif sur l’épuisement des fonds.
■
Importations et exportations de produits agricoles transformés 1000 t ExportationsImportations Sources: AFD, OFAG 2004 0 1000 1200 800 600 400 200 2005 2007 2006 Evolution des contributions à l'exportation de produits transformés mio. fr. Sources: AFD, OFAG 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 180 115 1991/922004 115 2003 79,2 2007 90 2006 90 2005 2.1 PRODUCTION ET VENTES 2 136
Importations et exportations de produits transformés
2.1.2Economie laitière
L’évolution du marché dans l’économie laitière a connu un essor inattendu en 2007, que ce soit sur le marché européen ou le marché mondial. Après une baisse continue pendant près de dix ans, les prix sont remontés, amélioration qui s’est également répercutée sur le marché laitier suisse. L’augmentation de la population mondiale ainsi qu’une demande accrue en produits laitiers en Asie et en Amérique du Sud expliquent en partie cette tendance. En outre, la stagnation de la croissance mondiale pour ce qui est de la production laitière, une exploitation différente des surfaces et les sécheresses survenues dans d’importantes régions productrices de lait limitent l’offre de lait en tant que matière première. Dans l’ensemble, la demande de lait et de produits laitiers a donc dépassé l’offre sur le marché mondial.
L’évolution du marché dans l’économie laitière suisse a été satisfaisante en 2007. Les livraisons de lait, ainsi que les exportations de lait, de fromage, de beurre et de crème, ont augmenté pendant l’exercice écoulé. A l’instar de l’année passée, la production indigène de beurre n’a pas réussi à couvrir la demande; aussi les importations de beurre ont-elles été plus élevées.

■■■■■■■■■■■■■■■■■
2.1 PRODUCTION ET VENTES 137 2
Mesures 2007/08 pour le marché du lait suisse
ProduitFromageBeurreLait écréméPoudre de laitLait de consommation, crème, produits à base de lait frais
Mesure
Protection douanière ■ 1 ■■■■
Suppléments ■
Aides accordées dans le pays ■ 2 ■ 2 ■ 3
Aides à l’exportation ■ 4 ■ 5 ■ 6
1suppression de la protection douanière en raison de la libéralisation totale du commerce du fromage entre la Suisse et l’UE à partir du 1er juin 2007
2 uniquement pour des utilisations particulières
3 uniquement en cas de renonciation aux importations
4 uniquement pour les exportations dans les pays non-membres de l’UE et différenciées en fonction des sortes de fromage
5 ont été abandonnées pour la poudre de lait écrémé le 1er septembre 2007 en raison des hausses inhabituelles des prix sur les marchés mondiaux
6 lait de consommation exclu
■ Moyens financiers 2007
Source: OFAG
Le soutien des prix à disposition dans le domaine du lait s’est élevé à 366 millions de francs pour 2007, ce qui représente une diminution de 76,8 millions de francs (–17,3%) par rapport à l’année précédente. Avec les suppléments pour le lait transformé en fromage et le supplément de non-ensilage, les mesures de soutien restent –comme c’était le cas dans les années précédentes –ciblées sur le fromage.
Source: OFAG
Parmi les quelque 366 millions de francs que la Confédération a versés en 2007 en faveur de l’économie laitière, 295,5 millions de francs (80,7%) ont été alloués au secteur du fromage, 28,9 millions (7,9%) à celui du beurre et 37 millions (10,1%) à la fabrication de poudre de lait et d’autres produits laitiers. Les frais administratifs se sont élevés à 4,6 millions de francs, soit 1,3% du budget laitier.
Répartition des fonds 2007 Total
Aides dans le pays 16,1%
Aides à l'exportation 3,5% Suppléments 79,1% Administration 1,3%
366 mio. de fr.
2.1 PRODUCTION ET VENTES 2 138
Tableau 27, page A28
■ Chiffres-clés à des fins statistiques
Contingentement laitier et données relatives au marché du lait
Au cours de l’année laitière 2006/07, 29’172 producteurs ont commercialisé du lait. Par rapport à 2000/01, ce nombre a diminué de 8’910, soit de 23,4%. La moyenne des livraisons par producteur de lait est montée à 106’904 kg, ce qui représente pour l’année laitière 2006/07 une hausse de 5% par rapport à l’année précédente. La moyenne des livraisons par vache laitière se monte à 5’457 kg pour l’exercice écoulé, soit 20% de plus que pour l’année laitière 1995/1996.
Le transfert à titre temporaire (location) ainsi que le transfert à titre définitif (achat) de contingents ont fortement perdu de leur importance au cours de l’exercice écoulé. 1’034 producteurs de lait ont, au cours de l’année laitière 2006/07, acheté des contingents (ce qui représente une baisse de 86,1% par rapport à l’année précédente) et
2’096 producteurs de lait en ont loué (54,7% de moins que l’année précédente). La quantité de contingents loués a diminué en conséquence de 47,5% au cours de l’exercice écoulé pour s’inscrire à 41,5 millions de kilos. Pour ce qui est de l’achat de contingents, le recul est encore plus notable, puisqu’il est de 85,8%, ce qui représente 27,3 millions de kilos de contingents achetés. La quantité totale des contingents transférés durant l’année laitière 2006/07 s’est élevée à environ 69 millions de kg, ce qui représente 9,8% du contingent de base.
■ Exemption anticipée du contingentement laitier
L’économie laitière suisse subit de plus en plus les influences internationales, qui placent les producteurs et les transformateurs de lait devant le défi de s’adapter aux nouvelles conditions de base afin d’être plus compétitifs. C’est dans ce contexte que le Parlement a opté, avec la révision de la LAgr (PA 2007), pour une période transitoire de trois ans qui durera jusqu’à la suppression du contingentement laitier le 1er mai 2009. Les conditions de production ont été adaptées de façon à ce que les producteurs et transformateurs de lait puissent mieux profiter des opportunités qui s’offrent à eux sur le marché. C’est ainsi que la responsabilité pour la gestion des quantités et la commercialisation ont été confiées aux partenaires commerciaux directement concernés. Le 1er mai 2008, 23’862 producteurs représentant une quantité de base de 2,6 millions de tonnes en tout ont fait valoir l’exemption du contingentement laitier au niveau fédéral.
■ Quantités supplémentaires
Les organisations qui ont bénéficié – tout comme leurs producteurs – d’une exemption anticipée du contingentement à partir du 1er mai 2006, du 1er mai 2007 ou du 1er mai 2008 (organisations exemptées), peuvent en vertu des art. 12 et 20 de l’ordonnance sur l’exemption du contingentement laitier (OECL) commercialiser une quantité de lait supplémentaire pendant une année laitière et ce, avec l’accord de l’OFAG. L’OFAG ne donnera son accord qu’à condition que cette quantité supplémentaire ne porte pas préjudice aux concurrents du marché intérieur. Pour cette raison, ce sont surtout les projets d’exportation qui sont autorisés. Les quantités supplémentaires pour des projets dans le pays sont autorisées lorsque les produits transformés requièrent une qualité de lait supérieure ou qu’ils présentent un caractère novateur. En tout état de cause, la nécessité de commercialiser une quantité supplémentaire doit pouvoir être prouvée.
2.1 PRODUCTION ET VENTES 2. MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE 2 139
Au cours de l’année laitière 2007/08, 30 organisations exemptées ont fait une demande de quantités supplémentaires.
Aperçu des demandes de quantités supplémentaires 2007/08
NombreQuantité (en millions de kg)
Demandes déposées136196 par des organisations de producteurs (OP)79126,5 par des organisations de producteurs et d’utilisateurs de lait (OPU)5769,5
Demandes approuvées135195,9 Projets d’exportation95148,5 Projets à l’intérieur du pays4047,4
Source: OFAG
En comparaison avec 2006/07, la quantité de lait autorisée pour des projets de quantités supplémentaires a plus que doublé au cours de l’année laitière 2007/08. Cette tendance est due à la situation favorable du marché qui enregistre une demande croissante en produits laitiers. La réglementation pour une exemption anticipée du contingentement laitier a été conçue de manière à offrir une certaine souplesse, ce qui permet aux organisations nouvellement fondées de réaliser rapidement leurs projets de demande de quantités supplémentaires. La possibilité d’une exemption anticipée se révèle être – même dans la deuxième année de transition –une façon utile de se préparer en vue de la suppression généralisée du contingentement laitier qui devrait intervenir le 1er mai 2009.
Afin que l’OFAG puisse observer et contrôler le déroulement des projets de demande de quantités supplémentaires approuvés, les organisations et les utilisateurs communiquent à l’OFAG tous les trois mois les chiffres concernant les exportations et les ventes des produits concernés pour ce qui est des produits provenant des quantités supplémentaires. De cette manière, on garantit que le lait provenant des quantités supplémentaires autorisées est transformé et commercialisé conformément à ce qui était prévu dans le projet et qu’il ne surcharge pas le marché intérieur. A la fin du troisième trimestre de l’année laitière en cours, l’OFAG vérifie, conjointement avec les organisations en question et les utilisateurs respectifs, que le projet de quantités supplémentaires se déroule bien de la façon qui était prévue dans la demande; à cet effet, des contrôles par sondages sont effectués sur place. Lors de la vérification d’un des projets de quantités supplémentaires pour l’année laitière 2006/07, il s’est avéré que dans l’un des cas, les conditions de transformation des quantités supplémentaires n’avaient – en partie – pas été respectées. L’OFAG est donc intervenu et a pris les mesures administratives nécessaires.
2.1 PRODUCTION ET VENTES 2 140
En plus des 34 organisations exemptées, quatre nouvelles organisations ont adressé une demande d’exemption pour la dernière année de transition précédant l’exemption définitive du contingentement laitier. Il s’agit exclusivement d’organisations disposant de leur propre utilisateur de lait. La quantité minimale exigée de 20 millions de kilos de lait à commercialiser ne sera pas entièrement atteinte par les organisations mentionnées. Etant donné que les producteurs et utilisateurs de lait concernés jouent toutefois un rôle important sur le plan régional en ce qui concerne la valeur ajoutée dans la production de lait, les demandes ont pu être autorisées sur la base de la disposition d’exception de l’art. 5 OECL.
Organisations exemptées à partir du 1er mai 2008
Pour l’année laitière 2008/09, 2’885 producteurs de lait supplémentaires ont opté pour l’abandon du contingentement et pour l’intégration à une organisation exemptée nouvelle ou déjà existante. Le nombre de producteurs de lait ayant renoncé au contingentement passe ainsi de 23’862 à 26’830, ce qui représente une hausse d’environ 11%. La quantité de lait livrée par les 38 organisations ayant dernièrement renoncé au contingentement se monte à 2,83 millions de tonnes par an. Ce chiffre représente environ 91% de l’ensemble de la production suisse, qui s’élève à 3,11 millions de tonnes (contingents supplémentaires et quantités supplémentaires non compris).

ProducteursQuantité de base (prov.) état au 07.04.2008 Organisation producteurs-utilisateurs (OPU)Nombrekg OPU Reutigen201 672 674 OPU SPTC Cremo42820 546 635 OPU Seiler282 459 604 OPU Gais564 943 275
2. MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE 2.1 PRODUCTION ET VENTES 141 2
■ Projet «Evaluation des données laitières» (EVDL)
Le projet «Evaluation des données laitières» (EVDL), anciennement projet partiel appelé «Evaluation», a été initié en juillet 2006. Ce projet prévoit la mise en place d’une plateforme qui permettra d’évaluer de façon homogène et transparente toutes les données laitières; cette plateforme couvre les besoins actuels et futurs de l’OFAG en matière d’évaluation et pourra être développée par la suite grâce à un réseau intégré de données agricoles. Dans le cadre de la clarification des besoins, la nécessité de créer une telle plateforme a été étudiée auprès d’utilisateurs concernés faisant partie ou non de l’administration fédérale, ce qui a débouché sur une première proposition de solution. Fin mai 2007, la phase de clarification des besoins a pris fin. Les travaux conceptuels ont commencé au début du mois de juin 2007 pour se terminer en été 2008. Parallèlement, le futur cadre relatif à l’utilisation et à la transmission de données laitières aux frais des intéressés à des fins de droit privé a été défini. C’est sur cette base qu’une offre pour une utilisation de droit privé concernant les données laitières ainsi que les taxes correspondantes a été élaborée et soumise aux intéressés externes. Celle-ci prévoit trois possibilités pour l’accès aux données laitières:
1.Données laitières des exploitations individuelles
Il est possible d’obtenir par produit et par transformateur les données relatives à la production laitière des exploitations telles que la livraison mensuelle ou les données relatives à la transformation du lait telles que les quantités transformées mensuellement. Cela évidemment, à condition que les dispositions en matière de protection des données soient respectées (l’utilisation des données doit être connue et acceptée par les personnes concernées).
2.Evaluations standard
Dans le cadre d’un abonnement mensuel ou annuel, l’accès au domaine protégé de la plate-forme d’évaluation est délivré ; il permet d’effectuer une série définie d’évaluations standard.
3.Evaluations individuelles
Des évaluations individuelles relatives à la production et à la transformation de lait peuvent être établies sur la base des données laitières disponibles.
Seul un nombre limité de questions prédéfinies sera à disposition sur la nouvelle plateforme d’évaluation. Grâce à l’outil d’évaluation Business Intelligence (BI-Tool), l’utilisateur pourra interroger individuellement la banque de données. Dans le cadre de la phase de conceptualisation, un outil d’évaluation approprié a été examiné.
Pendant les travaux relatifs au projet, plusieurs domaines liés aux données laitières, appelés objets d’information, ont été définis, grâce auxquels l’ensemble des données laitières peut être présenté de façon globale. Les données sur le marché sont un objet d’information important. Dans le cadre de la clarification des besoins du projet EVDL, il s’est avéré que des besoins concernant les données du marché existent à l’OFAG, que les informations sur le marché du lait actuellement disponibles ne peuvent satisfaire. C’est pour cette raison qu’un groupe de travail composé de spécialistes a été mandaté afin d’élaborer des propositions qui permettent de tirer au mieux parti des données du marché relatives au secteur du lait.
2.1 PRODUCTION ET VENTES 2 142
■ Modifications concernant les contributions destinées à promouvoir la mise en valeur du marché du lait
Soutien au marché par le biais des suppléments et des aides

Dans le cadre de la politique agricole 2002, la suppression du soutien des prix dans le secteur du lait a été établie. Le Conseil fédéral avait, à ce propos, édicté l’art. 188 LAgr avec effet au 1er janvier 1999, lequel attribuait une validité de dix ans à l’article concernant les suppléments et les aides dans le domaine du lait. Le 1er janvier 2009, les aides de soutien au marché seront ainsi démantelées. En revanche, suite à la modification de la loi due à la politique agricole 2011, l’octroi de suppléments pour le lait transformé en fromage et le non-ensilage a été prolongé au-delà du 1er janvier 2009.
Dans l’optique d’une mise en œuvre progressive, les taux des aides visant à la promotion des ventes à l’intérieur du pays ainsi que ceux des aides à l’exportation ont été abaissés de moitié le 1er janvier 2007. Le développement positif du marché du lait en 2007 a entraîné, à partir du 1er janvier 2008, une nouvelle baisse des taux pour ce qui est des aides à la promotion des ventes dans le pays d’environ 50% chacun. Les taux des aides à l’exportation de fromage dans d’autres pays que ceux de l’UE demeurent toujours entre 40 et 70 centimes par kg.
En ce qui concerne les mesures de soutien du prix du lait, il a été décidé – avec effet au 1er septembre 2007 –de suspendre les aides à l’exportation pour la poudre de lait écrémé. Cette décision a été motivée par l’augmentation exceptionnelle des prix sur le marché mondial dans le courant de l’année 2007 et qui a eu pour la première fois comme conséquence que la poudre de lait écrémé était parfois plus chère à l’étranger que dans le pays.
2.1 PRODUCTION ET VENTES 143 2
Projets de recherche
L’objectif principal du projet «Lait de montagne» consistait à développer des stratégies afin d’accroître la compétitivité dans les secteurs de la production, de la transformation et de la commercialisation du lait dans les régions de montagne suisses.
L’HESA a élaboré, avec le soutien et la collaboration de la Fédération des producteurs suisses de lait (PSL), d’une fondation privée, de l’Aide suisse aux montagnards, de la Migros, de divers services cantonaux de vulgarisation en matière d’agriculture, de l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) ainsi que de l’OFAG, des mesures visant à une revalorisation du lait provenant des régions de montagne suisses. Le projet s’est étalé de 2003 à 2007 et s’est concentré, dans un premier temps, sur les régions de l’Engadine, de Rheinwald/Andeer, de l’arrière-pays lucernois, du Haut-Emmental et du Neckertal dans le canton de St-Gall.
Il découle des projets partiels et sous-projets, 11 recommandations succinctes, dont la mise en œuvre a déjà commencé dans les régions qui devaient accueillir les projets. A l’avenir, l’HESA poursuivra son engagement en faveur du transfert des connaissances dans d’autres régions de montagne.
Les recommandations énoncées concernent, entre autres, le développement et la mise en oeuvre de stratégies d’entreprise et de production à long terme, un positionnement optimal sur le marché des produits de qualité en provenance des régions de montagne, l’établissement de mesures visant à faire baisser les coûts et à utiliser les instruments de l’économie d’entreprise. Enfin, l’accent a également été mis sur le fait qu’un engagement de la part des producteurs et transformateurs de lait sera indispensable à long terme si l’on veut assurer la compétitivité de la filière du lait et des produits laitiers au niveau régional.
Tous les rapports découlant du projet «Lait de montagne» conduit par l’HESA peuvent être consultés sur le site Internet suivant (uniquement en allemand): http://bergmilch. shl.bfh.ch
2.1 PRODUCTION ET VENTES 2 144
■ Projet «Lait de montagne» mené par la Haute école suisse d’agronomie (HESA)
2.1.3 Economie animale
La Confédération et les cantons doivent mettre à profit aussi bien les derniers acquis scientifiques que les expériences accumulées pour éviter la propagation des épizooties. C’est pourquoi, au cours de l’année sous revue, diverses mesures ont été prises dans le but de réduire les pertes de gain engendrées par les épizooties, qui grèvent l’économie animale suisse.
Le 12 septembre 2007, le Conseil fédéral a décidé d’éradiquer de la Suisse la diarrhée virale bovine (BVD). La BVD cause notamment des troubles digestifs et une diminution de la fécondité. Elle provoque également une augmentation du nombre d’avortements et de difformités à la naissance. En outre, elle amoindrit la production de lait et la performance d’engraissement. Cette maladie virale engendre des pertes financières d’environ 9 millions de francs par année pour l’agriculture suisse. Au printemps 2008, des tests ont été effectués, selon un plan de mesures échelonnées, sur tout le jeune bétail estivé, afin d’identifier et d’éliminer les animaux appartenant au groupe des infectés permanents (IP). Entre le 1er octobre et le 31 décembre 2008, tous les animaux de l’espèce bovine n’ayant pas encore été testés seront examinés. Les IP doivent être abattus sans délai. Les coûts du programme d’éradication de la BVD s’élèvent à un total d’environ 60 millions de francs. Un tiers de ces coûts est à la charge des éleveurs de bétail. Les deux tiers restants sont assumés par les cantons.
A fin octobre 2007, le premier cas de maladie de la langue bleue s’est déclaré en Suisse. Il s’agit d’une maladie infectieuse virale s’attaquant aux ruminants. Elle n’est pas directement contagieuse mais est transmise par les moustiques. La maladie peut entraîner une hausse de la température corporelle, des infections des onglons, de l’apathie, une salivation excessive et une destruction des muqueuses.

■■■■■■■■■■■■■■■■■
2.1 PRODUCTION ET VENTES 145 2
On peut déduire de l’expérience faite par d’autres pays d’Europe centrale que le nombre de cas de maladie de la langue bleue en Suisse va augmenter considérablement en 2008. Pour les éleveurs de bétail, les pertes pourraient, dans le pire des cas, dépasser les 50 millions de francs. C’est pourquoi, le 27 février 2007, le Conseil fédéral a décidé que la Confédération financerait les vaccins nécessaires à une campagne de vaccination nationale contre la maladie de la langue bleue.
Afin d’éviter que de nouveaux cas de grippe aviaire ne se déclarent en Suisse, des mesures préventives de protection étaient en vigueur pendant l’hiver 2007/2008 dans les régions proches de plans et de cours d’eau importants. En particulier, les poules et les dindes devaient être nourries et abreuvées dans des espaces protégés, et elles devaient être tenues à distance des oiseaux aquatiques. L’interdiction générale d’élever de la volaille en plein air, en vigueur pendant les deux hivers précédents, avait été levée.
Le 1er janvier 2008, la nouvelle ordonnance sur l’élevage est entrée en vigueur. Les principales modifications qu’elle apporte sont les suivantes: augmentation des contributions fédérales – en raison de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) – pour atteindre le niveau des contributions cantonales en vigueur jusqu’à fin 2007; reconnaissance des organisations d’élevage pour dix ans au maximum; introduction d’un «seuil de soutien» de 30’000 francs par organisation d’élevage. Cette modification aura pour conséquence que les organisations d’élevage reconnues dont les prestations de services ne donnent pas droit à un fonds de promotion d’au moins 30’000 francs ne recevront plus de soutien financier à partir de 2009. Font exception les organisations d’élevage de races suisses.
Mesures 2007
Animal/ProduitBovinsVeauxPorcsChevauxMoutonsChèvresVolailleOeufs
Campagnes de stockage
Campagnes de ventes à prix réduits
Campagnes d’œufs cassés et mesures de commercialisation
Contributions à la mise en valeur de la laine de mouton
Aides à l’exportation de bétail d’élevage et de rente
Effectifs maximums
Banque de données sur le trafic des animaux
Contributions à l’infrastructure des marchés publics dans les régions de montagne
de l’élevage
Mesure Protection
■■■■■■■■
■■■
■■■
douanière
Dégagement des marchés publics
■■■
■
■
■■■■
■■■■
■■■■■
■■■
■■■■■■ Source: OFAG 2.1 PRODUCTION ET VENTES 2 146
Promotion
■ Moyens financiers 2007
Le principal élément de soutien au marché de la viande suisse est la protection à la frontière avec les droits de douane et les contingents. L’OFAG accorde également des aides pour soutenir les marchés de la viande et des œufs et pour encourager l’exportation d’animaux d’élevage et de rente. Par ailleurs, pour garantir temporairement l’écoulement, les marchands de bétail de boucherie doivent reprendre les animaux excédentaires sur le marché public. En raison de la situation favorable sur le marché, le montant des aides octroyées pour la viande et les œufs a été moins élevé que prévu. La prise en charge de bétail non vendu sur les marchés publics a en outre été très faible. Dans le cadre du développement périodique des accords bilatéraux, le 1er janvier 2008, la Suisse a reçu de l’UE un contingent exempt de droits de douane pour 1’900 t de charcuterie. En contrepartie, elle a groupé les contingents de charcuterie de quatre pays (l’Italie, l’Allemagne, la France et la Hongrie) et les a fait passer de 800 t à 3’715 t net. De plus, de la charcuterie en provenance de tous les pays de l’UE peut désormais être importée en franchise de douane dans ce contingent élargi.
Le budget 2007 prévoyait 42,6 millions de francs pour les mesures en faveur de l’économie animale. Les dépenses pour le contrôle du trafic des animaux et l’élimination des sous-produits animaux n’étaient pas comprises dans cette somme. Des 42,6 millions, 37,5 ont été dépensés. Raison principale de la réduction des dépenses: la bonne situation régnant sur le marché des œufs et celui de la viande de bœuf. Seule la viande de veau a dû être stockée temporairement et l’excédent d’œufs qui suit la période de Pâques a été plus faible que les années précédentes. Dans le cadre du contrôle du trafic des animaux, l’exploitation de la banque de données sur le trafic des animaux (BDTA) a nécessité 8,9 millions de francs, qui ont été totalement couverts par les 9,5 millions de recette générés par les émoluments à l’importation. L’OFAG a dépensé 46 millions de francs pour l’élimination des sous-produits animaux. Environ un tiers de ce montant a bénéficié aux détenteurs de bovins. Les deux autres tiers sont allés à des abattoirs d’animaux appartenant aux espèces bovine, ovine, porcine et caprine.
Répartition des fonds 2007
Total 37,5 mio. de fr.
Aides financières pour le bétail de boucherie et la viande, contributions à l'infrastructure dans la région de montagne 10%
Aides à l'exportation d'animaux d'élevage ou de rente 15%
Contributions destinées à soutenir la production suisse d'œufs 5%
Conventions de prestations Proviande 18%
Contributions à la mise en valeur de la laine de mouton 2%
Elevage 50%
Source: Compte d'Etat
2. MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE 2.1 PRODUCTION ET VENTES 147 2
Tableau 28, page A28
■ Bétail de boucherie et viande: convention de prestations
En vertu de l’art. 51, LAgr, l’OFAG a confié à la coopérative Proviande, le 1er janvier 2000, différentes tâches sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande. Un nouveau contrat de prestations de quatre ans avec Proviande est entré en vigueur le 1er janvier 2008, après que les tâches ont fait l’objet d’un appel d’offres public.
1.Taxation neutre de la qualité
Proviande doit taxer de façon neutre la qualité des animaux abattus dans tous les grands abattoirs. A la fin de l’exercice, la qualité des carcasses a été taxée par le service de classification de Proviande dans 34 entreprises. Cinq exploitations ont abattu principalement des bovins, mais aussi des animaux des espèces chevaline, ovine et caprine. Trois exploitations n’ont abattu que des porcs. Vingt-six exploitations ont abattu des animaux de toutes les espèces. La taxation a porté sur 89% des porcs abattus, 88% des veaux, 87% des vaches, génisses, bœufs et taureaux et 64% des ovins. Dans le domaine de la CH-TAX, les contestations ont diminué de 8% par rapport à l’année précédente. Elles portaient en effet sur 6’060 carcasses de bovins et d’ovins. Pour environ un tiers des carcasses faisant l’objet d’une contestation, la classification a été corrigée. Ces contestations émanaient de fournisseurs (72%), et d’acheteurs (28%).
Répartition des carcasses selon les classes de charnure 2007 en %
La charnure et la couverture de graisse des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et chevaline font l’objet d’une appréciation visuelle. Cinq classes de charnure sont prises en compte: C = très bien en viande, H = bien en viande, T = charnure moyenne, A = charnure faible, X = très décharné. La couverture de graisse est également subdivisée en cinq classes. 57% des vaches étaient de charnure moyenne, bien en viande ou très bien en viande, ce qui représente 1% de plus que l’année précédente. Dans la catégorie des taureaux, 97% des animaux étaient de charnure moyenne, bien en
Source: Proviande
C = très bien en viande H = bien en viande T = charnure moyenne A = charnure faible X = très décharné
VachesTaureauxVeaux Classe de charnure AgneauxCabris 0 70 50 60 40 30 20 10 2.1 PRODUCTION ET VENTES 2 148
C H T A X
viande ou très bien en viande. Deux tiers des veaux et la moitié des agneaux abattus ont été jugés de charnure moyenne. Si l’on considère l’évolution sur plusieurs années, deux tendances se dégagent: l’augmentation de la charnure des vaches, des taureaux et des cabris d’une part et la stabilité de la charnure des veaux et des agneaux d’autre part. La première tendance est due à l’augmentation considérable du nombre de vaches mères bien en viande, ainsi qu’à l’amélioration de l’engraissement des taurillons. La seconde tendance s’explique par le fait que les méthodes d’alimentation et d’engraissement n’ont pas évolué depuis des années.
2.Surveillance des marchés publics et mise sur pied de mesures destinées à alléger le marché
Des marchés publics des animaux de boucherie appartenant aux espèces bovine et ovine ont été mis sur pied dans 21 cantons. Seuls les cantons de Bâle-Ville, Genève, Schaffhouse, Zurich et Zoug n’ont pas organisé de marchés.
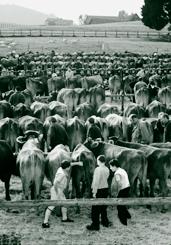
Des organisations paysannes et/ou des services cantonaux ont organisé durant toute l’année des marchés publics de bovins et de moutons. Le nombre d’ovins mis en adjudication sur les marchés publics a augmenté de 3,3% par rapport à 2006. Le nombre de veaux a quant à lui augmenté de 12,2%. Pour le gros bétail, le nombre d’animaux mis en adjudication sur les marchés publics a par contre baissé de 4,9%. Ce recul est dû pour l’essentiel au fait que moins de vaches ont été abattues.
Les marchés publics surveillés en 2007 en chiffres
ParamètreUnitéVeauxGros bétailOvins Marchés publics surveillésNombre269779334
Animaux présentés, vendus aux enchèresNombre35 53559 60476 688 Part d’animaux admis par rapport à l’ensemble des abattages%141730
Animaux attribués (dégagement du marché)Nombre14147551
Source: Proviande
En accord avec les cantons et les organisations paysannes, Proviande établit avant le début de l’année civile un programme annuel des marchés publics désignés. Ce programme indique notamment les places et les jours de marché ainsi que les catégories d’animaux pouvant être présentées. Il doit être approuvé par l’OFAG.
L’OFAG a versé 3,7 millions de francs à des abattoirs pour le stockage temporaire de 890 t de viande de veau. En revanche, en raison de la situation favorable du marché, aucun stockage ni aucune réduction du prix n’ont été nécessaires pour la viande de bœuf.
2. MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE 2.1 PRODUCTION ET VENTES 149 2
■ Dispositions relatives à l’importation de viande
Pour chaque catégorie de viande, après consultation du conseil d’administration de Proviande, l’OFAG définit les quantités à importer pendant une période d’importation donnée, en tenant compte de la situation du marché. La période d’importation pour la viande de bœuf et de porc en demi-carcasses est fixée à quatre semaines; celle concernant la viande de mouton, de chèvre, de cheval et de volaille, ainsi que les abats, à un trimestre. Si certaines conditions sont remplies, les périodes d’importation peuvent être raccourcies ou rallongées. En ce qui concerne les produits de charcuterie, les spécialités de viande et les viandes d’animaux abattus rituellement, les contingents d’importation sont fixés par le Conseil fédéral, dans l’ordonnance sur les importations agricoles. Ces contingents sont définis pour au moins une année. Pour la première fois en 2007, l’OFAG a mis en adjudication 100% des contingents d’importation de viande, mettant ainsi un terme à l’introduction par étapes de la mise aux enchères. Cependant, 10% des contingents d’importation de viande d’animaux de l’espèce bovine (sans les morceaux parés de la cuisse) et d’animaux de l’espèce ovine sont encore attribués sur la base d’une prestation en faveur de la production suisse. Par prestation en faveur de la production suisse, on entend le nombre d’animaux achetés aux enchères sur les marchés publics surveillés.
■ Mise en adjudication des contingents d’importation de viande
Le nombre d’entreprises enchérisseuses est passé, pour toutes les catégories de viande, de 170 (en 2005) à 197 (en 2007). Etant donné qu’un participant regroupe les offres de nombreuses petites entreprises sur une «plate-forme d’offre» pour ensuite présenter une seule offre, le nombre effectif de participants est plus élevé. La proportion d’entreprises ayant acquis pour la première fois des contingents d’importation de viande par adjudication est passée de 28% en 2005 à 43% en 2007. En 2007, 57% des entreprises enchérisseuses sont des importateurs qui ont acquis des parts de contingent tarifaire avant 2005, dans le système de la prestation en faveur de la production indigène. Avec la mise aux enchères, la plupart de ces entreprises ont étendu leurs activités à de nouvelles sortes de viande. Le nombre de participants varie considérablement selon les quatorze catégories de viande. Pour l’ensemble de l’année, il va de 22 offres pour la viande de cabri à 103 offres pour les aloyaux et le HighQuality-Beef (bœuf de haute qualité).
Sur le marché de la viande d’importation, la concurrence a augmenté de façon significative. Les marges brutes de transformation-distribution de viande de bœuf et de porc diminuent ainsi continuellement depuis 2005. Il n’y a pas eu de pression sur les prix à la production, excepté pour la viande de porc, dont l’offre indigène a fortement augmenté depuis 2005.
Par rapport à l’année 2005, la plupart des prix de la viande importée ont encore augmenté en 2006 et en 2007. Rien n’indique donc que davantage de viande bon marché a été importée.
L’ensemble des contingents d’importation de viande mis en adjudication entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007 ont généré des recettes de 178,2 millions de francs au bénéfice de la caisse fédérale. La viande de volaille, les aloyaux et le High-QualityBeef ainsi que la viande des animaux de l’espèce ovine y ont contribué à raison de 79%. Dans son message du 29 mai 2002 sur l’évolution future de la politique agricole, le Conseil fédéral estimait à 150 millions de francs les recettes supplémentaires de la Confédération pour l’année 2007. Les produits de charcuterie et les spécialités de
2.1 PRODUCTION ET VENTES 2 150
viande, qui sont intégralement mis en adjudication depuis 1999, n’ont cependant pas été pris en compte dans cette estimation. Ces produits ont généré des recettes de 17,8 millions de francs au cours de l’année sous revue.
Résultats des mises en adjudication en 2007
ProduitQuantité
appel
Nombre moyen
Unitéen kg brutNombrefr./kg brut Viande de volaille43 200 000571,83 Viande de porc en demi-carcasses5 725 000310,57 Viande des animaux de l’espèce ovine5 490 000573,61 Viande des animaux de l’espèce chevaline5 175 000210,75 Viande de vache en carcasses, destinée à la transformation4 365 000240,79 Aloyaux / High-Quality-Beef3 757 5007710,92 Viande de veau922 500373,96 Viande de vache destinée à la transformation787 500272,38 Langues495 00070,03 Viande des animaux de l’espèce caprine370 000221,01 Cuisses de bœuf350 0002610,57 Museaux de bœuf224 80060,03 Foies de veau117 000110,12 Pistolas de vaches45 000171,20 Viande de bœuf (kascher)267 00040,21 Viande de bœuf (halal)300 00030,31 Viande de mouton (kascher)16 60030,22 Viande de mouton (halal)150 00030,32 Jambon séché à l’air en provenance de l’UE1 100 000817,69 Viande séchée à l’air en provenance de l’UE220 000579,04 Jambon en boîte et jambon cuit71 500257,09 Viande de bœuf en conserve770 000130,58 Produits de charcuterie d’Italie2 856 000732,07 Produits de charcuterie de France125 000141,31 Produits de charcuterie d’Allemagne103 000182,40 Produits de charcuterie de Hongrie64 000100,39 Source: OFAG 2.1 PRODUCTION ET VENTES 2. MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE 151 2
Prix d’adjudication mise en des participants moyen adjudicationpar
d’offre
■
Selon le recensement fédéral des exploitations agricoles de l’OFS, pendant l’année 2005, 21’461 personnes, dans 2’075 exploitations, ont travaillé à l’abattage, à la transformation de la viande, ainsi que dans le commerce de gros ou dans le commerce de détail de la viande. Depuis 1995, le nombre de personnes exerçant ces activités a diminué de 9% et le nombre des exploitations, de 26%. Les boucheries, dont la principale activité est le commerce de détail de viande, sont particulièrement frappées par ce recul. En 1995, il y avait encore 2’227 boucheries; en 2005, elles n’étaient plus que 1’627 (–29%). Pendant la même période, le nombre de personnes y exerçant une activité a baissé d’un cinquième (8’441 personnes en 2005). En 2005, 104 entreprises avaient pour activité principale l’abattage de bétail alors que, dix ans plus tôt, ces entreprises étaient encore au nombre de 112. Le nombre de personnes actives est passé de 22 à 48 par exploitation. On constate donc que le travail d’abattage est transféré des boucheries aux entreprises spécialisées, dont la taille augmente. Entre 1995 et 2005, le nombre d’entreprises de transformation de la viande est resté stable, mais le nombre de personnes y exerçant une activité a, quant à lui, baissé de 22%. Dans le domaine de l’abattage, la tendance s’inverse. En 2005, seules 35 personnes en moyenne travaillaient encore dans chaque entreprise de transformation de la viande (contre 45 en 1995). Les entreprises de cette branche montrent que les petites entreprises ont aussi leur place sur le marché suisse, à condition, par exemple, de se spécialiser. Le commerce de gros avec des animaux vivants est par contre en régression. Entre 1995 et 2005, le nombre d’entreprises est passé de 314 à 233 et, dans le même temps, le nombre de personnes exerçant une activité dans ce domaine a diminué de 6%.
■ Oeufs: soutien de la production suisse et mesures de mise en valeur
La demande d’œufs suisses est particulièrement faible après Pâques et durant les mois d’été. Pour atténuer les effets de ces variations saisonnières du marché, l’OFAG a débloqué pour l’année sous rapport, après consultation des milieux concernés, un montant de 2,815 millions de francs pour des mesures de mise en valeur. Les fabricants de produits à base d’œufs ont cassé 7,4 millions d’œufs de consommation du pays pour alléger le marché, recevant pour chaque œuf cassé, preuve à l’appui, une contribution de 9 centimes. Les commerçants ont réduit le prix de 10,3 millions d’œufs en faveur des consommateurs, recevant 5 ct. par œuf. En tout, 14 entreprises ont participé aux campagnes d’œufs cassés et 10 entreprises, à la campagne de ventes à prix réduits. L’OFAG a procédé à des contrôles à domicile et examiné les justificatifs, afin de vérifier si les dispositions étaient respectées.

Evolution structurelle dans le domaine du bétail de boucherie et de la viande
2.1 PRODUCTION ET VENTES 2 152
■ Importation et exportation d’animaux d’élevage et de rente
Depuis le 1er janvier 2007, les parts de contingent tarifaire des animaux de l’espèce chevaline sont attribuées suivant la réception de la déclaration en douane (système du fur et à mesure). L’abandon de la mise en adjudication au profit de cette procédure a amené un allégement des tâches administratives liées à l’importation de chevaux. Le contingent tarifaire de 3’322 chevaux a donc été presque entièrement épuisé. La suppression du régime de l’autorisation (permis général d’importation) le 1er janvier 2008 représente une avancée supplémentaire. Le contingent tarifaire pour les animaux de l’espèce bovine (1’200 têtes) a été mis en adjudication en deux tranches. Le prix d’adjudication moyen était respectivement de 537 francs et 359 francs par animal. Les parts de contingent tarifaire de porcs, de moutons, de chèvres et de semence de taureaux sont attribuées d’après l’ordre d’arrivée des demandes à l’OFAG (système du fur et à mesure). En ce qui concerne les bœufs, les porcs, les moutons et les chèvres, seuls les animaux destinés à l’élevage peuvent être importés dans le cadre du contingent tarifaire.
■ Contrôle du trafic des animaux
La banque de données sur le trafic des animaux (BDTA) est gérée par l’entreprise Identitas AG sur mandat de la Confédération. De nombreux projets et améliorations ont été réalisés pendant l’année sous revue. Depuis la révision du 12 mai 2007, les exigences relatives à la traçabilité des bœufs (historique de l’animal) sont renforcées. Les deux unités d’élevage concernées doivent indiquer la même date pour un déplacement d’animaux (sortie et entrée). La règle était plus souple auparavant: on tolérait jusqu’à trois jours entre la sortie et l’entrée d’un animal. Un service de SMS a simultanément été mis en place. Il attire l’attention des éleveurs sur les lacunes dans la traçabilité de leurs bêtes et leur conseille de remplir des notifications de sortie. La révision du 17 novembre 2007 a permis d’atteindre un autre but important: la mise à profit du registre des entreprises du Système d’information sur la politique agricole (SIPA) pour la BDTA. C’est le résultat du travail considérable effectué par les services vétérinaires et les services de l’agriculture des cantons. Grâce à ce progrès, les mouvements d’animaux à destination et en provenance des exploitations d’estivage sont également enregistrés depuis le printemps 2008. Deux autres projets sont encore en cours: l’utilisation des données de la BDTA pour le calcul des paiements directs liés au bétail bovin d’une part et l’extension du contrôle du trafic des animaux aux porcs d’autre part.
■ Elevage
Le 14 novembre 2007, le Conseil fédéral a adopté une nouvelle ordonnance sur l’élevage, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Une révision totale de l’ordonnance sur l’élevage du 7 décembre 1998 s’imposait, pour deux raisons principales.
Le Contrôle fédéral des finances a inspecté la promotion de l’élevage pendant l’année 2006. Il est parvenu à la conclusion que les moyens financiers ont été utilisés, pour l’essentiel, de manière pertinente et conforme aux prescriptions. Il a cependant identifié deux domaines dans lesquels des améliorations seraient possibles: la reconnaissance des organisations d’élevage et les critères d’encouragement déterminés, qui pourraient créer de fausses incitations. De plus, le CDF a critiqué les subventions les plus petites, allouées aux organisations d’élevage de très petite taille, qui ne peuvent assurer une activité d’élevage autonome et efficace.
2. MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE 2.1 PRODUCTION ET VENTES 153 2 Tableau 29,
page A29
Depuis l’introduction de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) le 1er janvier 2008, la promotion de l’élevage incombe à la seule Confédération.
Les principales modifications dans le domaine de l’élevage sont les suivantes. Depuis la nouvelle péréquation financière, les contributions fédérales destinées à l’encouragement de l’élevage s’élèvent d’un montant équivalent à la participation cantonale versée jusqu’alors. Les cantons n’auront plus à contribuer au financement des mesures fondées sur le droit fédéral. Chaque année, un montant maximal est fixé pour les mesures zootechniques chez chaque espèce: bovine, chevaline, porcine, ovine, caprine, de même que chez les brebis laitières et les camélidés du Nouveau-monde. Les domaines bénéficiant d’une aide et les critères de reconnaissance des organisations d’élevage sont définis avec plus de précision. La reconnaissance d’une organisation d’élevage, jusqu’à présent illimitée, est réduite à dix ans, en conformité avec le droit de l’Allemagne. Les organisations d’élevage reconnues par le droit en vigueur gardent leur reconnaissance jusqu’à la fin de l’année 2009. Elles doivent déposer une nouvelle demande à l’OFAG avant l’expiration de ce délai afin que l’on puisse s’assurer qu’elles répondent aux conditions fixées pour la reconnaissance des organisations d’élevage. Jusqu’à présent, chaque organisation d’élevage reconnue recevait en principe des contributions de la Confédération et des cantons. Cela avait pour conséquence l’allocation de très petites subventions, qui devrait à présent être évitée, grâce à la fixation d’un «seuil de soutien». A partir de 2009, seules les organisations d’élevage qui touchent des contributions pour un montant total d’au moins 30’000 francs par année seront soutenues financièrement. Cela fixe un nombre minimal d’animaux. Les organisations d’élevage de races suisses ne sont pas concernées par le seuil de soutien. Par ailleurs, deux nouvelles catégories d’animaux ont été introduites dans la nouvelle ordonnance sur l’élevage. Pour la première fois en 2008, les camélidés du Nouveaumonde donnent droit à des contributions pour les animaux admis au herd-book, pour un total de 50’000 francs par année au maximum. Les abeilles mellifères ont été reconnues comme catégorie d’animaux afin que des contributions puissent être accordées pour la préservation de l’abeille noire en tant que race suisse. Suite à la motion Gadient (04.3733), plusieurs manières d’encourager l’apiculture ont été examinées par le groupe de travail mis sur pied par l’OFAG. Un rapport à ce sujet a été élaboré et publié pendant l’été 2008. En fonction des conclusions de ce dernier, l’encouragement de l’apiculture pourrait être introduit dans l’ordonnance sur l’élevage.

2.1 PRODUCTION ET VENTES 2 154
2.1.4Production végétale
Dans le domaine de la production végétale, aucun changement fondamental n’a été apporté au catalogue des mesures visant à soutenir la production indigène au cours de l’année écoulée. La protection douanière reste un instrument central bien qu’elle ait fortement baissé en ce qui concerne les aliments pour animaux du fait de la hausse des prix sur les marchés mondiaux et du recours au système des prix-seuils. Comme cela avait été annoncé, la contribution versée à la transformation de betteraves sucrières a été réduite.

Oléagineux
Betteraves sucrières
Fruits
1Selon l’utilisation ou le numéro du tarif, le prélèvement à la frontière est réduit ou nul.
2Ne concerne que des parties de la quantité récoltée (affouragement à l’état frais ou déshydratation pour ce qui est des pommes de terre, réserve de marché pour concentrés de jus de fruits à pépins).
3Pommes de terre: seulement pour les produits à base de pommes de terre destinés à l’alimentation / semences: seulement pour les plants de pommes de terre / fruits: seulement pour les cerises à conserve, transformées, et divers produits à base de fruits à pépins.
4Ne concerne que certaines cultures.
Source: OFAG
■■■■■■■■■■■■■■■■■
Mesure Protection douanière 1 ■■■■■■■■ Contributions à la transformation ■■ 2 ■■ 2 ■ 2 Contributions à la culture ■■■ Contributions à l’exportation 3 ■■■
pour la reconversion et la plantation de cultures novatrices 4 ■■
Mesures 2007
Contributions
Culture Céréales Légumineuses à graines
Pommes de terre
Semences Légumes, fleurs coupées, viticulture
2.1 PRODUCTION ET VENTES 155 2
■ Moyens financiers

Les fonds affectés au soutien du marché ont diminué par rapport à l’année précédente et sont passés de 112 à 109 millions de francs. Le soutien accordé à l’exportation de produits à base de fruits a légèrement baissé. Bien que les contributions à l’exportation pour les pommes de terre soient pratiquement restées au même niveau en comparaison avec l’année précédente, les changements intervenus dans le secteur des fruits ont entraîné au total une réduction de moitié des contributions à l’exportation. Le montant des contributions pour la transformation et la mise en valeur ainsi que celui des contributions à la culture n’a subi quant à lui que peu de changements.
Répartition des fonds 2007
Dans l’ensemble, les moyens investis pour la culture des champs ont augmenté de 2,6 millions de francs par rapport à l’année précédente. La nouvelle réduction pour ce qui est des contributions destinées à la transformation de betteraves sucrières a été répartie – comme c’était le cas jusqu’à présent –sur les deux dernières récoltes (2006, 2007). Une somme de 7,7 millions de francs supplémentaires a été octroyée pour la transformation de la récolte 2006 tandis que 14,8 millions avaient déjà été versés pour celle de 2007. Cette augmentation des dépenses pour les pommes de terre s’explique par le paiement anticipé de la contribution pour le premier semestre 2008 (effectué en décembre 2007 au lieu de janvier 2008). Cette dépense supplémentaire en 2007 sera compensée par le fait que le premier paiement de 2008 n’aura pas lieu. En ce qui concerne les oléagineux, l’augmentation des dépenses est due à une extension des surfaces.
Contributions pour la transformation et la mise en valeur 50% Source:
d'Etat Contributions à la culture 44% Total
fr. Contributions à l'exportation 4% Divers 2%
2.1 PRODUCTION ET VENTES 2 156
Compte
109 mio. de
Tableau 30, page A29
Répartition des fonds par culture
mio. de fr.
0253050 5 10 1520354045
Betteraves sucrières 1
Pommes de terre
Légumineuses à graines
Oléagineux (y compris MPR)
Matières premières renouvelables (sans les oléagineux)
Production de semences
Fruits
Viticulture
2005 2006 2007
Source: Compte d'Etat 1
Dépenses pour la mise en valeur des fruits en 2007
Total 6,0 mio. de fr.
Mise en valeur de pommes et de poires en Suisse 24%
Mesures d'adaptation au marché pour les fruits et les légumes (reconversion fruits) 7%
Autres 2%
Exportation de cerises 3%
Exportation d'autres produits à base de fruits à pépins 5%
Exportation de concentré de jus de poires 53%
Exportation de concentré de jus de pommes 6%
Source: OFAG
Les dépenses pour la mise en valeur des fruits se sont élevées à 6 millions de francs au total. Etant donné que les deux récoltes précédentes étaient peu importantes, seules de faibles quantités de concentré de jus de pommes et de poires ont été exportées. Les dépenses occasionnées par les exportations ont donc pu être réduites de 9,4 millions de francs.
11,3 mio. de fr.
la récolte 2005 et 18,3 mio. de fr. pour la récolte 2006; 2007: 7,7 mio. de fr. pour la récolte 2006 et 14,8 mio. de fr. pour la récolte 2007
2006:
pour
2. MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE 2.1 PRODUCTION ET VENTES 2 157
2.1 PRODUCTION ET VENTES 2 158
Cultures des champs
Depuis le 1er juillet 2007, le prix-seuil des aliments pour animaux est réduit de 3 francs par 100 kg en moyenne suite à une décision du Conseil fédéral. Celui de l’orge a été nouvellement établi à 40 fr./100 kg et celui du soja à 47 fr./100 kg. En outre, les prélèvements à la frontière pour les céréales panifiables à l’intérieur du contingent tarifaire ont chuté de 30 à 27 francs par 100 kg au 1er juillet 2007 (le taux du contingent [TC] est passé de 26.30 à 23.30 fr./100 kg; la contribution au fonds de garantie demeure à 3.70 fr./100 kg).
Entre 2003 et 2006, la production de blé panifiable pouvant être utilisée s’élevait à 400’000 tonnes par année en Suisse. Le prix à la production a encore augmenté d’environ 5 francs par q entre 2002 et 2003, puis, jusqu’en 2006, il a baissé de 10 francs pour atteindre env. 53 fr./q Une faible récolte indigène conjuguée à une hausse des prix sur le marché mondial ont entraîné une augmentation des prix à la production en 2007.
700 600 500 400 300 200 100 0
0
70 60 50 40 30 20 10 Quantité déclassée (q/ha) Production utilisable (CH) Prix à la production
■ Système des importations pour les céréales panifiables et fourragères 1000 t fr./q Sources: OFAG, ART, swiss granum
Pour ce qui est des céréales destinées à l’alimentation humaine, c’est le système des contingents avec droits de douane fixes qui a été utilisé jusqu’à présent. Des droits de douane fixes répercutent les variations de prix du marché mondial directement sur les prix à l’importation après dédouanement. Dans le domaine des aliments pour animaux, les fluctuations de prix sur le marché mondial sont tempérées grâce au système des prix-seuils, jusqu’à ce que les prix à l’importation atteignent le niveau des prix-seuils ou des valeurs indicatives d’importation et que les droits de douane deviennent ainsi nuls. Production et prix pour le blé panifiable 200220032004200620052007
■ Envolée du prix des céréales sur le marché mondial en 2007
Comparaison droits de douane fixes et système de prix-seuils
droits de douane fixes droits de douane souples
42 Durée
Prix à l'importation en cas de droits de douane fixes (blé panifiable)
Prix à l'importation en cas de système de prix-seuils (blé fourrager) Valeur indicative d'importation Prix franco frontière
Source: OFAG
Au milieu de l’année 2007, le prix des céréales sur les marchés internationaux a commencé à augmenter de manière imprévisible. Dans le domaine des aliments fourragers, l’évolution des prix a d’abord pu être compensée grâce au système des prixseuils. Depuis l’automne 2007, cependant, aucun prélèvement à la frontière n’a plus pu être effectué pour plusieurs sortes de céréales destinées à l’alimentation des animaux. Le prix des importations et celui des produits indigènes ont dépassé les prixseuils. Les droits de douane fixes dans le domaine des céréales panifiables ont renchéri les matières premières importées au-delà du niveau de protection agricole visé.
Cotations en bourse pour le blé propre à la mouture (MATIF, Paris) (1.1.2007–20.6.2008)
Contrat mai 08
Contrat août 08 (nouvelle récolte) Contrat novembre 08 Contrat janvier 09
Source: Reuters
fr./100 kg
Euros/t
300 250 200 150 100 50 0 2.1.2007 23.1.2007 13.2.2007 6.3.2007 27.3.2007 19.4.2007 11.5.2007 1.6.2007 22.6.2007 13.7.2007 3.8.2007 24.8.2007 14.9.2007 5.10.2007 26.10.2007 16.11.2007 7.12.2007 2.1.2008 23.1.2008 13.2.2008 5.3.2008 28.3.2008 18.4.2008 12.5.2008 2.6.2008 2. MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE 2.1 PRODUCTION ET VENTES 2 159
■ Assouplissement du droit de douane pour les céréales panifiables
Le prix à l’importation franco frontière suisse pour le blé panifiable traditionnel a augmenté d’environ 31 fr./100 kg en 2006, pour s’établir à 47 fr./100 kg en janvier 2008. Les prélèvements à la frontière de 27 fr./100 kg ont conduit à des prix à l’importation pouvant atteindre jusqu’à 74 fr./100 kg en moyenne mensuelle. Pour les céréales indigènes (qualité top), le prix indicatif à la production a été fixé en 2006 à 57 fr./ 100 kg par l’interprofession. Le 1er juillet 2007, le Conseil fédéral a réduit le taux du contingent ainsi que les prix-seuils de 3 fr./100 kg, de sorte que pour 2007 un prix indicatif de 54 fr./100 kg en aurait résulté malgré l’évolution des prix sur le marché mondial. Or, l’interprofession n’a pas réussi à se mettre d’accord; aucun prix indicatif n’a été fixé pour les céréales panifiables en 2007.
Quantité importée et prix à l'importation pour le blé panifiable entre 2006 et 20081
Afin de ne pas renchérir le prix des matières premières importées au-delà du niveau de protection visé, un assouplissement du droit de douane pour les céréales panifiables a été discuté avec les milieux concernés. Le Conseil fédéral a fixé, par le biais d’une modification de l’ordonnance sur les importations agricoles, à 60 fr./100 kg le prix de référence pour les céréales panifiables. Avant le 1er avril et le 1er octobre de chaque année (la première fois sera le 1er octobre 2008), les données relatives au prix du marché des céréales panifiables seront relevées, cela afin d’ajuster les droits de douane au prix fixé. Ce relevé s’effectuera sur la base d’informations boursières et d’informations sur les prix fournies par des partenaires commerciaux représentatifs. Si le prix du marché calculé se situe en dehors de la fourchette d’application (prix de référence ±5 fr.), il faudra alors procéder à une adaptation du prélèvement à la frontière. Le prélèvement à la frontière sera adapté à hauteur de 60% de la différence entre le prix de référence et le prix sur le marché.
en 1000 t fr./100 kg 2006 Quantité 2007 Quantité 2008 Quantité Source: OFAG 1 marchandise biologique et conventionnelle 2006 Prix 2007 Prix 2008 Prix 0 2498 8282 83 77 75 81 90 82 74 66 58 50 20 16 12 8 4 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
2.1 PRODUCTION ET VENTES 2 160
Adaptations
Prix de référencefr. 60.–/100 kg
(fr. 56.–/100 kg dès le 1.7.2009)
Adaptations des prix1er avril et 1er octobre
Fourchette d’application±fr. 5.–/100 kg

Ampleur de la correction si le prix du marché Correction de 60% se référant à la se situe en dehors de la fourchette prévue au différence par rapport au prix de moment du relevéréférence
Prélèvement à la frontière maximalfr. 27.–/100 kg
(fr. 23.–, dès le 1.7.2009)
Le prix de référence de 60 fr. et de 56 fr./100 kg, effectif dès le 1er juillet 2009, sert de critère pour l’adaptation semestrielle des prélèvements à la frontière. Une correction de 60% du prélèvement à la frontière permet d’adapter les prix indigènes en fonction des tendances en cours sur les marchés mondiaux. Grâce à cela, les producteurs indigènes de céréales pourront bénéficier d’une augmentation des prix. Il n’en demeurepas moins que la fourchette de ±5 fr./100 kg retarde l’augmentation des taux du contingent en cas de baisse des prix sur les marchés mondiaux, ce qui représente pour le producteur un certain risque lié aux prix.
2.1 PRODUCTION ET VENTES 2 161
■ PA 2011: bref aperçu des modifications d’ordonnances
Le Conseil fédéral a adopté, le 14 novembre 2007, la modification de la loi sur l’agriculture (LAgr, RS 910.1). Sur la base des modifications, de nombreuses adaptations ont été apportées aux ordonnances concernées. Dans le domaine de la culture des champs, les principales modifications sont les suivantes:
1.Ordonnance sur les contributions à la culture des champs, OCCCh (RS 910.17)
Contributions à la culture: la contribution à la culture pour ce qui est du chanvre a été supprimée avec effet au 1er janvier 2008. Les raisons qui ont motivé cette décision sont les suivantes: manque de transparence du marché du chanvre, faible valeur ajoutée dans des secteurs d’activité légaux et taille réduite des surfaces affectées à cette culture jusqu’à présent. Les dépenses liées aux contrôles par les autorités (Confédération, cantons) étaient en outre trop importantes. En ce qui concerne les betteraves sucrières destinées à la fabrication de sucre, une contribution à la culture a été introduite au 1er janvier 2008, qui s’élève à 850 francs par hectare et qui sera augmentée le 1er janvier 2009 à 1’900 francs par hectare. Les contributions à la culture doivent permettre de compenser partiellement les baisses du prix des betteraves résultant de la réforme du marché du sucre sur le territoire de l’UE ainsi que la suppression du mandat de transformation confié aux sucreries contre rétribution.
La contribution à la culture pour les oléagineux, les légumineuses à graines, les plantes à fibres et les semences a été harmonisée avec effet au 1er janvier 2009 et se montera à 1’000 fr. par hectare.
Contributions à la transformation pour les oléagineux: aucune contribution ne sera plus versée pour la transformation d’oléagineux (excepté dans des installations pilotes et des installations de démonstration reconnues) et ce, dès la récolte 2009.
Installations pilotes et installations de démonstration: à partir du 1er juillet 2009, la durée de reconnaissance des installations pilotes et des installations de démonstration sera limitée à trois ans. Si cela se justifie, il est possible de prolonger cette durée de deux ans; le taux de contribution devra alors être réduit simultanément.
Une contribution maximale de 400’000 francs par année est payée pour chaque installation pilote ou installation de démonstration. Il a en outre été établi que, dans des installations pilotes ou installations de démonstration, le taux maximal pour la transformation de matières premières renouvelables s’élève à 100 fr. par hectolitre produit d’éthanol pur, d’huile brute ou de biodiesel ou à 17 ct. par kWh d’énergie produite.
2.Ordonnance sur les pommes de terre (RS 916.113.11)
L’ordonnance sur les pommes de terre sera abrogée le 1er juillet 2009. Les contributions pour la mise en valeur des pommes de terre et des plants de pommes de terre ne pouvant être commercialisés seront supprimées. Parallèlement, le versement des contributions à l’exportation pour les produits à base de pommes de terre sera suspendu. L’importation de pommes de terre sera à l’avenir réglementée dans l’ordonnance sur les importations agricoles.
2.1 PRODUCTION ET VENTES 2 162
3.Ordonnance sur le sucre (RS 916.114.11)
Le 1er octobre 2007, la rémunération pour la transformation des betteraves sucrières destinées à la production de sucre a été réduite. La suppression totale des contributions pour la transformation de betteraves à sucre entraîne l’abrogation de l’ordonnance sur le sucre au 1er octobre 2009.
4.Ordonnance sur les semences (RS 916.151)
L’aide financière accordée à la production de maïs, de plantes fourragères et de semences de soja sera supprimée au 1er janvier 2009. La nouvelle contribution à la culture pour les semences de maïs et de plantes fourragères ainsi que pour les plants de pommes de terre devrait contribuer à soutenir la préservation de la production indigène de semences.
5.Ordonnance sur les importations agricoles (RS 916.01)

Céréales panifiables: un assouplissement des prélèvements à la frontière en ce qui concerne les céréales panifiables permettra de lutter contre des prix à l’importation élevés (cf: «Flexibilisation des droits de douane des céréales panifiables»).
La contribution à un fonds de garantie pour les céréales panifiables, prélevée dans le but de couvrir les réserves obligatoires, devra être majorée de 3.70 fr. le 1er juillet 2009 et se montera à 12 fr. par 100 kg. Cette hausse sera toutefois sans conséquence pour l’importateur puisque, parallèlement, les droits de douane seront réduits de la même somme.
Céréales transformées destinées à l’alimentation humaine: les droits de douane pour les céréales transformées destinées à l’alimentation humaine découleront dès le 1er juillet 2009 de la protection douanière pour les matières premières à partir des valeurs de rendement. En outre, un supplément de 20 fr. par 100 kg sera prélevé.
Aliments pour animaux: afin d’améliorer la compétitivité de la production animale, les prix-seuils des aliments pour animaux seront abaissés de 4 fr. par 100 kg en moyenne au 1er juillet 2009. Le prix-seuil de l’orge a été réévalué à 36 fr./100 kg. S’agissant des tourteaux de soja, c’est avant tout la qualité importée, plus riche en protéines, qui devrait servir de référence à l’avenir. En raison de cette valeur nutritive plus élevée, le prix-seuil des tourteaux de soja n’est réduit que de 2 francs, passant ainsi à 45 fr./100 kg.
2.1 PRODUCTION ET VENTES 2 163
Cultures spéciales
Les cidreries écoulant des boissons à base de jus de fruits à pépins disposent de leur propre réserve. Cette réserve correspond à l’approvisionnement ordinaire d’une exploitation, à savoir les besoins annuels auxquels s’ajoute une quantité de transformation de 10%. En plus de cela, il est possible de constituer une réserve du marché liée à l’exploitation et cofinancée par la Confédération. La part en pour-cent de la réserve du marché liée à l’approvisionnement ordinaire des exploitations est établie sur une base annuelle et équivaut tout au plus à 50% de cet approvisionnement. Le maintien de la réserve du marché permettra de compenser les fluctuations des récoltes résultant de causes naturelles pour ce qui est de la production de fruits à cidre. Les fluctuations du marché sont grandes, car la majorité de la production de fruits à cidre provient d’arbres fruitiers haute-tige. Or, ce type d’arbres fournit un rendement alterné (floraison abondante tous les deux ans). La réserve du marché représente un filet de sécurité permettant d’assurer un certain approvisionnement même en cas de récolte faible ou limitée et garantit une offre constante de produits à base de jus de pommes au bon goût fruité typiquement suisse (Swissness). Par ailleurs, ce cofinancement pour un stockage approprié des réserves du marché dénote l’intérêt accordé à un marché stable, à la préservation des arbres fruitiers haute-tige, à l’obtention de produits de haute qualité ainsi qu’à la prise en compte des aspects écologiques (par ex.: courtes distances de transport).

Le graphique ci-après illustre clairement la régularité de l’alternance: quatre récoltes –dont deux très nettement –se situent au-dessus de la moyenne établie sur dix ans (121’841 t). De tels extrêmes dans les récoltes de pommes semblent toutefois appartenir au passé. La moyenne des six dernières récoltes montre en effet une quantité excédentaire de 18% par rapport à l’approvisionnement ordinaire moyen. En outre, quatre des dix dernières récoltes ont été plus faibles que la quantité de l’approvisionnement ordinaire des cidreries.
Grâce au maintien des réserves du marché, l’effet de compensation visé a porté ses fruits. En règle générale, la quantité de réserves du marché reconnue par l’OFAG est fixée à un niveau plus élevé les années où la récolte est grande, voire abondante, qu’en cas de faible récolte. Cela vient du fait que, selon la régularité de l’alternance, une petite récolte succède en principe à une grande récolte. Dans les années 1999, 2001 et 2003, lorsque la récolte ne parvenait pas à couvrir l’approvisionnement ordinaire, ce sont les réserves du marché des années précédentes qui ont été utilisées, dans leur totalité ou en partie. En 2005, les réserves du marché ont été nouvellement constituées. Grâce à la quantité excédentaire de l’année précédente, qui avait été destinée à l’exportation, l’approvisionnement ordinaire a pu être couvert.
2.1 PRODUCTION ET VENTES 2 164
■ Des marchés stables grâce à la réserve du marché
Comparaison récolte de pommes transformée, approvisionnement ordinaire et réserve du marché en
C’est dans le cadre de la politique agricole 2002 que la possibilité a été donnée de constituer des réserves du marché avec du concentré de jus de poires. Cela est dû au fait que, dans les années quatre-vingt-dix, contrairement à ce qui avait cours jusqu’alors, deux récoltes de poires consécutives (en 1996 et 1997) ont à peine réussi à couvrir la demande. Ce n’est qu’avec la récolte de 1999 qu’il aurait enfin été vraiment possible de constituer pour la première fois une réserve du marché avec du concentré de jus de poires. Cette idée a toutefois été abandonnée à cause de l’important excédent de concentré de jus de poires provenant de la récolte de 1998. Suivant le principe de la régularité de l’alternance, aucune réserve du marché n’a été constituée et ce, malgré une récolte 2002 ayant à peine pu couvrir l’approvisionnement ordinaire.
Un jus de pommes suisse authentique doit être constitué d’au moins 90% de jus de pommes naturel. Le reste peut être composé de 10% maximum de jus de poires naturel. Le jus de poires n’étant consommé que dans de faibles quantités, la demande en jus de poires ne concerne qu’environ 11% de la vente de boissons.
Du fait d’une protection élevée à la frontière, le marché intérieur des produits à base de fruits à cidre est protégé. Cela a pour avantage qu’aujourd’hui les produits indigènes de qualité supérieure sont devenus la norme. En cas d’ouverture du marché, la qualité du jus de pommes suisse pourra être utilisée comme argument de vente (Swissness).
Le stockage de réserves du marché constituées de concentré de jus de pommes joue un rôle important, car il permet d’assurer la provenance suisse de certains produits sur le marché des boissons à base de jus de fruits. Si l’offre indigène de matières premières devenait insuffisante, le manque devrait être comblé par l’importation de pommes à cidre ou de produits à base de jus de fruits à pépins, ce qui serait préjudiciable à la qualité reconnue encore aujourd’hui du jus de pommes suisse. Par ailleurs, la volonté de maintenir les réserves du marché dénote celle de préserver les arbres fruitiers hautetige.
Le cofinancement de la Confédération pour le maintien des réserves du marché se monte à quelque 60 centimes par arbre haute-tige, ce qui représente un très bon rapport coûts-bénéfices.
t
Récolte de pommes transformée Approvisionnement ordinaire AO Récolte Réserve du marché RMar 1998199920002001 0 200000 250000 150000 100000 50000 2004 2003 2002200520062007 2. MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE 2.1 PRODUCTION ET VENTES 2 165
Source: OFAG
■ Perspectives
Dans le cadre de la politique agricole 2011, la promotion de la qualité au niveau régional sera renforcée et la mise en réseau de surfaces de compensation écologique dans l’agriculture accélérée. Les cidreries écoulant leurs boissons pourront continuer à constituer des réserves de marché liées à l’exploitation, avec le cofinancement de la Confédération, ce qui permettra de compenser, en partie, certaines fluctuations des récoltes pour cause naturelle. Ces mesures contribuent à la préservation des arbres fruitiers haute-tige. Le Parlement a décidé que les dernières exportations de produits à base de jus de fruits à pépins soutenues par des aides financières fédérales auraient lieu en 2009.
2.1 PRODUCTION ET VENTES 2 166
■■■■■■■■■■■■■■■■
2.2 Paiements directs
Servant à rétribuer les prestations fournies par l’agriculture à la demande de la société, les paiements directs sont l’un des principaux éléments de la politique agricole. Il convient de distinguer les paiements directs généraux et les paiements directs écologiques.
Dépenses au titre des paiements directs 2000–2007
Domaine20002001200220032004200520062007 mio. de fr.

Paiements directs généraux18041929199519991994200020072070
Paiements directs écologiques361413452477495507518524
Réductions2317211718202619
Total21422325242624592470248625002575
Remarque: une comparaison directe avec les données du compte d’Etat est impossible. Les valeurs indiquées sous 2.2 «Paiements directs» se rapportent à l’ensemble de l’année de contributions, alors que le Compte d’Etat indique les dépenses effectuées.
Source: OFAG
Tableau 31, page A30 2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 167
■ Rétribution de prestations fournies dans l’intérêt général
2.2.1Importance des paiements directs
D’utilité publique, les prestations de l’agriculture sont rétribuées au moyen des paiements directs généraux. En font partie les contributions à la surface et les contributions pour les animaux consommant des fourrages grossiers. Toutes deux ont pour objectif d’assurer l’exploitation et l’entretien de la surface agricole dans son ensemble. En outre, dans les régions des collines et de montagne, les agriculteurs touchent des contributions pour des terrains en pente et pour la garde d’animaux dans des conditions difficiles. Il est ainsi tenu compte des difficultés d’exploitation dans ces régions. L’octroi de tous les paiements directs (contributions d’estivage exceptées) est lié à la fourniture des prestations écologiques requises (PER).

■ Rétribution de prestations écologiques particulières
Les paiements directs écologiques englobent aussi bien les contributions écologiques et éthologiques que les contributions pour la protection des eaux ou les contributions d’estivage. Ces contributions représentent un soutien économique versé aux agriculteurs afin de les inciter à remplir des exigences allant au-delà des dispositions légales générales et des prestations écologiques requises.
Les contributions écologiques comprennent les contributions à la compensation écologique, à la qualité écologique, pour la culture extensive de céréales et de colza (culture extensive) ainsi que pour la culture biologique. Par le biais des contributions éthologiques, la Confédération encourage le système de stabulation particulièrement respectueux des animaux (SST) et les sorties régulières en plein air (SRPA). Pour ce qui est des contributions pour la protection des eaux, elles devraient permettre de réduire la pollution des eaux par les nitrates et le phosphore; quant aux contributions d’estivage, elles devraient exhorter à exploiter les surfaces d’estivage de manière durable et dans le respect de l’environnement.
■■■■■■■■■■■■■■■■
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 168
■ Importance économique des paiements directs en 2007
En 2007, les paiements directs se sont élevés à 2,575 milliards de francs, ce qui représente en moyenne la somme de 47’071 francs par exploitation. Les régions de montagne et des collines ont bénéficié de 61% de la totalité des paiements directs versés.
Paiements directs 2007
une comparaison directe avec les données du compte d’Etat est impossible. Les valeurs indiquées sous 2.2 «Paiements directs» se rapportent à l’ensemble de l’année de contributions, alors que le compte d’Etat indique les dépenses d’une année civile. Quant aux réductions, il s’agit de retenues effectuées en raison de limites et de sanctions légales et administratives.
Source: OFAG
Type de contribution TotalRégion de Région des Région de plainecollinesmontagne 1 000 fr. Paiements directs généraux 2 070 357788 662536 891733 398 Contributions à la surface 1 275 681638 873312 072324 737 Contributions pour la garde d’animaux consommant des fourrages grossiers 412 813142 708114 733155 371 Contributions pour la garde d’animaux dans des conditions difficiles 277 786 4 69477 420195 672 Contributions générales pour des terrains en pente92 671 2 38632 66757 617 Contributions pour les surfaces viticoles en forte pente et en terrasses 11 407 Paiements directs écologiques 523 533210 817116 32998 387 Contributions écologiques 217 738114 43854 33448 966 Contributions à la compensation écologique126 92873 68731 72321 518 Contributions au sens de l’ordonnance sur la qualité écologique (OQE) 32 10710 118 8 79013 199 Contributions pour la culture extensive de céréales et de colza (culture extensive) 30 62921 898 8 138 593 Contributions pour la culture biologique 28 074 8 735 5 68313 656 Contributions éthologiques 207 79696 37961 99549 422 Contributions pour des systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux (SST)51 60229 56915 048 6 985 Contributions pour les sorties régulières en plein air (SRPA) 156 19466 81046 94742 437 Contributions d’estivage 92 110 Contributions pour la protection des eaux 5 890 Réductions 18 851 Total paiements directs 2 575 039999 479653 220831 785 Paiements directs par exploitation 47 07142 97444 02950 074 Remarque:
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 169 2. MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE
■ Exigences requises pour l’octroi de paiements directs
Part des paiements directs au rendement brut d’exploitations de référence, selon la région, en 2007
ParamètreUnitéTotalRégion de Région des Région de plainecollinesmontagne
ExploitationsNombre3 3281 524961843
SAU en Øha20,3121,2219,2919,81
Paiements directs générauxfr.40 53734 78040 19150 554
Contributions écologiques et éthologiquesfr.8 1869 1648 3626 370

Total paiements directsfr.48 72443 94448 55356 924
Rendement brutfr.242 567297 284222 356170 563
Part des paiements directs au rendement brut%20,114,821,833,4
Source: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
L’octroi de contributions pour les conditions de production difficiles dans la région des collines et de montagne a pour effet de majorer le montant des paiements directs versés à l’hectare au fur et à mesure que lesdites difficultés augmentent. Conséquence des plus faibles rendements obtenus en montagne, la part des paiements directs au rendement brut y est également plus élevée qu’en plaine.
Pour toucher des paiements directs, les agriculteurs doivent remplir de nombreuses conditions. Au nombre de celles-ci figurent, d’une part, des conditions générales telles qu’une forme juridique, un domicile de droit civil, etc. et, d’autre part, des critères structurels et sociaux, eux aussi déterminants, comme le besoin minimal en travail, l’âge de l’exploitant, le revenu et la fortune. A cela s’ajoutent des charges spécifiquement écologiques qui sont regroupées sous la notion de prestations écologiques requises (PER). Les exigences PER comprennent un bilan de fumure équilibré, une part équitable de surfaces de compensation écologique, un assolement régulier, une protection appropriée du sol, l’utilisation ciblée de produits phytosanitaires, ainsi que la garde d’animaux de rente respectueuse de l’espèce. Des manquements aux prescriptions déterminantes donnent lieu à une réduction des paiements directs ou à un refus d’octroi.
Tableaux 41a–42, pages A46–A49
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 170
■ Système d’information sur la politique agricole
La plupart des données statistiques sur les paiements directs proviennent de la banque de données du système d’information sur la politique agricole (SIPA) développée par l’OFAG. Ce système est alimenté par les relevés annuels des données structurelles qui sont compilés et transmis par les cantons, ainsi que par les indications relatives aux versements (surfaces, cheptels et contributions pertinentes) de chaque type de paiement direct. La banque de données sert en premier lieu au contrôle administratif des montants versés aux exploitants par les cantons, mais elle permet aussi d’établir des statistiques générales sur les paiements directs. Grâce à cette mine d’informations et à l’utilisation d’outils informatiques performants, bon nombre de questions de politique agricole peuvent être éclairées sous des angles différents.
Sur les 59’985 exploitations enregistrées dans le SIPA en 2007 et qui dépassent la limite fixée par la Confédération pour l’établissement de relevés, 54’705 touchent des paiements directs.
■ Impact des échelonnements et des limitations
Les échelonnements et les limitations ont un impact sur la répartition des paiements directs. Pour ce qui est des limitations, il s’agit de limites de revenu et de fortune ainsi que du montant maximum alloué par UMOS; les échelonnements dégressifs concernent, quant à eux, les surfaces et les animaux.
Impact des limites d’octroi des paiements directs en 2007
Part au total concernéescontributionsdes paiements des exploitationsdirects concernées
Les limites d’octroi entraînent des réductions de paiements directs d’à peine 12 millions de francs, dont 11,2 pour des raisons de dépassement des limites de revenu et de fortune. Le nombre d’exploitations concernées par les réductions et le montant des réductions ont tous deux augmenté par rapport à l’année précédente.
Limites
Réduction
Nombrefr.%%
standard390780 3745,660,03 en fonction
revenu1 1406 166 88110,930,24 en fonction
la fortune2855 001 13953,220,19 Total11 948 3940,46
OFAG
d’octroiExploitations
Part aux
par unité de maind’œuvre
du
de
Source:
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 2. MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE 171
Effets de l’échelonnement des contributions en fonction de la surface ou du nombre d’animaux en 2007
Les échelonnements prévus dans l’ordonnance sur les paiements directs concernent en tout 9’579 exploitations. Dans la plupart des cas, les réductions portent sur diverses mesures. Comparée à l’ensemble des paiements directs dégressifs, la part de toutes les réductions opérées s’élève globalement à 41,2 millions de francs, soit à 1,6%. Les échelonnements dégressifs ont un effet notable sur les contributions à la surface et concernent plus de 7’800 exploitations (près de 14,3% de l’ensemble des exploitations touchant des paiements directs). Quant aux exploitations qui bénéficient de contributions pour la garde d’animaux consommant des fourrages grossiers, les réductions touchent 333 d’entre elles. Il faut dire que d’autres limitations comme la limite d’octroi entrent ici en jeu bien avant l’échelonnement des paiements directs. Les paiements directs écologiques font eux aussi l’objet de réductions. Ainsi, dans le cas de 3’762 exploitations (sans les doubles comptages), il a fallu réduire les paiements directs accordés pour la garde d’animaux de rente particulièrement respectueuse de l’espèce (programmes SST et SRPA), respectivement de 10,8% et de 8,7%. 819 exploitations bio ont touché des paiements réduits de 7,6% en moyenne.
MesureExploitations Surface/effectif Réduction Part aux Part au total concernéespar exploitationcontributions
de despaiements exploitationsdirects Nombreha ou UGBfr.%% Contributions à la surface7 81242,533 427 1767,71,30 Contributions pour la garde d’animaux consommant des fourrages grossiers33359,11 167 1067,00,05 Contributions générales pour des terrains en pente9434,444 3163,20,01 Contributions pour les surfaces viticoles en forte pente et en terrasses135,04 2713,60,01 Contributions à la compensation écologique2938,689 0419,20,01 Contributions pour la culture extensive de céréales et de colza (culture extensive)5936,343 5635,00,01 Contributions pour la culture biologique81940,3656 2757,60,03 Contributions pour les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux2 36569,12 268 57610,80,09 Contributions pour sorties régulières en plein air3 41265,63 452 5028,70,13 Total9 579 1 41 152 8267,91,60 1sans les doubles comptages Source: OFAG
du type
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 172
■ Exécution et contrôle
L’art. 66 de l’ordonnance sur les paiements directs (OPD) délègue aux cantons la tâche de contrôler les prestations écologiques requises (PER). Ces derniers y associent des organismes accrédités présentant toutes garanties de compétence et d’indépendance. Mais ils sont tenus de surveiller l’activité de contrôle par sondage. Les exploitations bio ayant droit aux paiements directs doivent non seulement respecter les exigences de la culture biologique, mais aussi fournir les PER et garder les animaux de rente selon les prescriptions SRPA. Elles font, chaque année, l’objet de contrôles effectués par un organisme de certification accrédité, sous la surveillance des cantons. L’art. 66, al. 4, OPD précise selon quels critères les cantons ou les organismes associés sont tenus de contrôler les exploitations.
Sont ainsi contrôlées: –toutes les exploitations qui demandent des contributions pour la première fois; –toutes les exploitations dans lesquelles des manquements ont été constatés lors de contrôles effectués l’année précédente; et –au moins 30% du reste des exploitations, choisies au hasard.
En cas de fourniture insuffisante des PER, les contributions sont réduites selon des critères uniformes qui sont énoncés dans une directive édictée par la Conférence des directeurs cantonaux de l’agriculture.
■ Contrôles et réductions de contributions en 2007
En 2007, sur les 54’705 exploitations agricoles ayant droit aux contributions, 30’913 (56,5%) ont été contrôlées par les cantons ou par les services mandatés à cet effet pour s’assurer qu’elles respectaient les prescriptions PER. Les contributions ont été réduites pour 1’806 exploitations (3,3% des entités contrôlées) en raison de manquements aux prescriptions PER.
Conformément à l’ordonnance sur l’agriculture biologique, toutes les exploitations bio doivent être contrôlées chaque année. Seulement 3,5% d’entre elles ont été pénalisées par une réduction des contributions en raison de manquements.
En ce qui concerne les programmes SST et SRPA, les contrôles ont porté, en moyenne, respectivement sur 58,5% et 49,6% des exploitations ayant droit à des contributions. Les contrôles sont en majeure partie coordonnés avec ceux des PER. Aussi le pourcentage effectif est-il plus élevé. Les réductions prononcées ont visé 2,6% des exploitations participant au programme SST et 2,0% des exploitations adhérant au programme SRPA.
Au total, des insuffisances ont été constatées dans 5’463 exploitations et ont entraîné une réduction des contributions s’élevant à quelque 6,8 millions de francs.
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 2. MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE 173
Enregistrements lacunaires, garde d’animaux de rente non respectueuse de l’espèce, autres raisons (échantillons du sol manquants, expiration du délai requis pour le test des pulvérisateurs), bilan de fumure non équilibré, bordures tampons et bandes herbeuses inadéquates, sélection et application des produits phytosanitaires non conformes, annonces tardives, part des SCE inadéquate.
Période de fauche et mesures d’entretien non respectées, fausses indications sur le nombre d’arbres, envahissement par les mauvaises herbes, fausses données concernant les surfaces, fumure non autorisée, protection phytosanitaire et annonces tardives.
Annonces tardives, récolte faite avant maturité des graines, produits phytosanitaires interdits.
Eléments autres que ceux mentionnés dans la liste (infraction aux prescriptions d’affouragement ou concernant la garde d’animaux ou la protection des eaux ou les enregistrements, non-respect des prescriptions bio par les entreprises exploitées à titre de loisirs), utilisation d’engrais et de produits phytosanitaires interdits dans la culture biologique, annonces tardives, fausses indications.
Eléments autres que ceux mentionnés dans la liste (litière inadéquate), annonces tardives, absence de système de stabulation à aires multiples, garde non conforme de certains animaux d’une même catégorie, aire de repos insuffisante, éclairage de l’étable non conforme, fausses indications.
Eléments autres que ceux mentionnés dans la liste (durée d’engraissement minimale non respectée, aire de repos avec caillebotis/trous, protection des animaux insuffisante, surface pacagère trop petite, mise au pâturage tardive, etc.), nombre insuffisant de jours de sortie, annonces tardives, enregistrements lacunaires, garde non conforme de certains animaux d’une même catégorie, fausses indications, parcours insuffisant.
Charge usuelle en bétail dépassée ou non atteinte, gestion incorrecte des pâturages, utilisation de surfaces non pâturables, infractions aux prescriptions agricoles pertinentes, annonces tardives, épandage d’engrais non autorisés, autres éléments (sur-livraisons de lait), fausses indications sur l’effectif d’animaux ou la durée d’estivage, documents manquants, entretien inadéquat des bâtiments, entraves aux contrôles, données lacunaires, emploi d’herbicides interdits, récidives.
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 Récapitulatif des réductions de contributions prononcées en 2007 CatégorieExploitations Exploitations ExploitationsRéductionsRaisons principales ayant droit contrôléessanctionnées aux par des contributionsréductions NombreNombreNombrefr. PER54 70530 9131 8062 159 538 SCE 51 823-612523 149 Culture 15 8265 5194221 311 extensive Culture 6 0826 296218190 244 biologique SST 18 64910 901498441 402 SRPA 37 97818 796742588 615 Estivage7 2997836641 076 871 Source: Rapports cantonaux sur les activités de contrôle et les réductions de contributions
174
Tableaux 43a–43b, pages A50–A51
Récapitulatif des réductions de contributions prononcées en 2007
CatégorieExploitations Exploitations ExploitationsRéductionsRaisons principales ayant droit contrôléessanctionnées aux par des contributionsréductions
Fausses indications sur les surfaces ou l’effectif d’animaux, autres éléments (fausses indications concernant les PER, moins de 50%), propre main-d’œuvre, inscriptions à un programme ou désistements tardifs, entraves aux contrôles), fausses indications sur l’exploitation ou les exploitants ou l’estivage.
Pas d’indication possible
Pas d’indication possible
Pas d’indication possible

2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2
NombreNombreNombrefr. Données de --6391 146 679 base Protection --210647 186 des eaux Protection de --1520 334 la nature et du paysage Protection --1715 040 de l’environnement Total--5 4636 830 369
Source: Rapports cantonaux sur les activités de contrôle et les réductions de contributions
Tableaux 43a–43b, pages A50–A51
175
■ Autorisations spéciales dans le domaine de la protection des végétaux
Dans certains cas, les services phytosanitaires cantonaux peuvent délivrer des autorisations spéciales en vertu de l’annexe 6.4 de l’ordonnance sur les paiements directs. En 2007, ils en ont accordé 2’253 pour 4’986 ha de SAU. Comme les années précédentes, la plupart de ces autorisations ont été accordées afin de permettre le traitement du rumex et des renoncules dans les prairies naturelles.
Autorisations spéciales accordées dans le domaine de la protection des végétaux en 2007
Application de produits phytosanitaires pendant l’interdiction de traiter en hiver462,0105,12,1
Céréales: lutte contre la criocère des céréales 1
Colza: lutte contre l’altise des
Pommes de terre: lutte contre le
Légumineuses, tabac et tournesols: lutte contre les pucerons11,4
Autre lutte antiparasitaire dans les grandes cultures25411,3592,311,9
1avec des produits autres que ceux énumérés dans les directives de la Conférence des services cantonaux de protection des plantes. Dans le cadre de la lutte contre la criocère des céréales, les cantons d’Argovie et de Zurich ont accordé une autorisation spéciale ne figurant pas dans le tableau. 2autorisations spéciales délivrées pour des mesures phytosanitaires qui sont exclues dans les instructions spécifiques reconnues.
Source: OFAG
CatégorieAutorisationsSurface NombreExploita-ha% de la surd’exploita-tions face totale tionsen %concernée
Emploi
39017,31 185,123,8
d’insecticides et de nématicides granulés
713,2426,18,5
crucifères251,160,11,2
40,24,60,1
doryphore 1
Herbages
traitement
surface1 39561,92 460,949,4 Culture maraîchère 2 60,350,1 Arboriculture fruitière 2 582,6138,52,8 Viticulture 2 30,170,1 Total2 2531004 986,1100
permanents:
de la
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 176
Nouveautés 2008/2009
Par décision du 14 novembre 2007 et du 25 juin 2008, le Conseil fédéral a procédé à quelques modifications dans le cadre de la mise en oeuvre de PA 2011.
Mise en vigueur de l’ordonnance sur la coordination des inspections dans les exploitations agricoles en tant que base légale pour la coordination des inspections de droit public sur les exploitations agricoles effectuées dans le domaine de la production primaire. Elle contient les éléments-clés suivants:
–une, voire deux (exceptionnellement), inspections de droit public par année pour les exploitations sans manquement; –harmonisation de la fréquence des inspections requises par différents textes de loi; –reconnaissance réciproque des résultats des inspections; –gestion des données résultant des inspections à l’aide d’un système d’information commun, exhaustif et normalisé; –coordination des inspections par les cantons.
Prestations écologiques requises: –dispense des contrôles selon la méthode Suisse-Bilan et des analyses du sol pour les exploitations gérées de manière peu intensive; –critères plus stricts en ce qui concerne l’apport de phosphore dans l’aire d’alimentation des lacs chargés de phosphore; –amélioration de la protection des eaux avant l’application de produits phytosanitaires grâce à l’élargissement de la bande de surface herbagère, laquelle passe de 3 à 6 m; –utilisation obligatoire de réservoirs d’eau claire sur les pulvérisateurs.
2. MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE 2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 177
■
2.2.2 Paiements directs généraux
Contributions à la surface
Objectif visé: exploitation de toute la surface agricole

Les contributions à la surface servent à rétribuer les prestations fournies dans l’intérêt général telles que la protection et l’entretien du paysage rural, la garantie de la production alimentaire et la préservation du patrimoine naturel. Depuis 2001, une contribution supplémentaire pour les terres ouvertes et les cultures pérennes est venue s’y ajouter.
Taux de 2007fr./ha 1
– jusqu’à 30 ha1 150
– de 30 à 60 ha862.5
– de 60 à 90 ha575
– plus de 90 ha0
1D’un montant de 450 fr. par ha et par an, la contribution supplémentaire allouée pour les terres ouvertes et les cultures pérennes est également soumise à l’échelonnement en fonction des surfaces.
Pour les surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère, les taux de tous les paiements directs liés aux surfaces sont réduits de 25%. Quelque 5’000 ha en tout sont exploités dans cette zone depuis 1984. Les exploitations suisses qui achètent ou afferment aujourd’hui des surfaces dans la zone limitrophe étrangère ne reçoivent pas de paiements directs.
■■■■■■■■■■■■■■■■
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 178
Tableaux 32a–32b, pages A31–A32
Contributions à la surface versées en 2007 (contribution supplémentaire comprise)
La contribution supplémentaire a été versée pour 270’414 ha de terres ouvertes et 18’545 ha de cultures pérennes.
Répartition des exploitations et de la SAU selon les classes de grandeur en 2007
La dégression des contributions concerne 10,4% de la SAU. Le montant versé au titre de la contribution à la surface s’élève en moyenne à 1’242 francs par ha (contribution supplémentaire incluse). Les exploitations comptant jusqu’à 10 ha couvrent en tout 8,5% de la SAU. Seul 1,6% de l’ensemble des exploitations dispose de plus de 60 ha; celles-ci exploitent 6,2% de la SAU.
ParamètreUnitéRégion de Région desRégion de Total
Surfaceha479 374259 916287 7031 026 993 ExploitationsNombre23 13814 79416 60354 535 Surface par exploitationha20,717,617,318,8 Contribution par exploitationfr. 27 61121 09419 55923 392 Total des contributions1 000 fr.638 873312 072324 7371 275 681 Total des contributions 20061 000 fr. 653 275325 471340 3571 319 103 Source: OFAG
plainecollinesmontagne
Source:
Classes de grandeur en ha Exploitations SAU < 30 60 < SAU < 90 30 < SAU < 60 SAU > 90 30 302020100 Répartition en % 20 1030 >90 60–90 30–60 20–30 15–20 10–15 5–10 <5 2,02,10,7 21,8 27,5 16,2 13,3 7,1 13,7 1,3 0,1 0,3 0,3 0,4 0,3 21,3 17,6 20,0 17,7 1,4 6,5 Exploitations en %SAU en % 8,1 0,1 1,32,02,10,7 0,30,40,3 0,3 2. MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE 2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 179
OFAG
■ Surfaces utilisées comme herbages
Contributions pour la garde d’animaux consommant des fourrages grossiers
Cette mesure vise à préserver la compétitivité des producteurs de viande disposant d’une base fourragère et, en même temps, à assurer l’exploitation de l’ensemble des terres agricoles de la Suisse, pays à vocation herbagère.

Les contributions pour la garde d’animaux consommant des fourrages grossiers sont versées pour des animaux gardés dans l’exploitation durant la période d’affouragement d’hiver (période de référence: du 1er janvier au jour de référence de l’année de contributions). Sont considérés comme animaux consommant des fourrages grossiers les bovins et les équidés, ainsi que les moutons, les chèvres, les bisons, les cerfs, les lamas et les alpagas. Les contributions sont versées en fonction des surfaces herbagères permanentes et des prairies artificielles existantes. Pour ce faire, les diverses catégories d’animaux sont converties en unités de gros bétail consommant des fourrages grossiers (UGBFG) et leur nombre par ha est limité. Cette limitation est échelonnée en fonction des zones.
Limites d’encouragementUGBFG/ha
–Zone de grandes cultures, zone intermédiaire élargie et zone intermédiaire2,0
–Zone des collines1,6
–Zone de montagne I1,4
–Zone de montagne II1,1
–Zone de montagne III0,9
–Zone de montagne IV0,8
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 180
Les UGBFG sont réparties en trois groupes de contributions. Pour les bovins, équidés, bisons, chèvres et brebis laitières, le taux est de 900 francs par UGBFG, alors qu’il est fixé à 400 francs pour les autres chèvres et moutons ainsi que pour les cerfs, les lamas et les alpagas. En 2007, l’effectif d’animaux des producteurs de lait destiné à la commercialisation, qui donnait droit aux contributions, a été réduit d’une UGBFG par 4’400 kg de lait livrés l’année précédente. Concernant les UGBFG touchées par la déduction pour le lait commercialisé, le taux de contribution a été fixé en 2007 à 200 francs par UGBFG. Suite à cette modification, la somme totale versée au titre de contribution pour animaux consommant des fourrages grossiers a augmenté de quelque 110 millions de francs et s’est élevée au total à 413 millions de francs.
Contributions versées en 2007 pour la garde d’animaux consommant des fourrages grossiers
Contributions versées en 2007 aux exploitations avec et sans lait commercialisé
ParamètreUnitéExploitations avec Exploitations sans commercialisationcommercialisation
par
Déduction pour limitation des contributions en fonction de la surface herbagèreUGBFG2,61,4
pour lait commercialiséUGBFG20,50,0
donnant droit aux
Source: OFAG
Certes, les entreprises qui commercialisent du lait touchent environ 3’500 francs de moins de contributions UGBFG que celles qui ne le font pas. Mais elles bénéficient en revanche de mesures de soutien du marché laitier (p.ex. supplément pour le lait transformé en fromage).
ParamètreUnitéRégion de Région desRégion de Total plainecollinesmontagne UGBFG donnant droit aux contributionsNombre370 165280 467273 883924 515 ExploitationsNombre17 47013 99815 96947 437 UGBFG donnant droit aux contributions par exploitationNombre21,220,017,219,5 Contributions par exploitationfr. 8 1698 1969 7308 702 Total des contributions1 000 fr.142 708114 733155 371412 813 Total des contributions 20061 000 fr.89 52077 905133 788301 213 Source: OFAG
ExploitationsNombre27 80819 629 Animaux
Animaux
contributionsUGBFG24,112,9 Contributions
exploitationUGBFG26,714,2
Déduction
par exploitationfr. 7 22910 789
2. MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE 2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 181
■ Compensation des difficultés de production
Contribution pour la garde d’animaux dans des conditions difficiles
Ces contributions servent à compenser les conditions de production difficiles des éleveurs dans la région de montagne et dans la zone des collines. A la différence des contributions «générales» allouées pour la garde d’animaux de rente consommant des fourrages grossiers et destinées en premier lieu à promouvoir l’exploitation et l’entretien des herbages, celles-ci visent des objectifs à caractère social ou structurel ou relevant de la politique d’occupation du territoire. Donnent droit aux contributions les mêmes catégories d’animaux que dans le cas des contributions versées pour la garde d’animaux consommant des fourrages grossiers. Ces contributions sont versées pour 20 UGBFG au plus par exploitation.

Taux par UGBFG en 2007fr./UGB
– Zone des collines260
– Zone de montagne I440
– Zone de montagne II690
– Zone de montagne III930
– Zone de montagne IV1 190
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 182
Contributions versées en 2007 pour la garde d’animaux dans des conditions difficiles
ParamètreUnitéRégion de Région desRégion de Total plainecollinesmontagne
UGBFG donnant droit aux contributionsNombre53 490223 647236 786513 923 ExploitationsNombre2 98013 99715 97132 948
UGBFG par exploitationNombre17,916,014,815,6 Contributions par exploitationfr. 1 5755 53112 2528 431
Total des contributions1 000 fr.4 69477 420195 672277 786
Total des contributions 20061 000 fr.4 63978 648197 972281 258
Source: OFAG
La tendance à la baisse enregistrée en ce qui concerne les contributions pour la garde d’animaux dans des conditions difficiles s’est poursuivie durant l’année de contributions 2007. Comparé à 2005, les contributions allouées pour la garde d’animaux dans des conditions difficiles ont baissé d’environ 3,5 millions de francs par suite de l’évolution structurelle et de la limitation à 20 UGBFG par exploitation. En conséquence, les UGBFG donnant droit aux contributions ont diminué de 4’706 unités et le nombre d´exploitations ayant droit aux contributions a diminué de 443 unités.
Répartition des animaux consommant des fourrages grossiers dans des conditions de production difficiles en 2007, selon les classes de grandeur
Exploitations (en centaines)
Animaux (en milliers d'UGBFG) donnant droit aux contributions
Animaux
milliers d'UGBFG) ne donnant pas droit aux contributions
Source: OFAG
En 2007, 69% du cheptel UGBFG étaient gardées dans des exploitations ayant droit aux contributions et concernées par cette limitation. Dans ces dernières, la part des UGBFG ne donnant pas droit aux contributions s’est élevée à 36%.
>90 45–90 30–45 20–30 15–20 10–15 5–10 <5
Classes de grandeur en UGBFG
100 10050500 0 Nombre 50100150200250 67 53 39 52 8 23 99 56 16435 82 9166 44 4260 18 49 1 2. MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE 2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 183
(en
■ Contributions générales pour des terrains en pente: compensation des difficultés dans l’exploitation des surfaces
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 184
Contributions pour des terrains en pente
Les contributions générales pour des terrains en pente rétribuent l’exploitation des terres dans des conditions difficiles dans la région des collines ou celle de montagne. Elles ne sont versées que pour les prairies, les surfaces à litière et les terres assolées. Les prairies doivent être fauchées au moins une fois par an, les surfaces à litière une fois par an au plus et tous les trois ans au moins. Selon leur déclivité, les terrains en pente sont répartis en deux catégories:
Contributions versées en 2007 pour des terrains en pente
Exploitations ayant reçu des contributions pour terrains en pente en 2007
déclivité inférieure à 18% 61%
18–35%
L’étendue des surfaces annoncées varie légèrement d’une année à l’autre, évolution qui dépend surtout des conditions climatiques et de leur impact sur le type d’exploitation (plus ou moins de pâturages ou de prairies de fauche).
Taux de 2007fr./ha – Déclivité de 18 à 35%370 –Déclivité de plus de 35%510
ParamètreUnitéRégion de Région desRégion de Total plainecollinesmontagne Surfaces donnant droit aux contributions: –déclivité de 18 à 35%ha4 56064 07472 907141 541 –déclivité de plus de 35%ha1 37017 57160 14379 084 Totalha5 93181 644133 051220 626 ExploitationsNombre2 08913 24915 45030 788 Contribution par exploitationfr. 1 1422 4663 7293 010 Total des contributions1 000 fr.2 38632 66757 61792 671 Total des contributions 20061 000 fr.2 38933 27058 56894 227 Source: OFAG
déclivité de
25% déclivité de
Source: OFAG 14%
35% et plus
Total 567 703 ha
■ Contributions pour les surfaces viticoles en pente: préservation des surfaces viticoles en forte pente et en terrasses
Ces contributions aident à préserver les vignobles plantés en forte pente et en terrasses. Afin d’apprécier correctement les surfaces viticoles pour le calcul des contributions, il convient de faire la distinction entre, d’une part, les fortes et les très fortes pentes et, d’autre part, les terrasses aménagées sur des murs de soutènement. Pour les vignobles en forte pente et en terrasses, les contributions ne sont allouées qu’à partir d’une déclivité de 30%. Les taux des contributions sont fixés indépendamment des zones.
Contributions versées en 2007 pour les vignes en forte pente et en terrasses
Par rapport à la surface viticole totale, la part des surfaces en forte pente et en terrasses donnant droit à des contributions est d’environ 25%.

Taux de 2007fr./ha – Surfaces de 30 à 50% de déclivité1 500 –Surfaces de plus de 50% de déclivité3 000 –Surfaces en terrasses5 000
Unité Surfaces donnant droit aux contributions, totalha3 747 Surfaces en forte pente, déclivité de 30 à 50%ha1 892 Surfaces en forte pente, déclivité de plus de 50%ha353 Aménagements en terrassesha1 503 Nombre d’exploitationsNombre2 857 Surface par exploitation (en ha)ha1,3 Contributions par exploitation (en fr.)fr. 3 993 Total des contributions (en 1 000 fr.)1 000 fr.11 407 Total des contributions 20061 000 fr. 11 380 Source: OFAG
2. MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE 2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 185
Nouveautés 2008/2009
Par décision du 14 novembre 2007 et du 25 juin 2008, le Conseil fédéral a procédé à quelques modifications dans le cadre de la mise en œuvre de PA 2011.
La contribution générale à la surface a baissé de 70 francs, elle est passée le 1er janvier 2008 à 1080 francs par ha. En outre, la contribution pour la garde d’animaux consommant des fourrages grossiers concernant les catégories animales bovins, équidés, bisons, chèvres et brebis laitières a été réduite, elle est passée de 900 à 860 francs par UGBFG.
Un des éléments-clés de la Politique agricole 2011 est la réduction des moyens financiers utilisés pour le soutien du marché et la réallocation des fonds ainsi libérés à l’octroi de paiements directs non liés à la production. Les modifications suivantes entrent en vigueur le 1er janvier 2009.
Echelonnement des contributions
Relèvement des valeurs limites pour l’échelonnement des contributions en fonction de la surface et du nombre d’animaux.
Limites de revenu et de fortune
Légère majoration des déductions pour couples d’exploitants et des contributions maximales par unité de main-d’œuvre standard.
Contributions à la surface
Réduction de la contribution générale à la surface; nouveau montant: 1’040 fr./ha. Augmentation de la contribution supplémentaire allouée pour les terres ouvertes et les cultures pérennes; nouveau montant: 620 fr./ha.
Calcul du nombre de bovins à l’aide des données BDTA
Le nombre moyen BDTA, en lieu et place du nombre relevé le jour de référence, sert à la détermination du nombre d’animaux donnant droit à une contribution.
Contributions UGBFG
Prise en compte des surfaces affectées à la culture du maïs et des betteraves fourragères, compte tenu de la limite d’octroi. Maintien des contributions réparties en trois catégories:
–bovins, équidés, bisons, chèvres laitières et brebis laitières: nouveau 690 fr./UGBFG
–autres chèvres et moutons, lamas, alpagas: nouveau 520 fr./UGBFG
–UGB avec déduction «lait commercialisé»: nouveau 450 fr./UGBFG
Maintien du soutien apporté au marché du lait au moyen de la déduction pour le lait commercialisé.
Contributions GACD
Suppression de la limitation des contributions (20 UGB par exploitation); le même échelonnement que pour tous les autres types de contributions. Institution d’une limite d’octroi, comme dans le cas des contributions UGBFG; les taux de contributions sont relevés pour toutes les zones de 40 fr./UGB; réglementation transitoire pour les petites exploitations jusqu’en 2011.
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 186
2.2.3Paiements directs écologiques
Contributions écologiques

Les paiements directs écologiques rétribuent des prestations écologiques particulières qui dépassent le cadre des PER. Les exploitants peuvent choisir librement de participer aux différents programmes qui leur sont proposés. Ceux-ci sont indépendants les uns des autres, les contributions pouvant être cumulées.
Total 217,7 mio. de fr.
■■■■■■■■■■■■■■■■
Tableaux 33a–33b, pages A33–A34 Répartition des contributions écologiques entre les programmes en 2007
Source: OFAG
Compensation écologique 58% Culture biologique 13% Culture extensive 14% OQE 15% 2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 187
Compensation écologique
La compensation écologique vise à préserver et, si possible, à élargir l’espace vital de la faune et de la flore suisses dans les régions agricoles. De surcroît, elle contribue au maintien des structures et des éléments typiques du paysage. Certains éléments de la compensation écologique sont rétribués par des contributions et peuvent simultanément être imputés à la compensation écologique obligatoire des PER, alors que d’autres sont imputables à cette dernière mais ne donnent pas droit aux contributions.
Eléments de la compensation écologique, donnant droit ou non à des contributions
Eléments imputables aux PER Eléments imputables aux PER et donnant droit aux contributions sans donner droit aux contributions
Prairies extensivesPâturages extensifs
Prairies peu intensivesPâturages boisés
Surfaces à litièreArbres isolés indigènes adaptés au site et allées d’arbres
Haies, bosquets champêtres Fossés humides, mares, étangs et berges boisées
Jachères floralesSurfaces rudérales, tas d’épierrage et affleurements rocheux
Jachères tournantesMurs de pierres sèches
Bandes culturales extensivesChemins naturels non stabilisés
Arbres fruitiers à haute-tigeSurfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle
Autres surfaces de compensation écologique faisant partie de la SAU, définies par le service cantonal de protection de la nature
Ces surfaces ne doivent pas être fertilisées et peuvent être utilisées pendant six ans au plus tôt à partir de la mi-juin à la mi-juillet, selon la zone. La fauche tardive a pour but de garantir que les semences arrivent à maturité et que leur dispersion naturelle favorise la diversité des espèces. Elle laisse par ailleurs suffisamment de temps à de nombreux invertébrés, aux oiseaux nichant au sol et aux petits mammifères pour leur reproduction.
Les contributions versées pour les prairies extensives, les surfaces à litière, les haies et les bosquets champêtres sont réglées de manière uniforme et échelonnées selon les zones où se trouve la surface. La part des prairies extensives n’a cessé d’augmenter au cours des dernières années.
Taux de 2007fr./ha
– Zone de grandes cultures et zones intermédiaires1 500
– Zone des collines1 200
– Zones de montagne I et II700
– Zones de montagne III et IV450
Tableaux 34a–34d, pages A35–A38
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 188
■ Prairies extensives
■ Surfaces à litière
Contributions versées en 2007 pour les prairies extensives
■ Haies, bosquets champêtres et berges boisées
Par surfaces à litière, on entend les surfaces exploitées de manière extensive, situées dans des lieux humides et marécageux et qui, en règle générale, sont fauchées en automne ou en hiver pour la production de litière.
Contributions versées en 2007 pour les surfaces à litière
Par haies, bosquets champêtres et berges boisées, on entend les haies basses, les haies arbustives et arborées, les brise-vents, les groupes d’arbres, les talus et les berges boisées. Ces surfaces doivent être exploitées de manière adéquate et convenablement entretenues pendant six ans, sans interruption.
Contributions versées en 2007 pour les haies, bosquets champêtres et berges boisées
de Région desRégion de Total plainecollinesmontagne
ParamètreUnitéRégion de Région desRégion de Total plainecollinesmontagne ExploitationsNombre19 0179 94710 17339 137 Surfaceha27 72711 26517 06656 058 Surface par exploitationha1,461,131,681,43 Contribution par exploitationfr. 2 1351 1578821 561 Total des contributions1 000 fr.40 59711 5118 96961 077 Total des contributions 20061 000 fr.39 59511 3498 85359 797 Source: OFAG
ParamètreUnitéRégion de Région desRégion
ExploitationsNombre1 9081 9223 2227 052 Surfaceha1 9091 5273 6777 112 Surface par exploitationha1,000,791,141,01 Contribution par exploitationfr. 1 466771719935 Total des contributions1 000 fr.2 7971 4822 3166 594 Total des contributions 20061 000 fr.2 7601 4922 2966 548 Source: OFAG
de Total plainecollinesmontagne
ParamètreUnitéRégion
ExploitationsNombre5 8223 0811 41210 315 Surfaceha1 4218023152 538 Surface par exploitationha0,240,260,220,25 Contribution par exploitationfr. 361270146304 Total des contributions1 000 fr.2 1008322063 138 Total des contributions 20061 000 fr.2 0808212053 106 Source: OFAG
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 2. MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE 189
■
Prairies peu intensives
Les prairies peu intensives peuvent être légèrement fertilisées avec du fumier ou du compost. Les prescriptions concernant l’exploitation sont les mêmes que celles pour les prairies extensives.
Taux de 2007fr./ha
– Zone de grandes cultures à zone des collines650
– Zones de montagne I et II450
– Zones de montagne III et IV300
Contributions versées en 2007 pour les prairies peu intensives
Par jachères florales, on entend les bordures pluriannuelles de 3 m de largeur au moins, non fertilisées et ensemencées d’herbacées sauvages indigènes. Ces jachères servent à protéger les herbacées sauvages menacées. Elles offrent également habitat et nourriture aux insectes et autres petits animaux. De surcroît, elles servent de refuge aux lièvres et aux oiseaux. Les jachères florales donnent droit à une contribution de 3’000 fr./ha, qui est versée pour les surfaces situées dans la zone des grandes cultures, zone des collines comprise.
Contributions versées en 2007 pour les jachères florales
ParamètreUnitéRégion de Région desRégion de Total plainecollinesmontagne ExploitationsNombre6 4506 8769 17922 505 Surfaceha5 6866 24117 39829 325 Surface par exploitationha0,880,911,901,30 Contribution par exploitationfr. 565502643577 Total des contributions1 000 fr.3 6443 4515 89912 994 Total des contributions 20061 000 fr.3 9113 6106 12013 641
Source: OFAG
ParamètreUnitéRégion de Région desRégion de Total plainecollinesmontagne1 ExploitationsNombre1 91037752 292 Surfaceha1 82231632 141 Surface par exploitationha0,950,840,500,93 Contribution par exploitationfr. 2 8622 5191 5122 802 Total des contributions1 000 fr.5 46694986 423 Total des contributions 20061 000 fr.5 8771 00956 891 1Il s’agit d’entreprises exploitant des surfaces dans la zone des collines ou la région de plaine Source: OFAG
■ Jachères florales 2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 190
■ Jachères tournantes
Par jachères tournantes, on entend des surfaces non fertilisées qui sont ensemencées d’herbacées sauvages indigènes, messicoles, pendant un ou deux ans; elles doivent présenter une largeur de 6 m au moins et couvrir au minimum 20 ares. Ces jachères offrent un habitat aux oiseaux couvant au sol, aux lièvres et aux insectes. L’enherbement naturel est également possible à des endroits propices. Dans la zone des grandes cultures et la zone des collines, les jachères tournantes donnent droit à une contribution de 2’500 fr./ha.
Contributions versées en 2007 pour les jachères tournantes
ParamètreUnitéRégion de Région desRégion de Total plainecollinesmontagne1
1Il s’agit d’entreprises situées dans la région des collines et celle de montagne, mais exploitant une partie de leurs surfaces dans la région de plaine
Source: OFAG
■ Bandes culturales extensives
Les bandes culturales extensives offrent un espace de survie aux herbacées accompagnant traditionnellement les cultures (espèces messicoles). On entend par là des bandes de cultures des champs (céréales, colza, tournesols, pois protéagineux, féveroles et soja, sans le maïs), d’une largeur de 3 à 12 m et exploitées de manière extensive. Dans toutes les zones, un montant de 1’500 francs a été versé par ha.
Contributions versées en 2007 pour les bandes culturales extensives
ParamètreUnitéRégion de Région desRégion de Total plainecollinesmontagne1
ExploitationsNombre6024084
Surfaceha308038
Surface par exploitationha0,520,420,090,48
Contribution par exploitationfr. 7994570718
Total des contributions1 000 fr.4811059
Total des contributions 20061 000 fr.4811059
Source: OFAG
Surfaceha7141292845 Surface par exploitationha1,421,331,051,41 Contribution par exploitationfr. 3 5583 3232 6253 517 Total des contributions1 000 fr.1 78632252 114 Total des contributions 20061 000 fr.1 67532031 998
ExploitationsNombre502972601
1Il s’agit d’entreprises exploitant des surfaces dans la zone des collines ou la région de plaine
2. MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE 2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 191
■ Arbres fruitiers
La Confédération verse des contributions pour les arbres haute-tige de fruits à noyau ou à pépins ne faisant pas partie d’une culture fruitière, ainsi que pour les châtaigneraies et les noiseraies entretenues. Un montant de 15 francs est alloué par arbre annoncé.
Contributions versées en 2007 pour les arbres fruitiers haute-tige
■ Aperçu des surfaces de compensation écologique
Répartition des surfaces de compensation écologique selon les régions en 2007
de Région desRégion de Total plainecollinesmontagne ExploitationsNombre16 12812 1425 39533 665 Arbresha1 150 217877 656274 2972 302 170 Arbres par exploitationha71,3272,2850,8468,38 Contribution par exploitationfr. 1 0701 0847631 026 Total des contributions1 000 fr.17 25013 1644 11434 529 Total des contributions 20061 000 fr.17 45513 3674 11334 935 Source: OFAG
ParamètreUnitéRégion
Elémentsla SAUla SAUla SAU Prairies extensives27 7275,5211 2654,2417 0665,86
peu intensives5 6861,136 2412,3517 3985,97 Surfaces à litière1 9090,381 5270,573 6771,26 Haies, bosquets champêtres et berges boisées1 4210,288020,303150,11 Jachères florales1 8220,363160,1230,00 Jachères tournantes7140,141290,0520,00 Bandes culturales extensives300,0180,0000,00 Total39 3097,8320 2887,6338 46013,21
OFAG
Région de Région des Région de plainecollinesmontagne ha% deha% deha% de
Prairies
Source:
haute-tige
2007
Prairies extensives 57,2% Surfaces à litière 7,3% Jachères tournantes 0,9% Prairies peu extensives 29,9% Bosquets champêtres
boisées 2,6%
OFAG 1 sans les arbres fruitiers haute-tige Total
Bandes culturales extensives 0,0% Jachères florales
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 192
Répartition des surfaces de compensation écologique1 en 2007
et rives
Source:
98 058 ha
2,2%
Ordonnance sur la qualité écologique
Afin de conserver et de promouvoir la richesse naturelle des espèces, la Confédération alloue des aides financières pour les surfaces de compensation écologique d’une qualité biologique particulière aménagées sur la SAU et pour leur mise en réseau. Il appartient aux cantons de fixer les exigences que doivent remplir les surfaces pour donner droit à des contributions selon l’ordonnance sur la qualité écologique (OQE), et à la Confédération de vérifier les prescriptions cantonales sur la base de critères minimaux. Dans la mesure où les exigences cantonales sont conformes aux exigences minimales de la Confédération et où le cofinancement régional est assuré, celle-ci accorde aux cantons des aides financières pour les contributions qu’ils versent aux agriculteurs. Les aides financières de la Confédération représentent 80% des coûts imputables, les 20% restants devant être pris en charge par des tiers (cantons, communes, particuliers, organismes). Les contributions à la qualité biologique peuvent être cumulées avec celles versées pour la mise en réseau. L’OQE se fonde sur le caractère facultatif de la compensation écologique, sur des incitations financières et sur la prise en considération des différences régionales eu égard à la biodiversité.
Taux imputables
Taux de 2007fr.
– Pour la qualité biologique500.–/ha
– Pour la qualité biologique des arbres fruitiers haute-tige20.–/arbre
– Pour la mise en réseau500.–/ha
Une surface de compensation écologique contribue particulièrement à la préservation et à la promotion de la biodiversité lorsqu’elle présente des espèces indicatrices et des éléments de structure déterminés ou encore lorsque son emplacement est judicieux du point de vue écologique. L’exploitant peut annoncer directement sa surface de compensation écologique au titre de la qualité biologique; par contre, la mise en réseau de ces surfaces exige une stratégie portant sur un ensemble qui justifie cette mesure sur les plans paysager et écologique.
2. MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE 2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 193
Contributions 1 versées en 2007 en vertu de l’ordonnance sur la qualité écologique
1
Contributions 1 versées en 2007 pour la qualité biologique et la mise en réseau
ParamètreUnitéRégion de Région desRégion de Total plainecollinesmontagne ExploitationsNombre10 0487 9399 62327 610 Surface 2 ha15 75912 67723 55251 989 Surface 2 par exploitationha1,571,602,451,88 Contribution par exploitationfr. 1 0071 1071 3721 163 Total des contributions1 000 fr.10 1188 79013 19932 107 Total des contributions 20061 000 fr.9 6428 52912 08630 256
sans prise
des arriérés
conversion des arbres haute-tige:
arbre
Source: OFAG
en considération des réductions, des remboursements et
2
1
= 1 are
ParamètreUnitéQualité Mise en Qualité biologique réseaubiologique et mise en réseau 2 Prairies extensives, prairies peu intensives et surfaces à litière ExploitationsNombre9 77613 4748 029 Surfaceha11 74512 71712 538 Contributions1 000 fr.4 5395 0729 770 Haies, bosquets champêtres et berges boisées ExploitationsNombre5082 8831 144 Surfaceha114518289 Contributions1 000 fr.44236233 Arbres fruitiers à haute-tige ExploitationsNombre3 6659 0703 947 ArbresPièces222 541304 938206 331 Contributions1 000 fr.3 4971 2094 090 Autres éléments ExploitationsNombre-7 137Surfaceha-6 729Contributions1 000 fr.-3 423-
sans prise en considération des réductions, des remboursements et des arriérés
combinaison des deux programmes
OFAG
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 194
1
2
Source:
Tableau 35, page A39
Surfaces de compensation écologique de qualité (arbres haute-tige y compris)

Source: OFAG GG25 ©swisstopo
Surfaces de compensation écologique en réseau (arbres haute-tige y compris)
OFAG GG25 ©Swisstopo
0 1–5 6–10 11–20 >20 Estivage en % de la SAU
Valeurs par commune
0 1–5 6–10 11–20 >20 Estivage en % de la SAU
Valeurs par commune 2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 195
Source:
Culture extensive de céréales et de colza
Cette mesure a pour objectif d’inciter les cultivateurs à renoncer, dans la culture de céréales et de colza, aux régulateurs de croissance, aux fongicides, aux stimulateurs chimiques de synthèse des défenses naturelles et aux insecticides. En 2007, la contribution s’est élevée à 400 francs par hectare.
Contributions versées en 2007 pour la culture extensive de céréales et de colza

Répartition de la surface de cultures extensives en 2007
ParamètreUnitéRégion de Région desRégion de Total plainecollinesmontagne ExploitationsNombre9 7415 47461115 826 Surfaceha55 04520 3841 48476 913 Surface par exploitationha5,653,722,434,86 Contribution par exploitationfr. 2 2481 4879711 935 Total des contributions1 000 fr.21 8988 13859330 629 Total des contributions 20061 000 fr.21 8068 59969031 094 Source: OFAG
Céréales panifiables 54% Colza 7% Céréales fourragères 39% Source: OFAG Total 76 913 ha Tableau 36, page A40 2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 196
Culture biologique
En complément des recettes supplémentaires que l’agriculture biologique peut réaliser sur le marché, la Confédération encourage celle-ci comme mode de production particulièrement respectueux de l’environnement. Du reste, les exploitants doivent appliquer les règles de l’ordonnance sur l’agriculture biologique s’ils veulent obtenir des contributions. Des dérogations au principe de la globalité existent pour la viticulture et les cultures fruitières pérennes.
L’agriculture biologique renonce complètement à l’emploi de matières auxiliaires chimiques de synthèse comme les engrais de commerce ou les pesticides, ce qui permet d’économiser l’énergie et de préserver l’eau, l’air et le sol. La prise en considération des cycles et procédés naturels est donc d’une importance cruciale pour l’agriculteur bio. Dans l’ensemble, la culture biologique exploite les ressources existantes de manière plus efficace. Cette efficacité constitue un indicateur important de la durabilité du système de production.
En renonçant aux herbicides, l’agriculture biologique favorise le développement de nombreuses espèces messicoles. Les surfaces dont la flore est diversifiée offrent de la nourriture à un plus grand nombre de petits organismes qui constituent, à leur tour, une proie pour les prédateurs arthropodes tels les carabidés, et créent ainsi de bonnes conditions pour la lutte naturelle contre les organismes nuisibles. Grâce à la présence de plantes, d’animaux et de micro-organismes en plus grand nombre, l’écosystème est en mesure de mieux résister aux perturbations et au stress.
L’agriculteur bio épand de la fumure organique, travaille le sol avec ménagement, renonce aux produits phytosanitaires et favorise par là le développement et la variété des organismes du sol. L’activité biologique augmente la fertilité du sol: elle contribue en effet à enrichir la couche d’humus, à améliorer la structure du sol et à réduire l’érosion.
Pour faire coexister de manière harmonieuse les plantes, le sol, les animaux et l’homme, l’agriculteur bio veille à ce que les circuits d’éléments nutritifs fonctionnent en boucle fermée dans son exploitation, en faisant coïncider la base fourragère de son entreprise agricole avec le nombre d’animaux qu’il détient. Autre aspect important: la culture de légumineuses améliore l’offre en azote dans le sol. Par ailleurs, les engrais de ferme et le matériel organique provenant des engrais verts et des résidus de récolte garantissent aux plantes un apport équilibré en éléments nutritifs par le biais des organismes du sol.
Quant à l’élevage des animaux de rente, il doit satisfaire aux exigences du programme SRPA qui, en agriculture biologique, sont considérées comme un minimum à observer. Ce programme interdit en outre l’administration à titre préventif d’aliments médicamenteux aux animaux. En utilisant essentiellement les fourrages produits dans l’exploitation, l’agriculteur bio obtient un rendement raisonnable et garde des animaux en bonne santé. Autre particularité: il applique en premier lieu des méthodes thérapeutiques naturelles en cas de besoin.
En 2007, 10,9% de la SAU totale ont été cultivés selon les règles de l’agriculture biologique.
2. MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE 2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 197
200
– Terres ouvertes, cultures spéciales exceptées800
–
herbagères et surfaces à litière200
Contributions versées en 2007 pour la culture biologique
Part de la surface exploitée selon les règles de la culture biologique, par région en 2007
Cultures spéciales1
Taux de 2007fr./ha –
Surfaces
ParamètreUnitéRégion de Région desRégion de Total plainecollinesmontagne ExploitationsNombre1 1771 3743 5316 082 Surfaceha21 89723 30468 330113 531 Surface par exploitationha18,6016,9619,3518,67 Contribution par exploitationfr. 7 4214 1363 8674 616 Total des contributions1 000 fr.8 7355 68313 65628 074 Total des contributions 20061 000 fr.8 8805 79913 99328 672 Source: OFAG
Tableau 33a, page A33
Région de plaine 19% Région de montagne 60% Source: OFAG Total 113 531 ha Région des collines 21% 2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 198
■ Systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux (SST)
Programmes éthologiques
Le terme éthoprogrammes regroupe les programmes «Systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux» et «Sorties régulières en plein air» (cf. à ce propos le paragraphe 1.3.2)
La Confédération encourage les agriculteurs à garder les animaux dans des systèmes de stabulation qui répondent à des exigences dépassant largement le niveau requis dans la législation relative à la protection des animaux.
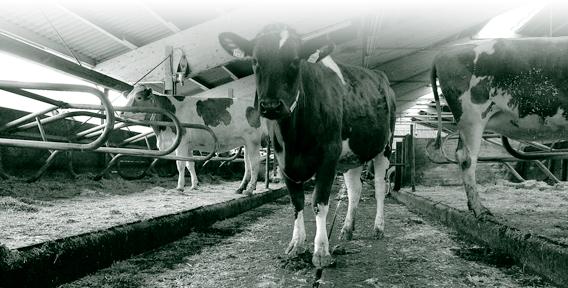
Contributions SST 2007fr./UGB – bovins, veaux exceptés, chèvres, lapins90 – porcs155 – poules pondeuses, poulettes et jeunes coqs, poules et coqs d’élevage, poussins280 – poulets de chair et dindes180
Contributions SST 2007
Source: OFAG
ParamètreUnitéRégion de Région desRégion de Total plainecollinesmontagne ExploitationsNombre8 9055 7953 94918 649 UGBNombre264 135134 21368 636466 984 UGB par exploitationNombre29,6623,1617,3825,04 Contribution par exploitationfr. 3 3212 5971 7692 767 Total des contributions1 000 fr.29 56915 0486 98551 602 Total des contributions 20061 000 fr.28 35014 7186 68149 749
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 199
Tableau 37, page A41
■ Sorties régulières en plein air (SRPA)
La Confédération encourage les sorties régulières des animaux de rente en plein air, c’est-à-dire sur un pâturage, dans une aire d’exercice ou à climat extérieur, répondant aux besoins des animaux. Contributions SRPA 2007fr./UGB –bovins et équidés, bisons, moutons, chèvres, daims et cerfs rouges, lapins180
SRPA 2007

–porcs155 –volaille280 Contributions
ParamètreUnitéRégion de Région desRégion de Total plainecollinesmontagne ExploitationsNombre13 96111 20112 73637 898 UGBNombre386 804267 199237 348891 352 UGB par exploitationNombre27,7123,8518,6423,52 Contribution par exploitationfr. 4 7854 1913 3324 121 Total des contributions1 000 fr.66 81046 94742 437156 194 Total des contributions 20061 000 fr.65 11246 33342 053153 498 Source: OFAG
Tableau 39, page A43
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 200
■ Exploitation durable des régions d’estivage
Contributions d’estivage
Les contributions d’estivage ont pour objectif d’assurer l’exploitation et l’entretien de nos vastes pâturages d’estivage dans les Alpes, les Préalpes et le Jura. La région d’estivage est utilisée et entretenue par quelque 300’000 UGB. La charge en bétail est fixée selon les principes d’une exploitation durable; c’est ladite charge usuelle. Les contributions sont versées par pâquier normal (PN) calculé à partir de la charge usuelle. Un PN correspond à l’estivage d’une UGB pendant 100 jours.
Taux de 2007fr. –vaches traites, chèvres et brebis laitières, par UGB (56 à 100 jours d’estivage)300 –moutons, brebis laitières exceptées, par PN –en cas de surveillance permanente par le berger300 –en cas de pâturage tournant220 –dans le cas des autres pâturages120 –autres animaux consommant des fourrages grossiers, par PN300
Contributions d’estivage versées en 2007
Des contributions d’estivage, dont le montant varie en fonction du système de pacage, sont versées pour les moutons (brebis laitières exceptées) depuis l’année de contributions 2003. L’octroi de contributions plus élevées permet, d’une part, de rétribuer les frais plus importants qu’occasionnent la présence de bergers et les pâturages tournants et, d’autre part, par analogie avec les contributions écologiques, d’inciter les agriculteurs à pratiquer l’estivage durable des moutons. La garde permanente des moutons signifie que le troupeau est mené par un berger accompagné de chiens, et conduit quotidiennement à un pâturage choisi par le berger. Dans le cas de pâturages tournants, le pacage se fait pendant toute la durée de l’estivage dans des enclos entourés d’une clôture ou clairement délimités par des conditions naturelles.
ParamètreContributionsExploitationsUGB ou PN 1 000 fr.NombreNombre Vaches traites, chèvres laitières, brebis laitières15 9692 05353 316 Moutons, brebis laitières exceptées 5 10993524 824 Autres animaux consommant des fourrages grossiers71 0466 693237 046 Total92 1247 299 1 Total 200691 6967 336 1 1Il s’agit ici du total des exploitations d’estivage ayant droit aux contributions (sans doubles comptages) Source: OFAG
2. MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE 2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 201
Tableau 40a–40b, page A44–A45
Estivage de moutons en fonction des systèmes de pacage en 2007
Système de pacageExploitationsAnimaux
Evolution de l’estivage entre 2000 et 2007: exploitations et animaux estivés en pâquiers normaux, selon les catégories d’animaux
donnant Contributions droit aux contributions NombrePN1 000 fr. Présence d’un berger en permanence948 3852 516 Pâturages tournants2085 4901 203 Autres pâturages61310 0381 200 Combinaison de systèmes de pacage20910190 Total93524 8245 109 Total 200695524 5354 967 Source: OFAG
Année20002001200220032004200520062007 Catégorie d’animauxUnité Nombre de vaches laitièresExploitations4 9614 7124 6004 4904 3534 3014 2594 662 PN118 793118 021116 900116 679111 123112 858110 070118 919 Vaches mères et nourricesExploitations1 2801 1601 2271 3541 4341 5121 5921 643 PN13 85414 48615 71517 94918 90421 22722 66224 962 Autres bovinsExploitations6 6846 4536 5036 4256 3586 3196 3326 294 PN134 457129 217127 946126 910121 169120 421118 060122 562 EquidésExploitations1 1321 0861 0751 0841 0631 0791 0561 024 PN4 6524 3154 3644 3404 3474 5154 5584 550 MoutonsExploitations1 1731 1451 1041 1501 1111 0761 053993 PN29 67826 17224 71026 63325 81326 85626 08625 803 ChèvresExploitations1 7001 6231 6671 6691 6571 6481 6151 557 PN5 1655 2145 4345 6625 6645 9775 8575 926 Autres animaux estivésExploitations22289277241240236225223 PN60899764735541496497518 Un PN = 1 UGB x durée d’estivage / 100 jours
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 202
Source: OFAG
■ Eviter le lessivage et le ruissellement de substances
Contributions pour la protection des eaux
Depuis 1999, l’art. 62a de la loi sur la protection des eaux habilite la Confédération à indemniser les agriculteurs pour les mesures qu’ils prennent contre le lessivage et le ruissellement de substances dans les eaux superficielles et souterraines. La mise en œuvre de l’article a été placée sous la responsabilité du groupe de travail «Nitrates» de la Confédération. Celui-ci est dirigé par l’OFAG. Font partie du groupe de travail, outre l’OFAG, des représentants de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), de la Conférence des chefs des services cantonaux de la protection de l’environnement (CCE), de la Conférence des chefs des services cantonaux de l’agriculture (COSAC) et des centrales de vulgarisation AGRIDEA. Il s’agit en priorité de réduire la charge en nitrates de l’eau potable et la charge en phosphore des eaux superficielles dans les régions où les PER, l’agriculture biologique, les interdictions et les prescriptions ainsi que les programmes volontaires encouragés par la Confédération (production extensive, compensation écologique) ne suffisent pas.

En 2007, 25 projets ont fait l’objet d’une mise en œuvre, à savoir 20 projets «nitrates», 3 projets «phosphore» et 2 projets dans le domaine des produits phytosanitaires (PPS). Les 3 projets «phosphore» relatifs aux lacs du Plateau et 8 projets «nitrates» se trouvent dans la seconde phase du projet. Quelque 10 nouveaux projets sont en phase préparatoire ou de planification.
Selon l’ordonnance sur la protection des eaux, les cantons ont l’obligation de délimiter une aire d’alimentation pour les captages d’eaux souterraines et de surface et de déterminer les mesures nécessaires à un assainissement, si la qualité des eaux est insuffisante. Ces mesures peuvent, par rapport à l’état de la technique, entraîner des restrictions considérables dans l’utilisation du sol et causer des pertes financières que les exploitations agricoles ne peuvent supporter. Les contributions fédérales aux coûts sont de 80% pour les adaptations structurelles et de 50% pour les mesures d’exploitation.
En 2007, elles se sont élevées à quelque 5,9 millions de francs.
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 203
Aperçu des projets 2007
CantonRégion, Durée probable SubstanceRégion viséeCoûts totaux Contributions communedu projetpar le projetprévusversées en 2007
Le léger recul, par rapport à 2006, des contributions octroyées est imputable aux mesures structurelles en matière de construction qui, en 2007, ont été plus modestes.
Annéehafr.fr. AGBaldingen2004–2009Nitrates69281 40025 728 AGBirrfeld2002–2007Nitrates8131 909 500177 914 AGWohlenschwil2001–2009Nitrates62547 69652 172 AGKlingnau2007–2012Nitrates101486 60010 506 AGLac de Hallwil2001–2010 1 Phosphore1 200851 398124 902 FRAvry-sur-Matran2000–2011 1 Nitrates37405 73927 133 FRCourgevaux2003–2008Nitrates27164 83820 880 FRDomdidier2004–2009Nitrates30195 58822 677 FRFétigny2004–2009Nitrates631 526 110107 716 FRLurtigen2005–2010Nitrates2861 218 964100 500 FRTorny (Middes) 2000–2012 1 Nitrates45369 85321 817 FRSalvenach2005 2 Nitrates13,5202 334LULac de Baldegg2000–2010 1 Phosphore5 60018 800 7821 856 306 LULac de Sempach2005–2010 1 Phosphore4 90517 577 4551 432 713 LULac de Hallwil2001–2010 1 Phosphore3 7867 312 967954 917 SHKlettgau2001–2012 1 Nitrates3574 049 470186 437 SOGäu I2000–2008 1 Nitrates6582 220 050218 445 SOGäu II2003–2008Nitrates8501 217 040186 000 VDBavois2005–2010Nitrates5178 98522 333 VDBofflens2005–2010Nitrates112580 10074 421 VDBoiron / Morges2005–2010PPS2 2501 313 10045 847 VDMorand/ Montricher2000–2013 1 Nitrates4031 082 996128 622 VDThierrens1999–2011 1 Nitrates17333 57026 738 VDSugnens2007–2012Nitrates16129 90017 298 ZHBaltenswil2000–2008 1 Nitrates et PPS130712 00041 926 Total 63 668 4355 889 747 Total 2006 6 269 542 1 Prolongation décidée 2 Projet s’inscrivant dans le cadre d’une amélioration intégrale et assorti d’un versement unique en 2005 Source:
OFAG
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 204
Nouveautés 2008/2009
Par décision du 14 novembre 2007 et du 25 juin 2008, le Conseil fédéral a procédé à quelques modifications dans le cadre de la mise en oeuvre de PA 2011.
Compensation écologique
–Introduction du nouvel élément ourlet sur terres assolées, en plaine et jusqu’à la zone de montagne II.
–Réduction des contributions pour prairies peu intensives en plaine et jusqu’à la zone de montagne II.
Qualité écologique
–Nouvelles contributions pour la qualité biologique des pâturages utilisés de manière extensive, des pâturages boisés et des surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle.
–Augmentation des contributions dans le domaine de la qualité biologique et de la mise en réseau de différents éléments jusque dans les zones de montagne III et IV.
–Concrétisation des exigences en matière de mise en réseau.
Programmes éthologiques
–Les ordonnaces SST et SRPA, jusqu’ici applicables, sont regroupées dans une seule ordonnance, soit celle sur les programmes éthologiques.
–Adaptations des catégories animales relatives aux bovins suite à la nouvelle réglementation sur le nombre déterminant d’animaux (BDTA).
–Nouveau programme SST pour les équidés de plus de 30 mois.
–Catégorie «Porcs d’élevage» subdivisée en quatre catégories.
Contributions d’estivage
–A partir de 2009, un montant de 10 millions de francs est disponible en plus pour le soutien de l’estivage.
–La contribution par pâquier normal est augmentée de 20 francs (sauf pour les moutons estivés sur des «autres pâturages».
–L’apport d’aliments pour animaux est limité.
–L’apport d’engrais ne provenant pas de l’alpage nécessite une autorisation du service cantonal compétent.
Protection des eaux
–Les dispositions de la nouvelle péréquation financière s’appliquent aussi aux projets de protection des eaux.
–Elément nouveau: des conventions sont conclues entre la Confédération et les cantons réglementant les objectifs à atteindre, la mise en œuvre des mesures ainsi que les modalités de paiement.
2. MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE 2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 205
Utilisation durable des ressources naturelles (programme)
Conformément à l’art. 77 LAgr, la Confédération octroie à partir de 2008 des contributions destinées à l’amélioration de l’utilisation des ressources naturelles dans l’agriculture. Les domaines-cibles sont les ressources nécessaires à la production agricole, telles que l’azote, le phosphore et l’énergie, l’optimisation de la protection phytosanitaire ainsi que la protection renforcée et l’utilisation plus durable du sol, de la biodiversité dans l’agriculture et du paysage.
–Dans leurs exigences, les mesures doivent aller au-delà des lois, des prestations écologiques requises ou d’autres programmes d’encouragement fédéraux tels que l’ordonnance sur la qualité écologique.
–Les contributions octroyées pour une durée limitée à six ans doivent permettre à de nouvelles techniques ou formes d’organisation de s’imposer lorsqu’elles apportent des améliorations dans ces domaines.
–Une aide est accordée aux mesures dont l’introduction nécessite un soutien financier, pour autant que, dans un avenir prévisible, elles puissent être poursuivies sans aide fédérale.
–La participation à ces mesures est facultative.
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 206
■ Contexte et mandat
Développement du système des paiements directs
Depuis le début de la réforme de la politique agricole, en 1992, l’importance des paiements directs n’a cessé de croître. La protection à la frontière et le soutien interne du marché ont été progressivement réduits, alors que les fonds destinés à la rémunération directe des prestations multifonctionnelles de l’agriculture ont été augmentés.
Les délibérations relatives à la Politique agricole 2011, qui ont porté essentiellement sur la poursuite du transfert aux paiements directs des fonds destinés au soutien du marché, ont suscité un débat au Parlement au sujet de l’aménagement des paiements directs et de leur montant. Le Parlement a finalement accepté l’orientation proposée par le Conseil fédéral, mais a déposé une motion lui demandant de soumettre d’ici 2009 un rapport qui permette de juger si le système des paiements directs devrait être encore développé après 2011 et, dans l’affirmative, de quelle façon (motion CER-E, 06.3635). Pour ce faire, il conviendra de prendre en considération différents points de vue. Une utilisation des fonds la plus conforme aux objectifs visés constitue toutefois la principale exigence formulée dans la motion.
■ Prestations multifonctionnelles et objectifs clairement définis
L’art. 104 de la Constitution fédérale de 1996 servira de base à l’élaboration du rapport. Cet article constitue un point d’ancrage solide. Il est le dénominateur commun des attentes vis-à-vis de l’agriculture, comme l’a confirmé une enquête menée en 2007 par l’Université de St-Gall.
L’al. 1 de l’art. 104 stipule que la Confédération est chargée de veiller à ce que l’agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement (a) à la sécurité de l’approvisionnement de la population, (b) à la conservation des ressources naturelles et à l’entretien du paysage rural et (c) à l’occupation décentralisée du territoire. Le bien-être des animaux s’ajoute implicitement en tant qu’objectif supplémentaire, vu que l’al. 3 de l’article constitutionnel précise que la Confédération encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d’exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l’environnement et des animaux. Un autre objectif encore de la politique agricole –la garantie du revenu –joue également un rôle primordial au plan politique. A cet égard, l’article constitutionnel précise que la Confédération complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies.
Afin de pouvoir ajuster les mesures étatiques aux objectifs poursuivis, il faut que ces objectifs soient concrétisés. L’élaboration du rapport sur le développement du système des paiements directs devra se faire sur la base d’objectifs définis et si possible quantifiés à l’aide d’indicateurs.
La production agricole a des effets extérieurs, dits «externalités» qui peuvent être aussi bien positifs que négatifs. La contribution de l’agriculture à la sécurité de l’approvisionnement, à l’entretien du paysage, au maintien de la biodiversité et de la fertilité des terres cultivables, de même qu’à l’occupation décentralisée du territoire, sont des externalités positives. D’un autre côté, la production agricole génère également des externalités négatives dans le domaine des ressources naturelles (qualité des sols, de l’eau et de l’air), telles que l’apport de substances nocives dans le sol par l’épandage
2. MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE 2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 207
■ Des instruments à la fois efficaces et efficients
de lisier, les émissions d’ammoniac dans l’air dues à l’élevage ou la pollution des eaux de surface par des produits phytosanitaires.
Un autre aspect à considérer pour la définition des prestations et des objectifs – et aussi pour l’aménagement des instruments – est celui de la régionalisation. Même si la politique agricole est fondamentalement du ressort de la Confédération, définir également des objectifs et des instruments adaptés à des contextes régionaux différents, voire déléguer certaines compétences aux régions, peut augmenter l’efficience des mesures. Ce pourrait être le cas du paysage, qui diffère d’une région à l’autre, mais aussi celui des externalités négatives, telle la pollution des eaux, laquelle peut être nettement plus élevée dans une région que dans d’autres, en raison, p.ex., d’une branche de production dominante.
Sur la base de la description des prestations, de la détermination des objectifs et de l’établissement d’indicateurs, les instruments du système développé de paiements directs seront définis en fonction des principes de base suivants:
–Les paiements directs sont utilisés de manière efficace et efficiente en ce qui concerne la réalisation des objectifs.
–Les externalités positives de la production agricole sont encouragées au moyen d’incitations financières; la prévention des externalités négatives ne constitue pas une prestation qui peut être soutenue de manière permanente avec des moyens financiers.
–La politique agricole relève largement de la politique fédérale. Les prestations pour lesquelles un objectif différencié au plan régional est défini sont encouragées au moyen de mesures différenciées au plan régional (mesures régionalisées).
–Les objectifs doivent pouvoir être atteints avec le même système de paiements directs, quels que soient les différents scénarios prix/coûts. Cependant, les différents instruments seront plus ou moins dotés de moyens selon leur niveau de prix.
–Le montant des paiements directs est calculé de façon que les prestations qui ont été définies puissent être fournies par l’agriculture à long terme.
–Les paiements directs sont coordonnés avec les autres domaines politiques.
■ Suite de la procédure
Les travaux de mise au point d’un système plus développé de paiements directs, fondé sur des objectifs et des principes de base définis, sont en cours. Les organisations concernées (groupe d’encadrement) tout comme les scientifiques (comité consultatif) sont intégrés au processus d’élaboration. Le projet bénéficie ainsi d’une large base de soutien. Le rapport devrait être adopté par le Conseil fédéral au cours du premier semestre 2009.
En fonction de l’accueil qui sera réservé au rapport par les commissions d’examen préalable et des développements au plan de la politique du commerce extérieur (OMC, accord de libre-échange agroalimentaire avec l’UE), le Conseil fédéral mettra un projet de modification de la LAgr en consultation, puis soumettra un message au Parlement.
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 208
2.3Amélioration des bases de production
Les mesures prises à ce titre encouragent et soutiennent les agriculteurs afin de permettre une production de denrées alimentaires efficiente et respectueuse de l’environnement, ainsi que l’accomplissement des multiples tâches qu’ils assument.
Aides financières destinées à l’amélioration des bases de production et aux mesures d’accompagnement social
1y compris l’assainissement des dommages dus aux intempéries de 2005
2y compris une contribution extraordinaire «vulgarisation», conséquence de l’entrée en vigueur de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches (RPT)
3y compris des crédits supplémentaires destinés à la lutte contre le feu bactérien 4reprise des contributions cantonales, suite à l’entrée en vigueur de la RPT
Ces mesures visent à atteindre les objectifs suivants: –renforcement de la compétitivité par l’abaissement des coûts de production; –promotion d’un développement durable dans le milieu rural; –structures d’exploitation modernes et surfaces agricoles utiles bien desservies; –production efficiente et respectueuse de l’environnement; –variétés à rendement élevé, aussi résistantes que possible, et produits de haute qualité;
–protection de la santé humaine et animale, ainsi que de l’environnement; –diversité génétique.

■■■■■■■■■■■■■■■■■
Mesure200620072008 5 en mio. de fr. Contributions pour améliorations structurelles107 1 92 1 90 1 Crédits d’investissements695451 Aides aux exploitations paysannes268 Aides à la reconversion professionnelle0,20,52 Vulgarisation et contributions à la recherche232427 2 Lutte contre les maladies et les organismes nuisibles des plantes213 3 9 3 Sélection végétale et élevage-sélection222338 4 Total225,2212,5225,0
OFAG
5budget Source:
209 2.3 AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2
■ Petites entreprises artisanales de la région de montagne logées à la même enseigne
2.3.1Améliorations structurelles et mesures d’accompagnement
Améliorations structurelles
Les améliorations structurelles contribuent à améliorer les conditions de vie et la situation économique du monde rural, notamment dans la région de montagne et dans les régions périphériques. La mise en œuvre des intérêts de la collectivité passe par la réalisation d’objectifs relevant de la protection de l’environnement, de la protection des animaux et de l’aménagement du territoire tels que la remise à l’état naturel de petits cours d’eau, la mise en réseau de biotopes ou la construction de systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux.
Les aides à l’investissement servent à financer les infrastructures agricoles et permettent ainsi d’adapter les exploitations à l’évolution des conditions-cadre. L’abaissement des coûts de production et la promotion de l’écologisation ont pour effet d’améliorer la compétitivité de l’agriculture acquise au principe de la production durable. Dans d’autres pays aussi, en particulier au sein de l’UE, ces aides constituent des mesures de promotion importantes du milieu rural.
Les aides à l’investissement sont accordées au titre d’aide à l’entraide pour des mesures aussi bien individuelles que collectives. Deux instruments sont disponibles: –les contributions à fonds perdu, exigeant la participation des cantons, avant tout pour des mesures collectives; –les crédits d’investissement octroyés sous la forme de prêts sans intérêts, principalement pour des mesures individuelles
Dans le cadre de PA 2011, le Parlement a décidé d’accorder des crédits d’investissements aux petites entreprises artisanales dans les régions de montagne pour leurs bâtiments et installations, pour autant qu’elles transforment et commercialisent des produits agricoles, augmentant ainsi leur valeur ajoutée. Avant l’investissement envisagé, le personnel de l’entreprise ne doit pas dépasser un taux d’emploi de 1000% et les entreprises doivent être autonomes. Leur activité comprend au moins le premier échelon de la transformation des matières premières agricoles. Grâce à l’élargissement de la promotion, les fromagers privés de la région de montagne sont mis sur un pied d’égalité avec les sociétés de fromagerie.

■■■■■■■■■■■■■■■■■
210 2.3AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2
■ Moyens financiers destinés aux contributions
En 2007, les montants versés pour des améliorations foncières, des constructions rurales et l’assainissement des dégâts causés par les intempéries de 2005 se sont élevés à 92,4 millions de francs. En outre, l’OFAG a approuvé de nouveaux projets qui ont bénéficié de contributions fédérales (85,6 millions de francs) et entraîné un volume d’investissements de 405 millions de francs. Le montant total de ces contributions fédérales ne correspond toutefois pas à celui budgétisé à la rubrique «Améliorations foncières et constructions rurales», car il est rare qu’une contribution annoncée soit versée la même année; les crédits sont par ailleurs souvent accordés par tranche.
Contributions de la Confédération approuvées en 2007
Remaniements parcellaires y compris infrastuctures
Constructions de chemins

Adductions d'eau
Dommages dus aux intempéries et autres mesures de génie civil
Bâtiments d'exploitation pour animaux cons. des four. grossiers
Tableaux 44–45, page A52
Autres constructions
en mio. de fr. Région de plaine Région des collines Région de montagne 051020152530 Source: OFAG 62% 11% 27% 211 2.3 AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2
rurales
Contributions fédérales versées pour des améliorations foncières et des constructions rurales entre 1998 et 2007
En 2007, les cantons ont accordé 1’861 crédits d’investissements portant sur un montant total de 275,5 millions de francs, dont 81,8 % concernaient des mesures individuelles et 18,2% des mesures collectives. Dans la région de montagne, des crédits de transition d’une durée maximale de trois ans, appelés «crédits de construction» peuvent en outre être consentis pour des projets à caractère communautaire.
Les crédits destinés aux mesures individuelles ont été alloués principalement au titre de l’aide initiale ainsi que pour la construction ou la transformation de maisons d’habitation et de bâtiments d’exploitation. Ils sont remboursés en moyenne dans un délai de 13,6 ans. Le volume des crédits octroyés dans 55 cas au titre de la «diversification» s’est élevé à 5 millions de francs.
Concernant les crédits alloués pour des mesures collectives, ils ont permis notamment de soutenir la réalisation d’améliorations foncières, l’acquisition communautaire de machines et de véhicules et des mesures de construction (bâtiments et équipements destinés à l’économie laitière ainsi qu’à la transformation, au stockage et à la commercialisation de produits agricoles).
En 2007, de nouveaux fonds fédéraux, d’un montant de 53,875 millions de francs, ont été mis à la disposition des cantons. Avec les remboursements courants, ils seront utilisés pour l’octroi de nouveaux crédits. Le fonds de roulement, alimenté depuis 1963, s’élève actuellement à 2,2 milliards de francs.
Crédits d’investissements en 2007 CasMontantPart Nombremio. de fr.% Mesures individuelles1 655224,081,8 Mesures collectives sans les crédits de construction15028,39,8 Crédits de construction5623,28,4 Total1 861275,5100 Source: OFAG
■ Moyens financiers destinés aux crédits d’investissements
1990/92199819992000200120022003200420062007 2005 en mio. de fr. Source: OFAG 0 20 40 60 80 100 120 140 1197575871029010294,5107,592,4 85
2.3AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2 212
Tableaux 46–47, pages A53–A54
Crédits d'investissement 2007 par catégorie de mesures, crédits de construction non compris
Aide initiale Achat de l'exploitation par le fermier
Mesures collectives 1
Diversification
Maison d'habitation

Bâtiments d'exploitation
en mio. de fr. Région de plaine Région des collines Région
1 Achat communautaire de cheptel, aide initiale pour les organisations d'entraide paysannes, transformation, stockage et commercialisation de produits agricoles.
Améliorations foncières Source: OFAG
de montagne 0 20406080100120
25% 47% 28% 213 2.3 AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2
■ Aide aux exploitations
Mesures d’accompagnement social
Allouée sous forme de prêts sans intérêts, l’aide aux exploitations sert à parer ou à remédier à une difficulté financière passagère dont la faute ne peut être imputée aux agriculteurs. De par ses effets, elle correspond à une mesure de désendettement indirecte.
En 2007, des prêts au titre d’aide aux exploitations ont été accordés dans 131 cas pour un montant total de 18,4 millions de francs. Le prêt moyen s’est élevé à 140’082 francs et sera remboursé dans un délai de 13,8 ans.
Prêts au titre de l’aide aux exploitations en 2007
Nombremio. de fr. Conversion de dettes8914,2 Difficultés financières extraordinaires à surmonter424,2
Total13118,4
Source: OFAG
En 2007, un montant supplémentaire de 5,637 millions de francs a été mis à la disposition des cantons. Son octroi était lié à une prestation équitable des canton, laquelle varie en fonction de leur capacité financière et représente entre 20 et 80% de l’aide fédérale. Ajoutés aux remboursements courants, les montants accordés par la Confédération et les cantons ont été utilisés pour l’octroi de nouveaux prêts. Le fonds de roulement, qui est alimenté depuis 1963 par des fonds fédéraux et des remboursements, s’élève à 216 millions de francs, parts cantonales comprises.
■ Aides à la reconversion professionnelle
Pour les personnes exerçant une activité indépendante dans l’agriculture, l’aide à la reconversion professionnelle facilite le passage à une activité non agricole. Comprenant des contributions aux coûts de la reconversion professionnelle et des contributions aux coûts de la vie, elle s’adresse aux chefs d’exploitation, hommes ou femmes, âgés de moins de 52 ans. L’octroi de cette aide implique bien entendu la cessation de l’activité agricole. En 2007, une aide de 75’000 francs a été garantie à un chef d’exploitation. Au total, sur la base des aides garanties les années précédentes, un montant de 402’800 francs a été versé à huit personnes en phase de reconversion professionnelle. Selon la formation, la reconversion dure un an, voire deux ou trois ans. L’éventail des programmes de formation destinés à la reconversion professionnelle est large et va des professions sociales (physiothérapeute, catéchiste ou infirmier) aux professions manuelles ou commerciales (charpentier, serrurier, cuisinier ou agent agro-commercial).
DispositionCasMontant
214 2.3AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2
■ Une enquête fournit des estimations plus précises
Irrigation en Suisse: état actuel et perspectives
On ne disposait pas jusqu’ici en Suisse de relevés systématiques de données couvrant l’ensemble du territoire en ce qui concerne les surfaces irriguées et les besoins en eau d’irrigation. C’est pour pallier cette lacune que la Division Améliorations structurelles (DAS) de l’OFAG a effectué auprès des services cantonaux chargés des améliorations structurelles, en 2006, une enquête sous forme de questionnaire sur les installations d’irrigation. Le questionnaire pouvait être rempli conjointement avec les services cantonaux responsables des eaux. Tous les cantons ont participé à l’enquête. La qualité des données fournies varie fortement d’un canton à l’autre. Les estimations détaillées sont cependant nettement plus fiables que les données dont disposait l’OFAG jusqu’à ce jour.
■ Cultures différentes, techniques d’irrigation différentes
Selon les indications des cantons, 38’000 ha sont irrigués régulièrement et 12’000 ha sont irrigués à l’occasion. Plusieurs cantons, parmi lesquels des cantons de grande superficie, n’ont pu fournir de données fiables. Dans ces cantons, on estime que 5000 ha supplémentaires au moins sont irrigués régulièrement. L’OFAG considère donc que –43’000 ha sont irrigués régulièrement, auxquels s’ajoutent 12’000 ha dans les années de sécheresse, et que –les besoins en eau s’élèvent à 144 millions de m3 pour une année de sécheresse.
Utilisation des surfaces: superficies les plus régulièrement irriguées
Surface totale irriguée: 43 000 ha
suppl. selon évaluation
3%
Par type de culture, 18’000 ha de prairies, 5’200 ha de vignes, 4’400 ha de cultures maraîchères, 2’300 ha de cultures fruitières, 1’200 ha de cultures de pommes de terre et 6’800 ha d’autres cultures sont régulièrement irrigués. Sont irrigués à l’occasion 5’100 ha de prairies, 2’400 ha de cultures maraîchères, 800 ha de cultures de pommes de terre, 150 ha de cultures fruitières, 70 ha de vignes et 3600 ha d’autres cultures. Différentes techniques d’irrigation sont utilisées. Les asperseurs, alimentés par des réseaux de conduites fixes, sont les plus répandus. Les systèmes d’irrigation goutte à goutte ou de micro-irrigation sont encore peu nombreux, couvrant une surface qui ne dépasse pas 1’650 ha. Les installations subventionnées couvrent 17’200 ha, soit à peine la moitié des surfaces régulièrement irriguées, selon les estimations des cantons.
Surface
OFAG 12% Fruits 5%
Prairie 42% Pommes de terre
Source: OFAG
Autres 16%
Vigne 12% 2. MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE 215 2.3 AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2
Légumes 10%
Part de surface à la superficie totale irriguée, par type d'installation
Surface totale irrriguée: 55 000 ha
Indéterminé 35%
Micro-irrigation et d'irrigation goutte à goutte 3%
Irrigation traditionnelle de surface 9%
Réseaux de conduites fixes avec asperseurs 44%
Asperseurs automatiques 8%
Irrigation par rigoles d'infiltration 1%
Source: OFAG
Part de surface à la superficie totale irriguée, selon le type d'approvisionnement en eau
Surface totale irriguée: 55 000 ha
En plus, évaluation OFAG 25%
Eau tirée des bisses 37% des canaux, des ruisseaux 8%
de l'alimentation en eau potable 3% des rivières 4% de la nappe phréatiques 16% des lacs 7%
Source: OFAG
Deux tiers de l’eau nécessitée pour l’irrigation sont acheminés par des bisses dans la zone d’irrigation. Ce moyen d’approvisionnement traditionnel prédomine surtout en Valais. Un tel système d’irrigation implique des pertes d’eau importantes et une grande charge de travail. Ces inconvénients sont cependant largement compensés par les avantages que représentent les bisses aux points de vue écologique, paysager, historique et culturel. Quelque 5% de l’eau nécessitée sont prélevés dans les canaux, les ruisseaux, les rivières et la nappe phréatique. Quant à la quantité prélevée dans les lacs et le réseau d’eau potable (1%), celle-ci reste limitée.

216 2.3AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2
■ Besoins modestes en eau de l’agriculture suisse
Il ne ressort pas de l’enquête effectuée que l’agriculture aurait eu tendance, ces dernières années, à recourir davantage à l’irrigation. Les valeurs plus élevées enregistrées reposent pour l’essentiel sur des estimations plus précises des cantons.
L’agriculture suisse n’est pas une gaspilleuse d’eau: pour l’irrigation de ses terres, il lui faut 12% de la totalité des besoins en eaux de la Suisse. Dans l’Union européenne, ces besoins s’élèvent à 33% et au plan mondial à 70%. Vu les demandes auxquelles on doit s’attendre, l’OFAG estime qu’au cours des prochaines années, les besoins en eau de l’agriculture passeront de 144 à 170 millions de m3 par an.
Par rapport à l’écoulement fluvial moyen annuel de la Suisse, évalué à environ 53’000 millions de m3, les besoins en matière d’irrigation représentent seulement 0,3% de ce volume. Comparativement au bilan global, ce pourcentage est négligeable. Toutefois, les besoins en eau augmenteront également dans notre pays en raison des changements climatiques. Sur le plan régional, il pourrait néanmoins se produire ponctuellement des situations de concurrence avec d’autres formes d’utilisation, comme le montre le Rapport OcCC (Organe consultatif sur les changements climatiques) «Les changements climatiques et la Suisse en 2050». Le bilan global qui n’a apparemment rien d’inquiétant ne doit pas occulter le fait qu’il convient de tenir compte, aussi bien au plan des exploitations qu’au plan régional, des répercussions économiques et écologiques de l’irrigation, lesquelles joueront à l’avenir un rôle toujours plus important.
■ Agir avant qu’il ne soit trop tard
L’enquête a révélé que les connaissances sur l’état actuel de l’irrigation agricole étaient hétérogènes et lacunaires. A l’heure actuelle, les lacunes constatées n’ont guère d’effets négatifs. L’été caniculaire 2003 a toutefois montré qu’il est nécessaire de mieux connaître la manière dont l’irrigation est pratiquée dans notre pays. Cela sera un avantage lorsque, dans des situations de concurrence, on sera à même de pondérer les différents intérêts, afin de développer des systèmes d’irrigation optimisés aux plans économique et écologique ou lorsque de nouvelles dispositions légales seront élaborées dans le domaine de la gestion des eaux.
A l’avenir, l’OFAG examinera les demandes concernant le soutien d’installations d’irrigation avec retenue et selon des critères stricts. Outre les besoins en matière d’irrigation justifiés par les changements climatiques, il s’agira de prouver l’utilité de l’irrigation (aspects agronomiques et pédologiques) ainsi que sa faisabilité (aspects écologiques et techniques).
Ce qui rend difficile un aperçu fiable de la situation, c’est le fait qu’il n’y a pas de coordination entre les services cantonaux de l’agriculture et les services compétents pour le prélèvement d’eau. Des mesures doivent donc être prises dans ce domaine. Il en va de même pour l’harmonisation de la surveillance du prélèvement d’eau, l’enregistrement des quantités prélevées et l’harmonisation des tarifs. Sur la base de l’expérience des cantons qui s’occupent aujourd’hui déjà de projets d’irrigation, les différents aspects touchant l’irrigation devraient être davantage intégrés dans la formation des ingénieurs agronomes et des agriculteurs.
217 2. MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE 2.3 AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2
■
L’eau à la base de la vie
Constructions rurales au bénéfice d’une meilleure qualité des eaux
L’eau est le composant principal de chaque cellule vivante. Elle est indispensable à toute forme de vie. Rien ne peut remplacer l’eau. La pureté de l’eau ne va pas de soi. Des substances nuisibles peuvent être lessivées dans les eaux superficielles et souterraines et polluer ces dernières pour des années, voire des décennies. Depuis 1999, la Confédération soutient des projets dans le cadre de l’article 62a de la loi sur la protection des eaux (LEaux). Ces projets visent à empêcher le ruissellement et le lessivage de substances pour satisfaire aux exigences posées à la qualité des eaux superficielles et souterraines. On peut notamment citer les substances telles que nitrates, phosphates et résidus de produits phytosanitaires.
■ Mesures agricoles soutenues par la Confédération
L’initiative d’un projet est laissée aux acteurs du terrain qui peuvent bénéficier de conseils et d’outils de l’OFAG pour l’établissement d’un dossier de candidature. Le dossier de demande est mis à consultation auprès de l’Office fédéral de l’environnement. Ce dernier juge si les mesures prévues garantissent une protection des eaux adéquate. Le soutien de la Confédération vise les mesures prisent par l’agriculture et qui ne sont pas supportables du point de vue économique pour cette dernière. Le montant des indemnités est fixé en fonction des propriétés et de la quantité des substances dont le ruissellement et le lessivage sont empêchés. Pour les mesures qui entraînent des modifications des structures d’exploitation, le montant des indemnités peut atteindre au plus 80% des coûts imputables. Les 20% restants doivent être couverts entre les fonds propres de l’exploitant et les contributions de tiers privés ou publics.
Répartition géographique des projets soutenus selon l’art. 62a LEaux
Projets Nitrates (N)
Projets N avec mesures structurelles
Projets Phosphores
Projets Produits phytosanitaires
Source: OFAG
218 2.3AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2
■ L’exemple de la lutte contre le lessivage des nitrates
Actuellement, on peut compter sur l’ensemble du territoire suisse vingt projets en cours s’attaquant à la problématique de la charge en nitrates des eaux souterraines, trois projets phosphates et deux projets phytosanitaires. Dans le cadre de la lutte contre les nitrates, on relève que sept projets sont en cours d’élaboration.
Le mode d’exploitation des agriculteurs est déterminant dans la lutte contre le lessivage des nitrates. Une meilleure couverture des sols diminue la probabilité que l’eau d’infiltration entraîne des nitrates dans les eaux souterraines. Les mesures telles que la réduction des terres assolées ouvertes au bénéfice des herbages, le renoncement de certaines cultures dans les régions sensibles (p.ex. pommes de terres, tabac, maïs et légumes), la réduction du travail du sol (p.ex. pratiquer le semis direct au lieu de labourer), voire la conversion à l’agriculture biologique peuvent contribuer substantiellement à la résolution du problème.
Les exploitations qui participent à de tels projets doivent parfois opter pour un changement radical des branches de production pour atteindre les objectifs de qualité des eaux superficielles et souterraines. En matière de lutte contre les nitrates, la mesure des plus efficaces consiste en la réduction des terres assolées au bénéfice de cultures herbagères permanentes. En principe, si la part des prairies permanentes se situe entre un tiers à deux tiers des surfaces situées dans les régions sensibles au lessivage, les objectifs de qualité des eaux devraient être atteints.
■ La ville de Morges soucieuse de la qualité de son eau potable
A titre d’exemple, on peut citer un projet visant à diminuer la charge en nitrates des eaux souterraines dans le canton de Vaud. La source du «Puits du Morand» située sur la commune de Montricher, est la propriété de la ville de Morges, citée de plus de 14’000 habitants. Une distance de plus de 14 kilomètres à vol d’oiseau sépare les deux communes. Depuis le début des années 1960, les teneurs en nitrates du puits précité n’ont cessé d’augmenter pour atteindre des valeurs dépassant le seuil de tolérance en 1993. La ville de Morges a entrepris différentes démarches, dont en premier temps, une quinzaine d’hectares de prairies a été installée à proximité du puits. Afin de renforcer les mesures, un projet «nitrates» a été lancé en 2000. Ces mesures ont conduit à une augmentation significative des prairies (+60 ha), notamment sur les terrains les plus sensibles de l’aire d’alimentation d’où provient 90% de l’eau captée. Cela a permis de maintenir les concentrations moyennes en nitrates à un niveau proche, voire inférieur à l’objectif de qualité qui se situe à 25 milligrammes par litre, et d’atténuer les pics de concentration.
2. MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE 219 2.3 AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2
Zone d’alimentation (Zu)

Zone de protection S1

Zone de protection S2

Zone de protection S3
Puits du Morand
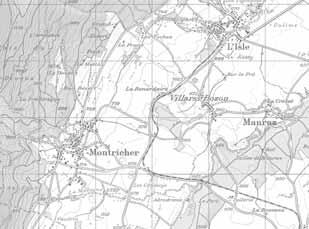
Exploitation
Surfaces de l’exploitation
Source: OFAG
Plus de 15 agriculteurs de la commune de Montricher sont diversement touchés par le projet «nitrates» suivant la situation du parcellaire des exploitations. Le Service d’agriculture du canton de Vaud, lors de la première phase du projet (2001–2007), a proposé l’aménagement de prairies permanentes et la mise en place de rotations vertes (sur 6 ans, au moins 4 à 5 ans de prairies) comme mesures de lutte contre le lessivage des nitrates. Dans la deuxième phase du projet (2007–2013), le labour des prairies permanentes et des prairies temporaires dans la rotation verte n’a plus été autorisé. Un agriculteur se situant dans l’aire d’alimentation Zu du «Puits du Morand», essentiellement en zone sensible, a fait le choix de renoncer aux grandes cultures et consacrer essentiellement son exploitation à la garde d’animaux consommant du fourrage grossier. Mais qui dit accroissement des herbages sur l’exploitation, dit aussi augmentation de la production de fourrage. Cette masse fourragère doit être mise en valeur. En général, l’exploitation agricole confrontée à ce problème décide d’investir dans l’agrandissement, respectivement la transformation des ruraux existants pour détenir un cheptel d’animaux en relation avec la nouvelle base fourragère. De tels investissements peuvent bénéficier d’un soutien par le biais de l’art. 62a.
Pour bénéficier d’une aide aux améliorations structurelles, l’agriculteur s’est engagé à exploiter les surfaces déterminantes du projet en herbage (16,6 ha), et cela pour les 18 prochaines années. Une mention au registre foncier sur les parcelles converties garantit l’exploitation en herbage des surfaces.


■ Une exploitation réoriente ses branches de production
Bassin d’alimentation du «Puits du Morand»
220 2.3AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2
Le projet se devait pour des raisons économiques et de mise en valeur du patrimoine bâti, transformer une partie de l’étable existante à stabulation entravée et de créer les nouveaux volumes nécessaires à la détention de vaches allaitantes de la race d’Hérens, dont la viande est vendue sous l’égide d’un label régional. L’étable s’est orientée vers une solution économique de détention des animaux en stabulation libre sur aire paillée. Les nouveaux volumes permettent la détention de 40 unités de gros bétail consommant des fourrages grossiers (UGBFG). Les travaux de construction ont été menés à bien pendant l’année 2006.
Les coûts de construction se sont élevés à 676’000 francs. La participation de la Confédération par le biais de l’art. 62a LEaux représente une prise en compte de 1,95 UGBFG par hectare, multipliées par un montant forfaitaire de 9’375 francs par UGBFG de coûts imputables (cas d’un rural complet). Une réduction de 10% du forfait a été opérée pour tenir compte de la réutilisation d’une partie de la surface bâtie. La Confédération a pris en charge 80% de ce montant, soit une contribution à fonds perdu de 218’000 francs. Comme l’exploitation se situe en zone des collines, le Service cantonal des améliorations foncières, actuellement Service du développement territorial, a soutenu le projet par une contribution conformément aux dispositions de l’ordonnance sur les améliorations structurelles (OAS) pour un montant de 75’300 francs. La ville de Morges a également soutenu le projet pour un montant de 27’300 francs. Un crédit d’investissement sans intérêts et remboursable de 198’000 francs selon l’OAS a financé en partie le solde des frais n’étant pas couverts par des contributions. A titre de comparaison, un soutien de la Confédération au moyen d’une contribution selon l’OAS se serait monté à environ 87’000 francs.

221 2.3 AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2
■ Une construction destinée à la détention de vaches allaitantes de la race d’Hérens
C’est une réalisation au cœur d’un projet au service de la qualité des eaux potables d’une ville de grande importance, garantissant le bien être des animaux et au bénéfice des saveurs régionales.
Le projet «nitrates» continue son chemin sur une zone d’étude de 403 ha de surface agricole utile, en ayant pour objectif de diminuer encore plus fortement les pics de concentration des nitrates dans les eaux du «Puits du Morand» et cela jusqu’en 2013.
222 2.3AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2
2.3.2 Système de connaissances agricoles
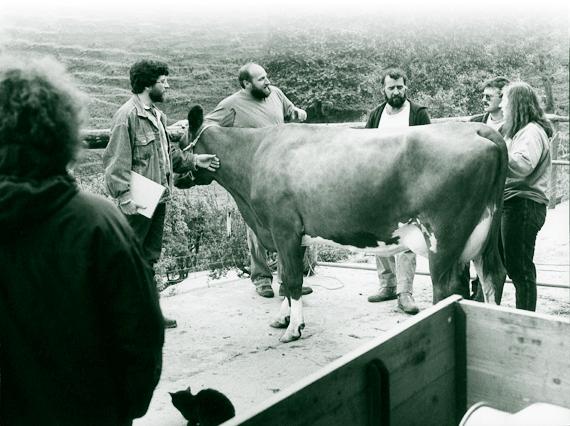
Le système de connaissances agricoles regroupe toutes les connaissances et expériences acquises pour constituer un savoir sur la production agricole, son interaction avec l’environnement biologique et économique et avec l’utilisation ultérieure des produits, savoir qui englobe aussi certains aspects de l’alimentation humaine.
Les principaux acteurs de ce système sont les producteurs agricoles (agriculteurs) et les entreprises de transformation. Ils agissent sur la base des connaissances et des expériences acquises. Ils sont par conséquent tributaires dans une large mesure d’une formation solide et d’une vulgarisation adéquate. Un outillage, des machines ainsi que des méthodes et procédés à la pointe de la technique accroissent aussi leurs performances. La formation, la vulgarisation, de même que la technique et les méthodes, sont sans cesse améliorées par la recherche privée et publique. Ces avancées et l’expérience pratique constituent la base permettant à la production agricole de répondre de façon appropriée aux nouveaux défis et d’évoluer positivement.
La recherche, la formation et la vulgarisation jouent ainsi un rôle clé en complément de l’expérience pratique. Il faut toutefois que ces quatre unités de système soient interconnectées et interagissent largement.
■■■■■■■■■■■■■■■■■
223 2.3 AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2
■ Mandat de prestations d’Agroscope de 2008 à 2011
Recherche
Les trois stations de recherches d’Agroscope, c’est-à-dire Changins-Wädenswil ACW, Liebefeld-Posieux ALP et Reckenholz-Tänikon ART, ainsi que le Haras national d’Avenches, sont gérés depuis huit ans par mandat de prestations et enveloppe budgétaire (GMEB). Le Conseil fédéral leur a attribué les nouveaux mandats de prestations pour la prochaine période de quatre ans (2008 à 2011).
Pour la prochaine période du mandat de prestations, Agroscope devra atteindre les buts stratégiques énoncés ci-après.
Agroscope
–œuvre en faveur d’un secteur agroalimentaire économiquement performant; –traite les problématiques écologiques et éthologiques du secteur agricole; –contribue à une évolution socialement supportable de l’espace rural et notamment du secteur agricole; –fournit les connaissances nécessaires pour relever les défis à venir et évalue notamment les chances et les risques liés aux nouvelles technologies, tels les OGM; –fait de la recherche axée sur les problèmes et les systèmes. En effet, une approche systémique et transdisciplinaire est souvent nécessaire pour résoudre efficacement les problèmes qui se posent; –communique les résultats de la recherche conformément aux besoins des clients.
■ Plus que trois groupes de produits
Le mandat de prestations d’Agroscope comprend désormais trois et non plus quatre groupes de produits. Ce changement est étroitement lié au regroupement de la recherche en trois unités comprenant chacune deux stations, intervenu le 1er janvier 2006. De plus, ALP et le Haras national sont maintenant regroupés depuis 2008.
– Groupe de produits 1: Production végétale et produits végétaux.
Le groupe de produits 1 relève de la station de recherche ACW, qui traite les domaines suivants: grandes cultures, systèmes de pacage et cultures spéciales. Elle fournit les bases scientifiques et techniques permettant de garantir l’approvisionnement en denrées alimentaires et en aliments pour animaux sûrs et de haute qualité et d’améliorer la compétitivité par des mesures d’optimisation des coûts de production. Font également partie de ces mesures les activités qui contribuent à augmenter la compatibilité avec l’environnement, la qualité, la sécurité et le potentiel de commercialisation des produits.
– Groupe de produits 2: Production animale et denrées alimentaires d’origine animale.
Le groupe de produits 2 relève de la station de recherche ALP. Il englobe toutes les activités visant à promouvoir une production durable et concurrentielle de lait, viande et miel, ainsi que leur transformation en denrées alimentaires saines, sûres et de qualité élevée. ALP développe à cet effet des connaissances scientifiques, des aides à la décision et à l’élaboration des mesures d’exécution par une recherche et une vulgarisation bien coordonnées tout au long de la chaîne alimentaire, qui va de l’aliment pour animaux à la transformation en denrée alimentaire, en passant par la production.
224 2.3AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2
Groupe de produits 3: Agroécologie et agriculture biologique, économie et technique rurales.

Le groupe de produits 3 relève de la station de recherche ART; il comprend l’écologisation de la production dans le domaine des grandes cultures et de la culture fourragère, la préservation et la promotion de la biodiversité ainsi que la réduction du flux des substances nocives entre la zone agricole et le reste de l’environnement. Il englobe en outre toutes les activités permettant d’élaborer une base agroéconomique et agrotechnologique destinée aussi bien à la politique agricole qu’aux praticiens de l’agriculture.
Les modèles d’évaluation des effets utilisés dans ce domaine présentent comme suit l’impact (réaction des groupes-cibles aux prestations) et l’outcome (incidence de l’output).
Impact:
–La pratique ainsi que les secteurs situés en amont et en aval mettent à profit les nouvelles connaissances.
–La vulgarisation et la formation utilisent les connaissances d’Agroscope et diffusent les connaissances actuelles.
–Les politiciens, les autorités et les organisations non gouvernementales utilisent les connaissances d’Agroscope pour prendre des décisions.
–Les médias répercutent les travaux d’Agroscope.
–Des expertises, contrôles, certificats, etc., sont sollicités.
Outcome:
–La population perçoit positivement les prestations écologiques et d’aménagement du paysage fournies par l’agriculture.
–La population a confiance dans les produits suisses et son alimentation est conforme à ses besoins, saine et durable.
–Les denrées alimentaires suisses gardent leur part de marché.
–L’agriculture suisse est viable à long terme; elle contribue à l’occupation décentralisée du territoire et à l’aménagement d’un espace rural attractif.
Agroscope met sur pied des programmes de recherche ciblés portant sur des problématiques essentielles de l’agriculture. Il s’agit d’activités de recherche coordonnées, déployées par les trois stations de recherche d’Agroscope collaborant, le cas échéant, avec d’autres instituts de recherche.
Plusieurs éléments caractérisent ces programmes de recherche: une durée limitée assortie d’objectifs clairement définis, une orientation interdisciplinaire, ainsi qu’une collaboration avec des parties prenantes qui utilisent directement les résultats de la recherche. L’échange de connaissances et de savoir-faire est un élément essentiel des programmes de recherche d’Agroscope.
–
225 2. MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE 2.3 AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2
■ Programmes de recherche Agroscope
Trois programmes sont prévus pour la période du mandat de prestations 2008–2011:
ProfiCrops –De nouvelles pistes pour une production végétale indigène porteuse d’avenir dans un marché libéralisé. ProfiCrops s’est fixé pour objectif d’assurer un avenir à la production végétale suisse dans un marché largement libéralisé et de renforcer la confiance des consommateurs dans les produits indigènes.
NutriScope – Des denrées alimentaires d’origine suisse, saines, sûres, et de haute qualité. NutriScope s’est fixé pour objectif d’optimiser les paramètres déterminants pour la qualité, la sécurité et la santé tout au long de la chaîne alimentaire, allant de la mise en culture jusqu’au produit prêt à la consommation. Il entend apporter une contributionessentielle à une alimentation saine, donc à la bonne santé de la population.
AgriMontana – Contributions de l’agriculture au développement durable de la région de montagne. L’objectif d’AgriMontana est d’analyser les incidences économiques, sociales et écologiques des différents systèmes d’exploitation en région de montagne (recherche des meilleures pratiques). Le programme contribue à la mise en place d’une politique régionale et sectorielle coordonnée (best policies = les meilleures stratégies), en servant de référence aux milieux politiques.

Au printemps 2008, des variétés de blé génétiquement modifiés ont été semées sur la parcelle expérimentale d’ART. Il s’agit des plus grands essais en plein air menés jusqu’ici en Suisse avec des plantes génétiquement modifiées. A Reckenholz, sur une surface d’environ un demi-hectare, 6 variétés de blé génétiquement modifié sont testées et comparées avec d’autres variétés. Suite à des recours déposés devant le Tribunal administratif fédéral, l’essai 2008 sur la parcelle expérimentale de Pully n’a pas pu être réalisé.
Le Conseil fédéral a lancé le Programme national de recherche 59 (PNR 59), qui doit analyser l’utilité et les risques de la dissémination de plantes génétiquement modifiées. Les essais en plein champ, avec du blé génétiquement modifié, font partie du PNR 59. L’université de Zurich (direction du programme), l’EPF de Zurich, ART, ACW, ainsi que les universités de Bâle, Berne, Neuchâtel et Lausanne, soit au total 11 groupes de recherche, se sont associées au consortium du blé pour participer au PNR 59.
226 2.3AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2
■ Un rôle actif dans la recherche sur la sécurité biologique
■
Objectifs des essais de plein champ
Les essais en plein champ du consortium étudient les effets du blé génétiquement modifié sur l’environnement. C’est ce que l’on appelle la recherche sur la biosécurité. En laboratoire et sous serre, les plantes ont présenté une résistance accrue contre l’oïdium. Deux projets portent sur la résistance des plantes, alors que six autres sont consacrés aux risques écologiques. Il s’agit notamment de savoir:
–comment la résistance à l’oïdium se manifeste en plein champ et quelles sont la spécificité et l’efficacité de la résistance du blé GM à l’oïdium (Université et EPF de Zurich);
–si le blé GM a une influence sur les organismes vivants du sol, p.ex. champignons, bactéries, insectes (Université de Berne);
–si et, le cas échéant, dans quelle mesure, le blé GM peut se croiser avec des plantes sauvages (Université de Neuchâtel);
–si et, le cas échéant, comment réagissent en tant qu’organismes non-cibles divers insectes,tels les pucerons, les criocères des céréales et les parasitoïdes du puceron, qui peuvent entrer en contact avec le blé génétiquement modifié (ART);
–si le blé GM est plus compétitif que le blé non génétiquement modifié (Université de Zurich);
–si le blé GM peut se croiser avec du blé des surfaces voisines (ART).
En outre, on entend analyser si les plantes de blé GM possèdent vraiment les propriétés pour lesquelles elles ont été sélectionnées ainsi que l’effet de la modification génétique sur les propriétés de la plante telles que le rendement ou la qualité panifiable. On a ensuite prévu de comparer les résultats obtenus avec les propriétés des variétés initiales ainsi qu’avec celles d’autres nouvelles obtentions.
De par leurs connaissances spécifiques sur la sécurité biologique dans le domaine de l’agriculture, Agroscope ACW et ART sont prédestinés à participer activement au consortium du blé. Les hautes mesures de sécurité exigées par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) doivent être respectées. Agroscope dispose de solides connaissances dans le domaine de la mise en culture et du suivi des essais en plein champ. Les deux sites se trouvent en milieu urbain, près des universités en question.
Malheureusement, une action de destruction par des activistes masqués a sérieusement endommagé le champ d’essai. Les études portant sur la sécurité biologique des plantes génétiquement modifiées sont notamment concernées par les dégradations.
La recherche ne fournira pas de réponse directe à la question de savoir s’il s’agit ou non de cultiver, dans notre pays, à des fins commerciales, des plantes GM. Mais, dans le processus de décision politique, elle contribuera à rendre le débat plus objectif grâce aux bases scientifiques qu’elle sera en mesure de livrer.
227 2. MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE 2.3 AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2
■ Recherche en arboriculture – Feu bactérien
Le feu bactérien a connu une forte extension en 2007 (cf. chapitre 2.3.3). La motion déposée le 21 juin 2007 par le conseiller national Walter Müller demande au Conseil fédéral d’étoffer la recherche fondamentale en matière d’arboriculture fruitière –surtout en ce qui concerne le feu bactérien – afin d’assurer la pérennité de l’arboriculture fruitière professionnelle.
Vu l’urgence de trouver une solution au problème du feu bactérien et l’importance économique de l’arboriculture, le Conseil fédéral estime justifié de prévoir plus de moyens (0,5 million par an) destinés aux crédits de recherche correspondants, pour une période limitée de quatre ans (2008–2011) et de les employer de manière ciblée pour des projets dans le domaine de la recherche en culture fruitière. Les moyens financiers libérés n’auront pas d’incidence sur le budget, grâce à une redistribution des crédits alloués dans le cadre de l’enveloppe budgétaire.

Le centre de compétence Feu bactérien de ACW peut accélérer et étendre la mise en œuvre de projets de recherche, notamment dans les domaines suivants:
–monitoring de la résistance et évaluation des aspects écotoxicologiques dans le cas d’une autorisation de la streptomycine;
–développement de stratégies de lutte alternatives destinées à la culture bio et PI, (études des antagonistes, stratégies de cultures de hautes tiges et de cultures bassetige, renforcement de la bactériologie en culture fruitière);
–validation et mise en œuvre de nouvelles méthodes de diagnostic; –sélection de pommiers et de poiriers résistants au feu bactérien, en collaboration avec l’EPF et des entreprises privées.
L’Institut de recherche de l’agriculture biologique (IRAB) possède les capacités pour effectuer des recherches sur les aspects spécifiques à la culture bio en matière de lutte contre le feu bactérien, p.ex. optimisation de l’action des produits phytosanitaires compatibles avec la culture bio).
L’OFAG a mis en place une cellule d’accompagnement (BegObst ou AccFruits) en matière de recherche dans le domaine du feu bactérien et de l’arboriculture fruitière. Les producteurs et les milieux écologiques attentent que l’on fasse de la recherche axée sur la pratique. Pour pouvoir répondre au mieux à ces attentes et relativiser les choses, là où c’est nécessaire, il y a lieu de prévoir une marche à suivre coordonnée, une culture du débat, un échange actif des connaissances et un projet de communication.
228 2.3AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2
■ Rôle du cheval et formation des utilisateurs de chevaux en Suisse –chiffres actuels
Haras national suisse
Conformément à son mandat de prestations, le Haras national suisse soutient une détention et un élevage de chevaux respectueux des animaux, durables, compétitifs, et qui répondent aussi aux objectifs de la politique agricole. Dans ce contexte, le transfert du savoir occupe un rôle central en plus de la détention des étalons FranchesMontagnes et de la recherche appliquée. En effet, des études en sciences équines, initiées en septembre 2007 en collaboration avec la clinique équine de l’Université de Berne et la Haute école suisse d’agronomie de Zollikofen complètent notre offre de formations qui propose par ailleurs un bureau de conseils, un centre de documentation et, depuis 4 ans, le cours très prisé «Equigarde®», d’une durée d’un an, destiné aux détenteurs de chevaux.
L’idée préconçue très répandue selon laquelle les détenteurs de chevaux appartiendraient aux milieux aisés, conduisant leurs chevaux le week-end au concours de saut dans un véhicule de luxe, est dépassée. Autrefois animal de travail ou servant dans l’armée, le cheval est aujourd’hui un partenaire pour le loisir, même dans les cercles moins favorisés de la population, et il a conquis la gent féminine. Le contingent équin en Suisse a augmenté ces 20 dernières années de 53,1% pour atteindre 85’000 bêtes. 85% d’entre-elles sont détenues au sein d’exploitations agricoles; environ 10% des surfaces agricoles utiles en Suisse leur sont réservées. La détention de chevaux concerne ainsi largement les politiques de développements régionales et rurales et contribue à l’amélioration de la qualité de vie des campagnes. Partant de l’hypothèse d’une augmentation de 2’000 équidés par an, on estime que le nombre de 100’000 animaux sera atteint d’ici à l’an 2010.
Depuis la disparition graduelle des troupes montées, parallèlement à l’abolition de la formation équine agricole, la transmission des connaissances sur la détention et les soins aux chevaux perd de son efficacité. Seuls 24% des détenteurs de chevaux disposent d’une formation adéquate et un tiers d’entre eux de connaissances spécifiques concernant la détention des chevaux. Une telle éducation n’est pour l’instant exigée que pour les métiers d’écuyer-palefrenier, de jockey de course, de vétérinaire et de maréchal-ferrant. Jusqu’à l’introduction de la formation Equigarde® par le Haras national, les détenteurs de chevaux ne disposaient d’aucune offre leur proposant des cours complets et spécifiques sur l’élevage et les soins à donner aux chevaux. Tous les secteurs touchés sont unanimes: une amélioration durable de la condition des chevaux en Suisse n’est réalisable qu’au moyen d’ un renforcement de la formation. Celle-ci a encore gagné en importance depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance pour la protection des animaux.
2. MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE 229 2.3 AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2
Les trois partenaires suivants: la Haute école suisse d’agronomie (HESA) à Zollikofen, le Haras national et la clinique équine de la faculté vetsuisse de l’Université de Berne ont réagi à cette situation en créant un bachelor en agronomie, suivi d’un approfondissement (major) en sciences équines. Ces études sont organisées par la HESA et les enseignements sont donnés au sein des trois institutions. La concentration des compétences et des infrastructures de ces instituts dans les régions Berne/ Suisse-occidentale est évidemment profitable aux étudiants.
Après une courte annonce préliminaire, la première volée a pu commencer en septembre 2007 déjà. Après un tronc commun à la grande majorité des étudiants de l’HESA de deux semestres, les études d’agronomie avec approfondissement en sciences équines commencent et durent encore 4 semestres. L’offre comprend plus d’une douzaine de modules obligatoires et facultatifs, couvrant tous les champs thématiques: histoire de la garde du cheval, physiologie et anatomie, races, nutrition, aspects médicaux, reproduction, éthologie, sport et entraînement, etc. D’autres modules proposent des sujets de base, souvent en rapport avec des fonctions administratives comme la gestion, le droit, le marketing, la communication, l’éthique, etc. L’objectif de ces études est de laisser suffisamment de place à la pratique et en aucun cas de former de purs théoriciens. C’est pourquoi les étudiants doivent avoir effectué au préalable un stage agricole d’un an en lien avec les chevaux.

Les possibilités d’engagement des futurs diplômés sont larges, comme par exemple dans les domaines administratifs, de conseil, de communication ou en tant que spécialistes dans la recherche.
Grâce à cette innovation, le Haras national contribue de façon notable à l’amélioration du transfert de savoir professionnel dans les domaines encore à peine exploités de l’élevage, de la détention et de la gestion des chevaux.
230 2.3AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2
■ Introduction des études de sciences équines
■ Coup de frein à la réduction de la vulgarisation cantonale
Vulgarisation
Comme le prévoit l’art. 136 LAgr, remanié début 2008, la vulgarisation assiste toutes les personnes en formation continue professionnelle qui sont actives dans les secteurs de l’agriculture et de l’économie familiale rurale, au sein d’une organisation agricole, dans le cadre du développement du milieu rural ou dans celui de la garantie et de la promotion de la qualité des produits agricoles. Cet article concrétise simultanément les dispositions liées à la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). Aux termes de cette réforme, la vulgarisation à l’échelon cantonal incombe aux seuls cantons, tandis que la Confédération apporte comme auparavant un soutien aux centrales de vulgarisation d’AGRIDEA et à quelques services de vulgarisation particuliers d’organisations agricoles. Les derniers versements de la Confédération aux services cantonaux de vulgarisation ont été effectués au cours de l’année 2008.
Dépenses de
la Confédération pour la vulgarisation en 2007
DestinatairesMontant mio. de fr. Services cantonaux de vulgarisation agricole8,6 Services cantonaux de vulgarisation en économie familiale rurale0,6 Services spéciaux de vulgarisation d’organisations agricoles0,8 AGRIDEA (centrales de vulgarisation de Lausanne et de Lindau)8,0
Total18,0
Source: Compte d’Etat
Fin 2007, la confédération a accordé des aides financières à 473 personnes (personnel de vulgarisation auxiliaire non compris) travaillant dans les services cantonaux de vulgarisation agricole. Cela correspond à 224 postes à plein temps. S’y ajoute quelque 18 postes dans le domaine de la vulgarisation en économie familiale rurale. AGRIDEA emploie 140 collaborateurs dans ses centrales de vulgarisation, ce qui équivaut à 108 postes à plein temps.
Plus aucun poste n’a donc été supprimé dans le secteur de la vulgarisation cantonale depuis 2005. Près de 8% d’emplois ont été néanmoins supprimés depuis 1998.
Développement de la vulgarisation cantonale
Destinataires1998200320052007 postes à plein temps subventionnés
Services de vulgarisation agricole243237222224
Services de vulgarisation en économie pas de familiale rurale
données241918
Total261241242
Source: OFAG
2. MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE 231 2.3 AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2
■ 50 ans de vulgarisation en Suisse

La vulgarisation est axée sur les paysans, leur famille et leur contexte de vie, l’exploitation agricole et sa gestion, la région, les infrastructures et activités communautaires en faveur de l’économie alpestre ainsi que la commercialisation des produits agricoles. Depuis 1958, la vulgarisation est l’un des instruments de la politique agricole fondé sur la loi sur l’agriculture qui sert à accompagner les processus d’adaptation de la filière agricole. La vulgarisation complète la formation agricole de base et concrétise les activités menées par les instituts de recherche agronomique et les hautes écoles.
La crise économique mondiale, la Seconde Guerre mondiale et le recrutement obligatoire, le plan Wahlen d’autonomie alimentaire, la pression concurrentielle exercée par la reprise de l’économie mondiale, le soutien des prix et la protection douanière essuient indistinctement le feu des critiques de consommateurs à la mémoire courte. Ces circonstances qui ont menacé l’existence de nombreuses familles paysannes au milieu du 20e siècle ont incité des personnalités de Suisse alémanique et de Suisse romande à s’engager en faveur du développement de la vulgarisation agricole. La Confédération et les cantons ont alors également pris des initiatives, avec l’élaboration de la loi fédérale sur l’amélioration de l’agriculture et le maintien de la population paysanne (1951), de l’ordonnance sur la formation professionnelle et la recherche agricoles (1955), du cadastre de la production animale (années 50) et de l’ordonnance sur l’élevage (1958). Les agriculteurs durent participer à des groupes de vulgarisation pour avoir droit aux contributions à l’exploitation et à l’élimination du bétail. Les incitations financières mises en place par la nouvelle législation rendirent les activités de vulgarisation attrayantes, aussi bien pour les familles de paysans que pour les organisations paysannes et les cantons. La création de services cantonaux de vulgarisation a rapidement suivi. La mise en place d’un organe fédéral centralisé a même été envisagée. La solution de l’association a été finalement choisie parce qu’on en attendait plus de proximité avec la pratique que dans le cas, également envisagé, d’un rattachement à un institut de recherche ou à l’EPF. En 1958 fut fondée l’Association suisse pour l’encouragement du conseil d’exploitation en agriculture ASCA (aujourd’hui AGRIDEA).
Le travail des services de vulgarisation au cours des 50 dernières années a été marqué par un certain nombre d’événements et d’évolutions. Les points forts ont changé en ce qui concerne les objectifs. La formation continue et la vulgarisation ont depuis toujours contribué à permettre aux familles de paysans d’améliorer la gestion technique et économique de leur exploitation, de même que leur position sociale. Elles accroissent leur capacité d’adaptation de même que les possibilités de production et de commercialisation. Depuis quelques temps, l’écologie et le bien-être des animaux sont également encouragés et l’on considère que le développement économique régional est important pour le secteur agroalimentaire.
Les vulgarisateurs apportent leurs connaissances techniques tout en tenant compte de la situation individuelle, des atouts et des aptitudes de la famille d’agriculteurs, de même que des particularités régionales et environnementales. La réforme de la politique agricole accroît encore l’importance d’un marché offrant des produits différenciés grâce à l’octroi de labels de qualité. Les vulgarisateurs fonctionnent comme conseillers et conseillères de l’espace rural et sont confrontés aux problèmes sociaux spécifiques de ce milieu. Les activités accessoires, l’agritourisme, l’accueil d’hôtes ainsi que la transformation et la vente des produits directement à la ferme, sont des thèmes qui dépassent le cadre purement agricole, mais qui sont désormais indissociables de l’univers des exploitations agricoles et des familles de paysans. Dans le système de connais-
2.3AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2 232
■ De la réforme à la mise en œuvre du nouvel apprentissage dans le «Champ professionnel de l’agriculture et de ses professions»
sances agricoles, la vulgarisation joue le rôle de plate tournante entre les acteurs de la recherche fondamentale et appliquée, de la formation initiale et continue et les familles d’agriculteurs.
Les familles de paysans suisses ont maintenant un accès rapide aux informations pertinentes: les services de vulgarisation y contribuent en collaboration avec les partenaires de la recherche, de la formation de base, des hautes écoles et des organisations paysannes. Les vulgarisateurs ne sont pas là pour défendre les prescriptions de la politique agricole, mais il fait partie de leurs attributions d’en communiquer le contenu en mettant l’accent sur les exigences qu’elles comportent et les chances qu’elles offrent. Une formation continue et une vulgarisation qui bénéficient du soutien de la population contribuent notablement, avec les autres acteurs du système de connaissances, à assurer la multifonctionnalité et la durabilité de l’agriculture. La manière, la forme, les tâches à accomplir et le taux de couverture des coûts font l’objet d’un débat permanent.
Formation professionnelle
L’économie et le marché du travail servent de cadre à la conception de la formation professionnelle. La formation de base (trois ans de préparation au certificat fédéral de capacité CFC et deux ans de préparation à l’obtention de l’attestation fédérale de formation professionnelle AFP), tout comme la formation professionnelle supérieure, ont pour but d’accroître l’employabilité. La réforme en cours de la formation vise à l’intégration dans la nouvelle loi sur la formation professionnelle du métier d’agriculteur de même que des professions agricoles spécialisées et du secteur de la transformation des produits agricoles, autrefois réglés dans la législation sur l’agriculture. La réforme s’effectue dans le «Champ professionnel de l’agriculture et de ses professions». Les professions concernées ont été régies jusqu’ici dans 14 règlements (en partie dans des dispositions cantonales ou selon les régions linguistiques). A l’avenir, la formation de base professionnelle à l’échelon CFC et l’AFP sera réglée par une ordonnance qui assurera une formation professionnelle uniforme dans toute la Suisse. Neuf associations professionnelles s’engagent dans la formation de six professions réunies dans le même champ professionnel, en mettant l’accent sur l’agriculture biologique. Ces associations professionnelles se sont associées à l’organisation du monde du travail (OMT) AgriAliForm. Celle-ci assume les tâches selon le principe du partenariat exigé dans la loi sur la formation professionnelle et joue ainsi le rôle d’interlocuteur de la Confédération (Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie OFFT) et des cantons (Conférence suisse des offices de formation professionnelle CSFP).
Après trois ans de travaux, la réforme de la formation agricole de base a franchi début 2008 une étape importante. L’ordonnance sur la formation professionnelle initiale «Champ professionnel de l’agriculture et de ses professions» entre en vigueur le 1er janvier 2009. Les dispositions de l’ancien règlement continuent de s’appliquer aux apprenants qui ont commencé leur apprentissage professionnel en 2008 ou antérieurement.
2.3 AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2 233 2. MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE
Les travaux de mise en œuvre déjà amorcés vont être poursuivis avec détermination. Ils touchent pour l’essentiel aux domaines suivants:
–matériel didactique répondant aux objectifs du nouveau concept pédagogique (axé sur les processus et sur la pratique);
–documentation didactique en tant que produit destiné à remplacer le cahier d’exploitation;
–cours interentreprises qui doivent être introduits en tant que nouvel espace de formation;
–documents utilisés en relation avec le contrat d’apprentissage (annexe au contrat d’apprentissage, dispositions relatives au droit du travail, tableau des salaires de référence);
–marketing et moyens télématiques pour le nouvel apprentissage.
La réforme de la formation agricole de base entraînera des changements pour les apprenants, les exploitations d’apprentissage et les écoles. En voici un résumé sous forme de tableau récapitulatif.
Eléments de la formation initiale:jusqu’ici nouveau à partir de l’apprentissage 2009
Modèle de formation
Formation dans une exploitation
Cours interentreprises
Exigences auxquelles doit satisfaire le formateur (= maître d’apprentissage)
Formation en agriculture biologique
deux années d’apprentissage avec fréquentation de l’école professionnelle et deux semestres dans une école d’agriculture formation terminée après 2 ans aucun
Diplôme de Maître-agriculteur
Spécialisation agriculture bio en passant une année de formation dans une exploitation formatrice bio
trois années d’apprentissage avec formation pratique et école professionnelle en cours de formation
formation dans l’exploitation sur trois ans nouveau: 8 jours répartis sur toute la durée de la formation
au moins agriculteur avec brevet (examen professionnel = premier échelon de la formation professionnelle continue)
Point fort agriculture biologique pour toutes les professions du champ professionnel de l’agriculture (sauf cavistes), avec au moins 50% de la formation pratique dans une exploitation biologique.
Deuxième formation
Répartition de l’enseignement
une année de formation et cours particulier de 8 mois ou trois années en cours d’emploi
1re année: 240 leçons
2e année: 240 leçons école d’agriculture: 1120 à 1320 leçons
2e et 3e années ou formation en cours d’emploi davantage axées sur la formation pratique
1re année: 360 leçons
2e année: 360 leçons
3e année: 880 leçons* (total: 1600 leçons)
Organisation de l’enseignement
École
1e et 2e années en classes mixtes Ecole professionnelle et école d’agriculture séparées. Moyens didactiques différents.
1re à 3e années en classes séparées par niveau Ecole professionnelle avec développement structuré de l’enseignement sur les trois années d’apprentissage
2.3AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2 234
* En 3e année, les maraîchers ont 780 leçons, les aviculteurs et les cavistes, 820 leçons respectivement.
L’objectif a toujours été d’intégrer la formation agricole dans la nouvelle loi sur la formation professionnelle en conservant les éléments positifs et les acquis de l’apprentissage professionnel dans sa conception actuelle. Nous avons le plaisir de constater que d’importants objectifs ont été atteints grâce à la réforme de la formation:
–un profil professionnel (image de marque) comprenant des compétences en économie d’entreprise (bases) ;
–une ordonnance sur la formation professionnelle et un programme d’études qui s’appliquent à 6 professions et prennent en compte le thème central de l’agriculture biologique;
–la formation de base duale de trois ans (formation parallèle dans l’entreprise formatrice et à l’école professionnelle);
–exigences plus élevées imposées aux formateurs (maîtres d’apprentissage) par rapport à ce qui est la norme dans d’autres filières professionnelles; –modèle d’enseignement progressif (1600 leçons); plus de leçons en 3e année que pendant les deux premières années; –changement intercantonal d’entreprise formatrice (également au-delà des frontières linguistiques);
–un plan de formation axé sur les processus et sur la pratique; –introduction des cours interentreprises (8 jours répartis sur toute la durée de l’apprentissage);
–procédure de qualification simplifiée et transparente.
Outre la réforme de la formation de base de trois ans à l’échelon CFC, une autre réforme est en cours, celle de l’attestation fédérale de formation professionnelle (AFP, formation de deux ans). Le nouveau concept d’apprentissage sera introduit en 2009, au début de la nouvelle période de formation. Il est prévu de distinguer deux niveaux de formation dans la nouvelle loi sur la formation professionnelle. Cela permettra de s’adresser à un plus large cercle de jeunes et de les introduire dans le monde du travail. L’attestation fédérale de formation professionnelle répond à un besoin du marché du travail. Elle contribue de plus à accroître la qualité de la formation au sein du champ professionnel de l’agriculture.
CIEA
Cela fait 50 ans que l’OFAG soutient le CIEA (Centre international d’études agricoles) dans sa recherche de processus de formation et de vulgarisation efficients, novateurs et durables.

Dans le cadre des séminaires CIEA, il a été possible –d’assurer la formation continue de plus de 2500 formateurs et vulgarisateurs; –de donner une impulsion à la formation dans plus de 70 pays; –d’échanger des expériences tirées de la pratique agricole de nombreux pays.
Le CIEA est arrivé à un tournant décisif. Le besoin de formation initiale et continue pour les formateurs et les vulgarisateurs agricoles est toujours aussi important. De futurs entretiens permettront de savoir dans quelle mesure la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l’OFAG pourront encore assurer leur participation après 2008.
2.3 AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2 2. MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE 235
■ Organisation de séminaires depuis 50 ans
Il y a exactement cinquante ans, en août 1958, s’est tenu à Zurich un séminaire de formation continue au sujet de la formation professionnelle agricole. A l’initiative de F.T. Wahlen, qui occupait alors une fonction de directeur au sein de la FAO à Rome, plus de 50 spécialistes de la formation du monde entier accueillis par l’OFAG se sont rencontrés pour réfléchir ensemble sur les moyens d’assurer une meilleure formation aux agricultrices et agriculteurs. En marge du séminaire, fut également réalisé un programme diversifié autour des activités et spécialités de l’agriculture.
Du 11 au 23 août 2008, un séminaire CIEA a de nouveau été organisé en Suisse. Soutenu et financé respectivement par la DDC ou par l’OFAG selon les domaines et coordonné sur le plan du contenu par la Haute Ecole suisse d’agronomie (HESA), le thème du séminaire s’intitulait «Apprentissage: les clés de la réussite». Divers aspects de la formation ont été abordés au cours de ce séminaire où l’on a tenté entre autres de répondre à la question «Que faut-il pour que nos paysannes et nos paysans soient motivés à apprendre?» Une place importante a été accordée à la présentation de projets de vulgarisation et de formation, tels que ceux de l’Ecole d’agriculture Los Andes au Chili, de la Télé-académie pour les paysans de la Forêt-Noire en Allemagne ou encore le projet de vulgarisation LEAP au Laos. La manifestation s’est terminée par la conclusion de contrats de formation personnels dans lesquels les participants ont formulé ce qu’ils souhaitaient changer une fois de retour dans leur pays et dans leur institution.
L’organisation de séminaires CIEA poursuit les objectifs didactiques suivants:
Les participants
–approfondissent et acquièrent des connaissances sur la manière de concevoir des processus d’enseignement et d’apprentissage efficaces et efficients;
–discutent avec des spécialistes de thèmes d’actualité ayant trait à la pédagogie professionnelle et à la didactique;
–sont confrontés à des cas de figure concrets et les analysent;
–élaborent en commun des idées visant à améliorer la formation et la vulgarisation dans le milieu rural;
–font des constatations personnelles à partir des contributions apportées au séminaire et formulent des idées concernant les changements concrets qu’ils pourraient opérer dans leur activité professionnelle;
–échangent leurs opinions de différentes manières avec tous les autres participants.
Durant 50 ans, les séminaires CIEA en Suisse et à l’étranger ont été ainsi des manifestations en prise sur l’actualité, instructives et diversifiées, organisées à l’intention des spécialistes de la formation et de la vulgarisation en milieu rural.
2.3AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2 236
2.3.3 Moyens de production
Protection phytosanitaire
Parmi les maladies bactériennes connues des arbres portant des fruits à pépins et de certaines plantes ornementales apparentées, le feu bactérien est la plus dangereuse. Elle est causée par la bactérie Erwinia amylovora qui s’est manifestée pour la première fois au 18e siècle aux Etats-Unis où la maladie a déjà occasionné de graves dommages aux cultures fruitières au cours du 19e siècle. La bactérie est toutefois inoffensive pour l’être humain et les animaux.
A la fin des années 50 du 20e siècle, le feu bactérien a été détecté pour la première fois en Angleterre où l’agent pathogène avait été très probablement introduit lors d’importations de matériel végétal infecté. Le premier foyer de contamination sur le continent a été découvert quelques années plus tard au Danemark. De là, l’agent infectieux s’est propagé assez rapidement, si bien qu’aujourd’hui, la quasi-totalité du continent européen est contaminée.
En Suisse, l’agent infectieux du feu bactérien se manifeste pour la première fois en 1989 sur des plantes du genre Cotoneaster, à Stein am Rhein (SH), à Eschenz (TG) et à Stammheim (ZH). En Suisse alémanique, la bactérie s’est entre-temps largement propagée. Depuis 2007, elle a été mise en évidence au moins une fois dans tous les cantons, même si les cultures d’arbres fruitiers à pépins du canton de Vaud et en particulier du Valais restent encore peu touchées. On trouvera des informations actualisées sur la contamination et son évolution depuis 1989 sur le site www.feuerbrand.ch.
La contamination des arbres à fruits à pépins était extrêmement étendue en 2007. La plupart des communes des cantons TG, SG, AR, AI, ZH, SZ, GL, LU, NW et OW ont été touchées. Les cantons BE et GR qui appartenaient à la zone protégée par rapport au feu bactérien ont dû en être exclus au 1er octobre 2007 en raison de la progression de la contamination. Dans les cantons SH, AG, BL, JU, NE et FR également, on n’avait jamais encore constaté autant de foyers d’infection.

En 2007, près de 75’000 arbres fruitiers haute-tige (environ 50’000 pommiers et 25’000 poiriers) ont été déclarés contaminés. De 25’000 à 30’000 arbres fruitiers haute-tige ont été abattus et près de 110 ha de culture ont été détruits dans les plantations de rendement.
Les températures élevées du mois d’avril, où les arbres fruitiers à pépins étaient déjà en fleurs, sont à l’origine de cette attaque massive de feu bactérien. Bien qu’il n’y ait eu que très peu de précipitations à cette période, les nuits encore relativement fraîches ont favorisé la formation de rosée qui a également contribué à une multiplication massive des bactéries du feu bactérien.
■■■■■■■■■■■■■■■■■
2.3 AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2 2. MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE 237
■ Feu bactérien: derniers développements
Les nombreux foyers de contamination ont exigé dans beaucoup de cantons une importante mobilisation pour la détection et la lutte contre le feu bactérien, aussi bien de la part des autorités d’exécution (services phytosanitaires cantonaux, stations cantonales de protection des plantes, contrôleurs communaux du feu bactérien) que de la part des détenteurs de plantes-hôtes (essentiellement arboriculteurs et pépiniéristes). Dans de nombreuses communes on a dû renoncer à la stratégie d’éradication en raison de l’intensité de la contamination, l’élimination de l’agent pathogène n’étant plus possible. La lourde charge de travail, de même que le fait de devoir sans cesse décider de la mesure sanitaire la mieux appropriée – destruction systématique des plantes infectées ou taille phytosanitaire – ont constitué pendant des mois un constant défi. La situation était particulièrement délicate dans les régions possédant d’importantes plantations d’arbres fruitiers haute-tige. L’abattage des arbres malades a eu de fortes répercussions sur le cadre paysager. La lutte contre le feu bactérien se heurte ici aux limites d’acceptation, non seulement chez les propriétaires des arbres, mais aussi chez tous ceux qui tiennent à la conservation des arbres haute-tige. La situation s’est avérée particulièrement complexe là où les plantations d’arbres haute-tige et les cultures basse-tige sont entremêlées. Elle a aboutit à des conflits d’intérêts entre culture fruitière intensive et culture fruitière extensive: certains ont privilégié des mesures d’assainissement rigoureuses dans le but de maintenir des conditions phystosanitaires acceptables pour la production fruitière, d’autres se sont au contraire opposés à des interventions radicales sur le patrimoine naturel, notamment parce qu’ils doutaient de l’utilité de l’assainissement.
La stratégie de lutte définie par le Conseil fédéral a été critiquée dans les médias et par quelques parlementaires par la voie d’interventions. L’audition d’organisations écologistes et de la «Vereinigung Hochstamme Schweiz» (association de défense des arbresfruitiers haute-tige) début 2088 a toutefois amélioré la compréhension mutuelle.Bien que l’on ne puisse pas encore parler d’obtention d’un consensus, la directive n°3 sur la lutte contre le feu bactérien édictée par la Confédération au début de l’été 2006 s’est avérée suffisamment cohérente et nuancée pour tenir compte de façon adéquate de la structure des effectifs de plantes-hôtes et de l’état de la contamination au plan local. La stratégie de lutte adoptée par la Confédération n’a pas été remise en question par les arrêts rendus par le Tribunal administratif fédéral sur trois litiges en rapport avec la lutte contre le feu bactérien survenus en 2007 dans le canton de St-Gall.
Communes touchées par le feu bactérien 2007 (état le 31.12.2007)
2.3AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2 238
Source: ACW
■ Révision de la loi sur la protection des variétés
Après avoir consulté les offices fédéraux concernés, l’OFAG a décidé d’autoriser l’utilisation de l’antibiotique streptomycine pour lutter contre le feu bactérien. Des conditions d’utilisation très strictes ont été fixées afin de réduire au maximum les risques pouvant être liés à un tel usage. Au printemps 2008, 453 kg de streptomycine ont été utilisés dans 144 communes réparties dans les cantons suivants: TG, SG, ZH, BE, LU, ZG, SO, SH, GR, AG.
La contamination progresse inexorablement en direction de la Suisse occidentale. La stratégie de lutte de la Confédération prévoit que les mesures prises ralentiront la propagation de la maladie et que là où elle est déjà installée, elles atténueront ses répercussions sur les objets à protéger. Dans les régions fortement touchées en 2007, le potentiel infectieux d’Erwinia amylovora a sans aucun doute augmenté. Les conditions météorologiques pendant la période de floraison des arbres fruitiers à pépins continueront de jouer un rôle important pour l’ampleur de la contamination dans les années à venir.
Protection des variétés
La protection des variétés est un droit d’exclusivité comparable à un brevet. Elle protège la propriété intellectuelle des obtentions végétales. De cette manière, l’obtenteur peut amortir ses investissements. La protection des variétés contribue donc substantiellement à l’obtention de nouvelles variétés végétales répondant aux exigences économiques et écologiques.
Ainsi, la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales (C-UPOV) fixe des exigences minimales à l’échelon international. La Suisse a ratifié la version 1978 de cette convention. La C-UPOV a été entièrement révisée en 1991 afin de tenir compte des nouveaux développements en matière de sélection végétale. Pour que la Suisse puisse ratifier la convention révisée, il fallait d’abord modifier en conséquence la loi fédérale en vigueur sur la protection des obtentions végétales (loi sur la protection des variétés).
Le Parlement a adopté la loi révisée le 5 octobre 2007 et le délai référendaire n’a pas été utilisé. Avec l’entrée en vigueur de la loi révisée en automne 2008, tous les obtenteurs, indépendamment du fait que leur Etat accorde ou non la réciprocité, peuvent demander en Suisse la protection de leurs nouvelles obtentions pour toutes les variétés.
2.3 AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2 2. MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE 239
Les conditions matérielles d’obtention de la protection (distinction, nouveauté, homogénéité et stabilité) demeurent inchangées. L’étendue de la protection est en revanche élargie à deux points de vue: En premier lieu, elle n’est plus exclusivement limitée au matériel de multiplication des variétés protégées. Le détenteur d’un titre de protection suisse peut également faire encore valoir son droit sur le produit de sa récolte, pour autant qu’il n’a pas eu l’occasion de le faire en ce qui concerne le matériel de multiplication. Ainsi, lorsque des pommes d’une des variétés protégées en Suisse, provenant de plantations d’un pays dans lequel elle n’est pas protégée, sont mises sur le marché suisse, le détenteur du titre de protection doit néanmoins pouvoir encore invoquer son droit en Suisse à ce moment-là. En second lieu, la protection est étendue aux variétés essentiellement dérivées. Il s’agit certes de variétés qui se différencient de la variété protégée, mais qui en présentent néanmoins tous les caractères essentiels. Si, par exemple, un obtenteur découvre parmi plusieurs plantes d’une variété à pétales rouge un mutant à pétales bleues, à partir de laquelle il développe une variété homogène et stable, il devra requérir l’accord du détenteur de la variété à pétales rouges s’il souhaite commercialiser sa variété.
Une autre nouveauté est la réglementation explicite du privilège de l’agriculteur, selon lequel il a le droit de réensemencer ses champs avec une partie du produit de la récolte sans avoir à en demander l’autorisation à l’obtenteur de la variété utilisée. Le privilège de l’agriculteur constituant une restriction notable du droit de protection des variétés, il est limité aux espèces végétales d’une importance primordiale en ce qui concerne l’alimentation (pommes de terre, céréales, plantes fourragères et oléagineuses). Les espèces concernées sont énumérées dans la nouvelle ordonnance sur la protection des variétés qui entre en vigueur en même temps que la loi correspondante. Il n’y a pas de privilège de l’agriculteur concernant les fruits et les baies. Premièrement parce que dans le cas des fruits et des baies le produit de la récolte et le matériel de multiplication ne sont pas identiques (ce qui constitue selon la C-UPOV un préalable pour bénéficier du privilège de l’agriculteur). Deuxièmement, parce que l’obtenteur ne serait pratiquement pas indemnisé pour ses investissements si l’agriculteur n’achetait que quelques plantes et pouvait les multiplier sans avoir besoin d’une licence, pour aménager ensuite toute une plantation.
La nouvelle ordonnance prévoit aussi l’introduction d’un nouvel instrument, à savoir la licence obligatoire pour les brevets dépendants. Sous certaines conditions, les autorités judiciaires pourront contraindre le détenteur de variétés protégées à octroyer une licence, si l’exercice d’un droit de brevet l’exige. Le détenteur d’un droit de protection peut en contrepartie exiger du titulaire du brevet qu’il lui accorde une licence d’exploitation de son droit de brevet. La loi sur les brevets comporte une réglementation analogue pour les titres de protection des variétés qui dépendent d’un brevet.
Par ailleurs, la durée de la protection a été prolongée de cinq ans. Elle est maintenant de 30 ans pour les arbres et les ceps et de 25 ans pour les autres plantes. De plus, les dispositions sur la procédure et la protection de droit civil ont été harmonisées à celles d’autres domaines de la législation régissant les droits incorporels et les articles sur la protection pénale ont été adaptés au nouveau contexte.
La C-UPOV de 1991 pourra être ratifiée après l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions. Le droit suisse sur la protection des variétés correspond en outre maintenant au droit européen en la matière.
2.3AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2 240
Engrais
D’une manière générale, la législation sur les engrais règlemente la mise en circulation, l’importation et l’utilisation d’engrais. Les adaptations de la législation sur les engrais (ordonnance sur les engrais et ordonnance sur le Livre des engrais) qui ont pris effet au 1er janvier 2008 ont été motivées par les progrès techniques considérables réalisés au cours de ces dernières années dans la production et l’utilisation de résidus de fermentation.
Les engrais ne peuvent être mis en circulation que s’ils sont homologués et s’ils remplissent les conditions requises, à l’exception des engrais de ferme provenant d’une exploitation pratiquant l’élevage d’animaux et qui sont remis directement aux utilisateurs finals. Les valeurs limites imposées jusqu’ici exclusivement aux engrais de recyclage doivent être désormais également respectées en ce qui concerne la mise en circulation d’engrais de ferme. Cependant, lorsque la majeure partie de la masse (soit plus de 50% de la matière sèche) est constituée d’excréments de porc, la valeur limite pour les deux métaux lourds que sont le cuivre et le zinc peut être relevée respectivement de 100 à 150 g/t et de 400 à 600 g/t.
L’utilisation d’engrais de ferme est régie par à loi et l’ordonnance sur la protection des eaux. Sur la base de prescriptions relatives entre autres au bilan de fumure, à la quantité d’épandage et à la cession d’engrais de ferme. La définition des engrais de ferme donnée dans l’ordonnance sur les engrais englobe maintenant aussi les engrais de ferme fermentés à l’aide d’au maximum 20% de matériel non agricole. Les agriculteurs pratiquant la cofermentation qui utilisent moins de 20% de cosubstrat d’origine non agricole peuvent céder leur produit aux consommateurs finals sans avoir besoin d’une autorisation. Les cosubstrats d’origine non agricoles sont tolérés, à condition toutefois que les valeurs limites concernant les polluants présents dans les cosubstrats ne soient pas dépassées.
Au lieu de digestats et de jus de pressage, on parle aujourd’hui de digestats solides et de digestats liquides. Les digestats solides ou liquides sont définis comme des matières végétales, animales ou (nouvellement) microbiennes fermentées de manière appropriée en conditions anaérobies. Les produits des installations de méthanisation et de compostage sont considérés comme annoncés si une copie de l’autorisation cantonale d’exploitation est fournie à l’OFAG. Les producteurs de compost et de digestats doivent toutefois obtenir comme auparavant une autorisation de l’OFAG, lorsque du matériel tel que viande, graisse, os, sang, cornes, onglons, déchets solides et boues d’abattoir est utilisé.
Les détenteurs d’installations de compostage et de méthanisation doivent tenir un registre des acquéreurs qui leur achètent plus de 5 tonnes par an de compost ou de digestats par rapport à la matière sèche. Ce registre doit être conservé pendant dix ans au moins. La quantité cédée peut être aussi enregistrée via HODUFLU, une nouvelle application internet de contrôle des flux d’engrais de ferme d’une région à l’autre.

2.3 AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2 2. MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE 241
■ Modifications de la législation sur les engrais concernant les engrais de ferme et les engrais de recyclage
Organismes génétiquement modifiés dans les aliments pour animaux
L’importation d’aliments pour animaux qui contiennent des organismes génétiquement modifiés (OGM) ou qui sont produits à partir d’OGM s’est stabilisée à la baisse. En 2007, les aliments pour animaux contenant des OGM ne représentaient plus que 0,01% des aliments pour animaux importés. Ce faible pourcentage est confirmé par le nombre élevé des échantillons prélevés par la douane dans lesquels aucun composant OGM n’a été identifié. En ce qui concerne les aliments pour animaux de compagnie, une amélioration de l’étiquetage est envisageable.
Importations d’aliments pour animaux contenant des OGM ayant fait l’objet d’une déclaration douanière
AnnéeQuantité totale Aliments pour animaux Aliments pour animaux d’alimentspour animaux contenant des OGMcontenant des OGM importésdéclarésdéclarés en ten
Sources: OFAG, DGD
Analyses effectuées par ALP portant sur les aliments pour animaux de rente quant à leur teneur en OGM
AnnéeEchantillons prélevés faussesEchantillons prélevés fausses par la douane lors de indicationspar ALP dans le indications l’importationcommerce
Source: ALP
Analyses effectuées par ALP portant sur les aliments pour animaux de compagnie quant à leur teneur en ingrédients OGM
AnnéeAliments pour animaux de fausses indications compagnie contrôlés
2003412 1636880,2 2004383 5952 1010,55 2005356 1494020,11 2006373 228600,02 2007486 743550,01
ten %
NombreNombreNombreNombre 20038102670 20046122285 20053002503 20067903000 20079302603
NombreNombre 20051264 200611410 2007979
2.3AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2 242
Source: ALP
2.4 Section Inspectorat des finances
Le programme d’inspection de l’Inspectorat des finances est élaboré sur la base d’analyses de risques internes à la section, de données empiriques ainsi que d’une planification pluriannuelle. Pour éviter les lacunes, les doubles emplois et les chevauchements dans le programme d’évaluation, celui-ci est harmonisé avec le programme du Contrôle fédéral des finances, qui l’approuve.
Inspectorat des finances
Dans l’année sous rapport, les activités de révision ont été les suivantes:
–révisions internes effectuées par l’OFAG dans trois sections et un état-major de l’office; –contrôles périodiques de pièces justificatives au sein de l’OFAG, stations de recherches et Haras compris; –une révision financière auprès d’Agroscope ALP Liebefeld-Posieux; –six révisions de clôture auprès de bénéficiaires de subventions; –suivi de révisions achevées antérieurement.
Tous les contrôles ont été réalisés selon les normes professionnelles de l’Institute of Internal Auditors (IIA) et de l’Association suisse d’audit interne (ASAI); ils ont par ailleurs été soumis à un contrôle interne de la qualité. De plus, conformément à son mandat légal, le Contrôle fédéral des finances a également contrôlé la qualité et l’efficacité de l’Inspectorat des finances de l’OFAG dans le cadre d’un audit général de tous les inspectorats des finances de l’administration fédérale. La révision et l’évaluation ont été réalisées selon les normes internationales de l’ASAI. L’audit s’est soldé par un bilan positif. Il a généralement attesté d’un haut niveau de professionnalisation dans l’exécution des tâches.
Les travaux de révision ont porté essentiellement sur l’évaluation du système et le contrôle des effets dans trois sections et un état-major de l’OFAG. Ces révisions consistent en une évaluation neutre et systématique de l’organisation et des activités de l’unité concernée. Elles portent sur la structure et l’organisation d’une section. Un autre élément important est la vérification du contrôle interne (système de contrôle interne) qui ne se contente pas de constater les écarts entre l’état effectif et l’état souhaité, mais en recherche aussi la cause. Les résultats des contrôles sont largement positifs. Les instruments de gestion et de pilotage utilisés sont, pour la plupart, appropriés. Pour autant que les sections puissent avoir une influence sur les objectifs visés, ceux-ci ont été atteints.
2.4 SECTION INSPECTORAT DES FINANCES 2 243 2. MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE ■■■■■■■■■■■■■■■■■
■ Rapport de gestion annuel
■ Suivi
A l’occasion du passage de la Confédération au nouveau modèle comptable NMC, l’Inspectorat des finances a soumis la migration et les bilans d’ouverture de l’OFAG, d’Agroscope et du Haras national à un examen approfondi. La migration des données du bilan s’est faite selon les directives de l’Administration des finances et du Contrôle fédéral des finances. La révision financière a été limitée, étant donnée que le CDF a procédé à une révision intermédiaire. Les contrôles ont eu lieu en fonction des risques. Le contrôle de rubriques choisies, réalisé par sondage, nous permet de confirmer la régularité et la légalité des dépenses effectuées. Les comptes de l’office sont tenus conformément aux principes de la comptabilité et de la gestion budgétaire. La révision financière auprès d’Agroscope ALP s’est soldée par un résultat positif.
Toutes les révisions de clôture ont été approuvées sans restriction. L’organisation des systèmes de contrôle internes est jugée suffisante, mais il y a toutefois encore un potentiel d’amélioration. Dans le cas de deux organisations partenaires, la présentation requise du point de vue légal et du point de vue contractuel de la comptabilité, à savoir une comptabilité des centres et une comptabilité des supports de coûts, ne correspond pas encore aux exigences. Il n’est ainsi pas possible de différencier clairement les activités de droit public des activités de droit privé des organisations. Le bilan et la comptabilité d’une organisation partenaire présentent des lacunes. Ils doivent être étoffés et améliorés. Dans le cas d’une organisation de projet, la vue d’ensemble financière des activités fait défaut. La question se pose en outre de savoir s’il est vraiment judicieux d’attribuer des projets à des particuliers, notamment dans la perspective d’une poursuite durable de ce type de projets.
Dans le cadre du suivi, les réviseurs ont vérifié dans quelle mesure les sections concernées avaient pris en compte les recommandations émises lors des cinq révisions effectuées auparavant. Résultat: les sections ont appliqué 89% des recommandations. Quant à celles qui n’ont pas encore été suivies, elles feront l’objet d’une vérification cette année encore.
2.4 SECTION INSPECTORAT DES FINANCES 2 244
■ Infractions
Service d’inspection chargé des contrôles sur le terrain
Les inspecteurs chargés des contrôles sur le terrain effectuent, d’office ou à la demande des services de l’OFAG, des contrôles dans tous les domaines de la production et des ventes régis par la législation agricole. Ils ont effectué 447 contrôles en 2007 dans les secteurs suivants:
–lait et produits laitiers: 344 contrôles; –fruits, légumes et fleurs coupées: 34 contrôles; –viande et œufs: 24 contrôles; –culture des champs et culture fourragère: 15 contrôles; –viticulture en rapport avec les mesures de reconversion: 19 contrôles; –mesures d’adaptation au marché: 11 contrôles.
Les contrôles de quantités effectués dans l’économie laitière, en relation avec les suppléments et/ou les aides (soutien du prix du lait) et/ou les taxes (contingentement laitier) ont été faits conformément aux prescriptions de la norme internationale EN 45004 (ISO/IEC 17020, organisme d’inspection accrédité de type B). Les mêmes normes de qualité ont été appliquées dans les autres secteurs contrôlés.
Les entreprises à contrôler dans les domaines du lait et des produits laitiers sont choisies sur la base d’une analyse des risques mise à jour périodiquement et d’un mandat annuel global de la section compétente. Dans l’année sous rapport, des suppléments et aides accordés dans le pays totalisant 361,4 mio. de fr. ont été versés à 1’145 exploitations ayant droit à des contributions, dont 344 (30%) ont fait l’objet d’un contrôle. Des manquements ont été signalés dans 116 exploitations. Vingt-quatre d’entre elles ont été financièrement pénalisées puisqu’elles ont dû restituer les contributions déjà versées ou payer des arriérés.
Les contrôles à domicile dans le secteur des fruits et légumes frais ont été effectués au cours du premier semestre 2007. Compte tenu de la modification des dispositions de l’ordonnance sur les importations agricoles, la responsabilité d’effectuer ces contrôles incombe depuis le 1er mai 2007 à l’Administration fédérale des douanes.
Dans les autres secteurs, les contrôles n’ont donné lieu à aucune remarque.
Les clarifications, enquêtes et interrogatoires requis en cas d’infractions aux dispositions de la législation agricole sont réalisés en collaboration avec les autorités d’instruction fédérales et cantonales, des organisations privées et d’autres instances d’entraide judiciaire. Dans l’année sous rapport, cinq cas ont donné lieu à l’ouverture d’une procédure dans le domaine du contingentement laitier; quatre sont achevées et une est en cours. Il convient de constater qu’il est de plus en plus complexe de suivre les flux laitiers et donc de parvenir à apporter des preuves juridiquement suffisantes lors de suspicion d’infraction à l’ordonnance, étant donné que près de 80% des producteurs ne sont plus assujettis à la réglementation étatique des quantités.
■ Activités de contrôle en 2007
2.4 SECTION INSPECTORAT DES FINANCES 2 245 2. MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE
■ Eviter les chevauchements
2.5Mise en réseau des banques de données agricoles
Conformément à l’article 185, LAgr et aux documents approuvés par le comité du programme ASA (Administration du Secteur agricole) 2011, la Confédération, en collaboration avec les cantons et l’économie privée, met sur pied un système d’information agricole national. Ce dernier soutiendra l’exécution des actes législatifs en vigueur à l’échelon national dans le domaine de l’agriculture et pourra également être utilisé pour répondre à des besoins privés comme les contrôles de label, dans le respect des dispositions concernant la protection des données. Le système d’information prévu met en lien des systèmes cantonaux de l’administration du secteur agricole existants et des systèmes fédéraux comme le système d’information sur la politique agricole (SIPA), la banque de données sur le trafic des animaux (BDTA) et la banque de données sur le lait.
Les paiements directs sont aujourd’hui administrés au moyen de six différents systèmes cantonaux. Cette situation est très contraignante pour les organes responsables de la coordination des contrôles, dans le domaine du droit public comme dans celui du droit privé. Les données relatives au secteur agricole sont en général transférées via des interfaces à divers systèmes fédéraux pour y être traitées. Quant aux acteurs directememnt concernés, les agriculteurs, ils sont appelés à annoncer certaines données à plusieurs reprises.
Les prescriptions nationales et internationales nécessitent une adaptation du système. De plus, plusieurs milieux demandent que les processus et la technologie de l’information soient simplifiés. Le projet «ASA 2011» offre un soutien à la collaboration entre les cantons et la Confédération dans les questions ayant trait à l’organisation et à la technologie de l’information, afin de réduire les charges administratives et financières. Le projet vise à simplifier l’agencement des systèmes et à répondre aux besoins de la production primaire.
De nombreux acteurs sont impliqués dans l’organisation du projet: en plus des cantons et des divers offices fédéraux, des organisations privées (p.ex., l’USP) ont été invitées à participer aux travaux. Cela permettra de garantir que les revendications des exploitations agricoles soient prises en compte à temps.
■ Allier expérience et innovation
L’analyse préliminaire s’est terminée au milieu de l’année 2007, avec le choix d’une variante. La solution choisie prévoit la mise à disposition centralisée de modules d’application (appelés services) pour les nouveaux domaines devant être réglementés au niveau fédéral. En outre, les applications existantes, mises en place aux niveaux fédéral et cantonal, sont intégrées dans une plate-forme de données centralisées (modèle avec bus de message et bus de services, voir illustration). La variante choisie est une solution flexible, qui offre la possibilité d’adapter le système aux besoins futurs selon les attentes des divers échelons et à peu de frais.
Un portail Internet central est également créé en commun, afin que les exploitations agricoles, les cantons, la Confédération et les milieux concernés puissent accéder, par une porte d’entrée commune, à toutes les informations et applications utiles dans le domaine de l’agriculture.
2.5 MISE EN RÉSEAU DES BANQUES DE DONNÉES AGRICOLES 2 ■■■■■■■■■■■■■■■■■
246
De plus, une banque nationale des données de contrôle est mise sur pied, sur laquelle les résultats des contrôles des exploitations agricoles sont tenus à la disposition des personnes autorisées, dans le respect de la loi sur la protection des données. Les contrôles effectués dans les exploitations agricoles pourront ainsi être mieux coordonnés et le plan des contrôles nationaux ainsi que le plan d’urgence pourront être mis en œuvre plus facilement.
Avec l’entrée en vigueur de l’ordonnance sur la géoinformation (OGéo) le 1er juillet 2008, l’OFAG a été chargé d’élaborer des modèles de données pour les géodonnées relevant de sa compétence. L’importance et le potentiel d’utilisation de géodonnées dans le domaine de l’administration du secteur agricole ont été reconnus et mis en évidence dans l’analyse préliminaire du projet «ASA 2011»
Le projet «plate-forme d’évaluation» prévoit l’automatisation et la simplification du traitement des données agricoles. Des supports décisionnels répondant aux besoins politiques ou de l’économie de marché seront ainsi rapidement disponibles.
Choix d’une variante (fin de l’analyse préliminaire): plate-forme de données comme «bus de message et bus de service».
Système central
OFAG
Organisations de contrôle Tiers (labels, marques) Agriculteurs
Registre national des exploitations avec identificateur unique
· Administration centralisée des contrôles
· Calcul centralisé du montant des paiements directs
· Portail Internet central pour les agriculteurs
Adaptateur
BDLait.ch
Banque de données sur le trafic des animaux (BDTA)
Adaptateur
Plate-forme de données: bus de message et bus de service
Adaptateur
Spécialistes des services cantonaux de l‘agriculture
Administration cantonale Tiers
Systèmes cantonaux Agricola, Agridea, Lawis, Gelan
Modules cantonaux
Gestion des contributions et comptabilité
· Protection de la nature et des eaux
· Améliorations structurelles
· Service vétérinaire (caisse épizooties)
· Forêts, viticulture et autres aspects cantonaux
· Sites internet cantonaux
Autres systèmes cantonaux
OVF
Autres systèmes
Fruits.ch
2. MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE 247
2.5 MISE EN RÉSEAU DES BANQUES DE DONNÉES AGRICOLES 2
Source: OFAG
Adaptateur OFS OFSP
Adaptateur
Adaptateur
248 2

3
249
■■■■■■■■■■■■■■■■■ 3. Aspects internationaux
L’élargissement des rapports commerciaux internationaux touche de plus en plus l’agriculture. Au niveau mondial, celle-ci est soumise aux règles internationales de l’OMC. Etant donné la concentration géographique des échanges agricoles, les relations contractuelles avec l’UE et l’intégration croissante dans l’Europe revêtent une importance primordiale pour l’agriculture suisse.
La Suisse est dépendante d’un accès aussi libre que possible aux marchés étrangers pour pouvoir maintenir et améliorer ses possibilités d’exportation. Elle s’engage en outre fermement au niveau international pour que la multifonctionnalité de l’agriculture soit mieux prise en compte dans les accords internationaux.
Le rapport agricole tient compte de cette évolution et traite les sujets internationaux dans la troisième partie.
–Le chapitre 3.1 apporte des informations sur l’état actuel du dossier européen, des négociations au sein de l’OMC et des accords de libre-échange et sur les derniers événements dans le cadre de l’OCDE et de la FAO.
–Le chapitre 3.2 est consacré à des comparaisons internationales. L’étude de l’évolution du prix des matières premières agricoles sur les marchés internationaux, abordée dans le précédent rapport agricole, est poursuivie. Elle est complétée par une comparaison des prix à la production entre la Suisse et l’Allemagne et par une représentation de l’évolution des prix à la consommation en Suisse comparativement à l’UE.
3. ASPECTS INTERNATIONAUX 3 250
3.1 Développements internationaux
L’économie mondiale qui traverse actuellement une zone de turbulences n’est pas sans influer sur les développements internationaux. Les troubles sociaux engendrés dans plusieurs pays en développement par la hausse du prix de nombreuses matières premières agricoles, de même que le climat d’effervescence autour des négociations d’accords commerciaux bi-et multilatéraux, déterminent l’évolution sur les marchés et le contexte de production de l’agriculture suisse. Par ailleurs, la Suisse poursuit sa politique d’accords bilatéraux.
–Interruption du cycle de Doha de l’OMC: aucune avancée dans les négociations multilatérales en cours depuis 2001 n’a pu être obtenue lors de la Conférence ministérielle de juillet 2008. La clôture des négociations est ainsi repoussée à une date indéterminée.
–Accord de libre-échange avec l’UE dans le secteur agroalimentaire: le Conseil fédéral a donné mandat pour l’ouverture de négociations. La phase des entretiens exploratoires se termine donc et celle des négociations débute. L’objectif est de parvenir à un accord qui prenne en compte l’ensemble de la filière alimentaire, autrement dit l’agriculture et les secteurs situés en amont et en aval.

–Regain d’activité au niveau des accords bilatéraux de libre-échange: en 2008, d’importantes avancées ont pu être obtenues dans le cadre de nombreux accords. Des entretiens exploratoires sont en cours avec une nouvelle série de pays.
–Conférence ministérielle de la FAO: en réaction aux turbulences sur les marchés mondiaux, la FAO a convoqué une conférence ministérielle à Rome pour débattre des moyens de sortir de la crise et élaborer des instruments adéquats pour les pays en développement.
–Conférence des Nations Unies sur le développement durable: la Suisse, qui a participé aux discussions qui se sont tenues à New York en 2008, a insisté pour que les résultats soient concrétisés en 2009.
3.1 DÉVELOPPEMENTS INTERNATIONAUX 3 ■■■■■■■■■■■■■■■■■
251
Accord de libre-échange avec l’UE dans le secteur agroalimentaire (ALEA)
Au printemps 2006 déjà, le Conseil fédéral avait décidé d’examiner les avantages et les inconvénients d’un traité de libre-échange agroalimentaire avec l’UE (ALEA). Depuis, les discussions préliminaires ont été approfondies par étapes. Les entretiens exploratoires avec la Commission de l’UE ainsi que l’évaluation des répercussions économiques se sont achevés début 2008. Sur la base de leurs résultats, le Conseil fédéral a décidé, le 14 mars 2008 – sous réserve de la consultation des commissions parlementaires et des cantons – d’engager des négociations avec l’UE sur une ouverture globale et réciproque du marché agroalimentaire et une collaboration accrue dans le domaine de la santé publique. Il a été en outre décidé que les milieux touchés par le passage à la nouvelle situation de marché seraient soutenus par des mesures d’accompagnement. Comme exposé ci-après, les négociations avec l’UE, la concrétisation des mesures d’accompagnement et leur financement constituent trois processus qui se déroulent parallèlement.
Accord de libre-échange agroalimentaire avec l’UE (ALEA) et collaboration dans le domaine de la santé publique
Financement des mesures d’accompagnement
Mesures d’accompagnement
Ouverture réciproque du marché
Ensemble de la chaîne alimentaire
Suppression des obstacles tarifaires au commerce
Suppression des obstacles non tarifaires au commerce
Sécurité des denrées alimentaires
Sécurité des produits
Santé publique
Autorité européenne de sécurité des aliments AESA
Système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux RASFF
Système d’alerte rapide pour les produits de consommation non alimentaires RAPEX
Maladies transmissibles ECDC, EWRS Programmes de santé HP 2008–2013
Objets de négociation avec l’UE
Décision du CF du 14 mars ALEA élargi
Source: OFAG
3.1 DÉVELOPPEMENTS INTERNATIONAUX 3 252
■ Entretiens exploratoires avec l’UE
Au cours des entretiens exploratoires, la Commission européenne a confirmé plusieurs fois son intérêt de principe pour une ouverture réciproque du marché agroalimentaire et une collaboration accrue dans le domaine de la santé publique. L’approche large de l’ALEA est accueillie favorablement. En ce qui concerne la suppression des droits de douane, il s’agit surtout de négocier les délais transitoires. Les entretiens exploratoires ont mis de surcroît en évidence que la suppression des obstacles non tarifaires au commerce ne saurait se faire sans une reprise étendue de l’acquis communautaire (droit communautaire européen). Il convient de trouver des approches pragmatiques pour tenir compte des sensibilités suisses, en ce qui concerne notamment l’indication du pays de production ou la déclaration des œufs provenant d’élevage en batterie, les organismes génétiquement modifiés et les allergènes. Des réglementations d’exception semblent toutefois envisageables dans ces domaines. De plus, la libre circulation des marchandises et le rapprochement des législations doivent être accompagnés d’une intégration de la Suisse aux processus et aux organes communautaires au niveau de l’analyse des risques et de la prise de décision en matière de santé, d’environnement et de protection des consommateurs.
■ Mandat de négociation
L’approche large de l’ALEA comporte l’élimination des entraves au commerce tarifaires (droits de douane, contingents) et non tarifaires (prescriptions applicables aux produits, normes de commercialisation, admission de produits) et englobe toute la chaîne de production agroalimentaire. Ainsi, non seulement l’agriculture, mais aussi l’échelon situé en amont (moyens de production et biens d’investissement) et l’échelon situé en aval (transformation et commerce) sont exposés à une concurrence accrue. Cette approche globale permet une réduction des coûts de production et ouvre d’importantes opportunités d’exportation aux produits suisses.
Le mandat de négociation avec l’UE prévoit, outre l’ouverture réciproque du marché agroalimentaire, une collaboration optimisée dans les domaines de la sécurité des denrées alimentaires, de la sécurité des produits en général et de la santé publique. Ces quatre domaines sont négociés dans le cadre d’un seul mandat, du fait notamment que la sécurité des produits alimentaires et l’ouverture du marché doivent être étroitement liés au plan du contenu. L’harmonisation de la législation sur les denrées alimentaires a une importance primordiale dans la perspective de la suppression des obstacles non tarifaires au commerce et donc de l’amélioration de l’accès réciproque au marché. Mais elle est en même temps la condition de la participation de la Suisse aux agences européennes concernées par un ALEA telles que l’AESA (Autorité européenne de sécurité des aliments) et le RASFF (système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux).
Après avoir été formulé par le Conseil fédéral le 14 mars 2008, le mandat de négociation a été mis en consultation auprès des commissions parlementaires compétentes (Commissions de l’économie et des redevances et Commissions de politique extérieure du Conseil national et du Conseil des Etats) et des cantons. Les commissions parlementaires se sont toutes prononcées en faveur de l’ouverture de négociations avec l’UE dans le domaine agroalimentaire et dans le domaine de la santé. La majorité est d’avis qu’une ouverture du marché comporte plus d’opportunités que de risques et qu’elle représente un avantage pour l’économie suisse. Ce projet pose néanmoins un grand défi à l’agriculture suisse. Il nécessite la mise en œuvre de mesures d’accompagnement et ne pourra être mené à bien qu’au moyen d’une stratégie cohérente. Les
3. ASPECTS INTERNATIONAUX 3.1 DÉVELOPPEMENTS INTERNATIONAUX 3 253
■ Répercussions sur l’économie, le secteur agricole et les finances fédérales
participants à la consultation ont souligné la nécessité de prendre en compte d’importants acquis suisses en matière de protection de l’environnement et des animaux ou en matière d’information des consommateurs. Il conviendrait également d’éviter une baisse du taux d’autoapprovisionnement. Dans sa prise de position, la Conférence des gouvernements cantonaux s’est prononcée contre l’ouverture de négociations à l’heure actuelle. Son attitude n’est pas motivée par des divergences sur l’orientation du mandat. Compte tenu de considérations générales de politique européenne, les gouvernements cantonaux pensent qu’il n’est actuellement pas opportun d’entamer des négociations sur de nouveaux dossiers de politique européenne. Ils se réservent toutefois la possibilité de réexaminer la situation en temps utile.
Parallèlement aux discussions exploratoires avec l’UE, on a procédé à une analyse des répercussions d’un ALEA sur l’ensemble de l’économie nationale et sur les secteurs de l’agroalimentaire. Les résultats de cette analyse effectuée sur la base d’un modèle d’équilibre général montrent qu’il faut s’attendre à une augmentation durable du PIB suisse de l’ordre de 0,5% par an, soit environ 2 milliards de francs par an. Cet effet économique positif s’explique par une hausse du pouvoir d’achat en raison de la baisse des prix à la consommation, de la réallocation de ressources (travail et capital) et d’un plus grand potentiel d’exportation pour les produits suisses.
En dépit de ces effets globalement positifs sur l’économie, l’agriculture suisse serait, elle, confrontée à des défis considérables. Etant donné que le revenu sectoriel de l’agriculture reculerait plus rapidement en cas de scénario ALEA qu’en cas de scénario sans ouverture du marché, selon les estimations modélisées, il faut tabler sur des pertes de revenu de plusieurs milliards de francs cumulées sur une période d’adaptation de plusieurs années. L’importance effective de ce manque à gagner dépend en particulier de l’utilisation du potentiel d’exportation et de baisse des coûts, de l’évolution générale des prix et des coûts, du résultat des négociations avec l’UE et, enfin, de l’aménagement et de l’ampleur des mesures d’accompagnement.
Un ALEA aurait de surcroît aussi des conséquences sur les finances fédérales. A court terme, le budget sera grevé par les pertes de recettes douanières et les dépenses temporaires supplémentaires au titre des mesures d’accompagnement. A long terme cependant, l’effet général de croissance générera une augmentation des recettes fiscales. Il faut donc s’attendre à une charge accrue pour les finances publiques durant la phase de mise en œuvre de l’accord, suivie d’une augmentation durable des recettes annuelles. Les cantons et les communes n’auraient pas de frais supplémentaires à supporter, mais pourraient profiter dès le début d’une augmentation des recettes en raison de l’effet de croissance.
■ Mesures d’accompagnement
Les pertes de revenus à court et moyen termes précédemment évoquées que subiront certaines parties du secteur agroalimentaire exigent la prise de mesures d’accompagnement destinées à soutenir l’adaptation des exploitations à la nouvelle situation du marché. Ces mesures serviront à créer des conditions-cadre applicables à tout le secteur agroalimentaire et lui permettront dès le départ de faire jouer ses atouts sur un marché libéralisé. A cette fin, les mesures d’accompagnement doivent satisfaire aux exigences suivantes:
3.1 DÉVELOPPEMENTS INTERNATIONAUX 3 254
–Lors du passage à un marché libéralisé, elles devront, en premier lieu, soutenir les exploitations agricoles dans leur nouvelle orientation et les aider à utiliser rapidement et de manière optimale le potentiel des nouveaux marchés.
–Elles devront promouvoir les atouts (qualité, crédibilité, confiance, modes de production respectueux de l’environnement et des animaux, etc.) du secteur agroalimentaire suisse.
–Elles devront également soutenir les exploitations agricoles qui se reconvertiront dans un nouveau secteur.
–Elles doivent être conçues de telle façon que l’évolution structurelle engendrée par les nouvelles conditions-cadre ne soit pas entravée. L’objectif est de disposer de structures créant des conditions économiques optimales pour les exploitations restantes.
Les mesures d’accompagnement sont limitées dans le temps. A titre complémentaire, il s’agira d’envisager aussi l’adaptation des instruments permanents de la politique agricole et d’autres domaines politiques. Un groupe de travail constitué d’experts extérieurs à l’administration et de représentants des milieux concernés doit élaborer d’ici mai 2009 des propositions de concrétisation des mesures d’accompagnement.
Le groupe de travail «mesures d’accompagnement» consiste en représentants des organisations suivantes:
–Union suisse des paysans (USP)
–Fédération des producteurs suisses de lait (PSL)
–Association suisse des organisations d’agriculture biologique (Bio-Suisse)
–Association suisse des paysannes et paysans pratiquant la production intégrée (PI-Suisse)
–Fédération suisse des producteurs de céréales (FSPC) pour la culture des champs
–Union maraîchère suisse (UMS) pour les cultures spéciales
–Fédération des éleveurs et producteurs de porcs (Suisseporcs) pour les producteurs de viande
–Fédération des entreprises suisses (economiesuisse)
–Fédération des industries alimentaires suisses (FIAL)
–Association de l’industrie laitière suisse (AIL)
–Union professionnelle suisse de la viande (UPSV)
–Association suisse du commerce de fruits, légumes et pommes de terre (Swisscofel)
–Fromarte (Association représentant les intérêts des artisans fromagers)
–Communauté d’intérêt du commerce de détail suisse (CI CDS)
–Communauté d’intérêts pour le secteur agro-alimentaire suisse (CISA)
–Forum des consommateurs (kf)
–2 représentants de la Conférence des directeurs cantonaux de l’agriculture
3. ASPECTS INTERNATIONAUX 3.1 DÉVELOPPEMENTS INTERNATIONAUX 3 255
■ Financement des mesures d’accompagnement

Les mesures d’accompagnement précédemment évoquées exigent une injection de fonds publics de l’ordre de plusieurs milliards. Afin de garantir le soutien aux domaines concernés, il est nécessaire de constituer à temps une réserve du bilan pour le financement ultérieur des mesures d’accompagnement. L’ampleur des moyens nécessaires à cet effet sera fonction du recul du revenu sectoriel agricole qui ne peut pas être compensé par des gains de productivité et une évolution structurelle socialement supportable. Le montant du recul du revenu sectoriel dépend tant de l’évolution des prix et des coûts que du résultat des négociations et devra donc être recalculé au moment de l’entrée en vigueur de l’accord.
Le financement des mesures planifiées devrait vraisemblablement être réparti sur plusieurs années pour répondre aux exigences du frein à l’endettement. Il s’agit là de l’instrument central pour atteindre les objectifs de la politique financière. Le 10 septembre 2008, le Conseil fédéral a adopté un projet de consultation sur la création d’une réserve du bilan pour le financement de mesures d’accompagnement en faveur de l’agriculture. Selon ce projet, des moyens seraient réservés d’avance pour le financement ultérieur des mesures d’accompagnement grâce à un financement spécial tel qu’il est prévu à l’art. 53 de la loi fédérale sur les finances. Le système consisterait à réserver au financement des mesures d’accompagnement les recettes provenant des droits de douane à l’importation de produits agricoles et de denrées alimentaires, et ce avant l’entrée en vigueur de l’ALEA. Le budget fédéral doit de toute façon anticiper à long terme le manque à gagner qui se produirait en cas de conclusion d’un ALEA ou dans le cadre d’une ouverture multilatérale des marchés, lesquelles entraîneraient l’une comme l’autre une baisse des recettes douanières.
3.1 DÉVELOPPEMENTS INTERNATIONAUX 3 256
■ Accords de libre-échange dans le cadre de l’AELE
Accords de libre-échange avec des pays non-membres de l’UE
La tendance mondiale à conclure des accords régionaux ou suprarégionaux de libreéchange va en s’accentuant, d’autant plus que l’issue du cycle de négociations de Doha de l’OMC demeure incertaine.
La Suisse poursuit par ce moyen l’objectif de procurer à ses entreprises un accès à une sélection de marchés étrangers qui soit équivalent à celui de ses principaux concurrents étrangers. Les accords de libre-échange apportent ainsi une contribution indispensable au maintien et à l’amélioration de la compétitivité et au rayonnement économique de la Suisse.
La Suisse est membre depuis 1960 de l’Association européenne de libre-échange (AELE), dont font encore partie aujourd’hui l’Islande, la Norvège et la Principauté du Liechtenstein. Outre la Convention AELE, il existe actuellement plus de 18 accords de libre-échange AELE. De plus, l’Islande, la Norvège et la Principauté du Liechtenstein sont membres de l’Espace économique européen (EEE), auquel la Suisse n’a pas adhéré en 1992.
Le but des Etats membres de l’AELE dans l’espace méditerranéen est de participer à la grande zone euro-méditerranéenne de libre-échange qu’il est prévu de réaliser d’ici 2010 dans le cadre du Processus de Barcelone de l’UE. C’est pour cette raison que des négociations ont été entamées fin 2007 avec l’Algérie. Les Etats de l’AELE s’efforcent d’obtenir la suppression des désavantages qui frappent leurs produits sur le marché algérien depuis septembre 2005 par rapport à ceux de l’UE.
Des réunions d’experts ont par ailleurs eu lieu avec la Serbie et l’Albanie. Ces deux pays ont confirmé leur intérêt pour l’ouverture de négociations de libre-échange. Le Monténégro, qui a signé avec l’UE un accord de stabilité et d’association, a aussi pris des contacts à cet effet avec l’AELE. Avec la Russie comme avec l’Ukraine, des accords de libre-échange ne pourront être envisagés au plus tôt qu’après leur adhésion à l’OMC.
Un groupe de réflexion AELE-Inde chargé d’étudier la faisabilité d’un accord global de libre-échange a recommandé dans son rapport l’ouverture de négociations. A la demande du gouvernement mongole, une déclaration de collaboration a été signée entre les Etats de l’AELE et la Mongolie. Des contacts dans ce sens ont été également noués avec d’autres Etats, tels le Pakistan et la Malaisie. Les négociations entreprises en octobre 2005 avec la Thaïlande ont été suspendues suite aux troubles intérieurs du printemps 2006. Elles sont poursuivies à l’échelon technique. Un accord de libreéchange a été signé avec la Colombie et les négociations avec le Pérou sont en passe d’aboutir.
3. ASPECTS INTERNATIONAUX 3.1 DÉVELOPPEMENTS INTERNATIONAUX 3 257
En plus des dispositions sur la circulation des marchandises, la nouvelle génération d’accords AELE comporte des règlements relatifs à la libéralisation du commerce des services, à la protection de la propriété intellectuelle, aux investissements et aux marchés publics. La caractéristique des accords AELE est que les produits agricoles transformés sont négociés de façon multilatérale, mais que les dispositions relatives aux produits agricoles de base font par contre l’objet de négociations bilatérales, autrement dit de négociations séparées avec chacun des Etats contractants. Cette approche permet d’une part de négocier des concessions sur mesure et garantit, d’autre part, un développement autonome de la politique agricole de chacun des Etats membres de l’AELE.
La Suisse poursuit l’extension dynamique de son réseau d’accords de libre-échange, en premier lieu dans le cadre éprouvé de l’AELE. Toutefois, lorsque dans certains cas concrets, ce cadre s’avère trop rigide ou inadéquat pour la préservation de ses intérêts économiques, la Suisse a aussi la possibilité de conclure des accords bilatéraux ellemême. Le Japon, par exemple, n’était pas intéressé par un accord dans le cadre de l’AELE du fait de ses structures commerciales trop différentes de celles des Etats membres de l’AELE. La Chine aussi a préféré conclure séparément des accords bilatéraux de libre-échange avec les Etats de l’AELE plutôt que d’engager un processus multilatéral dans le cadre de cette association. En été 2008, l’accord avec le Japon était en voie de conclusion et celui avec la Chine en était seulement à la phase des études de faisabilité.

3.1 DÉVELOPPEMENTS INTERNATIONAUX 3 258
■ Accords bilatéraux de libre-échange
Accords de libre-échange hors UE avec exemples de concessions accordées dans le domaine des produits agricoles (état juin 2008)
PaysEntrée en vigueurExemples de concessions accordées Exemples de concessions accordées par par la Suisse à des pays partenaires des pays partenaires à la Suisse
Egypteratifié le 27.1.2007
Contingent de fromage réciproque, lait en poudre, miel destiné à la transformation industrielle, fleurs coupées, pommes de terre (contingent), raisins de table (contingent), huile d’olive (contingent), pêches et nectarines (contingent)
Chili1.2.2004
Iles Féroé 1.3.1995
GCC négociations (GulfCooperation terminées Council)
Raisins de table, noisettes, huile d’olive
Concessions AELE
Pas de concessions supplémentaires audelà des contingents OMC existants ou du Système généralisé de préférences (SGP)
Lait en poudre, contingent de fromage, pectine et pectinates Bétail d’élevage, viande séchée, semences de taureaux
Accès en franchise douanière au marché pour tous les produits agricoles, à l’exception de quelques lignes tarifaires
Accès en franchise douanière pour le café, le fromage, les produits laitiers et les produits à base de crème, les fleurs coupées, les pommes de terre, la margarine; réduction des droits de douane sur la confiture, les jus de fruits et de légumes, les soupes et les sauces
Israël1.1.1993
Jordanie1.1.2002
Canadaratifié le 26.1.2008
Colombienégociations terminées Croatie1.1.2002
Liban24.6.2004
Pas de concessions supplémentaires
Viande de volaille, raisins de table, huile d’olive, jus de fruits (sans adjonction de sucre)
Blé dur, viande de cheval, semences de taureaux, contingent à droit zéro pour les aliments pour chiens et chats
Fruits tropicaux, café, fruits et préparations aux légumes, cigarettes
Rabais pour le fromage, le miel, les kiwis, la farine de malt, l’huile d’olive, les soupes et les sauces
Viande de mouton et de chèvre, abats comestibles, viande de volaille, fromages frais, plantes ornementales vivantes, fleurs coupées, arbres de Noël, raisins de table (contingent), huile d’olive, charcuterie, conserves de viande
Produits agricoles transformés
Bétail d’élevage, lait en poudre, fromage à pâte dure et à pâte mi-dure, café torréfié, préparations fourragères
Fromage à pâte dure et mi-dure, viande bovine, semences de taureaux, préparations fourragères
Fromage, produits à base de viande, chocolat, biscuits, yoghourts, pâtes, vin
Bétail d’élevage, contingents de lait en poudre et de fromage, préparations alimentaires et alcool éthylique
Bétail d’élevage, lait en poudre, fromage, semences de taureaux, café torréfié, fruits en conserve, essences et extraits de café et de thés, préparations fourragères
Maroc1.1.1998
Macédoine1.1.2001
Mexique1.7.2001
Fleurs coupées, tomates, divers légumes, huile d’olive, légumes préparés, conserves de légumes, noix, jus de fruits
Conserves de légumes (mélanges), jus de fruits
Oeufs exempts d’agents pathogènes, miel destiné à la transformation industrielle, bananes, raisins de table, café brut et torréfié, jus de plantes, pectines, jus de fruits, bière, liqueurs, eau de vie
Fromage, fruits en conserve, essences et extraits de café et de thés, préparations fourragères
Bétail d’élevage, contingents de fromage, essences et extraits de café et de thés
Bétail d’élevage, semences de taureaux, pectines et pectinates, essences et extraits de café et de thés, soupes, sauces, préparations alimentaires, alcools éthyliques, liqueurs et eaux de vie, préparations fourragères
Autorité 1.7.1999
palestinienne
Miel, raisins de table, agrumes, pommes de terre, olive, huile d’olive
Lait en poudre, fromage, café torréfié, confitures, fruits en conserve
3. ASPECTS INTERNATIONAUX 3.1 DÉVELOPPEMENTS INTERNATIONAUX 3 259
Accords de libre-échange hors UE avec exemples de concessions accordées dans le domaine des produits agricoles (état juin 2008)

PaysEntrée en vigueurExemples de concessions accordées Exemples de concessions accordées par par la Suisse à des pays partenaires des pays partenaires à la Suisse
SACU ratifié le Union douanière1.7.2006 de l’Afrique australe
Tout le SPG, plus viande fraîche, réfrigérée et congelée (contingent), viande séchée (Biltong), contingent de fromages à pâte mi-dure et dure, miel destiné à la transformation industrielle, noisettes, raisins de table, caséines, ovalbumines
Bétail d’élevage, viande séchée, contingents de fromage à pâte dure et à pâte mi-dure, poudre de fruits, légumes en conserve, essences et extraits de café et de thés, soupes, sauces, préparations fourragères, cigares, cigarettes, tabac préparé
Singapour1.1.2003
Corée du Sud1.9.2006
Tunisie1.6.2005
Turquie1.4.1992
Orchidées spéciales
Conserves de légumes (Kimchi), vin de riz («Cheong ju», «Yek ju», «Tak ju», «Makkoli»)
Viande de gibier, d’autruche et de dromadaire, pommes de terre, huile d’olive (contingent)
Foies de volaille, fleurs coupées, jus de fruits, raki, huile d’olive
Accès en franchise douanière au marché pour tous les produits agricoles
Bétail d’élevage, viande séchée, contingents de fromage, semences de taureaux, vins, préparations fourragères, cigarettes
Lait en poudre, fromage fondu, confitures, fruits en conserve, essences et extraits de café et de thés, préparations fourragères
Produits agricoles transformés
3.1 DÉVELOPPEMENTS INTERNATIONAUX 3 260
■ Négociations relatives à la protection mutuelle des AOP et des IGP entre l’UE et la Suisse
Accord agricole entre la Suisse et l’UE
Le Comité mixte de l’agriculture, chargé de l’accord agricole conclu en 1999 entre la Suisse et l’UE, s’est réuni pour la septième fois le 29 novembre 2007 à Berne sous la présidence de la Suisse. La délégation du Lichtenstein, faisant partie de la délégation suisse, a pour la première fois participé à une séance du Comité mixte. Suite à l’accord additionnel qui étend l’accord agricole Suisse-CE de 1999 au Lichtenstein, la Principauté peut faire valoir ses intérêts par l’intermédiaire de la délégation suisse dans le Comité mixte. Cet accord additionnel a été signé le 27 septembre 2007 par les trois Parties à Bruxelles et est entré en vigueur le jour même.
La Suisse a accueilli favorablement l’abandon des licences d’importation européennes pour le fromage au 1er janvier 2008, qui supprime les derniers obstacles administratifs dans le cadre de l’accord de libre-échange sur le fromage. Depuis, les commerçants ne doivent plus présenter qu’un certificat d’origine pour pouvoir exporter. Le libreéchange des fromages entre la Suisse et l’UE est en vigueur depuis le 1er juin 2007.
Après l’adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie à l’UE, la Suisse et l’UE ont convenu de maintenir les anciennes préférences douanières, conclues dans le cadre des accords AELE, pour des quantités correspondant aux échanges enregistrés jusqu’alors et de les transformer en contingents tarifaires en faveur de l’UE à 27. En contrepartie, la Suisse a obtenu des contingents à droit zéro pour les côtes de bettes, les cardons et les fraises. L’UE a mis en œuvre les concessions au 1er septembre 2007, alors que la Suisse les appliquera rétroactivement à l’année 2007.
La Suisse et l’UE ont convenu de communautariser, en faveur de l’UE, les contingents tarifaires bilatéraux de saucisses qui existaient auparavant dans les échanges avec l’Italie, l’Allemagne et la Hongrie, de réduire les droits de douane à zéro et d’augmenter le volume de 800 t. Pour sa part, la Suisse a obtenu de l’UE un nouveau contingent à droit zéro pour les mêmes produits de charcuterie. Les deux Parties ont convenu d’appliquer réciproquement et de manière autonome les concessions, à partir du 1er janvier 2008.
Dans le paquet Bilatérales I, l’UE et la Suisse avaient exprimé leur intention d’inclure des dispositions de protection mutuelle pour les appellations d’origine protégées (AOP) et les indications géographiques protégées (IGP) des produits agricoles telles qu’elles existent déjà pour les vins et les spiritueux. Sur cette base, le Conseil fédéral a octroyé en juin 2005 un mandat de négociation dont l’objectif était de procéder à une reconnaissance mutuelle des différentes dénominations suite à un échange de listes de dénominations protégées. Suite au panel sur les indications géographiques réuni par les USA et l’Australie dans le cadre de l’OMC, l’UE a été contrainte de modifier son règlement en 2006 et rejette depuis l’approche d’échange de listes. Un tel accord comporterait, à ses yeux, en fonction de la clause de la nation la plus favorisée (NPF), le risque de devoir accorder la même protection à des indications géographiques de pays tiers qui ne correspondent pas aux standards communautaires. C’est pourquoi la Commission a proposé à la Suisse une nouvelle approche pour un accord: chaque Partie soumettrait à l’autre Partie une liste de dénominations à protéger. Ces dernières seraient examinées et soumises à une procédure d’opposition et d’enregistrement.
3. ASPECTS INTERNATIONAUX 3.1 DÉVELOPPEMENTS INTERNATIONAUX 3 261
Ainsi, un tel accord ne pourrait pas exclure la procédure d’opposition, mais tout au plus la simplifier (enregistrement simplifié).
Les négociations entre la Suisse et l’UE pour la protection mutuelle des AOP et des IGP ont débuté en octobre 2007 et se sont poursuivies à un rythme intense. La dernière réunion en date a eu lieu en juin 2008 à Bruxelles. Le défi principal consiste à concilier la nécessité de solutions négociées pour les dénominations intéressant les deux Parties et la volonté de la Commission européenne de prévoir des procédures d’opposition et de recours pour toutes les dénominations. Le rapprochement des positions sur un projet de texte est actuellement freiné en raison des différences existant dans ces procédures entre la Suisse et l’UE. Les deux Parties restent néanmoins constructives pour surmonter cette difficulté. La Suisse garde comme objectif la conclusion d’un accord représentant une plus-value par rapport à l’enregistrement direct et individuel des dénominations et garantissant au maximum la sécurité juridique de ses opérateurs.
Protocole 2
Le Protocole 2 de l’accord de libre-échange conclu par la Suisse et l’UE autorise la Suisse, dans le commerce avec l’UE, à compenser les désavantages de prix au niveau des matières premières agricoles en accordant des subventions à l’exportation de ses produits transformés et en prélevant des droits de douanes sur les importations. Ces mesures de compensation ne doivent toutefois pas dépasser la différence de prix entre les matières premières agricoles de la Suisse et celles de l’UE. Le Protocole 2 comporte les prix de référence et les différences de prix qui sont déterminants pour la fixation des mesures de compensation et charge le Comité mixte de contrôler au moins une fois par an les prix de référence et de les adapter si besoin est.
Le prix des matières premières sur les marchés internationaux a fortement augmenté ces derniers temps. Les marchés internationaux des matières premières se caractérisent de surcroît par une forte volatilité des cours. Les causes de cette évolution sont à chercher aussi bien du côté de l’offre que du côté de la demande. Le changement des habitudes de consommation de larges couches de la population dans certains pays émergents, en particulier la Chine et l’Inde, et la tendance persistante à produire toujours plus de bioéthanol ont gonflé la demande. Par ailleurs, des récoltes moins abondantes et les restrictions temporaires d’exportation décrétées par certains pays grands exportateurs de produits agricoles ont entraîné une réduction de l’offre. Enfin, le fait que dans le même temps, de puissants instituts financiers se soient mis à investir sur les marchés des matières premières a pour le moins contribué à la forte volatilité des marchés.
3.1 DÉVELOPPEMENTS INTERNATIONAUX 3 262
■ «Derniers développements»
Durant la période de référence (septembre et octobre 2007) pour les prix valables à partir du 1er février 2008, le prix du lait en poudre suisse a été temporairement inférieur à celui pratiqué dans l’UE. Cependant, dès la fin 2007, il est remonté à un niveau supérieur à celui du prix UE. Aussi, lorsque les nouveaux prix de référence sont entrés en vigueur, ils ne correspondaient déjà plus à la situation réelle en ce qui concerne certaines matières premières agricoles.
Il en a résulté un handicap considérable pour les exportateurs suisses de produits transformés à base de lait entier et de lait écrémé. En ce qui concerne le beurre aussi, s’est instaurée depuis le 1er février 2008 une situation de sous-compensation, du fait que les prix internationaux étaient déjà redescendus, tandis que le prix sur le marché intérieur avait grimpé. En ce qui concerne la farine de blé, compte tenu du calcul du prix EU sur la base d’un coefficient (rapport entre le prix du blé panifiable et du blé tendre suisses ), il subsistait une différence trop peu importante, si bien que les exportations suisses ont été dans ce cas aussi sous-compensées.
L’administration fédérale a ainsi reçu de nombreuses demandes d’autorisation pour le trafic de perfectionnement actif. L’interprofession a alors mis en place des mesures d’entraide pour compenser le handicap lié au prix des matières premières et l’autorisation pour le trafic de perfectionnement actif n’a donc pas été délivrée.
Compte tenu des prix de référence en vigueur, l’UE était habilitée, à partir du 1er février 2008, à prélever des droits de douane sur les produits de l’industrie alimentaire suisse contenant du lait en poudre ou à accorder des subventions aux exportations vers la Suisse. Cela a entamé un peu plus encore la compétitivité de l’industrie alimentaire suisse tournée vers l’exportation.
A la mi-2008, de nouveaux prix de référence ont pu être négociés dans le cadre d’entretiens d’experts et sont entrés en vigueur en été 2008. Le prix du lait en poudre et d’autres matières premières agricoles a pu être adapté aux conditions réelles sur les deux marchés de référence. Cela signifie concrètement qu’avec l’entrée en vigueur des prix révisés, la Suisse peut de nouveau prélever des droits de douane sur les produits alimentaires en provenance de l’UE qui contiennent du lait en poudre ou que les exportateurs suisses de ce genre de produits peuvent de nouveau bénéficier de restitutions sur ces exportations. L’expérience de cette année montre que les marchés volatiles ont mis en évidence les limites du système de compensation des prix prévu par le Protocole 2.
3. ASPECTS INTERNATIONAUX 3.1 DÉVELOPPEMENTS INTERNATIONAUX 3 263
■ Bilan de santé de la Politique agricole commune (PAC)
Politique agricole commune de l’UE
La Commission européenne a proposé le 20 mai 2008 de moderniser, de simplifier et de rationaliser la politique agricole commune (PAC), ainsi que de lever certains obstacles empêchant les agriculteurs de répondre à la demande croissante de produits alimentaires. Ce processus, baptisé «Bilan de santé de la PAC», propose notamment les mesures suivantes:
1.Suppressions des quotas laitiers, des jachères obligatoires et de la prime aux cultures énergétiques: Les quotas laitiers auront entièrement disparu en avril 2015. Pour garantir un «atterrissage en douceur», la Commission propose de relever ces quotas au moyen de cinq augmentations annuelles de 1% entre les campagnes 2009/10 et 2013/14. Elle propose aussi de supprimer l’obligation faite aux exploitants de terres arables de maintenir 10% de leurs terres en jachère.
2.Découplage des aides: suppression des derniers paiements couplés et intégration dans le régime de paiement unique (RPU), à l’exception de la prime à la vache allaitante ainsi que des primes aux ovins et aux caprins, que les États membres pourront maintenir couplées à leur niveau actuel.
3.Abandon progressif des paiements «historiques»: dans certains Etats membres, les agriculteurs perçoivent des aides dont le montant est calculé sur la base du soutien dont ils ont bénéficié au cours d’une période de référence. Dans d’autres Etats, ces paiements sont déterminés sur une base régionale, par hectare. Avec le temps, le modèle «historique» devient de plus en plus difficile à justifier. C’est pourquoi la Commission propose d’autoriser les États membres à adopter un système de paiements plus uniforme.
4.Hausse de la modulation: en 2008 les agriculteurs de l’UE qui reçoivent des aides directes d’un montant supérieur à 5’000 € par an voient ces paiements réduits de 5%, les moyens correspondants étant transférés au budget du développement rural. La Commission propose de porter ce taux à 13% d’ici à 2012. Des réductions supplémentaires seront opérées pour les grandes exploitations (le prélèvement additionnel s’élèvera respectivement à 3%, 6% et 9% pour les exploitations percevant plus de 100’000 euros, 200’000 euros et 300’000 euros par an). Les moyens provenant de l’application de ce mécanisme pourront être utilisés par les États membres pour renforcer les programmes concernant le changement climatique, les énergies renouvelables, la gestion de l’eau et de la biodiversité.
5.Mécanismes d’intervention: suppression de l’intervention pour la viande de porc. Pour les céréales fourragères, l’intervention sera fixée à zéro, alors que pour le blé tendre, le beurre et le lait écrémé en poudre, un mécanisme d’adjudication sera introduit.
3.1 DÉVELOPPEMENTS INTERNATIONAUX 3 264
■
6.Conditionnalité: l’aide aux agriculteurs est subordonnée au respect de normes dans les domaines de l’environnement, du bien-être animal et de la qualité des aliments. Les agriculteurs qui ne se conforment pas aux règles s’exposent à une réduction des aides dont ils bénéficient. Ce système, appelé «conditionnalité», sera simplifié. De nouvelles exigences seront ajoutées, destinées à préserver les avantages environnementaux des jachères et à améliorer la gestion de l’eau.
7.Limitation des paiements: les Etats membres devront prévoir un seuil de paiement de 250 euros par exploitation ou une superficie admissible minimale d’un hectare par exploitation, ou les deux.
Lors du troisième débat des ministres de l’agriculture de l’UE sur le bilan de santé de la PAC, le 15 juillet 2008 à Bruxelles, plusieurs Etats membres ont exprimé des réserves à l’égard des propositions concernant l’augmentation du taux de modulation des aides directes, l’érosion des mécanismes d’intervention et le caractère obligatoire des normes de bonnes conditions agricoles et environnementales. Le débat au niveau ministériel devrait s’intensifier cet automne 2008.
Le lecteur intéressé trouvera plus d’informations sur le bilan de santé de la PAC à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/agriculture/healthcheck/index_fr.htm.
OMC
La dynamique des négociations OMC dans le cadre du cycle de Doha qui s’était accélérée depuis septembre 2007 a été rompue lors de la Conférence ministérielle de juillet 2008, à Genève. Au moment de la rédaction du présent rapport agricole, les perspectives de poursuite des négociations sont incertaines compte tenu du poids de plusieurs facteurs de politique interne, entre autres, l’élection présidentielle du 4 novembre 2008 aux Etats-Unis.
Durant la phase préparatoire à la conférence ministérielle, quelques travaux préliminaires ont été accomplis, principalement dans les champs de négociation «produits agricoles» et «biens industriels». Ils ont abouti à l’élaboration de plusieurs versions des «modalités» (points décisifs pour la réalisation d’un accord global). Ainsi, en ce qui concerne le dossier agricole, trois versions de ces modalités ont été mises successivement sur la table (février, mai et juin 2008) par le chef de négociation, l’ambassadeur néo-zélandais, Crawford Falconer. Toutes ont contribué à réduire notablement le nombre des points en suspens. De plus, des aspects méthodiques, tel le calcul de l’extension du contingent qui aurait dû être adopté à titre de compensation lors de la déclaration de produits sensibles, ont été clairement formulés. Il a été également possible de faire largement converger les positions dans d’autres domaines, tels que le traitement de produits tropicaux et l’administration des contingents tarifaires. Ces initiatives ont rehaussé le niveau d’ambition dans le domaine agricole, en particulier au niveau de l’accès au marché, entre autres par l’introduction d’une réduction des droits de douane d’au minimum 54% sur toutes les lignes tarifaires et par la suppression ou la réduction à plus que 1,5% seulement sur toutes les lignes tarifaires de la clause de sauvegarde spéciale s’appliquant aux pays développés.
3. ASPECTS INTERNATIONAUX 3.1 DÉVELOPPEMENTS INTERNATIONAUX 3 265
Déroulement des négociations dans le cadre du cycle de Doha depuis septembre 2007
■ Examen de la politique commerciale suisse (Trade Policy Review)

Au cours des négociations au niveau ministériel, conduites dans un premier temps avec un trentaine de ministres et par la suite principalement au sein d’un groupe restreint de sept représentants des pays économiquement les plus importants (Australie, Brésil, Chine, UE, Inde, Japon et Etats-Unis), un accord sur les points essentiels dans les domaines agricole et industriel semblait possible De plus, des avancées se profilaient dans d’autres domaines de négociation du cycle de Doha, tel le secteur des services. Le processus s’est néanmoins bloqué au sein du groupe des sept à propos du mécanisme de sauvegarde spéciale pour les pays en développement sur lequel les négociations ont achoppé. Cette situation a été unanimement déplorée dans les premières déclarations qui ont suivi la rupture des négociations. Leurs auteurs ont plaidé pour une reprise du processus en partant des résultats déjà obtenus.
La politique commerciale suisse fait l’objet en 2008 d’un examen par le Secrétariat de l’OMC. Au terme de cette procédure qui a lieu tous les quatre ans, le Secrétariat de l’OMC établit un rapport sur tous les aspects de la politique commerciale du pays considéré et en évalue l’évolution. Dans le chapitre consacré à l’agriculture, l’analyse se concentre sur divers aspects de l’accès au marché et du soutien interne à l’agriculture et en particulier sur les changements initiés par la PA 2011. La Suisse avait toute latitude de prendre position sur ce rapport, comme c’est le cas dans le cadre de ces examens des politiques commerciales par l’OMC. Elle a élaboré de son côté un rapport sur les changements de sa politique commerciale qu’elle a ensuite distribué aux Etats membres. Lors d’une visite des services de l’administration suisse en août 2008, le Secrétariat de l’OMC a abordé certains points du rapport de manière plus approfondie. Après publication des deux rapports en décembre 2008, tous les pays membres de l’OMC auront la possibilité de formuler des questions sur lesquelles la Suisse prendra position dans le cadre d’une procédure d’audition.
3.1 DÉVELOPPEMENTS INTERNATIONAUX 3 266
FAO
En 2005, le Conseil de la FAO avait engagé la première évaluation externe indépendante (EEI) de l’Organisation dont l’objectif était de renforcer et d’améliorer la FAO. Ladite évaluation, réalisée par un team d’experts internationaux de haut niveau, avait porté sur tous les aspects du travail, de la structure institutionnelle et des processus de décision de la FAO, y compris sur son rôle au sein du système international.
L’équipe d’évaluation a déposé, en automne 2007, son rapport sous le titre «FAO: Le défi du renouveau». Selon l’EEI, la FAO fournit une gamme de produits et de services utiles et efficaces et «si la FAO venait à disparaître demain, il faudrait la réinventer mais sous une forme différente». Le monde a besoin de la FAO mais la FAO doit changer radicalement et de toute urgence. L’EEI a proposé une réforme assortie de croissance «reform with growth» et a pour ce faire formulé 110 recommandations à mettre en œuvre. Elle a recommandé l’élaboration et l’adoption d’un Plan d’action immédiat basé sur ses recommandations.
L’EEI a suggéré de raviver la FAO autour des quatre grands pôles suivants:
–un nouveau cadre stratégique, la FAO devant définir ses priorités sur la base de ses avantages comparatifs, –l’investissement dans la gouvernance, notamment en renforçant le rôle et l’indépendance du Conseil, –la modification de la culture institutionnelle («culture opposée au risque») de l’Organisation et la réforme des systèmes administratifs et de gestion de la FAO et –la restructuration des services du siège et de terrain pour assurer l’efficacité et l’efficience.
Appelée à se prononcer sur la suite à donner à l’EEI, la 34ème session de la Conférence de la FAO, en novembre 2007, a notamment décidé:
–de mettre en route le processus de réforme par l’élaboration d’un Plan d’action immédiat et d’un Cadre stratégique pour le renouveau de l’Organisation;
–de convoquer en novembre 2008 une session extraordinaire de la Conférence afin de décider des propositions pour un Plan d’action immédiate ainsi que des incidences financières; –d’établir un Comité de la Conférence de durée limitée chargé d’élaborer les propositions relatives à un Plan d’action immédiate.
Ce Comité a commencé ses travaux en décembre 2007. Il a constitué trois groupes de travail. La Suisse a été membre du groupe de travail I chargé de se pencher sur la «Vision et les programmes prioritaires de la FAO». Le Comité a déposé son rapport final en octobre 2008. Ce rapport, incluant le Plan d’action immédiate pour le renouveau de la FAO, sera soumis pour adoption à une session spéciale de la Conférence de la FAO en novembre 2008.
3. ASPECTS INTERNATIONAUX 3.1 DÉVELOPPEMENTS INTERNATIONAUX 3 267
■ Réforme de la FAO
■ Conférence ministérielle de la FAO sur la sécurité alimentaire, le changement climatique et les biocarburants.
La Suisse a soutenu, dès le départ, l’idée de la réalisation d’une Evaluation externe indépendante et a été l’un des premiers pays à lui apporter une contribution financière. Elle a également suivi et participé de manière active aux travaux liés à cette évaluation et a accueilli de manière favorable le rapport d’évaluation dont le contenu fournit une excellente base pour entreprendre la réforme nécessaire de l’Organisation. La Suisse souhaite collaborer avec une FAO forte, efficace et dynamique, en mesure de répondre aux besoins de ses membres. Son objectif est de renforcer la FAO afin de lui permettre de relever les grands défis du XXIe siècle, notamment ceux de la sécurité alimentaire et de l’utilisation durable des ressources naturelles. La Suisse considère que la FAO devra assumer de manière efficace son rôle de chef de file en matière de questions touchant l’alimentation, l’agriculture et les ressources naturelles, en devenant un véritable forum d’échanges, de discussions et de négociations au niveau de la définition des politiques et de leur mise en œuvre et en se fondant sur les trois objectifs de l’Organisation à savoir:
–l’éradication de la faim et de la malnutrition, –la contribution de l’agriculture au développement économique et social, –la conservation et la gestion durable des ressources naturelles pour l’alimentation et l’agriculture ainsi que la sécurité sanitaire et la qualité des denrées alimentaires.
Plus d’informations sont disponibles à l’adresse suivante: http://www.fao.org/ieefollow-up-committee/home-iee/fr/?no_cache=1
Le prix des denrées alimentaires sur le marché international a fortement augmenté depuis 2006. La FAO craint qu’en raison de ces développements le nombre des personnes souffrant de la faim n’augmente de 100 millions pour passer à près de 1 milliard. C’est sur cette toile de fond que la FAO a organisé à Rome, du 3 au 5 juin 2008, une conférence axée sur la problématique de la sécurité alimentaire et de la lutte contre la pauvreté dans un contexte de flambée des prix des produits alimentaires, d’aggravation des changements climatiques et de production accrue de bioénergie.
La quarantaine de chefs d’Etat présents se sont mis d’accord pour une augmentation rapide de l’aide d’urgence. Divers pays, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et la Banque islamique de développement ont promis une aide de plusieurs milliards. Une majorité des représentants gouvernementaux présents étaient d’avis que la solution à long terme réside dans une augmentation de la production sur la base d’une agriculture locale durable. Les pays exportateurs de produits agricoles ont plaidé pour une augmentation de la production grâce à l’intensification de l’agriculture et pour une libéralisation rapide des marchés agricoles. La production de biocarburants a été citée par la plupart comme l’une des causes majeures de la hausse marquée des produits alimentaires. Par contre, le Brésil et la Slovénie (assurant à cette période la présidence de l’UE) ont soit nié, soit minimisé, les répercussions dommageables des biocarburants sur la crise alimentaire. La grande majorité des délégués des plus de 180 pays représentés était en revanche d’avis que les changements climatiques allaient influer négativement sur la production des denrées alimentaires. L’agriculture doit réduire ses émissions de gaz à effet de serre et s’adapter au changement climatique.
3.1 DÉVELOPPEMENTS INTERNATIONAUX 3 268
Dans sa déclaration, la délégation suisse, conduite par Manfred Bötsch, a souligné l’importance d’une organisation efficace, cohérente et bien coordonnée des activités internationales de lutte contre la faim. La Suisse a confirmé qu’une agriculture multifonctionnelle s’appuyant sur une production locale durable, des exploitations de type familial, l’ouverture progressive des marchés agricoles à des conditions équitables pour les pays en développement ainsi que l’encouragement de la recherche et de l’innovation devaient constituer les piliers stratégiques de la sécurité alimentaire à venir. La Suisse a en outre souligné que les biocarburants ne pourraient avoir un avenir que si les répercussions écologiques et sociales ainsi que leurs effets sur la sécurité alimentaire étaient intégrés dans l’évaluation de leur durabilité. De ce point de vue, la représentation suisse a insisté sur la nécessité de définir des conditions-cadre internationales et des critères de durabilité applicables au niveau international.
Après trois jours de discussions serrées, la Conférence s’est terminée par l’adoption d’une déclaration finale. L’augmentation de l’aide immédiate y est recommandée en tant que mesure à court terme. La Conférence propose aussi de recourir à l’offre des marchés locaux et régionaux. Afin d’augmenter à long terme la production de denrées alimentaires et la productivité, les ressources doivent être gérées plus efficacement et de manière durable. L’accès à la nourriture pour les populations affamées et aux marchés pour les petits paysans des pays en développement doit être amélioré. La libéralisation des marchés agricoles doit être poursuivie parallèlement. La déclaration finale exige en outre une étude approfondie de la durabilité des biocarburants. Afin de pouvoir assurer la sécurité alimentaire à venir, compte tenu aussi des effets du changement climatique, il est nécessaire d’investir davantage encore dans la recherche et le développement et d’améliorer la coopération internationale. La Task Force récemment constituée sous la direction du Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-Moon, va reprendre les recommandations énoncées dans la déclaration et formuler des actions concrètes.
Des informations supplémentaires sont disponibles sous http://www.fao.org/foodclimate/hlc-home/fr/.
3. ASPECTS INTERNATIONAUX 3.1 DÉVELOPPEMENTS INTERNATIONAUX 3 269
OCDE
La situation exceptionnelle sur les marchés agricoles mondiaux durant l’année 2008 a également marqué les travaux de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).
–La publication annuelle OECD-FAO-Agricultural Outlook qui pronostique l’évolution de la demande, de l’offre et des prix des principaux produits agricoles pour la prochaine décennie, a étudié en profondeur la situation tendue sur les marchés internationaux. Selon ses conclusions, les prix, qui ont atteint un record historique, devraient avoir plus ou moins atteint leur maximum. A moyen et long termes, ils devraient redescendre, mais se stabiliser à un niveau nettement plus élevé que la moyenne de ces dernières années. Les modèles de l’OCDE et de la FAO prédisent de plus une volatilité accrue des prix sur les marchés agricoles, due aux fluctuations des récoltes en raison du changement climatique, à la spéculation sur les produits agricoles et au bas niveau des réserves alimentaires mondiales. Cette édition d’Agricultural Outlook, qui comporte pour la première fois un chapitre consacré aux biocarburants, prévoit une nette augmentation des carburants issus de ressources renouvelables. La production de bioéthanol devrait doubler d’ici 2017 pour atteindre quelque 125 milliards de litres par an. La production de biodiesel devrait même augmenter plus fortement encore et atteindre 24 milliards de litres par an dans dix ans.
–L’évolution sur les marchés agricoles a aussi été abondamment commentée dans la publication OECD-Agricultural Policies: Monitoring and Evaluation Report, qui présente une évaluation annuelle des politiques agricoles des pays de l’OCDE. Les prix élevés ont grandement contribué à ce que l’indice ESP (estimation du soutien aux producteurs), qui représente l’évaluation du transfert monétaire annuel des contribuables et des consommateurs aux producteurs agricoles, atteigne un plancher record. La part du soutien à la valeur de production est en baisse depuis 1986: de 37%, elle est passée à 23% aujourd’hui. En ce qui concerne la Suisse, l’indicateur de soutien a baissé de 12 points par rapport à l’année précédente pour atteindre actuellement 50%. Par comparaison avec la valeur maximale enregistrée en 1988, cela représente un recul de 28%. Si à la fin des années 80, les prix en Suisse étaient encore presque cinq fois plus élevés que les prix sur le marché mondial, ils n’atteignent même plus le double aujourd’hui. Dans son évaluation, l’OCDE loue la Suisse pour les mesures de réduction de la régulation du marché et de la protection à la frontière pour les céréales fourragères qu’elle a prises dans le cadre de la PA 2011. Les experts critiquent par contre la forte protection douanière qui constitue encore près de la moitié du soutien à l’agriculture.
3.1 DÉVELOPPEMENTS INTERNATIONAUX 3 270
Commission des Nations Unies pour le Développement Durable (CSD)
Depuis 1992, la CSD fait office d’instance de haut niveau aux Nations Unies pour le suivi des objectifs du développement durable. La 16ème Session de la Commission pour le Développement Durable s’est tenue du 5 au 16 mai 2008 au siège des Nations Unies à New-York et avait pour objectif la revue des progrès réalisés dans les domaines de l’agriculture, du développement rural, des sols, de la sécheresse, de la désertification, de l’Afrique, de l’eau et de l’assainissement. Compte tenu des difficultés d’approvisionnement en denrées alimentaires auxquelles ont été confrontés un bon nombre de pays importateurs nets depuis le début de l’année 2008, les thèmes de l’Agenda ont eu l’avantage de répondre à des questions d’actualité. L’OFAG a présidé les travaux interdépartementaux de préparation et de suivi de cette 16ème session de la Commission pour la Suisse.
Les gouvernements ont constaté une dégradation sensible des ressources naturelles. Ils en ont conclu que d’importants changements étaient nécessaires à l’avenir pour faire face à la demande croissante en denrées alimentaires et en énergie au niveau mondial. Cet état de fait est encore renforcé par les changements climatiques.
L’agriculture a été reconnue comme un secteur important mais trop négligé pour le développement des zones rurales et la lutte contre la pauvreté. La nécessité d’un réinvestissement massif, particulièrement afin d’encourager la production agricole locale diversifiée à travers un soutien accru aux exploitations familiales et surtout aux femmes, a été identifiée. Le problème de désertification, de dégradation des sols et la perte des surfaces cultivables ont été identifiés comme des menaces réelles et nécessitant une attention particulière à l’avenir. Le manque de données fiables pour une gestion durable des ressources naturelles, l’instabilité politique, la mauvaise gouvernance, le manque de volonté politique, le manque de coordination entre les secteurs, le poids politique faible des organisations d’agriculteurs et les faiblesses de mise en œuvre ont été reconnus comme les obstacles principaux au progrès vers un développement durable. La Suisse s’est engagée pour une agriculture multifonctionnelle, assurant la productivité et la rentabilité, mais aussi ménageant les ressources naturelles (l’eau, le sol et la biodiversité) et contribuant au développement rural. La reconnaissance des services rendus par les agriculteurs au plan écologique a été présentée comme un moyen innovateur permettant une gestion intégrée des ressources. Une attention particulière a été portée sur la gestion des sols et la perte des sols arables au niveau mondial. Concernant les biocarburants, la Suisse a exprimé la nécessité de mettre en place des conditions-cadre internationales assurant un effet positif prouvé de leur utilisation tout en assurant que leur production remplit les standards sociaux et environnementaux minimaux. La Suisse a aussi organisé un «side event» sur les «Défis pour un développement durable en région de montagne» où le projet de la FAO «Sustainable Agriculture in Mountain Regions» (SARD-M) et les travaux du Groupe d’Adelboden ont été présentés.
3. ASPECTS INTERNATIONAUX 3.1 DÉVELOPPEMENTS INTERNATIONAUX 3 271
En 2009, la Suisse sera à nouveau présente à la 17ème session de la Commission pour y négocier des recommandations concrètes.
3.1 DÉVELOPPEMENTS INTERNATIONAUX 3 272
3.2Comparaisons internationales
L’année dernière, le chapitre Comparaisons internationales du rapport agricole a traité plus spécialement de la forte augmentation du prix du lait et d’importants produits végétaux sur le marché international. L’étude de l’évolution des prix internationaux est poursuivie dans la présente édition. Elle est complétée par une comparaison des prix à la production entre la Suisse et l’Allemagne et par une représentation de l’évolution des prix à la consommation en Suisse par rapport à l’UE.
L’année 2007 s’est caractérisée par une hausse notable du prix des produits alimentaires de base sur les marchés internationaux. En ce qui concerne les produits laitiers, cette hausse s’est amorcée dès la fin 2006. En 2007 (moyenne annuelle), le prix du beurre avait augmenté de 87%, celui du lait écrémé en poudre de 93%, celui du lait entier en poudre de 91% et celui du cheddar de 51% par rapport à 2006 (moyenne annuelle). En ce qui concerne les céréales, la montée des prix s’est produite un peu plus tard, à savoir à la mi-2007. Celle du maïs a commencé fin 2007 et a été un peu moins marquée.

■■■■■■■■■■■■■■■■■
Les prix internationaux demeurent élevés Evolution
de produits Indice, 1998/2000 = 100 50 150 100 200 250 300 350 200001020304050607Jan 08 Fév 08 Mars 08 Avr 08 Mai 08 Juin 08 JuiI 08 Août 08 Céréales Lait Viande Source: FAO Sucre Huiles et graisses 3.2 COMPARAISONS INTERNATIONALES 3 273
■
des prix pour divers groupes
■ Evolution en 2008
Alors que les prix des produits laitiers avaient déjà atteint leur maximum fin 2007, ceux des céréales l’ont atteint au printemps 2008 et ceux des huiles et des graisses, au début de l’été 2008. Depuis, tous les prix sont redescendus. A l’exception du prix du lait, ils se sont toutefois stabilisés au niveau élevé de fin 2007. Le prix du lait a enregistré une baisse plus marquée, mais en été 2008, il était encore supérieur à la moyenne 2006.
Contrairement à ce qui se passe pour les produits végétaux, on n’observe aucune tendance à la baisse du prix de la viande. Après un fléchissement au printemps 2008, le prix du sucre affiche de nouveau une tendance à la hausse.
Evolution des prix des matières premières
CH lait août, D lait août, pommes de terre de table août Légumes Suisse: prix indicatifs franco grande distribution; légumes Allemagne: prix marché de gros
Sources: Ministère bavarois de l’agriculture et des forêts, USP, OFS, CCM, FUS, swisspatat, ZMP
Produits Ø 2006Ø 20072008 (sept.) DCHDCHDCH Laitct./kg43.0271.8254.9670.0454.4584.39 Viande Taureaux T3fr./kg PM4.798.224.748.735.269.18 Veaux T3fr./kg PM8.0814.078.4014.527.6714.90 Porcsfr./kg PM2.373.762.244.042.824.98 Poulet cl. 1fr./kg PV1.042.541.282.411.392.63 Céréales et oléagineux Blé cl. 1fr./100 kg18.2151.9535.1652.1026.8257.96 Orgefr./100 kg16.2639.5530.7436.6222.1637.11 Maïs-grainfr./100 kg19.3941.0232.3641.0224.6139.55 Colzafr./100 kg35.7876.9948.6083.6656.5497.66 Cultures sarclées Pommes de terre de tablefr./100 kg31.6651.4521.3545.6031.9249.30 Betteraves sucrièresfr./100 kg6.9111.496.7311.866.3311.10 Légumes Carottesfr./kg0.751.440.781.480.841.53 Tomates rondesfr./kg2.142.592.112.482.352.45 Laitue pomméefr./kg2.183.942.173.772.253.51 Chou-fleurfr./kg1.322.811.422.601.332.65 Prix 2008:
3.2COMPARAISONS INTERNATIONALES 3 274
■ Prix à la consommation
La forte augmentation des prix sur le marché mondial n’a que peu d’incidence sur les prix à la production en Suisse, compte tenu que l’agriculture suisse est protégée par des droits de douane. L’évolution sur les marchés internationaux a cependant entraîné une réduction de l’écart des prix par rapport aux pays voisins. Les matières premières suisses ont par conséquent gagné en compétitivité.
Alors qu’en 2006 encore les prix à la production de produits des champs essentiels tels le blé, l’orge ou le maïs étaient de deux à trois fois plus élevés qu’en Allemagne, cette différence n’est plus que d’un facteur 1 à 1,5. Actuellement, les prix suisses sont 1,5 à 2 fois plus élevés qu’en Allemagne.
Alors qu’en 2006, le prix du lait en Suisse était encore 67% plus élevé qu’en Allemagne, cet écart n’était plus que de 27% en 2007. En août 2008, la différence s’est de nouveau creusée (écart de 55%). En ce qui concerne la viande, l’écart est resté pratiquement constant de 2006 à 2008.
Sur le front des prix à la consommation, quelques changements sont intervenus au cours des dernières années, du moins en ce qui concerne la Suisse. Cela ressort du graphique ci-dessous qui traduit l’évolution depuis 2000 des prix en Suisse et dans les pays voisins membres de l’UE, par comparaison à la moyenne de l’UE.
Evolution du prix à la consommation de denrées alimentaires dans des pays sélectionnés par comparaison à la moyenne UE
La Suisse s’est rapprochée de la moyenne de l’UE au cours des cinq dernièresannées. En Allemagne, les prix se situent depuis 2000 dans la moyenne de l’UE, alors que ce n’est le cas que depuis 2005 pour la France. En Italie et en Autriche, les prix à la consommation sont légèrement supérieurs à la moyenne de l’UE.
Indice (UE15 = 100) 80 110 100 90 120 130 150 140 160 20002001200220032004200520062007 Allemagne France Italie
Autriche Suisse 3. ASPECTS INTERNATIONAUX 3.2 COMPARAISONS INTERNATIONALES 3 275
Source: Eurostat
Evolution du prix à la consommation de denrées alimentaires en Suisse par comparaison à la moyenne UE
Les prix à la consommation en Suisse se sont rapprochés de la moyenne de l’UE dans tous les groupes de produits alimentaires, la différence la plus petite touchant le prix du lait, du fromage et des œufs et la plus grande, celui de la viande.
Indice (UE15 = 100) 100 140 120 160 180 200 220 20002001200220032004200520062007 Céréales Viande Source: Eurostat Lait, fromage et œufs Graisses et huiles 3.2COMPARAISONS INTERNATIONALES 3 276
3.2 COMPARAISONS INTERNATIONALES 3 277 3. ASPECTS INTERNATIONAUX
Collaboration au rapport agricole 2008
■ Direction du projet, Werner Harder
secrétariat Alessandro Rossi
Monique Bühlmann
■ Auteurs
■ Rôle et situation de l’agriculture
L’agriculture, partie intégrante de l’économie
Alessandro Rossi
Marchés
Jean-Marc Chappuis, Simon Hasler, Nicole Locher, Frédéric Rothen, Beat Ryser, Beat Sahli, Nadine Studer
Situation économique
Vinzenz Jung
Aspects sociaux
Esther Grossenbacher, Ruth Rossier
Ecologie et éthologie
Brigitte Decrausaz, Ruth Badertscher, Reto Burkard, Anton Candinas, Daniel Felder, Christiane Vögeli-Albisser, Esther Grossenbacher
Marchés agro-alimentaires internationaux
Werner Harder, Vinzenz Jung
■ Mesures de politique agricole
Production et ventes
Jean-Marc Chappuis
Instruments transversaux
Thomas Ackermann, Emanuel Golder, Samuel Heger, Jacques Henchoz, Stefan Schönenberger
Economie laitière
Nadine Studer
Production animale
Simon Hasler
Production végétale
Beat Ryser, Nicole Locher, Beat Sahli
278
■ Services de traduction
Paiements directs
Thomas Maier, Lukas Barth, Jonas Plattner, Hugo Roggo, Olivier Roux, Beat Tschumi, Conrad Widmer, Peter Zbinden
Amélioration des bases de production
Améliorations structurelles et mesures d’accompagnement social René Weber, Samuel Brunner, Johnny Fleury, Willy Riedo, Andreas Schild
Système de connaissances agronomiques
Anton Stöckli, Dominik Burger, Urs Gantner, Jean-Pierre Perdrizat, Pierre-André Poncet, Jakob Rösch, Roland Stähli, Denise Tschamper, Esther Weiss, Christoph Zimmermann
Moyens de production
Alfred Klay, Eva Tscharland, Markus Hardegger
Section Inspectorat des finances
Rolf Enggist
Mise en réseau des banques de données agricoles
Dieter Wälti
■ Aspects internationaux
Développements internationaux
Krisztina Bende, Thomas Ackermann, Claudia Challandes Binggeli, Jean Girardin, Tim Kränzlein, Isabelle Pasche, Hubert Poffet, François Pythoud, Fabian Riesen, Stefan Rösch
Comparaisons internationales
Vinzenz Jung, Alessandro Rossi
Français: Elisabeth Tschanz, Delphine Binder, Odile Derossi, Giovanna Mele, Laura Sanchez
Allemand: Cornelia Heimgartner
Italien: Patrizia Singaram, Francesca De Giovanni, Simona Stückrad
■ Internet Denise Kummer
■ Support technique Hanspeter Leu, Peter Müller
279
280
ANNEXE A1 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ Annexe Tableaux Structures A2 Tableaux Marchés A4 Tableaux Résultats économiques A14 Comptes économiques de l’agriculture A14 Résultats d’exploitation A16 Tableaux Dépenses de la Confédération A27 Dépenses Production et ventes A27 Dépenses Promotion des ventes A27 Dépenses Economie laitière A28 Dépenses Economie animale A28 Dépenses Production végétale A29 Dépenses Paiements directs A30 Dépenses Amélioration des bases de production A52 Dépenses Agriculture et alimentation A58 Textes légaux, Définitions et méthodes A59 Abréviations A60 Bibliographie A62
■■■■■■■■■■■■■■■■■ Tableaux Structures
A2 ANNEXE
Tableau 1
ExploitationsSurface agricole utileUnités de gros bétail Classes de grandeur, en ha de surface 199020002007199020002007199020002007 agricole utilenombrenombrenombrehahahanombrenombrenombre 0-16 6293 6092 7402 8951 336947 82 55061 01656 808 1-313 1904 7623 83723 8288 8617 039 34 46614 75312 234 3-58 2595 3933 69932 24321 34814 790 42 47327 71420 031 5-1018 83313 14910 449141 40399 05678 746 209 784127 36199 273 10-1518 92013 81211 177233 888171 817139 369 341 563230 628183 900 15-2012 71011 1729 699218 771193 856168 498 290 523247 517219 577 20-256 6777 2446 961147 772161 311155 173 173 896191 057193 181 25-303 3644 4304 73491 271121 005129 413 97 680130 901147 539 30-402 6744 1684 80290 726142 266163 738 87 709142 628175 999 40-508751 5911 94938 67270 50186 485 32 21461 91482 456 50-705079211 26228 84952 67272 919 23 17242 70766 791 70-10012720935310 37117 02128 644 7 41413 29024 629 >10050771027 80211 44414 518 6 3158 02510 866 Total92 81570 53761 7641 068 4901 072 4921 060 2781 429 7591 299 5121 293 284 Source: OFS
Evolution des exploitations agricoles, de la surface agricole utile et des unités de gros bétail
ANNEXE A3 Tableau 2 Personnes occupées dans l'agriculture CatégorieEmployés à plein tempsEmployés à temps partielTotal 199020002007199020002007199020002007 Chefs d'exploitationHommes62 72049 33940 41826 16925 38518 34888 88974 72458 766 Femmes1 4565241 0052 4701 8221 9933 9262 3462 998 Autre main-d'œuvre familialeHommes21 7968 7499 70722 72918 21220 12044 52526 96129 827 Femmes14 36714 2819 14165 77047 66541 92580 13761 94651 066 Main-d'œuvre familialetotal100 33972 89360 271117 13893 08482 386217 477165 977142 657 Main-d'œuvre non familiale suisseHommes12 45310 8367 7832 9495 1253 92715 40215 96111 710 Femmes3 2002 5922 0083 3044 1943 6476 5046 7865 655 étrangèreHommes10 9108 0616 2621 7583 4542 88512 66811 5159 147 Femmes6631 6131 5568471 9412 2661 5103 5543 822 Main-d'œuvre non familiale total27 22623 10217 6098 85814 71412 72536 08437 81630 334 Personnes occupéestotal127 56595 99577 880125 996107 79895 111253 561203 793172 991 Source: OFS
■■■■■■■■■■■■■■■■■ Tableaux Marchés
A4 ANNEXE
Tableau 3 Surface agricole utile en fonction des modes d'utilisation Produit1990/92200520062007 1 1990/92–2005/07 hahahaha% Céréales207 292167 689165 659157 572-21.1 Céréales panifiables102 84088 03980 08581 925-19.0 Blé96 17383 74475 83577 550-17.8 Epeautre2 1602 4282 5292 37213.1 Amidonnier, engrain 2 165160205 Seigle4 4321 6771 5391 780-62.4 Méteil de céréales panifiables75252218-71.1 Céréales fourragères104 45379 65085 57475 647-23.1 Blé-6 33415 00310 803Orge59 69537 68937 05134 874-38.8 Avoine10 4342 9502 4162 226-75.7 Méteil de céréales fourragères238254231194-4.9 Maïs-grain25 73920 61219 61617 464-25.3 Triticale8 34711 81111 25710 08632.4 Légumineuses2 2585 1785 6525 609142.6 Pois protéagineux2 1124 8075 2545 243141.5 Féveroles14627229327892.0 Lupins-9910588Cultures sarclées36 38532 19831 98433 613-10.4 Pommes de terre18 33312 51011 97311 745-34.1 Betteraves sucrières14 30818 24818 73920 66034.3 Betteraves fourragères3 7441 4401 2721 208-65.1 Oléagineux18 20323 14323 83024 52830.9 Colza16 73016 54917 40218 6494.8 Tournesol-5 0425 2684 851Soja1 4741 5181 125998-17.6 Courges à huile-343530Matières premières renouvelables-1 3061 4611 645Colza-1 1021 2861 551Tournesol-414123Autres (kénaf, chanvre, etc.)-16313471Légumes de plein champ8 2508 9149 1759 25410.5 Maïs d'ensilage et maïs vert38 20442 93841 86942 77311.3 Jachères vertes et florales3193 2923 1003 033885.9 Autres terres ouvertes8301 6551 7361 644102.1 Terres ouvertes311 741286 431284 466279 671-9.1 Prairies artificielles94 436119 101120 500126 20829.1 Autres3 9772 3252 5172 192-41.0 Terres ouvertes total410 154407 739407 483408 071-0.6 Cultures fruitières6 9146 6726 6366 602-4.0 Vigne14 91914 90314 88514 847-0.3 Roseaux de Chine32312312287 566.7 Prairies naturelles, pâturages638 900625 432625 132619 420-2.4 Autre utilisation, ainsi que prairies à litière et tourbe7 39410 14111 06411 33846.7 Surface agricole utile1 078 6001 065 1181 065 2001 060 278-1.4 1 provisoire 2 saisie séparée depuis 2002 Sources: viticulture et cultures fruitières: OFAG; autres produits: USP, OFS
1 Provisoire
2 Moyenne des années 1990/93
3 Variation 1990/93–2004/07
Sources:
Lait et produits laitiers: USP (1990–98), dès 1999 TSM
Viande: Proviande
Oeufs: Aviforum
Céréales, cultures sarclées et oléaginieux: USP
Fruits: Fruit-Union suisse, Interprofession des fruits et légumes du Valais
Légumes: Centrale suisse de la culture maraîchère
Vin: OFAG, cantons
ANNEXE A5
Production ProduitUnité1990/922005200620071990/92–2005/07 % Lait et produits laitiers Lait de consommationt549 810488 412493 246489 227-10.8 Crèmet68 13364 41664 74367 105-4.0 Beurret38 76640 27340 84543 4747.1 Poudre de laitt35 84450 80448 37350 83439.5 Fromaget134 400167 708172 914176 27928.2 Viande et œufs Viande de bœuft PM130 710100 024104 217102 147-21.9 Viande de veaut PM36 65632 28931 58830 831-13.9 Viande de porct PM266 360236 165243 321241 902-9.7 Viande de moutont PM5 0656 1915 7885 42414.5 Viande de chèvret PM541568525514-0.9 Viande de chevalt PM1 212941911798-27.1 Volaillet poids de vente20 73333 36129 78134 57957.1 Oeufs en coquillemio. de têtes6386576606542.9 Céréales Blé tendret546 733521 400533 200535 600 1 -3.0 Seiglet22 9789 4008 60010 100 1 -59.2 Orget341 774231 200230 000210 900 1 -34.4 Avoinet52 80715 30012 00010 100 1 -76.4 Maïs-graint211 047198 900152 400180 900 1 -15.9 Triticalet43 94068 40064 60057 600 1 44.6 Autrest11 46911 90011 80011 600 1 2.6 Cultures sarclées Pommes de terret750 000485 000392 000490 000 1 -39.2 Betteraves sucrièrest925 8671 409 4001 242 7281 572 925 1 52.1 Oléagineux Colzat46 11456 20053 30056 500 1 20.0 Tournesolt-15 00013 60012 900 1Autrest3 6584 3724 4323 309 1 10.4 Fruits (de table) Pommest91 503 2 102 900102 881109 20013.6 3 Poirest-16 25114 23818 790Abricotst3 407 2 3 3554 5554 54025.3 3 Cerisest1 818 2 1 5881 6892 2023.2 3 Pruneauxt2 837 2 1 9982 3823 714-2.3 3 Fraisest4 2635 6955 4015 77631.9 Légumes (frais) Carottest49 16255 92459 47261 26419.8 Oignonst23 50532 84426 76629 59826.5 Céleri-ravet8 50610 7858 20310 10414.0 Tomatet21 83032 03531 79836 32352.9 Laitue pomméet18 82115 66713 21214 207-23.7 Chou-fleurt8 3316 4615 4556 038-28.2 Concombret8 6089 6699 9469 81614.0 Vin Vin rougehl550 276522 415539 742528 139-3.7 Vin blanchl764 525478 988471 380512 292-36.2
Tableau 4
Production produits laitiers
A6 ANNEXE
Tableau 5
Produit1990/922005200620071990/92–2005/07 tttt% Total fromage134 400167 708172 914176 27928.2 Fromages frais4 38739 78140 55141 382824.8 Mozzarella-14 81515 47016 191 Autres fromages frais-24 96625 08125 190 Fromages à pâte molle4 8126 5656 7736 90940.3 Tommes1 2492 0341 9882 06162.3 Fromages à pâte blanche persillée, mi-gras à gras1 5731 4551 4881 416-7.6 Autres fromages à pâte molle1 9903 0753 2973 43264.2 Fromages à pâte mi-dure40 55649 43349 56052 15824.2 Appenzell8 7259 1888 6628 8402.0 Tilsit7 7364 1434 1234 124-46.6 Fromage à raclette9 89813 20412 92913 71134.2 Autres fromages à pâte mi-dure14 19722 89823 84625 48369.6 Fromages à pâte dure84 62971 05075 10574 836-13.0 Emmentaler56 58832 18033 89430 772-43.0 Gruyère22 46427 52928 37128 21124.8 Sbrinz4 6591 5631 6642 003-62.6 Autres fromages à pâte dure9189 77811 17613 8501 163.8 Spécialités 1 158799279956 124.4 Total produits laitiers frais680 822740 535748 474746 8309.5 Lait de consommation549 810488 412493 246489 227-10.8 Autres131 012252 123255 228257 60394.6 Total beurre38 76640 27340 84543 4747.1 Beurre de choix27 2004 1924 3555 421-82.9 Autres11 56636 08136 49038 053218.8 Total crème68 13364 41664 74367 105-4.0 Total poudre de lait35 84450 80448 37350 83439.5 1Fromages au pur lait de brebis ou de chèvres Sources: USP (1990–98), dès 1999 TSM Tableau 6 Mise en valeur du lait commercialisé Produit1990/922005200620071990/92–2005/07 1 000 t de lait1 000 t de lait1 000 t de lait1 000 t de lait% Lait de consommation549448450447-18.3 Lait transformé2 4902 7552 7282 78510.7 Fromage1 5311 3721 4031 427-8.5 Beurre35648146445230.8 Crème430251251261-40.9 Autres produits laitiers173652611646267.8 Total 1 3 0393 2033 1793 2335.5 1 Sans le lait en provenance de la zone franche de Genève ni de la Principauté de Liechtenstein Sources: USP (1990–98), depuis 1999 TSM
Tableau 7
Mise en valeur de la récolte en production végétale
ANNEXE A7
Produit1990/922005200620071990/92–2005/07 tttt% Pommes de terre Pommes de terre de table285 300166 200160 200163 500 1 -42.8 Pommes de terre destinées à la transformation114 700133 200114 741135 000 1 8.9 Semences35 93324 70029 11024 000 1 -24.6 Affouragement de pommes de terre fraîches225 967134 00072 600156 000 1 -47.4 Transformation en aliments pour animaux146 90021 50014 1005 600 1 -79.3 Pommes et poires à cidre suisses (transformation dans des cidreries artisanales)183 006 2 95 768132 917162 992-25.1 3 Quantité de fruits à cidre pour jus brut182 424 2 95 651132 850162 767-24.9 3 fraîchement pressés10 477 2 9 1669 6797 993-13.2 3 cidre de fruits destiné à la fabrication d'eau-de-vie de fruits3 297 2 1622331-92.5 3 concentré de jus165 263 2 81 195115 597151 423-25.3 3 Autres jus (vinaigre compris)3 387 2 5 1287 3413 35023.4 3 Fruits foulés582 2 11767225-72.7 3 Fabrication de spiritueux à base de pommes et poires suisses40 255 2 21 66811 10413 104-60.8 3 à base de cerises et pruneaux suisses23 474 2 12 7268 06510 728-52.2 3 Légumes frais suisses destinés à la fabrication de denrées alimentaires Légumes congelés26 06124 10430 04925 4551.8 Légumes de conserve (haricots, petits pois, carottes parisiennes)19 77614 35414 93718 421-19.6 Choucroute (choux à choucroute)8 4755 6825 7805 970-31.4 Raves d'automne1 495997951773-39.3 1 Provisoire 2 Moyenne des années 1990/93 3 Variation 1990/93–2004/07 Sources: Pommes de terre: swisspatat Fruits à cidre: OFAG; spiritueux: Régie fédérale des alcools Légumes destinés à la transformation: Centrale suisse de la culture maraîchère
A8 ANNEXE
8 Commerce extérieur Produit1990/922005200620071990/92–2005/07 tttt% Exporta-Importa-Exporta-Importa-Exporta-Importa-Exporta-Importa-Exporta-Importationstionstionstionstionstionstionstionstionstions Lait et produits laitiers Lait1923 00732623 05533523 9292 45423 1935 280.01.7 Yoghourts1 195177 3001 8776 9183 9036 5006 674477.824 319.6 Crème909254 2753 2104 0113 0434 3862 800364.711 827.5 Beurre04 15422 04154 507126 9092 011.18.0 Poudre de lait8 1583 26616 97054512 6913847 07230150.1-87.4 Fromage62 48327 32851 70931 91350 48733 89254 32137 329-16.525.8 Viande, œufs et poissons Viande de bœuf2807 8731 22312 6101 34614 4501 39115 966371.482.2 Viande de veau0916097201 20851 161-21.6 Viande de porc2881 95624312 88929911 96733812 6971.9540.0 Viande de mouton56 48906 07306 07705 923-100.0-7.2 Viande de chèvre0403025403310349--22.8 Viande de cheval04 60004 27804 74804 871-0.7 Volaille1039 94273842 13044043 50618050 2804 426.713.4 Oeufs031 4017028 3442928 912532 329--4.9 Poissons, crustacés et mollusques62031 13215737 01116840 47118041 616-72.827.5 Céréales Blé6232 13478202 62970257 241197332 7751 708.413.8 Seigle03 05702 7793008 754484 776-77.9 Orge43644 50417214 06812455 0158982 751-70.513.7 Avoine13160 885047 408054 97650055 63027.3-13.5 Maïs-grain19460 51253376 09617156 30473162 27133.362.3 Cultures sarclées Pommes de terre9 6958 72252520 2101 74357 3251 87747 512-85.7377.9 Sucre40 882124 065302 485313 561284 086277 158222 932306 135560.0141.0 Oléagineux Oléagineux489134 57060379 1271 11685 12377980 92370.2-39.3 Huiles et graisses végétales18 68057 7652 953110 9572 865123 1653 155119 875-84.0104.3 Fruits (frais) Pommes683 1 12 169 1 61110 62975910 0082 3585 41142.4 2 -2.6 2 Poires491 1 11 803 1 3289 605788 48249710 247-42.5 2 -26.3 2 Abricots226 1 10 578 1 19 1281358 363495 212-78.4 2 -31.4 2 Cerises256 1 1 062 1 251 561221 86044900-90.6 2 27.5 2 Prunes et pruneaux12 1 3 290 1 16 313295 603334 66535.4 2 59.6 2 Fraises15011 0237412 3846811 2994410 380-58.83.0 Raisin2333 691636 71014032 67615833 225334.31.5 Agrumes161135 7805123 676351126 087303131 92336.4-6.3 Bananes8577 896574 2203174 068878 237-82.7-3.1 Légumes (frais) Carottes711 710705 87745 411258 398-53.5283.7 Oignons8623 44463 40118 692506 127-97.876.4 Céleri-rave020609702040923-97.7 Tomate40235 7004140 3524841 1943138 964-90.012.5 Laitue pommée373 95402 394132 65422 694-86.4-34.7 Chou-fleur119 98518 58079 420139 003-38.2-9.9 Concombre6517 4791916 113116 222814 080-85.6-11.5 Vin (de table) Vin rouge (en hl)3 4991 494 29411 7711 348 27415 1251 287 36212 7481 346 110277.7-11.2 Vin blanc (en hl)7 59076 83511 651228 17511 129239 4595 844292 33825.7229.7 1 Moyenne des années 1990/93 2 Variation 1990/93–2004/07 Sources: Lait et produits laitiers, oeufs, céréales, cultures sarclées, oléagineux, fruits, légumes et vin: DGD Sucre: réservesuisse
Tableau
Tableau 9
Commerce extérieur de fromage
ANNEXE A9
Produit1990/922005200620071990/92–2005/07 tttt% Importations Fromages frais 1 4 1759 2299 89611 629145.6 Fromages râpés 2 233833804880260.7 Fromages fondus 3 2 2212 1752 4082 3884.6 Fromages à pâte persillée 4 2 2762 0802 0782 205-6.8 Fromages à pâte molle 5 6 6285 7835 7006 796-8.1 Fromages à pâte mi-dure 6 11 795 4 8925 5086 275 Fromages à pâte dure 7 6 9216 9067 156 6.4 Total fromages et séré27 32831 91333 30037 32925.1 Exportations Fromages frais 1 22984581 09530 750.0 Fromages râpés 2 104881351044.8 Fromages fondus 3 8 2454 6154 2534 339-46.6 Fromages à pâte persillée 4 01320160 Fromages à pâte molle 5 306073743911 419.2 Fromages à pâte mi-dure 6 54 102 8 9599 35510 636 Fromages à pâte dure 7 37 12836 35037 739 -13.6 Total fromages et séré62 48351 70950 94554 320-16.3 1 0406.1010, 0406.1020, 406.1090 2 0406.2010, 0406.2090 30406.3010, 0406.3090 4 0406.4010, 0406.4021, 0406.4029, 0406.4081, 0406.4089 5 0406.9011, 0406.9019 6 0406.9021, 0406.9031, 0406.9051, 0406.9091 7 0406.9039, 0406.9059, 0406.9060, 0406.9099 Source: DGD
Consommation par habitant
A10 ANNEXE
10
Tableau
Produit1990/92200520062007 1 1990/92–2005/07 kgkgkgkg% Lait et produits laitiers Lait de consommation104.3779.1078.9077.70-24.7 Crème6.438.208.208.4028.5 Beurre6.205.605.605.70-9.1 Fromage (sans séré)16.9019.7018.7019.4014.0 Fromages frais3.466.406.406.5085.9 Fromages à pâte molle1.831.701.801.90-1.8 Fromages à pâte mi-dure5.655.605.605.70-0.3 Fromages à pâte dure5.966.006.106.504.0 Viande et œufs Viande de bœuf13.7110.3910.9110.70-22.2 Viande de veau4.253.433.353.24-21.4 Viande de porc29.7325.2025.6625.36-14.5 Viande de mouton1.421.401.361.29-4.9 Viande de chèvre0.120.090.100.10-19.4 Viande de cheval0.750.630.680.68-11.6 Volaille8.059.698.279.6214.2 Oeufs en coquille (pces)199185185189-6.4 Céréales Articles de boulangerie et de pâtisserie50.7051.0051.6047.90-1.1 Cultures sarclées Pommes de terre et produits à base de pommes de terre44.1743.6447.1047.003.9 Sucre (y compris sucre dans des produits transformés)42.3758.6056.9057.0035.7 Oléagineux Huiles et graisses végétales12.8016.1016.8017.0029.9 Fruits (de table) Pommes15.26 2 15.1314.9314.790.4 3 Poires-3.423.023.76Abricots2.04 2 1.671.701.28-24.9 3 Cerises0.39 2 0.420.470.409.6 3 Prunes et pruneaux0.91 2 1.111.061.1017.3 3 Fraises2.242.412.222.120.4 Agrumes20.0916.5816.7517.34-15.9 Bananes11.539.959.8610.30-12.9 Légumes (frais) Carottes7.538.278.649.1715.4 Oignons3.864.864.724.7023.3 Céleri-rave1.291.461.121.454.1 Tomate8.469.709.719.9115.5 Laitue pommée3.372.432.132.25-32.6 Chou-fleur2.712.021.981.98-26.4 Concombre2.972.802.882.94-3.3 Vin Vin rouge (en l)31.9725.5924.8325.76-20.6 Vin blanc (en l)14.4710.2110.8111.26-25.6 Vin total (en l)46.4435.8035.6437.02-22.2 1 En partie provisoire 2 Moyenne des années 1990/93 3 Variation 1990/93–2004/07 Sources: Lait et produits laitiers, œufs, cultures sarclées et oléagineux: USP Viande: Proviande Fruits, légumes et vin: OFAG
Prix à la production
1Moyenne des années 1990/93
2 Variation 1990/93–2004/07
3 Prix franco abattoir, excepté les porcs charnus départ ferme, QM: Qualitätsmanagement Schweizer Fleisch
4 Le prix ne s'applique pas aux excédents
Sources:
Lait: OFAG
Bétail de boucherie: Proviande
Céréales, cultures sarclées et oléaginieux: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
Fruits: Fruit-Union suisse, Interprofession des fruits et légumes du Valais; il s’agit de prix indicatifs à la production définitifs
Légumes: Centrale suisse de la culture maraîchère; prix franco grande distribution
ANNEXE A11
Tableau 11
ProduitUnité1990/922005200620071990/92–2005/07 % Lait CH totalct./kg104.9772.4171.8270.04-32.0 Lait transformé en fromage (à partir de 1999)ct./kg-72.2171.6570.66Lait biologique (à partir de 1999)ct./kg-81.8180.2478.31Bétail de boucherie 3 Vaches T3fr./kg PM7.826.166.356.77-17.8 Jeunes vaches T3fr./kg PM8.136.947.087.24-12.8 Taureaux T3fr./kg PM9.287.978.448.73-9.7 Boeufs T3fr./kg PM9.837.958.418.71-15.0 Génisses T3fr./kg PM8.667.948.238.58-4.7 Veaux T3fr./kg PM14.3913.2014.4314.47-2.5 Porcs charnus, depuis 2003 QMfr./kg PM5.834.023.854.04-31.9 Agneaux jusqu'à 40 kg, T3fr./kg PM15.4010.3010.3410.45-32.7 Céréales Bléfr./100 kg99.3452.4252.3753.57-46.9 Seiglefr./100 kg102.3644.7844.6645.02-56.2 Orgefr./100 kg70.2442.2441.8741.20-40.5 Avoinefr./100 kg71.4046.9747.7345.22-34.7 Triticalefr./100 kg70.6942.6641.8341.24-40.7 Maïs-grainfr./100 kg73.5442.2342.8742.60-42.1 Cultures sarclées Pommes de terrefr./100 kg38.5534.3038.0737.73-4.8 Betteraves sucrièresfr./100 kg14.8411.7711.4911.67-21.5 Oléagineux Colzafr./100 kg203.6776.8375.5580.73-61.8 Tournesolfr./100 kg-82.0082.9284.46Fruits Pommes: Golden Delicious Ifr./kg1.12 1 1.01 4 0.97 4 0.90 4 -12.1 2 Pommes: Maigold Ifr./kg1.35 1 0.90 4 0.90 4 0.91 4 -27.4 2 Poires: Conférencefr./kg1.33 1 1.09 4 1.23 4 0.92 4 -20.7 2 Abricotsfr./kg2.09 1 2.372.532.5514.1 2 Cerisesfr./kg3.20 1 3.703.603.3010.2 2 Pruneaux: Fellenbergfr./kg1.40 1 2.052.051.8033.0 2 Fraisesfr./kg4.775.005.205.6010.4 Légumes Carottes (de garde)fr./kg1.091.381.451.5433.6 Oignons (de garde)fr./kg0.890.971.601.6658.4 Céleris-raves (de garde)fr./kg1.622.322.432.7153.5 Tomates rondesfr./kg2.422.342.592.482.1 Laitue pomméefr./kg2.373.633.943.7759.5 Chou-fleurfr./kg1.852.302.812.6038.9 Concombres pour la saladefr./kg1.662.152.362.2736.1
Prix
A12 ANNEXE
12
Tableau
consommation ProduitUnité1990/922005200620071990/92–2005/07 % Lait et produits laitiers Lait entier pasteurisé, emballéfr./l1.851.541.521.52-17.5 Lait «drink» pasteurisé, emballéfr./l1.851.501.491.49-19.2 Lait écrémé UHTfr./l-1.421.431.48Emmentalerfr./kg20.1519.6319.2119.04-4.3 Gruyèrefr./kg20.4020.1919.9719.94-1.8 Tilsitfr./kg-17.5916.8016.66Camembert 45% (ES)125 g-2.902.882.76Fromage à pâte molle, croûte fleurie150 g-3.683.643.52Mozzarella 45% (ES)150 g-2.132.121.90Beurre de choix200 g3.462.952.852.77-17.5 Le beurre (beurre de cuisine)250 g3.442.842.762.66-20.0 Crème entière, emballée 1⁄2 l-4.223.973.63Crème à café, emballée 1⁄2 l-2.342.272.01Yoghourt, aromatisé ou contenant des fruits180 g0.890.660.650.64-26.6 Viande de bœuf Entrecôtes, en tranchesfr./kg48.3655.7057.0558.7018.2 Steakfr./kg37.5942.8643.7544.5516.3 Rôti d'épaulefr./kg26.3427.8928.1627.846.2 Viande hachéefr./kg15.0016.9517.2117.4014.6 Viande de veau Côtelettes, coupéesfr./kg35.3244.1747.5348.3832.2 Rôti d'épaulefr./kg32.5636.3537.8437.0313.9 Ragoûtfr./kg21.6731.8633.5832.7551.0 Viande de porc Côtelettes, coupéesfr./kg19.8819.9219.6420.360.5 Steakfr./kg24.4825.7925.9725.765.6 Rôti d'épaulefr./kg18.4319.5918.5318.111.7 Ragoût d'épaulefr./kg16.6918.9718.4117.8010.2 Viande d'agneau suisse, fraîche Gigot sans l'os du bassinfr./kg26.3428.7528.9129.5810.4 Côtelettes, coupéesfr./kg30.3238.4641.6243.3535.7 Produits à base de viande Jambon de derrière modèle, coupéfr./kg25.5629.6729.7629.0615.4 Salami suisse I, coupéfr./100 g3.094.464.514.5445.8 Poulets suisses, fraisfr./kg8.419.129.569.5812.0 Production végétale et produits végétaux Farine fleur 3 fr./kg-1.391.38-Pain noir 3 fr./500 g-1.371.26-Pain mi-blanc 3 fr./500 g-1.411.30-Petits pains / Ballons 3 fr./kg-10.4910.66-Croissants 3 fr./kg-16.2116.36-Spaghetti 3 fr./500 g-1.101.06-Pommes de terrefr./kg1.432.262.312.3761.8 Sucre cristalliséfr./kg1.651.651.831.816.9 Huile de tournesol 3 fr./l5.054.81---4.0 Fruits (suisses et étrangers) Pommes: Golden Delicious Ifr./kg3.15 1 3.824.023.7123.7 2 Poiresfr./kg3.25 1 3.563.903.7315.0 2 Abricotsfr./kg3.93 1 6.156.807.5269.5 2 Cerisesfr./kg7.35 1 9.889.5810.5836.2 2 Pruneauxfr./kg3.42 1 4.464.333.8821.1 2 Fraisesfr./kg8.6910.8311.9212.6134.9 Légumes (consommation à l'état frais, suisses et étrangers) Carottes (de garde)fr./kg1.912.022.202.2212.4 Oignons (de garde)fr./kg1.861.952.662.6429.9 Céleris-raves (de garde)fr./kg3.143.854.574.7439.7 Tomates rondesfr./kg3.733.593.513.68-3.7 Laitue pomméefr./kg4.461.862.011.99-56.2 Chou-fleurfr./kg3.584.214.674.3623.3 Concombres pour la saladefr./kg2.804.101.801.74-9.0 1 Moyenne des années 1990/93 2 Variation 1990/93–2004/07 3 Les données ne sont plus relevées par l’OFS Sources: Lait, viande (panier viande de label et traditionnelle): OFAG Production végétale et produits végétaux: OFAG, OFS
à la
1 Produits de meneurie et blé germé sur pied compris, sans les tourteaux; les modifications des réserves ne sont pas prises en considération
2 Blé dur, avoine, orge et maïs compris
3 Pommes, poires, cerises, pruneaux et prunes, abricots et pêches
4 Part de la production suisse au poids de la viande prête à la vente et des produits carnés
5 Viande chevaline et caprine, lapins, gibier, poissons, crustacés et mollusques compris
6 Energie digestible en joules, boissons alcoolisées comprises
7 Sans les produits animaux à base d'aliments pour animaux importés
8 Valeur calculée en prix au producteur, pour la production suisse, et aux prix selon la statistique commerciale, pour les importations (franco fontière non dédouanées)
Source: USP
ANNEXE A13
13 Taux d’autosuffisance Produit1990/922004200520061990/92–2004/06 % Part en termes de volume:%%%% Céréales panifiables 118928781-26.6 Céréales fourragères 1 6175727119.1 Total céréales 2 64636359-3.6 Pommes de terre de table101959176-13.5 Sucre465050422.9 Graisses végétales, huiles22222219-4.5 Fruits 3 72735971-6.0 Légumes55555147-7.3 Lait de consommation 979998981.4 Beurre 899793873.7 Fromage 137114117118-15.1 Total lait et produits laitiers110108108105-2.7 Viande de veau 4 979897960.0 Viande de bœuf 4 93888684-7.5 Viande de porc 4 99939695-4.4 Viande de mouton 4 3945444413.7 Volaille 4 3748494729.7 Viande de toutes sortes 4 5 76697070-8.3 Oeufs et conserves d'œufs444644463.0 Part énergétique 6 : Denrées alimentaires végétales 43454340-0.8 Denrées alimentaires animales, brut 97949493-3.4 Total denrées alimentaires, brut62606057-4.8 Total denrées alimentaires, net 7 58555453-6.9 Total denrées alimentaires, en termes de valeur 8 72646364-11.6
Tableau























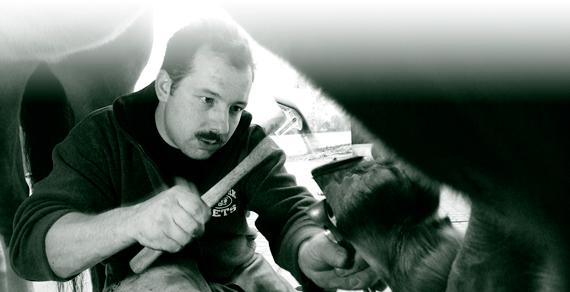
















 Source: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
1 La moyenne comprend d’autres exploitations évaluées, en plus des types d’exploitation ici représentés.
Lisier Engrais minéraux fumier Autres engrais
Source: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
1 La moyenne comprend d’autres exploitations évaluées, en plus des types d’exploitation ici représentés.
Lisier Engrais minéraux fumier Autres engrais