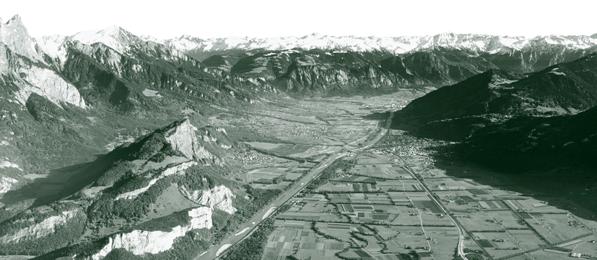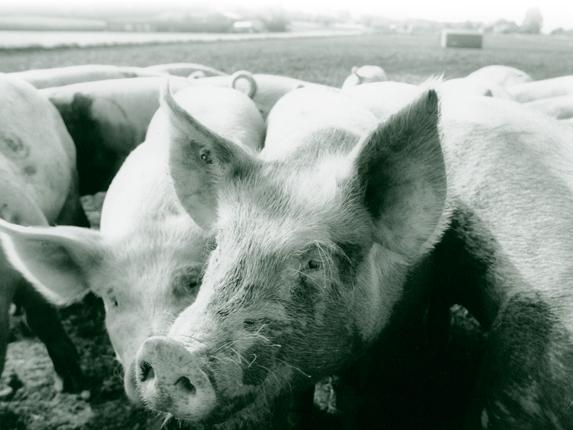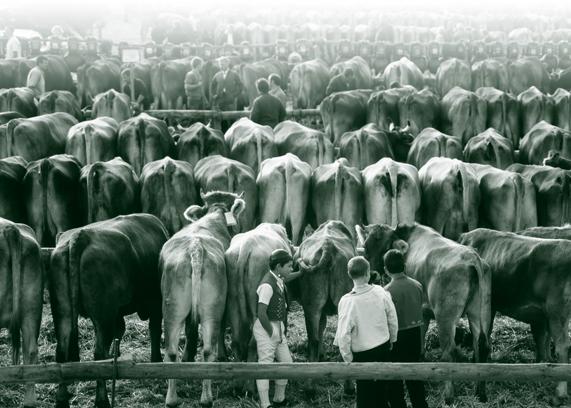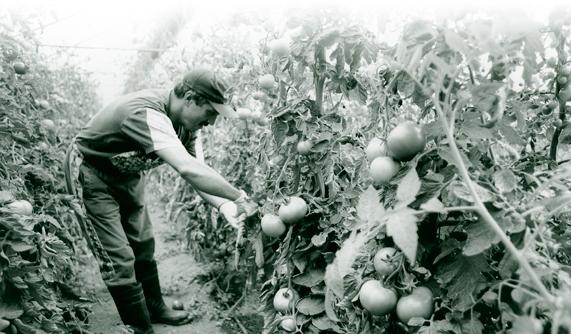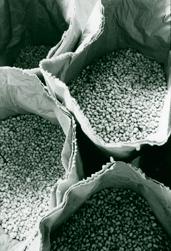RAPPORT AGRICOLE
Rapport agricole 2006 de l’Office fédéral de l’agriculture
■■■■■■■■■■■■■■■■
1
Editeur
Office fédéral de l’agriculture (OFAG)
CH-3003 Berne
Tél.:031 322 25 11
Fax:031 322 26 34
Internet:www.blw.admin.ch
Copyright:OFAG,Berne 2006
Layout et graphisme
Artwork,Grafik und Design,Saint-Gall
Impression RDV AG,Berneck
Photos
– Agroscope Changins-Wädenswil ACW
– Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
–Archives d’illustrations Agrofot
–BananaStock Ltd.
–Christof Sonderegger,photographe
–Getty Images GmbH
–Herbert Mäder,photographe
–OFAG Office fédéral de l’agriculture
–Peter Mosimann,photographe
–Peter Studer,photographe
–PhotoDisc Inc.
–Switzerland Cheese Marketing AG
–Tobias Hauser,photographe
Diffusion
OFCL,Diffusion publications
CH-3003 Berne
No de commande:
français:730.680.06 f allemand:730.680.06 d italien:730.680.06 i www.publicationsfederales.admin.ch
ACHEVÉ D’IMPRIMER 2 11.06 1100 161996/2
■■■■■■■■■■■■■■■■ Table des matières Préface 4 ■ 1.Rôle et situation1.1Economie 9 de l‘agriculture 1.1.1L’agriculture,partie intégrante de l‘économie 10 1.1.2Marchés 19 1.1.3 Situation économique du secteur agricole 43 1.1.4 Situation économique des exploitations 49 1.2Aspects sociaux 57 1.2.1 Revenu et consommation 58 1.2.2 Prestations des assurances sociales 60 1.2.3 Les paysannes et paysans à l’âge de la retraite 68 1.3Ecologie et éthologie 89 1.3.1 Ecologie 89 1.3.2 Ethologie 113 ■ 2.Mesures de politique2.1Production et ventes 119 agricole 2.1.1Instruments transversaux 120 2.1.2Economie laitière 129 2.1.3 Economie animale 135 2.1.4 Production végétale 143 2.2Paiements directs 151 2.2.1 Importance des paiements directs 152 2.2.2 Paiements directs généraux 161 2.2.3 Paiements directs écologiques 169 2.3Amélioration des bases de production 185 2.3.1 Améliorations structurelles et mesures d’accompagnement social 186 2.3.2 Recherche,haras,vulgarisation,formation professionnelle,CIEA 197 2.3.3 Moyens de production 204 2.3.4 Elevage 209 2.4 Section Inspectorat des finances 211 ■ 3.Aspects internationaux 3.1Développements internationaux 217 3.2 Comparaisons internationales 227 ■ Annexe Tableaux A2 Textes légaux,Définitions et méthodes A64 Abréviations A65 Bibliographie A67 TABLE DES MATIÈRES 3
L’année agricole 2005 peut être qualifiée de moyenne,en comparaison pluriannuelle. Ainsi,par rapport à la très bonne année 2004,tant la valeur de la production animale que celle de la production végétale ont régressé.Le revenu sectoriel s’est élevé à un peu plus de 2,7 milliards de francs,s’établissant à un niveau similaire à celui de l’année 2003.Quant aux estimations pour l’année en cours,elles tablent sur un léger recul par rapport à 2005.

L’attention se focalise aujourd’hui sur les délibérations concernant la Politique agricole 2011 au Parlement,lesquelles ont été précédées de nombreuses discussions.Fait indéniable,les paysans accomplissent quotidiennement un travail précieux et les prestationsqu’ils fournissent en faveur de la population suisse – production de denrées alimentaires de haute qualité,contribution à l’approvisionnement de la population ou à l’entretien du paysage rural – ont leur prix dans un pays comme la Suisse où le niveau de vie est élevé.Par contre,les avis sur la manière de rétribuer au mieux ces prestations sont des plus partagés.Dans son message sur la Politique agricole 2011,le Conseil fédéral a en effet proposé de réallouer aux paiements directs les fonds destinés au soutien du marché et de réduire les droits de douane perçus sur les fourrages et les céréales.Ces mesures visent à rendre les matières premières agricoles suisses plus compétitives au niveau des prix et doivent permettre également à l’industrie de transformation de s’orienter davantage vers le marché.
Pour autant,cette nouvelle étape de la réforme est-elle une réponse adéquate et le secteur agricole est-il en état de supporter les conséquences qui en découleront? Le Conseil fédéral s’est penché intensivement sur ces deux questions et,pour prendre sa décision,il s’est appuyé sur les résultats enregistrés dans les domaines économique, social et écologique,qui sont présentés dans les rapports agricoles.La production est un facteur essentiel pour le développement durable de l’agriculture.Les recettes provenant de la vente des produits constituent toujours la première source de revenu des exploitations,en particulier pour les entreprises agricoles installées en plaine.Et les produits agricoles suisses trouvent des acheteurs quand ils sont compétitifs.Par des mesures politiques,il importe donc de créer les conditions favorisant d’autres améliorations.Cette démarche ne conduit pas à des pertes de revenu si les agriculteurs parviennent à compenser les baisses de prix par une augmentation de leur productivité.Ils y parviennent d’ailleurs,comme le montrent les chiffres publiés dans les rapports agricoles.C’est ainsi que,malgré la baisse des prix à la production,les revenus sont restés stables depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’agriculture en 1999.En outre,pour la période 2003 à 2005,on constate que le produit du travail des exploitations a,en moyenne,atteint ou dépassé le salaire de référence du reste de la population dans le premier quartile de toutes les régions.Autre preuve de la stabilité de la situation:depuis l’an 2000 l’évolution structurelle se poursuit à un rythme plus lent que dans la décennie précédente.On peut donc en conclure que le rythme des réformes était adéquat jusqu’à présent.La Politique agricole 2011 ne prévoit pas de l’accélérer,mais de le maintenir afin de permettre une évolution continue qui laisse aux intéressés la marge de manœuvre nécessaire pour prendre les décisions qui s’imposent.
PRÉFACE ■■■■■■■■■■■■■■■■
Préface
4
En revanche,les progrès réalisés dans le domaine écologique sont incontestables.Le présent rapport agricole montre que les agriculteurs utilisent aujourd’hui moins d’engrais commerciaux et moins de produits phytosanitaires qu’au début des années nonante,qu’ils entretiennent davantage de surfaces de compensation écologique et gardent un plus grand nombre d’animaux conformément aux exigences des programmes SRPA et SST.L’agriculture suisse a globalement atteint un bon niveau sur le plan écologique.Mais il existe encore un potentiel d’amélioration au niveau régional. C’est pourquoi,la Politique agricole 2011 propose d’allouer des aides initiales pour la mise en œuvre de techniques et de systèmes de production ménageant les ressources. Des améliorations sont également envisagées au niveau de l’exécution.Ainsi,la coordination des contrôles et la simplification des processus,tout en restant crédibles, doivent contribuer à ce que la charge administrative soit raisonnable pour les agriculteurs.
Le Conseil des Etats examinera la Politique agricole 2011 au cours de la session d’hiver 2006 avant que le projet soit soumis au Conseil national.Les adaptations prévues dans la Politique agricole 2011 ainsi que le montant des fonds requis pour l’enveloppe financière 2008 à 2011 seront probablement connus l’été prochain.L’important est que l’on connaisse d’ici fin 2007 les dispositions d’exécution nécessaires pour que les paysans disposent ensuite jusqu’en 2011 d’un cadre clair pour prendre leurs décisions.
Manfred Bötsch
Directeur de l’Office fédéral de l’agriculture
PRÉFACE
5
■■■■■■■■■■■■■■■■ 1.Rôle et situation de l’agriculture

1 7
Conformément à l’art.104 Cst.,la Confédération veille à ce que l’agriculture,par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché,contribue substantiellement:
a.à la sécurité de l’approvisionnement de la population;
b.à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural;
c.à l'occupation décentralisée du territoire.
Les buts ancrés dans la Constitution indiquent clairement que l’agriculture remplit des tâches qui vont au-delà de la seule production de denrées alimentaires.On parle à ce propos de multifonctionnalité de l’agriculture.L’entretien du paysage,le maintien des bases naturelles de l’existence et l’occupation décentralisée du territoire sont des prestations d’intérêt public qui ne peuvent être compensées que partiellement par le marché.
En 1996,la Constitution a introduit la notion de durabilité.Celle-ci constitue,depuis la Conférence sur l'environnement et le développement durable de 1992,à Rio de Janeiro,une ligne directrice majeure en matière de politique.
Le Conseil fédéral entend suivre les effets de la nouvelle politique agricole.Il a créé les conditions indispensables pour ce faire dans son ordonnance sur l'évaluation de la durabilité de l'agriculture.Les dispositions de l’art.1,al.1,de ladite ordonnance prévoient que la politique agricole et les prestations de l’agriculture soient régulièrement appréciées sous l’angle de la durabilité,celles de l’art.2 que les conséquences économiques,sociales et écologiques soient évaluées.L’OFAG a reçu mandat de présenter chaque année un rapport présentant les résultats des analyses;il y répond par la rédaction du rapport agricole.
Les trois dimensions de la durabilité constituent la structure de base des informations contenues dans la 1ère partie du rapport agricole,partie consacrée au rôle et à la situation de l’agriculture.
8 1.RÔLE ETSITUATION DE L’AGRICULTURE 1
Pour pouvoir fournir les prestations que l’on attend d’elle,l’agriculture doit disposer d’une base économique suffisante.La représentation des incidences économiques de la politique agricole constitue de ce fait une partie importante du rapport.Elle fournit notamment des informations sur les résultats économiques des exploitations agricoles, l’évolution des structures,les liens financiers au reste de l’économie ainsi que les relations aux différents marchés.
Les paragraphes qui suivent présentent la place économique de l’agriculture en tant que pan de l’économie,quelques informations quant à la production,la consommation,le commerce extérieur,les prix à la production et à la consommation sur les différents marchés,la situation économique du secteur dans son ensemble et celle des exploitations individuelles.

■■■■■■■■■■■■■■■■
1.1 Economie
9 1.1 ECONOMIE 1
■ Exploitations
1.1.1 L’agriculture,partie intégrante de l’économie
Evolutions structurelles
L’évolution des structures agricoles représente un processus d’adaptation aux nouvelles conditions économiques.Ces changements se traduisent par une diminution du nombre des exploitations,qui va de pair avec une augmentation de la surface moyenne des exploitations,un recul de la population agricole et une mécanisation croissante.Les chapitres qui suivent donnent un aperçu des structures dans l’agriculture,sur la base de l’évolution du nombre des exploitations et des personnes exerçant une activité dans le secteur agricole.
Le nombre des exploitations ne cesse de décroître depuis plusieurs décennies.Dans les années cinquante et soixante,le recul était de 2% en moyenne par an.Moins marquée pendant les deux décennies suivantes,l’évolution structurelle s’est à nouveau accélérée avec la réorientation de la politique agricole dans les années nonante.Depuis le changement de millénaire,le recul est de nouveau plus faible par rapport aux années nonante.
Evolution du nombre d’exploitations,par classe de grandeur et par région
■■■■■■■■■■■■■■■■
ParamètreNombre d'exploitationsVariation annuelle en % 19902000200320051990–20002000–2005 Classe de grandeur 0–3 ha19 8198 3717 1186 622–8,3–4,6 3–10 ha27 09218 54216 22015 133–3,7–4,0 10–20 ha31 63024 98423 07721 994–2,3–2,5 20–25 ha6 6777 2447 1557 1570,8–0,2 25–30 ha3 3644 4304 6134 6492,81,0 30–50 ha3 5495 7596 2166 4945,02,4 >50 ha6841 2071 4671 5785,85,5 Région Région de plaine41 59031 61229 10228 180–2,7–2,3 Région des collines24 54118 95717 97217 398–2,5–1,7 Région de montagne26 68419 96818 79218 049–2,9–2,0 Total92 81570 53765 86663 627–2,7–2,0 Source:OFS
10 1.1 ECONOMIE 1
Tableau 1,page A2
Au cours de la dernière décennie,la moitié des exploitations qui ont disparu étaient des mini-exploitations dont la surface ne dépassait pas 3 ha.Les exploitations de 3 à 20 ha ont également été en nette diminution.En revanche,celles supérieures à 20 ha ont vu leur nombre s’accroître.
Au cours de la période quinquennale 2000–2005,le taux de diminution annuel a faibli par rapport aux années nonante pour les très petites exploitations,alors qu’il a légèrement progressé pour les exploitations de 3 à 10 ha et de 10 à 20 ha.Constat semblable pour les exploitations de 20 à 25 ha:elles sont en légère diminution.Pour ce qui est du seuil de croissance,il a progressé,passant de 20 à 25 ha.Cela signifie que,depuis 2000,le nombre d’exploitations ne dépassant pas 25 ha a diminué et le nombre de celles comptant plus de 25 ha a augmenté.
L’évolution du nombre d’exploitations par région entre 1990 et 2000 montre,en chiffres absolus,une baisse plus forte en plaine (environ 10’000) que dans la région des collines (5’500) et celle de montagne (6’500).Mais en termes relatifs,le taux de diminution annuel a été le plus élevé dans la région de montagne.Ces cinq dernières années,le taux de diminution a nettement baissé par rapport aux années nonante, avant tout dans la région des collines et dans celle de montagne.
Evolution du nombre d’exploitations à plein temps et à temps partiel, par région
Source:OFS
Pour les exploitations à plein temps,le taux de diminution a reculé entre 2000 et 2005, par rapport aux années nonante,dans toutes les régions.Il a été le plus bas (0,6% par année) dans la région de montagne.Pour les exploitations à temps partiel,le taux de diminution enregistré dans cette région a été presque deux fois plus élevé que pendant la décennie précédente.Dans la région de plaine et des collines,il est resté plus ou moins stable,quoique à un niveau relativement élevé.Dans l’ensemble,entre 2000 et 2005,le nombre d’exploitations à plein temps a baissé de 3’300 et celui des exploitations à temps partiel de 3’600.

ParamètreNombre d'exploitationsVariation annuelle en % 19902000200320051990–20002000–2005 Exploitations à plein temps Région de plaine30 13923 53622 00721 454–2,4–1,8 Région des collines17 45213 79313 21712 894–2,3–1,3 Région de montagne16 65111 91011 90211 563–3,3–0,6 Total64 24249 23947 12645 911–2,6–1,4 Exploitations à temps partiel Région de plaine11 4518 0767 0956 726–3,4–3,6 Région des collines7 0895 1644 7554 504–3,1–2,7 Région de montagne10 0338 0586 8906 486–2,2–4,2 Total28 57321 29818 74017 716–2,9–3,6
1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE 1.1 ECONOMIE 11 1
■ Main-d’œuvre
La diminution du nombre d’exploitations agricoles a pour corollaire la réduction du nombre de personnes occupées dans l’agriculture.
Evolution de la main-d’œuvre
Dans les années nonante,le nombre de personnes engagées dans l’agriculture a reculé de quelque 50’000.La réduction a concerné exclusivement la main-d’œuvre familiale, alors que la main-d’œuvre non familiale a,en revanche,légèrement augmenté durant cette période.
Depuis l’année 2000,la main-d’œuvre a encore baissé (–15’700).A la différence des années nonante toutefois,cette diminution a aussi concerné la main-d’œuvre non familiale,étant donné que presque la moitié de la diminution a touché cette catégorie.

ParamètreMain-d’œuvre Variation annuelle en % 19902000200320051990–20002000–2005 Main-d’œuvre familiale217 477165 977157 683157 360–2,7–1,1 dont: chefs d’exploitation88 889 74 72469 48167 888–1,7–1,9 cheffes d’exploitation3 9262 3462 5171 989–5,0–3,2 Main-d’œuvre non familiale36 08437 81635 49630 6640,5–4,1 Total253 561203 793193 179188 024–2,2–1,6
Source:OFS
Tableau
1.1 ECONOMIE 1 12
2,page A3
Paramètres économiques
L’économie suisse a réalisé en 2004 une valeur ajoutée brute de 447’976 millions de francs,soit une augmentation de 2,1% par rapport à 2003.La part revenant au secteur primaire,dont les trois quarts proviennent de l’agriculture,est restée faible (1,3%).
Evolution de la valeur ajoutée brute dans les trois secteurs économiques Indications en prix courants
Dans les années 2000 à 2005,les importations globales ont augmenté de 18,2 milliards de francs,soit de 13,1%,les exportations de 30 milliards de francs,soit de 22,1%. Le commerce de produits agricoles a également augmenté durant cette période:les importations se sont accrues de 0,9 milliard de francs pour atteindre 9,4 milliards,les exportations de 0,9 milliard également pour atteindre 4,4 milliards.
Durant l’exercice écoulé,75,7% des importations agricoles (7,1 milliards de fr.) provenaient de l’UE (UE25).69% des exportations agricoles représentant une valeur totale de 3,1 milliards de francs étaient destinées à l’UE (UE25).Par rapport à 2004,les importations en provenance de l’UE (UE25) ont progressé de 208 millions de francs et les exportations vers ces pays de 302 millions de francs.
Secteur199920002001200220032004 1 Variation 1999/2004 en mio.de fr.en % Secteur primaire5 9656 4365 7725 6935 4245 866–1,7 dont l’agriculture selon les CEA4 6454 9874 4244 3704 0244 398–5,3 Secteur secondaire109 973111 978116 423116 687115 784117 8737,2 Secteur tertiaire285 005300 106303 493313 354317 489324 23713,8 Total400 943418 520425 688435 734438 698447 97611,7 1 provisoire Source:OFS
Evolution du commerce extérieur 200020012002200320042005Variation 2000/05 en milliards de fr.en % Importations globales139,4141,9130,2129,7138,8157,613,1 Produits agricoles8,58,68,58,98,99,410,6 dont produits provenant de l’UE 1 6,06,26,36,76,97,118,1 Exportations globales136,0138,5136,5135,4147,4166,022,1 Produits agricoles3,53,63,53,64,04,425,7 dont produits exportés vers l’UE 1 2,32,42,32,52,83,133,4 1 UE15 jusqu’en 2003;à partir de
Source:DGD
2004,UE25
■ Valeur ajoutée brute
1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE 1.1 ECONOMIE 1 13
■
Commerce extérieur
Commerce extérieur de produits agricoles avec l'UE 2005
Importations Excédents d'importations Exportations
Source: DGD
En termes de valeur,la Suisse a importé des produits agricoles en 2004 principalement de France,mais aussi d’Italie et d’Allemagne.Presque deux tiers de l’ensemble des importations de l’UE provenaient de ces trois pays.La situation n’était guère différente les années précédentes.La majeure partie des exportations était destinée à l’Allemagne.Le bilan de la Suisse est fortement négatif par rapport à l’Italie,la France,les Pays-Bas et l’Espagne.En revanche,en ce qui concerne l’Autriche,les importations et les exportations sont équilibrées à un niveau relativement bas.
Importations et exportations de produits agricoles et de produits transformés, par catégorie, en 2005
Tabac et divers (13, 14, 24)
Produits laitiers (4)
Denrées alimentaires (20, 21)
Produits d'agrément (9, 17, 18)
Aliments pour animaux, déchets (23)
Céréales et préparations (10, 11, 19)
Oléagineux, graisses et huiles (12, 15)
Plantes vivantes, fleurs (6)
Légumes (7)
Fruits (8)
Boissons (22)
Produits animaux, poissons (1, 2, 3, 5, 16)
Source: DGD
Allemagne France Italie Autriche Espagne Pays-Bas Autres pays 1 018 1 318 575 1 662 298 1 493 251 282 115 526 251 849 573 959 2 000 1 5001 500 1 000500 0 en mio. de fr. 5001 000
609 397 584 442 1 140 999 917 996 219 327 505 712 68 432 3 562 5 587 11 1 011 288 1 500 77 1 395 en mio. de fr.
des
Importations Excédents d'importations ou d'exportations Exportations 2 0001 5001 500 1 00050005001
14 1.1 ECONOMIE 1
( ): Numéro du tarif
douanes
000
Grande importatrice de denrées alimentaires,la Suisse a,durant le dernier exercice, importé surtout des boissons,des produits d’origine animale (poissons compris) ainsi que des fruits et des préparations alimentaires.Les importations de boissons concernent le vin,à raison d’environ 67%,les spiritueux,à raison d’environ 10%,et les eaux minérales,à raison d’environ 10%.De toutes les importations figurant dans la catégorie «produits animaux»,40% environ peuvent être attribués au secteur de la viande, 30% au secteur des poissons et les 30% restants au secteur des préparations à base de viande et des conserves de viande.
Pour ce qui est des exportations,les denrées alimentaires et les produits d’agrément figuraient en tête.La majeure partie des denrées alimentaires exportées concernait les préparations alimentaires,les extraits de café,les soupes et les sauces.Dans la catégorie «produits d’agrément» ont principalement été exportés du café torréfié,des préparations à base de sucre ainsi que du chocolat.Pour ce qui est des fruits,des légumes et des produits animaux,les exportations sont restées modestes.
Des excédents d’exportation ont été réalisés dans les catégories «tabac et divers» (+213 millions de fr.),«produits laitiers» (+142 millions de fr.) et «denrées alimentaires» (+141 millions de fr.).Par rapport à 2004,l’excédent a diminué de 63 millions de francs dans la catégorie «tabac et divers» et de 20 millions dans celle des produits laitiers;en revanche,il a augmenté de 46 millions dans la catégorie «denrées alimentaires».
Selon la Constitution,l’agriculture suisse est chargée de fournir une contribution substantielle à l’approvisionnement sûr de la population en denrées alimentaires.Par degré d’autosuffisance,on entend la part de la production indigène à la consommation totale du pays.
La production animale constitue depuis toujours le pilier principal de l’agriculture suisse,ce qui explique le taux d’autosuffisance plutôt élevé dans ce domaine.En 2004, celui-ci était de 94%,en légère diminution par rapport à 2003 (–1%).Concernant les produits végétaux,il a nettement augmenté après l’année de sécheresse 2003,passant de 39% à 45%.Globalement,le taux d’autosuffisance a atteint 60% en 2004,en hausse de 4% par rapport à l’année précédente.
Evolution du taux d'autosuffisance 199319941995199619971998199920002001200320022004 part en calories, exprimée en % Denrées alimentaires d'origine animale Total des denrées alimentaires Denrées alimentaires d'origine végétale Source: USP 0 100 80 60 40 20 Tableau 13,page
15 1.1 ECONOMIE 1 1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE
■ Taux d’autosuffisance
A13
■ Evolution des indices des prix
L'indice des prix à la production a fortement baissé pour les produits agricoles entre 1990 et 2002.Après une légère hausse enregistrée en 2003 et 2004,l’indice s’est de nouveau mis à baisser.En 2005,il s’élevait à 74%,un plancher jamais encore atteint au cours des 15 dernières années.La diminution est de presque 3% par rapport à l’année précédente (76,8%):dans l’ensemble,la plupart des positions étaient en recul; les plus touchés étaient les prix des porcs de boucherie et ceux des légumes.Seul le prix des veaux a connu une forte augmentation par rapport à 2004.
A la différence de l’indice des prix à la production,l’indice suisse des prix à la consommation n’a cessé d’augmenter pour le sous-groupe «denrées alimentaires et boissons» jusqu’en 2004.Une forte hausse est observée notamment à partir de 1999.Durant l’année sous revue,il a légèrement reculé (–0,8 point),pour s’établir à 110,4 points.
Evolution de l'indice des prix à la production, à la consommation et à l'importation de denrées alimentaires et de l'indice des prix des moyens de production agricoles
Indice (1990/92 = 100)
Indice des prix à la production, agriculture
Indice suisse des prix à la consommation, sous-groupe denrées alimentaires et boissons
Indice des prix des moyens de production agricoles 1
Indice des prix à l'importation de denrées alimentaires 2
1 Base mai 1997 = 100. Le nouvel indice porte à 100% sur des moyens de production. Dans l'ancien (base 1976), les facteurs de production travail et capital étaient inclus dans l'indice total avec un poids de 25%. Le poids des moyens de production était donc de 75%.
2 Base mai 2003 = 100. Pour cet indice, des données portant sur une période antérieure ne sont pas disponibles. Jusqu'en avril 2003, l'indice des prix à l'importation relatif au groupe «Denrées alimentaires» ne comprenait que les sous-groupes «Viande», «Autres denrées alimentaires» et «Boissons». Depuis la révision de mai 2003, d'autres sous-groupes ont été pris en compte. Ainsi, l'indice couvre désormais une part bien plus importante des denrées alimentaires importées.
Sources: OFS, USP
L’indice des prix des moyens de production agricoles affiche,depuis 1999,une légère tendance à la hausse.Une augmentation un peu plus forte est perceptible ces deux dernières années.En 2005,il a progressé de 1,5 point par rapport à 2004,passant à 105,3 points.L’indice peut être réparti entre les moyens de production d'origine agricole (semences,aliments pour animaux) et les autres moyens de production.L’indice partiel des moyens de production d’origine agricole a baissé dans l’intervalle précité, celui des autres moyens de production a augmenté.
En mai 2003,l’indice des prix à l’importation de denrées alimentaires a été revu et une nouvelle base a été définie (mai 2003 = 100).Des sous-groupes supplémentaires ont été admis dans le panier de la ménagère,de sorte que l’indice regroupe une plus grande part des importations de denrées alimentaires.Au cours de l’exercice considéré,l’indice s’est élevé à 103,3 points,ce qui fait 0,9 point de plus qu’en 2004.
70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 1990–1992 19931994199519961997199819992000200120032005 2004 2002 16 1.1 ECONOMIE 1
Dépenses de la Confédération
■ Dépenses pour 1.1
Tableau 1
A58
Les dépenses totales de la Confédération se sont élevées en 2005 à 51'403 millions de francs.Cela équivaut à une augmentation de 1,1 milliard de francs ou 2,2% par rapport à 2004.Pour l’agriculture et l’alimentation,les dépenses ont été de 3’771 millions de francs.Elles figurent toujours à la cinquième place,après la prévoyance sociale (14’143 millions),les finances et les impôts (10’216 millions),les transports (7’806 millions) et la défense nationale (4’576 millions).Par rapport à l’année précédente,on note que si les dépenses ont progressé globalement de quelque 1,3 milliard de francs,à savoir de 330 millions pour la prévoyance sociale,de 779 millions pour les finances et les impôts et de 371 millions pour les transports,elles ont diminué de 65 millions pour la défense nationale et de 131 millions pour l’agriculture et l’alimentation,soit de près de 200 millions de francs.
La part de l’agriculture et de l’alimentation à l’ensemble des dépenses de la Confédération a été de 7,3% en 2005,le pourcentage le plus bas jamais atteint.
l’agriculture et l’alimentation Evolution des dépenses de la Confédération pour l'agriculture et l'alimentation ECONOMIE 1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE
19951996199719981999200020012002200320042005 en mio. de fr. en % chiffres absolus (mio. de fr.) en % des dépenses totales Source: Compte d'Etat 0 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0,0 1,0 10,0 8,0 9,0 6,0 7,0 4,0 5,0 2,0 3,0 3 547 3 953 3 922 3 925 4 197 3 727 3 962 4 067 3 908 3 902 3 771
51,page
Les dépenses consacrées à la production et aux ventes continuent de diminuer.Après que,durant la période de 1998 à 2003,l’engagement prévu à l’art.187 des dispositions transitoires de la nouvelle LAgr – réduction d’un tiers des moyens destinés au soutient du marché – a été respecté,il a été possible de réduire encore,en 2004 et 2005,les dépenses dans ce domaine de 60 millions de francs annuellement,soit d’environ 8%. 17
Evolution des dépenses de la Confédération pour l’agriculture et l’alimentation
Remarque:la répartition des moyens financiers entre les différents domaines d’activité repose sur le compte d’Etat 1999. Les dépenses pour la mise en valeur des pommes de terre et des fruits,par exemple,ou celles liées à l’Administration fédérale des blés en 1990/92,ont été intégrées dans les dépenses de l’OFAG,alors qu’à l’époque,les comptes étaient encore séparés.Les chiffres de 1990/92 ne coïncident donc pas avec les données du compte d’Etat,mais ceux de 2003 à 2005 sont de nouveau comparables.
Sources:Compte d’Etat,OFAG
Concernant les paiements directs effectués pendant l’exercice écoulé,ils ont été inférieurs à ceux de 2004,le recul dépassant quelque peu les 30 millions de francs.Il est dû avant tout aux économies réalisées dans le cadre du programme d’allégement 03 (PA 03).
Les dépenses faites dans le domaine de l’amélioration des bases de production ont, quant à elles,diminué de 24 millions de francs.Comme c’est le cas pour les paiements directs,le recul des dépenses s’explique par les économies réalisées dans le cadre du PA 03.
Domaine1990/92200320042005 en mio.de fr. Production et ventes1 685798731677 Paiements directs7722 4352 4982 464 Amélioration des bases de production186215202178 Autres dépenses405460471452 Total agriculture et alimentation3 0483 9083 9023 771
1.1 ECONOMIE 1 18
L'année 2005 s'est déroulée sous des auspices moins favorables que l'année précédente.Les conditions météorologiques de l'année sous revue – sauf dans les régions touchées par des événements majeurs – ont permis aux agriculteurs d'obtenir des rendements moyens.La production laitière est restée plus ou moins stable par rapport à 2004,malgré la baisse des prix aux producteurs.Le marché de la viande de bœuf bénéficia d’un bon prix alors que le porc a connu une année plus difficile qu’en 2004 à cause des prix aux producteurs relativement bas.Par contre,la consommation de viande porcine a continué à augmenter,aux dépens de la consommation de viande de volaille.La production maraîchère a,parallèlement au maintien des prix à un niveau relativement élevé,atteint des rendements stables par rapport à 2004.Globalement, la valeur de la production de l’ensemble du secteur s’élève à 10,3 milliards de francs.
Ventilation
Activités annexes non agricoles 3%

Lait 22% Porcs 9%
Bovins 11%
œufs 4% Autres produits animaux 1%
5% Source: OFS
La production de denrées alimentaires (produits animaux et végétaux) a diminué de 6,6% par rapport à 2004,année relativement bonne par rapport à 2005.La production végétale a diminué de 8,4% (–414 millions de fr.) et la production animale de 4,8% (–247 millions de fr.).La production animale étant moins directement liée aux conditions météorologiques,il est compréhensible que sa valeur ait diminué plus faiblement que la production végétale.
■■■■■■■■■■■■■■■■
1.1.2 Marchés
du secteur agricole en 2005
Fruits
Volaille,
Cultures maraîchères et horticulture 13% Prestations de services agricoles 6% Vin
Pommes de terre, betteraves sucrières 3% Céréales 5% Plantes fourragères
Autres produits végétaux 2% 1.1 ECONOMIE 19 1
4%
12%
Tableau 14,page A14
■ Production:volume total en hausse – livraisons de lait en légère baisse

Lait et produits laitiers
En 2005,il a été livré un peu moins de lait que l’année d’avant.L’évolution concernant le fromage,le principal produit de l’économie laitière,a été réjouissante sur les marchés tant intérieur qu’extérieur.De même,les ventes de produits laitiers frais,de yogourt et de crème de consommation ont augmenté,d’où une baisse des quantités de poudre de lait et de beurre,qu’il est souvent difficile de mettre en valeur d’une manière conforme au marché.Les prix à la production du lait,quant à eux,continuent de baisser.
Par rapport à l’année précédente,la production laitière totale a augmenté de 20'000 t pour passer à 3,96 millions de t,dont quelque 19% ont servi à l’auto-approvisionnement ou à l’affouragement dans la ferme.Au contraire,les livraisons de lait (3,203 mio. de t) ont légèrement baissé en 2005 (–8'765 t).Cette quantité a été produite par 567'997 vaches.La performance laitière moyenne par vache s’est un peu améliorée (+10 kg) pour atteindre 5'690 kg.
Livraisons de lait par mois 2004 et 2005
Les fortes fluctuations saisonnières des livraisons de lait posent toujours le même défi pour la transformation.Une pointe a ainsi été enregistrée au mois de mai de l’année sous revue,soit 59'500 t ou 24% de plus que,par exemple,en août.
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre en 1 000 t Livraisons de lait en 2005 Livraisons de lait en 2004 Source: TSM 220 230 250 240 270 260 280 290 300 310 320 1.1 ECONOMIE 1 20
Tableaux 3–12,pages A4–A12
En 2005,la totalité du lait commercialisé (3,203 mio.de t) a été mise en valeur comme suit (en t de lait):
lait de consommation et autres produits laitiers:1 099 889 t(–2,6%) fromage:1 371 514 t(+2,2%)
crème/beurre:731 819 t(–1,2%)
La quantité de fromage fabriquée a progressé de 3,3% par rapport à l’année précédente,passant à 167'708 t.Les quantités produites de fromage frais,à pâte mi-dure et à pâte dure se sont également accrues,passant respectivement à 39'781 t (+8%), 49'433 t (+3,2%) et 71'050 t (+0,5%).Le volume de production de fromage à pâte molle a légèrement reculé à 6'565 t (–2,4%),tandis que celui des fromages de brebis et de chèvre a augmenté à 879 t (+8%).
La production de produits laitiers frais poursuit,elle aussi,sa courbe ascendante.Celle de yogourt a atteint,à elle seule,un volume de presque 140'471 t (+4,6%).La production de crème de consommation a par contre régressé de 1,7%,passant à 488'412 t.
Dans l’année considérée,la production de crème a accusé une faible tendance à la hausse,pour la première fois depuis quelques années.La production de lait écrémé et de lait entier a un peu baissé,alors que pour le beurre,le recul a été plus marqué: –3,7%,ou presque 1'500 t.
1990/92 200320042005 en 1 000 t de lait Autres produits laitiers Crème Beurre Sources: TSM, USP Fromage Lait de consommation 0 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 ■ Mise en valeur: davantage de fromage 1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE 1.1 ECONOMIE 21 1
Evolution de la mise en valeur du lait commercialisé
■ Commerce extérieur: bilan global positif
Dans le secteur laitier,le bilan du commerce extérieur est resté positif.En termes de volumes,la Suisse a exporté plus de fromage,de lait en poudre,de yoghourt et de crème qu’elle n’en a importé.
Les exportations de fromage (y compris 5'312 t de fondue prête à l’emploi) ont progressé de 2% à 57'020 t,les importations ont légèrement augmenté et sont passées à environ 31'912 t.A noter surtout,en 2005,un recul marqué des exportations de yogourt de 57,1% à 7'300 t.Les exportations de crème,en revanche,ont fait un bond de 210%,passant à 4'275 t.Cette différence s’explique en partie par une utilisation judicieuse du contingent tarifaire «Yogourt et crème» permettant l’importation en franchise dans l’UE.Par rapport à l’année précédente,les exportations de poudre de lait se sont accrues de 1'353 t ou 8,7%,atteignant ainsi 16’970 t,alors que les importations ont diminué de 41,1%.
Dans la quatrième année suivant l’entrée en vigueur de l’accord sur le fromage avec l’UE,une fois de plus,les quantités pouvant être importées dans le cadre des contingents à droit zéro n’ont pas été entièrement attribuées.Sur les 19'500 t disponibles, 16'059 t seulement ont été acquises aux enchères.Contrairement aux deux années précédentes,le contingent 119 (mozzarella) a toutefois été attribué intégralement en 2005.
Contingents d’importation de fromage en Suisse
gentattribuéegentattribuée
La mise aux enchères des deux premières tranches semestrielles de droits d’importation pour l’année 2006/07 a confirmé l’évolution des quatre années passées.Alors que les quantités contingentaires de mozzarella,d'autres fromages frais,à pâte molle,à pâte mi-dure et dure ont été entièrement attribuées,2'090 t seulement des 2'500 t de la quantité contingentaire no 121 ont été acquises et 163 t des 250 t offertes en ce qui concerne le provolone.
Produit1ère année 2ème année 3ème année4ème année (juin 02 – mai 03)(juin 03 – mai 04)(juin 04 – mai 05)(juin 05 – mai 06) Contin-QuantitéContin-QuantitéContin-QuantitéContin-Quantité gentattribuéegentattribuée
en ten ten ten ten ten ten ten t 119Mozzarella5005007005009507001 0501 050 120Fromages frais et à pâte molle1 0001 0003 3001 0004 8504 8506 3506 037 121Asiago,bitto,brà,fontal, montasio,etc.5 0002 7195 0005 0005 0003 4275 0003 073 122Provolone500211500500500304500273 123Fromages à pâte dure et mi-dure5 0004 5695 0005 0005 7005 3676 6005 626 Source:OFAG
N o du contingent 1.1 ECONOMIE 1 22
■ Consommation: yogourts à la mode
Selon l’accord précité,la Suisse a disposé la quatrième année d’un volume de 6'750 t pour des exportations supplémentaires de fromage en franchise vers l’UE (augmentation du contingent à droit zéro de 1’250 t par rapport à la troisième année).Comparé à la troisième année,cette possibilité d’accès au marché a été mieux utilisée.En juillet 2005 (début de l’année contingentaire),l’UE a délivré pour la période de juillet à décembre 2005 des licences d’importation correspondant à un volume de 1'564 t,ce qui représente une augmentation de 613 t,soit 64,4%,par rapport à la période correspondante de l’année précédente.Or,une quantité de 3'375 t était disponible pour ce premier semestre contingentaire.Il resterait donc pour le second semestre 2005/06 un volume de 5'186 t,lequel incluait les contingents non utilisés au premier semestre.
Le contingent de 2'000 t offert par l’UE pour les importations en franchise de yogourt et de crème a,quant à lui,de nouveau été utilisé intégralement.
L’évolution de la consommation de certains produits laitiers par habitant montre qu’à l’exception de la hausse concernant les yogourts,la tendance reste stable.
La consommation par habitant de fromages à pâte molle,mi-dure et dure a légèrement diminué par rapport à l’année précédente.Celle de fromages frais a compensé ce recul par une augmentation de 4,9%,qui a fait passer la consommation par habitant à 6,4 kg.Quant aux ventes de yogourts,elles ont atteint 17,8 kg par habitant,soit une remarquable hausse de 2,2 kg ou 14,1%.
Evolution de la consommation par habitant 1990/92 200320042005 kg par habitant Fromage Yoghourt Source: USP Beurre Séré 0,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 14,0 16,0 18,0 20,0 1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE 1.1 ECONOMIE 23 1
■ Prix à la production: tendance à la baisse
En comparaison de l’année précédente,le prix à la production moyen du lait au départ de la ferme ou du centre collecteur a baissé de 2,2 ct.,passant à 72,41 ct.
Prix du lait en 2005,pour toute la Suisse et selon les régions 1
■ Prix à la consommation: pression accrue
1Région I:Suisse romande;région II:Berne,Suisse centrale;région III:Suisse du Nord-Ouest; région IV:Zurich/Suisse orientale;région V:Suisse méridionaleSource:OFAG
Dans l’année sous revue,les différences régionales de prix concernant le lait industriel et le lait transformé en fromage ont augmenté,atteignant respectivement jusqu’à 2,22 ct.et 8,66 ct.Au contraire,la différence régionale du prix du lait biologique a diminué jusqu’à 4,24 ct.Le prix de ce lait a baissé de 4,3% pour s’établir en moyenne à 81,81 ct./kg.Selon la région,le lait biologique est de 8,36 à 14,03 ct./kg plus élevé que le lait industriel ou le lait transformé en fromage.
Quelques exemples illustrent la pression générale exercée sur les prix des produits laitiers au niveau de la vente:en 2005,1 kg d’emmental a coûté en moyenne 19,63 francs,soit 30 ct.de moins que l’année précédente.De même,le consommateur a payé 20,19 francs le kg de gruyère,à savoir 35 ct.de moins.S’agissant de la mozzarella 45%,le prix à la consommation a baissé de 7 ct.par rapport à l’année précédente, s’établissant à 2,13 francs les 150 g.Les prix du beurre surchoix et de la crème entière ont également baissé en l’espace d’une année,passant respectivement de 3,14 à 2,95 francs (200 g) et de 4,50 à 4,22 francs (1⁄2 l ).
Evolution des indices des prix à la consommation du lait et de produits laitiers
Contrairement à l’année précédente,les indices des prix à la consommation de tous les produits laitiers accusent une tendance à la baisse en 2005.Celui du beurre a reculé le plus fortement:moins 2,91 points ou 3%.
ct./kgSuisseRégion IRégion IIRégion IIIRégion IVRégion V Total72.4172.6972.0971.5774.0274.15 Lait industriel71.0471.4271.1070.3671.6972.58 Lait transformé en fromage72.2175.1770.7071.8271.8179.36 Lait biologique81.8184.4181.6484.3980.17 non relevé
1990/92 200320042005 Indice (mai 1993 = 100) Lait Fromage Beurre Source: OFS Crème Autres produits laitiers 75 85 80 90 95 100 105 1.1 ECONOMIE 1 24
■ Marge du marché: tendance à la baisse
Après avoir atteint le pic au mois de juin,la marge brute totale sur le lait et les produits laitiers a continuellement baissé jusqu’en décembre.L’évolution de la marge brute réalisée sur le fromage est un exemple typique.De manière générale,cette baisse, très évidente aussi pour le beurre,s’explique par diverses ventes promotionnelles au second semestre 2005.

Indice (janvier 1997 = 100) Fromage Lait et produits laitiers Yogourt Beurre Source: OFAG 40 50 60 70 80 100 90 110 120 130 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 1.1 ECONOMIE 25 1
Evolution de la marge brute en 2005
Animaux et produits d’origine animale
L’apparition de la grippe aviaire en Europe a occasionné un effondrement de la consommation de viande de volaille vers la fin de l’année sous revue.A partir d’octobre 2005,les ventes ont chuté d’environ 20%,et n’ont pas repris avant le printemps 2006. La consommation de viande de volaille par habitant a ainsi baissé de 2,8% par rapport à l’année précédente.Les prix à la production de poulets et de dindes sont restés relativement stables,mais les abattoirs ont réduit leur production.Ils ont demandé aux engraisseurs de se procurer moins de coquelets ou d’observer des périodes intermédiaires prolongées.Ces deux mesures ont causé des pertes de recettes aux engraisseurs.En revanche,la grippe aviaire n’a pas eu d’influence notable sur le marché des œufs.Dans l’année sous revue,chaque habitant a mangé 185 œufs en moyenne. La production dans le pays s’est accrue de 0,8% (5 mio.de pces),mais la Suisse a aussi importé 1'300 t de plus que l’année d’avant.
Le marché des porcs a subi une baisse historique,et les producteurs n’ont obtenu en moyenne de l’année que 4,02 fr./kg PM.Ce phénomène est le résultat d’une augmentation de la production de 4%.Les consommateurs ont profité du recul d’environ 10% des prix de vente,et la consommation de viande de porc a ainsi augmenté de plus de 2% par rapport à 2004.Avec un prix annuel de 13,20 fr./kg PM,les engraisseurs de veaux ont connu une bonne année.Ce prix n’avait pas été atteint depuis plus de 10 ans.Comme les veaux dits «maigres» destinés aux exploitations d'engraissement de veaux ou de gros bétail étaient rares,ils ont coûté cher.Sur le marché des bovins, les prix à la production étaient plus bas que l’année précédente;la consommation en revanche a continué d’augmenter.En considération du manque de viande de transformation,l’importation de plus de 2'400 t de viande de vache a été autorisée.

26 1.1 ECONOMIE 1
Tableaux 3–12,pages A4–A12
■ Production:progression du cheptel de porcs
Pour la première fois depuis 2001,l’effectif de bovins s’est accru (+0,7%).Depuis des années,le nombre de vaches produisant du lait destiné à la commercialisation diminue, tandis que celui de vaches allaitantes augmente.Les bovins étaient détenus dans 45'430 exploitations,soit quelque 750 exploitations de moins qu’en 2004.L’effectif de porcs, en hausse de 4,7%,a atteint 1,609 millions de têtes.Il n’a jamais été aussi important depuis 1994.Le nombre de truies d’élevage a augmenté de 5'600 têtes,passant à 148'800 animaux.La garde de moutons,de chèvres et de chevaux étant très appréciée, ces cheptels ont beaucoup augmenté depuis 1990.C’est dans la région de montagne que les effectifs de moutons et de chèvres sont les plus nombreux.
Evolution des effectifs
Espèce animale19902003200420051990–2003/05
en 1 000en 1 000en 1 000en 1 000%
Bovins1 8581 5701 5441 555–16,24 –vaches dont le lait est commercialisé726587570568–20,80 –vaches traites,dont le lait n’est pas commercialisé515151531,31
–vaches allaitantes14657078407,14
Porcs1 7761 5291 5371 609–12,26
Moutons35544544044624,98
Chèvres6167717415,85
Chevaux3853545542,11
Poulets de chair2 8784 5184 9715 06068,51
Poules pondeuses et poules d’élevage2 7952 1172 0882 189–23,75
Source:OFS
L’effectif de poulets de chair a continué de grimper et compte désormais plus de 5 millions de têtes,soit une augmentation de 76% par rapport à 1990.Dans l’ensemble,quelque 1'000 exploitations gardent des poulets de chair.
La production de viande de porc (236'165 t PM) est la plus importante du point de vue quantitatif,suivie de la viande de bœuf (100'024 t PM) et de la viande de volaille (33'361 t de poids prêt à la vente).Par rapport à 2004,la production suisse de viande de chèvre a augmenté de 16,4% et celle de viande de porc de 4%.On a par contre enregistré une baisse dans la production de viande de cheval (–10,4%),de mouton et d’agneau (–6,1%),de veau (–4,1%) et de volaille (–2,9%).Depuis le début des années nonante,la production de viande de volaille en Suisse s’est accrue chaque année.Cette tendance a été interrompue pour la première fois en 2005 à cause de la grippe aviaire.Depuis 1990/92,les effectifs de bovins et de porcs sont en diminution dans les fermes suisses,ce qui a entraîné une baisse de la production de 23,5% et 11,4% respectivement.La production de ces deux types de viande s’est donc adaptée à la consommation en recul à long terme.Le phénomène inverse a été observé pour la viande de volaille,dont la production en Suisse s’est accrue de 60,9% suite à la hausse substantielle de la consommation depuis 1990/92.En ce qui concerne la viande de mouton et d’agneau,l’évolution n’est pas parallèle:alors que la consommation est restée stable depuis 15 ans,la production indigène a augmenté de 22,2%.
1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE 1.1 ECONOMIE 27 1
Evolution de la production animale
■ Commerce extérieur: le Brésil,principal fournisseur de viande de bœuf et de volaille
Les viandes de bœuf et de porc consommées sont produites en Suisse à raison de 85,9% et de 94,3% respectivement.Mais seulement un kilo de viande de cheval sur dix,un kilo de viande de lapin sur cinq et un kilo de viande de volaille,de chèvre et de mouton sur deux sont issus de la production suisse.Toutes catégories confondues,la part de la production suisse s’est montée à 80,5% dans l’année sous revue.
La production d’œufs,quant à elle,a augmenté de 0,8%,passant à 657 millions de pièces.En comparaison de la période 1990/92,elle s’est accrue de 3%.
Les exportations de viande et de produits à base de viande suisses se sont élevées à 2'160 t.Avec une part de marché de 1'218 t,la viande séchée de bœuf est le produit d’exportation principal,qui est presque exclusivement destiné à la France et à l’Allemagne.La valeur commerciale des exportations de viande s’est montée à quelque 30 millions de francs.
Dans l’ensemble,les entreprises suisses ont importé plus de 103’000 t de viande,de produits à base de viande et d’abats pour une valeur commerciale d’environ 690 millions de francs.Les principaux pays fournisseurs ont été l’Allemagne (31'000 t),le Brésil (20'000 t) et la France (10'000 t).Ces importations représentent au total une valeur commerciale d’environ 275 millions de francs.En termes quantitatifs,la viande de volaille et de bœuf l’emportent,avec des importations de 42'100 t et 12'600 t respectivement.L’offre de viande de bœuf dans le pays a été faible;depuis de nombreuses années,la Suisse n’en avait pas importée autant.
79% des importations de viande de bœuf et de veau proviennent du Brésil,ce qui correspond à une augmentation de 5% par rapport à l’année précédente.Suivent l’Afrique du Sud (5%),les Pays-Bas (4%) et la France (4%),mais d’assez loin.Le Brésil exporte avant tout des morceaux parés de la cuisse de bœuf,des aloyaux et du HighQuality-Beef.Avec une part de 82%,l’Australie et la Nouvelle-Zélande sont les plus grands exportateurs de viande de mouton et d’agneau.Quant à la viande de cheval, elle provient principalement des Etats-Unis (46%) et du Canada (34%).Pour la première fois,le Brésil est devenu notre fournisseur le plus important de viande de volaille,avec une part de 26% aux importations.Ce pays est également le plus grand
1990/92200320042005
bœuf Viande de mouton Viande de volaille
Proviande, USP Viande de veau Viande de chèvre Oeufs en coquille 70 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 Viande de porc Viande de cheval
Indice (1990/92 = 100) Viande de
Sources:
1.1 ECONOMIE 1 28
■ Consommation:la viande de porc vient en tête
exportateur au niveau mondial.19% de la viande de volaille sont importés d’Allemagne et 17% chacun de France et de Hongrie.Les produits de charcuterie italiens ont toujours la cote dans notre pays;quelque 2'600 t y sont vendues.En outre,les ménages suisses et le secteur de la restauration utilisent environ 1'600 t de préparations de viande et de conserves provenant de France.

3'229 ânes et chevaux ont été importés en Suisse.Un cheval sur trois provient d’Allemagne,un sur quatre de France.La Suisse a également exporté 1'064 équidés.
Le commerce extérieur d’œufs se distingue par son caractère unilatéral.En effet, les importations s’élèvent à plus de 28'300 t alors que les exportations n’excèdent pas 70 t.Les importations ont augmenté de 1'300 t par rapport à l’année d’avant. La moitié environ des oeufs importés sont vendus dans le commerce de détail,l’autre moitié étant cassée et utilisée dans l’industrie alimentaire.Les œufs provenant d’Allemagne,des Pays-Bas et de France,soit 22'800 t au total,représentent la majeure partie des importations.La Suisse a par ailleurs importé 10'500 t de produits à base d’œufs liquides et séchés,ainsi que des ovalbumines,dont plus de la moitié provient des Pays-Bas.Quant aux exportations,elles s’élèvent seulement à 10 t.
Dans le cadre du cycle d’Uruguay de l’OMC,la Suisse s’est engagée à faciliter l’accès au marché pour une quantité de viande déterminée en abaissant les droits de douane perçus sur les contingents.Depuis 1996,le contingent d’importation s’élève en tout à 22'500 t pour les viandes de bœuf,de mouton,de cheval et de chèvre.La Suisse a respecté cet engagement chaque année et autorisé,en moyenne annuelle,l’importation de plus de 28'000 t au cours des dix dernières années.Quant à la viande de porc et de volaille,le volume du contingent tarifaire a passé de 50'020 t en 1996 à 54'500 t en 2000 et s’est stabilisé à ce niveau depuis.Les contingents convenus pour ces deux viandes ont également été dépassés pour la moyenne des années 1996 à 2005,s’élevant à 54'570 t par an.Durant six années,la quantité contingentaire n’a toutefois pas été atteinte,mais ce déficit a été plus que compensé par des importations supplémentaires dans quatre années.Depuis 1996,le contingent tarifaire d’animaux de l’espèce chevaline est fixé à 3'322 têtes.Il est utilisé en moyenne à raison de 89%.
La consommation de viande,qui s’est élevée à 393'296 t,a progressé de 0,6% par rapport à celle de l’année précédente.La viande de porc en représente la moitié,tandis que la viande de chèvre n’y a qu’une faible part (708 t).De plus en plus appréciées,tant la viande de bœuf que celle de porc ont été davantage consommées (+2,1%).Par contre, la consommation de volaille a régressé de 2,3%,surtout à cause de la grippe aviaire. Cependant,le recul le plus marqué a été enregistré pour la viande de gibier et de lapin (–6,6%) ainsi que pour celle de mouton et d’agneau (–4,2%).En outre,les Suisses ont consommé 58'057 t de poissons et de crustacés,ce qui correspond à une baisse de 1%.
La consommation de viande par habitant est restée stable,à 51,75 kg,pendant l’année sous revue.Comme l’année précédente,la consommation de viande de porc vient en tête (25,2 kg),suivie de la viande de bœuf (10,39 kg).La consommation par habitant s’est accrue de 1,6% dans les deux cas.Celle de viande de cheval est restée inchangée à 0,63 kg.Les baisses de consommation les plus importantes par habitant ont été observées pour la viande de volaille (–0,28 kg) et pour la viande de veau (–0,11 kg).
1.1 ECONOMIE 1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE 29 1
■ Prix à la production: hausse du prix des veaux de boucherie
De même,les poissons et les crustacés ont été moins prisés et la consommation a baissé de 1,5%,pour s’établir à 7,64 kg.La consommation d’œufs,qui avait tendanciellement diminué depuis 1990/92,a repris en 2005.185 œufs ont été consommés par personne (2004:182).
Indice (1990/92 = 100)
1990/92
Les ménages privés consomment beaucoup de saucisses et de charcuterie,à savoir 45% de la consommation totale.La viande de porc et la viande de volaille sont importantes en termes de quantité (18% chacune).Le secteur de la restauration sert le plus souvent de la charcuterie (part de 19%) et de la viande de bœuf (17%).
Concernant les animaux de l’espèce bovine (taureaux,bœufs et génisses) de qualité moyenne (classe commerciale T3),le prix du kg de viande PM franco abattoir s’est établi à environ 8 francs en moyenne annuelle.Les prix sont restés stables depuis 2003.Par contre,les prix des vaches ont baissé;dans toutes les classes commerciales, ils étaient inférieurs d’environ 0,5 fr./kg PM à ceux de l’année précédente.Pour une vache de la classe commerciale T3,les agriculteurs ont touché 6,16 fr./kg PM.Vers la fin de l’année sous revue,le prix des veaux de boucherie a grimpé à plus de 15 fr./kg PM.Le prix annuel moyen de 13,20 fr./kg PM a été le plus élevé depuis 1994.Cette hausse s’explique principalement par l’offre restreinte qui,à son tour,résulte d’un faible effectif de vaches et d’une consommation stable.L’accroissement de la production de porcs (4%) a causé un effondrement du prix annuel des porcs à viande,qui a atteint un plancher record de 4,02 fr./kg PM.Le prix des agneaux de qualité moyenne (classe commerciale T3) a légèrement augmenté (1%) en raison d’une diminution de la production suisse (–6,1%).
Evolution de la consommation de viande et d'œufs par habitant
200320042005
Viande de bœuf Viande de porc Viande de chèvre
Proviande,
Viande de volaille Viande de veau Viande de mouton 70 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 Viande de cheval Oeufs en coquille (pces)
Sources:
USP
1.1 ECONOMIE 1 30
Des variations saisonnières de prix sont apparues et ont concerné les porcs et les veaux.Au cours du second semestre,le prix des veaux a grimpé de 11,85 fr.à 15,10 fr. le kg PM en raison de la diminution de l’offre.Comme d’ordinaire,c’est de mai à juillet que le prix des porcs était le plus élevé (4,76 fr./kg PM),car la demande s’accroît généralement à la saison des grillades.A partir de l’été,les prix des porcs ont continuellement baissé,atteignant encore 3,73 fr./kg PM en novembre.S’agissant des agneaux,les pics saisonniers de l'offre sont observés au printemps et en automne.Aux mois d’avril et d’octobre,les producteurs ont ainsi touché moins de 10 fr./kg PM.
Dans l’année sous revue,les morceaux de viande de porc ont été vendus aux consommateurs à un prix jusqu’à 10% inférieur à celui de 2004.La baisse des prix à la production s’est donc répercutée jusqu’à l’étalage.Ces trois dernières années,les prix à la consommation de divers morceaux de bœuf et d’agneau sont restés stables.Toutes catégories d’animaux confondues,les prix à la consommation au cours de la même période ont été supérieurs à ceux de 1990/92.Cela s’explique probablement par la part plus élevée de viande produite sous label et des coûts supplémentaires dans la chaîne de valeur ajoutée (RPLP,élimination de sous-produits animaux,coûts supplémentaires pour la déclaration et la traçabilité des denrées alimentaires,etc.).C’est le prix du ragoût de veau qui a grimpé le plus fortement depuis 1990/92 (+43%).Celui des côtelettes de porc n’a augmenté que de 3,5%.Une chute des prix a par contre été enregistrée depuis 1990/92 pour les taureaux (–13%),les veaux (–12%),les porcs (–25%) et les agneaux (–31%).L’écart entre les prix à la production et à la consommation s’est donc nettement creusé.
Prix mensuels du bétail de boucherie et des porcs en 2005 Fr./kg PM
Veaux cl. commerciale T3 Agneaux cl. commerciale T3 Taureaux cl. commerciale T3
Vaches cl. commerciale T2/3 Porcs charnus, légers
2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Source: USP
1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE 1.1 ECONOMIE 31 1
■ Prix à la consommation: viande de porc meilleur marché
La hausse continue de la marge brute nominale de transformation-distribution réalisée sur la viande de bœuf,la viande de porc et le panier de toutes les sortes de viande fraîche,y compris produits carnés et charcuterie,a marqué le pas en 2005.La marge a baissé de 5% en ce qui concerne la viande de bœuf et de 2,4% et 1,6% pour ce qui est respectivement de la viande de porc et de l’ensemble des sortes de viande fraîche. Quant à la viande d’agneau,la marge n’a pas changé par rapport à l’année précédente.En effet,la tendance à la hausse qui avait été observée de 1999 à 2003,avait pris fin en 2004.De manière générale,le recul des marges brutes est attribuable au renforcement de la concurrence dans la filière de la viande.L’entrée annoncée sur le marché de grands discounters de denrées alimentaires est une des raisons.Par ailleurs, la mise aux enchères d’une partie des contingents tarifaires de viande a déjà accru la concurrence.L’augmentation de la marge la plus marquée depuis 1999 a été observée pour la viande de porc (+35,5%) et la plus faible pour la viande de veau (+15,1%).La marge réalisée sur le panier de la ménagère contenant toutes les sortes de viande fraîche,y compris des produits à base de viande et des produits de charcuterie,n’a cessé de grimper depuis la période de référence (février-avril 1999,indice = 100),pour atteindre 118,8 points.
■ Marge brute réalisée sur la viande
Indice (février–avril 1999 = 100) Porcs Bœuf Veau Agneau Viande fraîche, produits carnés et charcuterie Source: OFAG 150 135 140 145 130 125 120 115 110 105 100 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 1.1 ECONOMIE 1 32
Evolution des marges brutes sur la viande en 2005
■ Conditions météorologiques:temps chaud et ensoleillé
Production végétale et produits végétaux
Dans l’année sous revue,les températures ont dépassé la moyenne de 1961 à 1990 des deux côtés des Alpes.Le plus grand excédent de chaleur a été enregistré en juin, suivi des mois de mai,octobre,avril et septembre.Les mois de février et décembre,par contre,ont été plus froids que d’ordinaire.Le long du Plateau suisse et des Alpes centrales surtout,les précipitations sont restées en dessous de la moyenne.En août, elles ont été particulièrement fortes au nord des Alpes,ramenant régionalement la somme annuelle à la normale.Dans toute la Suisse,le mois de novembre et à maints endroits aussi le mois de mars,ont été trop secs.Comme la quantité de pluie a été inférieure,chaque mois,à la moyenne pluriannuelle au sud des Alpes,cette région a enregistré un gros déficit de précipitations.A l’exception du Puschlav et de la BasseEngadine,la durée d’ensoleillement a dépassé la moyenne pluriannuelle.Les mois de juin,mai,mars et janvier,en particulier,ont été plus ensoleillés que d’habitude.
Il y a aussi eu des événements extrêmes:la période de froid de mi-février à mi-mars, avec un déficit moyen de température de 5°C par rapport à la moyenne pluriannuelle; le retour de l’hiver en Suisse occidentale du 17 avril,avec 20 cm de neige à Aarberg et 30 cm à Lausanne;la tempête de grêle du 18 juillet dans le Lavaux,qui a causé de gros dégâts dans une grande partie des vignobles,et les fortes pluies des 21 et 22 août au nord des Alpes.Depuis 1901,la Suisse n’avait plus connu de pluies diluviennes occasionnant autant de dégâts.Cet événement a surtout touché l’Oberland bernois et la Suisse centrale,partiellement aussi les Préalpes,en particulier entre l’Emmental et la région des lacs de Zoug et des Quatre-Cantons,ainsi que le Prättigau.Dans ces régions,on a mesuré la plus grande quantité de pluie jamais tombée en 1,2 et 5 jours depuis 1901.

1.1 ECONOMIE 33 1
■ Production:extension des cultures de colza et de céréales
Cultures des champs
La surface occupée par les terres ouvertes a globalement augmenté de 6'412 ha (2%) par rapport à l’année précédente.Les cultures de céréales fourragères se sont étendues plus fortement (7%) que celles de céréales panifiables (1%),si bien que la régression de l’année passée a été compensée.Les surfaces ont également augmenté en ce qui concerne les légumineuses (6%),le colza (5%),ainsi que le maïs d’ensilage et le maïs vert (2%).Elles ont au contraire diminué pour ce qui est du soja (–39%),des betteraves fourragères (–13%),des pommes de terre (–6%) et des betteraves sucrières (–1%).
Composition des terres ouvertes en 2005 (provisoire)
Total 287 715 ha
Maïs d'ensilage et maïs vert 15% 43 111 ha
Légumes de plein champ 3% 8 840 ha
Colza 6% 17 715 ha
Betteraves sucrières 6% 18 352 ha
Autres cultures 7% 18 686 ha
Céréales 59% 168 449 ha
Pommes de terre 4% 12 562 ha
Source: UFP
En comparaison des très bons résultats de l’année précédente,les rendements ont été moindres dans l’année sous revue.Le recul le plus marqué a été enregistré pour l’orge (–11%) et le plus faible pour les betteraves sucrières (–1%).
Evolution des rendements à la surface de divers produits des champs
Indice (1990/92 = 100)
1990/92199920002001200220042005 2003
Produits (rendements 2005 provisoires)
Blé d'automne (57,5 dt/ha)
Pommes de terre (387,0 dt/ha)
Colza (32,3 dt/ha)
Orge (61,4 dt/ha)
Betteraves sucrières (762,8 dt/ha)
Source: USP
70 140 130 120 110 100 90 80 1.1 ECONOMIE 1 34
Tableaux 3–12,pages A4–A12
En dépit de l’extension des surfaces céréalières,la production de céréales,tant panifiables que fourragères,est restée en-deça de celle de l’année précédente (–3%).Une tendance inverse a été observée seulement pour le maïs-grain,avec une augmentation de la surface et des rendements légèrement plus élevés.Pour la première fois depuis 2001,200'000 t de maïs-grain ont été battues.
Malgré une plus faible récolte de céréales panifiables,la Fédération suisse des producteurs de céréales a été contrainte de transférer quelque 41'000 t au secteur des aliments pour animaux,en raison d’une offre excédentaire.Les conditions de croissance ayant été favorables jusqu’à fin novembre,les betteraves ont présenté une teneur en sucre réjouissante de 17,5%,et la récolte (13,3 t/ha) a également été très bonne.Avec un taux de rendement approchant les 90%,la production de sucre s’est élevée à 221'434 t.En moyenne des années 2002 à 2004,environ 35% de la récolte de pommes de terre n’ont pas pu être utilisés dans le secteur de l’alimentation.Alors qu’en 2003,65% de cette quantité ont été affouragés à l’état frais,cette part à augmenté à 73% en 2004 et à 88% dans l’année sous revue.L’affouragement des tubercules non traités a nettement gagné en importance.La très bonne récolte de colza de l’année 2004 a été suivie d’une bonne récolte en 2005 (57'000 t).Pour la première fois depuis l’introduction de l’égalisation des récoltes en 2001,elle a couvert,en 2005, les besoins pour la fabrication d’huiles comestibles;il n’a donc pas été nécessaire de céder aux huileries du colza destiné à un usage technique.
1990/92 200320042005 1 en 1 000 t Blé Triticale Source: USP 1 provisoire Seigle Avoine Epeautre Maïs-grain Orge 0 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 547 516 232 201 528 257 181 428 218 91 342 211
1.1 ECONOMIE 1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE 35 1
Evolution de la production céréalière
■ Mise en valeur: l’affouragement de pommes de terre à l’état frais a augmenté
■ Commerce extérieur: huiles et oléagineux destinés à des fins techniques
Les huiles végétales sont utilisées dans l’alimentation humaine et animale ou,en dehors du secteur alimentaire,à des fins techniques,par exemple comme lubrifiants dans des domaines sensibles de l’industrie alimentaire ou pour la fabrication de carburants,tels que l'ester méthylique de colza.Dans l’année considérée,environ 31'000 t d’huiles ont servi à des fins techniques;de plus,7'100 t d’oléagineux destinés à la fabrication d’huile pour des fins techniques ont été importées.Sur les 42'710 t d’huile de tournesol importées,46% étaient destinés à un usage technique.S’agissant des oléagineux importés pour la fabrication d’huile à des fins techniques,le colza vient au premier rang,suivi du soja.
Importations d'huiles végétales et d'oléagineux destinés à des fins techniques 2005
Tournesols, carthame en 1 000 t Ricin Betteraves, colza, moutarde
■ Prix à la production: baisse des céréales
Le prélèvement à la frontière sur les céréales panifiables et les aliments pour animaux ayant été réduit au 1er juillet 2005,la branche a abaissé les prix indicatifs.Tandis que celui fixé pour les céréales de la classe I avait été largement dépassé dans l’année 2003 marquée par la sécheresse et qu’il avait été atteint en 2004,le prix à la production a été inférieur au prix indicatif dans l’année sous revue.
La réduction des contributions fédérales octroyées pour la transformation de betteraves sucrières et d’oléagineux,ainsi que pour la mise en valeur de pommes de terre, n’a que légèrement influé sur leurs prix à la production.S’agissant des pommes de terre,les prix moyens à la production ont été un peu plus élevés que l’année précédente,bien que la part utilisée dans l’alimentation animale ait de nouveau été importante.
Palme Soja Jojoba Arachide Tung Olives Coco Autres végétaux Source: DGD Huile Fruits 0 48121620
Lin
1.1 ECONOMIE 1 36
1990/92199920002001200220042005 2003
Prix à la production 2005
Blé cl. I, 52.42 fr./dt
Betteraves sucrières, 11.77 fr./dt
Colza, 76.83 fr./dt
Orge, 42.24 fr./dt
Pommes de terre, 34.30 fr./dt

Source: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
Les prix à la consommation de la farine blanche et du pain mi-blanc sont restés stables. Une augmentation des prix a été enregistrée pour le pain bis (1%),les pommes de terre (1%),les petits-pains (2%) et le sucre (4%),tandis que ceux de l’huile de tournesol (–2%) et des spaghettis (–8%) ont baissé.
partiellement en baisse
des recettes des producteurs pour des produits des champs
■ Prix à la consommation:
Evolution
Ecart en %
–70 0 –10 –20 –30 –40 –50 –60 1.1 ECONOMIE 37 1
■ Production:plus de légumes et de fruits, mais moins de vin
Cultures spéciales
Une surface de 23'745 ha,soit 2,2% de la SAU,a été affectée aux cultures pérennes, dont 14'903 ha de vignes,6'672 ha de cultures fruitières et 297 ha de baies.
Les surfaces recensées (y compris les cultures successives) par la Centrale suisse de la culture maraîchère (CCM) se sont élevées à 13'800 ha.Elles ont augmenté de 350 ha par rapport à l’année précédente.Ce sont les cultures d’épinards de conserve (+150 ha),ainsi que de haricots à conserve et de chicorée Witloof (+50 ha chacune) qui se sont le plus fortement accrues.Après le recul enregistré l’année précédente, les cultures d’épinards ont repris au cours de l’année sous revue.Pour les surfaces affectées aux carottes et aux oignons,l’offre fluctue beaucoup d’année en année. En comparaison de l’année précédente,où elle avait augmenté de 110 ha,la surface affectée à ces légumes a reculé de 130 ha.
En ce qui concerne les surfaces dévolues aux fruits,la tendance observée ces dernières années s’est confirmée.La surface affectée aux pommiers (4'315 ha) a perdu quelques hectares,mais elle a diminué moins fortement que les années antérieures.En revanche, les surfaces occupées par les variétés Gala,Braeburn,Topaz et Pinova se sont encore accrues.Elles ont ainsi doublé au cours des sept dernières années et couvrent désormais 1'000 ha.La surface de poiriers s’est élevée à 946 ha,en légère baisse par rapport à 2004.Les fruits à noyau et les baies sont toujours très appréciés,de sorte que la surface affectée aux fruits à noyau a augmenté de 15 ha (1'366 ha) et celle réservée aux baies a progressé de 24 ha (720 ha).
La surface de vigne s’est élevée à 14'903 ha,soit 34 ha de moins que l’année précédente.Cette surface était plantée de cépages blancs sur 6'454 ha (–133 ha) et de cépages rouges sur 8'449 ha (+99 ha).En raison de la demande modérée de vins blancs et des contributions octroyées pour l’arrachement de plants de vignes Chasselas et Müller-Thurgau,les surfaces plantées de cépages blancs continueront de diminuer les prochaines années,mais plus faiblement.
Salades à feuilles: évolution de l'offre de 1996/98 à 2003/05
Salade pommée en t Batavia Chou de Chine Endives Salade à feuilles, autres Lollo rouge Salade pain de sucre Salade iceberg Salade feuilles de chêne Doucette Chicorée rouge Source: CCM 1996/98 2003/05 0 5 000 10 000 15 00020 000 1.1 ECONOMIE 1 38
■ Mise en valeur:faible récolte de fruits à cidre
Les récoltes de légumes se sont montées à 316'000 t (sans la transformation) et celles de fruits de table à 133'000 t.Comparés à la moyenne des quatre dernières années, les rendements obtenus ont progressé de 6% pour les légumes et de 5% pour les fruits.
Les légumes-feuilles,qui ont généré 273 millions de francs,représentent un tiers du chiffre d’affaires réalisé par la vente de légumes.En termes quantitatifs,leur importance est toutefois moindre.Les 80'000 t récoltées correspondent à un quart de la quantité totale de légumes.Dans les sept dernières années,l’offre de légumes-feuilles a augmenté de 6'400 t,soit de 9%.Le choix de salades a fortement varié durant cette période.L’offre de salade feuilles de chêne et de salade iceberg a respectivement triplé et doublé.La salade pommée est restée la principale variété consommée,même si la baisse de l’offre a été la plus marquée (26%).

Les quantités commercialisées de variétés de légumes et de fruits pouvant être cultivées en Suisse ont atteint 516’000 t et 183’000 t respectivement.Par rapport à la moyenne des quatre années précédentes,cela équivaut à une hausse de 1% pour les légumes et de 5% pour les fruits.La part des légumes suisses au volume du marché s’est élevée à environ 61% et celle des fruits à 73%.Elle est de 3% supérieure à la moyenne des années 2001/04 en ce qui concerne les légumes et égale à cette moyenne pour les fruits.
Au cours de l’exercice considéré,100,1 millions de litres de vin ont été encavés,soit 15,8 millions de litres de moins que l’année précédente.Le volume encavé comprend 47,9 millions de litres de vins blancs et à 52,2 millions de litres de vins rouges.Les rendements moyens ont été de 0,7 l/m2 pour les cépages blancs et de 0,6 l/m2 pour les cépages rouges.
La quantité de pommes à cidre récoltée et transformée dans les cidreries s’est élevée à 73'431 t et celle des poires à cidre à 22'165 t.De fait,comparée à l'estimation préalable de l'USP d’août 2005,la récolte a été inférieure de 9% pour les pommes et de 8% pour les poires.Comme elle attendait une faible récolte,l'interprofession a renoncé à percevoir des retenues en vue de la mise en valeur des excédents.Les stocks (réserves de marché et excédents) constitués de pommes à cidre récoltées en 2004 ont permis de couvrir entièrement les besoins du pays en produits à base de jus de pommes.
La tendance à la hausse que l'on enregistre depuis l'an 1998 pour les boissons non fermentées à base de jus de fruits s'est renforcée après la chute de l’année précédente.
1.1 ECONOMIE 1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE 39 1
■ Commerce extérieur: augmentation des exportations de vin
Les importations de légumes frais et de fruits frais pouvant être cultivés en Suisse se sont élevées à 200'000 t et à 51'000 t,respectivement,en baisse de 6% pour les légumes et en hausse de 5% pour les fruits par rapport à la moyenne des quatre dernières années.Le recul des importations a surtout concerné les carottes (–1'500 t) et les oignons (–4'200 t),tandis que les importations ont augmenté pour ce qui est des pruneaux,des poires et des fraises (env.1'000 t chacun).Les exportations ont atteint le même ordre de grandeur que les années précédentes,soit 200 t pour les légumes et 1'100 t pour les fruits,mais elles sont insignifiantes dans l’ensemble.
157,6 millions de litres de vin de bouche ont été importés,dont 134,8 millions de litres de rouge et 22,8 millions de litres de blanc.Il convient d’y ajouter 12,9 millions de litres de mousseux,8 millions de litres de vins destinés à la transformation et 1,5 million de litres de vins doux ou de spécialités.Par rapport à 2004,on observe toutefois une diminution de l’ordre de 1,2 million et une augmentation de 0,5 million de litres pour les importations de vins rouges et blancs respectivement.Les importations de mousseux ont légèrement augmenté.Il en va de même des exportations de vins suisses en bouteille,qui ont atteint 1,8 million de litres (+29%).
■ Consommation: consommation de vin encore en baisse
La consommation par habitant de légumes frais s’est chiffrée à 69 kg,celle de fruits de table (sans les fruits tropicaux) à 25 kg.Comparée à la moyenne de quatre ans 2001/2002,elle est restée stable pour les légumes et s’est accrue de 1 kg pour les fruits.
La consommation de vin rouge et de vin blanc (sans ceux destinés à l’industrie) s’est élevée à 264,9 millions de litres.Pour autant,la consommation globale a continué de régresser (–6,4 millions de litres).Par contre,la consommation de vins étrangers, rouges et blancs,a légèrement augmenté.Selon les indications concernant les stocks données par le commerce à la Commission fédérale du commerce de vins (sans les stocks des vignerons-encaveurs),la consommation de vins suisses a reculé de 10 millions de litres au total (rouges:–5,5 mio.;blancs:–4,5 mio.).La part de marché des vins suisses a donc diminué et n’atteint plus que 37,4%,soit 2,3% de moins que l’année précédente.Toutefois,si l’on tenait compte des stocks constitués par les vignerons-encaveurs,la consommation de vins suisses serait stable.Malgré ce résultat réjouissant,une certaine prudence est indiquée,car les données sont encore peu nombreuses.La consommation totale de vins,y compris ceux destinés à l’industrie, s’est montée à 273 millions de litres,dont environ 70% de vins rouges.

40 1.1 ECONOMIE 1
■ Prix:de nouveau chiffre d’affaires record pour les légumes,franco grande distribution
Ces dernières années,les ventes de légumes ont constamment augmenté;dans l’année sous revue,les recettes ont atteint 806 millions de francs comme l’année d’avant,soit une hausse de 9% par rapport à la moyenne des quatre années précédentes.Le prix moyen des légumes (emballé,franco grande distribution) s’est élevé à 2,55 fr./kg contre 2,52 fr./kg en 2004 et 2,48 fr./kg en moyenne pour les quatre dernières années.
Salades à feuilles: évolution des prix, des quantités et des recettes de 1996/98 à 2003/05
Salade pommée en %
Batavia
Chou de Chine Endives
Salades à feuilles, autres Lollo rouge Salade pain de sucre
Les prix des salades à feuilles sont à la hausse depuis 1996/98,mais l’évolution a été très différente selon la variété.La hausse a été inférieure à 20% pour la doucette et la chicorée rouge et supérieure à 50% pour la salade pommée,la batavia,le chou de Chine et les endives.En conséquence,les recettes tirées de la vente de toutes les variétés de légumes-feuilles ont augmenté;cela ne signifie toutefois pas dans tous les cas que les hausses des prix et des recettes évoluent parallèlement.La plus forte augmentation a été enregistrée pour la chicorée pain de sucre,la salade iceberg et la salade feuilles de chêne,ce qui s’explique surtout par l’énorme accroissement des quantités.S’agissant de la salade pommée,du chou de Chine,des endives et du lollo rouge,l’augmentation des recettes a été déterminée par des prix plus élevés,l’offre étant plus faible qu’il y a quelques années.On peut supposer que la hausse des prix n’a pas toujours engendré un bénéfice accru,car les prestations de services dans le secteur maraîcher ont augmenté et occasionnent ainsi davantage de coûts.
Salade iceberg Salade feuilles de chêne Doucette Chicorée rouge Source: CCM –50 –500 0 50 100 150 200 250 300 Evolution des prix Evolution des quantités Evolution des recettes 41 1.1 ECONOMIE 1 1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE
■ Marge brute sur les fruits de nouveau en recul
Evolution des prix et des marges brutes de divers légumes
Pour la première fois depuis 2002,la marge brute réalisée sur les légumes a quelque peu progressé en 2005,malgré un prix de revient stable.Le prix de revient moyen a représenté,en 2005,41% du prix de vente final.
La marge réalisée sur les composantes de la marge totale s’est accrue pour les tomates et le chou-fleur,tandis qu’elle a baissé pour les oignons,les carottes et la chicorée et qu’elle n’a pas changé pour les pommes de terre.
Evolution des prix et des marges brutes de divers fruits
La marge brute sur les fruits a fléchi de 24 ct.en 2005,et le prix de revient de 7 ct. Le prix de revient moyen a représenté,en 2005,43% du prix de vente final.
À l’exception des oranges,on a constaté une baisse de la marge sur tous les fruits observés (pommes,poires,abricots,cerises,nectarines,fraises).
199319941995199619971998199920002001200220032005 2004 fr./kg
0 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 Prix de vente
Source: OFAG Légumes choisis: tomates, choux-fleurs, carottes, chicorées, concombres, oignons et pommes de terre
Prix de revient Marge brute
199319941995199619971998199920002001200220032005 2004 fr./kg
0 5.00 4.50 3.50 4.00 3.00 2.00 1.50 2.50 1.00 0.50 Prix de vente
de
Marge
Source: OFAG
Prix
revient
brute
Fruits choisis: pommes, poires, abricots, cerises, nectarines, fraises et oranges
42 1.1 ECONOMIE 1
■ Deux systèmes d'indicateurs
Revenu et paramètres d’économie d’entreprise
Evolution du revenu des exploitations agricoles: moyenne de toutes les régions
Le rendement brut de la production agricole a progressé de 3% en 2005 par rapport à la moyenne des années 2002/04,mais il a baissé de 2% en comparaison avec l’année précédente.Si l’on considère la moyenne des exploitations,les paiements directs ont augmenté de 4% par rapport aux trois dernières années et d’environ 3% depuis 2004. Cette hausse est la conséquence d’une participation croissante aux programmes écologiques et éthologiques tels que SST (systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux),SRPA (sorties régulières en plein air),ainsi qu’aux programmes de promotion régionale de la qualité et de mise en réseau des surfaces de compensation écologique.
En 2005,les charges réelles ont augmenté de 5,4% par rapport à la période 2002/04 et de 1,2% en comparaison avec l’année 2004,une hausse qui a principalement concerné les frais de personnel,de bâtiments et de carburant,suite à l’envolée des prix des carburants.Les coûts inhérents à l’achat ou à la location d’un contingent laitier ont encore progressé.Les aliments pour animaux sont le seul domaine où les exploitations ont réalisé le plus d’économies puisque les agriculteurs ont acheté moins de fourrage grâce aux bonnes récoltes de fourrages grossiers enregistrées en 2004/05 et que les prix des aliments pour animaux ont baissé.
Le revenu agricole correspond à la différence entre le rendement brut et les charges réelles.Il rémunère,d’une part,le travail de 1,24 unité de main-d’œuvre familiale en moyenne et,d’autre part,les fonds propres investis dans l’exploitation,lesquels s’élèvent en moyenne à quelque 410'000 francs.En 2005,le revenu agricole était inférieur de 2,5% à la moyenne des années 2002/04 et de 10,2% par rapport à celui de l’année précédente.
1990/9220042005 20022003 fr. par exploitation Revenu extra-agricole Revenu agricole
Agroscope Reckenholz-Tänikon ART 0 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 16 264 62 822 1,39 UTAFUnités de travail annuel de la famille UTAF 21 557 60 472 1,25 22 172 54 274 1,24 18 577 51 500 1,28 21 210 55 029 1,24 50 1.1 ECONOMIE 1
Source:
Comparé à la période 2002/04,le revenu agricole a reculé de 6% en région de plaine et de 2% dans la région des collines au cours de l’exercice sous revue alors qu’il a augmenté de 5% en région de montagne.Quant au revenu extra-agricole,il est partout en hausse,progressant de 12% en région de plaine,de 11% dans la région des collines et de 2% dans la région de montagne.Ainsi,le revenu total a progressé de 4% dans la région de montagne et de 1% dans la région des collines,mais il a diminué de 2% en région de plaine.
En 2005,la part des paiements directs au rendement brut a atteint 17% dans les exploitations de plaine,25% dans les exploitations de la région des collines et 38% en montagne.Elle a donc légèrement augmenté dans les régions de plaine et des collines par rapport à la période 2002/04,mais elle a un peu régressé dans la région de montagne.
Revenu des exploitations agricoles,selon les régions Revenu,selon les régionsUnité1990/9220022003200420052002/04–2005 % Région de plaine Surface agricole utileha16,6620,6819,7920,0720,642,3 Main-d’œuvre familialeUTAF1,361,251,191,211,19–2,2 Revenu agricolefr.73 79463 40264 12972 61562 696–6,0 Revenu extra-agricolefr.16 42916 74320 64220 53221 53111,5 Revenu totalfr.90 22380 14584 77193 14684 227–2,1 Région des collines Surface agricole utileha15,3018,0918,4818,5218,923,0 Main-d’œuvre familialeUTAF1,401,241,261,231,23–1,1 Revenu agricolefr.59 83846 25751 44254 74249 627–2,3 Revenu extra-agricolefr.14 54419 36921 67122 16723 27710,5 Revenu totalfr.74 38265 62673 11476 90972 9041,4 Région de montagne Surface agricole utileha15,7618,5518,6018,6319,092,7 Main-d’œuvre familialeUTAF1,421,351,311,331,340,8 Revenu agricolefr.45 54137 51243 92146 10944 8075,4 Revenu extra-agricolefr.17 85320 74821 66222 64522 1512,1 Revenu totalfr.63 39458 26065 58368 75466 9584,3 Source:Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE 51 1.1 ECONOMIE 1
Tableaux 16–19,pages A16–A19
En termes de revenu,la situation laisse toutefois apparaître des écarts significatifs entre les 11 types d’exploitation (branches de production).
Revenu des exploitations agricoles,selon le type,2003/05
Si l’on considère la moyenne des années 2003/05,ce sont les exploitations pratiquant les cultures spéciales,les grandes cultures et la transformation,de même que certaines exploitations combinant des activités (transformation,lait commercialisé/grandes cultures) qui ont réalisé le revenu agricole le plus élevé.En commun avec les exploitations «combinaison vaches mères»,celles-ci ont également affiché le revenu total le plus élevé.A l’opposé,les exploitations ayant enregistré le revenu agricole et le revenu total le plus bas appartiennent aux types «autre bétail bovin» et «chevaux/moutons/ chèvres».Quant aux exploitations spécialisées «lait commercialisé»,elles figurent entre les deux.Dans toutes les catégories de revenu,leurs résultats sont inférieurs à la moyenne.
Type d’exploitationSurface Main-d’œuvre RevenuRevenuRevenu agricole utilefamilialeagricoleextra-agricoletotal haUTAFfr.fr.fr. Moyenne de toutes les exploitations19,371,2456 59221 64678 238 Grandes cultures22,220,9963 35728 36391 720 Cultures spéciales13,181,2567 52622 75390 279 Lait commercialisé19,451,3253 33618 41471 750 Vaches mères18,981,1145 75232 04877 800 Autre bétail bovin16,531,2536 81825 90662 724 Chevaux/moutons/chèvres12,441,1724 31439 06463 378 Transformation11,521,2361 95323 10485 057 Combinaison lait commercialisé/ grandes cultures26,021,2770 51014 67185 182 Combinaison vaches mères22,631,0752 68832 87785 565 Combinaison transformation19,621,2572 51817 01789 535 Combinaison autres21,181,2458 05521 81779 872 Source:Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
52 1.1 ECONOMIE 1
Tableaux 20a–20b,pages A20–A21
Le revenu du travail des exploitations agricoles (revenu agricole après déduction des intérêts sur les fonds propres investis dans l’exploitation) indemnise la main-d’œuvre familiale non salariée.Par rapport à la moyenne triennale 2002/04,le revenu du travail (médiane) par unité de main-d’œuvre familiale s’est amélioré de 4% en 2005,mais il a reculé de 8% en regard de 2004.Par conséquent,le revenu du travail a baissé moins fortement que le revenu agricole.Cette évolution s’explique par les taux d’intérêt qui ont baissé malgré l’augmentation des fonds propres (baisse des taux d’intérêt rémunérant les obligations de la Confédération).De surcroît,les exploitations ont employé un peu moins de main-d’œuvre familiale.
Autre constat,le revenu du travail varie fortement d’une région à l’autre.En moyenne, il est toutefois sensiblement plus élevé en région de plaine qu’en région de montagne. Les écarts entre les quartiles sont eux aussi importants.Ainsi,pour la période 2003/05, le revenu du travail par unité de main-d’œuvre familiale du premier quartile a atteint 26% dans la région de plaine et celui du quatrième quartile 197% de la moyenne de toutes les exploitations de la région.Les écarts sont similaires dans la région des collines (21% et 195%) et encore plus marqués dans la région de montagne (11% et 207%).
Revenu du travail des exploitations agricoles 2003/05: selon les régions et les quartiles

Revenu du travail 1 en fr.par UTAF 2
1Intérêts sur les fonds propres au taux moyen des obligations de la Confédération:2003:2,63%,2004:2,73%, 2005:2,11%
2Unités de travail annuel de la famille:base 280 journées de travail
Source:Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
MédianeValeurs moyennes Région1er quartile2e quartile3e quartile4e quartile (0–25%)(25–50%)(50–75%)(75–100%) Région de plaine44 141 12 069 35 501 52 959 90 745 Région des collines32 345 7 324 25 699 39 649 67 144 Région de montagne25 682 3 128 19 742 32 098 56 455
Tableaux 21–24,pages A22–A25
53 1.1 ECONOMIE 1
■ Revenu du travail en 2005
Dans les régions de plaine et des collines,le 4e quartile des exploitations agricoles a dépassé en moyenne de 22'000 francs et de 4’000 francs,respectivement,le salaire annuel brut correspondant du reste de la population au cours de la période 2003/05. Dans la région de montagne,le 4e quartile a à peine atteint le salaire comparatif durant cette période.En comparaison avec la période 2002/04,c’est surtout la région des collines qui a amélioré sa situation relative.
Salaire comparatif 2003/05,selon les régions
RégionSalaire comparatif 1 en fr.par année
Région de plaine68 266
Région des collines62 836
Région de montagne57 521
Sources:OFS,Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
Il convient de noter que le train de vie des ménages agricoles n’est pas uniquement assuré par le revenu du travail.Leur revenu total,y compris le revenu extra-agricole,est sensiblement plus élevé que le revenu du travail.
La part des capitaux tiers à l’ensemble du capital (ratio d’endettement) renseigne sur le financement externe d’une exploitation.Considéré parallèlement à la constitution des fonds propres,ce paramètre permet de juger si les dettes d’une exploitation sont supportables.Une exploitation présentant un ratio d’endettement élevé et une diminution des fonds propres n’est pas viable à long terme.
Compte tenu de ces critères,les exploitations sont réparties en quatre groupes,selon leur stabilité financière.
Répartition des exploitations en quatre groupes,compte tenu de leur stabilité financière
Exploitations avec … Ratio d’endettement faible (<50%)élevé (>50%)
Formation de fonds propres
positive...situation financière...autonomie financière sainerestreinte
négative...revenu insuffisant ...situation financière précaire
Source:De Rosa
1Médiane des salaires annuels bruts de toutes les personnes employées dans les secteurs secondaire et tertiaire
54 1.1 ECONOMIE 1
■ Stabilité financière
L’appréciation de la stabilité financière des exploitations montre une situation similaire dans les trois régions;44% des exploitations connaissent une situation financière saine,alors que celle-ci doit être qualifiée de plus problématique pour 32% d’entre elles (diminution des fonds propres).La moyenne triennale 2003/05 présente donc dans toutes les régions une légère amélioration par rapport à 2002/04.
Appréciation de la stabilité financière 2003/05 selon les régions

Région de plaineRégion des collinesRégion de montagne Part des exploitations en % Situation financière précaire Revenu insuffisant Autonomie financière restreinte Situation financière saine Source: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART 0 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 16 17 23 44 16 15 26 43 13 19 21 46 55 1.1 ECONOMIE 1
■ Constitution de fonds propres,investissements et ratio d’endettement
Les investissements des exploitations de référence ART ont régressé de 0,4% en 2005 par rapport à la période 2002/04.Dans le même temps,la marge brute d’auto-financement (cash-flow) a diminué elle aussi de 6%,d’où une baisse de 6% du rapport entre le cash-flow et les investissements.Quant à la constitution de fonds propres (revenu total moins déduction de la consommation privée),elle a chuté de 20% par rapport à la période de référence,tandis que le ratio d’endettement restait pratiquement inchangé.
Evolution des fonds propres,des investissements et du ratio d’endettement
1 Investissements bruts (sans les prestations propres),moins les subventions et les désinvestissements
2 Rapport entre cash-flow (fonds propres plus amortissements,plus/moins les variations des stocks et du cheptel) et investissements
Paramètre1990/9220022003200420052002/04–2005 % Formation de fonds propresfr.19 5136 84013 34315 5909 493–20,4 Investissements 1 fr.46 91443 69547 58051 26147 336–0,4 Rapport entre cash-flow et investissements 2 %9594959188–5,7 Ratio d’endettement %43414344430,8
Reckenholz-Tänikon
Source:Agroscope
ART
56 1.1 ECONOMIE 1
1.2 Aspects sociaux
Le rapport sur le social dans l’agriculture porte sur trois domaines:
–revenu total et consommation privée des ménages agricoles; –relevé de la situation concernant les principaux aspects sociaux; –études relatives à des questions sociales.
Le présent Rapport agricole présente le revenu et la consommation des ménages agricoles sur la base du dépouillement centralisé des données comptables d'Agroscope Reckenholz-Tänikon ART.Quant au relevé de la situation concernant les principaux aspects sociaux,cette édition porte sur les prestations des assurances sociales. L’étude de cette année aborde différentes questions liées aux «paysannes et paysans à l’âge de la retraite».

■■■■■■■■■■■■■■■■
1.2 ASPECTS SOCIAUX 1 57
■ Revenu total et consommation privée
1.2.1Revenu et consommation
Le revenu et la consommation sont des paramètres importants permettant d’appréhender la situation sociale des familles d’agriculteurs.En ce qui concerne la dimension économique de la durabilité,le revenu est surtout un indicateur de la performance des exploitations.Quant à la dimension sociale,c’est avant tout le revenu total des ménages agricoles qui compte,raison pour laquelle le revenu non agricole des familles paysannes est pris en compte dans l’analyse.Celle-ci porte sur l’évolution aussi bien du revenu total que de la consommation privée.
En moyenne des années 2003 à 2005,le revenu total,qui se compose des revenus agricole et extra-agricole,se situait entre 67'100 francs et 87'400 francs par ménage, selon la région.Dans la région de montagne,les ménages ont atteint environ 77% du revenu total de ceux de plaine.Permettant aux familles paysannes de réaliser en moyenne 20'900 à 22'400 francs,l’activité extra-agricole est une source de revenu supplémentaire non négligeable.Sa part représente 24% du revenu total des ménages en plaine,30% dans la région des collines et 33% en montagne.En chiffres absolus, le revenu extra-agricole a été le plus élevé dans la région des collines,atteignant 22'400 francs.
Revenu total et consommation privée des exploitations par région 2003/05
en fr.
Région de plaineRégion des collinesRégion de montagne
Consommation privée
Revenu extra-agricole
Revenu agricole
Source: Dépouillement centralisé d'Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
La formation de capital propre,part non consommée du revenu total,représente en moyenne quelque 16% du revenu total toutes régions confondues.La consommation privée est supérieure au revenu agricole.Comme le revenu total,elle est,en chiffres absolus,la plus élevée dans la région de plaine et la plus basse dans celle de montagne.
En 2005,le revenu total moyen par exploitation,d'environ 76'500 francs,a légèrement dépassé la moyenne des années 2002/04,où il se situait à 76'100 francs.La consommation privée par ménage a,elle aussi,progressé d'environ 2’800 francs par rapport à la période précitée,pour s'établir à près de 67'000 francs.
■■■■■■■■■■■■■■■■
0 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 1.2 ASPECTS SOCIAUX 1 58
Revenu total et consommation privée par unité de consommation, en fonction des quartiles 1 2003/05
1er quartile2ème quartile3ème quartile4ème quartileEnsemble des exploitations Revenu
Source:Dépouillement centralisé d’Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
Les ménages du premier quartile ont atteint 43% du revenu total par unité de consommation de ceux du quatrième quartile.La différence entre les deux quartiles est nettement plus faible en ce qui concerne la consommation privée:dans le premier quartile, elle a représenté 68% de celle des ménages du quatrième quartile.
Dans la période 2003/05,le revenu total par unité de consommation n’a pas suffi à couvrir la consommation des familles dont l’exploitation fait partie du premier quartile. La formation de capital propre a donc présenté un bilan négatif.Si elles continuent de ronger le capital pendant longtemps,elles devront tôt ou tard cesser leur activité.En revanche,les dépenses privées ont été inférieures au revenu total pour ce qui est des autres quartiles:elles ont représenté environ 91% du revenu total dans le deuxième quartile,82% dans le troisième et 69% dans le quatrième.
En 2005,le revenu total par unité de consommation a été supérieur aux trois années précédentes,2002 à 2004,et cela dans tous les quartiles.La consommation privée a elle aussi progressé dans tous les quartiles par rapport à la moyenne des années 2002/04.

total par UC 2 (fr.)14 48218 49323 16134 00322 441 Consommation
par UC (fr.)16 02716 80418 91423 53418 778
privée
1 Quartiles selon le revenu du travail par unité de travail annuel de la famille
2 Unité de consommation = membre de la famille,âgé de 16 ans ou plus,participant toute l’année à la consommation de la famille
1.2 ASPECTS SOCIAUX 1 59
1.2.2Prestations des assurances sociales
La relation entre l’activité professionnelle agricole et le droit à des prestations sociales est un des principaux aspects sociaux faisant l’objet de rapports périodiques (première fois dans le Rapport agricole 2000).Les assurances sociales et personnelles publiques d’une part,de même que les assurances des biens et les institutions privées,d’autre part,constituent le filet de sécurité formel tant pour les paysans que pour la population non agricole.Une comparaison des prestations d’assurances versées à ces deux groupes de la population montre leur importance capitale,mais aussi de grandes différences concernant le recours au droit à ces prestations.
Les assurances sociales publiques
La rente AVS instituée en 1948 dépend du revenu soumis à cotisation durant la vie active ainsi que,le cas échéant,des bonifications pour tâches éducatives et d'assistance.
La statistique des revenus AVS de 2001 fait ressortir que 4'716’709 cotisants comprennent 28’182 agriculteurs indépendants,dont 1’898 femmes,n'exerçant aucune autre activité soumise à cotisation.31’935 agriculteurs indépendants,dont 1’482 femmes,exerçaient en outre une activité salariée.
Activité et revenu soumis à cotisation AVS,2001,en fr.
Les agriculteurs et agricultrices exerçant une activité salariée perçoivent en moyenne une rente de vieillesse à peine inférieure à la moyenne suisse,alors que celle des indépendants à part entière est clairement inférieure à cette moyenne.
Le droit à la rente de la paysanne (pré-splitting) est généralement très faible.Si la paysanne ne dispose pas d’un revenu extérieur à l’exploitation,son revenu ne relève pas de l’AVS;l’ensemble du revenu comptant pour l’AVS revient au mari.L'introduction des bonifications pour tâches éducatives et d'assistance a néanmoins amélioré la situation.Il est maintenant possible de verser un revenu à l’épouse qui collabore à l’exploitation ou,lorsque des conditions déterminées sont remplies,de la déclarer comme personne exerçant une activité indépendante;cependant,les chiffres exacts ne sont pas connus à ce sujet.
■■■■■■■■■■■■■■■■
Agricultrices et agriculteurs indépendants40 592 Autres indépendants67 638 Agricultrices et agriculteurs
accessoire57 360 Salariés58 852 Source:OFAS
exerçant une activité
1.2 ASPECTS SOCIAUX 1 60
■ Assurance-vieillesse et survivants AVS
■ Assurance-invalidité AI
L’échelle dégressive des cotisations joue un rôle tout particulier en raison des faibles revenus AVS réalisés dans l’agriculture.Le revenu AVS moyen des paysans indépendants s'est élevé en 2001 à quelque 40’600 francs.Selon un calcul simplifié,il en résulte un taux de contribution AVS/AI/APG de 7,917%;ce taux s'élèverait à 9,5% sans l'échelle dégressive.Cela correspond,en moyenne,à une réduction annuelle de la prime de 641 francs par exploitation.
L’AI a pour objectif principal la réinsertion,c’est-à-dire le rétablissement de la capacité de gain.
En 2001,sur les 28'182 agriculteurs travaillant exclusivement dans l’agriculture,1'852 personnes,soit 6,6%,ont bénéficié d’une rente AI.Dans cette même année,la probabilité de toucher une rente AI se situait à 4,6% à l’échelle nationale.La part élevée de bénéficiaires dans le secteur agricole reflète notamment la dureté du travail et les risques qu’il implique.
■ Prestations complémentaires
Des prestations complémentaires sont versées aux bénéficiaires de rentes AVS ou AI lorsque ces rentes ne suffisent pas à couvrir les besoins vitaux.Le niveau de la fortune nette et les modalités de la cession du patrimoine (droit d'habitation,renonciation, etc.) sont décisifs dans le calcul des prestations complémentaires destinées aux personnes qui ont été ou sont encore propriétaires d’une exploitation agricole.Les chiffres particuliers concernant le versement de prestations complémentaires dans l'agriculture ne sont pas disponibles,mais selon diverses études,les paysannes et paysans sont, de manière générale,sous-représentés dans les services sociaux (p.ex.Wicki et Pfister 2000).
■ Allocations familiales
La finalité des allocations familiales allouées dans l’agriculture relève de la politique familiale:il convient de soutenir les familles paysannes au revenu modeste ayant des enfants.Le versement d’allocations familiales aux employés agricoles ainsi qu’aux paysans de montagne et aux petits paysans est régi par le droit fédéral.La limite de revenu est fixée à 30'000 francs plus 5'000 francs par enfant ayant droit à l’allocation. Par contre,ce sont les dispositions cantonales qui réglementent l’octroi d’allocations familiales aux salariés en dehors de l’agriculture.Conformément à la loi fédérale,les allocations familiales sont octroyées sous la forme d’allocations pour enfants et d’allocations de ménage.
1.2 ASPECTS SOCIAUX 1 1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE 61
Allocations de ménage et allocations pour enfants (état le 1er janv.2006)
Allocation de ménage par travailleur agricole et par mois100 fr.
Allocation pour enfant Région de 175 fr.pour les deux premiers enfants par enfant et par moisplaine180 fr.à partir du troisième enfant Région de 195 fr.pour les deux premiers enfants montagne200 fr.à partir du troisième enfant
Répartition des allocations familiales:exercice 2005
Rendementmio.de fr.Dépensesmio.de fr. Cotisations des employeurs12,6Prestations en espèces121,7
Contributions des pouvoirs publics112,2Frais d'administration3,1 dont les 2⁄3 de la Confédération74,8 + contribution d’allégement1,4 – coût total pour la Confédération76,2 – dont 1⁄3 des cantons36,0
Recettes totales124,8Total dépenses124,8
Source:OFAS
Les adaptations en faveur des exploitations familiales de type paysan prévues dans le cadre de la PA 2011 comprennent la suppression de la limite de revenu pour les agriculteurs indépendants et l’augmentation du taux des allocations pour enfant:il est proposé de majorer les taux de 15 francs par mois,ce qui les porterait à 190 francs par enfant et par mois en plaine et à 210 francs en montagne.Par contre,il est prévu de renoncer à l’augmentation de 5 francs pour l’allocation versée à partir du troisième enfant.
Les Chambres fédérales ont adopté le 24 mars 2006 une nouvelle loi sur les allocations familiales,qui prévoit le droit de tous les salariés à des allocations pour enfant de 200 francs au moins par enfant et par mois et à des allocations pour formation professionnelle de 250 francs au moins.Si la nouvelle loi entre en vigueur,les personnes occupées dans l’agriculture recevront les allocations pour enfants et formation professionnelle selon ces nouveaux taux,majorés comme maintenant de 20 francs dans la région de montagne.Le référendum contre cette loi a abouti en été;la votation est fixée à fin novembre.
1.2 ASPECTS SOCIAUX 1 62
■ Prestations d'assistance sociale

L’imbrication de l’exploitation et du ménage permet une grande flexibilité aux plans du travail et des finances.C’est pourquoi,notamment,les paysans sont sous-représentés auprès des services sociaux:ils se serrent la ceinture dans les périodes de vaches maigres et «mangent le capital».En outre,la crainte d’être stigmatisé comme bénéficiaire d’assistance sociale demeure grande.
Les premiers résultats de la statistique nationale des assurances sociales sont certes disponibles,mais une évaluation représentative selon la catégorie professionnelle n’est pas encore possible.
■ Autres assurances
L’allocation pour perte de gain a pour objectif de compenser l’absence de revenu pendant le service militaire ou civil des assurés:il s’agit d’éviter que des exploitations paysannes subissent des difficultés financières en raison de l’obligation de servir incombant à leurs collaborateurs.C’est pourquoi des allocations d'exploitation sont versées aux membres de la famille travaillant dans l’exploitation.Cette réglementation spéciale privilégie l’agriculture par rapport à d’autres branches où l’on trouve des entreprises familiales.Suite à la révision de la loi sur les allocations pour perte de gain, l’assurance maternité est entrée en vigueur le 1er juillet 2005.Les ayants droit, c’est-à-dire les mères exerçant une activité professionnelle avant la naissance de l’enfant,bénéficient d’une allocation pour perte de gain pendant 14 semaines.Cette indemnité de base équivaut à 80% du revenu réalisé avant la perte de gain.Les chiffres concernant le recours à ce droit des femmes dans l’agriculture ne sont pas encore disponibles.
La loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité vise à garantir aux personnes assujetties à l’AVS une compensation convenable du manque à gagner causé par le chômage,la réduction de l'horaire de travail,les intempéries ou l'insolvabilité de l'employeur.Comme,de manière générale, les indépendants ne sont pas assurés,les agriculteurs indépendants n’ont,eux non plus,pas droit à l’assurance-chômage.En sont également exclus les membres de la famille qui travaillent dans l’exploitation et qui sont mis sur le même plan que les agriculteurs indépendants.Cette assurance n’entre donc en ligne de compte que pour une activité accessoire.De même,les exploitations paysannes,à la différence des autres entreprises artisanales tributaires des conditions météorologiques,ne sont pas indemnisées en cas d'intempéries.
L’assurance militaire vise à protéger les personnes accomplissant un service militaire ou civil,ou un service de protection civile,contre les conséquences pécuniaires de toutes les affections physiques ou psychiques survenant durant le service.L’assurance militaire comprend des indemnités spéciales pour les indépendants,agriculteurs compris.
1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE 1.2 ASPECTS SOCIAUX 1 63
■ Assurances maladie et accidents

Assurances personnelles
L'assurance maladie porte obligatoirement sur l'assistance médicale nécessaire en cas de maladie,d'accident,en l’absence d’assurance accidents,et de maternité;à titre facultatif,elle comprend l'assurance d'indemnités journalières.La plupart des agriculteurs bénéficient de l’assurance de base et d’une assurance supplémentaire pour des soins ambulatoires,ainsi que pour les soins hospitaliers en division commune.
D'après les cas traités par une caisse maladie dont les assurés proviennent pour la plupart du monde agricole (assurances supplémentaires et indemnités journalières étant réservées aux familles paysannes),l'utilisation de l'assurance maladie par la population paysanne est inférieure à la moyenne,ce qui se répercute sur les primes.En outre,les agriculteurs ont tendance à être domiciliés dans des régions où les primes sont meilleur marché.Dans de nombreux cantons,la limite de fortune prévue dans le système de réduction des primes défavorise les indépendants.Or,ce sont précisément les paysans au revenu modeste qui doivent investir leur fortune dans leur exploitation, où elle apparaît dès lors comme fortune imposable.C'est pourquoi de nombreux agriculteurs n'ont pas droit à une réduction de prime en dépit d’un revenu modeste.
L’assurance accidents protège toute personne salariée en Suisse contre les conséquences économiques des accidents professionnels et non professionnels ainsi que des maladies professionnelles.Les dispositions de la loi sur l'assurance accidents ne s’appliquent pas obligatoirement aux agriculteurs indépendants ni aux membres de leur famille travaillant dans l’exploitation.
1.2 ASPECTS SOCIAUX 1 64
Les personnes actives dans l’agriculture sans revenu accessoire,qui ne sont pas assurées obligatoirement par un employeur,sont assurées contre l’accident auprès de leur caisse maladie.Si le risque d'accident est plus élevé dans l'agriculture que dans les autres secteurs de l'économie,les accidents non professionnels sont moins fréquents et les frais dans cette catégorie par conséquent plus bas.Dans une caisse maladie agricole,la part des frais d’accident à l’ensemble des prestations est inférieure à 10%.
La prévoyance professionnelle (pilier 2a) s’ajoutant à l’AVS garantit aux anciens salariés âgés un revenu de remplacement leur permettant de maintenir le niveau de vie antérieur.Les indépendants et les membres de la famille qui travaillent dans leur entreprise ne sont pas assujettis à la prévoyance professionnelle obligatoire.La prévoyance professionnelle plus poussée (pilier 2b) offre aux paysans la possibilité d’adhérer à la Fondation de prévoyance de l'agriculture suisse:en 2004 quelque 19'000 personnes ont conclu à ce titre des assurances de risques ou d’épargne.
En 2001,53 sur 100 personnes travaillant dans l’agriculture ont exercé une activité accessoire,le plus souvent en tant que salariés.Pour les hommes exerçant plusieurs activités,le revenu annuel moyen s’est élevé à 58'342 francs,pour les femmes à 36'312 francs.S’il est possible de ventiler les chiffres concernant le revenu soumis à l’AVS selon l’activité indépendante ou salariée,une moyenne purement arithmétique ne permet pas de déduire le nombre d’agriculteurs exerçant une activité salariée qui sont effectivement soumis à l’obligation légale:la limite de revenu provenant d’une activité salariée selon la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle était fixée en 2001 à 24'720 francs.La part des personnes travaillant dans l’agriculture qui,au titre de la prévoyance professionnelle,ne bénéficient que peu ou pas d’une assurance dans la vieillesse ou en cas d’invalidité ou de décès est vraisemblablement très élevée,bien que l’exercice d’une activité salariée soit assez fréquent.
La prévoyance privée comprend la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) et la prévoyance libre (pilier 3b:assurances de risques,d’épargne ou mixtes).Le pilier 3a, que la Confédération soutient par des mesures relevant de la politique fiscale et de la promotion du logement,présente divers avantages fiscaux.Le pilier 3b comprend toutes les économies,obligations,logements en propriété,etc.Le capital épargne est en tout temps librement disponible.A la différence de la prévoyance liée,celle qui est libre n’offre en principe aucun privilège fiscal.Toutefois,les assurances vie permettant une accumulation du capital présentent également des avantages fiscaux à certaines conditions.
1.2 ASPECTS SOCIAUX 1 1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE 65
■ Prévoyances professionnelle et privée
■ Assurance-grêle
Assurances mobilières et institutions privées
La Société suisse d’assurance contre la grêle de Zurich est la seule compagnie qui assure les cultures contre cet élément naturel.Hormis la grêle,elle couvre toute une série de dommages causés par les éléments naturels.
Dans les principales zones de culture de Suisse,quelque 90% des agriculteurs sont assurés contre la grêle.Les primes de l’assurance sont fonction de la vulnérabilité à la grêle des cultures assurées,du danger local de grêle et des prétentions particulières de l’assuré (système du bonus/malus).
Assurance-grêle 2005
CulturesSurfaceValeur de Frais d’assurance 2 assurée 1 l’assurancepar ha risque risque modérémoyen
%fr./hafr./hafr./ha
Céréales854 5004186
Pommes de terre7015 000135285
Maïs603 40061109
Betteraves sucrières658 00080168
Vin (ct.VS non compris)7040 0001 3602 080
Fruits4521 0001 4702 352
Herbages (prairies et pâturages) 3 35Assurance 2860 forfaitaire
1part estimée dans l’ensemble des surfaces cultivées 2valeurs moyennes 3prairies et pâturages dans la région préalpine
■ Autres assurances
Source:Société suisse d'assurance contre la grêle
L’assurance-responsabilité civile couvre les dommages matériels et corporels causés à des tiers.En règle générale,les agriculteurs optent pour une assurance responsabilité civile combinée d'exploitation et privée.Une assurance responsabilité civile est obligatoire pour tous les véhicules à moteur circulant sur la voie publique.Cela s'applique aux véhicules agricoles comme les tracteurs,les moissonneuses-batteuses, etc.
Les bâtiments et le cheptel vif et mort sont exposés à de multiples dangers,avant tout aux dommages causés par les incendies ou les éléments naturels.L'assurance incendie couvre notamment les dommages causés par l'incendie,la fumée et les explosions.Les dommages consécutifs (eau,suie,etc.) sont également couverts.Dans la majorité des cantons, l'assurance immobilière est obligatoire.Par contre,l'obligation d’assurance est rare pour le mobilier.Dans l’agriculture,les risques sont en particulier accrus en ce qui concerne les bâtiments,ce qui conduit à des primes légèrement plus élevées que pour les autres bâtiments.
1.2 ASPECTS SOCIAUX 1 66
■ Institutions privées
L’assurance du bétail est pour l’essentiel organisée sur les plans privé et communal. De nombreux agriculteurs ont conclu une assurance contre les maladies et les accidents pour leurs vaches et même une assurance-vie pour leurs chevaux.Les agriculteurs sont indemnisés des pertes d’animaux en cas d’épizootie en vertu des dispositions de la législation fédérale.En règle générale,les indemnités sont calculées sur la base d’une estimation officielle des animaux ou des cheptels.
Diverses institutions et organisations soutiennent les familles paysannes à titre privé. A cet égard,les prestations peuvent être fournies en espèces,en travail et en nature. Les œuvres d'entraide se spécialisent généralement dans un type de prestation.Seuls quelques acteurs principaux sont mentionnés dans les considérations qui suivent.Il existe de nombreux autres fonds et fondations exerçant des activités dans ce domaine. Aides financière d’institutions privées
pour les améliorations d’exploitations dans l’agriculture de montagne875761917641648500 Fondation pour l’entraide et pour l’aide sociale dans l’agriculture,en particulier dans la région de
■ Service volontaire à la ferme
L’objectif principal du service à la ferme consiste à favoriser la compréhension entre la ville et la campagne.Les jeunes apprennent à connaître la vie et le travail des paysans et reçoivent,outre table et logis,de l’argent de poche pour leur collaboration.Ils déchargent les familles paysannes,qui de leur côté se font une idée de leur conception de la vie.
Chiffres concernant le service à la ferme
200020012002200320042005 en 1 000 fr. Aide suisse aux montagnards, projets individuels et projets collectifs274512402522127167441757120992 Parrainage COOP2 6052 3582 3631 7962 1072 369 Parrainage suisse pour communes de montagne,projets communautaires dans l’agriculture1 8733 3982 8452 0781 4861 157 Fédération suisse
montagne324279231747980
200020012002200320042005 Journées de travail690076934652798563705643753816 Participants3 3023 1952 8142 9602 8782 857 Durée,en jours (Ø)212219192019
1.2 ASPECTS SOCIAUX 1 1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE 67
■
1.2.3Les paysannes et paysans à l’âge de la retraite
Le présent rapport sur les aspects sociaux vise entre autres à présenter la situation sanitaire,sociale et financière des paysannes et paysans à l’âge de la retraite.Il se base sur une évaluation spéciale des données de l’Enquête suisse sur la santé.Par ailleurs, il expose les résultats d’interviews menées avec des experts et fait le portrait de 13 paysannes et paysans qui sont à la retraite ou le seront prochainement.Nous commençons par les données tirées de l’enquête sur la santé.
Evaluation de l’Enquête sur la santé
Les données de l’Enquête suisse sur la santé (ESS) ont servi à l’évaluation statistique. Tous les cinq ans depuis 1992,l’OFS réalise un recensement qui prend notamment en compte des données relatives à l’état de santé,aux habitudes de vie et aux comportements ayant une incidence au plan de la santé.Lors du dernier recensement,en 2002, environ 19'700 personnes sélectionnées de façon aléatoire dans l’annuaire téléphonique ont été questionnées par téléphone et par écrit.La population de l’ESS est constituée par les résidents permanents en Suisse,âgés de 15 ans au moins et vivant dans un ménage privé.
Le recensement 2002 englobait au total 165 agriculteurs et 135 paysannes répartis de la manière suivante:62 agriculteurs et 42 paysannes âgés de 55 à 64 ans,60 agriculteurs et 42 paysannes dans la tranche d’âge de 65 à 74 ans ainsi que 43 agriculteurs et 51 paysannes de 75 ans ou plus.La prise en compte de paysannes et d’agriculteurs dès leur 55ème année permet de montrer si et comment le passage de la vie active à la retraite influe sur la santé.Pour pouvoir comparer le groupe agricole avec d’autres groupes de la population,on a attribué à chaque agriculteur et à chaque paysanne deux personnes du même âge et du même sexe habitant dans la même région,choisies au hasard dans l’échantillon non agricole.Il en est résulté un groupe de référence comprenant 330 hommes et 270 femmes.Les résultats de l’analyse des deux groupes sont présentés ci-après.
Le rapport a dû se limiter à certains aspects de la santé physique,psychique et psychosociale qui semblaient jouer un rôle dans ce domaine.
■ Santé physique
L’appréciation personnelle de son état de santé par une personne permet de conclure à sa santé physique.Plusieurs études ont en effet montré que les personnes d’âge moyen ou avancé qui jugent leur état de santé mauvais présentent un risque accru de décès et ont plus de difficultés à s’accommoder des infirmités de l’âge que celles qui le considèrent comme étant bon.
La question a été posée comme suit:«Comment allez-vous en ce moment?».
■■■■■■■■■■■■■■■■
1.2 ASPECTS SOCIAUX 1 68
Auto-évaluation de l'état de santé
de 55 à 64 ans
Agriculteurs
Gr hommes
Paysannes
Gr femmes
de 65 à 74 ans
Agriculteurs
Gr hommes
Paysannes
Gr femmes
après 75 ans
Agriculteurs

Gr hommes
Paysannes
Gr femmes
Entre 55 à 64 ans,les agriculteurs s’estiment en nettement plus mauvaise santé que les hommes du groupe de référence,alors que les estimations respectives se rejoignent après le passage à la retraite.S’agissant des femmes,les paysannes de 55 à 64 ans s’estiment en meilleure santé que celles du groupe de référence,tandis que la tendance s’inverse après 75 ans.
Les troubles de la santé et les douleurs ont plusieurs causes:de grandes contraintes physiques subies durant de longues années,par exemple,peuvent engendrer des douleurs articulaires et rhumatismales.
Source: OFS
Gr = groupe de référence
très mauvais mauvais moyen
en % 02040 10 30 1.2 ASPECTS SOCIAUX 1 69
■
Santé psychique
Douleurs articulaires et rhumatismales (pendant les 4 semaines précédant l'étude) en %
de 55 à 64 ans
Agriculteurs
Gr hommes
Paysannes
Gr femmes
de 65 à 74 ans
Agriculteurs
Gr hommes
Paysannes
Gr femmes
après 75 ans
Agriculteurs
Gr hommes
Paysannes
Gr femmes
Gr = groupe de référence
20 10 60 50
0403070
fortes faibles
Selon l’étude,les agriculteurs âgés de 55 à 74 ans souffrent nettement plus souvent de ce type de maux que les hommes du groupe de référence:il s’agit en effet principalement de phénomènes d’usure dus à l’intense activité physique.En ce qui concerne les paysannes de 55 à 74 ans,elles en souffrent elles aussi plus souvent que les représentantes du groupe de référence,mais dans une moindre mesure que les hommes.À un âge avancé,les hommes des deux groupes sont concernés de manière à peu près égale par les douleurs articulaires ou rhumatismales,alors que les paysannes se portent mieux à cet égard que les autres femmes.
Par santé psychique,on entend le bien-être personnel,l’équilibre,la confiance en soi, la satisfaction,la sociabilité,la capacité de gérer le quotidien et de mener à bien une tâche,de même que la faculté de participer à la vie sociale.À l’inverse,la maladie psychique est définie comme l’apparition cliniquement perceptible de troubles psychiques ou comportementaux.
L’équilibre psychique,choisi comme critère pour ce rapport,est une composante importante de la santé psychique et une condition essentielle à l’accomplissement approprié des tâches quotidiennes.La tension psychique cause au contraire un déséquilibre stressant qui risque de menacer la santé.On mesure l’équilibre psychique à l’aide de questions sur la fréquence d’abattements,l’équilibre personnel,la nervosité et le sentiment d’être optimiste et plein d’énergie.
Source: OFS
1.2 ASPECTS SOCIAUX 1 70
Equilibre psychique (durant la semaine précédant l'étude) en %
03060 20 10 50 40
de 55 à 64 ans
Agriculteurs Gr hommes Paysannes Gr femmes
de 65 à 74 ans
Agriculteurs Gr hommes
Paysannes Gr femmes
après 75 ans
Agriculteurs Gr hommes
Paysannes Gr femmes
Gr = groupe de référence
■ Santé psychosociale
Source: OFS
Dans le groupe des agriculteurs de 55 à 64 ans,le pourcentage de troubles psychiques est plus élevé (19%) que dans le groupe de référence (12%).S’agissant des autres groupes d’âge,cette part se monte à 10% aussi bien pour les agriculteurs que le groupe de référence.La part des paysannes souffrant de troubles psychiques est plus élevée que celle des femmes du groupe de référence,et cela dans tous les groupes d’âge;la valeur atteint même 25% dans le groupe de 65 à 74 ans.
Les relations sociales et le soutien que peut accorder le réseau social sont une condition essentielle au bien-être psychique.Ils forment une ressource importante dans la gestion des problèmes (de santé) et influent ainsi même sur l’espérance de vie.On constate par exemple que l’absence de relations sociales fiables augmente la vulnérabilité aux troubles de la santé.Cet aspect se mesure à la fréquence de sentiments de solitude et,pour les personnes ayant des enfants,à la fréquence des contacts avec ceux-ci.
faible moyen
1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE 1.2 ASPECTS SOCIAUX 1 71
Sentiment de solitude en % 0302050
de 55 à 64 ans
Agriculteurs
Gr hommes
Paysannes
Gr femmes
de 65 à 74 ans
Agriculteurs
Gr hommes
Paysannes
Gr femmes
après 75 ans
Agriculteurs
Gr hommes
Paysannes
Gr femmes
Gr = groupe de référence
très souvent assez souvent parfois
Source: OFS
Contrairement au groupe de référence,les agriculteurs interrogés souffrent plus souvent de solitude en prenant de l’âge.La solitude en général est un sujet encore plus fréquent chez les femmes que chez les hommes;selon la catégorie d’âge,dans 29 à 43% des cas,les paysannes se sentent «parfois,voire fréquemment seules»,alors que les valeurs correspondantes du groupe de référence sont légèrement inférieures (25 à 35%).Le sentiment de solitude,particulièrement fréquent chez les paysannes de 65 à 74 ans,s’explique sans doute,entre autres,par la diminution de la mobilité.

10
40
1.2 ASPECTS SOCIAUX 1 72
Contact avec leurs enfants
de 55 à 64 ans
Agriculteurs
Gr hommes
Paysannes
Gr femmes
de 65 à 74 ans
Agriculteurs
Gr hommes
Paysannes
Gr femmes
après 75 ans
Agriculteurs
Gr hommes
Paysannes
Gr femmes
De manière générale,les agriculteurs et les paysannes ont des contacts plus fréquents avec leurs enfants,le cas échéant,que les hommes et les femmes des groupes de référence.Les exploitations agricoles,où il n’est pas rare que deux générations ou plus se côtoient,favorisent probablement les contacts.La contradiction apparente,à savoir le sentiment de solitude plus fréquent des paysannes et des agriculteurs,malgré le nombre plus élevé de visites de leurs enfants,résulte probablement de l’inclusion de personnes sans enfants dans la première analyse.
De manière générale,les agriculteurs et les paysannes âgés questionnés apprécient leur état de santé physique moins favorablement que les groupes de référence.Les longues années de dur labeur n’ont pas que des incidences sur cette auto-évaluation; elles provoquent aussi plus fréquemment des phénomènes d’usure douloureux.Quant à la santé psychique,on constate un faible équilibre,de même qu’un sentiment fréquent de solitude chez les paysannes d’un certain âge.En prenant de l’âge,les agriculteurs interrogés souffrent plus souvent de solitude,éventuellement à cause de la diminution de leur mobilité.En raison des conditions de vie particulières dans les exploitations agricoles,les agriculteurs et les paysannes d’un certain âge mentionnent des contacts beaucoup plus fréquents avec leurs enfants que les personnes des groupes de référence.De manière générale,force est de constater que l’état de santé de la population paysanne est plutôt plus mauvais que celui des autres groupes de la population.
1 fois par jour min. 1 fois par semaine min.
en % 06040100 20 80 Source: OFS Gr =
de
groupe
référence
1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE 1.2 ASPECTS SOCIAUX 1 73
■ Conclusions de l’Enquête suisse sur la santé
Interviews d’experts
Les interviews réalisées avec des experts sur le thème «Les paysannes et les agriculteurs à l’âge de la retraite» ont montré que l’AVS est de loin l’assurance de base la plus importante pour la population agricole âgée.Comme les cotisations contribuent directement à la formation des rentes,il importe d’optimiser le revenu durant la vie active,non seulement dans l’optique d’éventuelles économies d’impôts,mais également en vue des futures rentes AVS.Selon les estimations des experts consultés,les prestations complémentaires et les allocations pour impotents ne sont que rarement sollicitées,la fortune étant prise en compte dans le calcul des limites.La plus grande réticence de la population agricole à solliciter des aides,en comparaison des autres groupes de la population,a été confirmée.
Le logement en propriété et le droit d’habitation sont également un élément de prévoyance important.Le droit d’habitation revêt encore une grande importance économique,car il permet aux titulaires de disposer d’un logement extrêmement bon marché sinon gratuit et de demeurer dans leur environnement habituel,ce qui est précieux sur le plan social.Il importe donc de veiller à ce que dans le contrat, le droit d’habitation soit clairement réglé.
De manière générale,il est recommandé de planifier la prévoyance professionnelle à temps,dans l’ordre de priorités suivant:1.investissements dans une exploitation porteuse d’avenir,2.investissements dans le logement,3.assurance décès/invalidité,4.épargne.
Au printemps 2006,13 interviews ont été menées dans l’ensemble du pays avec des paysannes et paysans retraités ou peu avant la retraite,en collaboration avec Agroscope ART.Plusieurs interlocutrices et interlocuteurs possibles par région ont été choisis,soit par hasard en référence au recensement des exploitations de l’OFS,soit sur la base des indications fournies par les services de vulgarisation agricole.Toutes ces personnes ont reçu une lettre d’information,car on ne savait pas qui serait prêt à donner des renseignements sur sa situation personnelle.Cette question leur a été posée lors d’entretiens téléphoniques et,le cas échéant,un rendez-vous a été fixé pour une interview.Les portraits résultant de ces entretiens sont une source d’informations précieuse sur la vie et la situation actuelle de la population paysanne âgée en Suisse.
1.2 ASPECTS SOCIAUX 1 74
■ Portraits
■ L’exploitation d’abord
Armand J.a repris l’exploitation familiale de 11 hectares de son père à 46 ans.Trop tard,et en plus trop cher,estime-t-il.Armand et Martha étaient déjà mariés et avaient quatre enfants:une fille et trois garçons.Ne voulant pas répéter la même erreur pour la génération suivante,Armand a remis l’exploitation (45 hectares à cette époque),à l’âge de 61 ans,à son plus jeune fils à la moitié de la valeur de rendement,pour lui assurer un bon départ.
Armand et Martha n’ont pas vraiment pu faire des économies,car les recettes de l’exploitation étaient systématiquement investies dans de nouvelles terres.Aujourd’hui, le couple retraité vit de son AVS.Il a gardé deux champs,environ deux hectares en tout, qui reviendront plus tard aux autres enfants,en reconnaissance du travail accompli dans l’exploitation durant leur jeunesse.Armand et Martha jouissent d’un droit d’habitation dans l’ancienne demeure de l’exploitation,où ils vivent avec un des petits-fils, qu’ils ont accueilli et qui étudie au gymnase tout proche.Le successeur et sa famille vivent à 50 m de là,dans une maison que le père d’Armand avait acquise autrefois.
Armand travaille encore tous les jours dans la ferme,mais il ne fait aujourd’hui que ce qui lui plaît:entraîner les chevaux à l’attelage ou acheter des poulains pour son fils sur le marché des chevaux.Les chevaux sont sa grande passion:dans ce domaine,il est incontestablement un spécialiste.Il n’est pas mécontent d’être affranchi du travail de bureau et de la comptabilité.Il ne perçoit pas de salaire pour son travail.Armand a abandonné presque toutes ses autres activités (il était notamment 25 ans maire de D.), qui le retenaient souvent loin de son exploitation dans le passé.Après une journée bien remplie,Armand aime se coucher de bonne heure.Quant à Martha,elle ne travaille plus du tout dans l’exploitation,mais elle continue à entretenir le ménage seule, malgré quelques problèmes de santé.Le couple est content de l’évolution de l’exploitation;leur fils et sa femme continuent l’œuvre de leur vie,à leur manière.Des affermages supplémentaires ont permis à l’exploitation de croître encore,pour atteindre aujourd’hui quelque 100 hectares,avec des chevaux et des vaches laitières.

Tant que leur santé le leur permettra,Armand et Martha J.souhaitent rester aussi longtemps que possible chez eux.Mais ils ne veulent en aucun cas devenir une charge pour leurs enfants,et préfèrent,le jour venu,rejoindre une maison de retraite.
Tous les deux sont satisfaits de leur vie.Mais ils souhaiteraient avoir un peu plus d’argent:après une vie de labeur,ils auraient aimé avoir une retraite plus facile.Mais ils ne s’en plaignent pas:«On ne peut de toute façon rien changer».
1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE 1.2 ASPECTS SOCIAUX 1 75
■
Bien en selle
Tout aurait été différent si le frère aîné de Fritz M.avait vécu jusqu’à maintenant dans la ferme à F.,mais il est mort dans un accident de moto.Fritz M.n’a donc pas pu suivre une formation bancaire comme il l’aurait voulu:il allait de soi qu’il devait travailler et vivre dans l’exploitation paternelle.Dans ses loisirs,il faisait de l’équitation,par plaisir et pour se divertir un peu du travail quotidien dans l’exploitation.En 1955,il a épousé Elisabeth,qui l’a secondé au foyer et à la ferme.Le jeune couple partageait le ménage avec les parents,même après la naissance des trois filles.Les M.ont repris l’exploitation parentale en 1969,tout en maintenant son orientation (vaches laitières,fruits et grandes cultures).
Les filles s’intéressant à l’entretien de la maison d’habitation parentale,mais non à l’agriculture pratique,la famille s’est demandée,dans les années nonante,comment cesser l’exploitation.La réponse ne s’est fait pas attendre:un jeune voisin a proposé de prendre à bail le bâtiment d’exploitation et les surfaces.L’affaire fut rapidement conclue et le successeur a pu poursuivre la gestion de l’exploitation comme un tout.
Pour Elisabeth M.,la cession à bail de la ferme n’a nullement signifié le début de la retraite.Elle a continué à travailler comme maman de jour jusqu’à l’âge de 70 ans.Elle a considéré comme une chance toute particulière la possibilité de s’occuper des enfants et de jouer et chanter avec eux.Et puis,elle exploite toujours le grand jardin.Fritz M. est,lui aussi,très actif.Il taille les arbres fruitiers de nombreux voisins et exploite toujours lui-même ses hautes tiges,les traite et récolte les fruits.

Cependant,la cessation de l’exploitation a été pour les M.avant tout un pas vers la liberté.Ainsi,elle a été suivie d’un premier voyage commun au Canada et d’un deuxième en Espagne.L’équitation a été remise un temps à l’honneur et le jass s’est ajouté aux activités de loisirs.Les visites dominicales chez les enfants et les petitsenfants se sont détendues:«On y allait déjà avant,mais ce n’est pas la même chose quand on doit être à la maison à cinq heures et on se fait piéger par un bouchon». 1.2 ASPECTS SOCIAUX 1 76
Pietro,fils de paysan du Nord de l’Italie,et Luigina V.,fille d’un petit paysan de la région,ont réalisé le rêve de devenir propriétaires d’une exploitation agricole:ils ont élevé du bétail et cultivé des vignes jusqu’il y a deux ans.En 1980,ils ont construit une étable et pris des parcelles en fermage,de sorte que l’exploitation a atteint 15 hectares. Il y a deux ans,la cadette des deux filles a pris possession de la maison,de l’étable et du petit vignoble.Elle a mis sens dessus dessous le concept de l’exploitation et mise sur l’agrotourisme:elle a vendu les animaux pour transformer l’étable et la grange à foin en chambres d’hôtes attractives,pouvant accueillir 30 personnes.Les V.ont gardé le droit d’habiter à la ferme,de sorte qu’ils partagent le ménage avec leur fille,célibataire.
Luigina V.aurait en fait préféré abandonner définitivement l’agriculture et vendre aussi les vignobles,afin de pouvoir se reposer à l’automne de la vie après des années de labeur.Par contre,Pietro a eu de la peine à arrêter.Eleveur passionné,il n’a manqué naguère aucune exposition de bétail et a accumulé coupes,cloches de vaches et autres distinctions;or,il doit y renoncer aujourd’hui pour des raisons de santé.Au moins,il peut encore assister sa fille pour les côtés techniques de la viticulture.Lâcher l’agriculture n’est pas facile pour ce paysan de vocation,même si l’âge l’y contraint.

Les V.ont soutenu financièrement leur fille dans la réalisation de son projet et ont pris un crédit pour financer les investissements nécessaires.Ceux-ci grèvent maintenant énormément le budget du ménage.Heureusement,il ont pu mettre un peu d’argent de côté quand ils étaient encore exploitants.La rente AVS n’aurait pas été suffisante à elle seule.
Les V.ne sont pas très exigeants.Luigina est contente de pouvoir faire ses courses une fois par semaine en compagnie d’une amie.Le dimanche,elle aime aussi faire de la randonnée.En outre,elle chante dans une chorale et fait une fois par semaine de la gymnastique dans un groupe de seniors.Pietro,quant à lui,est content d’avoir encore quelque chose à faire dehors et de passer chaque été deux semaines auprès de sa famille en Italie du Nord.
1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE 1.2 ASPECTS SOCIAUX 1 77
■ S’ouvrir au nouveau
■ Le deuxième des neuf enfants
Thomas S.n’a pas toujours suivi l’exemple de ses parents.Alors que ceux-ci se sont mariés tôt et ont eu neuf enfants,il est resté célibataire.Alors que son père a vécu jusqu’à sa 92ème année dans l’exploitation,Thomas a décidé de déménager déjà à l’âge de 62 ans:il a admis en souriant que la peur l’a tout d’un coup saisi dans l’isolement de la montagne.Enfin,alors que la transmission de l’exploitation au sein de la famille allait de soi pour son père,Thomas S.a vendu le domaine entier à un collègue de la région,qui gère dès lors deux exploitations en parallèle.
Certes,cette dernière décision vient notamment de ce que Thomas S.n’a pas d’enfants et qu’aucun de ses neveux ou nièces ne s’est montré intéressé par son exploitation de montagne de 6,5 ha;quant à lui,il aurait «préféré la céder à un membre de la famille, gratuitement ou à moitié prix».Il a eu bien de la peine à céder l’exploitation à quelqu’un d’étranger à la famille.Entre-temps,il a cependant reconnu les avantages de la cessation de l’exploitation.Selon ses souvenirs,l’agriculture a été toujours liée à des soucis et des craintes,qui appartiennent maintenant au passé.
Son exploitation étant isolée,Thomas S.n’a jamais livré son lait à la laiterie,mais l’a transformé lui-même en fromage.En outre,il a élevé des veaux et des chèvres.Son expérience dans ces domaines fait encore autorité.Quand Thomas S.a offert une fois ses services dans un journal,40 intéressés l’ont contacté.Il a travaillé par la suite trois hivers dans la région l.,jusqu’à en avoir assez.Depuis son déménagement,il passe ses étés à l’alpage à aider son frère,qui lui offre table et logis en contrepartie.

Thomas S.ne jouit donc de la véritable «retraite» qu’en dehors de la belle saison.Il se promène alors en forêt,y cherche du bois à brûler pour l’une de ses sœurs et lui-même (il était garde-chasse durant une demi-douzaine d’années) ou s’occupe à sculpter du bois.La famille a vécu un événement tout particulier l’année passée,lorsque tous les frères et sœurs ont fait ensemble de la randonnée pendant les vacances,à l’exception d’un frère émigré au Canada.
En fait,Thomas S.a aussi émigré,même s’il s’agit d’un village en aval éloigné de quelques kilomètres.Il y loue un appartement de la commune.L’AVS et quelques réserves suffisent pour couvrir les frais de location et les besoins quotidiens et deux sœurs aident à tenir le ménage.Thomas S.est donc très reconnaissant des liens familiaux, depuis toujours solides.
1.2 ASPECTS SOCIAUX 1 78
Le père de Hans W.n’a transmis son exploitation à son fils qu’à l’âge de 83 ans,une année avant sa mort.A l’époque,il n’y avait pas encore de paiements directs,mais «le lait valait encore quelque chose»,se souvient Hans W.Lui et sa femme Margret avaient déjà deux fils;deux enfants sont venus au monde après la reprise de l’exploitation. L’exploitation de dix hectares n’étant pas très grande,un revenu accessoire gagné aux remontées mécaniques a contribué à ce que la famille aille bien,«peut-être trop bien», dit aujourd’hui Margret W.
Hans et Margret W.,qui avaient beaucoup investi dans les bâtiments de leur exploitation,se sont réjouis de voir leur fils cadet s’intéresser à la succession.A cet égard,il a été clair que la reprise coïnciderait avec le 65e anniversaire de Hans W.,en raison du système des paiements directs.Mais le moment venu,la transmission ne s’est pas très bien passée et personne n’était vraiment enthousiaste.Le notaire a raté son coup en invitant les parties à montrer davantage de joie.

Aujourd’hui,Hans et Margret W.considèrent que l’omission du droit d’habitation dans le contrat a été une erreur:ils ont dû chercher un nouveau logement peu après la cession de l’exploitation,en raison des tensions avec la belle-fille.La coïncidence du déménagement avec une fracture de la colonne vertébrale de Margret W.a-t-elle été un hasard? En tout cas,cette lésion a été une difficulté supplémentaire,car il a fallu beaucoup de travail pour aménager le nouveau chez soi.De plus,la route a été rectifiée et passe maintenant directement devant la maison,ce qui provoque un certain bruit.
Entre-temps,les W.se sont arrangés avec leurs nouvelles conditions de vie.L’AVS permet tout juste de couvrir les dépenses courantes.Le nouveau logement est assez grand pour que les enfants et les petits-enfants puissent venir en visite,par exemple pour aller skier avec Hans W.Le culte dominical est un événement régulier et les courses communes en ville illuminent le quotidien.Mais on voit souvent Hans W.se mettre à la fenêtre du premier étage et regarder pâturer les vaches qu’il trayait jadis.
1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE 1.2 ASPECTS SOCIAUX 1 79
■ Déménagement
Albertina et Guido F.habitent dans un village de montagne.Leurs deux filles ont étudié pour devenir l’une enseignante et l’autre architecte,optant ainsi pour une vie en dehors de l’agriculture.Quant aux trois petits-enfants,ils viennent avec plaisir voir leurs grands-parents à la ferme,mais âgés de quatre,huit et dix ans,ils sont encore trop jeunes pour une décision professionnelle.Guido F.a été éleveur passionné et estimé de la vache Brune et Albertina F.le secondait toujours dans l’exploitation. Lorsque son mari voyageait en tant que marchand de bétail,elle se chargeait de toutes les tâches à accomplir.Dans les années septante,les F.avaient pensé à une nouvelle étable.Ils y ont finalement renoncé en l’absence de successeur,et s’en réjouissent aujourd’hui.

A l’âge de 65 ans,Guido transmet l’exploitation à Albertina,plus jeune.Ils adaptent progressivement l’exploitation de 12 hectares à leurs forces:ils réduisent progressivement le cheptel,puis cèdent à bail d’abord une partie et ensuite l’ensemble de l’exploitation.Cependant,ils ne veulent pas tout de suite vendre leur exploitation,en raison des petits-enfants d’une part et du prix des terrains peu attractif d’autre part.
Les F.habitent une maison pour deux familles,que le père de Guido avait achetée en son temps.Albertina et Guido F.vivent dans une partie de la maison,une sœur de Guido dans l’autre.Qui s’occupera d’eux lorsqu’ils ne le pourront plus? M.et Mme F. se posent souvent la question de l’indépendance dans la vieillesse.Plus que sa femme, Guido F.a beaucoup de peine à s’imaginer la vie dans une maison de retraite.
En revanche,les F.ne se font pas pour l’instant trop de soucis financiers:leur revenu provenant de l’AVS et des fermages est suffisant.Les frais d’entretien de la maison sont très bas.En outre,ils ont pu mettre de côté un peu d’argent,car ils ont renoncé à des gros investissements dans l’exploitation.
Comme toujours,Guido F.aime des discussions animées:il a exercé la fonction de président de bourgeoisie et,durant des années,celle de conseiller communal.Albertina et Guido vont souvent voir leurs filles et petits-enfants.Les F.prennent volontiers leur temps pour faire des balades prolongées dans la nature,qui ne leur dicte plus leur rythme quotidien.
1.2 ASPECTS SOCIAUX 1 80
■ Pas par pas vers la retraite
Peter B.ne correspond pas à l’idée qu’on se fait d’un paysan retraité typique.Il ne passe pas l’automne de sa vie dans son ancienne exploitation ni ne continue à y mettre la main à la pâte.En dépit de sa septantaine,il travaille toujours comme estimateur. Seul son employeur a changé:auparavant employé du canton pour avoir une deuxième source de revenu en complément de son exploitation d’engraissement de porcs,Peter B.s’est mis à son propre compte.Il en est satisfait,car il peut ainsi gérer son temps librement,même s’il travaille maintenant plus qu’à mi-temps.En outre,il est président du conseil d'administration d’une organisation d’engraisseurs de porcs.

Vu son agenda chargé,son fils,qui a repris l’exploitation,l’appelle de plus en plus rarement pour lui demander un coup de main dans la fenaison ou l’affouragement. Peter B.se réjouit que son fils,avec sa femme et ses quatre enfants,a développé son exploitation,qui compte maintenant 25 ha,90 truies mères et 60 taureaux,et qu’il la gère de manière autonome.Par contre,sa fille a plutôt hérité ses intérêts économiques et travaille aujourd’hui dans une banque.
La mort de sa femme a marqué une césure dans la vie de Peter B.Peu après un voyage commun en Chine – rêve que sa femme nourrissait depuis des années – celle-ci est tombée gravement malade et n’est décédée que sept mois plus tard.La motivation de continuer à gérer l’exploitation familiale en a nettement pâti:quatre ans plus tard, Peter B.a opté pour la cession.
Il ne regrette aujourd’hui aucune de ses décisions.En raison de la cession de l’exploitation à la valeur de rendement et sans droit d’habitation,sa situation financière est peut-être moins rose qu’il ne l’aurait souhaité.Il raconte en riant que l’AVS et la petite rente versée au titre de son emploi auprès du canton suffisent pour les douze premiers jours du mois,mais qu’il doit reprendre le travail le 13.Souhaitons-lui qu’il obtienne encore de nombreux mandats d’estimateur.
1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE 1.2 ASPECTS SOCIAUX 1 81
■ Apprendre à apprécier l’âge
■ Succession pleine d’obstacles
Daniel et Martha vivent une situation pour le moins difficile:la remise de l’exploitation s’est avérée extrêmement difficile pour cette exploitation de 10 hectares spécialisée dans l’élevage de truies.Lorsque Daniel J.décide,à 64 ans,d’affermer l’exploitation à son neveu,il le fait dans l’optique de donner une chance à ce jeune qui,à 15 ans déjà, prêtait main forte dans l’exploitation.

La seule fille du couple,bien qu’ayant marqué de l’intérêt au départ,a renoncé à reprendre la ferme;elle s’est finalement mariée avec un agriculteur à la tête d’une exploitation laitière et tabacole.Quant au neveu,il ne dispose ni de la formation agricole nécessaire lui permettant d’obtenir des crédits d’investissement pour assainir la porcherie,ni des moyens financiers nécessaires pour racheter l’exploitation.Les J. empruntent alors l’argent nécessaire,à leur compte.C’est une charge énorme pour le couple,car ils devront rembourser des dettes jusqu’à un âge avancé,ce qui les pousse aux limites de leurs capacités,tant financières que psychiques.De plus,leur santé est fragile:Mme J.souffre depuis longtemps de diabète et de rhumatismes,et son mari de troubles rénaux depuis sa jeunesse.
En 1959,Daniel décidait de construire une maison pour deux familles,indépendante de l'exploitation.Il souhaitait une vie de famille indépendante.En 1974,un incendie a détruit le bâtiment d'exploitation,tout en épargnant la porcherie construite en 1959. Cependant,la seconde partie de la maison n’offre pas assez de place à son neveu et sa famille,raison pour laquelle ils habitent ailleurs,et l’appartement de trois pièces est loué.C’est dans cette maison que Mme J.,avec le soutien de son mari,s’est occupée d’abord de ses beaux-parents,puis de ses propres parents.Pour eux-mêmes,Daniel et Martha entrevoient les choses autrement:au moment voulu,ils iront dans une maison de retraite.
Petit réconfort pour Daniel et Martha J.:leurs visites annuelles auprès de leurs amis agriculteurs en France.Daniel avait fait connaissance de son ami français dans sa jeunesse,alors qu'il était stagiaire agricole au village.Le contact ne s’est jamais rompu. Il est même devenu plus facile:il est aujourd’hui possible de quitter l’exploitation pour quelques jours sans problèmes.
1.2 ASPECTS SOCIAUX 1 82
■ Soins mutuels dans la vieillesse
Les époux Anton et Alice Z.ont repris l’exploitation des parents d’Anton dans les années septante.Hormis 14 vaches laitières et quelques veaux à l’engrais,ils ont gardé au début dans leur exploitation douze truies mères,sous les soins d’Alice Z.Suite à la reprise de l’exploitation,les parents de Anton Z.ont acquis non seulement le droit d’habitation,mais aussi celui d’être soignés,qu’ils soient malades ou en bonne santé. Les soins ont représenté une charge considérable pour Alice Z.,paysanne diplômée,et pour toute la famille Z.Les temps étaient durs.Après la reprise de l’exploitation,il a fallu investir beaucoup d’argent dans l’assainissement des bâtiments d’exploitation et d’habitation.Les Z.ont certes acquis quelque chose dans l’exploitation,mais ils y ont consacré toute leur vie et n’avaient pas le temps de prendre des vacances.Vacances? «Aujourd’hui je n’en veux plus»,dit Alice Z.

Anton Z.continue à passer son temps en plein air dans l’exploitation.Afin d’avoir un contact avec les gens,il chante depuis 45 ans dans la chorale de l’église et,depuis quelques années,dans la petite chorale de seniors.Alice Z.fait de l’aquafit:c’est bon pour la santé.Le couple entretient le contact avec ses trois filles et le petit enfant,qui viennent les voir régulièrement.Par contre,le contact avec le monde extérieur est difficile pour Alice Z.;il s’est délité notamment en raison du temps qu’elle a dû consacrer aux soins des parents.Cet isolement non voulu leur fait un peu souci.
Une année avant son 65ème anniversaire,Anton Z.cède l’exploitation à son fils unique, afin que celui-ci puisse bénéficier de l'aide initiale aux jeunes agriculteurs:de nouveaux investissements sont nécessaires.Le successeur est célibataire et habite encore chez les parents.Alice Z.s’occupe du ménage de trois personnes.Elle a arrêté le travail dans l’exploitation,mais a gardé le jardin familial.Le jeune successeur travaille parfois hors exploitation.Il doit donc compter sur la collaboration du père.Anton Z.renonce à son salaire,bien que son fils le lui ait proposé.Il n’aimerait pas être une charge supplémentaire pour son fils et pour l’exploitation.
Grâce au droit d’habitation,l’AVS et les frais de pension payés par le fils permettent au couple Z.de s’en sortir financièrement.Seul l’argent obtenu pour le cheptel vif et mort est resté du produit de la vente de l’exploitation au fils.Les dettes et la valeur de rendement de l’exploitation se compensent plus ou moins.Anton et Alice Z.ne peuvent envisager la construction d’un appartement dans l’exploitation (Stöckli) qu’au moment où Alice fait un héritage.Autrement,ils auraient cherché un appartement ailleurs pour éviter de devenir une charge pour leur fils et de compromettre son avenir.
Les soins apportés aux (beaux-)parents ont usé leurs forces:selon Alice Z.,ils ont perdu quelques années de bonne santé.Ils ne pensent pas volontiers au vieillissement:cela viendra assez tôt de toute manière.Quoi qu’il en soit,ils comptent avant tout sur eux mêmes et veulent se soigner mutuellement aussi longtemps que possible.
1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE 1.2 ASPECTS SOCIAUX 1 83
■ Début tardif,fin précoce
Quand Balzer A.a repris l’exploitation parentale,à l’âge de 45 ans,les terres avaient déjà été cédées à bail et son père vivait dans une maison de retraite.C’est le mariage avec Päuly qui a poussé Balzer à reprendre la ferme:la jeune femme,divorcée d’un gros paysan de la région,préférait nettement l’air de la campagne à son appartement en ville.Le couple a donc repris l’exploitation et,de plus,reçu 14 moutons en cadeau de mariage.Dès le début,la garde des animaux respectueuse de l’espèce à été une préoccupation importante.
Même si Balzer et Päuly A.travaillaient tout le temps en dehors de l’exploitation,le troupeau est passé avec le temps de 14 à 130 moutons;la surface a été portée de trois hectares détenus en propriété à neuf hectares.Certes,il n’a jamais été facile de concilier le travail comme ouvrier du bâtiment et comme cuisinière dans la maison de retraite avec l’affouragement,l’agnelage et le fanage,plus les problèmes croissants avec les maladies des onglons,mais en 2002,la poursuite de l’exploitation n’a plus été possible du tout:Balzer A.,qui n’avait jamais souffert du dos,a tout d’un coup eu une hernie discale.Il a dû laisser à sa femme tout le travail dans l’exploitation,étant luimême admis au bénéfice d’une rente AI.
La journée fatidique du printemps 2003,lorsque les moutons ont été vendus,a été dure pour le couple.Elle est sortie,et lui,il s’est dit que cela ne différait pas beaucoup d’une inalpe,pour passer ensuite un trimestre à l’hôpital et à la cure.Puis un sentiment de vide vint s’installer,lorsque les moutons ne revinrent pas de l’alpage en automne. Véhicules de chargement et moto-faucheuses ont changé de propriétaire et les terres ont été cédées à bail à un voisin.Pour des raisons de santé,il a fallu renoncer à l’idée d’ouvrir une pension pour chevaux,en dépit de bâtiments propices.
Entre-temps,Balzer et Päuly A.se sont accommodés de la cessation inattendue de l’exploitation.Elle continue de travailler dans la maison de retraite jusqu’à sa retraite l’année prochaine et s’engage au théâtre d’amateurs.Lui s’occupe de quelques maisons de vacances et va boire des cafés avec ses collègues dans le village d’I.voisin. Quant aux animaux,quatre chats ont remplacé le troupeau de moutons.Mais la famille applique à leurs compagnons félins le même principe qui valait naguère pour leurs moutons:il ne suffit pas de garder les animaux,il faut encore avoir une relation avec eux.

1.2 ASPECTS SOCIAUX 1 84
■ Comme par le passé
Il y a un an,ayant atteint l’âge de la retraite,Ernest et Marinette Sch.ont remis l’exploitation à leur fils.Pour eux,peu de choses ont changé:la retraite n’est pas encore synonyme de repos.Ernest et Marinette travaillent toujours dans l’exploitation,car leur fils est aussi inspecteur des viandes et n’a pas encore trouvé de partenaire qui puisse le seconder.32 hectares de terres et 25 vaches sont trop pour un seul homme.
Aujourd’hui,le couple Sch.doit cependant se ménager en raison de problèmes de santé.Ernest a dû se faire opérer d’une hanche et Marinette souffre encore des suites d’un accident:attaquée par une bête au pâturage,elle a dû se soumettre à plusieurs opérations.C’est pourquoi ils engagent un aide en été pour les travaux pénibles.
Marinette et Ernest Sch.habitent au rez-de-chaussée,alors que leur fils est à l’étage. En été,l’ouvrier agricole loge également dans la maison et on mange ensemble.C’est Marinette qui s’en occupe le plus souvent.Toutefois,lorsque sa santé l’en empêche, c’est Ernest qui reprend les commandes aux fourneaux et mijote de bons petits plats. Dans leur temps libre,Marinette aime lire et Ernest joue dans un ensemble d’instruments à vent.Les deux aiment le mieux passer le temps à la maison,en particulier Marinette.C’est là qu’ils se sentent à l’aise.

Ernest et Marinette sont habitués à vivre avec peu d’argent.N’ayant pas de loyer à payer,leur rente AVS leur suffit.Ernest et Marinette ont remis la ferme à leur fils sans rien lui demander.Ils n’ont ni économies,ni troisième pilier.Cependant,Marinette,fille unique,vient d’hériter la maison familiale,qu’elle pense revendre prochainement.
Dans la mesure du possible,Ernest et Marinette souhaitent demeurer jusqu’à la fin de leurs jours chez eux,comme l’avaient fait les parents d’Ernest.Le jour où ils ne pourront plus travailler,leur fils devra sans doute abandonner la production laitière. Mais ils espèrent que ce jour arrivera le plus tard possible,et que tout reste comme avant.
1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE 1.2 ASPECTS SOCIAUX 1 85
Martha et Otto H.ont exploité une ferme 29 ans durant.Les sept hectares de terres ont été utilisés pour l’économie laitière et l’horticulture.Martha H.avait,elle aussi,du travail dans l’exploitation;même les enfants ont dû mettre la main à la pâte.Les H.ont habité avec les six enfants,trois garçons et trois filles,dans un bel endroit tranquille en marge du village,idéal pour une famille nombreuse.Au début,la jeune famille a habité dans cette même maison avec les parents,jusqu’à ce que le quatrième enfant soit en route.Les parents ont alors déménagé au village pour faire la place à la jeune famille. Un deuxième appartement dans l’exploitation n’entant pas en ligne de compte,il n’était pas non plus question du droit d’habitation.
Puisque aucun des enfants ne voulait se lancer dans l’agriculture,les H.ont décidé de vendre leur exploitation même avant l’âge AVS.A cet égard,Martha avait presque plus de peine qu’Otto,qui de toute manière aurait préféré travailler dans une banque.Tous deux ont néanmoins été tristes de voir leurs vaches partir aux enchères.Ils ont trouvé important qu’une famille ait pu acheter l’exploitation.Au lieu de la vendre au plus offrant,ils ont donc décidé de donner une chance à une famille d’anciens fermiers.
Après la vente,Martha et Otto se sont partagé un poste de concierge à l’école.Les beaux jours n’ont pas duré comme prévu jusqu’à l’âge AVS.Le décès prématuré d’Otto a de nouveau bouleversé la situation de Martha.Elle a finalement abandonné l’emploi à l’école après y avoir travaillé encore deux ans avec l’un des fils.Aujourd’hui,la veuve loue un appartement au village voisin.Elle se rend régulièrement sur la tombe de son mari à l’ancien domicile;elle passe alors toujours à côté de son ancienne exploitation. Cependant,elle n’a pas beaucoup de contact avec les nouveaux propriétaires.
Ancienne paysanne et consommatrice consciente,Martha H.donne la préférence aux produits suisses.Elle prend aussi le parti des paysans lorsque ceux-ci passent sous le feu de la critique.En dépit de ses 80 ans,Martha est encore très active:«la semaine est trop courte»,dit-elle.Elle s’occupe du ménage,fait le massage des zones réflexes du pied et se charge de la communion des malades pour l’église.L’été,elle aime bien faire de la randonnée avec les amis de la nature.Elle l’apprécie aujourd’hui d’autant plus qu’elle était auparavant clouée sur place tant à la maison parentale,au restaurant, qu’ensuite dans l’exploitation.Seule une opération des yeux imminente lui fait un peu souci;autrement,Martha est contente et reconnaissante pour la vie actuelle.

1.2 ASPECTS SOCIAUX 1 86
■ Donner une chance à d’autres
■ Une nouvelle phase de la vie
Fritz et Ursula A.ont trois fils adultes.L’aîné et le cadet ont repris la ferme parentale en communauté d’exploitation,après que Fritz A.a dû se faire opérer d’une hanche et a été incapable de travailler pendant deux ans en raison de complications.La cession précoce de l’exploitation a été la meilleure solution pour tous.

La vieille maison paysanne est maintenant habitée par la jeune génération.Fritz et Ursula A.habitent une maison à côté qui ne fait pas partie de l’exploitation.Ils ont commencé par la louer pour l’acheter ensuite.En dépit du financement par des tiers,ils s’en sortent,car la location du deuxième appartement couvre les intérêts.Leur situation financière est donc solide.
L’exploitation va bien,elle aussi.Les frères ont étendu la communauté à une deuxième exploitation,et afferment encore l’ensemble des terres d’une troisième.Fritz A.continue de s’occuper de l’étable.Matinal,il n’a rien contre le fait de se lever tôt.Au contraire,le travail dans l’étable est pour lui un changement bienvenu.
Fritz et Ursula A.aiment aller à la montagne et ont maintenant plus de temps pour se vouer à cette activité.Naguère,Ursula a beaucoup tricoté et Fritz a joué de l’accordéon,mais les doigts ne sont aujourd’hui plus ce qu’ils étaient.En revanche,Ursula A. aime jouer avec l’ordinateur,même si cela fait parfois sourire les voisins du même âge. Fritz A.est par contre plutôt bricoleur et s’occupe à travailler du bois.Tous deux trouvent important de pouvoir conduire,notamment parce qu’ils habitent un peu à l’écart et gagnent ainsi un peu d’indépendance.
La jeune et la vieille générations s’arrangent bien,notamment grâce à une certaine distance spatiale,selon Ursula A.Au début,elle a eu un peu de peine avec le passage d’une grande famille à un ménage de deux personnes.Le remue-ménage et les nombreux contacts sociaux lui ont manqué après le déménagement dans la nouvelle maison.Elle raconte en souriant:«Là-bas,j’ai dû constamment courir au téléphone ou à la porte et ici,c’est le silence».Les A.trouvent tous les deux positif de ne plus devoir assumer la responsabilité de l’exploitation.Ils ont accepté qu’un chapitre soit définitivement fermé.
1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE 1.2 ASPECTS SOCIAUX 1 87
■ Conclusions des portraits
De nombreuses personnes interrogées apprécient beaucoup l’indépendance de l’exploitationqu’elles ont gagnée grâce à la retraite.Les retraités ont maintenant plus de loisirs et la possibilité de prendre des vacances.Ces déclarations vont dans la même direction que les résultats de l’enquête quantitative sur la qualité de la vie (cf.Rapport agricole 2005),selon lesquels les paysannes et paysans considèrent que les plus grands déficits par rapport aux autres groupes sociaux concernent le temps disponible et les loisirs.Hormis le droit d’habitation,la reprise de l’exploitation a le plus souvent impliqué un droit aux soins des (beaux-)parents,car aucune assurance maladie obligatoire n’existait à ce temps-là.Ce droit a souvent été lié à une grande charge,tant physique que psychique.Selon la personnalité et la situation,il est plus ou moins facile de lâcher et de céder l’exploitation.Lorsqu’une cession de l’exploitation était envisageable,il a été beaucoup investi et des développements considérables ont été parfois possibles.Au total,l’automne de la vie paysanne présente un tableau serein,en dépit de quelques ombres.
1.2 ASPECTS SOCIAUX 1 88
1.3Ecologie et éthologie
1.3.1Ecologie
La politique agricole est axée sur le développement durable,dont l’écologie est un des piliers.Afin d’en analyser les effets,six thèmes retenus sont observés au cours un cycle de quatre ans.En 2006,les thèmes du phosphore et du sol,qui ont déjà été traités en 2002,marquent le début d’un nouveau cycle.
Comme chaque année,la première partie du chapitre est consacrée au développement observé dans l’utilisation des terres cultivées et des moyens de production.La deuxième partie s’articule autour du thème du phosphore,qui est observé à divers niveaux:international,national et régional,et par type de culture.La troisième partie,sur le thème du sol,fait le point de la situation au plan mondial et analyse ensuite les changements d’affectation des sols en Suisse,ainsi que l’évolution de la qualité des sols agricoles (risque d’érosion,métaux lourds,substances organiques nocives).

1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 89 ■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■
Utilisation des terres et moyens de production
Evolution de la part des surfaces exploitées de manière respectueuse de l'environnement
1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1
en % de la SAU Exploitation respectueuse de l'environnement 1 dont bio Source: OFAG 1 1993 à 1998: PI + bio; à partir de 1999: PER 1993199419951996199719981999200020012002 0 100 80 60 40 20 90 70 50 30 10 2005 2004 2003 Evolution des surfaces de compensation écologique 1 199319941995199619971998199920002001200220032005 2004 en 1 000 ha Région de montagne Région de plaine Source: OFAG 1 sans les arbres fruitiers haute-tige, avant 1999 seulement surfaces de compensation écologique donnant droit aux contributions 0 140 120 100 80 60 40 20 Evolution du nombre d'animaux 199019961997199819992000200120022005 (prov.) 2004 2003 en 1 000 UGB 1 Autres Porcs Bovins Source: OFS 1 UGB = unité de gros bétail 0 1 500 1 250 1 000 750 500 250 90

1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 Evolution de l'utilisation d'engrais minéraux en 1 000 t Azote (N)Phosphates (P2O5) Source: USP 1990/9219941996199820002002 19931995199719992001 0 80 70 60 50 30 40 20 10 20032005 2004 Evolution de l'utilisation d'aliments concentrés 199019911992199319941995199619971998199920002001200220032005 (prov.) 2004 en 1 000 t Autres CH Tourteaux d'oléagineux CH Céréales fourragères CH Perfectionnement de produits importés Aliments importés Source: USP 0 2 000 1 750 1 500 1 250 1 000 750 500 250 91

Evolution des ventes de produits phytosanitaires 199019911992199319941995199619971998199920002001200220032005 2004 en t de substance active Fongicides, bactéricides, désinfectants de semences Herbicides Insecticides, acaricides Régulateurs de croissance Rodenticides Source: Société suisse de l'industrie chimique 0 2 500 2 000 1 500 1 000 500 1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 92
■ Fumure au phosphore indispensable pour l’agriculture productrice
Phosphore
Les deux règles fondamentales ci-après déterminent l’utilisation correcte des engrais:
1.La loi du minimum,selon laquelle c’est le facteur de croissance présent en quantité la plus faible qui détermine le rendement et la qualité (substances nutritives des plantes,eau,lumière,température).
2.La loi de la décroissance du rendement marginal,selon laquelle,en cas d’offre grandissante de substances nutritives,la croissance du rendement par unité de substance nutritive supplémentaire décroît.En effet,une offre excessive de substances nutritives peut entraîner une perte de rendement et/ou de qualité.
Le phosphore (P) fait partie des substances nutritives indispensables aux plantes, comme l’azote,le potassium,le calcium,le magnésium et d’autres oligo-éléments.Il est tiré du sol,absorbé par les plantes et intégré dans les produits agricoles.En Suisse, pays herbager avec un cheptel relativement nombreux,une grande partie de ces substances nutritives retourne dans le sol sous la forme d’engrais de ferme.La partie intégrée dans les produits agricoles destinés à l’alimentation humaine (ou à la production d’énergie) quitte toutefois l’exploitation agricole et doit être remplacée par des engrais;sinon le rendement et la qualité se détériorent plus ou moins rapidement, selon la substance concernée.
■ Fumure adéquate,une tâche exigeante
Les bonnes pratiques agricoles tiennent compte des aspects suivants lors de la fumure:
–besoin des plantes en substances nutritives –réserves de substances nutritives dans le sol –quantité d’engrais de ferme produits dans l’exploitation –technique de stockage et d’épandage des engrais de ferme –teneur en substances nutritives et autres propriétés des engrais de ferme,des engrais de recyclage et des engrais minéraux –comportement des engrais et des substances nutritives dans le sol –moment où les cultures ont besoin de substances nutritives –rentabilité
Lorsque ces aspects sont pris en compte,la fumure répond aux exigences aussi bien agronomiques qu’écologiques.
1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE 1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 93
Au début du siècle passé,la plupart des sols en Suisse ne contenaient pas suffisamment de phosphore.Pendant environ 80 ans,ces sols ont par la suite été fertilisés au moyen d’engrais phosphatés bon marché.Aujourd’hui,la majeure partie des sols agricoles sont bien,voire trop bien approvisionnés en phosphore.Du point de vue agronomique,ces réserves sont précieuses,car le phosphore est bien retenu dans le sol jusqu’à saturation.Ensuite,il risque cependant d’être éliminé par lessivage.Le phosphore devient problématique s’il parvient en trop grandes quantités dans les plans d’eau.Il s’agit par ailleurs d’une matière première non renouvelable;selon la source et compte tenu du taux d’utilisation actuel,elle sera encore disponible en quantité suffisante pendant 80 à 120 ans.Fertiliser inutilement au phosphore revient donc à gaspiller une ressource rare.La qualité des gisements de phosphore a en outre tendance à diminuer,ceux à faible teneur en métaux lourds étant pour la plupart épuisés.En considération de la rareté de cette ressource,la récupération du phosphore contenu dans les déchets qui sont généralement éliminés (boues d’épuration,déchets de viande et d’os) devrait redevenir un sujet d’actualité.En Suisse,les sols contiennent aujourd’hui suffisamment de phosphore et ils sont bien approvisionnés par les engrais de ferme.Si l’on tient compte des apports de phosphore sous la forme de compost et d’autres engrais de recyclage (sans les boues d’épuration),il ne faut à l’agriculture que très peu de phosphore pour couvrir les besoins,à savoir moins de 1000 t par an ou moins de 5% des besoins totaux.Une tâche exigeante consiste à répartir de manière optimale les engrais de ferme.
Besoin d’engrais minéraux phosphatés dans l'agriculture en 2004
Source: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
■ Il ne manque que très peu de phosphore dans l’agriculture
Besoin en PApports de P en t P
Besoin en engrais minéraux Retombées atm., compost et autres Engrais de ferme Production de fourrages Denrées alimentaires 0 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 94
■ Forte diminution des apports de phosphore dans les
Dans les pays industrialisés,le phosphore est depuis des décennies surtout considéré comme un problème environnemental en raison de la charge qu’il représente pour les eaux.En Suisse,97% des eaux usées provenant des ménages,de l’industrie et de l’artisanat sont conduites dans des stations d’épuration où elles sont en majeure partie traitées par précipitation de phosphore et passent parfois même une quatrième phase de nettoyage (filtration par floculation permettant l’élimination supplémentaire de phosphore).Les produits à lessive contenant du phosphore ont été interdits en 1986. L’agriculture a également pris des mesures efficaces:l’épandage d’engrais minéraux phosphatés notamment a diminué de presque trois quarts depuis 1990/92,des aliments concentrés appauvris en phosphore sont très souvent utilisés dans l’engraissement des porcs et les capacités de stockage des engrais de ferme ont beaucoup augmenté.On constate une forte régression des apports de phosphore dans les eaux superficielles, surtout grâce à l’épuration des eaux et aux efforts consentis par l’agriculture.La Suisse a ainsi nettement dépassé l’objectif fixé dans la convention OSPAR (accord Oslo-Paris pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du nord-est) consistant à réduire jusqu’en 2000 les apports de phosphore dans le Rhin de 50% par rapport à 1985.
Une comparaison portant sur plusieurs pays montre qu’entre 1985 et 2000,tous sont parvenus à réduire massivement,c’est-à-dire de 50% au moins,les apports de phosphore dans les eaux superficielles.La Suède fait exception à la règle,mais les apports de phosphore y étaient déjà très faibles en 1985.S’agissant des sources,les réductions majeures concernent l’industrie,l’artisanat et les ménages.Elles ont été obtenues grâce au traitement des eaux et à des mesures prises dans l’industrie.
Les réductions sont nettement moins importantes pour ce qui est des apports de phosphore diffus.Il s’agit là des autres apports,causés en particulier par le ruissellement,l’érosion,le lessivage et le drainage,dont une partie n’est pas attribuable à l’agriculture.C’est un phénomène naturel qui reste constant.En 1985,la part de la charge diffuse aux apports totaux de phosphore était généralement inférieure à 20%, tandis qu’en 2000,elle était bien plus élevée dans beaucoup de pays.
eaux
198520001985200019852000198520001985200019852000 1985 BelgiqueDanemarkAllemagnePays-BasNorvègeSuèdeSuisse 2000 17 800 7 429 5 875 1 605 73 365 25 018 30 615 8 875 1 853 693 995 1 140 3 064 665 Apports de P en %, par source Industrie,
Source:
t/P 0 100 80 60 40 20 1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE 95
Apports de P dans la mer, directs ou via des affluents, comparaison de pays
artisanat, ménages Charge diffuse (agriculture et apports naturels)
OSPAR Commission 2003
Pendant la période sous revue,les apports diffus de phosphore dans le bassin versant du Rhin,en aval des lacs,ont diminué de 154 t,soit 28%.Si l’on ne considère que les apports provenant de l’agriculture (total des apports diffus moins les apports naturels de 137 t),la réduction atteint 38%.En 2000,la part de la charge diffuse aux apports totaux de phosphore dans les eaux superficielles s’est montée à 27%.La majeure partie des apports totaux émane en Suisse de sources non agricoles,même si l’agriculture est la principale responsable en ce qui concerne plusieurs lacs petits et moyens du Plateau.
De manière générale,on constate pendant la période sous revue une diminution significative des concentrations de phosphore dans les lacs suisses.Cette évolution a commencé vers le milieu des années 70.C’est dans les Lacs de Sempach,de Hallwil et de Baldegg,dans lesquels la concentration était particulièrement forte,que la régression est la plus marquée.Elle s’explique en premier lieu par les progrès qui ont été faits dans l’assainissement des eaux usées.Le Lac de Thoune et le Lac des Quatre-Cantons présentent de très faibles concentrations de phosphore,qui sont demeurées plus ou moins stables pendant la période considérée.

■ Diminution significative des teneurs en phosphore des lacs Evolution des concentrations de P dans les lacs suisses 1990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005 mg P/m 3 d’eau Source: OFEV 0 140 120 100 80 60 40 20 Greifensee Lac de Thoune Lac de Sempach Lac de Baldegg Lac de Hallwil Lac de Zurich Lac de Lugano sud Lac des Quatre-Cantons Objectif qualitatif 1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 96
■ L’agriculture,principale responsable des trop fortes concentrations de phosphore dans certains lacs
L’OFEV a délimité les bassins d’alimentation des lacs présentant des teneurs en phosphore trop élevées,afin de pouvoir déterminer les régions posant problème.Ce faisant,il n’a tenu compte que des lacs ayant une surface de plus de 3 km2 et dont le bassin d’alimentation se situe à moins de 1'200 m d’altitude.Il est prévu de prendre des mesures dans les zones où la teneur en phosphore en pleine eau brassée est supérieure à 20 µg/l.
Bassins d'alimentation avec teneurs en P élevées dans les eaux lacustres 1 2004
Teneur en P de plus de 20 µg / l dans les eaux lacustres (apports de P provenant de l’agriculture à raison de plus de 50%) Bilan de phosphore (auto-approvisionnement) >100% Région d’estivage
Source:
La carte ne montre que les lacs dans lesquels,d’une part,la teneur en phosphore était supérieure à 20 µg/l en moyenne des cinq dernières années et,d’autre part,la charge provenant de l’agriculture représente plus de 50% des apports totaux.Il s’agit des lacs de Hallwil,Baldegg,Sempach,Zoug,Morat et Gruyère.D’autres lacs (p.ex.Lac de Lugano,Greifensee,Lac Léman et Lac de Zurich) ont également une teneur en phosphore de plus de 20 µg/l,mais dans leur cas,les apports principaux proviennent de sources non agricoles.
Un auto-approvisionnement en phosphore excédant 100% est une cause possible des apports élevés dans les eaux superficielles attribuables à l’agriculture.La carte indique de grandes régions avec un cheptel très nombreux,qui produit plus d’engrais de ferme que les cultures n’en ont besoin (il n’est pas tenu compte des achats d’engrais minéraux ni des cessions d’engrais de ferme à des tiers).Il y a par ailleurs d’autres causes,telles que le mode d’exploitation,la manière d’utiliser les engrais de ferme, l’érosion de sols enrichis de phosphore et le lessivage de phosphore dans ces sols.Pour résoudre ces problèmes,des projets d’assainissement visés à l’art.62a de la loi sur la protection des eaux ont été lancés il y a déjà plusieurs années.Conformément à la loi précitée,la Confédération peut,sous certaines conditions et dans les limites des crédits approuvés,verser des indemnités pour les mesures prises par l’agriculture afin d’empêcher le ruissellement et le lessivage de substances.
Bassins d’alimentation = bilan98
OFAG, SIPA Données cartographiques GG25 ©Swisstopo/OFEV
1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE 1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 97
1 seulement lacs, dont les apports en phosphore proviennent de l’agriculture à raison de plus de 50%; la teneur en P se réfère aux moyennes 2000–2004
Les excédents de phosphore se calculent à partir de la différence entre les entrées et les sorties de cette substance dans l'agriculture.La méthode OSPAR appliquée pour ce calcul ne prend pas en compte le cycle de substances à l’intérieur de l’agriculture, notamment les fourrages produits dans les exploitations et les engrais de ferme.L’agriculture tout entière est considérée comme une seule exploitation.Les entrées comprennent les aliments pour animaux importés,les engrais minéraux et les engrais de recyclage,les semences importées et les dépositions atmosphériques.Les sorties englobent les denrées alimentaires végétales et animales ainsi que d’autres produits fournis par l’agriculture.Les excédents ont fortement diminué surtout dans la première moitié des années 90;ensuite,leur régression s’est beaucoup ralentie.Depuis l’an 2000,ils fluctuent entre 5’500 et 7'000 t.
L’efficacité du phosphore (sortie en kg P par entrée en kg P) a ainsi nettement augmenté pendant la période sous revue;elle atteint aujourd’hui facilement 60%. Idéalement,elle devrait approcher les 100%.L’agriculture est toutefois encore bien loin de cet objectif.L’augmentation marquée de l’efficacité du phosphore au milieu des années 90 est frappante.Il s’explique surtout par le fait qu’en raison de l’ESB,l’utilisation de farines animales dans l’alimentation des animaux a été partiellement interdite; les quantités de phosphore issues de l’agriculture ont régressé par la suite (entretemps lesdites farines ont été interdites pour l’alimentation de toutes les catégories d’animaux).L’utilisation croissante d’aliments pauvres en azote et en phosphore dans l’engraissement des animaux a également contribué à augmenter l’efficacité du phosphore.
/ entrées Evolution des excédents de P et de l'efficacité du phosphore 199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004 Excédent de P Source: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART 0 25 000 20 000 10 000 5 000 15 000 en t de P Sorties / entrées 0 0,70 0,50 0,60 0,40 0,30 0,20 0,10 1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 98
■ Utilisation de plus en plus efficace des engrais phosphatés
Sorties
■ Engrais minéraux en forte régression
de P
La majeure partie des apports de phosphore provient des engrais minéraux et des aliments pour animaux importés.Tandis que les apports dus à ces derniers ont légèrement augmenté durant la période sous revue,ceux liés aux engrais minéraux ont diminué de plus de 60%.On a par ailleurs observé,à partir de 2000,une régression frappante des apports causés par les boues d’épuration,suite à l’annonce de l’interdiction de les utiliser dans l’agriculture.
Composition des entrées
199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004 en t de P
Agroscope Reckenholz-Tänikon ART 0 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000
pour animaux importés Boues d'épuration Engrais minéraux Autres intrants 1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE 1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 99
Source:
Aliments
■ Les terres utilisables par l’agriculture sont rares …
Sol
Par sol,on entend la couche vivante,la plus externe de l’écorce terrestre,soumise aux altérations atmosphériques,qui a généralement une épaisseur de 50 cm à 2 m.Il peut être considéré comme la «peau» extrêmement fine et vulnérable de la terre.Le sol remplit une multitude de fonctions sans lesquelles la vie sur terre ne serait pas possible (cf.Rapport agricole 2002,p.113 ss).
Une des fonctions du sol indispensable à la survie de l’humanité,la production de denrées alimentaires,implique notamment que deux conditions soient remplies:les surfaces agricoles utiles doivent être disponibles en quantité suffisante et leur qualité doit être préservée,voire améliorée.
Sur les quelques 51'000 millions d’hectares de la surface terrestre,environ 30% (14'800 mio.d’ha) sont de la terre ferme,dont plus d’un tiers est couvert de glace ou se présente sous la forme de déserts ou de hautes montagnes infertiles (5'600 mio. d’ha).Les forêts occupent elles aussi près d’un tiers de la surface (4'172 mio.d’ha).Le dernier tiers enfin est aujourd’hui affecté principalement à l’agriculture (pâturages et steppe:3'485 mio.d’ha;cultures des champs et cultures pérennes:1'534 mio.d’ha).
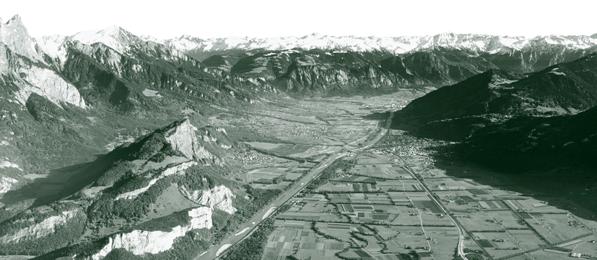
Répartition de la surface terrestre
Pâturages, steppe 7%
Forêt 8%
Désert, hautes montagnes, couvert de glace 11%
Expl. agricole intensive 3%
Surface d'eau 71%
Source: FAO, PNUE
1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 100
■ … et les possibilités d’extension sont modestes …
Selon les indications de la FAO,il n’est plus guère possible de gagner des terres cultivables.En Asie du Sud et de l’Est,de même qu’en Europe,la plupart des surfaces utilisables par l’agriculture sont déjà affectées à cette fin actuellement.En Asie de l’Ouest, ainsi que dans de grandes parties de l’Australie et de l’Afrique du Nord,la pénurie d’eau limite les surfaces pouvant être affectées à l’agriculture.C’est en Afrique,au Sud du Sahara,et en Amérique du Sud que se trouvent les plus importantes réserves de terres cultivables.Elles sont toutefois conquises au détriment des forêts,ce qui peut avoir de graves conséquences (pertes de biodiversité,baisse de la production de bois, changement climatique,etc.).Selon les estimations de la FAO,seulement 11% des sols (1'630 mio.d’ha) se prête à une agriculture intensive.
De 1900 à 1980,les terres ouvertes ont été continuellement étendues et surtout soustraites à la forêt.Depuis,elles sont restées plus ou moins inchangées.L’extension des terres agricoles se heurte en effet à des limites.Au contraire,la population mondiale a augmenté,passant de 1,6 milliard de personnes en 1900 à 6,4 milliards en 2000,et elle continue de s’accroître.Il en résulte une diminution sensible de la surface de terres ouvertes par habitant;celle-ci a ainsi passé de 0,5 ha en 1900 à 0,23 ha en l’an 2000.On estime qu’en 2100,la population mondiale aura atteint quelque 10 milliards de personnes.La part de terres ouvertes par habitant est donc en constante diminution.
Il s’y ajoute que les surfaces limitées de bonnes terres se détériorent pour diverses raisons.Environ 15% de la surface terrestre (22 mio.de km2) sont aujourd’hui qualifiés de dégradés.Sur le plan mondial,l’érosion par l’eau est le principal facteur de dégradation des sols,suivie des polluants,de l’érosion éolienne,du compactage et de la salinisation.
Population mondiale (milliards d'hab.) Terres ouvertes (milliards d'ha) Terres ouvertes par habitant dans le monde 190019201940196019802000 Terres ouvertes (ha / hab.) Source: FAO 0 7 6 5 3 4 2 1 milliards d'ha / milliards d'hab. ha / hab. 0 0,6 0,4 0,5 0,3 0,2 0,1 1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE 1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 101
■ En Suisse,les sols se prêtant à la culture des champs sont particulièrement rares
Environ 10% de la surface totale de la Suisse de quelque 41'000 km2 se prêtent à la culture des champs.D’après la statistique de la superficie,ces surfaces comprennent les prairies et les terres assolées facilement exploitables,les autres prairies et terres assolées ainsi que les pâturages attenants à la ferme;elles sont situées à une altitude inférieure à 900 m et leur déclivité est inférieure à 20%.Ces sols précieux du point de vue agronomique sont particulièrement rares et,qui plus est,soumis à une forte pression.La surface affectée à l’urbanisation et aux transports représente d’ores et déjà environ 7% de la surface totale de la Suisse;elle continue de croître,en partie au détriment des terres cultivables.L’obligation de remplacer les défrichements inscrite dans la loi sur les forêts et l’espace nécessaire aux cours d’eau peuvent aussi contribuer à la diminution des terres cultivables.
La surface de terres se prêtant à la culture des champs,soit la base de notre alimentation,s’est rétrécie de 10’352 ha entre 1979/85 et 1992/97.Il n’existe pas de données plus récentes.Pendant cette période,le nombre d’habitants en Suisse a augmenté. Nous disposons à cet égard de données pour 2005.La part desdites surfaces par habitant a ainsi été calculée à l’aide des données de 1992/97 en ce qui concerne les premières et du nombre d’habitants actuel.Elle représente aujourd’hui 6,5 ares en Suisse,en comparaison de 23 ares au niveau mondial.La surface effective est probablement un peu plus restreinte compte tenu de l’activité de construction incessante.

Habitants (mio.) Sols arables (mio. x 10 a)
1979/851992/972005 Sols arables (a / hab.) Source: OFS 0 8 7 6 3 4 5 2 1 mio. d'hab. / mio. x 10 a a / hab. 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 102
Terres arables par habitant en Suisse
■ Surfaces d’assolement comme protection des sols de bonne qualité agronomique
Depuis l’entrée en vigueur de la loi sur l’aménagement du territoire,en juin 1979,la protection des meilleures terres cultivables est un élément-clé de la politique suisse dans ce domaine.Pour mieux protéger ces terres,le Conseil fédéral a adopté le 9 avril 1992 un plan sectoriel des surfaces d'assolement (SDA).Ce plan fixe l’étendue minimale des SDA (total:438'560 ha) et les parts cantonales.Il oblige les cantons à prendre les mesures nécessaires à la protection de la part qui leur est attribuée.Par SDA,on entend les terres cultivables (y compris les prairies naturelles arables) et donc une partie seulement de la SAU.Lors du réexamen du plan sectoriel de 2003,on a constaté que la superficie minimale de SDA existait toujours pour l’ensemble de la Suisse,mais que les réserves avaient sensiblement diminué.Dans certains cantons,la superficie minimale n’a pas été maintenue.Un aide-mémoire visant à améliorer l’application du plan sectoriel a dès lors été élaboré.Lors du classement de bien-fonds dans une zone ou lors de projets de construction impliquant des SDA,il y a toujours lieu de considérer les intérêts en jeu de part et d’autre et de pondérer le plan sectoriel comme projet d’intérêt national.
Les SDA sont surtout situées sur le Plateau suisse,où la pression exercée par l’urbanisation est particulièrement forte.Dans l’espace alpin,la part de SDA à la SAU est modeste.
■ Changements permanents dans l’utilisation du sol
Les changements permanents dans l’utilisation du sol modifient aussi le paysage en Suisse,lentement mais visiblement.Conformément à la statistique de la superficie,les surfaces agricoles dans la région d’habitat permanent ont diminué de 30'300 ha (–3,0%) entre 1979/85 et 1992/97,une évolution presque exclusivement imputable à l’extension des surfaces urbanisées.Les surfaces d’estivage ont elles aussi régressé de 17’900 ha (–3,2%).Environ 80% de cette régression s’expliquent pas l’extension de surfaces boisées (forêt,broussaille).Globalement,la surface exploitée à des fins agricoles a diminué de 48’200 ha (–3,1%).
On observe aussi de grands changements en ce qui concerne l’utilisation de la SAU. Pendant la période sous revue,la surface plantée d’arbres fruitiers haute-tige,par exemple,a diminué de plus d’un quart,surtout en raison de l’urbanisation.Au contraire, les cultures spéciales à forte valeur ajoutée,telles que l’horticulture et la viticulture,ont nettement augmenté.
La progression de l’urbanisation et la pression sur les meilleures terres cultivables ne s’affaiblissent pas.La statistique de la superficie montre que par habitant,quelque 400 m2 de sol servent aujourd’hui à des fins d’urbanisation.En l’espace de 12 ans (de 1979/85 à 1992/97),l’agriculture a perdu 482 km2 de terres cultivables,ce qui correspond à la surface du canton d’Obwald.Et elle continue d’en perdre 11 ha tous les jours.Etant donné que la surface forestière est protégée par la loi et que ni les surfaces improductives ni les cours et les plans d’eau ne changent,les pertes de surfaces touchent presque exclusivement la SAU.
1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE 1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 103
■ La qualité des sols doit être préservée
La préservation d’une bonne qualité des sols ne va pas de soi.L’activité agricole et d’autres facteurs peuvent entraîner une considérable détérioration de cette qualité (Concept du sol de l’OFAG,Rapport agricole 2002,p.113 ss).Un mode d’exploitation approprié offre toutefois de grandes chances de régénération.Mais la perte de sol par érosion,notamment,ainsi que le compactage du sous-sol et l’apport de polluants organiques et de métaux lourds difficilement dégradables occasionnent des dégâts pratiquement irréversibles.Il faut les éviter car sinon,les sols ne peuvent plus remplir de manière satisfaisante leurs fonctions consistant à filtrer l’eau pour qu’elle soit potable,ainsi qu’à réguler le régime hydrique régional et l’évolution climatique (fixation de carbone).
Afin de pouvoir évaluer la qualité du sol au fil du temps,l’OFAG a décidé de définir des indicateurs et de procéder à un suivi.Il prévoit d’appliquer les indicateurs suivants: risque d’érosion,teneur en métaux lourds et en polluants organiques persistants et biomasse microbienne dans les sols.Seul l’indicateur «teneur en métaux lourds dans les sols» est pour l’instant applicable et saisi systématiquement (NABO).Des données de base doivent encore être élaborées pour les autres.Pour l’heure,l’évolution est donc suivie à l’aide de chiffres-clés plus ou moins fiables.
■ En Suisse,l’érosion est relativement faible
Malgré le fort potentiel d’érosion en raison des précipitations et de la déclivité des terres,les phénomènes d’érosion prononcés des terres agricoles sont,en Suisse,relativement rares en comparaison internationale.Les sols y sont en général utilisés de manière appropriée (forêt,herbages,assolements avec prairies artificielles,petites parcelles,etc.).Cela n’empêche toutefois pas entièrement l’érosion.Comme la formation annuelle moyenne de sol,soit une tonne par ha,est minime,sa profondeur risque de diminuer à certains endroits.
Erosion des terres ouvertes en Suisse
DescriptionPertes de sol
Valeur indicative 1 (sol avec une profondeur de 70 cm ou moins)2
Valeur indicative 1 (sol avec une profondeur de plus de 70 cm)4
Formation moyenne de sol1
Phénomènes d’érosion fréquents1–2
Phénomènes d’érosion locaux dans certaines années6–10
Phénomènes d’érosion raresjusqu’à 55
1Valeurs indicatives prévues dans l’ordonnance sur les atteintes portées au sol (OSol);lorsqu’elles sont dépassées, les cantons déterminent les causes et prennent des mesures.
Source:Société suisse de pédologie
t/ha/an
1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 104
■ Le risque d’érosion du sol varie fortement selon la région
Le risque local dépend de la sensibilité naturelle d’un sol à l’érosion,de la déclivité du terrain et de la force d’érosion régionale des précipitations.Même si l’agriculture ne peut guère influer sur ces facteurs,il convient d’en tenir compte dans l’exploitation. Agroscope Reckenholz-Tänikon ART établit actuellement,en collaboration avec l’université de Berne (CDE),une carte digitale des risques d’érosion à l’échelle de l’hectare en Suisse.
A cet effet,ART a tout d’abord évalué la sensibilité naturelle des sols à l’érosion,qui est notamment déterminée par la composition granulométrique,la pierrosité,la teneur en humus et la perméabilité.Le lœss limoneux,fortement menacé,est rare en Suisse; il n’existe qu’au nord du pays et ne représente que 1% de la surface totale.Par contre, au centre du Plateau suisse,ainsi que dans diverses vallées fluviales,on trouve des dépôts molassiques et des alluvions de grès,également menacés.Il s’agit d’environ 3% de la surface.Les sols à l’ouest du Plateau suisse,soit quelque 25% de la surface, sont considérés comme moyennement menacés d’érosion.La plupart des sols de l’est du Plateau et du Jura,environ 31% de la surface,ne présentent quant à eux qu’un faible risque d’érosion.Il en va de même des sols des Alpes (la déclivité et la force d’érosion régionale des précipitations n’étant pas prises en compte).
■ L’exploitation du sol influe fortement sur le risque d’érosion
L’agriculture peut considérablement réduire le risque d’érosion en adoptant un mode d’exploitation approprié.La grandeur des champs,par exemple,en particulier leur longueur,influe sur le risque d’érosion.Celui-ci peut aussi être atténué par des améliorations structurelles:ouvrages et chemins construits parallèlement à la pente et écoulement optimal de l’eau.Une bonne couverture du sol (largement déterminée par le choix des cultures) et des techniques d’exploitation ménageant le sol sont cependant les mesures les plus importantes.Un sol couvert de végétation est bien protégé contre la battance,le compactage et l’érosion;il est biologiquement actif et garde l’eau.Or, en culture des champs,le travail du sol est indispensable.Intensif,il facilite la maîtrise des mauvaises herbes et la préparation de l’ensemencement,tandis que le sol se rapproche de l’état idéal lorsqu’il est faiblement travaillé.L’influence du mode d’exploitation (couverture et travail du sol) sur le risque d’érosion est apprécié à l’aide du facteur C,qui indique la différence des pertes de sol,entre un certain type d’exploitation et une jachère nue,le relief et le type de sol n’étant pas considérés.Une valeur élevée signifie un grand risque d’érosion.
Dans le District des Lacs,la Vallée du Rhône près du Lac Léman,l’Unterland zurichois, ainsi que dans les vallées de l’Orbe et de la Broye,la culture maraîchère et les cultures sarclées sont très répandues.Ce mode d’exploitation renferme un assez grand risque d’érosion.En raison de la part importante de prairies artificielles,l’exploitation pratiquée dans les Préalpes et dans le Jura ne pose en revanche pas de problèmes.
1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE 1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 105
■ Le choix des cultures a atténué le risque d’érosion
Calculée au niveau communal et pondérée en fonction de la surface (sans prise en compte du travail du sol),la moyenne des facteurs C concernant les terres ouvertes a augmenté d’environ 11% de 1985 à 1990,pour ensuite diminuer constamment jusqu’en 2003,où la valeur de 1985 était de nouveau atteinte.Cette évolution s’explique par l’augmentation de la surface de terres ouvertes et la diminution simultanée des prairies artificielles jusqu’en 1990,et par un renversement de la tendance à ce moment-là.
Evolution des facteurs C en fonction du choix des cultures
= 100%
Source: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
■ Evolution régionale des terres ouvertes et des facteurs C
Evolution
des
facteurs C dans diverses régions
Source: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
Dans les cantons BE,SH et VD,les terres ouvertes ont augmenté alors que la surface de prairies artificielles a régressé;on y a par conséquent enregistré une hausse du facteur C.Il n’y a guère eu de changements dans les cantons SO,FR,ZH,TG et AG.Dans les autres cantons,le facteur C a baissé,car la part de prairies artificielles s’est nettement accrue,alors que les terres ouvertes ont régressé.C’est aussi dans ce groupe que les facteurs C sont actuellement les plus bas en termes absolus.Les cantons de la Suisse centrale,qui ne comptent que très peu de terres ouvertes,n’ont pas été pris en considération.
Indice:
1985
1985199019961998200020032004 94 112 108 110 106 104 102 100 98 96
1985199019961998200220032004
60 120 110 100 90 80 70 Indice: 1985 = 100%
1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 106
BE, SH, VD SO, FR, ZH, TG, AG ZG, SG, GR, TI, JU, NE, VS, BL, LU, GE
■ Utilisation plus fréquente de techniques d’exploitation préservant le sol
L’évolution est également positive en ce qui concerne la deuxième possibilité des agriculteurs d’atténuer le risque d’érosion.Dans toute la Suisse,on observe une tendance à utiliser des techniques d’exploitation préservant le sol.Grâce au progrès technique, les agriculteurs disposent aujourd’hui d’appareils pour un travail conservateur du sol ou de combinaisons d’appareils qui réduisent le nombre de passages et offrent par ailleurs l’avantage d’une économie de temps et d’énergie.Dans la première moitié des années 90,la préparation des semis se faisait presque exclusivement par le labour. Depuis,le travail conservateur du sol s’est propagé (semis direct,sous litière et en bandes fraisées).Ces méthodes augmentent la couverture du sol et sont considérées comme des mesures de protection contre l’érosion particulièrement efficaces.Plusieurs cantons les encouragent par des programmes spéciaux.
Le semis direct,le travail du sol sans labour le plus répandu,a été pratiqué sur presque 12'000 ha en 2004,contre 60 ha en 1992.Cela ne représente néanmoins qu’environ 3% de la surface totale de terres ouvertes en Suisse.
Des métaux lourds parviennent dans les sols surtout par les retombées atmosphériques (gaz d’échappement,abrasion) et par l’activité agricole.Alors que les retombées atmosphériques se répartissent sur tous les sols de la Suisse,les apports dus à l’activité agricole se limitent évidemment aux sols agricoles.L’évolution a été calculée à l’aide d’indications (lacunaires) sur les teneurs et les quantités de substances utilisées.Des données publiées étaient également disponibles.Il ressort des calculs que les apports de métaux lourds provenant de toutes les sources ont nettement diminué de 1989 à 2004,comme le montrent les exemples du cadmium et du cuivre.
Evolution
surfaces
en ha Source: no-till.ch 1992199319941995199619971998199920002001 0 14000 12000 6000 4000 10000 8000 2000 20042005 2003 2002 ■ L’apport de métaux lourds diminue 1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE 1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 107
des
de semis direct en Suisse
Pendant toute la période de 1989 à 2004,les retombées atmosphériques ont été la source majeure des apports de cadmium,mais ceux-ci ont diminué de deux tiers.Les apports dus aux engrais minéraux,qui occupent la deuxième place,ont eux aussi baissé et représentent moins d’un tiers.Les autres sources d’apports sont moins importantes.En ce qui concerne les boues d’épuration,les apports ont reculé à moins d’un sixième de la quantité initiale,surtout parce que leur utilisation a fortement diminué, alors que pour la raison inverse,les apports par le compost ont doublé.Aucun changement majeur n’est observé pour ce qui est des engrais de ferme.
Evolution des apports de cadmium dans le sol 1989199419992004 en kg Cd Source: OFAG 0 2000 1800 1600 1200 1400 800 1000 600 200 400 Boues d'épuration Compost Engrais de ferme Engrais minéraux Air Evolution des apports de cuivre dans le sol 1989199419992004 en t Cu Source: OFAG 0 120 100 80 60 40 20 Boues d'épuration Compost Engrais de ferme Engrais minéraux Produits phytosanitaires 1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 108
Les engrais de ferme sont la source principale des apports de cuivre.Ce métal circule,dans l’exploitation,entre le sol,les plantes et les déjections des animaux et n’entraîne ainsi pas d’enrichissement du sol en cuivre.Environ 50% des apports dans les engrais de ferme proviennent des additifs contenus dans les aliments pour animaux.On n’observe qu’une légère diminution des apports par le biais des engrais de ferme.Les pesticides sont la deuxième source d’apports de cuivre.Ces apports ont beaucoup diminué surtout depuis 1999.Quant aux retombées atmosphériques,nous ne disposons de données que pour 1996.Elles apportent quelque 40 t de cuivre et occupent le troisième rang,suivies des boues d’épuration.Pour les raisons évoquées ci-dessus,ces dernières ont perdu de l’importance au cours des ans,tandis que les apports attribuables au compost ont au contraire augmenté.Les engrais minéraux ne causent pas d’apports de cuivre notables.
Les apports des métaux lourds considérés ont reculé de manière générale.Des mesures de protection de l’air,comme l’interdiction de l’essence plombée,l’interdiction d’utiliser les boues d’épuration pour la fumure (2006),ainsi que l’utilisation plus modérée d’engrais phosphatés ont notamment contribué à ce recul.Celui-ci n’équivaut toutefois pas à une amélioration de la qualité des sols.Tant que les apports de métaux lourds sont plus élevés que les sorties (par le biais des plantes,du lessivage et de l’érosion),la charge augmente,bien que plus lentement.

1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 109
■ Les métaux lourds s’accumulent encore dans beaucoup d’exploitations
L’accumulation de métaux lourds dans les sols agricoles est généralement un processus sournois difficile à saisir.Pour obtenir des indications à temps,les bilans de Cd,Zn,Pb et Cu sont établis annuellement depuis 1996 pour 48 parcelles agricoles dans le cadre du réseau NABO,en sus des mesurages usuels.Le graphique ci-après montre le bilan du zinc des années 1996 à 2003 à titre d’exemple.
Evolution du bilan en zinc (48 parcelles agricoles1)
ExtrantsIntrants
Cultures
–800 –800–400–4000400
1 Parcelles NABO, années 1996 à 2003, selon les types d'exploitation
Source: NABO 2005
en g / ha et an 12001600 8002000
Flux net = Bilan Récolte Dépositions Pesticides spéciales <0,2 UGB/ha Grandes cultures <0,2 UGB/ha lait/mixte 0,5–1,1 UGB/ha mixte/hors sol 1,4–1,9 UGB/ha hors sol 2,2–2,8 UGB/ha
Engrais de ferme Engrais minéraux Boues d'épuration 1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 110
■ Les apports actuels de métaux lourds poseront problème à long terme
Dans pratiquement toutes les exploitations examinées,les apports de zinc dépassent les sorties.Il existe cependant de grandes différences entre les types d’exploitations. Les exploitations de production hors sol présentent en moyenne les excédents les plus élevés,suivies des exploitations du type mixte/hors sol,tandis que dans les exploitations de grandes cultures et de cultures spéciales,le bilan est peu excédentaire,voire négatif.Les apports de zinc et de cuivre dépendent essentiellement du nombre d’animaux détenus par les exploitations.Ces deux substances sont en effet des macroéléments importants contenus dans les additifs pour les aliments pour animaux.
Pour apprécier l’importance écologique des apports de métaux lourds dans les exploitations agricoles,il convient de les comparer avec les valeurs indicatives fixées pour chacun d’eux.
Sur la plupart des 48 parcelles en question,les apports et les sorties étaient assez équilibrées.Les concentrations de métaux lourds dans le sol augmentent,au cours d’un siècle,de moins de 1% des valeurs indicatives respectives.Une augmentation de la concentration supérieure à 1% a,par contre,été pronostiquée pour le cadmium sur sept des 48 parcelles NABO,pour le cuivre sur dix parcelles et pour le zinc sur 20 parcelles.Des apports très élevés de zinc,par le biais des engrais de ferme,et de cuivre,par le biais des produits phytosanitaires ou des engrais de ferme,ont été observés sur plusieurs parcelles.Selon les estimations,la teneur en métaux lourds peut augmenter de jusqu’à 5% de la valeur indicative en ce qui concerne le cuivre et le zinc dans la garde d’animaux intensive,et même de 21% s’agissant du cuivre en viticulture.
■ Des polluants organiques parviennent également dans les sols
Le nombre de métaux lourds est limité;il y en a 63.Par contre,il existe quelque 100'000 composés organiques,dont un nombre inconnu peut porter atteinte à la fertilité du sol.Cependant,contrairement aux métaux lourds,ces composés sont dégradables.Seuls ceux d’entre eux qui se dégradent très lentement (après des années ou des siècles) comptent donc du point de vue écologique,car ils peuvent s’accumuler dans le sol et potentiellement aussi dans les cycles de substances.
Les dioxines et les furanes (PCDD/F) sont particulièrement problématiques.Il s’agit de polluants organiques chlorés très stables,dont beaucoup sont extrêmement toxiques et s’accumulent dans le sol.Ce sont des sous-produits de nombreux processus thermiques,en particulier de l’incinération des déchets.De 1950 à 1980,les retombées atmosphériques de dioxine en Suisse (de loin les émissions les plus importantes) ont augmenté,passant de <50 à >450 g I-TEQ (équivalents de toxicité internationaux permettant de comparer différents PCDD/F).Depuis,ces émissions ont fortement diminué et sont aujourd’hui bien inférieures à 100 g I-TEQ.Il reste principalement, comme source d’émission,l’incinération non contrôlée de déchets dans les ménages et sur les chantiers de construction.L’agriculture ne contribue pratiquement pas à ces émissions,mais elle les subit.
1.BEDEUTUNGUNDLAGEDERLANDWIRTSCHAFT 1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 111
■ Les teneurs en dioxine et en furane des sols agricoles ne posent généralement pas de problèmes
Depuis 1998,il existe en Suisse des valeurs seuils légales concernant la teneur des sols en dioxine et en furane.Si la valeur indicative de 5 ng I-TEQ/kg est dépassée,la fertilité du sol n’est plus garantie à long terme;une surveillance est alors obligatoire.En cas de dépassement du seuil de 20 ng I-TEQ/kg,il faut vérifier si la fertilité du sol est concrètement menacée et prendre des mesures,telles que des restrictions d’utilisation, s’il y a lieu.Les sols doivent absolument être assainis,quelque soit leur utilisation,si le seuil de 1'000 ng I-TEQ/kg est dépassé.
Des résultats d’analyses PCDD/F de sols effectuées dans les cantons sont disponibles. Toutefois,comme les analyses concernent surtout des endroits pollués,ils ne reflètent pas les teneurs dans des conditions normales.Mais ils montrent néanmoins qu’en moyenne,les teneurs des sols agricoles ne sont pas problématiques eu égard aux valeurs indicatives.Des valeurs critiques ponctuelles ne sont cependant pas exclues. Dans ce cas,le canton compétent doit en rechercher les causes et ordonner les mesures qui s’imposent (p.ex.restrictions d’utilisation).
Teneurs en dioxine et en furane des couches superficielles du sol
Source:NABO 2001
On trouve plus souvent des teneurs PCDD/F élevées dans les sols des sites forestiers, parce que les arbres extraient ces substances de l’air.En 2002,dans le cadre du réseau NABO,des échantillons ont été prélevés,jusqu’à une profondeur de 10 cm,à 23 des 105 endroits observés;ils ont été analysés quant à leur teneur en dioxine et en furane, afin de documenter la pollution «normale» des sols en Suisse.Conformément aux résultats,la valeur indicative n’a été dépassée dans aucun des sites agricoles.Un dépassement a par contre été constaté pour 4 des 11 sites forestiers.
1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 112
Utilisationmin.médianemax. ng I-TEQ/kg 1 Nombre de valeurs Culture des champs0,71,134,241 Prairies permanentes0,51,9179,556
1Par ng I-TEQ,on entend un nanogramme d’équivalents de toxicité international (unité qui permet d’apprécier la toxicité de mélanges de dioxine et de furane)
Tableaux 37–38,pages A42–A43
1.3.2Ethologie
Participation aux programmes de garde d’animaux SRPA et SST
Par le biais des paiements directs qu’elle verse aux agriculteurs,la Confédération encourage la garde d'animaux de rente particulièrement respectueuse de l'espèce au travers de deux programmes éthologiques:«Sorties régulières en plein air» (SRPA) et «Systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux» (SST).Le programme SRPA est essentiellement axé sur les sorties au pâturage,au parcours ou,pour la volaille,dans l’aire à climat extérieur.Le programme SST,quant à lui,pose surtout des exigences qualitatives,notamment pour les locaux de stabulation à aires multiples qui offrent une liberté de mouvement aux animaux.La participation à ces programmes est cependant facultative.Les pourcentages indiqués ci-après se réfèrent à l’ensemble des exploitations recevant des paiements directs et à l’ensemble des animaux de rente gardés dans celles-ci.
Depuis leur instauration en 1993 (SRPA) et en 1996 (SST),la participation à ces programmes de garde a régulièrement progressé.Ainsi,en 2005,quelque 37'700 exploitations adhéraient au programme SRPA et 17'800 exploitations au programme SST.
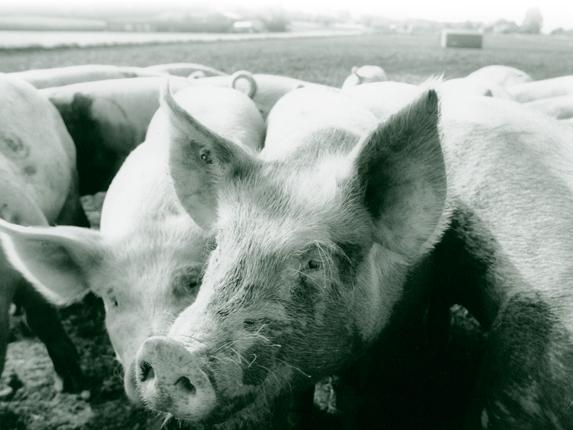
■■■■■■■■■■■■■■■■
1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 113
Evolution de la participation aux programmes SRPA et SST
Entre 1996 et 2005,le pourcentage d’animaux de rente gardés selon les exigences SRPA a passé de 19 à 69%.Au cours de la même période,cette part a progressé de 9 à 38% pour le programme SST.Il s'agit de valeurs moyennes englobant les quatre catégories d'animaux concernées (bovins,autres herbivores,porcs et volaille).
Evolution de la participation au programme SRPA, par
Si l’on différencie la participation au programme SRPA par groupe d’animaux de rente, on constate que la part des bovins et des autres herbivores a fortement augmenté entre 1996 et 2005,passant de quelque 20% à environ 70% et 80%,respectivement.En ce qui concerne les porcs,la participation a bondi,passant d’à peine 5% à près de 60%. Cette participation légèrement moindre dans le cas des porcs par rapport aux bovins s’explique par le fait qu’elle requiert des investissement plus importants.
Part d'UGB en % SRPA SST Source: OFAG 1996199719981999 0 60 70 80 50 40 30 20 10 2000 2001 200220032004 2005
groupe d'animaux Part d'UGB en % Source: OFAG Bovins Autres herbivores PorcsVolaille 199619971998199920012002 2000 0 70 80 90 50 60 40 30 20 10 20032004 2005 1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 114
Quant à la volaille de rente,la participation aux programmes a évolué de façon très différente selon qu’il s’agit de poules pondeuses ou de poulets de chair.Alors que le taux de participation pour les poules pondeuses a toujours augmenté jusqu’en 2005 (63% en 2005),il a cessé de croître en 1999 pour les poulets de chair en s’établissant à 42%.Depuis lors,ce taux a sans cesse reculé pour tomber à 9% en 2005.Cette évolution est imputable à la durée minimale d’engraissement qui a été fixée à 56 jours pour les poulets.Nettement plus longue que celle en vigueur dans le mode de production classique,cette durée d’engraissement a eu pour effet d’augmenter considérablement les frais de production et,partant,le prix sur le marché.La demande en poulets SRPA a reculé en conséquence.
Si l’on différencie la participation au programme SST par groupe d’animaux de rente, on constate que la part des bovins et des autres herbivores a augmenté dans une proportion nettement moindre entre 1996 et 2005 par rapport au programme SRPA, passant d’environ 10% à quelque 30%.Ceci est principalement dû au fait que les investissements sont la plupart du temps très élevés (local à stabulation libre) si bien qu’ils ne sont généralement opérés qu’en cas de nécessité.
Pour ce qui est des porcs,le programme SST n’a été introduit qu’en 1997.La participation des exploitations a évolué de manière similaire à celle au programme SRPA pour la bonne raison que les principaux labels dans la branche porcine exigent des exploitants qu’ils adhèrent aux programmes SRPA et SST.
L’évolution extrêmement rapide de la participation au programme SST pour la volaille est en grande partie attribuable au succès commercial des labels qui prônent les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des poules pondeuses et des poulets de chair.

Part d'UGB en %
Bovins Autres herbivores PorcsVolaille 199619971998199920012002200320042005 2000 0 80 90 50 60 70 40 30 20 10 1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE 115
Evolution de la participation au programme SST, par groupe d'animaux
Source: OFAG
1 116

■■■■■■■■■■■■■■■■ 2.Mesures de politique agricole 117 2
On a rangé les mesures de politique agricole dans trois domaines:
– Production et ventes: les mesures prises dans ce domaine visent à créer les conditions-cadres appropriées pour la production et l’écoulement des denrées alimentaires.Les dépenses consenties par la Confédération pour la production et les ventes de produits agricoles diminuent continuellement.En 2005,elle y a affecté un montant de 677 millions de francs,soit plus d’un milliard de moins qu’avant le début de la réforme agricole dans les années 1990/92.
– Paiements directs: ces paiements sont considérés comme une rétribution des prestations en faveur de la collectivité,au rang desquelles figurent l’entretien du paysage,la sauvegarde des bases naturelles de l’existence,la contribution à une occupation décentralisée du territoire ainsi que des prestations écologiques particulières.Les prix payés pour les denrées alimentaires ne comprennent pas ces prestations car le marché correspondant est inexistant.Par le biais des paiements directs, l’Etat s’assure le concours de l’agriculture pour fournir des prestations d’intérêt général.
– Amélioration des bases de production: il s’agit de mesures permettant à la Confédération de promouvoir et de soutenir une production de denrées alimentaires respectueuse de l’environnement,sûre et efficiente.Elles concernent l’amélioration des structures,les domaines de la recherche et de la vulgarisation,ainsi que ceux des matières auxiliaires et de la protection des végétaux et des variétés.
118 2.MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE 2
■ Moyens financiers en 2005
2.1 Production et ventes
Conformément à l’art.7 LAgr,qui fixe les objectifs relatifs à la production et à la vente de produits agricoles,l’agriculture doit être en mesure d’assurer une production durable et peu coûteuse ainsi que de tirer des recettes aussi élevées que possible de la vente des produits.Pour qu’elle en ait les moyens,la Confédération peut prendre des mesures dans les domaines qualité,promotion des ventes et désignation,importation et exportation,économie laitière,production animale,production végétale et économie viti-vinicole.

En 2005,677 millions de francs ont été consacrés à la promotion de la production et des ventes.Par rapport à l’année précédente,cela représente une diminution des dépenses de 54 millions de francs,soit de 7,4%.
Dépenses pour la production et les ventes
■ Perspectives
Il faut s’attendre en 2007 à de nouvelles coupes budgétaires suite aux blocages de crédit de 1%.
■■■■■■■■■■■■■■■■
Comptes 2005Budget 2006 Poste de dépensesMontantPartMontantPart mio.de fr.%mio.de fr.% Promotion des ventes578,4558,6 Economie laitière4747044369,2 Economie animale213,1243,8 Production végétale (viticulture comprise)12518,511818,4 Total677100640100 Sources:Compte d’Etat,OFAG
2.1 PRODUCTION ET VENTES 119 2
Tableaux 26–29,pages A27–A30
■ Favoriser le regroupement des forces dans le secteur agricole
2.1.1 Instruments transversaux
Interprofessions et organisations de producteurs
La loi fédérale sur l’agriculture (art.8 et 9) permet au Conseil fédéral de rendre obligatoires,pour les non-membres,certaines décisions des interprofessions et des organisations de producteurs concernant des mesures collectives liées à l’amélioration de la qualité,à la promotion des ventes et à l’adaptation de l’offre à la demande.On parle alors «d’extension des mesures d’entraide».Le soutien du Conseil fédéral se justifie pour des mesures bénéficiant à l’ensemble d’un secteur ou d’une filière,et donc pas aux seuls membres de l’organisation (problème des profiteurs ou «passagers clandestins»).Sans cette intervention,les entreprises qui ne participent pas aux mesures mais en profitent néanmoins compromettraient rapidement toute initiative collective.Par son action subsidiaire,le Conseil fédéral encourage le regroupement des forces.Les interprofessions sont également autorisées à publier des prix indicatifs,sous certaines conditions (art.8a LAgr).Ces instruments renforcent la position des producteurs dans la définition des produits et les négociations commerciales.
■ Une première jurisprudence du Tribunal fédéral
Les premières décisions d’extension de mesures collectives ont été prises par le Conseil fédéral en 2001.Les expériences faites depuis sont positives de manière générale.La cohésion des filières soutenues par le Conseil fédéral s’est renforcée grâce à la maîtrise efficace du problème des «passagers clandestins».Les organisations doivent cependant compter avec les possibilités de recours offertes aux entreprises qui refusent de se soumettre aux mesures collectives.L’exécution des mesures par ces entreprises risque effectivement d’être retardée.En mars 2006,le Tribunal fédéral s’est prononcé pour la première fois sur la mise en œuvre de cet instrument par le Conseil fédéral.Il a soutenu sans réserve l’ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, ainsi que la décision d’extension du Conseil fédéral concernant une contribution destinée à financer la promotion de l’Emmentaler.Cette jurisprudence devrait désormais accélérer la mise en œuvre des décisions du Conseil fédéral.
Le Conseil fédéral a décidé le 23 novembre 2005 d’étendre,pour deux ans,aux nonmembres les mesures d’entraide de trois organisations de producteurs (Union suisse des paysans,Producteurs suisses de lait,GalloSuisse) et de quatre interprofessions (Interprofession du Gruyère,Interprofession du Vacherin fribourgeois,Emmentaler Switzerland,Sbrinz GmbH).
■■■■■■■■■■■■■■■■
2.1 PRODUCTION ET VENTES 2 120
■ Des adaptations proposées par le Conseil fédéral dans la PA 2011
Dans son message sur la PA 2011,le Conseil fédéral propose au Parlement d’assurer la continuité du soutien accordé pour les mesures de promotion des ventes et d’amélioration de la qualité.En effet,le Conseil fédéral a étendu plusieurs fois aux nonmembres des décisions prises par des organisations dans ces deux domaines.Il s’est avéré dans la pratique que ces mesures exigent de la continuité.Contrairement à d’autres pays,comme l’Allemagne ou l’Autriche,la Confédération ne fixe pas de sa propre initiative le montant que les producteurs doivent verser à la promotion des ventes.En Suisse,les producteurs et les entreprises des filières agroalimentaires décident des montants qu’ils veulent affecter à cette mesure.La Confédération intervient ensuite,à titre subsidiaire,pour résoudre le problème des «profiteurs».Les mesures de promotion des ventes et d’amélioration de la qualité nécessitent une certaine constance.C’est pourquoi le Conseil fédéral a déjà renouvelé son soutien à deux reprises. L’art.9 doit être modifié pour que les mesures puissent être reconduites après une vérification périodique.Comme aujourd’hui,les bénéficiaires devront adresser une nouvelle requête au Conseil fédéral dans ce sens.Le soutien des mesures concernant l’adaptation de l’offre aux besoins du marché devra au contraire conserver un caractère exceptionnel et se limiter à des situations extraordinaires ne résultant pas de problèmes structurels.

2.1 PRODUCTION ET VENTES 121 2
■ Commercialisation de produits régionaux
Promotion des ventes
Les initiatives en matière de marketing prises à l’échelle régionale qui,à la fin des années nonante,étaient encore très dispersées,sont désormais regroupées en réseaux interrégionaux dans la plupart des régions suisses.Pendant la phase initiale,durant laquelle la Confédération a accordé un soutien,plusieurs projets de promotion des ventes sont devenus des initiatives revêtant en partie une grande importance économique dans la région d’implantation,alors que d’autres n’ont pas atteint le seuil de rentabilité et ont de ce fait été abandonnés.
Aujourd’hui,la promotion des ventes de produits régionaux est presque entièrement gérée par le biais des réseaux interrégionaux,qui sont aussi les destinataires de l’aide fédérale.De nouvelles initiatives régionales peuvent s’associer à ces réseaux et profiter ainsi de leur savoir-faire.
Les produits dont l’origine régionale est garantie sont en vogue:une grande majorité des consommateurs salueraient l’introduction d’un label d’origine pour les produits agricoles suisses.C’est ce qui ressort d’un sondage représentatif mandaté par l’OFAG. 81% des interlocuteurs ont répondu affirmativement à la question:«Le cas échéant, feriez-vous aussi attention à l’indication de votre région comme origine?» Il existe donc une grande sensibilité en ce qui concerne les denrées alimentaires fabriquées localement.L’origine régionale influe favorablement sur les décisions d’achat,même si, comme on le sait,il y a une certaine divergence entre les affirmations des consommateurs et leurs décisions concrètes,qui dépendent beaucoup du prix.
Les responsables des projets et d’autres milieux intéressés ont élaboré,sous les auspices de l’OFAG,des exigences minimales nationales relevant du droit privé pour les marquesrégionales.Une grande partie des produits régionaux vendus dans le commerce et dans l’hôtellerie sont ainsi soumis aux mêmes exigences concernant la garantie de l’origine,les parts de matières premières devant provenir de la région,ainsi que l’assurance qualité et le contrôle.C’est d’ailleurs une condition importante pour renforcer la confiance des acheteurs dans ce segment du marché.

2.1 PRODUCTION ET VENTES 2 122
Tableau 26,page A27
■ Désignation de la volaille
Politique de la qualité et désignation
Quiconque achètera,à l’avenir,de la viande de poulet ou de dinde saura exactement comment la volaille a été élevée.Le Conseil fédéral a en effet mis en vigueur,au 1er janvier 2006,l’ordonnance sur la désignation de la volaille (ODVo).Celle-ci définit clairement les désignations de la viande de volaille issue de systèmes d’élevage respectueux des animaux,permettant ainsi de les protéger contre les abus et la concurrence déloyale.Les consommateurs peuvent désormais être sûrs que les produits munis d’une telle désignation répondent effectivement à leurs attentes en matière d’élevage respectueux des animaux.L’ODVo règle l’utilisation de ces désignations.Elle n’implique pas de modification majeure des dispositions actuelles sur la garde d’animaux,concernant les sorties régulières en plein air (SRPA) et les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux (SST).Les producteurs n’ont par conséquent pas à supporter de charge supplémentaire significative et l’application de l’ordonnance n’a ainsi pas présenté de difficultés particulières.L’UE a formellement reconnu l’équivalence des nouvelles dispositions au droit européen.La Suisse a ainsi rempli un engagement découlant des accords bilatéraux.
■ Etat du registre AOC/IGP
Trois demandes d’enregistrement d’une appellation d’origine contrôlée (AOC) ont été publiées en 2005.Il s’agit du Vacherin fribourgeois,de la Damassine et de la Poire à Botzi.Les trois demandes ont fait l’objet d’oppositions lors de la mise à l’enquête du cahier des charges.Seul le Vacherin fribourgeois a pu être enregistré en 2005,après le traitement des oppositions qui concernaient l’aire géographique,et plus particulièrement la demande d’y inclure les enclaves bernoises de Clavaleyres et de Münchenwiler. Une nouvelle demande d’enregistrement AOC a été adressée à l’OFAG cette année pour le Sauerkäse/Bloderkäse,et six autres dossiers sont en cours d’examen (2 AOC et 4 IGP).Des demandes concernant la modification des cahiers des charges ont également été déposées pour des produits déjà enregistrés,à savoir les AOC Vacherin Mont-d’Or et Berner Alpkäse,ainsi que les IGP Saucisson vaudois,Saucisse aux choux vaudoise,Saucisse neuchâteloise et Saucisson neuchâtelois.
S’agissant du dossier «Emmentaler»,la Commission de recours n’a pas reconnu la qualité pour recourir des entreprises étrangères étant donné qu’elles n’exercent pas d’activités économiques sur le territoire de la Confédération.Le dossier Raclette est en suspens auprès du Tribunal fédéral.
2.1 PRODUCTION ET VENTES 2.MESURESDEPOLITIQUEAGRICOLE 123 2
Registre des AOC-IGP au 31 décembre 2005
NombreNombrett
Fromages
L’EtivazAOC671354378OIC
GruyèreAOC3 10726728 00028 148OIC
SbrinzAOC224351 7501 314Procert
Tête de MoineAOC25891 6691 791OIC
Formaggio d’alpe TicineseAOC2727135135OIC
Vacherin Mont- d’OrAOC24211590555OIC
Berner AlpkäseAOC549151 0121 020OIC
Produits carnés
BündnerfleischIGP15950994Procert
Saucisse d’AjoieIGP105657OIC
Viande séchée du ValaisIGP27337396OIC
Saucisse neuchâteloise
Saucisson neuchâteloisIGP18123123OIC
Saucisson vaudoisIGP50620650OIC
Saucisse aux choux vaudoiseIGP44480450OIC
Spiritueux
Eau-de-vie de Poire du ValaisAOC3974 OIC
Abricotine
Autres produits
AOC1423OIC
Rheintaler RibelAOC412930Procert
Cardon épineux genevoisAOC517074Procert
Pain de seigle du ValaisAOC4565350480OIC
Munder SafranAOC150,0030,00091OIC
Source:OFAG
Dénomination Protection Exploitations agricoles Entreprises (transformation/ élaboration) Volume de production certifié en 2004 Volume de production certifié en 2005 Organisme de certification 95 792 litres d'alcool à 100% 98 824 litres d'alcool à 100% 28 756 litres d'alcool à 100% 32 981 litres d'alcool à 100% 2.1 PRODUCTION ET VENTES 2 124
■ Evolution au plan international dans le domaine des AOC/IGP
Le Conseil fédéral a confié à la délégation suisse un mandat de négociation avec la Commission européenne,en vue de la reconnaissance réciproque des registres AOC/IGP. La délégation européenne,quant à elle,attend encore un mandat de la part du Conseil des ministres.A ce jour,l’équivalence des législations suisse et communautaire a été constatée au niveau technique.Les résultats du panel OMC et notamment les discussions entre l’UE et USA/Australie ont modifié la position de la Commission sur certains aspects de la protection dans l’UE.Il a ainsi fallu modifier le règlement européen afin de le rendre conforme aux obligations OMC.C’est la raison pour laquelle la Communauté européenne a tardé à entrer en négociation avec la Suisse.
Dans le cadre des négociations à l’OMC,la Suisse entend toujours demander l’extension,à tous les produits,de la protection additionnelle accordée pour les vins et spiritueux (art.23 de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce,accord ADPIC).

2.1 PRODUCTION ET VENTES 125 2
■ Simplification des réglementations d’importation,des dédouanements et de l’administration des parts de contingents
Instruments du commerce extérieur
Dans certains domaines,les mesures tarifaires destinées à soutenir l’agriculture productrice ont encore été simplifiées et assouplies.Le contingent tarifaire de plants d'arbres fruitiers,par exemple,est réparti dans l’ordre des dédouanements depuis cette année.Dans ce système dit du fur et à mesure à la frontière,la déclaration douanière est considérée comme demande de part de contingent.Par ailleurs,la baisse des prixseuils des aliments pour animaux et celle du taux du contingent applicable aux céréales panifiables représentent également un assouplissement de la protection à la frontière.
Le rapport du Conseil fédéral du 15 février 2006 sur les mesures tarifaires contient une récapitulation détaillée de ces mesures et renseigne notamment sur l’attribution et l’utilisation des contingents tarifaires en 2005.Les documents pertinents sont dorénavant publiés uniquement sur Internet et peuvent être consultés sur la page d’accueil de l’OFAG,à la rubrique Importations et exportations.
■ Aménagement des instruments informatiques
Les nouveaux instruments informatiques facilitent la gestion des contingents par les importateurs et déchargent l’administration.Il s’agit en particulier du système e-dec réaménagé servant au dédouanement électronique,combiné avec le système e-quota qui permet de contrôler les parts de contingents disponibles,et de l’application Internet AEV14online.
Lors du dédouanement électronique avec e-dec,le système permet de contrôler,avant l’acceptation de la déclaration douanière,si les parts de contingents de produits agricoles encore disponibles suffisent.Ce contrôle s’effectue avec la nouvelle application informatique e-quota de l’Administration fédérale des douanes.Depuis début 2006,les dépassements de contingents et les importations sans part de contingent sont ainsi pratiquement exclus.Grâce à cette solution,l’OFAG peut par ailleurs renoncer aux contrôles après coup.Il n’aura plus non plus à recouvrer les droits de douane sur mandat de l’Administration fédérale des douanes,dès que les cas datant de 2005 seront réglés.Ces tâches ne devant plus être accomplies,il sera possible de faire des économies de personnel et,partant,de réduire progressivement les émoluments administratifs perçus pour les déclarations douanières.
L’application Internet AEV14online,quant à elle,permet d’enregistrer les ententes sur l’utilisation de parts de contingents tarifaires.L’OFAG la met à la disposition des détenteurs de parts de contingents depuis le 1er janvier 2006.Non seulement,cette application simplifie la transmission des droits d’utilisation,mais elle renseigne aussi les détenteurs de parts de contingents – de manière limitée et sans garantie – sur les parts attribuées et sur celles qui sont encore disponibles.Ce projet,mis sur pied dans les délais prévus,est très bien accueilli par les utilisateurs.En mars 2006,par exemple, toutes les ententes concernant les fruits frais,soit 80% du total de 1'900 ententes,ont été passées sur Internet.
2.1 PRODUCTION ET VENTES 2 126
Les mesures de protection à la frontière continuent d’être adaptées aux besoins.Des modifications sont ainsi proposées dans le cadre de la PA 2011 en ce qui concerne les critères à appliquer pour l’attribution des contingents tarifaires.La tendance consiste à adopter des procédures plus simples,mieux adaptées au marché,telles que le système du fur et à mesure et la mise aux enchères.Elle procède aussi de décisions concernant l’amélioration de l’accès au marché,prises dans l’OMC ou en rapport avec des accords bilatéraux de libre-échange,ainsi que de la franchise quasi-totale qui sera probablement accordée pour les importations provenant des pays en développement les moins avancés (PMA).Une clause de sauvegarde spéciale permet de restreindre les préférences douanières concédées aux PMA.
Le Protocole 2 de l’accord de libre-échange Suisse – CE de 1972 est entré en vigueur le 1er février 2005.Il étend le champ d’application de l’accord et prévoit un nouveau mécanisme de compensation des prix.
Conformément au Protocole 2,l’UE s’engage à réduire tous les droits de douane grevant les produits agricoles transformés exportés de Suisse vers l’UE;la Suisse,de son côté,s’engage à réduire fortement les droits de douane perçus sur les importations provenant de l’UE,voire à les supprimer en partie.
L’extension du champ d’application concerne essentiellement des produits faisant l’objet d’un libre-échange entre la Suisse et l’UE (tarif des douanes chapitre 5:peaux, cheveux,crins,etc.,chapitre 9:thé,café,épices,chapitre 20:confitures,chapitre 21: extraits de café et de thé,soupes,sauces,moutarde,levures,chapitre 22:bière,eau-devie de vin et eaux-de-vie de fruits,etc.),qui ne sont donc pas grevés de droits de douane à l’importation et pour lesquels il n’est pas non plus versé de contributions à l’exportation.
Importations et exportations de produits transformés Importations et exportations de produits agricoles transformés 1000 t ImportationsExportations Protocole 2 révisé Champ d'application étendu Sources: AFD, OFAG 2003 0 1000 1200 800 600 400 200 2004 2005 2.1 PRODUCTION ET VENTES 2.MESURESDEPOLITIQUEAGRICOLE 127 2
■ Perspectives ■
Grâce au nouveau mécanisme de compensation des prix,il a été possible de réduire les fonds nécessaires au financement des contributions à l’exportation,qui ont passé à 90 millions de francs,soit au niveau autorisé par le Parlement (crédits supplémentaires inclus).
En même temps,par la révision du Protocole 2,la solution dite double zéro a été introduite pour le sucre contenu dans des produits transformés.Le sucre servant de matière première à la transformation de produits agricoles est ainsi également devenu un produit de libre-échange.La solution double zéro implique cependant que les prix de cette matière première soient à peu près au même niveau dans l’UE et en Suisse.La nouvelle organisation du marché du sucre,préparée par l’UE dans l’année sous revue et adoptée en février 2006 par le Conseil des ministres,a entraîné une évolution différente des prix en Suisse et dans l’UE.Un groupe de travail comprenant des représentants des acteurs économiques concernés a élaboré une procédure permettant de fixer le droit de douane à percevoir sur les importations en Suisse de sorte que les prix suisses et européens soient ramenés environ au même niveau.L’industrie de transformation suisse a ainsi les mêmes chances que ses concurrents européens,tant sur le marché de l’UE que sur le marché intérieur.
L’aboutissement de négociations complémentaires avec l’UE offre par ailleurs à la Suisse la possibilité d’appliquer à nouveau des mesures de compensation des prix pour les boissons non-alcooliques à base de lait,qui avaient été incluses par erreur dans la liste de libre-échange.
Contributions à l'exportation mio. de fr. Sources: AFD, OFAG 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 180 115 115 1991/922003 115 20022004 90 2005 128 2.1 PRODUCTION ET VENTES 2
Mesures 2005/06
2.1.2Economie laitière
En 2005,les ventes de fromage ont progressé de manière réjouissante.La hausse enregistrée a atteint un peu plus de 2% aussi bien en Suisse qu’à l’étranger.Les ventes de produits laitiers frais,de crème de consommation et de yogourt ont de nouveau connu un développement positif,raison pour laquelle la production de beurre a légèrement régressé.Dans l’ensemble,la production de lait et de produits laitiers a vu sa valeur augmenter bien que les livraisons de lait aient légèrement fléchi par rapport à l’année précédente.
ProduitFromageBeurreLait écréméPoudre de laitLait de consommation, crème,produits à base de lait frais
1 seulement pour des utilisations particulières
2 uniquement en cas de renonciation aux importations
3 seulement pour les exportations dans les pays non-membres de l’UE et différenciées en fonction des sortes de formage
4 lait de consommation exclu
Source:OFAG
Par rapport à 2004,le prix moyen à la production a reculé de 2,2 centimes pour le lait,s’établissant à 72,4 ct./kg.Celui du lait bio a enregistré une baisse plus forte,de 3,6 ct./kg,et s’est élevé à 81,8 ct/kg.Les mesures de soutien,englobant le supplément pour le lait transformé en fromage et le supplément de non-ensilage,restent focalisées sur le fromage.

■■■■■■■■■■■■■■■■
Mesure Protection douanière ■■■■■ Suppléments ■ Aides accordées dans le pays ■ 1 ■ 1 ■ 2 Aides à l’exportation ■ 3 ■■ 4
2.1 PRODUCTION ET VENTES 129 2
■ Moyens financiers 2005 Répartition des fonds 2005
Les dépenses de la Confédération en faveur de l’économie laitière ont légèrement diminué en 2005,conformément au cadre budgétaire;les montants à disposition ont baissé de 29,3 millions de francs,soit de 5,8%.

Tableau 27,page A28
Le soutien des prix dans le domaine laitier a nécessité un montant total de 474,2 millions de francs,dont 341,1 millions (72%) ont été alloués au secteur du fromage,61,5 millions (13%) à celui du beurre et 65,6 millions (13,8%) à la fabrication de poudre de lait et d’autres produits laitiers.Les frais administratifs se sont élevés à 5,9 millions de francs,soit à 1,2% du budget laitier.
Aides dans le pays 21%
Total 474,2 mio de fr.
Aides à l'exportation 8% Suppléments 70% Administration 1% 2.1 PRODUCTION ET VENTES 2 130
Source: OFAG
■ 27 demandes présentées en vue de l’exemption anticipée du contingentement laitier
Contingentement laitier
Au cours de l’année laitière 2004/05,31'673 producteurs ont commercialisé du lait. Leur nombre a diminué de 1'399 ou 4,2% par rapport à l’année précédente,une baisse annuelle qui correspond à la moyenne observée depuis le 1er mai 1999.Quant au contingent moyen,celui-ci a augmenté de 4,7% durant l'année laitière 2004/05, pour s’établir à 95'958 kg.Sa progression a été de 5'908 kg en région de plaine où il a atteint 115'214 kg,et de 3,9% en région de montagne où il s’est élevé à 71'421 kg. Depuis l’année laitière 1999/2000,l’augmentation du contingent représente près de 27’000 kg (30%) en plaine et quelque 12'800 kg (22%) en montagne.
Le commerce de contingents laitiers a également été dynamique au cours de l’exercice sous revue.Cependant,dans la perspective de l’exemption anticipée,le transfert à titre temporaire (location) a perdu de l’importance au profit d’un transfert à titre définitif (achat).6'315 producteurs ont acheté,en 2004/05,quelque 163 millions de kg de contingents et 8'831 producteurs ont loué environ 146 millions de kg.La quantité transférée en vertu de l’article 3 de l’ordonnance sur le contingentement de la production laitière a atteint 308 millions de kg,soit 10% du contingent de base.Si la quantité des contingents loués a diminué de 23,0 millions de kg (–14%) par rapport à l’année précédente,celle des contingents achetés s’est accrue de 33,7 millions de kg (+26%), s’établissant à 163 millions de kg.
La quantité contingentaire transférée à titre temporaire s’est élevée à 421 millions de kg durant l’année laitière 2004/05.Quant à l’ensemble des contingents acquis de manière définitive depuis l’introduction du commerce des contingents en 1999,il se monte à 591 millions de kg.Ainsi,1,01 million de t,soit un tiers du contingent de base,ont été utilisées par d’autres producteurs au cours de l’année laitière 2004/05 grâce à des transferts de contingents non liés à la surface.
Durant cette période,les livraisons excédentaires soumises à la taxe ont atteint la quantitérecord de 23,4 millions de kg.Conséquence de l’abaissement de la taxe à 10 ct. par kg de lait livré en trop,les exploitations d’estivage ont livré à elles seules un excédent de lait de 17,2 millions de kg.La somme des taxes perçues s’est élevée à près de 5,5 millions de francs.
Les organisations réunissant les producteurs qui s’étaient prononcés en faveur de l’exemption anticipée du contingentement laitier au 1er mai 2006 devaient déposer une demande en ce sens à l’OFAG avant la fin octobre 2005.Du 1er janvier 2005 jusqu’à cette date butoir,les producteurs et organisations intéressés se sont donc occupés activement des préparatifs.Durant cette phase,l’OFAG a sans cesse montré qu’il était disposé à conseiller les parties lors de l’élaboration des statuts et des règlements régissant les quantités et à prêter main-forte pour éclaircir des questions de procédure. Toutes les organisations pratiquement ont fait usage de cette offre.Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que les 27 demandes déposées aient été de bonne qualité et généralement bien documentées.Au final,l’OFAG a pu approuver l’ensemble des 27 demandes,fin 2005 et début 2006.
2.MESURESDEPOLITIQUEAGRICOLE 2.1 PRODUCTION ET VENTES 131 2
Les 27 organisations exemptées comprennent 9 organisations de producteurs (OP) et 18 organisations de producteurs-utilisateur (OPU).Avec elles,ce sont au total 21'929 producteurs représentant une quantité contingentaire d’environ 2,34 millions de t qui sont exemptés,soit 63% des producteurs et 75% des quantités.
OrganisationProducteursQuantité de base (prov.) (état:26 sept.2006)
kg Organisations de producteurs OP FTPL 25216,6 PO ZMP 4 143407,4 PO LOBAG3 099259,9 PO Nordostmilch AG2 128225,4 OP Prolait3 103428,4 PO MIBA 2 063256,4 PO Biomilchpool GmbH69855,7 OP FLV-WMV97747,3 PO Ostschweiz 75783,1 Total OP17 2201 780,2 Organisations de producteurs-utilisateur OPU Le Maréchal122,1 PMO Thur Milch Ring AG15825,9 PMO Bodensee Milch16423,1 PMO Schwyzer Milch 32521,5 PMO BEMO80884,0 OPU GAE 32442,8 PMO MIMO1 029131,6 PMO Swiss Premium Milk 16218,7 PMO Gourmino Plus16123,1 PMO Mittelthurgau11417,5 OPU Chasseral20122,7 PMO Bachthalkäserei Girenbad GmbH91,0 PMO Ostschweiz 24122,3 PMO Biedermann / Züger22431,4 PMO Strähl6411,8 PMO ZeNoOs65171,1 PMO Bergkäsereien Untervaz-Savognin322,7 PMO NapfMilch AG302,1 Total OPU4 709555,7 Total OP et OPU21 9292 335,9 2.1 PRODUCTION ET VENTES 2 132
Nombremio.de
■ Projet «Admin Milch 2006»
Dans l’ensemble,8 organisations n’ont pas atteint les quantités minimales requises. Néanmoins,leurs demandes ont été approuvées en vertu des dispositions d’exception (art.4,al.3,pour le Valais et le Tessin ou art.5,al 2,OECL).Le tableau ci-dessus met en évidence la création de quelques grandes OP opérant sur tout le territoire et plusieurs OPU plutôt petites,lesquelles se focalisent principalement sur le fromage. Elles se trouvent en majeure partie en Suisse orientale.
L’exemption du contingentement laitier a fait bouger la branche laitière.Les structures traditionnelles ont disparu tandis que des OP et OPU se sont formées,une évolution qui a eu des répercussions sur le flux des données laitières.Durant la phase transitoire allant de 2006 à 2009,deux systèmes d’orientation de la production seront gérés en parallèle:l’actuel système du contingentement laitier et le nouveau système s’appliquant aux producteurs exemptés.Par ailleurs,un monitoring de la production,au niveau des exploitations laitières,est prévu à l’art.43 LAgr pour la période au-delà de 2009.
Comme la libéralisation du marché laitier ira de pair avec une simplification de la saisie et de la gestion des données relatives à la production,une plus grande coordination s’impose dans la gestion des données en matière de production laitière en même temps qu’une baisse des coûts liés à l’administration des mesures agricoles.C’est à cette fin que l’OFAG a lancé le projet «Admin Milch 2006».Celui-ci consiste à réorganiser l’administration des données relatives à la production laitière tout en respectant les dispositions de droit public.Ces données seront gérées dans le cadre d’un processus déjà externalisé à la TSM Fiduciaire Sàrl.Afin d’avoir une vue d’ensemble du secteur laitier même après l’exemption du contingentement laitier,les données relatives à la production laitière seront saisies et gérées de manière uniforme et centralisée pour les deux systèmes.En même temps,les quantités de lait produites feront l’objet d’un controlling et les évaluations et publications requises seront assurées.Pour ce faire,on utilisera les données de base du système d’information sur la politique agricole (SIPA) de l’OFAG et les données laitières y seront directement raccordées.En adoptant cette double approche – centralisation et mise en réseau avec le SIPA,d’une part,et partenariat avec le secteur privé,d’autre part –,l’OFAG ouvre la voie menant à une plate-forme de données commune qui servira les intérêts de l’économie laitière et permettra le développement cohérent d’un réseau intégré de données agricoles.
■ Ordonnance concernant le contingentement de la production laitière (OCL)
La modification de l’ordonnance concernant le contingentement de la production laitière,décidée le 1er mars 2006,avait pour toile de fond la possibilité d’une exemption anticipée du contingentement.D’une part,elle a eu pour effet de simplifier considérablement les annonces et la gestion des données relatives à la production laitière; elle est d’ailleurs harmonisée avec le projet «Admin Milch 2006».
2.1 PRODUCTION ET VENTES 2.MESURESDEPOLITIQUEAGRICOLE 2 133
■ Modifications de l’ordonnance sur l'exemption du contingentement laitier
D’autre part,la taxe exigée en cas de surlivraison a été réduite pour les producteurs pour lesquels un décompte final doit être établi suite à l’exemption du contingentement laitier.Ainsi,il a été largement tenu compte d’un souhait émis par les Producteurs suisses de lait.Si un producteur est en effet exempté du contingentement,il n’a plus la possibilité de reporter 5'000 kg sur l’année laitière suivante sans payer de taxe. En abaissant de 30 à 10 ct.par kg la taxe perçue pour cette quantité,le producteur voit sa charge financière diminuer.
Les modifications de l’ordonnance sur l’exemption du contingentement laitier (OECL; RS 916.350.4) dépendent aussi en grande partie du projet Admin Milch 2006.De plus, il est désormais possible d’annoncer après-coup les producteurs intéressés,quand bien même les organisations auxquelles ils veulent être affiliés ont déjà déposé une demande d’exemption ou que cette dernière a déjà été approuvée par l’OFAG.Par analogie avec les réglementations en matière de contingent,le délai a été fixé à fin février pour les producteurs.
Soutien du marché par le biais des aides et des suppléments
Les instruments destinés au soutien du marché n’ont pas connu de changements majeurs en 2005.Toutefois,en raison de la réduction de 29,3 millions de francs des fonds affectés à cette fin,il a fallu réduire les aides accordées pour le beurre dans le pays.Le taux octroyé pour les emballages de 1 kg (plaques) a été abaissé de 29 ct. par kg pour s’établir à 1 fr.80,alors que celui pour les emballages de 1 kg (beurre en feuille) a été relevé de 23 ct.par kg pour atteindre 1 fr.60.
La future politique laitière poursuit de manière conséquente les réformes entreprises jusqu’à présent en ce qui concerne l’orientation du marché.Ce faisant,elle tient compte en particulier de la suppression du contingentement laitier qui a été décidée. L’élément central du concept adopté dans le cadre de la Politique agricole 2011 réside dans la réallocation aux paiements directs,en deux étapes,des fonds destinés au soutien du marché.En conséquence,les vaches laitières donnent aussi droit aux contributions pour animaux de rente consommant des fourrages grossiers.
A cette fin,les aides et suppléments seront réduits dans un premier temps de 66 millions de francs en 2007 comme en 2008.Cela permettra de financer une contribution de 200 francs par vache laitière à partir du 1er janvier 2007.Dans un deuxième temps,les fonds alloués au soutien du marché dans le domaine laitier seront encore amputés de 205 millions de francs à partir de 2009 pour que le financement d’une contribution unitaire de 600 francs soit possible pour tous les animaux de rente consommant des fourrages grossiers.
Afin de disposer de suffisamment de temps pour la mise en œuvre de ces changements dans le secteur laitier,le Conseil fédéral a fixé,fin 2005,les taux applicables aux aides et aux suppléments à compter du 1er janvier 2007.Le supplément versé pour le lait transformé en fromage sera ainsi abaissé à 15 ct.par kg de lait transformé en fromage (–3 ct.) et le supplément de non-ensilage diminuera de 3 ct.En outre,la baisse des taux des aides contribuera à réduire les dépenses.
2.1 PRODUCTION ET VENTES 2 134
2.1.3 Economie animale
Après que les premiers cas de grippe aviaire sont apparus en Europe chez des oiseaux sauvages et dans des effectifs de volaille de rente,les autorités suisses ont pris différentes mesures pour prévenir l’introduction de cette maladie en Suisse.Ont été interdits notamment l’importation et le transit de produits de volaille en provenance de nombreux pays non-membres de l’UE.Le 21 octobre 2005,le Conseil fédéral a décidé d’interdire la garde de la volaille en plein air jusqu’au 15 décembre 2005.La détention dans une aire à climat extérieur,protégée de tous côtés contre les oiseaux sauvages, était cependant autorisée.Durant la période en question,les marchés de volaille et les expositions de volaille étaient également interdits.Le Conseil fédéral a toutefois assuré aux aviculteurs que les paiements directs ne seraient pas réduits en raison de l’interdiction de la garde en plein air.La déclaration «bio» ou «plein air» pouvait toujours être utilisée,si une notice explicative sur le lieu de vente signalait les limitations temporaires intervenues.L’interdiction de garder de la volaille en plein air a été renouvelée le 20 février 2006.Peu de temps après,le virus de la grippe aviaire était détecté chez un oiseau sauvage au bord du lac Léman.Début mai,le Conseil fédéral a levé l’interdiction,la période de la migration des oiseaux étant alors pratiquement terminée.

■■■■■■■■■■■■■■■■
2.1 PRODUCTION ET VENTES 135 2
Dégagement des marchés publics
Campagnes de ventes à prix réduits
Contributions à l’investissement (construction de poulaillers)
Campagnes d’œufs cassés et mesures de commercialisation
Contributions à la mise en valeur de la laine de mouton
Aides à l’exportation de bétail d’élevage et de rente
Effectifs maximums
Banque de données sur le trafic des animaux
Les droits de douane et les contingents tarifaires sont les instruments les plus importants pour la protection de la production indigène.En outre,des aides sont allouées, visant aussi bien à soutenir les marchés de la viande et des œufs qu’à encourager l’exportation d’animaux d’élevage et de rente.Le soutien financier des essais axés sur la pratique dans le domaine de la volaille a par contre été supprimé fin 2004.Vu la forte demande sur le marché de la viande et la baisse de l’offre indigène,il n’a pas été nécessaire de procéder à des campagnes de stockage de bœuf et de porc;on a également pu renoncer au dégagement des abattoirs pour ce qui est des animaux des espèces bovine,porcine et chevaline.
■ Moyens financiers 2005
Des 28,3 millions de francs budgétisés pour les mesures fédérales en faveur de l’économie animale,seuls 20,6 millions ont été dépensés.Raison principale de la réduction des dépenses:la bonne situation régnant sur les marchés de la viande et des œufs. D’une part,les interventions sur le marché ont été moins nombreuses,d’autre part,les aides à l’exportation de bétail d’élevage et de rente n’ont pas été entièrement utilisées. Dans le cadre du contrôle du trafic des animaux,la convention de prestations avec la banque de données sur le trafic des animaux a nécessité 8,9 millions de francs et les recettes en matière d’émoluments (marques auriculaires,émoluments d’abattage et émoluments de traitement) se sont élevées à 9,8 millions de francs.C’est avant tout en raison d’investissements réduits que la convention de prestations a entraîné des dépenses inférieures de quelque 0,9 million à ce qui était budgétisé.L’élimination des sous-produits animaux des animaux des espèces bovine,porcine,ovine et caprine a coûté 44,3 millions de francs.Les dépenses pour le contrôle du trafic des animaux et l’élimination des sous-produits animaux ont pu être financées grâce aux montants figurant dans des rubriques budgétaires non rattachées à l’économie animale.
Mesures 2005
■■■■■■■■
Animal/produitBovinsVeauxPorcsChevauxMoutonsChèvresVolailleOeufs Mesure Protection douanière
■■■
■■■■■
■■■
Dégagement des abattoirs
Campagnes de stockage
■■■
■
■
■
■■■■
■■■■
■■■■■
Source:OFAG
2.1 PRODUCTION ET VENTES 2 136
Tableau 28,page A29
■ Bétail de boucherie et viande:conventions de prestations
Répartition des fonds 2005
Total 20,6 mio. de fr.
Contribution à la mise en valeur de laine de mouton 4%
Contributions au stockage et à la réduction des prix de la viande de bœuf et de veau 19%
Contribution destinées au soutien de la production suisse d'œufs 15%
Aides à l'exportation d'animaux d'élevage et de rente 28%
Mandats de prestations
Proviande 34%
Source: Compte d'Etat
En vertu de l’art.51 LAgr,l’OFAG a confié à Proviande,le 1er janvier 2000,différentes tâches sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande.Les mandats et l’indemnisation de Proviande ont été réglés dans trois conventions de prestations.Celle concernant l’enregistrement et le contrôle des demandes de parts de contingent tarifaire a pris fin le 31 décembre 2005.Les deux autres conventions échoiront fin 2007.En 2007,les tâches confiées jusqu’ici à Proviande feront l’objet d’un appel d’offres public.
1.Taxation neutre de la qualité
La qualité des animaux abattus doit être taxée dans tous les grands abattoirs par un organisme neutre,en l’occurrence Proviande.A la fin de l’exercice,elle était taxée par le service de classification de Proviande dans 36 entreprises.Ainsi,la taxation a porté sur 90% des animaux abattus de l’espèce porcine,85% des animaux abattus de l’espèce bovine et 60% des animaux abattus de l’espèce ovine.Lors de l’introduction de la taxation en 2000,Proviande travaillait dans 45 abattoirs.L’organisation a en outre déterminé la qualité de tous les animaux sur pied des espèces bovine et ovine sur les marchés publics.Dans les domaines de la formation,de la formation continue et de l’organisation de cours,Proviande a également effectué un grand nombre d’heures de travail.
Le pourcentage de viande maigre constitue le critère de qualité des carcasses de porcs. Il est déterminé à l’aide d’appareils techniques.La proportion de viande maigre relevée dans un échantillon de 1,5 million d’abattages (56% de tous les abattages) a atteint en moyenne 55,7%.Par rapport à 2004,on note une augmentation de 0,2%.
2.1 PRODUCTION ET VENTES 2.MESURESDEPOLITIQUEAGRICOLE 137 2
La charnure et la couverture de graisse des animaux des espèces bovine,ovine,caprine et chevaline font l’objet d’une appréciation visuelle.Il existe cinq classes de charnure: C = très bien en viande,H = bien en viande,T = charnure moyenne,A = charnure faible,X = très décharné.La couverture de graisse est également subdivisée en cinq classes.23% des vaches présentaient une charnure faible et 20% étaient très décharnées.Par rapport à 2004,la part des animaux dont la charnure était faible a reculé de 1% et celle des animaux très décharnés de 2%.Cette baisse résulte vraisemblablement de l’augmentation du nombre de vaches allaitantes.Concernant les taureaux, leur charnure tend à augmenter;ils font presque tous partie des classes «charnure moyenne»,«bien en viande» ou «très bien en viande».Il en va de même pour les agneaux,dont la charnure tend à s’améliorer.La moitié d’entre eux présente une charnure moyenne et plus d’un tiers est bien en viande.Par rapport à l’année précédente,la répartition des veaux et des cabris en fonction des classes de charnure est restée stable.
2.Surveillance des marchés publics et mise sur pied de mesures destinées à alléger le marché
Des organisations paysannes et/ou des services cantonaux ont organisé durant toute l’année des marchés publics de bovins et de moutons.Le nombre de moutons présentés a baissé de 13% par rapport à 2004,celui de gros bétail de 6 % et celui de veaux de 49%.Ces diminutions sont dues principalement au recul de l’offre qui touche toutes les catégories animales.Autre explication:le nombre croissant d’animaux labellisés qui ne sont pas commercialisés sur un marché public.Sur les marchés de moutons, 2’011 animaux (2,7% des animaux présentés) n’ont pas été achetés sur une base volontaire.Ces animaux ont été attribués par Proviande aux abattoirs et aux maisons de commerce ayant l’obligation de prendre en charge les animaux non achetés,qui les ont payés aux prix usuels pratiqués sur le marché,tels qu’ils ont été relevés par Proviande.L’organisation a par ailleurs attribué 7'652 cabris,en rapport avec le dégagement du marché dans les abattoirs.Cela fait quelque 700 animaux de plus que l’année précédente.
Répartition des carcasses en fonction des classes de charnure 2005 en %
C H T A X VachesTaureauxVeaux Classe de charnure AgneauxCabris 0 70 50 60 40 30 20 10 2.1 PRODUCTION ET VENTES 2 138
Source: Proviande C = très bien en viande H = bien en viande T = charnure moyenne A = charnure faible X = très décharné
Les marchés publics surveillés en 2005 en chiffres
CaractéristiqueUnitéVeauxGros bétailAnimaux de l’espèce ovine
Marchés publics surveillésNombre466891314
Animaux présentésNombre24 53160 69773 214
Part d’animaux admis à tous les abattages%91728
Animaux attribués
(dégagement du marché)Nombre63232 011
Source:Proviande
Des marchés publics sont organisés dans 20 cantons et font l’objet d’une surveillance par Proviande.Le canton de Berne compte le plus grand nombre de marchés,à savoir 25 de gros bétail,18 de moutons et 5 de veaux.233 animaux sont commercialisés en moyenne par marché de moutons,68 par marché de gros bétail et 53 par marché de veaux.
L’OFAG a payé 2,7 millions de francs pour la congélation de viande de veau et 1,2 million de francs pour la réduction du prix de la viande de bœuf.76 abattoirs et maisons de commerce ont stocké au printemps 743 t de viande de veau,qui ont pu être écoulées avant la fin de l’année sous revue.En outre,574 t de viande de bœuf (quartiers de devant) destinées à la transformation et 2’800 cuisses de bœuf destinées à la production de viande séchée ont fait l’objet d’une réduction de prix.
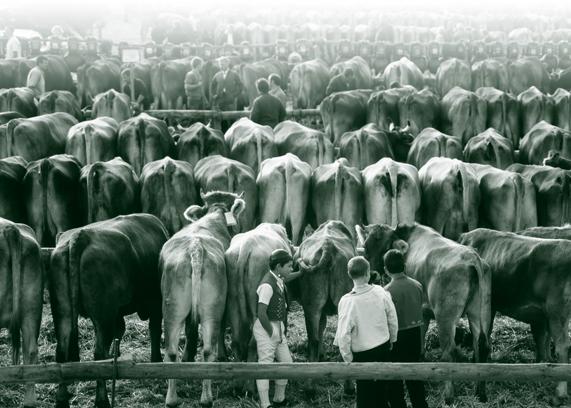
2.1 PRODUCTION ET VENTES 139 2
3.Enregistrement et contrôle des demandes de parts de contingent tarifaire
En été 2005,les prestations en faveur de la production suisse déterminantes pour la répartition de 34% de la quantité d’une catégorie de viande durant la période contingentaire 2006 ont été annoncées par la voie de demandes.Depuis l’année 2000,au cours de laquelle 1’003 demandes ont été présentées,leur nombre n’a cessé de diminuer pour s’établir à 730.A partir de 2007,seuls 10% des parts de contingent tarifaire de viande des animaux de l’espèce bovine (sans les cuisses de bœuf) et de viande des animaux de l’espèce ovine seront encore attribués sur la base d’une prestation en faveur de la production suisse.Compte tenu des prestations fournies,l’OFAG a notifié à 721 personnes morales et physiques (2005:761) leurs parts de contingent tarifaire 2006 par voie de décision:568 personnes ont eu droit à des parts de viande des animaux de l’espèce bovine (sans les cuisses de bœuf),345 à des parts de viande de porc en demi-carcasses,170 à des parts de viande des animaux de l’espèce ovine, 141 à des parts de cuisses de bœuf,36 à des parts de viande des animaux de l’espèce chevaline et 22 à des parts de viande des animaux de l’espèce caprine.Le recul le plus marqué de détenteurs de parts de contingent tarifaire (12%) a été enregistré dans la catégorie «viande de porc».Contrairement à la tendance générale,le nombre de détenteurs de parts de contingent tarifaire de viande de cheval a augmenté,passant de 33 en 2005 à 36.Les parts de contingent de viande de volaille ont été attribuées pour 2006 à raison de 34% selon la prestation en faveur de la production suisse. 30 personnes se sont vu attribuer des parts pour cette catégorie de viande.
L’OFAG définit les quantités à importer pendant une période d’importation après consultation du Conseil d’administration de Proviande,compte tenu de la situation du marché.La période d’importation pour la viande de bœuf et de porc en demi-carcasses est fixée à quatre semaines;celle concernant la viande de mouton,de chèvre,de cheval et de volaille,ainsi que les abats,à un trimestre.Si certaines conditions sont remplies, les périodes d’importation peuvent être raccourcies ou rallongées.L’OFAG a mis en adjudication 33% de toutes les importations de viande pour la période contingentaire 2005.
Les enchérisseurs peuvent présenter leurs offres à l’OFAG par fax,par courrier postal ou grâce à un accès Internet sécurisé,par l’intermédiaire de l’application «mise en adjudication électronique».Plus de 80% des offres sont transmises sous cette forme. En 2005,170 entreprises ont participé à la mise en adjudication de viande des animaux des espèces bovine,ovine,porcine,chevaline et caprine,ainsi que de viande de volaille et d’abats.Etant donné qu’un participant regroupe les offres de nombreuses petites entreprises sur une «plate-forme d’offre» pour ensuite présenter une seule offre,le nombre effectif de participants est plus élevé.47 entreprises (28%) n’étaient pas,jusqu’ici,détentrices de parts de contingent tarifaire moyennant une prestation en faveur de la production suisse.Ce sont surtout des entreprises approvisionnant des établissements de restauration collective qui peuvent maintenant participer directement au marché d’importation.Elles ont principalement acquis de la viande de volaille et des aloyaux/High-Quality-Beef.57 entreprises (33%),qui détenaient déjà des parts de contingent de certaines catégories de viande dans le système de la prestation en faveur de la production suisse,ont aussi participé à la mise en adjudication d’autres catégories.Elles ont donc étendu leur commerce d’importation à de nouvelles sortes
2.1 PRODUCTION ET VENTES 2 140
■ Mise en adjudication de viande
de viande.Il s’agissait surtout de morceaux parés de la cuisse de bœuf,de viande de mouton et de viande de volaille.66 entreprises (39%) ont acquis uniquement de la viande des catégories dont elles détenaient déjà des parts dans le système de la prestation en faveur de la production suisse.La mise en adjudication d’un tiers des contingents a déjà renforcé le dynamisme et la concurrence sur le marché des importations de viande.
Résultats des mises en adjudication en 2005
ProduitQuantité mise en Nombre moyen dePrix d’adjudication adjudicationparticipants moyen
Les catégories de viande mises en adjudication pour la première fois en 2005 ont généré des recettes de 42,7 millions de francs,qui ont été versées dans la caisse fédérale.Les aloyaux/High-Quality-Beef y ont contribué à raison de 45%.Dans le message sur l’évolution future de la politique agricole (Politique agricole 2007; FF no 29 2002,p.4485) du 29 mai 2002,le Conseil fédéral estimait à 50 millions de francs les recettes supplémentaires qui alimenteraient la caisse fédérale en 2005.Parce qu’il manquait alors des valeurs empiriques concernant les prix d'adjudication et en raison de la fluctuation des quantités importées de certaines catégories de viande selon la situation du marché,le chiffre effectif du montant versé à la caisse fédérale était légèrement inférieur à cette estimation.Les produits de charcuterie et les spécialités de viande sont intégralement mis en adjudication depuis 1999.Ces produits ont généré des recettes de 15,1 millions de francs,destinées à la caisse fédérale.
Unitéen kg brutNombrefr./kg brut Viande de volaille13 200 000600,59 Viande des animaux de l’espèce ovine2 079 000433,51 Viande de porc en demi-carcasses1 996 000270,57 Viande des animaux de l’espèce chevaline1 518 000161,07 Aloyaux / High-Quality-Beef1 460 2505613,16 Viande de fabrication de vache808 500331,73 Viande de bœuf (halal)300 00050,67 Cuisses de bœuf297 000339,80 Viande de veau264 000293,33 Viande de bœuf (kascher)241 000270,05 Langues195 50080,05 Viande de mouton (halal)100 00061,27 Viande des animaux de l’espèce caprine82 500200,90 Museaux de bœuf61 50050,15 Foies de veau24 40090,20 Viande de mouton (kascher)17 35020,19 Ris de veau3 30030,02 Source:OFAG
2.1 PRODUCTION ET VENTES 2.MESURESDEPOLITIQUEAGRICOLE 141 2
■ Oeufs:soutien de la production suisse et mesures de mise en valeur
L’OFAG a octroyé des contributions à l’investissement pour la construction et la transformation de poulaillers particulièrement respectueux des animaux.Ces contributions, allouées uniquement pour la volaille destinée à la production d’œufs,ne sont ni remboursables ni grevées d’intérêts.L’OFAG a ainsi octroyé une aide à 12 exploitations de pondeuses,3 exploitations de poulettes et 1 exploitation de pondeuses et de poulettes, pour un total de 460’446 francs.Les 16 exploitations détiennent en moyenne 5’750 animaux.3 d’entre elles produisent conformément aux règles de l’agriculture biologique.
Par rapport à la période qui précède Noël et Pâques,la demande d’œufs suisses est particulièrement faible après Pâques et durant les mois d’été.Pour atténuer les effets de ces variations saisonnières,l’OFAG a débloqué,après consultation des milieux concernés,un montant maximum de 3 millions de francs pour des mesures de mise en valeur.Les fabricants de produits à base d’œufs ont cassé 20,3 millions d’œufs excédentaires,recevant pour chaque œuf cassé,preuve à l’appui,une contribution de 9 ct. Les commerçants,quant à eux,ont réduit le prix de 13,9 millions d’œufs en faveur des consommateurs,recevant 5 ct.par œuf.En tout,14 entreprises ont participé aux campagnes d’œufs cassés et 13 entreprises à la campagne de ventes à prix réduits. L’OFAG a procédé à des contrôles à domicile et examiné les justificatifs,afin de vérifier si les dispositions relatives aux campagnes d’œufs cassés et de ventes à prix réduits étaient respectées.
■ Chevaux de rente et de sport:mise en adjudication du contingent tarifaire
Au cours de l’exercice sous revue,l’OFAG a mis en adjudication le contingent tarifaire «animaux de l'espèce chevaline (sans les animaux d'élevage,les ânes,les bardots et les mulets)» en deux tranches de 1’461 sujets chacune.Les deux fois,environ 200 personnes ont présenté des offres.Le prix d’adjudication a été en moyenne de 357 francs par cheval de rente et de sport;pour la caisse fédérale,il en est résulté des recettes s’élevant à plus d’un million de francs.
■ Contrôle du trafic des animaux et élimination des sous-produits animaux
Depuis 1999,la banque de données sur le trafic des animaux est gérée par Identitas SA (auparavant Banque de données sur le trafic des animaux SA),qui remplit principalement les tâches suivantes:attribution des marques auriculaires,enregistrement et traitement des notifications concernant le trafic des animaux,facturation des émoluments et versement des contributions à l’élimination aux éleveurs et aux abattoirs.En avril 2005,le Conseil fédéral a décidé qu’une entreprise privée sera chargée,à l’avenir aussi,de gérer la banque de données sur le trafic des animaux.Se fondant sur cette décision,l’OFAG a conclu avec Identitas SA une nouvelle convention de prestations pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010.
2.1 PRODUCTION ET VENTES 2 142
Mesures 2005
2.1.4Production végétale
Au cours de l'année sous revue,aucune modification majeure n’est intervenue dans le catalogue des mesures destinées à soutenir la production indigène.Dans le secteur du blé panifiable et des aliments pour animaux,une réduction de la protection à la frontière a été introduite.
Pour ce qui est des fruits,des légumes et des fleurs coupées,la protection douanière représente une mesure essentielle.La participation financière à la mise en valeur des fruits à cidre excédentaires,aux mesures de dégagement du marché des fruits à noyau et à la plantation de cultures novatrices revêt également de l’importance dans le domaine des fruits.Dans le domaine viti-vinicole,il y a lieu de mentionner la reconversion de vignobles.

1Selon l’utilisation ou le numéro du tarif,le prélèvement à la frontière est réduit ou nul.
2Ne concerne que des parties de la quantité récoltée (affouragement à l’état frais ou déshydratation de pommes de terre,réserve de marché pour concentrés de fruits à pépins).
3Pommes de terre:seulement pour les produits à base de pommes de terre destinés à l’alimentation / semences:seulement pour les plants de pommes de terre / fruits: seulement pour les cerises transformées en conserves et divers produits de fruits à pépins.
4Ne concerne que certaines cultures.
Source:OFAG
■■■■■■■■■■■■■■■■
Mesure Protection douanière 1 ■■■■■■■■ Contributions à la transformation ■■ 2 ■■ 2 ■ 2 Contributions à la culture ■■■ Contributions à l’exportation 3 ■■■ Contributions pour la reconversion et la plantation de cultures novatrices 4 ■■
Culture Céréales Légumineuses à graines Oléagineux Pommes de terre Betteraves sucrières Semences Légumes,fleurs coupées, viticulture Fruits 2.1 PRODUCTION ET VENTES 143 2
■ Moyens financiers
Les fonds affectés au soutien du marché ont diminué par rapport à l’année précédente et sont passés de 142 à 125 millions de francs.Du fait de l’extension des surfaces,les dépenses pour les contributions à la culture ont augmenté de 0,9 million de francs, tandis que celles pour les contributions à la transformation et à la mise en valeur ont diminué,en raison des mesures d’économie.
Répartition des fonds 2005
Total 125 mio. de fr.
Contributions à l'exportation 7%
Diverses 3%
Contributions à la transformation et à la mise en valeur 55%
Contributions à la culture des champs 35%
Source: Compte d'Etat
De manière générale,les fonds versés pour les grandes cultures ont diminué de 6,7 millions de francs par rapport à l’année précédente.Comme l’an dernier,la contribution à la mise en valeur de betteraves sucrières a été répartie sur les récoltes 2004 et 2005. Suite à une nouvelle réduction des contributions,le montant affecté à la transformation du produit de la récolte 2004,n’a plus été que de 35,6 millions de francs.Si les fonds affectés aux pommes de terre ont diminué,cela est dû à la réduction de la contribution à la transformation des pommes de terre non commercialisables.Il en va de même des fonds affectés aux oléagineux:ils ont diminué en raison d’une réduction de la contribution à la transformation.L'interprofession swiss granum,à laquelle l’exécution du mandat de prestations a été confiée,a par conséquent dû adapter les taux de contributions,échelonnés en fonction du type d’oléagineux et de l’utilisation,ce qui s’est directement répercuté sur les recettes des producteurs.
Par rapport à l’année précédente,le soutien à la mise en valeur des fruits a diminué de 8,7 millions de francs.Cette diminution s’explique essentiellement par la faible récolte de pommes à cidre,qui n’a pas suffi à couvrir les besoins annuels.Le concentré de jus de pommes,produit l’année dernière à partir des excédents,a été en partie utilisé pour couvrir les besoins du pays.
2.1 PRODUCTION ET VENTES 2 144
29,page A30
Tableau
Répartition des fonds par culture
mio. de fr. 0253050 5 10 1520354045
Betteraves sucrières 1
Pommes de terre
Légumineuses à graines
Oléagineux (y c. MPR)
Matières premières renouvelables (sans oléagineux)
Production de semences

Fruits
Viticulture 2
2003 2004 2005
1 2004: 38,2 mio. de fr. pour récolte 2003 et 7,1 mio. de fr. pour récolte 2004; 2005: 28,5 mio. de fr. pour récolte 2004 et 17,5 mio. de fr. pour récolte 2005
2 dès 2004 sans promotion des ventes, 2003 mise en valeur de jus de raisins
Dépenses pour la mise en valeur de fruits 2005
Total 9,7 mio. de fr. Exportation d'autres
Source: Compte d'Etat
Exportation de concentré de jus de pommes 38,1%
Exportation de concentré de jus de poires 43,3%
Mesures d'adaptation au marché pour fruits et légumes 8,9%
Autres 1,5%, dont allégement du marché des cerises et des pruneaux 0,3%
Source: OFAG
Dans l’année sous revue,le soutien à la mise en valeur des fruits s’est monté à 9,7 millions de francs,ce qui correspond à 53% seulement des dépenses moyennes des quatre années précédentes.Par rapport à 2004,les dépenses occasionnées par les exportations de concentré de jus de pommes ont diminué de 7,0 millions de francs et celles concernant les exportations de concentré de jus de poire,de 1,1 million de francs.
1,5%
Exportation de cerises
Mise
et de poires dans le pays 4,0%
en valeur de pommes
pépins 2,7%
produits de fruits à
2.1 PRODUCTION ET VENTES 2.MESURESDEPOLITIQUEAGRICOLE 145 2
Cultures des champs
En novembre 2004,le Conseil fédéral a décidé de réduire le prix-seuil des aliments pour animaux et le taux du contingent de céréales panifiables;ces deux réductions sont entrées en vigueur le 1er juillet 2005.Le prélèvement à la frontière sur les aliments riches en énergie destinés aux animaux (céréales fourragères) et sur les céréales panifiables a baissé de 3 fr./100 kg et sur les aliments protéiques pour animaux (pois protéagineux,sous-produits issus de la transformation d'oléagineux),de 1 fr./100 kg.
Lors de sa formation,la biomasse lie une certaine quantité de CO2;la même quantité est libérée lors de la combustion de cette biomasse.Elle est donc considérée comme neutre au plan du CO2.Certes,les sources énergétiques fossiles se sont également formées à partir de matériel organique,mais cette formation de puits de carbone naturels,à haute capacité de stockage qui a eu lieu à l’ère préhistorique a réduit,à cette époque,la teneur en CO2 de l’atmosphère.La composition relativement constante de l’air a influé sur les conditions climatiques globales de ces derniers millénaires. L’utilisation toujours plus importante de pétrole et de gaz naturel,qui a débuté au milieu du siècle passé,entraîne une augmentation de la teneur de l’air en CO2.La substitution des énergies fossiles par des énergies renouvelables peut contribuer à la réduction des émissions de CO2.Si plus de 50% de l’électricité produite est d’origine hydraulique,les énergies renouvelables ne représentent néanmoins,en tout,qu’environ 16% de l’énergie totale consommée.Avec une part de quelque 70%,l’énergie hydraulique est l’agent énergétique renouvelable le plus important.
■ Mesures à la frontière ■ Potentiel énergétique de la biomasse Consommation finale d'énergie depuis 1910 par agent énergétique 1910192019301940195019601970198019902000 PJ (10 15 Joule) Autres énergies renouvelables Chaleur à distance Electricité 1 Gaz Carburants pétroliers Combustibles pétroliers Ordures ménagères et déchets industriels Charbon et coke Bois et charbon Source: OFEN 1 env. 50% de l'électricité et sont produits par force hydraulique 0 500 400 300 200 100 600 700 800 900 2.1 PRODUCTION ET VENTES 2 146
■ Utilisation énergétique de la biomasse
L’étude intitulée «Potentiale zur energetischen Nutzung von Biomasse in der Schweiz» publiée par l’Office fédéral de l’énergie (2004) montre les potentiels théoriques et écologiques de différents types de biomasse jusqu’à l’horizon 2040.Le potentiel de production écologique net correspond à la biomasse qui peut être tirée de la production agricole et sylvicole (sous-produits compris) pour une utilisation durable et énergétique avec un rapport coûts/rendement acceptable.Les bilans énergétiques et écologiques doivent être clairement positifs.Le classement des potentiels réalisables d’ici à 2040 place la biomasse issue du bois de forêt et des taillis devant les déchets biogènes de l’industrie et des ménages et devant les résidus de récolte et les engrais de ferme.Selon un scénario conservateur,l’exploitation du potentiel écologique entraînerait une production d’énergie issue de la biomasse qui se monterait à 100 petajoules.Cette production correspondrait,par rapport à la consommation d’énergie en 2004,à une augmentation de 4% à 11% de l’énergie issue de la biomasse.
PJ (10 15 Joule) 060120 204080100
Bois de forêt et essences de croissance rapide
Cultures des champs, plantes énergétiques
Prairies
Résidus de récolte, engrais de ferme
Biomasse fortement structurée
Vieux bois, déchets de bois Déchets biogènes de l'industrie et des ménages
Potentiel théorique
Potentiel de production écologique net Exploitation 2003
Source: OFEN
Pour une utilisation appropriée à des fins énergétiques,la biomasse doit être bon marché et disponible de manière continue ou stockable,et elle doit avoir une haute teneur énergétique.Outre le bois,les déchets organiques et les produits agricoles à haute teneur en amidon ou en huile,comme les céréales et les oléagineux entrent avant tout en ligne de compte.Les pommes de terre,les betteraves sucrières et l’herbe sont en principe aussi des produits de récolte riches en énergie,mais comme leur teneur en eau est élevée,les volumes et les masses à transporter et à stocker sont importants et la durée de l’entreposage limitée.La biomasse peut,soit être brûlée directement à des fins thermiques,soit être utilisée pour la production de carburants, ce qui implique un processus de pressage,d’estérification et de fermentation éthylique ou méthylique.Le bois débité en bûches ou transformé en copeaux ou en pellets est avant tout destiné à remplacer le mazout.
Potentiel de biomasse 2040
2.MESURESDEPOLITIQUEAGRICOLE 2.1 PRODUCTION ET VENTES 147 2
■ Production de carburants à partir de biomasse

L’offre courante de biocarburants renouvelables comprend l’éthanol,l’ester méthylique d’acides gras d’origine végétale (biodiesel),le biogaz et les huiles végétales brutes. L’huile brute de haute qualité peut être utilisée directement dans les moteurs diesel aménagés à cet effet.Les huiles végétales brutes,les huiles végétales usées et les graisses animales peuvent être transformées en esters méthyliques d’acides gras (p.ex. ester méthylique de colza).L’ester méthylique d’acide gras est un produit de substitution du diesel;cependant,s’il est utilisé à l’état pur ou si le taux d’incorporation au diesel est élevé,le fabricant du véhicule doit donner son aval concernant le maintien des prestations de garantie.A partir d’une biomasse riche en cellulose,en amidon ou en sucre,on peut obtenir de l’éthanol,au moyen d’une fermentation alcoolique,ou du biogaz,au moyen d’une fermentation méthylique effectuée dans une installation de biogaz.L’éthanol peut être incorporé à l’essence ou au diesel,mais un taux d’incorporation important nécessite que le moteur du véhicule soit équipé d’une technologie appropriée.Le biogaz est en général transformé en courant électrique dans des petites installations décentralisées de biogaz.Pour les installations plus grandes,il existe une autre solution qui consiste à traiter le biogaz et à l’injecter dans le réseau existant de gaz naturel.
Sur la base des rendements spécifiques des grandes cultures,on peut calculer le rendement en carburant par unité de surface à l’aide d’un facteur de conversion.Indépendamment de toute considération économique,ce sont les betteraves sucrières qui présentent le plus grand rendement en éthanol.Cependant,la puissance calorifique de l’éthanol ne correspond qu’à environ deux tiers de celle de l’essence.Pour produire la puissance réalisée au moyen d’un litre d’essence,un volume nettement plus important d’éthanol est donc nécessaire.La surface agricole utile de la région de plaine dans son ensemble est de quelque 600'000 ha.Si cette surface était entièrement plantée de betteraves sucrières,la quantité d’éthanol qui en résulterait couvrirait moins de la moitié de la quantité d’essence et de diesel utilisée en 2004.Compte tenu de notre taux d'auto-approvisionnement,en termes de calories,qui ne dépasse pas 60%,de la valeur ajoutée qui est plus élevée dans les secteurs des denrées alimentaires et des aliments pour animaux ainsi que de la nécessité d’observer des rotations et des pauses entre les cultures si on veut pratiquer une culture des champs durable,le potentiel disponible restant pour la culture de matières premières renouvelables destinées à la production de carburant est minime.L’exploitation énergétique des déchets ménagers organiques ainsi que des déchets issus de l’industrie alimentaire et de l’industrie des aliments pour animaux est prioritaire.Les technologies courantes utilisées pour la production d’éthanol ou d’esters méthyliques d’acides gras issus de matières premières renouvelables génèrent des bilans énergétiques à peine positifs.Afin que les cultures des champs puissent contribuer substantiellement à couvrir les besoins en carburants,de nouvelles technologies et de nouveaux processus seront nécessaires.
2.1 PRODUCTION ET VENTES 2 148
■ Conditions-cadre relatives à l’obtention de carburant
Ethanol CHVolume des Rendement Ester méthylique Equivalents récoltes moyenneen éthanolde colzaessence 2003/05
Le Département fédéral des finances prélève un impôt sur les carburants ainsi qu’un supplément.En tout,les impôts à la consommation s’élèvent aujourd’hui à 73 centimes par litre d’essence.Les carburants obtenus à partir de biomasse renouvelable sont exemptés d’impôts,pour autant que,conformément à l'ordonnance sur l'imposition des huiles minérales,ils soient produits dans les installations pilotes et de démonstration reconnues par l’Administration fédérale des douanes.En vertu de l'ordonnance sur les contributions à la culture des champs,l’OFAG verse des contributions pour la transformation de matières premières dans des installations pilotes et de démonstration. Ces contributions sont considérées comme un financement de départ et non comme un soutien octroyé de manière permanente à des installations de transformation, artisanales ou industrielles.Durant l'année sous revue,deux installations pilotes et de démonstration ont reçu en tout une somme de 1,2 million de francs (en moyenne 31,80 fr./100 kg de colza) pour la transformation de 3'900 t de colza indigène en carburant (ester méthylique de colza),en additifs pour carburants ou en lubrifiants. Grâce à ce soutien,les producteurs de colza destiné à des fins techniques obtiennent environ le même prix que pour le colza transformé en huile comestible.Sans ce soutien, les entreprises de transformation auraient dû,pour des raisons de rentabilité,acquérir la matière première,en franchise de douane,sur le marché international en plus des 4'000 t de colza importé à des fins techniques.
■ Perspectives
En juin 2006,le Conseil fédéral a décidé de réduire le prix-seuil des aliments protéiques fourragers de 2 francs par 100 kg au 1er juillet 2006.Parallèlement,il a procédé à un changement de système dans le domaine des aliments composés pour animaux.On renonce dorénavant à fixer des valeurs indicatives d’importation;la taxe douanière est calculée sur la base d’une recette standard qui prend en compte la taxe à laquelle sont soumis les différents composants.La protection industrielle accordée jusqu’ici aux producteurs d’aliments composés pour animaux sera réduite par étapes,ce qui permettra d’abaisser le prix du fourrage et d’accroître en même temps la compétitivité des éleveurs.
Dans le secteur de l’énergie,les révisions en cours des lois sur l’imposition des huiles minérales,sur le CO2 et sur l’aménagement du territoire,de même que la conception de la loi sur l’énergie,peuvent conduire à de nouvelles conditions-cadre.Compte tenu de la réduction de la protection douanière à laquelle il faut s’attendre dans les secteurs des denrées alimentaires et des aliments pour animaux après la conclusion d’accords multilatéraux et/ou bilatéraux,la valeur ajoutée,donc l’efficience des moyens financiers de la Confédération,sera toujours plus élevée dans le secteur de l’alimentation que dans celui de l’énergie.
t/hal/hal/hal/ha Betteraves sucrières74,98 0005 200 Blé5,82 2001 400 Triticale5,92 3001 500 Seigle6,02 4001 600 Maïs grain9,33 5002 300 Pommes de terre37,33 0002 000 Colza3,21 2001 200 Sources:USP,BMVEL,OFAG
2.MESURESDEPOLITIQUEAGRICOLE 2.1 PRODUCTION ET VENTES 149 2
■ Exportations de concentré de jus de pommes et de poires
Cultures spéciales
Le concentré de jus de pommes ou de poires qui ne peut être écoulé sur le marché intérieur est exporté au cours des années suivantes.Les fluctuations importantes touchant les exportations sont préjudiciables aux prix à l’exportation.Les coûts élevés de la production et du transport constituent des difficultés supplémentaires,auxquelles s’ajoutent des droits de douane atteignant 18 à 21% de la valeur d’exportation,applicables aux concentrés de jus de fruits à pépins suisses exportés dans l’UE.
Récolte de pommes à cidre, besoin et exportation de concentré de jus de pommes de 1998 à 2005
■ Perspectives
Le graphique montre les liens entre la récolte des pommes à cidre,la demande de pommes à cidre indigènes et l’exportation de concentré de jus de pommes.Alors que la demande de pommes à cidre indigènes ne varie guère d’une année à l’autre,les récoltes subissent d’importantes fluctuations.Les pommes à cidre sont,pour une bonne part,transformées en concentré de jus de pommes.Le concentré qui ne peut être écoulé dans le pays au cours des années suivantes est exporté.Les exportations ont tendance à diminuer.
La situation est encore plus marquée en ce qui concerne les poires à cidre.En effet,les quantités récoltées et ainsi les exportations de concentré de jus de poires sont plus élevées que la demande.
De 1991 à 2001,le nombre d’arbres fruitiers hautes-tiges a reculé de 20%.Les raisons de cette évolution sont notamment la faible rentabilité de cette production,les constructions à la périphérie des villages et la rationalisation de l’agriculture.Il est probable que le recul se poursuivra dans une même mesure.Les quantités de pommes et de poires à cidre diminueront en conséquence.Alors que pour les pommes à cidre on peut s’attendre à un marché équilibré en 2009,il faut encore s’attendre à des excédents pour les poires à cidre.Dans le cadre de la PA 2011,la Confédération versera,en 2009,la dernière fois une aide financière pour les exportations de concentrés de jus de fruits à pépins.Le renforcement de la promotion régionale de la qualité et de la mise en réseau des surfaces de compensation écologique dans l’agriculture contribuera à la préservation des arbres fruitiers hautes-tiges.Quant à la production de fruits à pépins,elle sera déterminée par le marché des produits de fruits,notamment par la consommation de jus de fruits à pépins.
en t 1
Source: OFAG
de concentré de jus de pommes 199819992000200120032004 2002 0 25000 30000 35000 15000 20000 10000 5000 2005 2.1 PRODUCTION ET VENTES 2 150
1 sous forme de concentré de jus de pommes 71% poids, trouble Récolte de pommes à cidre Besoin en pommes à cidre Exportation
2.2 Paiements directs
Servant à rétribuer les prestations fournies par l’agriculture à la demande de la société, les paiements directs sont l’un des principaux éléments de la politique agricole.Il convient de distinguer les paiements directs généraux et les paiements directs écologiques.
Dépenses au titre des paiements directs
Domaine200020012002200320042005
Remarque:une comparaison directe avec les données du compte d’Etat est impossible.Les valeurs indiquées sous 2.2 «Paiements directs» se rapportent à l’ensemble de l’année de contributions,alors que le Compte d’Etat indique les dépenses d’une année civile.

■■■■■■■■■■■■■■■■
mio.mio.mio.mio.mio.mio. de
Paiements directs généraux1 8041 9291 9951 9991 9942 000 Paiements directs écologiques361413452477495507 Réductions231721171820 Total2 1422 3252 4262 4592 4702 486
fr.de fr.de fr.de fr.de fr.de fr.
Source:OFAG 2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 151
■ Rétribution de prestations fournies dans l’intérêt général
2.2.1Importance des paiements directs
D’utilité publique,les prestations de l’agriculture sont rétribuées au moyen des paiements directs généraux.En font partie les contributions à la surface et les contributions pour les animaux consommant des fourrages grossiers.Toutes deux ont pour objectif d’assurer l’exploitation et l’entretien de la surface agricole dans son ensemble. En outre,dans la région des collines et de montagne,les agriculteurs touchent des contributions pour des terrains en pente et pour la garde d’animaux dans des conditions difficiles.Il est ainsi tenu compte des difficultés d’exploitation dans ces régions. L’octroi de tous les paiements directs (contributions d’estivage exceptées) est lié à la fourniture des prestations écologiques requises (PER).

■ Rétribution de prestations écologiques particulières
De leur côté,les paiements directs écologiques incitent les agriculteurs à fournir les prestations écologiques particulières.En font partie les contributions à la compensation écologique,les contributions à la qualité écologique,les contributions pour la protection des eaux,les contributions d’estivage et les contributions éthologiques pour la garde d’animaux particulièrement respectueuse de l’espèce.Par leurs incitations financières,ils encouragent les prestations de l’agriculture qui vont au-delà des exigences légales et notamment des PER.Entre autres objectifs,ils visent à préserver et à augmenter la diversité des espèces dans les régions agricoles,à encourager les systèmes de garde particulièrement respectueux des animaux,à réduire les charges en nitrates et en phosphore dans les eaux et à utiliser durablement la région d’estivage.
■■■■■■■■■■■■■■■■
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 152
■ Importance économique des paiements directs en 2005
En 2005,les paiements directs ont représenté près de 72% des dépenses de l’OFAHG; 63% de ces paiements sont allés à la région des collines et de montagne.
Une comparaison directe avec les données du compte d’Etat est impossible.Les valeurs indiquées sous 2.2 «Paiements directs» se rapportent à l’ensemble de l’année de contributions,alors que le compte d’Etat indique les dépenses d’une année civile.Quant aux réductions,il s’agit de retenues effectuées en raison de limites et de sanctions légales et administratives.
Paiements directs en 2005 Type de contributionTotalRégion de Région des Région de plainecollinesmontagne 1 000 fr. Paiements directs généraux1 999 606744 144514 634729 772 Contributions à la surface1 319 595652 743326 778340 074 Contributions pour la garde d’animaux consommant des fourrages grossiers291 96784 58875 287132 093 Contributions pour la garde d’animaux dans des conditions difficiles282 2204 49679 109198 615 Contributions générales pour des terrains en pente94 7682 31733 46058 991 Contributions pour les surfaces viticoles en forte pente et en terrasses11 056 Paiements directs écologiques506 895202 253113 81093 285 Contributions écologiques409 348202 253113 81093 285 Contributions à la compensation écologique126 02372 97431 99721 053 Contributions au sens de l’ordonnance sur la qualité écologique (OQE)27 4428 8028 13310 507 Contributions pour la culture extensive de céréales et de colza (culture extensive)31 51622 0498 711756 Contributions pour la culture biologique28 6018 7285 86914 004 Contributions pour la garde d’animaux de rente particulièrement respectueuse de l’espèce195 76789 70059 10046 967 Contributions d’estivage91 610 Contributions pour la protection des eaux5 936 Réductions20 378 Total paiements directs2 485 758946 396628 444823 058 Paiements directs par exploitation en fr.44 12839 62541 08647 992 Remarque:
Source:OFAG
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 153 2.MESURESDEPOLITIQUEAGRICOLE
■ Exigences requises pour l’octroi de paiements directs
Part des paiements directs au rendement brut d’exploitations de référence, selon la région,en 2005
ParamètreUnitéTotalRégion de Région des Région de plainecollinesmontagne
Source:Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
L’octroi de contributions pour les conditions de production difficiles dans la région des collines et de montagne a pour effet de majorer le montant des paiements directs versés à l’hectare au fur et à mesure que lesdites difficultés augmentent.Conséquence des plus faibles rendements obtenus en montagne,la part des paiements directs au rendement brut y est également plus élevée qu’en plaine.
Pour toucher des paiements directs,les agriculteurs doivent remplir de nombreuses conditions.Au nombre de celles-ci figurent,d’une part,des conditions générales telles qu’une forme juridique,un domicile de droit civil,etc.et,d’autre part,des critères structurels et sociaux,eux aussi déterminants,comme le besoin minimal en travail, l'âge de l'exploitant,le revenu et la fortune.A cela s’ajoutent des charges spécifiquement écologiques qui sont regroupées sous la notion de prestations écologiques requises (PER).Les exigences PER comprennent un bilan de fumure équilibré,une part équitable de surfaces de compensation écologique,un assolement régulier,une protection appropriée du sol,l’utilisation ciblée de produits phytosanitaires,ainsi que la garde d’animaux de rente respectueuse de l’espèce.Des manquements aux prescriptions déterminantes donnent lieu à une réduction des paiements directs ou à un refus d’octroi.

ExploitationsNombre3 1351 426901808 SAU en Øha19,7520,6418,9219,09 Paiements directs générauxfr.37 65731 21737 31748 738 Contributions écologiquesfr.7 9008 7968 1496 159 Total paiements directsfr.45 55740 01345 46754 896 Rendement brutfr.210 986254 733194 361154 400 Part des paiements directs au rendement brut%21,615,723,435,6
Tableaux 40a–41,pages A46–A49
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 154
■ Système d'information sur la politique agricole
La plupart des données statistiques sur les paiements directs proviennent de la banque de données du système d'information sur la politique agricole (SIPA) développée par l’OFAG.Ce système est alimenté par les relevés annuels des données structurelles qui sont compilés et transmis par les cantons,ainsi que par les indications relatives aux versements (surfaces,cheptels et contributions pertinentes) de chaque type de paiement direct.La banque de données sert en premier lieu au contrôle administratif des montants versés aux exploitants par les cantons,mais elle permet aussi d’établir des statistiques générales sur les paiements directs.Grâce à cette mine d’informations et à l’utilisation d’outils informatiques performants,aussi questions de politique agricole peuvent être éclairées sous des angles différents.
Sur les 61'981 exploitations enregistrées dans le SIPA en 2005 et dépassant la limite fixée par la Confédération pour l’établissement de relevés,56'330 touchent des paiements directs.
■ Impact des échelonnements et des limitations
Les échelonnements et les limitations ont un impact sur la répartition des paiements directs.Les échelonnements dégressifs concernent les surfaces et les animaux tandis que les limitations consistent en des limites de revenu et de fortune ainsi que du montant maximum alloué par UMOS.
Impact des limites d’octroi des paiements directs en 2005 Limites d’octroiExploitations Réduction Part aux Part au total concernéescontributionsdes paiements des exploitationsdirects concernées
Les limites d’octroi entraînent des réductions de paiements directs,surtout pour les 217 exploitants dont la fortune est trop élevée.En outre,quelque 970 exploitations ont dépassé la limite de revenu en 2005.La réduction des paiements directs s’est élevée dans leur cas à 10,45% en moyenne.Globalement,les limites d’octroi ont conduit à des réductions de 10,3 millions de francs,ce qui correspond à 0,41% du montant total.
Nombrefr.%%
standard409910 7076,140,04
fonction
revenu9684 782 94910,450,19
fonction
la fortune2174 592 46367,240,18 Total10 286 1190,41
par unité de maind’œuvre
en
du
en
de
Source:OFAG
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 2.MESURESDEPOLITIQUEAGRICOLE 155
Effets de l’échelonnement des contributions en fonction de la surface ou du nombre d’animaux en 2005
Les échelonnements prévus dans l’ordonnance sur les paiements directs concernent en tout 8'908 exploitations.Dans la plupart des cas,les réductions portent sur diverses mesures.Comparée à l’ensemble des paiements directs dégressifs,la part de toutes les réductions opérées s’élève globalement à 37,5 millions de francs,soit à 1,51%. Les échelonnements dégressifs ont un effet notable sur les contributions à la surface et concernent plus de 7'400 exploitations (environ 13,2% de l’ensemble des exploitations recevant des paiements directs).Quant aux exploitations qui bénéficient de contributions pour la garde d'animaux consommant des fourrages grossiers,les réductions touchent 262 d’entre elles.Il faut dire que d’autres limitations comme la limite d’octroi et la déduction pour le lait commercialisé entrent ici en jeu bien avant l’échelonnement des paiements directs.Les paiements directs écologiques font eux aussi l’objet de réductions.Ainsi,dans le cas de 3'143 exploitations (sans les doubles comptables),il a fallu réduire les paiements directs accordés pour la garde d’animaux de rente particulièrement respectueuse de l’espèce (programmes SST et SRPA) de 10,4% et de 8,3% respectivement.Environ 777 exploitations bio ont touché des paiements réduits de 7,3%.
MesureExploitations Surface/effectif Réduction Part aux Part au total concernéespar exploitation contributions
de despaiements exploitationsdirects Nombreha ou UGBfr.%% Contributions à la surface7 40842,131 612 0867,61,27 Contributions pour la garde d’animaux consommant des fourrages grossiers26258,4745 9935,80,03 Contributions générales pour des terrains en pente9934,345 0793,10,00 Contributions pour les surfaces viticoles en forte pente et en terrasses133,02 5462,30,00 Contributions à la compensation écologique1442,287 27012,00,00 Contributions pour la culture extensive de céréales et de colza (culture extensive)4737,634 7865,00,00 Contributions pour la culture biologique77740,0585 6917,30,02 Contributions pour les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux1 86868,01 732 57710,40,07 Contributions pour sorties régulières en plein air2 83664,32 663 0398,30,11 Total8 908 1 37 509 0677,61,51 1sans les doubles comptages Source:OFAG
du type
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 156
■ Exécution et contrôle
L’art.66 de l’ordonnance sur les paiements directs (OPD) délègue aux cantons la tâche de contrôler les prestations écologiques requises (PER).Ces derniers y associent des organismes accrédités présentant toutes garanties de compétence et d'indépendance. Mais ils sont tenus de surveiller l’activité de contrôle par sondage.Les exploitations bio ayant droit aux paiements directs doivent non seulement respecter les exigences de la culture biologique,mais aussi fournir les PER et garder tous leurs animaux de rente selon les prescriptions SRPA.L’art.66,al.4,OPD précise selon quels critères les cantons ou les organismes associés sont tenus de contrôler les exploitations.
Sont ainsi contrôlées: –toutes les exploitations qui demandent des contributions pour la première fois; –toutes les exploitations dans lesquelles des manquements ont été constatés lors de contrôles effectués l’année précédente;et –au moins 30% du reste des exploitations choisies au hasard.
En cas de fourniture insuffisante des PER,les contributions sont réduites selon des critères uniformes qui sont énoncés dans une directive édictée par la Conférence des directeurs cantonaux de l’agriculture.
■ Contrôles et réductions de contributions en 2005
En 2005,sur les 56'330 exploitations agricoles ayant droit aux contributions,29'431 (52,4%) ont été contrôlées par les cantons ou par les services mandatés à cet effet pour s’assurer qu’elles respectaient les prescriptions PER.Cependant,la part des exploitations soumises à un contrôle varie fortement d’un canton à l’autre (de 21 à 100%).Les contributions ont été réduites pour 2'143 exploitations (3,8% des entités contrôlées) en raison de manquements aux prescriptions PER.
Conformément à l’ordonnance sur l’agriculture biologique,toutes les exploitations bio doivent être contrôlées chaque année.Seulement 3,6% d’entre elles ont été pénalisées par une réduction des contributions en raison de manquements.
S’agissant des programmes SST et SRPA,en moyenne les contrôles ont porté respectivement sur 30,5% (11,2 à 100%) et 53,4% (14,9 à 100%) des exploitations ayant droit à des contributions.Les réductions prononcées ont visé 1,4% des exploitations participant au programme SST et 2,4% des exploitations adhérant au programme SRPA.
Au total,des insuffisances ont été constatées dans 6'683 exploitations et ont entraîné des réductions des contributions s’élevant à quelque 9 millions de francs.
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 2.MESURESDEPOLITIQUEAGRICOLE 157
Enregistrements lacunaires,garde d’animaux de rente non respectueuse de l’espèce,autres raisons (échantillons du sol manquants,expiration du délai requis pour le test des pulvérisateurs),bilan de fumure non équilibré,bordures tampons et bandes herbeuses inadéquates,sélection et application non conformes des produits phytosanitaires,annonces tardives,part des SCE inadéquate.
Eléments autres que ceux mentionnés dans la liste (utilisation différente de celle prévue,période de fauche et mesures d’entretien non respectées),utilisation trop précoce ou non admise,fausses indications sur le nombre d’arbres ou les surfaces,envahissement par des mauvaises herbes,fumure et produits phytosanitaires non autorisés,annonces tardives.
Annonces tardives,récolte faite avant maturité des graines,produits phytosanitaires interdits.
Eléments autres que ceux mentionnés dans la liste (infraction aux prescriptions d’affouragement ou concernant la garde d’animaux,la protection des eaux ou les enregistrements,non-respect des prescriptions bio par les entreprises exploitées à titre de loisirs),utilisation d’engrais et de produits phytosanitaires interdits dans la culture biologique, annonces tardives,fausses indications.
Eléments autres que ceux mentionnés dans la liste (litière inadéquate),annonces tardives,absence de système de stabulation à aires multiples,garde non conforme de certains animaux d’une même catégorie, aire de repos insuffisante,éclairage de l’étable non conforme,fausses indications.
Eléments autres que ceux mentionnés dans la liste (durée d’engraissement minimale non respectée,aire de repos avec caillebotis/trous,protection des animaux insuffisante,surface pacagère trop petite,mise au pâturage tardive,etc.),nombre insuffisant de jours de sortie,annonces tardives,enregistrements lacunaires, garde non conforme de certains animaux d’une même catégorie,fausses indications,parcours insuffisant. Charge usuelle en bétail dépassée ou non atteinte, gestion incorrecte des pâturages,utilisation de surfaces non pâturables,infractions aux prescriptions agricoles pertinentes,annonces tardives,épandage d’engrais non autorisés,autres éléments (sur-livraisons de lait), fausses indications sur l’effectif d’animaux ou la durée d’estivage,documents manquants,entretien inadéquat des bâtiments,entraves aux contrôles,données lacunaires,emploi d’herbicides interdits,récidives.
Source:Rapports cantonaux sur les activités de contrôle et les réductions de contributions
contributionsréductions NombreNombreNombrefr. PER56 33029 4312 1432 895 337 SCE 53 403-1 324671 781 Culture 16 9287 19356153 572 extensive Culture 6 3505 944230357 198 biologique SST 38 64311 783520420 534 SRPA 37 70720 127915845 579 Estivage7 3871 5954911 235 282
Récapitulatif des réductions de contributions prononcées en 2005 CatégorieExploitations Exploitations ExploitationsRéductionsRaisons principales ayant droit contrôléessanctionnées aux par des
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 158
Tableaux 42a–42b,pages A50–A51
Récapitulatif des réductions de contributions prononcées en 2005
CatégorieExploitations Exploitations ExploitationsRéductionsRaisons principales ayant droit contrôléessanctionnées aux par des contributionsréductions
Tableaux 42a–42b,pages A50–A51
Fausses indications sur les surfaces ou l’effectif d’animaux,autres éléments (fausses indications concernant les PER,moins de 50%),propre main-d’œuvre, inscriptions à un programme ou désistements tardifs, entraves aux contrôles),fausses indications sur l’exploitation,les exploitants ou l’estivage.
Pas d’indication possible
Pas d’indication possible
Pas d’indication possible
Source:Rapports cantonaux sur les activités de contrôle et les réductions de contributions

NombreNombreNombrefr. Données de--6451 699 717 base Protection--311844 798 des eaux Protection de--2111 876 la nature et du paysage Protection de--2724 600 l’environnement Total--6 683 9 160 274
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 159
■ Autorisations spéciales dans le domaine de la protection des végétaux
Dans certains cas,les services phytosanitaires cantonaux peuvent délivrer des autorisations spéciales en vertu de l’annexe 6.4 de l'ordonnance sur les paiements directs. En 2005,ils en ont accordé 2'269 pour 4'887 ha de SAU.Lors de la dernière révision de l’OPD,les exigences PER concernant les produits phytosanitaires ont été adaptées. Les principales modifications ont porté sur l’emploi d’herbicides dans les cultures céréalières ainsi que sur la lutte contre le criocère des céréales d’après le principe du seuil de tolérance.Cet assouplissement a entraîné une diminution du nombre des autorisations spéciales délivrées.Comme les années précédentes,la plupart de ces autorisations ont été accordées afin de permettre le traitement du rumex et des renoncules dans les prairies naturelles.
Autorisations spéciales accordées dans le domaine de la protection des végétaux en 2005
Moyen de lutteAutorisationsSurface
de produits phytosanitaires pendant l’interdiction de traiter en
contre la mouche de la
1avec des produits autres que ceux énumérés dans les directives de la Conférence des services cantonaux de protection des plantes
2 autorisations spéciales délivrées pour des mesures phytosanitaires qui sont exclues dans les directives spécifiques reconnues
3 les autorisations spéciales accordées en arboriculture fruitière concernent pour la plupart une matière active qui a été autorisée au cours de l’année de culture
NombreExploita-ha% de la surd’exploita-tions face totale tionsen %concernée
Emploi
25511,260712,4 Céréales:lutte
351,5881,8 Colza:lutte
betterave50,270,1 Pommes de terre:lutte
le doryphore 1 662,91072,2 Légumineuses,tabac
les pucerons90,4230,5 Autre lutte anti-parasitaire dans les grandes cultures1787,971514,6 Herbages permanents: traitement de surface1 44863,82 49151 Culture maraîchère 2 100,510,02 Arboriculture fruitière 2,3 1185,23857,9 Viticulture 2 50,220,04 Total2 2691004 887100
Application
hiver1406,24629,5
d’insecticides et de nématicides granulés
contre le criocère des céréales 1
contre
et tournesols:lutte contre
Source:OFAG
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 160
■ Objectif visé:exploitation de toute la surface agricole
2.2.2 Paiements directs généraux
Contributions à la surface
Les contributions à la surface servent à rétribuer les prestations fournies dans l'intérêt général telles que la conservation et l’entretien du paysage rural,la garantie de la production alimentaire et la préservation du patrimoine naturel.Depuis 2001,une contribution supplémentaire pour les terres ouvertes et les cultures pérennes est venue s’y ajouter.

Taux de 2005fr./ha 1
– jusqu’à 30 ha1 200
– de 30 à 60 ha900
– de 60 à 90 ha600
– plus de 90 ha0
1D’un montant de 400 fr.par ha et par an,la contribution supplémentaire allouée pour les terres ouvertes et les cultures pérennes est également soumise à l’échelonnement en fonction des surfaces.
Pour les surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère,les taux de tous les paiements directs liés aux surfaces sont réduits de 25%.Quelque 5'000 ha en tout sont exploités dans cette zone depuis 1984.Les exploitations suisses qui achètent ou afferment aujourd’hui des surfaces dans la zone limitrophe étrangère ne reçoivent pas de paiements directs.
■■■■■■■■■■■■■■■■
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 161
Tableaux 31a–31b,pages A31–A32
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 162
Contributions à la surface versées en 2005 (contribution supplémentaire comprise)
La contribution supplémentaire a été versée pour 275'893 ha de terres ouvertes et 18'334 ha de cultures pérennes.
0,3 0,2 1,1 1,72,4
0,9
plus de 90 60–90 30–60 20–30 15–20 10–15 5–10 jusqu'à 5
Répartition des exploitations et de la SAU selon les classes de grandeur en 2005 Classes de grandeur en ha Exploitations SAU avec contributions intégrales SAU touchée par la dégression
Exploitations en %SAU en % 8,8
12,3 1,1 0,2 0,3 0,9 20,5 18,2 20,6 18,4 1,6
1,72,4 20,4 27,5 17,5 14,2 7,7
6,0
Source: 30 20 10 0201030
ParamètreUnitéRégion de Région desRégion de Total plainecollinesmontagne Surfaceha479 162262 166288 0581 029 386 Exploitationsnombre23 76815 25717 13756 162 Surface par exploitationha20,217,216,818,3 Contribution par exploitationfr.27 46321 41819 84423 496 Total des contributions1 000 fr.652 743326 778340 0741 319 595 Total des contributions 20041 000 fr.650 815326 632340 3271 317 773 Source:OFAG
La dégression des contributions concerne 9,3% de la SAU.Le montant versé au titre de la contribution à la surface s’élève en moyenne à 1'282 francs par ha (contribution supplémentaire incluse).Les exploitations comptant jusqu’à 10 ha couvrent en tout 9,3% de la SAU.Seul 1,3% de l’ensemble des exploitations dispose de plus de 60 ha; celles-ci exploitent 5,3% de la SAU. OFAG
■ Surfaces utilisées comme herbages
Contribution pour la garde d’animaux consommant des fourrages grossiers
Cette mesure vise à préserver la compétitivité des producteurs de viande disposant d’une base fourragère et,en même temps,à assurer l’exploitation de l’ensemble des terres agricoles de la Suisse,pays à vocation herbagère.

Les contributions pour la garde d'animaux consommant des fourrages grossiers sont versées pour des animaux gardés dans l'exploitation durant la période d'affouragement d'hiver (période de référence:du 1er janvier au jour de référence de l'année de contributions).Sont considérés comme animaux consommant des fourrages grossiers les bovins et les équidés,ainsi que les moutons,les chèvres,les bisons,les cerfs,les lamas et les alpagas.Les contributions sont versées en fonction des surfaces herbagères permanentes et des prairies artificielles.Pour ce faire,les diverses catégories d’animaux sont converties en unités de gros bétail consommant des fourrages grossiers (UGBFG) et leur nombre par ha est limité.Cette limitation est échelonnée en fonction des zones.
Limites d’encouragementUGBFG/ha
–Zone de grandes cultures,zone intermédiaire élargie et zone intermédiaire2,0
–Zone des collines1,6
–Zone de montagne I1,4
–Zone de montagne II1,1
–Zone de montagne III0,9
–Zone de montagne IV0,8
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 163
Les UGBFG sont réparties en deux groupes de contributions.Pour les bovins,équidés, bisons,chèvres et brebis laitières,le taux des contributions s’élève à 900 francs par UGBFG,alors qu’il est fixé à 400 francs pour les chèvres et les moutons ainsi que pour les cerfs,les lamas et les alpagas.
versées en 2005 pour la garde d’animaux consommant des fourrages grossiers
En 2005,l’effectif d’animaux des producteurs de lait destiné à la commercialisation, qui donnait droit aux contributions,a été réduit d'une UGBFG par 4’400 kg de lait livrés l'année précédente.
Contributions versées en 2005 aux exploitations avec et sans lait commercialisé
ParamètreUnitéExploitations avec Exploitations sans commercialisationcommercialisation Exploitationsnombre16 97418 789
Animaux par exploitationUGBFG24,113,3
Déduction pour limitation des contributions en fonction de la surface herbagèreUGBFG1,21,2
Déduction pour lait commercialiséUGBFG16,10,0 Animaux donnant droit aux contributionsUGBFG6,812,2
Contributions par exploitationfr.5 97110 145
Source:OFAG
Certes,les entreprises qui commercialisent du lait touchent environ 4'175 francs de moins de contributions UGBFG que celles qui ne le font pas.Mais elles bénéficient en revanche de mesures de soutien du marché laitier (p.ex.supplément pour le lait transformé en fromage).
Contributions
ParamètreUnitéRégion
plainecollinesmontagne UGBFG donnant droit aux contributionsnombre98 73888 121157 347344 206 Exploitationsnombre10 08010 44715 23635 763 UGBFG donnant droit aux contributions par exploitationnombre9,88,410,39,6 Contributions par exploitationfr.8 3927 2078 6708 164 Total des contributions1 000 fr.84 58875 287132 093291 967 Total des contributions 20041 000 fr.79 84873 487132 785286 120 Source:OFAG
de Région desRégion de Total
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 164
Contribution pour la garde d’animaux dans des conditions difficiles
Ces contributions servent à compenser les conditions de production difficiles des éleveurs dans la région de montagne et dans la zone des collines.A la différence des contributions «générales» allouées pour la garde d’animaux de rente consommant des fourrages grossiers et destinées en premier lieu à promouvoir l’exploitation et l’entretien des herbages,celles-ci visent des objectifs à caractère social ou structurel ou relevant de la politique d’occupation du territoire.Donnent droit aux contributions les mêmes catégories d’animaux que dans le cas des contributions versées pour la garde d’animaux consommant des fourrages grossiers.Ces contributions sont versées pour 20 UGBFG au plus par exploitation.

Taux par UGBFG en 2005fr./UGB
– Zone des collines260
– Zone de montagne I440
– Zone de montagne II690
– Zone de montagne III930
– Zone de montagne IV1 190
■
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 165
Compensation des difficultés de production
Contributions versées en 2005 pour la garde d’animaux dans des conditions difficiles ParamètreUnitéRégion de Région desRégion de Total plaine 1 collinesmontagne
Comparé à 2004,les contributions allouées pour la garde d’animaux dans des conditions difficiles ont baissé d’environ 1,8 millions de francs par suite de l’évolution structurelle.En conséquence,les UGBFG donnant droit aux contributions ont diminué de 2'959 unités.De même,le recul du nombre des exploitations s’est poursuivi (–475 unités).
Répartition des animaux consommant des fourrages grossiers dans des conditions de production difficiles en 2005, selon les classes de grandeur
jusqu'à 5 Exploitations en 100Animaux en milliers d'UGBFG
Exploitations (en %) Animaux (en milliers) donnant droit aux contributions Animaux (en milliers) ne donnant pas droit aux contributions
Source:OFAG
En 2005,66% du cheptel UGBFG étaient gardées dans des exploitations ayant droit aux contributions et concernées par cette limitation.Dans ces dernières,la part des UGBFG ne donnant pas droit aux contributions s’est élevée à 33%.
UGBFG donnant droit aux contributionsnombre50 504228 463240 408519 375 Exploitationsnombre2 84214 41116 49033 743 UGBFG par exploitationnombre17,815,914,615,4 Contributions par exploitationfr.1 5825 49012 0458 364 Total des contributions1 000 fr.4 49679 109198 615282 220 Total des contributions 20041 000 fr.4 42579 473200 125284 023
Entreprises
1
exploitant une partie des surfaces dans la région de montagne et des collines Source:OFAG
5–10 10–15 15–20 20–30 30–45 45–90 plus de 90
Classes de grandeur en UGBFG
100 50 0 050100150200250 9 41 71 1080 16535 8762 3650 57 55 24 62 82 42 15 7 3 2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 166
■ Contributions générales pour des terrains en pente:compensation des difficultés dans l’exploitation des surfaces
Contributions pour des terrains en pente
Les contributions générales pour des terrains en pente rétribuent l’exploitation des terres dans des conditions difficiles dans la région des collines ou celle de montagne. Elles ne sont versées que pour les prairies,les surfaces à litière et les terres assolées. Les prairies doivent être fauchées au moins une fois par an,les surfaces à litière une fois par an au plus et tous les trois ans au moins.Selon leur déclivité,les terrains en pente sont répartis en deux catégories:
Contributions versées en 2005 pour des terrains en pente
1Exploitations disposant de surfaces situées dans la région de montagne et des collines
Exploitations ayant reçu des contributions pour des terrains en pente en 2005
déclivité inférieure à 18% 60%
de 18 à 35%
L’étendue des surfaces annoncées varie légèrement d’une année à l’autre,évolution qui dépend surtout des conditions climatiques et de leur impact sur le type d’exploitation (plus ou moins de pâturages ou de prairies de fauche).
2.MESURESDEPOLITIQUEAGRICOLE 2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 167
Taux de 2005fr./ha – Déclivité de 18 à 35%370 – Déclivité de plus de 35%510
ParamètreUnitéRégion de Région desRégion de Total plaine 1 collinesmontagne Surfaces donnant droit aux contributions: – déclivité de 18 à 35%ha4 42565 26874 322144 016 – déclivité de plus de 35%ha1 33218 26361 81381 408 Totalha5 75783 532136 135225 424 Exploitationsnombre2 04713 65715 92231 626 Contribution par exploitationfr.1 1322 4503 7052 997 Total des contributions1 000 fr.2 31733 46058 99194 768 Total des contributions 20041 000 fr.2 27633 73059 30295 308
Source:OFAG
déclivité
26% déclivité
Source: OFAG 14%
de
35% et plus
Total 562 122 ha
■ Contributions pour les surfaces viticoles en pente:préservation des surfaces viticoles en forte pente et en terrasses
Ces contributions aident à préserver les vignobles plantés en forte pente et en terrasses. Afin d’apprécier correctement les surfaces viticoles pour le calcul des contributions,il convient de faire la distinction entre,d’une part,les fortes et les très fortes pentes et, d’autre part,les terrasses aménagées sur des murs de soutènement.Pour les vignobles en forte pente et en terrasses,les contributions ne sont allouées qu’à partir d’une déclivité de 30%.Les taux des contributions sont fixés indépendamment des zones.
Contributions versées en 2005 pour les vignes en forte pente et en terrasses
50
La part des surfaces viticoles en forte pente et en terrasses,qui donnent droit aux contributions,représente quelque 30% de la surface viticole totale,et le nombre d’exploitations 52% de l’ensemble des exploitations viticoles.
Taux de 2005fr./ha – Surfaces de 30 à
% de déclivité1 500 – Surfaces de plus de 50 % de déclivité3 000 – Surfaces en terrasses5 000
50
Unité Surfaces donnant droit aux contributions,totalha3 629 Surfaces en forte pente,déclivité de
à
834 Surfaces en forte pente,déclivité de plus
Aménagements en terrassesha1 460 Exploitationsnombre2 908 Surface par exploitationha1,25 Contributions par exploitationfr.3 802 Total des contributions1 000 fr.11 056 Total des contributions 20041 000 fr.10 691 Source:OFAG
30
50 %ha1
de
%ha335
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 168
2.2.3Paiements directs écologiques
Contributions écologiques
Les paiements directs écologiques rétribuent des prestations écologiques particulières qui dépassent le cadre des PER.Les exploitants peuvent choisir librement de participer aux différents programmes qui leur sont proposés.Ceux-ci sont indépendants les uns des autres,les contributions pouvant être cumulées.

Total 409,3 mio. de fr.
extensive 8%
Source: OFAG
■■■■■■■■■■■■■■■■
Tableaux 32a–32b,pages A33–A34 Répartition des contributions écologiques entre les programmes en 2005
Compensation
Culture
SRPA 35% SST 12% Culture
OQE 7% 2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 169
écologique 31%
biologique 7%
Compensation écologique
La compensation écologique vise à préserver et,si possible,à élargir l’espace vital de la faune et de la flore suisses dans les régions agricoles.De surcroît,elle contribue au maintien des structures et des éléments typiques du paysage.Certains éléments de la compensation écologique sont rétribués par des contributions et peuvent simultanément être imputés à la compensation écologique obligatoire des PER,alors que d’autres sont imputables à cette dernière mais ne donnent pas droit aux contributions.
Eléments de la compensation écologique,donnant droit ou non à des contributions
Eléments imputables aux PER Eléments imputables aux PER et donnant droit aux contributions sans donner droit aux contributions prairies extensivespâturages extensifs prairies peu intensivespâturages boisés surfaces à litièrearbres isolés indigènes adaptés au site et allées d'arbres haies,bosquets champêtres fossés humides,mares,étangs et berges boisées jachères floralessurfaces rudérales,tas d’épierrage et affleurements rocheux jachères tournantesmurs de pierres sèches bandes culturales extensiveschemins naturels non stabilisés arbres fruitiers haute-tigesurfaces viticoles à haute diversité biologique autres surfaces de compensation écologique faisant partie de la SAU,définies par le service cantonal de protection de la nature
Ces surfaces ne doivent pas être fertilisées et peuvent être utilisées pendant six ans au plus tôt à partir de la mi-juin à la mi-juillet,selon la zone.La fauche tardive a pour but de garantir que les semences arrivent à maturité et que leur dispersion naturelle favorise la diversité des espèces.Elle laisse par ailleurs suffisamment de temps à de nombreux invertébrés,aux oiseaux nichant au sol et aux petits mammifères pour leur reproduction.
Les contributions versées pour les prairies extensives,les surfaces à litière,les haies et les bosquets champêtres sont réglées de manière uniforme et échelonnées selon les zones où se trouve la surface.La part des prairies extensives n’a cessé d’augmenter au cours des dernières années.
Taux de 2005fr./ha
– Zone de grandes cultures et zones intermédiaires1 500
– Zone des collines1 200
– Zones de montagne I et II700
– Zones de montagne III et IV450
Tableaux 33a–33d,pages A35–A38
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 170
■ Prairies extensives
■ Surfaces à litière
Contributions versées en 2005 pour les prairies extensives
■ Haies,bosquets champêtres et berges boisées
Par surfaces à litière,on entend les surfaces exploitées de manière extensive,situées dans des lieux humides et marécageux et qui,en règle générale,sont fauchées en automne ou en hiver pour la production de litière.
Contributions versées en 2005 pour les surfaces à litière
Par haies,bosquets champêtres et berges boisées,on entend les haies basses,les haies arbustives et arborées,les brise-vents,les groupes d’arbres,les talus et les berges boisées.Ces surfaces doivent être exploitées de manière adéquate et convenablement entretenues pendant six ans,sans interruption.
Contributions versées en 2005 pour les haies,bosquets champêtres et berges boisées
de Région desRégion de Total plainecollinesmontagne
ParamètreUnitéRégion de Région desRégion
plainecollinesmontagne Exploitationsnombre19 0349 84510 11638 995 Surfaceha26 20810 72915 28252 219 Surface par exploitationha1,381,091,511,34 Contribution par exploitationfr.2 0161 1118021 473 Total des contributions1 000 fr.38 38110 9388 11657 434 Total des contributions 20041 000 fr.36 93110 4817 85755 269 Source:OFAG
de Total
ParamètreUnitéRégion de Région
Exploitationsnombre1 8691 9673 1707 006 Surfaceha1 8741 5273 5646 964 Surface par exploitationha1,000,781,120,99 Contribution par exploitationfr.1 470755707924 Total des contributions1 000 fr.2 7471 4852 2426 474 Total des contributions 20041 000 fr.2 7541 4402 2546 448 Source:OFAG
desRégion de Total plainecollinesmontagne
Exploitationsnombre5 7012 9711 2119 883 Surfaceha1 3827733022 457 Surface par exploitationha0,240,260,250,25 Contribution par exploitationfr.358269165308 Total des contributions1 000 fr.2 0437982003 041 Total des contributions 20041 000 fr.2 0167721942 981
ParamètreUnitéRégion
Source:OFAG
2.MESURESDEPOLITIQUEAGRICOLE 2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 171
■ Prairies peu intensives
Les prairies peu intensives peuvent être légèrement fertilisées avec du fumier ou du compost.
Taux de 2005fr./ha
– Zone de grandes cultures à zone des collines650
– Zones de montagne I et II450
– Zones de montagne III et IV300
Contributions versées en 2005 pour les prairies peu intensives ParamètreUnitéRégion de Région desRégion de Total plainecollinesmontagne
■ Jachères florales
Par jachères florales,on entend les bordures pluriannuelles de 3 m de largeur au moins, ensemencées d'herbacées sauvages indigènes et non fertilisées.Ces jachères servent à protéger les herbacées sauvages menacées.Elles offrent également habitat et nourriture aux insectes et autres petits animaux.De surcroît,elles servent de refuge aux lièvres et aux oiseaux.Les jachères florales donnent droit à une contribution de 3'000 fr./ha pour les surfaces affectées aux grandes cultures,y compris la zone des collines.
Contributions versées en 2005 pour les jachères florales
ParamètreUnitéRégion de Région desRégion de Total plainecollinesmontagne1
Exploitationsnombre7 4277 6549 77124 852 Surfaceha6 5576 90618 77332 236 Surface par exploitationha0,880,901,921,30 Contribution par exploitationfr.566498651579 Total des contributions1 000 fr.4 2043 8086 36514 378 Total des contributions 20041 000 fr.4 5224 0256 56015 107 Source:OFAG
Exploitationsnombre2 08941042 503 Surfaceha1 98033832 321 Surface par exploitationha0,950,820,800,93 Contribution par exploitationfr.2
4082 781 Total des contributions1 000 fr.5 9391 013106 961 Total des contributions 20041 000 fr.6 2441 03757 286 1Il s’agit d’entreprises exploitant
Source:OFAG
8432 4702
des surfaces dans la zone des collines ou la région de plaine.
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 172
■ Jachères tournantes
Par jachères tournantes,on entend des surfaces non fertilisées qui sont ensemencées d'herbacées sauvages indigènes,accompagnatrices de cultures,pendant un ou deux ans;elles doivent présenter une largeur de 6 m au moins et couvrir au minimum 20 ares. Ces jachères offrent un habitat aux oiseaux couvant au sol,aux lièvres et aux insectes. L’enherbement naturel est également possible à des endroits propices.Dans la zone des grandes cultures et la zone des collines,les jachères tournantes donnent droit à une contribution de 2'500 fr./ha.
Contributions versées en 2005 pour les jachères tournantes
ParamètreUnitéRégion de Région desRégion de Total plainecollines1 montagne1
Exploitationsnombre5711091681
Surfaceha7501421893
1Il s’agit d’entreprises situées dans la région des collines et de montagne,mais exploitant une partie de leurs surfaces dans la région de plaine.
Source:OFAG
■ Bandes culturales extensives
Les bandes culturales extensives offrent un espace de survie aux herbacées accompagnant traditionnellement les cultures.On entend par là des bandes de cultures des champs (céréales,colza,tournesols,pois protéagineux,féveroles et soja,sans le maïs), d’une largeur de 3 à 12 m et exploitées de manière extensive.Un montant de 1'500 francs a été versé par ha.
Bandes culturales extensives
ParamètreUnitéRégion de Région desRégion de Total plainecollines1 montagne1
Exploitationsnombre7821099
Surfaceha456051
Surface par exploitationha0,570,310,000,52
Contribution par exploitationfr.8604590775
Total des contributions1 000 fr.6710077
Total des contributions 20041 000 fr.458053
Source:OFAG
Total des contributions1 000 fr.1 87535532 233 Total des contributions 20041 000 fr.2 26140772 673
Surface par exploitationha1,311,301,001,31 Contribution par exploitationfr.3 2833 2602 5003 279
1Il s’agit d’entreprises exploitant des surfaces situées en plaine ou dans la région des collines.
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 2.MESURESDEPOLITIQUEAGRICOLE 173
■ Arbres fruitiers haute-tige
La Confédération verse des contributions pour les arbres haute-tige de fruits à noyau ou à pépins ne faisant pas partie d’une culture fruitière,ainsi que pour les châtaigneraies et les noiseraies entretenues.En 2005,un montant de 15 francs a été alloué par arbre annoncé.
Contributions versées en 2005 pour les arbres fruitiers haute-tige
ParamètreUnitéRégion de Région desRégion de Total plainecollinesmontagne
■ Aperçu des surfaces de compensation écologique 2005
Répartition des surfaces de compensation écologique1 en 2005
Total 97 142 ha
Jachères tournantes 0,9%
Jachères florales 2,4%
Prairies peu intensives 33,2%
Bosquets champêtres et rives boisées 2,5%
Bandes culturales extensives 0,1%
Prairies extensives 53,8%
Surfaces à litière 7,2%
Source: OFAG 1 sans les arbres fruitiers haute-tige
Répartition des surfaces de compensation écologique selon les régions en 2005
Région de Région des Région de plainecollinesmontagne ha% deha% deha% de Elémentsla SAUla SAUla SAU
Jachères florales1 9800,403380,1330,00
Jachères tournantes7500,151420,0510,00
Prairies peu intensives6 5571,316 9062,5718 7736,42
Bosquets champêtres et berges boisées1 3820,287730,293020,10
Bandes culturales extensives450,0160,0000,00
Prairies extensives26 2085,2310 7293,9915 2825,22
Surfaces à litière1 8740,371 5270,573 5641,22
Total38 7967,7420 4217,6037 92412,96
Source:OFAG
Exploitationsnombre16 76012 5385 48134 779 Arbresha1 181 444905 980274 5182 361 942 Arbres par exploitationha70,4972,2650,0967,91 Contribution par exploitationfr.1 0571 0847511 019 Total des contributions1 000 fr.17 71813 5904 11835 426 Total des contributions 20041 000 fr.18 04013 6864 12235 848 Source:OFAG
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 174
Ordonnance sur la qualité écologique
Afin de conserver et de promouvoir la richesse naturelle des espèces,la Confédération alloue des aides financières pour les surfaces de compensation écologique d’une qualité biologique particulière aménagées sur la SAU et pour leur mise en réseau.Il appartient aux cantons de fixer les exigences que doivent remplir les surfaces pour donner droit à des contributions selon l’ordonnance sur la qualité écologique (OQE),et à la Confédération de vérifier les prescriptions cantonales sur la base de critères minimaux.En fonction de la capacité financière des cantons,le montant de ces aides se situe entre 70 et 90% des contributions imputables,les 10 à 30% restants devant être pris en charge par des tiers (cantons,communes,particuliers,organismes).Les contributions à la qualité biologique peuvent être cumulées avec celles versées pour la mise en réseau. L’OQE se fonde sur le caractère facultatif de la compensation écologique,sur des incitations financières et sur la prise en considération des différences régionales eu égard à la biodiversité.
Taux imputables
Taux de 2005fr.
– Pour la qualité biologique500.–/ha
– Pour la qualité biologique des arbres fruitiers haute-tige20.–/arbre
– Pour la mise en réseau500.–/ha
Une surface de compensation écologique contribue particulièrement à la préservation et à la promotion de la biodiversité lorsqu'elle présente des espèces indicatrices et des éléments de structure déterminés ou encore lorsque son emplacement est judicieux du point de vue écologique.L'exploitant peut annoncer directement sa surface de compensation écologique au titre de la qualité biologique;par contre,la mise en réseau de ces surfaces exige une stratégie portant sur un ensemble qui justifie cette mesure sur les plans paysager et écologique.
Contributions 1 versées en 2005 en vertu de l'ordonnance sur la qualité écologique
ParamètreUnitéRégion de Région desRégion de Total plainecollinesmontagne
Exploitationsnombre9 0347 4439 03525 512 Surface 2 ha12 99411 64325 96850 605 Surface 2 par exploitationha1,441,562,871,98 Contribution par exploitationfr.9741 0931 1631 076 Total des contributions1 000 fr.8 8028 13310 50727 442 Total des contributions 20041 000 fr.7 3096 7968 90223 007
1sans prise en considération des réductions,des remboursements et des arriérés 2 conversion des arbres haute-tige (1 arbre = 1 are)
2.MESURESDEPOLITIQUEAGRICOLE 2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 175
Source:OFAG
Contributions 1 versées en 2005 pour la qualité biologique et la mise en réseau
Mise en Qualité biologique réseaubiologique et mise en réseau 2 Prairies extensives,prairies peu intensives et surfaces à litière
Haies,bosquets champêtres et berges boisées
Autres éléments
922-
000 fr.-2 366-
1 sans prise en considération des réductions,des remboursements et des arriérés
2 combinaison des deux programmes Source:OFAG
Exploitationsnombre10 21110 2216
Surfaceha16 04910 36811 740 Contributions1 000 fr.5 1873 8757 251
Exploitationsnombre5362 044895 Surfaceha117419218 Contributions1
Exploitationsnombre3 9287 3643 099 Arbresnombre233 283256 776171 746 Contributions1 000 fr.3 8101 0813 469
Exploitationsnombre-5
Surfaceha-4
ParamètreUnitéQualité
000
000 fr.46178179 Arbres fruitiers haute-tige
100-
Contributions1
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 176
Tableau 34,page A39
Culture extensive de céréales et de colza
Cette mesure a pour objectif d’inciter les cultivateurs à renoncer,dans la culture de céréales et de colza,aux régulateurs de croissance,aux fongicides,aux stimulateurs chimiques de synthèse des défenses naturelles et aux insecticides.En 2005,la contribution s’est élevée à 400 francs par hectare.

Contributions versées en 2005 pour la culture extensive de céréales et de colza
Répartition de la surface de cultures extensives en 2005
ParamètreUnitéRégion de Région desRégion de Total plainecollinesmontagne Exploitationsnombre10 2095 96875116 928 Surfaceha55 39821 8151 88979 102 Surface par exploitationha5,433,662,524,67 Contribution par exploitationfr.2 1601 4601 0061 862 Total des contributions1 000 fr.22 0498 71175631 516 Total des contributions 20041 000 fr.21 5348 54774330 824 Source:OFAG
Céréales panifiables 54% Colza 6% Céréales fourragères 40% Source: OFAG Total 79 102 ha Tableau 35,page A40 2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 177
Culture biologique
En complément des recettes supplémentaires que l’agriculture biologique peut réaliser sur le marché,la Confédération encourage celle-ci comme mode de production particulièrement respectueux de l’environnement.Du reste,les exploitants doivent appliquer les règles de l’ordonnance sur l’agriculture biologique s’ils veulent obtenir des contributions.
L'agriculture biologique renonce complètement à l’emploi de matières auxiliaires chimiques de synthèse comme les engrais de commerce ou les pesticides,ce qui permet d'économiser l'énergie et de préserver l'eau,l'air et le sol.La prise en considération des cycles et procédés naturels est donc d’une importance cruciale pour l’agriculteur bio. Si l’agriculteur utilise davantage d’énergie pour l’infrastructure et pour les machines,il exploite cependant les ressources de manière plus efficace.Cette efficacité constitue un indicateur important de la durabilité du système de production.
En renonçant aux herbicides,l’agriculture biologique favorise le développement de nombreuses espèces messicoles.Les surfaces dont la flore est diversifiée offrent de la nourriture à un plus grand nombre de petits organismes qui constituent,à leur tour, une proie pour les prédateurs arthropodes tels les carabidés,et créent ainsi de bonnes conditions pour la lutte naturelle contre les parasites.Grâce à la présence de plantes, d’animaux et de micro-organismes en plus grand nombre,l'écosystème est en mesure de mieux résister aux perturbations et au stress.
L'agriculteur bio épand de la fumure organique,travaille le sol avec ménagement,renonce aux produits phytosanitaires et favorise par là le développement et la variété des organismes du sol.L'activité biologique augmente la fertilité du sol:elle contribue en effet à enrichir la couche d'humus,à améliorer la structure du sol et à réduire l'érosion.
Pour faire co-exister de manière harmonieuse les plantes,le sol,les animaux et l'homme,l'agriculteur bio veille à ce que les circuits d'éléments nutritifs fonctionnent en boucle fermée dans son exploitation,en faisant coïncider la base fourragère de son entreprise agricole avec le nombre d'animaux qu'il détient.Autre aspect important:la culture de légumineuses améliore l’offre en azote dans le sol.Par ailleurs,les engrais de ferme et le matériel organique provenant des engrais verts et des résidus de récolte garantissent aux plantes un apport équilibré en éléments nutritifs par le biais des organismes du sol.
Quant à l'élevage des animaux de rente,celui-ci doit satisfaire aux exigences du programme SRPA qui,en agriculture biologique,sont considérées comme un minimum à observer.Ce programme interdit en outre le recours aux appareils à décharges électriques (dresse-vaches) et l'administration d'aliments médicamenteux aux animaux.En utilisant essentiellement les fourrages produits dans l’exploitation,l’agriculteur bio obtient un rendement raisonnable et garde des animaux en bonne santé. Autre particularité:il applique en premier lieu des méthodes thérapeutiques naturelles en cas de besoin.
En 2005,10,8% de la SAU totale ont été cultivés selon les règles de l’agriculture biologique.
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 178
Taux de 2005fr./ha – cultures spéciales1 200 – terres ouvertes,cultures spéciales exceptées800 – surfaces herbagères et surfaces à litière200
Contributions versées en 2005 pour l’agriculture biologique
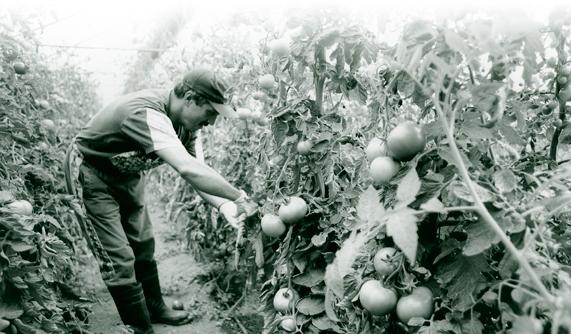
Part de la surface exploitée selon les règles de la culture biologique, par région en 2005
115 387 ha
60%
21%
ParamètreUnitéRégion
Exploitationsnombre1 1981 4383 7146 350 Surfaceha21 66823 88169 838115 387 Surface par exploitationha18,0916,6118,8018,17 Contribution par exploitationfr.7 2854 0823 7704 504 Total des contributions1 000 fr.8 7285 86914 00428 601 Total des contributions 20041 000 fr.8 5275 68313 75227 962 Source:OFAG
de Région desRégion de Total plainecollinesmontagne
Tableau 32a,page A33
Région
Région
Total
Région
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 179
de plaine 19%
de montagne
Source: OFAG
des collines
■ Systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux (SST)
Garde d’animaux de rente particulièrement respectueuse de l’espèce
Les deux programmes SST et SRPA décrits ci-dessous (cf.aussi paragraphe 1.3.2) sont regroupés sous ce titre.
La Confédération encourage les agriculteurs à garder les animaux dans des systèmes de stabulation qui répondent à des exigences dépassant largement le niveau requis dans la législation relative à la protection des animaux.
Taux de 2005fr./UGB
– bovins,veaux exceptés,chèvres,lapins90 – porcs155 – poules pondeuses,poulettes et jeunes coqs,poules et coqs d'élevage,poussins280 – poulets de chair et dindes180
Contributions versées en 2005 pour les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux
■ Sorties régulières en plein air (SRPA)
La Confédération encourage les sorties régulières des animaux de rente en plein air, c’est-à-dire sur un pâturage,dans une aire d'exercice ou à climat extérieur,répondant aux besoins des animaux.
Taux de 2005fr./UGB
– bovins et équidés,bisons,moutons,chèvres,daims et cerfs rouges,lapins180 – porcs155 – volaille280
ParamètreUnitéRégion de Région desRégion de Total plainecollinesmontagne Exploitationsnombre8 6005 5793 66117 840 UGBnombre235 679121 44159 530416 650 UGB par exploitationnombre27,4021,7716,2623,35 Contribution par exploitationfr.3 1302 5071 6902 640 Total des contributions1 000 fr.26 91913 9846 18647 089 Total des contributions 20041 000 fr.26 71013 6366 17146 517 Source:OFAG
Tableau 36,page A41
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 180
■
Tableaux 39a–39b,pages A44–A45
Contributions versées en 2005 pour les sorties régulières en plein air
de Région desRégion de Total plainecollinesmontagne
Contributions d’estivage
Les contributions d’estivage ont pour objectif d’assurer l’exploitation et l’entretien de nos vastes pâturages d'estivage dans les Alpes,les Préalpes et le Jura.La région d'estivage est utilisée et entretenue par quelque 300'000 UGB.La charge en bétail est fixée selon les principes d’une exploitation durable;c’est ladite charge usuelle.Les contributions sont versées par pâquier normal (PN) calculé à partir de la charge usuelle.Un PN correspond à l’estivage d’une UGB pendant 100 jours.
Taux de 2005fr.
–vaches traites,chèvres et brebis laitières,par UGB (56 à 100 jours d’estivage)300 –moutons,brebis laitières exceptées,par PN – surveillance permanente par le berger300 – pâturages tournants220 – autres pâturages120
–autres animaux consommant des fourrages grossiers, par PN300
Contributions d’estivage versées en 2005
ParamètreContributionsExploitationsUGB ou PN 1 000 fr.nombrenombre
traites,brebis laitières,
1Il s’agit ici du total des exploitations d’estivage ayant droit aux contributions (sans doubles comptages) Source:OFAG
ParamètreUnitéRégion
Exploitationsnombre13 90911 16112 63737 707 UGBnombre361 012255 943227 993844 948 UGB par exploitationnombre25,9622,9318,0422,41 Contribution par exploitationfr.4 5144 0423 2273 943 Total des contributions1 000 fr.62 78145 11640 781148 678 Total des contributions 20041 000 fr.60 83743 62536 672144 134 Source:OFAG
Vaches
chèvres laitières16 2102 15554 155 Moutons,brebis laitières exceptées 4 84797524 644 Autres animaux consommant des fourrages grossiers70 5536 755235 356 Total91 6107 387 1 Total 200491 0667 449 1
Tableau 36,page A41
Exploitation durable des régions d’estivage
2.MESURESDEPOLITIQUEAGRICOLE 2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 181
Des contributions d’estivage,dont le montant varie en fonction du système de pacage, sont versées pour les moutons (brebis laitières exceptées) depuis l’année de contributions 2003.L’octroi de contributions plus élevées permet,d’une part,de rétribuer les frais plus importants qu’occasionnent la présence de bergers et les pâturages tournants et,d’autre part,par analogie avec les contributions écologiques,d’inciter les agriculteurs à pratiquer l’estivage durable des moutons.La garde permanente des moutons signifie que le troupeau est mené par un berger accompagné de chiens,et conduit quotidiennement à un pâturage choisi par le berger.Dans le cas de pâturages tournants,le pacage se fait pendant toute la durée de l’estivage dans des enclos entourés d’une clôture ou clairement délimités par des conditions naturelles.
Estivage de moutons en fonction des systèmes de pacage en 2005
de l’estivage entre 2000 et 2005: exploitations et animaux estivés en pâquiers normaux,
Système de pacageExploitationsAnimaux don- Contributions nant droit aux contributions nombrePNfr. Présence d’un berger en permanence796 9372 081 011 Pâturages tournants1965 6161 233 313 Autres pâturages68111 1081 328 901 Combinaison de systèmes de pacage19983203 412 Total97524 6444 846 637 Total 20041 00524 5404 703 163 Source:OFAG
selon les catégories d’animaux Année200020012002200320042005 Catégorie d’animauxUnité Vaches laitièresExploitat.4 9614 7124 6004 4904 3534 301 PN118 793118 021116 900116 679111 123112 858 Vaches mères et Exploitat.1 2801 1601 2271 3541 4341 512 nourricesPN13 85414 48615 71517 94918 90421 227 Autres bovinsExploitat.6 6846 4536 5036 4256 3586 319 PN134 457129 217127 946126 910121 169120 421 EquidésExploitat.1 1321 0861 0751 0841 0631 079 PN4 6524 3154 3644 3404 3474 515 MoutonsExploitat.1 1731 1451 1041 1501 1111 076 PN29 67826 17224 71026 63325 81326 856 ChèvresExploitat.1 7001 6231 6671 6691 6571 648 PN5 1655 2145 4345 6625 6645 977 Autres animaux Exploitat.22289277241240236 estivésPN60899764735541496 Un PN = 1 UGB * durée d’estivage / 100 jours Source:OFAG 2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 182
Evolution
■ Eviter le lessivage et le ruissellement de substances
Contributions pour la protection des eaux
L’art.62a de la loi sur la protection des eaux habilite la Confédération à indemniser les agriculteurs pour les mesures qu’ils prennent afin d’éviter le lessivage et le ruissellement de substances dans les eaux superficielles et souterraines.Il s’agit en priorité de réduire la charge en nitrates de l’eau potable et la charge en phosphore des eaux superficielles dans les régions où les PER,l’agriculture biologique,les interdictions et les prescriptions contraignantes ou les programmes volontaires encouragés par la Confédération (production extensive,compensation écologique) ne suffisent pas.Entretemps,divers projets ont été prolongés pour une seconde période de six ans.Quant au nouveau projet lancé à Boiron,près de Morges,il vise à empêcher le ruissellement des produits phytosanitaires dans les eaux.
Par ailleurs,l’ordonnance sur la protection des eaux oblige les cantons à délimiter une aire d’alimentation pour les captages d’eaux souterraines et de surface,et à déterminer les mesures nécessaires à un assainissement,si la qualité des eaux est insuffisante.Ces différentes mesures peuvent,par rapport à l’état de la technique,entraîner des restrictions considérables dans l’utilisation du sol et causer des pertes financières que les exploitations agricoles ne peuvent supporter.Les contributions fédérales aux coûts sont fixées à 80% pour les adaptations structurelles et à 50% pour les mesures d’exploitation.En 2005,elles se sont élevées à quelque 6,1 millions de francs.

2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 183
Aperçu des projets 2005
CantonRégion,Durée probable SubstanceRégion visée Coûts totaux Contributions communedu projetpar le projetprévusversées en 2005
Annéehafr.fr. AGBaldingen2004–2009Nitrate69281 40024 399 AGBirrfeld2002–2007Nitrate8131 909 500139 946 AGWohlenschwil2001–2009Nitrate62547 69651 967 BEWalliswil2000–2005Nitrate54513 80046 720 FRAvry-sur-Matran2000–2011 1 Nitrate37405 73927 463 FRCourgevaux2003–2008Nitrate27164 83820 880 FRDomdidier2004–2009Nitrate30195 58825 564 FRFétigny2004–2009Nitrate631 526 110444 291 FRLurtigen2005–2010Nitrate2861 218 964136 227 FRMiddes2000–2012 1 Nitrate45369 85323 543 FRSalvenach2005 2 Nitrate13,5202 3345 Versement à partir de 2006 LULac de Baldegg2000–2010 1 Phosphore5 60018 800 7821 600 000 LULac de Sempach2005–2010 1 Phosphore4 90517 577 4551 400 000 LU/AGLac de Hallwil2001–2006 1 Phosphore3 7864 283 7321 447 981 SHKlettgau2001–2006Nitrate3571 866 870198 944 SOGäu I2000–2008 1 Nitrate6582 220 050177 627 SOGäu II2003–2008Nitrate8501 217 040132 668 VDBavois2005–2010Nitrate5178 9855 647 VDBofflens2005–2010Nitrate112580 10061 942 VDBoiron/Morges2005–2010Produits 2 2501 313 10010 217 phyto-sanitaires VDMorand2000–2007Nitrate3911 572 848125 974 VDThierrens1999–2011 1 Nitrate17333 57017 614 ZHBaltenswil2000–2008 1 Nitrate et produits 130712 00032 776 phyto-sanitaires Total 58 134 3256 152 390 Total 2004 5 520 501 1 Prolongation décidée 2 Projet s’inscrivant dans le cadre d’un remaniement parcellaire
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 184
Source:OFAG
2.3Amélioration des bases de production
Les mesures prises à ce titre encouragent et soutiennent les agriculteurs afin de permettre une production de denrées alimentaires efficiente et respectueuse de l’environnement,ainsi que l’accomplissement des multiples tâches qu’ils assument.
Amélioration des bases de production:aides financières
Mesure200420052006 en millions de fr.
Contributions pour améliorations structurelles958589
Crédits d’investissements766869
Aide aux exploitations paysannes9211
Aides à la reconversion professionnelle-0,13
Vulgarisation et contributions à la recherche242423
Lutte contre les maladies et parasites des plantes333
Sélection végétale et élevage222323
Total229205,1221
Source:OFAG
Ces mesures visent à atteindre les objectifs suivants:
–amélioration de la compétitivité par l’abaissement des coûts de production; –promotion de l’espace rural;
–structures d’exploitation modernes et surfaces agricoles utiles bien desservies; –production efficiente et respectueuse de l’environnement;
–variétés à rendement élevé,aussi résistantes que possible,et produits de haute qualité;
–protection de la santé humaine et animale,ainsi que de l’environnement; –diversité génétique.

■■■■■■■■■■■■■■■■
185 2.3 AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2
■ Projets pilotes de développement régional: premières expériences
2.3.1Améliorations structurelles et mesures d’accompagnement social
Améliorations structurelles
Les améliorations structurelles contribuent à améliorer les conditions de vie et la situation économique du monde rural,notamment en montagne et dans les régions périphériques.
Les aides à l’investissement sont accordées au titre de l’aide à l’entraide pour des mesures aussi bien individuelles que collectives.Deux instruments sont ainsi à disposition: –les contributions (à fonds perdu) exigeant la participation des cantons,surtout pour des mesures collectives; –les crédits d’investissements octroyés sous la forme de prêts sans intérêts,principalement pour des mesures individuelles.
Les aides à l’investissement servent à financer les infrastructures agricoles et permettent d’adapter les exploitations à l’évolution des conditions-cadre.L’abaissement des coûts de production et la promotion de l’écologisation ont pour effet d’améliorer la compétitivité de l’agriculture acquise au principe de la production durable.Dans d’autres pays aussi,notamment au sein de l’UE,ces aides figurent au nombre des principales mesures de promotion du milieu rural.
Depuis 2004,la LAgr permet d’allouer des contributions aux projets axés sur le développement régional ou la promotion de produits indigènes et régionaux,dans la mesure où l’agriculture y participe à titre prépondérant.En vue de l’élaboration des dispositions d’exécution,deux travaux de recherche ont été menés à bonne fin et deux projets pilotes ont été lancés au Tessin (Brontallo) et en Valais (St-Martin) en 2004.Les connaissances et expériences acquises à cette occasion ont permis de tirer les conclusions suivantes pour la mise en œuvre:
–Il est prioritaire d’augmenter la valeur ajoutée dans l’agriculture.Ce faisant,la collaboration entre le secteur agricole et les autres secteurs joue un rôle clé.Comme dans le cas des améliorations intégrales,les aspects d’intérêt public doivent être pris en compte.Il est absolument nécessaire d’harmoniser les objectifs des projets avec les concepts du développement régional.
–Un projet a toutes les chances de réussir lorsque l’initiative en a été prise dans la région.L’approche selon le principe dit de «bas en haut»,qui a fait ses preuves dans le domaine des améliorations structurelles,doit également être adoptée pour les projets axés sur le développement régional.Le financement est assuré par des fonds publics alloués par la Confédération et le canton,mais les coûts restants sont à la charge d’un organisme local qui voit ainsi sa responsabilité engagée.
■■■■■■■■■■■■■■■■
186 2.3AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2
–Les mesures sélectionnées en fonction du projet doivent garantir autant que faire se peut que les objectifs soient atteints.Lors de la réalisation de tels projets,il convient de donner la priorité aux mesures classiques d’améliorations structurelles dans le domaine des constructions rurales et le génie civil.Un concept de marketing bien pensé revêt à cet égard une importance primordiale.
–La participation de l’agriculture aux projets de développement régional est considérée comme prépondérante dans les conditions suivantes:

–la moitié au moins de l’offre (produits,prestations de services) provient de la région et est d’origine agricole,ou
–la moitié au moins des prestations de travail nécessaires à l’offre sont fournies par des exploitants agricoles ou leurs familles,ou –les membres de l’organisme responsable sont majoritairement des exploitants agricoles et ils détiennent la majorité des voix.
–L’offre envisagée (produits,prestations de services) doit être ciblée en fonction des opportunités du marché et harmonisée au niveau régional.Il importe de mettre en évidence le potentiel de plus-value au moyen d’une planification appropriée (business plan) et d’un controlling utilisant des indicateurs mesurables pour les aspects publics et privés.Les analyses du marché indispensables et les examens préalables seront effectués dans le cadre d’un coaching.En outre,il convient de prouver que le financement du projet et la charge en résultant sont supportables.
–Les différentes parties en présence doivent discuter et négocier entre elles les objectifs,les mesures et les modalités du projet.Une convention-programme (contrat de droit public) conclue entre la Confédération et le canton sert de base légale pour la mise en œuvre de ces projets.L’organisme responsable du projet (prestataire) est associé aux négociations.
–La contribution fédérale est allouée sous la forme d’un montant forfaitaire pour l’ensemble du projet,ce qui incite les intéressés à faire des économies et à trouver des solutions innovantes.Le montant forfaitaire peut être calculé selon les principes déjà applicables aux améliorations structurelles et il implique une participation financière du canton.
Ces conclusions auront une influence déterminante sur l’élaboration des dispositions d’application et seront intégrées dans l’ordonnance sur les améliorations structurelles (OAS).Ainsi,les dispositions générales applicables aux améliorations structurelles sont également valables pour ce nouveau type de projet.L’ordonnance remaniée entrera vraisemblablement en vigueur le 1er janvier 2007.
187 2.3 AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2.MESURESDEPOLITIQUEAGRICOLE 2
■ Moyens financiers destinés aux contributions
En 2005,le montant disponible pour les contributions au titre des améliorations foncières et des constructions rurales s’est élevé à 85 millions de francs.L’OFAG a approuvé de nouveaux projets qui ont bénéficié de contributions fédérales (86,6 millions de fr.,et entraîné un volume global d’investissements de 373 millions de francs. Le montant total de ces contributions fédérales ne correspond toutefois pas à celui budgétisé dans la rubrique «améliorations foncières et constructions rurales»,car il est rare qu’une contribution allouée soit versée la même année;les crédits sont par ailleurs souvent accordés par tranche.
Contributions de la Confédération approuvées en 2005
Remaniements parcellaires (y compris infrastructures)
Construction de chemins

Adductions d'eau
Dommages dus aux intempéries et autres mesures de génie civil Bâtiments d'exploitation destinés aux animaux consommant des fourrages grossiers
Autres constructions rurales
Les moyens financiers engagés par la Confédération sous la forme de contributions ont baissé de 10% en 2005 par rapport à l’année précédente et de 17% par rapport à 2003.Cette diminution s’explique par la hausse des dépenses qui avaient été nécessaires en 2003 pour réparer les dégâts causés par les intempéries de 2002.De surcroît, les intempéries extraordinaires survenues en 2005 ont entraîné l’arrêt des travaux commencés dans des projets ordinaires et ont exigé l’affectation de toutes les ressources disponibles pour réparer les dommages provoqués par les intempéries.
Tableaux 43–44,page A52
mio. de
Région de plaine Région des collines Région de montagne 051015202530 Source: OFAG 16,6 17,3 9,8 16,5 25,1 1,3 62,4% 12,6% 24,9% 2.3AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2 188
fr.
■
Intempéries d’août 2005

Les graves intempéries survenues entre le 21 et le 23 août 2005 ont fortement touché l’agriculture dans les cantons de BE,LU,UR,SZ,OW,NW,GL,ZG et GR,dépassant par leur ampleur tout ce que l’on avait connu jusqu’alors.Les dommages causés aux biens privés et publics ont atteint 2,5 milliards de francs et constituent le plus gros sinistre individuel jamais enregistré.
La facture des dégâts causés par les intempéries en 2005 s’est élevée à 72 millions de francs pour l’agriculture,dont 50 millions pour la réparation de chemins agricoles et de ponts,4 millions pour des adductions d’eau desservant l’agriculture et 18 millions pour la remise en état des terres agricoles.Par arrêté fédéral du 21 décembre 2005,le Conseil fédéral a décidé d’allouer une aide de 40 millions de francs en tout,dont deux millions furent payés la même année.Quelque 21 millions de francs demandés sous la forme de crédits supplémentaires ont été versés en 2006.Les contributions restantes, soit 17 millions de francs,seront dépensées dans le cadre du budget 2007.
Contributions fédérales versées pour des améliorations foncières et des constructions rurales 1996–2005 1990/92199619971998199920002001200220032005 2004 mio. de fr. Source: OFAG 0 20 40 60 80 100 120 140 11985827575871029010285 94,5 2.MESURESDEPOLITIQUEAGRICOLE 189 2.3 AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2
En 2005,les cantons ont accordé 2'185 crédits d’investissements portant sur un montant total de 320,3 millions de francs,dont 83,7% concernaient des mesures individuelles et 16,3% des mesures collectives.Dans la région de montagne,des crédits de transition d’une durée maximale de trois ans,appelés «crédits de construction»,peuvent en outre être consentis pour des projets à caractère communautaire.
Crédits d’investissements en 2005
CasMontantPart
Mesures individuelles1 990267,983,7
Mesures collectives,sans crédits de construction13926,08,1
Crédits de construction5626,48,2
Total2 185320,3100
Source:OFAG
Les crédits destinés aux mesures individuelles ont principalement été alloués au titre de l’aide initiale ainsi que pour la construction ou la transformation de maisons d’habitation et de bâtiments d’exploitation.Ils sont remboursés dans un délai de 13,8 ans en moyenne.Le volume des crédits octroyés dans 39 cas au titre de la «diversification des activités» s’est élevé à 4,4 millions de francs.
Quant aux crédits alloués pour des mesures collectives,ils ont permis notamment de soutenir la réalisation d’améliorations foncières,l’acquisition communautaire de machines et de véhicules et des mesures de construction (bâtiments et équipements destinés à l’économie laitière ainsi qu’à la transformation,au stockage et à la commercialisation de produits agricoles).
En 2005,de nouveaux moyens fédéraux,d’un montant de 68 millions de francs,ont été mis à la disposition des cantons.Avec les remboursements courants,ils seront utilisés pour l’octroi de nouveaux crédits.Le fonds de roulement alimenté depuis 1963 s’élève actuellement à quelque 2,082 milliards de francs.
Nombremio.de fr.%
190 2.3AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2
■ Moyens financiers destinés aux crédits d’investissements
Tableaux 45–46,pages A53–A54
Crédits d'investissements 2005 par catégories de mesures, sans les crédits de construction
1 Achat d’inventaire en commun, prêt de démarrage pour organisations d'entraide paysanne, transformation, stockage et commercialisation de produits agricoles

Aide initiale Achat de l'exploitation par le fermier Mesures collectives 1 Diversification Maisons d'habitation Bâtiments d'exploitation mio. de fr. Région de plaine Région des collines Région de montagne 76 0 20 40 60 80 100 120 140 6,7 Améliorations foncières 4,6 21,4 4,4 55,3 125,6
Source: OFAG
25,0% 48,5% 26,5% 191 2.3 AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2
■ Aide aux exploitations
Mesures d'accompagnement social
Allouée sous forme de prêts sans intérêts,l’aide aux exploitations sert à parer ou à remédier aux difficultés financières passagères dont la faute ne peut être imputée aux agriculteurs sollicitant cette aide.De par ses effets,elle correspond à une mesure de désendettement individuelle.
En 2005,des prêts au titre d’aide aux exploitations ont été accordés dans 120 cas pour un montant total de 16,6 millions de francs.Le prêt moyen s’est élevé à 138'264 francs et sera remboursé dans un délai de 13,9 ans.
Prêts au titre de l’aide aux exploitations 2005
Conversion de dettes existantes8412,6 Difficultés financières extraordinaires à surmonter364,0
Total12016,6
Source:OFAG
Au cours de l’exercice considéré,un montant supplémentaire de 1,588 million de francs a été mis à la disposition des cantons.Son octroi est lié à une prestation équitable des cantons,laquelle varie en fonction de leur capacité financière et représente entre 20 et 80% de l’aide fédérale.Ajoutés aux remboursements courants,les montants accordés par les pouvoirs publics sont utilisés pour l’octroi de nouveaux prêts.Le fonds de roulement,qui est alimenté depuis 1963 par des deniers publics fédéraux et des remboursements,s’est élevé à 206 millions de francs,parts des cantons comprises.
■ Aides à la reconversion professionnelle
Pour les personnes exerçant une activité indépendante dans l’agriculture,l’aide à la reconversion professionnelle facilite un changement d’activité dans une profession non agricole.Comprenant des contributions aux frais de la reconversion professionnelle et des contributions aux coûts de la vie,elle s’adresse aux chefs d’exploitation,hommes ou femmes,âgés de moins de 52 ans.L’octroi de cette aide implique bien entendu la cessation de l’activité agricole.Selon la formation suivie,la durée de la reconversion professionnelle varie de un à trois ans.En 2005,trois personnes ont bénéficié de cette aide dont le montant total s’est chiffré à 415'700 francs;dans deux cas,l’exploitation sera affermée à long terme tandis que,dans le troisième cas,elle sera vendue.La première tranche des aides allouées à quatre requérants l’année précédente,d’un montant total de 91'400 francs,a été versée au cours de l’exercice 2005.
DispositionCasMontant Nombremio.de fr.
192 2.3AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2
Concurrence neutre vis-à-vis de l’artisanat en cas de diversification des activités de l’entreprise agricole
Les exploitations agricoles diversifient de plus en plus souvent leurs activités,cherchant à réaliser une valeur ajoutée et à gagner des parts de marché dans des branches non agricoles.Elles peuvent ainsi concurrencer des entreprises artisanales actives en dehors de l’agriculture.Parallèlement au soutien au titre de la diversification des activités qui a été mis en place en 2004 dans le cadre de la Politique agricole 2007,des réglementations ont été adoptées en vue d’assurer une concurrence neutre vis-à-vis de l’artisanat.Conformément à l’art.87,al.2,LAgr,les améliorations structurelles bénéficiant d’un soutien ne doivent pas avoir d'incidence sur la concurrence avec les entreprises artisanales implantées dans la zone d'influence immédiate.Et l’art.13 OAS stipule que, avant de prendre une décision relative à l’octroi d’une aide à l’investissement,les cantons doivent consulter les entreprises artisanales directement concernées ainsi que leurs organisations locales ou cantonales.Si une entreprise artisanale établie dans la région fournit une prestation de services équivalente ou accomplit de manière équivalente la tâche prévue,il n’est pas possible d’allouer cette aide fédérale.
Ici ou là,des reproches se font tout de même entendre quant à l’inégalité de traitement entre les offreurs agricoles et non agricoles de biens et de services.Il est notamment reproché que les prescriptions sont moins nombreuses pour les offreurs agricoles et que leur application est aussi moins stricte.
L’OFAG a donc commandé à l’automne 2005,en association avec l'Union suisse des arts et métiers,une étude portant sur la neutralité en matière de concurrence vis-à-vis de l'artisanat (HESA,2005, Konkurrenz mit ungleich langen Spiessen?).La Haute école suisse d’agronomie (HESA) a examiné dans ce travail si la concurrence entre une activité accessoire non agricole ou para-agricole exercée par une exploitation agricole et une entreprise artisanale se fait «à armes égales».
L’étude menée par l’HESA arrive à la conclusion que les lois,ordonnances et instructions ne contiennent guère de différences favorisant une activité accessoire par rapport à l’artisanat.Les différences relevées concernent l’étendue des activités ou leur forme (activité lucrative indépendante/non indépendante).Les non-agriculteurs profitent également des allègements apportés à la législation.En outre,l’étendue des activités accessoires est restreinte,car il s’agit seulement de compléter et d’améliorer le revenu de l’exploitation principale agricole,raison pour laquelle leurs effets sur les exploitations artisanales concurrentes restent limités.Aucun avantage concurrentiel découlant des prescriptions n’a ainsi été constaté dans les cas de figure étudiés.Lorsque des aides à l’investissement ont été accordées,la neutralité requise en matière de concurrence a été correctement respectée.
193 2.MESURESDEPOLITIQUEAGRICOLE 2.3 AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2
■ Charges identiques pour les exploitations agricoles
Dans des proportions restreintes,les réglementations suivantes peuvent conduire à des conditions-cadre différentes pour l’activité accessoire par rapport à l’entreprise artisanale:
–Il n’existe pas de convention collective pour l’ensemble de la branche dans l’agriculture.Le recours à la main-d’œuvre non familiale est néanmoins très limité et restreint par la législation sur l’aménagement du territoire (art.24b LAT et art.40 OAT). –Les divers systèmes d’allocations familiales existants peuvent avoir une incidence positive ou négative selon la branche,le canton ou la situation économique.

L’étude ne s’est pas penchée sur les questions relevant de l’aménagement du territoire puisqu’elles sont l’objet de la révision partielle anticipée du droit de l’aménagement du territoire,laquelle concerne les «constructions en dehors des zones à bâtir».Il est ainsi envisagé de faciliter la réaffectation de bâtiments existants ou l’agrandissement limité de ces derniers.
Seule l’application de la législation a été difficile à déterminer puisqu’elle relève principalement de la compétence des cantons.Lorsque des manquements sont décelés lors de la mise en œuvre,les intéressés ont la possibilité de faire constater la concurrence déloyale et d’intenter une action en justice pour y mettre fin.
194 2.3AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2
■ L’UMOS:un critère d’entrée en matière adéquat pour les aides à l’investissement
Etude d’impact des aides à l’investissement pour des constructions rurales
L’instauration de la Politique agricole 2002 s’est accompagnée en 1999 d’un changement de système dans l’octroi des aides à l’investissement pour des mesures individuelles dans le domaine des constructions rurales,système qui est passé d’un financement du solde au financement d’un forfait.Depuis,quel que soit le montant des coûts effectifs,l’exploitant se voit allouer des contributions ou crédits d’investissements forfaitaires par élément de construction.Ce système encourage donc la réalisation de projets moins coûteux (cf.article Réduction des coûts de constructions rurales,paru dans le rapport agricole 2004).Des relevés et des comparaisons établis en 2005 permettent de conclure que les investissements par unité de bétail opérés dans des bâtiments ont considérablement diminué au cours des dix dernières années en dépit des conditions plus strictes que doivent remplir les bâtiments d’exploitation agricoles (protection des animaux,protection des eaux,mécanisation des équipements intérieurs,etc.).
Ce constat montre bel et bien que le changement de système contribue à l’abaissement des coûts de production et,partant,à une plus grande compétitivité de l’agriculture.Dans une étude scientifique,l’OFAG a fait examiner l’impact des aides à l’investissement,en y associant le Contrôle fédéral des finances.L’étude a été effectuée par Agroscope Reckenholz-Tänikon (ART),et les questions posées ont été traitées dans le cadre de sous-projets.
Dans la première partie de l’étude,il s’agissait d’analyser l’influence de l’unité de main-d’œuvre standard (UMOS) sur la rentabilité et son utilité comme critère d’entrée en matière pour l’octroi d’aides à l’investissement à une exploitation individuelle.Ont été utilisées pour ce faire les données comptables issues du dépouillement centralisé de la station ART et les indications fournies par la Caisse de crédit agricole d’Argovie. Les résultats des analyses de régression montrent que l’UMOS a une incidence positive sur le revenu du travail.On peut donc en conclure qu’elle constitue un indicateur pertinent de la rentabilité des exploitations agricoles.
Il convient cependant de se montrer prudent dans l’interprétation des résultats en raison de la faible quantité de données à disposition pour les analyses de régression, d’une part,et de la brève période de temps analysée,d’autre part.Ainsi,il n’a pas été possible de prendre suffisamment en compte l’impact d’autres branches de production ou le changement de production suite aux investissements opérés.
■ Les aides à l’investissement induisent une baisse des coûts
Dans la seconde partie de l’étude,il s’agissait d’analyser la rentabilité des aides à l’investissement.Les données utilisées en l’occurrence provenaient du dépouillement centralisé des données comptables de ART,de la banque de données MAPIS de l’OFAG et d’un sondage effectué par écrit auprès de 196 exploitations de référence ayant opéré d’importants investissements dans les années 1999 à 2002.
195 2.MESURESDEPOLITIQUEAGRICOLE 2.3 AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2
L’étude d’impact des aides à l’investissement avec une comparaison de la situation avant et après investissements est un travail complexe,car elle doit tenir compte de nombreux facteurs comme les coûts de production,les amortissements,le niveau des recettes,les changements intervenus dans l’exploitation dans son ensemble,etc.
L’étude menée par ART permet de tirer les enseignements suivants,lesquels concernent en premier lieu les deux groupes d’exploitation étudiés de manière approfondie «cheptel laitier important» (au moins 30 vaches) et «cheptel laitier moyen» (13 à 26 vaches).
–Si l’on considère les indicateurs «coût de production par kg de lait» et «flux de fonds dans l’agriculture»,l’objectif concernant l’abaissement des coûts de production n’est que partiellement atteint,résultat imputable à la courte période prise en considération.
–Si l’on considère les indicateurs «qualité de vie» et «cash-flow»,l’objectif relatif à l’amélioration des conditions de vie et de la situation économique a été en majeure partie atteint.
–Si l’on considère les indicateurs «prestations écologiques requises» et «contributions pour systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux»,les objectifs en matière de protection de l’environnement et de protection des animaux ont été largement atteints.
–Si l’on considère l’indicateur «stabilité financière»,l’objectif de la survie de l’exploitation à long terme a été atteint à 85%.A cet égard,les exploitations laitières de plus grande taille tirent mieux leur épingle du jeu que les exploitations de taille moyenne.
–Au vu de ces résultats,l’efficacité des aides à l’investissement est largement prouvée.
L’étude fournit également des indices quant au rendement des fonds engagés.Pour cela,elle a analysé à combien de francs se monte le flux de fonds pour un franc d’aide à l’investissement.Les premiers résultats révèlent que les valeurs diffèrent considérablement d’une exploitation à l’autre.Il va donc falloir approfondir et affiner ces analyses pour en tirer des conclusions pertinentes.
196 2.3AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2
■ Agroscope optimise la gestion et les procédures
2.3.2Recherche,haras,vulgarisation, formation professionnelle,CIEA
Recherche agronomique

Le budget d’Agroscope s’est élevé à quelque 109 millions de francs net en 2005.En raison des programmes d’allégement et d’abandon de tâches de la Confédération,il sera réduit à 102 millions de francs en 2008.Agroscope devra supprimer des postes, mais tâchera d’éviter des licenciements.Les mesures d’économie obligent Agroscope à abandonner un certain nombre de prestations qu’il fournissait jusqu’à présent.
Agroscope chapeaute actuellement six sites de recherche agronomique.Les activités d’Agroscope Liebefeld-Posieux (ALP) portent sur la production animale,c’est-à-dire sur les procédés allant des aliments pour animaux aux denrées alimentaires.Les chercheurs de Wädenswil et de Changins s’occupent,quant à eux,des questions liées à la production végétale (grandes cultures et cultures spéciales).Enfin,les recherches menées à Reckenholz et à Tänikon concernent l’écologie,l’économie et la technique agricole. Michael Gysi a repris,le 1er janvier 2006,la direction d’Agroscope Liebefeld-Posieux ALP.La direction d’Agroscope Changins-Wädenswil ACW a été confiée à Jean-Philippe Mayor au 1er février 2006.La troisième unité,Agroscope Reckenholz-Tänikon ART,sera dirigée par Paul Steffen,l’actuel directeur de Reckenholz.
Manfred Bötsch,directeur de l’OFAG,et MM.Steffen,Gysi et Mayor,directeurs des trois stations de recherche,constitueront le nouveau comité directeur d’Agroscope.La direction,avec le soutien de l’Etat-major Recherche de l’OFAG,conduit Agroscope et assume la responsabilité de la stratégie et de la définition des objectifs ainsi que de leur réalisation.Chacun des directeurs sera responsable d’un des trois domaines stratégiques suivants:planification et ressources,recherche et développement ainsi que communication et échange de connaissances.
■■■■■■■■■■■■■■■■
197 2.3 AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2
■ L’exécution de tâches légales stimule la recherche
Les tâches d’exécution et de contrôle mobilisent une part importante des ressources d’Agroscope,pouvant atteindre 40% selon des enquêtes.Elles lui sont déléguées en vertu d’une loi ou d’une ordonnance.Les tâches principales,qui prennent beaucoup de temps,concernent l’examen des produits phytosanitaires,l’autorisation et le contrôle des aliments pour animaux,les analyses du laboratoire de référence en matière d'économie laitière,les travaux liés à la protection du sol et l’évaluation de la situation économique de l’agriculture.Elles visent pour la plupart à protéger les êtres humains, les animaux et l’environnement contre les effets secondaires intolérables de la production agricole et contribuent substantiellement à l’assurance qualité des produits agricoles.D’autres tâches servent à soutenir l’action de l’Etat,par le biais d’informations et d’instruments de décision élaborées à l’intention des organes politiques et de l’administration.
Il est possible de tirer parti des synergies que recèle le regroupement de la recherche et des tâches légales sous un même toit.Ces tâches fournissent souvent des informations,des impulsions et des idées pour de nouveaux projets de recherche;les problèmes qui apparaissent au cours de l’exécution des tâches légales peuvent être étudiés sur-le-champ;les connaissances des collaborateurs,spécifiques et axées sur la Suisse,ainsi que les infrastructures coûteuses sont utilisées en commun;les tâches d’exécution révèlent des tendances et développements et sont ainsi un instrument important de la détection précoce.Dans cette optique,les tâches légales sont un enrichissement pour la recherche d’Agroscope.
■ Recherche dans le domaine du génie génétique
Depuis la votation de novembre 2005,la Suisse doit respecter un moratoire de cinq ans concernant la culture de végétaux génétiquement modifiés.Dans le débat qui a précédé la votation,les deux camps ont fait remarquer que,durant la période en question,il conviendrait d’accorder beaucoup de poids à la recherche sur les chances et les risques du génie génétique.
Il y a quelques années,Agroscope a déjà étudié les effets possibles de végétaux génétiquement modifiés sur les abeilles et d’autres organismes utiles;en outre,il a mis sur pied un monitoring environnemental et a examiné la possibilité de faire coexister,en Suisse,des végétaux génétiquement modifiés et des végétaux non génétiquement modifiés.
Plusieurs interventions parlementaires demandent une intensification de la recherche sectorielle dans ce domaine et notamment la réalisation d’essais sur le terrain.C’est le seul moyen,selon les auteurs des interventions,de faire une recherche globale sur la sécurité biologique et d’en exploiter les résultats dans l’application de l’ordonnance sur la coexistence.Agroscope entend par ailleurs s’engager pleinement dans le programme national de recherche «Utilité et risques de la dissémination de plantes génétiquement modifiées» (PNR 59).
198 2.3AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2
■ Clients d’Agroscope satisfaits
Dans le mandat de prestations d’Agroscope pour la période 2004 à 2007,la proximité de la clientèle et la satisfaction des clients sont des aspects importants.Comme les stations de recherche servent deux types de clients,deux enquêtes ont été effectuées par écrit de mi-2005 à fin mai 2006.Une auprès des clients directs (presse,interprofessions et organisations professionnelles,offices fédéraux,Office fédéral de l’agriculture,institutions cantonales et centrales de vulgarisation) et une auprès des agriculteurs,qui comptent parmi les clients indirects.
Les clients directs d’Agroscope sont très satisfaits des prestations des stations de recherche:plus de 80% des avis leur ont donné une des deux notes les plus élevées. Les clients sont en particulier très satisfaits des collaborateurs et des conférenciers. Ils ont apprécié favorablement l’amabilité,les connaissances professionnelles et la compétence linguistique.Par contre,la disponibilité et la flexibilité méritent d’être améliorées.
Presque 70% des agriculteurs interrogés estiment important que les stations puissent continuer à faire de la recherche au service de l’agriculture.C’est à ce facteur de satisfaction qu’a été accordé le plus de poids dans toutes les régions linguistiques et par tous les types d’exploitations.L’utilité pratique pour la propre exploitation a été jugée de manière un peu plus critique.L’enquête a aussi révélé des différences spécifiques aux régions linguistiques et aux types d’exploitations.Les interlocuteurs de Suisse romande sont presque tous plus satisfaits des prestations des stations de recherche et des personnes chargées de transmettre des connaissances (clients directs) que les agriculteurs de Suisse allemande.S’agissant des types d’exploitations,le degré de satisfaction est plus élevé dans le domaine des cultures spéciales (cultures fruitière et viticole) que dans celui de la production animale;ces agriculteurs ont aussi davantage recours aux sources d’information.
En ce qui concerne les sources d’information,les agriculteurs interrogés utilisent le plus souvent les journaux,les revues et les publications des organisations professionnelles. Agroscope peut donc s’en servir pour informer également la clientèle indirecte.
2.MESURESDEPOLITIQUEAGRICOLE 199 2.3 AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2
■ Le groupe de travail sur la filière du cheval
Haras national
La garde d’équidés dans les exploitations agricoles a progressé,bien que le cheval ne soit plus utilisé comme animal de trait.Cette évolution n’est pas toujours accompagnée du savoir-faire adéquat,surtout en matière de compétitivité et de bien-être des chevaux.Ces questions socio-économiques complexes exigent un effort conjoint de plusieurs disciplines.Les besoins en recherche appliquée et échange de connaissances augmentent.Dans ce contexte,le Haras a favorisé la mise sur pied de deux réseaux de compétences.Le premier dresse un état des lieux du monde du cheval dans notre pays et le deuxième réseau rassemble les chercheurs prêts à partager leurs connaissances et à échanger les résultats pratiques en fonction des besoins des utilisateurs.
Ce groupe réunit des représentants des pouvoirs publics (Office fédéral de l’agriculture, Haras national,Département fédéral de la défense,de la protection de la population et des sports) et des organisations intéressées au rôle économique et social croissant du cheval.
Les premiers travaux montrent que la Suisse compte plus de 80'000 équidés,une progression de 40% depuis 10 ans.85% sont détenus dans des exploitations agricoles,alors que seulement 50% l’étaient il y a moins de 20 ans.Cette augmentation est due avant tout aux besoins de diversification des activités agricoles et permet de mieux exploiter les infrastructures (pension pour chevaux) et les surfaces vertes (consommation de fourrages grossiers).Le nombre d’exploitations détenant des équidés a aussi progressé de 7%,une tendance inverse de celle observée pour d’autres animaux de rente.
On constate aussi que le cheval s’est popularisé et qu’il attire surtout la jeunesse féminine.Cet animal est devenu un compagnon de la famille pendant les loisirs dans la nature.Contrairement à une opinion largement répandue,seulement 10% des chevaux et personnes intéressées au cheval participent à des compétitions équestres.
■ Le réseau de recherche et les journées publiques
Les premiers échanges entre les participants montrent la nécessité d’une meilleure communication,d’une coordination structurée des travaux de recherche et d’une optimalisation des synergies et des compétences scientifiques.Les éleveurs de chevaux et les utilisateurs ont souligné qu’ils cherchaient surtout le bien-être d’un cheval jouissant d’une bonne santé et d’un comportement irréprochable.
La première journée publique a présenté les possibilités de prévenir diverses maladies, la génétique moléculaire pour définir la race des Franches-Montagnes et les maladies héréditaires,ainsi que l’influence de l’homme et des conditions de garde sur le bienêtre des chevaux.
200 2.3AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2
■ La réduction budgétaire est répercutée sur les cantons
Vulgarisation en agriculture et en économie familiale rurale
Ce sont en général les services de vulgarisation cantonaux qui offrent des conseils aux familles paysannes et,moins souvent,ceux d’organisations actives dans des domaines spéciaux qui travaillent à l’échelle nationale.Les deux centrales de vulgarisation d’AGRIDEA à Lausanne et à Lindau soutiennent les services de vulgarisation en proposant des cours de formation continue aux vulgarisateurs,en développant des méthodes de vulgarisation,en mettant à jour des bases de données,en publiant des outils de travail sur papier ou par voie électronique et en encourageant l’échange d’informations,de connaissances et d’expériences.
Dépenses de la Confédération pour la vulgarisation en 2005
DestinatairesMontant mio.de fr. Services cantonaux de vulgarisation agricole8,4 Services cantonaux de vulgarisation en économie familiale rurale0,6 Services spéciaux de vulgarisation d’organisations agricoles0,9 AGRIDEA (centrales de vulgarisation de Lausanne et de Lindau)8,4
Total18,3
Source:Compte d’Etat
Pour la deuxième fois déjà,le Parlement a réduit les montants prévus à la rubrique budgétaire «Vulgarisation»,après avoir procédé à une première réduction dans le cadre du programme d’allégement 03.Jusqu’ici,la réduction a été comblée par l’abaissement des contributions versées aux centrales de vulgarisation et aux organisations. Mais en 2006,il a fallu diminuer les aides financières octroyées aux services cantonaux de vulgarisation,qui sont appelées à disparaître à moyen terme,lors de l’entrée en vigueur,en 2008,de la nouvelle péréquation financière entre la Confédération et les cantons.
■ AGRIDEA –Développement de l’agriculture dans le milieu rural
Depuis 2006,les deux centrales de vulgarisation (précédemment LBL et SRVA) et leur organisation faîtière,l’Association suisse pour le conseil en agriculture,se présentent sous le nom d’AGRIDEA.Ses membres (les cantons et les organisations agricoles) ont adopté une modification des statuts en été 2005.AGRIDEA souhaite montrer ainsi qu’elle est garante d’idées novatrices pour l’agriculture.Son nouveau nom indique aussi que la vulgarisation prête désormais davantage d’attention au milieu géographique et économique tout entier en tant que contexte de l’activité agricole.

■ Tâches du Forum
La Vulg Suisse
Malgré la régression du nombre d’exploitations,les services de vulgarisation ont à traiter des questions de plus en plus complexes.En 2005,ils ont fondé le Forum La Vulg Suisse,dont les objectifs consistent notamment à promouvoir la vulgarisation,le conseil et la formation continue d’entreprises actives dans le secteur agricole et dans le milieu rural,et à coordonner les activités de ses membres.Les cantons ne sont plus seuls quand il s’agit d’élaborer des solutions innovantes en réponse à de nouvelles questions.
201 2.MESURESDEPOLITIQUEAGRICOLE 2.3 AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2
■ Formation professionnelle initiale
Formation professionnelle agricole
La nouvelle loi sur la formation professionnelle (LFPr),entrée en vigueur le 1er janvier 2004,tient compte des profonds changements qui ont marqué la formation et le monde du travail.Elle vise à ouvrir de nouvelles voies dans la formation professionnelle et à rendre le système plus perméable.Le subventionnement des dépenses sera remplacé,à partir de 2008,par un système forfaitaire axé sur les prestations,qui exige une collaboration plus étroite de la Confédération,des cantons et des organisations du monde du travail (OrTra) également sur le plan financier.L’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) octroie une aide annuelle de quelque 10 millions de francs à la formation professionnelle agricole.
La réforme des formations professionnelles initiales avec CFC des professions agricoles et équestres est en cours.Les associations professionnelles des différentes branches se sont regroupées au sein d’OrTras:
–AgriAliForm pour les professions d’agriculteur,agriculteur avec spécialisation en agriculture biologique,maraîcher,arboriculteur,aviculteur,viticulteur et caviste; –OrTra «professions équestres» pour les professions d’écuyer,de palefrenier et de cavalier de courses.
Les ordonnances ainsi que les plans de formation décrivant les objectifs de formation pour les apprenants sont en cours de rédaction.Les documents sont rédigés par des groupes de travail réunissant professionnels et enseignants.Tous les travaux sont pilotés par les commissions de réforme comprenant des représentants des organisations du monde du travail,des offices cantonaux de formation professionnelle et de la Confédération.La mise en consultation auprès de tous les partenaires de la formation professionnelle est prévue pour le printemps 2007 et l’entrée en vigueur pour janvier 2008.
La mise en place d’une formation professionnelle initiale avec attestation (formation d’une durée de 2 ans) est prévue pour 2008 dans le domaine équestre et 2009 dans le domaine agricole.
■ Examen professionnel et examen professionnel supérieur pour agriculteurs
Pour la mise en œuvre d'un examen professionnel ou d'un examen professionnel supérieur,les OrTras compétentes forment une organisation faîtière.Les règlements d’examen définissent les conditions d'admission,la matière à traiter,la procédure de qualification,les brevets et les titres.Ils doivent être approuvés par l’OFFT.
L’OrTra AgriAliForm évoquée ci-dessus assume dès maintenant également les responsabilités liées à l’organisation et à la surveillance des examens professionnels supérieurs.
Les règlements de l’examen professionnel et de l’examen professionnel supérieur pour agriculteurs ont été revus.Les premiers brevets établis sur la base des nouveaux règlements seront décernés à partir de juin 2007.Le premier examen final et la première évaluation des diplômes à modules de l’examen professionnel supérieur selon le nouveau règlement auront lieu en 2008.
202 2.3AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2
■ Axer la formation continue sur le transfert
Centre international d’études agricoles (CIEA)
Depuis presque 50 ans,le CIEA apporte une contribution à la formation continue du personnel de vulgarisation et des enseignants en milieu rural,sur mandat de l’OFAG et de la DDC.
Comme les années précédentes,le séminaire 2006 avait pour but d’accroître les prestations de transfert des participants,soit l’application à la réalité professionnelle de la matière traitée durant le cours.Selon le CIEA,il importe en effet que les idées et résultats discutés et élaborés lors du séminaire aient un effet à long terme.L’offre de formation continue doit motiver les participants à agir concrètement dans le quotidien professionnel,une fois rentrés chez eux.Pour cela,les séminaires CIEA doivent se concentrer sur deux éléments: l’apprentissage durable et letransfert
C’est sous cette devise que le séminaire CIEA s’est déroulé du 13 au 26 août 2006 à l’Institut agricole de Grangeneuve.
■ Séminaires du CIEA au service de l’agriculture
Les résultats du séminaire 2006 sont encourageants,comme l’étaient ceux des séminaires précédents.Cette fois aussi,on a vu émerger,à la fin du séminaire,des idées de changements dans les différents pays des participants ainsi que des accords concernant de petits projets (p.ex.échange d’experts ou de matériel,échange d’étudiants,mise sur pied de formations continues communes,réalisation d’évaluations). L’évaluation finale a en outre montré un taux élevé de satisfaction quant à la structure et aux résultats du séminaire.Les organisateurs sont persuadés que l’apprentissage et les transformations produisent leur effet à partir du moment où il se passe quelque chose de concret dans le cadre des formations continues.L’apprentissage dépasse le simple processus cognitif,car il comprend également un facteur émotionnel.«Le transfert ne se résume pas à des chiffres et des faits reportés sur une feuille de papier;le transfert est un sentiment de satisfaction et de réussite»,comme le formule le pédagogue A.Müller.Et celui-ci d’ajouter:«Si quelque chose m’interpelle,qu’elle est importante pour moi,il se développe une dynamique dans les processus d’apprentissage et de transformation».Il semblerait que les organisateurs du séminaire CIEA aient réussi, grâce à des petits pas et de nombreux éléments,à éveiller de telles émotions et ainsi à créer les conditions nécessaires à un transfert réussi.
D’autres informations se trouvent sous www.ciea.ch.
203 2.MESURESDEPOLITIQUEAGRICOLE 2.3 AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2
■ L’importance du marché
2.3.3 Moyens de production
Réduction des coûts
La réussite économique d’une exploitation agricole dépend de plusieurs facteurs, notamment de l’acquisition d’intrants agricoles et de l’accès à ceux-ci,à un prix le plus avantageux possible.Ci-après,nous étudions plus en détail les moyens de production, et plus particulièrement les engrais,les produits phytosanitaires et les semences.Selon les comptes économiques de l’agriculture,la valeur totale de ces intrants agricoles s’est élevée à 419 millions de francs en moyenne des années 2002 à 2004.Plusieurs acteurs du marché influent sur leur prix.
Le bon fonctionnement du marché est la condition essentielle pour l’achat de moyens de production à un prix avantageux.Or,tous les acteurs du marché cherchent à maximiser leur marge.Aussi,les prix des produits sont fixés,selon la théorie,à un niveau aussi élevé que possible,mais suffisamment attractif,pour que la quantité vendue soit aussi grande que possible.Il importe,pour le bon fonctionnement du marché,que les agriculteurs comparent les prix proposés par les fournisseurs.La publication,par les services de vulgarisation ou par les médias,de statistiques comparatives des prix peut leur être utile à cet égard.De même,la réduction du nombre d’acteurs de la filière des moyens de production,entre la production et l’utilisateur final,peut induire une baisse des prix,sans que pour autant les marges des acteurs ne diminuent. Ces achats directs impliquent cependant souvent l’acquisition de quantités plus importantes et de plus grands emballages.Ainsi,selon une étude réalisée en 2005 par la Haute école suisse d’agronomie (HESA) et comparant les prix des moyens de production agricoles en Suisse,en Allemagne et en France,les engrais conditionnés en bigbags (gros sacs jetables) sont jusqu’à 2 fr.50 / q meilleur marché que ceux ensachés de manière traditionnelle.Des achats collectifs ou la création de coopératives d’achat exigent cependant la coopération des agriculteurs intéressés et une bonne planification.Le commerce en bénéficie dans la mesure où il n’a pas à supporter de coûts de logistique supplémentaires pour les petites quantités.
Outre l’offre et la demande,qui déterminent le prix d’équilibre,d’autres éléments peuvent jouer un rôle dans la formation des prix.S’agissant des engrais,par exemple, la livraison franco exploitation est un facteur important.De même,des rabais sont accordés lorsque les commandes de moyens de production sont passées tôt.Les différences de prix entre la Suisse et l’étranger (cf.graphique) constatées dans l’étude de la HESA s’expliquent en partie par les conseils gratuits offerts par les différents acteurs. Les coûts de cette prestation de service sont généralement répercutés sur les prix des produits.
■■■■■■■■■■■■■■■■
204 2.3AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2
Prix des moyens de production en Allemagne et en France, en % des prix suisses
EngraisProduits phytosanitaires
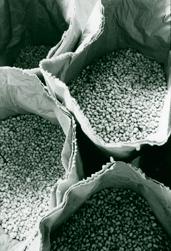
SemencesMédicaments vétérinaires
Les importations parallèles,c’est-à-dire l’achat de moyens de production directement à l’étranger,sont encore peu pratiquées.Elles ne sont du reste possibles que pour les produits non brevetés et ceux dont le brevet est échu.L’Etat fixe par ailleurs certaines exigences concernant l’importation de moyens de production,que nous aborderons dans le prochain chapitre.
Les moyens de production agricoles sont régis par plusieurs textes légaux visant des objectifs différents.Ci-après,nous passons en revue les principales réglementations.
Pour qu’un moyen de production agricole puisse être mis en circulation,il doit,selon la LAgr,se prêter à l’usage prévu,ne pas avoir d’effets secondaires intolérables sur l’être humain,l’animal et l’environnement,ni sur les produits de base traités,et il doit être homologué.La Suisse reconnaît les homologations étrangères,si les conditions agronomiques et environnementales du pays concerné sont équivalentes à celles de la Suisse.Seuls les aliments pour animaux et certaines semences multipliées en Suisse sont grevés de droits de douane.Une taxe pour la constitution des réserves obligatoires est perçue sur les importations d’engrais azotés.En outre,les importateurs de produits phytosanitaires,d’engrais et de certaines semences doivent être titulaire d’un permis général d’importation (PGI).Celui-ci sert à garantir la traçabilité du moyen de production.
Le droit des brevets et la législation sur la protection des variétés protègent la propriété intellectuelle;ils permettent au détenteur d’un titre de protection de percevoir,durant une durée déterminée,des redevances de licence pour les produits dont le développement a exigé des investissements élevés.Le principe de l’épuisement national, appliqué actuellement en raison d’un arrêt du Tribunal fédéral,empêche l’importation parallèle de produits brevetés.Si les importations parallèles étaient admises,ces produits pourraient être achetés dans les régions limitrophes,à un prix généralement plus avantageux.
Prix UE en % du prix CH Moyenne Moyenne 1er quartile Moyenne 4ème quartile Source: HESA Zollikofen 0 120 100 80 60 40 20 66 81 43 76 107 49 50 53 76 101 78 96
2.MESURESDEPOLITIQUEAGRICOLE 205 2.3 AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2
■ Influences de l’Etat sur les moyens de production
■ Utilisation des moyens de production
Un autre facteur contribuant à la réduction des coûts,et sur lequel l’agriculteur a la possibilité d’influer,est l’utilisation efficace des moyens de production.La production extensive,par exemple,de même que l’application optimale des moyens de production,c’est-à-dire le choix du bon moment et de la quantité adéquate en fonction des besoins des plantes et des animaux,permettent de diminuer la quantité utilisée et, partant,de réduire les coûts.L’utilisation de génériques,c’est-à-dire de moyens de production dont le brevet est échu et qui peuvent être importés sans autorisation s’ils figurent sur la liste décrite dans le prochain chapitre,recèle également un potentiel de réduction des coûts.Enfin,l’utilisation de moyens de production propres à l’exploitation,tels que aliments pour animaux ou engrais de ferme,peut contribuer à diminuer les charges réelles.
Importations parallèles de produits phytosanitaires
Un grand nombre de produits autorisés en Suisse sont également autorisés dans les pays qui nous entourent.Pour permettre l’importation directe de ces produits sans une procédure complète d’autorisation,le Parlement a introduit à l’art.160,al.6,LAgr une disposition habilitant l’autorité compétente à établir une liste des produits phytosanitaires autorisés en Suisse et à l’étranger qui peuvent être importés librement.L’OFAG est chargé d’établir cette liste dans le cadre de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits phytosanitaires.
■ Procédure régissant l’inscription dans la liste des produits importables
L’OFAG détermine dans un premier temps les produits commercialisés dans les pays voisins qui correspondent à un produit phytosanitaire autorisé en Suisse.Pour cela, l’OFAG se base principalement sur les listes officielles publiées par ces pays.Les informations disponibles dans ces listes officielles,à savoir la teneur en matière active et le type de formulation,servent de base pour déterminer si le produit étranger correspond aux produits autorisés en Suisse.
Une fois la liste des produits étrangers établie,l’OFAG la transmet pour examen à l’Office fédéral de la santé publique et à l’Office fédéral de l’environnement,et ensuite aux détenteurs suisses de l’autorisation du produit de référence.Cette dernière consultation offre aux détenteurs de l’autorisation la possibilité de s’opposer à l’inscription de produits étrangers dans la liste,au cas où le produit de référence serait breveté.
Il s’agit là du principe de l’épuisement national des brevets,selon lequel un produit ne peut être importé ou vendu pour la première fois en Suisse qu’avec l’accord du détenteur du brevet.Ce dernier peut donc s’opposer à l’importation directe d’un produit étranger correspondant au produit breveté en Suisse.
206 2.3AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2
■ Mode d’emploi
A l’intérieur de l’UE,c’est l’épuisement régional qui s’applique.Ainsi,lorsque qu’un produit est vendu dans un Etat membre avec l’accord du détenteur du brevet,ce dernier ne peut pas s’opposer à son «exportation» ou à sa vente dans un autre Etat membre.Cependant,le détenteur du brevet a évidemment la possibilité de percevoir des droits de licence lors de la vente du produit dans les autres Etats membres,si les produits en question y sont également protégés par un brevet.
A la suite de la consultation,l’OFAG inscrit les produits qui remplissent les exigences dans la liste des produits phytosanitaires pouvant être importés librement.Cette décision est publiée dans la Feuille fédérale et peut faire l’objet d’un recours dans les 30 jours.Passé ce délai,les produits concernés sont publiés dans la liste disponible sur le site Internet de l’OFAG (thèmes,protection des végétaux,produits phytosanitaires).
Les conditions d’utilisation des produits phytosanitaires en Suisse ou à l’étranger ne sont pas forcément identiques.Les agriculteurs qui utilisent de tels produits sont tenus légalement de se conformer aux instructions.Par exemple,les produits ne pouvant pas être utilisés à proximité des zones de captage de sources en Suisse doivent comporter une mention spéciale sur l’étiquette.Cette mention ne figure pas sur l’étiquette du produit acheté à l’étranger.Pour permettre aux utilisateurs suisses de connaître les conditions légales d’utilisation,ces dernières sont publiées sur le site Internet de l’OFAG.
■ Procédure d’importation
Les personnes souhaitant importer des produits phytosanitaires doivent être titulaire d’un permis général d’importation (PGI).Les formulaires de demande sont disponibles sur le site Internet de l’OFAG.Lors du dédouanement,l’importateur doit indiquer le numéro du PGI.
Seuls les produits inscrits dans la liste publiée par l’OFAG peuvent être importés librement.
2.MESURESDEPOLITIQUEAGRICOLE 207 2.3 AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2
Organismes génétiquement modifiés dans les aliments pour animaux
Les organismes génétiquement modifiés (OGM) ne peuvent être mis en circulation qu’avec une autorisation.À ce jour,plusieurs OGM ont été autorisés pour l’utilisation dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.Lors de l’importation,les produits OGM,ou ceux qui en contiennent,sont soumis à déclaration à la douane. Ainsi,la quantité d’aliments pour animaux contenant des OGM est connue.Il ressort du tableau que cette quantité est très faible en regard des importations totales d’aliments pour animaux.En chiffres absolus,quelque 400 à 2'000 t d’aliments pour animaux contenant des OGM sont importées chaque année.
Importations déclarées d’aliments pour animaux contenant des OGM
AnnéeQuantité d’aliments pour Aliments pour animaux Aliments pour animaux animaux importéscontenant des OGMcontenant des OGM
Les aliments pour animaux OGM,ou ceux qui en contiennent,doivent être étiquetés en conséquence afin de garantir la liberté de choix.La déclaration est obligatoire lorsque la part d’OGM est supérieure à 0,9%,et l’application de cette disposition est vérifiée par la Station de recherche Liebefeld-Posieux ALP dans le cadre des contrôles des aliments pour animaux effectués à l’échelle nationale.Des échantillons sont prélevés à l’importation de matières brutes par la douane et sur les marchés par ALP;cette dernière les examine quant à leur teneur en OGM et à leur désignation.Ces dernières années,seuls deux échantillons prélevés par la douane ont donné lieu à une réclamation.De même,la désignation OGM des produits par les producteurs est correcte de manière générale;les erreurs sont rares.
Analyse des aliments pour animaux quant à leur teneur en OGM
AnnéeÉchantillons prélevés Fausses Échantillons prélevés Fausses par la douaneindicationspar ALPindications
totaldéclarésdéclarés en ten ten % 2001272 9913 7811,40 2002318 0682 5630,80 2003412 1636880,20 2004383 5952 1010,55 2005356 1494020,11
NombreNombreNombreNombre 20013002372 20025402033 20038102670 20046122285 20053002503 2.3AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2 208
2.3.4Elevage
En comparaison internationale,le droit suisse sur l’élevage est considéré comme très libéral et progressiste.Plusieurs pays s’en servent de modèle pour élaborer leurs nouvelles dispositions étatiques de promotion de l’élevage d’animaux de rente agricoles. Au cours des dernières années,l’élevage indigène a suivi une évolution continue,sans toutefois perdre son indépendance.Le libre accès à la génétique étrangère a conduit à une nette augmentation de la diversité des races,en premier lieu de bovins,de moutons et de chevaux.En dépit de la forte concurrence étrangère,les races suisses restent demandées et défendent avec succès leur place traditionnelle au sein de l’élevage indigène.
Durant l’exercice sous revue,les efforts entrepris par les organisations d’élevage en faveur d’un élevage concurrentiel et indépendant ont été encouragés par la Confédération et les cantons avec un montant de 19,4 millions de francs.

■■■■■■■■■■■■■■■■
2.3 AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2 209
Tableau 50,page A57
■ Conférence technique internationale de la FAO sur les ressources zoogénétiques
Depuis une dizaine d’années,la Commission des ressources génétiques de la FAO élabore une stratégie mondiale pour la conservation et l’utilisation durable des ressources zoogénétiques dans l’agriculture.Les pays affiliés,dont la Suisse,sont étroitement associés au processus.La FAO élabore actuellement un rapport sur l’état de la biodiversité des animaux de rente agricoles à l’échelle mondiale ainsi qu’un rapport sur les mesures d’urgence à mettre en œuvre pour assurer et améliorer l’utilisation de la diversité des races à l’échelle mondiale.Pour ce faire,elle se fonde sur plus de 170 rapports de situation remis par les différents pays au cours des deux dernières années. Ces deux rapports devront être adoptés lors de la première conférence technique internationale sur les ressources zoogénétiques.
La Suisse s’est mise à disposition comme hôte de cette conférence,qui sera organisée en collaboration avec la FAO en septembre 2007 à Interlaken.Elle offrira une tribune unique permettant de présenter à un large public la diversité de nos races indigènes, ainsi que leurs qualités,par exemple sous la forme de produits exceptionnels ou en tant que patrimoine culturel.
■ Libéralisation de l’insémination artificielle du bétail bovin
En Suisse,l’insémination artificielle n’est réglementée que pour le bétail bovin.Le prélèvement,le stockage et la commercialisation de semence de taureau requièrent une autorisation de l’OFAG.Jusqu’à présent,des autorisations n’étaient accordées qu’aux organisations d’insémination suisses qui détiennent des taureaux élevés dans le pays,dont elles prélèvent et commercialisent la semence,et qui contribuent ainsi au maintien d’un élevage bovin indigène indépendant.Les marchands de semence ne disposant pas d’une station d’insémination n’obtenaient pas d’autorisation.Suite à un recours,le Tribunal fédéral a jugé,dans un arrêté du mois de mars 2005,que l’ordonnance sur la protection des animaux en vigueur ne fournit pas de fondement à l’interdiction prononcée par la Confédération de commercialiser directement de la semence de taureau.La réglementation actuelle relative à l’insémination artificielle sera donc révisée dans le sens d’une libéralisation.
■ Projets novateurs de mise en valeur de la laine de mouton du pays
Depuis le début de 2004,les éleveurs de moutons et les transformateurs de laine peuvent bénéficier de contributions octroyées en faveur de projets novateurs favorisant la mise en valeur de la laine de mouton indigène dans le pays.Parmi les projets déposés,quatre satisfont à ce jour aux exigences requises pour bénéficier d’un soutien financier:des aides initiales ont été accordées pour la création d’une entreprise de fabrication de produits en laine de mouton et d’autres produits naturels dans le Prättigau et pour le lancement d’un centre proposant diverses activités et formations en rapport avec la laine de mouton dans le Jura.En Suisse orientale,le cofinancement d’une machine à carder et d’une installation de lavage de la laine offre à une organisation la possibilité de transformer la laine de tonte indigène,en plusieurs étapes,de la tonte à la fabrication de rembourrages de lits pour l’aide au développement. L’installation de lavage étant unique en Suisse,toutes les organisations de mise en valeur de la laine reconnues par la Confédération doivent y avoir accès.
2.3AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2 210
2.4 Section Inspectorat des finances
L’Inspectorat des finances coordonne son programme d’inspection avec le Contrôle fédéral des finances et l’adopte d’entente avec lui.Les contrôles sur le terrain sont réalisés en accord avec les sections ou sur la base d’analyses de risques.
Inspectorat des finances
En 2005,les activités de révision ont été les suivantes: –révisions externes effectuées par l’OFAG auprès de neuf bénéficiaires de prestations ou de subventions et auprès de leurs mandataires chargés de l'exécution; –révisions internes dans trois sections de l’OFAG; –contrôles périodiques de pièces justificatives à l’OFAG,y compris les stations de recherche et le Haras; –sept révisions de clôture auprès de quatre bénéficiaires de subventions; –suivi de révisions précédentes.
Tous les contrôles ont été réalisés selon les standards professionnels de l'Institute of Internal Auditors (IIA) et de l’Association suisse d’audit interne (ASAI);ils ont par ailleurs été soumis à un contrôle qualité.
Les travaux de révision ont porté essentiellement sur l’évaluation du système des paiements directs et de son efficacité dans neuf cantons.Les systèmes cantonaux de contrôle interne (SCI) sont généralement bien organisés,mais il est néanmoins possible de les perfectionner.La haute surveillance des services de contrôle exercée par les cantons devrait être renforcée.En revanche,l’étendue des contrôles effectués dans les exploitations est jugée trop importante et une meilleure sélection des risques permettrait d’en limiter le nombre.Il y a unanimité quant à l’effet déterminant des paiements directs sur les revenus de la population agricole.
Les révisions internes de l’OFAG (lesdites révisions de services administratifs) consistent en une évaluation neutre et systématique de l’organisation et des activités de l’unité concernée.Elles portent en particulier sur la structure et sur l’organisation d’une section.Autre élément important:la vérification du contrôle interne,qui ne se contente pas de constater les écarts entre l’état effectif et l’état souhaité,mais en recherche aussi la cause.Les résultats des contrôles sont largement positifs.Les deniers publics sont utilisés de manière légitime et ciblée.Les instruments de gestion et de pilotage utilisés dans ce cadre sont,pour la plupart,appropriés et transparents.
2.4 SECTION INSPECTORAT DES FINANCES 2 211 2.MESURESDEPOLITIQUEAGRICOLE ■■■■■■■■■■■■■■■■
■ Rapport de gestion annuel
La révision financière au sein de l’OFAG a comporté plusieurs examens partiels et périodiques.Le contrôle des comptes de certaines rubriques,réalisé par sondage,nous permet de confirmer la régularité et la légalité des dépenses effectuées.
Les révisions de clôture ont généralement donné des résultats satisfaisants.Cependant, dans trois cas,la régularité et la légalité des décomptes n’ont été acceptées que sous certaines restrictions,et ce pour plusieurs raisons:vérification suffisante impossible à effectuer,enregistrements incomplets,mode de comptabilisation inadapté et tenue de la comptabilité inappropriée.Les organisations ont néanmoins fournies les prestations convenues et,à quelques exceptions près,ont employé les fonds fédéraux à bon escient et de façon économique.
Dans le cadre du suivi,les inspecteurs ont vérifié dans quelle mesure les sections concernées avaient pris en compte les recommandations émises à l’occasion de 14 révisionsdans les années 2002 et 2004.Ils ont pu constater que la majorité d’entre elles mettaient en pratique les recommandations ayant été convenues lors des entretiens finaux.Quant à celles qui n’ont pas encore été suivies,elles feront l’objet d’une vérification cette année encore.Lorsqu’il donne des conseils ou apporte son soutien, l’inspectorat des finances ne manque pas de rappeler que c’est aux responsables hiérarchiques d’assumer la responsabilité de leurs décisions.

2.4 SECTION INSPECTORAT DES FINANCES 2 212
■ Suivi
■ Infractions
Contrôles sur le terrain
Les inspecteurs chargés des contrôles sur le terrain effectuent,pour les services de l’OFAG,des contrôles,vérifications,investigations et études dans tous les domaines de la production et de la vente assujettis à la législation agricole.Ils ont effectué 484 contrôles en 2005 dans les secteurs suivants:
–lait et produits laitiers:363 contrôles; –légumes,fruits,fleurs coupées et concentrés de fruits:58 contrôles; –viande et œufs:36 contrôles; –grandes cultures et culture fourragère:20 contrôles,1 calcul de prix et 1 contrôle de quantités; –viticulture en rapport avec les mesures de reconversion:6 contrôles.
Les contrôles de quantités effectués dans l’économie laitière,en relation avec les suppléments et/ou les aides (soutien du prix du lait) et/ou les taxes (contingentement laitier) ont eu lieu selon les prescriptions de la norme internationale EN 45004 (ISO/IEC 17020,service d’inspection accrédité de type B).Les mêmes normes de qualité ont été appliquées dans les autres secteurs contrôlés.
Environ un tiers des exploitations produisant du lait et des produits laitiers ont fait l’objet de contrôles;132 exploitations ont prêté le flanc à la critique et 2% d’entre elles ont été financièrement pénalisées puisqu’elles ont dû restituer des contributions versées ou payer des arriérés.
20% des contrôles effectués à domicile dans le secteur des fruits et légumes frais ont suscité des réclamations entraînant par la suite des mesures administratives.
Dans les autres secteurs,les contrôles n’ont donné lieu à aucune remarque particulière.
Les examens,enquêtes et interrogatoires requis en cas d’infractions aux dispositions de la législation agricole sont réalisés en collaboration avec les autorités d’instruction fédérales et cantonales,avec des organisations privées et d’autres instances d’entraide judiciaire.Durant l’exercice sous revue,une procédure pénale a été ouverte et le dossier transmis aux instances compétentes.En tout,quatre cas ont été définitivement liquidés.
■ Activités de contrôle en 2005
2.4 SECTION INSPECTORAT DES FINANCES 2 213 2.MESURESDEPOLITIQUEAGRICOLE
214 2

3 ■■■■■■■■■■■■■■■■ 3.Aspects internationaux 215
L’élargissement des rapports commerciaux internationaux touche de plus en plus l’agriculture.Au niveau mondial,celle-ci est soumise aux règles de l’OMC.Au regard de la concentration géographique des échanges agricoles,les relations contractuelles avec l’UE et l’intégration croissante dans l’Europe sont d’une importance primordiale pour l’agriculture suisse.
La Suisse dépend d’un accès libre aux marchés étrangers pour pouvoir maintenir et améliorer ses possibilités d’exportation.Elle s’engage en outre fermement au niveau international pour que la multifonctionnalité de l’agriculture soit mieux prise en compte dans les accords internationaux.
Le Rapport agricole tient compte de cette évolution et traite les sujets internationaux dans la troisième partie.
–Le chapitre 3.1 informe sur l’état actuel du dossier européen,des négociations de l’OMC et des accords de libre-échange.
–Le chapitre 3.2 est consacré à des comparaisons internationales.Le présent rapport poursuit les comparaisons internationales de prix entamées en 2000.
3.ASPECTS INTERNATIONAUX 3 216
3.1 Développements internationaux
L’année sous revue a été marquée par la suspension de durée indéterminée,le 27 juillet 2006,de toutes les négociations menées dans le cadre du cycle de Doha.Il est encore trop tôt pour en apprécier les conséquences sur le système commercial mondial et sur la réforme de la politique agricole en Suisse.Une période prolongée sans décision significative pourrait cependant avoir des incidences sur l’évolution future de la politique suisse en matière de commerce extérieur.
En revanche,les relations avec l’UE ont très bien évolué.Il y a eu des progrès concernant aussi bien le commerce de produits agricoles que le développement contractuel de l’accord agricole.En juin 2006,le Conseil fédéral a chargé les services administratifs compétents de mener avec l’UE des entretiens exploratoires sur la forme et le contenu d’un éventuel accord de libre-échange agricole.Une décision sur l’engagement de négociations formelles pourrait être prise en 2007.
Un accord de libre-échange et des concessions dans le domaine agricole sont entrés en vigueur entre la Suisse et la Corée du Sud,et la Suisse a signé un accord avec l’Union douanière des pays de l'Afrique du Sud.Le Conseil fédéral a par ailleurs décidé l’introduction de l’accès en franchise et sans contingents de tous les produits provenant des pays les moins développés.

■■■■■■■■■■■■■■■■
3.ASPECTSINTERNATIONAUX 3.1 DÉVELOPPEMENTS INTERNATIONAUX 3 217
Libre-échange agricole entre la Suisse et l’UE?
En janvier 2006,le Conseil fédéral a chargé le DFE et le DFAE d’examiner la faisabilité d’un accord de libre-échange agricole avec l’UE.Des premiers résultats de cet examen ont montré qu’un tel accord serait avantageux du point de vue macroéconomique et sur le plan de la politique agricole à condition de porter sur l’ensemble de la chaîne de production dans le domaine agroalimentaire,mais aussi sur toutes les entraves au commerce,tarifaires et non tarifaires.Le rapprochement au niveau des prix de l’UE représenterait toutefois un défi de taille pour l’agriculture et les échelons situés en amont et en aval.Selon les modalités de transition,des mesures d’accompagnement de durée limitée seraient indispensables.Sur cette base,le Conseil fédéral a décidé,le 10 mars 2006,de poursuivre le projet,de consulter les milieux intéressés en Suisse et de prendre contact avec la Commission européenne.
Des pourparlers exploratoires ont eu lieu avec la Commission européenne à fin mai 2006.Il s’agissait de s’assurer de l’intérêt de l’UE à un accord et d’examiner notamment les thèmes suivants:harmonisation des prescriptions dans le domaine non tarifaire et en matière d’homologation de moyens de production et de denrées alimentaires,épuisement régional des brevets de produits phytosanitaires et de médicaments vétérinaires,ainsi que des droits de protection des variétés,reconnaissance de l’équivalence dans le domaine non encore harmonisé (principe du Cassis de Dijon) et aspects institutionnels.Les sondages effectués en Suisse et à Bruxelles ont fait ressortir un intérêt de principe en ce qui concerne la poursuite du projet et de nouvelles clarifications.
Fin juin 2006,le Conseil fédéral a dès lors décidé d’entamer,avec la Commission européenne,des entretiens exploratoires sur les éléments-clés matériels et formels d’un éventuel accord de libre-échange.En même temps,il s’agit d’estimer plus exactement les conséquences macroéconomiques et spécifiques aux différentes branches ainsi que d’étudier les mesures d’accompagnement adéquates et l’intégration d’un ALEA dans les politiques en place.
Le Conseil fédéral prendra probablement en 2007 la décision concernant l’engagement de négociations sur un accord de libre-échange dans le domaine agroalimentaire,en se fondant sur les résultats des entretiens exploratoires.
3.1 DÉVELOPPEMENTS INTERNATIONAUX 3 218
■ Développements
Accord agricole Suisse – UE
L’Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (accord agricole) vise l’amélioration de l’accès mutuel au marché de produits agricoles par la réduction des droits de douane, des subventions à l’exportation et des entraves techniques au commerce.Il reconnaît l’équivalence des prescriptions techniques dans certains domaines tels que la protection des végétaux,l’agriculture biologique et la lutte contre les épizooties.
Le volet tarifaire concerne essentiellement la libéralisation complète et réciproque du marché du fromage.A partir du 1er juin 2007,toutes les sortes de fromage bénéficieront d’une franchise totale dans le commerce entre la Suisse et l’UE;il n’y aura plus ni restrictions quantitatives ni subventions à l’exportation ou droits de douane.
L’équivalence des denrées alimentaires d’origine animale est le nouveau point fort du domaine non tarifaire.Dans cette optique,la Suisse a adapté sa législation aux dispositions européennes en matière d’hygiène et mené des négociations avec l’UE sur l’équivalence.L’Office fédéral de la santé publique (OFSP),l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) et l’Office vétérinaire fédéral (OVF) se sont chargés des préparatifs dans le cadre d’un projet commun.La première étape a été franchie dès le 1er janvier 2006, dans la mesure où la reconnaissance de l’équivalence est maintenue pour le lait et les produits laitiers.A l’avenir (probablement à partir de fin 2006),un nombre considérable d’entraves au commerce de toutes les autres denrées alimentaires d’origine animale seront levées,ce qui simplifiera l’accès au marché.
■ Comité mixte de l’agriculture
Le Comité mixte de l’agriculture,organe de l’accord agricole conclu par la Suisse et l’UE,s’est réuni pour la cinquième fois le 25 novembre 2005 à Bruxelles sous la présidence suisse.
Il a approuvé la demande de la Principauté du Liechtenstein concernant l’extension de l’accord agricole bilatéral à ce pays.L’échange de lettres concernant l’extension devrait être finalisé lors d’une réunion de représentants de la Suisse,de l’UE et de la Principauté du Liechtenstein en novembre 2006;il sera ensuite soumis à l’approbation du Conseil fédéral.
En 2005,le Comité mixte a approuvé deux décisions concernant la simplification administrative du commerce de vins et de végétaux,ainsi que deux autres décisions concernant des concessions douanières liées à l’élargissement de l’UE à l’Est et l’actualisation de l’annexe sur les produits biologiques.Il est également prévu d’adapter les annexes relatives aux vins et aux spiritueux.En ce qui concerne ces derniers,l’UE entend adapter sa liste de produits dès que la base légale requise à cet effet sera établie.
Dans le domaine de la production biologique,il a été relevé,en rapport avec l’actualisation des annexes de l’accord agricole,que les normes juridiques suisses et européennes peuvent être adaptées sans problème.La possibilité,pour la Suisse,de participer au «Comité permanent pour l’agriculture biologique» afin d’assurer l’échange d’informations doit encore être examinée.La Suisse a adapté ses normes juridiques portant sur la désignation de la volaille;les adaptations sont entrées en vigueur le 1er janvier 2006 et assurent l’équivalence avec les normes européennes en la matière.
3.ASPECTSINTERNATIONAUX 3.1 DÉVELOPPEMENTS INTERNATIONAUX 3 219
■ Négociations AOC
Les Parties contractantes ont aussi discuté de la demande présentée par le BadeWurtemberg et portant sur l’éventualité de doubles paiements aux agriculteurs suisses exploitant des terres en Allemagne.Le Conseil fédéral a décidé que les versements de l’UE devaient être déduits des paiements directs octroyés en Suisse,pour autant que la Suisse reçoive les informations nécessaires sur les agriculteurs concernés.
Le groupe de travail ad hoc AOC,institué par le Comité mixte de l’agriculture,a reconnu l’équivalence des législations et désigné les cas problématiques (dénominations protégées par une partie et utilisées par une autre partie).Le 10 juin 2005,le Conseil fédéral a autorisé l’engagement de négociations en vue de la reconnaissance réciproque des AOC (appellations d’origine contrôlée) et des IGP (indications géographiques protégées).L’UE,quelque peu ébranlée par le Panel OMC des Etats-Unis et de l’Australie sur les indications géographiques,ne dispose pas encore de mandat de négociation.Néanmoins,elle partage avec la Suisse l’intérêt à conclure un tel accord et la volonté de trouver des solutions aux cas problématiques.
Politique agricole commune de l’UE
La Politique agricole commune (PAC) de l’UE a évolué dans plusieurs domaines en 2006.
Le 24 novembre 2005,les ministres de l’agriculture ont décidé une réorganisation du marché sucrier:le prix garanti du sucre blanc sera abaissé de 36% en l’espace de quatre ans.Le manque à gagner des agriculteurs sera compensé à raison de 64,2% en moyenne par un paiement découplé de la production,mais lié au respect de certaines normes relatives à la protection de l’environnement et à l’exploitation du sol,et intégré dans le paiement unique par exploitation.Les pays qui réduisent leur quota de production de plus de la moitié sont autorisés à octroyer en plus,pendant cinq ans,un paiement lié à la production correspondant à 30% des pertes de revenu.Une réglementation généreuse concernant les restructurations volontaires doit inciter les producteurs peu compétitifs à abandonner leur activité dans le secteur du sucre. L’intervention consistant à racheter les excédents sera progressivement supprimée dans un délai de quatre ans.Quant aux pays en développement,ils continueront de bénéficier d’un accès préférentiel au marché européen.Dans le cadre d’un programme de soutien,un montant de l’ordre de 40 millions d’euros est mis à la disposition des pays ACP (Afrique,Caraïbes et Pacifique) ayant besoin d’une aide.Le chapitre 2.1 Production et ventes présente plus de détails les conséquences de cette réforme pour la politique sucrière suisse.
Début 2006,la Commission européenne a proposé une stratégie concernant les carburants biologiques.Les trois objectifs principaux consistent,premièrement,à promouvoir les carburants biologiques tant dans l’UE que dans les pays en développement, deuxièmement,à améliorer la compétitivité au niveau des coûts et à renforcer la recherche sur les carburants biologiques «de la deuxième génération» et,troisièmement,à soutenir les pays en développement,où la production de carburants biologiques pourrait favoriser une croissance économique durable.
3.1 DÉVELOPPEMENTS INTERNATIONAUX 3 220
L’accord bilatéral sur le vin conclu par l’UE et les Etats-Unis a été signé le 10 mars 2006 à Londres,après plus de vingt ans de négociations.Eléments-clés de l’accord:1.quelques noms de vins européens,tels que Porto, Sherry et Champagne,sont aujourd’hui considérés comme dénominations génériques aux Etats-Unis.L’accord restreint l’utilisation de ces noms dans ce pays.2.Des procédés de vinification appliqués aux EtatsUnis et qui ne sont pas mentionnés comme dérogations par l’UE,sont désormais reconnus.3.Les vins de l’UE sont aussi exemptés des prescriptions de certification édictées en 2004 aux Etats-Unis.
Dans quelques pays membres de l’UE,l’apparition de la grippe aviaire a fait chuter la consommation et les prix de la volaille et des œufs.C’est pourquoi le Conseil européen et le Parlement ont adopté,fin avril 2006,la proposition de la Commission d’assumer, à titre exceptionnel,50% des coûts des mesures de soutien du marché.
Début avril 2006,700 représentants politiques européens,fonctionnaires de l’UE et experts renommés des sciences et du commerce,ainsi que des représentants d’ONG, ont discuté des futures stratégies de coexistence entre plantes cultivées génétiquement modifiées,conventionnelles et biologiques,à une réunion d’experts tenue à Vienne.Ils sont principalement arrivés à la conclusion qu’en considération des expériences restreintes acquises jusqu’à présent dans l’UE avec les cultures de plantes génétiquement modifiées et du fait que,dans les pays membres,l’introduction de mesures ad hoc n’est pas encore terminée,il n’est actuellement pas indiqué d’élaborer des normes juridiques pour l’ensemble de l’UE.

3.1 DÉVELOPPEMENTS INTERNATIONAUX 3 221
■ Conférence ministérielle de Hong Kong (13–18 décembre 2005)
L’été 2006 a été marquée par l’interruption des négociations du cycle de Doha entamé en 2001.En effet,après de longs mois de discussions continues à Genève,notamment en marge du Sommet du G8 à Saint-Petersbourg (15–17 juillet),les Membres de l’OMC se sont finalement résignés à reporter la conclusion du cycle.Il n’y a pas,à l’heure actuelle,de date de reprise.Entre autres,les Etats-Unis d’Amérique sont tournés vers leurs élections partielles de mi-novembre et ne peuvent s’aventurer sur le terrain des concessions,notamment agricoles,et d’autres contraintes politiques sont encore à venir.Au vu de ces circonstances,les négociations risquent de ne pas reprendre rapidement,d’aucuns estiment que l’interruption pourrait durer des mois,voire des années.
Alors que la deuxième moitié de l’année 2005 avait été pour l’essential consacrée aux préparatifs de ce qui devait être la Conférence ministérielle décisive du cycle,en janvier 2006,les ministres à nouveau réunis en marge du Forum économique mondial de Davos ont dû constater le peu d’avancées effectives dans les principaux dossiers.Les discussions ont repris ensuite avec plus ou moins d’entrain,puisque les ministres avaient mandatés leurs négociateurs de préparer cette fois-ci la conclusion définitive des modalités pour la fin avril.La Conférence de Hong Kong avait quand même permis aux 149 Membres d'entériner le principe de l'élimination des subventions à l'exportation jusqu’en 2013 et de figer certains des paramètres de la formule de réduction du soutien interne.
Subventions aux exportations: La Suisse a soutenu l'UE qui s'est battue pour obtenir l'assurance que le même sort soit réservé à toutes les formes de soutien aux exportations.Les ministres ont essayé de définir les pratiques à éliminer:les éléments de subventions contenus dans les crédits à l'exportation,l'aide alimentaire provenant d’excédents de production et les entreprises exportatrices d'Etat.Dans le domaine de l'aide alimentaire,une «catégorie sûre» a été créée (safe box) composée d'aides supposées sans effets de distorsion.Les bénéficiaires d'aide alimentaire (et les grands donateurs) se sont opposés à ce que toute aide en nature soit interdite,surtout dans des cas d'urgence.En Suisse,alors que les subventions aux exportations étaient encore de 206 millions de francs en 2003,les dépenses dans ce pilier n'ont été que de 145 millions de francs en 2005.
Soutien interne: Dans ce pilier,les Membres ont structuré les formules qui permettront de réduire la mesure globale de soutien et le montant total des subventions internes. Il s'agira de deux formules à trois bandes au sein desquelles les Membres ont été classés.L’UE figure en tête,le Japon et les USA dans la bande médiane et tous les autres y compris la Suisse dans la bande inférieure.Les taux de réduction augmentent d'une bande à l'autre.Les Membres ont confirmé leur volonté de procéder à des diminutions «effectives» des niveaux de soutien.Une telle formulation confirme que les réductions devraient toucher aux niveaux de soutien réels et pas seulement aux niveaux des engagements du Cycle d'Uruguay.
OMC
3.1 DÉVELOPPEMENTS INTERNATIONAUX 3 222
■ Réunions à Genève (janvier–juin 2006)
Accès au marché: Le pilier de l'accès au marché n'a pas pu être négocié au niveau ministériel,en ce qui concerne les pays développés.Des discussions techniques ont eu lieu.Le texte ministériel confirme l'idée d'une formule de réduction des droits de douane à quatre bandes,assortie de «produits sensibles» (dont les droits de douane baisseraient moins fortement mais dont,en revanche,les volumes ouverts aux importations sous forme de contingents tarifaires doivent être augmentés) et de «produits spéciaux» stratégiques dans les pays en développement.
La période post-Hong Kong a été riche en réunions techniques dans chacun des trois piliers et quelques sujets annexes.Les discussions ont permis au président des négociations agricoles de produire des textes de référence décrivant les positions des Membres.Ceux-ci ont essayé de préparer au mieux le délai de fin avril fixé pour la plupart des sujets par les Ministres en décembre,mais sans succès.L’agenda a donc été retardé jusqu’à juin.
Accès au marché: Les discussions ont surtout porté sur la question du traitement des produits sensibles.En parallèle,les revendications des pays en développement ont trouvé une bonne place dans les réunions,ainsi on a défriché la question de la sélection des produits spéciaux,du contenu du mécanisme de sauvegarde spéciale,de la désignation et du traitement des produits tropicaux,entre autres.N’ont par contre, pratiquement pas changé les questions du «capping» des droits de douane (limite supérieure absolue) ou du nombre et du traitement des produits sensibles.Il semblait clair,à l’orée de la rencontre ministérielle de fin juin,que personne n’avait le pouvoir, au niveau des négociateurs,d’avancer des chiffres,et que cette tâche revenait donc aux Ministres.
■ Réunion ministérielle restreinte de Genève (29 juin–1er juillet 2006)
Ce qui devait être une étape décisive du Cycle de Doha s’est en fait transformé en réunion cordiale entre Ministres en mal de flexibilité.En effet,les USA,complètement bloqués par leur Congrès en phase pré-électorale,n’ont pu faire montre d’aucune ouverture sur leur position,notamment dans le dossier agricole.L’UE a imité son partenaire en ne cédant sur aucun point,le G20 des grands pays exportateurs en développement en a fait de même.La rencontre ministérielle s’est terminée plus tôt que prévu et sans aucun résultat.Le Directeur général a décrété l’état de crise et a pris la responsabilité,sur demande des Membres,de jouer un rôle de catalyseur et de tenter de dégager des compromis au moyen de rencontres bilatérales.Il n’y est pas parvenu et le cycle de l’OMC a dès lors été suspendu.
3.ASPECTSINTERNATIONAUX 3.1 DÉVELOPPEMENTS INTERNATIONAUX 3 223
Pays les moins avancés
Le Conseil national a approuvé à l’unanimité,le 15 juin 2006,la loi fédérale portant modification de Arrêté fédéral du 9 octobre 1981 concernant l’octroi de préférences tarifaires en faveur des pays en développement (A sur les préférences tarifaires) (RS 632.91,http://www.admin.ch/ch/f/ff/2006/2875.pdf).Il a décidé ainsi de ne plus limiterla durée de validité de l’arrêté en vigueur après le 28 février 2007.
Dans le cadre de la révision du système des préférences généralisées (SPG),le Conseil fédéral a mis en consultation une révision de l’ordonnance du 29 janvier 1997 fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (Ordonnance sur les préférences tarifaires) (RS 632.911) auprès des experts douaniers le 18.07.06. Cette révision comporte les éléments suivants:
–l’élimination de tous les droits de douane en faveur des pays les moins avancés (PMA) au premier mars 2007;

–l’extension des droits de douane préférentiels accordés aux PMA aux Pays Pauvres Très Endettés (PPTE) (Côte-d’Ivoire,Congo et Kirghizstan) sous réserve que ces préférences soient tolérées par l’accord GATT (clause d’habilitation);
–l’annulation des droits préférentiels pour certains pays en développement avancés, ou sur certains produits de ces pays (notion de graduation partielle).
En décembre 2005 lors de la 6e Conférence ministérielle de l’OMC à Hong Kong,les Membres se sont engagés,dès 2008 ou au plus tard au début de la période de mise en œuvre d’un éventuel accord de Doha et pour au moins 97% des lignes tarifaires,à garantir l’accès des PMA au marché en franchise de droits et sans contingent.
En Suisse,deux étapes de réduction des droits de douane en faveur des PMA ont déjà été franchies,la première en 2002 et la seconde en 2004.Les droits résiduels des chapitres tarifaires 1 à 24 se situent entre 0 et 45% du taux normal.La part des importations originaires des PMA est,jusqu’ici,négligeable.Elle s’élève à 0,12 pour cent de nos importations.La troisième étape (probablement) de mars 2007 a déjà été mentionnée ci-dessus.Cependant deux produits seront exemptés de l’élimination des droits de douane à cette date.Il s’agit du sucre (libéralisation entière prévue en juillet 2009 coordonnée avec le calendrier de l’UE) et des brisures de riz (idem en septembre 2009).
Accords de libre-échange conclus avec des pays
non-membres de l’UE
Comme les négociations à l’OMC durent dans le temps,de nombreux pays ont commencé dès 2005 à intensifier parallèlement les négociations en vue d’accords de libreéchange bilatéraux.En comparaison mondiale,l’économie suisse est restreinte et doit donc veiller à améliorer l’accès à des marchés non européens et à garantir la sécurité du droit,en faveur de son économie d’exportation (marchandises et prestations de services) ou,du moins,à empêcher une éviction par ses concurrents.Hormis ceux conclus avec l’UE,14 accords de libre-échange sont en vigueur actuellement.
3.1 DÉVELOPPEMENTS INTERNATIONAUX 3 224
Le 15 décembre 2005,la Suisse a signé un accord global de libre-échange avec la Corée du Sud.Cet accord est entré en vigueur le 1er septembre 2006.Il porte sur le commerce de produits industriels (produits agricoles transformés,poissons et autres produits de la mer compris),le commerce de prestations de services,la propriété intellectuelle,les marchés publics et la concurrence.En complément de cet accord,la Suisse,le Liechtenstein et l’Islande ont conclu avec la Corée un accord d’investissement qui prévoit l’accès au marché pour de nouveaux investissements et la protection de ceux qui existent.Il remplacera l’accord bilatéral sur la protection des investissements que la Suisse et la Corée avaient conclu en 1971.Le commerce de produits agricoles non transformés est régi par des accords agricoles bilatéraux que les Etats membres de l’AELE et la Corée ont conclus afin de tenir compte des particularités des marchés et des politiques agricoles des Etats membres.Ces accords avec la Corée améliorent largement l’accès au marché et la sécurité du droit pour les exportations suisses (marchandises et prestations de services) et assurent aussi bien la possibilité d’investir que la protection de la propriété intellectuelle.Ils renforcent la compétitivité de l’économie suisse sur le marché coréen en évitant la discrimination pouvant résulter de la conclusion,par la Corée,d’accords préférentiels avec d’autres pays.Les membres de l’AELE bénéficient aussi d’un avantage concurrentiel sur le marché coréen,dans la mesure où leurs principaux concurrents de l’UE,des Etats-Unis et du Japon n’ont pas encore d’accès préférentiel à ce marché.Jusqu’à présent,la Corée a conclu des accords de libre-échange avec le Chili et Singapour;elle a par ailleurs entamé des négociations avec les pays de l’ASEAN,le Japon et le Canada.
Les négociations avec le SACU (Union douanière de l'Afrique australe regroupant le Botswana,la Namibie,le Lesotho,l'Afrique du Sud et le Swaziland) ont été menées à bonne fin en août 2005.Il s’agit là d’un accord sur le commerce de marchandises s’appliquant aussi bien à l’industrie (produits agricoles transformés,poissons et autres produits de la mer compris) qu’aux produits agricoles non transformés.La conclusion d’un accord de libre-échange global est impossible en raison de l’absence d’une base légale suffisante dans plusieurs Etats membres du SACU.La tâche des Etats membres de l’AELE a été particulièrement exigeante,car ils négociaient pour la première fois avec une union douanière comprenant cinq pays membres dont le niveau économique diverge fortement (le Lesotho fait partie des pays les moins avancés),de même que les formes juridiques de ces pays (républiques et royaumes).Les processus de signature et de ratification des accords ont ainsi pris beaucoup de temps.On s’attend à ce que l’accord entre en vigueur au cours de 2007.
Des négociations sont par ailleurs en cours ou prévues avec les pays suivants:Canada, Egypte,Thaïlande,Algérie,Conseil de coopération du Golfe (Koweït,Qatar,Oman, Arabie saoudite,Bahrain,Emirats Arabes Unis),Japon,Indonésie,Mercosur,Malaisie, Syrie,Ukraine,Russie (après son adhésion à l’OMC),Serbie et Monténégro.
3.ASPECTSINTERNATIONAUX 3.1 DÉVELOPPEMENTS INTERNATIONAUX 3 225
OCDE
L’indicateur ESP (estimation du soutien aux producteurs) calculé par l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) mesure le transfert monétaire annuel des contribuables et des consommateurs aux producteurs agricoles.En Suisse, l’ESP se compose du soutien du marché,de la promotion des ventes,des paiements directs,des contributions à l’amélioration des bases de production et de la protection à la frontière.L’ESP par pays indique la part en pour-cent de la valeur de production que l’agriculture d’un pays donné obtient indirectement ou directement des consommateurs et des contribuables et non par la voie du marché.Avec un ESP de 68% en 2005,la Suisse est en tête des pays de l’OCDE.L’ESP calculé en fonction des biens sert à estimer la part que représente le transfert des contribuables et des consommateurs à la valeur de production d’un bien déterminé dans un pays donné.S’agissant du lait,par exemple,cette valeur s’élevait en Suisse à environ 87% en 1986;elle a baissé à 68% depuis.L’indice des ESP,qui est publié chaque année dans le rapport de l’OCDE «Suivi et évaluation»,est considéré mondialement comme un des principaux indicateurs économiques du secteur agricole;il en est ainsi souvent question dans les médias.En tant qu’indice du soutien accordé à l’agriculture,l’ESP n’intéresse pas que la population active dans l’agriculture et les représentants politiques,mais il sert aussi d’argument dans les débats sur la libéralisation du commerce mondial.
L’OCDE a entamé il y a plusieurs années une révision du classement ESP,selon laquelle les diverses mesures de soutien appliquées sont attribuées à des catégories.Cette révision vise à représenter de manière plus transparente et différenciée les réformes agricoles entreprises dans les pays membres,et à refléter la tendance à remplacer le soutien du marché lié à la production par des mesures découplées.Or,ladite révision porte sur le classement ESP,mais ne change que très peu la méthode de calcul et, partant,les valeurs finales de l’ESP par pays.En ce qui concerne l’ESP se référant aux biens,la principale question est de savoir quelles mesures de soutien devront ou pourront à l’avenir être ventilées entre les produits.Plus une mesure de soutien est découplée,plus la répartition de la somme monétaire entre les divers biens est aléatoire et plus l’indicateur risque d’être mal interprété.L’opinion des experts de l’OCDE est partagée sur cette question.Tandis que quelques pays membres souhaitent ventiler toutes les mesures de soutien entre les biens selon un barème,conformément à la méthode actuelle,un deuxième groupe estime que d’un point de vue scientifique, seuls les soutiens directement attribuables (p.ex.droits de douane ou contributions à la culture de betteraves) devraient entrer dans l’ESP se référant aux produits.Ce dernier changera considérablement selon l’issue des débats.Il n’est pas encore certain si et quand l’ESP révisé sera introduit dans le rapport de suivi et d’évaluation.
ESP 3.1 DÉVELOPPEMENTS INTERNATIONAUX 3 226
■ Révision de l’indicateur
3.2Comparaisons internationales
Le présent chapitre présente une comparaison internationale des prix à la production et à la consommation.Les coûts unitaires des facteurs de la production,mis à part celui de l’orge et du maïs,ne font pas partie de la présente comparaison.

Pourquoi faire une comparaison internationale?
Une comparaison internationale des prix est utile pour mieux «se connaître».Elle met en évidence la différence de coûts à la production entre les pays comparés.Elle fait la lumière sur les motivations du tourisme d'achat transfrontalier.Elle sert à définir les mesures à prendre aux frontières (réduction possible des droits de douane dans le cadre d’accords de libre échange).Elle est nécessaire enfin pour montrer au contribuable que l'agriculture suisse fait des efforts importants au niveau de sa compétitivité par les prix.
Si les prix sont un ingrédient important de la compétitivité,d’autres éléments déterminent aussi le succès des produits sur un segment de marché déterminé:la qualité,la sécurité et l’image des produits,la publicité,le réseau de distribution,la force de vente et les services liés aux produits.
■■■■■■■■■■■■■■■■
3.2 COMPARAISONS INTERNATIONALES 3 227
Méthode et définition
La comparaison internationale de prix est réalisée à partir de marchés identiques, similaires ou importants.Cet exercice présente certaines difficultés,dont le choix des produits,la disponibilité des données,la pertinence des valeurs,les modes de production et de commercialisation différents et les influences liées aux facteurs monétaires. Les prix utilisés dans ce chapitre ont les caractéristiques suivantes:
–Ce sont des moyennes nationales.C’est-à-dire qu’elles peuvent cacher des valeurs minimale et maximale selon les régions ou la mise en valeur du produit (prix à la production).
–Ils sont à prendre pour leur ordre de grandeur,car,par souci de représentativité,les produits (qualité,label) et les conditions de commercialisation (quantité,stade de commercialisation) ainsi que les canaux de vente et le mode de calcul de la moyenne ne sont pas parfaitement identiques entre les pays sous revue.
–Ce sont des prix bruts.
–Ils sont observés sur le marché (dans le cadre de la politique agricole propre à chaque pays).Les prix à la production sont exprimés sans la taxe sur la valeur ajoutée alors que cet impôt est inclus pour les prix à la consommation,car il s’agit d’une taxe imputée au consommateur.

–Sauf indication contraire,ils ne sont pas ajustés de la différence de pouvoir d’achat entre les différents pays comparés.Voir à ce sujet notamment les publications de l’OCDE (www.oecd.org/std/ppp),d’Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu) et de l’UBS,(http://www.ubs.com/1/f/career_candidates/experienced_professionals? newsId=103135)
Ce ne sont donc pas tellement les valeurs absolues qui sont les plus importantes mais plutôt les évolutions enregistrées au fil du temps.
3.2COMPARAISONS INTERNATIONALES 3 228
Les recettes réalisées par les producteurs sur la vente d’un «panier type» servent de base à la comparaison.Le «panier type» est composé de la production moyenne (1998–2000) suisse de 15 des 17 produits agricoles faisant l'objet de la présente comparaison internationale de prix.Les statistiques de prix des betteraves sucrières et du colza des USA étant non disponibles,ces productions sont exclues du «panier-type». Sa composition détaillée est indiquée en bas du tableau 53b de l’annexe.Il représente 3,2 millions de t de lait,2,7 millions de têtes de porcs,35,5 millions de têtes de poulets,etc.Cette composition suisse est ainsi appliquée aux pays faisant l’objet de la comparaison.
Les prix de l’UE (UE-4/6) portent sur les quatre pays voisins.Les cinquième et sixième pays sont les Pays-Bas et la Belgique.Ces deux pays sont également retenus en cas de production importante.Le calcul du prix moyen pour l’UE-4/6 repose sur le volume de la production 1995/2001 des pays concernés.La composition du «panier type» et le poids des pays de l’UE-4/6 sont choisis fixes à travers les années afin de ne mettre en évidence que les variations de prix.
Quel est le niveau des prix agricoles suisses par rapport à ceux en vigueur dans l’UE ou aux USA?
–Si les paysans de l’UE-4/6 ou des USA vendaient «sortie ferme»,le «panier-type» suisse dans leur propre pays en 2003/05,ils en retireraient une recette équivalente à environ la moitié (respectivement 54 et 47%) de celle obtenue par leurs homologues suisses.
–Les paysans de l’UE-4/6 ou des USA bénéficient cependant d’une situation relative plus élevée que celle exprimée ci-dessus en francs suisses si on fait la comparaison en terme de parité de pouvoir d'achat.En effet,selon l’OCDE,un même panier représentatif de biens et services coûtait en 2003/05,100 CHF en Suisse contre 80 CHF en UE-4/6 et 74 CHF aux États-Unis.Ainsi,si les paysans de l’UE-4/6 ou des USA vendaient le «panier type» suisse dans leur propre pays,ils disposeraient d’un pouvoir d’achat équivalent à respectivement 68 et 64% de celui de leurs homologues suisses.
–Des différences existent entre pays de l’UE.Ainsi les recettes obtenuessur le «panier type» équivalent en Italie à 65%,en Allemagne à 54%,en France à 54%,et en Autriche à 51% du prix de ce même panier en Suisse en 2003/05.
–Des différences existent aussi selon les produits.Les prix des produits des grandes cultures comme le blé (30% du prix suisse),l’orge (35%),le colza (42%) et les pommes de terre (49%) sont,en 2003/05,particulièrement faibles dans l’UE-4/6. Le prix des betteraves sucrières (52%),produit contingenté dans l’UE,n’est cependant pas aussi faible que celui des autres grandes cultures.A l’opposé,le prix du lait (63%),produit encore contingenté dans l’UE,est assez élevé dans l’UE-5.
–En conséquence des différences plus importantes encore existent dans le couple «pays-produits».Alors qu’en France,les poires se vendaient à 96% du prix suisse en 2003/05,le prix des carottes en Belgique n’atteignait que 10% de celui obtenu en Suisse.
3.ASPECTSINTERNATIONAUX 3.2 COMPARAISONS INTERNATIONALES 3 229
■ Prix à la production Tableaux 52–53b,pages A59–A61
(CH =
Evolution des prix à la production dans l'UE et en Suisse
Lait (10 kg) Gros bovin (kg PM) Veau (kg PM) Porc (kg PM) Poulet (2 kg PV) Oeuf (20 pces) Blé (10 kg) Orge (10 kg) Maïs-grain (10 kg) Bett. suc. (100 kg) Pommes de t. (20 kg) Colza (5 kg) Pomme (10 kg) Poire (10 kg) Carotte (10 kg) Oignon (10 kg) Tomate (5 kg) Panier type (mia an)
UE 1990/92
Supplément CH 1990/92
UE 2003/05
Supplément CH 2003/05
Sources: OFAG, OFS, Banque nationale suisse, USP, Eurostat, ZMP, Agreste
Prix à la production dans l'UE-4/6 par rapport à la CH
1990/92 2003/05
Lait Gros bovin Veau Porc Poulet Oeuf Blé Orge Maïs-grain Bett. suc. Pomme de t. Colza Pomme Poire Carotte Oignon Tomate Panier type 3.2COMPARAISONS INTERNATIONALES 3 230
0 16 14 12 10 8 6 4 2
0 100 90 80 70 60 40 50 30 20 10
francs
Indice
Sources: OFAG, OFS, Banque nationale suisse, USP, Eurostat, ZMP, Agreste 100)
Les prix agricoles suisses se rapprochent-ils de ceux en vigueur dans l’UE ou aux USA?
–Les prix du «panier-type» à la production (exprimés en francs suisses) entre 1990/92 et 2003/05 ont baissé non seulement en Suisse (–25%) mais aussi dans l’UE (–20%).La baisse des prix dans l’UE est à mettre en rapport non seulement avec les réformes agricoles mais aussi avec l’affaiblissement de 14% de l’euro face au franc suisse.
–L’écart relatif entre la Suisse et l’UE s’est quelque peu réduit entre ces deux périodes. Le prix du «panier-type» dans l’UE était de 51% du prix suisse en 1990/92 contre 54% actuellement (2003/05).
–Mais c’est surtout au niveau absolu que les prix suisses se sont significativement rapprochés des prix de l’UE.L’écart de prix du «panier-type» entre la Suisse et les pays de l’UE voisins se montait à 49% (3’553 mio.de fr.) du prix de ce panier en Suisse en 1990/92 et se situait à 46% (2’484 mio.de fr.) pour la période 2003/05. L’écart absolu entre la Suisse et l’UE,s’est donc rétréci d’un tiers (–30%) entre ces deux périodes.
Evolution des prix à la production du panier type
Sources: OFAG, OFS, Banque nationale suisse, USP, Eurostat, ZMP, Agreste, U.S. Department of Agriculture
–Des différences existent entre les pays de l’UE.Entre ces deux périodes,l’écart absolu du prix du «panier type» s’est rétréci le plus avec la France (–34%),l’Italie (–32%) et l’Allemagne (–29%) alors qu’il s’est réduit dans une moindre mesure avec l’Autriche (–8%).
–Des différences existent aussi selon les produits.Entre 1990/92 et 2003/05,l’écart absolu des prix entre l’UE et la Suisse s’est réduit le plus pour le colza (–71%),les œufs (–35%),le lait (–43%) et le blé (–43%) alors qu’il stagnait dans le cas des gros bovins (0%) ou augmentait même pour les oignons (+70%).
1990/9219971998199920002001200220032005 2004 0 60 50 40 30 20 10 70 80 90 100 CHUE-4/6USA
Indice (CH 1990/92 = 100)
3.2 COMPARAISONS INTERNATIONALES 3 231 3.ASPECTSINTERNATIONAUX
Prix à 3.2COMPARAISONS INTERNATIONALES 3 232
–Aux États-Unis,l’évolution depuis 1990/92 a été différente.Les prix à la production (exprimés en francs suisses) ont connu une courbe ascendante (+28%) jusqu’en 2001 descendante jusqu'en 2003 et de nouveau ascendante en 2004.En 2003/05 le prix du «panier-type» aux USA revenait pratiquement au même niveau (+0%) que celui de la période de référence 1990/92.Le cours du dollar face au franc suisse a régressé (–9%) entre les deux périodes sous revue.Par rapport à la période de référence 1990/92,la différence du prix du «panier-type» avec les USA s’est réduite aussi bien en valeur relative (Les prix USA étaient de 47% des prix suisses en 2003/05 contre 35% en 1990/92) qu’en valeur absolue (–39%).
Evolution des prix à
du
■ 1990/9219971998199920002001200220032005 2004
la consommation Tableaux 54–55,pages A62–A63 0 60 50 40 30 20 10 70 80 90 110 100 CHMoyenne haute UE UE-4/5 Moyenne basse UE USA
la consommation
«panier standard» Indice (CH 1990/92 = 100)
L’écart des prix au détail des denrées alimentaires entre la Suisse et les pays considérés a été estimé sur la base du prix d’un «panier standard» à la consommation en magasin, TVA comprise.Ce «panier standard» correspond grossièrement à la consommation annuelle moyenne d'un habitant en Suisse (voir le tableau 10 en annexe) des 21 denrées alimentaires faisant l'objet de la présente comparaison internationale.«Grossièrement» car,par exemple,toute la viande de bœuf est représentée par le seul rôti de bœuf.Ce panier représente 380 kg ou 91% des 417 kg de denrées alimentaires (sans le vin) consommés annuellement par un habitant en Suisse.Sa composition détaillée est indiquée en bas du tableau 55 de l’annexe. OFAG, OFS, ZMP (D), services statistiques nationaux de F, B, A, USA,Service statistique de la ville de Turin (I)
Sources:
Le groupe «UE-4» comprend,comme pour les prix à la production,les pays environnants,c’est-à-dire l’Allemagne,la France,l’Italie et l’Autriche.Pour l’Italie,les prix de la ville de Turin ont servi de base de référence.La Belgique a été prise en considération dans le domaine des légumes ou lorsque les prix des pays voisins n’étaient pas disponibles.Par ailleurs,les prix nationaux minimaux ou maximaux ont été regroupés pour former respectivement la moyenne basse et haute de l’UE-4/5.
Le poids des pays de l’UE-4/6 (valeur des dépenses des ménages privés en 1998) comme la composition en produits du «panier standard» sont choisis fixes afin de ne faire ressortir à travers les années que les variations de prix.
En 2003/05,le prix du «panier standard» à la consommation dans l’UE-4/6 valait 62% de celui du même panier acheté en Suisse contre pour rappel 54% pour le «paniertype» à la production.Ce prix européen relativement plus élevé à la consommation qu’à la production s’explique notamment en raison de la non identité de la composition du «panier standard» à la consommation avec celle du «panier-type» à la production,de l’influence des denrées alimentaires importées mais aussi de la taxe sur la valeur ajoutée qui est plus élevée dans l’UE (environ 7% avec des variations entre pays et produits) qu’en Suisse (2,4%).
En Suisse,le prix à la consommation du «panier standard» est resté pratiquement inchangé (+2%) entre les deux périodes sous observation 1990/92 et 2003/05 alors que dans l’UE une baisse de 8% a été enregistrée.En conséquence,l’écart de prix entre la Suisse et les pays de l’UE voisins qui se montait à 31% (697 fr.) du prix de ce panier en Suisse en 1990/92 a augmenté à 38% (872 fr.) pour la période 2003/05.L’écart absolu entre la Suisse et l’UE,s’est même accru d’un quart (+25% ou +175 fr.) entre ces deux périodes.
Contrairement aux prix à la production,le fossé entre la Suisse et l’UE se creuse donc en ce qui concerne les prix à la consommation.La hausse en Suisse de la part des labels (Bio,M-7,Coop Natura Plan),notamment dans le domaine de la viande,expliqueau moins en partie ce développement.
Il existe toutefois d’énormes différences entre les pays.Tandis que le prix du lait de consommation est plus élevés en Italie (Turin) qu’en Suisse et que le sucre peut également être plus cher dans l’UE,les côtelettes de porc y sont vendues la moitié du prix suisse.Cette dernière différence s’explique en partie par le fait que la viande de porc proposée dans l’UE-4 est pour la plupart issue d’exploitations conventionnelles,alors que celle proposée dans les magasins suisses était en 2001 composée à 60% de viandes de marque ou labels.
Entre 1990/92 et 2003/05,les prix à la consommation – exprimés en francs suisses –ont augmenté de 10% aux États-Unis alors qu’ils étaient quasi stationnaires (+2%) en Suisse.Ainsi,l’écart par rapport à la Suisse s’est réduit,il est de 48% du prix suisse en 2003/05 contre encore 51% en 1990/92.

3.2 COMPARAISONS INTERNATIONALES 3 233 3.ASPECTSINTERNATIONAUX
Collaboration au rapport agricole 2006
■ Direction du projet, Werner Harder
secrétariat Alessandro Rossi
Monique Bühlmann
■ Auteurs
■ Rôle et situation de l‘agriculture
L’agriculture,partie intégrante de l’économie
Alessandro Rossi
Marchés
Jacques Gerber,Simon Hasler,Katja Hinterberger,Beat Ryser,Hans-Ulrich Tagmann
Situation économique
Alessandro Rossi
Aspects sociaux
Esther Grossenbacher,Stefan Mann,Ruth Rossier
Ecologie et éthologie
Brigitte Decrausaz,Anton Candinas,Esther Grossenbacher,Hans-Jörg Lehmann
■ Mesures de politique agricole
Production et ventes
Jacques Gerber
Instruments transversaux
Friedrich Brand,Jean-Marc Chappuis,Emanuel Golder,Samuel Heger, Jacques Henchoz
Economie laitière
Katja Hinterberger
Production animale
Simon Hasler
Production végétale
Beat Ryser,Hans-Ulrich Tagmann
Paiements directs
Thomas Maier,Daniel Meyer,Hugo Roggo,Olivier Roux,Beat Tschumi,Martin Weber, Michael Weber
3 234
■ Services de traduction
Amélioration des bases de production
Améliorations structurelles et mesures d’accompagnement social René Weber,Samuel Brunner,Willi Riedo
Recherche,haras,vulgarisation,formation professionnelle,CIEA
Anton Stöckli,Urs Gantner,Geneviève Gassmann,Pierre-André Poncet,Roland Stähli
Moyens de production
Lukas Barth,Olivier Félix,Markus Hardegger
Elevage
Karin Wohlfender
Section Inspectorat des finances
Rolf Enggist
■ Aspects internationaux
Développements internationaux
Krisztina Bende,Friedrich Brand,Jean Girardin,Gisèle Jungo,Fabian Riesen
Comparaisons internationales
Jean Girardin
Français:Christiane Bokor,Pierre-Yves Barrelet,Yvan Bourquard, Giovanna Mele,Elisabeth Tschanz,Marie-Thérèse Von Graffenried, Magdalena Zajac
Allemand:Yvonne Arnold
Italien:Patrizia Singaram,Floriana Dondina,Simona Stückrad
■ Internet Denise Vallotton
■ Soutien technique Hanspeter Leu,Peter Müller
235
236
ANNEXE A1 ■■■■■■■■■■■■■■■■ Annexe Tableaux Structures A2 Tableaux Marchés A4 Tableaux Résultats économiques A14 Comptes économiques de l’agriculture A14 Résultats d’exploitation A16 Tableaux Dépenses de la Confédération A27 Dépenses Production et ventes A27 Dépenses Promotion des ventes A27 Dépenses Economie laitière A28 Dépenses Economie animale A28 Dépenses Production végétale A29 Dépenses Paiements directs A30 Dépenses Amélioration des bases de production A52 Dépenses Agriculture et alimentation A58 Tableaux Aspects internationaux A59 Textes légaux,Définitions et méthodes A64 Abréviations A65 Bibliographie A67
■■■■■■■■■■■■■■■■ Tableaux Structures
A2 ANNEXE
Tableau 1
ExploitationsSurfaceagricoleutileUnitésdegrosbétail Classesdegrandeur, enhadesurface199020002005199020002005199020002005 agricoleutilenombrenombrenombrehahahanombrenombrenombre 0-16 6293 6092 8062 8951 33694382 55061 01661 507 1-313 1904 7623 81623 8288 8617 05034 46614 75313 001 3-58 2595 3934 02532 24321 34816 08542 47327 71420 980 5-1018 83313 14911 108141 40399 05683 756209 784127 361105 828 10-1518 92013 81211 806233 888171 817147 143341 563230 628194 006 15-2012 71011 17210 188218 771193 856176 906290 523247 517227 510 20-256 6777 2447 157147 772161 311159 578173 896191 057194 761 25-303 3644 4304 64991 271121 005126 97197 680130 901141 074 30-402 6744 1684 68090 726142 266159 71387 709142 628165 937 40-508751 5911 81438 67270 50180 53432 21461 91475 289 50-705079211 16928 84952 67267 47423 17242 70758 340 70-10012720931810 37117 02125 7507 41413 29021 673 > 1005077917 80211 44413 2166 3158 0259 418 Total928157053763627106849010724921065118142975912995121289324 Source:OFS
Evolution des exploitations agricoles,de la surface agricole utile et des unités de gros bétail
ANNEXE A3
2 Personnes occupées dans l'agriculture CatégorieEmployésàpleintempsEmployésàtempspartielTotal 199020002005199020002005199020002005 Chefs d'exploitationHommes62 72049 33944 06726 16925 38523 82188 88974 72467 888 Femmes1 4565244552 4701 8221 5343 9262 3461 989 Autre main-d'œuvre familialeHommes21 7968 74913 32322 72918 21217 62144 52526 96130 944 Femmes14 36714 2819 79065 77047 66546 74980 13761 94656 539 Main-d'œuvrefamilialeTotal10033972893676351171389308489725217477165977157360 Main-d'œuvre non familiale suisseHommes12 45310 8367 9862 9495 1253 86715 40215 96111 853 Femmes3 2002 5921 8823 3044 1943 3366 5046 7865 218 étrangèreHommes10 9108 0617 0081 7583 4543 03412 66811 51510 042 Femmes6631 6131 4858471 9412 0661 5103 5543 551 Main-d'œuvrenonfamilialeTotal27226231021836188581471412303360843781630664 PersonnesoccupéesTotal1275659599585996125996107798102028253561203793188024 Source:OFS
Tableau
■■■■■■■■■■■■■■■■ Tableaux Marchés
A4 ANNEXE
3 Surface agricole utile en fonction des modes d'utilisation Produit1990/9220032004200511990/92–2003/05 hahahaha% Céréales207292166558161753168449-20.1 Céréalespanifiables102840864198728188440-15.0 Blé96 17382 42883 16684 141-13.4 Epeautre2 1601 7662 2492 432-0.5 Amidonnier,engrain 2 181163165Seigle4 4321 9901 6801 677-59.8 Méteil de blé panifiable75542325-54.7 Céréalesfourragères104453801397447280009-25.1 Blé-2 0002 5696 340Orge59 69539 36837 40137 821-36.0 Avoine10 4344 4163 0282 960-66.8 Méteil de céréales fourragères23834425825419.9 Maïs grain25 73921 09818 81620 779-21.4 Triticale8 34712 91312 40011 85548.4 Légumineuses2258540149255202129.2 Pois protéagineux2 1124 9894 6004 825127.5 Féveroles14631124927890.9 Lupins-1017699Culturessarclées36385330223360932355-9.3 Pommes de terre18 33313 57813 33512 562-28.2 Betteraves sucrières14 30817 53918 62218 35227.0 Betteraves fourragères3 7441 9051 6521 441-55.5 Oléagineux1820322880232272320326.9 Colza16 73014 87515 75116 598-5.9 Tournesol-5 4784 9815 086Soja1 4742 5272 4951 51948.0 Matièrespremièresrenouvelables-124012391287Colza-1 1231 0881 117Autres (kénaf,chanvre,etc.)-117151170Légumesdepleinchamp82508399881388405.3 Maïsd'ensilageetmaïsvert382044038042433431119.9 Jachèresvertesetflorales3193824359235001041.8 Autres terres ouvertes830168 329163 465170 21720 053.0 Terresouvertes311741283475281303287715-8.8 Prairiesartificielles9443612261812447411949029.4 Autres3 9772 9893 0692 969-24.3 Terresouvertestotal410154409082408846410174-0.2 Cultures fruitières6 9146 5976 7336 672-3.6 Vigne14 91914 92914 93714 9030.0 Roseaux de Chine32392382387 844.4 Prairies naturelles,pâturages638 900626 446624 337624 705-2.2 Autre utilisation,ainsi que prairies à litière et tourbe7 3949 7629 4838 42624.8 Surfaceagricoleutile1078600106705510645741065118-1.2 1 provisoire 2 saisie séparée depuis 2002 Sources:viticulture et cultures fruitières:OFAG;autres produits:USP,OFS
Tableau
1 provisoire
2 Moyenne des années 1990/93
3 Variation 1990/93–2002/05
Sources: Lait et produits laitiers:USP (1990–98),dès 1999 TSM
Viande:Proviande Oeufs:Aviforum Céréales,cultures sarclées et oléaginieux:FAT Fruits:Fruit-Union suisse,Interprofession des fruits et légumes du Valais Légumes:Centrale suisse de la culture maraîchère Vin:OFAG,cantons
ANNEXE A5
Production ProduitUnité1990/922003200420051990/92–2003/05 % Laitetproduitslaitiers Lait de consommationt549 810494 635497 021488 412-10.3 Crèmet68 13363 99763 92764 416-5.9 Beurret38 76640 85740 66440 2734.7 Poudre de laitt35 84455 53651 04850 80446.4 Fromaget134 400160 165162 397167 70821.6 Viandeetœufs Viande de bœuft PM130 710102 789100 308100 024-22.7 Viande de veaut PM36 65634 12733 67932 289-9.0 Viande de porct PM266 360229 658227 085236 165-13.3 Viande de moutont PM5 0656 1786 5966 19124.8 Viande de chèvret PM541475488568-5.7 Viande de chevalt PM1 2121 0311 050941-16.9 Volaillet poids de vente20 73332 35834 34133 36160.9 Oeufs en coquillemio.de têtes6386806526573.9 Céréales Blé tendret546 733428 300528 300516 400 1 -10.2 Seiglet22 97810 50011 3009 400 1 -54.7 Orget341 774218 000257 400232 000 1 -31.0 Avoinet52 80721 50015 70015 400 1 -66.8 Maïs graint211 04790 700180 900200 600 1 -25.4 Triticalet43 94067 90082 90069 300 1 67.0 Autrest11 46910 30012 50011 400 1 -0.6 Culturessarclées Pommes de terret750 000458 000526 700505 000 1 -33.8 Betteraves sucrièrest925 8671 257 3001 455 8001 409 400 1 48.4 Oléagineux Colzat46 11445 30059 10057 000 1 16.7 Tournesolt-17 33013 60015 200 1Autrest3 6586 0307 3204 540 1 63.0 Fruits(detable) Pommest91 503 2 93 864100 755102 90010.1 3 Poirest-16 52917 20716 251Abricotst3 407 2 8454 6253 355-21.7 3 Cerisest1 818 2 1 7042 0261 5881.3 3 Pruneauxt2 837 2 3 2282 9951 998-8.0 3 Fraisest4 2635 1095 7755 69529.6 Légumes(frais) Carottest49 16254 08057 84455 92413.8 Oignonst23 50527 93932 35732 84432.1 Céleri-ravet8 5069 5988 85210 78514.6 Tomatet21 83030 05034 93132 03548.1 Laitue pomméet18 82115 46815 59015 667-17.2 Chou-fleurt8 3315 5917 4416 461-22.0 Concombret8 6089 1459 3039 6698.9 Vin Vin rougehl550 276486 455606 909522 415-2.1 Vin blanchl764 525483 639552 261478 988-34.0
Tableau 4
Production produits laitiers
A6 ANNEXE
Tableau 5
Produit1990/922003200420051990/92–2003/05 tttt% Totalfromage13440016016516239716770821.6 Fromages frais4 38737 10136 82239 781763.9 Mozzarella-13 32113 33714 815Autres fromages frais-23 78023 48524 966Fromages à pâte molle4 8126 7796 7276 56539 Tommes1 2491 8892 1812 03462.9 Fromages à pâte blanche persillée,mi-gras à gras1 5731 6411 3971 455-4.8 Autres fromages à pâte molle1 9903 2493 1493 07558.7 Fromages à pâte mi-dure40 55646 65047 87849 43318.3 Appenzell8 7258 0618 3009 188-2.4 Tilsit7 7365 2014 4534 143-40.6 Fromage à raclette9 89813 25613 11713 20433.3 Autres fromages à pâte mi-dure14 19720 13222 00822 89852.7 Fromages à pâte dure84 62968 92770 16071 050-17.2 Emmentaler56 58834 63233 50432 180-40.9 Gruyère22 46425 70826 72027 52918.6 Sbrinz4 6592 1471 7161 563-61.2 Autres fromages à pâte dure9186 4408 2209 778787.4 Spécialités 1 157088108795 226.7 Totalproduitslaitiersfrais6808227128347269017405356.8 Lait de consommation549 810494 635497 021488 412-10.3 Autres131 012218 199229 880252 12378.2 Totalbeurre387664085740664402734.7 Beurre de choix27 2007 2134 2194 192-80.9 Autres11 56633 64436 44536 081206 Totalcrème68133639976392764416-5.9 Totalpoudredelait3584455536510485080446.4 1Fromages de brebis et de chèvres pures Sources:USP (1990–98),dès 1999 TSM Tableau 6 Mise en valeur du lait commercialisé Produit1990/922003200420051990/92–2003/05 1000tdelait1000tdelait1000tdelait1000tdelait% Laitdeconsommation549454456448-17.5 Laittransformé24902699273227559.6 Fromage1 5311 2951 3231 372-13.1 Beurre35649649448137.7 Crème430247247251-42.2 Autres produits laitiers173661668652281.7 Total30393152318732034.7 Sources:USP (1990–98),depuis 1999 TSM
Tableau 7
Mise en valeur de la récolte en production végétale
ANNEXE A7
Produit1990/922003200420051990/92–2003/05 tttt% Pommesdeterre Pommes de terre de table285 300162 800162 800166 200 1 -42.5 Pommes de terre destinées à la transformation114 700116 100126 700133 200 1 9.3 Semences35 93326 70027 50029 600 1 -22.3 Affouragement de pommes de terre fraîches225 96796 400150 100129 100 1 -44.6 Transformation en aliments pour animaux146 90050 90055 70021 500 1 -70.9 Pommesetpoiresàcidresuisses (transformationdansdescidreriesartisanales)183006212203215682395768-30.83 Quantité de fruits à cidre pour jus brut182 424 2 121 845156 59795 651-30.7 3 fraîchement pressés10 477 2 11 0399 5289 166-5.4 3 cidre de fruits destiné à la fabrication d'eau-de-vie de fruits3 297 2 722598162-88.2 3 concentré de jus165 263 2 109 044145 56881 195-31.4 3 Autres jus (vinaigre compris)3 387 2 1 0409035 128-20.1 3 Fruits foulés582 2 187226117-72.3 3 Fabricationdespiritueux à base de pommes et poires suisses40 255 2 19 77217 18621 668-53.0 3 à base de cerises et pruneaux suisses23 474 2 12 83413 32912 726-47.0 3 Légumesfraissuissesdestinésàlafabrication dedenréesalimentaires Légumes congelés26 06126 47420 05924 104-9.7 Légumes de conserve (haricots,petits pois, carottes parisiennes)19 77612 58514 53214 354-30.1 Choucroute (choux à choucroute)8 0915 3156 1235 564-30.0 Raves d'automne1 5351 003924898-38.7 1 provisoire 2 Moyenne des années 1990/93 3 Variation 1990/93–2002/05 Sources: Pommes de terre:swisspatat Fruits à cidre:OFAG;spiritueux:Régie fédérale des alcools Légumes destinés à la transformation:Centrale suisse de la culture maraîchère
A8 ANNEXE
8 Commerce extérieur Produit1990/922003200420051990/92–2003/05 tttt% Exporta-Importa-Exporta-Importa-Exporta-Importa-Exporta-Importa-Exporta-Importationstionstionstionstionstionstionstionstionstions Laitetproduitslaitiers Lait1923 00711822 3035722 64032623 055778.9-1.5 Yoghourts1 1951710 64271817 0336937 3001 877875.46 347.1 Crème909251 0628821 3791 0124 2753 210146.36 705.4 Beurre04 1546531 751598622 0410.0-61.7 Poudre de lait8 1583 26619 05440915 61738116 970545111.0-86.4 Fromage62 48327 32849 59731 86650 87531 46151 70931 913-18.816.2 Viande,œufsetpoissons Viande de bœuf2807 8731 0437 4741 15910 1031 22312 610307.727.8 Viande de veau0916039503770972--36.5 Viande de porc2881 9569011 56753413 49021610 036-2.8498.0 Viande de mouton56 48906 46506 23206 073-100.0-3.6 Viande de chèvre0403038903390254--18.8 Viande de cheval04 60003 94504 21104 278--9.9 Volaille1039 94266345 97147042 53372442 0646 090.09.0 Oeufs031 4011524 850127 0647028 344--14.8 Poissons,crustacés et mollusques62031 13212934 64717336 82015737 011-75.316.1 Céréales Blé6232 13453313 812107279 90178202 6291 145.914.4 Seigle03 05702 06606 57802 779-24.6 Orge43644 5041738 01011226 22517214 068-77.0-41.4 Avoine13160 885646 858144 007047 408-98.3-24.3 Maïs grain19460 512343121 80235379 30553376 096111.052.7 Culturessarclées Pommes de terre9 6958 7221 01833 3901 11938 35752520 210-90.8251.4 Sucre40 882124 065218 282245 503271 611288 462302 485313 561546.1127.7 Oléagineux Oléagineux489134 57064272 03749983 15560379 12718.8-42.0 Huiles et graisses végétales18 68057 7652 090108 6862 275105 1862 953110 957-86.987.4 Fruits(frais) Pommes683 1 12 169 1 1 8707 72616321 34661110 62929.9 2 2.1 2 Poires491 1 11 803 1 759 1352266 4803289 605-63.2 2 -27.3 2 Abricots226 1 10 578 1 218 179106 34119 128-94.6 2 -21.8 2 Cerises256 1 1 062 1 486851 094251 561-96.6 2 12.4 2 Prunes et pruneaux12 1 3 290 1 225 48424 42116 313-29.2 2 63.0 2 Fraises15011 023710 9444511 8967412 384-72.16.5 Raisin2333 691935 6011334 205636 710-60.05.4 Agrumes161135 78034125 58238125 4365123 676-84.1-8.0 Bananes8577 896372 1782873 538574 220-85.8-5.9 Légumes(frais) Carottes711 71007 197258 313705 877-55.4316.8 Oignons8623 44405 778299 98163 401-98.685.5 Céleri-rave020602450823097-88.2 Tomate40235 700740 922939 5214140 352-95.312.8 Laitue pommée373 95412 44312 48002 394-98.2-38.3 Chou-fleur119 98508 66909 23118 580-97.1-11.6 Concombre6517 479516 660115 712316 113-95.4-7.5 Vin(detable) Vin rouge (en hl)3 4991 494 2947 0161 409 8799 9131 360 28611 7711 348 274173.4-8.1 Vin blanc (en hl)7 59076 8356 474196 7938 540223 08911 651228 17517.1181.1 1 Moyenne des années 1990/93 2 Variation 1990/93–2002/05 Sources: Lait et produits laitiers,oeufs,céréales,cultures sarclées,oléagineux,fruits,légumes et vin:DGD Sucre:réservesuisse
Tableau
Tableau 9
Commerce extérieur de fromage
1 0406.1010,0406.1020,406.1090
2 0406.2010,0406.2090
30406.3010,0406.3090
4 0406.4010,0406.4021,0406.4029,0406.4081,0406.4089
5 0406.9011,0406.9019
6 0406.9021,0406.9031,0406.9051,0406.9091
7 0406.9039,0406.9059,0406.9060,0406.9099
ANNEXE A9
Produit1990/922003200420051990/92–2003/05 tttt% Importations Fromages frais 1 4 1759 1879 4159 229122.2 Fromages râpés 2 233634748833216.9 Fromages fondus 3 2 2212 2492 1922 175-0.7 Fromages à pâte persillée 4 2 2762 1672 1512 080-6.3 Fromages à pâte molle 5 6 6285 7965 6535 783-13.3 Fromages à pâte mi-dure 6 11 795 4 7724 9174 892 Fromages à pâte dure 7 7 0616 3856 921 -1.2 Totalfromagesetséré2732831866314613191316.2 Exportations Fromages frais 1 252862987 166.7 Fromages râpés 2 104719688-18.3 Fromages fondus 3 8 2454 4314 8954 615-43.6 Fromages à pâte persillée 4 083130 Fromages à pâte molle 5 301755406071 368.9 Fromages à pâte mi-dure 6 54 102 7 1247 7338 959 Fromages à pâte dure 7 37 73637 52237 128 -16.1 Totalfromagesetséré62483495975087551709-18.8
Source:DGD
Consommation par habitant
A10 ANNEXE
10
Tableau
Produit1990/9220032004200511990/92–2003/05 kgkgkgkg% Laitetproduitslaitiers Lait de consommation104.3781.4080.9079.10-22.9 Crème6.438.408.308.2029.1 Beurre6.205.605.605.60-9.7 Fromage16.9019.9019.8019.7017.2 Fromages frais3.466.106.106.4079.2 Fromages à pâte molle1.831.901.801.701.6 Fromages à pâte mi-dure5.655.705.705.600.3 Fromages à pâte dure5.966.206.206.002.9 Viandeetœufs Viande de bœuf13.7110.1510.2310.39-25.2 Viande de veau4.253.673.543.43-16.5 Viande de porc29.7325.1524.8025.20-15.7 Viande de mouton1.421.471.471.401.9 Viande de chèvre0.120.100.100.09-19.4 Viande de cheval0.750.600.630.63-17.3 Volaille8.0510.099.979.6923.2 Oeufs en coquille (pces)199183182185-7.9 Céréales Articles de boulangerie et de pâtisserie50.7050.3050.7051.00-0.1 Culturessarclées Pommes de terre et prodits à base de pommes de terre44.1742.7240.2641.00-6.4 Sucre (y compris sucre dans des produits transformés)42.3754.7856.8560.8035.7 Oléagineux Huiles et graisses végétales12.8016.1315.8516.6026.5 Fruits(detable) Pommes15.26 2 13.5316.4315.13-0.4 3 Poires-3.473.163.42Abricots2.04 2 1.221.481.67-27.5 3 Cerises0.39 2 0.350.420.425.1 3 Prunes et pruneaux0.91 2 1.181.001.1118.5 3 Fraises2.242.182.382.413.7 Agrumes20.0917.0316.9016.58-16.2 Bananes11.5310.089.919.95-13.4 Légumes(frais) Carottes7.538.318.918.2712.8 Oignons3.864.575.704.8630.7 Céleri-rave1.291.341.301.465.9 Tomate8.469.6310.039.7015.7 Laitue pommée3.372.452.452.43-27.5 Chou-fleur2.711.932.252.02-23.7 Concombre2.972.772.802.80-6.1 Vin Vin rouge (en l)31.9727.1226.3325.59-17.6 Vin blanc (en l)14.4711.6611.7810.21-22.5 Vin total (en l)46.4438.7838.1135.80-19.1 1 en partie provisoire 2 Moyenne des années 1990/93 3 Variation 1990/93–2002/05 Sources: Lait et produits laitiers,oeufs,cultures
Viande:Proviande Fruits,légumes et vin:OFAG
sarclées et oléagineux:USP
Tableau 11
Prix à la production
1Moyenne des années 1990/93
2 Variation 1990/93–2002/05
3 Prix franco abattoir,excepté les porcs charnus départ ferme,QM:Qualitätsmanagement Schweizer Fleisch
4 Le prix ne s'applique pas aux excédents
Sources:
Lait:OFAG
Bétail de boucherie,volaille,œufs:USP
Céréales,cultures sarclées et oléaginieux:FAT
Fruits:Fruit-Union suisse,Interprofession des fruits et légumes du Valais
Légumes:Centrale suisse de la culture maraîchère
ANNEXE A11
ProduitUnité1990/922003200420051990/92–2003/05 % Lait CH totalct./kg104.9775.5474.6372.41-29.3 Lait transformé en fromage (à partir de 1999)ct./kg-75.1673.8472.21Lait biologique (à partir de 1999)ct./kg-89.2185.4581.81Bétaildeboucherie3 Vaches T3fr./kg PM7.825.786.626.16-20.9 Jeunes vaches T3fr./kg PM8.136.487.126.94-15.8 Taureaux T3fr./kg PM9.288.198.177.97-12.6 Bœufs T3fr./kg PM9.838.188.147.95-17.7 Génisses T3fr./kg PM8.667.898.077.94-8.0 Veaux T3fr./kg PM14.3912.1512.6113.20-12.1 Porcs charnus,depuis 2003 QMfr./kg PM5.834.474.544.02-25.5 Agneaux jusqu'à 40 kg,T3fr./kg PM15.4011.5310.2110.30-30.6 Volailleetœufs Poulets cl.I,à la fermefr./kg PV3.722.722.672.60-28.4 Oeufs issus d'un élevage au sol,aux grands consom.fr./100 pces41.0236.0036.0638.08-10.5 Oeufs issus d'un élevage avec parcours,au magasinfr./100 pces46.2142.6742.2442.08-8.4 Céréales Blé cl.Ifr./100 kg99.3461.1357.8452.42-42.5 Seiglefr./100 kg102.3646.7643.9944.78-55.9 Orgefr./100 kg70.2445.8244.2642.24-37.2 Avoinefr./100 kg71.4047.8444.6746.97-34.9 Triticalefr./100 kg70.6945.4944.9042.66-37.3 Maïs grainfr./100 kg73.5446.3143.3142.23-40.2 Culturessarclées Pommes de terrefr./100 kg38.5536.2133.3834.30-10.2 Betteraves sucrièresfr./100 kg14.8411.8711.8511.77-20.3 Oléagineux Colzafr./100 kg203.6781.6976.6076.83-61.5 Tournesolfr./100 kg-85.7383.7482.00Fruits Pommes:Golden Delicious Ifr./kg1.121.211.06 4 1.01 4 -8.5 2 Pommes:Maigold Ifr./kg1.351.401.21 4 0.90 4 -17.4 2 Poires:Conférencefr./kg1.331.240.98 4 1.09 4 -20.5 2 Abricotsfr./kg2.092.802.092.3712.0 2 Cerisesfr./kg3.203.403.503.709.4 2 Pruneaux:Fellenbergfr./kg1.401.701.552.0529.5 2 Fraisesfr./kg4.775.405.605.0011.8 Légumes Carottes (de garde)fr./kg1.091.371.261.3822.6 Oignons (de garde)fr./kg0.891.061.190.9720.6 Céleris-raves (de garde)fr./kg1.622.222.442.3243.6 Tomates rondesfr./kg2.422.412.372.34-1.9 Laitue pomméefr./kg2.373.663.433.6350.8 Chou-fleurfr./kg1.852.672.132.3027.9 concombres pour la saladefr./kg1.662.202.192.1531.3
Prix
(panier viande de label et traditionnelle):OFAG
A12 ANNEXE
Tableau 12
consommation ProduitUnité1990/922003200420051990/92–2003/05 % Laitetproduitslaitiers Lait entier pasteurisé,emballéfr./l1.851.531.541.54-16.9 Lait «drink» pasteurisé,emballéfr./l1.851.531.521.50-18.2 Lait écrémé UHTfr./l-1.461.401.42Emmentalerfr./kg20.1520.8919.9319.63Gruyèrefr./kg20.4021.0220.5420.190.9 Tilsitfr./kg-17.8617.3417.59Camembert 45% (ES)125 g-2.862.862.90Fromage à pâte molle,croûte fleurie150 g-3.673.673.68Mozzarella 45% (ES)150 g-2.342.202.13Beurre de choix200 g3.463.193.142.95-10.6 Le beurre (beurre de cuisine)250 g3.442.992.962.84-14.8 Crème entière,emballée 1⁄2 l-4.804.504.22Crème à café,emballée 1⁄2 l-2.482.412.34Yoghourt,aromatisé ou contenant des fruits180 g0.890.700.680.66-23.6 Viandedebœuf Entrecôtes,en tranchesfr./kg48.3653.3955.7455.7013.6 Steakfr./kg37.5941.7343.4242.8613.5 Rôti d'épaulefr./kg26.3427.1628.5627.895.8 Viande hachéefr./kg15.0016.6517.0216.9512.5 Viandedeveau Côtelettes,coupéesfr./kg35.3241.3042.5844.1720.8 Rôti d'épaulefr./kg32.5635.1436.3636.3510.4 Ragoûtfr./kg21.6729.7631.4631.8643.2 Viandedeporc Côtelettes,coupéesfr./kg19.8821.3220.4919.923.5 Steakfr./kg24.4827.7028.0025.7911.0 Rôti d'épaulefr./kg18.4319.9020.3419.598.2 Ragoût d'épaulefr./kg16.6919.2219.6018.9715.4 Vianded'agneausuisse,fraîche Gigot sans l'os du bassinfr./kg26.3429.4828.7228.7510.0 Côtelettes,coupéesfr./kg30.3237.2837.0538.4624.0 Produitsàbasedeviande Jambon de derrière modél,coupéfr./kg25.5629.9931.1429.6718.3 Salami suisse I,coupéfr./100 g3.094.004.364.4638.3 Poulets suisses,fraisfr./kg8.418.909.019.127.1 Productionvégétaleetproduitsvégétaux Farine fleurfr./kg2.051.711.781.78-14.3 Pain noirfr./500 g2.081.811.791.80-13.4 Pain mi-blancfr./500 g2.091.801.821.82-13.2 Petits painsfr./pce0.620.740.750.7620.6 Croissantsfr./pce0.710.880.890.8924.9 Spaghettisfr./500 g1.661.711.701.56-0.1 Pommes de terrefr./kg1.432.162.232.2655.1 Sucre cristalliséfr./kg1.651.591.591.65-2.5 Huile de tournesolfr./l5.054.304.894.81-7.6 Fruits(suissesetétrangers) Pommes:Golden Delicious Ifr./kg3.15 1 3.674.043.8221.7 2 Poiresfr./kg3.25 1 3.693.763.5612.4 2 Abricotsfr./kg3.93 1 6.296.176.1553.2 2 Cerisesfr./kg7.35 1 8.9710.019.8827.9 2 Pruneauxfr./kg3.42 1 4.363.894.4621.9 2 Fraisesfr./kg8.6910.9610.5710.8324.1 Légumes(consommationàl'étatfrais,suissesetétrangers) Carottes (de garde)fr./kg1.912.262.162.0212.3 Oignons (de garde)fr./kg1.862.392.281.9518.7 Céleris-raves (de garde)fr./kg3.143.944.213.8527.4 Tomates rondesfr./kg3.733.673.293.59-5.7 Laitue pomméefr./kg4.461.961.751.86-58.3 Chou-fleurfr./kg3.584.413.634.2114.1 Concombres pour la saladefr./kg2.804.453.904.1048.2 1 Moyenne des années
Sources: Lait,viande
Production
à la
1990/93 2 Variation 1990/93–2002/05
végétale et produits végétaux:OFAG,OFS
1 Produits de meunerie et blé germé sur pied compris,sans les tourteaux;les modifications des réserves ne sont pas prises en considération
2 Blé dur,avoine,orge et maïs compris
3 Pommes,poires,cerises,pruneaux et prunes,abricots et pêches
4 Part de la production suisse au poids de la viande prête à la vente et des produits carnés
5 Viande chevaline et caprine,lapins,gibier,poissons,crustacés et mollusques compris
6 Energie digestible en joules,boissons alcoolisées comprises
7 Sans les produits animaux à base d'aliments pour animaux importés
8 Valeur calculée en prix au producteur,pour la production suisse,et aux prix selon la statistique commerciale,pour les importations (franco frontière non dédouanés)
Source:USP
ANNEXE A13
13
d’autosuffisance Produit1990/922002200320041990/92–2002/04 % Partentermesdevolume:%%%% Céréales panifiables 118827892-28.8 Céréales fourragères 1 616749754.4 Totalcéréales264594662-13.0 Pommes de terre de table101948795-8.9 Sucre4661445012.3 Graisses végétales,huiles22201922-7.6 Fruits 3 72766473-1.4 Légumes55545155-3.0 Lait de consommation 979798991.0 Beurre 899897979.4 Fromage 137114113114-17.0 Totallaitetproduitslaitiers110108109108-1.5 Viande de veau 4 979798980.7 Viande de bœuf 4 93899188-3.9 Viande de porc 4 99959393-5.4 Viande de mouton 4 394142459.4 Volaille 4 3743434618.9 Viandedetoutessortes4,576707069-8.3 Oeufs et conserves d'œufs444747466.1 Parténergétique6: Denrées alimentaires végétales 43443945-0.8 Denrées alimentaires animales, brut 97959594-2.4 Totaldenréesalimentaires,brut62615660-4.8 Total denrées alimentaires,net 7 58555155-7.5 Totaldenréesalimentaires,entermesdevaleur872636262-13.4
Tableau
Taux