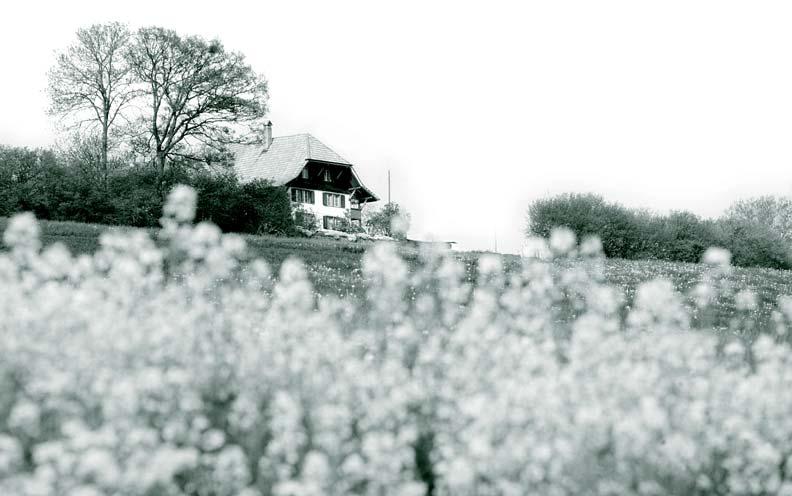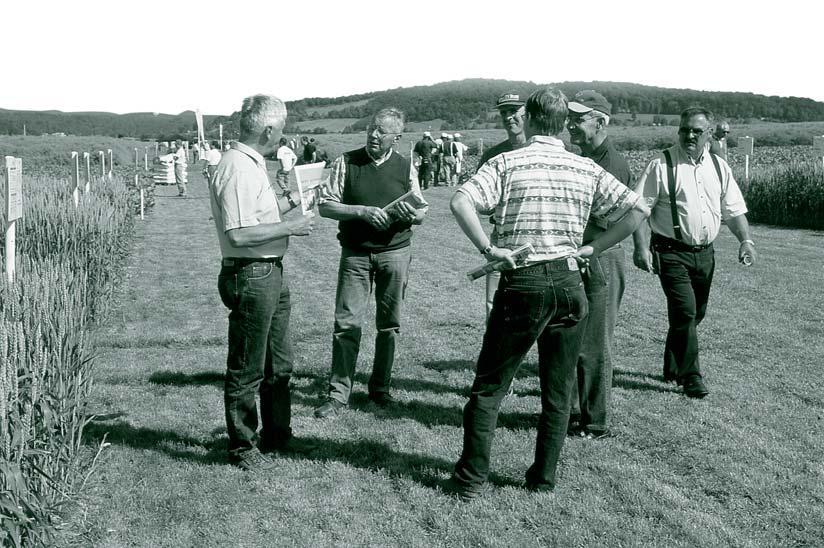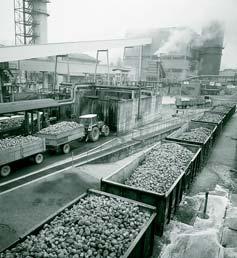RAPPORT AGRICOLE
Bundesamt für Landwirtschaft Office fédéral de l’agriculture Ufficio federale dell’agricoltura Uffizi federal d’agricultura
Rapport agricole 2005 de l’Office fédéral de l’agriculture
■■■■■■■■■■■■■■■■
1
Editeur
Office fédéral de l’agriculture (OFAG)
CH-3003 Berne
Tél.:031 322 25 11
Fax:031 322 26 34
Internet:www.blw.admin.ch
Copyright:OFAG,Berne 2005
Layout et graphisme
Artwork,Grafik und Design,Saint-Gall
Impression RDV AG,Berneck
Photos
– Agroscope FAL Reckenholz
– Agroscope FAW Wädenswil
–Agroscope RAC Changins
–Archives d’illustrations Agrofot
–Christof Sonderegger,photographe
–Corbis
–Herbert Mäder,photographe
–OFAG Office fédéral de l’agriculture
–Peter Mosimann,photographe
–Peter Studer,photographe
–PhotoDisc Inc.
–Tobias Hauser,photographe
–USP Union suisse des paysans
Diffusion
OFCL,Diffusion publications
CH-3003 Berne
No de commande:
français:730.680.05 f
allemand:730.680.05 d
italien:730.680.05 i
Fax:031 325 50 58
Internet:www.publicationsfederales.ch
ACHEVÉ D’IMPRIMER 2 10.2005 1200 860142266
■■■■■■■■■■■■■■■■ Table des matières Préface 4 ■ 1.Rôle et situation1.1Economie 9 de l‘agriculture 1.1.1L’agriculture,partie intégrante de l‘économie 10 1.1.2Marchés 19 1.1.3 Situation économique du secteur agricole 42 1.1.4 Situation économique des exploitations 49 1.2Aspects sociaux 57 1.3Ecologie et éthologie 73 1.3.1 Ecologie 73 1.3.2 Ethologie 95 1.4Appréciation de la durabilité 99 1.4.1Bilan 116 ■ 2.Mesures de politique2.1Production et ventes 119 agricole 2.1.1Instruments transversaux 120 2.1.2Economie laitière 129 2.1.3 Economie animale 135 2.1.4 Production végétale 143 2.2Paiements directs 151 2.2.1 Importance des paiements directs 153 2.2.2 Paiements directs généraux 160 2.2.3 Paiements directs écologiques 168 2.3Amélioration des bases de production 185 2.3.1 Améliorations structurelles et mesures d’accompagnement social 186 2.3.2 Recherche,haras,vulgarisation,formation professionnelle,CIEA 195 2.3.3 Moyens de production 204 2.3.4 Elevage 212 2.4 Section Inspectorat des finances 213 2.5 Evolution future de la politique agricole 216 ■ 3.Aspects internationaux 3.1Développements internationaux 223 3.2 Comparaisons internationales 233 ■ Annexe Tableaux A2 Textes légaux,Définitions et méthodes A64 Abréviations A65 Bibliographie A67 TABLE DES MATIÈRES 3
L’année 2004 a été une année agricole supérieure à la moyenne,en comparaison pluriannuelle.Ce résultat positif est essentiellement attribuable aux bons rendements obtenus dans la production végétale et aux conditions stables qui ont prévalu sur les marchés du bétail de boucherie.En 2005,il faut par contre s’attendre à un nouveau recul significatif des revenus qui,selon les estimations,devraient retomber au niveau de l’année 2003.
Conformément à l'ordonnance sur l'évaluation de la durabilité de l'agriculture,l'OFAG est tenu d’examiner les conséquences économiques,sociales et écologiques de la politique agricole et des prestations fournies par l’agriculture et de publier des informations à ce sujet.Son rapport établi avec des indicateurs se fonde pour la première fois sur un concept qui s’appuie sur la définition de la durabilité,retenue par le Conseil fédéral.Chacun des indicateurs renseignent sur les ressources et l’efficience ainsi que sur l’équité.Les tendances à court terme du développement ne permettent cependant pas de déduire si l’on est en présence d’un développement durable.En revanche,les indicateurs portant sur les trois dimensions de la durabilité (économie,social,écologie) révèlent dans quel sens les choses évoluent depuis 1990.
Vu sous l’angle de la durabilité,le développement de l’agriculture présente de nombreux aspects positifs mais aussi quelques aspects plutôt négatifs.Dans le domaine de l’économie,la productivité du travail s’est améliorée.Autre point positif:les investissements opérés dans les bâtiments,les machines et les installations sont restés constants depuis 1990 par rapport à l’ensemble du capital existant.Par contre,la diminution des terres arables a un effet pervers puisqu’elle affaiblit à long terme la sécurité de l’approvisionnement.Sur le plan social,l’écart de revenus entre la population agricole et les autres groupes de la population s’est creusé,évolution devant être considérée comme négative en termes de durabilité.Il convient de noter à ce propos que cet écart était devenu plus important avant la mise en œuvre de la réforme agricole de 1993 et qu’il s’est relativement stabilisé depuis.Les indicateurs qualité de vie et formation ne permettent pas encore de tirer des conclusions sur le développement.Dans le domaine de l’écologie,une évolution positive a été enregistrée pour l’azote,les produits phytosanitaires,la biodiversité et la qualité du sol.Pour autant,d’autres améliorations sont nécessaires dans tous les secteurs.Un autre point jugé négatif concerne l’indicateur énergie.L’efficience énergétique est restée stable,certes,mais il n’a pas été possible par contre d’observer la substitution des sources d’énergie fossile par des sources d’énergie renouvelable.Sous l’angle de la durabilité,il s’agit pourtant d’un défi majeur que la politique agricole ne saurait toutefois relever à elle seule.Il en va de même de l’indicateur terres arables qui affiche une évolution négative.
Globalement,l’agriculture a connu un développement durable tout au long de la réforme agricole,notamment dans les domaines sur lesquels la politique agricole peut influer.Ce développement durable est d’ailleurs l’objectif de demain.Et il est aussi une gageure.Au niveau international,il faut s’attendre,dans l’état actuel des choses,à une nouvelle réduction notable de la protection à la frontière en raison des négociations en cours à l’OMC.Sur le plan intérieur,le budget de l’agriculture est toujours sous la pression des mesures d’économie.Autant de défis qui ont été pris en considération dans le développement futur de la politique agricole projeté pour la période 2008 à

PRÉFACE ■■■■■■■■■■■■■■■■
Préface
4
2011.Le 14 septembre 2005,le Département fédéral de l’économie a donné le coup d’envoi de la consultation sur la politique agricole 2011 (PA 2011).Cette dernière entend aller de l’avant et poursuivre résolument les réformes entreprises.C’est ainsi que toutes les subventions à l’exportation et plus de la moitié des fonds affectés actuellement au soutien du marché seront réalloués aux paiements directs non liés à la production,afin d’améliorer la compétitivité de la production des denrées alimentaires.Les moyens à disposition,d’un montant annuel de 3,36 milliards de francs pour la période 2008 à 2011,doivent contribuer à ce que le développement reste socialement supportable.Il conviendra toutefois de réexaminer la situation si la clôture des négociations avec l’OMC ou un éventuel accord de libre-échange avec les Etats-Unis entraînent des pertes pour l’agriculture suisse,dépassant celles prévues dans la PA 2011.
Le délai de consultation sur la politique agricole 2011 court jusqu’au 16 décembre 2005.Les prises de position montreront si les propositions relatives au développement futur de la politique agricole trouvent une majorité et si d’éventuelles retouches doivent encore être apportées au projet.Le Conseil fédéral devrait adopter au printemps 2006 le message sur la PA 2011 à l’intention du Parlement pour que les Chambres puissent commencer les délibérations à l’automne 2006.L’objectif visé étant que les dispositions d’exécution soient connues fin 2007 et puissent entrer en vigueur en 2008.
Manfred Bötsch
Directeur de l’Office fédéral de l’agriculture
PRÉFACE
5
6
1.Rôle et situation de l’agriculture

1 7
■■■■■■■■■■■■■■■■
Conformément à l’art.104 Cst.,la Confédération veille à ce que l’agriculture,par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché,contribue substantiellement:
a.à la sécurité de l’approvisionnement de la population;
b.à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural;
c.à l'occupation décentralisée du territoire.
Les buts ancrés dans la Constitution indiquent clairement que l’agriculture remplit des tâches qui vont au-delà de la seule production de denrées alimentaires.On parle à ce propos de multifonctionnalité de l’agriculture.L’entretien du paysage,le maintien des bases naturelles de l’existence et l’occupation décentralisée du territoire sont des prestations d’intérêt public qui ne peuvent être compensées que partiellement par le marché.
En 1996,la Constitution a introduit la notion de durabilité.Celle-ci constitue,depuis la Conférence sur l'environnement et le développement durable de 1992,à Rio de Janeiro,une ligne directrice majeure en matière de politique.
Le Conseil fédéral entend suivre les effets de la nouvelle politique agricole.Il a créé les conditions indispensables pour ce faire dans son ordonnance sur l'évaluation de la durabilité de l'agriculture.Les dispositions de l’art.1,al.1,de ladite ordonnance prévoient que la politique agricole et les prestations de l’agriculture soient régulièrement appréciées sous l’angle de la durabilité,celles de l’art.2 que les conséquences économiques,sociales et écologiques soient évaluées.L’OFAG a reçu mandat de présenter chaque année un rapport présentant les résultats des analyses;il y répond par la rédaction du rapport agricole.
Les trois dimensions de la durabilité constituent la structure de base des informations contenues dans la 1ère partie du rapport agricole,partie consacrée au rôle et à la situation de l’agriculture.
8 1.RÔLE ETSITUATION DE L’AGRICULTURE 1
Pour pouvoir fournir les prestations que l’on attend d’elle,l’agriculture doit disposer d’une base économique suffisante.La représentation des incidences économiques de la politique agricole constitue de ce fait une partie importante du rapport.Elle fournit notamment des informations sur les résultats économiques des exploitations agricoles, l’évolution des structures,les liens financiers au reste de l’économie ainsi que les relations aux différents marchés.
Les paragraphes qui suivent présentent la place économique de l’agriculture en tant que pan de l’économie,quelques informations quant à la production,la consommation,le commerce extérieur,les prix à la production et à la consommation sur les différents marchés,la situation économique du secteur dans son ensemble et celle des exploitations individuelles.

■■■■■■■■■■■■■■■■
1.1 Economie
9 1.1 ECONOMIE 1
■ Exploitations
1.1.1
L’agriculture,partie intégrante de l’économie
Evolutions structurelles
L’analyse des structures dans l’agriculture se concentre cette année sur l’évolution du nombre des exploitations et des personnes qui y travaillent.Cette analyse se fonde sur le recensement des exploitations effectué depuis 1990 et sur les relevés annuels des structures agricoles.
Le nombre d’exploitations est en constante diminution depuis plusieurs décennies. Dans les années cinquante et soixante,la diminution annuelle était de 2% en moyenne.Moins marquée pendant les deux décennies suivantes,l’évolution structurelle s’est à nouveau accélérée avec la réorientation de la politique agricole mise en œuvre dans les années nonante,pour ensuite ralentir durant les quatre premières années du nouveau millénaire.
Evolution du nombre des exploitations,par classes de grandeur et par régions
■■■■■■■■■■■■■■■■
ParamètreNombre d'exploitationsVariation annuelle en % 1990200020041990–20002000–2004 Classe de grandeur 0–3 ha19 8198 3716 819–8,3–5,0 3–10 ha27 09218 54215 529–3,7–4,3 10–20 ha31 63024 98422 521–2,3–2,6 20–25 ha6 6777 2447 0850,8–0,6 25–30 ha3 3644 4304 6592,81,3 30–50 ha3 5495 7596 3315,02,4 >50 ha6841 2071 5225,86,0 Région Région de plaine41 59031 61229 005–2,7–2,1 Région des collines24 54118 95717 448–2,5–2,1 Régionde montagne26 684 19 96818 013–2,9–2,5 Total92 81570 53764 466–2,7–2,2 Source:OFS
10 1.1 ECONOMIE 1
Tableau 1,page A2
Près de la moitié des exploitations disparues entre 1990 et 2000 étaient des exploitations de très petite taille,d’une surface inférieure ou égale à 3 ha.De même,les exploitations de la classe 3–20 ha sont en nette diminution.En revanche,on a constaté une augmentation des exploitations d’une taille supérieure à 20 ha.
De 2001 à 2004,le recul annuel des très petites exploitations a fléchi par rapport à la précédente décennie,tandis qu’il s’est accentué pour les exploitations appartenant aux classes de 3 à 10 ha et de 10 à 20 ha.Quant au seuil de croissance,il a lui aussi progressé,passant de 20 à 25 ha.Cela signifie que,depuis 2000,le nombre d’exploitations a diminué en ce qui concerne les classes allant jusqu’à 25 ha et qu’il a augmenté pour les exploitations comptant plus de 25 ha.
Entre 1990 et 2000,le nombre d’exploitations a reculé de 10'000 unités dans la région de plaine,de 5'500 dans celle des collines et de 6'500 dans la région de montagne, avec un taux de diminution annuel comparable pour les trois régions.De 2000 à 2004, ce taux a,par rapport à la décennie précédente,baissé davantage dans la région de plaine que dans les deux autres régions.
Evolution du nombre d’exploitations gérées à titre principal et à titre accessoire,par région
4518 0767 115–3,4–3,1
Région des collines7 0895 1644 510–3,1–3,3

Région de montagne10 0338 0586 435–2,2–5,5
Total28 57321 29818 060–2,9–4,0 Source:OFS
De 2000 à 2004,les entreprises exploitées à titre principal connaissent,dans toutes les régions,un taux de diminution plus faible par rapport aux années nonante.Ce taux était le plus bas (–0,7%) dans la région de montagne.Par rapport à la décennie précédente,ce taux a augmenté pour les entreprises exploitées à titre accessoire,notamment en région de montagne.Au total,entre 2000 et 2004,le nombre d’exploitations gérées à titre principal a baissé de 2'833 et celui des exploitations gérées à titre accessoire de 3'238 unités.
ParamètreNombre d'exploitationsVariation annuelle en % 1990200020041990–20002000–2004 Entreprises exploitées à titre principal Région de plaine30 13923 53621 890–2,4–1,8 Région des collines17 45213 79312 938–2,3–1,6 Région de montagne16 65111 91011 578–3,3–0,7 Total64 24249 23946 406–2,6–1,5 Entreprises exploitées à titre accessoire Région de plaine11
1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE 1.1 ECONOMIE 11 1
■ Main-d’œuvre
Ces dernières années,la main-d’œuvre occupée dans l’agriculture a continué de diminuer,parallèlement au nombre des exploitations.
En 2000,l’agriculture occupait dans l’ensemble 49'768 personnes de moins qu’en 1990,réduction qui,durant cette période,a concerné exclusivement la main-d’œuvre familiale.La part de la main-d’œuvre non familiale a,quant à elle,légèrement progressé.
Entre 2000 et 2004,la diminution de la main-d’œuvre a été moins marquée dans l’ensemble,mais surtout en ce qui concerne la main-d'œuvre familiale,alors que la main-d’œuvre non familiale a nettement reculé durant la même période.Par rapport à 2000,le nombre de personnes employées en 2004 a diminué de 7'000 unités (–18%). Concernant la main-d’œuvre familiale,il est frappant de constater que le taux de diminution des chefs d'exploitation est resté pratiquement identique à celui de la décennie précédente.

Evolution de la main-d’œuvre ParamètreMain-d’œuvre Variation annuelle en % 1990200020041990–20002000–2004 Main-d’œuvre familiale217 477165 977159 447–2,7–1,0 dont: chef d’exploitation88 88974 72469 348–1,7–1,8 cheffe d’exploitation3 9262 3462 030–5,0–3,6 Main-d’œuvre non familiale36 08437 81630 9310,5–4,9 Total253 561203 793190 378–2,2–1,7 Source:OFS
Tableau 2,page A3 1.1 ECONOMIE 1 12
Paramètres économiques
La valeur ajoutée brute aux prix du marché sert à mesurer la prestation d’une économie.Elle correspond à la valeur brute de la production,déduction faite des consommations intermédiaires,et sert à payer les facteurs de production,soit le travail (frais de personnel) et le capital (excédent net d'exploitation),les amortissements (diminution de valeur des immobilisations) ainsi que les impôts indirects,moins les subventions.Les flux d’argent (production,consommations intermédiaires et valeur ajoutée) peuvent être classifiés selon la branche,le secteur institutionnel (entreprises non financières,instituts financiers,assurances,etc.) ou selon le secteur économique.
Evolution de la valeur ajoutée brute dans les trois secteurs économiques Indications en prix courants
Entre 1998 et 2003,la valeur ajoutée brute aux prix du marché a connu une évolution différente dans les trois secteurs.Alors qu'elle a chuté de 18,4% dans le secteur primaire,elle a progressé de 6,4% et de 12,6% dans les secteurs secondaire et tertiaire.De manière générale,on a enregistré une augmentation de 10,4% durant la période considérée.L'économie dans son ensemble a réalisé en 2003 une valeur ajoutée brute de 438'507 millions de francs.Le secteur primaire y a contribué faiblement,avec une part de 1,0%,provenant pour les trois quarts de l'agriculture.
Durant l’exercice considéré,les importations totales ont progressé de 6,7% et les exportations de 8,6% par rapport à l’année précédente.Les importations ont passé de 129,7 à 138,8 milliards de francs,les exportations de 135,4 à 147,4 milliards de francs.Le commerce de produits agricoles a légèrement repris au cours de cette période,du moins pour ce qui est des exportations.Alors que les importations sont restées pratiquement au niveau de l'année précédente (8,9 milliards de fr.),les exportations se sont accrues,passant de 3,6 à 4,0 milliards de francs.
En 2004,74,9% des importations agricoles (6,7 milliards de fr.) provenaient de l’UE (UE15) et 2,4% des dix nouveaux pays membres.67,3% de nos exportations représentant une valeur totale de 2,7 milliards de francs étaient destinées à l'UE (UE15) et 1,9% aux nouveaux pays membres.En comparaison de l’exercice précédent,les importations en provenance de l’UE15 ont progressé de 40 millions de francs environ et les exportations dans ces pays d’environ 378 millions de francs.
Secteur199819992000200120022003 1 Variation 1998/2003 en mio.de fr.en % Secteur primaire6 6525 9656 4365 7725 6935 426–18,4 dont agriculture selon CEA5 2614 6454 9874 4244 3704 020–23,6 Secteur secondaire108 982109 973111 978116 423116 687115 9896,4 Secteur tertiaire281 707285 005300 106303 493313 354317 09212,6 Total397 342400 943418 520425 688435 734438 50710,4 1 provisoire Source:OFS
■ Valeur ajoutée brute
1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE 1.1 ECONOMIE 1 13
■ Commerce extérieur de produits agricoles
Commerce extérieur agricole avec l'UE 2004
Source: DGD
En termes de valeur,la Suisse a importé ses produits agricoles principalement de France,mais aussi d'Italie et d'Allemagne,soit environ deux tiers de l’ensemble des importations en provenance de l’UE.Il en a été de même en 2002 et en 2003.La plupart des exportations ont pris la destination de l’Allemagne.Le bilan de notre pays est cependant fortement négatif avec la France,l’Italie,les Pays-Bas et l'Espagne,mais équilibré,quoique à un niveau relativement bas,avec l’Autriche.
Importations et exportations de produits agricoles et de produits agricoles transformés, par catégorie de produits 2004
Tabac et divers (13, 14, 24)
Produits laitiers (4)
Denrées alimentaires (20, 21)
Produits d'agrément (9, 17, 18)
Aliments pour animaux, déchets (23)
Céréales et préparations (10, 11, 19)
Oléagineux, graisses et huiles (12, 15)
Plantes vivantes, fleurs (6)
Légumes (7)
Fruits (8)
Produits animaux, poissons (1, 2, 3, 5, 16)
Boissons (22)
Source: DGD
Grande importatrice de denrées alimentaires,la Suisse a surtout importé,en 2004,des boissons,des produits d’origine animale (y compris des poissons) ainsi que des préparations alimentaires et des fruits.Les importations de boissons se sont composées d’environ 67% de vin et d’environ 10% de spiritueux et autant d’eaux minérales.
Allemagne France Italie Autriche Espagne Pays-Bas Autres pays 910 1 231 501 1 693 278 1 436 238 261 87 505 164 804 603 951 2 0001 5001 500 1 0005000 en mio. de fr. 5001 000 Importations Excédents d'importations Exportations
653 357 584 422 1 034 939 754 808 198 337 498 715 42 419 3 559 4 566 5 912 69 1 362 174 1 500 en mio. de fr.
): no du tarif douanier
Excédents d'importations ou d'exportations Exportations 2 0001 5001 500 1 00050005001 000 14 1.1 ECONOMIE 1
(
Importations
De toutes les importations appartenant à la catégorie «produits animaux»,environ 40% sont attribuables au secteur de la viande,30% au secteur des poissons et les 30% restants au secteur des viandes préparées et des conserves de viande.
■ 1.1
Ont figuré en tête des exportations les denrées alimentaires et les produits d’agrément. La plus grande part des denrées alimentaires exportées a concerné les aliments élaborés,les extraits de café,les soupes et les sauces.Dans la catégorie «produits d’agrément» ont principalement été exportés du café torréfié,des sucreries ainsi que du chocolat.Pour ce qui est des fruits,des légumes et des produits animaux,les exportations sont restées modestes.
Des excédents d’exportation ont été réalisés dans la catégorie «tabac et divers» (+296 millions de fr.),ainsi qu'avec les produits laitiers (+162 millions de fr.) et les denrées alimentaires (+95 millions de fr.).Comparé à l'année précédente,l'excédent s’est accru de 35 millions de francs pour la catégorie «tabac et divers»,de 40 millions pour les produits laitiers et de 84 millions pour les denrées alimentaires (année précédente:11 millions de fr.).
13,page A13 ECONOMIE
Selon la Constitution,l’agriculture helvétique a pour mandat de fournir,à travers sa production,une contribution essentielle à l’approvisionnement sûr de la population en denrées alimentaires.Par degré d’autosuffisance,on entend la part de la production indigène à la consommation totale du pays.
Les fluctuations annuelles dans le degré d'autosuffisance sont dues aux rendements réalisés dans la production végétale et qui dépendent fortement des conditions atmosphériques.C’est ainsi que de grands écarts ont été enregistrés notamment à partir de la seconde partie de la dernière décennie.
1 1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE
Taux d’autosuffisance Evolution du taux d'autosuffisance 19931994199519961997199819992000200120022003 Part de calories en % Denrées alimentaires animales Denrées alimentaires total Denrées alimentaires végétales Source: USP 0 100 80 60 40 20 Tableau
En 2003,le degré d’autosuffisance,situé à 56%,a été de 5% inférieur à l'année 2002. Dans la production végétale,cette valeur a passé de 44% en 2002 à 39%,en raison de la grande sécheresse.S’agissant des produits animaux,la part indigène est restée stable à 95%,comme en 2002. 15
■ Evolution des indices des prix
Concernant les produits agricoles,l'indice des prix à la production a fortement baissé de 1990 à 2002.Pour 2003 et 2004,l'indice affiche une légère tendance à la hausse. En 2004,il a augmenté de 1,2 point pour s’établir à 76,8 points.Cette augmentation est due avant tout aux prix relativement élevés des animaux de boucherie de l'espèce bovine.Les prix des produits biologiques,quant à eux,ont évolué en-dessous de la moyenne.
Comparé à l’indice des prix à la production,l’indice suisse des prix à la consommation a connu une évolution diamétralement opposée durant cette période pour le sousgroupe «Denrées alimentaires et boissons».Après une progression enregistrée surtout à partir de 1999,l’indice a continué d’augmenter de 0,6 point par rapport à 2003 pour atteindre le niveau de 111,2 points en 2004.
Evolution des indices de prix de denrées alimentaires à la production, à la consommation et à l'importation ainsi que de l'indice des prix des moyens de production agricoles
Indice des prix à la production
Indice (1990/92 = 100)
1 Base mai 1997 = 100. Le nouvel indice porte à 100% sur des moyens de production. L'ancien (base 1976) comprenait également les facteurs de production travail et capital avec un poids de 25% de l'indice total. Le poids des moyens de production était alors de 75%.
Agriculture
Indice suisse des prix à la consommation, sous-groupe denrées alimentaires et boissons
Indice des prix des moyens de production agricoles 1
Indice des prix à l'importation de denrées alimentaires 2
2 Base mai 2003 = 100. Des séries de chiffres plus anciennes ne sont pas disponibles pour cet indice. Jusqu'en avril 2003, l'indice des prix à l'importation du groupe «denrées alimentaires» comprenait uniquement les sous-groupes «viande», «autres denrées alimentaires» et «boissons». Lors de la révision de mai 2003, des sous-groupes y ont été ajoutés. L'indice couvre maintenant un champ bien plus large des importations de denrées alimentaires.
Sources: OFS, USP
L’indice des prix des moyens de production agricoles a été revu et une nouvelle base a été définie (mai 1997 = 100).Dans l'ancien indice (base 1976),les facteurs de production travail et capital étaient compris dans l'indice total à raison de 25%.La pondération des moyens de production n'était donc que de 75%.Dans le nouvel indice,la pondération des moyens de production est de 100 %,les facteurs de production travail et capital (intérêts sur le capital) sont considérés séparément.
L'indice des prix des moyens de production agricoles affiche,depuis 1999,une légère tendance à la hausse.En 2004,il a progressé de 1,3 point par rapport à 2003,passant ainsi à 103,8 points.L'indice peut être subdivisé en moyens de production d'origine agricole (semences,aliments pour animaux) et autres moyens de production.S’agissant des premiers,il a diminué tout au long de la période observée,tandis qu’il a grimpé pour ce qui est des seconds.
En mai 2003,l’indice des prix à l’importation a été revu et modifié pour les denrées alimentaires et une nouvelle base a été définie (mai 2003 = 100).Des sous-groupes supplémentaires ont été admis dans le panier type,de sorte que l'indice regroupe une plus grande part des importations de denrées alimentaires.Au cours de l’exercice considéré,l’indice s’est élevé à 102,4 points,soit 2 points de plus qu'en 2003.
70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 1990–9219931994 199519961997199819992000200120032004 2002 16 1.1 ECONOMIE 1
■ Dépenses pour l’agriculture
et l’alimentation
Dépenses de la Confédération
Les dépenses totales de la Confédération se sont élevées à 50’285 millions de francs en 2004.Cela équivaut à une augmentation de 323 millions ou 0,6% par rapport à 2003.Les dépenses concernant l’agriculture et l’alimentation,pour leur part,ont été pratiquement identiques,puisqu’elles se sont montées à 3’902 millions de francs.Elles se situent toujours en cinquième position après la prévoyance sociale (13’813 millions de fr.),les finances et les impôts (9’417 millions de fr.),les transports (7’435 millions de fr.) et la défense nationale (4’641 millions de fr.).
La part de l’agriculture et de l’alimentation à l’ensemble des dépenses de la Confédération a atteint 7,8%,comme en 2003.Depuis 2000,elle est légèrement inférieure à 8%.
De 1998 à 2003,les dépenses pour la production et les ventes ont été comprimées; elles ont passé de 1’203 millions de francs à 798 millions.L’obligation définie à l’art. 187,al.12,des dispositions transitoires de la nouvelle loi sur l’agriculture,selon lequel, dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi,les moyens financiers affectés au soutien du marché doivent diminuer d’un tiers,a ainsi été remplie.Au cours de l’année sous revue,ces fonds ont encore diminué de 67 millions de francs,soit de 8,4% par rapport à 2003.
19941995199619971998199920002001200220032004 en mio. de fr. en % en chiffres absolus (mio. de fr.) en % des dépenses totales Source: Compte d'Etat 0 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 7,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 3 496 3 547 3 953 3 922 3 925 4 197 3 727 3 962 4 067 3 908 3 902
Evolution des dépenses de la Confédération pour l'agriculture et l'alimentation
17 1.1 ECONOMIE 1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE 1
Tableau 50,page A58
Evolution des dépenses de la Confédération pour l’agriculture et l’alimentation
Remarque:la répartition des moyens financiers entre les différents domaines d’activité repose sur le compte d’Etat 1999. Les dépenses pour la mise en valeur des pommes de terre et des fruits,par exemple,ou celles liées à l’Administration fédérale des blés en 1990/92,ont été intégrées dans les dépenses de l’OFAG,alors que les comptes étaient encore séparés dans la période de référence.Les chiffres de 1990/92 ne coïncident donc pas avec les données du compte d’Etat, mais ceux de 2002 à 2004 sont de nouveau comparables.
1Les dépenses dans ces domaines ont été regroupées en fonction des enveloppes financières.Ce regroupement a entraîné une adaptation de la rubrique «amélioration des bases de production»,de sorte que le total figurant dans cette rubrique ne peut plus être comparé à celui des rapports agricoles précédents. 2Les dépenses extraordinaires dans le secteur laitier sont comprises dans ce montant;elles ont été prélevées sur les montants attribués à d’autres secteurs tels que les améliorations structurelles et la production animale.
Sources:Compte d’Etat,OFAG
L’augmentation des dépenses pour les paiements directs en 2004 s’explique par une participation accrue aux programmes écologiques et éthologiques.
Le recul des dépenses pour l’amélioration des bases de production (–13 millions de fr.) est notamment lié au fait qu’en 2003,un crédit supplémentaire a été adopté pour la réparation des dégâts causés par les intempéries de 2002.
Domaine1990/92200220032004 en mio.de fr. Production et ventes 1 1 685979 2 798731 Paiements directs 1 7722 4292 4352 498 Amélioration des bases de production 1 186190215202 Autres dépenses405469460471 Total agriculture et alimentation3 0484 0673 9083 902
1.1 ECONOMIE 1 18
L'année 2004 s'est déroulée sous des auspices plus favorables que l'année précédente. En effet,les conditions météorologiques ont permis aux cultures de se développer normalement et ainsi aux agriculteurs d'engranger de bonnes récoltes.La production laitière a légèrement augmenté par rapport à 2003;il en est allé de même de l'écoulement du fromage,des yoghourts et de la crème sur les marchés d'exportation.Les marchés de la viande de bœuf et de porc ont connu une bonne année.Par contre, la consommation de viande de volaille a reculé pour la première fois depuis de nombreuses années.La production maraîchère a atteint des rendements-record en 2004.
La production de denrées alimentaires (produits animaux et végétaux) a augmenté de 6,6% par rapport à 2003,année durant laquelle l'été très sec avait restreint la production de plusieurs secteurs agricoles.La production végétale a progressé de 12,4% (+525 millions de fr.) et la production animale de 1,5% seulement (75 millions de fr.). La production animale ayant moins fortement souffert de la sécheresse de 2003,il est compréhensible que sa valeur ait augmenté plus faiblement.Le secteur agricole comprend depuis 2003 également les plantes fourragères,les produits horticoles,les prestations de services agricoles et les activités accessoires non agricoles.

■■■■■■■■■■■■■■■■
1.1.2 Marchés
Ventilation du secteur agricole en 2004 Lait
Porcs
Bovins
Activités annexes non agricoles 3% Fruits 5% Source: OFS Volaille, œufs
Autres produits animaux
Cultures maraîchères et horticulture 13% Prestations de services agricoles 6% Vin 4% Pommes de terre, betteraves sucrières 3% Céréales 4% Plantes fourragères 13% Autres produits végétaux 1% 1.1 ECONOMIE 19 1
23%
10%
10%
4%
1%
■ Production:livraisons de lait en légère hausse

Lait et produits laitiers
En 2004,les laiteries et fromageries ont transformé environ 3,21 millions de t de lait et les productions de fromage et de produits à base de lait frais ont augmenté. Parallèlement à la nouvelle hausse des exportations de fromage,les exportations de yoghourts et de crème se sont accrues elles aussi.Cependant,les prix du lait à la production ont continué de baisser au cours de l’exercice sous revue,alors que les indices des prix à la consommation,à l’exception de celui du beurre,ont affiché une légère tendance à la hausse.
Durant l’exercice considéré,la production laitière totale a augmenté de 32'800 t pour s’établir à 3,94 millions de t,dont quelque 23% ont servi à l’auto-approvisionnement ou à l’affouragement dans les exploitations.La production laitière par vache s’est encore accrue de 90 kg en moyenne par rapport à l’année précédente,pour atteindre 5'680 kg.
En 2004,les producteurs ont vendu 3,21 millions de t de lait,soit 1,15% de plus que l’année d’avant.Cette quantité a été produite par 570'000 vaches.Le cheptel de vaches a légèrement régressé (–5'000 têtes) par rapport à 2003.
de lait par mois 2003 et 2004
En janvier,février,mai,juin,octobre et novembre 2004,les livraisons de lait mensuelles ont été supérieures à celles de l’exercice antérieur,alors qu’elles ont été à peu près équivalentes pour les mois de juillet à septembre et en novembre.La quantité de lait commercialisé a été moindre seulement en mars et en avril.
Livraisons
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre en 1 000 t Livraisons 2004 Livraisons 2003 Source: TSM 220 230 250 240 270 260 280 290 300 310 320 1.1 ECONOMIE 1 20
Le lait commercialisé (3,21 millions de t) au cours de l’exercice 2004 a été transformé en totalité,à savoir:
en fromage:1 323 000 t (+2,2%) en lait de consommation et autres produits laitiers:1 124 000 t (+0,8%) en crème/beurre:741 000 t (–0,3%)
La production de fromage,en hausse de 1,4% par rapport à l’année précédente,s’est élevée à 70'160 t de fromage à pâte dure (+1'238 t ou +1,8%) et à 47'878 t de fromage à pâte mi-dure (+1'228 t ou +2,6%).Par contre,la production de fromage frais qui avait progressé ces dernières années a marqué le pas (–279 t) pour s’établir à 36'822 t.A l’instar des années précédentes,la production de fromage de brebis et de fromage de chèvre s’est développée de manière positive,passant de 708 à 810 t (+14,5%).
L’accroissement de la production de produits à base de lait frais enregistré en 2003 a pu être également observé durant l’exercice 2004;il a ainsi atteint près de 5,4% tandis que la production s’établissait à 229'880 t.Concernant le lait de consommation,la tendance baissière observée depuis quelques années s’est redressée en 2004.La quantité produite a augmenté de 2'386 t pour atteindre 497'021 t.
Quant à la production de beurre,elle est restée stable,contrairement à celle de poudre de lait qui a reculé de 8,1% par rapport à 2003,passant de 55'536 t à 51'048 t.
Evolution de la mise en valeur du
1990/92200220032004 en 1000 t de lait Autres produits laitiers Crème Beurre Sources: TSM, USP Fromage Lait de consommation 0 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 ■ Mise en valeur: davantage de fromage 1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE 1.1 ECONOMIE 21 1
lait commercialisé
■ Commerce extérieur: exportations de yoghourt en
Comme les années passées,la balance du commerce extérieur a été positive.En termes de volumes,la Suisse a exporté davantage de fromage,de yoghourt,de lait en poudre et de crème qu’elle n’en a importé.Deux points méritent pourtant d’être relevés,à savoir la hausse notable des exportations de yoghourt et de crème et le recul des exportations de poudre de lait.
En 2004,les exportations de yoghourt ont bondi de 60,1% pour atteindre 17'033 t,à la différence des importations qui ont légèrement régressé par rapport à l’année précédente.En ce qui concerne le lait en poudre,les exportations ont diminué de 18% à 15'617 t,tandis que les importations reculaient elles aussi.Les importations de beurre pour l’approvisionnement du pays ont augmenté de 107% et s’élevaient à 977 t en 2004 tandis que les exportations de crème augmentaient de 317 t (+29,8%) pour s’établir à 1'379 t.
Trois ans après l’entrée en vigueur de l’accord sur le fromage,les contingents à droit zéro n’ont pas tous été épuisés.Sur un volume disponible de 17'000 t,14'898 t au total ont été mises en adjudication.Comme les deux premières années,les deux contingents 119 (Mozzarella) et 120 (fromages frais et à pâte molle) ont pu être intégralement attribués.
Contingents d’importation
de fromage en Suisse
Produit1re
Contin-QuantitéContin-QuantitéContin-Quantité gentattribuéegentattribuée gentattribuée en ten ten ten ten ten
En vertu de l’accord précité,la Suisse a disposé la troisième année d’un volume de 5'500 t pour des exportations supplémentaires de fromage en franchise de douane à destination de l’UE (augmentation des contingents à droit zéro de 1’250 t par rapport à la deuxième année).Comparé à la deuxième année,l’accès au marché a été mis à profit de manière à peu près similaire.En juillet 2004,l’UE a délivré des certificats d’importation portant sur un volume de 951 t pour la période de juillet à décembre 2004,le contingent disponible pour ce premier semestre étant de 2'750 t.Il est donc resté pour le second semestre 2004/05 un volume de 4'549 t,lequel incluait les contingents non utilisés au premier semestre.
Le contingent disponible pour l’exportation dans l’UE de yoghourt et de crème en franchise de douane a,pour la première fois,été attribué dans sa totalité (2'000 t).
année 2e année 3e année (juin 02 à mai 03)(juin 03 à mai 04)(juin 04 à mai 05)
119Mozzarella500500700700950950 120Fromages frais et à pâte molle1 0001 0003 3003 3004 8504 850 121Asiago,Bitto, Brà,Fontal, Montasio,etc.5 0002 7195 0003 4135 0003 427 122Provolone500211500293500304 123Fromages à pâte dure et mi-dure5 0004 5695 0005 0005 7005 367 Source:OFAG
t
No du contingent 1.1 ECONOMIE 1 22
hausse
■ Consommation de yoghourt en léger recul
La consommation de lait et de produits laitiers par habitant a été stable,celle de séré, de fromage et de beurre est restée pratiquement inchangée en 2004.

Consommation par habitant
1990/92200220032004
La consommation de boissons à base de lait a augmenté par rapport à l’année précédente,passant de 4,6 kg à 6,1 kg (+32,6%).Quant à la consommation de yoghourt, elle accuse un léger recul de 0,6 kg (–3,7%) par rapport à 2003 et s’établit à 15,6 kg.
kg par habitant Fromage Yoghourt
Beurre Seré 0,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 14,0 16,0 18,0 20,0 1.1 ECONOMIE 23 1
Source: USP
■ Prix à la production: la tendance à la baisse persiste
Par rapport à 2003,une nouvelle baisse des prix à la production a été enregistrée en 2004.Le prix moyen du lait en Suisse a diminué de 0,91 ct.par kg de lait pour atteindre 74,63 ct.Cela dit,les prix du lait industriel,du lait transformé en fromage et du lait biologique étaient inférieurs en 2004 à ceux de l’année précédente.
Prix du lait en 2004,pour toute la Suisse et selon les régions
En ce qui concerne le lait industriel et le lait biologique,les différences régionales se sont une nouvelle fois légèrement accentuées par rapport à 2003.Durant l’exercice considéré,les écarts de prix ont atteint 1,48 ct.pour le lait industriel et 4,59 ct.pour le lait biologique.En revanche,les différences de prix entre les régions ont été à peu près comparables à celles de 2003 pour le lait transformé en fromage et n’ont pas dépassé 7,76 ct.Le prix à la production du lait biologique a reculé de 3,76 ct.par kg de lait (–4,3%) en comparaison de l’exercice précédent.Le consommateur le paie de 2,71 à 15,06 centimes plus cher que le lait ordinaire.
■ Prix à la consommation: en baisse pour le beurre
Les prix à la consommation ont évolué de manière contrastée pour le fromage en 2004. L’Emmental surchoix a ainsi coûté en moyenne 19,93 fr.le kilo (–4,6% ou –96 ct.) et le Gruyère surchoix 20,54 fr.le kilo (–2,3% ou –48 ct.).Par contre,le prix du Sbrinz a augmenté de 4,4%,progressant de 21,75 fr.à 22,71 fr.,et celui de l’Appenzell surchoix de 0,25% qui est passé de 19,76 fr.à 19,81 fr.En ce qui concerne le camembert à 45% et les fromages à pâte molle et croûte fleurie,le consommateur a payé les mêmes prix qu’en 2003.
Les indices des prix à la consommation pour le fromage,la crème et d’autres produits laitiers ont affiché une légère tendance à la hausse en 2004,contrairement au beurre dont l’indice a baissé de 1,76 point,soit de 1,8%.
ct./kgSuisseRégion IRégion IIRégion IIIRégion IVRégion V Total74,6374,5074,6274,0176,4675,78 Lait industriel73,2973,5473,3172,9272,9974,40 Lait transformé en fromage73,8476,5072,7773,8272,7880,53 Lait biologique85,4587,5685,7487,8383,24 non relevé Source:OFAG
Indice (mai 1993 = 100) Lait Fromage Beurre Source: OFS Crème Autres produits laitiers 75 85 80 90 95 100 105 1.1 ECONOMIE 1 24
Evolution des indices des prix à la consommation pour le lait et les produits laitiers
1990/92200220032004
Après avoir observé,entre mars et juin 2004,une légère tendance à la hausse de la marge brute totale réalisée sur le lait et les produits laitiers,on a enregistré une baisse continue de celle-ci entre juillet et octobre,suivie d’une nouvelle augmentation vers la fin de l’exercice.Cette évolution a également concerné la marge brute de transformation-distribution réalisée sur le groupe de produits «fromage» de même que celle afférente au yoghourt.En revanche,la marge brute sur le beurre était plus élevée fin 2004 qu’en début d’année.Pour autant,les importantes fluctuations enregistrées au cours de l’exercice sont imputables à l’évolution contrastée des prix à la production et à la consommation.La baisse des prix à la production en avril et en mai a entraîné une forte augmentation de la marge brute.L’adaptation des prix à la consommation vers le bas a induit en juillet une nouvelle diminution de la marge brute qui s’est ensuite redressée du fait de la baisse des prix à la production pour des raisons saisonnières.
 ■ Marge brute:lait et produits laitiers
■ Marge brute:lait et produits laitiers
Indice (janvier 1997 = 100) Fromage Lait et produits laitiers Yoghourt Beurre Source: OFAG 40 50 60 70 80 100 90 110 120 130 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 1.1 ECONOMIE 25 1
Evolution de la marge brute 2004
Animaux et produits d’origine animale
Le cheptel bovin ne cesse de diminuer en Suisse depuis le début des années nonante: de 1,85 millions de têtes,il est tombé à 1,54 millions d’animaux.Ce recul est principalement imputable à l’exploitation de plus en plus extensive des surfaces ainsi qu’aux progrès réalisés en matière de sélection,alors que la production laitière faisait simultanément l’objet d’un contingentement.Durant l’exercice 2004,le nombre de vaches gardées en Suisse a,pour la première fois,été inférieur à 700'000 têtes.

L’ESB a pratiquement disparu puisque seuls trois cas de maladie ont été enregistrés. Les années précédentes,le nombre de cas dépistés était toujours supérieur à vingt. Cette situation réjouissante est attribuable à la fixation de normes claires,à l’application de contrôles systématiques uniformisés tout au long de la chaîne de production et au conseil accru,axé sur la pratique,dont bénéficient les exploitations.
De l’avis des producteurs,le marché de la viande et des œufs s’est développé de manière positive.Ceux-ci ont en effet obtenu des prix supérieurs ou au moins identiques à ceux de l’exercice précédent,sauf pour la viande d’agneau.Conséquence de la diminution de 10% des abattages de vaches,les prix à la production ont par exemple augmenté de 15%.Le prix de la viande de porcs (4,54 fr.par kg PM) a également été supérieur à celui des années 2002 et 2003.Par contre,les producteurs de viande d’agneau,confrontés à une offre accrue sur le marché intérieur,ont vu leurs prix fondre de 11%.La production indigène,toutes catégories de viande confondues, a néanmoins baissé et a été partiellement compensée par la hausse des volumes d’importation.Sur les 391'000 t de viande globalement consommées en Suisse, quelque 85'000 t,soit 22%,étaient d’origine étrangère,contre 21% en 2003.La consommation de viande et de poisson,en baisse de 0,6%,s’est s’élevée en 2004 à 59,49 kg par habitant.Pour la première fois depuis des années,la viande de volaille a perdu de son importance,la consommation étant retombée sous la barre des 10 kg par habitant.
26 1.1 ECONOMIE 1
■ Production:augmentation du cheptel de chevaux,de chèvres et de poulets de chair
Le cheptel de bovins,en constante diminution,a régressé de 1,6%.C’est surtout le nombre de vaches dont le lait est commercialisé qui a baissé (–17'000 têtes).En revanche,celui des vaches mères et nourrices a progressé (+5'000 têtes).Dans l’ensemble,quelque 46'200 exploitations gardent des bovins.L’effectif de porcs d’environ 1,5 millions de têtes et celui des truies d’élevage qui atteint quelque 143'000 têtes sont restés relativement stables par rapport aux dernières années. Cependant,le nombre d’exploitations a chuté de 20% depuis 2001.
Evolution des effectifs
Espèce animale19902002200320041990–2002/04
en 1 000en 1 000en 1 000en 1 000%
Bovins1 8581 5941 5701 544–15,54
– vaches dont le lait est commercialisé726605587570–19,10 –vaches traites,dont le lait n’est pas
commercialisé515351511,31
–vaches allaitantes14586570359,52
Porcs1 7761 5611 5291 537–13,16
Moutons35543044544023,47
Chèvres6166677111,48
Chevaux3851535438,60
Poulets de chair2 8784 2984 5184 97159,68
Poules pondeuses et poules d’élevage2 7952 1542 1172 088–24,16
Source:OFS
L’effectif de poulets de chair a continué de grimper et compte désormais près de 5 millions de têtes.Comparé à 1990,ce chiffre représente une augmentation de 74%. Les 1'084 poulaillers d’engraissement gardent en moyenne un effectif de 4'500 têtes. Cependant,suite à l’amélioration continue des performances de ponte,le nombre de poules pondeuses et de poules d’élevage a diminué de 1,3%.Cet effectif a même été divisé par quatre par rapport à celui enregistré en 1990.Quant au nombre d’exploitations,il a lui aussi continuellement baissé et s’est élevé à 16'400 (–5,5%) en 2004.
Concernant la production de viande indigène,la viande de porc occupe le premier rang avec 227'085 t PM,suivie par la viande de bœuf avec 100'308 t PM.Ces deux catégories de viande représentent une part d’environ 76% à l’ensemble de la production qui atteint 431'745 t PM.Environ la moitié de la production de viande de bœuf est en fait de la viande de vache provenant surtout des exploitations laitières.
Par rapport à 2003,l’agriculture suisse a accru sa production de viande de mouton et d’agneau de 6,8% et celle de volaille de 6,1%.Depuis 1990/92,la production suisse a même augmenté de 30% pour la viande de mouton et d’agneau et de 66% pour la viande de volaille.Fait remarquable,le marché a absorbé aisément ces quantités supplémentaires de viande de volaille.A l’inverse,le prix des agneaux a été fortement mis sous pression.Depuis deux ans toutefois,la production de viande de bœuf,de veau et de porc ainsi que la production d’œufs diminuent en raison du recul des effectifs d’animaux.
1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE 1.1 ECONOMIE 27 1
Evolution de la production animale
■ Commerce extérieur: le Brésil est notre premier fournisseur de viande bovine
Les viandes de bœuf et de porc consommées sont produites en Suisse à raison de 88% et de 93% respectivement.Mais seulement un kilo de viande de cheval sur huit,un kilo de viande de lapin sur six et un kilo de viande de volaille,de chèvre et de mouton sur deux sont issus de la production suisse.
La production d’œufs a baissé de 4% et s’élève à 652 millions d’unités,sachant que 97% des œufs indigènes sont vendus dans le commerce de détail et dans la restauration.Les œufs restants sont cassés et vendus à l’industrie agroalimentaire.Quant aux importations d’œufs,elles sont le fait du commerce de détail et de l’industrie agroalimentaire,à raison de 50% chacun.
Les exportations de viande et de produits à base de viande suisses ont bondi de 360 t pour s’établir à 2'160 t.Plus de la moitié de ces exportations (1'151 t) concerne la fameuse viande de bœuf séchée qui est presque intégralement vendue (plus de 99%) en France et en Allemagne.La valeur commerciale des exportations de viande s’est élevée à quelque 25 millions de francs.
Dans l’ensemble,les entreprises suisses ont importé plus de 103’000 t de viande,de produits à base de viande et d’abats pour une valeur commerciale d’environ 680 millions de francs.En termes de volumes,les importations ont concerné en premier lieu les viandes de volaille (42'500 t) et de porc (11'600 t).Notre principal partenaire est l’Allemagne avec une part de 35'000 t représentant une valeur commerciale de 82 millions de francs.
Les viandes de bœuf et de veau importées proviennent du Brésil à raison de 74%,ainsi que d’Afrique du Sud (13%),d’Italie (9%) et de France (7%).Ce sont essentiellement des morceaux de la cuisse de bœuf et des pièces répondant au label High-Quality-Beef que nous importons du Brésil.Depuis plusieurs années,les Suisses ont une préférence pour la viande de mouton et d’agneau venant d’Australie et de Nouvelle-Zélande,dont les importations représentent une part de 82%.La France,l’Allemagne et le RoyaumeUni se partagent les 18% restants.Quant à la viande de cheval,nos principaux fournisseurs sont le Canada (38%),les Etats-Unis (38%),l’Argentine (11%) et l’Australie (9%).Les importations de viande de volaille proviennent essentiellement de France et
1990/92 2002 2003 2004 Indice (1990/92 =
Viande de bœuf Viande de mouton Viande de volaille Sources: Proviande, USP Viande de veau Viande de chèvre Oeufs en coquille 70 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 Viande de porc Viande de cheval
100)
1.1 ECONOMIE 1 28
■ Consommation:la viande de porc vient en tête
de Hongrie,avec une part respective de 21%.Les produits de charcuterie italiens ont toujours la cote dans notre pays,comme le prouvent les quelque 2'600 t achetées chez notre voisin méridional par les entreprises de commerce suisses.Par contre,les préparations de viande et les conserves (1'400 t) sont essentiellement importées de France.

Dans le cadre du cycle d’Uruguay à l’OMC,la Suisse s’est engagée à faciliter l’accès au marché pour une quantité de viande déterminée en abaissant les droits de douane perçus sur les contingents.Depuis 1996,le contingent d’importation s’élève en tout à 22'500 t pour les viandes de bœuf,de mouton,de cheval et de chèvre.La Suisse a respecté cet engagement chaque année et autorisé,en moyenne annuelle,l’importation de plus de 27'000 t au cours des neuf dernières années.Quant à la viande de porc et de volaille,le volume du contingent tarifaire a passé de 50'020 t en 1996 à 54'500 t en 2000 et s’est stabilisé à ce niveau depuis.Les contingents convenus pour ces deux viandes ont également été dépassés pour la moyenne des années 1996 à 2004,s’élevant à environ 55'200 t par an.Si le volume du contingent tarifaire n’a pas été entièrement atteint certaines années,il a cependant été plus que compensé par des importations supplémentaires effectuées d’autres années.
Les importations de chevaux et d’ânes ont régressé de 4% pour s’établir à 3'064 têtes. Un cheval sur trois provient d’Allemagne et un sur quatre de France.En contrepartie,la Suisse a tout même exporté 1'035 chevaux.
Le commerce extérieur d’œufs se distingue par son caractère unilatéral.En effet,aux importations qui s’élèvent à plus de 27'000 t font pendant des exportations qui n’excédent pas 1 t.Les quelque 14'800 t d’œufs allemands et français importés sont principalement écoulées dans le commerce de détail.En revanche,les œufs cassés en Suisse qui sont utilisés dans l’industrie alimentaire proviennent en majeure partie des pays d’Europe de l’Est:Bulgarie,Pologne et République tchèque.Ces trois pays livrent en tout 7'400 t d’œufs au commerce suisse.De surcroît,10'800 t de produits à base d’œufs (liquides ou séchés) et d’ovalbumine sont importées en Suisse,dont plus de la moitié provient des Pays-Bas.Quant aux exportations,elles s’élèvent seulement à 190 t.
La consommation de viande s’est élevée à 391'065 t,soit 0,2% de moins qu’en 2003. D’une manière générale,les Suisses ont consommé davantage de viande de cheval (+6,1%),de gibier et de lapins (+3,2%),de viande de bœuf (+1,3%) ainsi que de viande de mouton et d’agneau (+0,9%).Par contre,la consommation de volaille a régressé de 0,6%.En outre,les Suisses ont consommé 58'649 t de poissons et de crustacés,ce qui correspond à une augmentation de 2,8%.
La consommation de viande par habitant a diminué de 0,7% pour s’établir à 51,73 kg. Cependant,le porc demeure la viande la plus consommée (24,80 kg),suivi du bœuf (10,23 kg),de la volaille (9,97 kg) et de la viande de veau (3,54 kg).Les autres catégories de viande sont beaucoup moins consommées.L’assiette du consommateur contient en moyenne 140 g de viande et de produits à base de viande par jour.La consommation par habitant de poissons et de crustacées a évolué de manière positive: en augmentation de 2,4%,elle a atteint 7,76 kg.
1.1 ECONOMIE 1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE 29 1
Evolution de la consommation de viande et d'œufs par habitant
(1990/92 = 100)
Les ménages privés ont principalement consommé de la viande de porc et de la volaille.De même,la charcuterie et les produits de charcuterie occupent une place significative en termes de quantité.Dans la restauration,en revanche,ce sont la viande de bœuf et la charcuterie qui viennent en tête du classement.
Concernant les animaux de l’espèce bovine (taureaux,bœufs et génisses) de qualité moyenne (classe commerciale T3),le prix du kilo de viande PM franco abattoir s’est établi entre 8,07 fr.et 8,17 fr.en moyenne annuelle.Par conséquent,les engraisseurs ont obtenu des prix aussi élevés que l’année précédente.Le prix des vaches de bonne qualité (classe commerciale T3) a,quant à lui,grimpé de 15%,s’établissant à 6,62 fr./kg PM.Cette augmentation s’explique principalement par la diminution du nombre des abattages (–10%).La baisse enregistrée dans la production de viande de porc (–1,1%) a induit une augmentation de 2% du prix des porcs à viande,lequel a passé à 4,54 fr. par kg/PM.Quant au prix des agneaux de qualité moyenne (classe commerciale T3),il a baissé pour atteindre,en moyenne annuelle,10,21 fr.le kg PM,soit une chute de 11% par rapport à 2003 et de 24% par rapport à 2002.Cette évolution est surtout imputable à la hausse continue de l’offre indigène.En comparaison de l’année 2002,les ventes de viande de mouton et d’agneau ont en effet augmenté de 11% sur le marché suisse.
1990/92 2002 2003 2004 Indice
Viande de bœuf Viande de porc Viande de chèvre Sources: Proviande, USP Viande de volaille Viande de veau Viande de mouton 70 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75
(pces)
Viande de cheval Oeufs en coquille
fr./kg PM
Taureaux
Porcs charnus, légers Source: USP 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Prix mensuels du bétail de boucherie et des porcs en 2004, départ de la ferme
Veaux classe commerciale T3
classe commerciale T3
Vaches
classe commerciale T2/3
1.1 ECONOMIE 1 30
■ Prix à la production: hausse du prix des vaches
de boucherie
Comme à l’accoutumée,des variations de prix saisonnières sont apparues et ont concerné les porcs et les veaux.Au cours du second semestre,le prix des veaux a grimpé de 11,15 fr.à 13,90 fr.le kg/PM en raison de la diminution de l’offre.Pour les porcs,c’est entre mai et juillet que les prix les plus élevés ont été payés,à savoir jusqu’à 5,40 fr.le kg/PM,la saison des grillades ayant favorisé la demande.Malgré la désalpe, le prix payé pour les vaches s’est stabilisé à l’automne,s’établissant entre 6,40 fr.et 6,80 fr.le kg PM.
La hausse des prix à la production enregistrée pour les bœufs et les veaux s’est répercutée au comptoir avec une augmentation des prix à la consommation allant de 50 ct. à 2,50 fr.le kg.En revanche,pour les morceaux de porc et d’agneau les prix à la consommation sont demeurés relativement stables.Néanmoins,les consommateurs ont dépensé plus d’argent que pendant la période 1990/92 pour les morceaux de viande observés,toutes catégories d’animaux confondues.Ainsi,les hausses de prix se sont inscrites dans une fourchette allant de 4% pour le rôti de bœuf à 39% pour l’émincé de veau.L’augmentation de la part de viande sous label a influé en partie sur cette évolution.Par rapport à 1990/92,les prix à la production par kg PM se sont effondrés en 2004 pour le bœuf (–12%),le veau (–15%) et les vaches (–28%).
La marge brute de transformation-distribution a augmenté en valeur nominale de 9 points par rapport à 2003 pour la viande de bœuf,mais elle a diminué pour la viande d’agneau (–6 points),la viande de porc (–1 points) et la viande de veau (–2 points). La plus forte augmentation de marge (+38%) jamais enregistrée depuis le début des observations en 1999 a été observée pour la viande de porc,tandis que l’augmentation la plus faible a été relevée pour la viande de veau (+13%).La marge réalisée sur le panier de la ménagère contenant toutes les sortes de viande fraîche,y compris des produits à base de viande et des produits de charcuterie,n’a cessé de grimper depuis la période de référence (février-avril 1999,indice = 100).Ainsi,en 2004,cet indice s’élevait en moyenne à 119,2 points,en hausse de 3 points par rapport à l’année précédente.C’est la viande d’agneau qui a connu les plus fortes fluctuations mensuelles avec un indice se situant entre 105 et 127,8 points.
Indice (février–avril 1999 = 100) Porc Bœuf Veau Agneau Viande fraîche, produits carnés et charcuterie Source: OFAG 150 135 140 145 130 125 120 115 110 105 100 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Evolution des marges brutes sur la viande 2004
■ Prix à la consommation: de nouveau en hausse pour les viandes de bœuf et de veau
1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE 1.1 ECONOMIE 31 1
■ Marge brute réalisée sur la viande
■ Conditions météorologiques:temps chaud et ensoleillé
Production végétale et produits végétaux

La douceur de l’hiver 2003 s’est poursuivie sur le Plateau en janvier et février 2004. Hormis en mars et en mai,toutes les valeurs moyennes mensuelles ont dépassé la moyenne des températures mesurées entre 1961 et 1990 sur les versants Nord et Sud des Alpes.De même,les mois de janvier et février ainsi que septembre et octobre ont été plus chauds qu’en 2003,année de la canicule.La période comprise entre février et mai et le mois de septembre ont bénéficié d’un bon ensoleillement.A l’exception de janvier et d’octobre,la durée moyenne d’ensoleillement pour les autres mois a été conforme à la moyenne de ces dernières années.Toujours par rapport à cette moyenne, janvier et octobre ont connu un faible ensoleillement mais de nombreuses précipitations.Les pluies ont,par contre,été rares en février et en avril ainsi qu’en septembre, novembre et décembre.Malgré l’impression contraire ressentie par rapport à la canicule de 2003,l’année 2004 a globalement été chaude et ensoleillée;pour autant la quantité de précipitations est restée légèrement en-deçà de la moyenne des dernières années.
Au nombre des caprices de la météo figurent les précipitations extrêmes mesurées en janvier où,dans le nord et l’ouest de la Suisse,à peu près l’équivalent d’un mois normal est tombé en deux jours.Fin mars,l’hiver a fait un retour en force jusqu’à basse altitude en Suisse orientale avec 75 cm de neige fraîche à St-Gall.Début juin,de très fortes précipitations ont provoqué des glissements de terrain et des inondations notamment dans l’Oberland bernois.Le 8 juillet,un orage de grêle avec des grêlons mesurant jusqu’à 4 cm de diamètre a traversé le Plateau,du lac Léman jusqu’au lac de Constance.Conséquence des hautes températures enregistrées,de nombreux et violents orages d’été sont survenus en octobre,phénomène inhabituel à cette période de l’année.
1.1 ECONOMIE 1 32
■ Production:des rendements de pointe compensent le recul des surfaces
Cultures des champs
La surface occupée par les terres ouvertes a globalement diminué de 2'173 ha (–0,8%) par rapport à l’année précédente.Le recul le plus significatif a concerné les cultures de céréales fourragères (–6'236 ha ou –8,0%) alors que la surface des céréales panifiables progressait de 1'430 ha (+1,6%).Une extension des surfaces a également été enregistrée pour le maïs d’ensilage et le maïs vert (+5,1%),les cultures maraîchères (+4,9%),le colza (+5,3%) et les betteraves sucrières (+6,2%).Par rapport à la surface cultivée,le recul enregistré pour les cultures de betteraves fourragères et de matières premières renouvelables (plantes à fibres) s’est poursuivi.
Composition des terres assolées 2004 (provisoire)
Total 281 302 ha
Maïs d'ensilage et maïs vert
15% 42 433 ha
Légumes de plein champ
3% 8 813 ha
Colza 6%
16 839 ha
Betteraves sucrières 7%
18 622 ha
Autres cultures 7% 19 508 ha
Céréales 57% 161 752 ha
Pommes de terre 5% 13 335 ha
Source: USP
Alors que la sécheresse de l’été 2003 avait provoqué une chute des rendements,les conditions météorologiques de l’année 2004 ont favorisé les cultures des champs –sauf celles de pommes de terre,de tournesol et de soja – qui ont affiché des rendements de pointe.
Evolution des rendements à la surface pour des cultures sélectionnées
1990/9219992000200120022004 2003
Produits (rendements 2004 chiffres provisoires)
Blé d'autome (63,1 dt/ha)
Pommes de terre (395,0 dt/ha)
Colza (34,5 dt/ha)
Orge (68,8 dt/ha)
Betteraves sucrières (779,0 dt/ha)
Source: USP
Indice (1990/92 = 100)
70 140 130 120 110 100 90 80 1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE 1.1 ECONOMIE 33 1
■ Mise en valeur:marché en déséquilibre pour le blé panifiable et les pommes de terre
Compte tenu des rendements élevés obtenus malgré le recul des surfaces cultivées,la production céréalière a excédé en 2004 les récoltes des trois précédentes années.Si la production de céréales fourragères a pu être écoulée sans problèmes sur le marché,il n’en a pas été de même pour le blé panifiable,l’offre ayant considérablement excédé les besoins.
■ Commerce extérieur: bilans de sucre et importations d’aliments pour animaux
Les conditions météorologiques favorables de l’année 2004 ont permis d’obtenir non seulement des rendements élevés mais aussi des récoltes de bonne qualité.Soucieuse de stabiliser les prix en raison de l’excédent de blé panifiable,la Fédération suisse des producteurs de céréales a mis en œuvre un train de mesures pour assurer la mise en valeur de cet excédent par le secteur fourrager.En service continu pendant 90 jours,les sucreries d’Aarberg et de Frauenfeld ont transformé la récolte record de betteraves sucrières (1,45 millions de t) en 221'803 t de sucre.L’importante récolte de pommes de terre s’est toutefois heurtée à une limitation de la demande,qu’il s’agisse des pommes de terre de table ou de celles destinées à la transformation.Excédentaire et de qualité insuffisante,cette récolte a dû être en partie transformée dans le secteur fourrager,avec le soutien de la Confédération.Concernant les oléagineux,seule la récolte de colza a dépassé l’objectif visé.Mais au vu de la demande réjouissante,les transformateurs se sont déclarés prêts à prendre en charge la totalité de la récolte pour produire notamment de l’huile de table et,à titre complémentaire,du carburant (ester méthylique de colza).
Conséquence de la variation des surfaces cultivées et des fluctuations du rendement dues aux conditions météorologiques,la production indigène de sucre s’établissait autour de 200'000 t depuis 1999 pour des besoins estimés à 230'000 t.Durant cette période,les importations ont augmenté,passant de 140'000 à 288'000 t.Les quantités supplémentaires importées ont été utilisées presque exclusivement dans des produits de transformation destinés à l’exportation.De plus,une gestion active des stocks a permis de parer à tout approvisionnement insuffisant ou excédentaire.
1990/92200220032004 1 en 1 000 t Blé Triticale Source: USP 1 provisoire Seigle Avoine Epeautre Maïs-grain Orge 0 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 547 539 258 181 428 218 91 509 247 189 342 211
Evolution de la production céréalière
1.1 ECONOMIE 1 34
bilans de sucre
Le sucre importé en Suisse provient en majeure partie de l’UE.Assurant 47,8% des importations totales de sucre en Suisse,la France a été le premier fournisseur en 2004, devançant l’Allemagne (45,5%),la Grande-Bretagne (3,6%),l’île Maurice (1,0%) et le Brésil (0,8%).Vingt-neuf autres pays se partagent le reste des importations (1,3%) –sucre de canne,sucre de betterave ou saccharose pur.
La baisse des rendements provoquée par la sécheresse de l’été 2003 a eu des répercussions sur le commerce extérieur jusqu’à la récolte 2004.Grâce aux bons rendements à la surface réalisés dans les fourrages au cours de l’exercice considéré,les importations ont diminué au second semestre.Comparées à 2003,les importations complémentaires de foin et de céréales fourragères ont régressé.
Evolution des importations des principaux aliments pour animaux
Evolution des
en 1 000 t Diminution des stocks Importations Production dans le pays Source:
Augmentation des stocks Exportations Consommation nette 0 600 500 400 300 200 100
199920002001200220032004
rérservesuisse
en 1 000 t
2001 2002 20032004 FoinBlé tendreMaïs-grainOrge 0 120 80 100 60 40 20 1.1 ECONOMIE 1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE 35 1
Source: DGD
■ Prix à la production: en majorité plus bas qu’en 2003
L’importante récolte et la réduction des taux de contributions ont eu une incidence négative sur le prix des pommes de terre en 2004.Dans le secteur alimentaire,les prix ont été comparables à ceux de l’année précédente,cependant les prix à la production se sont ressentis de la quantité plus importante à disposition,laquelle a été mise en valeur à bas prix dans le domaine fourrager.Malgré la baisse des contributions fédérales et l’importance de la récolte,le prix des betteraves sucrières a pu se maintenir à peu près au niveau de 2003.En ce qui concerne le blé,si l’offre excédentaire a pénalisé les prix à la production,la réduction des droits de douane décidée en novembre 2004 par le Conseil fédéral,avec effet au 1er juillet 2005,a elle aussi influé sur ces prix.En dépit des mesures d’allégement du marché financées par les producteurs,le prix du blé a fléchi.Anticipant la baisse des prix-seuils qui avait été décidée,le prix de l’orge a également diminué tandis que le prix des oléagineux et des autres aliments protidiques résistait plutôt bien.
■ Prix à la consommation: tendance à la hausse
1990/92200220032004
Prix à la production 2004 Blé cl. I, 57,84 Fr./dt Betteraves sucrières, 11,85 Fr./dt Colza, 76,60 Fr./dt
44,26 Fr./dt
de terre, 33,38 Fr./dt
Source: Agroscope FAT Tänikon
Le prix à la consommation de la farine fleur qui avait tendance à augmenter a continué de grimper en 2004.En revanche,les prix des produits de boulangerie comme le pain bis et le pain mi-blanc,ainsi que des petits pains et des croissants sont restés pratiquement stables.Le prix du sucre cristallisé est demeuré inchangé par rapport à l’année précédente,alors que les prix des pommes de terre et de l’huile de tournesol ont progressé.
Evolution des recettes réalisées par les producteurs avec des produits des champs
Ecart en %
Orge,
Pommes
–40 –50 –60 –70 –30 –20 –10 0 1.1 ECONOMIE 1 36
■ Production:conditions météorologiques optimales

Cultures spéciales
Une surface de 23'700 ha,soit de 2,2% de la SAU a été affectée aux cultures pérennes,dont 14'937 ha de vignes,6'750 ha de cultures fruitières et 284 ha de baies.
Les surfaces recensées (y compris les cultures successives) par la Centrale suisse de la culture maraîchère (CCM) se sont élevées à 13'500 ha,ne variant que de quelques hectares par rapport à l’année précédente.Ce sont les surfaces consacrées aux légumes de garde qui ont le plus augmenté.Occupant une surface de 733 ha,soit 10% de plus qu’en 2003,les cultures dévolues aux carottes de garde n’ont jamais été aussi étendues.Le plus net recul des surfaces cultivées a concerné les légumes de conserve.A titre d’exemple,la surface affectée aux épinards de conserve a chuté de 28% et ne couvre plus que 858 ha.
En ce qui concerne les surfaces dévolues aux fruits,la tendance observée ces dernières années s’est confirmée.La surface affectée aux pommiers (4'384 ha) a perdu quelques hectares,mais elle a diminué moins fortement que les années antérieures.En revanche, les surfaces occupées par les variétés Gala,Braeburn,Topaz et Pinova se sont encore accrues.Elles ont ainsi doublé au cours des sept dernières années et couvrent désormais 927 ha.La surface de poiriers s’est élevée à 958 ha,soit de nouveau en légère hausse par rapport à 2003.Les fruits à noyau et les baies sont toujours appréciés de sorte que la surface affectée aux fruits à noyau a augmenté de 159 ha (+13%) et s’établit à 1'353 ha,celle réservée aux baies a progressé de 20 ha (+3%) et atteint 671 ha.
Surface des cultures fruitières protégées contre les intempéries en 2004
Total 1 120 ha
Poiriers 88 ha
Pommiers 940 ha
Cerisiers 78 ha
Pruneautiers 14 ha
Source: OFAG
Sur une surface de 1'120 ha (17%),les cultures fruitières étaient protégées par des filets anti-grêle et/ou des films de protection contre la pluie.Ce sont les vergers de pommiers qui sont le mieux protégés contre les intempéries;940 ha ou 21% des surfaces sont équipés de filets anti-grêle.L’emploi de ces filets est également répandu dans les vergers de poiriers (88 ha),de cerisiers (77 ha) et de pruneautiers (14 ha). Dans les vergers de cerisiers,55 ha étaient en outre dotés d’une couverture contre la pluie et 9 ha d’un système combinant filet anti-grêle et film de protection contre la pluie.
1.1 ECONOMIE 1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE 37 1
■ Mise en valeur:récolte moyenne de fruits à cidre

De son côté,la surface viticole a atteint 14'937 ha,soit 8 ha de plus que l’année précédente.Cette surface était plantée de cépages blancs sur 6'587 ha (–130 ha) et de cépages rouges sur 8'350 ha (+138 ha).Le recul des surfaces de cépages blancs devrait se poursuivre,mais de façon plus modérée,ces années prochaines,en raison de la demande et des contributions versées pour la reconversion des vignobles.
Les récoltes de légumes se sont montées à 320'000 t (sans la transformation) et celles de fruits de table à 134'000 t.De nombreuses variétés de légumes et de fruits ont connu des récoltes records.Comparés à la moyenne des quatre dernières années,les rendements obtenus ont progressé de 11% pour les légumes et de 5% pour les fruits.
Les volumes du marché pour les variétés de légumes et de fruits pouvant être cultivés en Suisse ont atteint 533'000 t et 190'000 t respectivement.Comparé à la moyenne des quatre dernières années,le volume du marché a progressé de 7% pour les légumes et de 9% pour les fruits.La part des légumes et des fruits suisses aux volumes du marché s’est élevée à environ 60% et 71%,respectivement,en hausse de 2% pour les légumes et en baisse de 3% pour les fruits par rapport à la moyenne des années 2000 à 2003.
En viticulture,les sévères restrictions décrétées en 2002 et 2003 en raison de la situation sur le marché du vin ont été prorogées en 2004.Au cours de l’exercice considéré, 115,9 millions de litres de vin ont été encavés,soit 18,9 millions de plus que l’année précédente,les vendanges 2003 ayant été exceptionnellement faibles par suite de la sécheresse.Le volume encavé s’est élevé à 55,2 millions de litres pour les vins blancs et à 60,7 millions de litres pour les vins rouges.Les rendements moyens ont été de 0,8 l/m2 pour les cépages blancs et de 0,7 l/m2 pour les cépages rouges.
Avec ses 156'670 t,dont 133'210 t de pommes à cidre et 23'460 t de poires à cidre, la récolte moyenne de fruits à cidre a été conforme à la moyenne des dix dernières années.De fait,comparée à l'estimation préalable de l'USP effectuée en août 2004,la récolte a correspondu précisément aux attentes pour les pommes et avec un taux de précision de 97% pour les poires.Sur la base de ces estimations,Fruit-Union Suisse a pu une nouvelle fois renoncer à percevoir des retenues pour la mise en valeur des excédents.Si l’on considère un approvisionnement normal,les besoins indigènes en produits à base de jus de pommes et de poires sont couverts à raison de 147% pour les pommes à cidre et de 124% pour les poires à cidre.
La consommation de boissons non fermentées à base de jus de fruits a reflété la tendance actuelle et été conforme à la moyenne des deux dernières années,tandis que le déclin des boissons à base de jus de fruits fermentés ou partiellement fermentés s’est encore poursuivi.
1.1 ECONOMIE 1 38
■ Commerce extérieur: hausse des importations malgré les bonnes récoltes indigènes
Les importations de légumes frais et de fruits frais pouvant être cultivés en Suisse se sont élevées à 213'000 t et à 55'000 t respectivement,en hausse de 1% pour les légumes et de 16% pour les fruits par rapport à la moyenne des quatre dernières années.Ces importations provenaient de l’UE à raison de 85%,notamment d’Italie,de France,d’Espagne et des Pays-Bas.Les principaux pays fournisseurs non européens sont le Maroc pour les tomates,les Etats-Unis pour les asperges vertes,la NouvelleZélande pour les pommes et l’Afrique du Sud pour les poires.Les exportations ont atteint le même ordre de grandeur que les années précédentes,soit 180 t pour les légumes et 450 t pour les fruits,mais elles sont insignifiantes dans l’ensemble.
Les importations de vin de table,dont 136,0 millions de litres de vin rouge et 22,3 millions de litres de vin blanc,se sont élevées à 158,3 millions de litres.S’y sont encore ajoutés 12,4 millions de litres de mousseux,7,2 millions de litres de vins destinés à la transformation et 1,5 million de litres de vins dits liquoreux ou de spécialités.Par rapport à 2003,on observe toutefois une diminution de l’ordre de 5,7 millions et une augmentation de 2,4 millions de litres pour les importations de vins rouges et blancs respectivement.Quant aux importations de mousseux,elles sont restées stables.Les exportations de vins suisses en bouteille,en forte progression (+75%) par rapport à 2003,ont atteint 1,4 million de litres.
■ Consommation: en hausse pour les légumes et les fruits
La consommation par habitant de légumes frais s’est chiffrée à 72 kg,celle de fruits de table (sans les fruits tropicaux) à 25 kg,soit une hausse de 3 kg pour les légumes et de 2 kg pour les fruits par rapport à la moyenne des années 2000/03.
La consommation de vin rouge et de vin blanc (sans ceux destinés à la transformation) s’est élevée à 275,6 millions de litres.Pour autant,la consommation globale a continué de régresser (–2,2 millions de litres).Quant aux vins étrangers,si la consommation a diminué pour le vin rouge,elle a en revanche légèrement augmenté pour le vin blanc.Concernant les vins suisses,la consommation de vin blanc est demeurée stable tandis que celle de vin rouge a baissé d’environ 3 millions de litres.La part de marché détenue par les vins suisses a donc reculé et n’atteint plus que 39,7%,soit 0,5% de moins que l’année précédente.La consommation totale de vins,y compris ceux destinés à la transformation,s’est montée à 283 millions de litres,dont environ 69% de vins rouges.
■ Prix à la production: chiffre d’affaires record pour les légumes
Le chiffres d’affaires réalisé avec les légumes,d’un montant de 806 millions de francs, a battu tous les records,progressant de 5% par rapport à 2003 et de 17% comparé à la moyenne des quatre dernières années.Le prix moyen des légumes (emballé,franco grande distribution) s’est élevé à 2,52 fr./kg contre 2,59 fr./kg en 2003 et 2,39 fr./kg en moyenne des quatre dernières années.
1.1 ECONOMIE 1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE 39 1
Les récoltes de carottes connaissent parfois d’importantes fluctuations d’une année à l’autre.Mais considérée sur plusieurs années,l’offre a cependant tendance à augmenter. Cette tendance est encore plus perceptible pour les surfaces affectées à cette culture. Depuis neuf ans,celles-ci n’ont cessé d’augmenter chaque année de 40 ha en moyenne et ont atteint 1'400 ha en 2004.Le graphique montre comment les prix réagissent en fonction de l’offre:les prix baissent en présence de grandes quantités et montent quand l’offre est réduite.Au fil des années,on dénote toutefois une hausse des prix notamment imputable au fait que les prix à la production englobent toujours plus de prestations de services (lavage,portionnement,emballage,etc.).Les recettes elles aussi n’ont cessé de croître,parallèlement à l’augmentation de l’offre et des prix. Elles se sont chiffrées à 88 millions de fr.en 2004,les fluctuations des prix à la production ayant été reportées sur les prix à la consommation.La marge réalisée,c’est-à-dire l’écart entre le prix à la consommation et le prix franco grande distribution,est restée constante au cours des neuf dernières années.
 Prix de vente final Prix à la production
Prix de vente final Prix à la production
96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 Quantité offerte Saison Sources: CCM, OFAG 0 80 000 70 000 60 000 30 000 40 000 20 000 10 000 50 000 Quantité en t Prix en fr./kg 0 3.00 2.00 2.50 1.50 1.00 0.50 40 1.1 ECONOMIE 1
Carottes: offre et prix de la saison 1996/97 à la saison 2004/05
■ Prix à la consommation, marge brute:augmentation de la marge sur les fruits
Evolution des prix et des marges brutes de légumes choisis
L’amélioration significative de l’approvisionnement par rapport à 2003 a entraîné une baisse des prix des légumes.Le prix de revient des sept principaux légumes (tomates, choux-fleurs,carottes,chicorées,concombres,oignons et pommes de terre) a diminué de 12 ct.pour s’établir à 1,10 fr.le kilo (–10%).Le prix de vente final,en recul de 13 ct., s’est élevé à 2,64 fr.Pour la deuxième fois consécutive,la marge brute a donc légèrement régressé (–1 ct.) et a atteint 1,53 fr.le kilo en 2004.
Evolution des prix et des marges brutes de fruits choisis
En ce qui concerne les fruits,la fourchette de prix s’est par contre élargie.Le prix de revient moyen des sept fruits choisis (pommes,poires,abricots,cerises,nectarines, fraises et oranges) a baissé de 3 ct.(–1,1%) pour passer à 1,81 fr.le kilo,tandis que le prix de vente final augmentait de 11 ct.pour s’établir à 4,34 fr.le kilo.La marge brute s’est donc accrue de 14 ct.ou de 5,9% et a atteint 2,53 fr.le kilo.
19931994199519961997199819992000200120022004 2003 fr./kg Marge brute Source: OFAG 0 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 Prix de revientVente
19931994199519961997199819992000200120022004 2003 fr./kg Marge brute Source: OFAG 0 4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 1.50 2.00 0.50 1.00 Prix de revientVente
41 1.1 ECONOMIE 1 1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE
■ Deux systèmes d'indicateurs
1.1.3Situation économique du secteur agricole
Conformément à l’art.5 LAgr,les mesures de politique agricole ont pour objectif de permettre aux exploitations remplissant les critères de durabilité et de performance économique de réaliser,en moyenne pluriannuelle,un revenu comparable à celui de la population active dans les autres secteurs économiques d’une même région.
L’évaluation est réglée dans l'ordonnance sur l'évaluation de la durabilité (art.3 à 7) et se fait à l’aide de deux systèmes d’indicateurs.L’évaluation sectorielle repose sur les Comptes économiques de l’agriculture suisse (CEA),qui sont établis par l’OFS avec le soutien du secrétariat de l’USP (cf.ch.1.1.3).Quant à l'évaluation individuelle des exploitations,elle se fonde sur les résultats comptables du dépouillement centralisé effectué par Agroscope FAT Tänikon (cf.ch.1.1.4).
■ Revenu sectoriel 2004
En 2004,le revenu net des entreprises du secteur agricole s’est élevé à 3,218 milliards de francs;il a ainsi augmenté d’environ 8% par rapport à 2001/03.Cette augmentation s’explique principalement par l’accroissement de la production de 346 millions de francs (+3,4%).La rubrique des «autres subventions» (surtout paiements directs non liés à la production) a également enregistré une hausse de 79 millions de francs (+3%).
En comparaison de 2003,le revenu net des exploitations s’est accru de 432 millions de francs (+15,5%).Le revenu plus élevé du secteur en 2004 est notamment dû à la hausse de la production agricole (+478 mio.de fr.,soit +4,7%).Les rendements dans la production végétale notamment ont été bien plus élevés qu’en 2003,année marquée par une sécheresse prolongée en été.L’équilibre du marché dans le secteur du bétail de boucherie a,lui aussi,influé favorablement sur la production agricole en 2004.Les «autres subventions» ont augmenté de 57 millions de francs,soit de 2,1%. En ce qui concerne les coûts,ceux des consommations intermédiaires ont grimpé de 103 millions de francs (+1,7%) et ceux des amortissements de 17 millions (+0,9%), tandis que les dépenses pour les intérêts ont reculé de 17 millions (–5,3%).De manière générale,la hausse des coûts a été nettement plus faible que celle des recettes tirées de la production et des paiements directs.
■■■■■■■■■■■■■■■■
42 1.1 ECONOMIE 1
Résultats des comptes économiques de l'agriculture suisse
Indications en prix courants,en mio de fr.
dans la littérature et dans la méthodologie Eurostat
rapport à la banque de données de l’OFS en raison de l’arrondissement des chiffres sont possibles

1990/92 2001200220032004 1 2005 2 Production de la branche agricole13 87010 24310 38110 11410 5929 995 – Consommations intermédiaires6 6275 8206 0106 0916 1935 971 Valeur ajoutée brute aux prix de base7 2424 4244 3704 0244 3984 025 – Amortissements2 0151 9171 9251 9191 9361 973 Valeur ajoutée nette aux prix de base5 2282 5062 4462 1052 4622 052 – Autres impôts sur la production44328328335333332 + Autres subventions (non liées à la production)8782 6092 7092 6942 7502 712 Revenu des facteurs6 0624 7884 8264 4634 8794 432 – Rémunération des salariés1 2341 1381 1251 1511 1531 148 Excédent net d’exploitation / revenu de l’activité indépendante4 8283 6503 7023 3123 7263 285 – Fermages193202203200199199 – Intérêts dus553391393326309309 Revenu net d'entreprise4 0833 0573 1062 7863 2182 776
provisoires,état
septembre
désigné comme revenu
De légers écarts
Source:OFS 43 1.1 ECONOMIE 1
1Chiffres
au 9 septembre 2005 2Estimation,état au 9
2005 3est
net d’entreprise
par
■ Estimation du revenu sectoriel 2005
Autres subventions
Production du secteur agricole
Dépenses (consommations intermédiaires, autres impôts sur la production, consommation de capital fixe,rémunération des salariés, fermages, intérêts dus moins intérêts reçus) Revenu net des exploitations
La valeur de la production 2005 est estimée à 9,995 milliards de francs,ce qui correspond à une baisse de 3,5% par rapport à la moyenne triennale 2002/04.Ce chiffre s’explique par un recul des recettes aussi bien en culture des champs et qu’en production animale.
La production végétale (y compris l’horticulture) est estimée à 4,202 milliards de francs,en recul de 4,9% par rapport à la moyenne des trois dernières années.
En termes de qualité et avant tout de quantité,la récolte de céréales 2005 a été moins bonne que celle de l’an dernier.Notamment en ce qui concerne le blé,les poids à l’hectolitre ont atteint des valeurs basses,de sorte que certains lots ont été immédiatement déclassés.Les rendements d’orge ont également été inférieurs à ceux de 2004.En revanche,on s’attend à une récolte plus abondante de maïs en raison de l’extension des surfaces.Les prix indicatifs des céréales ont de nouveau été abaissés.La valeur de la récolte de céréales 2005 sera donc probablement inférieure de 6,3% à la moyenne triennale 2002/04.
Les premières analyses de betteraves permettent d’escompter une bonne récolte en termes de quantité.La teneur en sucre devrait égaler celle de l’an dernier.En 2005,les prix de base ont été réduits et la production de betteraves biologiques a été abandonnée.Le soutien du marché alloué par la Confédération sous la forme de contributions à la transformation des oléagineux a également diminué.Les prix de tous les oléagineux ont ainsi baissé.S’agissant du colza,les rendements ont par ailleurs été sensiblement inférieurs à ceux de 2003,tandis que la surface cultivée s’est accrue.Par rapport à 2004,la valeur de la production de colza a fortement reculé.Il en va de même de la surface affectée à la culture de soja.Dans l’ensemble,on estime que la valeur de la production de plantes industrielles sera de 6,5% inférieure aux valeurs moyennes des années 2002/04.
Evolution des Comptes économiques de l'agriculture 1990/922001200220032004 1 2005 2 Indications en prix courants, en mio. de fr.
Source: OFS 1 Chiffres provisoires, état 9.9.2005 2 Estimation, état 9.9.2005 0 12 000 14 000 16 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000
1.1 ECONOMIE 1 44
Tableaux 14–15,pages A14–A15
La récolte de plantes fourragères,quant à elle,devrait être bonne,voire très bonne, aussi bien en termes de qualité que de quantité.D’où des prix bien plus bas que l’année précédente.La valeur de la production de plantes fourragères devrait dès lors rester de 10,2% en-deça de la moyenne triennale 2002/04.
Dans le domaine des légumes,l’offre et la demande ont généralement été équilibrées, de sorte qu’il a été possible d’obtenir de bons prix.On peut une nouvelle fois s’attendre à une bonne récolte de légumes de garde,mais la quantité record de l’an dernier ne sera vraisemblablement pas atteinte.Dans l’ensemble,on escompte une valeur de la production comparable à celle de 2004.
Dans le secteur de l’horticulture productrice,la situation s’est sensiblement détériorée. Il est probable que les recettes diminueront tant en ce qui concerne les plants de pépinières que les cultures de fleurs.On s’attend à un recul de la valeur de la production de 6,5% par rapport à la moyenne des trois dernières années.
Comme les années précédentes,la surface affectée aux cultures de pommes de terre s’est rétrécie.Les rendements sont donc moins élevés qu’en 2004,mais la qualité est bonne.A prix égaux,la valeur de la récolte sera,selon les estimations,légèrement inférieure à celle de l’an passé,à savoir –2,3%,et de 7,2% inférieure à la moyenne des années 2002/04.
La récolte de fruits de cette année sera probablement bonne;elle devrait dépasser de 0,8% la moyenne triennale 2002/04.Les prix,par contre,seront sans doute plus bas et il faut donc s’attendre à une légère baisse de la valeur de la production par rapport à 2004.
La valeur de la production de vins se fonde,en partie du moins,sur les données des années précédentes (modification des stocks).L’écoulement des derniers stocks du millésime 2003,qui était d’une très grande qualité,marque encore les ventes de vin de 2005.Les prix sont donc plus élevés qu’il ne l’étaient entre 2002 et 2004 et l’on s’attend à ce que la valeur de la production augmente de 5,6%.Malgré de fortes chutes de grêle dans la région de Lavaux,la récolte de raisin 2005 devrait être à peine inférieure à celle de l’an dernier et le prix du raisin rester en moyenne stable.Selon les estimations,la valeur de la production dépassera de 6,4% la moyenne triennale 2002/04.

1.1 ECONOMIE 1 45 1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE
Dans le secteur de la production animale,on pronostique une diminution de 4,0% (4,843 milliards de fr.) par rapport à la moyenne des années 2002/04.Cette diminution devrait toucher aussi bien la production d’animaux de rente et de boucherie que la production laitière.Par rapport à 2004,le prix de la viande de bœuf est resté assez stable,mais le nombre des abattages a baissé.Les ventes d’animaux de rente peuvent être considérées comme bonnes.De même,l’exportation de bovins ne devrait pas souffrir de la réduction des contributions à l’exportation.L’augmentation des abattages de porcs a fait sensiblement baisser les prix à la production en comparaison de l’année précédente.La valeur de la production devrait dès lors reculer de 8% par rapport à la moyenne triennale 2002/04.La production indigène de volaille a reculé, alors que le volume des importations n’a guère varié par rapport à 2004.On estime donc que la valeur de la production sera légèrement au-dessous de la moyenne des trois dernières années.Dans le secteur des agneaux de boucherie,la production a chuté,mais les prix sont restés à peu près les mêmes qu’une année auparavant.Les prix des poulains sont soumis à une forte pression,étant donné que,depuis cette année,les abattoirs n’ont plus droit à un contingent d’importation lorsqu’ils achètent un poulain indigène.La valeur de la production laitière continue de baisser,à l’instar des prix à la production.Quant à la production et au prix des œufs,ils devraient demeurer stables.La récolte de miel enfin,fortement tributaire des conditions atmosphériques,sera inférieure à celle des années précédentes,selon les estimations.
En 2005,les prestations de services agricoles devraient augmenter de 8% par rapport à la moyenne des années 2002/04 et atteindre une valeur de 667 millions de francs.La hausse depuis 2004 sera toutefois faible.On estime que les recettes provenant de la location de contingents laitiers devraient se situer au niveau de l’an dernier.
La valeur des activités secondaires non agricoles non séparables augmentera probablement de 1,2% par rapport à la moyenne triennale 2002/04,pour s’élever à 284 millions de francs.Cette valeur dépend largement de la quantité de fruits à cidre transformés et des prestations fournies en dehors du secteur agricole,telles que l’entretien des bordures de routes et du paysage,la garde d’animaux en pension et les nuitées sur la paille.

46 1.1 ECONOMIE 1
Les dépenses liées aux consommations intermédiaires sont estimées cette année à 5,971 milliards de francs,ce qui correspond à une diminution de 2,1% par rapport à la moyenne des trois dernières années.Les dépenses relatives aux aliments pour animaux devraient être,dans l’ensemble,inférieures à celles des années précédentes. Cette baisse concerne aussi bien les aliments pour animaux produits et utilisés dans les exploitations (contrepartie au compte de production) que les aliments achetés.La baisse des prix des aliments composés devrait en effet excéder l’augmentation quantitative.Les coûts de l’énergie ont fortement augmenté ces dernières années,notamment en raison de la hausse du prix du pétrole,qui accroîtra probablement de 16% (35 millions de fr.) les dépenses pour les combustibles et les carburants par rapport à la moyenne triennale 2002/04.En outre,les coûts salariaux des autres secteurs économiques,en légère hausse,ont renchéri au cours des dernières années les prestations achetées telles que les consultations vétérinaires et la remise en état ainsi que les charges administratives.La diminution estimée des dépenses pour les consommations intermédiaires en 2005 est due presque uniquement à la baisse des dépenses liées aux aliments pour animaux.
En ce qui concerne la valeur ajoutée brute aux prix de base,on s’attend à une diminution de 5,6% par rapport à la moyenne des années 2002/04 (4,025 milliards de fr.).La baisse des dépenses pour les consommations intermédiaires ne suffit pas à compenser celle de la valeur de la production agricole.
Les amortissements sont estimés à 1,973 milliard de francs,ce qui correspond à une augmentation de 2,4% par rapport à la moyenne des trois années précédentes.Pour 2005,on s’attend certes à un recul aussi bien des investissements dans des biens non agricoles que des nouveaux investissements dans des équipements (véhicules et machines) et des bâtiments.Cependant,les amortissements dépendent en grande partie des investissements effectués les années précédentes et de l’évolution actuelle des prix.Or,ceux-ci ont augmenté tant en ce qui concerne les biens d’équipement que les bâtiments.
Par rapport à la moyenne triennale 2002/04,les autres impôts sur la production devraient rester inchangés.Alors que les autres taxes sur la production (taxes sur les véhicules à moteur et droits de timbre) devraient augmenter,la sous-compensation de la TVA (qui dépend des dépenses pour les consommations intermédiaires et les investissements) diminuera probablement.
Les autres subventions comprennent tous les paiements directs,les intérêts calculés pour des prêts publics sans intérêts (crédits d’investissements,aide aux exploitations paysannes) et les autres contributions allouées par les cantons et les communes.Par contre,elles n’incluent pas les subventions de produits,qui sont prises en compte dans la valeur de la production aux prix de base (p.ex.supplément pour le lait transformé en fromage) ni les transferts de fortune (p.ex.crédits d’investissements pour des améliorations structurelles),qui sont comptabilisés dans le compte de capital.En plus,les autres subventions comprennent la surcompensation de la TVA,estimée pour cette année à 155 millions de francs.D’un montant estimé à 2,712 milliards de francs (2,557 milliards de fr.,sans la surcompensation de la TVA),les autres subventions 2005 devraient être de 0,2% inférieures à la moyenne triennale 2002/04.La différence,à la charge de l’agriculture,entre la surcompensation et la sous-compensation de la TVA, s’élève à 115 millions de francs en 2005 (hausse de 6,6% par rapport à la moyenne des années 2002/04).
1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE 47 1.1 ECONOMIE 1
La rémunération des salariés (= frais de main-d’œuvre) est estimée à 1,148 milliard de francs,ce qui correspond à une augmentation de 0,4% par rapport à la moyenne des trois années précédentes.Le recul de la main-d’œuvre employée dans l’agriculture (–2,3%,exprimée en unités de travail annuel) est plus que compensé par la hausse des coûts salariaux (y compris cotisations sociales payées par les employeurs).
Pour le poste fermages,on s'attend à une diminution de 0,7% par rapport à la moyenne triennale 2002/04 (199 millions de fr.).Quant aux intérêts à payer, ils devraient être de 9,7% inférieurs à la moyenne des trois dernières années (309 millions de fr.),ce qui s’explique principalement par la baisse des taux hypothécaires.On escompte toutefois aussi un léger recul de la part que représentent les crédits à court terme coûteux dans la totalité du capital étranger.
Le revenu net des exploitations devrait s’établir à 2,776 milliards de francs et donc accuser une baisse de 8,6% par rapport à la moyenne triennale 2002/04.Il devrait correspondre environ à celui de 2003,année marquée par la sécheresse.
48 1.1 ECONOMIE 1
1.1.4Situation économique des exploitations
L’appréciation de la situation économique des exploitations se fonde sur les résultats du dépouillement centralisé des données comptables effectué par Agroscope FAT Tänikon.En plus des diverses données concernant le revenu,des indicateurs relatifs à la stabilité financière ou à la rentabilité,par exemple,fournissent de précieux renseignements.Ces indicateurs sont mentionnés en annexe et étudiés plus en détail ciaprès.

■■■■■■■■■■■■■■■■
Définitions et méthodes,page A64 49 1.1 ECONOMIE 1
■ Revenu 2004 meilleur que la moyenne 2001/03
Tableaux 16–25,pages A16–A26
Revenu et paramètres d’économie d’entreprise
Evolution du revenu des exploitations agricoles: moyenne de toutes les régions
En 2004,les résultats économiques ont été,en moyenne,meilleurs que durant les années 2001/03;le rendement brut de la production agricole a en effet augmenté de 9%.Dans la production végétale,les recettes ont augmenté de 11%,ce qui s’explique essentiellement par les rendements élevés des grandes cultures,une production élevée de fourrages grossiers et les bons prix obtenus pour les fruits.En économie animale,les recettes se sont accrues de 4%.La baisse du prix du lait de 5 centimes a pu être compensée par une augmentation des prix sur le marché du bétail de rente et de boucherie.Ainsi,les recettes ont augmenté légèrement dans la production porcine et fortement dans la production de volaille,avant tout en raison de l’accroissement des effectifs.Une réévaluation à la hausse du bétail bovin a influé positivement sur les résultats.Les paiements directs par exploitation ont augmenté en moyenne de 5% par rapport aux trois dernières années.Cette augmentation est la conséquence d’une participation croissante aux programmes écologiques et éthologiques tels que SST (systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux),SRPA (sorties régulières en plein air) et promotion régionale de la qualité,et de la mise en réseau de surfaces de compensation écologique.
En 2004,les charges réelles se sont accrues en moyenne de 8% par rapport aux années 2001/03.L’augmentation des coûts d’un contingent laitier acheté ou loué a un rapport direct avec les rendements plus élevés obtenus dans ce secteur.Malgré la hausse des dettes hypothécaires,des économies substantielles ont pu être réalisées au niveau du service de la dette en raison de la baisse des taux d’intérêt.
1990/92 2004 2001 2002 2003 fr. par exploitation Revenu extra-agricole Revenu agricole Source: Agroscope FAT Tänikon 0 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 16 264 62 822 1,39 UTAF
21 557 60 472 1,25 18 633 52 434 1,29 18 577 51 500 1,28 21 210 55 029 1,24 50 1.1 ECONOMIE 1
Unités de travail annuel de la famille
Le revenu agricole correspond à la différence entre le rendement brut et les charges réelles.En 2004,il a dépassé de 10% le niveau atteint une année auparavant et de 14% le niveau moyen des années 2001/03.Le revenu agricole indemnise en moyenne le travail de 1,25 unité de main-d’œuvre familiale ainsi que les fonds propres investis dans l’exploitation,qui s’élèvent en moyenne à quelque 400’000 francs.
Par rapport aux années 2001/03,le revenu agricole a augmenté dans toutes les régions;c’est la région de plaine qui a connu la plus forte augmentation (+15%), suivie de la région de montagne (+14%) et de la région des collines (+13%).Le revenu extra-agricole,lui aussi,est partout en hausse,de 13% dans la région de plaine,de 10% dans la région de montagne et de 8% dans la région des collines.Ainsi,le revenu total a augmenté le plus fortement dans la région de plaine (+14%),suivie de la région de montagne (+13%) puis de celle des collines (+12%).
En 2004,la part des paiements directs au rendement brut a atteint 16% dans les exploitations de plaine,24% dans celles de la région des collines et 38% en montagne.Elle a ainsi diminué dans toutes les régions,la plus forte diminution étant enregistrée dans la région de montagne.
Revenu des exploitations agricoles,selon les régions Revenu,selon les régionsUnité1990/9220012002200320042001/03–2004 % Région de plaine Surface agricole utileha16,6619,9320,6819,7920,07–0,3 Main-d’œuvre familialeUTAF1,361,261,251,191,21–1,9 Revenu agricolefr.73 79462 45363 40264 12972 61514,7 Revenu extra-agricolefr.16 42917 04316 74320 64220 53213,2 Revenu totalfr.90 22379 49680 14584 77193 14614,3 Région des collines Surface agricole utileha15,3017,9518,0918,4818,521,9 Main-d’œuvre familialeUTAF1,401,261,241,261,23–1,9 Revenu agricolefr.59 83847 49646 25751 44254 74213,1 Revenu extra-agricolefr.14 54420 55719 36921 67122 1678,0 Revenu totalfr.74 38268 05365 62673 11476 90911,6 Région de montagne Surface agricole utileha15,7618,8518,5518,6018,63–0,2 Main-d’œuvre familialeUTAF1,421,381,351,311,33–1,2 Revenu agricolefr.45 54140 13537 51243 92146 10913,8 Revenu extra-agricolefr.17 85319 41420 74821 66222 6459,9 Revenu totalfr.63 39459 54958 26065 58368 75412,5 Source:Agroscope FAT Tänikon
1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE 51 1.1 ECONOMIE 1
Tableaux 16–19,pages A16–A19
En termes de revenu,la situation laisse toutefois apparaître des écarts significatifs entre les 11 types d’exploitation (branches de production).
agricoles,selon le type,2002/04
Si l’on considère la moyenne des années 2002/04,ce sont les exploitations pratiquant les cultures spéciales,les grandes cultures et la transformation,de même que certaines exploitations combinées (transformation,lait commercialisé/grandes cultures) qui ont réalisé le revenu agricole le plus élevé.
Prises avec les exploitations «combinaison vaches mères»,celles-ci ont réalisé le revenu total le plus élevé.Inversement,les exploitations ayant enregistré le revenu agricole et le revenu total le plus bas appartiennent aux types «autre bétail bovin» et «chevaux/moutons/chèvres».Les exploitations spécialisées «lait commercialisé» figurent entre les deux.Dans toutes les catégories de revenu,leurs résultats sont inférieurs à la moyenne.
Type d’exploitationSurface Main-d’œuvre RevenuRevenuRevenu agricole utilefamilialeagricoleextra-agricoletotal haUTAFfr.fr.fr. Moyenne de toutes les exploitations19,241,2655 66720 44876 115 Grandes cultures23,021,0568 90724 52393 430 Cultures spéciales13,051,2769 19120 36189 552 Lait commercialisé19,111,3250 97418 39569 369 Vaches mères18,231,1043 18631 48974 674 Autre bétail bovin16,391,2535 13523 20058 335 Chevaux/moutons/chèvres12,051,1219 57239 86259 435 Transformation11,451,2167 82220 35488 177 Combinaison lait commercialisé/ grandes cultures25,651,2968 99114 29383 284 Combinaison vaches mères21,721,0851 40333 23684 639 Combinaison transformation19,531,2772 14116 14988 290 Combinaison autres20,911,2555 99720 29076 288 Source:Agroscope FAT Tänikon
Revenu des exploitations
52 1.1 ECONOMIE 1
Tableaux 20a–20b,pages A20–A21
Le revenu du travail des exploitations agricoles (revenu agricole après déduction des intérêts calculés sur les fonds propres investis dans l’exploitation) indemnise la maind’œuvre familiale non salariée.Par rapport à la moyenne triennale 2001/03,le revenu du travail (médiane) par unité de main-d’œuvre familiale s’est amélioré de 25% en 2004 et de 10% par rapport à 2003.L’augmentation est due principalement à la baisse des taux d’intérêt et,par conséquent,à la forte diminution des intérêts sur les fonds propres.
Autre constat,ce revenu varie fortement d’une région à l’autre.En moyenne,il est toutefois sensiblement plus élevé en région de plaine qu’en région de montagne.Les écarts entre les quartiles sont eux aussi importants.Ainsi,pour la période 2002/04,le revenu du travail par unité de main-d’œuvre familiale du premier quartile a atteint 24% dans la région de plaine et celui du quatrième quartile 197% de la moyenne de toutes les exploitations de la région.Les écarts sont similaires dans la région des collines et encore plus marqués dans la région de montagne.
Revenu du travail des exploitations agricoles 2002/04, selon les régions et les quartiles

Revenu du travail 1 en fr.par UTAF 2
1Intérêts sur les fonds propres au taux moyen des obligations de la Confédération: 2002:3,22%;2003:2,63%,2004:2,73%
2Unités de travail annuel de la famille:base 280 journées de travail
Source:Agroscope FAT Tänikon
MédianeValeurs moyennes Région1er quartile2e quartile3e quartile4e quartile (0–25%)(25–50%)(50–75%)(75–100%) Région de plaine42 204 10 800 33 884 50 579 87 101 Région des collines30 322 6 101 23 948 37 251 63 747 Région de montagne22 849 1 840 17 659 29 086 52 048
Tableaux 21–24,pages A22–A25
53 1.1 ECONOMIE 1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE 1
■ Revenu du travail en 2004
■ Stabilité financière
Dans la région de plaine,le quatrième quartile des exploitations agricoles a nettement dépassé la valeur du salaire brut annuel correspondant du reste de la population durant la période 2002/04.Dans la région des collines par contre,le quatrième quartile a à peine dépassé le salaire comparatif et dans la région de montagne,il a été au-dessous de la valeur comparative (–5’000 fr.environ).Par rapport à la période 2001/03,ce sont avant tout les régions de plaine et de montagne qui ont amélioré leur situation relative.
Salaire comparatif 2002/04,selon les régions
RégionSalaire comparatif 1 en fr.par année
Région de plaine67 623
Région des collines62 459
Région de montagne56 823
1Médiane des salaires annuels bruts de toutes les personnes employées dans les secteurs secondaire et tertiaire
Sources:OFS,Agroscope FAT Tänikon
Il y a lieu de noter que le train de vie des ménages agricoles n’est pas uniquement assuré par le revenu du travail.Leur revenu total,y compris le revenu extra-agricole,est sensiblement plus élevé que le revenu du travail.
La part des capitaux étrangers au capital total (ratio d’endettement) renseigne sur le financement externe d’une exploitation.Considéré parallèlement à la formation des fonds propres,ce paramètre permet de juger si les dettes d’une exploitation sont supportables.Une exploitation dont le ratio d’endettement est élevé et la formation de fonds propres négative n’est pas viable long terme.
Compte tenu de ces critères,les exploitations sont réparties en quatre groupes,selon leur stabilité financière.
Répartition des exploitations en quatre groupes,compte tenu de leur stabilité financière
Exploitations avec … ratio d’endettement faible (<50%)élevé (>50%) formation de fonds positive...situation financière...autonomie financière propres sainerestreinte négative...revenu insuffisant ...situation financière précaire
Source:De Rosa
54 1.1 ECONOMIE 1
L’appréciation de la stabilité financière des exploitations montre une situation similaire dans les trois régions;44% des exploitations connaissent une situation financière saine,alors que celle-ci doit être qualifiée de problématique pour 34% d’entre elles (formation négative de capital propre).La moyenne triennale 2002/04 affiche donc dans toutes les régions une légère amélioration par rapport à 2001/03.
Appréciation de la stabilité financière 2002/04 selon les régions

Région de plaineRégion des collinesRégion de montagne part des exploitations en % Situation financière précaire Revenu insuffisant Autonomie financière restreinte Situation financière saine Source: Agroscope FAT Tänikon 0 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 17 18 22 44 17 16 24 43 15 19 20 46 55 1.1 ECONOMIE 1
■ Formation de fonds propres,investissements et ratio d’endettement
Comparé à 2001/03,les investissements des exploitations de référence FAT ont augmenté de 11% en 2004.La marge brute d’auto-financement (cash-flow) s’est également accrue de 11%,maintenant ainsi le rapport entre le cash-flow et les investissements pratiquement inchangé.Quant à la formation de fonds propres (revenu total,déduction faite de la consommation privée),elle est nettement meilleure (+70%) que durant la période de référence,alors que le ratio d’endettement est moins bon (+5%).Cela s’explique par le fait que les crédits d’investissements et les crédits hypothécaires ont augmenté plus fortement que le capital propre.
Evolution de la formation de fonds propres,des investissements et du ratio d’endettement
1 Investissements bruts (sans prestations propres),moins les subventions et les désinvestissements
2 Rapport entre cash-flow (formation de fonds propres plus amortissements,plus/moins les variations des stocks et du cheptel) et investissements
FAT Tänikon
Paramètre1990/9220012002200320042001/03–2004 % Formation de fonds propresfr.19 5137 2886 84013 34315 59070,3 Investissements 1 fr.46 91447 46943 69547 58051 26110,8 Rapport entre cash-flow et investissements 2 %95839495910,4 Ratio d’endettement %43414143444,8
Source:Agroscope
56 1.1 ECONOMIE 1
1.2 Aspects sociaux
Les aspects sociaux sont l’un des trois piliers de la durabilité;il est donc naturel que le rapport sur les répercussions des mesures de politique agricole leur accorde une place à part.Le chapitre sur les aspects sociaux dans l’agriculture est consacré,d’une part, au revenu et à la consommation des ménages agricoles et,d’autre part,aux relevés périodiques des cinq thématiques sociales prioritaires suivantes:

– recours aux prestations sociales;
– travail et formation;
– santé;
– revenu et consommation;
– qualité de vie.
Les relevés périodiques des cinq thématiques sont réalisés tous les quatre à cinq ans. Par ailleurs,on examine certains aspects sociaux à l’aide d’études de cas,dont les résultats sont ensuite traités dans le chapitre sur les aspects sociaux.
Le présent rapport agricole commente les données relatives au revenu et à la consommation des ménages agricoles,découlant du dépouillement centralisé des données comptables d’Agroscope FAT Tänikon.S’agissant des cinq thématiques précitées,il traite les résultats d’une enquête sur la qualité de vie de la population agricole en comparaison au reste de la population.
■■■■■■■■■■■■■■■■
1.2 ASPECTS SOCIAUX 1 57
■ Revenu total et consommation privée
Revenu et consommation
Le revenu et la consommation sont des paramètres importants permettant d’appréhender la situation sociale des familles d’agriculteurs.En ce qui concerne la dimension économique de la durabilité,le revenu intéresse surtout en tant qu’indicateur de la performance des exploitations.Pour la dimension sociale,le revenu des ménages agricoles est le paramètre essentiel.C’est d’ailleurs pour cette raison que le revenu non agricole des familles paysannes est pris en compte dans l’analyse.Celle-ci porte sur l’évolution aussi bien du revenu total que de la consommation privée.
En moyenne des années 2002 à 2004,le revenu total,qui se compose du revenu agricole et du revenu extra-agricole,se situait entre 64'200 francs et 86'000 francs par exploitation,selon les régions.Les exploitations de montagne ont réalisé environ 75% du revenu total de celles de plaine.Atteignant en moyenne 19'300 à 21'700 francs,le revenu extra-agricole est une source de revenu supplémentaire non négligeable des familles paysannes.Il représente 22% du revenu total dans les exploitations de plaine, 29% dans celles de la région des collines et 34% en montagne,où il est aussi le plus élevé en valeur absolue (21'700 francs).
Revenu total et consommation privée par exploitation selon les régions 2002/04
Source: dépouillement centralisé, Agroscope FAT Tänikon
La formation de capital propre,à savoir la part non consommée du revenu total,a représenté environ 15% du revenu total dans toutes les régions.La consommation privée est supérieure au revenu agricole.Comme le revenu total,elle est,en chiffres absolus,la plus élevée dans la région de plaine et la plus basse dans celle de montagne.
En 2004,le revenu total moyen par exploitation,d’environ 82'000 francs,a dépassé celui des années 2001/03,où il se situait à 72'500 francs.La consommation privée par exploitation a elle aussi progressé d’environ 3'100 francs par rapport à la période précitée,pour s’établir à 66'400 francs.
en
Consommation privée Revenu
Revenu agricole
Région de plaineRégion des collinesRégion de montagne
fr.
extra-agricole
0 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 1.2 ASPECTS SOCIAUX 1 58
Revenu total et consommation privée par unité de consommation, ventilés par quartile 1 2002/04
1er quartile2e quartile3e quartile4e quartileEnsemble des exploitations
à
Source:dépouillement centralisé,Agroscope FAT Tänikon

Les exploitations du premier quartile ont atteint 43% du revenu total par unité de consommation de celles du quatrième quartile.En ce qui concerne la consommation privée,la différence entre ces deux quartiles était nettement plus faible:en effet,la consommation des exploitations du premier quartile a représenté 68% de celle des exploitations du quatrième quartile.
Dans la période 2002/04,le revenu total par unité de consommation des familles dont l’exploitation fait partie du premier quartile n’a pas suffi à couvrir leur consommation. Ces exploitations ont donc dû puiser dans les moyens financiers destinés à des investissements de remplacement,à de nouveaux investissements ou à la prévoyance vieillesse.La formation de capital de ces exploitations est dès lors négative.Si elles continuent de ronger le capital pendant longtemps,elles devront tôt ou tard cesser leur activité.En revanche,les dépenses privées ont été inférieures au revenu total pour ce qui est des exploitations classées dans les autres quartiles.Dans les exploitations du deuxième quartile,elles correspondaient à 92% du revenu total,à 83% dans celles du troisième et à 69% dans celles du quatrième quartile.
En 2004,le revenu total par unité de consommation a nettement dépassé celui des trois années précédentes 2001/03 dans tous les quartiles.De même,la consommation privée s’est légèrement accrue,dans tous les quartiles,par rapport à la moyenne des années 2001/03.
Revenu total par UC 2 (fr.)13 93217 71622 43732 64121 602 Consommation privée par UC (fr.)15 45316 31918 66722 60118 219
1 Quartiles selon le revenu du travail par unité de travail annuel de la famille
2 Unité de consommation = membre de la famille,âgé de 16 ans ou plus,participant toute l’année
la consommation de la famille
1.2 ASPECTS SOCIAUX 1 59
■ Qualité de vie:concept
Enquête sur la qualité de vie
Les conséquences de l’activité professionnelle agricole sur la qualité de vie sont une des cinq thématiques sociales prioritaires faisant l’objet d’un relevé périodique représentatif.
En 1999,l’OFAG avait chargé l’Institut d'économie rurale (IER) de l’EPF Zurich de développer les bases du rapport sur la situation sociale de l’agriculture suisse.Le concept de la qualité de vie était l’élément-clé de l’étude de l’EPF:la qualité de vie est élevée si,en fonction des objectifs définis et du taux d’atteinte des objectifs,une personne donne une appréciation subjective favorable de ses conditions ou des sphères de la vie objectivement mesurables.
Au printemps 2001,gfs-zürich a,sur mandat de l’OFAG,procédé à une enquête téléphonique sur la satisfaction dans différentes sphères de la vie,la situation financière à venir,les aspects positifs et négatifs de la profession d’agriculteur ainsi que sur le niveau d’insécurité.Les résultats,publiés dans le Rapport agricole 2001,sont disponibles sous www.blw.admin.ch/agrarberichte/.
■ Enquête au printemps 2005
En 2005,l’OFAG a fait répéter la même enquête,à un point près,en vue d’une comparaison des résultats avec ceux de 2001.Il s’agissait de nouveau de comparer la situation des paysannes et des paysans avec celle d’autres groupes de la population (groupe de référence) vivant soit en agglomération,soit dans une commune rurale. Dans cette enquête,l’appréciation de l’importance des différentes sphères est venue s’ajouter au degré de satisfaction.A l’aide de ces indications,on a ensuite calculé un indice:en combinant l’appréciation de la satisfaction dans les différentes sphères de la vie avec l’importance qui leur est accordée,il est en effet possible de calculer un indice subjectif de la qualité de la vie.L’étude précitée de l’EPF a servi de base conceptuelle au calcul de cet indice.
Outre le degré de satisfaction et l’importance accordée aux 12 sphères de la vie (travail rémunéré,formation,perfectionnement,revenu,niveau de vie général,famille, contexte social,stabilité des conditions générales,loisirs,santé,temps disponible,offre culturelle),ont été relevées les appréciations concernant la situation future du revenu, les aspects positifs ou négatifs de la profession d’agriculteur,les craintes ou le sentiment d’insécurité personnelle (niveau d’insécurité).Les réponses possibles étaient définies d’avance,à l’exception de celles concernant les aspects positifs ou négatifs inhérents à la profession d’agriculteur.Comme le groupe de référence ne pouvait logiquement pas donner d’appréciation personnelle dans ce dernier cas,il lui était demandé d’indiquer comment il perçoit la profession d’agriculteur.
1.2 ASPECTS SOCIAUX 1 60
gfs-zürich a réalisé l’enquête entre mi-février et début mars 2005.S’agissant de la population agricole,un échantillon représentatif a été sélectionné à partir de la liste des exploitations ayant droit aux paiements directs,lequel comprenait 261 agriculteurs et 245 paysannes.Quant au groupe de référence,on a également établi,à partir d'un échantillon tiré de façon aléatoire de l'annuaire téléphonique électronique,des quotas représentatifs de 256 hommes et 257 femmes,en fonction de la région,de l'activité professionnelle et de la classe d'âge.
Etant donné que les résultats ne diffèrent guère entre les sexes,les figures ne présentent que les deux groupes,agriculture et référence.
Les réponses à la question de la satisfaction dans les 12 sphères de la vie proposées font ressortir que la population agricole,comme le reste de la population d’ailleurs, trouve la plus grande satisfaction dans les domaines de la famille et de la santé (satisfaction élevée = moyenne basse).Les conditions générales politiques et économiques suscitent,dans les deux groupes,la plus grande insatisfaction.C’est principalement en ce qui concerne le temps disponible et les loisirs que la population agricole est beaucoup moins satisfaite que le groupe de référence.

Satisfaction en baisse dans l’agriculture Satisfaction dans différentes sphères de la vie Famille Activité professionnelle Contexte social Niveau de vie général Perfectionnement Formation Santé Valeurs moyennes 0 1 2 3 Source: gfs-zürich Valeurs moyennes, échelle de 1 = très satisfait à 5 = très insatisfait Loisirs Offre culturelle Revenu Temps disponible Stabilité des conditions-cadre pol./écon. Agriculture Référence 1,4 1,5 1,7 1,7 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0 2,1 2,1 2,2 2,3 2,3 2,5 2,6 2,7 2,7 2,3 1,8 1,8 1.2 ASPECTS SOCIAUX 1 1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE 61
■
Dans l’ensemble,le degré de satisfaction de la population agricole appelée à participer à l’étude s’est amélioré au cours des quatre dernières années;cette amélioration est particulièrement marquée pour ce qui est du revenu et de la stabilité des conditions générales politiques et économiques.S’agissant du revenu,ce n’est pas étonnant,car les chiffres comptables confirment cette appréciation.

Evolution de la satisfaction dans la population agricole
La population agricole est également plus satisfaite qu’en 2001 pour ce qui est des loisirs et du temps disponible,mais son degré de satisfaction sur ces deux points reste néanmoins,comme il y a quatre ans,nettement plus faible que celui des autres groupes de la population.Ainsi,en 2001,la moyenne relevée pour les loisirs se situait à 2,6 et à 2,0 respectivement,et à 2,9 et 2,4 respectivement en ce qui concerne le temps disponible.En 2001,les plus grandes différences étaient apparues dans l’appréciation du revenu et des conditions-cadre politiques et économiques (les deux fois agriculture:3,1;référence:2,4).
Dans les autres domaines – famille,santé,travail,contexte social,formation,niveau de vie général,perfectionnement ou offre culturelle –,le degré de satisfaction de l’agriculture n’a changé que de 0,1 point par rapport à 2001.
Revenu Temps disponible Loisirs Perfectionnement Niveau de vie général Offre culturelle Stabilité des conditions-cadre pol./écon. Valeurs moyennes 0 1 2 3 4
Valeurs moyennes, échelle de 1 = très satisfait à 5 = très insatisfait Formation Contexte social Activité professionnelle Santé Famille 2005 2001 2,5 3,1 2,7 3,1 2,6 2,9 2,3 2,3 2,0 2,2 2,0 2,0 1,9 1,8 2,0 1,9 1,9 1,8 1,7 1,4 1,5 1,9 2,6 2,1 1.2 ASPECTS SOCIAUX 1 62
Source: gfs-zürich
■ Santé et famille au premier plan
En 2005,la population de référence est moins satisfaite des conditions-cadre politiques et économiques (0,3 points) et de l’offre culturelle (0,2),en revanche plus satisfaite du temps disponible (0,3).Dans les neuf autres domaines,l’évaluation de la satisfaction est soit demeurée la même qu’il y a quatre ans,soit elle n’a varié que de 0,1 point.
L’importance des 12 sphères de la vie a pour la première fois été évaluée au printemps 2005.Les priorités ont été très semblables dans les deux groupes,la santé et la famille étant au premier rang.
Importance des différentes sphères de la vie
Les deux groupes accordent le moins d’importance à l’offre culturelle,mais cet avis est plus prononcé dans le groupe agricole que dans l’autre.Il en va de même du niveau de vie et des loisirs.En effet,la population agricole est habituée à faire des concessions dans ces domaines et y attache donc moins d’importance.En revanche,la stabilité des conditions-cadre politiques et économiques lui paraît plus importante qu’au groupe de référence.
Santé Formation Activité professionnelle Revenu Temps disponible Contexte social Famille Valeurs moyennes 0 1 2 3 Source: gfs-zürich Valeurs moyennes, échelle de 1 = très important à 5 = sans aucune importance Perfectionnement Stabilité des conditions-cadre pol./écon. Loisirs Niveau de vie général Offre culturelle Agriculture Référence 1,1 1,2 1,2 1,3 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 1,7 2,1 2,1 1,8 1,8 1,9 2,2 2,3 2,7 2,5 1,9 1,7 1,7 1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE 1.2 ASPECTS SOCIAUX 1 63
Pour illustrer l’appréciation subjective de la qualité de la vie,la méthode appliquée dans l’étude précitée de l’EPF consiste à mettre en rapport les avis concernant l’importance des sphères choisies avec le degré de satisfaction,et de présenter ce rapport sous la forme d’un indice.A cette fin,les échelles d’appréciation ont été modifiées;elle s’étendent de 0,2 à 1 («sans aucune importance» à «très important») et de –3 à +3 («très insatisfait» à «très satisfait»).On obtient l’indice de la qualité de la vie en multipliant tout d’abord,pour chaque sphère,le facteur de l’importance par celui de la satisfaction,et en additionnant ensuite les 12 produits.Vu les échelles appliquées,l’indice peut avoir des valeurs entre –36 et +36.
Calcul de l’indice de la qualité de la vie
Echelle modifiée ImportanceEchelle modifiée Satisfaction sans aucune importance 0,2très insatisfait–3 sans importance0,4insatisfait–1,5 indéterminé0,6indéterminé0 important0,8satisfait+1,5 très important1très satisfait+3
L’indice de la qualité de la vie correspond à la somme des produits calculés pour les 12 sphères de la vie.On l’obtient en multipliant tout d’abord,pour chaque sphère,le facteur de l’importance par celui de la satisfaction,et en additionnant ensuite les 12 produits. L’indice s’élève à 36 points,lorsque les 12 sphères sont qualifiées de «très important» et «très satisfait » ou,à l’inverse,à –36 points lorsqu’elles sont qualifiées de «très important» et «très insatisfait».Si l’appréciation de la satisfaction est «indéterminé» dans les 12 sphères, il en résulte un indice 0.
En moyenne,l’indice de la qualité de la vie atteint 14,6 en ce qui concerne la population agricole.La majorité des indices de ce groupe se situent entre 8 et 18.De manière générale,ils sont légèrement plus élevés pour les femmes.Dix personnes vivant dans une exploitation agricole ont même un indice négatif,c’est-à-dire qu’elles sont insatisfaites de leur situation.
Alors que nous n’avons présenté que des moyennes dans les figures précédentes,les deux graphiques ci-après reflètent la dispersion des réponses.
1.2 ASPECTS SOCIAUX 1 64
■ Indice de la qualité de la vie plus bas dans l’agriculture
Indice de la qualité de la vie de la population agricole moyenne 14,6
Nombre de mentions
Source: gfs-zürich
Avec une moyenne de 16,5,l’indice du groupe de référence est,dans l’ensemble,plus élevé que celui de la population agricole.Trois personnes seulement sont très insatisfaites dans les 12 sphères de la vie.
Indice de la qualité de la vie de la population de référence moyenne 16,5
Nombre de mentions
gfs-zürich

< 0 < 0 et ≤ 2 < 2 et ≤ 4 < 4 et ≤ 6 < 6 et ≤ 8 < 8 et ≤ 10 < 10 et ≤ 12 < 12 et ≤ 14 < 14 et ≤ 16 < 16 et ≤ 18 < 18 et ≤ 20 < 20 et ≤ 22 < 22 et ≤ 24 < 24 et ≤ 26 < 26 et ≤ 28 < 28 et ≤ 30 < 30 et ≤ 32 < 32 et ≤ 34 < 34 et ≤ 36 en %
0 4 2 6 8 10 12 14
< 0 < 0 et ≤ 2 < 2 et ≤ 4 < 4 et ≤ 6 < 6 et ≤ 8 < 8 et ≤ 10 < 10 et ≤ 12 < 12 et ≤ 14 < 14 et ≤ 16 < 16 et ≤ 18 < 18 et ≤ 20 < 20 et ≤ 22 < 22 et ≤ 24 < 24 et ≤ 26 < 26 et ≤ 28 < 28 et ≤
< 30 et ≤
<
et ≤
<
et ≤
en %
30
32
32
34
34
36
0 4 2 6 8 10 12 14
Source:
1.2 ASPECTS SOCIAUX 1 1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE 65
■ L’agriculture s’attend à une aggravation de sa situation financière
Après avoir traité l’indice de la qualité de la vie,soit la satisfaction dans les 12 sphères de la vie et l’importance qui leur est accordée,nous abordons maintenant la situation financière à venir,les aspects positifs ou négatifs de la profession d’agriculteur et les réponses aux 25 questions concernant les craintes et le sentiment d’insécurité.
En 2005,l’agriculture demeure plus pessimiste en ce qui concerne sa situation financière à venir que le groupe de référence.
Possibilité de faire des économies dans les trois années à venir
Environ un tiers des personnes interrogées du groupe agricole pense pouvoir épargner plutôt moins dans les trois prochaines années,alors qu’un quart seulement du groupe de référence partage cet avis.A l’instar de la satisfaction accrue en matière de revenu, la population agricole apprécie néanmoins son avenir financier plus favorablement qu’il y a quatre ans.Les différences entre les deux groupes se sont amenuisées depuis 2001,notamment parce que la population non agricole est devenue plus pessimiste.
Evolution de la situation financière dans les 12 prochains mois
plutôt davantage plutôt moins ne sais pas / pas de réponse à peu près autant 0 20 10 30 40 50 Source: gfs-zürich Agriculture Référence 12 (9) 23 (18) 45 (38) 47 (56) 32 (32) 24 (12) 12 (21) 7 (14) en %, entre parenthèses
valeurs 2001
amélioration détérioration ne sait pas / pas de réponse statu quo 0 30 20 10 40 60 50 70 Source: gfs-zürich Agriculture Référence 8 (9) 20 (23) 65(48) 63 (61) 20 (26) 12 (9) 8 (17) 5 (7)
%, entre parenthèses valeurs
1.2 ASPECTS SOCIAUX 1 66
en
2001
■ Avantages et inconvénients de la profession d’agriculteur
Comme le groupe de référence,un peu plus de 60% de la population agricole estiment que leur situation financière ne devrait pas changer dans les 12 mois à venir.La majorité des autres s’attend toujours à une aggravation,mais la proportion s’est améliorée en comparaison de l’autre groupe:alors qu’en 2001,la population agricole pronostiquait encore trois fois plus souvent une aggravation de sa situation financière (agriculture: 26%;référence:9%),ce ratio est inférieur au double aujourd’hui.
L’indépendance et le travail dans la nature sont les aspects particulièrement positifs de la profession d’agriculteur que relèvent les deux groupes.
Appréciation des avantages de la profession d'agriculteur
Indépendance, libre gestion du temps, être son propre chef

Travail
avec
Etre avec
enfants Entretien du paysage Autres arguments concernant le mode de travail Produits de l'exploitation, autosuffisance Travail dans la nature, proximité de la nature en %, entre parenthèse valeurs 2001 0 20 40 60 80 10 30 50 70
gfs-zürich Mode de travail sain, qualité de vie Exploitation familiale Production de denrées biologiques Agriculture Référence 74 (63) 42 (42) 61 (60) 53 22 (18) 16 (16) 19 (12) 5 (6) 4 14 (11) 4 4 (5) 6 (12) 3 (4) 5 6 (11) 1 4 6 (7) 10 1.2 ASPECTS SOCIAUX 1 1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE 67
et contact
les animaux
la famille, les
Source:
Les aspects qui ont pris de la valeur aux yeux de la population agricole depuis 2001 sont l’indépendance,le travail en famille,le contact avec les animaux et le travail dans la nature.D’autres aspects,comme l’autosuffisance ou l’entreprise familiale sont mentionnés moins souvent,tandis que de nouveaux aspects,tels que l’entretien du paysage,un mode de travail sain ou la production de produits biologiques sont soulevés.Le groupe de référence cite le plus souvent le travail dans la nature.Le travail en famille,par contre,revêt à son avis moins d’importance,contrairement à des thèmes chers aux consommateurs ou liés à l’écologie,comme l’autosuffisance ou l’entretien du paysage.
Appréciation des inconvénients de la profession d'agriculteur
Selon les deux groupes et comme dans l’enquête précédente,les aspects particulièrement négatifs sont les longues heures de travail,les nombreuses prescriptions,le manque de loisirs et les bas revenus.Les heures de travail,la pression du marché et le faible revenu sont moins souvent mentionnées qu’il y a quatre ans par le groupe agricole,qui accorde maintenant davantage d’importance au manque de loisirs et de vacances,ainsi qu’à la faible estime de la profession.Ce groupe signale aussi,comme nouveaux éléments,la charge physique et psychique liée à la profession,ainsi que l’augmentation de la bureaucratie.La population de référence,quant à elle,cite moins d’aspects négatifs;les nombreuses prescriptions,le manque de loisirs et de vacances, de même que la bureaucratie croissante sont bien plus rarement mentionnés.Il s’agit là soit d’aspects que la population non agricole connaît peu,soit de véritables différences d’appréciation.
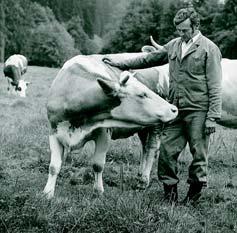
Longue durée de travail ou de présence Peu de loisirs ou de vacances Faible gain ou revenu Charge phys./psych., stress, isolement Problème d'image/faible estime Chute des prix, pression du marché Nombreuses prescriptions, conditions-cadre changeantes en %, entre parenthèses valeurs 2001 0 15 30 5 10 20 25 Source: gfs-zürich Autres arguments concernant le mode de travail Augmentation de la bureaucratie Dépendance des conditions météorologiques Agriculture Référence 26 (36) 25 (28) 25 (25) 11 (10) 25 (18) 15 (28) 20 (21) 17 (20) 7 (14) 11 (7) 12 12 (7) 8 (4) 1 11 (7) 10 6 (4) 6 (4) 17 (21) 11 1.2 ASPECTS SOCIAUX 1 68
■
Craintes et insécurité en progression
Les craintes et le sentiment d’insécurité sont environ aussi fréquents dans l’un est l’autre des deux groupes.La crainte majeure est liée à l’égoïsme des gens.
Indicateurs des craintes
Egoïsme humain
Surpopulation d'étrangers et de réfugiés
Pollution de l'air et des eaux, changements climatiques Interdépendance économique mondiale croissante (fusions)
Maladies incurables (p.ex. cancer, SIDA)
Risques liés au génie génétique Dégénérescence et dépérissement des moeurs
Détresse dans la vieillesse
Construction de routes et de pâtés de maisons, progression désordonnée de l'urbanisation Pénurie d'énergie Changements
Ne pas avoir assez d'argent pour vivre
Inflation/hausses de prix Accidents graves, invalidité
Déclin du rôle de la religion
Criminalité/agressions
Contamination nucléaire
Evolution technique et bouleversements dans tous les domaines
Sentiment de n'être plus qu'un rouage insignifiant Peur de perdre l'emploi ou de ne pas en trouver Ne plus se sentir chez soi en Suisse
Peur d'être seul/de ne pas avoir d'amis
Valeurs moyennes, échelle de 1 = menace inexistante à 10 = forte menace
Valeurs moyennes 0 1 2 3 5 6 4 7
Source: gfs-zürich
radicaux Guerre Agriculture Référence 5,9 6,2 5,9 5,7 5,8 6,1 5,8 5,6 5,0 5,8 5,4 5,1 5,3 4,9 4,7 5,0 4,9 4,9 4,8 4,8 5,4 5,0 5,6 4,9
politiques, mouvements
4,6 4,7 4,6 4,9 4,6 4,3 4,1 4,4 4,1 4,1 4,2 3,3 3,4 4,1 4,1 3,4 3,1 2,7 3,0 4,2 Problèmes personnels (conjuguaux) Peur de perdre le logement 2,9 2,4 2,1 2,6 4,0 4,4
1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE 1.2 ASPECTS SOCIAUX 1 69
Autant que l’égoïsme des gens,le groupe agricole craint aussi la surpopulation étrangère.Les deux types de craintes indiquent une perte de solidarité.D’autres aspects jugés importants sont la pollution de l’air et de l’eau,ainsi que les changements climatiques,ou encore la dépendance économique croissante du reste du monde.Les femmes expriment tendanciellement plus de craintes dans divers domaines.Le groupe de référence s’inquiète,quant à lui,davantage du risque de guerre et de la perte d’emplois.
Au cours des quatre dernières années,l’indice général d’insécurité a progressé tant dans la population agricole (de 4,0 à 4,4) que dans le groupe de référence (de 4,2 à 4,5).
Si l’on considère les changements intervenus depuis 2001 par groupes de thèmes,on constate que,dans les milieux agricoles,l’insécurité a surtout augmenté quant au risque de guerre et à l’égoïsme,mais aussi en ce qui concerne une menace d’ordre culturel (moindre importance de la religion et des traditions).Une grande partie de la population agricole et les autres groupes de la population non citadine semblent souffrir du dépérissement des valeurs traditionnelles.Les craintes concernant l’intégrité physique (maladies incurables,accident/invalidité) et l’aliénation (ne plus se sentir chez soi,surnombre d’étrangers,criminalité,progrès technique,ne plus être qu’un simple rouage) ont fortement augmenté.
Indice total d'insécurité Egoïsme humain Menace culturelle Aliénation Menace socio-économique Intégrité physique Guerre 0 3 7 1 2 4 6 5 Source: gfs-zürich Valeurs moyennes, échelle de 1 = aucune menace à 10 = forte menace Menace écologique Isolement 2005 2001 4,4 4,0 4,8 3,5 5,9 4,7 4,7 5,1 4,8 4,7 4,5 3,9 3,6 2,3 5,0 2,5 3,7 4,1 1.2 ASPECTS SOCIAUX 1 70
Evolution des craintes dans la population agricole
Evolution des craintes dans la population de référence
Dans la population de référence,c’est la crainte d’une menace culturelle qui a le plus fortement augmenté depuis 2001.De même,les craintes concernant le risque de guerre,la menace socio-économique (peur de perdre son emploi,de ne pas avoir assez d’argent pour vivre,de perdre son logement,peur de l’inflation et de détresse dans la vieillesse) et l’égoïsme ont aussi nettement gagné en importance depuis la dernière enquête.Seule la crainte relative à l’intégrité physique a clairement reculé entre 2001 et 2005.

Indice total d'insécurité Guerre Menace socio-économique Intégrité physique Isolement Egoïsme humain Menace culturelle 0 3 7 1 2 4 6 5
Valeurs
de 1 = menace inexistante à 10 =
menace Menace écologique Aliénation 2005 2001 4,5 4,2 4,8 3,6 5,4 4,5 4,3 6,2 5,1 5,6 4,9 2,9 2,5 4,4 5,0 4,5 3,6 5,5 1.2 ASPECTS SOCIAUX 1 71
Source: gfs-zürich
moyennes, échelle
forte
Comparée à 2001,l’appréciation de la population agricole est aujourd’hui plus favorable dans plusieurs sphères.Ce groupe est en particulier plus satisfait de son revenu et des conditions-cadre politiques et économiques,de sorte qu’il ne reste que de légères différences par rapport au groupe de référence.Globalement,les perceptions subjectives des deux groupes se sont rapprochées.La plus grande différence reste celle concernant le temps disponible et les loisirs.
L’indice de la qualité de la vie,qui indique le rapport entre la satisfaction dans les diverses sphères de la vie et l’importance qui leur est accordée,est plus bas dans la population agricole que dans le groupe de référence.Cette différence est significative. Elle s’explique surtout par la plus grande insatisfaction de la population agricole en ce qui concerne les loisirs et le temps disponible.Le degré de satisfaction du groupe agricole est égal à celui du groupe de référence dans deux domaines (santé et conditions-cadre politiques et économiques),plus élevé dans quatre domaines (famille, travail,formation et perfectionnement) et un peu moins élevé dans quatre domaines également (contexte social,niveau de vie général,offre culturelle,revenu).
En 2005 comme en 2001,les milieux agricoles sont plus pessimistes quant à leur avenir financier que les autres groupes de la population,mais les optimistes ont gagné du terrain.
Les aspects positifs de la profession d’agriculteur relevés par les deux groupes sont l’indépendance et le lien avec la nature.Les longues heures de travail sont le principal aspect négatif cité.De nouveaux aspects positifs et négatifs ont été soulevés,à savoir l’entretien du paysage et la charge physique et psychique de la profession d’agriculteur.
Les craintes et le sentiment d’insécurité se sont accrus de manière générale au cours des quatre dernières années.La population agricole s’inquiète principalement du risque de guerre,de l’égoïsme,de la perte de valeurs traditionnelles,du risque d’accidents et de maladies,ainsi que de l’aliénation.Il est intéressant de constater que les craintes socio-économiques sont plus fréquentes dans la population non agricole que dans le groupe agricole,bien que ce dernier soit plus pessimiste quant à son avenir financier.
1.2 ASPECTS SOCIAUX 1 72
■ Perception subjective plus favorable de la situation actuelle
Ecologie et éthologie
1.3.1 Ecologie
Une des lignes directrices de la politique agricole nationale est le respect de l'environnement et de la diversité biologique.Le présent chapitre a pour but cette année,de rapporter sur le domaine de la biodiversité.Les domaines de l'eau et de l'azote ont été rapportés dans le rapport agricole 2004,ceux de l'énergie et du climat ont été présentés en 2003 et ceux du phosphore et du sol sont traités dans le rapport agricole 2002.Le premier cycle s'achève ainsi et permet une présentation globale des résultats du monitoring agro-environnemental.Les quelques résultats principaux sont présentés dans le chapitre 1.4.sur l'appréciation de la durabilité.
L'évolution de l'utilisation des terres et des moyens de production est présentée comme chaque année en première partie du chapitre.La seconde partie présente le thème de la diversité biologique et l'agriculture.La troisième partie montre les effets de l'exploitation agricole sur la qualité et la richesse des habitats.Une ultime partie présente enfin la diversité des races et des variétés utilisées dans l'agriculture.
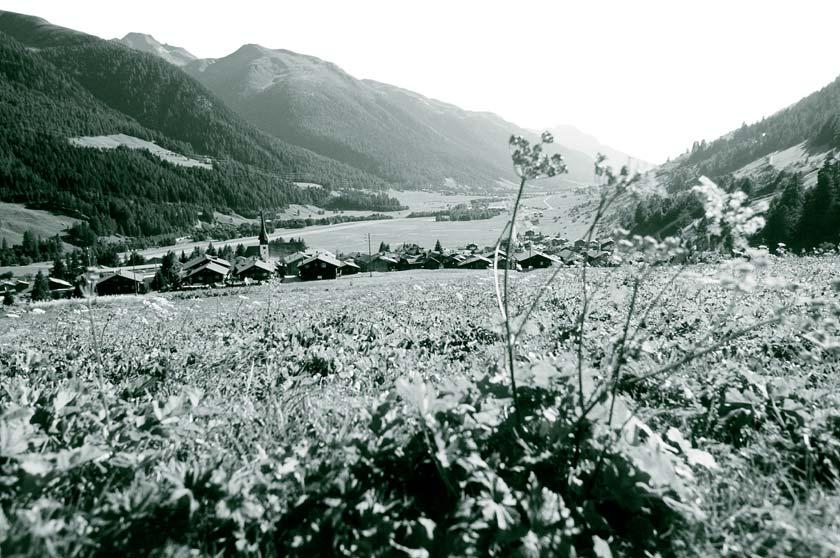
■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■
1.3
1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 73
Utilisation des terres et moyens de production
Evolution de la part des surfaces exploitées de manière respectueuse de l'environnement en % de la SAU Exploitation respectueuse de l'environnement 1 dont bio Source: OFAG 1 1993 à 1998: PI + bio; dès 1999: PER 1993199419951996199719981999200020012002 0 100 80 60 40 20 90 70 50 30 10 2004 2003 Evolution des surfaces de compensation écologique 1 199319941995199619971998199920002001200220032004 en 1 000 ha Région de montagne Région de plaine Source: OFAG 1 sans arbres fruitiers haute-tige, avant 1999 seulement surfaces de compensation écologique donnant droit aux contributions 0 140 120 100 80 60 40 20 Evolution des cheptels 199019961997199819992000200120022004 2003 en 1 000 UGB 1 Autres Porcs Bovins Source: OFS 1 UGB: unité de gros bétail 0 1 500 1 250 1 000 750 500 250 1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 74
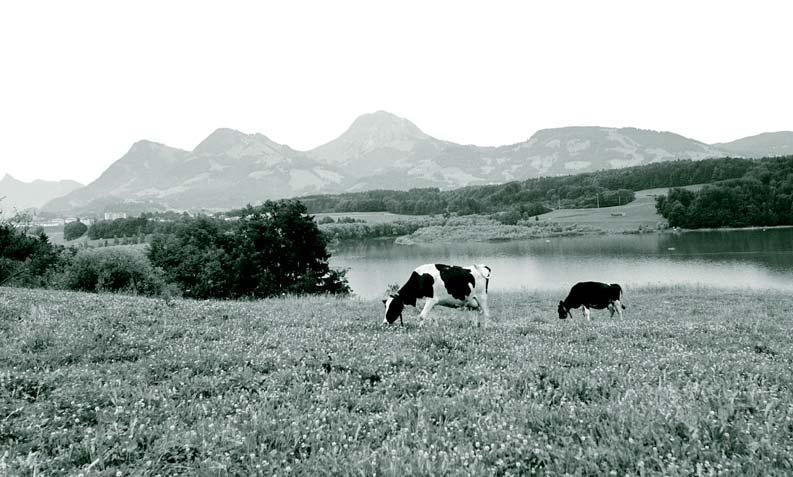
Evolution de l'utilisation d'engrais minéraux en 1 000 t Azote (N)Phosphate (P205) Source: USP 1990/9219941996199820002002 19931995199719992001 0 80 70 60 50 30 40 20 10 20032004 Evolution de la consommation d'aliments concentrés 199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004 (prov.) en 1 000 t Autres CH Tourteaux d'oléagineux CH Céréales fourragères CH Transformation de produits importés Aliments importés Source: USP 0 2 000 1 750 1 500 1 250 1 000 750 500 250 1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 75
Evolution des ventes de produits phytosanitaires 19901991199219931994199519961997199819992000200120022003 2004 en t de substances actives Fongicides, bactéricides, désinfectants de semences Herbicides Insecticides, acaricides Régulateurs de croissance Rodenticides Source: Société suisse de l'industrie chimique 0 2 500 2 000 1 500 1 000 500 1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 76
■ Qu’entend-on par diversité biologique et qu’apporte-t-elle?
Biodiversité dans l’agriculture
Depuis 6000 ans,l’homme marque de son empreinte le couvert végétal naturel de la Suisse et le façonne.La couverture végétale,composée pour l'essentiel de forêts mixtes de feuillus,a été éclaircie par des défrichements et le pacage du bétail;le nouvel espace ainsi libéré a servi à l'agriculture et à l'habitat.Grâce à l’exploitation agricole, des espèces provenant de différents biotopes et ayant besoin de beaucoup de lumière se sont disséminées sur les terres ouvertes et ont formé de nouvelles associations végétales.Par la suite,une variété de structures et d’espaces vitaux se sont développés.
L’élevage d’animaux de rente et la production de plantes utiles qui remontent à des milliers d’années a permis de développer des variétés et des races dont les caractéristiques sont adaptées aux conditions environnementales et aux besoins de l’homme. Avec la flore et la faune sauvages,elles forment des systèmes agroécologiques adaptés au site.Cette biodiversité est précieuse,car elle permettra d’assurer l’alimentation de la population mondiale dans des conditions environnementales changeantes.
L’agriculture qui exploite de grandes surfaces a un rôle essentiel à jouer dans le contexte de la préservation de la diversité biologique.Les prairies riches en espèces,les terres assolées,les haies et les arbres fruitiers haute-tige font partie de notre patrimoine culturel et de ce que nous appelons communément le «paysage rural»,dont l’entretien et la gestion sont indemnisés au moyen de paiements directs alloués aux agriculteurs.
La diversité biologique sur la surface agricole utile est appelée agrobiodiversité Cette diversité et l’adaptabilité des animaux,des végétaux et des micro-organismes sont nécessaires au maintien des fonctions-clés du système agroécologique,à sa structure et à ses processus.Nos besoins fondamentaux dans les domaines de l’alimentation,de l’habillement,des soins médicaux et des matériaux de construction ne pourront être satisfaits,à l'avenir,que si la biodiversité en général et la biodiversité agricole en particulier sont maintenues.

1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 77
Selon la Convention sur la biodiversité,on distingue généralement trois catégories:
– Diversité des écosystèmes: les écosystèmes exploités (agriculture,sylviculture) et non exploités (biotopes) approvisionnent l’homme en ressources vitales telles que nourriture,eau,oxygène et servent de base à l’agriculture et à la sylviculture.Ils jouent un rôle important dans la régulation du climat,la fertilité du sol,le régime hydrique,la protection contre l’érosion et contre les inondations et génèrent des milieux naturels et des espaces récréatifs,notamment pour le tourisme.
– Biodiversité: les millions d’espèces animales et les centaines de milliers d’espèces végétales forment ensemble un système de vie communautaire,bien rodé au cours des siècles.Le World Wildlife Fund for Nature (WWF) estime qu’au cours des 30 dernières années,un tiers des espèces a disparu;en 2004,la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN) recensait,à l’échelle mondiale,15’589 espèces menacées de disparition.En Suisse,le nombre d’espèces vivantes s’élève à environ 75’000,à savoir quelque 45’000 espèces animales (vertébrés,arthropodes,insectes,vers, mollusques)et quelque 30’000 espèces de plantes vasculaires,mousses,lichens et champignons.
–Par diversité génétique,on entend la diversité à l’intérieur des espèces. D’elle dépend l’évolution,donc la survie des espèces.Elle est utilisée notamment dans la sélection et la production.Jusqu’ici,la richesse des ressources génétiques n’a été étudiée qu’en partie.
L’exploitation agricole et la biodiversité interagissent.L’augmentation des rendements de la production agricole,qui a débuté vers le milieu du XVIIIe siècle,a exercé une pression toujours croissante sur la biodiversité des écosystèmes générée par l’agriculture,les habitats et les biotopes ainsi que sur la diversité des espèces spécifique à l’agriculture.Lentement dans un premier temps,puis toujours plus rapidement,les variétés et les races traditionnelles ont été remplacées,pour une meilleure adaptation de la production agricole aux exigences de la société et de l’économie,par de nouvelles variétés et races,plus résistantes aux maladies et au rendement plus élevé.Cette évolution a sacrifié,en fin de compte,la diversité au profit d’une sélection déséquilibrée visant les rendements élevés.La diversité générée par l’exploitation agricole risquait ainsi de disparaître à nouveau.
Les améliorations foncières à grande échelle,l’utilisation de produits phytosanitaires, l’exploitation plus intensive des terres ainsi que la fumure plus fréquente des prairies ou la réduction des surfaces laissées en friche ont accéléré la perte des écosystèmes proches de l’état naturel et la diminution de la diversité des espèces.Les petits biotopes présents dans l’espace utilisé par l’agriculture ont peu à peu disparu.
1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 78
■ La biodiversité sous pression
■ Efforts fournis au niveau international pour préserver la diversité
L’uniformisation globale des modes de production accélère encore la diminution de la biodiversité agricole.Les variétés végétales et les races d’animaux de rente qui fournissent notre alimentation sont aujourd'hui peu nombreuses.La majeure partie de notre approvisionnement total en denrées alimentaires provient de 12 variétés végétales et de 5 espèces animales domestiquées.A long terme,la diminution de la biodiversité agricole risque de poser des problèmes.La diversité génétique en agriculture permet de se protéger contre les mauvaises récoltes et contre la vulnérabilité des espèces végétales aux maladies et aux organismes nuisibles et offre ainsi la meilleure garantie possible pour une production suffisante de denrées alimentaires.
Cette évolution est le résultat d’une extension des activités humaines au siècle dernier. La population mondiale a triplé,les activités économiques ont augmenté d’un facteur encore plus important.L’alimentation de la population,en forte croissance,a impliqué une intensification de l’agriculture qui s’est faite aux dépens de la biodiversité. L’accroissement des activités économiques a encore accentué la pression.Celles-ci nécessitent toujours plus d’espace.Pour que la biodiversité puisse se maintenir et poursuivre son développement,elle a besoin de surfaces en nombre suffisant.
La préservation de la biodiversité est une tâche qui concerne l’ensemble de la société. L’agriculture peut assumer cette tâche importante qui est la sienne uniquement si elle est soutenue dans ses efforts par la société.Il importe avant tout qu’elle soit indemnisée pour les prestations spécifiques qu’elle fournit à cette fin.
La mondialisation de l’utilisation des ressources naturelles dans l’agriculture,la pêche et la sylviculture et la pression qui en résulte sur le milieu naturel exige des mécanismes de régulation globaux.En 1992,la Conférence de l’ONU sur l’environnement et le développement,tenue à Rio,a adopté la Convention sur la biodiversité.Le Traité international de la FAO sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (2004),de très grande importance pour l’agriculture,s’est aligné sur cette convention.Ces deux accords se caractérisent par le fait qu’ils comprennent aussi bien une dimension écologique (maintien et utilisation durable de la diversité) qu’une dimension socio-économique (répartition équitable des avantages qui résultent de l’utilisation de la diversité;protection des connaissances traditionnelles).
Dans le domaine de la biodiversité,il existe depuis longtemps des traités internationaux.Au XIXe siècle déjà,les transports,toujours plus nombreux,de végétaux et de denrées alimentaires d’un pays à l’autre ont conduit aux premiers accords dans le secteur de la protection phytosanitaire.Des réglementations destinées à la lutte contre les organismes nuisibles tels que le doryphore et le phylloxéra ont été conclues en 1878.Plus récentes sont la Convention de Ramsar sur les zones humides (1971), servant notamment d’espace vital aux oiseaux aquatiques,la Convention de Bonn sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (1979) ou la Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (1979).
1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE 79
Dans les années quatre-vingt,la politique agricole de la Suisse qui garantissait aux agriculteurs des prix fixes pour leurs produits ainsi que leur écoulement atteignait ses limites.L’intensification de la production qui en découlait a conduit à des déficits écologiques que la diminution de la biodiversité a rendus manifestes.Pour parer à cette situation,la Confédération a dû mettre sur pied différentes mesures.
Elles sont présentées brièvement ci-dessous,pour chacune des trois catégories de la biodiversité.
Diversité des systèmes écologiques
–En 1993,on a introduit les paiements directs écologiques ainsi que des contributions pour différents programmes,notamment les surfaces de compensation écologique (SCE).Depuis cette année-là,les différents éléments de la compensation écologique tels que les prairies extensives,les surfaces à litière,les jachères florales et les arbres fruitiers haute-tige ont pu être soutenus financièrement.Dans ce contexte,il faut noter l’exigence des PER,selon laquelle 7% de la SAU doit être exploitée en tant que surface de compensation écologique.L’exigence concerne tous les paiements directs depuis 1999.Ces surfaces ont un impact positif sur la diversité biologique.Les SCE,qui sont des surfaces de transition importantes entre les espaces vitaux proches de l’état naturel et la surface de production agricole,représentent aujourd’hui presque 10% de la SAU.Par le biais des PER,la politique agricole a créé une incitation supplémentaire encourageant les agriculteurs à préserver,créer et mettre en réseau des espaces vitaux pour les animaux et les plantes sauvages.D’autres éléments PER tels qu’un bilan de fumure équilibré,des exigences en matière de protection du sol,la rotation des cultures ou l’utilisation ciblée des produits phytosanitaires,vont également dans ce sens.
–En outre,l’ordonnance sur la qualité écologique (OQE),entrée en vigueur en 2001, vise le développement de surfaces de haute qualité écologique par une contribution spéciale et encourage également la mise en réseau ciblée des surfaces écologiques entre elles et de celles-ci avec les surfaces proches de l’état naturel.
–Depuis toujours,l’exploitation des terres crée de nouveaux espaces vitaux.Les terres assolées,les prairies riches en espèces ou les vergers constituent des habitats abritant une flore et une faune caractéristiques.Le maintien d'une agriculture productrice préserve ces différents écosystèmes et contribue activement à la sauvegarde de la diversité.
1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 80
■ Programmes de la politique agricole destinés à l’encouragement de la biodiversité dans l’agriculture
Diversité des espèces
–Pour plusieurs espaces vitaux proches de l’état naturel (biotopes),utilisés par l’agriculture,il existe des inventaires et des mesures de mise en œuvre,notamment pour les bas marais,les prairies sèches et les pâturages secs.La préservation de ces espaces vitaux contribue activement à la présence durable des espèces qui y vivent.

Diversité génétique
–Ressources phytogénétiques:dans le cadre du Plan d’action national pour la conservation et l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture,l’OFAG soutient depuis 1999 les mesures destinées à l’établissement d’inventaires et à la préservation durable des plantes cultivées traditionnellement en Suisse (fruits,vignes,baies,pommes de terre,plantes issues des grandes cultures, plantes fourragères,légumes ainsi que plantes médicinales et plantes aromatiques).
–Ressources zoogénétiques:toutes les races de rente de la Suisse ont été inventoriées et décrites:bovins,chevaux,porcs,moutons,chèvres,lapins,poules d’élevage et pigeons;un statut a été attribué à chaque race,conformément aux critères établis par la FAO (état critique,animaux menacés de disparition,animaux en difficulté rares ou à observer).
–Les connaissances traditionnelles des agriculteurs relatives aux variétés et aux races, à la culture et à l’utilisation de la production sont enregistrées et font l’objet d’une documentation dans le cadre des plans d’action nationaux pour la conservation et l’utilisation durable des ressources génétiques.Les appellations d’origine contrôlée (AOC) permettent d’augmenter la valeur ajoutée des produits issus de races rustiques ou de variétés locales.
Les interactions entre les modes de production agricole et la biodiversité sont recensées à l’aide d’indicateurs.L’évaluation des mesures écologiques montre dans quelle mesure l’agriculture contribue,compte tenu des conditions-cadre actuelles,à préserver et à promouvoir la biodiversité.
1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE 1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 81
■ Compensation écologique:évolution des surfaces et des contributions
En 2004,quelque 116’000 ha ont été exploités comme surfaces de compensation écologique,ce qui représente 11% de la SAU.Parallèlement,les dépenses de la Confédération pour la compensation écologique n’ont cessé d’augmenter.
Evolution des contributions pour la compensation écologique
■ Compensation écologique:le type de SCE utilisé varie selon les régions
Contributions pour la compensation écologique Contributions
En 2001,le montant total des contributions a légèrement régressé.Deux raisons expliquent cette baisse:la suppression,en 2000,des contributions pour prairies extensives aménagées sur des terres assolées gelées et le fait que les surfaces de compensation écologique ont donné droit,dans certains cas,à des contributions moins élevées.
Depuis 2001,les prairies extensives sont le type de SCE qui a le plus augmenté en terme de surfaces (49'000 ha = 42% de toutes les SCE).Les deux principaux types de SCE,à savoir les prairies extensives et les prairies peu intensives,couvrent une surface totale de 72% de l’ensemble des SCE,ce qui représente 8% de la SAU.
Les deux types de SCE que sont les prairies extensives et les prairies peu intensives dominent dans toutes les régions biogéographiques de la Suisse.
Répartition des surfaces de compensation écologique d'après les régions biogéographiques 2004
Prairies extensives Prairies peu intensives Autres SCE 1
Source: OFAG, AGIS/GIS 2005 GG25 ©Swisstopo 1 sans arbres fruitiers haute-tige
en 1000
Contributions
fr.
selon l'OQE Source:
1993199419951996199719981999200020012002 0 140 000 80 000 60 000 120 000 100 000 40 000 20 000 2004 2003
OFAG
1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 82
Les autres types de SCE ne jouent,en tant que tels,guère de rôle dans la plupart des régions.Dans leur ensemble cependant,ces SCE peuvent être très importantes localement.On trouve les surfaces à litière avant tout dans les régions préalpines et sur le Plateau oriental.Les jachères florales sont aménagées essentiellement sur le Plateau, dans les bassins du Rhin et du lac Léman ainsi que dans le Jura et sur le Randen (SH).
1 y compris arbres fruitiers haute-tige 2004
Dans la région des collines et de montagne,le rapport SCE/SAU est en général plus élevé qu’en plaine.D’une manière générale,il est plus élevé dans les régions à culture fourragère que dans celles des grandes cultures.
Evolution et composition des SCE en plaine et en montagne 1
montagne
SCE sans contributions 2
SCE sur terres assolées 3
Prairies peu intensives
Prairies extensives, surfaces à litière, haies, bosquets champêtres et rives boisées
1 sans arbres fruitiers haute-tige
2 Pâturages extensifs, pâturages boisés, etc.
3 Prairies extensives aménagées sur des terres assolées gelées, jachères florales, jachères tournantes, bandes culturales extensives
Source: OFAG
En plaine (zone des collines comprise),ce sont les prairies extensives qui constituent l’essentiel des surfaces de compensation écologique.En région de montagne (zones I à IV),par contre,les prairies peu intensives prédominent.Le rapport SCE/SAU est nettement plus important en montagne (14,2%) qu’en plaine (8,8%).
en ha
199920002001200220032004199920002001200220032004 Région de plaine Région de
0 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000
Compensation écologique
0 ≤10 11–20 21–30 >30 Région d'estivage en % de la SAU 1
Source: OFAG GG25 ©Swisstopo
1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE 1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 83
1 Chiffres par commune, ha de SCE donnant droit aux contributions divisés par ha de SAU
Les exploitations à cheptel peu important optent,lors du choix des surfaces de compensation écologique,en premier lieu pour les prairies extensives et pour les prairies peu intensives.Dans une exploitation,plus le cheptel est important,plus le nombre d’arbres haute-tige est élevé.Cette situation s’explique par le fait que les exploitations à grand cheptel ont davantage besoin de surfaces fertilisables pour épandre les engrais de ferme.
Les mesures introduites en 2001 dans le cadre de l’ordonnance sur la qualité écologique (OQE) ont recueilli un écho favorable.En 2003,25% de toutes les exploitations ont participé à l’un des programmes proposés.
Surface
0–1,51,5–2,0 2,0–2,5 Charge
2,5–3,0>3,0 en % Arbres fruitiers haute-tige
Autres Prairies peu intensives Prairies extensives
0 14 12 10 8 6 4 2
de compensation écologique donnant droit aux contributions selon la charge en bétail 2004
en bétail en UGB/ha
(1 are par arbre)
Source: OFAG
Evolution des surfaces OQE donnant droit à des contributions 200220032004 en ha
0 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 84
Source: OFAG
La compensation écologique agit positivement sur la préservation et la promotion de la biodiversité dans l’espace rural.La diversité biologique est plus grande sur les surfaces de compensation écologique que sur les surfaces exploitées de manière plus intensive.Les études de cas effectuées confirment que,selon la région,jusqu’à 80% des espèces dénombrées sont directement liées aux SCE.
Les SCE (jachères florales,haies,arbres fruitiers haute-tige,prairies extensives et prairies peu intensives) représentent au maximum 20% de la SAU des régions étudiées,mais par rapport aux prairies et aux pâturages intensifs ainsi qu’aux grandes cultures,elles contribuent dans une proportion allant de 50 à 80% à la diversité globale des espèces végétales et des arthropodes examinés.La sauvegarde des organismes utiles est un principe fondamental des SCE;les résultats obtenus documentent de manière impressionnante ce qui a été fait en la matière.

■ Compensation écologique:effets positifs sur la biodiversité Biodiversité sur la SAU Papillons diurnesAraignéesCarabidésVégétaux en % Autre SAU Surfaces de compensation écologique
Agroscope FAL Reckenholz 0 120 100 80 60 40 20 1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 85
Source:
Par rapport aux normes de qualité figurant dans l’OQE et selon une évaluation de la FAL,20% des SCE de la plaine présentent une bonne qualité botanique.Cette proportion est plus élevée dans le cas des prairies extensives (29%) que dans celui des prairies peu intensives (11%).7% des prairies extensives du Plateau abritent des espèces menacées de disparition;concernant les prairies peu intensives,cette proportion n'est plus que de 3%.En montagne,quelque 82% des surfaces écologiques satisfont aux normes prévues dans l’OQE.Dans l’ensemble,les jachères florales et les surfaces à litière sont de très bonne qualité.Il y a deux explications à ces différences: d’une part les caractéristiques naturelles des régions biogéographiques qui conduisent à des groupes d’espèces différents;d’autre part,les régions se distinguent par leurs systèmes culturaux et leurs traditions agricoles,qui influent également sur la biodiversité du paysage rural.
Nombre d'araignées, de carabidés et de papillons diurnes dans les prairies SCE et dans les prairies intensives
La composition floristique des prairies écologiques de la plaine qui ne satisfont pas aux critères de l’OQE est encore marquée par l'exploitation telle qu’elle avait cours avant que les prairies deviennent des SCE.Des études de cas ont cependant montré que ces surfaces abritent,elles aussi,d’une manière générale davantage d’espèces de végétaux et d’arthropodes que les prairies exploitées intensivement.Bien des espèces découvertes dans les prairies vivaient exclusivement dans les prairies écologiques (araignées: 33%;carabidés:15%;papillons diurnes:7%).
Selon une étude faite sur 16 espèces d’oiseaux nicheurs menacés,la population de trois espèces s’est accrue de manière significative.Cinq espèces ont continué de diminuer,alors que les huit espèces restantes se sont développées,bien qu'à un niveau bas.Grâce à l’aménagement de jachères florales,on a pu observer plus fréquemment l’hespérie de la mauve.Des études de cas ont en outre montré que des espèces de sauterelles rares profitent aussi du système de la compensation écologique,en particulier lorsque les surfaces sont mises en réseau avec des réserves naturelles.

CarabidésPapillons diurnes Araignées Exclusivement dans prairies SCE Plus fréquents dans prairies SCE Fréquence égale Plus fréquents dans prairies intensives Exclusivement dans prairies intensives 82 119 16 18 18 3 2 3 35 80 4 16 15 1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 86
Source: Agroscope FAL Reckenholz
■ Ressources phytogénétiques et zoogénétiques: situation en Suisse
Les surfaces de compensation sont riches en espèces,notamment là où il subsiste des restes d’habitats proches de l'état naturel.Les espèces animales et végétales menacées de disparition ne peuvent réapparaître que si leur population n’a pas entièrement disparu de la région.Lorsqu’une espèce a disparu d’une région,sa recolonisation n’est pas garantie même à long terme.Les SCE ont pour effet de sauvegarder la présence des espèces non menacées de disparition et d'empêcher les espèces potentiellement menacées de disparition de devenir rares au point de devoir figurer dans la liste rouge.
Aujourd’hui,seul un petit nombre d'espèces végétales et animales constituent,pour l'essentiel,la base de l’alimentation mondiale.La majeure partie de la biodiversité agricole demeure sous-exploitée.Selon des estimations de la FAO relatives à l’érosion génétique,la diminution de la biodiversité depuis le début du XXe siècle est supérieure à 90%.
En Suisse,on note une augmentation des enregistrements dans les herd-books ou dans le catalogue des variétés.Les nouveaux enregistrements dans les herd-books sont essentiellement dus à l’accord de libre-échange Suisse – UE,selon lequel les races existant dans l’UE peuvent être enregistrées dorénavant dans les herd-books suisses.
Nombre Source: OFAG 1985 1990 19952000 2002 PorcsBovins 0 25 15 20 10 5
Evolution des animaux de rente inscrits dans le herd-book
Nombre Source: OFAG 1985 1990 19952000 2002 Pommes de terreBlé 0 40 35 25 20 30 15 10 5 1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE 1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 87
Evolution des variétés de plantes utiles inscrites au catalogue des variétés
L’augmentation des plantes utiles figurant dans le catalogue des variétés s'explique en premier lieu par les progrès plus rapides réalisés dans le domaine de la sélection et par la diminution de la durée d’utilisation d’une variété.En plus des variétés de pommes de terre et de blé enregistrées dans le catalogue des variétés,respectivement 67 et 14 variétés locales ont été utilisées en 2002,conformément à l’art.29 de l’ordonnance du DFE sur les semences et plants.
Bien que nous disposions d’un éventail de races de rente et de variétés de plantes utiles relativement important,seule une partie de la diversité génétique est utilisée pour la sélection et la production.Dans le secteur de l'élevage porcin,le cheptel suisse est constitué presque exclusivement de deux races et dans celui de l'élevage laitier,de trois races.
Dans le domaine des grandes cultures,la variété de blé la plus utilisée représente entre 25 et 50% de l’ensemble de la production.Depuis 1985 toutefois,le taux d'utilisation de ces principales races et variétés va en diminuant.
Dans le cadre des deux programmes spéciaux «Plan d'action national pour la conservation et l'utilisation durable des ressources phytogénétiques» et «Concept visant à la préservation de la diversité des races de rente»,la diversité existant
Suisse est inventoriée et protégée.
en
en %
Evolution de la part des principales races d'animaux de rente et de variétés de plantes utiles à la production
1985 1990 19952000 2002 Porcs (2)Bovins
0 100 90 60 50 70 80 40 30 20 10
Source: OFAG
(3)Pommes de terre (5)Blé (5)
en %
Part des principales variétés de céréales à la production correspondante
Blé
Triticale
0 100 60 80 40 20 1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 88
Source: OFAG
(5)Orge d'automne (3) Orge de printemps (3)
(4)Avoine (3)
■ Ressources phytogénétiques:plan d’action national
En réaction à l’érosion génétique croissante dans le domaine des plantes cultivées utilisées par l’agriculture,la Commission de la FAO pour les ressources phytogénétiques a élaboré un rapport sur la situation mondiale de ces ressources dans les domaines de l’alimentation et de l’agriculture ainsi qu’un plan d’action global.

L’OFAG a concrétisé le plan d’action global pour la Suisse et a créé ainsi la base pour la mise en oeuvre du Plan d’action national pour la conservation et l’utilisation durable des ressources phytogénétiques dans l’alimentation et l’agriculture (PAN).Le PAN, adopté en 1997,complète les mesures de politique agricole et les efforts déployés dans le domaine de la diversité des espèces et des écosystèmes.
Durant la phase d’introduction (1999–2002),les activités ont été axées sur l’inventorisation des plantes cultivées,l’estimation du risque de disparition ainsi que la mise sur pied des premiers programmes concrets de préservation et d’exploitation.Durant la deuxième phase,en cours de réalisation (2003–2006),il s’agit d’accélérer la préservation et l’exploitation des ressources phytogénétiques,sur la base d’analyses spécifiques aux cultures,de la situation telle qu’elle se présente aujourd’hui et de la situation souhaitée.La préservation se fait ex situ,c’est-à-dire en dehors de la région d’origine.Dans le cadre de la préservation ex situ,on distingue les collections in vitro, c’est-à-dire la préservation dans un laboratoire/éprouvette (pommes de terre et petits fruits),les collections dans des banques de gènes/banques de semences (céréaleset légumes) et les collections sur le terrain (fruits et vignes).La préservation in situ,c’est-à-dire celle qui se fait dans la région d’origine,concerne uniquement les plantes fourragères,domaine où la Suisse joue un rôle important.
Un autre élément consiste en la banque de données nationale (BDN).La BDN vise à la gestion centralisée et à la publication des nombreuses informations recueillies sur les plantes cultivées,préservées dans le cadre du programme spécial en question,ce qui devrait faciliter l’échange de données aux plans national et international.Elle est accessible sur Internet (www.bdn.ch).
Dans le contexte de travaux de sensibilisation,il s’agira d’informer le grand public du rôle de la biodiversité agricole,de la préservation de notre patrimoine variétal et des connaissances que cela implique en matière de techniques culturales,de mise en valeur et de propriétés des produits.Si nous voulons préserver la biodiversité agricole, nous devons la vivre au quotidien.
1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE 1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 89
Projets PAN dans la phase II
Plantes fourragères (4)
Pommes de terre (4)
Vignes (6)
Légumes (7)
Baies (6)
Plantes médicinales et aromatiques (2)
Banque de données nationale (1)
Fruits (26)
Communication (8)
Plantes de grandes cultures (8)
Source: OFAG
La réalisation des projets mis sur pied devrait nous permettre d’atteindre les objectifs définis.Les organisations intéressées peuvent présenter des propositions allant dans ce sens.La gestion globale et la haute surveillance appartiennent à l’OFAG.En 2004, quelque 70 projets ont bénéficié d’une aide se montant à 2,8 millions de francs.
Agroscope RAC Changins est responsable des aspects scientifiques du PAN;il dirige notamment les travaux relatifs aux banques de données et à la préservation in vitro. Il garantit en outre la coordination dans le domaine de la recherche.
La Commission suisse pour la conservation des plantes cultivées (CPC) accompagne les travaux en tant qu’organe consultatif.Elle coordonne les multiples travaux des personnes concernées au plan national (organisations de sauvegarde,producteurs de semences,agriculteurs,éleveurs,recherche agronomique,universités,etc.) ainsi que l’échange d’informations au plan international et fournit un rapport à l’OFAG sur la situation dans le domaine des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture.
Ressources génétiques de fruits comprises dans le PAN
Châtaigne (50)
Noix commune (100)
Pruneau (209)
Cerise (590)
Autres (49)
Pomme (1104)
Poire (701)
Source: OFAG
1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 90
La diversité variétale des groupes de cultures examinés dans le PAN est importante.Le secteur prédominant,celui des fruits,recense 2800 variétés et lignées connues,méritant d’être sauvegardées:pommes (1104),poires (701),cerises douces (590),noix (100), châtaignes (50),noisettes (15),coings (12),griottes (11) et abricots (11).
Dans le cadre du projet d’inventorisation des fruits,plus de 190'000 sites (arbres fruitiers et arbustes à petits fruits) ont été enregistrés dans la banque de données créée à cet effet.
Pourcentage de variétés de pommiers annoncés par canton
En tête viennent les pommiers,qui représentent à eux seuls un tiers de tous les arbres fruitiers enregistrés.Le plus grand nombre de pommiers a été inventorié dans les cantons de Thurgovie,St-Gall et Berne.

de variétés de poiriers annoncés par canton
> 49% 40–49% 30–39% 20–29% 10–19% < 10%
Une annonce sur cinq concerne un poirier.Ce sont les cantons de Nidwald et d’Obwald qui possèdent le plus grand nombre de poiriers. > 49% 40–49% 30–39% 20–29% 10–19% < 10%
Source: Fructus / Agroscope FAW Wädenswil Pourcentage
1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE 1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 91
Source: Fructus / Agroscope FAW Wädenswil
Un quart environ des annonces provenant des cantons de Bâle-Ville,Bâle-Campagne, Schwyz,Zoug,Schaffhouse et Vaud concernent les cerises.Berne et Lucerne sont les cantons à avoir annoncé le plus grand nombre d’arbres.C’est dans ces deux cantons également qu’on a dénombré,lors du recensement de 2001,la majeure partie des arbres haute-tige.
En deuxième position,il y a les céréales;on dénombre 1'850 variétés locales,populations et lignées méritant d’être sauvegardées:orge (800),blé (440),épeautre (400), triticale (200) et seigle (10).Concernant le secteur des légumes,c’est moins la diversité des variétés qui ressort que celle des espèces;non loin de 100 espèces sont (ou ont été) cultivées en Suisse.
La véritable richesse de la biodiversité agricole de la Suisse réside dans les plantes fourragères.Selon les estimations des spécialistes,il existe plus de 13'000 variétés, lignées et populations locales.Cette très grande diversité génétique,concernant les plantes fourragères,s'explique par les caractéristiques climatiques,pédologiques et géographiques très variées des différentes régions du pays.L’inventorisation des plantes fourragères exige beaucoup de temps,car,contrairement aux autres groupes de cultures enregistrées dans le PAN,il s’agit d’examiner non pas des plantes individuelles,mais des populations adaptées aux sites les plus variés.Le programme PAN soutient actuellement des projets de sauvegarde concernant le trèfle violet,l’esparcette,la fétuque des prés et le ray-grass.Cependant,la préservation des plantes fourragères a lieu avant tout par le biais des SCE (prairies et pâturages extensifs,pâturages boisés ainsi que prairies peu intensives).
FruitsCéréalesMaïsLégumesBaiesVignesPommes de terre Nombre de variétés et de lignées Source: CPC 0 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 2803 1850 410400300 111100 1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 92
Variétés et lignées comprises dans le PAN
■ Ressources zoogénétiques:concept visant la préservation de la diversité des races de rente
De 1996 à 1998,un groupe de travail,mandaté par l’OFAG,a recensé le nombre d’animaux de rente élevés en Suisse,puis a procédé à l’évaluation des races notamment en ce qui concerne le risque de disparition et a élaboré un concept visant à la préservation de la diversité des races.
Comptant environ 90 races de bovins,chevaux,porcs,moutons et chèvres,la Suisse bénéficie d’une diversité impressionnante d’animaux de rente.Mais seules 24 d’entreelles peuvent être reconnues comme originaires de Suisse ou traditionnelles (races élevées par tradition depuis au moins 50 ans en Suisse,preuves à l’appui).Elles sont les mieux adaptées à nos conditions topographiques et climatiques et font partie du paysage traditionnel de notre pays.
Depuis 1999,la Confédération et les cantons soutiennent la mise en œuvre de ce concept par des contributions.Des programmes de sauvegarde sont mis sur pied, depuis lors,pour toutes les races suisses appartenant aux espèces bovine,chevaline, porcine,ovine et caprine qui,selon des critères internationaux,sont considérées comme menacées de disparition.Les races concernées sont la vache d’Evolène,le mouton de l’Engadine,le mouton de l’Oberland grison,le mouton Miroir,le mouton Roux du Valais,la chèvre Bottée,la chèvre de l’Appenzell,la chèvre Grisonne à raies et la chèvre de Paon.En outre,des mesures préventives ont été approuvées pour le cheval de la race des Franches-Montagnes,la vache Brune originale,le porc amélioré du pays, la chèvre Col noir du Valais et la chèvre Nera Verzasca.De plus,les programmes destinés à l’encouragement des races de poules et d’abeilles menacées de disparition bénéficient d’un soutien financier.
de races faisant l'objet de projets
Source:
Moutons Chèvres Bovins Porcs Chevaux Abeilles 2004 2003 2002 2001 2000 1999 0 6 4 5 3 2 1 1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE 93
Nombre
OFAG
Les projets sont réalisés par des organisations d’élevage reconnues et sont soumis à la haute surveillance de la Confédération.La plupart des races bénéficient d’activités destinées à une préservation in situ (dans la région d’origine).En outre,une conservation par le biais de banques de semences (ex situ) est prévue pour la vache d'Evolène, le cheval des Franches-Montagnes et les races de chèvres du pays.
En 2002,un groupe de travail pluridisciplinaire a,sur mandat de l’OFAG,analysé et évalué une nouvelle fois la situation et montré dans quels domaines des mesures s’imposaient encore.Le rapport qui en est résulté représente une contribution au rapport sur la situation mondiale des ressources zoogénétiques,élaboré par la FAO et dont la parution est prévue pour 2007.
Depuis le début de l’encouragement des projets concernant la préservation de la diversité des races,une quarantaine de demandes représentant 17 races au total ont été soumises à l’OFAG et évaluées par une commission d’experts externe.30 demandes satisfaisaient aux exigences requises pour l’octroi d’une contribution de soutien. L’année dernière,12 races de rente indigènes ont participé à des programmes de sauvegarde.Ainsi que le montre une évaluation intermédiaire de projets arrivés à terme,le bilan des mesures de sauvegarde prises à ce jour peut être qualifié de positif. Pour toutes les races,il a été possible soit d’augmenter le cheptel,soit d’en stopper la diminution.
1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 94
1.3.2Ethologie
Participation aux programmes de garde d’animaux SRPA et SST

Les deux programmes «Sorties régulières en plein air» (SRPA) et «Systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux» (SST) encouragent la garde d'animaux de rente particulièrement respectueuse de l'espèce.Le premier est essentiellement axé sur les sorties au pâturage,au parcours ou dans l’aire à climat extérieur pour la volaille.Le second pose surtout des exigences qualitatives en matière d’aires de repos et de liberté de mouvement (entre autres,pas de stabulation entravée).La participation à ces programmes est facultative.
Depuis l’instauration de SRPA en 1993 et de SST en 1996,la participation à ces programmes de garde n’a cessé de croître.Ainsi,pour le premier,le nombre d'adhérents a passé de 4'500 à 37'400,de 1993 à 2004,et pour le second,il a passé de 4'500 à 19'600,de 1996 à 2004.
■■■■■■■■■■■■■■■■
1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 95
Tableaux 37–38,pages A42–A43
Entre 1996 et 2004,le pourcentage des animaux gardés selon les exigences SRPA a bondi de 19 à 68%.Dans le même laps de temps,cette part a progressé de 9 à 37% pour le programme SST.Il s'agit de valeurs moyennes pour les quatre catégories d'animaux concernées (bovins,autres herbivores,porcs,volaille).
Participation au programme SRPA en 2004
La ventilation de la participation au programme SRPA selon la catégorie
et le nombre d’exploitations montre qu’en ce qui concerne les bovins,le nombre d'exploitations et d'UGB est pratiquement égal.S’agissant des autres catégories,ce sont en majorité les exploitations détenant des effectifs supérieurs à la moyenne qui ont participé au programme SRPA.
d’animaux
Part d'UGB en % SRPASST Source: OFAG 1996199719981999 0 60 70 80 50 40 30 20 10 2000 2001 200220032004
Evolution de la participation aux programmes SRPA et SST
en % Part d'animaux
Source: OFAG BovinsAutres herbivores PorcsVolaille 0 70 80 90 60 50 40 30 20 10 1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 96
(en UGB)Part d'exploitations
Le nombre d’animaux des exploitations SST gardant de la volaille,des herbivores autres que des bovins,ainsi que des porcs a davantage dépassé la moyenne suisse que dans le programme SRPA.En ce qui concerne la volaille,il est frappant de constater que 18% des exploitations ont gardé 81% des animaux selon les prescriptions SST en 2004.A l’inverse,la part des exploitations a été plus élevée que le nombre d’animaux pour ce qui est des bovins.Cela signifie que de nombreuses exploitations avec des effectifs de bovins peu élevés ont pris part au programme SST.

de la participation au programme SRPA,
La proportion d'animaux gardés selon les exigences SRPA a augmenté entre 1996 et 2004 pour toutes les catégories d'animaux,excepté la volaille.Le recul dans cette catégorie s'explique d'une part par le nombre moins élevé de poulets de chair gardés selon ce programme,de l'autre par le fait que l'augmentation de l'effectif total de volaille a été plus forte que la participation au programme SRPA.Le recul constaté auprès des poulets de chair s'explique probablement par l'exclusion des poulets dont l'engraissement dure moins que 56 jours.
en % Part d'animaux (en UGB)Part d'exploitations Source: OFAG BovinsAutres herbivores PorcsVolaille 0 80 90 70 60 50 40 30 20 10
Participation au programme SST en 2004
par groupe d'animaux Part d'UGB en % Source: OFAG Bovins Autres herbivores PorcsVolaille 199619971998199920012002 2000 0 70 80 90 50 60 40 30 20 10 20032004 1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE 97
Evolution
Evolution de la participation au programme SST, par groupe d'animaux
Une des caractéristiques de la participation au programme SST est la part importante de la volaille.La raison principale est le succès des labels existants sur le marché.Le programme SST n’a été introduit pour les porcs qu’en 1997,et le développement a également été très réjouissant dans ce domaine,le pourcentage de porcs gardés dans des étables SST a passé,de l'introduction du programme à 2004,de 8 à 61%.

1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 98
Part d'UGB en % Source: OFAG Bovins Autres herbivores PorcsVolaille 1996199719981999200120022003 2004 2000 0 80 90 50 60 70 40 30 20 10
■ Situation de départ
1.4 Appréciation de la durabilité
La Constitution fédérale de 1999 exige que des considérations concernant la durabilité soient prises en compte dans tous les domaines politiques (art.2 et 73).Dès 1996,le principe de la durabilité a été inscrit dans l’article constitutionnel agricole (art.104).
L’ordonnance sur l'évaluation de la durabilité de l'agriculture prévoit que l’OFAG présente,dans le rapport agricole,la situation de l’agriculture et les résultats de la politique agricole sous l’angle de la durabilité.Son rapport établi avec des indicateurs se fonde pour la première fois sur un concept présenté dans le Rapport agricole 2001. Un compte rendu est prévu tous les quatre ans.
■ Concept d’évaluation
Le concept présenté dans le Rapport agricole 2001 tient compte d’autres travaux concernant l’évaluation de la durabilité.Il permet une évaluation ex ante selon la méthode développée par l’Office fédéral du développement territorial (ODT) pour évaluer la durabilité de projets de grande envergure (cf.références bibliographiques dans l’encadré).
Références bibliographiques concernant le développement durable et l’évaluation de la durabilité:
–Mauch Consulting,INFRAS,Ernst Basler und Partner AG,Politik der nachhaltigen Entwicklung in der Schweiz:Standortbestimmung und Perspektiven (im Auftrag des IDARio),2001
–OFS/OFEFP/ODT,MONET (Monitoring du développement durable) Rapport final, Méthodes et résultats,2003
–OFS,Le développement durable en Suisse – Indicateurs et commentaires,2003
–ODT,Evaluation de la durabilité:Conception générale et bases méthodologiques,2004
–Commission européenne,Direction générale de l'agriculture,Cadre pour des indicateurs relatifs aux dimensions économique et sociale d'une agriculture et d'un développement rural durables,2001
1.4 APPRÉCIATION DE LA DURABILITÉ 1 99 1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE ■■■■■■■■■■■■■■■■
La durabilité est un concept axé sur l'avenir et sur les ressources,qui vise à assurer aux générations futures les ressources nécessaires à satisfaire leurs besoins.Il faut,pour cela,préserver une certaine quantité de ressources d’une qualité donnée.Par ressources,on entend les ressources naturelles,humaines (savoir) ou investies (capital financier investi dans des actifs à long terme).
Etant donné que les besoins quantitatifs et qualitatifs des générations à venir ne sont pas connus et qu’il est impossible de prévoir l'influence du progrès technique sur la productivité des ressources et la mesure dans laquelle celles-ci seront substituées,on ne peut déterminer la quantité et les genres de ressources qu'il convient de préserver. Le tarissement des agents énergétiques fossiles est toutefois prévisible.A titre de précaution,il convient donc de rechercher des moyens de substituer des ressources naturelles renouvelables aux ressources non renouvelables.Il faut par ailleurs veiller à ce que les ressources renouvelables soient utilisées de sorte à pouvoir se régénérer;les ressources humaines (savoir) et les ressources investies doivent être continuellement renouvelées.La pénurie de ressources naturelles en particulier impose leur utilisation efficace.
Ces critères sont nécessaires mais pas suffisants pour assurer la durabilité.Leur application peut,certes,conduire à un bien-être intergénérationnel maximum,mais elle n’empêche pas les déséquilibres dans la répartition de ce bien-être.C’est pourquoi,la répartition équitable du bien-être,non seulement entre la génération actuelle et les générations futures,mais aussi à l’intérieur de la génération actuelle,est un élément primordial du concept de durabilité.
Eléments du concept de développement durable:
– Ressources: utilisation des ressources naturelles,compte tenu de réserves minimales;remplacement de ressources naturelles non renouvelables par des ressources naturelles renouvelables et ménagement de ces dernières;renouvellement continuel des ressources humaines (savoir) et des ressources investies (capital).
– Efficience: efficience dans le processus de transformation entre intrants et extrants à tous les échelons du processus de fourniture de prestations.
Equité: répartition intra- et intergénérationnelle équitable du bien-être (il existe un lien étroit entre l’équité intergénérationnelle et la transmission d’une certaine quantité de ressources,la première étant un objectif et la seconde le moyen de le réaliser).
–
100 1.4 APPRÉCIATION DE LA DURABILITÉ 1
■ Présentation des résultats
Les indicateurs de la durabilité dans l’agriculture montrent si,dans des conditions générales déterminées (habitudes alimentaires,conditions-cadre définies par l’Etat), l’agriculture évolue vers la durabilité.Ils portent sur les thèmes précités (ressources, efficience,équité).L’importance de ces thèmes centraux varie en fonction de la dimension considérée de la durabilité (économie,écologie,social).La question des ressources (ressources naturelles,humaines et investies) joue un rôle capital dans les trois cas. L’efficience est le deuxième élément essentiel en ce qui concerne l’écologie et l’économie,et l’équité pour ce qui est du social.
Les indicateurs de la durabilité mentionnés ci-après ont été définis sur la base de travaux internes,de travaux du groupe d’accompagnement sur les indicateurs agroenvironnementaux et d’une expertise (Bürgenmeier Beat,Nachhaltigkeitsindikatoren der ökonomischen und sozialen Dimensionen in der Landwirtschaft,Gutachten zuhanden des BLW,2003):
Récapitulation des indicateurs de la durabilité
DimensionsEconomieSocialEcologie
Thèmes
Ressources
Renouvellement du capital
Formation
Biodiversité:
–Effets potentiels des pratiques agricoles sur la biodiversité –ou:compensation écologique de qualité
Eau:
–risque d’écotoxicité aquatique
Sol (quantité)
Efficience
Productivité du travail
Sol (qualité): –risque d’érosion –teneur en phosphore des sols
Emissions potentielles azotées
Efficience énergétique
Equité
Comparaison des revenus avec les autres groupes de la population
Comparaison de la qualité de vie avec les autres groupes de la population
Le développement des indicateurs n’est pas encore terminé en ce qui concerne l’écologie.Nous utilisons donc des indicateurs de substitution pour cette première évaluation.Ils sont présentés dans la partie consacrée à l’écologie.
1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE 1.4 APPRÉCIATION DE LA DURABILITÉ 1 101
Pour présenter l’évolution des indicateurs,nous avons repris les symboles utilisés par l’OFS dans le projet MONET:
Tendance (depuis 1990)Appréciation
➚ Augmentation+ Positive (vers la durabilité)
➘ Diminution– Négative (éloignement de la durabilité)

➙ Pas de changement majeur ≈ Neutre
~ Irrégulière ❏ Pas d’indication
Pour chaque indicateur,les flèches montrent la direction dans laquelle il doit évoluer pour que l’on puisse parler d’un développement durable.Ensuite,les mêmes flèches indiquent la tendance observée depuis 1990.La comparaison des deux symboles permet d’évaluer l’évolution.
1.4 APPRÉCIATION DE LA DURABILITÉ 1 102
Economie
Définition
Capital disponible à prix constants en 1990 / investissements en capital bruts à prix constants 1990.
Constatation
L’indicateur indique le nombre d’années qui serait nécessaire au renouvellement du capital disponible pour autant que les investissements en capital bruts demeurent inchangés.
Appréciation
Aujourd’hui,le capital disponible se renouvelle au même rythme qu’au début des années nonante,c’est-à-dire environ tous les 25 à 30 ans.Cela signifie que l’agriculture peut générer autant de moyens pour renouveler les bâtiments et les machines qu’il y a 10 à 15 ans.Tant le capital disponible que les investissements en capital bruts ont diminué d’environ 10%,ce qui est normal compte tenu de l’évolution structurelle de l’agriculture.
Vers la durabilitéTendance 1990–2004Appréciation
➙ Constant ➙ Pas de changement +Positive majeur
■ Renouvellement du capital Evolution du renouvellement du capital Années Source :OFS 199019941996199820002002 1993 1992 19911995199719992001 0 35 30 25 20 15 10 5 20032004 1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE 1.4 APPRÉCIATION DE LA DURABILITÉ 1 103
Définition
Surfaces qui se prêtent moyennement bien à très bien aux grandes cultures,selon les critères de la Carte des terres productives de la Suisse.D’après la statistique de la superficie,ces surfaces comprennent les prairies et les terres assolées facilement exploitables,les autres prairies et terres assolées ainsi que les pâturages attenants à la ferme;elles sont situées à une altitude inférieure à 900 m et leur déclivité est inférieure à 20%.Cet indicateur a été développé pour le projet MONET.
Constatation
L’indicateur trace l’évolution de la partie de la SAU qui est nécessaire afin que l’agriculture puisse contribuer substantiellement à l’approvisionnement de la population en denrées alimentaires.
Appréciation
Le recul de 2,1% des terres se prêtant aux grandes cultures correspond presque à la moitié du Lac de Neuchâtel.Pratiquement toutes ces surfaces ont été perdues par la rurbanisation et la construction d’infrastructures;elles sont dès lors en grande partie imperméabilisées et,partant,perdues à long terme pour l’exploitation agricole.La protection des sols arables est du ressort du droit sur l'aménagement du territoire (plan sectoriel des surfaces d'assolement).En effet,il n’existe pas d’instrument de politique agricole pour enrayer ce phénomène.Sur les autres terres assolées,l’influence de la politique agricole est positive.Elle a assuré une exploitation durable de ces surfaces.
Vers la durabilitéTendance 1990–2004Appréciation ➙ Constant ➘ Diminution –Négative (pas le résultat de la politique agricole) ■ Sol Evolution des terres arables 1979/19851992/1997 en ha Source: OFS 0 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 1.4 APPRÉCIATION DE LA DURABILITÉ 1 104
■
Définition
Création de valeur brute aux prix de revient constants de 1990 / total unités annuelles de travail.

Constatation
La productivité du travail reflète l’efficacité avec laquelle la main-d’œuvre est engagée dans l’agriculture suisse.L’augmentation de cette productivité est une condition essentielle à l’amélioration de la compétitivité.
Appréciation
L’évolution est positive.Compte tenu de la forte baisse de la main-d’œuvre utilisée (–26%) et du recul moins marqué de la valeur ajoutée brute (–10%),il en est résulté une hausse de la productivité du travail de 21%,soit de 1,4% par an entre 1990 et 2004.
Vers la durabilitéTendance 1990–2004Appréciation ➚ Augmentation ➚ Augmentation +Positive
Productivité
travail Evolution de la productivité du travail fr./UTA Source: OFS 199019941996199820002002 1993 1992 19911995199719992001 0 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 20032004 1.4 APPRÉCIATION DE LA DURABILITÉ 1 105
du
■ Formation
Social
Définition
Part des exploitants disposant d’expérience pratique et ayant suivi une formation de base et une formation continue.
Constatation
Cet indicateur présente la manière dont évolue le niveau de formation des chefs d’exploitation.En termes de durabilité,l’évolution est positive lorsque la part de personnes ayant suivi une formation augmente.
Appréciation
Environ deux tiers des exploitants avaient,en 2003,suivi une formation de base ou une formation continue.Pour des raisons relevant de la méthode,ces chiffres les plus récents ne sont pas directement comparables avec les relevés antérieurs.
Vers la durabilitéTendance 1990–2004Appréciation
➚ AugmentationPas d’indication possible ❏ Pas d’indication car il n’existe qu’un mesurage
Niveau de formation 2003 en % Source: OFS Formation continue Formation de base Expérience pratique 0 100 80 60 40 20 1.4 APPRÉCIATION DE LA DURABILITÉ 1 106
Définition
Revenu du travail par UTAF / salaire de référence.
Constatation
Cet indicateur montre l’évolution des différences de revenu entre la population agricole et la population non agricole.Du point de vue de la durabilité,il serait optimal si le rapport évoluait en direction de 1 (la rétribution de l’unité de travail engagée dans l’agriculture est environ la même que celle de l’unité de travail engagée dans les autres secteurs économiques) et que ce rapport reste constant.
Appréciation
L'écart entre les revenus des agriculteurs et ceux du reste de la population s'est creusé entre 1990 et 2004.Il s’était agrandit avant la réforme agricole de 1993,par le découplage des prix et des revenus,et atteignit son point le plus bas en 1995.Depuis 1997, il est resté plus ou moins constant.Les familles paysannes ont partiellement compensé leur perte de pouvoir d'achat en exerçant une activité lucrative en dehors du secteur agricole.Mais elles ont aussi réduit leur consommation,qui a reculé d’environ 9% en termes réels.
1990–2004Appréciation
Vers
➚ Augmentation ➘ Diminution –Négative
la durabilitéTendance
■ Comparaison des revenus avec les autres groupes de la population
en %
Evolution du rapport entre le revenu du travail par UTAF et le salaire de référence
199019941996199820002002 1993 1992 19911995199719992001 0 100 80 60 40 20 20032004 1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE 1.4 APPRÉCIATION DE LA DURABILITÉ 1 107
Source: Agroscope FAT Tänikon
Définition
Indice de la qualité de vie de la population agricole / indice de la qualité de vie des autres groupes de la population.
Constatation
Cet indice montre comment la qualité de vie de la population agricole évolue,selon son autoévaluation,en comparaison de celle de la population non agricole.
L’indice porte sur les 12 sphères de la vie suivantes:travail professionnel,formation, formation continue,revenu,niveau de vie général,famille,contexte social,stabilité des conditions générales,loisirs,santé,temps disponible,offre culturelle.Il indique le rapport entre la satisfaction dans les diverses sphères de la vie et l'importance qui leur est accordée (multiplication de la somme des valeurs).
Appréciation
L’indice 2005 de la qualité de vie est plus bas pour la population agricole que pour les autres groupes de la population.L’écart est significatif.Il s’explique surtout par la plus grande insatisfaction de la population agricole en ce qui concerne les loisirs et le temps disponible.Le degré de satisfaction du groupe agricole est égal à celui du groupe de référence dans deux domaines (santé et conditions-cadre politiques et économiques), un peu plus élevé dans quatre domaines (famille,travail,formation et perfectionnement) et un peu moins élevé dans quatre domaines également (contexte social,niveau de vie général,offre culturelle,revenu).

Vers la durabilitéTendance
➚ AugmentationPas d’indication possible ❏ Pas d’indication car il n’existe qu’un mesurage ■
2005 en %
1990–2004Appréciation
Comparaison de la qualité de vie avec les autres groupes de la population Indice de la qualité de vie 2005
0 100 80 60 40 20 1.4 APPRÉCIATION DE LA DURABILITÉ 1 108
Source: Institut GfS Zurich
Indice
de la qualité de vie: rapport entre la population agricole et les autres groupes de la population
Ecologie
Les indicateurs retenus pour l'évaluation du volet environnemental de la durabilité de l'agriculture sont pour la plupart en phase de développement et nécessitent encore plusieurs années de travaux.Des indicateurs de substitution ont été sélectionnés afin de les remplacer pendant cette période transitoire.
Indicateurs de durabilitéIndicateurs publiés en 2005
Effets potentiels des pratiques agricoles sur la biodiversité ou compensation écologique de qualité

Risque d'écotoxicité aquatique
Risque d'érosion
Teneurs en phosphore des sols
Emissions potentielles azotées
Efficience énergétique
Surfaces de compensation écologique
Ventes de produits phytosanitaires -
Efficience du phosphore (sur la base du bilan P,OSPAR)
Efficience de l'azote (sur la base du bilan N,OSPAR)
Efficience énergétique
1.4 APPRÉCIATION DE LA DURABILITÉ 1 109
Définition
Surfaces de compensation écologique imputables (donnant et ne donnant pas droit aux contributions),sans les arbres fruitiers haute-tige,par zone agricole.
Constatation
Les surfaces de compensation écologique sont des habitats semi-naturels pour de nombreuses espèces sauvages.Elles contribuent au maintien de la diversité biologique, qui est une prestation environnementale en soi et assure à long terme la stabilité des écosystèmes.Cette prestation est une ressource essentielle pour l'humanité et les générations futures,en particulier pour l'agriculture,l'alimentation,la médecine et l'industrie.
Appréciation
En 2004,11% environ de la surface agricole utile (SAU) étaient aménagés comme surfaces de compensation écologique (région de montagne 14%;région de plaine 9%).Les habitats existants ont ainsi été maintenus et leur valeur écologique s'est parfois améliorée.De nouvelles surfaces de compensation écologique ont aussi été crées,en particulier en région de plaine.
1.4 APPRÉCIATION DE LA DURABILITÉ 1 110
Vers la durabilitéTendance 1990–2004Appréciation ➚ Augmentation ➚ Augmentation +Positive ■ Surfaces de
tion écologique Surfaces de compensation écologiques imputables 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 en 1 000 ha SAU montagne SAU plaine Source: OFAG 0 140 120 100 80 60 40 20
compensa-
Définition
Quantité totale de produits phytosanitaires vendus,exprimée en tonnes de substances actives.
Constatation
Les ventes de produits phytosanitaires sont une valeur sommaire indiquant le risque d'émissions dans l'environnement,en particulier dans l'eau,le sol et l'air,ainsi que les effets de ces émissions sur la biodiversité.
Appréciation
Les ventes de produits phytosanitaires ont chuté d’environ 40% depuis 1990.Ce recul s’explique par l’optimisation de l’emploi des produits phytosanitaires du fait de la production intégrée et par l’application de nouveaux produits présentant une plus grande efficacité biologique et permettant de réduire les quantités utilisées.Il n’est cependant pas possible de tirer directement des conclusions sur l’écotoxicité à partir de la quantité de substances actives.
1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE 1.4 APPRÉCIATION DE LA DURABILITÉ 1 111
Vers la durabilitéTendance 1990–2004Appréciation ➘ Diminution ➘ Diminution +Positive
Ventes
phytosanitaires Evolution des ventes de produits phytosanitaires en t de substance active 1990 1994 1996 1998 2000 2002 1993 1992 1991 1995 1997 1999 2001 0 2 500 2 000 1 500 1 000 500 2003 2004
■
de produits
Fongicides, bactéricides, désinfectants des semences Herbicides Insecticides, acaricides Régulateurs de croissance Rodenticides
Source: Société suisse de l'industrie chimique
■
Définition
La méthode appliquée pour établir le bilan de phosphore et pour mesurer l’efficience est la même que pour l'azote.
Constatation
Le phosphore est une ressource non renouvelable.Comme les réserves mondiales de cette substance sont limitées,une haute priorité est accordée à leur ménagement du point de vue de la durabilité.Il importe si possible d’éviter des excédents dans le bilan.
Appréciation
L’excédent du bilan de phosphore a diminué de presque deux tiers ces dix dernières années,passant à 6'270 t aujourd’hui.Ce résultat s’explique surtout par la forte baisse de l’utilisation d’engrais minéraux phosphatés.L’efficience de l’utilisation de phosphore dans l’agriculture s’est accrue pendant cette période,passant d’environ 25% à 55% à l’heure actuelle.L’excédent encore présent indique toutefois que des problèmes subsistent dans l’exécution,en rapport avec l’équilibre du bilan de fumure.On observe encore des pollutions régionales par l’apport de phosphore dans les lacs,en particulier dans le lac de Hallwil et le lac de Baldegg.
1.4 APPRÉCIATION DE LA DURABILITÉ 1 112
Vers la durabilitéTendance 1990–2004Appréciation ➚ Augmentation ➚ Augmentation +Positive
Efficience
Efficience P Evolution de l'excédent de phosphore et de l'efficience du phosphore 199019911992 1993199419951996199719981999200020012002 Excédent P Source: Agroscope FAL Reckenholz 0 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 en t P en % 0 100 90 80 70 60 30 50 40 20 10
du phosphore
■ Efficience de l’azote
Définition
L'efficience de l'azote est déterminée par le rapport entre les sorties et les entrées, conformément au bilan N,les sorties étant exprimées en pour-cent des entrées.
Le cycle de l'azote est un processus complexe et dynamique pour lequel diverses modélisations ont été élaborées.Le bilan de l'azote calculé selon la méthode OSPAR considère l'agriculture suisse comme une seule exploitation.Les entrées azotées annuelles sont issues des engrais minéraux,des aliments pour animaux et semences importés,des engrais à base de déchets et autres engrais,ainsi que de la fixation et de la déposition d'azote.Les sorties se composent de l'azote contenu dans les denrées alimentaires végétales ou animales et d'autres produits commercialisables quittant l'exploitation.
Constatation
L’amélioration de l’efficience a pour effet de diminuer,entre autres,la part d’azote qui se volatilise dans l’air sous forme d’ammoniac ou s’infiltre dans la nappe phréatique sous forme de nitrate.On estime que dans les conditions actuelles de l’agriculture et compte tenu des processus déterminés par les conditions naturelles,l’efficience de l’azote pourra progresser de 30% au maximum.L’utilisation efficiente de l'azote permet de limiter les émissions azotées par unité produite (output) dans l'environnement,en particulier dans l'eau et l'air.
1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE 1.4 APPRÉCIATION DE LA DURABILITÉ 1 113
Efficience N Evolution des inputs, des outputs et de l'efficience N selon la méthode OSPAR 199019911992 1993199419951996199719981999200020012002 Input Source: Agroscope FAL Reckenholz Output 0 200 160 120 80 40 en 1 000 t N en % 0 30 25 20 10 15 5
■ Efficience énergétique
Appréciation
L’excédent d’azote dans l’agriculture a diminué de quelque 13% depuis 1990 (132'000 t) et s’élève encore à 115'000 t aujourd’hui.Ce recul s’explique notamment par la réduction de l’apport d’engrais minéraux azotés et par la diminution de la déposition d’azote.Cependant,cette évolution s’est interrompue ces dernières années. L’efficiencedans l’utilisation d’azote s’est améliorée de 1990 à 2002,passant d’environ 22% à 27%,mais a stagné les dernières années.
Vers la durabilitéTendance 1990–2004Appréciation
Définition
L'efficience énergétique de l'agriculture suisse se calcule selon la méthode Ecobilan, développée par le Service romand de vulgarisation agricole.L'énergie consommée se compose des ressources énergétiques non renouvelables contenues dans les bâtiments,les machines,l’électricité,les autres énergies fossiles,les engrais,les pesticides,ainsi que les fourrages et semences.Le rapport entre l’énergie consommée et l’énergie alimentaire produite donne l’efficience énergétique.

Constatation
Les réserves d’énergie fossile sont limitées.Qui plus est,leur combustion produit le gaz à effet de serre CO2.Sous l’angle de la durabilité,il est donc indiqué d’utiliser cette énergie avec efficience.Il faut par ailleurs veiller à ce que les agents énergétiques fossiles soient remplacés à temps par des ressources énergétiques renouvelables.
1.4 APPRÉCIATION DE LA DURABILITÉ 1 114
➚ Augmentation ➚ Augmentation +Positive
Appréciation
Après une diminution au milieu des années nonante,on note à nouveau une tendance à l'augmentation de la consommation d'énergie.Depuis 1990,l'efficience énergétique de l'agriculture se situe autour de 40%,avec de légères variations annuelles.
Il est positif de constater que l’efficience énergétique n’a pas subi de changement majeur,malgré le recul considérable de la main-d’œuvre engagée pendant la période en question.En termes de durabilité,il est toutefois négatif que l’utilisation d’énergie fossile n’ait pas diminué.Ce n’est pas étonnant,car les conditions générales n’incitent actuellement guère à substituer l’énergie fossile,mais la politique agricole ne peut influer sur ces conditions-cadres.
1.RÔLEETSITUATIONDEL’AGRICULTURE 1.4 APPRÉCIATION DE LA DURABILITÉ 1 115
Vers la durabilitéTendance 1990–2004Appréciation ➚ Augmentation ➙ Pas de changement –Négative majeur Efficience énergétique
199019911992 19931994199519961997199819992000200120022003 Consommation énergie totale Energie de la production alimentaire Source: SRVA 0 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 MJ/ha TJ fossile / TJ alimentaire (%) 0 100 90 80 70 60 30 50 40 20 10
Evolution de la consommation énergétique, de l'énergie de la production alimentaire et de l'efficience énergétique
Du point de vue de la durabilité,le bilan global est mitigé.Sur le plan économique,la productivité du travail s’est améliorée.De même,il est positif de constater que les investissements effectués dans des bâtiments,des machines et des installations,par rapport au capital total,sont restés stables depuis 1990.Par contre,la diminution des terres fertiles,un facteur de production à la fois essentiel et non reproductible,est un point négatif.Elle ne procède toutefois pas de la politique agricole.Dans le domaine social,l’écart de revenus entre la population agricole et les autres groupes de la population s’est creusé,ce qui est négatif en termes de durabilité.Il convient toutefois de noter qu’il s’accroissait avant la réforme agricole et qu’il est resté assez constant depuis.Les deux autres indicateurs ne permettent pas encore de tirer des conclusions, car il n’existe qu’un mesurage.L’indice de la qualité de la vie,qui est plus bas en ce qui concerne la population agricole,doit être suivi attentivement.Il ne doit en effet pas baisser davantage.S’agissant de l’écologie,les tendances vont toutes en direction de la durabilité,à l’exception de l’indicateur concernant l’énergie.Des améliorations sont néanmoins nécessaires dans tous les domaines.C’est notamment le cas de l’efficience énergétique,de par l’ampleur et l’urgence du problème.La production agricole,à l’instar d’ailleurs de la production de biens et de la fourniture de prestations en général,repose dans une large mesure sur l’utilisation d’énergie fossile.Or,dans un avenir prévisible,celle-ci ne sera plus disponible dans la quantité actuelle.Sous l’angle de la durabilité,son remplacement par des ressources énergétiques renouvelables représente donc un défi primordial.Il ne peut toutefois être résolu par le biais de la politique agricole,mais doit être abordé dans le cadre de la politique énergétique.Il en va de même pour l’évolution négative concernant l’indicateur sol.A cet égard,c’est l’aménagement du territoire qui est sollicité.
Evolution des indicateurs de la durabilité depuis 1990
DimensionsIndicateursAppréciation
EconomieRenouvellement du capital+ Positive Sol (quantité)– Négative (pas le résultat de la politique agricole)
Productivité du travail+ Positive
SocialFormation ❏ Pas d’indication
Comparaison des revenus avec – Négative les autres groupes de la population
Comparaison de la qualité de vie ❏ Pas d’indication avec les autres groupes de la population
EcologieSurfaces de compensation + Positive
écologique
Vente de produits phytosanitaires+ Positive
Efficience du phosphore+ Positive
Efficience de l’azote+ Positive
Efficience énergétique–Négative
116 1 ■■■■■■■■■■■■■■■■ 1.4.1
Bilan

■■■■■■■■■■■■■■■■ 2.Mesures de politique agricole 117 2
On a rangé les mesures de politique agricole dans trois domaines:
– Production et ventes: les mesures prises dans ce domaine visent à créer les conditions-cadres appropriées pour la production et l’écoulement des denrées alimentaires.Les dépenses consenties par la Confédération pour la production et les ventes de produits agricoles diminuent continuellement.En 2004,elle y a affecté un montant de 731 millions de francs,soit presque un milliard de moins qu’avant le début de la réforme agricole dans les années 1990/92.
– Paiements directs: ces paiements sont considérés comme une rétribution des prestations en faveur de la collectivité,au rang desquelles figurent l’entretien du paysage,la sauvegarde des bases naturelles de l’existence,la contribution à une occupation décentralisée du territoire ainsi que des prestations écologiques particulières.Les prix payés pour les denrées alimentaires ne comprennent pas ces prestations car le marché correspondant est inexistant.Par le biais des paiements directs, l’Etat s’assure le concours de l’agriculture pour fournir des prestations d’intérêt général.
– Amélioration des bases de production: il s’agit de mesures permettant à la Confédération de promouvoir et de soutenir une production de denrées alimentaires respectueuse de l’environnement,sûre et efficiente.Elles concernent l’amélioration des structures,les domaines de la recherche et de la vulgarisation,ainsi que ceux des matières auxiliaires et de la protection des végétaux et des variétés.
118 2.MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE 2
2.1 Production et ventes
Conformément à l’art.7 LAgr,qui fixe les objectifs relatifs à la production et à la vente de produits agricoles,l’agriculture doit être en mesure d’assurer une production durable et peu coûteuse ainsi que de tirer des recettes aussi élevées que possible de la vente des produits.Pour qu’elle en ait les moyens,la Confédération peut prendre des mesures dans les domaines qualité,promotion des ventes et désignation,importation et exportation,économie laitière,production animale,production végétale et économie viti-vinicole.
En 2004,731 millions de francs ont été consacrés à la promotion de la production et des ventes.Par rapport à l’année précédente,cela représente une diminution des dépenses de 67 millions de francs,soit de 8,4%.

Dépenses pour la production et les ventes
■■■■■■■■■■■■■■■■
Comptes 2004Budget 2005 Poste de dépensesMontantPartMontantPart mio.de fr.%mio.de fr.% Promotion des ventes648,8578,3 Economie laitière50469,247469,3 Economie animale223,1284,1 Production végétale (viticulture comprise)14218,912518,3 Total731100684100
d’Etat,OFAG
Sources:Compte
2.1 PRODUCTION ET VENTES 119 2
■ Moyens financiers en 2004
■ Le soutien aux interprofessions encourage les démarches communes
2.1.1 Instruments transversaux
Interprofessions et organisations de producteurs
Les interprofessions et les organisations de producteurs sont des forums de discussion, de négociation et de coordination pour les partenaires du secteur agroalimentaire,où les orientations stratégiques pour le positionnement des produits peuvent être définies.Ces forums donnent aux producteurs la possibilité de participer aux décisions sur le marketing mix et sur certaines règles concernant le fonctionnement des marchés. En outre,la mise en commun des ressources,souvent limitées au niveau des entreprises,permet de disposer au niveau collectif de services performants (promotion des ventes,observation des marchés,contrôle de la qualité,information,conseil d’entreprise,etc.).
La LAgr (art.8 et 9) habilite le Conseil fédéral à rendre obligatoires pour les nonmembres des mesures décidées en commun par les interprofessions et les organisations de producteurs,concernant l’amélioration de la qualité,la promotion des ventes et l’adaptation de l’offre à la demande.On parle alors «d’extension» des mesures collectives.Le soutien du Conseil fédéral se justifie pour les mesures qui profitent à l’ensemble d’un secteur ou d’une branche et dont les membres de l’organisation ne peuvent se réserver le bénéfice (problème des profiteurs ou «passagers clandestins»).
Sans l’intervention du Conseil fédéral,les entreprises ne participant pas aux mesures, mais en profitant néanmoins,empêcheraient rapidement toute initiative collective.Par son action,le Conseil fédéral encourage ainsi le regroupement des forces.A certaines conditions,les interprofessions peuvent aussi publier des prix indicatifs (art.8a LAgr). Les mesures prévues aux art.8 et 9 LAgr,qui permettent au Conseil fédéral de soutenir subsidiairement les acteurs du secteur alimentaire,renforcent la position des producteurs dans la définition des produits et les négociations commerciales.
■ L’extension des mesures est soumise à des conditions sévères
Les conditions à remplir pour bénéficier d’une extension sont strictes:(1) les mesures sont ou risquent d’être compromises par des entreprises qui en bénéficient sans les appliquer ou sans participer aux coûts;(2) l’organisation n’a pas le droit d’exercer ellemême une activité commerciale;(3) elle doit être représentative et (4) elle doit avoir adopté les mesures à la grande majorité de ses membres.L’ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs définit les modalités d’exécution.Les conditions relatives à la représentativité d’une organisation et au processus de décision sont particulièrement sévères:les décisions doivent être prises,à la majorité des deux tiers,par l’assemblée des délégués,ceux-ci ayant été élus démocratiquement par la base.Lorsqu’il s’agit d’une interprofession,une majorité de deux tiers des délégués à tous les niveaux est requise pour chaque décision.Ces exigences témoignent de l’importance que le Conseil fédéral attache à la légitimité et à la transparence des organisations.En outre,les mesures dont l’extension est demandée doivent impérativement bénéficier à toutes les entreprises d’une filière et ne doivent pas générer de distorsions de la concurrence entre partenaires commerciaux.
■■■■■■■■■■■■■■■■
2.1 PRODUCTION ET VENTES 2 120
■ Quelques années de recul pour juger cet instrument
Le Conseil fédéral a rendu les premières décisions d’extension en 2001.Les expériences faites depuis lors sont globalement positives.La cohésion des filières s’est trouvée renforcée grâce à la maîtrise efficace du problème des passagers clandestins. Les organisations doivent toutefois s’attendre à des recours de la part d’entreprises qui refusent de se soumettre aux mesures collectives,ce qui en retardera l’application par ces entreprises.L’interprofession Emmentaler Switzerland,en particulier,a été confrontée à ce problème.Deux cas sont encore en suspens au Tribunal fédéral.Jusqu’ici, les autorités judiciaires ont soutenu la mise en oeuvre pratiquée par le Conseil fédéral.
Cet instrument nécessite néanmoins des améliorations régulières.Aussi l’ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs est-elle régulièrement adaptée à la pratique et à l’évolution du droit.Les organisations au bénéfice d’une extension des mesures doivent présenter chaque année au DFE un rapport sur la mise en œuvre et les résultats.L’Inspectorat des finances de l’OFAG procède aussi à des contrôles afin de garantir que les contributions versées par les non-membres servent effectivement à financer les mesures collectives prévues.En 2005,trois organisations de producteurs (Union suisse des paysans,Producteurs suisses de lait,GalloSuisse) et quatre interprofessions (Interprofession du Gruyère,Interprofession du Vacherin fribourgeois,Emmentaler Switzerland,Sbrinz GmbH) bénéficient d’une telle extension. Celle-ci peut être prorogée,mais elle doit alors faire l’objet d’une réévaluation.
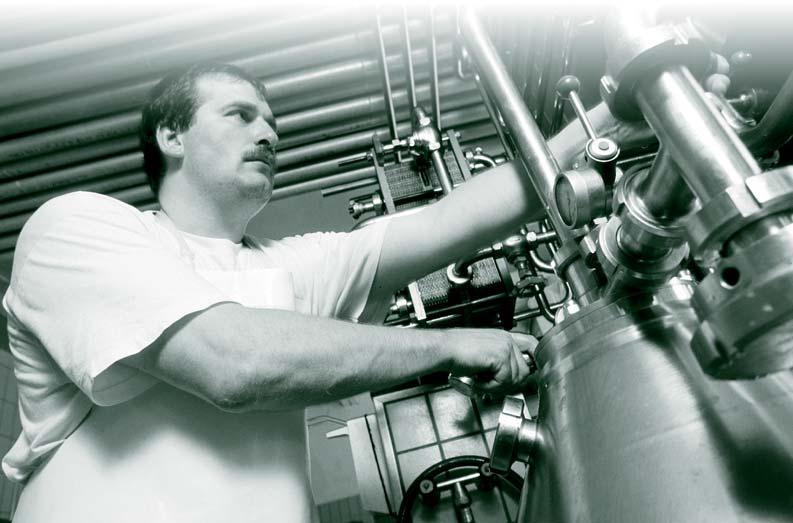
2.1 PRODUCTION ET VENTES 121 2
■ Importance croissante de la communication
Promotion des ventes
La promotion des ventes de produits agricoles commence par la communication marketing.La Confédération ne soutient,dans le marketing mix,que les mesures de communication,afin d’éviter les distorsions de la concurrence.Elle ne participe en outre qu’à raison de 50% au maximum au financement de ces mesures.Ce soutien au titre de la promotion des ventes est subsidiaire,car il importe de responsabiliser les acteurs et de les inciter à s’organiser.
En raison de la concurrence accrue dans l’agriculture,il devient de plus en plus important de prendre des mesures de communication efficaces (do the right thing) et efficientes (do the things right) pour mettre en valeur les atouts.Il faut aussi engager de manière économique les ressources financières de plus en plus restreintes de la Confédération.D’où la nécessité d’accorder davantage de poids aux coûts lors de l’évaluation de l’impact des mesures.
■ Impact de la promotion des ventes
Les mesures prises par la Confédération pour promouvoir les ventes produisent l’effet souhaité.Il a été possible de préserver,voire de renforcer la préférence des consommateurs pour les produits suisses,bien que l'écart des prix à la consommation par rapport aux pays voisins se creuse et que les importations leur fassent de plus en plus concurrence.L’agriculture suisse a commencé à renforcer sa présence sur le marché ces dernières années.Elle a ainsi réussi à maintenir la bonne renommée de ses produits également à l’étranger.
L’impact de la promotion des ventes est partiellement indirect.Il serait souhaitable que l’effet de la publicité se manifeste concrètement dans le comportement des consommateurs,mais il est difficile d’établir un lien clair et net entre les dépenses et les effets, car ces derniers ne se produisent parfois qu’avec un certain retard.Par ailleurs,la communication n’est qu’un des éléments du marketing mix.Des facteurs exogènes, tels que l’évolution des prix ou de la concurrence et le comportement des concurrents, ont également une influence sur la valeur ajoutée et le volume des ventes.L’impact de la communication sur les ventes n’est cependant pas contesté sur le plan scientifique.
■ Contrôle plus approfondi des résultats
Un contrôle approfondi des résultats des projets de promotion des ventes est effectué dès 2005.Jusqu’ici,on se fondait essentiellement sur des enquêtes destinées à déterminer les préférences des consommateurs et sur les indications fournies à titre volontaire par les promoteurs.Depuis 2005,les promoteurs de tous les projets sont tenus de fournir à l’OFAG des données sur certains indicateurs.En outre,l’OFAG exige que l’on tienne compte du rapport entre l’impact des mesures et leur coût.Le contrôle porte donc sur l’efficacité à la fois des mesures et de l’utilisation des ressources.
Le contrôle des résultats sert aussibien de feedback sur les projets en cours que de base de décision,mais il permet également et surtout d’évaluer et de développer la promotion des ventes.
2.1 PRODUCTION ET VENTES 2 122
Désignation
La Suisse dispose depuis 1997 d’une base légale pour les appellations d’origine contrôlée et les indications géographiques protégées (AOC/IGP).Plusieurs filières utilisent cet instrument pour protéger la désignation de leur produit et ont donc opté pour une stratégie de différenciation par la qualité liée à l’origine.A ce jour,dix-neuf désignations (treize AOC et six IGP) ont été inscrites au Registre fédéral des appellations d’origine contrôlée et des indications géographiques protégées.En 2004,trois AOC (Pain de seigle valaisan,Safran de Mund et Berner Alpkäse) et deux IGP (Saucisse aux choux vaudoise et Saucisson vaudois) ont été enregistrées.D’autres produits sont en cours d’enregistrement,comme le Raclette du valais et l’Emmentaler.Ces deux dossiers sont examinés actuellement par la Commission de recours du DFE.
Registre des AOC/IGP le 31 décembre 2004
NombreNombrett
Fromage
L’EtivazAOC671290354OIC
GruyèreAOC3 00025925 12028 000OIC
SbrinzAOC52034-1 750Procert
Tête de MoineAOC2699-1 669OIC
Formaggio d’Alpe TicineseAOC25--135OIC
Vacherin Mont-d’OrAOC20013592590OIC
Berner AlpkäseAOC549--1 012OIC
Produits à base de viande
Viande des GrisonsIGP-31658950Procert
Saucisse d’AjoieIGP-11-56OIC
Viande séchée du ValaisIGP-28-337OIC
Saucisson neuchâtelois / Saucisse neuchâteloiseIGP-18-123OIC
Saucisson vaudoisIGP-51-620OIC
Saucisse aux choux vaudoiseIGP-50-480OIC
Spiritueux
Eau-de-vie de Poire du ValaisAOC3974 OIC
Abricotine AOC1003OIC
Autres produits
Rheintaler RibelAOC632829Procert
Cardon épineux genevoisAOC923870Procert
Pain de seigle valaisanAOC3957-35OIC
Safran de MundAOC116--0,003OIC
Total5 297574
■ Etat du registre AOC/IGP
Protection Exploitations agricoles Entreprises de transformation ou de perfectionnement Volumes de production certifiés en 2003 Volumes de production certifiés en 2004 Organismes de certification 139 224 litres d’alcool pur 95 792 litres d’alcool pur 32 981 litres d’alcool pur 17 228 litres d’alcool pur 2.1 PRODUCTION ET VENTES 2.MESURESDEPOLITIQUEAGRICOLE 123 2
Source:OFAG
Désignation
■
Dans le cadre de la mise en oeuvre des accords bilatéraux,la Suisse a entamé avec l’UE des entretiens sur la reconnaissance réciproque des registres.A cette occasion,le groupe d’experts AOC/IGP du Comité mixte a reconnu l’équivalence des législations suisse et européenne en matière de protection des appellations d’origine et des indications géographiques.En outre,les deux parties ont échangé des listes de produits sensibles qui devront faire l’objet de négociations.Elles préparent maintenant leurs mandats de négociation.
La Suisse est également très active dans l’Organisation mondiale du commerce (OMC), où elle s’efforce d’améliorer la protection des indications géographiques sur le plan international.Elle demande que la protection accordée pour le vin et les spiritueux (art.23 de l’Accord sur les aspects commerciaux des droits de la propriété intellectuelle;Accord ADPIC) soit étendue à tous les produits.Plusieurs membres,dont l’UE, défendront probablement eux aussi cette position dans les négociations en cours.
Instruments du commerce extérieur
Les importations de produits agricoles sont gérées par diverses mesures tarifaires, destinées à soutenir une agriculture productive en Suisse.Ainsi,les droits de douane sont appliqués de deux manières:selon le système des prix-seuils,applicable uniquement aux céréales fourragères et aux aliments pour animaux,le prix d’importation est maintenu dans une fourchette donnée par le biais de droits de douane variables.Les importations d’autres produits agricoles sont gérées au moyen de contingents tarifaires,qui limitent les quantités pouvant être importées au taux moins élevé du contingent (TC).Des importations en dehors du contingent sont possibles,mais elles sont frappées de droits de douane nettement plus élevés.
Les procédures administratives liées au régime d’importation sont régulièrement adaptées aux nouvelles conditions-cadre.Des adaptations peuvent s’imposer à cause de l’évolution du commerce extérieur,des réformes de la politique agricole suisse ou de changements dans la demande de produits agricoles,ou encore en raison de la recherche de procédés simples et efficaces pour l’attribution des parts de contingents.
Mis à part la procédure administrative la plus simple,le système du fur et à mesure à la frontière (attribution dans l’ordre des dédouanements),la répartition des contingents tarifaires incombe à l’OFAG.La mise aux enchères électronique permet aux abonnés de recevoir les appels d’offres par courrier électronique.Ils peuvent soumettre leurs offres dans un domaine protégé de l’Internet.D’emblée,ils ont très souvent eu recours à cette nouvelle méthode.Entre octobre et décembre 2004,27 mises aux enchères ont été effectuées par voie électronique,et 640 offres ont été soumises par Internet.Comme jusqu’à présent,les appels d’offres seront désormais publiés dans la Feuille officielle suisse du commerce et sur le site Internet de l’OFAG,sous la rubrique «Importations»,mais ils ne seront généralement plus annoncés par voie postale.
■ Evolution au plan international
2.1 PRODUCTION ET VENTES 2 124
Régime d’importation différencié
■ Elargissement de l’UE à l’Est – prorogation des préférences douanières
En considération des particularités que présentent les importations de céréales panifiables (grande quantité contingentaire rarement épuisée et TC élevé),le système d’attribution a été simplifié.Depuis le début de 2005,le contingent de 70'000 t n’est plus mis aux enchères,mais adjugé à la frontière,en quatre tranches,selon le système du fur et à mesure.
Le nouveau système de dédouanement électronique «e-dec»,qui doit remplacer le modèle douanier 90,permettra également de simplifier les procédures grâce à des solutions techniques.A partir du 1er janvier 2006,la gestion des parts de contingents tarifaires individuelles aura ainsi lieu à la frontière,et non plus après coup à l’OFAG.Le critère d'attribution «prestation fournie au fur et à mesure en faveur de la production suisse» a été supprimé dès le début de 2005 comme préparation à ce changement. Depuis,une partie du contingent tarifaire de fleurs coupées est mise aux enchères.La prestation fournie durant l’année précédente en faveur de la production suisse sera toutefois prise en compte,outre les importations effectuées,pour l’attribution des parts de quelques sortes de légumes.
Toutes les procédures de répartition de contingents tarifaires,ainsi que les quantités attribuées et leur utilisation par les maisons d’importation,sont présentées en détail dans le tiré à part du rapport du Conseil fédéral sur les mesures tarifaires douanières (Publication de l'attribution des contingents tarifaires) disponible sous «Rubriques > Importations» sur la page Internet de l’OFAG.
Dans l’année sous revue,les préférences douanières accordées aux pays qui ont adhéré à l’UE le 1er mai 2004 ont été converties en contingents tarifaires préférentiels,qui sont accessibles à tous les membres de l’UE.Ces contingents sont répartis selon le système du fur et à mesure à la frontière.Lorsque l’attribution est soumise à des critères selon l’art.22,al.2,LAgr,il incombe à l’OFAG de répartir et de gérer les parts de contingents. Comme les quantités bénéficiant des conditions préférentielles ont été attribuées rétroactivement au pro rata à partir du 1er mai 2004,l’OFAG a été obligé de vérifier, pour chaque demande,si l’importateur avait effectivement le droit d’importer à ces conditions.C’est l’Administration fédérale des douanes (AFD) qui s’est ensuite chargée du remboursement des droits de douane.Le degré d’utilisation des contingents déjà répartis est indiqué sur son site Internet www.zoll.admin.ch,sous la rubrique «contingents tarifaires».

2.1 PRODUCTION ET VENTES 2.MESURESDEPOLITIQUEAGRICOLE 125 2
■ Révision de la loi sur les douanes – modifications influant sur l’agriculture et sur le commerce de produits agricoles
Les Chambres fédérales ont adopté la nouvelle loi sur les douanes le 18 mars 2005. Cette loi entrera vraisemblablement en vigueur le 1er juillet 2006.Les dispositions mentionnées ci-après sont particulièrement importantes pour l’agriculture:
Art.12 Trafic de perfectionnement actif: ce système permet l’importation,en Suisse,de matières premières étrangères destinées au perfectionnement ou à la transformation,à des droits de douane réduits ou en franchise.La loi en vigueur réglemente déjà ce type de commerce de marchandises transfrontalier.En ce qui concerne les produits agricoles et les matières de base agricoles,les conditions du trafic de perfectionnement actif s’appliquent uniquement si des marchandises suisses équivalentes ne sont pas disponibles en quantité suffisante ou que le handicap de l'industrie alimentaire ne peut être compensé par d'autres mesures appropriées.L’importation à ces conditions particulières requiert toujours une autorisation de l’AFD.Cette autorisation sera désormais accordée si aucun intérêt public ne s’y oppose.Les décisions en la matière relèvent de la compétence de l’AFD.
Aujourd’hui,les autorisations concernant les produits agricoles sont généralement accordées selon le principe de l’identité et,exceptionnellement,selon celui de l’équivalence.La marchandise réexportée doit donc être identique à celle qui a été importée pour le perfectionnement ou la transformation.Ce sera dorénavant l’inverse.Selon le principe de l’équivalence,les marchandises importées peuvent être remplacées par des produits indigènes.
Une dérogation au principe de l’équivalence est prévue lorsque l’entreprise de perfectionnement ne peut pas attester crédiblement la quantité,les caractéristiques et la qualité de la marchandise réexportée ou que,dans le cas de droits de douane variant selon les saisons,le trafic de perfectionnement risque de troubler le marché.Cela permet à la fois de répondre à l’intérêt public de la sécurité alimentaire et aux exigences concernant les modes de production,et d’empêcher les distorsions de la concurrence.
Art.13 Trafic de perfectionnement passif: ce régime est traité séparément dans la nouvelle loi,car il diffère désormais de la réglementation applicable au trafic de perfectionnement actif.Il permet de réimporter,à des droits de douane réduits ou en franchise,des matières premières indigènes préalablement exportées à des fins de perfectionnement ou de transformation.C’est donc l’envers du trafic de perfectionnement actif.
Dans ce cas,l’AFD n’accorde l’autorisation que si l’opération ne porte pas atteinte à des intérêts majeurs de l’économie nationale.
2.1 PRODUCTION ET VENTES 2 126
Art.15 Produits agricoles: cette disposition concerne le traitement des réserves de fruits et de légumes au passage de la période libre à une période contingentée.Elle sert à empêcher que des excédents de marchandises soient importés au taux du contingent pendant la phase libre,pour être écoulées sur le marché dès le début de la période contingentée.Par ailleurs,elle établit la sécurité du droit en exigeant une nouvelle déclaration douanière pour les réserves concernées,qui peut être liée à l’obligation de payer après coup la différence de droit d’avec le taux hors contingent.

Art.43 Trafic dans la zone frontière: cet article sert à faciliter la gestion des marchandises dans la zone frontalière.S’agissant de l’Allemagne,de la France et de l’Italie,cette zone est aujourd’hui définie comme zone radiale;elle comprend les territoires suisse et étranger situés dans un rayon de 10 km à compter du poste de douane accessible le plus proche.Avec l’Autriche,la Suisse a convenu d’une zone parallèle,à savoir d’une bande de 10 km de largeur le long de la frontière.
Le législateur a décidé que dorénavant,sauf conventions contraires relevant du droit international,le principe de la zone parallèle s’appliquera pour tous nos pays voisins. La bande de territoire de 10 km de largeur le long de la frontière suisse tombe ainsi sous le coup des dispositions relatives au trafic dans la zone frontière.
Selon les statistiques,les exportations de matières premières agricoles ont augmenté d’environ 30% en 2004.Cette augmentation s’explique presque exclusivement par un trafic de perfectionnement accru de sucre.Plus de 50% de ce sucre sont exportés dans des jus de fruits et de légumes,10% dans du chocolat,4% dans des eaux minérales, environ 4% dans des sucreries,des produits de boulangerie et de pâtisserie ainsi que des confitures.Les jus de fruits et de légumes ne tombent pas sous le coup de la «Schoggigesetz».
Importation et exportation de produits
Quantités exportées en t Sources: AFD, OFAG 0 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 92 000 247 000 281 000 360 000 1991/92 2002 2003 2004 2.1 PRODUCTION ET VENTES 2.MESURESDEPOLITIQUEAGRICOLE 127 2
■
transformés («Schoggigesetz»)
La compensation de prix en vertu de la «Schoggigesetz» ne s’est appliquée qu’à environ 82'000 t des 360'000 t de matières premières agricoles exportées dans des produits transformés.Cela représente néanmoins une hausse de 10'000 t par rapport à 2003.La moitié de cette hausse (env.5'000 t) résulte des exportations de lait frais, qui ont atteint un record de 15'600 t.Avec une augmentation de quelque 2'500 t,les exportations de blé tendre ont atteint 27'700 t,ce qui les place au deuxième rang.
Après avoir initialement réduit le budget à 100 millions de francs,le Parlement a,comme l’année précédente,adopté un crédit supplémentaire le portant à 114,9 millions de francs,plafond admissible au sein de l’OMC.Ce montant a été entièrement utilisé.Les demandes déposées auprès de l’AFD l’ont dépassé d’environ 15 millions de francs. Pour 2005,le Parlement n’a budgétisé que 80 millions de francs,dont il faut encore déduire le report de quelque 15 millions de francs de l’année 2004.
Le 1er février 2005,la Suisse et l’UE ont mis en vigueur le Protocole 2 révisé de l’accord de libre-échange de 1972.L’industrie d’exportation escompte une évolution favorable en 2005,notamment grâce à ce Protocole.Elle s’attend donc à un besoin financier d’environ 113 millions de francs pour les contributions à l’exportation,les conséquences dudit Protocole étant prises en compte.Il résultera ainsi de nouveau,en 2005, un écart entre les moyens financiers budgétisés pour la compensation de prix et les ressources qui seront probablement nécessaires.Pour combler cet écart,on peut envisager les mesures suivantes:crédit supplémentaire augmentant le budget des contributions à l’exportation (à décider par le Parlement),d’autres mesures appropriées (contributions des organisations de producteurs et du 1er échelon de transformation) et trafic de perfectionnement des matières de base agricoles concernées.
Contributions à l'exportation mio. de fr. Sources: AFD, OFAG 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 180 115 115 1991/92 2003 115 2002 2004 128 2.1 PRODUCTION ET VENTES 2
Mesures 2004/05
2.1.2Economie laitière
En 2004,les ventes de produits laitiers ont poursuivi leur ascension.Les livraisons accrues de lait ont ainsi été absorbées par une augmentation de la production de produits fromagers et de produits au lait frais.La progression des exportations de produits laitiers a également contribué à détendre la situation.
ProduitFromageBeurreLait écréméLait en poudreLait de consommation, crème,produits à base de lait frais Mesure
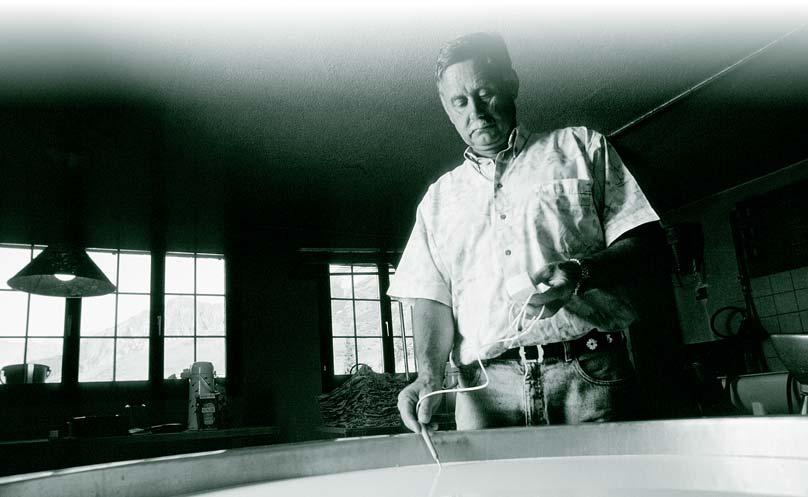
1seulement pour des utilisations particulières
2 uniquement en cas de renonciation aux importations
3 destinées aux exportations vers les pays non-membres de l’UE seulement et différenciées selon la sorte
4 lait de consommation exclu
Source:OFAG
Le prix moyen à la production du lait a reculé de près de 1 centime par rapport à 2003,passant à 74,6 ct./kg.Celui du lait bio a diminué plus fortement,à savoir de 3,76 ct./kg.Les mesures de soutien,englobant le supplément pour le lait transformé en fromage et le supplément de non-ensilage,restent focalisées sur le fromage.
■■■■■■■■■■■■■■■■
Protection douanière ■■■■■ Suppléments ■
accordées dans le pays ■ 1 ■ 1 ■ 2
à l’exportation ■ 3 ■■ 4
Aides
Aides
2.1 PRODUCTION ET VENTES 129 2
■ Moyens financiers en 2004 Répartition des fonds 2004
La Confédération a encore réduit ses dépenses en faveur de l’économie laitière en 2004.Le montant disponible a ainsi diminué de quelque 55,7 millions de francs (–10,1%) par rapport à l’année précédente.
En 2004,les dépenses dans le domaine laitier se sont montées à 503,5 millions de francs,dont 350 millions (69,5%) ont été versés pour le fromage,71,7 millions (14,2%) pour le beurre et 75,5 millions (14,9%) pour la fabrication de poudre de lait et d’autres produits laitiers.Les frais administratifs se sont élevés à 6,4 millions de francs (1,4%).

Aides dans le pays 24%
Total 503,5 mio de fr.
Aides à l'exportation 9% Suppléments 66% Administration 1% 2.1 PRODUCTION ET VENTES 2 130
Source: OFAG
■ Modification de l’ordonnance sur le contingentement de la production laitière (OCL)
Contingentement laitier
Durant l’année laitière 2003/04,33'072 producteurs commercialisaient encore du lait. Leur nombre a ainsi reculé de 1’599 ou de 4,6% par rapport à 2002/03.Ce recul correspond à la diminution annuelle moyenne enregistrée depuis le 1er mai 1999:993 producteurs de plaine et 606 producteurs de montagne ont renoncé à commercialiser du lait.À l’échelle suisse,le contingent moyen a atteint 91’612 kg.Il a augmenté de 4’449 kg (5,1%) par rapport à l’année précédente et de 15’923 kg (21 %) par rapport à l’année laitière 1999/2000.En plaine,il a passé de 103’467 à 109’306 kg (+5,6%) et en montagne de 65'684 à 68'542 kg (+4,4%).Depuis l’année laitière 1999/2000, il s’est ainsi accru de près de 21’000 kg (+23%) en plaine et de 10'000 kg (+17,4%) en montagne.
La taxe pour dépassement du contingent laitier touchant les exploitations d’estivage a été abaissée;elle a passé de 60 à 10 centimes par kg de lait avec effet au 1er mai 2004. En même temps,les transferts de contingents des exploitations d’estivage aux exploitations principales ont été fortement limités (art.3,al.3bis,OCL).Une partie des contingents d’alpage a été transférée aux exploitations principales avant ce changement.Alors que le contingent de base dans la région d’estivage s’élevait encore à 86,9 millions de kg dans l’année laitière 2002/03,il a baissé à 79,9 millions de kg dans l’année 2003/04.19 millions de kg ont été soustraits à la région d’estivage par des transferts définitifs,mais elle a récupéré 12 millions de kg par voie de location.
Après une hausse considérable des contingents supplémentaires attribués durant la période précédente (+77%),à 43,6 millions de kg,la quantité s’est réduite de 5,4 millions de kg dans l’année 2003/04;elle n’atteignait alors plus que 38,2 millions de kg.19'095 animaux ont donné droit à des contingents supplémentaires.
Du 1er mai 2006 au 30 avril 2009,un second système d’orientation de la production existera parallèlement au contingentement laitier.Les deux systèmes sont perméables, ce qui donne une certaine souplesse dans la mise en œuvre.L’adaptation de l’ordonnance sur le contingentement de la production laitière (OCL,RS 916.350.1) assure à cet effet le lien avec l’ordonnance sur l’exemption du contingentement laitier (OECL, RS 916.350.4).
L’art.3a,inscrit au printemps 2004 dans l’OCL,restreint les transferts de contingents; il est directement lié au débat sur les exemptions du contingentement laitier.Un contingent transféré à titre temporaire et retourné au titulaire du contingent après le 1er mai 2004 ne peut ensuite plus faire l’objet d’un transfert.Seule la restitution à l’échéance d’un contrat d’élevage fait exception à cette règle.La durée de garde exigée pour les animaux qui sont placés en région de montagne pour l’élevage et qui donnent droit à un contingent supplémentaire lorsqu’ils retournent dans l’exploitation,a également été modifiée:elle passe de 22 à 18 mois (art.11).
2.MESURESDEPOLITIQUEAGRICOLE 2.1 PRODUCTION ET VENTES 131 2
Après l’exemption du contingentement et le retrait du contingent,le service administratif chargé du contingentement laitier (SACL) doit établir le décompte de chaque producteur pour l’année laitière écoulée.Comme il s’agit d’un décompte final,les producteurs ne peuvent pas bénéficier du système de compensation dans la dernière année contingentaire.L’art.17 indique la formule de décompte à appliquer dans ces cas.La possibilité de reporter 5'000 kilos au maximum (art.16) a été supprimée pour les producteurs exemptés,lesquels doivent donc verser une taxe en cas de surlivraison. La taxe est réduite pour une première tranche de 5'000 kg.Au moment du décompte, les deux systèmes ne peuvent en effet pas être perméables.Comme il n’est plus établi de décompte selon le droit public pour les producteurs exemptés,ceux-ci ne peuvent pas compenser les surlivraisons.
L’art.36a LAgr,qui règle la suppression du contingentement laitier,est entré en vigueur le 1er janvier 2004.Cet article habilite le Conseil fédéral à exempter de manière anticipée des producteurs du contingentement s’ils remplissent certaines conditions, de même que leurs organisations.Le 10 novembre 2004,le Conseil fédéral a adopté l’ordonnance sur l’exemption du contingentement laitier (OECL,RS 916.350.4),qui contient des dispositions d’exécution pour la période allant du 1er mai 2006 au 30 avril 2009,date de la suppression générale du contingentement.Pendant ces trois ans,un système de gestion des quantités relevant du droit privé existera ainsi parallèlement au contingentement de droit public.
Les art.3 à 5 dans la deuxième section de l’OECL définissent la manière dont les organisations doivent se constituer pour permettre à leurs membres d’être exemptés du contingentement laitier.Les formes d’organisation admises à ce titre sont les interprofessions,les organisations de producteurs et les organisations de producteurs-utilisateur.Ces dernières regroupent des producteurs et un utilisateur de lait important de la région.Les dispositions précitées indiquent par ailleurs les exigences auxquelles doivent satisfaire lesdites organisations,telles que le mode de prise de décision ou la quantité minimale.
La troisième section est consacrée au calcul et à l’adaptation de la quantité de lait de base.Le jour de l’exemption (1er mai 2006,2007 ou 2008),les producteurs concernés se voient retirer leur contingent de base.Ce dernier correspond au contingent sur lequel s'est basé le décompte de la dernière période précédant l'exemption,déduction faite des contingents supplémentaires.Une quantité de base étant fixée,l’organisation devra néanmoins respecter un plafonnement semblable au contingentement.La liberté des producteurs exemptés a été limitée de la sorte,afin qu’ils n’augmentent pas excessivement les quantités produites,provoquant ainsi une pression sur les prix au détriment des producteurs encore soumis au contingentement.La quantité de base augmente ou diminue en fonction des adaptations visées aux art.7 à 10.
2.1 PRODUCTION ET VENTES 2 132
■ Ordonnance sur l'exemption du contingentement laitier (OECL)
La quatrième section de l’ordonnance contient les dispositions concernant la répartition des quantités et les tâches incombant aux organisations.Celles-ci sont en principe libres de choisir le mode de répartition de la quantité entre les membres et la manière dont elles procéderont ensuite aux adaptations.Elles doivent toutefois consigner ces modalités dans un règlement (art.13).Pour bénéficier de l’exemption,les organisations doivent mettre en place un service administratif ou mandater un organisme approprié (art.14).Il leur incombe notamment,dans le cadre de la gestion des quantités,de prononcer des sanctions contre les membres qui ne respectent pas les règles (art.15).
L’art.17 dans la cinquième section mentionne dans les détails les pièces à joindre aux demandes d’exemption.
Malgré les coûts,le commerce de contingents est vivement pratiqué.En effet,dans l'année laitière 2004/05,6’315 producteurs ont acheté des contingents et 8’835 en ont pris en location.La quantité transférée s’est élevée à environ 308’080 t,soit 10,1% du contingent de base.
Commerce de contingents

1
2 données provisoiresSource:OFAG
La perspective de l’exemption du contingentement laitier a dynamisé le commerce des contingents.La quantité transférée selon l’art.3 OCL (achat et location) a atteint environ 300 millions de kg dans l’année laitière 2003/04,ce qui correspond à 10% du contingent de base.Les volumes loués ont augmenté de 25,9 millions de kg (+18%) par rapport à l’année précédente,et les volumes achetés encore plus fortement,de 37,1 millions de kg ou 40%.
La quantité contingentaire totale louée durant l'année laitière 2003/04 s'est élevée à environ 440 millions de kg,ce qui représente 14,2% du contingent de base.Depuis l’introduction du commerce des contingents en 1999,près de 428 millions de kg ont été définitivement acquis.Ainsi,en 2003/04,868 millions de kg ou 27,9% du contingent de base ont été utilisés par d'autres producteurs grâce à des transferts de contingents non liés à des surfaces.
Unité2002/03 1 2003/04 1 2004/05 2 Vente Producteurs concernésNombre2 6923 9113 950 Quantité totale de laitmio.de kg91,6128,6162,3 par transfertkg34 03732 88841 084 Location Producteurs concernésNombre6 6847 4106 847 Quantité totale de laitmio.de kg142,7168,4145,5 par transfertkg21 34522 72820 843
données définitives
2.1 PRODUCTION ET VENTES 2.MESURESDEPOLITIQUEAGRICOLE 2 133
■ Commerce de contingents laitiers
■ Exemption anticipée du contingentement laitier: rapport sur le traitement des premières demandes
Avant la pause d’été 2005,une organisation de producteurs et trois organisations producteurs-utilisateur ont présenté une demande d’exemption anticipée du contingentement laitier.Les demandes sont ainsi moins nombreuses que celles qui avaient été annoncées et attendues.D’une part,les préparatifs prennent plus de temps que prévu par les organisations et,d’autre part,le délai pour une exemption au 1er mai 2006 n’échoit qu’à fin octobre 2005.
L’OFAG considère,quant à lui,le faible nombre de demandes comme un signe que la vingtaine d’organisations intéressées se préparent très bien au changement souhaité. Avant la présentation des demandes,il a été réjouissant de constater que le sujet était largement et parfois intensément discuté.En outre,les organisations concernées ont presque toutes pris contact avec l’OFAG afin de pouvoir adopter dans les règles les documents à mettre au dossier (surtout statuts et réglementations quantitatives).
L’OFAG a pu donner son avis à cette occasion,ce qui devrait faciliter le traitement des demandes qui doit débuter en automne.
Soutien du marché par le biais des aides et des suppléments
Les instruments destinés au soutien du marché n’ont pas subi de changements majeurs en 2004.Toutefois,en raison de la réduction de 55,7 millions de francs des fonds affectés à cette fin,il a fallu abaisser plusieurs types d’aides.Compte tenu des moyens financiers disponibles pour 2005,le supplément de 19 ct./kg versé pour le lait transformé en fromage a été réduit d’un centime au 1er mai.A la même date,l’aide à l'exportation par équivalent lipido-protéique a passé à 27 centimes par équivalent suite à une diminution de 2 centimes.Une baisse de 50 ct./kg a également frappé les aides octroyées pour les exportations de fromage (emmental,Switzerland Swiss,sbrinz et fromages à pâte molle) vers des pays non-membres de l’UE.
2.1 PRODUCTION ET VENTES 2 134
Mesures 2004
2.1.3 Economie animale
La protection douanière,c’est-à-dire les droits de douane et les contingents tarifaires, est le principal instrument de soutien de la production de viande suisse.Des aides sont en outre versées pour le marché de la viande et celui des œufs,ainsi que pour l'exportation d'animaux d'élevage
rente.
Source:OFAG
Le délai transitoire fixé pour l’octroi de contributions à la reconversion de poulaillers selon les programmes SRPA et/ou SST est échu à fin 2003.Depuis 1997,l’OFAG a versé un montant total de quelque 19 millions de francs à ce titre.Grâce à ce soutien supplémentaire,la part de poules pondeuses gardées selon les exigences SRPA et/ou SST a augmenté à plus de deux tiers.En raison de la situation favorable sur le marché, Proviande a renoncé à plusieurs mesures d’allégement sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande.Elle n’a pas organisé d’actions de dégagement des marchés de bovins,de veaux,de porcs ou de chevaux dans les abattoirs,et n’a pas non plus lancé de campagnes de stockage de viande de bœuf ou de porc.
■■■■■■■■■■■■■■■■
et de
Animal/produitBovinsVeauxPorcsChevauxMoutonsChèvresVolailleOeufs Mesure Protection douanière ■■■■■■■■ Dégagement des marchés publics ■■■ Dégagement des abattoirs ■■■■■ Campagnes de stockage ■■■ Campagnes de vente à prix réduits ■■■ Essais axés sur la pratique ■ Contributions à l’investissement (construction de poulaillers) ■ Campagnes d’œufs cassés et mesures de commercialisation ■ Contributions à la mise en valeur de la laine de mouton ■ Aides à l’exportation de bétail d’élevage et de rente ■■■■ Effectifs maximums ■■■■
2.MESURESDEPOLITIQUEAGRICOLE 2.1 PRODUCTION ET VENTES 135 2
■ Moyens financiers en 2004
Sur les 40,2 millions de francs inscrits au budget fédéral pour les mesures en faveur de l'économie animale,seul 22,5 millions de francs ont été dépensés.5 millions du solde ont été utilisés pour compenser un crédit supplémentaire ayant servi à financer les contributions à l’exportation de produits agricoles transformés.La baisse des dépenses dans l’économie animale s’explique principalement par la demande accrue sur le marché de la viande.Etant donné la consommation élevée de viande de bœuf,il n'a pas été nécessaire d’intervenir sur le marché comme d’usage au second semestre.Par ailleurs,les fonds affectés aux mesures saisonnières de mise en valeur sur le marché des œufs n'ont pas été épuisés,car après Pâques et en été,l’offre a été plus faible que ce que l’on attendait.
Répartition des fonds 2004
Total 22,5 millions de fr.
Contributions à la mise en valeur de laine de mouton 3%
Contributions au stockage et à la réduction des prix de viande de bœuf et de veau 22%
Soutien de la production d'œufs indigène 13%
Aides à l'exportation de bétail d'élevage et de rente 29%
Source: Compte d'Etat

Mandats de prestations de Proviande 33% 2.1 PRODUCTION ET VENTES 2 136
■ Bétail de boucherie et viande:conventions de prestations
Depuis le 1er janvier 2000,Proviande remplit des mandats que lui confie l’OFAG sur les marchés publics de bétail de boucherie et sur ceux de moutons,ainsi que dans les abattoirs.De nouveaux contrats de durée limitée sont entrés en vigueur au 1er janvier 2004.Sur le plan du personnel comme sur celui des finances,la taxation neutre de la qualité des animaux sur pied et des carcasses est la tâche essentielle du mandataire.
1.Taxation neutre de la qualité
Le service de taxation de Proviande a apprécié environ 85% des bovins et des porcs abattus,ainsi que 60% des moutons.Il a en outre déterminé la qualité de tous les bovins et ovins sur pied présentés sur les marchés publics.Les collaborateurs de Proviande ont fourni plus de 46'000 heures de travail dans les abattoirs et ont été présents sur 1'641 marchés publics.
Le pourcentage de viande maigre,critère de qualité des carcasses de porcs,est déterminé à l’aide d’appareils techniques.La proportion de viande maigre relevée dans un échantillon de 1,4 million d’abattages (54% de tous les abattages) a atteint en moyenne 55,5%.Elle s’est donc accrue d’un demi-pourcent par rapport à 2003.La qualité des tissus gras est un critère supplémentaire essentiel en ce qui concerne la consistance et la résistance à l'oxydation de la charcuterie.Cependant,son évaluation (détermination de ce qu’on appelle l’indice de graisse) est facultative pour les abattoirs.
Ventilation des carcasses selon les classes de charnure 2004
en %
C H T A X VachesTaureauxVeaux Classe de charnure AgneauxChevreaux 0 70 50 60 40 30 20 10 2.1 PRODUCTION ET VENTES 2.MESURESDEPOLITIQUEAGRICOLE 137 2
Source: Proviande
C
= très bien en viande, H = bien en viande T = charnure moyenne A = charnure faible et X = très décharné
La qualité des carcasses de bovins,ovins,caprins et équidés fait l’objet d’une appréciation visuelle.On distingue cinq classes de charnure:C = très bien en viande,H = bien en viande,T = charnure moyenne,A = charnure faible,X = très décharné.La couverture de graisse est également subdivisée en cinq classes.L’évaluation d’un échantillon de 2004 révèle des différences considérables entre les carcasses de taureaux et celles de vaches.L’échantillon comprenait environ 70% de tous les animaux abattus;24% des vaches présentaient une charnure faible et 22% étaient très décharnées.Le pourcentage d’animaux très décharnés a tout de même reculé de 6 points par rapport à 2002.Cette baisse résulte probablement de l’augmentation du cheptel de vaches mères et de vaches allaitantes.Quant aux taureaux,95% des animaux compris dans l'échantillon entraient dans les classes T à C.Au cours des dernières années,l’optimisation de l’engraissement de taureaux a stabilisé le nombre d’animaux bien en viande à un niveau élevé.Quant aux agneaux,la charnure s’est également améliorée,ce qui indique un engraissement de qualité.Ici,les carcasses de charnure moyenne ont prévalu,leur proportion s'élevant à 47%.Les taxateurs ont en outre attribué à deux tiers des chevreaux abattus la notation «bien en viande».
2.Surveillance des marchés publics et allégement du marché
Des organisations paysannes locales et/ou des services cantonaux ont organisé des marchés publics de bétail de boucherie durant toute l’année pour les animaux des espèces bovine et ovine.Le nombre d’animaux présentés de l’espèce bovine a chuté de 8% par rapport à 2003,celui de gros bétail et de veaux de 11% et 9% respectivement. C’est un recul de l’offre qui a provoqué cette baisse.En dépit de cette évolution, 10'001 ovins n’ont pas été achetés sur une base volontaire (11,9% des animaux présentés),ce qui a contraint Proviande à attribuer ces animaux aux abattoirs et commerçants ayant l'obligation de prendre en charge les animaux non achetés;ces entreprises les ont payés aux prix du marché relevés par Proviande.En revanche,seuls 398 animaux de la catégorie «gros bétail» et 5 veaux ont été attribués au titre de dégagement du marché.
Les marchés publics surveillés en 2004 en chiffres
CaractéristiqueUnitéVeauxGros bétailOvins
Marchés publics surveillésNombre420882339
Animaux présentésNombre47 79564 76784 123
Part d’animaux admis à tous les abattages%171829
Animaux attribués
(dégagement du marché)Nombre539810 001
Source:Proviande
2.1 PRODUCTION ET VENTES 2 138
Des marchés publics surveillés sont organisés dans 20 cantons sur 187 places de marché.On trouve des marchés de gros bétail,de moutons et d’agneaux dans presque tous les cantons,mais huit cantons seulement en organisent pour les veaux.Les marchés des cantons d’Argovie,Bâle-ville,Genève,Schaffhouse,Zurich et Zoug ont déjà été supprimés il y a quelques années.Le canton de Berne compte le plus grand nombre de places de marché (50),suivi des Grisons (20) et du Valais (19).La grandeur du canton et la part de la région de montagne sont les principaux facteurs à cet égard. Les marchés de bétail de boucherie ont une importance marginale dans les cantons de Nidwald et de Soleure,où l’on ne compte qu’une place de marché de gros bétail.
Bien que le nombre de marchés publics de veaux (18) soit nettement inférieur à celui des marchés de gros bétail (74) ou de moutons (95),un quart du nombre total d’animaux présentés sont des veaux.Durant l’année sous revue,les places de marché des veaux ont admis en moyenne 2'655 animaux,alors que la moyenne était de 875 animaux pour le gros bétail et de 886 animaux pour les moutons.
CantonPlaces de marchés Places de marchés Places de marchésTotal de veauxde gros bétailde moutons
L'OFAG a versé au total 4,9 millions de francs d’aides pour la congélation de viande de veau et pour les ventes à prix réduit de viande de bœuf.Quelque 70 abattoirs et entreprises de commerce ont stocké au printemps 1'011 t de viande de veau qui ont été écoulées jusqu’à la fin 2004.Pour la première fois,447 t de quartiers de devant de bœuf ont été vendus à prix réduit pour la transformation.Par ailleurs,l’OFAG a soutenu l’utilisation de 10'847 cuisses de bœuf pour la production de viande séchée.
 Nombre de places de marchés publics par canton en 2004
Nombre de places de marchés publics par canton en 2004
AI112 AR1113 BE5252050 BL112 FR15713 GL123 GR551020 JU617 LU34411 NE112 NW11 OW123 SG1359 SO11 SZ1157 TG123 TI3811 UR99 VD8311 VS51419 Source:Proviande
2.1 PRODUCTION ET VENTES 2.MESURESDEPOLITIQUEAGRICOLE 139 2
3.Enregistrement et contrôle des demandes de parts de contingents tarifaires
Au total,762 demandes de parts de contingent tarifaire pour la période contingentaire 2005 ont été déposées en été 2004.Les demandes sont accompagnées des données relatives à la prestation en faveur de la production suisse,lesquelles font foi pour l’attribution de 67% de la quantité d’une catégorie de viande.Le nombre de demandes est à la baisse depuis 2000,où 1'003 demandes avaient été présentées.Proviande a vérifié les notifications concernant les prestations fournies en faveur de la production suisse quant à leur exactitude et à leur plausibilité.Elle a contrôlé la quantité de morceaux parés et salés de la cuisse de bœuf une fois dans chaque entreprise,tandis que les autres prestations,telles que les abattages et les achats libres,ont fait l’objet de contrôles par sondage.La période de référence pour la prestation en faveur de la production suisse allait du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004.Proviande a transmis les données saisies et contrôlées à l’OFAG,qui s’en est servi pour attribuer,par voie de décision,des parts de contingents tarifaires à 761 personnes physiques et morales pour 2005:630 parts de viande de bovins (sans les morceaux parés de la cuisse de bœuf),392 de viande de porc,174 de viande de mouton,150 de morceaux parés de la cuisse de bœuf,33 de viande d’équidés et 28 de viande de caprins.Une demande déposée tardivement n’a pu être prise en considération.Le recul le plus marqué (–11%) du nombre de détenteurs de parts de contingents tarifaires a été enregistré dans la catégorie de la viande de bovins.À l’inverse de la tendance générale,le nombre de détenteurs de parts de contingents tarifaires de viande de mouton s’est accru, passant de 171 (2004) à 174.Les parts de contingents tarifaires de viande de volaille ont été attribuées à raison de 67% selon la prestation en faveur de la production suisse.42 personnes ont bénéficié de parts pour cette catégorie de viande.
Pour la période contingentaire 2005,33% de toutes les quantités d’importation de viande libérées périodiquement sont mises aux enchères.En 2006,cette proportion passera à 66% et à 100% en 2007.La part attribuée selon le critère de la prestation en faveur de la production suisse diminue en conséquence.Une disposition particulière s’applique aux parts de contingents tarifaires de viande des animaux des espèces bovine (sans les morceaux parés de la cuisse) et ovine:même après 2006,10% des animaux de cette catégorie continueront d’être attribués selon le nombre d’animaux adjugés sur les marchés publics.
L’OFAG définit les quantités à importer pendant une période d’importation après consultation du conseil d’administration de Proviande et en tenant compte de la situation du marché.La période d'importation pour la viande d’animaux des espèces bovine ou ovine en demi-carcasses est fixée à quatre semaines;celle concernant les animaux des espèces ovine,caprine,équine,ainsi que la volaille et les abats,correspond à un trimestre.Depuis la fin 2004,l’OFAG procède à des appels d’offres périodiques pour les quantités à importer.Il y mentionne les principales dispositions et informations concernant la mise aux enchères.Les appels d’offres sont publiés sur le site Internet de l’OFAG et dans la Feuille officielle suisse du commerce,et ils sont également transmis par courrier (Newsletter).Sont habilitées à participer aux enchères les personnes physiques et morales ou les communautés de personnes qui ont leur domicile ou leur siège social sur le territoire douanier suisse.
2.1 PRODUCTION ET VENTES 2 140
■ Mise aux enchères de la viande
Au plan administratif,les premières enchères se sont déroulées sans accroc,aussi bien du côté des enchérisseurs que de celui de l'administration.Les enchérisseurs peuvent déposer leurs offres à l’OFAG par un accès Internet sécurisé,à l’aide de l’application Web «eVersteigerung» (mise en adjudication électronique).Plus de 80% des offres sont d’ores et déjà déposées sous cette forme;les autres sont transmises par fax ou par courrier postal,et doivent donc être saisies manuellement.Les parts sont attribuées selon un ordre décroissant,en commençant par le prix le plus élevé offert.Le prix d’adjudication correspond au prix offert.À l’expiration du délai fixé pour la présentation des offres,l’OFAG rend une décision et publie l’attribution en l’espace d’un jour.
Les résultats des enchères montrent que,d’une part,de nouvelles entreprises participent au marché d’importation et que,d’autre part,les importateurs déjà présents déposent également des offres dans d’autres catégories de viande ou de produits carnés.La mise aux enchères semble donc renforcer la concurrence entre les importateurs et permet ainsi d’atteindre un objectif défini dans la PA 2007.La pression qui en résulte sur les marges des échelons en aval de la production de viande,de même que l’échéance,le 1er juillet 2005,du délai transitoire de 10 ans fixé pour l’adaptation des locaux et équipements dans les abattoirs,assouplissent les structures et favorisent une réduction des surcapacités.Alors que plusieurs associations ou organisations prédisaient une augmentation des prix à la consommation et une baisse simultanée des prix à la production,on ne peut actuellement affirmer l’existence d’un rapport de cause à effet.
adjudicationde participantsd'adjudication (déc.04–sept.05) Unitékg brutNombrefr./kg brut Viande de volaille13 200 000600.59 Viande d’animaux de l’espèce ovine1 881 000463.49 Viande d’animaux de l’espèce chevaline1 419 000181.06 Viande de porc en demi-carcasses1 699 000280.58 Aloyaux / High Quality Beef1 014 7505813.59 Viande de fabrication de vache709 500341.68 Cuisses de bœuf280 500339.75 Viande d’animaux de l’espèce caprine82 500200.90
2.1 PRODUCTION ET VENTES 2.MESURESDEPOLITIQUEAGRICOLE 141 2
Résultats des adjudications en 2005
ProduitQuantité mise Nombre moyen Prix moyen en
Source:OFAG
■ Oeufs:soutien de la production suisse et mesures de mise en valeur
L’OFAG a de nouveau octroyé,en 2004,des contributions à l’investissement pour la transformation et la construction de poulaillers particulièrement respectueux des animaux.Ces contributions,versées uniquement pour la volaille destinée à la production d’œufs,ne sont ni grevées d’intérêts ni remboursables.L'OFAG a ainsi accordé un soutien à 13 exploitations de pondeuses et 2 exploitations de poulettes,pour un total de 357'000 francs;si l’on y ajoute les montants alloués en 2003,il a versé au total 439'000 francs au titre de contributions à l’investissement durant l'exercice considéré. Les exploitations concernées détiennent en moyenne quelque 4'800 pondeuses ou 4'900 poulettes.Sur les 15 exploitations auxquelles des contributions ont été allouées dans l’exercice sous revue,3 (20%) sont gérées selon les directives de l’agriculture biologique.
Comparé aux périodes qui précèdent Noël et Pâques,la demande d’œufs suisses est particulièrement faible après Pâques et durant les mois d’été.Pour atténuer les effets de ces variations saisonnières,l’OFAG a débloqué un montant maximal de 3 millions de francs pour des mesures de mise en valeur.Les fabricants de produits à base d'œufs ont cassé 13,7 millions d'œufs indigènes excédentaires.Ils ont reçu à cet effet une contribution de 9 centimes par œuf.Les fournisseurs ont vendu 10,9 millions d’œufs à prix réduit au profit des consommateurs,grâce à un soutien de 5 centimes par pièce. L’OFAG a procédé à des contrôles à domicile et examiné les justificatifs pour vérifier que les dispositions relatives aux campagnes d’œufs cassés et de ventes à prix réduit étaient observées.
L’OFAG a soutenu,en 2004,des essais sur la volaille axés sur la pratique et la diffusion des résultats par le biais de la formation et de la vulgarisation,en accordant un montant d’environ 580'000 francs à l’Aviforum et au Centre spécialisé dans la détention convenable de la volaille et des lapins à Zollikofen pour les projets suivants: évaluation de la performance de ponte de deux races hybrides nourries avec des aliments biologiques ou dont l’alimentation ou la litière contenaient un additif biologique;influence de l’éclairage et de la teneur en acide linoléique de l’alimentation des pondeuses sur la part de gros œufs (>70 g) de deux races brunes d’origine hybride; influence de l’éclairage et de la gestion du poids durant l’élevage ainsi que de la teneur en acide linoléique de l’alimentation des pondeuses sur la part de gros œufs (>70 g); influence de la teneur en protéine brute et en méthionine ainsi que de l'origine des hybrides sur la performance,la mortalité et le plumage des pondeuses;rognage du bec chez les poussins d'un jour de poules pondeuses en Suisse:incidence des malformations consécutives à l'intervention;optimisation de la garde de poules pondeuses avec sortie sur prairie / gestion et élevage.
■ Chevaux de rente et de sport:mise aux enchères de parts de contingent tarifaire
Au cours de l’exercice sous revue,l’OFAG a mis aux enchères le contingent tarifaire «Animaux de l'espèce chevaline (sans les animaux d'élevage,les ânes,les bardots et les mulets)» en deux tranches de 1'461 têtes chacune.Les deux fois,plus de 250 personnes ont fait des offres pour plus de 2'500 têtes au total.Le prix d’adjudication moyen s’est monté à 360 francs par cheval de rente ou de sport.Les recettes, dépassant 1 million de francs,ont été versées dans la caisse fédérale.
2.1 PRODUCTION ET VENTES 2 142
Mesures 2004
2.1.4Production végétale
Dans le domaine de la production végétale,la PA 2007 n’a apporté que peu de modifications au catalogue des mesures destinées à soutenir la production indigène.Une nouveauté a néanmoins été introduite en 2004:des contributions sont versées pour la reconversion des cultures fruitières et pour la plantation de cultures novatrices de fruits et de légumes.La protection douanière demeure toutefois la principale mesure.
À l’exception de la contribution à la transformation de betteraves sucrières,qui a été réduite pour la période budgétaire 2004 à 2007,les fonds servant au soutien des autres mesures ont été du même ordre que dans la période précédente.
Contributions pour la reconversion et la plantation de cultures novatrices 4

1selon l’utilisation ou le numéro du tarif,le prélèvement à la frontière est réduit ou nul
2ne concerne que des parties de la quantité récoltée (affouragement à l’état frais et déshydratation de pommes de terre,réserve de marché pour concentrés de fruits à pépins)
3Pommes de terre:seulement pour les produits à base de pommes de terre destinés à l’alimentation / semences:seulement pour les plants de pommes de terre / fruits seulement pour les cerises transformées en conserves et divers produits de fruits à pépins
4ne concerne que certaines cultures
Source:OFAG
■■■■■■■■■■■■■■■■
Mesure Protection douanière 1 ■■■■■■■■ Contributions à la transformation ■■ 2 ■■ 2 ■ 2 Contributions à la culture ■■■
l’exportation
■■■
■■
Contributions à
3
Culture Céréales Légumineuses à graines Oléagineux Pommes de terre Betteraves sucrières Semences Légumes,fleurs coupées, viticulture Fruits 2.1 PRODUCTION ET VENTES 143 2
■ Moyens financiers en 2004
Les fonds affectés au soutien du marché ont diminué par rapport à l’année précédente et sont passés de 154 à 142 millions de francs.Les dépenses pour les contributions à la transformation et à la mise en valeur ont diminué,tandis que celles pour les contributions à la surface et à l’exportation sont restées pratiquement inchangées.
Total 142 mio. de fr.
Contributions à l'exportation 12%
Divers 3%
Primes de culture 31%
Source: Compte d'Etat
De manière générale,les fonds versés pour les grandes cultures sont restés stables par rapport à l’année précédente.Toutefois,en raison de la réduction des contributions à la transformation de la récolte de betteraves sucrières,seuls 38,2 millions de francs ont été versés en 2003;dans l’exercice sous revue,7,1 millions ont déjà été payés pour la récolte 2004.Les dépenses pour les pommes de terre ont baissé,car l’octroi de contributions à l’exportation de produits à base de pommes de terre a exigé un montant moins élevé.De même,l’octroi de contributions à la surface a coûté moins cher,la surface de cultures de légumineuses à graines s’étant rétrécie.En viticulture,on constate une très forte diminution des dépenses en regard des autres années,pour les raisons suivantes:les contributions à la mise en valeur de jus de raisin étaient limitées aux années 2002 et 2003,et celles allouées pour la promotion des ventes figurent désormais dans la rubrique budgétaire générale.
Source: Compte d'Etat
au perfectionnement et à la transformation 54%
Répartition des fonds 2004 Contributions
Répartition des fonds par culture mio. de fr. 200220032004
1 récolte 2003 38,2 mio. de fr.; récolte 2004 7,1 mio. de fr. 2 depuis 2004 sans promotion des ventes, 2002 et 2003 mise en valeur de jus de raisins Betteraves sucrières 1 Pommes de terrre Légumineuses à graines Oléagineux (y c. MPR) Matières premières renouvelables (plantes à fibres) Production de semences FruitsViticulture 2 0 45 50 40 35 30 25 20 15 10 5 2.1 PRODUCTION ET VENTES 2 144
■ Mesures à la frontière
Dépenses pour la mise en valeur de fruits 2004
Total 18,5 mio. de fr.
Exportations d'autres produits de fruits à pépins
2,1%
Exportations de cerises
2,0%
Mise en valeur de pommes et de poires dans le pays 4,3%
Mesures d'adaptation au marché concernant les fruits et les légumes 3,1%
Exportation de concentrés de jus de pommes 57,8%
Exportations de concentrés de jus de fruits 29,0%
Autres 1,7%, dont allégement du marché des cerises et pruneaux 1,3%
Source: OFAG
Dans l’année sous revue,le soutien à la mise en valeur de fruits s’est monté à 18,5 millions de francs,ce qui correspond aux dépenses moyennes des quatre dernières années.Comparés à 2003,les dépenses occasionnées par les exportations de concentré de jus de pommes ont augmenté de 1,4 million de francs.En revanche,celles pour l’exportation de concentré de jus de poires ont diminué presque d’autant.
Cultures des champs
Au cours du deuxième semestre de l’année sous revue,les autorités fédérales ont décidé qu’à partir de 2005,le contingent tarifaire de céréales panifiables serait attribué en quatre tranches pouvant être importées jusqu’à la fin de l’année,selon la procédure du fur et à mesure à la frontière.En outre,le Conseil fédéral a baissé les prix-seuils des aliments pour animaux (céréales fourragères moins 3 fr.,aliments protidiques moins 1 fr.par 100 kg) et le taux du contingent de céréales panifiables (moins 3 fr.par 100 kg) au 1er juillet 2005.
■ Evolution du marché du sucre
En complément de la protection douanière et jusqu’en 1995,la Confédération,les consommateurs et les producteurs ont couvert ensemble les pertes liées à la production de sucre en Suisse.De 1995 à 1998,la Confédération a couvert le déficit des comptes des sucreries d'Aarberg et de Frauenfeld,qui ont fusionné en 1996 et forment désormais la «Sucreries d'Aarberg et de Frauenfeld SA».Dans le cadre de la PA 2002, la Confédération a accordé à cette dernière un mandat de transformation portant sur une quantité de sucre de 120'000 à 185'000 t au maximum et rétribué par un montant forfaitaire.Une fourchette de prix a été fixée compte tenu du risque d’exploitation accru que présentent les fluctuations des prix sur le marché mondial.Lorsque ces derniers sont bas,la Confédération verse davantage de contributions et vice versa.Le plafond de production a été relevé au 1er mars 2001 par l’ajout d’un contingent maximum de 2'000 t de sucre bio.La contribution fédérale à la transformation de betteraves sucrières a baissé;en comparaison du montant annuel initial de 45 millions de francs,38,2 millions ont été versés en 2004 pour la transformation de la récolte de 2003.En considération de la libéralisation des marchés agricoles,le Conseil fédéral a supprimé le plafonnement de la production sucrière au 1er octobre 2004.
2.1 PRODUCTION ET VENTES 2.MESURESDEPOLITIQUEAGRICOLE 145 2
Auparavant,la sucrerie devait reporter les quantités de sucre excédentaires à l’année suivante ou les mettre en valeur indépendamment du mandat.Lors de la suppression du plafonnement,la Confédération a interdit à la sucrerie de réduire le prix à l’exportation à l’aide de fonds fédéraux.La sucrerie a dès lors introduit un système de quotas lui permettant de convenir,chaque année,le volume de livraison avec les planteurs de betteraves,en fonction de la situation sur le marché.Lorsqu’un planteur abandonne la production,son droit de livraison est attribué à d’autres producteurs,conformément à une réglementation négociée par la sucrerie avec la Fédération suisse des betteraviers.

Les programmes d'allégement ont encore restreint le budget destiné au soutien de la transformation de betteraves sucrières.Ainsi,l’indemnisation de la sucrerie,fixée dans l’ordonnance sur le sucre,doit être réduite par rapport au montant réservé dans l’enveloppe financière.Les montants prévus sont les suivants:35 millions de francs pour les années 2004/05,28,8 millions pour les années 2005/06 et 26,3 millions pour les années 2006/07.Par ailleurs,à partir de l’année 2005/06 (début le 1er octobre 2005),les fluctuations des recettes de la vente de sucre,occasionnées par les variations de prix sur le marché mondial,ne sont plus prises en compte.
Le Protocole 2 de l'accord de libre-échange conclu par la Suisse et l’UE et révisé dans le cadre des bilatérales II,qui est en vigueur depuis le 1er février 2005,stipule la «double solution zéro» pour le sucre.Celle-ci exclut toute mesure de compensation des prix (contributions à l'exportation,restitutions de droits de douane et taxes douanières) pour le sucre contenu dans les produits agricoles transformés qui relèvent du champ d'application de l'accord.Il existe donc un libre-échange entre la Suisse et l’UE dans ce domaine.Cela signifie que l’industrie suisse de transformation ne peut rester compétitive que si le prix du sucre suisse correspond à peu près à celui pratiqué dans l'UE.
2.1 PRODUCTION ET VENTES 2 146
■ Evolution structurelle dans la culture de betteraves sucrières
Ces dernières années,la culture de betteraves sucrières,qui exigeait autrefois beaucoup de main-d’œuvre,s’est transformée en une branche hautement mécanisée.Alors que les jeunes plants étaient auparavant éclaircis manuellement,la semence de haute qualité disponible aujourd’hui permet d’ensemencer d’emblée de sorte à obtenir la distance finale souhaitée.Le démariage des plantes n’étant ainsi plus nécessaire,cette méthode permet d’économiser quelque 70 heures de travail par ha de betteraves sucrières.
Evolution des structures dans la culture de betteraves
Autres exploitations avec terres ouvertes
Exploitations avec betteraves sucrières
En 2003,quelque 350 exploitations de la catégorie < 10 ha SAU cultivaient 440 ha de betteraves sucrières.Dans la même catégorie,environ 20% des exploitations ont abandonné la production de betteraves entre 1999 et 2003,alors que le nombre des autres exploitations disposant de terres ouvertes a reculé de 35%.Dans la catégorie 10 à 30 ha SAU,la surface moyenne de betteraves sucrières par exploitation ne s’est accrue que de 0,1 ha entre 1999 et 2003.Par contre,elle a diminué de plus de 1 ha dans les exploitations comptant plus de 60 ha SAU.
La surface de culture totale n’a que très peu évolué depuis 1999,mais le nombre d’exploitations pratiquant cette culture a constamment reculé.Trois phénomènes méritent d’être signalés en ce qui concerne l’évolution structurelle:a) le nombre de petites exploitations cultivant des betteraves sucrières a moins fortement reculé que celui des exploitations comptant des terres ouvertes;b) la part de betteraves sucrières à la surface de terres ouvertes diminue plus les exploitations sont grandes;c) malgré une valeur ajoutée relativement élevée,la surface moyenne de betteraves sucrières par exploitation ne s’est pas accrue dans la même mesure que la surface de terres ouvertes.Ces trois observations permettent de conclure que l’évolution des structures est entravée.
Nombre ou ha ha par exploitation
sucrières
Surface de
Surface moyenne de
par exploitation Surface moyenne de betteraves par exploitation Source: OFAG 1999 2001 2003 0 25 00050 40 30 20 10 0 20 000 15 000 10 000 5 000 1999 2001 2003 1999 2001 2003 1999 2001 2003 1999 2001 2003 0–10 ha SAU 10–30 ha SAU 30–60 ha SAU >60 ha SAU total 2.MESURESDEPOLITIQUEAGRICOLE 2.1 PRODUCTION ET VENTES 147 2
betteraves sucrières
terres ouvertes
■ Réforme du marché du sucre de l’UE
Ce sont des facteurs internes et externes qui font progresser la réforme du marché du sucre dans l’UE.D’une part,en 2003,ce marché avait été exclu de la grande réforme de la Politique agricole commune.D’autre part,la même année,les grands pays exportateurs de sucre,à savoir le Brésil,l’Australie et la Thaïlande,ont déposé plainte auprès de l’OMC contre le régime européen du marché du sucre,qui est caractérisé par un prix bien supérieur à celui du marché mondial et par de grands volumes d’exportation. En juillet 2004,la Commission de l’UE a présenté un premier projet de réforme,qui prévoyait une réduction du prix du sucre d’un tiers et une compensation partielle,de 60%,des pertes subies par les producteurs de betteraves.L’organe compétent de l’OMC a approuvé la plainte précitée en avril 2005.Selon son jugement,les contributions allouées pour la réexportation de sucre importé de pays d’Afrique,des Caraïbes ou du Pacifique,à des taux préférentiels,doivent être considérées comme une promotion des exportations,ainsi d’ailleurs que le subventionnement indirect des exportations de sucre ayant été produit dans l’UE.En juin 2005,la Commission de l’UE a soumis un nouveau projet de réforme tenant compte de ce jugement et selon lequel le prix du sucre sera abaissé de 39% dès l’année économique 2007/08.Le prix minimum des betteraves sucrières,quant à lui,diminuera de 42,6%.
Projet de réforme de la Commission de l’UE du 22 juin 2005
sucre
(départ sucrerie)%10010075,471,261,0
Contribution de restructurationfr./t0192138980
Prix de référence du sucre
(production)fr./t960768586586586
Prix minimum des betteravesfr./t6650383838
Prix minimum des betteraves%10075,357,457,457,4
Cours de change:1 C = = 1.52 fr.
Même si le projet de la Commission prévoit une compensation,indépendante du marché du sucre,pour les producteurs de betteraves sucrières,il déclenchera probablement une profonde restructuration dans l’économie sucrière.Les pays membres peu compétitifs abandonneront éventuellement la production de sucre à moyen terme.La Commission de l’UE souhaite que le Conseil des Ministres approuve ses propositions en novembre 2005.Depuis février 2005,l’UE et la Suisse pratiquent le libre-échange en ce qui concerne le sucre contenu dans des produits transformés qui tombent sous le coup des bilatérales II.L’industrie alimentaire suisse,qui utilise environ 80% du sucre,doit pouvoir compter sur un prix de la matière première comparable à celui pratiqué dans l’UE pour rester compétitive.La réforme du marché européen se répercute ainsi directement sur l’économie sucrière suisse.En raison de l’abaissement du prix de référence du sucre (départ sucrerie) en trois étapes dans les années 2007 à 2009,le prix des betteraves sucrières devra,lui aussi,diminuer afin que les coûts de la production de sucre soient couverts.Malgré les mesures prévues pour compenser partiellement les pertes de revenu,ce seront le potentiel local de baisse des coûts et la compétitivité de l’échelon de transformation qui détermineront en fin de compte où il
Prix de référence du sucre (départ sucrerie)fr./t960960724684586 Prix de référence du
20052006/072007/082008/092009/10
2.1 PRODUCTION ET VENTES 2 148
■ Adaptation au marché dans le secteur des fruits et des légumes: premières expériences
est opportun de cultiver des betteraves sucrières.Il faut ainsi s’attendre à ce que cette culture perde de son attrait et que,par conséquent,le système de quotas actuel en Suisse ne revête plus la même importance qu’aujourd’hui.
Cultures spéciales
Depuis le 1er janvier 2004,l’ordonnance sur les mesures en faveur du marché des fruits et des légumes (ordonnance sur les fruits et les légumes) prévoit l’octroi de contributions à la reconversion des cultures fruitières et à la plantation de cultures novatrices de fruits ou de légumes.La surface minimale permettant de déposer une demande a été fixée à 1,5 ha et 1 ha respectivement.Ces mesures sont limitées à fin 2011.Des demandes peuvent être présentées par des groupements de producteurs ou des producteurs individuels disposés à consacrer les surfaces minimales requises aux mesures en question.L’exigence d’une surface minimale favorise le regroupement de l’offre,qui à son tour est susceptible d’accroître l’intérêt du commerce de détail,dans la mesure où il permet de produire des quantités appropriées.
Une reconversion donne droit à la contribution lorsqu’un arrachage de cultures de pommiers,poiriers,cerisiers ou pruniers est suivi de la plantation de cultures de cerisiers ou de pruniers dont la récolte a lieu,pour l’essentiel,avant ou après une période où le taux moyen d’auto-approvisionnement du marché suisse,calculé sur une période de quatre ans,dépasse 80%.On garantit ainsi l’adéquation de la production aux besoins du marché et empêche un surapprovisionnement.Les contributions aux cultures novatrices peuvent être octroyées pour les cultures pérennes de fruits et de légumes ne bénéficiant d’aucune protection douanière.Les récoltes de ces cultures doivent par ailleurs présenter la qualité de fruits de table.Le soutien n’est accordé que si la commercialisation des produits a été planifiée avec soin et que la rentabilité a été vérifiée.
Surface en ha
Demandes présentées pour cultures novatrices de fruits et de légumes 2004
Raisins de table 0 14 16 12 10 8 6 4 2 Cerises de conserve
2.MESURESDEPOLITIQUEAGRICOLE 2.1 PRODUCTION ET VENTES 149 2
Source: OFAG
Asperges
Sureau Myrtilles Kiwis/ mini-kiwis Mirabelles Prunes NectarinesPêches
■ Perspectives
La première année,des demandes ont été présentées pour la reconversion de 4 ha et pour l’aménagement de cultures novatrices sur 70 ha.Une des trois demandes de reconversion n’a pas pu être prise en compte,car la surface de replantation n’atteignait pas la limite de 1,5 ha.Les membres de ce groupe de producteurs ont la possibilité d’accroître la surface et de déposer une nouvelle demande.Les deux autres demandes concernent l’arrachage de cultures de pommiers (2,1 ha),de poiriers (0,5 ha),de cerisiers (1 ha) et de pruniers (0,4 ha) et la plantation de cultures de cerises et de prunes de table à raison de la moitié chacune.S’agissant de la plantation de cultures novatrices,24 demandes ont été déposées dans l’année sous revue.Les raisins de table et les cerises de conserve se prêtant à la cueillette mécanique représentent, avec 14 ha chacune,la majeure part de la surface concernée.Suivent les asperges blanches avec 11 ha.Quant aux cultures de sureau,de myrtilles et de kiwis/mini kiwis, elles se situent dans la moyenne avec 6,7 à 8 ha.Après les mirabelles (4,6 ha) et les prunes (3,7 ha),les nectarines et les pêches couvrent les plus petites surfaces avec 1 are chacune.
L’OFAG collabore étroitement avec les services cantonaux d’arboriculture et de culture maraîchère,qui connaissent parfaitement les conditions locales.Il étudie en détail les demandes pour réserver le soutien aux projets prometteurs qui satisfont aux exigences de rentabilité.
Le Conseil fédéral propose,dans son rapport de consultation sur la PA 2011,de supprimer les subventions à l’exportation,notamment dans le domaine fruitier.Il entend ainsi tenir compte de l’ouverture des marchés et des résultats probables du cycle de Doha concernant les aides aux exportations,et par ailleurs prolonger autant que possible la période de mise en œuvre des mesures qui s’imposent.Les conditions du marché montrent que la production de cerises de conserve pour le marché intérieur et l’exportation de cerises de conserve transformées peuvent rester concurrentielles, pour autant que les conditions de production,de livraison et de transformation s’améliorent.La PA 2007 a déjà introduit une aide à la modernisation de ces cultures,afin que les coûts de production baissent et que la mise en valeur ne nécessite plus d’aide fédérale.L’octroi de contributions pour la plantation de cultures novatrices et pour la reconversion de cultures est conforme à cette stratégie et soutient les producteurs dans les efforts qu’ils consentent pour répondre aux besoins du marché.En raison de l’importance de ces contributions pour l’amélioration de la compétitivité,il est prévu de les allouer également à l’avenir,pour autant que l’évolution du marché le permette. Selon la loi,ces contributions peuvent être octroyées jusqu’en 2011.
2.1 PRODUCTION ET VENTES 2 150
2.2 Paiements directs
Les paiements directs sont l’un des principaux éléments de la politique agricole et servent à rétribuer les prestations fournies par l’agriculture à la demande de la société. Il convient de distinguer les paiements directs généraux et les paiements directs écologiques.

Dépenses au titre des paiements directs
Domaine199920002001200220032004 mio.mio.mio.mio.mio.mio. de fr.de fr.de fr.de fr.de fr.de fr.
Paiements directs généraux1 7791 8041 9291 9951 9991 994 Paiements directs écologiques326361413452477495
Remarque:une comparaison directe avec les données du compte d’Etat est impossible.Les valeurs indiquées sous 2.2 «Paiements directs» se rapportent à l’ensemble de l’année de contributions,alors que le compte d’Etat indique les dépenses d’une année civile.Quant aux réductions,il s’agit de retenues effectuées en raison de limites et de sanctions légales et administratives.
■■■■■■■■■■■■■■■■
Total 2 0812 1422 3252 4262 459 2 470
Réductions242317211718
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 151
Source:OFAG
■ Rétribution de prestations fournies dans l’intérêt général
2.2.1Importance des paiements directs
D’utilité publique,les prestations de l’agriculture sont rétribuées au moyen des paiements directs généraux.En font partie les contributions à la surface et les contributions pour les animaux consommant des fourrages grossiers.Toutes deux ont pour objectif d’assurer l’exploitation et l’entretien de la surface agricole dans son ensemble. En outre,dans la région des collines et de montagne,les agriculteurs touchent des contributions pour des terrains en pente et pour la garde d’animaux dans des conditions difficiles.Il est ainsi tenu compte des difficultés d’exploitation dans ces régions. L’octroi de tous les paiements directs (contributions d’estivage exceptées) est lié à la fourniture des prestations écologiques requises (PER).
■ Rétribution de prestations écologiques et éthologiques particulières
De leur côté,les paiements directs écologiques incitent les agriculteurs à fournir les prestations écologiques et éthologiques particulières qui sortent du cadre des PER. En font partie les contributions écologiques,les contributions à la qualité écologique, les contributions pour la protection des eaux,les contributions d’estivage et les contributions pour la garde d’animaux particulièrement respectueuse de l’espèce (SST, SRPA).Par leurs incitations financières,ils encouragent les prestations de l’agriculture qui vont au-delà des exigences légales et notamment des PER.Entre autres objectifs, ils visent à préserver et à augmenter la diversité des espèces dans les régions agricoles, à encourager les systèmes de garde particulièrement respectueux des animaux,à réduire l’utilisation d’engrais et de produits phytosanitaires,de même que la pollution des eaux par les nitrates et le phosphore,et à assurer une exploitation durable de la région d’estivage.

■■■■■■■■■■■■■■■■
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 152
■ Importance économique des paiements directs en 2004
En 2004,les paiements directs ont représenté quelque 70% des dépenses de l’OFAG. 63% de ces paiements sont allés à la région des collines et de montagne.
une comparaison directe avec les données du compte d’Etat est impossible.Les valeurs indiquées sous 2.2 «Paiements directs» se rapportent à l’ensemble de l’année de contributions,alors que le compte d’Etat indique les dépenses d’une année civile.Quant aux réductions,il s’agit de retenues effectuées en raison de limites et de sanctions légales et administratives. Source:OFAG
Paiements directs
Type de contributionTotalRégion de Région des Région de plainecollinesmontagne 1 000 fr. Paiements directs généraux1 993 915737 363513 322732 538 Contributions à la surface1 317 773650 815326 632340 327 Contributions pour la garde d’animaux consommant des fourrages grossiers286 12079 84873 487132 785 Contributions pour la garde d’animaux dans des conditions difficiles284 0234 42579 473200 125 Contributions générales pour des terrains en pente95 3082 27633 73059 302 Contributions pour les surfaces viticoles en forte pente et en terrasses10 691 Paiements directs écologiques494 695197 728110 14490 237 Contributions écologiques398 109197 728110 14490 237 Contributions à la compensation écologique125 66572 81131 85620 997 Contributions au sens de l'ordonnance sur la qualité écologique (OQE)23 0077 3096 7968 902 Contributions pour la culture extensive de céréales et de colza (culture extensive)30 82421 5348 547743 Contributions pour la culture biologique27 9628 5275 68313 752 Contributions pour la garde d’animaux de rente particulièrement respectueuse de l’espèce (SST,SRPA)190 65187 54757 26145 843 Contributions d'estivage91 066 Contributions pour la protection des eaux5 521 Réductions18 120 Total paiements directs2 470 490935 092623 466822 776 Paiements directs par exploitation en fr.43 28438 67940 31547 191 Remarque:
en 2004
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 153 2.MESURESDEPOLITIQUEAGRICOLE
■ Exigences requises pour l’octroi de paiements directs
Part des paiements directs au rendement brut d’exploitations de référence, selon la région,en 2004
ParamètreUnitéTotalRégion de Région des Région de plainecollinesmontagne
L’octroi de contributions pour les conditions de production difficiles dans la région des collines et de montagne a pour effet de majorer le montant des paiements directs versés à l’hectare au fur et à mesure que lesdites difficultés augmentent.Conséquence des plus faibles rendements obtenus en montagne,la part des paiements directs au rendement brut y est également plus élevée qu’en plaine.
Pour toucher des paiements directs,les agriculteurs doivent remplir de nombreuses conditions.Au nombre de celles-ci figurent,d’une part,des conditions générales telles qu’une forme juridique,un domicile de droit civil,etc.et,d’autre part,des critères structurels et sociaux,eux aussi déterminants,comme le besoin minimal en travail, l'âge de l'exploitant,le revenu et la fortune.A cela s’ajoutent des charges spécifiquement écologiques qui sont regroupées sous la notion de prestations écologiques requises (PER).Les exigences PER comprennent un bilan de fumure équilibré,une part équitable de surfaces de compensation écologique,un assolement régulier,une protection appropriée du sol,l’utilisation ciblée de produits phytosanitaires,ainsi que la garde d’animaux de rente respectueuse de l’espèce.Des manquements aux prescriptions déterminantes donnent lieu à une réduction des paiements directs ou à un refus d’octroi.

ExploitationsNombre3 0771 435846796 SAUha19,2520,0718,5218,63 Paiements directs générauxfr.36 88830 30436 46248 235 Contributions écologiquesfr.7 7028 6377 8086 045 Total paiements directsfr.44 59038 94144 27054 280 Rendement brutfr.215 341263 974196 665153 507 Part des paiements directs au rendement brut%20,714,822,535,4
Tänikon
Source:Agroscope FAT
Tableaux 40a–41,pages A46–A49
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 154
■ Système d'information sur la politique agricole
La plupart des données statistiques sur les paiements directs proviennent de la banque de données du système d'information sur la politique agricole (SIPA) développée par l’OFAG.Ce système est alimenté par les relevés annuels des données structurelles qui sont compilés et transmis par les cantons,ainsi que par les indications relatives aux versements (surfaces,cheptels et contributions pertinentes) de chaque type de paiement direct.La banque de données sert en premier lieu au contrôle administratif des montants versés aux exploitants par les cantons,mais elle permet aussi d’établir des statistiques générales sur les paiements directs.Grâce à cette mine d’informations et à l’utilisation d’outils informatiques performants,bon nombre de questions de politique agricole peuvent être éclairées sous des angles différents.
Sur les 62'692 exploitations enregistrées dans le SIPA en 2004 et qui dépassent la limite fixée par la Confédération pour l’établissement de relevés,57'076 touchent des paiements directs.
■ Répercussions des échelonnements et des limitations
Les échelonnements et les limitations ont un impact sur la répartition des paiements directs.Les échelonnements dégressifs concernent les surfaces et les animaux tandis que les limitations consistent en des limites de revenu et de fortune ainsi que du montant maximum alloué par UMOS.
Impact des limites d’octroi des paiements directs en 2004
LimitationExploitations Montant total Part au total desPart à la somme concernéesdes réductionscontributionsdes paiements touchées pardirects exploitation
Les limites d’octroi entraînent des réductions de paiements directs,surtout pour les 200 exploitants dont la fortune est trop élevée.En outre,quelque 890 exploitations ont dépassé la limite de revenu en 2004.La réduction des paiements directs s’est élevée dans leur cas à 10,18% en moyenne.Globalement,les limites d’octroi ont conduit à des réductions de 9,4 millions de francs,ce qui correspond à 0,38% du montant total.
Nombrefr.%% par UMOS (65'000 fr.)4431 101 5946,770,04 en fonction du revenu8874 340 32810,180,18 en fonction de la fortune2003 998 79067,280,16 Total9 440 712 0,38
Source:OFAG
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 2.MESURESDEPOLITIQUEAGRICOLE 155
Effets de l’échelonnement des contributions en fonction de la surface ou du nombre d’animaux en 2004
Les échelonnements prévus dans l’ordonnance sur les paiements directs concernent en tout 8'579 exploitations.Dans la plupart des cas,les réductions portent sur diverses mesures.Comparée à l’ensemble des paiements directs dégressifs,la part de toutes les réductions opérées s’élève globalement à 35,6 millions de fr.,soit à 1,44%.Les échelonnements dégressifs ont un effet notable sur les contributions à la surface et concernent près de 7'200 exploitations (environ 12,6% de l’ensemble des exploitations recevant des paiements directs).Quant aux exploitations qui bénéficient de contributions pour la garde d'animaux consommant des fourrages grossiers,les réductions touchent 220 d’entre elles.Il faut dire que d’autres limitations comme la limite d’octroi et la déduction pour le lait commercialisé entrent ici en jeu bien avant l’échelonnement des paiements directs.Les paiements directs écologiques font eux aussi l’objet de réductions.Ainsi,il a fallu réduire les paiements directs accordés pour la garde d’animaux de rente particulièrement respectueuse de l’espèce (programmes SST et SRPA) dans le cas de 2'864 exploitations (sans les doubles comptages),de 10,2% et de 8,3% respectivement.Environ 734 exploitations bio ont touché des paiements réduits de 7,3%.
MesureExploitations Surface/effectif Réduction Part aux Part
totale desdes paiements exploitationsdirects Nombreha ou UGBfr.%% Contributions à la surface7 19042,030 236 4107,51,22 Contributions pour la garde d’animaux consommant des fourrages grossiers22058,8633 2925,90,03 Contributions générales pour des terrains en pente8834,440 7143,20,00 Contributions pour les vignes en forte pente et en terrasses133,529522,60,00 Contributions à la compensation écologique1145,582 07913,60,00 Contributions pour la culture extensive de céréales et de colza (culture extensive)5435,529 3853,90,00 Contributions pour la culture biologique73440,0553 1397,30,02 Contributions pour les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux1 82767,11 628 33710,30,07 Contributions pour sorties régulières en plein air2 50364,12 350 9268,30,10 Total8 579 1 35 557 2348,21,44 1sans les doubles comptages Source:OFAG
à la concernéespar exploitationcontributions somme
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 156
■ Exécution et contrôle
L’art.66 de l’ordonnance sur les paiements directs (OPD) délègue aux cantons la tâche de contrôler les prestations écologiques requises (PER).Ces derniers y associent des organismes accrédités présentant toutes garanties de compétence et d'indépendance. Mais ils sont tenus de surveiller l’activité de contrôle par sondage.Les exploitations bio ayant droit aux paiements directs doivent non seulement respecter les exigences de la culture biologique,mais aussi fournir les PER et garder tous leurs animaux de rente selon les prescriptions SRPA.Elles font l’objet de contrôles effectués par un organisme de certification accrédité,sous la surveillance des cantons.L’art.66,al.4,OPD précise selon quels critères les cantons ou les organisations associées sont tenus de contrôler les exploitations.
Sont ainsi contrôlées: –toutes les exploitations qui demandent des contributions pour la première fois; –toutes les exploitations dans lesquelles des manquements ont été constatés lors de contrôles effectués l’année précédente;et –au moins 30% du reste des exploitations choisies au hasard.
En cas de fourniture insuffisante des PER,les contributions sont réduites selon des critères uniformes qui sont énoncés dans une directive édictée par la Conférence des directeurs cantonaux de l’agriculture.
■ Contrôles et réductions de contributions en 2004
En 2004,sur les 57'076 exploitations agricoles ayant droit aux contributions,33'697 (59%) ont été contrôlées par les cantons ou par les services mandatés à cet effet pour s’assurer qu’elles respectaient les prescriptions PER.A vrai dire,la part des exploitations soumises à un contrôle varie fortement d’un canton à l’autre (de 24 à 100%). Les contributions ont été réduites pour 1'896 exploitations (5,6% des exploitations contrôlées) en raison de manquements aux prescriptions PER.
Conformément à l’ordonnance sur l’agriculture biologique,toutes les exploitations bio doivent être contrôlées chaque année.Seulement 3,2% d’entre elles ont été pénalisées par une réduction des contributions en raison de manquements.
S’agissant des programmes SST et SRPA,les contrôles ont porté sur 69,2% (33 à 100%) et 51,6% (20 à 100%) des exploitations ayant droit à des contributions.Dans le cas du programme SST,les réductions prononcées ont visé 5,3% de toutes les exploitations ayant droit aux paiements directs et,pour le programme SRPA,elles ont frappé 6% des exploitations contrôlées.
Au total,des insuffisances ont été constatées dans 5'606 exploitations et ont entraîné des réductions des contributions s’élevant à quelque 5 millions de francs.
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 2.MESURESDEPOLITIQUEAGRICOLE 157
Récapitulatif des réductions de contributions prononcées en 2004
CatégorieExploitations Exploitations ExploitationsRéductionsRaisons principales ayant droit contrôléessanctionnées aux par des contributionsréductions
Enregistrements lacunaires,garde d’animaux de rente non respectueuse de l’espèce,autres raisons (échantillons du sol manquants,expiration du délai requis pour le test des pulvérisateurs),bilan de fumure non équilibré,bordures tampons et bandes herbeuses inadéquates,sélection et application non conformes des produits phytosanitaires,annonces tardives,part des SCE inadéquate.
Eléments autres que ceux mentionnés dans la liste (utilisation différente de celle prévue,période de fauche et mesures d’entretien non respectées),utilisation trop précoce ou non admise,fausses indications sur le nombre d’arbres ou les surfaces,envahissement par des mauvaises herbes,fumure et produits phytosanitaires non autorisés,annonces tardives.
Annonces tardives,récolte faite avant maturité des graines,produits phytosanitaires interdits
Eléments autres que ceux mentionnés dans la liste (infraction aux prescriptions d’affouragement ou concernant la garde d’animaux ou la protection des eaux ou les enregistrements),non-respect des prescriptions bio par les entreprises exploitées à titre de loisirs),utilisation d’engrais et de produits phytosanitaires interdits dans la culture biologique, annonces tardives,fausses indications.
Eléments autres que ceux mentionnés dans la liste (litière inadéquate),annonces tardives,absence de système de stabulation à aires multiples,garde non conforme de certains animaux d’une même catégorie, aire de repos insuffisante,éclairage de l’étable non conforme,fausses indications.
Eléments autres que ceux mentionnés dans la liste (durée d’engraissement minimale non respectée,aire de repos avec caillebotis/trous,protection des animaux insuffisante,surface pacagère trop petite,mise au pâturage tardive,etc.),nombre insuffisant de jours de sortie,annonces tardives,enregistrements lacunaires, garde non conforme de certains animaux d’une même catégorie,fausses indications,parcours insuffisant.
Charge usuelle en bétail dépassée ou non atteinte, gestion incorrecte des pâturages,utilisation de surfaces non pâturables,infractions aux prescriptions agricoles pertinentes,annonces tardives,épandage d’engrais non autorisés,autres éléments (sur-livraisons de lait), fausses indications sur l’effectif d’animaux ou la durée d’estivage,documents manquants,entretien inadéquat des bâtiments,entraves aux contrôles,données lacunaires,emploi d’herbicides interdits,récidives.
1 Sans JU:données manquantesSource:Rapports cantonaux sur les activités de contrôle et les réductions de contributions
NombreNombreNombrefr. PER57 07633 6971 896980 686 SCE 54 101-747722 607 Culture 17 263-4818 663 extensive Culture 6 3185 859205112 221 biologique SST 19 57713 551719483 325 SRPA 37 44619 3211 157934 538 Estivage7 4501 227 1 383777 039
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 158
Tableaux 42a–42b,pages A50–A51
Récapitulatif des réductions de contributions prononcées en 2004
CatégorieExploitations Exploitations ExploitationsRéductionsRaisons principales ayant droit contrôléessanctionnées aux par des contributionsréductions
Tableaux 42a–42b,pages A50–A51
Fausses indications sur les surfaces ou l’effectif d’animaux,autres éléments (fausses indications concernant les PER,moins de 50%),de main-d’œuvre propre à l’exploitation,inscriptions à un programme ou désistements tardifs,entraves aux contrôles),fausses indications sur l’exploitation ou les exploitants ou l’estivage. Pas
Source:Rapports cantonaux sur les activités de contrôle et les réductions de contributions
■ Autorisations spéciales dans le domaine de la protection des végétaux
Dans certains cas,l’utilisation de produits phytosanitaires ou le recours à des traitements non admis dans le cadre des PER sont autorisés pour protéger les cultures lorsque les conditions météorologiques ou les particularités du site l’exigent.C’est pourquoi les services cantonaux de protection des plantes peuvent délivrer des autorisations spéciales en vertu de l’annexe 6.4 de l'OPD.En 2004,ils en ont accordé 3'416 pour 8'721 ha de SAU.Comme les années précédentes,la plupart de ces autorisations ont été délivrées afin de permettre le traitement des mauvaises herbes dans des prairies naturelles.Il s’agissait avant tout de lutter contre le rumex et les renoncules.
Autorisations spéciales accordées dans le domaine de la protection des végétaux en 2004 Moyen de lutteAutorisationsSurface Nombre Exploitations ha% de la d’exploitationsen %surface totale Herbicides en prélevée203694210,8 Insecticides94927,83 47739,9 Granulés dans le maïs601,82683,1 Granulés dans les betteraves3159,21 01511,6 Herbicides pour prairies1 56545,82 60829,9 Autres3249,54114,7
Total3 4161008 721100
Source:OFAG
NombreNombreNombrefr. Données --166578 578 de base Protection --248454 442 des eaux Protection de --1513 863 la nature et du paysage Protection de --2213 450 l’environnement Total--5 606 5 089 412
d’indication possible
d’indication
2.MESURESDEPOLITIQUEAGRICOLE 2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 159
Pas d’indication possible Pas
possible
■ Objectif visé:exploitation de toute la surface agricole
2.2.2 Paiements directs généraux
Contributions à la surface
Les contributions à la surface servent à rétribuer les prestations fournies dans l'intérêt général telles que la protection et l’entretien du paysage rural,la garantie de la production alimentaire et la préservation du patrimoine naturel.Depuis 2001,une contribution supplémentaire pour les terres ouvertes et les cultures pérennes est venue s’y ajouter.
Taux de 2004fr./ha 1
– jusqu’à 30 ha1 200
– de 30 à 60 ha900
– 60 à 90 ha600
– plus de 90 ha0
1D’un montant de 400 fr.par ha et par an,la contribution supplémentaire allouée pour les terres ouvertes et les cultures pérennes est également soumise à l’échelonnement en fonction des surfaces
Pour les surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère,les taux de tous les paiements directs liés aux surfaces sont réduits de 25%.Quelque 5'000 ha en tout sont exploités dans cette zone depuis 1984.Les exploitations suisses qui achètent ou afferment aujourd’hui des surfaces dans la zone limitrophe étrangère ne reçoivent pas de paiements directs pour ces surfaces.
Contributions à la surface versées en 2004 (contribution supplémentaire comprise)
La contribution supplémentaire a été versée pour 270'936 ha de terres ouvertes et 18'217 ha de cultures pérennes.
■■■■■■■■■■■■■■■■
ParamètreUnitéRégion de Région desRégion de Total plainecollinesmontagne Surfaceha478 170262 102288 0881 028 360 ExploitationsNombre24 06115 42617 42156 908 Surface par exploitationha19,917,016,518,1 Contribution par exploitationfr.27 04921 17419 53523 156 Total des contributions1 000 fr.650 815326 632340 3271 317 773 Total des contributions 20031 000 fr.650 201327 052340 7041 317 956 Source:OFAG
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 160
Tableaux 31a–31b,pages A31–A32
Répartition des exploitations et de la SAU selon les classes de grandeur 2004 Source:
La dégression des contributions concerne 9,2% de la SAU.Au titre de la contribution à la surface,il est versé en moyenne un montant de 1'281 francs par ha (contribution supplémentaire incluse).Les exploitations comptant jusqu’à 10 ha couvrent en tout 9,3% de la SAU.Seul 1,1% de l’ensemble des exploitations dispose de plus de 60 ha; celles-ci exploitent 5,1% de la SAU.

Classes de grandeur en ha Exploitation SAU < 30 30 < SAU < 60 60 < SAU < 90 SAU > 90 30 20 2010 0201030 plus de 90 60–90 30–60 20–30 15–20 10–15 5–10 jusqu'à 5 1,71,80,6 20,4 27,5 17,5 14,2 7,7 12,3 1,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 20,5 18,2 20,6 18,4 1,6 6,0 Exploitations en %SAU en % 8,8 2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 161
OFAG
■ Surfaces utilisées comme herbages
Contributions pour la garde d’animaux consommant des fourrages grossiers
Cette mesure vise à préserver la compétitivité des producteurs de viande disposant d’une base fourragère et,en même temps,à assurer l’exploitation de l’ensemble des terres agricoles de la Suisse,pays à vocation herbagère.

Les contributions pour la garde d’animaux consommant des fourrages grossiers sont versées pour des animaux gardés dans l’exploitation durant la période d’affouragement d’hiver (période de référence:du 1er janvier au jour de référence de l’année de contributions).Sont considérés comme animaux consommant des fourrages grossiers les bovins et les équidés,ainsi que les moutons,les chèvres,les bisons,les cerfs,les lamas et les alpagas.Les contributions sont versées en fonction des surfaces herbagères permanentes et des prairies artificielles existantes.Pour ce faire,les diverses catégories d’animaux sont converties en unités de gros bétail consommant des fourrages grossiers (UGBFG) et leur nombre par ha est limité.Cette limitation est échelonnée en fonction des zones.
Limites d’encouragementUGBFG/ha
–Zone de grandes cultures,zone intermédiaire élargie et zone intermédiaire2,0
–Zone des collines1,6
–Zone de montagne I1,4
–Zone de montagne II1,1
–Zone de montagne III0,9
–Zone de montagne IV0,8
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 162
Les UGBFG sont réparties en deux groupes de contributions.Pour les bovins,équidés, bisons,chèvres et brebis laitières,le taux des contributions s’élève à 900 francs par UGBFG,alors qu’il est fixé à 400 francs pour les chèvres et les moutons ainsi que pour les cerfs,les lamas et les alpagas. Contributions versées en 2004 pour la garde d’animaux consommant des fourrages grossiers
En 2004,l’effectif de bétail des producteurs de lait destiné à la commercialisation,qui donnait droit aux contributions,a été réduit d'une UGBFG par 4’400 kg de lait livrés l'année précédente.Le montant des contributions a ainsi baissé d’environ 1,6 million de francs par rapport à l’année précédente.
Contributions versées en 2004 aux exploitations avec et sans lait commercialisé
ParamètreUnitéExploitations avec Exploitations sans commercialisationcommercialisation
ExploitationsNombre18 60518 236
Animaux par exploitationUGBFG23,612,9
Déduction pour limitation des contributions en fonction de la surface herbagèreUGBFG1,11,2
Déduction pour lait commercialiséUGBFG15,90,0
Animaux donnant droit aux contributionsUGBFG6,611,8
Contributions par exploitationfr.5 8099 763
Certes,les entreprises qui commercialisent du lait touchent environ 3'950 francs de moins de contributions UGBFG que celles qui ne le font pas.Mais elles bénéficient en revanche de mesures de soutien du marché laitier (p.ex.supplément pour le lait transformé en fromage).
ParamètreUnitéRégion de
desRégion de Total plainecollinesmontagne UGBFG donnant droit aux contributionsNombre93 27885 951158 268337 497 ExploitationsNombre10 33310 82615 68236 841 UGBFG donnant droit aux contributions par exploitationNombre9,07,910,19,2 Contributions par exploitationfr.7 7276 7888 4677 766 Total des contributions1 000 fr.79 84873 487132 785286 120 Total des contributions 20031 000 fr.78 58873 870135 234287 692 Source:OFAG
Région
Source:OFAG
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 2.MESURESDEPOLITIQUEAGRICOLE 163
■ Compensation des difficultés de production
Contributions pour la garde d’animaux dans des conditions difficiles
Ces contributions servent à compenser les conditions de production difficiles des éleveurs dans la région de montagne et dans la zone des collines.A la différence des contributions «générales» allouées pour la garde d’animaux de rente consommant des fourrages grossiers et qui sont destinées en premier lieu à promouvoir l’exploitation et l’entretien des herbages,celles-ci visent des objectifs à caractère social ou structurel quand ils ne relèvent pas de la politique d’occupation du territoire.Donnent droit aux contributions les mêmes catégories d’animaux que dans le cas des contributions versées pour la garde d’animaux consommant des fourrages grossiers.Ces contributions sont versées pour 20 UGBFG au plus par exploitation.
Taux par UGBFG en 2004fr./UGBFG
– Zone des collines260
– Zone de montagne I440
– Zone de montagne II690
– Zone de montagne III930
– Zone de montagne IV1 190
Contributions versées en 2004 pour la garde d’animaux dans des conditions difficiles
Comparées à 2003,les contributions pour la garde d’animaux dans des conditions difficiles ont baissé d’environ 3,3 millions de francs par suite de l’évolution structurelle. En conséquence,les UGBFG donnant droit aux contributions ont diminué de 2'829 unités.De même,le recul du nombre des exploitations s’est poursuivi (–181 unités).
ParamètreUnitéRégion de Région desRégion de Total plaine 1 collinesmontagne UGBFG donnant droit aux contributionsNombre50 492229 686242 155522 334 ExploitationsNombre2 84714 59616 77534 218 UGBFG par exploitationNombre17,715,714,415,3 Contributions par exploitationfr.1 5545 44511 9308 300 Total des contributions1 000 fr.4 42579 473200 125284 023 Total des contributions 20031 000 fr.4 15680 886202 246287 289 1 Entreprises exploitant une partie des surfaces dans
la région de montagne et des collines Source:OFAG
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 164
Répartition des animaux consommant des fourrages grossiers dans des conditions de production difficiles, selon les classes de grandeur – 2004
En 2004,64% du cheptel UGBFG étaient gardés dans des exploitations ayant droit aux contributions et concernées par cette limitation.Dans ces dernières,la part des UGBFG ne donnant pas droit aux contributions s’est élevée à 34%.

45–90 Exploitations en 100 Animaux en 1 000 UGBFG 30–45 20–30 15–20 10–15 5–10 jusqu'à 5
Classes de grandeur en UGBFG Exploitations (en
Animaux (en 1000) avec
Animaux (en 1000) sans contribution 100 50 0 50 100 150200250 31 44 86 60 166 112 0 74 42 9 83 41 13 64 59 57 25 34 2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 165
Source: OFAG
100)
contribution
■ Contributions générales pour des terrains en pente:compensation des difficultés dans l’exploitation des surfaces
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 166
Contributions pour des terrains en pente
Les contributions générales pour des terrains en pente rétribuent l’exploitation des terres dans des conditions difficiles dans la région des collines ou celle de montagne. Elles ne sont versées que pour les prairies,les surfaces à litière et les terres assolées. Les prairies doivent être fauchées au moins une fois par an,les surfaces à litière une fois par an au plus et tous les trois ans au moins.Selon leur déclivité,les terrains en pente sont répartis en deux catégories:
Contributions versées en 2004 pour des terrains en pente
1Exploitations disposant de surfaces situées dans la région de montagne et des collines Source:OFAG
Exploitations ayant touché des contributions pour terrains en pente en 2004
Total 560 600 ha
déclivité inférieure à 18% 59% déclivité de 35% et plus 15%
L’étendue des surfaces annoncées varie légèrement d’une année à l’autre,évolution qui dépend surtout des conditions climatiques et de leur impact sur le type d’exploitation (plus ou moins de pâturages ou de prairies de fauche).
Taux de 2004fr./ ha – Déclivité de 18 à 35%370 – Déclivité de plus de 35%510
ParamètreUnitéRégion de Région desRégion de Total plaine 1 collinesmontagne Surfaces donnant droit aux contributions: – déclivité de 18 à 35 %ha4 32265 59274 026143 940 – déclivité de plus de 35 %ha1 32618 55862 62982 513 Totalha5 64884 150136 655226 452 ExploitationsNombre2 06113 74716 17631 984 Contribution par exploitationfr.1 1042 4543 6662 980 Total des contributions1 000 fr.2 27633 73059 30295 308 Total des contributions 20031 000 fr.2 25533 95059 42495 630
Source: OFAG déclivité de 18 à 35% 26%
■ Contributions pour les surfaces viticoles en forte pente et en terrasses
Ces contributions aident à préserver les vignobles plantés en forte pente et en terrasses.Afin d’apprécier correctement les surfaces viticoles pour le calcul des contributions,il convient de faire la distinction entre,d’une part,les fortes et les très fortes pentes et,d’autre part,les terrasses aménagées sur des murs de soutènement.Pour les vignobles en forte pente et en terrasses,les contributions ne sont allouées qu’à partir d’une déclivité de 30%.Les taux des contributions sont fixés indépendamment des zones.
Contributions versées en 2004 pour les vignes en forte pente et en terrasses
La part des surfaces viticoles en forte pente et en terrasses représente quelque 29% de la surface viticole totale,et le nombre d’exploitations 52% de l’ensemble des exploitations viticoles.

Taux de 2004fr./ ha – Surfaces de 30 à 50 % de déclivité1 500 – Surfaces de plus de 50 % de déclivité3 000 – Surfaces en terrasses5 000
Unité Surfaces donnant droit aux contributions,totalha3 486 Surfaces en forte pente,déclivité de 30 à 50 %ha1 737 Surfaces en forte pente,déclivité de plus
%ha328 Aménagements en terrassesha1 420 ExploitationsNombre2 905 Surface par exploitationha1,2 Contribution par exploitationfr.3 680 Total des contributions1 000 fr.10 691 Total des contributions 20031 000 fr.10 524 Source:OFAG
de 50
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 167
2.2.3Paiements directs écologiques
Contributions écologiques
Total 381,3 mio. de fr. 2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 168
Les paiements directs écologiques rétribuent des prestations écologiques particulières qui dépassent le cadre des PER.Les exploitants peuvent choisir librement de participer aux différents programmes qui leur sont proposés.Ceux-ci sont indépendants les uns des autres,les contributions pouvant être cumulées.
écologique 32%
extensive 8%

■■■■■■■■■■■■■■■■
Tableaux 32a–32b,pages A33–A34 Répartition des contributions écologiques entre les programmes en 2004
Compensation
Culture
SRPA
SST 12% Culture biologique
Source: OFAG OQE 6%
35%
7%
Compensation écologique
Par la compensation écologique,on entend préserver et,si possible,élargir l’espace vital de la faune et de la flore suisses dans les régions agricoles.Celle-ci contribue également au maintien des structures et des éléments paysagers typiques.Certains éléments de la compensation écologique sont rétribués par des contributions et peuvent simultanément être imputés à la compensation écologique obligatoire des PER,alors que d’autres sont imputables à cette dernière mais ne donnent pas droit aux contributions.
Eléments de la compensation écologique,donnant droit ou non à des contributions
Eléments imputables aux PER Eléments imputables aux PER et donnant droit aux contributions sans donner droit aux contributions prairies extensivespâturages extensifs prairies peu intensivespâturages boisés surfaces à litièrearbres isolés indigènes adaptés au site et allées d'arbres haies,bosquets champêtres et fossés humides,mares,étangs berges boisées jachères floralessurfaces rudérales,tas d’épierrage et affleurements rocheux jachères tournantesmurs de pierres sèches bandes culturales extensiveschemins naturels non stabilisés arbres fruitiers haute-tigesurfaces viticoles à haute diversité biologique autres surfaces de compensation écologique faisant partie de la SAU,définies par le service cantonal de protection de la nature
Ces surfaces ne doivent pas être fertilisées et peuvent être utilisées pendant six ans au moins au plus tôt à partir de la mi-juin à la mi-juillet,selon la zone.La fauche tardive a pour but de garantir que les semences arrivent à maturité et que leur dispersion naturelle favorise la diversité des espèces.Elle laisse par ailleurs suffisamment de temps à de nombreux invertébrés,aux oiseaux nichant au sol et aux petits mammifères pour leur reproduction.La part des prairies extensives n’a cessé d’augmenter au cours des dernières années.
Les taux par ha des contributions versées pour les prairies extensives,les surfaces à litière,les haies et les bosquets champêtres sont uniformes et échelonnés selon les zones où se trouve la surface.
Taux de 2004fr./ ha
– Zone de grandes cultures et zones intermédiaires1 500
– Zone des collines1 200
– Zones de montagne I et II700
– Zones de montagne III et IV450
Tableaux 33a–33d,pages A35–A38
2.MESURESDEPOLITIQUEAGRICOLE 2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 169
■ Prairies extensives
■ Surfaces à litière
Contributions versées en 2004 pour les prairies extensives
■ Haies,bosquets champêtres et berges boisées
Par surfaces à litière,on entend les surfaces exploitées de manière extensive,situées dans des lieux humides et marécageux et qui,en règle générale,sont fauchées en automne ou en hiver pour la production de litière.
Contributions versées en 2004 pour les surfaces à litière
Par haies,bosquets champêtres et berges boisées,on entend les haies basses,les haies arbustives et arborées,les brise-vents,les groupes d’arbres,les talus et les berges boisées.Ces surfaces doivent être exploitées de manière adéquate et convenablement entretenues pendant six ans,sans interruption.
Contributions versées en 2004 pour les haies,bosquets champêtres et berges boisées
ParamètreUnitéRégion de Région desRégion de Total plainecollinesmontagne
ParamètreUnitéRégion de Région desRégion de Total plainecollinesmontagne ExploitationsNombre18 9239 6519 91738 491 Surfaceha25 21710 29214 77950 288 Surface par exploitationha1,331,071,491,31 Contribution par exploitationfr.1 9521 0867921 436 Contributions1 000 fr.36 93110 4817 85755 269 Contributions en 20031 000 fr.35 3149 8597 83853 011 Source:OFAG
ParamètreUnitéRégion de Région desRégion
plainecollinesmontagne ExploitationsNombre1 8351 9233 1706 928 Surfaceha1 8761 4943 5806 950 Surface par exploitationha1,020,781,131,00 Contribution par exploitationfr.1 501749711931 Contributions1 000 fr.2 7541 4402 2546 448 Contributions en 20031 000 fr.2 6951 4212 2286 345 Source:OFAG
de Total
ExploitationsNombre5 6332 8791 1679 679 Surfaceha1 3637502922 405 Surface par exploitationha0,240,260,250,25 Contribution
Contributions1 000 fr.2 0167721942 981 Contributions en 20031 000 fr.1 9617321942 887
par exploitationfr.358268166308
Source:OFAG
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 170
■ Prairies peu intensives
Les prairies peu intensives peuvent être légèrement fertilisées avec du fumier ou du compost.
Taux de 2004fr./ ha
– Zone de grandes cultures à zone des collines650
– Zones de montagne I et II450
– Zones de montagne III et IV300
Contributions versées en 2004 pour les prairies peu intensives
■ Jachères florales
Par jachères florales,on entend les bordures pluriannuelles de 3 m de largeur au moins, ensemencées d'herbacées sauvages indigènes et non fertilisées.Ces jachères servent à protéger les herbacées sauvages menacées.Elles offrent également habitat et nourriture aux insectes et autres petits animaux.De surcroît,elles servent de refuge aux lièvres et aux oiseaux.Les jachères florales donnent droit à une contribution de 3'000 fr./ha pour les surfaces dans la zone de grandes cultures,y compris la zone des collines.

ParamètreUnitéRégion de Région desRégion de Total plainecollinesmontagne ExploitationsNombre7 9968 06510 05126 112 Surfaceha7 0497 29319 31633 659 Surface par exploitationha0,880,901,921,29 Contribution par exploitationfr.565499653579 Contributions1 000 fr.4 5224 0256 56015 107 Contributions en 20031 000 fr.4 8624 2586 79415 913 Source:OFAG
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 171
Contributions versées en 2004 pour les jachères florales ParamètreUnitéRégion de Région desRégion de Total plainecollinesmontagne1
Dans le contexte de la libéralisation du marché des céréales,les jachères florales sont devenues une solution de substitution intéressante aux cultures des champs.
Par jachères tournantes,on entend des surfaces non fertilisées qui sont ensemencées d'herbacées sauvages indigènes,accompagnatrices de cultures,pendant un ou deux ans;elles doivent présenter une largeur de 6 m au moins et couvrir au minimum 20 ares.Ces jachères offrent un habitat aux oiseaux couvant au sol,aux lièvres et aux insectes.L’enherbement naturel est également possible à des endroits propices.Dans la zone des grandes cultures et la zone des collines,les jachères tournantes donnent droit à une contribution de 2'500 fr./ha.
Contributions versées en 2004 pour les jachères tournantes
ParamètreUnitéRégion de Région desRégion de Total plainecollines1 montagne1
Source:OFAG
ExploitationsNombre2 17741152 593 Surfaceha2 08234622 429 Surface par exploitationha0,960,840,340,94 Contribution par exploitationfr.2 8682 5241 0322 810 Contributions1 000 fr.6 2441 03757 286 Contributions en 20031 000 fr.6 2091 05457 268 1Il s’agit d’entreprises exploitant des surfaces dans la zone des collines ou la région de plaine Source:OFAG
ExploitationsNombre6671303800 Surfaceha90416321 069 Surface par exploitationha1,361,250,731,34 Contribution par exploitationfr.3 3903 1311 8253 342 Contributions1 000 fr.2 26140752 673 Contributions en 20031 000 fr.2 79947063 276
1Il s’agit d’entreprises situées dans la région des collines et de montagne,mais exploitant une partie de leurs surfaces dans la région de plaine
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 172
■ Jachères tournantes
Répartition des surfaces de compensation écologique1 en 2004
Total 96 836 ha Bandes

2,5%
Répartition des SCE selon les régions en 2004 Région
Source:OFAG
Région
ha% deha% deha% de Elémentsla SAUla SAUla SAU Jachères florales2 0820,423460,1320,00 Jachères tournantes9040,181630,0620,00 Prairies peu intensives7 0491,417 2932,7119 3166,61 Bosquets champêtres et berges boisées1 3630,277500,282920,10 Bandes culturales extensives300,0150,0000,00 Prairies extensives25 2175,0310 2923,8314 7795,05 Surfaces à litière1 8760,371 4940,563 5801,22 Total38 5227,6920 3427,5737 97112,98
de
des Région de plainecollinesmontagne
extensives 51,9%
à litière 7,2%
tournantes
peu intensives
Prairies
Surfaces
Jachères
1,1% Prairies
34,8%
et rives boisées
Bosquets champêtres
1
Source: OFAG
sans les arbres fruitiers haute-tige
culturales extensives
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 174
0,0% Jachères florales 2,5%
Ordonnance sur la qualité écologique
Afin de conserver et de promouvoir la richesse naturelle des espèces,la Confédération alloue des aides financières pour les surfaces de compensation écologique d’une qualité biologique particulière aménagées sur la SAU et pour leur mise en réseau.Il appartient aux cantons de fixer les exigences que doivent remplir les surfaces pour donner droit à des contributions selon l’ordonnance sur la qualité écologique (OQE),et à la Confédération de vérifier les prescriptions cantonales sur la base de critères minimaux.Dans la mesure où les exigences cantonales sont conformes aux exigences minimales de la Confédération et où le cofinancement régional est assuré,celle-ci accorde aux cantons des aides financières pour les contributions qu’ils versent aux agriculteurs.En fonction de la capacité financière des cantons,le montant de ces aides se situe entre 70 et 90% des contributions imputables,les 10 à 30% restants devant être pris en charge par des tiers (cantons,communes,particuliers,organismes).Les contributions à la qualité biologique peuvent être cumulées avec celles versées pour la mise en réseau.L’OQE se fonde sur le caractère facultatif de la compensation écologique,sur des incitations financières et sur la prise en considération des différences régionales eu égard à la biodiversité.
Taux imputables
Taux de 2004fr.
– Pour la qualité biologique500.–/ha
– Pour la qualité biologique des arbres fruitiers haute-tige20.–/arbre
– Pour la mise en réseau500.–/ha
Une surface de compensation écologique contribue particulièrement au maintien et à la promotion de la biodiversité lorsqu'elle présente des bioindicateurs ou des éléments de structure déterminés ou encore lorsque son emplacement est judicieux du point de vue écologique.L'exploitant peut annoncer directement sa surface de compensation écologique au titre de la qualité biologique;par contre,la mise en réseau de ces surfaces exige une stratégie portant sur un ensemble qui justifie cette mesure sur les plans paysager et écologique.
Contributions versées en 2004 en vertu de l'ordonnance sur la qualité écologique
ParamètreUnitéRégion de Région desRégion de Total plainecollinesmontagne
ExploitationsNombre7 9636 5518 57323 087
Surface 1 ha10 8089 92521 96742 700
Surface 1 par exploitationha1,361,522,561,85
Contribution par exploitationfr.9181 0371 038997
Contributions1 000 fr.7 3096 7968 90223 007
Contributions en 20031 000 fr.4 4414 4485 74914 638
1Conversion des arbres haute-tige:1 arbre = 1 areSource:OFAG
2.MESURESDEPOLITIQUEAGRICOLE 2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 175
■ Bandes culturales extensives
Les bandes culturales extensives offrent un espace de survie aux herbacées accompagnant traditionnellement les cultures.On entend par là des bandes de cultures des champs (céréales,colza,tournesols,pois protéagineux,féveroles et soja,sans le maïs), d’une largeur de 3 à 12 m et exploitées de manière extensive.En 2004,un montant de 1'500 francs a été versé par ha.Les contributions ne sont allouées que pour les surfaces situées en plaine et dans la zone des collines.
Contributions versées en 2004 pour les bandes culturales extensives
ParamètreUnitéRégion de Région desRégion de Total plainecollinesmontagne1
ExploitationsNombre98180116
Surfaceha305035
Surface par exploitationha0,310,290,000,30
Contribution par exploitationfr.4604380457
Contributions1 000 fr.458053
Contributions en 20031 000 fr.389046
1Il s’agit d’entreprises exploitant des surfaces situées en plaine ou dans la région des collines
■ Arbres fruitiers haute-tige
La Confédération verse des contributions pour les arbres haute-tige de fruits à noyau ou à pépins ne faisant pas partie d’une culture fruitière,ainsi que pour les châtaigneraies et les noiseraies entretenues.En 2004,un montant de 15 francs a été alloué par arbre annoncé.
Contributions versées en 2004 pour les arbres fruitiers haute-tige
ParamètreUnitéRégion de Région desRégion de Total plainecollinesmontagne
Source:OFAG
Source:OFAG
ExploitationsNombre17 02112 6885 52135 230 ArbresNombre1 202 865912 444274 7892 390 098 Arbres par exploitationNombre70,6771,9149,7767,84 Contribution par exploitationfr.1 0601 0797471 018 Contributions1 000 fr.18 04013 6864 12235 848 Contributions en 20031 000 fr.18 25113 8324 09936 182
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 2.MESURESDEPOLITIQUEAGRICOLE 173
Contributions versées en 2004 pour la qualité biologique et la mise en réseau
ParamètreUnitéQualité
en réseau 1 Prairies extensives,prairies
ExploitationsNombre10 9687 2944 434 Surfaceha16 6637 4818 663 Contributions1 000 fr.5 7702 7645 479 Haies,bosquets champêtres et berges boisées ExploitationsNombre5521 462708 Surfaceha117318184 Contributions1 000 fr.47134150 Arbres fruitiers haute-tige ExploitationsNombre3 9115 5892 160 ArbresPièce232 471206 345118 308 Contributions1 000 fr.3 7838632 372 Autres éléments ExploitationsNombre-3
Surfaceha-3
Contributions1 000 fr.-1
1 les deux programmes combinés Source:OFAG Surfaces de compensation écologique de qualité (arbres haute-tige y compris) 0 1–5 6–10 11–20 >20 Estivage en % de la SAU
Valeurs par commune 2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 176 Tableau
Mise en Qualité biologique réseaubiologique et mise
peu intensives et surfaces à litière
668-
483-
648-
Source: OFAG GG25 ©swisstopo
34,page A39
Surfaces de compensation écologique en réseau (arbres haute-tige y compris)
Culture extensive de céréales et de colza
Cette mesure a pour objectif d’inciter les cultivateurs à renoncer,dans la culture de céréales et de colza,aux régulateurs de croissance,aux fongicides,aux stimulateurs chimiques de synthèse des défenses naturelles et aux insecticides.En 2004,un montant de 400 francs a été versé par ha.
Culture extensive de céréales et de colza en 2004
Répartition
de
la surface de cultures extensives 2004
Source: OFAG
ExploitationsNombre10 3856 11176717 263 Surfaceha54 10221 4001 85977 361 Surface par exploitationha5,213,502,424,48 Contribution par exploitationfr.2 0741 3999691 786 Contributions1 000 fr.21 5348 54774330 824 Contributions en 20031 000 fr.21 5208 89584131 255
ParamètreUnitéRégion de Région desRégion de Total plainecollinesmontagne
Source:OFAG
0 1–5 6–10 11–20 >20 Estivage en % de la SAU
Valeurs par commune
Source: OFAG GG25 ©Swisstopo
Céréales panifiables 53% Colza 7% Céréales fourragères 40%
Total
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 2.MESURESDEPOLITIQUEAGRICOLE 177
77 361 ha Tableau 35,page A40
Culture biologique
En complément des recettes supplémentaires que l’agriculture biologique peut réaliser sur le marché,la Confédération encourage celle-ci comme mode de production particulièrement respectueux de l’environnement.Du reste,les exploitants doivent appliquer les règles de l’ordonnance sur l’agriculture biologique s’ils veulent obtenir des contributions.
L'agriculture biologique renonce complètement à l’emploi de matières auxiliaires chimiques de synthèse comme les engrais de commerce ou les pesticides,ce qui permet d'économiser l'énergie et de préserver l'eau,l'air et le sol.La prise en considération des cycles et procédés naturels est donc d’une importance cruciale pour l’agriculteur bio.S’il utilise davantage d'énergie pour l'infrastructure et pour les machines,il exploite cependant les ressources existantes de manière plus efficace.Cette efficacité constitue un indicateur important de la durabilité du système de production.
En renonçant aux herbicides,l’agriculture biologique favorise le développement de nombreuses espèces messicoles.Les surfaces dont la flore est diversifiée offrent de la nourriture à un plus grand nombre de petits organismes qui constituent,à leur tour, une proie pour les prédateurs arthropodes tels les carabidés,et créent ainsi de bonnes conditions pour la lutte naturelle contre les organismes nuisibles.Grâce à la présence de plantes,d’animaux et de micro-organismes en plus grand nombre,l'écosystème est en mesure de mieux résister aux perturbations et au stress.
L'agriculteur bio épand de la fumure organique,travaille le sol avec ménagement, renonce aux produits phytosanitaires et favorise par là le développement et la variété des organismes du sol.L'activité biologique augmente la fertilité du sol:elle contribue en effet à enrichir la couche d'humus,à améliorer la structure du sol et à réduire l'érosion.
Pour faire co-exister de manière harmonieuse les plantes,le sol,les animaux et l'homme,l'agriculteur bio veille à ce que les circuits d'éléments nutritifs fonctionnent en boucle fermée dans son exploitation,en faisant coïncider la base fourragère de son entreprise agricole avec le nombre d'animaux qu'il détient.Autre aspect important:la culture de légumineuses améliore l’offre en azote dans le sol.Par ailleurs,les engrais de ferme et le matériel organique provenant des engrais verts et des résidus de récolte garantissent aux plantes un apport équilibré en éléments nutritifs par le biais des organismes du sol.
Quant à l'élevage des animaux de rente,celui-ci doit satisfaire aux exigences du programme SRPA qui,en agriculture biologique,sont considérées comme un minimum à observer.Ce programme interdit en outre le recours aux appareils à décharges électriques (dresse-vaches) et l'administration d'aliments médicamenteux aux animaux. En utilisant essentiellement les fourrages produits dans l’exploitation,l’agriculteur bio obtient un rendement raisonnable et garde des animaux en bonne santé.Autre particularité:il applique en premier lieu des méthodes thérapeutiques naturelles en cas de besoin.
En 2004,10,3% de la SAU totale ont été cultivés selon les règles de l’agriculture biologique.
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 178
Taux de 2004fr./ ha – cultures spéciales1 200 – terres ouvertes,cultures spéciales exceptées800 – surfaces herbagères et surfaces à litière200
Contributions versées en 2004 pour l’agriculture biologique ParamètreUnitéRégion de Région desRégion de Total plainecollinesmontagne ExploitationsNombre1 1941 4283 6966 318 Surfaceha21 44623 41668 434113 295

Part de la surface exploitée selon les règles de la culture biologique, par région en 2004 Région de plaine 19% Région de montagne 60%
Total 113 295 ha Région des collines 21% PAIEMENTS
2 179
DIRECTS
Contributions1
Contributions
Surface par exploitationha17,9616,4018,5217,93 Contribution par exploitationfr.7 1423 9803 7214 426
000 fr.8 5275 68313 75227 962
en 20031 000 fr.8 1615 58113 39327 135 Source:OFAG
Tableau 32a,page A33
Source: OFAG 2.2
■ Systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux (SST)
Garde d’animaux de rente particulièrement respectueuse de l’espèce
Les deux programmes SST et SRPA décrits ci-dessous (cf.aussi paragraphe 1.3.2) sont regroupés sous ce titre.
La Confédération encourage les agriculteurs à garder les animaux dans des systèmes de stabulation qui répondent à des exigences dépassant largement le niveau requis dans la législation relative à la protection des animaux.
Taux de 2004fr./UGB
– bovins,veaux exceptés,chèvres,lapins90 – porcs155 – poules pondeuses,poulettes et jeunes coqs,poules et coqs d'élevage,poussins280 – poulets de chair et dindes180
Contributions versées en 2004 pour les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux
■ Sorties régulières en plein air (SRPA)
La Confédération encourage les sorties régulières des animaux de rente en plein air, c’est-à-dire sur un pâturage,dans une aire d'exercice ou à climat extérieur,répondant aux besoins des animaux.
Taux de
– bovins et équidés,bisons,moutons,chèvres,daims et cerfs rouges,lapins180 – porcs155 – volaille280
ParamètreUnitéRégion de Région desRégion de Total plainecollinesmontagne ExploitationsNombre9 1446 1414 29219 577 UGBNombre235 202119 17459 807414 183 UGB par exploitationNombre25,7219,4113,9321,16 Contribution par exploitationfr.2 9212 2211 4382 376 Contributions1 000 fr.26 71013 6366 17146 517 Contributions en 20031 000 fr.24 91312 6165 72943 257 Source:OFAG
2004fr./UGB
Tableau 36,page A41
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 180

air ParamètreUnitéRégion de Région desRégion de Total plainecollinesmontagne ExploitationsNombre13 80711 06512 57437 446 UGBNombre349 459246 616221 649817 724 UGB par exploitationNombre25,3122,2917,6321,84 Contribution par exploitationfr.4 4063 9433 1553 849 Contributions1 000 fr.60 83743 62539 672144 134 Contributions en 20031 000 fr.59 17542 33738 595140 106 Source:OFAG
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 181
Contributions versées en 2004 pour les sorties régulières en plein
Tableau 36,page A41
■ Exploitation durable des régions d’estivage
Contributions d'estivage
Les contributions d’estivage ont pour objectif d’assurer l’exploitation et l’entretien de nos vastes pâturages d'estivage dans les Alpes,les Préalpes et le Jura.La région d'estivage est utilisée et entretenue par quelque 300'000 UGB.La charge en bétail est fixée selon les principes d’une exploitation durable;c’est ladite charge usuelle.Les contributions sont versées par pâquier normal (PN) calculé à partir de la charge usuelle.Un PN correspond à l’estivage d’une UGB pendant 100 jours.
Taux de 2004fr. –vaches traites,chèvres et brebis laitières,par UGB (56 à 100 jours d’estivage)300 –moutons,brebis laitières exceptées,par PN –surveillance permanente par le berger300 –pâturages tournants220 –autres pâturages120 –autres animaux consommant des fourrages grossiers,par PN300
Contributions d’estivage versées en 2004
Des contributions d’estivage,dont le montant varie en fonction du système de pacage, sont versées pour les moutons (brebis laitières exceptées) depuis l’année de contributions 2003.L’octroi de contributions plus élevées permet,d’une part,de rétribuer les frais plus élevés qu’occasionnent la présence de bergers et les pâturages tournants et, d’autre part,par analogie avec les contributions écologiques,d’inciter les agriculteurs à pratiquer l’estivage durable des moutons.La garde permanente des moutons signifie que le troupeau est mené par un berger accompagné de chiens,et conduit quotidiennement à un pâturage choisi par le berger.Dans le cas de pâturages tournants,le pacage se fait pendant toute la durée de l’estivage dans des enclos entourés d’une clôture ou clairement délimités par des conditions naturelles.
ParamètreContributionsExploitationsUGB ou PN 1 000 fr.NombreNombre Vaches traites,brebis laitières, chèvres laitières16 2822 19854 257 Moutons,brebis laitières exceptées4 7031 00524 540 Autres animaux consommant des fourrages grossiers70 0816 761233 807 Total91 0667 449 1 Total 200391 3817 493 1 1Il s’agit ici du total des exploitations d’estivage ayant droit aux contributions (sans doubles comptages) Source:OFAG
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 182
Tableaux 39a–39b,pages A44–A45
Estivage de moutons en fonction des systèmes de pacage en 2004

Système de pacageExploitationsAnimaux don- Contributions nant droit aux contributions
Evolution de l’estivage entre 2000 et 2004:exploitations et animaux estivés en pâquiers normaux,selon les catégories d’animaux
NombrePNfr. Présence d’un berger en permanence746 3621 897 729 Pâturages tournants1885 4501 203 622 Autres pâturages71811 4111 365 584 Combinaison de systèmes de pacage251 317236 228 Total 1 00524 5404 703 163 Source:OFAG
Année20002001200220032004 Catégorie d’animauxUnité Vaches laitièresExploitations4 9614 7124 6004 4904 353 PN118 793118 021116 900116 679111 123 Vaches mères et Exploitations1 2801 1601 2271 3541 434 nourrices PN13 85414 48615 71517 94918 904 Autres bovinsExploitations6 6846 4536 5036 4256 358 PN134 457129 217127 946126 910121 169 EquidésExploitations1 1321 0861 0751 0841 063 PN4 6524 3154 3644 3404 347 MoutonsExploitations1 1731 1451 1041 1501 111 PN29 67826 17224 71026 63325 813 ChèvresExploitations1 7001 6231 6671 6691 657 PN5 1655 2145 4345 6625 664 Autres animaux estivésExploitations22289277241240 PN60899764735541 Un PN = 1 UGB * durée d’estivage / 100 Source:OFAG 2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 183 2.MESURESDEPOLITIQUEAGRICOLE
■ Eviter le lessivage et le ruissellement de substances
Contributions pour la protection des eaux
L’art.62a de la loi sur la protection des eaux habilite la Confédération à indemniser les agriculteurs pour les mesures qu’ils prennent afin d’éviter le lessivage de substances dans les eaux souterrains et le ruissellement dans les eaux superficielles.Il s’agit en priorité de réduire la charge en nitrates de l’eau potable et la charge en phosphore des eaux superficielles dans les régions où les PER,l’agriculture biologique,les interdictions et les prescriptions contraignantes ou les programmes volontaires encouragés par la Confédération (production extensive,compensation écologique) ne suffisent pas. De son côté,le canton de Vaud a également élaboré un projet pilote visant à réduire les charges en pesticides.
Par ailleurs,l’ordonnance sur la protection des eaux oblige les cantons à délimiter une aire d’alimentation pour les captages d’eaux souterraines et de surface,et à déterminer les mesures nécessaires à un assainissement,si la qualité des eaux est insuffisante.Ces différentes mesures peuvent,par rapport à l’état de la technique,entraîner des restrictions considérables dans l’utilisation du sol et causer des pertes financières que les exploitations agricoles ne peuvent supporter.Les contributions fédérales aux coûts sont fixées à 80% pour les adaptations structurelles et à 50% pour les mesures d’exploitation.En 2004,elles se sont élevées à quelque 5,5 millions de francs.
Aperçu des projets 2004
Région visée Coûts totaux Contributions communeprobable par le projetprévusversées
CantonRégion,Durée
du projeten 2004 Annéehafr.fr. LULac de Sempach1999–2004 1 4 9058 811 1661 500 000 LULac de Baldegg2000–2005 1 5 6009 559 6941 670 000 LU/AGLac de Hallwil2001–2006 1 3 7865 029 9061 074 609 AGWohlenschwil2001–200962547 69652 747 AGBirrfeld2002–20078131 909 500122 259 AGBaldingen2004–200969281 40016 907 VDThierrens1999–200817121 23617 614 VDMorand2000–2008391760 18387 186 VDBavois prov.2003–200454 316 ZHBaltenswil2000–2008130428 35329 308 BEWalliswil2000–2005 54381 10847 233 SHKlettgau2001–20063571 136 221166 733 FRAvry-sur-Matran2000–2005 37158 23227 463 FRMiddes2000–200645159 99623 819 FRCourgevaux2003–2008 27164 83820 880 FRFétigny2004–2009631 526 000349 278 FRDomdidier2004–200930195 58825 564 SOGäu2000–20051 5082 487 090284 585 Total 5 520 501 Total 20034 023 637 1 Prolongation nécessaire Source:OFAG
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 184
2.3Amélioration des bases de production
Les mesures prises à ce titre encouragent et soutiennent les agriculteurs afin de permettre une production de denrées alimentaires efficiente et respectueuse de l’environnement,ainsi que l’accomplissement de leurs multiples tâches.
Amélioration des bases de production:aides financières
MesureComptes Comptes Budget 200320042005 en mio.de fr.
Contributions pour améliorations structurelles102 1 9591
Crédits d'investissements797670
Aide aux exploitations paysannes12915
Aides à la reconversion professionnelle--3
Vulgarisation et contributions à la recherche242424
Lutte contre les maladies et parasites des plantes423
Sélection végétale et élevage222223
Total242228229
1 y compris crédit supplémentaire intempéries (7 millions de fr.)
Source:OFAG
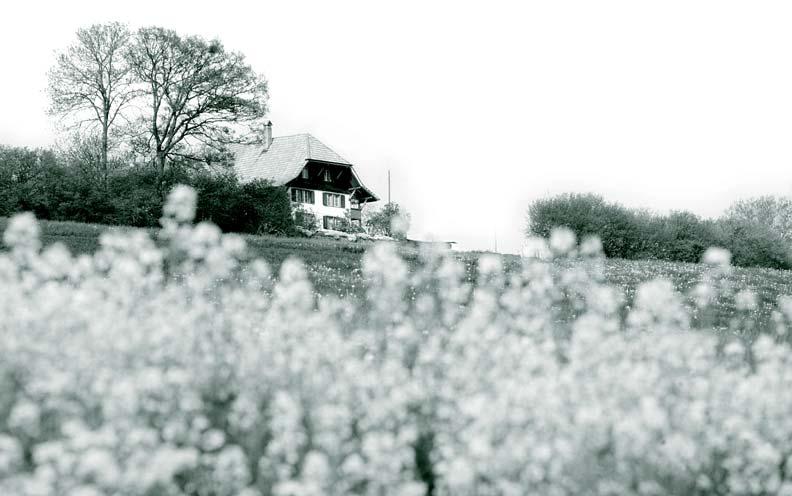
Ces mesures visent à atteindre les objectifs suivants: –amélioration de la compétitivité par l’abaissement des coûts de production; –promotion de l’espace rural; –structures d’exploitation modernes et surfaces agricoles utiles bien desservies; –production efficiente et respectueuse de l’environnement;
–variétés à rendement élevé,aussi résistantes que possible,et produits de haute qualité;
–protection de la santé humaine et animale,ainsi que de l’environnement; –diversité génétique.
■■■■■■■■■■■■■■■■
185 2.3 AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2
2.3.1 Améliorations structurelles et mesures d’accompagnement social
Améliorations structurelles
Les améliorations structurelles contribuent à améliorer les conditions de vie et les conditions économiques du monde rural,notamment en montagne et dans les régions périphériques.
Les aides à l’investissement sont accordées pour des mesures aussi bien individuelles que collectives.Deux instruments sont ainsi à disposition: –les contributions (à fonds perdu) exigeant la participation des cantons,surtout pour des mesures collectives; –les crédits d’investissements octroyés sous la forme de prêts sans intérêts,surtout pour des mesures individuelles.
Les aides à l’investissement servent à financer les infrastructures agricoles et permettent d’adapter les exploitations à l’évolution des conditions-cadre.Elles visent également à abaisser les coûts de production,à promouvoir l’écologisation et,partant,à renforcer la compétitivité d’une agriculture tournée vers la production durable.Dans d’autres pays aussi,notamment au sein l’UE,ces aides figurent au nombre des principales mesures de promotion du milieu rural.
Les expériences faites avec les dispositions légales de la PA 2002 et avec les adaptations apportées par la PA 2007 sont largement positives dans le domaine des améliorations structurelles.En ce qui concerne les mesures individuelles,le changement de critère pour l’entrée en matière,qui est passé de la composition du revenu (rapport entre le revenu agricole et l’activité accessoire) au besoin minimal en main-d’œuvre standard,ainsi que l’introduction d’un soutien au titre de la diversification des activités dans le secteur agricole et les branches connexes,ont induit une plus grande flexibilité. Les nouvelles aides accordées pour la remise en état périodique d’améliorations foncières,pour des bâtiments communautaires servant à la commercialisation de produits issus de la région et pour l’octroi de prêts de démarrage lors de la création d’organisations d’entraide paysanne ont en outre facilité le développement des exploitations agricoles en leur ouvrant de nouvelles perspectives.
Depuis 2004,la LAgr permet d’accorder un soutien aux projets destinés à encourager le développement régional ou la promotion de produits indigènes et régionaux, auxquels l’agriculture participe à titre prépondérant.En créant cette nouvelle mesure, le législateur a voulu renforcer l’orientation régionale de la politique agricole et permettre à l’agriculture de contribuer davantage au développement du milieu rural. En vue de l’élaboration des dispositions d’exécution,l’office a,d’une part,mandaté deux travaux de recherche qui ont été menés à bonne fin et,d’autre part,lancé deux projets pilotes au Tessin (Brontallo) et en Valais (St-Martin) (cf.commentaires,pages 191 à 194).
186 2.3AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2 ■■■■■■■■■■■■■■■■
■ Premiers enseignements tirés de la PA 2007
■ Moyens financiers destinés aux contributions
En 2004,le montant disponible pour les contributions au titre des améliorations foncières et des constructions rurales s’est élevé à 98,5 millions de francs.L’OFAG a approuvé de nouveaux projets qui ont déclenché un volume global d’investissements de 373 millions de francs et pour lesquels des contributions fédérales de 83,5 millions de francs au total ont été versées.Cette somme ne correspond toutefois pas à celle budgétisée dans la rubrique «améliorations foncières et constructions rurales»,car il est rare qu’une contribution allouée soit versée la même année;les crédits sont par ailleurs souvent accordés par tranche.
Contributions de la Confédération approuvées en 2004
Remaniements parcellaires (y compris infrastructures)
Construction de chemins
Adductions d'eau
Intempéries et autres mesures de génie civil
Bâtiments d'exploitation pour animaux cons. des fourr. grossiers
Autres
Constructions rurales
Les moyens financiers engagés par la Confédération sous la forme de contributions ont baissé de 7% en 2004 par rapport à l’année précédente.Cette diminution s’explique en grande partie par les dépenses qui avaient été nécessaires pour réparer les dommages après les intempéries de 2002.A cette fin,le Parlement avait accordé en 2003 une rallonge de crédit de 7 millions de francs.Néanmoins,le montant des contributions versées en 2004 pour des projets en cours ou achevés s’est élevé à 95 millions de francs.
187 2.3 AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2.MESURESDEPOLITIQUEAGRICOLE 2
mio. de fr. Région de plaine Région des collines Région de montagne 20,4 13,2 9,8 051015202530 12,3 26,2 1,6 Source: OFAG 64% 14% 22%
Tableaux 43–44,pages A52–A53
En 2004,les cantons ont accordé 2'159 crédits d’investissements portant sur un montant total de 301,2 millions de francs,dont 86,2% étaient consacrés à des mesures individuelles et 8,8% à des mesures collectives.Dans la région de montagne, des crédits de transition d’une durée maximale de trois ans,appelés «crédits de construction»,peuvent en outre être consentis pour des projets communautaires.
Crédits d’investissements en 2004
Source:OFAG
Les crédits destinés aux mesures individuelles ont principalement été alloués au titre de l’aide initiale ainsi que pour la construction ou la transformation de maisons d’habitation et de bâtiments d’exploitation.Ils sont remboursés dans un délai de 14 ans en moyenne.Le volume des crédits dédiés à la nouvelle mesure en faveur de la diversification des activités et répartis entre 20 exploitations s’est élevé à 2,1 millions de francs.
Quant aux crédits alloués pour des mesures collectives,ils ont permis notamment de soutenir la réalisation d’améliorations foncières et de mesures de construction (bâtiments et équipements destinés à l’économie laitière ainsi qu’à la transformation et au stockage de produits agricoles).
Le fonds de roulement alimenté depuis 1963 a franchi la barre des 2 milliards de francs.En 2004,la Confédération a mis 76,5 millions de francs à la disposition des cantons.Avec les remboursements courants,cette somme est utilisée pour l’octroi de nouveaux crédits.
2.3AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2 Contributions fédérales allouées pour des améliorations foncières et des constructions rurales 1994–2004 1995 1994199619971998199920002001200220032004 mio. de fr. Source: OFAG 0 20 40 60 80 100 120 85 10685827575871029010295
DispositionCasMontantPart Nombremio.de fr.% Mesures individuelles1 978259,786,2 Mesures collectives,sans crédits de construction14326,38,8
de construction3815,25,0
159301,2100
Crédits
Total2
188
■ Moyens financiers destinés aux crédits d’investissements
Crédits d'investissements 2004 par catégories de mesures, sans les crédits de construction
1 Achat de cheptel en commun, prêt de démarrage pour organisations d'entraide paysanne, transformation et stockage de produits agricoles

189 2.3 AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2
Aide initiale Achat de l'exploitation
le fermier Mesures collectives 1 Diversification Maisons d'habitation Bâtiments d'exploitation mio. de fr. Région de plaine Région des collines Région de montagne 80,5 0 20 40 60 80 100 120 140 3,8 Améliorations foncières 3,3 23,0 2,1 53,8 119,4
par
Source: OFAG
24,3% 49,4% 26,3%
■ Aide aux exploitations
Mesures d'accompagnement social
Allouée sous forme de prêts sans intérêts,l’aide aux exploitations sert à parer ou à remédier à des difficultés financières passagères dont la faute ne peut être imputée aux agriculteurs sollicitant cette aide.De par ses effets,elle correspond à une mesure de désendettement individuelle.
Ainsi,en 2004,des prêts ont été accordés dans 371 cas au titre de l’aide aux exploitations,pour un montant total de 31,2 millions de francs.S’élevant en moyenne à 84'030 francs,ils seront remboursés dans un délai de 10 ans.
Dans 162 cas représentant un total de 4'237'000 francs,des prêts sans intérêts ont été octroyés en vertu de l’ordonnance du 5 novembre 2003 instituant des mesures dans l'agriculture par suite de la sécheresse en 2003 (ordonnance sur la sécheresse).La date butoir de ces mesures était le 31 décembre 2004.
Prêts au titre de l’aide aux exploitations 2004
Conversion de dettes existantes15221,9 Difficultés financières extraordinaires à surmonter575,1
Prêts sécheresse au titre de l’aide aux exploitations1624,2
Total37131,2
Source:OFAG
Alimenté depuis 1963 par des deniers fédéraux et des remboursements,le fonds de roulement s’élève à quelque 202,2 millions de francs,y compris les parts des cantons.Les nouvelles ressources mises à la disposition de ces derniers ont atteint 8,814 millions de francs en 2004.Elles présupposent une prestation équitable des cantons laquelle varie,selon leur capacité financière,entre 20 et 80% de l’aide fédérale.Ajoutés aux remboursements courants,les montants accordés par les pouvoirs publics sont utilisés pour l’octroi de nouveaux prêts.
■ Aides à la reconversion professionnelle
L’aide à la reconversion professionnelle est une nouvelle mesure d’accompagnement social qui,depuis 2004,facilite aux personnes travaillant de manière autonome dans l’agriculture une reconversion dans une activité non agricole.Elle comprend des contributions aux frais de la reconversion professionnelle et des contributions aux coûts de la vie,et s’adresse aux chefs d’exploitation n’ayant pas encore 52 ans révolus.L’octroi d’une telle aide requiert bien entendu la cessation de l’activité agricole.Selon la formation,la durée de la reconversion professionnelle varie de un à trois ans.Durant l’exercice considéré,quatre personnes ont bénéficié de cette aide dont le montant total s’est chiffré à 401'400 francs;dans chaque cas,l’exploitation pourra être affermée à long terme.La première tranche des contributions allouées en 2004 a été versée en 2005.
190 2.3AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2
DispositionCasMontant Nombremio.de fr.
■ Nouvelles dispositions légales liées à la PA 2007
Projets en faveur du développement régional et de la promotion des produits indigènes
Au cours des délibérations sur la Politique agricole 2007,le Parlement a voté une nouvelle base légale (art.93,al.1,let.c,LAgr) qui permet dorénavant «le soutien de projets en faveur du développement régional et de la promotion des produits indigènes et régionaux».Ce faisant,le législateur a voulu renforcer l’orientation régionale de la politique agricole et la contribution de l’agriculture au développement du milieu rural. Il a toutefois prévu une restriction:il doit s’agir de projets «auxquels l’agriculture participe à titre prépondérant».Ce soutien implique un co-financement par la Confédération et les cantons car,selon la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches (NPT),le titre 5 de la loi sur l’agriculture (Amélioration des structures) reste une tâche commune.
Intégrée dans ce titre,la nouvelle disposition légale a pourtant des points communs avec les instruments de promotion existants,à savoir la promotion des ventes (art.12 LAgr),les mesures écologiques à caractère régional et la politique régionale.Afin d’élucider les questions en suspens concernant la coordination de ces instruments de promotion,différentes activités ont été mises sur pied en vue de la mise en œuvre par voie d’ordonnance.
Conjointement avec le Secrétariat à l’économie (seco),compétent en matière de politique régionale,et avec le Service de l’agriculture,des améliorations structurelles et des mensurations du canton des Grisons,l’OFAG a mandaté deux études («Analyse des régions» et «Analyse des besoins».Les travaux de recherche ont été achevés fin 2004 et peuvent être consultés (en allemand) sur la page d’accueil de l’OFAG (Rubrik News > Studien und Evaluationen,www.blw.admin.ch/news/publikationen).

■ Analyse des régions
En collaboration avec l’Institut d’économie rurale (IER) de l’EPF Zurich,le bureau d’études BHP Hanser und Partner a examiné dans le cadre de cette analyse les liens interprofessionnels et les potentiels de développement des régions périphériques en prenant l’exemple du Val Blenio dans le canton du Tessin.A partir des résultats obtenus,les auteurs de l’étude ont déduit sept critères de réussite pour la mise en œuvre de l’art.93,al.1,let.c,LAgr:
2.MESURESDEPOLITIQUEAGRICOLE 191 2.3 AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2
■ Analyse des besoins
Marché: les projets doivent s’autofinancer à moyen et à long terme;les chances offertes par le marché doivent être au cœur du projet.
Financement de départ: pas de financement permanent par les pouvoirs publics;les fonds sont réservés au décollage initial.
Structures interprofessionnelles: la mise à profit des synergies est impérative.
Diversification: l’offre (de produits et de services) doit être coordonnée au niveau interrégional.
Savoir-faire: la difficulté réside bien souvent non pas dans le manque d’idées, mais dans la concrétisation d’un projet.
Réalisation: réussir la réalisation est l’objectif à atteindre.
Promoteurs: les promoteurs du projet doivent être implantés au niveau local.
L’analyse des besoins a porté sur des améliorations intégrales en cours ou achevées en Basse-Engadine et dans le Val Mustair,dans le canton des Grisons,et a eu pour objectif de recenser les besoins de la région.Les études ont été réalisées par un groupe de travail sous l’égide du bureau d’études emac et avec la collaboration du bureau d’ingénieurs Kindschi et de l’IER de l’EFP Zurich.Un groupe de suivi ancré localement a assuré le soutien au niveau régional.
En guise de synthèse,les auteurs de l’analyse des besoins proposent une procédure d’évaluation des objectifs permettant de vérifier dans quelle mesure des objectifs concrets du projet correspondent aux objectifs du développement régional ou peuvent être associés à ces derniers.Cet examen de conformité repose sur l’idée d’une matrice d’objectifs dans laquelle les objectifs du projet sont mis en parallèle avec les objectifs généraux de la région.Les combinaisons d’objectifs sont appréciées en fonction de différents critères (soutien de l’objectif,conflit d’objectifs,champs d’action géographiques et matériels,variables du système influençables).Cette procédure implique que la région a auparavant défini ses objectifs de développement sous forme d’un système d’objectifs.Ce dernier devrait présenter une structure hiérarchisée et thématique des objectifs économiques,sociaux et écologiques,conformément au principe du développement durable.Il en va de même pour la définition des objectifs du projet.

192 2.3AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2
■ Recommandations découlant de ces analyses
L’analyse des régions a mis en lumière que celles-ci manquent d’abord de savoir-faire pour assurer de A à Z l’étude et la préparation d’un projet.L’établissement d’un solide business plan exposant les idées de produits,les chances offertes par le marché,des analyses micro-économiques,des solutions de financement,etc.s’avère en l’occurrence un instrument utile.Les auteurs proposent donc d’encourager le développement d’idées de projet en offrant un encadrement (coaching).Il faut que les acteurs issus des régions périphériques puissent présenter une idée de projet,la faire vérifier et demander à bénéficier de l’encadrement.Le suivi professionnel du développement d’un projet doit permettre aux acteurs de faire avancer les examens préliminaires nécessaires à la réalisation de l’idée de projet.A l’issue de ce suivi limité dans le temps, il appartiendra à un comité technique d’examiner le business plan et de délivrer une attestation de qualité cautionnant la qualité du projet et le business plan et pouvant servir de référence pour d’éventuels bailleurs de fonds.
Les auteurs de l’analyse des besoins émettent,quant à eux,les recommandations suivantes:
–Les applications possibles de l’art.93,al.1,let.c,LAgr doivent se fonder sur des critères de décision et d’évaluation dénués de toute ambiguïté.L’important est de respecter le principe du bas en haut et de comparer les objectifs du projet avec ceux du développement régional.
–Pour ce qui est de la mise en œuvre formelle,il est proposé d’ajouter diverses dispositions dans l’ordonnance sur les améliorations structurelles,lesquelles devront être coordonnées aussi étroitement que possible avec la promotion des ventes.Le schéma organisationnel et décisionnel présenté permettra d’apprécier sur la base de différents critères les demandes de contribution futures déposées en vertu du nouvel article de loi.En outre,il faudra tirer parti des synergies entre les instruments existants des améliorations structurelles (art.93 LAgr) et la promotion des ventes (art.12 LAgr).
–Dans sa forme actuelle,l’instrument que sont les améliorations foncières intégrales s’avère très efficace pour le développement régional.C’est donc un atout qu’il convient d’utiliser et de consolider.Le cahier des charges d’une amélioration foncière intégrale pourrait être complété,par exemple,par une étude de marché (en tant que composante de la planification agricole).
193 2.MESURESDEPOLITIQUEAGRICOLE 2.3 AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2
■ Les projets pilotes de Brontallo TI et de St-Martin VS
Parallèlement à ces travaux de recherche,l’OFAG a lancé des projets pilotes au Tessin (Brontallo,Lavizzara) et en Valais (St-Martin,val d’Hérens) afin d’expérimenter la réalisation de projets concrets.L’objectif clé de ces deux projets pilotes consiste à créer de la valeur ajoutée dans l’agriculture par le développement de l’offre agro-touristique et la commercialisation directe des produits agricoles.Mais il s’agit aussi d’atteindre des objectifs écologiques tels que la revalorisation et l’entretien du paysage rural,les mises en réseau et la promotion de la biodiversité,d’une part,et la conservation des biens culturels du monde rural,d’autre part.Les mesures sont coordonnées au niveau de la conception et réunies dans deux conventions-programmes qui ont été signées en 2004 par la Confédération et les cantons concernés.Il va de soi que le suivi joue un rôle essentiel dans la mise en œuvre.Aussi la Confédération et les cantons procéderont-ils chaque année à des bilans intermédiaires.Une évaluation finale aura lieu au terme du programme qui s’étalera sur quatre ans.
■ Dispositions d’exécution
Les modalités des dispositions d’exécution relatives à l’art.93,al.1,let.c,LAgr se fondent sur les enseignements tirés des travaux de recherche et des projets pilotes. La mise en œuvre se fera dans le cadre du processus de réforme en cours concernant la Politique agricole 2011 et nécessitera un remaniement de l’ordonnance sur les améliorations structurelles.Différentes exigences et conditions devront être fixées en l’occurrence,notamment en ce qui concerne l’initiative locale,la participation majoritairement agricole,le potentiel de valeur ajoutée,la rentabilité après la fin du soutien assuré par les pouvoirs publics,la coordination avec le développement régional et le concept intégral des mesures.
Parallèlement à la mise en œuvre de l’art.93,al.1,let.c,LAgr,la proposition issue de l’analyse des régions sera reprise et concrétisée dans le cadre de la Politique agricole 2011:en vertu des dispositions juridiques régissant la vulgarisation agricole,le développement de projets pourra,dès la phase des examens préliminaires,bénéficier d’un soutien financier en vue d’un encadrement assuré par des professionnels.Cette assistance devra être accessible à toutes les initiatives de projet communautaire caractérisées par la participation des milieux agricoles et un rayonnement régional. Autant d’éléments qui inciteront les acteurs à examiner de bonne heure,avec compétence et de manière approfondie,les possibilités offertes par le marché et les chances de réalisation et à explorer et à regrouper tous les potentiels d’une région dans le cadre de projets intégrés.
194 2.3AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2
■ Conséquences douloureuses
2.3.2 Recherche,haras,vulgarisation, formation professionnelle,CIEA
Recherche agronomique
Le budget 2004 des stations fédérales de recherches agronomiques s’est élevé à quelque 110 millions de francs net.En raison des programmes d’allégement et d'abandon de tâches de la Confédération,Agroscope devra économiser,à partir de 2008,près de 12 millions de francs par rapport à 2004.Il est dès lors contraint de supprimer plus de 100 postes d’ici à 2008,mais tâchera néanmoins d’éviter des licenciements.Les mesures d’économie obligent Agroscope à abandonner un certain nombre de prestations qu’il fournissait jusqu’à présent.
Les stations de recherches réduisent leurs tâches depuis des années.Jusqu’ici,elles ont réussi à réduire leurs coûts par des changements structurels et un accroissement d’efficacité.Or,maintenant,elles ne peuvent pas empêcher la suppression de plus de 100 postes.Les réductions budgétaires contraignent par ailleurs Agroscope à abandonner des tâches et des activités,à les réduire ou à les déléguer à des tiers.Les stations de recherches ne pourront ainsi plus fournir toutes les prestations que leurs clients attendent d’elles.La suppression d’emplois et de prestations leur feront perdre de l’expérience et du savoir.Les jeunes universitaires auront moins de possibilités de se lancer dans la recherche.Malgré ces économies,Agroscope entend faire comme jusqu’à présent de la recherche de premier ordre.
Ce furent déjà des réductions budgétaires qui ont déclenché le processus de fusion,qui vise à réduire de six à trois le nombre des stations de recherches.Dans ce contexte, Agroscope procède à une optimisation de ses activités.Certaines tâches sont concentrées à un endroit,et des postes ne sont parfois pas repourvus.Les fusions contribuent aux économies requises.
■ Pas de sélection OGM
Agroscope renonce désormais à développer des végétaux génétiquement modifiés (OGM),mais il poursuivra sa recherche sur les risques et sur l’impact de la technologie. S’agissant de la sélection dans le domaine des fruits,il limitera dorénavant son activité aux pommes.Il prévoit en outre de fermer la fromagerie expérimentale de Moudon et de concentrer les essais à Liebefeld et Uettligen (BE).
Les prestations diminueront aussi dans le secteur des grandes cultures,notamment en ce qui concerne les essais en plein champ et les analyses de laboratoire relatives à la nutrition des plantes,à la production végétale et à la qualité des végétaux.Agroscope ne procédera plus qu’aux essais et analyses strictement nécessaires.En culture fourragère,certaines analyses botaniques coûteuses ne seront plus effectuées.Agroscope étudiera moins de plantes pour la sélection de plantes fourragères.Il affectera moins de ressources financières aux mesures environnementales dans l’agriculture,ce qui se répercutera,par exemple,sur les analyses de sols arables et sur l’étude du comportement de produits phytosanitaires dans l’environnement.
195 2.MESURESDEPOLITIQUEAGRICOLE 2.3 AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2 ■■■■■■■■■■■■■■■■
■ Profiter collectivement
La technique agricole n’est pas non plus épargnée:les travaux concernant la pollution du sol par les machines agricoles notamment seront ainsi abandonnés.Les analyses portant sur la technique culturale et sur la récolte de produits des champs seront, quant à elles,radicalement restreintes.
Les stations de recherches agronomiques coopèrent étroitement avec des partenaires institutionnels.Quel que soit le domaine,enseignement,mesures communes de mise en oeuvre ou association des praticiens,la coopération engendre un vif échange de connaissances.L’utilisation des infrastructures en commun permet de faire des économies. Plus de 80 scientifiques d’Agroscope sont chargés de cours dans les hautes écoles du pays.Les collaborateurs des stations encadrent des étudiants qui préparent des travaux semestriels,des mémoires ou des thèses de doctorat.Ils forment aussi des doctorants, soit quelque 50 candidats à la fin de 2004.A l’EPF Zurich,des collaborateurs de toutes les stations de recherches donnent des cours dans leur domaine de spécialisation.
Les stations coopèrent aussi avec des universités étrangères,Agroscope FAL Reckenholz,par exemple,avec celle de Newcastle (Angleterre) pour ce qui est de la sécurité biologique.Les deux partenaires étudient des plantes transgéniques qui ont été obtenues à l’université de Newcastle.La FAL effectue les analyses moléculaires spéciales à Newcastle.Quant à la FAW Wädenswil,elle a conclu un protocole d’entente avec la Cornell University de New York.Cette dernière a invité un chercheur de la FAW à donner des cours.Les deux partenaires offrent par ailleurs ensemble le cadre pour une thèse de doctorat et divers autres travaux de recherche.

Les avantages de la coopération sont manifestes:Les collaborateurs des hautes écoles et d’Agroscope discutent des sujets de la recherche appliquée et les traitent souvent ensemble.Il se crée ainsi un réseau de relations très utile,dont bénéficient tous les partenaires.
■ Etre à la hauteur
Ces mêmes avantages résultent aussi de la coopération avec les hautes écoles spécialisées.La Haute école suisse d’agronomie (HESA) à Zollikofen (BE),par exemple,a confié des mandats d’enseignement à une vingtaine de chercheurs d’Agroscope Liebefeld-Posieux (ALP).D’autres collaborateurs de cette station encadrent des étudiants préparant un travail semestriel ou un travail de diplôme.
Des coopérations traditionnelles existent aussi entre la FAW et la Haute école de Wädenswil (HSW) et entre Agroscope RAC Changins et les écoles d’ingénieurs de Changins (EIC) et de Lullier.
■ Utilisation réciproque des infrastructures
Outre la coopération au niveau scientifique,il importe d’utiliser réciproquement les infrastructures.Ainsi,la FAW gère les cultures fruitières de la HSW,et les deux voisins FAW et HSW ont réuni leurs ateliers et leurs bibliothèques.
A Changins également,la RAC et sa voisine,l’Ecole d’ingénieurs de Changins (EIC), partagent un certain nombre de locaux,tels que les caves,la bibliothèque,la blanchisserie,l’aula,le restaurant et les terrains expérimentaux de viticulture.Ensemble,elles
196 2.3AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2
■ Recherche et exécution
organisent des journées d’information,notamment la manifestation Agrovina,ainsi que des journées «portes ouvertes».
Un partenariat associe aussi depuis de longues années l’ALP et l’Institut agricole de Grangeneuve (IAG – FR),qui utilisent ensemble des champs,des animaux et l’exploitation biologique de Sorens (FR).L’Ecole d’agriculture de Châteauneuf (VS) et le Centre des Fougères de la RAC à Conthey pratiquent une coopération similaire.
Les coopérations FAW/HSW,RAC/EIC et ALP/IAG permettent de faire des économies substantielles.
Une coopération particulière s’est établie entre Agroscope FAT Tänikon et l’Office vétérinaire fédéral (OVF).Le centre OVF spécialisé dans la détention convenable des ruminants et des porcs est logé à la FAT,où il fait de la recherche et soutient l’exécution de la loi sur la protection des animaux.Comme la FAT fait,elle aussi,de la recherche sur les animaux de rente,cela permet de tirer parti des synergies.
La FAT collabore également avec le Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche (EMPA) de Dübendorf.Ce dernier lui confie les mesures de performance,de consommation et d’émission (qualité des gaz d'échappement) de tracteurs.En contrepartie,il met sa technique des mesurages à la disposition de la FAT,par exemple en mesurant les particules dans les gaz d’échappement ou les poussières fines dans les systèmes de stabulation.
■ Echange de connaissances avec les praticiens
Un partenariat lie la FAL et l’Institut de recherche de l’agriculture biologique (FiBL) de Frick.La FAL et le FiBL échangent des informations scientifiques,harmonisent leurs méthodes et s’entraident dans un certain nombre de projets.
FAL,FAT et ALP collaborent aussi étroitement avec le Centre de formation et de vulgarisation agricoles de Schüpfheim (LBBZ;LU).Dans l’exploitation LBBZ de Burgrain, différents systèmes culturaux sont comparés dans un essai de longue durée.La FAL soutient le LBBZ en procédant à des relevés spéciaux concernant plusieurs paramètres du sol et la biodiversité et en établissant des bilans énergétiques.
La FAL profite de ses nombreux contacts avec les praticiens,les vulgarisateurs et les enseignants.Quant à la FAT,elle lui donne des conseils pour le dépouillement des données sur les systèmes culturaux.ALP et le LBBZ étudient un système différent d’élevage de porcs en plein air;le LBBZ examine les questions de rentabilité et ALP celles relatives à la technique de production.Parallèlement,ALP participe au projet «types de vaches».
Au «Centre des Fougères» de la RAC,le centre de recherche Médiplant,une association soutenue par plusieurs partenaires,s’occupe de la domestication et de la sélection de plantes médicinales et aromatiques.La RAC lui met à disposition son infrastructure (laboratoires,serres et champs).Aussi bien Médiplant que les chercheurs de la RAC bénéficient de l’échange de connaissances.
197 2.MESURESDEPOLITIQUEAGRICOLE 2.3 AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2
Haras national

Depuis quelques années,on observe une reprise de l’élevage chevalin dans les régions rurales,en particulier dans les régions de montagne et à proximité des villes.Branche de production proche de la nature et respectueuse de l’environnement,l’élevage et l’exploitation de chevaux,notamment de la race des Franches-Montagnes,joue un rôle de plus en plus important dans la diversification des activités agricoles,ainsi que pour le développement régional et l’occupation décentralisée du territoire.Certes,le nombre d’éleveurs a augmenté,mais le niveau des connaissances a baissé,surtout en ce qui concerne la rentabilité,les conditions de garde et les besoins naturels des animaux.
Le Haras national suisse est un centre de compétences reconnu aux niveaux national et international.Il offre ses services dans les domaines de la génétique et de la formation,l’objectif étant d’améliorer la compétitivité de la branche et de promouvoir durablement le bien-être des chevaux.Dans le cadre de la recherche appliquée,il développe des techniques et méthodes d’élevage et d’exploitation,qu’il porte aussi à la connaissance des milieux concernés.
Ce soutien logistique et technique ne peut se faire sans la transmission de connaissances professionnelles et d’informations très spécifiques.Le centre de documentation et le bureau de conseils du Haras gagnent dès lors en importance,car ils tiennent à disposition un grand choix de documents et de publications traitant de sujets d’actualité en matière d’élevage,tels que le soutien de la race des Franches-Montagnes,l’amélioration de la compétitivité et la promotion du bien-être des chevaux dans le milieu rural.Les connaissances pratiques profitent aux éleveurs qui participent au cycle de formation Equigarde® ou qui s’adressent au bureau de conseils.Les informations scientifiques,quant à elles,sont utilisées pour les projets de recherche du Haras qui font partie de ses tâches stratégiques.En collaboration avec les fédérations d’élevage chevalin,le centre gère également des documents sur l’origine des chevaux élevés en Suisse.
198 2.3AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2
■ Centre de documentation et bureau de conseils
Vulgarisation en agriculture et en économie familiale rurale
La Confédération octroie des aides financières pour la vulgarisation.Celles-ci représentent en moyenne 20 à 25% des dépenses incombant aux services de vulgarisation et environ 55% des dépenses assumées par l’Association suisse pour le conseil en agriculture (ASCA).Cette association est l’organisation faîtière des centrales de vulgarisation LBL à Lindau (ZH) et SRVA à Lausanne.
Dépenses pour la vulgarisation en 2004
DestinatairesMontant mio.de fr.
Services cantonaux de vulgarisation agricole8,3
Services cantonaux de vulgarisation en économie familiale rurale0,8
Services spéciaux de vulgarisation d’organisations agricoles0,8
Association suisse pour le conseil en agriculture8,4
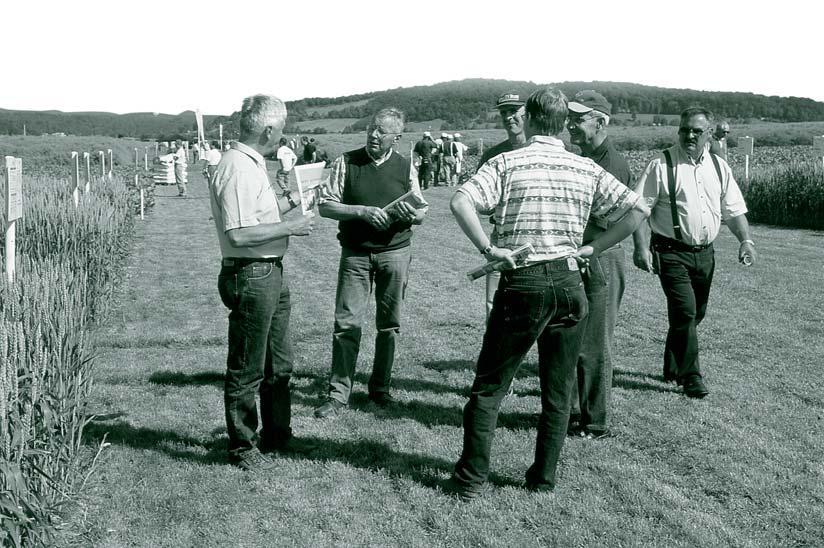
Total18,3
Source:Compte d’Etat
199 2.3 AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2
■ Nouvelle convention de prestations avec l’ASCA
Fin 2004,l’OFAG et l’ASCA ont signé une nouvelle convention de prestations portant sur les années 2006 et 2007.Cette convention proroge pour l’essentiel le mandat confié aux deux centrales de vulgarisation LBL et SRVA,qui sont ainsi chargées de poursuivre leurs travaux dans les cinq produits comprenant les diverses prestations.
ProduitDescription des principales prestations
Acquisition de connaissances de base et développement de méthodes
Initiation professionnelle, qualification et formation continue des vulgarisateurs
Information,documentation, moyens auxiliaires,informatique
Des méthodes éprouvées et des données de base actuelles sont disponibles sous forme de matière brute pour différents produits.Des données concernant la pratique sont saisies et évaluées,pour autant qu’elles ne soient pas déjà disponibles,et permettent des contacts avec des groupes de praticiens et de vulgarisateurs.
Les centrales de vulgarisation offrent un vaste programme d’initiation et de formation continue.Elles encouragent la qualification des vulgarisateurs.
Une vaste offre d'information,de documentation et de moyens auxiliaires est mise à la disposition des vulgarisateurs dans les domaines spécialisés et en particulier dans la gestion d'entreprise et l'économie familiale;elle est conçue de manière à pouvoir être directement mise en oeuvre dans les exploitations agricoles.Les logiciels sont destinés à améliorer la performance des vulgarisateurs.
Soutien direct des services de vulgarisation,de la branche et des régions
Sur demande et contre rémunération équitable,les centrales mettent à disposition,pour une durée déterminée,des connaissances spécifiques en vulgarisation,formation professionnelle,ainsi que dans le développement d’organisations et d’équipes,de même que leur capacité à résoudre les problèmes.Elles soutiennent des projets présentant un intérêt général pendant la phase initiale.
Création de plates-formes de coordination (initier,gérer et collaborer)
Sur demande ou d’entente avec les responsables ou les participants,les centrales assument des fonctions de réseau à l’intérieur du système de connaissances agricoles.
A l’instar de la GMEB (gestion par mandat de prestations et enveloppe budgétaire),qui est utilisée dans l’administration fédérale,il est fixé,pour chaque produit,des objectifs ainsi que des indicateurs et des normes (unités de mesure),qui permettent de juger,à la fin de l’année,si et dans quelle mesure les objectifs ont été atteints.L’OFAG sait ainsi comment les ressources financières ont été utilisées,et les centrales ont un aperçu des prestations qu’elles ont fournies et de leur qualité.Les résultats obtenus avec ce système les trois premières années sont très satisfaisants.
La nouvelle convention de prestations porte sur les années 2006 et 2007.Ensuite,on passera au rythme usuel de quatre ans,qui s’applique au mandat de prestations d’Agroscope et à la convention avec le FiBL.En raison des mesures d’économie,l’ASCA ne dispose plus dorénavant que de 8 millions de francs,soit de 400’000 francs de moins que les dix dernières années.
200 2.3AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2
Formation professionnelle agricole

La nouvelle loi sur la formation professionnelle (LFPr),entrée en vigueur le 1er janvier 2004,tient compte des profonds changements qui ont marqué la formation et le monde du travail.Elle vise à ouvrir de nouvelles voies dans la formation professionnelle et à rendre le système plus perméable.Le subventionnement des dépenses est remplacé par un système forfaitaire,axé sur les prestations,qui exige une collaboration plus étroite des trois partenaires aussi sur le plan financier.L’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) octroie une aide annuelle de quelque 10 millions de francs à la formation professionnelle agricole.
Selon la nouvelle loi,les organisations du monde du travail (OMT) actives au niveau national sont responsables du contenu des formations réglementées (objectifs de formation) et de son adéquation avec les besoins et les attentes du marché du travail.
Les organisations professionnelles des secteurs de l’agriculture,de l’agriculture biologique,du maraîchage,de l’arboriculture,de la viticulture,de l’œnologie et de l’aviculture ont fondé ce printemps l’organisation faîtière responsable de la formation professionnelle.Avec les représentants des offices cantonaux de la formation professionnelle et l'OFFT,elles soumettent la formation professionnelle de base à une révision totale en ce sens,afin de mettre en place une formation attrayante et complète,assurant une perméabilité maximale entre les professions de la terre et une utilisation optimale des ressources,sans que les catégories professionnelles ne perdent leur identité.Elles prévoient l’entrée en vigueur des ordonnances et des annexes le 1er janvier 2008 et leur application dès la rentrée de l’automne suivant.
Une réforme a également été initiée dans les professions équestres.Plusieurs organisations actives dans le monde du cheval s’y intéressent et l’ont annoncé à l'association compétente.L’OMT a été instituée,et elle a lancé la réforme officielle cet été,afin que les textes de loi puissent entrer en vigueur le 1er janvier 2008.
201 2.MESURESDEPOLITIQUEAGRICOLE 2.3 AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2
■ Nouvelles tâches et responsabilités des associations professionnelles
■ Examens professionnels et examens professionnels supérieurs

Pour la mise en oeuvre d'un examen professionnel ou d'un examen professionnel supérieur,les OMT compétentes forment l'organisation faîtière.Les règlements d'examen définissent les conditions d'admission,la matière à traiter,la procédure de qualification,les brevets et les titres.Ils doivent être approuvés par l'OFFT.
L'adaptation de tous les examens professionnels et des examens professionnels supérieurs aura lieu au plus tard lors d'une révision ou lors de l'adoption d'un nouveau règlement.Lors d'une demande de révision ou lors de l'adoption d'un nouveau règlement d'examen,il faut prendre en considération tous les règlements d'examen déjà existants qui,dans le même domaine,chevauchent considérablement le nouveau texte. Dans le domaine de l'agriculture,les règlements d'examen qui sont actuellement en révision pourront être approuvés conformément à la nouvelle base légale.
Les filières de formation et les études postdiplômes dans tout le domaine de l'agriculture sont désormais réglementées à l'annexe 4 (agriculture et sylviculture) de l'ordonnance du DFE concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures.Toutes les filières de formation reposent sur des plans d'études cadre,qui sont élaborés et édictés par les prestataires de la formation,en collaboration avec les OMT.L'OFFT les approuve sur proposition de la Commission fédérale des écoles supérieures.
202 2.3AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2
■ Identifier les besoins en formation et en vulgarisation et y répondre?
Centre international d’études agricoles (CIEA)
Depuis de nombreuses années,le CIEA (centre international d'études pour la formation et la vulgarisation en milieu rural) planifie et met en oeuvre des offres de formation pour les spécialistes de l'agriculture et du milieu rural,sur mandat de l'OFAG et de la Direction du développement et de la coopération (DDC).Plus de la moitié des participants proviennent de pays en développement.Le directeur et l’administratrice du CIEA s'inspirent notamment des problèmes actuels dans le domaine de la formation et des principaux besoins des groupes-cibles.
■ Le CIEA prend le pouls de son époque
Le CIEA définit les problèmes et les questions prioritaires:Il s’agit: –de l'évolution des besoins en formation et en vulgarisation; –du développement de la qualité de la formation et de la vulgarisation; –de l'analyse et de la mise en oeuvre de nouvelles tendances dans les méthodes didactiques; –de l'évolution des conditions générales relatives à l'organisation et à la direction d'institutions de formation; –du développement de nouvelles conceptions de formation,en rapport avec l'évolution du milieu rural dans différentes parties du monde.
■ Les activités principales du CIEA
Le CIEA peut répondre à ces besoins par différentes mesures: –planifier et mettre en oeuvre des offres de formation continue à l'attention de différents groupes-cibles (p.ex.membres de la direction d'institutions de vulgarisation ou de formation,enseignants et décideurs dans le système de formation agricole); –contribuer au dialogue et à l'échange d'expériences entre les différents acteurs dans le milieu rural (p.ex.entre familles paysannes et responsables de la formation); –mettre à disposition des informations et un réseau de spécialistes pour ce qui est des questions de formation et de vulgarisation dans le milieu rural.
■ Projets actuels du CIEA
En 2005,trois projets sont planifiés ou réalisés:
–un séminaire de formation continue pour directeurs d'école,enseignants et décideurs provenant de pays d'Amérique latine;
–un atelier pour l'analyse des besoins en formation dans le milieu rural d'Afrique de l'Ouest;
–le cinquantenaire du CIEA qui sera célébré en 2006 à Grangeneuve.
Toutes ces activités du CIEA contribuent d'une manière ciblée à développer et à améliorer les offres de formation et de vulgarisation pour l'agriculture.
203 2.MESURESDEPOLITIQUEAGRICOLE 2.3 AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2
■ Accord agricole bilatéral avec l’UE:reconnaissance du catalogue des variétés et de la certification
2.3.3 Moyens de production
Semences et plants
Dans l'accord agricole qui est en vigueur depuis le 1er juin 2002,les parties contractantes ont établi la reconnaissance réciproque pour la mise en circulation de matériel de multiplication végétal.L'UE est de loin le principal partenaire commercial dans ce domaine.La suppression des entraves techniques au commerce donne à l'agriculture suisse accès à une offre beaucoup plus grande de variétés destinées aux grandes cultures et aux cultures fourragères.Depuis le 5 juillet 2004,l’équivalence est reconnue en ce qui concerne l'homologation des variétés et la certification des semences.
L'annexe 6 de l'accord agricole avec l'UE réglemente la reconnaissance du matériel de multiplication des plantes cultivées dans l'agriculture,l'horticulture,la culture ornementale et la viticulture.Elle contient notamment des règles relatives à la reconnaissance des dispositions légales et des attestations (p.ex.étiquettes),à la procédure prévue pour l’harmonisation des législations et à l'importation de matériel provenant de pays tiers (pays autres que ceux de l'UE).Les appendices à l'annexe 6 indiquent l'état des dispositions légales,les services de contrôle et de certification et les pays tiers concernés.
■ Catalogue des variétés
En Suisse,520 variétés sont actuellement enregistrées dans le Catalogue national des variétés.Grâce à la reconnaissance du catalogue des variétés de la Communauté européenne,les agriculteurs suisses ont maintenant aussi accès à environ 16'000 variétés provenant de toute l'UE.Afin que l'agriculteur puisse choisir,parmi toutes ces variétés,celles qui conviennent le mieux aux conditions climatiques suisses,les interprofessions élaborent les listes de variétés recommandées en se fondant sur les résultats des essais effectués dans les stations de recherches.
Nombre de variétés homologuées en Suisse et dans l'UE
EspèceSuisseUECH en % EU
Blé441 2543,5
Epeautre101855,6
Maïs473 6621,3
Pommes de terre361 0123,6
Ray-grass d’Italie et ray-grass
Westerwold313179,8
Trèfle violet2516615,1
Colza36730,5
Sources:Catalogue national des variétés,OFAG;catalogue des variétés de plantes et de légumes agricoles de la CE, journal officiel de l'Union européenne,état mars 2005
204 2.3AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2 ■■■■■■■■■■■■■■■■
■ Certification des semences
La reconnaissance réciproque permet aux obtenteurs suisses,ou aux entreprises de sélection qui font examiner leurs variétés en Suisse,de mettre en circulation dans toute l'Europe les variétés qu'ils ont fait enregistrer dans le Catalogue national des variétés. Ils ont d’ailleurs de plus en plus souvent recours à cette possibilité,en exportant notamment des mélanges fourragers et des variétés de céréales panifiables se distinguant par une qualité exceptionnelle ou une résistance particulièrement bonne.
La certification des semences et plants englobe la visite des champs,le contrôle en laboratoire des échantillons ainsi que l'emballage,la fermeture et l'étiquetage des lots de multiplication selon des données clairement définies.Les dispositions correspondantes se trouvent dans l'ordonnance sur les semences (RS 916.151) et dans l'ordonnance du DFE sur les semences et plants (RS 916.151.1).Ces ordonnances,ainsi que d'autres dispositions légales concernées par l'annexe 6 de l'accord agricole,ont été reconnues par l'UE comme équivalentes aux directives européennes.La réciprocité est toutefois soumise à la condition que les textes légaux soient périodiquement adaptés en cas de modifications des prescriptions en vigueur dans l'UE ou en Suisse.

■ Intégration de nouveaux domaines
La clause évolutive de l'accord exige que,lors de l'adoption de nouvelles dispositions légales,les parties contractantes examinent si le nouveau domaine peut être intégré dans l'accord.Pour continuer de lever les entraves techniques au commerce,la Suisse souhaite l’extension de la réciprocité au matériel de multiplication des plants d'arbres fruitiers,des ceps de vigne et des légumes.
205 2.3 AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2
■ Mesures phytosanitaires: le passeport phytosanitaire remplace le certificat phytosanitaire

Protection des végétaux
Depuis la fin du XIXe siècle,on s'efforce d'empêcher dans le commerce international l'introduction accidentelle de nouveaux organismes nuisibles ou de nouvelles maladies des plantes.Le commerce international des végétaux est,aujourd'hui encore,réglementé par la Convention internationale sur la protection des végétaux (CIPV) de 1951. Celle-ci prescrit notamment un certificat phytosanitaire pour chaque exportation de matériel végétal,qui permet au service phytosanitaire du pays importateur de savoir si le service homologue du pays exportateur a examiné la marchandise et l’a jugée conforme aux exigences phytosanitaires du pays importateur.
Il y a quelques années,le certificat phytosanitaire a été remplacé en Europe par le passeport phytosanitaire.Celui-ci a été introduit en 1993,lorsque,en raison de la création du Marché unique européen,les contrôles de marchandises à la frontière des Etats membres ont été abolis.Le passeport phytosanitaire repose sur le principe selon lequel les contrôles phytosanitaires ne sont plus effectués peu avant la mise en circulation des végétaux,mais à un moment approprié de la période de végétation,au lieu de production.Obligatoire pour certaines espèces végétales,il sert à confirmer que le matériel végétal en question provient d'une exploitation de production officiellement agréée par l'organisation phytosanitaire nationale et que les parcelles de production ont été soumises à un contrôle phytosanitaire.Un passeport phytosanitaire peut être établi seulement si les cultures de l'exploitation de production sont indemnes d'organismes de quarantaine.Lors de la mise en circulation,les envois des plantes soumises au passeport phytosanitaire doivent être pourvus de ce passeport tout au long de la filière de commercialisation.Si les envois sont divisés ou au contraire regroupés,les partenaires commerciaux,qui ont besoin eux aussi d'un agrément,doivent établir un passeport de remplacement et tenir un registre afin de garantir la traçabilité en cas de problèmes phytosanitaires notamment.
■ Harmonisation des dispositions phytosanitaires suisses avec celles de l'UE
Depuis le 1er avril 2002,le passeport phytosanitaire est prescrit en Suisse pour les plantes ligneuses,c'est-à-dire pour le matériel végétal provenant de pépinières.Dans un premier temps,il n'était utilisé qu'en Suisse,où il servait en particulier à réglementer la commercialisation des plantes-hôtes du feu bactérien.Grâce à l'accord agricole bilatéral,l'UE et la Suisse reconnaissent réciproquement leurs passeports phytosanitaires,depuis le 1er avril 2004.La Suisse avait alors étendu le système du passeport à presque toutes les plantes qui y sont soumises dans l'UE.De plus,elle a repris les exigences européennes relatives à l'importation de plantes provenant des pays dits tiers.Cette harmonisation a eu pour effet qu'aujourd'hui,pour ce qui est du commerce de plantes,la Suisse est sur un pied d'égalité avec les membres de l'UE.Cela signifie, entre autres,que les plantes non soumises au régime du passeport peuvent être commercialisées librement,les dispositions hors du domaine phytosanitaire demeurant réservées.
206 2.3AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2
■ Collaboration avec les interprofessions
Les entreprises qui produisent et/ou mettent en circulation du matériel végétal soumis au passeport phytosanitaire doivent être agréées par le Service phytosanitaire fédéral. Les parcelles de production sont inspectées au moins une fois par année.Les producteurs sont tenus d'indiquer dans un registre les données figurant sur les passeports accompagnant les envois de plantes ainsi que la date et les indications sur les destinataires.Cette mesure s'applique également aux entreprises commerciales qui achètent et revendent ce matériel végétal.Celles-ci doivent en outre être en mesure d'informer immédiatement sur l'origine du matériel;c'est pourquoi elles sont tenues de conserver les passeports phytosanitaires.Par contre,les personnes produisant des plantes pour leurs propres besoins ne sont pas concernées par les prescriptions sur le passeport phytosanitaire.

En Suisse,et dans certains pays membres de l'UE,les contrôles officiels ont été confiés aux interprofessions.Par interprofession,on entend une organisation qui regroupe au moins deux associations professionnelles de la filière,qui ont entre elles un rapport du type fournisseur – client,afin que les intérêts des deux parties soient représentés.Les interprofessions ont été constituées lors de l'introduction des systèmes de certification pour les semences et plants,qu'elles sont chargées de gérer.Elles disposent donc des structures et des connaissances nécessaires pour mener à bien dans toute la Suisse la tâche que leur a confié le Service phytosanitaire fédéral.
■ Perspectives
L'équivalence des dispositions phytosanitaires suisses et européennes est une condition sine qua non pour la reconnaissance réciproque.C'est pourquoi,la Suisse doit examiner périodiquement sa législation en la matière,mais les nouvelles dispositions de l'UE ne sont pas reprises sans examen préalable.
2.MESURESDEPOLITIQUEAGRICOLE 207 2.3 AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2
■ L'agriculture met en valeur 50% du compost et des digestats
Compost et digestats dans l’agriculture
L'utilisation de compost et de digestats dans l'agriculture en tant qu'engrais ou en tant qu'amendements est en forte augmentation.Alors que le compost destiné à une utilisation agricole ou non agricole doit être annoncé à l'OFAG,les digestats ou le jus de pressage (l'eau obtenue lors de la fermentation de matériel végétal et animal) sont soumis à autorisation.
En 2002,728'300 t de déchets verts ont été livrées dans les environ 300 installations de compostage de Suisse qui transforment plus de 100 t de déchets biogènes par année,soit 103 kg par habitant.Actuellement,le potentiel de collecte de déchets verts n'est de loin pas épuisé.L'OFEFP estime que 650'000 t supplémentaires de déchets verts compostables finissent dans les poubelles.
Dans le bilan de fumure de l'agriculture suisse,le compost et les digestats représentent un peu moins de 10% de la quantité totale de substances nutritives.
La quantité diminue d’environ 45% lors du compostage.Environ la moitié des 400'000 t restantes de compost et de digestats est utilisée dans l'agriculture,selon les estimations de l'OFEFP.
2.3AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2 208
Origine et utilisation des déchets biogènes en 2002
Particuliers 38% Déchets pouvant être compostés dans des installations >100 t/a 728 300 t env. 55% Compost 401 000 t 100% Services publics 12% 38% Services de collecte publics 50% env. 45% Perte de substance 327 000 t sous la forme d’eau et de CO2 12% Loisirs Agriculture Horticulture Ouvrages de paysagisme Recultivations 50%
Source: Schleiss, 2005
Alors que pendant le compostage de matériel végétal et animal à teneur organique élevée,la décomposition est aérobie (au contact de l'air),la fermentation est caractérisée par une désintégration microbiologique totalement différente.Elle est anaérobie (sans apport d'air).Outre les digestats et le jus de pressage se forme du biogaz qui peut servir à la production d'énergie électrique et de chauffage ainsi que de carburant.
L'utilisation de compost et de digestats peut créer des problèmes particuliers,car le matériel initial est hétérogène.Manque d'hygiène,métaux lourds,polluants organiques ou propriétés agronomiques insuffisantes (rapport C:N,valeur du pH, teneur en sel,etc.) peuvent compromettre la sécurité des denrées alimentaires et la protection du sol à long terme.

Afin que la sécurité des denrées alimentaires et la protection du sol soient garanties,le contrôle de la qualité du compost et des digestats est prioritaire.La commission de l'inspectorat remplit une fonction importante à cet égard,de par sa neutralité et son indépendance.Elle se compose de représentants des interprofessions,des services spécialisés fédéraux (OFAG,OFEFP),des cantons et des stations de recherches.La commission organise,accompagne et surveille les inspections des installations.Elle élabore des propositions pour un contrôle de qualité uniforme et sert de plate-forme pour l'échange d'informations.Dans ses activités,elle accorde la priorité à des objectifs tels que la protection de l'environnement,la sécurité des denrées alimentaires et la sécurité des travailleurs.
De plus,le Groupement pour l'inspection du secteur suisse de compostage et de méthanisation a été fondé en décembre 2004.Dans ce groupement,toutes les associations importantes de la branche sont représentées.Les cantons,qui sont responsables du contrôle des installations,ont ainsi la possibilité de confier cette tâche à une organisation indépendante.Le contrôle de qualité offre à l'agriculture et aux autres utilisateurs la garantie que la qualité minimale prescrite par la loi est respectée.
2.3 AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2 209
■ Contrôle de la qualité du compost et des digestats
■ Peut-on garantir l'innocuité des produits phytosanitaires pour les abeilles?

Produits phytosanitaires
Ces dernières années,on a constaté une décimation inquiétante des populations d'abeilles tout d'abord en France,puis dans d'autres pays.D'abord en 2002,puis d'une manière plus accentuée en 2003,ce même phénomène a été observé en Suisse.Les médias ont fait état à plus d'une reprise de la mortalité des abeilles et plusieurs interventions parlementaires ont été déposées à ce sujet.En l'occurrence,l'opinion prédominante,provenant aussi des milieux apicoles,était que la mortalité des abeilles résultait des produits phytosanitaires utilisés comme désinfectants sur les semences.
L'importance et la multiplicité des fonctions de l'apiculture pour l'agriculture n'est plus à prouver.Aussi l'OFAG cherche-t-il depuis plusieurs années la cause de la mortalité des abeilles et tâche de trouver des solutions.Il a notamment examiné si des produits phytosanitaires étaient effectivement à l’origine du phénomène ou si d’autres raisons entraient en ligne de compte.C’est le seul moyen d’éviter que l’on se fixe trop rapidement sur une cause erronée et que l’on choisisse une solution inappropriée.
■ Examen des produits phytosanitaires quant à la tolérance par les abeilles
Ci-après,nous présentons la procédure d'examen des produits phytosanitaires,qui permet de garantir leur sécurité pour les abeilles.Les produits controversés concernant la mortalité des abeilles ont,eux aussi,été minutieusement testés au moyen de cette procédure.
En principe,les produits phytosanitaires ne peuvent être mis en circulation en Suisse que s'ils sont homologués.Le rôle de l’homologation obligatoire est d’assurer qu’un produit phytosanitaire n'est mis en circulation que s’il se prête suffisamment à l'usage prévu,qu’il n'entraîne pas d'effets secondaires nuisibles inacceptables,et qu'il ne présente de risques ni pour l'environnement,ni pour les animaux,ni pour l'être humain,lorsqu'il est utilisé conformément aux prescriptions.Des études circonstanciées concernant la sécurité pour les abeilles font partie intégrante des exigences à satisfaire pour l'homologation de ces produits.Si les abeilles sont mises en danger par l’usage,l’autorisation n’est pas accordée.
Les méthodes servant à tester la toxicité d'un produit pour les abeilles s'articulent en trois points:
Tests en laboratoire: les abeilles sont dans une cage et reçoivent une dose précise d'un produit en question.Ces tests permettent de constater la toxicité aiguë d'un pesticide par l'absorption orale ou par le contact.Le rapport entre la toxicité du produit et la dose utilisée permet de déterminer le danger qu'il représente pour les abeilles: c'est ce que l’on appelle le rapport de risque.Si ces tests montrent qu'il n'existe aucun risque pour les abeilles,rien n'entrave l'autorisation d'un produit phytosanitaire du point de vue de la toxicité pour les abeilles.Si,par contre,les tests laissent supposer une toxicité possible pour les abeilles,il faut procéder à un essai plus proche de l'utilisation dans la pratique qu'un test en laboratoire.
2.3AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2 210
Essais sous tente: sous une tente d'environ dix mètres carrés,on traite une culture mellifère avec une dose d'utilisation normale du produit à tester.On place ensuite une petite colonie d'abeilles dans la tente.On détermine alors l'intensité de vol et on note si des troubles du comportement apparaissent,s'il y a des abeilles mortes ainsi que leur nombre près de l'ouverture de la tente ou dans le champ.Pour les insecticides contenant un régulateur de croissance des insectes,ce test est étendu au développement du couvain,avec des indicateurs spécifiques.Dans ce test aussi,les abeilles sont soumises à un effet du produit plus élevé que lors de son application normale,car elles ne peuvent pas quitter la surface traitée.Si les essais sous tente laissent eux aussi supposer une toxicité possible pour les abeilles,il faut procéder à des essais en plein champ ou sous de grandes tentes.
Essais en plein champ ou sous de grandes tentes: ces essais offrent des conditions proches de la réalité agricole.Les grandes tentes sont en gaze synthétique perméable et la surface testée contient aussi bien des zones traitées que non traitées. On note à nouveau si des abeilles mortes se trouvent près de l'ouverture de la tente; une mesure de la densité de la population permet d'observer les éventuelles répercussions sur le développement des colonies.Dans les essais de cette envergure,des influences externes non contrôlables ne peuvent évidemment pas être exclues,ce qui peut rendre l'interprétation des résultats très difficile.

Ces méthodes d'essais ont été élaborées à l'échelle internationale dans les milieux de spécialistes et sont appliquées lors de l'homologation de produits phytosanitaires, notamment aussi dans l'UE.Elles reflètent l'état actuel de la technique et de la science et garantissent que la sécurité pour les abeilles est testée au mieux des connaissances et en toute conscience avant qu'un produit phytosanitaire soit mis sur le marché.
Des questions actuelles en rapport avec l'apiculture,comme par exemple la cause de la mortalité des abeilles,sont traitées au Centre de recherches apicoles à Liebefeld. Concrètement,le centre met à profit aussi bien ses contacts directs avec les autorités compétentes des pays voisins que ceux qu'il entretient avec les associations d'apiculteurs,en Suisse et à l'étranger.Dans cette recherche des causes,il est tenu compte de l'action des produits phytosanitaires,mais aussi d'une série d'autres facteurs qui pourraient être responsables de la mortalité des abeilles.A ce jour,il n'y a pas d'indications laissant supposer que les produits phytosanitaires sont la cause de cette mortalité.
2.3 AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2 211 2.MESURESDEPOLITIQUEAGRICOLE
■ Centre de recherches apicoles d'Agroscope Liebefeld-Posieux
■ La tradition dans l’élevage suisse
2.3.4Elevage
L’élevage d’animaux de rente a une longue tradition en Suisse et jouit d’une bonne renommée au-delà des frontières.Les animaux suisses tiennent la comparaison directe avec la génétique étrangère,à tous égards;ils atteignent de plus en plus souvent les premiers rangs dans les concours internationaux.Pour assurer un élevage indépendant en Suisse,l’Etat doit continuer de soutenir les éleveurs et leurs organisations dans leurs activités zootechniques.La Confédération et les cantons dépensent ensemble chaque année quelque 40 millions de francs pour la gestion des herd-books,l'organisation des épreuves de performances,l’évaluation des données zootechniques (estimation de la valeur d’élevage comprise),ainsi que pour les programmes de conservation des races suisses en danger.
La préservation de la diversité des races d’animaux de rente est une préoccupation publique essentielle.Les races suisses présentent non seulement un intérêt génétique, mais elles sont aussi un patrimoine culturel précieux méritant d’être conservé.Les organisations d’élevage ont reconnu l’importance de la biodiversité et s’appliquent à encourager et à conserver ces races dans le cadre de programmes spécifiques.
■ Importation et exportation d'animaux d'élevage et de semence
Les contingents tarifaires de chevaux,de porcs,de moutons et de chèvres ne sont pas épuisés,contrairement à celui de bovins d’élevage.En effet,la tendance à la reconversion de la production laitière à la garde de vaches mères fait croître la demande d’animaux des races à viande.Plus de 6'000 offres ont été déposées pour le contingent de 1'200 animaux de l’espèce bovine mis en adjudication durant l’année sous rapport.
En raison d’une plus faible offre d’animaux d’élevage et de rente sur le marché indigène,le nombre d’animaux exportés a diminué par rapport à l’année précédente. Environ 4'500 bovins d'élevage des races Tachetée Rouge,Brune ou Holstein ont été exportés dans 16 pays différents.Pour la première fois,30 bovins à viande ont été vendus en Estonie.
■ Mise en valeur de la laine de mouton du pays

Depuis le début de 2004,la Confédération reconnaît et soutient les organisations d’entraide d’utilisateurs de laine ou de détenteurs de moutons dans leurs tâches de collecte,de tri,de pressage,d'entreposage et de commercialisation de la laine indigène.En outre,les éleveurs de moutons et les transformateurs de laine peuvent bénéficier de contributions octroyées en faveur de projets novateurs favorisant la mise en valeur de la laine de mouton dans le pays.Pour ces mesures,la Confédération dispose d’un budget annuel de 600'000 et 200'000 francs respectivement.
En 2004,quatre organisations d’entraide reconnues ont mis en valeur quelque 400 t de laine de mouton du pays.Parmi les projets d’utilisation novatrice de la laine déposés,deux satisfont aux exigences requises et ont ainsi bénéficié d’un soutien de 40'000 francs.
2.3AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2 212 ■■■■■■■■■■■■■■■■
Tableau 49,page A57
2.4Section Inspectorat des finances
L’Inspectorat des finances coordonne son programme d’inspection avec le Contrôle fédéral des finances et l’adopte d’entente avec celui-ci.Les contrôles sur le terrain sont réalisés en accord avec les domaines d’activité ou sur la base d’analyses de risques.
Inspectorat des finances
En 2004,les activités de révision ont été les suivantes:
–révisions externes auprès de huit bénéficiaires de prestations ou de subventions et auprès de leurs mandataires chargés de l'exécution; –révisions internes dans trois sections de l’OFAG; –contrôles périodiques de pièces justificatives à l’OFAG,stations de recherches et Haras inclus; –révisions de clôture auprès de trois bénéficiaires de subventions; –suivi de révisions précédentes.
Tous les contrôles ont été réalisés selon les standards professionnels de l'Institute of Internal Auditors (IIA) et de l’Association suisse d’audit interne (ASAI);ils ont par ailleurs été soumis à un contrôle de qualité.
Les révisions externes ont donné de bons résultats dans l’ensemble;les objectifs ont été presque entièrement atteints.De manière générale,les organisations mandatées par l’OFAG sont bien organisées;elles disposent de structures appropriées et de procédures internes judicieuses.L’évaluation du système des paiements directs et de son efficacité dans six cantons a été un élément essentiel de l’activité de révision.Lesdits cantons ont été choisis en fonction de leur grandeur.Les systèmes cantonaux de contrôle interne sont généralement bien conçus,mais il est néanmoins possible de les développer.La surveillance des services de contrôle notamment devrait être mieux assurée.Il y a unanimité quant à l’effet déterminant des paiements directs sur les revenus de la population agricole.
Les révisions internes de l’OFAG (révisions de services administratifs) consistent en une évaluation neutre et systématique de l’organisation et des activités de l’unité concernée.Elles portent en particulier sur la structure et sur l’organisation des opérations de travail.La surveillance des contrôles internes est elle aussi importante.Elle ne se limite pas à constater les écarts entre l’état effectif et l’état souhaité,mais en recherche aussi la cause.Les résultats de nos contrôles sont le plus souvent positifs.Les deniers publics sont utilisés de manière légitime et ciblée.Les instruments de gestion et de pilotage appliqués sont souvent appropriés et transparents,et les tâches d’exécution administratives sont remplies consciencieusement.
■■■■■■■■■■■■■■■■
2.4 SECTION INSPECTORAT DES FINANCES 2 213 2.MESURESDEPOLITIQUEAGRICOLE
■ Rapport de gestion annuel
La révision financière au sein de l’OFAG a comporté plusieurs examens partiels et périodiques.L’examen par sondage des comptes de certaines rubriques nous permet de confirmer la régularité et la légalité des dépenses effectuées.
Les révisions de clôture ont donné des résultats insatisfaisants dans deux cas.Nous n’avons pas pu confirmer la régularité du décompte à l’intention de l’OFAG dans un d’eux et,dans le second,la régularité n’a été attestée qu’avec des restrictions.En revanche,lors d’une troisième révision,la clôture a été jugée correcte et conforme aux dispositions légales.Dans les trois cas précités,les prestations convenues ont néanmoins été fournies et,à quelques exceptions près,les fonds fédéraux ont été utilisés à bon escient et de façon économique.

Au titre de suivi,nous avons vérifié,dans quelle mesure les sections concernées avaient pris en compte les recommandations faites à l’occasion de 11 révisions dans les années 2002 et 2003.Nous avons constaté que la majorité d’entre elles mettent en pratique les recommandations qui ont été convenues lors des entretiens finaux.Quant à celles qui n’ont pas encore été suivies,elles font l’objet d’un examen dans l’année en cours.
L’Inspectorat des finances entretient de bons rapports avec toutes les unités d’organisation de l’OFAG.Lorsqu’il donne des conseils ou apporte son soutien,il souligne qu’il incombe aux services concernés d’assumer la responsabilité de leurs décisions.
2.4 SECTION INSPECTORAT DES FINANCES 2 214
■ Suivi
■ Activités de contrôle dans l’année sous revue
Contrôles sur le terrain
Les inspecteurs chargés des contrôles sur le terrain effectuent,pour les services de l’OFAG,des contrôles,vérifications,investigations et études dans tous les domaines de la production et de la vente régis par la législation agricole.En 2004,ils ont effectué 864 contrôles dans les secteurs suivants:
–lait et produits laitiers:652 contrôles; –légumes,fruits,fleurs coupées et concentrés de fruits:100 contrôles; –viande et œufs:28 contrôles; –grandes cultures et culture fourragère:9 contrôles et 1 relevé des prix; –viticulture en rapport avec les mesures de reconversion:44 contrôles.
S’agissant du secteur du lait et des produits laitiers,les contrôles ont révélé des irrégularités dans 25% des cas.Dans près de la moitié de ces cas,l’irrégularité ne dépassait pas la marge de tolérance,et il a donc suffi d’une réclamation.Les autres dossiers ont cependant été remis à la section compétente pour appréciation.
Un peu plus de la moitié des contrôles effectués à domicile dans le secteur des fruits et légumes frais ont fait apparaître des infractions qui ont été sanctionnées par des droits de douane supplémentaires ou des amendes.Ces montants ont été versés dans la caisse fédérale.
Dans les autres secteurs,les contrôles n’ont donné lieu à aucune remarque particulière.
■ Infractions
Les examens,enquêtes et interrogatoires requis en cas d’infractions aux dispositions de la législation agricole sont réalisés en collaboration avec les autorités d’instruction fédérales et cantonales,des organisations privées et d’autres instances d’entraide judiciaire.Durant l’exercice sous revue,six procédures pénales ont été ouvertes et les dossiers transmis aux instances compétentes;trois cas ont été réglés définitivement.
2.4 SECTION INSPECTORAT DES FINANCES 2 215 2.MESURESDEPOLITIQUEAGRICOLE
■ Mise en œuvre de la Politique agricole 2007
2.5 Evolution future de la politique agricole
La mise en œuvre des dispositions introduites avec la Politique agricole 2007 s’est déroulée comme prévu dans l’exercice sous rapport.C’est notamment le cas des travaux préparatoires à l’exemption anticipée du contingentement laitier,précédant pour sa part la suppression définitive le 1er mai 2009.La mise en adjudication des contingents d’importation de viande,quant à elle,est introduite par étapes;celle effectuée en 2004 s’est déroulée sans accrocs.
■ Une réforme agricole par étapes
À l’avenir,le rythme soutenu des changements ne devrait pas faiblir dans l’agriculture. Les contrats bilatéraux avec l’UE,en particulier,plusieurs accords de libre-échange avec des Etats tiers,ainsi que les répercussions probables des négociations en cours de l’OMC renforceront l’ouverture des marchés agricoles.Cette évolution ne concerne pas uniquement l’agriculture,mais la branche alimentaire dans son ensemble.A cela vient s’ajouter la pression liée aux impératifs d'économies de la Confédération et la baisse du seuil d’acceptation du soutien étatique au marché qui l’accompagne.Ainsi,des propositions émanant de l’administration et concernant la prochaine étape de réforme ont été formulées parallèlement à la mise en œuvre de la Politique agricole 2007. Cette étape,qui suit le rythme actuel imposé par l’enveloppe financière quadriennale de l’agriculture,est appelée «Politique agricole 2011» (PA 2011).
Étapes de réforme depuis 1992
1ère étape
■ Institution des paiements directs non liés à la production
■ Baisses de prix
■ Incitation à fournir des prestations écologiques particulières (p.ex. biodiversité)
■ Transformation de la protection douanière (OMC)
2ème étape
■ Fin de la garantie des prix et de l'écoulement
■ Suppression de Butyra et de l'Union suisse du commerce de fromage
■ Subordination des paiements directs aux prestations écologiques requises
3ème étape
■ Suppression du contingentement laitier
■ Mise en adjudication des contingents d'importation de viande
■ Développement des améliorations structurelles et des mesures d'accompagnement social
Découplage «plus d’écologie»
Déréglementation «plus de marché»
Déréglementation «compétitivité»
La PA 2011 constitue une nouvelle étape décisive de la réforme en cours depuis le début des années nonante.A l'avenir aussi,l’agriculture devra fournir ses prestations d’intérêt général par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché.
■■■■■■■■■■■■■■■■
PA 2002 PA 2007
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2.5 EVOLUTION FUTURE DE LA POLITIQUE AGRICOLE 2 216
La Commission consultative agricole,instaurée par le Conseil fédéral en vertu de l’art.186 LAgr,a élaboré en 2004 une charte de l’économie rurale suisse à l’horizon 2015.Ce document définit les attentes de la société vis-à-vis du secteur agroalimentaire et concrétise ainsi les objectifs et les tâches de l’agriculture tels qu’ils sont inscrits dans la Constitution.La Commission consultative rejette,dans sa charte,l’utilisation de végétaux et d’animaux génétiquement modifiés pour la production de denrées alimentaires.Ce point de vue correspond à la volonté de beaucoup de consommateurs et de producteurs,mais il est en contradiction avec la position ouverte du Conseil fédéral en la matière.
Charte de l’économie rurale suisse élaborée par la Commission consultative agricole
Production de denrées alimentaires
L'agriculture suisse et ses partenaires dans la transformation et la distribution des produits sont,sur le plan international,parmi les leaders dans la production durable de matières premières et de denrées alimentaires,et ils contribuent à la sécurité alimentaire de la Suisse.
■ Ils sont en tête sur le plan international dans la production – respectueuse de l’environnement et des animaux – de denrées alimentaires sûres.
■ Ils occupent avec succès des segments de marchés à forte valeur ajoutée,en Suisse et à l’étranger,et trouvent de nouveaux débouchés.
■ Ils offrent aux consommateurs d’excellents produits pour une alimentation saine et mettent à profit leurs possibilités en vue d’assurer à la Suisse un approvisionnement autonome en denrées alimentaires.
■ Ils renoncent à utiliser des végétaux et des animaux génétiquement modifiés dans la production et la transformation de denrées alimentaires.
Biens publics et prestations de services
L’agriculture suisse préserve la fertilité du sol,façonne les paysages ruraux et agit en partenaire forte dans le milieu rural.
■ Elle façonne les paysages ruraux en les soignant et en exploitant les terres,et elle préserve une flore et une faune variées.
■ Elle préserve la fertilité du sol et garantit le potentiel de production nécessaire à l’approvisionnement de la population.
■ Elle complète l’offre de matières premières et de denrées alimentaires par de multiples prestations de services.
■ Elle renforce la vie économique,sociale et culturelle dans le milieu rural.
Entrepreneurs / structures
Les agricultrices et les agriculteurs,ainsi que leurs partenaires dans la transformation et la distribution des produits,agissent avec prévoyance,en tant qu’entrepreneurs et en réseau.
■ Ils sont novateurs,décident avec prévoyance et font face aux conditions-cadre en mutation.
■ Ils conquièrent en commun de grandes parts de marché par une formation des prix et des conditions de marché équitables,et en pratiquant une coopération durable et efficiente dans l’ensemble de la chaîne de valeur ajoutée.
■ Ils assument leur responsabilité vis-à-vis de la société et de l’environnement.
■ Les agricultrices et les agriculteurs assurent la viabilité de leurs exploitations par la croissance,par la spécialisation,par la diversification ou par une activité accessoire.
2.5 EVOLUTION FUTURE DE LA POLITIQUE AGRICOLE 2 2.MESURESDEPOLITIQUEAGRICOLE 217
■ Charte de la Commission consultative
■ La Politique agricole 2011:prochaine étape de la réforme agricole
Les bases de la PA 2011 ont été élaborées au sein de l’administration.Les buts ancrés dans l’art.104 de la Constitution fédérale et la charte de la Commission consultative en constituent les lignes directrices.Le 2 février 2005,le Conseil fédéral a adopté les principes fondamentaux de la PA 2011.Suite à cela,de nombreux milieux ont été associés à l’élaboration des mesures concrètes.Les organisations concernées ont été informées lors de séances ad hoc appelées «Landsgemeinde» et les représentants des intérêts de l’agriculture ont régulièrement été consultés au moyen de forums de producteurs.L’orientation stratégique de la PA 2011 est admise par la majorité des milieux intéressés,alors que le rythme donne plutôt lieu à des critiques.
■ Des enjeux essentiels
Bien que la différence se soit amoindrie ces dernières années,les prix à la production des produits agricoles suisses restent plus élevés que ceux des pays voisins.Il en va de même pour les coûts.En cas de réduction de la protection douanière,la baisse des coûts risque de ne pas suffire pour maintenir un revenu paysan stable.
Il importe d’orienter encore plus l’offre et l’écoulement des produits agricoles suisses aux besoins du marché.La possibilité d’améliorer la mise en valeur des produits doit être systématiquement exploitée.
Les incidences négatives de la production agricole sur l’environnement ont fortement diminué.Cependant,des carences subsistent ponctuellement:les objectifs ne sont pas encore atteints en ce qui concerne les excédents du bilan d’azote et les surfaces de compensation écologique en plaine.
La réduction de l'écart de prix par rapport aux pays voisins doit être supportable au plan social.Autrement dit,l’écart de revenu ne devrait plus se creuser entre les populations agricole et non agricole.
■ Stratégie offensive
La stratégie poursuivie par la PA 2011 consiste à accroître la compétitivité de la production agricole par une réallocation,aux paiements directs non liés au produit, d’une grande partie des moyens affectés actuellement au soutien des prix,d’une part, et par une réduction des droits de douane perçus sur les aliments pour animaux, d’autre part.Cela assurerait à l’agriculture suisse une meilleure situation de départ pour faire face à d’éventuelles réductions de la protection douanière à venir (OMC, accord de libre-échange).Si les modes de transformation ne générant qu’une faible valeur ajoutée ne sont plus encouragées,la production et la transformation s’axeront davantage sur le marché.Cela permettra de mieux mettre en évidence la qualité et l’excellente renommée des produits suisses.L’amélioration de l’efficacité des instruments existants dans le domaine de la promotion des ventes et l’élargissement des possibilités de différenciation des produits devraient favoriser leur mise en valeur. Quant à la répercussion des baisses de prix sur les prix à la consommation,elle doit être encouragée par un renforcement de la libre concurrence.Ces mesures devraient également atténuer les différences de coûts,en complément à d’autres mesures prévues pour décharger l'agriculture à ce niveau,comme la suppression de certaines prescriptions.
2.5 EVOLUTION FUTURE DE LA POLITIQUE AGRICOLE 2 218
La baisse des prix diminue par ailleurs l’incitation à une production intensive,accroissant ainsi la rentabilité des surfaces de compensation écologique et l’intérêt à utiliser les ressources plus efficacement.Le soutien d’initiatives de projet destinées à l'utilisation durable des ressources permet d'augmenter l'attrait dans ce domaine et de créer un instrument servant à diminuer les atteintes à l'environnement au niveau régional. Pour ce faire,il n’est pas nécessaire de procéder à un durcissement généralisé des charges;il suffit d’en simplifier quelques-unes,tout en maintenant les standards écologiques.
L’assouplissement du droit foncier rural et du droit sur le bail à ferme ainsi qu’un allégement du remboursement des crédits d’investissements favoriseront une accélération de l’évolution des structures.Cette dernière dépendra en outre de l’évolution dans le reste de l’économie et des possibilités de travail existant dans le milieu rural. Par ailleurs,il est prévu d’augmenter les allocations familiales dans l’agriculture.Dans l’ensemble,la PA 2011 devrait rendre possible une évolution socialement supportable de l’agriculture.
Partant des enjeux et de la stratégie,cinq axes d’action ont été définis pour la PA 2011:
1Améliorer la compétitivité de la production et de la transformation par une réallocation,aux paiements directs,de fonds affectés au soutien du marché,et par des mesures destinées à abaisser les coûts.
2Garantir,par un système de paiements directs simplifié et compte tenu des fonds réalloués,les prestations d'intérêt général fournies par l'agriculture.
3Favoriser la création de valeur ajoutée et le développement durable dans le milieu rural par des mesures visant à faciliter une différenciation accrue des produits,une rationalisation de la promotion des ventes et le soutien d’initiatives de projet agricoles.
4Atténuer les conséquences de l'évolution structurelle sur le plan social et assouplir le droit foncier rural et le droit sur le bail à ferme agricole pour favoriser cette évolution.
5Simplifier l'administration et mieux coordonner les contrôles.
Le concept global de la PA 2011 est présenté dans le cadre de la consultation (www.blw.admin.ch;Dossiers «Politique agricole 2011»).Aussi,outre les modifications légales,les adaptations prévues au niveau des ordonnances sont-elles esquissées dans le dossier de consultation.Dans le domaine de la loi sur l’agriculture,les propositions peuvent en grande partie être réalisées au niveau des ordonnances.Notamment, le Parlement a déjà adopté dans le cadre de la Politique agricole 2007 la base légale nécessaire pour réallouer aux paiements directs les fonds destinés actuellement au soutien du prix du lait.
La PA 2011 consiste essentiellement à réallouer aux paiements directs non liés à la production les fonds destinés actuellement au soutien des prix,et à réduire les droits de douane perçus sur les aliments pour animaux.A partir de 2009,il ne sera pratiquement plus alloué de fonds,au titre du soutien du marché,aux entreprises de transformation et aux maisons de commerce opérant en aval.En contrepartie,l’agriculture sera déchargée au plan des coûts.
2.5 EVOLUTION FUTURE DE LA POLITIQUE AGRICOLE 2 2.MESURESDEPOLITIQUEAGRICOLE 219
■ Les cinq axes d'action
■ Enveloppe financière destinée à l’agriculture
Depuis l’an 2000,les Chambres fédérales approuvent la majeure partie des dépenses consacrées au soutien de l’agriculture pour une durée de quatre ans,sous la forme de trois enveloppes financières.Pour la période allant de 2008 à 2011,le Conseil fédéral prévoit 13'458 millions de francs pour les trois enveloppes;viennent s’y ajouter 80 millions de francs pour le financement des adaptations prévues dans le domaine des allocations familiales dans l’agriculture.
Evolution des trois enveloppes financières
2000–20032004–20072008–2011 mio.de fr.mio.de fr.mio.de fr. Décision du Parlement, arrêté du Conseil fédéral14 02914 09213 458
Dépenses effectives / décidées13 79413 485
Soutien du marché3 5202 6231 488
Paiements directs9 33610 06111 251
Amélioration des bases de production938801719
Sources:DFF,OFAG
D’une enveloppe à l’autre,on constate un déplacement du soutien au marché vers les paiements directs,lequel est dû à la réallocation mentionnée plus haut.Après 2009, les dépenses annuelles pour le soutien du marché ne se monteront plus qu’à quelque 300 millions de francs.
■ Répercussions et suite des opérations
La PA 2011 permettra,à l’avenir encore,de satisfaire aux buts inscrits dans la Constitution.Selon les modélisations d’Agroscope FAT,on doit s’attendre à ce que l’agriculture continue à utiliser toutes les surfaces et donc qu’elle fournira encore à l’avenir ses prestations d’intérêt général.Les résultats présentés ci-après sont encore provisoires.La valeur de la production baisse,chutant de 9,2 milliards de francs en 2001 à 7,7 milliards en 2009 (–15,9%).Une partie de cette baisse sera compensée par la diminution de 4,8% des charges réelles.Compte tenu de la réallocation des fonds du soutien du marché aux paiements directs,il en résulte une diminution du revenu net des exploitations de quelque 520 millions de francs (–17,4%).
L’agriculture continuera donc de subir une forte pression.Le revenu net des exploitations baissera de 2,4% par an.Si le nombre d’exploitations diminue au même rythme, le revenu nominal des exploitations restera stable.Cependant,afin que le pouvoir d’achat se maintienne,l’évolution structurelle devrait atteindre au moins 3,2% par an de 2001 à 2009.
Le 14 septembre 2005,le Conseil fédéral a autorisé le DFE à lancer une large consultation sur la PA 2011,qui s’achèvera le 16 décembre 2005.Une fois les prises de position évaluées,le Conseil fédéral se prononcera sur l’adoption du message,au printemps 2006,de sorte que les délibérations parlementaires pourront avoir lieu entre septembre 2006 et mars 2007.Il est prévu que les adaptations législatives entrent en vigueur le 1er janvier 2008,en même temps que la nouvelle enveloppe financière destinée à l’agriculture.
220 2.5 EVOLUTION FUTURE DE LA POLITIQUE AGRICOLE 2

3 ■■■■■■■■■■■■■■■■ 3.Aspects internationaux 221
L’élargissement des rapports commerciaux internationaux touche de plus en plus l’agriculture.Sur le plan mondial,celle-ci est soumise aux règles de l’OMC.Au regard de la concentration géographique des échanges agricoles,les relations contractuelles avec l’UE et l’intégration croissante dans l’Europe sont d’une importance primordiale pour l’agriculture suisse.
La Suisse dépend d’un accès libre aux marchés étrangers pour pouvoir maintenir et améliorer ses possibilités d’exportation.Elle s’engage en outre fermement au niveau international pour que la multifonctionnalité de l’agriculture soit mieux prise en compte dans les accords internationaux.
Le Rapport agricole tient compte de cette évolution et traite les sujets internationaux dans la troisième partie.
–Le chapitre 3.1 informe sur l’état actuel du dossier européen,des négociations de l’OMC et des accords de libre-échange.
–Le chapitre 3.2 est consacré à des comparaisons internationales.Le présent rapport poursuit les comparaisons internationales de prix entamées en 2000.Il compare en outre des exploitations suisses et européennes à l’aide de chiffres comptables et contient une analyse comparative de l’éco-conditionnalité pratiquée dans l’UE et des prestations écologiques requises en Suisse.
3.ASPECTS INTERNATIONAUX 3 222
3.1Développements internationaux
Dans l’année sous revue,l’évolution dans les rapports avec l’Union européenne s’est essentiellement limitée à la mise en vigueur du Protocole 2 révisé sur les produits agricoles transformés.Cet accord bénéficie grandement à l’industrie alimentaire et permet certaines économies en faveur des contribuables.Une des nouveautés consiste à faire évoluer l’organisation du marché du sucre parallèlement au régime de l’UE. Dans l’accord agricole,seules quelques adaptations techniques ont été convenues. Quant au commerce de produits agricoles avec l’UE,il a suivi son chemin,avec une légère augmentation de nos exportations de fromage.Un allégement administratif complémentaire a été introduit aux frontières de nos pays voisins.Par contre,il est regrettable que les exportateurs suisses aient moins bien exploité les préférences douanières accordées par l’UE qu’à l’inverse.
Les négociations agricoles menées au sein de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ont été intenses,mais n’ont pas abouti à des décisions majeures. L’entente du 1er août 2004 sur la suite des opérations a été suivie de huit tours de négociations et quatre «conférences mini-ministérielles»,lors desquels les participants ont quelque peu précisé les paramètres des «modalités» qui régiront l’établissement et la finalisation des nouvelles listes de concessions après la prochaine conférence des ministres en décembre 2005 à Hong Kong.Il faut évidemment en savoir davantage sur la réduction des droits de douane et d’autres engagements,avant de pouvoir évaluer les conséquences de l’ouverture des marchés.Toutefois,il s’annonce d’ores et déjà une forte pression sur les prix à la production et le volume de production dans le pays qui, très probablement,dépassera les adaptations visées par la prochaine étape de la réforme agricole (PA 2011).Les résultats des négociations à l’OMC ne pourront ainsi être assumés de façon supportable sur les plans économique et social qu’à travers deux étapes de réforme et à condition que l’agriculture fasse des efforts tout particuliers.Pour cela,elle aura besoin d’aide.

■■■■■■■■■■■■■■■■
3.ASPECTSINTERNATIONAUX 3.1 DÉVELOPPEMENTS INTERNATIONAUX 3 223
■ Développements
Accord agricole Suisse – UE
L’Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (accord agricole) est entré en vigueur le 1er juin 2002.Il vise à améliorer l’accès réciproque aux marchés de produits agricoles par une réduction des droits de douane,des subventions à l’exportation et des entraves techniques au commerce,et il reconnaît l’équivalence des prescriptions techniques dans les domaines de la protection phytosanitaire,de l’agriculture biologique,de la médecine vétérinaire et des normes de qualité en matière de fruits et de légumes.
Le volet tarifaire concerne essentiellement la libéralisation complète et réciproque du marché du fromage.A partir du 1er juin 2007,toutes les sortes de fromage bénéficieront d’une franchise totale dans le commerce entre la Suisse et l’UE;il n’y aura plus ni restrictions quantitatives ni subventions à l’exportation ou droits de douane.Si l’on considère l’évolution du commerce de fromage depuis l’entrée en vigueur de l’accord, rien n’indique un déplacement notable des parts de marché en 2007.En revanche,le libre accès au marché (notamment par la suppression des certificats d’hygiène et des émoluments) offre,surtout aux nouveaux exportateurs et aux PME,des chances d’écouler leurs spécialités de fromage.Il est d’ailleurs réjouissant de constater qu’ils en tirent de mieux en mieux parti.

3.1 DÉVELOPPEMENTS INTERNATIONAUX 3 224
■
Le Comité mixte chargé de l'Accord agricole Suisse – Communauté européenne (CE) a tenu sa quatrième séance le 27 octobre 2004.Cette séance,présidée par la Commission de la CE,a eu lieu à Berne.Elle a notamment porté sur les travaux des dix groupes de travail institués par le comité et sur la mise en œuvre des concessions accordées aux nouveaux membres de l’UE.
L’accord agricole a été actualisé dans les domaines protection des végétaux,semences, produits biologiques,fruits et légumes.L’équivalence des produits biologiques a été étendue aux produits d’origine animale,y compris les produits apicoles.Les modifications à apporter aux annexes concernant les produits viticoles et les spiritueux sont préparées,mais elles doivent encore être approuvées par le Conseil des ministres de la CE.
Comme le problème de l’ESB a été résolu dans le cadre de l’accord vétérinaire,l’accord bilatéral s’applique désormais aussi à la viande séchée.Les contingents accordés réciproquement peuvent donc être utilisés entièrement depuis le 1er janvier 2005.
En raison de leur adhésion à l’UE,le 1er mai 2004,les nouveaux membres ont résilié les accords de libre-échange et les accords agricoles qu’ils avaient conclus.Les droits de douane préférentiels que la Suisse leur accordait ont été transférés à l’UE-25 sous la forme de contingents tarifaires.En contrepartie d’augmentations des droits de douane OMC dans quelques-uns des nouveaux pays membres,la Suisse s’est vue accorder des concessions pour le bétail sur pied et les endives Witloof.Toutes les concessions sont entrées en vigueur rétroactivement au 1er mai 2004.
Un groupe de travail ad hoc s’est penché sur la question des indications géographiques protégées respectivement en Suisse et dans l’UE.Les entretiens devraient conduire à la reconnaissance réciproque de ces indications dans une nouvelle annexe à l’accord agricole.
3.ASPECTSINTERNATIONAUX 3.1 DÉVELOPPEMENTS INTERNATIONAUX 3 225
Comité mixte de l’agriculture
Le Protocole 2 de l’accord de libre-échange Suisse – CE de 1972 règle le commerce bilatéral de produits agricoles transformés entre la Suisse et l’UE.Ce document révisé lors des Bilatérales II a été mis en vigueur le 1er février 2005 par anticipation.Les deux Parties l’ont ratifié le 1er avril 2005.La révision apporte les améliorations suivantes:
1.Révision du mécanisme de compensation des prix:conformément au mécanisme simplifié,l’UE s’engage à supprimer les droits de douane sur les produits suisses et les subventions à l’exportation.La Suisse,quant à elle,réduit les droits de douane et les subventions à l’exportation ou les supprime également dans certains cas.
2.Extension et révision du champ d’application:l’accord s’applique désormais à un plus grand nombre de produits.
Utilité de la révision:
–compétitivité accrue de la production suisse de denrées alimentaires dans l’UE grâce à l’accès en franchise douanière à un marché de 450 millions de consommateurs; –augmentation d’un tiers,à environ 1,3 milliard de francs,du volume d’échanges relevant du champ d’application élargi;
–baisse des prix à la consommation en Suisse grâce à la concurrence accrue; –nouvelles perspectives pour l’agriculture suisse en tant que fournisseuse d’une industrie alimentaire compétitive;
–économies suite à la baisse des dépenses pour les subventions à l’exportation et les restitutions de droits de douane,de quelque 30 millions de francs respectivement; –renforcement de la position de la Suisse en tant que pôle de production et de recherche dans le domaine alimentaire.
Coût de la révision:
–quelque 90 millions de francs de recettes douanières en moins par l’introduction de la compensation des prix nets;
–impossibilité de fabriquer des produits à grande teneur en sucre,destinés à l’exportation,avec du sucre acheté au prix du marché mondial (double solution zéro:des deux côtés de la frontière,les fabricants de produits destinés à l’exportation se procurent le sucre sur le marché libre);
–pression supplémentaire,entre autres,sur les distilleries,les brasseries et les fabricants de vinaigre à cause de la réduction de la protection à la frontière.
3.1 DÉVELOPPEMENTS INTERNATIONAUX 3 226
■ Protocole 2
Politique agricole commune de l’UE
Deux éléments marquent le développement de la Politique agricole commune (PAC) de l'Union européenne (UE).Il s'agit,d’une part,de la réforme envisagée de l'organisation du marché du sucre et,d'autre part,du cadre budgétaire.
Au sujet du premier point,la Commission européenne a proposé le 22 juin 2005 que le prix de référence du sucre,qui se substituerait au prix d’intervention,serait fixé à 505,5 euros/t en 2006/07 (–20%) et 385,5 euros à partir de 2007/08 (–39% au total).Le prix minimum de la betterave passerait de 32,86 euros/t en 2006/07 (–24,7%) à 25,05 euros à partir de 2007/08 (–42,6% au total).Tout en prévoyant la fusion des quotas A et B,la Commission a reconnu qu’une proposition rendant obligatoires des baisses de quotas,ou qui admettrait un transfert de quotas entre les Etats membres,est vouée à l’échec.Ainsi,elle projette un nouveau plan de restructuration volontaire du secteur sucrier,à mettre en oeuvre sur une période de quatre ans.Ce plan permettrait d’octroyer une aide dégressive,passant de 730 euros par tonne de quota en 2006/07 à 370 euros en 2009/10 aux usines qui cesseraient leur activité et renonceraient à leur quota ainsi qu’un complément de paiement aux betteraviers qui abandonneraient la production du fait de ces fermetures.Il serait financé par une cotisation spécifique sur tous les quotas d’édulcorants.Les planteurs de betteraves recevraient un paiement direct par le biais d’enveloppes budgétaires nationales (896 millions d’euros au total en 2006/07 et 1,531 milliard à partir de 2007/08),grâce auxquelles la perte de revenu estimée pourrait être compensée à hauteur de 60%. Il reviendra au Conseil des ministres,probablement au début 2006,de statuer sur ces propositions.Les conséquences d'une telle réforme du régime sucrier européen en Suisse sont discutées au chiffre 2.1.4.
Au sujet du second point,six Etats membres proposent de réduire le budget communautaire à 1% du PIB.Etant donné que 46% de ce budget (2005 = 44 milliards d’euros dont 5 milliards pour le développement rural) sont destinés au financement de la Politique agricole commune,une telle réduction remettrait en cause le soutien des revenus et des marchés agricoles décidés pourtant par le Sommet européen d’octobre 2002 (perspectives financières 2007–2013).Ces pressions pourraient également aboutir à une réduction sensible des crédits proposés par la Commission européenne pour le développement rural.
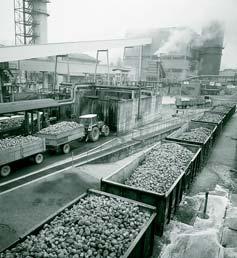
3.ASPECTSINTERNATIONAUX 3.1 DÉVELOPPEMENTS INTERNATIONAUX 3 227
Depuis l’adoption de l’Accord-cadre («framework»),le 1er août 2004,les négociations agricoles se sont intensifiées et ont été ponctuées de quatre rencontres ministérielles restreintes.L'une de ces rencontres qui s’est tenue au mois de mai à Paris,en présence du chef du DFE,a permis la conclusion d'un accord sur la méthode de conversion des droits de douane spécifiques en équivalents ad valorem (en anglais:«AVE»),sujet qui était sur la table des négociations depuis l'an dernier.Lors d'une autre rencontre en juillet à Dalian (Chine),en présence de 32 ministres,le groupe «G20» a présenté une proposition très ambitieuse sur tous les sujets de la négociation agricole.Ces propositions ont fait l'objet de discussions substantielles qui ont clarifié la position des Membres sur les trois piliers de la négociation.La proposition du G20 en matière d'accès au marché a été reconnue par la plupart des participants comme une base valable pour la suite de la négociation.
Equivalents ad valorem
Afin de pouvoir comparer les niveaux de protection (et les concessions futures),tous les droits de douane non-ad valorem (NAV) doivent être exprimés en équivalents ad valorem (AVE).Cette opération est nécessaire pour attribuer les positions tarifaires aux bandes d’une formule étagée de réduction.Pour ce faire,il faut prendre en compte uniquement les droits de douane sujets à réduction,à savoir les droits hors contingent et ceux pour lesquels il n'y a pas de contingent.
Le «compromis de Paris» sur la conversion des droits de douane a permis d'achever un chapitre apparemment technique mais néanmoins crucial des négociations.Les Membres concernés ont ensuite soumis leurs AVEs à l'OMC pour une vérification qui est encore en cours.
Formule étagée
Dès juin,la négociation s'est s'articulée autour de la formule même de réduction des droits de douane,principale problématique dans le domaine de l'accès au marché.Les points suivants ont été débattus:
–le nombre de bandes tarifaires;
–les seuils pour chacune de ces bandes;
–la formule de réduction pour chaque bande;
–le problème de l’inversion à proximité du passage des bandes (cas où les droits de la bande inférieure seraient réductibles davantage que ceux de la bande immédiatement supérieure);
–les produits sensibles,dont la sélection et,surtout,le traitement dépendent également de la formule de réduction tarifaire;
–les produits spéciaux (d’intérêt pour les pays en développement);
–les mesures de sauvegarde spéciale.
OMC
3.1 DÉVELOPPEMENTS INTERNATIONAUX 3 228
■ Accès aux marchés
■ Soutien interne
En ce qui concerne la formule de réduction,les formules dites de «Harbinson» –formule linéaire avec des taux de réduction incluant une moyenne et un minimum – et «suisse» – formule fortement harmonisante qui opère un plafonnement des tarifs dans chaque bande – se sont fait face pendant quelques mois sur la table des négociations. A l'occasion de la rencontre ministérielle restreinte de juillet,la proposition du G20, une formule strictement linéaire avec des taux de réduction croissants entre bandes,a suscité beaucoup d'attention.Le G20 a proposé de partager les tarifs des Membres en cinq bandes (avec pour seuils 20,40,60 et 80% AVE),dans lesquelles serait appliquée une réduction strictement linéaire.Cette formule génère une forte progressivité due aux cinq bandes,aux seuils bas entre bandes et aux coefficients de réduction croissants entre la 1ère et la 5e bande.Elle est de plus accompagnée de la proposition d'un capping des tarifs à 100% pour les pays développés.La Commission européenne a,de son côté,proposé de moduler les taux de réduction autour d'un «pivot» à l'intérieur des bandes,ce qui permettrait de moduler certains tarifs dans d'étroites limites autour de la valeur-cible.
Le besoin de flexibilité de la Communauté européenne et,dans une plus grande mesure,des importateurs nets comme la Suisse et les autres Membres du G10,est clairement palpable.La question est donc de déterminer si la notion de flexibilité,telle qu'exigée par la CE au moyen du «pivot»,sera effectivement concrétisée dans la formule de réduction ou seulement par le biais du choix des produits sensibles.Ces derniers ne seront pas soumis aux mêmes réductions que celles exigées par la formule. Les exportateurs souhaitent appliquer un maximum de progressivité dans la formule et traiter la question de la flexibilité uniquement au moyen des produits sensibles.Les importateurs savent cependant que le prix à payer pour le choix de produits sensibles devra également être âprement négocié.C'est pour cette raison qu'ils s'engagent à flexibiliser en priorité la formule de réduction.
Dans ce chapitre,les Membres négocient les modalités concernant les réductions substantielles du soutien interne ayant des effets de distorsion des échanges.Plus précisément,il s'agit de définir comment sera réduit le soutien interne,en particulier le nombre de bandes et la répartition dans ces bandes des principaux pays qui subventionnent leur production agricole.Pour la réduction du soutien total affectant les échanges et celle de la boîte orange,un compromis se dégage vers une distribution des pays développés au sein de trois bandes établies selon le niveau absolu de soutien (UE, USA,Japon,tous les autres),moyennant une contribution additionnelle des Membres pratiquant un soutien élevé en termes relatifs par rapport à la valeur de leur production (le Japon et les pays de l'AELE).
Ont également été discutées les autres formes de soutien interne,et notamment la révision des critères définissant la boîte verte tels qu'ils figurent dans l'Accord sur l'agriculture.A ce stade,il est clair qu'il s'agira essentiellement de précisions formelles et éventuellement d'une certaine ouverture pour les pays en développement.Le fondement des paiements directs ne sera pas remis en cause ni leur montant total soumis à une limite de la part de l'OMC.
3.ASPECTSINTERNATIONAUX 3.1 DÉVELOPPEMENTS INTERNATIONAUX 3 229
■ Concurrence aux exportations
L’élimination de toutes les subventions à l’exportation ayant été décidée en août 2004, la négociation porte sur tous les autres sujets pouvant fausser la concurrence sur les marchés étrangers,à savoir les crédits à l’exportation,les sociétés commerciales d’Etat et l’aide alimentaire.En ce qui concerne ce dernier sujet il faut noter que certains pays qui octroient une aide alimentaire en nature utilisent leurs surplus de produits agricoles pour le faire.Il s'agissait donc de distinguer l’aide «réelle» de celle dont le but est de contourner les disciplines OMC en matière de concurrence aux exportations. L’abolition des subventions à l'exportation – peut-être déjà en 2010 – pourrait être décidée rapidement,en tant qu'élément du paquet global des négociations,avec une finalisation des points encore ouverts dans les dossiers parallèles.
■ Programme des négociations
Le Comité agricole a tenu huit sessions de négociation depuis l’adoption du «framework».L'état des négociations à la fin juillet 2005 n'ayant pas avancé suffisamment pour permettre un consensus sur une première approximation des modalités,le président du Comité a dû se contenter de présenter un «état des lieux» de la négociation qui met en évidence les points essentiels restant à négocier.Les négociateurs se retrouvent dès septembre pour tenter d'aboutir à un projet de «modalités» que les Ministres souhaitent approuver à Hong Kong et qui permettrait,le cas échéant,l’établissement des listes de concessions pour chaque Membre de l’OMC.
Selon le calendrier prévu,les nouvelles listes de concessions devraient être établies en 2006 et l’accord final conclu au plus tôt à fin 2006.Les ratifications nationales pourraient alors intervenir en 2007 et la mise en vigueur des résultats du Cycle de Doha débuter en 2008.
3.1 DÉVELOPPEMENTS INTERNATIONAUX 3 230
Accords de libre-échange
Outre les Bilatérales I et II avec l’UE,la Suisse a aussi conclu,depuis les années nonante,des accords de libre-échange avec plusieurs pays dans le cadre de l’AELE. A l’heure actuelle,14 accords sont en vigueur:Israël (en vigueur depuis le 1.7.1993), Jordanie (2002),Maroc (1999),Organisation de libération de la Palestine,OLP (1999), Turquie (1992),Bulgarie (1994),Croatie (2002),Macédoine (2002),Roumanie (1994), Mexique (2001),Singapour (2003).Trois accords sont entrés en vigueur pendant la période sous revue:Chili (1.12.2004),Liban (1.1.2005) et Tunisie (1.6.2005).
On observe une tendance générale à conclure des accords de libre-échange dans le monde entier.L’économie suisse étant fortement axée sur les exportations,la Suisse est contrainte d’en faire de même pour empêcher que son industrie d’exportation ne soit discriminée et pour lui donner les mêmes chances que ces principaux concurrents sur les marchés tiers.Pour passer les accords,elle collabore en particulier avec ses partenaires de l’AELE,soit la Norvège,l’Islande et le Liechtenstein.Le choix des parties contractantes dépend dans une large mesure des accords de libre-échange conclus par l’UE,car les exportateurs de nos pays voisins sont généralement les principaux concurrents des offrants suisses sur les marchés tiers.
Les accords portent sur les domaines suivants:
–trafic de marchandises (industrie et agriculture); –prestations de services (finances,assurances,etc.); –marchés publics; –investissements; –propriété intellectuelle.
Des négociations sont en cours ou seront entamées prochainement avec les pays suivants:
–Egypte et Algérie (processus de Barcelone visant l’établissement d’une zone de libre-échange euro-méditerranéenne d’ici à 2010);
–Afrique du Sud;
–Corée du Sud;
–Thaïlande; –Canada;
–Mercosur (Argentine,Uruguay,Paraguay et Brésil);
–Indonésie;
–Japon;
–Ukraine;
–Russie (dès qu’elle sera membre de l’OMC);
–Etats arabes du Golfe (Koweït,Qatar,Oman,Arabie saoudite,Bahrain,Emirats Arabes Unis);

–Syrie;
–Serbie et Monténégro; –Etats-Unis (éventuellement).
3.ASPECTSINTERNATIONAUX 3.1 DÉVELOPPEMENTS INTERNATIONAUX 3 231
■ Réunion de haut niveau du Comité agricole
OCDE
Sous la présidence de l’ancien commissaire à l’agriculture de l’UE,Franz Fischler,une réunion de haut niveau du Comité agricole de l’OCDE s’est tenue les 14 et 15 juin 2005 à Paris.L’OCDE organise tous les quatre à cinq ans une réunion destinée à promouvoir l’échange informel d’informations et de réflexions sur des sujets d’actualité de la politique agricole entre des représentants gouvernementaux de haut rang.A part les délégations des pays membres de l’OCDE et d’organisations internationales telles que la Banque mondiale et la FAO,des délégations du Brésil,de Chine,d’Inde et d’Afrique du Sud ont également participé à la réunion.
Deux sujets étaient au centre des délibérations.Quels sont les objectifs actuels de la politique agricole et quel est le rapport des mesures prises à ce titre avec la libéralisation du commerce agricole?
Les délibérations ont montré que la politique agricole est de plus en plus déterminée par des intérêts socio-politiques – un phénomène qui a aussi poussé la Suisse à entreprendre des réformes.Un nombre croissant de pays a ainsi découplé le soutien agricole de la production et introduit des paiements directs permettant de tenir compte des fonctions écologiques et sociales de l’agriculture.Le débat sur le soutien interne du marché a été marqué par des dissensions.Alors que les pays exportateurs de produits agricoles ne sont disposés à accepter ce soutien que pour une durée limitée,les pays qui sont en premier lieu importateurs ont souligné la nécessité du soutien pour assurer la réalisation des objectifs de la politique agricole,en particulier l’indemnisation des prestations de l’agriculture non rétribuées sur le marché.
Du point de vue de la Suisse,la réunion a été satisfaisante.La délégation suisse a saisi l’occasion pour relever la nécessité de distinguer les produits agricoles selon la qualité et la provenance,de même que l’importance des prestations fournies en plus de l’activité agricole et des mesures prises à cet égard.Les participants,y compris les pays exportateurs de produits agricoles,ont manifesté une compréhension accrue pour ces deux préoccupations.Par contre,la Suisse a réitéré sa critique selon laquelle la méthode de l’estimation du soutien aux producteurs (ESP) ne tient pas suffisamment compte du transfert du soutien vers des mesures non liées à la production.L’ESP est un indicateur qui exprime la part du soutien aux recettes totales réalisées par l’agriculture. L’OCDE entend améliorer le calcul sur ce point.
3.1 DÉVELOPPEMENTS INTERNATIONAUX 3 232
3.2Comparaisons internationales
Pourquoi une comparaison internationale?
Une comparaison internationale des prix est utile pour mieux se connaître.Elle met en évidence la différence des coûts de production entre les pays comparés et fait la lumière sur les motivations du tourisme d'achat transfrontalier.Par ailleurs,elle sert à définir les mesures à prendre à la frontière (droits de douane et subventions à l’exportation).Enfin,elle montre au contribuable que l'agriculture suisse fait de gros efforts pour assurer sa compétitivité au niveau des prix.

■■■■■■■■■■■■■■■■
3.2 COMPARAISONS INTERNATIONALES 3 233
Méthode et définition
La comparaison de prix internationale porte sur des marchés identiques,similaires ou importants.Elle présente certaines difficultés,dont le choix des produits,la disponibilité des données,la pertinence des valeurs,la diversité des modes de production et de commercialisation et l’impact des facteurs monétaires.Les prix utilisés dans ce chapitre ont les caractéristiques suivantes.
–Ce sont des moyennes nationales,qui peuvent cacher des valeurs minimale et maximale selon les régions ou la mise en valeur du produit (prix à la production).
–Ils donnent un ordre de grandeur,car les produits (qualité,label) et les conditions de commercialisation (quantité,stade de commercialisation),ainsi que les canaux de vente et le mode de calcul de la moyenne,ne sont pas identiques dans les pays sous revue.

–Ce sont des prix bruts,à savoir: –ce sont ceux observés sur le marché (dans le cadre de la politique agricole propre à chaque pays).Les prix à la production ne comprennent pas la taxe sur la valeur ajoutée,alors qu’elle est incluse dans les prix à la consommation,car il s’agit d’une taxe à acquitter par le consommateur. –les prix ne sont pas ajustés de la différence de pouvoir d’achat entre les pays comparés.Voir à ce sujet notamment l’étude UBS «Prix et salaires».Comparaison du pouvoir d’achat et des salaires dans le monde,2003 (http://www.ubs.com/1/f/ about/newsalert?newsId=74358)
Ce ne sont donc pas tellement les valeurs absolues qui sont les plus importantes mais plutôt les variations enregistrées au fil du temps.
3.2COMPARAISONS INTERNATIONALES 3 234
■ Prix à la production
Tableaux 51–52b,pages A59–A61
Les recettes réalisées par les producteurs sur la vente d’un «panier type» servent de base à la comparaison.Le «panier type» est composé de la production moyenne (1998–2000) suisse de 15 des 17 produits agricoles faisant l'objet de la présente comparaison internationale de prix.Les statistiques de prix des betteraves sucrières et du colza des Etats-Unis n’étant pas disponibles,ces productions sont exclues du «panier type».Sa composition détaillée est indiquée en bas du tableau 52b de l’annexe. Il représente 3,2 millions de t de lait,2,7 millions de têtes de porcs,35,5 millions de têtes de poulets,etc.Cette composition suisse est ainsi appliquée aux pays faisant l’objet de la comparaison.
Les prix de l’UE (UE-4/6) portent sur les quatre pays voisins.Les pays cinq et six sont les Pays-Bas et la Belgique.Ils sont également retenus en cas de production importante.Le calcul du prix moyen pour l’UE-4/6 se fonde sur le volume de la production 1995/2001 des pays concernés.La composition du «panier type» et le poids des pays de l’UE-4/6 ne sont pas modifiés à travers les années,car il importe de mettre en évidence les variations de prix.
Quel est le niveau des prix agricoles suisses par rapport à ceux en vigueur dans l’UE ou aux Etats-Unis?
–Si les agriculteurs de l’UE-4/6 ou des Etats-Unis avaient produit et vendu le «panier type» suisse dans leur propre pays en 2002/04,ils en auraient retiré une recette équivalant à environ la moitié (respectivement 54 et 47%) de celle obtenue par leurs homologues suisses.Exprimée en parité de pouvoir d'achat selon l’étude de l'UBS mentionnée ci-dessus,la différence avec l'UE-4/6 est moins grande.La recette vaudrait grosso modo 64% dans l'UE-4/6 et 47% aux Etats-Unis.
–Des différences existent cependant selon les pays de l’UE.Ainsi les recettes obtenues sur le «panier type» équivalent en Italie à 63%,en Allemagne à 54%,en France à 53%,et en Autriche à 51% du prix de ce même panier en Suisse en 2002/04.
–Des différences existent aussi selon les produits.Les prix des produits des grandes cultures comme le blé (29% du prix suisse),l’orge (33%),le colza (44%) et les pommes de terre (51%) sont,en 2002/04,particulièrement bas dans l’UE-4/6.Le prix des betteraves sucrières (52%),produit contingenté dans l’UE,n’est cependant pas aussi bas que celui des autres grandes cultures.A l’opposé,le prix du lait (62%), produit également contingenté dans l’UE,est assez élevé dans l’UE-5.
–En conséquence,des différences plus importantes encore existent dans le couple «pays-produits».Alors qu’en France,les poires se vendaient à 92% du prix suisse en 2002/04,le prix des carottes en Autriche n’atteignait que 19% de celui obtenu en Suisse.
3.ASPECTSINTERNATIONAUX 3.2 COMPARAISONS INTERNATIONALES 3 235
Indice (CH = 100)
Evolution des prix à la production dans l'UE et en Suisse
Lait (10 kg) Gros bovin (kg PM) Veau (kg PM) Porc (kg PM) Poulet (2 kg PV) Oeuf (20 pces) Blé (10 kg) Orge (10 kg) Maïs-grain (10 kg) Bett. suc. (100 kg) Pommes de t. (20 kg) Colza (5 kg) Pomme (10 kg) Poire (10 kg) Carotte (10 kg) Oignon (10 kg) Tomate (5 kg) Panier type(mia an) 100 90 80 70 60 40 50 30 20 10
Prix à la production dans l'UE-4/6 par rapport à la CH
bovin Veau Porc Poulet Oeuf Blé Orge Maïs-grain Bett. suc. Pomme de t. Colza Pomme Poire Carotte Oignon Tomate Panier type
1990/922002/04
3.2COMPARAISONS INTERNATIONALES 3 236 Supplément CH 1990/92 UE 1990/92 Supplément CH 2002/04 UE 2002/04 0 16 14 12 10 8 6 4 2
francs
Sources: OFAG, OFS, Banque nationale suisse, USP, Eurostat, ZMP, Agreste 0
Lait
Sources: OFAG, OFS, Banque nationale suisse, USP, Eurostat, ZMP, Agreste
Gros
Les prix agricoles suisses se rapprochent-ils de ceux en vigueur dans l’UE ou aux EtatsUnis?
–La baisse des prix (exprimés en francs suisses) à la production du «panier type» entre 1990/92 et 2002/04 a été enregistrée non seulement en Suisse (–25%) mais aussi dans l’UE (–21%).Dans l’UE,cette baisse est liée non seulement aux réformes agricoles,mais aussi à l’affaiblissement de 15% de l’euro face au franc suisse.
–L’écart relatif entre la Suisse et l’UE s’est quelque peu réduit entre ces deux périodes. Le prix du «panier type» dans l’UE représentait 51% du prix suisse en 1990/92 contre 54% actuellement (2002/04).
–Mais c’est surtout au niveau absolu que les prix se rapprochent le plus de ceux pratiqués dans l’UE.L’écart de prix du «panier type» entre la Suisse et les pays de l’UE voisins se montait à 49% (3’553 mio.de fr.) en 1990/92 et se situait à 46% (2’546 mio.de fr.) pour la période 2002/04.L’écart absolu entre la Suisse et l’UE s’est rétréci de plus d’un quart (–28%) entre ces deux périodes.
Evolution des prix à la production du panier type
Sources: OFAG, OFS, Banque nationale suisse, USP, Eurostat, ZMP, Agreste, U.S. Department of Agriculture
–Des différences existent cependant selon les pays de l’UE.Entre ces deux périodes, la diminution de l’écart absolu du prix du «panier type» a été la plus marquée par rapport à la France (–33%),l’Allemagne (–28%) et l’Italie (–28%),alors qu’elle a été plus faible par rapport à l’Autriche (–7%),étant donné son adhésion à l’UE au premier janvier 1995.
–Il y a aussi des différences selon les produits.Entre 1990/92 et 2002/04,l’écart absolu des prix entre l’UE et la Suisse s’est réduit le plus pour le colza (–71%),les œufs (–44%),le lait (–40%) et le blé (–42%) et le moins pour le porc (–11%) et les gros bovins (0%);s’agissant des oignons (+99%),il s’est même creusé.
3.2 COMPARAISONS INTERNATIONALES 3 237 1990/9219971998199920002001200220032004 CHUE-4/6USA 0 60 50 40 30 20 10 70 80 90 100
Indice (CH 1990/92 = 100)
3.ASPECTSINTERNATIONAUX
–Aux États-Unis,l’évolution depuis 1990/92 a été différente.Les prix à la production (exprimés en francs suisses) ont connu une courbe ascendante (+28%) jusqu’en 2001,descendante jusqu'en 2003 et de nouveau ascendante en 2004.En 2002/04 le prix du «panier type» aux Etats-Unis revenait pratiquement au même niveau (+1%) de la période de référence 1990/92.Le cours du dollar face au franc suisse est,lui aussi,demeuré pratiquement inchangé (–2%) entre les deux périodes sous revue.Par rapport à la période de référence 1990/92,la différence du prix du «panier type» avec les Etats-Unis a diminué aussi bien en valeur relative (les prix USA atteignaient 47% des prix suisses en 2002/04 contre 35% en 1990/92) qu’en valeur absolue (–38%).
Remarquons finalement que le prix est,certes,une composante importante de la compétitivité de l’agriculture suisse,mais pas la seule:la qualité,la sécurité et l’image du produit,la publicité,le réseau de distribution,la force de vente et les services liés au produits sont autant d’autres éléments qui déterminent le succès d’un produit sur un segment de marché déterminé.
L’écart de prix des denrées alimentaires au détail entre la Suisse et les pays considérés a été estimé sur la base du prix d’un «panier standard» à la consommation en magasin,TVA comprise.Ce «panier standard» correspond sommairement à la consommation annuelle moyenne d'un habitant en Suisse (voir le tab.10 en annexe) des 21 denrées alimentaires faisant l'objet de la présente comparaison internationale. «Sommairement» car,par exemple,tout l’assortiment de viande de bœuf est représenté par le seul rôti de bœuf.Ce panier comprend 380 kg ou 91% des 417 kg de denrées alimentaires (sans le vin) consommés annuellement par un habitant en Suisse. Sa composition détaillée est indiquée en bas du tableau 54 de l’annexe.
Evolution des prix à la consommation du «panier standard»
3.2COMPARAISONS INTERNATIONALES 3 238
■ Prix à la consommation
CH Moyenne haute UE UE-4/5 0 60 50 40 30 20 10 70 80 90 110 100 Moyenne basse UE USA
Tableaux 53–54,pages A62–A63
Indice (CH 1990/92 = 100) Sources: OFAG, OFS, Banque nationale suisse, USP, Eurostat, ZMP, Agreste, U.S. Department of Agriculture 1990/92 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Le groupe «UE-4» réunit,comme pour les prix à la production,les pays voisins,soit l’Allemagne,la France,l’Italie et l’Autriche.Pour l’Italie,les prix de la ville de Turin ont servi de base de référence.La Belgique a été prise en considération dans le domaine des légumes ou lorsque les prix des pays voisins n’étaient pas disponibles.Par ailleurs, les prix nationaux minimaux ou maximaux ont été agrégés pour donner respectivement la moyenne basse et haute de l’UE-4/5.
Le poids des pays de l’UE-4/6 (valeur des dépenses des ménages privés en 1998) comme la composition en produits du «panier standard» restent fixes,afin que seules les variations de prix à travers les années soient mises en évidence.
En 2002/04,le prix du «panier standard» à la consommation dans l’UE valait 61% de celui du même panier acheté en Suisse contre 54% pour le «panier type» à la production.Ce prix européen relativement plus élevé à la consommation qu’à la production s’explique notamment par la composition non identique du «panier standard» à la consommation et du «panier type» à la production,par l’influence des denrées alimentaires importées,mais aussi par la taxe sur la valeur ajoutée plus élevée dans l’UE (environ 7% avec des variations entre pays et produits) qu’en Suisse (2,4%).
En Suisse,le prix à la consommation du «panier standard» est resté pratiquement inchangé (+2%) entre les deux périodes sous observation 1990/92 et 2002/04 alors que dans l’UE,une baisse de 10% a été enregistrée.Par conséquent,l’écart de prix entre la Suisse et les pays de l’UE voisins,qui se montait à 31% (697 fr.) du prix de ce panier en Suisse en 1990/92,a augmenté à 39% (892 fr.) pour la période 2002/04. L’écart absolu entre la Suisse et l’UE s’est même accru d’un quart (+28% ou +195 fr.) entre ces deux périodes.
Contrairement aux prix à la production,le fossé entre la Suisse et l’UE se creuse donc en ce qui concerne les prix à la consommation.La hausse importante en Suisse de la part des labels (Bio,M-7,Coop Natura Plan),notamment dans le domaine de la viande,explique au moins en partie ce développement.

Il existe toutefois d’énormes différences entre les pays.Tandis que le prix du lait de consommation est plus élevé en Italie (Turin) qu’en Suisse et que le sucre est également plus cher dans l’UE,les côtelettes de porc y sont vendues la moitié du prix suisse, notamment parce que la viande de porc proposée dans l’UE-4 est pour la plupart issue d’exploitations traditionnelles,tandis que celle offerte dans les magasins suisses était en 2001 composée à 60% de viandes de marque ou labels.
Entre 1990/92 et 2002/04,les prix à la consommation – exprimés en francs suisses –ont augmenté de 18% aux Etats-Unis,alors qu’ils restaient stables en Suisse.Ainsi, l’écart par rapport à la Suisse s’est réduit;il ne s’élevait plus qu’à 44% du prix suisse en 2002/04 contre encore 51% en 1990/92.
3.2 COMPARAISONS INTERNATIONALES 3 239 3.ASPECTSINTERNATIONAUX
Les entreprises agricoles suisses en comparaison avec l’UE
La commission de l’UE exploite avec tous les pays membres de l’Union un réseau d'Information comptable agricole (RICA),fondé sur une méthode unifiée.La Agroscope FAT Tänikon a converti les données comptables des dépouillements centralisés des années 2000 à 2002 selon ladite méthode.Ainsi,nous disposons de données actualisées comparables.Celles-ci seront comparées aux résultats des années 1996 à 1998, publiées dans le rapport agricole 2001.La comparaison est effectuée sur la base de l’euro.De 2000 à 2002,un euro valait environ 1 fr.50.
Il existe des différences méthodologiques entre le RICA et le dépouillement centralisé de la FAT.Les principales différences dont il faut tenir compte lors de la conversion portent sur la définition et la typologie des entreprises agricoles,sur l’évaluation des actifs,ainsi que sur les exploitations de référence et la pondération des résultats.
Les principales variables standard du RICA
Production brute totale
+Balance aides à l’exploitation / taxes (surtout paiements directs)
– Consommations intermédiaires
=Revenu d'exploitation brut
–Amortissements
=Revenu d’exploitation
–Coûts réels (salaires,fermages,intérêts)
+Balance aides à l’investissement et taxes sur investissement
=Revenu de l’exploitation familiale
Source:Commission de l’UE,RICA
Le revenu de l’exploitation familiale comprend la rétribution de la main-d’œuvre familiale non salariée ainsi que celle des fonds propres utilisés dans l’exploitation;il correspond donc à la notion de revenu agricole dans le dépouillement centralisé.
La variable standard «balance aides à l’exploitation / taxes» correspond pour l’essentiel aux paiements directs alloués par les pouvoirs publics.Dans les illustrations cidessous,elle est regroupée avec les «aides à l’investissement et taxes sur investissement» sous «aides et taxes».
3.2COMPARAISONS INTERNATIONALES 3 240
■ Le réseau RICA de l’UE
Définitions et méthodes,page A64
■ Revenu des exploitations
La surface moyenne des exploitations comptables évaluées se situe en Suisse bien audessous du niveau des pays voisins et de l’UE à 15 (moyenne).En ce qui concerne les cheptels et le volume de travail fourni,les données sont comparables avec celles de l’Autriche et de la moyenne des pays de l’UE. Structures
Même si les exploitations suisses sont plus petites,la somme de la production brute, des aides à l’exploitation et des aides à l'investissement est comparable à celle des exploitations allemandes et françaises.En termes absolus,c’est en Suisse que les paiements directs sont les plus élevés.Dans les années 2000/02,la part des «aides et taxes» à la production brute s’élevait à 24% en Autriche,à 20% en Suisse et à 14% en Allemagne et en France ainsi qu’en moyenne des pays de l’UE.
moyennes d’exploitations comptables dans des pays européens sélectionnés (1996/98 et 2000/02) Suisse 1 AllemagneFranceAutricheUE à 15 96/9800/0296/9800/0296/9800/0296/9800/0296/9800/02 Main-d’œuvre totale (UTA)1,861,801,992,091,791,921,911,821,501,47 Main-d’œuvre non salariée1,381,351,471,461,441,431,811,721,231,16 Surface agricole utile (ha)19,720,253,165,763,969,224,825,931,333,4 Cheptel total,exprimé en unités de bétail (UB)28,930,957,674,252,261,125,326,327,331,2 1 Chiffres pas comparables avec les exploitations de référence Agroscope FAT TänikonSources:Commission de l’UE,Agroscope FAT Tänikon
suisses supérieur à la moyenne de l’UE Production brute et aides 1996/98 et 2000/02 00/02 96/98 Euro/exploitation 1 Aides et impôts Autre production brute Total production animale brute Total production végétale brute Suisse 00/02 96/98 Allemagne 00/02 96/98 France 00/02 96/98 Autriche 00/02 96/98 UE (15) Sources: Commission UE, Agroscope FAT Tänikon 1 à partir de 2000 euro, avant ECU 0 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 3.ASPECTSINTERNATIONAUX 3.2 COMPARAISONS INTERNATIONALES 3 241
Les exploitations suisses s’en tirent assez bien pour ce qui est des dépenses,de sorte que le revenu de l’exploitation familiale dépasse nettement celui des pays de référence. Deux facteurs doivent être pris en compte lors de l’interprétation des résultats:les volumes de production beaucoup moins importants des exploitations suisses par rapport aux exploitations allemandes et françaises,et le pouvoir d’achat de l’euro,qui est de 20 à 30% plus bas en Suisse que dans les autres pays considérés.
Une comparaison de la variation relative entre les moyennes triennales 1996/98 et 2000/02 conduit aux constatations suivantes:
–Comparée aux pays de référence,la surface moyenne augmente moins fortement en Suisse.
–Les cheptels s’accroissent légèrement plus qu’en Autriche,mais moins qu’en moyenne de l’UE à 15.
–L’évolution de la main-d’œuvre est similaire à celle en Autriche.
–En Allemagne et en France,l’augmentation est supérieure à la moyenne,en ce qui concerne aussi bien la surface et les cheptels que la main-d’œuvre,ce qui s’explique en partie par des changements méthodologiques (échantillon et pondération).
–Quant à la hausse du revenu de l’exploitation familiale en Suisse,elle est comparable à l’évolution en Allemagne et en Autriche.
Dépenses et revenu des exploitations familiales 1996/98 et 2000/02 00/02 96/98 Euro/exploitation 1 Facteurs externes Amortissements Consommation intermédiaire Revenu des exploitations familiales Suisse 00/02 96/98 Allemagne 00/02 96/98 France 00/02 96/98 Autriche 00/02 96/98 UE (15) Sources: Comission UE, Agroscope FAT Tänikon 1 à partir de 2000 euro, avant ECU 0 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 3.2COMPARAISONS INTERNATIONALES 3 242
La comparaison entre exploitations laitières de taille similaire permet de situer en comparaison internationale les exploitations suisses présentant des conditions structurelles semblables aux exploitations de référence.Elle porte sur des exploitations comprenant une surface de 30 à 50 ha.
Pour mettre en évidence les conditions de production difficiles dans la région de montagne,les exploitations de plaine et de la région des collines sont présentées séparément.Elles sont comparées à des régions RICA où la production laitière joue un rôle important.Ainsi,outre la Bavière et le Schleswig-Holstein,la région française Rhône-Alpes est prise en compte,région comprenant non seulement les Alpes,mais aussi des parties de la Vallée du Rhône.Seules des données à l’échelle nationale sont disponibles pour l’Autriche.
Cette sélection est très restreinte;en Suisse et en Autriche,la taille des exploitations considérées est supérieure à la moyenne,tandis qu’elle correspond environ à la moyennenationale en Allemagne.Les exploitations de la région Rhône-Alpes,quant à elles,sont sensiblement plus petites qu’une exploitation laitière moyenne en France.
La main-d’œuvre engagée en Suisse,soit plus de deux unités,est comparable à celle en Autriche.Dans les autres régions de référence,la main-d’œuvre est nettement moins nombreuse.En effet,les exploitations des régions comparables de l’UE n’engagent que très rarement des employés,alors que dans les exploitations suisses,ils représentent de 0,6 à 0,8 unité de main-d’œuvre.La performance laitière des vaches en Suisse est plutôt supérieure à la moyenne.
Structures des exploitations laitières spécialisées comprenant de 30 à 50 ha de surface agricole utile, moyenne 2000/02
régionsdes collines Exploitations retenues2 5761 43610 5461 1022 7283 444 Main-d’œuvre totale (UTA)2,22,31,61,41,42,3 Main-d’œuvre non rémunérée1,61,51,51,31,42,2 Surface agricole utile (ha)36,636,237,240,839,637,2 Cheptel total (UB)45,453,257,374,441,141,9 Vaches laitières (UB)25,930,232,635,527,724,3 Performance laitière (kg/vache)6 3446 6986 0146 0285 2956 185 Production laitière (kg)164 200202 100196 200214 100146 700150 400 1 Chiffres pas comparables avec les exploitations de référence Agroscope FAT TänikonSources:Commission de l’UE,Agroscope FAT Tänikon
Comparaison
tions laitières de taille similaire ■ Main-d’œuvre dans les exploitations laitières suisses 3.ASPECTSINTERNATIONAUX 3.2 COMPARAISONS INTERNATIONALES 3 243
CH 1 CH 1 Plaine BavièreSchleswig-Rhônes-Autriche Toutes les et région HolsteinAlpes
■
d’exploita-
■ Production brute et paiements directs dans les exploitations laitières suisses sensiblement plus élevés
Dans des structures similaires,les exploitations suisses de plaine et de la région des collines atteignent une production agricole brute de 1,8 à 2,5 fois supérieure à celle des exploitations de référence européennes.Il s’y ajoute les paiements directs qui,avec quelque 47’000 euros,sont bien plus élevés,même que ceux alloués par l’Autriche,qui se montent à 23’000 euros.Quant aux exploitations allemandes et françaises analysées,elles touchent des paiements directs de 6’000 à 13’000 euros.
■ Dépenses dans les exploitations laitières suisses environ deux fois plus élevées
Concernant les dépenses aussi,les exploitations suisses se distinguent nettement de celles des pays voisins.Pour toutes les rubriques de dépenses,les deux groupes d’exploitations suisses se situent bien au-dessus des groupes de référence de l’UE.Ce sont les coûts salariaux qui frappent et que connaît pratiquement aucune des exploitations européennes de taille similaire.De même,les fermages et les intérêts sont en Suisse supérieurs à la moyenne.La part de surfaces affermées représente quelque 60% dans les exploitations suisses.Elle est plus élevée seulement dans les exploitations de la région Rhône-Alpes,les fermages étant toutefois plus bas.Dans les exploitations allemandes,la part de terres affermées se situe entre 40 et 50% et autour d’un tiers dans les exploitations autrichiennes.Quant aux dépenses pour l’entretien et la réparation de bâtiments,elles atteignent en Suisse au moins le double de celles enregistrées en Allemagne et en Autriche,voire le quadruple en ce qui concerne la région de référence française.S’agissant des amortissements,ils correspondent,dans les exploitations bavaroises,presque au niveau de la Suisse,alors qu’ils sont plus bas dans les autres régions.
Les dépenses totales des exploitations françaises et autrichiennes ne représentent que respectivement 35 et 37% de celles des entreprises suisses de plaine et des collines. Ce pourcentage avoisine 50% pour les exploitations allemandes.
3.2COMPARAISONS INTERNATIONALES 3 244
Euro/exploitation Aides et impôts Autre production brute Total production végétale brute Production animale brute sans lait Lait de vache et lait Suisse toutes les régions Suisse région de plaine/collines
Production brute et aides exploitations laitières 2000/02
Sources: Commission UE, Agroscope FAT Tänikon 0 240 000 220 000 200 000 160 000 180 000 140 000 100 000 120 000 80 000 60 000 20 000 40 000
Bavière Schleswig Holstein Rhônes-Alpes Autriche
■ Revenu de l’exploitation familiale le plus élevé en Suisse
Dépenses et revenu des exploitations laitières familiales 2000/02 Euro/exploitation
■ Amélioration du revenu dans toutes les régions depuis 1996/98
Fermages, intérêts Versement salaires Amortissements Autres consommations intermédiaires
Aliments
herbivores Revenu des exploitations familiales
La taille des exploitations n’explique pas ces importants écarts de coûts,puisque la comparaison porte sur des unités de taille semblable.Ainsi,en ce qui concerne par exemple les aliments pour animaux,ce sont les prix plus élevés qui occasionnent des coûts supérieurs aux exploitations suisses.S’agissant des autres rubriques de dépenses,l’aspect quantitatif joue probablement un certain rôle,surtout pour ce qui est de la main-d’œuvre,du capital étranger,ainsi que de l’entretien des bâtiments et des machines.Les conditions topographiques et climatiques,de même que les charges en matière de protection de l’environnement et des animaux,contribuent également aux dépenses plus élevées en Suisse.Ces facteurs n’expliquent néanmoins pas entièrement les grandes différences,par rapport à l’Autriche en particulier.
Le revenu de l’exploitation familiale équivaut à la différence entre la production brute, aides comprises,et les dépenses totales.S’il représente,dans les exploitations suisses, respectivement 53’000 et 57’000 euros,il se monte encore à 44’000 euros en Autriche (grâce aux coûts relativement faibles),mais n’atteint plus que 21’000 à 26’000 euros dans les autres groupes.Ceci dit,il convient de prendre en considération que dans les exploitations autrichiennes,le revenu de l’exploitation familiale rémunère 2,2 unités de main-d’œuvre non salariées,contre 1,3 à 1,6 dans tous les autres groupes,et que le pouvoir d’achat de l’euro est plus faible en Suisse.
Comparée à 1996/98 (cf.rapport agricole 2001),la production laitière dans les exploitations de la taille considérée s’est fortement accrue en Suisse,en Bavière et en Autriche,alors qu’elle est restée constante dans le Schleswig-Holstein et dans la région Rhône-Alpes.Dans les régions suisses de plaine et des collines,l’accroissement a été de 18 %,en Autriche même de 28 %.La somme de la production brute et des aides a augmenté en Autriche (+16%),en Suisse (toutes régions confondues:+18%,région de plaine et des collines:15 %) et dans la région Rhône-Alpes (+10%),tandis qu’elle a stagné dans les autres régions.Le revenu de l’exploitation familiale s’est accru en valeur nominale dans toutes les régions;la plus forte croissance a été enregistrée en Suisse (+20%),suivie du Schleswig-Holstein (+14%) et de l’Autriche (+14%).
Entretien bâtiments et machines 240 000 220 000 200 000 160 000 180 000 140 000 100 000 120 000 80 000 60 000 20 000 40 000 3.ASPECTSINTERNATIONAUX

3 245
Suisse toutes les régions Suisse région de plaine/collines
Bavière Schleswig Holstein Rhônes-Alpes Autriche
pour
Sources: Commission UE, Agroscope FAT Tänikon 0
■ Intégration des objectifs environnementaux dans les politiques agricoles de l’UE et de la Suisse
Analyse comparative de l’éco-conditionnalité (cross compliance) dans l’UE et des prestations écologiques requises en Suisse
La politique agricole de l’UE,dans un contexte de changements,a été marquée ces dernières années par des réformes en profondeur.Celles-ci se sont surtout imposées en raison des revendications de libéralisation des marchés agricoles,formulées dans les négociations de l’OMC.Un autre facteur consistait à prendre davantage en considération les aspects environnementaux dans la politique agricole.Les programmes agroécologiques ont ainsi gagné en importance et le droit à des mesures de promotion est, depuis,de plus en plus souvent lié à l’observation de normes environnementales. La Suisse a,elle aussi,intégré les objectifs environnementaux à sa politique agricole; les prestations écologiques requises (PER) en constituent l’élément-clé.Dans un cas comme dans l’autre,l’octroi de paiements directs est lié au respect de standards minimums dans la pratique agricole,un concept que l’UE désigne par le terme d’éco-conditionnalité (ou cross compliance [CC]).Le non-respect des standards peut entraîner une réduction des paiements.
L'Institut des milieux ruraux de la Station fédérale de recherches pour l'agriculture à Braunschweig (D) a comparé les deux approches,en relevant les similitudes et les dissemblances.
■ La politique agricole de l’UE et sa dernière réforme
Dans l’UE,les conditions générales relatives à l’utilisation des surfaces agricoles sont largement déterminées par la Politique agricole commune (PAC).Celle-ci évolue sur la base des décisions prises en commun par tous les pays membres.
Le premier pilier de la PAC,la politique des prix et marchés,ne laisse aux Etats membres qu’une marge d’action relativement étroite dans la mise en œuvre des dispositions communes.Celles-ci concernent des instruments de soutien des prix aussi bien que les paiements directs versés aux entreprises agricoles.La réforme agricole «Agenda 2000» décidée en 1999 regroupe dans le second pilier de la PAC des mesures servant au développement du milieu rural.Contrairement aux versements du premier pilier,un cofinancement national est exigé pour ce pilier qui comprend notamment des mesures agro-écologiques,des indemnités compensatoires pour les régions défavorisées ainsi que l’encouragement des exploitants à l’investissement.Les Etats bénéficient d’une plus grande marge d’action dans la mise en œuvre de ces mesures environnementales et structurelles.
La dernière réforme agricole de l’UE,adoptée en juin 2003 par les ministres de l’agriculture de l’UE dans le contexte de l’évaluation intermédiaire de «l’Agenda 2000»,de l’élargissement de l’Union à l’Est et des négociations OMC,a conduit à l’adoption d’un règlement sur les paiements directs et de règlements d’application,qui sont contraignants pour les pays membres.
Les éléments-clés de la réforme sont:
– le découplage des paiements directs de la production agricole;
– l’exigence,pour l’octroi de paiements directs,que des normes minimales soient respectées dans les domaines de l’environnement,de la protection des animaux et de la protection des consommateurs (éco-conditionnalité).
3.2COMPARAISONS INTERNATIONALES 3 246
■ Découplage des aides
La dernière réforme agricole de l’UE prévoit de découpler,de la production,la majorité des paiements directs faisant partie du premier pilier.Jusqu’à 100% des surfaces de l’exploitation peuvent désormais être gelées sans remettre en cause le droit aux aides. Il existe cependant de nombreuses options de mise en œuvre,y compris la possibilité de reporter le découplage jusqu’en 2007.La Grande-Bretagne et l’Allemagne opèrent le découplage le plus poussé,alors que d’autres Etats maintiennent un couplage partiel pour les primes d’animaux (p.ex.Autriche,France et Danemark).
Grâce au découplage des paiements directs,les agriculteurs sont libres de décider de l’utilisation des surfaces,ce qui devrait favoriser une meilleure adaptation aux besoins du marché.L’exploitation agricole sera abandonnée,lorsque les modes de production concernés ne sont pas rentables dans les conditions du marché et sans paiements directs liés à la production.La possibilité de geler la totalité de la surface de l’exploitation se distingue de la réglementation antérieure sur le gel des surfaces et incitera à cesser la production surtout dans les zones à faible rendement.Par ailleurs,le découplage des primes pour animaux devrait faire diminuer la garde d’animaux extensive liée aux surfaces herbagères,telles que la garde de vaches mères ou de moutons,car les primes sont ici essentielles pour la rentabilité.Outre certains risques,le découplage offre également quelques avantages concernant la protection de la nature,puisque les éléments paysagers comptent dorénavant parmi les surfaces donnant droit à des aides dans la culture des champs.
■ Eco-conditionnalité dans l’UE
Au début 2005,une nouvelle approche de l’éco-conditionnalité,harmonisée et contraignante pour les pays membres,a été mise en œuvre.Chaque pays membre doit ainsi introduire des dispositions d’éco-conditionnalité répondant à des critères prédéfinis.
L’éco-conditionnalité englobe:
–des exigences réglementaires en matière de gestion des exploitations dans les domaines de la protection de l’environnement,de la protection des animaux et de la sécurité des aliments,basées sur 19 règlements et directives de l’UE,qui devront être introduites par étapes jusqu’en 2007; –des standards de bonnes conditions agricoles et environnementales concernant la protection des sols,l’entretien minimal des surfaces et le respect des éléments du paysage; –des exigences relatives au maintien de pâturages permanents;la proportion de ceux-ci à la surface agricole totale utilisée ne doit pas diminuer de plus de 10% à l’échelon des Etats membres ou des régions.Si cette part recule notablement,il convient de prendre des mesures permettant d’interdire,dans les exploitations,le labour de pâturages permanents ou de prescrire un réensemencement.
3.ASPECTSINTERNATIONAUX 3.2 COMPARAISONS INTERNATIONALES 3 247
■ Les PER sont-elles comparables à l’écoconditionnalité de l’UE?
La comparaison avec l’éco-conditionnalité porte uniquement sur les exigences à remplir,dans le cadre des PER,pour l’obtention de paiements directs généraux et sur quelques autres exigences liées à l’octroi de paiements directs,qui sont définies dans l’ordonnance suisse sur les paiements directs (OPD).
Comme elles impliquent des charges en matière de protection de l’environnement et des animaux,les PER correspondent aux principes de l’éco-conditionnalité de l’UE.De nombreuses normes des PER concordent avec les exigences d’éco-conditionnalité formulées dans des pays membres de l’UE,par exemple en ce qui concerne l’assolement ou la couverture du sol.Les charges liées à l’utilisation des terres,définies dans l’OPD pour les surfaces donnant droit aux paiements directs,correspondent de facto à l’obligation européenne d’un entretien minimal.Les PER sont souvent plus sévères que les charges de l’UE.D’autres par contre ne sont pas comparables,mais il s’agit là de différences plutôt formelles,procédant des concepts respectifs.
■ Eléments des PER allant au-delà des exigences de l’UE
Les PER dépassent les normes de l’UE en particulier dans les domaines de la protection des animaux,de la protection des végétaux et de la compensation écologique.Les dispositions relatives au bilan de fumure,à la mise en place de bandes tampon ou le devoir de tenir un journal détaillé témoignent également de l’approche exigeante des PER.
L’obligation d’utiliser les surfaces selon l’OPD exclut le seul paillage (mulching) des surfaces,alors que de telles pratiques peuvent être autorisées au titre de l’entretien minimal par les Etats membres de l’UE.Indépendamment des PER,la Suisse limite la grandeur des cheptels pouvant donner droit aux contributions à la garde d’animaux consommant des fourrages grossiers.Les PER servent également de référence lors de l’octroi des paiements directs écologiques,ainsi que des contributions et des crédits d’investissements accordés pour des mesures individuelles dans le domaine des améliorations foncières,alors que l’UE se fonde encore,pour les mesures agro-écologiques et les mesures de compensation,sur une «bonne pratique professionnelle», généralement moins globale que l’éco-conditionnalité.
■ Différences entre l'approche européenne et les PER
Dans l'UE,des éléments du paysage déterminés doivent être préservés dans les pays membres.S'il sont supprimés,cela peut être sanctionné non seulement par une amende mais,en plus,par la réduction des paiements directs.La protection de ces structures uniquement par la législation sur la protection de la nature ne correspond pas à l’exigence européenne.En Suisse,les PER ne comprennent pas de charge spécifique à ce sujet.La protection des éléments paysagers y est réglée par d'autres instruments,ce qui rend difficile la comparaison avec l'éco-conditionnalité européenne.Une fois plantées,les haies sont protégées par la loi sur la protection de la nature et du paysage.
3.2COMPARAISONS INTERNATIONALES 3 248
Un élément-clé de la politique agro-environnementale suisse est la compensation écologique,par laquelle nous insistons sensiblement plus qu'en Europe sur la création, l'entretien et la valorisation écologique des éléments paysagers.La démarche de la Suisse,consistant à exiger,dans le cadre des PER,un pourcentage déterminé de surfaces de compensation écologique,va plus loin que celle de l'UE:ces surfaces doivent,le cas échéant,être aménagées ou affermées et rester en l’état pendant six ans au moins.En Suisse,les éléments de compensation imputables sont bien plus variés.En outre,la compensation écologique comprend en partie aussi des exigences concernant l'entretien et l'exploitation des prairies,les jachères florales et tournantes, les bandes culturales extensives,les arbres isolés,les haies,les bosquets champêtres et les berges boisées,etc.Les paiements directs écologiques sont basés sur la compensation écologique obligatoire.Certains éléments de la compensation écologique sont rémunérés par des contributions écologiques,et l'ordonnance de 2001 sur la qualité écologique vise à promouvoir la qualité et la mise en réseau des surfaces.Ainsi,le système suisse est plutôt dynamique et flexible,alors que l’approche européenne, consistant à faire l’inventaire des éléments paysagers et à assurer leur préservation,a un caractère plutôt statique.
Pour ce qui est de la protection des herbages,l'UE stipule que la part des herbages permanents à la surface agricole ne doit pas diminuer de plus de 10%.Il n'existe pas de réglementation comparable en Suisse.Elle y est moins nécessaire,car dans notre pays,le labour des surfaces herbagères n'est pas un phénomène aussi répandu que dans beaucoup d'Etats membres de l'UE.Les exigences relatives à l'éco-conditionnalité dans l'UE ne comportent pas de distinction quant à la qualité écologique de la surface herbagère.Tant que les surfaces herbagères régionales ne diminuent pas trop fortement,les surfaces ne sont pas protégées du labour,sauf si d’autres charges sont applicables,par exemple au titre de la protection de la nature.En Suisse,les surfaces herbagères peuvent être imputées comme surfaces de compensation écologique,à certaines conditions.

En ce qui concerne la protection du sol,certaines normes européennes ne sont pas expressément mentionnées en rapport avec les PER.La sauvegarde des terrasses ainsi que l'utilisation appropriée des machines,qui en Suisse ne porte pas impérativement sur l'ensemble du territoire,peuvent faire partie de plans de protection contre l'érosion.Enfin,le traitement des chaumes n’est pas non plus mentionné dans les PER.
En Suisse,les dispositions légales portant sur la désignation d'animaux,la sécurité alimentaire,l'interdiction de certaines substances dans la production animale,l'ESB et la notification de maladies ne sont pas liées à l'octroi des paiements directs.
Autre élément non comparable avec les exigences de l'UE:en Suisse,le respect de dispositions légales relatives à la protection des eaux,de l'environnement,de la nature et du paysage,applicables à l'agriculture,est une condition pour l’obtention de paiements directs,mais il ne fait pas l’objet de contrôles systématiques et uniformes en tant qu’élément des PER.
3.ASPECTSINTERNATIONAUX 3.2 COMPARAISONS INTERNATIONALES 3 249
Dans l'UE,les contrôles sont effectués par des services étatiques,sans participation financière directe des agriculteurs.L'introduction d'un système de conseil d'exploitation (vulgarisation),privé ou étatique,destiné à l’encadrement en matière d’éco-conditionnalité,ne sera obligatoire qu’à partir de 2007.Bien que ce système soit déjà susceptible d'un soutien par le 2e pilier,seuls quelques rares Etats membres y ont eu recours jusqu'à présent.En Suisse,il existe une relation plus étroite entre la vulgarisation et les contrôles,qui sont généralement effectués par des organisations privées accréditées.Les agriculteurs paient pour les contrôles et,parallèlement,ils demandent souvent aux organisations de contrôle des informations sur les pratiques agricoles conciliables avec les PER.
A la différence des PER,l'éco-conditionnalité n’a pas encore fait ses preuves dans l’UE. Les PER appliquées en Suisse montrent qu'une approche exigeante en matière d’écoconditionnalité est réalisable.
3.2COMPARAISONS INTERNATIONALES 3 250
Collaboration au rapport agricole 2005
■ Direction du projet, Werner Harder secrétariat Alessandro Rossi
Monique Bühlmann
■ Auteurs ■ Rôle et situation de l‘agriculture
L’agriculture,partie intégrante de l’économie
Alessandro Rossi
Marchés
Jacques Gerber,Simon Hasler,Katja Hinterberger,Beat Ryser,Hans-Ulrich Tagmann
Situation économique
Vinzenz Jung
Aspects sociaux
Esther Grossenbacher
Ecologie et éthologie
Brigitte Decrausaz,Ruth Badertscher,Anton Candinas,Heinz Hänni, Esther Grossenbacher,Hans-Jörg Lehmann,Olivier Roux
Appréciation de la durabilité
Brigitte Decrausaz,Esther Grossenbacher,Vinzenz Jung
■ Mesures de politique agricole
Production et ventes
Jacques Gerber
Instruments transversaux
Friedrich Brand,Jean-Marc Chappuis,Emanuel Golder,Samuel Heger
Economie laitière
Katja Hinterberger
Production animale
Simon Hasler
Production végétale
Beat Ryser,Hans-Ulrich Tagmann
Paiements directs
Thomas Maier,Janine Markwalder,Hugo Roggo,Olivier Roux,Martin Weber
251
Amélioration des bases de production
Améliorations structurelles et mesures d’accompagnement social
René Weber,Willi Riedo,Markus Wildisen
Recherche,haras,vulgarisation,formation professionnelle,CIEA
Anton Stöckli,Jacques Clément,Urs Gantner,Geneviève Gassmann,Roland Stähli
Moyens de production
Lukas Barth,Martin Huber,Alfred Klay,Albrecht Siegenthaler
Elevage
Karin Wohlfender
Section Inspectorat des finances
Rolf Enggist
Evolution future de la politique agricole
Thomas Meier
■ Aspects internationaux
Développements internationaux
Krisztina Bende,Friedrich Brand,Jean Girardin,Gisèle Jungo
Comparaisons internationales
Jean Girardin,Vinzenz Jung,Thomas Maier
■ Services de traduction Français:Christiane Bokor,Pierre-Yves Barrelet,Yvan Bourquard, Giovanna Mele,Elisabeth Tschanz,Marie-Thérèse Von Graffenried, Magdalena Zajac
Allemand:Yvonne Arnold
Italien:Patrizia Singaram,Floriana Dondina,Simona Stückrad
■ Internet Denise Vallotton
■ Soutien technique Hanspeter Leu,Peter Müller
252
ANNEXE A1 ■■■■■■■■■■■■■■■■ Annexe Tableaux Structures A2 Tableaux Marchés A4 Tableaux Résultats économiques A14 Comptes économiques de l’agriculture A14 Résultats d’exploitation A16 Tableaux Dépenses de la Confédération A27 Dépenses Production et ventes A27 Dépenses Promotion des ventes A27 Dépenses Economie laitière A28 Dépenses Economie animale A28 Dépenses Production végétale A29 Dépenses Paiements directs A30 Dépenses Amélioration des bases de production A52 Dépenses Agriculture et alimentation A58 Tableaux Aspects internationaux A59 Textes légaux,Définitions et méthodes A64 Abréviations A65 Bibliographie A67
■■■■■■■■■■■■■■■■ Tableaux Structures
A2 ANNEXE
Tableau 1
ExploitationsSurfaceagricoleutileUnitésdegrosbétail Classesdegrandeur, enhadesurface199019962004199019962004199019962004 agricoleutileNombreNombreNombrehahahaNombreNombreNombre 0-16 6295 0543 0152 8952 1231 05982 55054 58857 465 1-313 1907 1133 80423 82812 6147 04734 46622 52213 063 3-58 2596 9264 16432 24327 00416 67542 47334 35521 756 5-1018 83315 14811 365141 403113 65485 912209 784156 778108 642 10-1518 92015 90712 058233 888197 421150 220341 563273 225197 867 15-2012 71011 97010 463218 771207 194181 703290 523268 163229 941 20-256 6777 2487 085147 772161 294158 062173 896187 984189 175 25-303 3644 1434 65991 271112 886127 28597 680120 265139 458 30-402 6743 6694 57590 726124 930156 12487 709119 097158 445 40-508751 3511 75638 67259 90477 98832 21450 95671 721 50-705077281 14128 84941 22665 86123 17232 76154 608 70-10012716629410 37113 28723 7577 4149 49019 364 > 1005056877 8029 33912 8816 3156 0059 640 Total928157947964466106849010828761064574142975913361891271145 Source:OFS
Evolution des exploitations agricoles,de la surface agricole utile et des unités de gros bétail
ANNEXE A3
2
du nombre de personnes occupées dans l'agriculture CatégorieEmployésàpleintempsEmployésàtempspartielTotal 199019962004199019962004199019962004 Chef d'exploitationHommes62 72059 56044 67826 16920 83124 67088 88980 39169 348 Femmes1 4561 5054212 4701 3751 6093 9262 8802 030 Autre main-d'œuvre familialeHommes21 79613 82814 89122 72925 11816 47444 52538 94631 365 Femmes14 36722 0439 46265 77036 63447 24280 13758 67756 704 Main-d'œuvrefamilialeTotal10033996936694521171388395889995217477180894159447 Main-d'œuvre non familiale suisseHommes12 45311 4358 5632 9496 1883 89715 40217 62312 460 Femmes3 2002 8511 9503 3044 9763 3036 5047 8275 253 Main-d'œuvre étrangèreHommes10 9108 7266 8591 7584 9492 95912 66813 6759 818 Femmes6631 5281 4638473 6021 9371 5105 1303 400 Main-d'œuvrenonfamilialeTotal27226245401883588581971512096360844425530931 PersonnesoccupéesTotal12756512147688287125996103673102091253561225149190378 Source:OFS
Tableau
Evolution
■■■■■■■■■■■■■■■■ Tableaux Marchés Tableau
A4 ANNEXE
3
agricole utile selon les modes d'utilisation Produit1990/9220022003200411990/92–2002/04 hahahaha% Céréales207292173482166558161752-19.3 Céréalespanifiables102840953038841989849-11.3 Blé96 17389 34584 42885 734-10.1 Epeautre2 1602 1491 7662 249-4.9 Amidonnier,engrain 2 138181163Seigle4 4323 6281 9901 680-45.1 Méteil de blé panifiable75435423-46.7 Céréalesfourragères104453781797813971903-27.2 Orge59 69539 16139 36837 401-35.3 Avoine10 4344 0354 4163 028-63.3 Méteil de céréales fourragères23839734425839.9 Maïs-grain25 73920 50621 09818 816-21.8 Triticale8 34714 08012 91312 40057.3 Légumineuses2258437554014925117.0 Pois fourragers (pois protéagineux)2 1123 9894 9894 600114.3 Féveroles14630831124997.7 Lupins-7810176Culturessarclées36385338403302233609-8.0 Pommes de terres (plants compris)18 33313 46013 57813 335-26.6 Betteraves sucrières14 30818 17517 53918 62226.6 Betteraves fourragères3 7442 2051 9051 652-48.7 Oléagineux1820320968228802323522.8 Colza16 73014 24714 87515 751-10.6 Tournesols-5 1145 4784 996Soja1 4741 6072 5272 48849.8 Matièrespremièresrenouvelables-117512401239Colza-1 0631 1231 088Autres (kénaf,chanvre,etc.)-112117151Légumesdepleinchamp82508619839988134.4 Maïsd'ensilageetmaïsvert382044020240380424337.3 Jachèresvertesetflorales3194152382435921110.0 Autres terres ouvertes8301 8021 7711 704111.8 Terresouvertes311741288615283475281302-8.7 Prairiesartificielles9443611897812261812447429.2 Autres terres ouvertes3 9773 0902 9842 984-24.0 Totalterresouvertes410154410683409082408760-0.2 Cultures fruitières7 1626 7996 584 3 6 734-6.4 Vigne14 91915 01414 92914 9370.3 Roseaux de Chine32492392387 966.7 Prairies naturelles,pâturages638 900627 059626 446624 337-2.0 Autres utilisations,prairies à litière et tourbières 7 3949 9669 7759 56832.1 Surfaceagricoleutile1078600106977010670551064574-1.1
Surface
cultures
1 Provisoire 2 Saisie séparée depuis 2002 3Les
surfaces des
d’abricots n’ont pas été relevées intégralement pour des raisons techniques
Sources:USP,OFS,Vin:OFAG
1 provisoire
2 Moyenne des années 1990/93
3 Variation entre 1990/93 et 2001/04
Sources: Lait et produits laitiers:USP (1990–98),depuis 1999 TSM
Viande:Proviande
sarclées et oléagineux:USP
suisse
suisse de la culture maraîchère
ANNEXE A5
Production ProduitUnité1990/922002200320041990/92–2002/04 % Laitetproduitslaitiers Lait de consommationt549 810503 325494 635497 021-9.4 Crèmet68 13368 87363 99763 927-3.7 Beurret38 76642 22640 85740 6646.4 Poudre de laitt35 84454 56955 53651 04849.9 Fromaget134 400160 403160 165162 39719.8 Viandeetœufs Viande de bœuft SG130 710104 808102 789100 308-21.5 Viande de veaut SG36 65634 95134 12733 679-6.6 Viande de porct SG266 360235 736229 658227 085-13.3 Viande de moutont SG5 0655 9306 1786 59623.1 Viande de chèvret SG541481475488-11.0 Viande de chevalt SG1 2121 0901 0311 050-12.8 Viande de volaillet poids de vente20 73331 19632 35834 34157.4 Oeufs en coquillemio.d'unités6387036806526.2 Céréales Blé tendret546 733508 500428 300538 900 1 -10.0 Seiglet22 97821 50010 50011 000 1 -37.6 Orget341 774247 200217 900257 500 1 -29.5 Avoinet52 80721 50021 50015 500 1 -63.1 Maïs-graint211 047189 00090 700180 600 1 -27.3 Triticalet43 94089 80067 90083 200 1 82.7 Autrest11 46911 30010 30011 600 1 -3.5 Culturessarclées Pommes de terret750 000526 200467 900525 800 1 -32.4 Betteraves sucrièrest925 8671 407 9101 257 3001 449 000 1 48.1 Oléagineux Colzat46 11448 87045 30057 420 1 9.6 Autrest3 65820 61523 63521 112 1 495.6 Fruits(detable) Pommest91 503 2 105 64093 864100 7558.0 3 Poirest-15 08316 52917 207Abricotst3 407 2 1 8508453 370-52.6 3 Cerisest1 818 2 2 0451 7042 026-2.9 3 Prunest2 837 2 2 2143 2282 995-9.3 3 Fraisest4 2634 9805 1095 77524.1 Légumes(frais) Carottest49 16267 94254 08057 84422.0 Oignonst23 50526 81027 93932 35723.5 Céleris-ravest8 50610 3349 5988 85212.8 Tomatest21 83029 65730 05034 93144.5 Laitues pomméest18 82117 05716 11416 557-11.9 Choux-fleurst8 3316 5735 5917 441-21.6 Concombrest8 6089 2589 1459 3037.3 Vin Vin rougehl550 276546 595486 455606 909-0.7 Vin blanchl764 525565 804483 639552 261-30.2
Tableau 4
Oeufs:GalloSuisse Céréales,cultures
Fruits:Fruit-Union
Légumes:Centrale
Vin:OFAG,cantons
Production de produits laitiers
A6 ANNEXE
Tableau 5
Produit1990/922002200320041990/92–2002/04 tttt% Totalfromage13440016040316016516239719.8 Fromages frais4 38736 48637 10136 822738.9 Mozzarella-12 90613 32113 337Autres fromages frais-23 58023 78023 485Fromages à pâte molle4 8126 9496 7796 72741.7 Tommes1 2491 9131 8892 18159.7 Fromages à pâte blanche persillée,mi-gras à gras1 5731 8481 6411 3973.5 Autres fromages à pâte molle1 9903 1883 2493 14960.6 Fromages à pâte mi-dure40 55647 43546 65047 87816.7 Appenzeller8 7257 9128 0618 300-7.3 Tilsit7 7365 9775 2014 453-32.6 Fromage à raclette9 89814 13913 25613 11736.4 Autres fromages à pâte mi-dure14 19719 40720 13222 00844.5 Fromages à pâte dure84 62968 88168 92770 160-18.1 Emmentaler56 58835 53234 63233 504-38.9 Gruyère22 46424 96525 70826 72014.8 Sbrinz4 6592 4752 1471 716-54.7 Autres fromages à pâte dure9185 9096 4408 220646.9 Spécialités 1 156527088104 722.2 Totalproduitslaitiersfrais6808227054807128347269018.2 Lait de consommation549 810503 325494 635497 021-9.4 Autres131 012202 155218 199229 88081.7 Totalbeurre387664222640857406646.4 Beurre de choix27 2007 6437 2134 219-76.6 Autres11 56634 58333 64436 445201.7 Totalcrème68133688736399763927-3.7 Totalpoudredelait3584454569555365104849.9 1Fromages de brebis et de chèvre purs Sources:USP (1990–98),depuis 1999 TSM Tableau 6 Mise en valeur du lait commercialisé Produit1990/922002200320041990/92–2002/04 1000tdelait1000tdelait1000tdelait1000tdelait% Laitdeconsommation549456454456-17.1 Laittransformé24902735269927329.3 en fromage1 5311 2981 2951 323-14.7 en beurre35650649649440.1 en crème430263247247-41.3 en d'autres produits laitiers173667661668284.6 Total30393191315231874.5 Sources:USP (1990–98),depuis 1999 TSM
Tableau 7
Mise en valeur de la récolte de la production végétale
ANNEXE A7
Produit1990/922002200320041990/92–2002/04 tttt% Pommesdeterre Pommes de terre de table285 300167 400162 800162 300 1 -42.5 Pommes de terre destinées à la transformation114 700131 400116 100130 800 1 9.9 Semences35 93328 40026 70026 200 1 -24.6 Affouragement de pommes de terre fraîches225 967123 00094 100144 900 1 -46.6 Transformation en aliments pour animaux146 90068 50050 90057 000 1 -60.0 Pommesetpoiresàcidresuisses (transformationdansdescidreriesartisanales)1830062131861122032156823-30.63 Quantité de fruits à cidre pour jus brut182 424 2 131 745121 845156 597-30.5 3 fraîchement pressés10 477 2 9 90511 0399 528-8.3 3 Cidre de fruits destiné à la fabrication d'eau-de-vie de fruits3 297 2 78722598-88.9 3 Concentré de jus165 263 2 118 005109 044145 568-30.4 3 Autres jus (vinaigre compris)3 387 2 3 7571 040903-45.4 3 Fruits foulés582 2 116187226-64.2 3 Fabricationdespiritueux à base de pommes et poires suisses40 255 2 17 05619 77217 186-53.3 3 à base de cerises et prunes suisses23 474 2 10 85812 83413 329-48.8 3 Légumesfraissuissesdestinésàlafabrication dedenréesalimentaires Légumes congelés26 06125 15826 47420 059-8.3 Légumes de conserve (haricots,petits pois, carottes parisiennes)19 77612 94012 58514 532-32.5 Choucroute (choux à choucroute)8 0916 5345 3156 123-26.0 Raves d'automne1 5351 0011 003924-36.4 1 provisoire 2 Moyenne
Variation
Pommes
Fruits à cidre:OFAG;spiritueux:Régie
Légumes destinés à la transformation:Centrale suisse
culture maraîchère
des années 1990/93 3
entre 1990/93 et 2001/04 Sources:
de terre:Régie fédérale des alcools,swisspatat
fédérale des alcools
de la
A8 ANNEXE
8 Commerce extérieur Produit1990/922002200320041990/92–2002/04 tttt% Exporta-Importa-Exporta-Importa-Exporta-Importa-Exporta-Importa-Exporta-Importationstionstionstionstionstionstionstionstionstions Laitetproduitslaitiers Lait1923 0072722 83911822 3035722 640253.5-1.8 Yoghourt1 195173 80819210 64271817 033693778.03 042.8 Crème909255693491 0628821 3791 01210.42 891.0 Beurre04 1541 3061 9826531 7515986--62.1 Poudre de lait8 1583 26616 16883719 05440915 617381107.7-83.4 Fromage62 48327 32849 90731 18749 59731 86650 87531 461-19.815.3 Viande,œufsetpoissons Viande de boeuf2807 8739696 8321 0437 4741 15910 103277.53.3 Viande de veau0916056703950377--51.3 Viande de porc2881 9561768 6139011 56753413 490-7.4473.8 Viande de mouton56 48906 53706 46506 232-100.0-1.2 Viande de chèvre0403035503890339--10.5 Viande de cheval04 60004 05103 94504 211--11.5 Viande de volaille1039 94238743 70866345 97147042 5334 966.710.3 Oeufs031 401025 5041524 850127 064--17.8 Poissons,crustacés et mollusques62031 13213234 39512934 64717336 820-76.713.3 Céréales Blé6232 134126295 55028313 812107279 9011 265.827.7 Seigle03 05708 52102 06606 578-87.2 Orge43644 5043048 7541737 9855826 225-91.9-15.4 Avoine13160 8851753 513646 858144 007-94.0-21.0 Maïs-grain19460 51249539 819307121 80220679 30573.032.7 Culturessarclées Pommes de terre9 6958 7221 56526 64293733 3811 10838 357-87.6276.0 Sucre40 882124 065168 357208 693218 282245 503271 611288 462436.799.5 Oléagineux Oléagineux489134 57057971 21264272 03749983 15517.2-43.9 Huiles et graisses végétales18 68057 7651 912103 5282 090108 6862 275105 186-88.883.2 Fruits(frais) Pommes683 1 12 169 1 9059 9731 8707 72616321 34689.1 2 -4.3 2 Poires491 1 11 803 1 949 095759 1352266 480-71.4 2 -28.5 2 Abricots226 1 10 578 1 179 456218 179106 341-94.1 2 -20.5 2 Cerises256 1 1 062 1 11 251486851 094-99.0 2 3.0 2 Prunes et pruneaux12 1 3 290 1 95 233225 48424 421-29.2 2 60.1 2 Fraises15011 0231911 602710 9444511 936-84.34.3 Raisins2333 691534 293935 6011334 205-61.43.0 Agrumes161135 78075121 69934125 58238125 436-69.6-8.5 Bananes8577 896374 326372 1782873 538-86.6-5.8 Légumes(frais) Carottes711 710586 53807 197258 313-61.0329.7 Oignons8623 4441517 87205 778299 981-93.0128.7 Céleris-raves0206071902450823-188.7 Tomates40235 7002641 513740 922939 521-96.513.9 Laitues pommées373 95402 27012 44312 480-98.2-39.4 Choux-fleurs119 98509 09608 66909 231-100.0-9.9 Concombres6517 479417 184516 660115 712-94.8-5.5 Vin(detable) Vin rouge (en hl)3 4991 494 2944 9261 370 0517 0161 409 8799 9131 360 286108.2-7.6 Vin blanc (en hl)7 59076 8356 721240 7646 474196 7938 540223 089-4.5186.6 1 Moyenne des années 1990/93 2Variation entre 1990/93 et 2001/04 Sources: Lait et produits laitiers,viande,oeufs,céréales,cultures sarclées,oléagineux,fruits,légumes et vin:DGD Sucre:réservesuisse
Tableau
1 0406.1010,0406.1020,406.1090
2 0406.2010,0406.2090
3 0406.3010,0406.3090
4 0406.4010,0406.4021,0406.4029,0406.4081,0406.4089
5 0406.9011,0406.9019
6 0406.9021,0406.9031,0406.9051,0406.9091
7 0406.9039,0406.9059,0406.9060,0406.9099
ANNEXE A9
extérieur fromage Produit1990/922002200320041990/92–2002/04 tttt% Importations Fromages frais 1 4 1758 8259 1879 415119.0 Fromages râpés 2 233605634748184.3 Fromages fondus 3 2 2212 2972 2492 1921.1 Fromages à pâte persillée 4 2 2762 2432 1672 151-3.9 Fromages à pâte molle 5 6 6285 7215 7965 653-13.6 Fromages à pâte mi-dure 6 11 795 4 2344 7724 917 Fromages à pâte dure 7 7 2627 0616 385 -2.1 Totalfromagesetséré2732831187318663146115.3 Exportations Fromages frais 1 28452863 600.0 Fromages râpés 2 104947196-16.3 Fromages fondus 3 8 2454 6094 4314 895-43.7 Fromages à pâte persillée 4 011830.0 Fromages à pâte molle 5 30154175540865.6 Fromages à pâte mi-dure 6 54 102 7 2987 1247 733 Fromages à pâte dure 7 37 65837 73637 522 -16.8 Totalfromagesetséré62483499074959750875-19.8
Tableau 9 Commerce
Source:DGD
Consommation par habitant
A10 ANNEXE
10
Tableau
Produit1990/9220022003200411990/92–2002/04 kgkgkgkg% Laitetproduitslaitiers Lait de consommation104.3783.4081.4080.90-21.5 Crème6.439.208.408.3034.3 Beurre6.205.705.605.60-9.1 Fromage16.9019.6019.9019.8017.0 Fromages frais3.465.906.106.1074.4 Fromages à pâte molle1.831.901.901.802.0 Fromages à pâte mi-dure5.655.805.705.701.5 Fromages à pâte dure5.966.006.206.202.9 Viandeetœufs Viande de bœuf13.7110.6410.1510.23-24.6 Viande de veau4.253.763.673.54-14.0 Viande de porc29.7325.4825.1524.80-15.4 Viande de mouton1.421.461.471.473.3 Viande de chèvre0.120.100.100.10-16.7 Viande de cheval0.750.620.600.63-17.8 Viande de volaille8.059.7110.099.9723.3 Oeufs en coquille (unités)199190183182-7.0 Céréales Articles de boulangerie et de pâtisserie50.7051.2050.3050.700.1 Culturessarclées Pommes de terre et produits à base de pommes de terre44.1743.0844.7241.10-2.7 Sucre (y compris sucre dans des produits transformés) 42.3748.2954.7856.8025.8 Oléagineux Huiles et graisses végétales12.8015.8416.1316.3025.7 Fruits(detable) Pommes15.26 2 15.7113.5316.43-2.4 3 Poires-3.303.473.16Abricots2.04 2 1.551.221.31-32.9 3 Cerises0.39 2 0.450.350.420.0 3 Prunes et pruneaux0.91 2 1.021.181.0017.5 3 Fraises2.242.272.182.381.6 Agrumes20.0916.6617.0316.90-16.1 Bananes11.5310.1810.089.91-12.8 Légumes(frais) Carottes7.5310.198.318.9121.4 Oignons3.864.734.575.7029.4 Céleris-raves1.291.511.341.307.2 Tomates8.469.759.6310.0315.8 Laitues pommées3.372.652.522.57-23.4 Choux-fleurs2.712.151.932.25-22.2 Concombres2.972.902.772.80-4.9 Vin Vin rouge (en l)31.9727.4327.1226.33-15.7 Vin blanc (en l)14.4712.2511.6611.78-17.8 Total vin (en l)46.4339.6838.7838.11-16.3 1 chiffres en partie provisoires 2 Moyenne des années 1990/93 3 Variation entre 1990/93 et 2001/04 Sources: Lait et produits laitiers,œufs,cultures sarclées,céréales et oléagineux:USP Viande:Proviande Fruits,légumes et vin:OFAG
Tableau 11
Prix à la production
1 Moyenne des années 1990/93
2 Variation entre 1990/93 et 2001/04
3 Prix franco abattoir,excepté porcs charnus départ ferme,GQ:gestion de la qualité viande suisse
4 Prix non applicable aux quantités excédentaires
Sources:
Lait:OFAG
Bétail de boucherie,volaille,œufs:USP
Céréales,cultures sarclées et oléagineux:FAT
Fruits:Fruit-Union suisse,Interprofession des fruits et légumes du Valais
Légumes:Centrale suisse de la culture maraîchère
ANNEXE A11
ProduitUnité1990/922002200320041990/92–2002/04 % Lait CH totalRp./kg104.9778.3975.5474.63-27.4 Lait transformé en fromage (à partir de 1999)Rp./kg-78.5675.1673.84Lait biologique (à partir de 1999)Rp./kg-93.1789.2185.45Bétaildeboucherie3 Vaches T3fr./ kg poids mort7.824.585.786.62-27.6 Jeunes vaches T3fr./ kg poids mort8.135.316.487.12-22.4 Taureaux T3fr./ kg poids mort9.287.288.198.17-15.1 Bœufs T3fr./ kg poids mort9.837.268.188.14-20.0 Génisses T3fr./ kg poids mort8.666.897.898.07-12.0 Veaux T3fr./ kg poids mort14.3911.8212.1512.61-15.3 Porcs à viande,depuis 2003 GQfr./ kg poids mort5.834.244.474.54-24.2 Agneaux jusqu'à 40 kg,T3fr./ kg poids mort15.4012.6111.5310.21-25.6 Volailleetœufs Poulets cl.I,à la fermefr./ kg poids vif3.722.722.722.67-27.3 Oeufs issus d'un élevage au sol,au magasinfr./100 St.41.0235.4636.0036.06-12.6 Oeufs issus d'un élevage avec parcours,au magasinfr./100 St.46.2149.1942.6742.24-3.3 Céréales Bléfr./100 kg99.3456.5761.1357.84-41.4 Seiglefr./100 kg102.3646.6846.7643.99-55.2 Orgefr./100 kg70.2444.9145.8244.26-35.9 Avoinefr./100 kg71.4045.1347.8444.67-35.7 Triticalefr./100 kg70.6945.7445.4944.90-35.8 Maïs-grainfr./100 kg73.5444.7346.3143.31-39.1 Culturessarclées Pommes de terrefr./100 kg38.5535.0136.2133.38-9.5 Betteraves sucrièresfr./100 kg14.8411.6111.8711.85-20.6 Oléagineux Colzafr./100 kg203.6778.6181.6976.60-61.2 Tournesolsfr./100 kg-84.5985.7383.74Fruits Pommes:Golden Delicious IFr./ kg1.12 1 0.821.211.06 4 -7.8 2 Pommes:Maigold IFr./ kg1.35 1 0.951.401.21 4 -12.6 2 Poires:ConférenceFr./ kg1.33 1 0.921.240.98 4 -19.0 2 AbricotsFr./ kg2.09 1 2.102.802.0927.8 2 CerisesFr./ kg3.20 1 3.403.403.507.8 2 Prunes:FellenbergFr./ kg1.40 1 1.951.701.5525.7 2 FraisesFr./ kg4.774.805.405.6010.4 Légumes Carottes (de garde)fr./ kg1.091.281.371.2619.6 Oignons (de garde)fr./ kg0.891.211.061.1929.6 Céleris-raves (de garde)fr./ kg1.622.242.222.4441.7 Tomates rondesfr./ kg2.422.322.412.37-2.2 Laitues pomméesfr./ kg2.373.053.663.4342.6 Choux-fleursfr./ kg1.852.222.672.1326.5 Concombres pour la saladefr./ kg1.661.972.202.1927.7
Prix à la consommation
1 Moyenne des années 1990/93
2 Variation entre 1990/93 et 2001/04 Sources:
Lait,viande (panier viande produite sous label et traditionnelle):OFAG
Production végétale et produits végétaux:OFAG,OFS
A12 ANNEXE
Tableau 12
ProduitUnité1990/922002200320041990/92–2002/04 % Laitetproduitslaitiers Lait entier pasteurisé,emballéfr./l1.851.561.531.54-16.6 Lait «drink» pasteurisé,emballéfr./l1.851.561.531.52-16.9 Lait écrémé UHTfr./l-1.451.461.40Emmentalfr./ kg20.1520.3320.8919.931.2 Gruyèrefr./ kg20.4020.8821.0220.542.0 Tilsitfr./ kg-17.7817.8617.34Camembert 45% (ES)125 g-2.812.862.86Fromage à pâte molle,croûte fleurie150 g-3.633.673.67Mozzarella 45% (ES)150 g-2.402.342.20Beurre de choix200 g3.463.193.193.14-8.3 Le beurre (beurre de cuisine)250 g3.443.062.992.96-12.7 Crème entière,emballée 1⁄2 l-4.924.804.50Crème à café,emballée 1⁄2 l-2.542.482.41Yoghourt,aromatisé ou contenant des fruits180 g0.890.700.700.68-22.1 Viandedebœuf Entrecôtes,en tranchesfr./ kg48.3651.1653.3955.7410.5 Steakfr./ kg37.5939.6641.7343.4210.7 Rôti d'épaulefr ./kg26.3426.3527.1628.563.9 Viande hachéefr./ kg15.0015.6316.6517.029.6 Viandedeveau Côtelettes,coupéesfr./ kg35.3241.4941.3042.5818.3 Rôti d'épaulefr./ kg32.5634.5035.1436.368.5 Ragoûtfr./ kg21.6729.0729.7631.4638.9 Viandedeporc Côtelettes,coupéesfr./ kg19.8820.4021.3220.494.3 Steakfr./ kg24.4827.3827.7028.0013.1 Rôti d'épaulefr./kg18.4319.3519.9020.347.8 Ragoût d'épaulefr./ kg16.6918.3419.2219.6014.2 Vianded'agneausuisse,fraîche Gigot sans l'os du bassinfr./ kg26.3428.6829.4828.729.9 Côtelettes,coupéesfr./ kg30.3235.7537.2837.0521.0 Produitscarnés Jambon de derrière moulé,coupéfr./ kg25.5630.2429.9931.1419.2 Salami suisse I,en tranchesfr./100 g3.093.914.004.3632.3 Poulets suisses,fraisfr./ kg8.419.358.909.018.0 Productionvégétaleetproduitsvégétaux Farine fleurfr./ kg2.051.601.711.78-17.2 Pain bisfr./500 g2.081.781.811.79-13.8 Pain mi-blancfr./500 g2.091.741.801.82-14.5 Petits painsfr./ St.0.620.710.740.7518.0 Croissantsfr./ pce0.710.850.880.8923.0 Spaghettisfr./500 g1.661.691.711.702.5 Pommes de terrefr./ kg1.432.082.162.2350.9 Sucre cristalliséfr./ kg1.651.471.591.59-6.1 Huile de tournesolfr./l5.053.884.304.89-13.7 Fruits(suissesetétrangers) Pommes:Golden Deliciousfr./ kg3.15 1 3.813.674.0418.5 2 Poiresfr./ kg3.25 1 3.603.693.7611.6 2 Abricotsfr./ kg3.93 1 5.486.296.1749.3 2 Cerisesfr./ kg7.35 1 8.758.9710.0129.9 2 Prunesfr./ kg3.42 1 3.974.363.8918.8 2 Fraisesfr./ kg8.6910.4710.9610.5722.7 Légumes(consommationàl'étatfrais,suissesetétrangers) Carottes (de garde)fr./ kg1.912.092.262.1613.5 Oignons (de garde)fr./ kg1.862.562.392.2829.6 Céleris-raves (de garde)fr./ kg3.144.103.944.2130.1 Tomates rondesfr./ kg3.733.753.673.29-4.3 Laitues pomméesfr./ kg4.461.691.961.75-59.6 Choux-fleursfr./ kg3.584.024.413.6312.3 Concombres pour la saladefr./ kg2.803.604.453.9042.3
Totaldenréesalimentaires,entermesdevaleur872626362-10
1 Produits de meunerie et blé germé sur pied compris,sans les tourteaux;les modifications des réserves ne sont pas prises en considération
2 Blé dur,avoine,orge et maïs compris
3 Pommes,poires,cerises,pruneaux et prunes,abricots et pêches
4 Part de la production suisse au poids de la viande prête à la vente et des produits carnés
5 Viande chevaline et caprine,lapins,gibier,poissons,crustacés et mollusques compris
6 Energie digestible en joules,boissons alcoolisées comprises
7 Sans les produits animaux à base d'aliments pour animaux importés
8 Valeur calculée en prix au producteur,pour la production suisse,et aux prix selon la statistique commerciale,pour les importations (franco frontière non dédouanés) Source:USP
ANNEXE A13
d’autosuffisance Produit1990/922001200220031990/92–2001/03 % Partentermesdevolume:%%%% Céréales panifiables 1181028278-31 Céréales fourragères 1 616967491 Totalcéréales264645946-8 Pommes de terre de table101939483-11 Sucre464761445 Graisses végétales,huiles22202019-2 Fruits 3 72717665-1 Légumes55535451-2 Lait de consommation 979797980 Beurre 898898975 Fromage 137122113113-21 Totallaitetproduitslaitiers110107108109-2 Viande de veau 4 979898981 Viande de bœuf 4 93968991-1 Viande de porc 4 99969594-4 Viande de mouton 4 393941422 Volaille 4 374043435 Viandedetoutessortes4,576717070-6 Oeufs et conserves d'œufs444747473 Parténergétique6: Denrées alimentaires végétales 43404439-2 Denrées alimentaires animales, brut 97949595-2 Totaldenréesalimentaires,brut60586156-2 Total denrées alimentaires,net 7 58535550-5
Tableau 13 Taux
■■■■■■■■■■■■■■■■ Tableaux Résultats économiques
Tableau 14
Production de la branche agricole aux prix de base courants,en 1 000 fr.
A14 ANNEXE
Produit1990/9220022003200411990/92–200522002/04–2002/042005 %% Productiondedenréesagricoles13089023953905592111839641262-27.79044208-4.4 Productionvégétale5915309453326542031264522136-25.34201525-4.9 Céréales (semences comprises)1 116 180504 783412 827492 934-57.9440 747-6.3 Blé543 264279 105246 403285 716-50.2253 875-6.1 Orge306 591102 00589 53798 396-68.587 290-9.7 Maïs-grain153 80369 12435 15565 941-63.163 91312.6 Autres céréales112 52254 54941 73242 881-58.835 669-23.1 Plantes industrielles261 445289 201277 046301 89610.7270 650-6.5 Oléagineux et fruits oléagineux (semences comprises)96 23085 49188 54694 756-6.985 657-4.4 Plantes protéagineuses (semences comprises)10 28212 83015 85514 55640.214 088-2.3 Tabac brut16 94522 50023 89919 91630.518 407-16.7 Betteraves sucrières136 590164 486144 352168 42316.5148 271-6.8 Autres plantes industrielles1 3983 8944 3944 245198.94 2271.2 Plantes fourragères1 833 6231 199 0951 072 5421 240 710-36.11 051 554-10.2 Maïs fourrager210 59798 194117 426118 387-47.1114 9033.2 Plantes sarclées fourragères31 76113 32211 96411 385-61.59 125-25.3 Autres plantes fourragères1 591 2641 087 579943 1521 110 938-34.2927 526-11.4 Produits maraîchers et horticoles1 237 6051 355 6571 331 7271 275 4296.71 255 207-5.0 Légumes frais387 355503 967548 192520 10635.3509 892-2.7 Plantes et fleurs850 250851 690783 535755 323-6.3745 315-6.5 Pommes de terre (plants compris)276 669187 636181 001170 617-35.0166 736-7.2 Fruits701 314556 475524 795600 073-20.1565 1010.8 Fruits frais323 630310 523311 041344 804-0.5311 574-3.3 Raisins377 683245 952213 754255 269-36.9253 5276.4 Vin465 258418 009386 078420 537-12.3431 2625.6 Autres produits végétaux23 21422 40917 11019 940-14.620 2682.3 Productionanimale7173714500579050080575119126-29.74842683-4.0 Bovins1 743 669951 6511 048 5871 149 232-39.81 088 6563.7 Porcs1 517 1881 033 3011 062 8521 082 658-30.2974 889-8.0 Equidés15 0027 8806 5245 361-56.13 624-45.0 Moutons et chèvres62 47159 79655 00354 297-9.846 639-17.3 Volaille180 626193 510200 539209 07111.3192 391-4.3 Autres animaux32 12917 76817 46917 671-45.117 362-1.6 Lait3 396 1492 546 3602 420 6902 414 166-27.62 334 085-5.1 Oeufs211 437188 685186 866177 526-12.8177 463-3.7 Autres produits animaux15 0456 8399 5279 144-43.57 574-10.9 Productiondeservicesagricoles425198559702636129655787-6667208.0 Prestations de services agricoles425 198523 909596 166615 85736.1627 0298.4 Location de contingents laitiers035 79339 96339 930-39 6912.9 Productionagricole1351422110098757984731210297049-25.49710928-3.7 Activitésaccessoiresnonagricoles (nonséparables)355464281826267004294590-20.92844061.2 Transformation de produits agricoles276 878183 406171 745193 203-34.0183 8420.6 Autres activités accessoires non séparables (biens et services)78 58698 42095 259101 38725.2100 5642.2 Productiondelabrancheagricole13869686103805831011431610591639-25.39995334-3.5 1Provisoire,état au 9 septembre 2005 2 Estimation,état au 9 septembre 2005 De légers écarts par rapport à la banque de données de l’OFS en raison de l’arrondissement des chiffres sont possiblesSource:OFS
provisoires,état au 9 septembre 2005
Estimation,état au 9 septembre 2005
est désigné comme bénéfice net d'entreprise dans la littérature et dans la méthodologie Eurostat
légers écarts par rapport à la banque de données de l’OFS en raison de l’arrondissement des chiffres sont possiblesSource:OFS
ANNEXE A15 Tableau 15 Comptes économiques de l'agriculture,aux prix courants,en 1 000 fr. Produit1990/9220022003200411990/92–200522002/04–2002/042005 %% Productiondelabrancheagricole13869686103805831011431610591639-25.39995334-3.5 Consommationspréliminaires,total6627403601017960906966193416-8.05970805-2.1 Semences et plants346 577313 900319 567279 480-12.2276 576-9.1 Energie,lubrifiants334 723378 790385 041410 05116.9417 6796.7 Engrais et produits d'amendement du sol250 334154 738169 438179 385-32.9181 4468.1 Produits de traitement des plantes et pesticides138 587131 820127 863125 684-7.3127 818-0.5 Vétérinaire et médicaments156 121159 764170 519181 6429.3182 3966.9 Aliments3 654 3542 758 8942 656 5542 714 285-25.82 477 364-8.6 Entretien de machines et d'appareils353 833420 431436 734460 26324.1460 7744.9 Entretien d'installations de construction119 443158 219186 126193 99650.2194 3998.3 Prestations de services agricoles425 198559 702636 129655 78745.2666 7208.0 Autres biens et services848 232973 9211 002 725992 84316.7985 633-0.4 Valeurajoutéebruteauxprixdebase7242283437040440236204398223-41.14024529-5.6 Consommation de capital fixe2 014 6341 924 6541 919 0861 935 737-4.41 972 7072.4 Biens d'équipement1 013 2171 027 0011 033 0311 055 3142.51 072 6333.3 Constructions915 779783 177769 936763 902-15.7779 0510.9 Plantations82 09598 40898 32696 08818.997 491-0.1 Autres3 54316 06817 79320 433410.923 53230.0 Valeurajoutéenetteauxprixdebase5227649244575021045342462486-55.32051822-12.2 Autres impôts sur la production43 606328 174335 258333 481662.1331 739-0.2 + Autres subventions (non liées à la production)878 2112 708 7972 693 7032 750 304209.42 712 029-0.2 Revenudesfacteurs6062254482637344629794879309-22.14432112-6.2 Rémunération des salariés1 233 8401 124 6881 150 5491 153 222-7.41 147 5590.4 Excédentnetd'exploitation/ revenudel'activitéindépendante4828414370168533124303726087-25.93284553-8.3 Fermages à payer192 569202 526200 441199 3514.3199 439-0.7 Intérêts de la dette à payer552 714393 038326 225308 811-38.0309 416-9.7 Revenunetd'entreprise34083131310612127857643217925-25.62775698-8.6 1Chiffres
2
3
De
Tableau 16
Résultats d'exploitation:toutes régions confondues
Revenudutravailparunitédemain-d'œuvrefamiliale12fr./UTAF294652741727420333563670424.9 (médiane)
1Service de dette au taux moyen des obligations de la Confédération (1990:6.40%;1991:6.23%;1992:6.42%;2001:3.36%;2002:3.22%;2003:2.63%;2004:2.73%)
2Investissements bruts (sans prestations propres),moins les subventions et les désinvestissements
3Formation de capital propre (sans prestations propres pour investissements),plus amortissements plus/moins changements stocks et actif bétail
4Cash flow / total des investissements
5Part d'exploitations avec cash flow > total des investissements
6Part des capitaux étrangers < 50% et formation positive de capital propre
7Part des capitaux étrangers > 50% et formation positive de capital propre
8Part des capitaux étrangers < 50% et formation négative de capital propre
9Part des capitaux étrangers > 50% et formation négative de capital propre
10(Service de dette plus bénéfice/perte calculés plus intérêts sur le capital propre) / actifs de l'exploitation
11(bénéfice/perte calculés plus intérêts sur le capital propre) / capital propre de l'exploitation
12(revenu agricole moins intérêts sur le capital propre de l'exploitation) / unités de travail annuel de la famille
A16 ANNEXE
ParamètreUnité1990/9220012002200320042001/03–2004 % Exploitations de référencenombre4 302 3 067 2 379 2 663 3 077 13.8 Exploitations retenuesnombre62 921 52 470 51 421 50 516 50 976 -1.0 Structured'exploitation Surface agricole utileha16.06 19.10 19.38 19.10 19.25 0.3 Terres ouvertesha4.90 5.17 5.25 4.76 4.84 -4.3 Unités de main-d'œuvre dans l'exploitationUTA1.88 1.68 1.65 1.62 1.63 -1.2 dont:main-d'œuvre familialeUTAF1.39 1.29 1.28 1.24 1.25 -1.6 Total vachesnombre12.9 14.0 13.9 13.6 13.5 -2.4 Nombre total des animauxUGB23.2 24.7 24.6 22.9 23.1 -4.0 Structureducapital Actif totalfr.606 321 732 058 734 566 749 781 771 195 4.4 dont:actifs circulants totalfr.116 932 140 469 133 572 133 220 135 366 -0.3 dont:actif bétail total fr.60 662 45 448 43 507 46 012 48 205 7.1 dont:immobilisations totalfr.428 727 546 141 557 487 570 549 587 624 5.3 dont:actifs de l'exploitationfr.558 933 680 487 692 767 702 760 726 323 5.0 Ratio d'endettement %43 41 41 43 44 5.6 Intérêts sur le capital propre de l'exploitation 1 fr.19 808 13 319 12 880 10 383 11 028 -9.6 Comptederésultats Rendement brutfr.184 762 192 972 194 365 203 189 215 341 9.4 dont paiements directsfr.13 594 43 162 45 630 47 046 47 485 4.9 Coûts d'exploitationfr.91 735 114 173 117 279 123 272 128 875 9.0 Revenu d'exploitationfr.93 027 78 799 77 086 79 917 86 466 10.0 Frais de personnelfr.13 775 12 097 11 661 11 978 13 081 9.8 Service de la dettefr.11 361 8 492 8 411 7 309 7 095 -12.1 Intérêts du fermagefr.5 069 5 776 5 514 5 601 5 818 3.3 Charges réellesfr.121 941 140 539 142 865 148 160 154 868 7.7 Revenu agricolefr.62 822 52 434 51 500 55 029 60 472 14.1 Revenu extra-agricolefr.16 264 18 633 18 577 21 210 21 557 10.7 Revenu totalfr.79 086 71 067 70 077 76 238 82 030 13.2 Consommation privéefr.59 573 63 779 63 237 62 896 66 440 5.0 Formation de capital proprefr.19 513 7 288 6 840 13 343 15 590 70.3 Investissementsetfinancement Investissements total 2 fr.46 914 47 469 43 695 47 580 51 261 10.8 Cash flow 3 fr.44 456 39 389 41 177 45 285 46 392 10.6 Rapport entre cash flow et investissements 4 %95 83 94 95 91 0.4 Exploitations avec excédent de financement 5 %66 60 66 69 66 1.5 Stabilitéfinancière bonne situation financière%52 42 41 45 46 7.8 autonomie financière restreinte 7 %26 17 18 23 25 29.3 revenu insuffisant%10 22 22 17 14 -31.1 situation financière précaire 9 %12 19 20 15 14 -22.2 Relationrevenudel'exploitation/facteursutilisés Revenu d'exploitation par unité de main-d'œuvrefr./UTA49 473 47 027 46 648 49 356 53 174 11.5 Revenu d'exploitation par ha de SAUfr./ ha5 796 4 125 3 977 4 185 4 491 9.7 Rapport revenu d'exploitation / actifs de l'exploitation%16.7 11.6 11.1 11.4 11.9 4.7 Rentabilité Rentabilité du capital total 10 %0.8 -2.7 -2.9 -2.3 -1.6 -39.2 Rentabilité du capital propre 11 %-2.2 -6.8 -7.0 -5.9 -4.7 -28.4 Revenudutravailparunitédemain-d'œuvrefamiliale12fr./UTAF310253035630262358863967623.3 (moyenne)
(UTAF)Source:Agroscope FAT Tänikon
Tableau 17
Résultats d'exploitation:région de plaine*
1Service de dette au taux moyen des obligations de la Confédération (1990:6.40%;1991:6.23%;1992:6.42%;2001:3.36%;2002:3.22%;2003:2.63%;2004:2.73%)
2Investissements bruts (sans prestations propres),moins les subventions et les désinvestissements
3Formation de capital propre (sans prestations propres pour investissements),plus amortissements plus/moins changements stocks et actif bétail
4Cash flow / total des investissements
5Part d'exploitations avec cash flow > total des investissements
6Part des capitaux étrangers < 50% et formation positive de capital propre
7Part des capitaux étrangers > 50% et formation positive de capital propre
8Part des capitaux étrangers < 50% et formation négative de capital propre
9Part des capitaux étrangers > 50% et formation négative de capital propre
10(Service de dette plus bénéfice/perte calculés plus intérêts sur le capital propre) / actifs de l'exploitation
11(bénéfice/perte calculés plus intérêts sur le capital propre) / capital propre de l'exploitation
12(revenu agricole moins intérêts sur le capital propre de l'exploitation) / unités de travail annuel de la famille (UTAF)
*Région de plaine:zone de grandes cultures et zones intermédiaires
Source:Agroscope FAT Tänikon
ANNEXE A17
ParamètreUnité1990/9220012002200320042001/03–2004 % Exploitations de référencenombre2 356 1 376 1 006 1 219 1 435 19.6 Exploitations retenuesnombre29 677 24 183 23 072 22 533 23 059 -0.9 Structured'exploitation Surface agricole utileha16.66 19.93 20.68 19.79 20.07 -0.3 Terres ouvertesha8.34 9.26 9.82 8.77 8.88 -4.3 Unités de main-d'œuvre dans l'exploitationUTA2.05 1.77 1.78 1.68 1.70 -2.5 dont:main-d'œuvre familialeUTAF1.36 1.26 1.25 1.19 1.21 -1.9 Total vachesnombre12.8 13.8 13.8 13.7 13.7 -0.5 Nombre total des animauxUGB22.9 24.7 25.1 23.7 24.0 -2.0 Structureducapital Actif totalfr.706 406 832 078 852 833 849 670 866 584 2.6 dont:actifs circulants totalfr.149 871 172 076 168 801 160 321 161 665 -3.2 dont:actif bétail total fr.61 461 45 969 44 560 46 513 48 325 5.8 dont:immobilisations totalfr.495 074 614 033 639 472 642 837 656 594 3.9 dont:actifs de l'exploitationfr.642 757 773 158 797 415 793 919 814 884 3.4 Ratio d'endettement %41 40 41 43 44 6.5 Intérêts sur le capital propre de l'exploitation 1 fr.23 633 15 362 14 923 11 760 12 331 -12.0 Comptederésultats Rendement brutfr.225 249 233 144 242 450 247 188 263 974 9.6 dont paiements directsfr.7 248 38 399 40 791 40 265 41 563 4.4 Coûts d'exploitationfr.110 193 135 711 143 609 150 032 156 663 9.5 Revenu d'exploitationfr.115 056 97 433 98 841 97 157 107 311 9.7 Frais de personnelfr.20 784 17 349 17 799 16 905 18 517 6.7 Service de la dettefr.13 463 9 835 10 147 8 717 8 450 -11.7 Intérêts du fermagefr.7 015 7 796 7 493 7 405 7 729 2.2 Charges réellesfr.151 456 170 690 179 048 183 059 191 359 7.7 Revenu agricolefr.73 794 62 453 63 402 64 129 72 615 14.7 Revenu extra-agricolefr.16 429 17 043 16 743 20 642 20 532 13.2 Revenu totalfr.90 223 79 496 80 145 84 771 93 146 14.3 Consommation privéefr.67 985 70 993 71 999 70 092 73 335 3.2 Formation de capital proprefr.22 238 8 503 8 146 14 679 19 811 89.7 Investissementsetfinancement Investissements total 2 fr.56 951 52 828 50 533 51 053 56 403 9.6 Cash flow 3 fr.52 079 45 267 47 438 51 149 54 643 14.0 Rapport entre cash flow et investissements 4 %92 86 94 100 97 3.9 Exploitations avec excédent de financement 5 %64 61 65 68 66 2.1 Stabilitéfinancière bonne situation financière%52 42 41 43 46 9.5 autonomie financière restreinte 7 %24 17 15 23 27 47.3 revenu insuffisant%12 23 23 18 13 -39.1 situation financière précaire 9 %12 18 21 16 15 -18.2 Relationrevenudel'exploitation/facteursutilisés Revenu d'exploitation par unité de main-d'œuvrefr./UTA56 050 55 134 55 395 57 708 63 131 12.6 Revenu d'exploitation par ha de SAUfr./ ha6 908 4 889 4 779 4 909 5 348 10.1 Rapport revenu d'exploitation / actifs de l'exploitation%17.9 12.6 12.4 12.2 13.2 6.5 Rentabilité Rentabilité du capital total 10 %2.1 -1.3 -1.3 -1.0 -0.2 -83.3 Rentabilité du capital propre 11 %0.0 -4.4 -4.4 -3.7 -2.2 -47.2 Revenudutravailparunitédemain-d'œuvrefamiliale12fr./UTAF369243752338758439484991624.6 (moyenne)
Revenudutravailparunitédemain-d'œuvrefamiliale12fr./UTAF361863467135855426024815527.7 (médiane)
Tableau 18
Résultats d'exploitation:région des collines*
Revenudutravailparunitédemain-d'œuvrefamiliale12fr./UTAF295202660425797308113436023.9 (médiane)
1Service de dette au taux moyen des obligations de la Confédération (1990:6.40%;1991:6.23%;1992:6.42%;2001:3.36%;2002:3.22%;2003:2.63%;2004:2.73%)
2Investissements bruts (sans prestations propres),moins les subventions et les désinvestissements
3Formation de capital propre (sans prestations propres pour investissements),plus amortissements plus/moins changements stocks et actif bétail
4Cash flow / total des investissements
5Part d'exploitations avec cash flow > total des investissements
6Part des capitaux étrangers < 50% et formation positive de capital propre
7Part des capitaux étrangers > 50% et formation positive de capital propre
8Part des capitaux étrangers < 50% et formation négative de capital propre
9Part des capitaux étrangers > 50% et formation négative de capital propre
10(Service de dette plus bénéfice/perte calculés plus intérêts sur le capital propre) / actifs de l'exploitation
11(bénéfice/perte calculés plus intérêts sur le capital propre) / capital propre de l'exploitation
12(revenu agricole moins intérêts sur le capital propre de l'exploitation) / unités de travail annuel de la famille (UTAF)
*Région des collines:zone des collines et zone de montagne ISource:Agroscope FAT Tänikon
A18 ANNEXE
ParamètreUnité1990/9220012002200320042001/03–2004 % Exploitations de référencenombre1 125 907 698 745 846 8.0 Exploitations retenuesnombre17 397 14 343 13 946 14 062 14 013 -0.7 Structured'exploitation Surface agricole utileha15.30 17.95 18.09 18.48 18.52 1.9 Terres ouvertesha3.08 3.04 2.85 2.82 2.77 -4.6 Unités de main-d'œuvre dans l'exploitationUTA1.81 1.60 1.54 1.58 1.54 -2.1 dont:main-d'œuvre familialeUTAF1.40 1.26 1.24 1.26 1.23 -1.9 Total vachesnombre14.4 15.8 16.0 15.0 15.1 -3.2 Nombre total des animauxUGB26.0 27.8 27.9 24.8 25.3 -5.7 Structureducapital Actif totalfr.553 876 686 002 685 062 716 978 739 401 6.2 dont:actifs circulants totalfr.95 672 122 814 110 023 117 869 118 553 1.4 dont:actif animal total fr.66 366 49 611 48 151 49 785 53 082 7.9 dont:immobilisations totalfr.391 838 513 577 526 888 549 325 567 766 7.1 dont:actifs de l'exploitationfr.516 933 628 230 650 611 674 799 698 926 7.3 Ratio d'endettement %46 44 44 45 46 3.8 Intérêts sur le capital propre de l'exploitation 1 fr.17 271 11 653 11 650 9 549 10 213 -6.7 Comptederésultats Rendement brutfr.170 201 178 588 179 713 186 427 196 665 8.3 dont paiements directsfr.15 415 41 649 43 917 46 494 46 540 5.7 Coûts d'exploitationfr.85 602 108 086 111 844 113 382 119 831 7.9 Revenu d'exploitationfr.84 599 70 502 67 870 73 045 76 834 9.0 Frais de personnelfr.9 943 9 655 8 446 9 488 10 005 8.8 Service de la dettefr.10 915 8 265 8 045 7 120 6 913 -11.5 Intérêts du fermagefr.3 903 5 086 5 121 4 996 5 174 2.1 Charges réellesfr.110 363 131 092 133 456 134 985 141 923 6.6 Revenu agricolefr.59 838 47 496 46 257 51 442 54 742 13.1 Revenu extra-agricolefr.14 544 20 557 19 369 21 671 22 167 8.0 Revenu totalfr.74 382 68 053 65 626 73 114 76 909 11.6 Consommation privéefr.55 272 61 333 60 218 59 442 63 851 5.8 Formation de capital proprefr.19 110 6 720 5 408 13 672 13 058 51.8 Investissementsetfinancement Investissements total 2 fr.41 428 47 007 40 781 54 334 53 676 13.3 Cash flow 3 fr.41 445 37 263 39 152 43 742 42 906 7.1 Rapport entre cash flow et investissements 4 %100 79 96 81 80 -6.3 Exploitations avec excédent de financement 5 %68 58 68 69 66 1.5 Stabilitéfinancière bonne situation financière 6 %50 43 39 44 45 7.1 autonomie financière restreinte 7 %30 19 20 26 27 24.6 revenu insuffisant 8 %8 18 22 15 13 -29.1 situation financière précaire 9 %12 20 20 15 15 -18.2 Relationrevenudel'exploitation/facteursutilisés Revenu d'exploitation par unité de main-d'œuvrefr./UTA46 654 44 191 44 049 46 211 49 769 11.0 Revenu d'exploitation par ha de SAUfr./ ha5 533 3 927 3 753 3 954 4 149 7.0 Rapport revenu d'exploitation / actifs de l'exploitation%16.4 11.2 10.4 10.8 11.0 1.9 Rentabilité Rentabilité du capital total 10 %0.4 -3.3 -3.5 -3.0 -2.3 -29.6 Rentabilité du capital propre 11 %-3.3 -8.4 -8.5 -7.5 -6.1 -25.0 Revenudutravailparunitédemain-d'œuvrefamiliale12fr./UTAF303352845827817332093619721.4 (moyenne)
Tableau 19
Résultats d'exploitation:région de montagne*
1Service de dette au taux moyen des obligations de la Confédération (1990:6.40%;1991:6.23%;1992:6.42%;2001:3.36%;2002:3.22%;2003:2.63%;2004:2.73%)
2Investissements bruts (sans prestations propres),moins les subventions et les désinvestissements
3Formation de capital propre (sans prestations propres pour investissements),plus amortissements plus/moins changements stocks et actif bétail
4Cash flow / total des investissements
5Part d'exploitations avec cash flow > total des investissements
6Part des capitaux étrangers < 50% et formation positive de capital propre
7Part des capitaux étrangers > 50% et formation positive de capital propre
8Part des capitaux étrangers < 50% et formation négative de capital propre
9Part des capitaux étrangers > 50% et formation négative de capital propre
10(Service de dette plus bénéfice/perte calculés plus intérêts sur le capital propre) / actifs de l'exploitation
11(bénéfice/perte calculés plus intérêts sur le capital propre) / capital propre de l'exploitation
12(revenu agricole moins intérêts sur le capital propre de l'exploitation) / unités de travail annuel de la famille (UTAF)
*Région de montagne:zones de montagne II à IV
Source:Agroscope FAT Tänikon
ANNEXE A19
ParamètreUnité1990/9220012002200320042001/03–2004 % Exploitations de référencenombre821 784 675 699 796 10.7 Exploitations retenuesnombre15 847 13 944 14 403 13 921 13 904 -1.3 Structured'exploitation Surface agricole utileha15.76 18.85 18.55 18.60 18.63 -0.2 Terres ouvertesha0.44 0.26 0.25 0.24 0.23 -8.0 Unités de main-d'œuvre dans l'exploitationUTA1.63 1.60 1.55 1.55 1.59 1.5 dont:main-d'œuvre familialeUTAF1.42 1.38 1.35 1.31 1.33 -1.2 Total vachesnombre11.4 12.4 11.8 11.9 11.8 -1.9 Nombre total des animauxUGB20.5 21.5 20.6 19.6 19.3 -6.2 Structureducapital Actif totalfr.476 486 605 967 593 049 621 232 645 041 6.3 dont:actifs circulants totalfr.78 573 103 814 99 941 104 862 108 694 5.7 dont:actif animal total fr.52 902 40 263 37 323 41 392 43 089 8.6 dont:immobilisations totalfr.345 011 461 890 455 785 474 979 493 257 6.3 dont:actifs de l'exploitationfr.448 089 573 520 565 949 583 451 607 061 5.7 Ratio d'endettement %45 40 40 41 41 1.7 Intérêts sur le capital propre de l'exploitation 1 fr.15 432 11 491 10 798 8 997 9 690 -7.1 Comptederésultats Rendement brutfr.124 931 138 099 131 524 148 901 153 507 10.0 dont paiements directsfr.23 476 52 979 55 041 58 581 58 257 4.9 Coûts d'exploitationfr.63 905 83 081 80 364 89 948 91 904 8.8 Revenu d'exploitationfr.61 026 55 018 51 161 58 952 61 603 11.9 Frais de personnelfr.4 860 5 500 4 940 6 518 7 168 26.8 Service de la dettefr.7 918 6 397 5 984 5 221 5 029 -14.3 Intérêts du fermagefr.2 707 2 986 2 725 3 292 3 297 9.9 Charges réellesfr.79 390 97 964 94 013 104 979 107 398 8.5 Revenu agricolefr.45 541 40 135 37 512 43 921 46 109 13.8 Revenu extra-agricolefr.17 853 19 414 20 748 21 662 22 645 9.9 Revenu totalfr.63 394 59 549 58 260 65 583 68 754 12.5 Consommation privéefr.48 548 53 783 52 126 54 736 57 614 7.6 Formation de capital proprefr.14 846 5 766 6 133 10 847 11 140 46.9 Investissementsetfinancement Investissements total 2 fr.34 138 38 648 35 562 35 138 40 299 10.6 Cash flow 3 fr.33 482 31 384 33 108 37 352 36 224 6.7 Rapport entre cash flow et investissements 4 %98 81 93 106 90 -3.6 Exploitations avec excédent de financement 5 %70 60 66 71 68 3.6 Stabilitéfinancière bonne situation financière 6 %54 41 42 49 48 9.1 autonomie financière restreinte 7 %26 16 19 20 22 20.0 revenu insuffisant 8 %8 25 21 17 18 -14.3 situation financière précaire 9 %12 18 18 14 12 -28.0 Relationrevenudel'exploitation/facteursutilisés Revenu d'exploitation par unité de main-d'œuvrefr./UTA37 418 34 399 33 018 37 936 38 822 10.5 Revenu d'exploitation par ha de SAUfr./ ha3 874 2 919 2 758 3 170 3 306 12.1 Rapport revenu d'exploitation / actifs de l'exploitation%13.6 9.6 9.0 10.1 10.1 5.6 Rentabilité Rentabilité du capital total 10 %-2.3 -5.1 -5.7 -4.4 -4.1 -19.1 Rentabilité du capital propre 11 %-7.4 -10.5 -11.4 -9.0 -8.5 -17.5 Revenudutravailparunitédemain-d'œuvrefamiliale12fr./UTAF212012080919816266312746522.5
(moyenne) Revenudutravailparunitédemain-d'œuvrefamiliale12fr./UTAF207071848418355248172537423.5 (médiane)
Résultats d'exploitation selon les types d'exploitations* – 2002/04
1Intérêts au taux moyen des obligations de la Confédération (2002:3.22%;2003:2.63%;2004 2.73%)
2Investissements bruts (sans prestations propres),moins les subventions et les désinvestissements
3Formation de capital propre (sans prestations propres pour investissements),plus amortissements plus/moins changements stocks et actif bétail
4Cash flow / investissements total
5Part d'exploitations avec cash flow > investissements total
6Part des capitaux étrangers < 50% et formation positive de capital propre
7Part des capitaux étrangers > 50% et formation positive de capital propre
8Part des capitaux étrangers < 50% et formation négative de capital propre
9Part des capitaux étrangers > 50% et formation négative de capital propre
10(Service de dette plus bénéfice/perte calculés plus intérêts sur le capital propre) / actifs de l'exploitation
11(bénéfice/perte calculés plus intérêts sur le capital propre) / capital propre de l'exploitation
12(revenu agricole moins intérêts sur le capital propre de l'exploitation) / unités de travail annuel de la famille (UTAF)
* Nouvelle typologie des exploitations FAT99
Source:Agroscope FAT Tänikon
A20 ANNEXE
Tableau 20a
ProductionvégétaleGarded'animaux MoyenneLaitAutres ParamètreUnitédetoutesCulturesCulturescommer-Vachesbétail lesexpl.deschampsspécialescialisémèresbovin Exploitations de référencenombre2 706 91 65 1 090 95 157 Exploitations retenuesnombre50 971 3 152 2 933 17 842 2 168 3 768 Structured'exploitation Surface agricole utileha19.24 23.02 13.05 19.11 18.23 16.39 Terres ouvertesha4.95 18.98 6.36 0.94 0.89 0.23 Unités de main-d'œuvre dans l'exploitationUTA1.63 1.35 2.10 1.61 1.29 1.44 dont:main-d'œuvre familialeUTAF1.26 1.05 1.27 1.32 1.10 1.25 Total vachesnombre13.7 3.1 1.9 16.9 15.6 8.2 Nombre total des animauxUGB23.5 6.9 3.4 24.2 18.5 16.0 Structureducapital Actif totalfr.751 847 744 404 780 559 693 881 684 209 564 127 dont:actifs circulants totalfr.134 053 157 419 211 624 115 277 110 923 97 037 dont:actif animal total fr.45 908 14 329 8 050 47 911 44 154 37 885 dont:immobilisations totalfr.571 887 572 656 560 885 530 693 529 133 429 204 dont:actifs de l'exploitationfr.707 283 692 953 716 000 655 845 648 625 524 563 Ratio d'endettement %43 39 38 43 45 41 Intérêts sur le capital propre de l'exploitation 1 fr.11 430 12 026 12 481 10 510 10 147 8 743 Comptederésultats Rendement brutfr.204 298 221 908 253 616 173 400 139 877 123 085 dont paiements directsfr.46 720 45 589 26 430 47 611 60 893 58 321 Coûts d'exploitationfr.123 142 126 739 136 831 102 051 81 560 75 982 Revenu d'exploitationfr.81 156 95 169 116 785 71 349 58 317 47 103 Frais de personnelfr.12 240 9 987 34 281 8 647 5 029 4 684 Service de la dettefr.7 605 7 794 7 432 6 725 6 846 4 727 Intérêts du fermagefr.5 644 8 481 5 880 5 003 3 257 2 557 Charges réellesfr.148 631 153 001 184 424 122 426 96 691 87 949 Revenu agricolefr.55 667 68 907 69 191 50 974 43 186 35 135 Revenu extra-agricolefr.20 448 24 523 20 361 18 395 31 489 23 200 Revenu totalfr.76 115 93 430 89 552 69 369 74 674 58 335 Consommation privéefr.64 191 78 108 76 012 59 008 60 697 52 382 Formation de capital proprefr.11 924 15 321 13 540 10 360 13 977 5 953 Investissementsetfinancement Investissements total 2 fr.47 512 43 836 47 739 45 913 38 784 37 743 Cash flow 3 fr.44 285 50 237 47 702 39 502 40 896 28 920 Rapport entre cash flow et investissements 4 %93 122 105 86 108 77 Exploitations avec excédent de financement 5 %67 70 66 68 69 64 Stabilitéfinancière bonne situation financière 6 %44 45 40 45 48 41 autonomie financière restreinte 7 %22 19 22 22 27 21 revenu insuffisant 8 %18 19 20 18 11 23 situation financière précaire 9 %16 17 17 15 14 16 Relationrevenudel'exploitation/facteursutilisés Revenu d'exploitation par unité de main-d'œuvrefr./UTA49 726 70 290 55 698 44 184 45 315 32 746 Revenu d'exploitation par ha de SAUfr./ ha4 218 4 131 8 964 3 732 3 194 2 871 Rapport revenu d'exploitation / actifs de l'exploitation%11.5 13.7 16.3 10.9 9.0 9.0 Rentabilité Rentabilité du capital total 10 %-2.3 0.8 -1.1 -3.5 -2.5 -6.3 Rentabilité du capital propre 11 %-5.9 -0.5 -3.7 -8.0 -6.5 -12.3 Revenudutravailparunitédemain-d'œuvre familiale12fr./UTAF352745415644645306903013721056 (moyenne)
Tableau 20b
Résultats d'exploitation selon les types d'exploitations* – 2002/04
1Intérêts au taux moyen des obligations de la Confédération (2002:3.22%;2003:2.63%;2004 2.73%)
2Investissements bruts (sans prestations propres),moins les subventions et les désinvestissements
3Formation de capital propre (sans prestations propres pour investissements),plus amortissements plus/moins changements stocks et actif bétail
4Cash flow / investissements total
5Part d'exploitations avec cash flow > investissements total
6Part des capitaux étrangers < 50% et formation positive de capital propre
7Part des capitaux étrangers > 50% et formation positive de capital propre
8Part des capitaux étrangers < 50% et formation négative de capital propre
9Part des capitaux étrangers > 50% et formation négative de capital propre
10(Service de dette plus bénéfice/perte calculés plus intérêts sur le capital propre) / actifs de l'exploitation
11(bénéfice/perte calculés plus intérêts sur le capital propre) / capital propre de l'exploitation
12(revenu agricole moins intérêts sur le capital propre de l'exploitation) / unités de travail annuel de la famille (UTAF)
* Nouvelle typologie des exploitations FAT99
Source:Agroscope FAT Tänikon
ANNEXE A21
Garded'animauxCombiné LaitcomParamètreUnitéMoyennesChevaux,mercialisé/ detoutesmoutons,Trans-culturedesVachesTranslesexpl.chèvresformationchampsmèresformationAutres Exploitations de référencenombre2 706 28 56 271 32 507 314 Exploitations retenuesnombre50 971 1 798 1 320 4 709 677 5 701 6 904 Structured'exploitation Surface agricole utileha19.24 12.05 11.45 25.65 21.72 19.53 20.91 Terres ouvertesha4.95 0.48 1.13 13.48 9.54 6.09 6.84 Unités de main-d'œuvre dans l'exploitationUTA1.63 1.29 1.53 1.86 1.44 1.76 1.68 dont:main-d'œuvre familialeUTAF1.26 1.12 1.21 1.29 1.08 1.27 1.25 Total vachesnombre13.7 1.4 10.7 19.8 16.7 15.9 15.0 Nombre total des animauxUGB23.5 11.5 49.4 27.8 21.2 39.6 25.8 Structureducapital Actif totalfr.751 847 476 888 990 923 879 949 901 936 914 174 805 683 dont:actifs circulants totalfr.134 053 80 890 142 377 174 137 166 033 142 541 141 487 dont:actif animal total fr.45 908 20 494 71 070 54 043 48 928 65 616 56 092 dont:immobilisations totalfr.571 887 375 504 777 476 651 769 686 975 706 018 608 104 dont:actifs de l'exploitationfr.707 283 446 044 936 390 825 547 844 326 871 650 755 609 Ratio d'endettement %43 49 49 39 45 44 44 Intérêts sur le capital propre de l'exploitation 1 fr.11 430 6 384 13 779 14 261 13 211 13 741 11 880 Comptederésultats Rendement brutfr.204 298 89 979 315 979 258 715 211 361 293 837 216 271 dont paiements directsfr.46 720 38 461 33 489 47 619 64 209 44 497 46 996 Coûts d'exploitationfr.123 142 59 861 220 257 154 347 130 056 188 714 130 770 Revenu d'exploitationfr.81 156 30 118 95 721 104 368 81 305 105 124 85 502 Frais de personnelfr.12 240 3 500 11 665 17 912 13 064 16 834 14 178 Service de la dettefr.7 605 5 475 13 315 8 078 9 986 9 628 8 801 Intérêts du fermagefr.5 644 1 570 2 920 9 388 6 851 6 521 6 526 Charges réellesfr.148 631 70 406 248 156 189 724 159 958 221 696 160 274 Revenu agricolefr.55 667 19 572 67 822 68 991 51 403 72 141 55 997 Revenu extra-agricolefr.20 448 39 862 20 354 14 293 33 236 16 149 20 290 Revenu totalfr.76 115 59 435 88 177 83 284 84 639 88 290 76 288 Consommation privéefr.64 191 55 511 70 147 70 474 73 132 68 935 65 727 Formation de capital proprefr.11 924 3 924 18 030 12 810 11 507 19 354 10 561 Investissementsetfinancement Investissements total 2 fr.47 512 32 414 78 523 57 292 55 954 62 297 40 154 Cash flow 3 fr.44 285 24 907 60 464 51 411 47 716 60 869 45 016 Rapport entre cash flow et investissements 4 %93 81 80 90 94 99 114 Exploitations avec excédent de financement 5 %67 64 59 64 64 67 69 Stabilitéfinancière bonne situation financière 6 %44 38 45 47 46 46 43 autonomie financière restreinte 7 %22 25 25 18 18 23 24 revenu insuffisant 8 %18 16 11 22 9 15 16 situation financière précaire 9 %16 21 19 13 26 15 18 Relationrevenudel'exploitation/facteursutilisés Revenu d'exploitation par unité de main-d'œuvrefr./UTA49 726 22 996 62 569 56 084 56 541 59 762 50 763 Revenu d'exploitation par ha de SAUfr./ ha4 218 2 532 8 358 4 068 3 739 5 384 4 087 Rapport revenu d'exploitation / actifs de l'exploitation%11.5 6.7 10.2 12.6 9.6 12.0 11.3 Rentabilité Rentabilité du capital total 10 %-2.3 -9.3 0.4 -1.2 -1.2 -0.1 -2.2 Rentabilité du capital propre 11 %-5.9 -21.5 -2.1 -3.6 -4.4 -2.1 -6.1 Revenudutravailparunitédemain-d'œuvre familiale12fr./UTAF35274116194459442425353944613735323 (moyenne)
Tableau 21
Résultats d'exploitations selon les quartiles:toutes régions confondues 2002/04
Revenudutravailparunitédemain-d'œuvrefamiliale12fr./UTAF352745983251594069873417 (moyenne)
Revenudutravailparunitédemain-d'œuvrefamiliale12fr./UTAF32495 (médiane)
1Intérêts au taux moyen des obligations de la Confédération (2002:3.22%;2003:2.63%;2004 2.73%)
2Investissements bruts (sans prestations propres),moins les subventions et les désinvestissements
3Formation de capital propre (sans prestations propres pour investissements),plus amortissements plus/moins changements stocks et actif bétail
4Cash flow / investissements total
5Part d'exploitations avec cash flow > investissements total
6Part des capitaux étrangers < 50% et formation positive de capital propre
7Part des capitaux étrangers > 50% et formation positive de capital propre
8Part des capitaux étrangers < 50% et formation négative de capital propre
9Part des capitaux étrangers > 50% et formation négative de capital propre
10(Service de dette plus bénéfice/perte calculés plus intérêts sur le capital propre) / actifs de l'exploitation
11(bénéfice/perte calculés plus intérêts sur le capital propre) / capital propre de l'exploitation
12(revenu agricole moins intérêts sur le capital propre de l'exploitation) / unités de travail annuel de la famille (UTAF)Source:Agroscope FAT Tänikon
A22 ANNEXE
ventiléesselonlerevenudutravail ParamètreUnitéMoyenne1erquartile2equartile3equartile4equartile (0–25%)(25–50%)(50–75%)(75–100%) Exploitations de référencenombre2 706 570 688 730 718 Exploitations retenuesnombre50 971 12 753 12 737 12 745 12 736 Structured'exploitation Surface agricole utileha19.24 14.54 17.22 20.17 25.04 Terres ouvertesha4.95 2.51 3.22 4.92 9.16 Unités de main-d'œuvre dans l'exploitationUTA1.63 1.53 1.64 1.62 1.73 dont:main-d'œuvre familialeUTAF1.26 1.26 1.34 1.28 1.14 Total vachesnombre13.7 10.3 13.4 14.8 16.2 Nombre total des animauxUGB23.5 17.8 21.7 25.0 29.6 Structureducapital Actif totalfr.751 847 662 919 681 675 766 358 896 558 dont:actifs circulants totalfr.134 053 107 466 118 624 142 685 167 465 dont:actif animal total fr.45 908 36 314 43 040 48 602 55 687 dont:immobilisations totalfr.571 887 519 138 520 011 575 071 673 406 dont:actifs de l'exploitationfr.707 283 623 220 643 223 716 656 846 150 Ratio d'endettement %43 44 41 41 44 Intérêts sur le capital propre de l'exploitation 1 fr.11 430 9 968 10 634 11 885 13 237 Comptederésultats Rendement brutfr.204 298 135 624 171 631 211 643 298 385 dont paiements directsfr.46 720 39 585 44 289 47 891 55 124 Coûts d'exploitationfr.123 142 99 258 107 128 123 849 162 366 Revenu d'exploitationfr.81 156 36 366 64 503 87 794 136 018 Frais de personnelfr.12 240 8 474 9 462 10 681 20 350 Service de la dettefr.7 605 7 072 6 726 7 141 9 482 Intérêts du fermagefr.5 644 3 321 4 004 5 917 9 338 Charges réellesfr.148 631 118 126 127 320 147 587 201 536 Revenu agricolefr.55 667 17 498 44 310 64 056 96 849 Revenu extra-agricolefr.20 448 31 173 18 778 16 677 15 153 Revenu totalfr.76 115 48 671 63 088 80 733 112 002 Consommation privéefr.64 191 53 981 58 093 67 133 77 571 Formation de capital proprefr.11 924 -5 309 4 995 13 600 34 431 Investissementsetfinancement Investissements total 2 fr.47 512 44 540 37 475 43 265 64 776 Cash flow 3 fr.44 285 25 315 33 946 45 627 72 275 Rapport entre cash flow et investissements 4 %93 57 91 106 112 Exploitations avec excédent de financement 5 %67 56 67 71 74 Stabilitéfinancière bonne situation financière 6 %44 28 44 51 54 autonomie financière restreinte 7 %22 13 18 24 34 revenu insuffisant 8 %18 32 20 13 6 situation financière précaire 9 %16 27 19 12 7 Relationrevenudel'exploitation/facteursutilisés Revenu d'exploitation par unité de main-d'œuvrefr./UTA49 726 23 729 39 320 54 041 78 587 Revenu d'exploitation par ha de SAUfr./ ha4 218 2 504 3 743 4 348 5 441 Rapport revenu d'exploitation / actifs de l'exploitation%11.5 5.8 10.0 12.2 16.1 Rentabilité Rentabilité du capital total 10 %-2.3 -8.4 -5.0 -1.5 3.7 Rentabilité du capital propre 11 %-5.9 -17.2 -10.5 -4.3 4.8
Tableau 22
Résultats d'exploitation selon les quartiles:région de plaine* – 2002/04
(moyenne)
Revenudutravailparunitédemain-d'œuvrefamiliale12fr./UTAF42204 (médiane)
1Intérêts au taux moyen des obligations de la Confédération (2002:3.22%;2003:2.63%;2004 2.73%)
2Investissements bruts (sans prestations propres),moins les subventions et les désinvestissements
3Formation de capital propre (sans prestations propres pour investissements),plus amortissements plus/moins changements stocks et actif bétail
4Cash flow / investissements total
5Part d'exploitations avec cash flow > investissements total
6Part des capitaux étrangers < 50% et formation positive de capital propre
7Part des capitaux étrangers > 50% et formation positive de capital propre
8Part des capitaux étrangers < 50% et formation négative de capital propre
9Part des capitaux étrangers > 50% et formation négative de capital propre
10(Service de dette plus bénéfice/perte calculés plus intérêts sur le capital propre) / actifs de l'exploitation
11(bénéfice/perte calculés plus intérêts sur le capital propre) / capital propre de l'exploitation
12(revenu agricole moins intérêts sur le capital propre de l'exploitation) / unités de travail annuel de la famille (UTAF)
*Région de plaine:zone de grandes cultures et zones intermédiairesSource:Agroscope FAT Tänikon
ANNEXE A23
ventiléesselonlerevenudutravail ParamètreUnitéMoyenne1erquartile2equartile3equartile4equartile (0–25%)(25–50%)(50–75%)(75–100%) Exploitations de référencenombre1 220 276 322 306 316 Exploitations retenuesnombre22 888 5 744 5 742 5 695 5 707 Structured'exploitation Surface agricole utileha20.18 16.45 18.41 19.37 26.52 Terres ouvertesha9.16 6.83 7.60 8.33 13.89 Unités de main-d'œuvre dans l'exploitationUTA1.72 1.67 1.69 1.71 1.82 dont:main-d'œuvre familialeUTAF1.22 1.24 1.29 1.23 1.11 Total vachesnombre13.7 11.8 14.1 13.8 15.3 Nombre total des animauxUGB24.3 20.1 22.4 25.5 29.1 Structureducapital Actif totalfr.856 362 828 837 796 886 835 397 964 716 dont:actifs circulants totalfr.163 595 145 631 153 208 169 623 186 148 dont:actif animal total fr.46 466 40 021 44 499 46 721 54 680 dont:immobilisations totalfr.646 301 643 186 599 178 619 052 723 887 dont:actifs de l'exploitationfr.802 073 774 949 744 725 772 943 915 935 Ratio d'endettement %42 44 40 41 45 Intérêts sur le capital propre de l'exploitation 1 fr.13 005 12 300 12 472 12 917 14 335 Comptederésultats Rendement brutfr.251 204 191 260 214 851 251 704 347 653 dont paiements directsfr.40 873 33 465 36 554 39 387 54 162 Coûts d'exploitationfr.150 101 135 678 131 509 145 027 188 408 Revenu d'exploitationfr.101 103 55 583 83 342 106 676 159 246 Frais de personnelfr.17 740 15 324 13 292 16 393 26 016 Service de la dettefr.9 105 9 515 7 628 8 218 11 058 Intérêts du fermagefr.7 542 4 978 6 232 7 375 11 610 Charges réellesfr.184 489 165 495 158 662 177 013 237 091 Revenu agricolefr.66 715 25 765 56 189 74 691 110 562 Revenu extra-agricolefr.19 305 28 633 17 570 16 731 14 234 Revenu totalfr.86 021 54 399 73 758 91 422 124 796 Consommation privéefr.71 809 63 673 66 970 73 526 83 137 Formation de capital proprefr.14 212 -9 275 6 788 17 896 41 660 Investissementsetfinancement Investissements total 2 fr.52 663 45 083 42 720 54 125 68 823 Cash flow 3 fr.51 076 28 284 40 222 53 473 82 556 Rapport entre cash flow et investissements 4 %97 63 95 100 121 Exploitations avec excédent de financement 5 %66 55 69 66 76 Stabilitéfinancière bonne situation financière 6 %44 24 45 52 54 autonomie financière restreinte 7 %22 12 16 24 34 revenu insuffisant 8 %18 32 21 13 5 situation financière précaire 9 %17 32 18 11 6 Relationrevenudel'exploitation/facteursutilisés Revenu d'exploitation par unité de main-d'œuvrefr./UTA58 745 33 289 49 308 62 515 87 571 Revenu d'exploitation par ha de SAUfr./ ha5 012 3 383 4 525 5 518 6 014 Rapport revenu d'exploitation / actifs de l'exploitation%12.6 7.2 11.2 13.8 17.4 Rentabilité Rentabilité du capital total 10 %-0.8 -6.3 -3.2 0.0 5.1 Rentabilité du capital propre 11 %-3.4 -13.6 -7.2 -1.8 7.1 Revenudutravailparunitédemain-d'œuvrefamiliale12fr./UTAF4420810800338845057987101
Tableau 23
Résultats d'exploitation selon les quartiles:région des collines* – 2002/04
(moyenne)
Revenudutravailparunitédemain-d'œuvrefamiliale12fr./UTAF30322 (médiane)
1Intérêts au taux moyen des obligations de la Confédération (2002:3.22%;2003:2.63%;2004 2.73%)
2Investissements bruts (sans prestations propres),moins les subventions et les désinvestissements
3Formation de capital propre (sans prestations propres pour investissements),plus amortissements plus/moins changements stocks et actif bétail
4Cash flow / investissements total
5Part d'exploitations avec cash flow > investissements total
6Part des capitaux étrangers < 50% et formation positive de capital propre
7Part des capitaux étrangers > 50% et formation positive de capital propre
8Part des capitaux étrangers < 50% et formation négative de capital propre
9Part des capitaux étrangers > 50% et formation négative de capital propre
10(Service de dette plus bénéfice/perte calculés plus intérêts sur le capital propre) / actifs de l'exploitation
11(bénéfice/perte calculés plus intérêts sur le capital propre) / capital propre de l'exploitation
12(revenu agricole moins intérêts sur le capital propre de l'exploitation) / unités de travail annuel de la famille (UTAF)
*Région des collines:zone des collines et zone de montagne ISource:Agroscope FAT Tänikon
A24 ANNEXE
ventiléesselonlerevenudutravail ParamètreUnitéMoyenne1erquartile2equartile3equartile4equartile (0–25%)(25–50%)(50–75%)(75–100%) Exploitations de référencenombre763 150 190 208 215 Exploitations retenuesnombre14 007 3 522 3 501 3 493 3 491 Structured'exploitation Surface agricole utileha18.36 13.83 16.33 19.16 24.16 Terres ouvertesha2.82 1.67 2.35 3.18 4.07 Unités de main-d'œuvre dans l'exploitationUTA1.56 1.46 1.55 1.57 1.64 dont:main-d'œuvre familialeUTAF1.25 1.20 1.32 1.28 1.18 Total vachesnombre15.4 11.6 14.3 16.6 19.0 Nombre total des animauxUGB26.0 19.5 23.3 27.3 34.0 Structureducapital Actif totalfr.713 814 642 596 663 649 706 233 843 469 dont:actifs circulants totalfr.115 482 98 482 104 425 117 170 141 954 dont:actif animal total fr.50 339 39 376 45 075 53 005 64 022 dont:immobilisations totalfr.547 993 504 738 514 150 536 058 637 494 dont:actifs de l'exploitationfr.674 779 604 128 628 697 666 615 800 373 Ratio d'endettement %45 46 43 44 46 Intérêts sur le capital propre de l'exploitation 1 fr.10 470 9 189 10 001 10 535 12 167 Comptederésultats Rendement brutfr.187 602 131 207 164 310 194 192 261 292 dont paiements directsfr.45 650 36 460 40 506 47 319 58 413 Coûts d'exploitationfr.115 019 96 544 104 553 115 746 143 454 Revenu d'exploitationfr.72 583 34 663 59 757 78 446 117 838 Frais de personnelfr.9 313 7 678 7 308 8 232 14 054 Service de la dettefr.7 359 6 956 7 019 6 843 8 626 Intérêts du fermagefr.5 097 3 457 3 868 5 185 7 893 Charges réellesfr.136 788 114 636 122 748 136 006 174 027 Revenu agricolefr.50 814 16 571 41 562 58 186 87 265 Revenu extra-agricolefr.21 069 32 064 19 874 16 609 15 634 Revenu totalfr.71 883 48 635 61 436 74 795 102 899 Consommation privéefr.61 170 51 562 57 912 63 006 72 297 Formation de capital proprefr.10 713 -2 927 3 524 11 789 30 602 Investissementsetfinancement Investissements total 2 fr.49 597 53 863 41 603 36 493 66 401 Cash flow 3 fr.41 933 26 317 33 247 41 589 66 733 Rapport entre cash flow et investissements 4 %85 49 82 114 103 Exploitations avec excédent de financement 5 %67 55 66 72 76 Stabilitéfinancière bonne situation financière 6 %43 31 40 47 53 autonomie financière restreinte 7 %24 15 18 27 37 revenu insuffisant 8 %16 26 22 13 4 situation financière précaire 9 %17 27 20 13 6 Relationrevenudel'exploitation/facteursutilisés Revenu d'exploitation par unité de main-d'œuvrefr./UTA46 676 23 665 38 586 50 099 71 793 Revenu d'exploitation par ha de SAUfr./ ha3 952 2 508 3 655 4 091 4 877 Rapport revenu d'exploitation / actifs de l'exploitation%10.7 5.7 9.5 11.8 14.7 Rentabilité Rentabilité du capital total 10 %-2.9 -8.6 -5.4 -2.3 2.7 Rentabilité du capital propre 11 %-7.4 -18.3 -11.7 -5.9 3.2 Revenudutravailparunitédemain-d'œuvrefamiliale12fr./UTAF324086101239483725163747
Tableau 24
Résultats d'exploitation selon les quartiles:région de montagne* – 2002/04
(moyenne)
Revenudutravailparunitédemain-d'œuvrefamiliale12fr./UTAF22849 (médiane)
1Intérêts au taux moyen des obligations de la Confédération (2002:3.22%;2003:2.63%;2004 2.73%)
2Investissements bruts (sans prestations propres),moins les subventions et les désinvestissements
3Formation de capital propre (sans prestations propres pour investissements),plus amortissements plus/moins changements stocks et actif bétail
4Cash flow / investissements total
5Part d'exploitations avec cash flow > investissements total
6Part des capitaux étrangers < 50% et formation positive de capital propre
7Part des capitaux étrangers > 50% et formation positive de capital propre
8Part des capitaux étrangers < 50% et formation négative de capital propre
9Part des capitaux étrangers > 50% et formation négative de capital propre
10(Service de dette plus bénéfice/perte calculés plus intérêts sur le capital propre) / actifs de l'exploitation
11(bénéfice/perte calculés plus intérêts sur le capital propre) / capital propre de l'exploitation
12(revenu agricole moins intérêts sur le capital propre de l'exploitation) / unités de travail annuel de la famille (UTAF)
*Région de montagne:zones de montagne II à IV
Source:Agroscope FAT Tänikon
ANNEXE A25
ventiléesselonlerevenudutravail ParamètreUnitéMoyenne1erquartile2equartile3equartile4equartile (0–25%)(25–50%)(50–75%)(75–100%) Exploitations de référencenombre723 155 178 195 196 Exploitations retenuesnombre14 076 3 523 3 529 3 516 3 508 Structured'exploitation Surface agricole utileha18.60 13.22 15.94 19.27 25.99 Terres ouvertesha0.24 0.08 0.15 0.29 0.44 Unités de main-d'œuvre dans l'exploitationUTA1.56 1.48 1.63 1.61 1.53 dont:main-d'œuvre familialeUTAF1.33 1.29 1.44 1.36 1.23 Total vachesnombre11.8 8.7 10.5 12.8 15.3 Nombre total des animauxUGB19.8 15.6 17.1 21.3 25.3 Structureducapital Actif totalfr.619 774 537 982 574 629 629 142 737 903 dont:actifs circulants totalfr.104 499 73 204 100 434 115 832 128 666 dont:actif animal total fr.40 601 31 766 35 594 43 567 51 537 dont:immobilisations totalfr.474 674 433 012 438 601 469 743 557 700 dont:actifs de l'exploitationfr.585 487 514 588 542 651 590 152 695 077 Ratio d'endettement %41 41 38 40 43 Intérêts sur le capital propre de l'exploitation 1 fr.9 828 8 583 9 563 10 013 11 161 Comptederésultats Rendement brutfr.144 644 100 979 124 179 154 198 199 508 dont paiements directsfr.57 293 44 154 51 752 61 070 72 271 Coûts d'exploitationfr.87 405 77 724 77 497 89 486 105 010 Revenu d'exploitationfr.57 239 23 256 46 682 64 711 94 498 Frais de personnelfr.6 209 4 598 5 017 6 714 8 522 Service de la dettefr.5 411 5 499 4 591 5 324 6 237 Intérêts du fermagefr.3 105 2 191 2 197 3 307 4 734 Charges réellesfr.102 130 90 011 89 302 104 832 124 503 Revenu agricolefr.42 514 10 968 34 878 49 366 75 005 Revenu extra-agricolefr.21 685 34 082 18 783 18 030 15 820 Revenu totalfr.64 199 45 050 53 661 67 396 90 825 Consommation privéefr.54 825 48 345 49 380 55 267 66 365 Formation de capital proprefr.9 374 -3 296 4 280 12 129 24 460 Investissementsetfinancement Investissements total 2 fr.37 000 33 064 34 229 36 780 43 965 Cash flow 3 fr.35 561 23 409 27 609 38 179 53 141 Rapport entre cash flow et investissements 4 %96 73 83 104 122 Exploitations avec excédent de financement 5 %68 60 66 72 76 Stabilitéfinancière bonne situation financière 6 %46 31 44 56 55 autonomie financière restreinte 7 %20 12 18 20 31 revenu insuffisant 8 %19 35 21 11 6 situation financière précaire 9 %15 22 17 12 7 Relationrevenudel'exploitation/facteursutilisés Revenu d'exploitation par unité de main-d'œuvrefr./UTA36 592 15 676 28 716 40 131 61 667 Revenu d'exploitation par ha de SAUfr./ ha3 078 1 758 2 931 3 366 3 630 Rapport revenu d'exploitation / actifs de l'exploitation%9.8 4.5 8.6 11.0 13.6 Rentabilité Rentabilité du capital total 10 %-4.7 -11.1 -7.8 -3.8 1.6 Rentabilité du capital propre 11 %-9.6 -20.8 -14.1 -7.9 1.2
Revenudutravailparunitédemain-d'œuvrefamiliale12fr./UTAF246371840176592908652048
Tableau 25
Résultats d'exploitations selon les régions,les types d’exploitations et les quartiles 1990/92–2002/04
exploitations
grandescultures–laitvachesmèrestransformationautres
erquartile2equartile3equartile4equartile (0–25%)(25–50%)(50–75%)(75–100%)
A26 ANNEXE
UnitéEnsembledesRégiondeplaineRégiondescollinesRégiondemontagne
Revenu,selonlesrégions1990/922002/041990/922002/041990/922002/041990/922002/04 Surface agricole utileha16.06 19.24 16.66 20.18 15.30 18.36 15.76 18.60 Main-d'œuvre familialeUTAF1.39 1.26 1.36 1.22 1.40 1.25 1.42 1.33 Revenu agricolefr.62 822 55 667 73 794 66 715 59 838 50 814 45 541 42 514 Revenu extra-agricolefr.16 264 20 448 16 429 19 305 14 544 21 069 17 853 21 685 Revenu totalfr.79 086 76 115 90 223 86 021 74 382 71 883 63 394 64 199 Revenudutravailparunitéde main-d'œuvrefamilialefr./UTAF3102535274369244420830335324082120124637 UnitéCulturesdeschampsCulturesspécialesLaitcommercialiséVachesmères Revenu,selonlestypesd'exploitations1990/922002/041990/922002/041990/922002/041990/922002/04 Surface agricole utileha21.23 23.02 8.92 13.05 15.30 19.11 15.32 18.23 Main-d'œuvre familialeUTAF1.08 1.05 1.29 1.27 1.42 1.32 1.20 1.10 Revenu agricolefr.60 284 68 907 67 184 69 191 53 923 50 974 36 627 43 186 Revenu extra-agricolefr.26 928 24 523 21 555 20 361 16 044 18 395 33 558 31 489 Revenu totalfr.87 212 93 430 88 739 89 552 69 967 69 369 70 185 74 674 Revenudutravailparunitéde main-d'œuvrefamilialefr./UTAF3437554156303344464526471306901734830137 UnitéAutreChevaux/moutons/Transformation
Surface agricole utileha14.20 16.39 seulement 712.05 9.34 11.45 Main-d'œuvre familialeUTAF1.37 1.25 Exploitations1.12 1.35 1.21 Revenu agricolefr.38 407 35 135 disponibles19 572 86 288 67 822 Revenu extra-agricolefr.20 570 23 200 39 862 14 614 20 354 Revenu totalfr.58 977 58 335 59 435 100 902 88 177 Revenudutravailparunitéde main-d'œuvrefamilialefr./UTAF1679321056116194818244594
Surface agricole utileha20.37 25.65 17.93 21.72 15.59 19.53 17.24 20.91 Main-d'œuvre familialeUTAF1.45 1.29 1.24 1.08 1.40 1.27 1.43 1.25 Revenu agricolefr.75 368 68 991 51 161 51 403 84 363 72 141 66 705 55 997 Revenu extra-agricolefr.11 802 14 293 20 475 33 236 12 032 16 149 15 000 20 290 Revenu totalfr.87 170 83 284 71 636 84 639 96 395 88 290 81 705 76 288
main-d'œuvrefamilialefr./UTAF3642042425274563539442927461373273235323
Revenu,selonlesquartiles(revenudutravail)1990/922002/041990/922002/041990/922002/041990/922002/04 Surface agricole utileha14.68 14.54 15.30 17.22 15.78 20.17 18.47 25.04 Main-d'œuvre familialeUTAF1.36 1.26 1.49 1.34 1.42 1.28 1.27 1.14 Revenu agricolefr.26 883 17 498 52 294 44 310 69 198 64 056 102 975 96 849 Revenu extra-agricolefr.27 789 31 173 14 629 18 778 12 064 16 677 10 557 15 153 Revenu totalfr.54 672 48 671 66 923 63 088 81 262 80 733 113 532 112 002 Revenudutravailparunitéde main-d'œuvrefamilialefr./UTAF43675983235922515936016406986266573417 Source:Agroscope FAT Tänikon
bétailbovinchèvres Revenu,selonlestypesd'exploitations1990/922002/041990/922002/041990/922002/04
UnitéCombinéCombinéCombinéCombiné
Revenu,selonlestypesd'exploitations1990/922002/041990/922002/041990/922002/041990/922002/04
Revenudutravailparunitéde
Unité1
■■■■■■■■■■■■■■■■ Tableaux Dépenses de la Confédération
Dépenses Production et ventes
26
des ventes:affectation des fonds
2 Dès 2005 fromage Suisse et étranger
3 Dépenses plus élevées en 2004,compensation en 2005
4 Jusqu'à 2003 montants prélevés sur le fonds viticole
5 Jusqu'à 2003,dépenses mentionnées sous les mesures communes
ANNEXE A27
Tableau
Promotion
Secteurs/secteurproduit-marchéComptes2003Comptes20041Budget2005 fr.fr.fr. Productionlaitière417285613871363726918950 Fromage,étranger 2 30 459 24018 195 99720 572 000 Fromage,Suisse1 418 3212 968 080 Lait et beurre 3 9 851 00017 549 5606 346 950 Productionanimale289001946415875262250 Viande1 660 0503 316 5133 915 000 Oeufs618 519690 000703 000 Poissons 02 30712 500 Animaux sur pied611 450632 767631 750 Miel 000 Productionvégétale73548191144993712055471 Légumes et champignons1 919 6771 643 5672 203 927 Fruits2 607 7392 500 4002 425 149 Céréales530 536446 085438 270 Pommes de terre1 180 890860 011700 625 Oléagineux315 978299 874362 500 Plantes ornementales800 000700 000665 000 Vin 4 5 000 0005 000 000 Semences 260 000 Mesurescommunes585247125511272968179 MesuresconcernantplusieursSPM(bio,PI)275028828659763012164 Relationspubliques5030862002834250 Décomptes finals et engagements à long terme pour petits projets et sponsoring906 211561 302750 000 National614823696078356653051264 Régional258606519389602834250 Total649746456328382856635514
décompte provisoire
1 Après
Source:OFAG
Tableau 27
Dépenses économie laitière
Tableau 28
Dépenses économie animale
DésignationComptes2003Comptes2004Budget20051 fr.fr.fr.
Indemnitésverséesàdesorganisationsprivéesdubétaildeboucherieetdelaviande744800074445357212400
Soutiendumarchédelaviande
Contributions au stockage de viande de veau3 801 5753 418 583
Contributions au stockage de viande de bœuf provenant d'animaux destinés à la transformation (vaches)801 1320
Contributions destinées à réduire le prix des cuisses de bœuf0687 151
Contributions servant à réduire le prix de viande d'étal destinée à la transformation 0760 063 460270748657977644600
Soutiendumarchédesœufs
Contributions de reconversion pour les élevages particulièrement respectueux des pondeuses 53
la volaille204
Contributions à l'investissement (construction de poulaillers)597
Aidesàl'exportationdebétaild'élevageetderente923155066244509081000
A28 ANNEXE
525 0821
678471
297466129367133558000
8500 Campagnes d'œufs cassés (OC)1
335 847 Campagnes de vente à prix réduits593 203546 951 Essais pratiques sur
848582 616
299
Contributionsàlamiseenvaleurdelalainedemouton594000627327800000 Total248509182249882228296000 1 Compte tenu du blocage de crédits Sources:Compte d’Etat,OFAG
DésignationComptes2003Comptes2004Budget20051 fr.fr.fr. Soutiendumarché(supplémentsetaides) Supplément pour le lait transformé en fromage306 348 248290 426 314283 331 000 Supplément de non-ensilage42 956 25441 350 07941 000 000 Aides pour le beurre accordées dans le pays93 119 64071 662 05760 000 000 Aides pour le lait écrémé et la poudre de lait accordées dans le pays46 542 31049 300 03245 000 000 Aides pour le fromage accordées dans le pays000 Aides à l'exportation de fromages29 090 87618 222 92415 000 000 Aides à l'exportation d'autres produits laitiers34 801 67226 184 32524 000 000 552859000497145731468331000 Soutiendumarché(administration) Commission de recours Contingentement laitier43 04948 12894 900 Administration de la mise en valeur du lait et du contingentement laitier7 076 4926 319 1485 805 982 711954163672765900882 Total559978541503513007474231882 1 Compte tenu du blocage de crédits Sources:Compte d’Etat,OFAG
Tableau 29
Dépenses production végétale
1 Dès le budget 2004 nouvellement à la rubrique «Autres biens et services» (3190.000)
2Avant:promotion de la viticulture
3 Promotion des ventes de vin à l'étranger / Dans les comptes 2003,les contributions à la reconversion en viticulture sont incluses / dès le budget 2004,la promotion des ventes se trouve à la rubrique 3601.200
4 sans les oléagineux
5 dans l'exercice 2004,38,2 mio.de fr.ont été versés pour la transformation de la récolte 2003 et 7,1 mio.de fr.pour celle de la récolte 2004
Sources:Compte d’Etat,OFAG
ANNEXE A29
DésignationComptes2003Comptes2004Budget2005 fr.fr.fr. Contributionsàlaculturedeschamps435739254350372746353300 Contributions à la surface pour oléagineux35 178 96735 857 27937 767 800 Contributions à la surface pour légumineuses à graines7 905 3927 190 0818 105 300 Contributions à la surface pour plantes à fibres489 567456 367480 200 Contributionspourlatransformationetlamiseenvaleur940559199429815474039700 Transformation de betteraves sucrières 5 45 000 00045 338 10732 300 000 Transformation d'oléagineux8 500 0008 436 2502 577 500 Transformation de pommes de terre18 851 41218 329 41716 677 800 Production de semences3 889 3443 730 7423 428 400 Mise en valeur de fruits17 815 16418 463 63719 036 000 Transformation de matières premières renouvelables 4 0020 000 Promotiondesproduitsviticoles1641179039317695100000 Biens et services 1 82 934-Contrôle de la vendage 2 1 066 298935 7241 100 000 Mesures de mise en valeur 3 9 951 554-Utilisation non alcoolique de raisins5 311 004-Contributions de reconversion dans la viticulture-2 996 0454 000 000 Total154041634141733649125493000
Dépenses Paiements directs
Tableau 30
Evolution des paiements directs
n'est pas possible de comparer ces chiffres avec ceux du compte d'Etat.Ceux concernant les paiements directs se réfèrent à toute l'année de contributions, alors que ceux du compte d'Etat indiquent les dépenses d’une année civile.Les déductions sont celles effectuées sur la base de limites et de sanctions légales et administratives. Source:OFAG
A30 ANNEXE
20002001200220032004 Typedecontribution 1000fr.1000fr.1000fr.1000fr.1000fr. Paiementsdirectsgénéraux18036581929094199483819990911993915 Contributions à la surface1 186 7701 303 8811 316 1831 317 9561 317 773 Contributions pour la garde d'animaux consommant des fourrages grossiers258 505268 272283 221287 692286 120 Contributions pour la garde d'animaux dans des conditions difficiles251 593250 255289 572287 289284 023 Contributions générales pour des terrains en pente96 71496 64395 81195 63095 308 Contributions pour les surfaces viticoles en forte pente et en terrasses10 07610 04310 05110 52410 691 Paiementsdirectsécologiques361309412664452448476724494695 Contributionsécologiques278981329886359387381319398109 Contributions à la compensation écologique108 130118 417122 347124 927125 665 Contributions au sens de l'ordonnance sur la qualité écologique (OQE)--8 93414 63823 007 Contributions pour la culture extensive de céréales et de colza (culture extensive)33 39832 52631 93831 25530 824 Contributions pour les prairies extensives aménagées sur des terres assolées gelées (dispositions transitoires limitées à fin 2000)17 150 Contributions pour la culture biologique12 18523 48825 48427 13527 962 Contributions pour la garde d'animaux de rente particulièrement respectueuse de l'espèce108 118155 455170 684183 363190 651 Contributionsd'estivage8123880524895619138191066 Contributionspourlaprotectiondeseaux10902254350040245521 Réductions2254216763211431713818120 Totalpaiementsdirects21424252324995242614324586772470490 Remarque:Il
Tableau 31a
Paiements directs généraux – 2004
ANNEXE A31
ContributionsàlasurfaceContributionspouranimauxconsommantdesfourragesgrossiers ExploitationsSurfaceTotalcontributionsExploitationsUGBFGTotalcontributions Nombrehafr.NombreNombrefr. Canton ZH3 61670 19894 014 0111 82516 01113 597 132 BE12 514188 106243 541 6368 56763 64055 564 324 LU5 08977 36697 469 0433 06523 94421 038 809 UR6586 6978 037 2136135 2774 405 923 SZ1 67423 97528 748 9601 45313 91811 741 469 OW6987 9099 499 9216083 8853 386 141 NW4946 0957 313 0863882 4902 111 323 GL4117 2038 635 7763923 6663 162 280 ZG56210 58413 021 7633763 0642 623 344 FR3 19174 92997 394 0291 97917 70915 541 192 SO1 41131 47440 959 9709148 6057 370 475 BL94521 36227 119 4696295 8365 019 813 SH57514 11519 533 1062292 5402 201 855 AR76112 14714 498 2526204 8544 074 174 AI5647 3148 758 1573802 5122 168 455 SG4 32271 83587 305 7143 15728 49724 159 842 GR2 69552 00362 349 7192 57335 25028 762 867 AG3 07657 93678 681 9711 54314 44812 311 482 TG2 65749 24465 390 3148656 9325 667 628 TI90212 90415 656 3866917 0475 310 864 VD3 985106 320144 393 2381 94822 20819 275 242 VS3 78036 20845 593 9992 30919 35413 942 318 NE93233 16038 749 3686958 3427 352 934 GE30810 53714 207 1801021 3741 155 281 JU1 08838 73746 900 60092016 09914 174 692 Suisse569081028360131777288136841337497286119859 Zone1 Plaine24 061478 170650 814 64710 33393 27879 847 627 Collines8 061143 291182 252 2065 12341 83335 623 012 ZM I7 365118 810144 379 5195 70344 11837 864 348 ZM II9 047156 314183 719 3707 50270 78561 093 350 ZM III5 52585 474101 631 8565 38457 81947 918 373 ZM IV2 84946 30154 975 2832 79629 66423 773 149 1 Assignation de la surface en fonction de la part principale de la SAU qu'une entreprise exploite dans une zone donnée Source:OFAG
Tableau 31b
Paiements directs généraux – 2004
Garded'animauxdansdesconditionsContributionsgénéralesContributionspourdesterresenforte
A32 ANNEXE
difficilespourlesterrainsenpentepenteetenterrassesviticoles TotalTotalTotal ExploitationsUGBFGcontributionsExploitationsSurfacecontributionsExploitationsSurfacecontributions Nombrehafr.Nombrehafr.Nombrehafr. Canton ZH79512 9003 952 2787705 0892 092 065189169318 925 BE8 886129 87871 824 4488 24247 23119 805 9696897341 329 LU3 29551 13121 152 5333 26421 6889 051 137141427 270 UR6517 8486 821 7376094 7362 247 802111 245 SZ1 50422 48512 927 3531 46410 1404 334 234131223 220 OW66910 1875 860 7076424 7252 175 597112 500 NW4617 0413 726 7854453 8701 731 0410 GL3675 7924 308 7743653 3661 522 386127 950 ZG3686 1422 874 3613632 8311 186 09810465 FR1 82334 13812 497 6891 5207 1982 843 635171219 099 SO6039 8993 702 8275754 8221 847 1030 BL68710 7513 021 3686735 9622 297 260403764 260 SH1211 823305 033146839314 71212398162 210 AR75712 2247 052 1087546 6552 801 4763924 945 AI5578 6775 771 7785383 3871 411 6540 SG3 00148 78222 190 0052 91125 39410 583 19271102309 095 GR2 58539 25137 853 6472 52831 75713 862 707251739 360 AG1 11317 0063 428 2861 1387 3072 810 877136164281 550 TG1743 064955 7701481 154505 30481102154 455 TI6687 9936 511 8235633 1071 371 820184154313 170 VD1 28022 1439 423 4779735 7012 261 3714486982 430 855 VS2 29823 31121 119 2112 17412 3145 521 7041 3941 6715 938 808 NE78215 0268 993 5485913 5841 345 9365176151 795 GE00424976 170 JU77314 8397 747 3455883 5961 382 987212 400 Suisse3421852233428402289131984226452953080672905348610691076 Zone1 Plaine2 84750 4924 425 3352 0615 6482 275 5721 7942 3427 128 063 Collines7 495119 03830 509 4517 00437 47014 656 637213285732 664 ZM I7 101110 64848 963 5126 74346 68019 073 736194202605 079 ZM II8 484131 04589 386 3347 97761 60226 007 4665525972 022 715 ZM III5 46774 27168 730 0175 38747 57320 924 76411048161 850 ZM IV2 82436 83942 008 2422 81227 47912 369 892421140 705 1Assignation de la surface en fonction de la part principale de la SAU qu'une entreprise exploite dans une zone donnée Source:OFAG
Contributions écologiques – 2004
ANNEXE A33
Tableau 32a
Compensationécologique1Culturebiologique ExploitationsSurfaceTotalcontributionsExploitationsSurfaceTotalcontributions Nombrehafr.Nombrehafr. Canton ZH3 6069 13212 934 5123536 9192 180 776 BE12 24518 68818 211 6871 41320 8605 038 018 LU5 0698 4749 626 6783114 7741 209 433 UR6561 203620 53457752150 560 SZ1 6523 2732 890 3001582 499505 994 OW6931 093902 1102012 519506 133 NW492945741 76972997201 574 GL4051 058655 801921 660330 325 ZG5631 6341 768 109821 477325 960 FR3 1226 6217 400 6791112 185753 861 SO1 4064 2745 368 6411152 966753 955 BL9473 3974 485 7381282 834745 442 SH5601 6772 567 69518465203 187 AR706852692 9191402 481496 086 AI495558398 1243247093 701 SG4 2858 2438 821 3915198 9781 945 250 GR2 67114 1265 774 6731 43029 3346 019 378 AG3 0627 63410 427 0522103 9131 373 518 TG2 6285 2007 368 0422344 0731 486 359 TI8421 6171 218 9141041 573375 062 VD3 7719 79012 787 1591252 831978 375 VS2 1575 0672 977 1432744 3561 190 327 NE7151 8501 658 275481 283324 380 GE3051 1852 027 50555753 996 JU1 0483 1433 339 534863 040720 807 Suisse54101120737125664982631811329527962457 Zone2 Plaine23 09850 55072 811 3921 19421 4468 527 346 Collines7 96817 85221 504 63461610 6822 880 540 ZM I7 09211 61510 351 76981212 7342 802 653 ZM II8 08514 98610 571 3511 33923 5894 756 500 ZM III5 14013 5685 943 2431 40125 8755 231 058 ZM IV2 71812 1654 482 59395618 9693 764 360 1 Arbres fruitiers haute-tige convertis en ares 2 Assignation de la surface en fonction de la part principale de la SAU qu'une entreprise exploite dans une zone donnée Source:OFAG
Tableau 32b
Contributions écologiques – 2004
CultureextensivedecéréalesGarded'animauxderenteparticulièrement etdecolzarespectueusedel'espèce ExploitationsSurfaceTotalcontributionsExploitationsUGBTotalcontributions Nombrehafr.NombreNombrefr.
A34 ANNEXE
Canton ZH1 5726 2582 492 7572 13169 14510 447 221 BE5 12715 6546 259 7639 490235 58837 827 113 LU1 2843 3231 329 2203 997163 58124 438 563 UR0004216 4041 049 125 SZ203112 3801 06324 8644 038 749 OW231 38447511 7581 872 919 NW0002747 4181 164 990 GL0003017 4541 235 898 ZG8418071 82839815 3332 289 926 FR1 2735 8452 337 7022 586107 42116 735 552 SO7483 7811 505 9311 11234 5435 274 762 BL6303 0431 199 83758121 3343 237 679 SH3322 406944 83826611 5411 618 925 AR00062016 0252 678 927 AI00044112 2902 134 416 SG273624245 3572 92799 62115 874 939 GR189583233 0402 35256 6808 919 820 AG1 6416 7192 685 7271 83265 8329 928 078 TG8012 8871 154 5771 78371 79410 750 365 TI63283113 30468013 5712 130 634 VD1 97315 9346 364 6422 17784 24012 579 274 VS103293115 1581 23516 9282 797 373 NE3722 6351 052 94969028 5244 379 130 GE2143 2571 258 391732 456354 305 JU5623 6231 444 93393347 5626 892 322 Suisse172637736130823718388381231907190651005 Zone1 Plaine10 38554 10221 533 76214 693584 66187 547 091 Collines4 06314 7475 886 3165 948205 23931 811 278 ZM I2 0486 6532 660 3865 464160 55125 449 924 ZM II6651 735694 0336 478166 06726 909 857 ZM III8811445 6414 10477 92112 754 191 ZM IV1493 5802 15137 4686 178 664
1 Assignation de la surface en fonction de la part principale de la SAU qu'une entreprise exploite dans une zone donnée
Source:OFAG
Tableau 33a
Contributions à la compensation écologique – 2004
ANNEXE A35
PrairiesextensivesPrairiespeuintensives ExploitationsSurfaceTotalcontributionsExploitationsSurfaceTotalcontributions Nombrehafr.Nombrehafr. Canton ZH3 1464 6786 620 914995882560 599 BE7 5747 1177 175 7407 1275 9972 881 855 LU4 1283 7334 089 4881 9271 391708 879 UR393473228 347467558176 524 SZ1 020906668 390566465195 383 OW590655409 08919310746 327 NW387506314 91119115265 848 GL367750448 79515919372 645 ZG356355418 58023617493 048 FR1 9252 5423 328 3351 9412 6521 552 721 SO1 1852 2422 817 563567727416 751 BL7571 2371 468 393422511312 900 SH5271 0321 445 62514014090 944 AR367208151 064394254115 551 AI295202141 55716010547 479 SG2 8932 5652 762 2401 9551 362737 775 GR2 0215 1872 564 5242 3168 5232 618 446 AG2 5553 9575 368 8121 144949611 684 TG1 9541 8572 730 275972656423 612 TI517652554 156414708245 401 VD3 1035 1576 967 0751 2772 2001 151 027 VS9101 315885 6481 5543 0491 027 490 NE496853922 557359787364 627 GE2988561 283 31010159 915 JU7271 2541 503 1806261 101579 266 Suisse384915028855268568261123365915106698 Zone1 Plaine18 92325 21736 930 9237 9967 0494 521 643 Collines5 5746 6427 797 5884 1533 9302 467 395 ZM I4 0773 6502 683 0793 9123 3631 557 322 ZM II4 7254 9653 358 1024 3955 2292 290 937 ZM III3 2875 5982 588 4903 3986 5321 993 384 ZM IV1 9054 2161 910 3862 2587 5552 276 015 1Assignation de la surface en fonction de la part principale de la SAU qu'une entreprise exploite dans une zone donnée
Source:OFAG
Tableau 33b
Contributions à la compensation écologique – 2004
A36 ANNEXE
SurfacesàlitièreHaies,bosquetschampêtresetbergesboisées ExploitationsSurfaceTotalcontributionsExploitationsSurfaceTotalcontributions Nombrehafr.Nombrehafr. Canton ZH1 1721 3661 867 501972188271 149 BE755566355 7382 083434466 088 LU453342289 464550110146 335 UR585947 55721421 SZ8801 181942 6301721 647 OW1518579 9202021 464 NW12110284 9141821 641 GL594733 6361421 215 ZG308535418 7192826767 332 FR894749 344772232311 874 SO2041631989110 352 BL027083100 609 SH1068 7902456893 231 AR268189132 77061107 349 AI223196137 38964128 729 SG1 7621 8051 535 1874506474 800 GR774623 2691102521 330 AG12594138 3311 126319416 385 TG17094134 274477100148 031 TI294047 3912367 381 VD13411789 8631 053357481 441 VS43108 1621833829 824 NE542 5901174139 406 GE468 4601183451 165 JU301511 675333119122 070 Suisse692869506447989967924052981266 Zone1 Plaine1 8351 8762 753 7495 6331 3632 015 620 Collines830655785 9871 860486581 640 ZM I1 093839654 4551 019264190 432 ZM II2 0992 5731 777 176872236166 126 ZM III806735352 6862354722 878 ZM IV265272123 93560104 572
de la surface en fonction de la part principale de la SAU qu'une entreprise
zone donnée
1Assignation
exploite dans une
Source:OFAG
Contributions à la compensation écologique – 2004
1 Assignation de la surface en fonction de la part principale de la SAU qu'une entreprise exploite dans une zone donnée
ANNEXE A37
Tableau 33c
JachèresfloralesJachèrestournantes ExploitationsSurfaceTotalcontributionsExploitationsSurfaceTotalcontributions Nombrehafr.Nombrehafr. Canton ZH390300900 900116135337 125 BE309258772 7258788219 123 LU392161 890101639 825 UR000000 SZ113 0000 OW000000 NW000000 GL000000 ZG81030 330000 FR219242725 9304974185 366 SO7199295 7843352129 351 BL145122365 7605472180 500 SH171159477 6303543107 900 AR000000 AI000000 SG352676 860212 625 GR151442 5704921 925 AG413175525 750147156390 225 TG121104311 370293689 550 TI122163 72061537 675 VD4356411 924 320140197492 450 VS332679 3205511 600 NE3937110 070102664 000 GE6495284 67055120299 850 JU7378233 683182664 250 Suisse25932429728628280010692673340 Zone1 Plaine2 1772 0826 243 8766679042 260 830 Collines3993371 011 289127159398 287 ZM I12925 957338 748 ZM II424 770224 450 ZM III10390101 025 ZM IV000000
Source:OFAG
Tableau 33d
Contributions à la compensation écologique – 2004
1 Assignation de la surface en fonction de la part principale de la SAU qu'une entreprise exploite dans une zone donnée
A38 ANNEXE
BandesculturalesextensivesArbresfrutiershaute-tige ExploitationsSurfaceTotalcontributionsExploitationsArbresTotalcontributions Nombrehafr.NombreNombrefr. Canton ZH1233 7802 526158 2032 372 544 BE2457 0798 365422 3556 333 338 LU1122 8354 293285 8644 287 962 UR024311 179167 685 SZ101501 02971 9401 079 100 OW046024 354365 310 NW034918 297274 455 GL01466 63499 510 ZG050149 340740 100 FR845 6341 93682 7651 241 475 SO912 1601 157106 4251 596 264 BL0905137 1922 057 575 SH038222 905343 575 AR033819 079286 185 AI0784 19862 970 SG1022 7603 045241 9433 629 145 GR058832 174482 610 AG1445 7452 598198 0082 970 120 TG611 7402 184235 3203 529 190 TI023117 544263 190 VD161319 5902 077110 7601 661 393 VS083462 340935 100 NE018810 335155 025 GE402851135 99089 850 JU111 20066454 954824 210 Suisse116355295835230239009835847881 Zone1 Plaine983045 06617 0211 202 86518 039 684 Collines1857 8926 962563 6598 454 556 ZM I 5 726348 7855 231 776 ZM II 3 979197 9862 969 790 ZM III 1 30065 626984 390 ZM IV 24211 177167 685
Source:OFAG
Contributions versées en 2004 pour la qualité biologique et la mise en réseau
ANNEXE A39
Tableau 34
Seulementqualitébiologique1Seulementmiseenréseau1QualitébiologiqueetContributionsfédérales miseenréseau1 ExploitationsSurfaceExploitationsSurfaceExploitationsSurfaceExploitationsTotal contributions NombrehaNombrehaNombrehaNombrefr. Cantons ZH8079559431 3624205901 5921 549 227 BE1 4971 0324 6525 2292 4072 2965 9045 783 019 LU1 9401 8573014691201912 1772 154 636 UR25037135733579286270 604 SZ1 0201 5591051021533091 1351 110 018 OW28538424296484338265 966 NW2142079186168353347357 726 GL19038238742535231211 408 ZG39373820301823408450 202 FR23524634666192101582527 819 SO326602464300369326 852 BL82712365445289226311 191 416 SH11717655472416162113 584 AR2001095843122147281195 868 AI240231101324096 040 SG1 8742 3203105302313202 1411 759 909 GR 1 3034 2992921 8122802 4601 3951 608 708 AG2472244375444741 7227211 952 216 TG4923011 6941 4824073211 9071 480 916 TI20633225431561228198 928 VD1 0551 28344155001 063643 390 VS392692104500397332 186 NE2582998316100308200 410 GE17220000177 581 JU2274120000227 218 556 Suisse13867191059846135655584100302308723007184 Zone Plaine4 2783 9714 1944 8021 5982 0357 9637 308 756 Collines1 9371 8621 3681 7341 0211 9353 4314 179 333 ZM I1 7841 9361 3401 5517039063 1202 616 676 ZM II2 7714 0201 4031 8639721 3824 1643 561 312 ZM III1 8213 8931 0491 8198691 7072 8083 016 575 ZM IV1 2763 4234921 7964212 0651 6012 324 531 1 Arbres fruitiers haute-tige convertis en ares Source:OFAG
Tableau 35
Contributions pour la culture extensive de céréales et de colza – 2004
A40 ANNEXE
CéréalespanifiablesCéréalesfourragèresColzaTotal ExploitationsSurfaceExploitationsSurfaceExploitationsSurfaceTotalcontributions NombrehaNombrehaNombrehafr. Canton ZH1 2054 0949901 7861853792 492 757 BE3 0787 5004 1827 7542244006 259 763 LU7771 4489511 700861741 329 220 UR0000000 SZ3319271112 380 OW221101 384 NW0000000 GL0000000 ZG28586110861471 828 FR7793 0159882 5041113262 337 702 SO5341 9006201 724801571 505 931 BL4741 5435391 387431121 199 837 SH3191 90315840351100944 838 AR0000000 AI0000000 SG811712284181434245 357 GR1102951442611227233 040 AG1 3333 9971 2122 5141222082 685 727 TG6732 015451755651171 154 577 TI3616738102314113 304 VD1 2338 1321 4975 3767812 4266 364 642 VS67208587915115 158 NE1657623541 678631951 052 949 GE1892 052175907702981 258 391 JU3141 6094541 765652491 444 933 Suisse114004087713120312491983523630823718 Zone1 Plaine7 88232 5567 04117 1831 6104 36421 533 762 Collines2 5626 4003 4767 6663056815 886 316 ZM I7991 6771 9014 800621762 660 386 ZM II1252146141 507614694 033 ZM III262876860045 641 ZM IV63126003 580 1 Assignation de la surface en fonction de la part principale de la SAU qu'une entreprise exploite dans une zone donnée
Source:OFAG
Tableau 36
Contributions pour la garde d'animaux particulièrement respectueuse de l'espèce – 2004
ANNEXE A41
respectueuxdesanimaux ExploitationsUGBTotalcontributionsExploitationsUGBTotalcontributions NombreNombrefr.NombreNombrefr. Canton ZH1 21625 9502 754 6992 00143 1957 692 522 BE4 25865 6727 784 5889 187169 91630 042 525 LU2 79566 9198 081 7693 82996 66216 356 794 UR1151 211117 1364195 194931 989 SZ3815 930651 9911 04518 9353 386 758 OW2203 564401 8204668 1941 471 099 NW1522 646325 4192644 772839 571 GL791 349138 9883016 1051 096 910 ZG2425 867617 2943829 4661 672 632 FR1 65836 3514 105 8362 46071 07012 629 716 SO66011 7371 267 9421 05322 8064 006 820 BL3538 207886 81456213 1272 350 865 SH1996 203722 3272165 338896 598 AR1912 995348 89361713 0302 330 034 AI1603 160494 7074369 1301 639 709 SG1 28730 1743 538 6882 86569 44712 336 251 GR80314 6841 386 4282 35041 9967 533 392 AG1 18027 6503 180 9591 69338 1826 747 119 TG1 03429 1143 281 5801 67742 6807 468 785 TI1953 338306 96367610 2341 823 671 VD1 25231 2823 191 1432 06152 9589 388 131 VS2022 629247 9691 22214 2992 549 404 NE3268 606855 48368119 9183 523 647 GE3294694 404721 510259 901 JU58717 9991 733 34291129 5635 158 980 Suisse195774141834651718237446817724144133823 Zone1 Plaine9 144235 20226 710 11713 807349 45960 836 974 Collines3 48773 0788 519 9945 713132 16123 291 284 ZM I2 65446 0965 116 4985 352114 45520 333 426 ZM II2 57238 5124 163 7186 367127 55522 746 139 ZM III1 21414 8201 405 9784 06963 10111 348 213 ZM IV5066 475600 8772 13830 9935 577 787
la part
la
Source:OFAG
SystèmesdestabulationparticulièrementSortiesrégulièresenpleinair
1 Assignation de la surface en fonction de
principale de
SAU qu'une entreprise exploite dans une zone donnée
Tableau 37
Participation au programme SST – 2004 Base1ParticipationSST
A42 ANNEXE
CatégorieanimaleUGBExploitationsUGBExploitationsUGBExploitations NombreNombreNombreNombre%% Animaux d'élevage et de rente: Vaches laitières605 06337 088140 3555 71223.215.4 Génisses de plus d'un an142 20135 64440 5087 96228.522.3 Taureaux de plus d'un an5 1317 8661 5272 08229.826.5 Jeune bétail femelle,4 à 12 mois31 14027 8458 9576 27328.822.5 Jeune bétail mâle,4 à 12 mois1 9123 70520537110.710.0 Veaux d'élevage,de moins de 4 mois23 57424 5089 6638 09741.033.0 Vaches allaitantes: Vaches mères et nourrices avec leurs veaux63 4955 93150 7553 75779.963.3 Engraissement: Génisses,taureaux et boeufs de plus de 4 mois38 1927 13422 3372 70158.537.9 Veaux de moins de 4 mois3 9056 2662 1351 84454.729.4 Veaux à l'engrais10 91217 6245 3264 68148.826.6 Totalbovins925526447152817671680130.437.6 Chèvres8 5416 1192 32073427.212.0 Lapins5523 9078917716.14.5 Totalautresanimauxconsommantdesfourragesgrossiers90949160241086626.59.5 Porcs d'élevage de plus de 6 mois et porcelets58 6364 88532 0421 80154.636.9 Porcs de renouvellement,jusqu'à 6 mois,et porcs à l'engrais98 9949 70963 3263 87264.039.9 Totalporcs1576301168995368467260.540.0 Poules et coqs d'élevage8872 0222457427.63.7 Poules pondeuses17 56413 86413 7591 88778.313.6 Poulettes,jeunes coqs et poussins2 2975041 56211168.022.0 Poulets de chair20 5251 11417 42480484.972.2 Dindes2 1362932 04110195.634.5 Totalvolaille434101558235030279080.717.9 Totaltoutescatégoriesconfondues1135659481344145741956736.540.7 1 Exploitations ayant droit aux contributions (exploitations ayant touché des paiements directs) Source:OFAG
Tableau 38
Participation au programme SRPA – 2004
Base1ParticipationSRPA
ANNEXE A43
CatégorieanimaleUGBExploitationsUGBExploitationsUGBExploitations NombreNombreNombreNombre%% Animaux d'élevage et de rente: Vaches laitières605 06337 088443 17824 89473.267.1 Génisses de plus d'un an142 20135 64497 41322 47068.563.0 Taureaux de plus d'un an5 1317 8662 5893 97850.550.6 Jeune bétail femelle,4 à 12 mois31 14027 84518 57416 40459.658.9 Jeune bétail mâle,4 à 12 mois1 9123 7055431 12628.430.4 Veaux d'élevage de moins de 4 mois23 57424 5086 1126 11125.924.9 Vaches allaitantes: Vaches mères et nourrices avec leurs veaux63 4955 93158 7454 92592.583.0 Engraissement: Génisses,taureaux et boeufs de plus de 4 mois38 1927 13417 6403 10246.243.5 Veaux de moins de 4 mois3 9056 2669711 25324.920.0 Veaux à l'engrais10 91217 6241 0331 6319.59.3 Totalbovins925526447156467983165869.970.8 Equidés33 28711 47627 4788 26782.672.0 Moutons38 9769 87031 1116 78379.868.7 Chèvres8 5416 1195 9272 98869.448.8 Daims et cerfs rouges63519852714883.074.7 Bisons1701117011100.0100.0 Lapins5523 907212653.86.8 Totalautresanimauxconsommantdesfourragesgrossiers8216021859652331483979.467.9 Porcs d'élevage de plus de 6 mois et porcelets58 6364 88531 0691 86553.038.2 Porcs de renouvellement,jusqu'à 6 mois,et porcs à l'engrais98 9949 70958 9763 80659.639.2 Totalporcs1576301168990045469857.140.2 Poules et coqs d'élevage8872 02210121811.410.8 Poules pondeuses17 56413 86410 8343 57261.725.8 Poulettes,jeunes coqs et poussins2 2975043839216.718.3 Poulets de chair20 5251 1141 9972019.718.0 Dindes2 1362932 03412995.344.0 Totalvolaille434101558215349391335.425.1 Totaltoutescatégoriesconfondues1208726511918174263743067.673.1 1 Exploitations ayant droit aux contributions (exploitations ayant touché des paiements directs)
Source:OFAG
Tableau 39a
Contributions d'estivage – 2004
CantonsMoutons,Vachestraites,brebislaitières,AutresanimauxconsommantExploitationset brebislaitièresexceptéeschèvreslaitières1desfourragesgrossierscontributions,total ExploitationsChargedonnantExploitationsUGBdonnantExploitationsChargedonnantExploitationsContributions droitauxdroitauxdroitaux
A44 ANNEXE
contributionscontributionscontributions PâquiersPâquiers NombrenormauxNombreUBGNombrenormauxNombrefr. ZH000084598 137 697 BE1882 23352613 1711 58748 3531 69018 789 820 LU43370582842456 0392501 947 942 UR811 5002243 9752423 0603502 376 418 SZ516142722 7374279 6914573 845 553 OW22203537432458 2772622 739 626 NW19190151381284 1391341 317 151 GL1545861481126 6131202 123 498 ZG0013102301069 945 FR526001301 98359721 7426307 217 073 SO25315582 54058766 930 BL00001041510 124 629 SH00000000 AR11283061152 457116828 358 AI9951051 4861401 8771461 020 915 SG411 1721414 43843516 5504496 539 853 GR1978 24340514 62390532 6741 05815 941 097 AG42800843211 134 665 TG0000280223 103 TI761 769774 0791773 8512672 702 981 VD297611935264332 2856569 984 756 VS1705 9851295 66443215 9355257 492 928 NE2794971504 3281541 345 317 GE11100013234 061 JU21232128411 776843 561 327 Total1005245402198542576761233807744991065643 1 Animaux traits avec une durée d'estivage de 56 à 100 jours Source:OFAG
Tableau 39b
Statistique sur l'estivage en 2004:exploitations et pâquiers normaux par canton
ANNEXE A45
CantonsVacheslaitièresVachesmèresAutresbovinsChevauxMoutonsChèvresAutres etnourrices Exploita-ChargeExploita-ChargeExploita-ChargeExploita-ChargeExploita-ChargeExploita-ChargeExploita-Charge tionstionstionstionstionstionstions NombrePNNombrePNNombrePNNombrePNNombrePNNombrePNNombrePN ZH00168836310001200 BE1 15026 0852362 0071 53925 7232439422052 982527803728 LU991 220564482483 878276349383423612 UR2273 812312911742 025116821 52766235 SZ2793 019705704226 466471265764010525010 OW2114 440101622403 161223725268495129107 NW881 681131291251 920121218252286218106 GL1053 825222581102 281263015410365857113 ZG229251017710000000 FR3187 2818693559513 771882206284814322433 SO1315422345601 826134631441 BL0045510313123001100 SH00000000000000 AR791 3044321101 11612211143441335 AI1211 5921381 2704299248971982 SG2937 365749654239 2904265451 082149267510 GR45214 0114346 85380718 0282346572117 8241481 06453 AG003478346005780000 TG000027300000000 TI1163 866443761331 12665186972 1501231 8347750 VD37613 2281782 85061414 425105288359806814141 VS33513 516801 1373545 740501471855 9827248500 NE56868313391452 883251123882100 GE0000001311100000 JU333 827331 031834 966331 36031012711 Total435311112314341890463581211691063434711112581316575664240541 Un pâquier normal (PN) = 1 UGB * durée d'estivage / 100 Source:OFAG
Paiements directs par exploitation 1:selon les zones et les classes de grandeur – 2004
A46 ANNEXE
Tableau 40a
ParamètreUnité10–2020–3030–5010–2020–3030–50 haSAUhaSAUhaSAUhaSAUhaSAUhaSAU Exploitations de référenceNombre61746417520711140 Exploitations retenuesNombre8 9305 4332 9662 8811 532712 Surface agricole utileha15.3724.2335.6615.0823.9136.53 Paiements directs selon l'ordonnance sur les paiements directs (OPD) Paiementsdirectsgénérauxtotalfr.239223657851715284004428662675 Contributions à la surfacefr.20 83932 96847 49019 25731 02645 476 Contributions pour animaux consommant des fourrages grossiersfr.2 4852 9173 5592 9175 6948 580 Contributions pour la garde d'animaux dans des conditions difficilesfr.3603904044 3574 6615 247 Contributions pour des terrains en pentefr.2383022621 8692 9043 372 Totalcontributionsécologiquesetéthologiquesfr.7052101111472775781020513142 Compensation écologiquefr.2 4193 3065 3142 2133 2084 252 Culture extensivefr.6871 0851 7995929241 630 Culture biologiquefr.426510960479898269 Contributions éthologiquesfr.3 5205 2106 6544 2945 1766 990 Total paiements directs selon OPDfr.30 97446 68966 44235 97854 49075 816 Rendement brutfr.201 766288 664375 215184 482242 648328 900 Part des paiements directs selon OPD au rendement brut%15.416.217.719.522.523.1 Autres paiements directs 2 fr.1 9742 6725 1641 7522 9015 506 Total paiements directsfr.32 94849 36171 60737 73157 39181 322 Part du total des paiements directs au rendement brut%16.317.119.120.523.724.7 1 Les résultats se fondent sur les données du dépouillement centralisé de Agroscope FAT Tänikon 2 Contributions d'estivage,primes de culture,autres contributions Source:Agroscope FAT Tänikon
ZonedeplaineZC
Paiements directs par exploitation 1:selon les zones et les classes de grandeur – 2004
ANNEXE A47
Tableau 40b
ZMIZMII ParamètreUnité10–2020–3030–5010–2020–3030–50 haSAUhaSAUhaSAUhaSAUhaSAUhaSAU Exploitations de référenceNombre2221124721412250 Exploitations retenuesNombre3 3161 2837682 9931 544915 Surface agricole utileha15.1024.0936.8914.8024.2936.84 Paiements directs selon l'ordonnance sur les paiements directs (OPD) Paiementsdirectsgénérauxtotalfr.345774830266264390675613070822 Contributions à la surfacefr.18 55129 51544 33717 64329 35243 065 Contributions pour animaux consommant des fourrages grossiersfr.4 9715 8008 0595 7458 6429 146 Contributions pour la garde d'animaux dans des conditions difficilesfr.7 7779 0579 33911 78513 44213 689 Contributions pour des terrains en pentefr.3 2773 9304 5303 8934 6934 922 Totalcontributionsécologiquesetéthologiquesfr.62479713122535489824110659 Compensation écologiquefr.1 4632 0622 4241 3001 5311 471 Culture extensivefr.1874101 38318101365 Culture biologiquefr.8809316848821 4362 568 Contributions éthologiquesfr.3 7186 3107 7613 2895 1736 256 Total paiements directs selon OPDfr.40 82358 01578 51744 55664 37181 481 Rendement brutfr.154 345241 154296 055144 234199 672260 718 Part des paiements directs selon OPD au rendement brut%26.424.126.530.932.231.3 Autres paiements directs 2 fr.1 6422 3744 1283 7574 7194 217 Total paiements directsfr.42 46560 38982 64548 31369 08985 698 Part du total des paiements directs au rendement brut%27.525.027.933.534.632.9 1Les résultats se fondent sur les données du dépouillement centralisé de Agroscope FAT Tänikon 2 Contributions d'estivage,primes de culture,autres contributions Source:Agroscope FAT Tänikon
Paiements directs par exploitation 1:selon les zones et les classes de grandeur – 2004
A48 ANNEXE
Tableau 40c
ZMIIIZMIV ParamètreUnité10–2020–3030–5010–2020–3030–503 haSAUhaSAUhaSAUhaSAUhaSAUhaSAU Exploitations de référenceNombre110652972296 Exploitations retenuesNombre1 6899155691 288400 Surface agricole utileha14.6123.8835.6914.8724.86 Paiements directs selon l'ordonnance sur
paiements
Paiementsdirectsgénérauxtotalfr.4484266024871114967171200 Contributions à la surfacefr.16 93228 68341 19117 59129 760 Contributions pour animaux consommant des fourrages grossiersfr.9 46713 22317 3439 86412 330 Contributions pour la garde d'animaux dans des conditions difficilesfr.13 83817 84320 33017 02921 662 Contributions pour des terrains en pentefr.4 6046 2758 2485 1887 448 Totalcontributionsécologiquesetéthologiquesfr.440871801191543559055 Compensation écologiquefr.1 1191 3012 8571 3712 259 Culture extensivefr.084400 Culture biologiquefr.9911 8452 7149362 803 Contributions éthologiquesfr.2 2984 0266 3002 0493 993 Total paiements directs selon OPDfr.49 25073 20499 02654 02680 255 Rendement brutfr.116 654172 238227 440120 154190 326 Part des paiements directs selon OPD au rendement brut%42.242.543.545.042.2 Autres paiements directs 2 fr.3 6044 4007 7855 3547 882 Total paiements directsfr.52 85477 604106 81159 38088 138 Part du total des paiements directs au rendement brut%45.345.147.049.446.3 1 Les résultats se fondent sur les données du dépouillement centralisé de Agroscope FAT Tänikon 2 Contributions d'estivage,primes de culture,autres contributions 3 L'échantillon étant trop restreint,nous ne présentons pas de résultats Source:Agroscope FAT Tänikon
les
directs (OPD)
Tableau 41
Paiements directs par exploitation 1:selon les régions – 2004
ANNEXE A49
ParamètreUnitéTouteslesRégionRégionRégion exploitationsdeplainedescollinesdemontagne Exploitations de référenceNombre3 0771 435846796 Exploitations retenuesNombre50 97623 05914 01313 904 Surface agricole utileha19.2520.0718.5218.63 Paiements directs selon l'ordonnance sur les paiements directs (OPD) Paiementsdirectsgénérauxtotalfr.36888303043646248235 Contributions à la surfacefr.24 47826 97122 83122 002 Contributions pour animaux consommant des fourrages grossiersfr.4 8712 7344 8828 405 Contributions pour la garde d'animaux dans des conditions difficilesfr.5 4513326 02913 360 Contributions pour des terrains en pentefr.2 0882682 7204 467 Totalcontributionsécologiquesetéthologiquesfr.7702863778086045 Compensation écologiquefr.2 2472 9452 0311 306 Culture extensivefr.57289455259 Culture biologiquefr.7224896081 223 Contributions éthologiquesfr.4 1614 3094 6163 457 Total paiements directs selon OPDfr.44 59038 94144 27054 280 Rendement brutfr.215 341263 974196 665153 507 Part des paiements directs selon OPD au rendement brut%20.714.822.535.4 Paiements directs par hafr./ha2 3161 9412 3902 913 Autres paiements directs 2 fr.2 8952 6222 2713 977 Total paiements directsfr.47 48541 56346 54058 257 Part du total des paiements directs au rendement brut%22.115.723.738.0 1Les résultats se fondent
2 Contributions d'estivage,primes de culture,autres contributions Source:Agroscope FAT Tänikon
sur les données du dépouillement centralisé de Agroscope FAT Tänikon
Tableau 42a
Contrôles PER – 2004
Si le nombre des exploitations contrôlées est > au nombre des exploitations ayant droit aux paiements directs,ce canton compte plus d'exploitations annoncées que d'exploitations ayant droit aux paiements directs
et rapports cantonaux sur les activités de contrôle et les sanctions en 2004
A50 ANNEXE
Réclamations Nombre%NombreNombreNombre ZH3 63954.31 97607413615724180375316 BE12 53867.28 4297143296139 1160233 LU5 09480.54 103093224974521399627615 UR65856.7373214 4400000125 SZ1 67458.898585038132 0000102 OW70170.54940195533400037121 NW49442.72110327212 000035 GL41159.62453510 5200000759 ZG56547.326765 72010001637 FR3 19736.41 1650118 29772116153 SO1 417101.71 441025164114 207069 BL95199.694705 5209000324 SH57778.745406 41044131336 AR76364.148902113600 000848 AI56861.434904316700 000268 SG4 33846.32 00809424111 000039 GR2 70124.1652511103330005489 AG3 086421 29411731165122160545364 TG2 67768.21 827301593524251054175377 TI90972.666094624211000157240 VD3 99745.81 83114474133418783614222 VS3 786622 3467512100000364 NE93645.742872210130022258 GE30989.327675 01131321841 JU1 0904144701341303201054 CH57076336971218749922788423666282375133489
Source:SIPA
Canton Exploitations ayant droit aux PD (chiffres tirés du Rapport agricole 2004) Exploitations contrôlées en % de toutes les exploitations ayant droit aux contributions Exploitations contrôlées Annonce tardive Garde des animaux de rente respectueuse de l'espèce Enregistrements Bilan de fumure équilibré Part convenable de surfaces de compensation écologiques Bandes tampons / Bandes herbeuses Assolement régulier Protection du sol appropriée Sélection et application ciblée des produits phytosanitaires Autres Total des réclamations
Tableau 42b
Contrôles PER – 2004
Si le nombre des exploitations contrôlées est > au nombre des exploitations ayant droit aux paiements directs,ce canton compte plus d'exploitations annoncées que d'exploitations ayant droit aux paiements directs
Source:SIPA et rapports cantonaux sur les activités de contrôle et les sanctions en 2004
ANNEXE A51
%%Nombre%%fr.fr. ZH8.7016.001674.68.52 786.0465 250 BE1.902.802171.72.61 036.9225 006.25 LU12.1015.002003.94.91 984.60396 913 UR3.806.70253.86.71 49637 400 SZ6.1010.40573.45.81 680.1095 766 OW17.3024.50223.14.51 10024 200 NW7.1016.6040.81.91 5646 256 GL14.4024.104611.218.8547.1025 167 ZG6.5013.9091.63.46 580.2059 222 FR4.8013.101996.217.11 350.25268 700 SO4.904.80493.5 3.42 012.1098 594 BL2.502.50242.52.51 41233 889 SH6.207.90305.26.61 092.3032 769 AR6.300.80222.94.51 549.3034 084 AI12.0019.5040711.5893.935 755 SG0.901.90491.12.41 134.855 603 GR3.3013.70341.35.26 991.6237 714 AG11.8028.102839.222.0665.7188 395 TG14.1020.60782.94.31 432.6111 740 TI26.4036.4012013.218.21 435.3172 240 VD6.0012.101172.96.41 166.3136 461 VS1.702.70581.52.5910.452 804 NE6.2014.0070.71.6997.76 984 GE13.3014.90268.49.4640.616 655 JU5.0012.10131.22.91 427.118 552 CH18961605.6980686
Canton Taux de réclamation concernant les exploitations ayant droit aux paiements directs Taux de réclamation concernant les exploitations contrôlées Exploitations sanctionnées par des réductions Exploitations ayant droit aux paiements directs et sanctionnées par des réductions Exploitations contrôlées et sanctionnées par des réductions Montant de la réduction par exploitation sanctionnée Total des réductions
Dépenses Amélioration des bases de production
Tableau 43
Contributions versées aux cantons – 2004
A52 ANNEXE
CantonAméliorationsfoncièresBâtimentsagricolesTotal fr.fr.fr. ZH1 758 068600 6002 358 668 BE8 972 3936 933 90015 906 293 LU3 636 6381 488 4005 125 038 UR551 165727 0001 278 165 SZ1 630 106914 2002 544 306 OW227 000767 000994 000 NW517 260225 226742 486 GL373 277273 400646 677 ZG71 402343 300414 702 FR4 451 7492 946 4007 398 149 SO2 028 868496 1002 524 968 BL227 365482 200709 565 SH263 705120 700384 405 AR1 191 451513 9001 705 351 AI596 585539 1001 135 685 SG3 590 8452 495 1256 085 970 GR17 936 3073 969 60021 905 907 AG623 000419 1001 042 100 TG764 24227 500791 742 TI2 231 0241 444 1003 675 124 VD5 686 5461 006 3006 692 846 VS3 230 5091 422 7824 653 291 NE793 4501 369 8002 163 250 GE14 00014 000 JU2 308 2201 233 2973 541 517 Divers74 00074 000 Total637491753075903094508205 Source:OFAG
Tableau 44
Contributions pour des projets approuvés,par mesure et par région – 2004
ANNEXE A53
MesuresContributionsFrais totaux RégionRégionRégionTotalTotal deplainedescollinesdemontagne 1000fr. Améliorationsfoncières Remaniements parcellaires (y compris infrastructures)9 2723 8697 26120 40258 845 Construction de chemins2101 86811 08913 16743 340 Autres installations de transport1'0101'0103 696 Mesures concernant le régime hydrique du sol1 8263538553 03410 245 Adductions d'eau1 4848 3479 83140 488 Raccordements au réseau électrique2614417033 213 Réfection et préservation de différents objets3584 2444 60212 293 Documentation41 9501 9545 896 Remise en état périodique322966811 0084'821 Total1134484893587655709182838 Constructionsrurales Bâtiments d'exploitation destinés aux animaux consommant des fourrages grossiers9 43114 95224 383165 813 Bâtiments d’alpages201 7861 80612 744 Bâtiments communautaires pour transformation et stockage5699851 55411 842 Total100201772227743190399 Totalgénéral11344185095359983452373237 Source:OFAG
Crédits
A54 ANNEXE
Tableau 45
CantonMesuresMesuresTotal collectivesindividuelles CréditsdeconstructionCréditsd'investissementsCréditsd'investissements Nombre1000fr.Nombre1000fr.Nombre1000fr.Nombre1000fr. ZH670312119 73912720 442 BE124 200141 81131540 02834146 039 LU52 25591 93425531 95126936 140 UR1150151 446161 596 SZ22095455576 698647 362 OW14723118283 503324 093 NW21 5551120181 863213 538 GL 88618861 ZG 192 396192 396 FR203 87015222 31617226 186 SO142497 007507 049 BL3213385 224415 437 SH190344 726354 816 AR125414 270424 295 AI112292 989303 001 SG41 03061 35020526 98521529 365 GR74 420770712315 05413720 181 AG327010714 15411014 424 TG1509113 0359213 085 TI13503191151 978192 519 VD3547245 85112216 50714922 906 VS186 423293 285479 708 NE5578476 503527 081 GE4930227561 205 JU7591586 881657 472 Total38151881432633419782596732159301196 Source:OFAG
d'investissements approuvés par les cantons – 2004
Tableau 46
Crédits d'investissements accordés en 2004 par catégorie de mesures (sans les crédits de construction)
ANNEXE A55
CantonAideAchatdeDiversi-MaisonBâtimentMesuresTransformationAméliora-Total initialel'exploitationficationd'habitationd'exploitationcollectives1etstockagetions parledeproduitsfoncières fermieragricolesen commun 1000fr. ZH6 7802002631 91410 58220549820 442 BE12 2681 20213410 38816 0371 67114041 839 LU9 7802063338 64212 991601 62624833 885 UR1226906341 446 SZ1 620482 6032 427903657 153 OW9901 3181 19589293 621 NW5708364571201 983 GL270155436861 ZG6902971 4092 396 FR7 8604353 40510 616882 97181126 186 SO1 7401689304 168427 049 BL1 3794502303 165157565 437 SH1 9447332 049904 816 AR1 4811 6421 147254 295 AI7807461 463123 001 SG8 9101002925 46012 2231 19415628 335 GR3 5984522965 0265 6823267515 761 AG4 5904911 8097 26415012014 424 TG5 6702411 2565 8685013 085 TI1501 8284598482 169 VD5 7002 1118 6965564 99530022 358 VS5701 0951 620305 8135809 708 NE1 7255481 5302 700285507 081 GE2752307001 205 JU1 440608684 513166254007 472 Total8047738092110538341194441689213283317286007 1Achat de cheptel en commun,prêt
démarrage
organisations
paysanne
de
pour
d'entraide
Source:OFAG
Prêts autorisés par les cantons au titre de l'aide aux exploitations – 2004 (parts de la Confédération et du canton)
A56 ANNEXE
Tableau 47
CantonNombreSommeParcasDuréed'amortissement 1000fr.1000fr.Ans ZH8 91511414 BE18 2 83015715 LU30 4 43414818 UR1 21021014 SZ9 99111014 OW1 20420417 NW GL ZG FR14 1 70012110 SO10 8478510 BL5 278568 SH8 4806010 AR1 12012015 AI1 12418 SG20 1 9089515 GR8 7289118 AG6 415699 TG8 700888 TI6 74612413 VD37 5 90015912 VS6 1 62527116 NE12 9097610 GE10 575585 JU152 4 536305 Total37131175Ø:84Ø:10 Source:OFAG
ANNEXE A57 Tableau 48a Aperçu des contributions MesureProjetsapprouvés,en1000fr. 200220032004 Contributions7721410592683452 Remaniements parcellaires avec aménagement de l'infrastructure22 68721 99020 402 Construction de chemins 9 24315 05113 167 Adductions d'eau 5 5669 0929 831 Autres mesures foncières 5 68430 98312 309 Bâtiments d'exploitation pour animaux consommant des fourrages grossiers31 41025 71526 189 Autres mesures liées aux constructions rurales2 6243 0951 554 Source:OFAG Tableau 48b Aperçu des crédits d'investissements et des prêts au titre d'aide aux exploitations MesureCréditsautorisés,en1000fr. 200120022003 Créditsd'investissements1283412249509286007 Aide initiale 89 52086 80780 477 Achat de l'exploitation par le fermier5 5355 0183 809 Diversification 2 109 Maisons d'habitation 44 86640 67053 834 Bâtiments d'exploitation128 221105 020119 444 Achat de cheptel,transformation et stockage de produits agricoles en commun10 5839 13723 017 Améliorations foncières 4 6872 8573 317 Prêtsautitredel'aideauxexploitations1351642981531175 1autorisés par le canton Source:OFAG
Aides financières allouées pour l'élevage – 2004 EspèceanimaleetmesuresMontantAnimauxinscritsOrganisations auherd-bookd'élevage fr.Nombre Bovins138620005434818 Tenue du herd-book2 717 000 Contrôles de performance laitière et carnée10 480 000 Appréciations de la conformation664 000 Chevaux11070004677123 Porcs1650500159802 Moutons1098500904776 Chèvresetbrebislaitières833000258094 Elevage d'animaux inscrits au herd-book587 000 Contrôles de performance laitière et carnée246 000 Racesmenacéesd'extinction8800001 Total19431000676603 1 poulains identifiés Sources:Compte d'Etat / Organisations d'élevage
Tableau 49
Remarque:la répartition des moyens financiers entre les différents domaines d'activité repose sur le compte d'Etat 1999.
C'est ainsi que les dépenses pour la mise en valeur des pommes de terre et des fruits ou celles de l'Administration des blés de 1990/92 ont été assimilées à celles de l'OFAG,alors qu'à l'époque,les comptes étaient encore séparés. Les chiffres de 1990/92 ne coïncident donc pas avec les données du compte d'Etat.Ceux de 2002 à 2004 toutefois sont de nouveau comparables.L'augmentation des dépenses d'administration s'explique par le fait que des prestations, par exemple celles liées à la caisse de pensions,ne sont plus centralisées,mais attribuées aux offices concernés.
1 Les dépenses dans ces domaines ont été regroupées conformément aux enveloppes financières.Ce regroupement a entraîné un changement concernant l'amélioration des bases de production,si bien que le total de cette rubrique n'est plus comparable avec celui des rapports agricoles précédents.
2 Les dépenses extraordinaires dans le secteur laitier sont incluses dans le montant.Elles ont été consenties au dépens d'autres domaines,tels que les améliorations structurelles ou la production animale.
Sources:Compte d'Etat,OFAG
A58 ANNEXE
50 Dépenses de la Confédération pour l'agriculture et l'alimentation,en 1'000 francs Domaine1990/922002200320041990/92–2002/04 % DépensesOFAG269944236844053547769354361333.1 Enveloppefinancière---359738034480043431795 Productionetventes116849949786202798028731419-50.4 Promotion des ventes58 79859 23463 674 Economie laitière1 127 273753 583559 979503 513-46.3 Economie animale133 90220 33724 85122 499-83.2 Production végétale423 819145 901153 964141 734-65.3 Paiementsdirects1772258242867324350002498348217.8 Paiements directs généraux758 3321 981 4321 980 0002 023 000163.1 Paiements directs écologiques13 926447 241455 000475 3483197.4 Améliorationdesbasesdeproduction11858361900872149762020288.9 Améliorations structurelles133 87990 000102 00094 508-28.7 Crédits d'investissements27 13670 00079 41876 463177.5 Aide aux exploitations paysannes9529 00011 7208 814934.1 Sélection végétale et élevage23 86921 08721 83822 243-9.0 Endehorsdesenveloppesfinancières---8632399765111818 Administration33 42953 59050 32252 06555.5 Vulgarisation et contributions à la recherche21 47623 73723 73623 64110.4 Lutte contre les maladies et parasites des plantes1 4498 9963 6411 709230.0 Contrôle du trafic des animaux/élimination des déchets de viande------22 06634 403--Autresdépenses3481633833653599893581935.5 Contributions à l'exportation pour produits agricoles transformés93 867114 900114 900114 90022.4 Allocations familiales dans l'agriculture77 99680 40081 20077 8002.3 Stations de recherches agronomiques96 431118 297121 685121 48724.9 Haras6 8437 1967 6407 76010.1 Autres73 02662 57234 56436 246-39.1 Totalagricultureetalimentation304760540677703907758390180629.9
Tableau
■■■■■■■■■■■■■■■■
Tableaux Aspects internationaux
UE-4:comprend les pays voisins Allemagne (D),France (F),Italie (I) et Autriche (A)
UE-5:UE-4 plus Pays-Bas (NL) ou Belgique (B)
UE-6:UE-4 plus Pays-Bas (NL) et Belgique (B)
D:République fédérale d'Allemagne (incluant l'ex-RDA à partir de 1991)
Note:certains chiffres sont calculés sur la base d'indices d'Eurostat
Sources:OFAG,OFS,USP,Banque Nationale Suisse,Eurostat,ZMP,Agreste,U.S.Department of Agriculture
ANNEXE A59
Tableau 51
ProduitPaysUnité1990/922002200320041990/92–2002/04 % LaitCHct./kg104.9778.3975.5474.63-27 UE-5ct./kg56.5546.8747.2946.66-17 - Dct./kg57.2846.2145.4645.26-20 - Fct./kg48.6744.9546.3545.04-7 - Ict./kg68.7651.9453.9654.35-22 - Act./kg66.6446.2745.1445.57-31 - NLct./kg57.9348.0148.0846.64-18 USAct./kg40.5741.5537.1043.901 TaureauxCHfr./kgPM9.287.238.198.17-15 UE-4fr./kg PM5.594.014.184.30-26 - Dfr./kg PM5.223.673.794.04-27 - Ffr./kg PM5.564.014.134.19-26 - Ifr./kg PM5.834.334.584.65-22 - Afr./kg PM6.493.934.094.14-38 USAfr./kg PM4.354.384.584.503 VeauxCHfr./kgPM14.3911.7712.1512.61-15 UE-5fr./kg PM8.657.087.918.32-10 - Dfr./kg PM8.987.999.109.48-1 - Ffr./kg PM8.948.038.819.38-2 - Ifr./kg PM8.816.407.057.18-22 - Afr./kg PM9.606.227.037.13-29 - NLfr./kg PM7.836.006.947.39-13 USAfr./kg PM5.055.715.325.7511 PorcsCHfr./kgPM5.834.474.694.54-22 UE-6fr./kg PM2.931.931.882.11-33 - Dfr./kg PM2.881.981.902.20-30 - Ffr./kg PM2.841.901.872.02-32 - Ifr./kg PM3.482.402.482.51-29 - Afr./kg PM3.181.661.541.79-48 - NLfr./kg PM2.641.611.571.84-37 - Bfr./kg PM3.011.961.842.09-35 USAfr./kg PM1.881.441.411.78-18 PouletsCHfr./kgPV3.722.722.722.67-27 UE-5fr./kg PV1.491.071.131.16-25 - Dfr./kg PV1.431.051.081.10-25 - Ffr./kg PV1.301.001.021.06-21 - Ifr./kg PV1.891.281.501.49-25 - Afr./kg PV2.291.181.221.24-47 - NLfr./kg PV1.360.930.960.96-30 USAfr./kg PV0.981.071.051.2414 OeufsCHfr./100pces33.2923.4423.4419.40-34 UE-5fr./100 pces10.678.4810.888.86-12 - Dfr./100 pces13.129.6413.6711.90-11 - Ffr./100 pces8.606.188.055.71-23 - Ifr./100 pces12.8611.6213.1912.59-3 - Afr./100 pces12.6713.3616.6715.4720 - NLfr./100 pces7.946.418.244.66-19 USAfr./100 pces7.557.828.437.264
Prix à la production des produits animaux Suisse – divers pays
Prix à la production des produits végétauxSuisse – divers pays
UE-4:comprend les pays voisins Allemagne (D),France (F),Italie (I) et Autriche (A)
UE-5:UE-4 plus Pays-Bas (NL) ou Belgique (B)
UE-6:UE-4 plus Pays-Bas (NL) et Belgique (B)
D:République fédérale d'Allemagne (incluant l'ex-RDA à partir de 1991)
1 Moyenne des 4 années (pour cause d'alternance) 1990/93 et variation 1990/93–2001/04
Note:certains chiffres sont calculés sur la base d'indices d'Eurostat
Sources:OFAG,OFS,USP,Banque Nationale Suisse,Eurostat,ZMP,Agreste,U.S.Department of Agriculture
A60 ANNEXE
Tableau 52a
ProduitPaysUnité1990/922002200320041990/92–2002/04 % BléCHfr./100kg99.3456.6361.1357.84-41 UE-4fr./100 kg28.5915.6517.6018.24-40 - Dfr./100 kg26.8114.8816.7816.93-40 - Ffr./100 kg28.3715.6417.7318.66-39 - Ifr./100 kg35.9220.9822.1123.58-38 - Afr./100 kg43.3014.3315.3013.79-67 USAfr./100 kg15.3219.2516.9816.3014 OrgeCHfr./100kg70.2444.8845.8244.26-36 UE-4fr./100 kg25.9713.5715.3515.82-43 - Dfr./100 kg24.4712.7214.4515.05-42 - Ffr./100 kg25.6713.9215.9716.21-40 - Ifr./100 kg34.5219.8821.3823.45-38 - Afr./100 kg36.0512.8913.2912.32-64 USAfr./100 kg12.3013.9814.0011.407 Maïs-grainCHfr./100kg73.5445.1746.3143.31-39 UE-4fr./100 kg33.7218.0820.2221.00-41 - Dfr./100 kg30.4415.8618.9518.22-42 - Ffr./100 kg29.6316.7818.6019.48-38 - Ifr./100 kg40.8021.3923.3225.41-43 - Afr./100 kg36.3714.6719.4713.92-56 USAfr./100 kg12.7613.1012.0112.06-3 PommesdeterreCHfr./100kg38.5534.9436.2133.38-10 UE-6fr./100 kg16.9915.1819.2318.824 - Dfr./100 kg13.6912.4121.8922.1437 - Ffr./100 kg15.5015.1011.6911.68-17 - Ifr./100 kg43.7949.0953.4947.6114 - Afr./100 kg30.3612.6322.7815.28-44 - NLfr./100 kg16.3112.6912.0415.60-18 - Bfr./100 kg12.498.5817.678.16-8 USAfr./100 kg18.0827.5818.3215.9314 BetteravessucrièresCHfr./100kg14.8411.6411.8711.85-21 UE-4fr./100 kg7.375.946.146.27-17 - Dfr./100 kg7.896.526.766.86-15 - Ffr./100 kg5.844.915.075.08-14 - Ifr./100 kg9.597.057.257.72-23 - Afr./100 kg9.216.857.117.21-23 USAfr./100 kg----ColzaCHfr./100kg203.6778.5681.6976.60-61 UE-4fr./100 kg48.7133.1636.0435.10-29 - Dfr./100 kg55.4532.2634.9135.43-38 - Ffr./100 kg41.7734.4637.6435.25-14 - Ifr./100 kg52.5323.8625.4824.83-53 - Afr./100 kg53.6928.0629.8729.11-46 USAfr./100 kg----Pommes:GoldenDelicious1CHfr./kg1.120.821.211.06-8 UE-5fr./kg0.790.580.630.62-25 - Dfr./kg1.070.570.660.62-44 - Ffr./kg0.680.560.570.62-17 - Ifr./kg0.750.630.690.65-15 - A (div.)fr./kg1.020.500.650.54-46 - Bfr./kg0.800.470.610.58-34 USA (div.)fr./kg0.660.820.730.7713
Prix à la production des produits végétaux
UE-4:comprend les pays voisins Allemagne (D),France (F),Italie (I) et Autriche (A)
UE-5:UE-4 plus Pays-Bas (NL) ou Belgique (B)
UE-6:UE-4 plus Pays-Bas (NL) et Belgique (B)
UE-4/6:Etats membres de l'UE limitrophes de la Suisse (D,F,I,A) plus,pour certains produits abondants dans ces pays,la Belgique (B) et/ou les Pays-Bas (NL).
D:République fédérale d'Allemagne (incluant l'ex-RDA à partir de 1991)
1 Moyenne des 4 années (pour cause d'alternance) 1990/93 et variation 1990/93–2001/04
2 Le «panier type» est composé sommairement de la production moyenne (1998–2000) suisse de 15 des 17 produits agricoles faisant l'objet de la présente comparaison internationale (tableaux 52 et 53).Les statistiques de prix des betteraves sucrières et du colza des USA n’étant pas disponibles,ces productions sont exclues du «panier type».Il représente 3,2 mio t.de lait,2,7 mio têtes de porcs,35,5 mio têtes de poulets,674,3 mio d'œufs,0,52 mio tonnes de blé,0,14 mio tonnes de pommes,etc.
Note:certains chiffres sont calculés sur la base d'indices d'Eurostat
Sources:OFAG,OFS,USP,Banque Nationale Suisse,Eurostat,ZMP,Agreste,U.S.Department of Agriculture
ANNEXE A61
Tableau 52b
Suisse –
pays ProduitPaysUnité1990/922002200320041990/92–2002/04 % PoiresI1CHfr./kg1.330.921.240.98-19 UE-5fr./kg0.960.770.820.66-22 - Dfr./kg1.100.610.680.69-38 - Ffr./kg1.091.001.150.81-9 - Ifr./kg0.900.660.690.57-28 - Afr./kg1.200.911.000.83-29 - Bfr./kg0.950.970.940.80-6 USAfr./kg0.570.610.620.6111 CarottesCHfr./kg1.091.281.341.2619 UE-6fr./kg0.520.560.570.579 - Dfr./kg0.480.440.430.43-9 - Ffr./kg0.440.520.630.6335 - Ifr./kg0.831.111.061.0630 - Afr./kg0.420.290.260.21-40 - NLfr./kg0.390.160.120.12-65 - Bfr./kg0.360.310.260.26-22 USAfr./kg0.410.680.600.5851 OignonsCHfr./kg0.891.211.251.1937 UE-5fr./kg0.540.460.540.54-5 - Dfr./kg0.300.250.310.31-3 - Ffr./kg0.600.720.860.8636 - Ifr./kg0.700.420.480.48-35 - Afr./kg0.250.230.240.21-9 - Bfr./kg0.210.370.310.3156 USAfr./kg0.400.460.580.4122 TomatesCHfr./kg2.422.322.692.372 UE-6fr./kg0.980.790.870.85-15 - Dfr./kg0.891.171.060.8314 - Ffr./kg1.311.351.460.95-4 - Ifr./kg0.900.650.760.76-19 - Afr./kg0.390.991.180.52127 - NLfr./kg1.251.211.211.02-9 - Bfr./kg1.221.280.892.0816 USAfr./kg1.001.121.111.2717 Paniertype2CHmio.defr./an7268545155795424-25 UE-4/6mio.de fr./an3 7152 8582 9612 997-21 Dmio.de fr./an3 7422 8502 9433 011-22 Fmio.de fr./an3 4132 8332 9372 926-15 Imio.de fr./an4 4493 3323 5113 515-22 Amio.de fr./an4 3792 7422 8152 802-36 USA mio.de fr./an2 5792 6382 4262 7331
divers
Prix
UE-4:comprend les pays voisins Allemagne (D),France (F),Italie (I) et Autriche (A)
Rubrique «Pays»:min.et max.-> prix minimal et prix maximal observés durant une année dans un pays donné
Note:la part des labels (Bio,M-7,Coop Natura Plan) présents dans les magasins,notamment dans le domaine de la viande,est plus élevée en Suisse qu’à l'étranger.
Sources:OFAG,OFS,ZMP,services statistiques nationaux de F,B,A,USA,service statistique de la ville de Turin (I)
A62 ANNEXE
Tableau 53
–
ProduitPaysUnité1990/922002200320041990/92–2002/04 % LaitdeconsommationCHfr./l1.851.561.531.54-17 EU-4fr./l1.301.131.161.16-11 - min (D:90/92,02,03,04)fr./l1.070.890.880.89-17 - max (I:90/92,02,03,04)fr./l1.821.831.961.884 USAfr./l1.041.130.981.041 FromageCH-Emmentalfr./kg20.1520.3320.8919.931 EU-4 (UE-4 avec B,sans F)fr./kg15.9812.3812.8212.89-21 - min (D:90/92,02,03,04)fr./kg13.529.909.879.74-27 - max (I:90/92,B:02,03,I:04)fr./kg20.6817.0018.2518.29-14 USA (Cheddar)fr./kg11.1414.4711.7111.7013 BeurreCHfr./kg13.7612.2411.9711.84-13 EU-4fr./kg9.047.647.957.99-13 - min (D:90/92,02,03,04)fr./kg6.815.165.265.31-23 - max (I:90/92,02,03,04)fr./kg12.9011.4011.8811.78-9 USAfr./kg5.9610.548.349.5559 CrèmeCHfr./1⁄4l3.582.792.912.91-20 EU-3 (UE-4 avec B,sans F et I)fr./ 1⁄4 l1.250.940.950.95-24 - min (D:90/92,02,03,04)fr./ 1⁄4 l1.130.860.850.85-25 - max (A:90/92,B:02,03,04)fr./ 1⁄4 l2.531.591.691.68-34 USAfr./ 1⁄4 l RôtidebœufCHfr./kg26.3426.3527.1628.564 EU-4fr./kg16.0014.4015.3716.17-4 - min (F:90/92,02,03,04)fr./kg11.8511.6912.4913.305 - max (A:90/92,02,03,04)fr./kg24.3222.6824.2024.78-2 USAfr./kg9.2611.9410.9410.1219 RôtideporcCHfr./kg18.4319.3519.9020.348 EU-4fr./kg11.8011.2011.4311.74-3 - min (A:90/92,02;D:03,04)fr./kg10.009.599.429.59-5 - max (I:90/92,02,03,04)fr./kg13.6713.2514.0514.482 USAfr./kg CôtelettesdeporcCHfr./kg19.8820.4021.3220.494 EU-4fr./kg10.629.399.669.94-9 - min (D:90/92,02,03,04)fr./kg9.718.548.558.83-11 - max (I:90/92,02;A:03,04)fr./kg12.4310.3610.8811.25-13 USAfr./kg10.0211.679.278.43-2 JambonCHfr./kg25.5630.2429.9931.1419 EU-4fr./kg22.1320.2120.6621.24-6 - min (D:90/92,02,03,04)fr./kg20.3818.6518.6918.87-8 - max (I:90/92,02,03,04)fr./kg27.1523.9926.3028.02-4 USAfr./kg8.859.678.578.360 PouletfraisCHfr./kg8.419.358.909.018 EU-4fr./kg5.725.055.205.23-10 - min (F:90/92,02,03,04)fr./kg4.844.074.234.45-12 - max (I:90/92,02,03,04)fr./kg6.175.906.656.674 USAfr./kg2.743.683.072.9318 OeufsCHfr./pces0.570.610.610.639 EU-4 (UE-4 avec B,sans F)fr./pces0.250.240.260.274 - min (B:90/92,02,03,04)fr./pces0.220.220.250.233 - max (A:90/92,02,03,04)fr./pces0.330.340.370.3911 USAfr./pces0.100.140.120.1118
à la consommation des produits animaux
Suisse
divers pays
Prix à la consommation des produits végétaux et du panier standard
Suisse – divers pays
Moyenne basse de l'UEfr./panier1314114211671185-11
Moyenne haute de l'UEfr./panier2102187320012049-6 USA 2fr./panier110814651238120818
UE-4:comprend les pays voisins Allemagne (D),France (F),Italie (I) et Autriche (A) Rubrique «Pays»:min.et max.-> prix minimal et prix maximal observés durant une année dans un pays donné
1Moyenne des 4 années (pour cause d'alternance) 1990/93 et variation 1990/93–2001/04
2 Faute de statistiques sur les prix de la crème (32,27 boîtes de 1/4 litres),du rôti de porc (8,43 kg),des oignons (4,53 kg) et des carottes (8,84 kg),le «panier standard» aux USA n'est pas identique à ceux de la Suisse et de l'UE.Ces 4 produits absents sont remplacés dans le «panier standard» par respectivement 8,07 kg de beurre,8,43 kg de côtelettes de porc,4,53 kg de tomates et 8,84 kg de pommes de terre supplémentaires.
3Le «panier standard» correspond sommairement à la consommation annuelle moyenne d'un habitant en Suisse (Tab.10) des 21 denrées alimentaires faisant l'objet de la présente comparaison internationale (Tab.53 et 54).«Grossièrement» car,par exemple,toute la viande de bœuf est représentée par le seul rôti de bœuf.Il représente 380 kg ou 91% des 417 kg de denrées alimentaires (sans le vin) consommés annuellement par un habitant en Suisse.Il est composé de 83,03 litres de lait,19,80 kg de fromage, 5,77 kg de beurre,32,27 pots de 1/4 litre de crème,10,17 kg de rôti de bœuf,8,43 kg de rôti de porc,8,43 kg de côtelettes de porc,8,43 kg de jambon,9,81 kg de poulet frais, 187 œufs,25,25 kg de farine blanche,50,50 pains blancs de 500 gr,43,29 kg de pommes de terre,47,71 kg de sucre,17,09 litres d'huile végétale,14,39 kg de pommes golden, 3,33 kg de poires,10,15 kg de bananes,8,84 kilo de carottes,4,53 kg d'oignons et 9,89 kg de tomates.
Sources:OFAG,OFS,ZMP,services statistiques nationaux de F,B,A,USA,service statistique de la ville de Turin (I)
ANNEXE A63
Tableau 54
ProduitPaysUnité1990/922002200320041990/92–2002/04 % FarineblancheCHfr./kg2.051.601.711.81-17 EU-4 (UE-4 avec B,sans F)fr./kg1.100.930.940.97-14 - min (D:90/92;B:02,03,04)fr./kg0.790.770.820.863 - max (A:90/92,02,03,04)fr./kg1.671.101.171.30-29 USAfr./kg0.751.070.920.8325 PainblancCHfr./1⁄2kg2.091.741.801.81-15 EU-4fr./ 1⁄2 kg1.491.471.561.624 - min (D:90/92,02,03,04)fr./ 1⁄2 kg1.160.940.971.00-16 - max (A:90/92,02,03,04)fr./ 1⁄2 kg2.982.903.123.294 USAfr./ 1⁄2 kg1.121.741.481.3336 PommesdeterreCHfr./kg1.432.082.162.1348 EU-5 (UE-4 avec B)fr./kg0.921.061.161.2124 - min (B:90/92;D:02,03,04)fr./kg0.560.770.830.9049 - max (A:90/92;F:02,03,04)fr./kg1.271.581.661.8433 USAfr./kg1.041.691.361.2438 SucreCHfr./kg1.651.471.591.61-6 EU-3 (UE-4 avec B,sans D,F)fr./kg1.751.441.511.56-14 - min (B:90/92,02,03,04)fr./kg1.671.381.461.52-13 - max (A:90/92,02,03,04)fr./kg1.891.601.661.68-13 USAfr./kg1.221.441.251.154 HuilevégétaleCH-tournesolfr./l5.053.884.304.95-13 «EU-4» (UE-4 avec B,sans D)fr./l2.812.322.482.46-14 - min (I:90/92,02,03,04)fr./l1.942.022.192.2110 - max (F:90/92,02,03,A :04)fr./l3.562.572.712.68-26 USA - huile à saladefr./l2.263.703.373.3153 PommesGoldenDelicious1CHfr./kg3.153.813.674.0418 EU-4 (F et A:diverses sortes)fr./kg3.162.592.762.98-14 - min (A:90/92,04;I:02,03)fr./kg2.942.192.332.67-21 - max (D:90/92;F:02,03,04)fr./kg3.252.993.253.44-4 USAfr./kg2.583.252.912.8618 Poires1CHfr./kg3.253.603.693.7612 EU-4fr./kg3.432.872.972.98-16 - min (D:90/92,03,04;I:02)fr./kg3.322.642.672.69-21 - max (F:90/92,02,03,04)fr./kg3.623.363.533.47-7 USAfr./kg2.523.422.943.2031 BananesCHfr./kg2.523.063.063.0621 EU-4fr./kg2.612.142.152.16-18 - min (D:90/92,02,03,04)fr./kg1.891.911.861.910 - max (I:90/92;A:02,03,04)fr./kg3.562.512.492.49-30 USAfr./kg1.451.741.511.366 CarottesCHfr./kg1.912.092.262.1613 EU-5 (UE-4 avec B)fr./kg1.711.431.441.41-17 - min (B:90/92,02,03,04)fr./kg1.061.101.120.93-1 - max (I:90/92,02,03,04)fr./kg2.321.751.781.91-22 USAfr./kg1.35 OignonsCHfr./kg1.862.562.392.2830 EU-5 (UE-4 avec B)fr./kg1.541.661.701.7911 - min (B:90/92,02,03,04)fr./kg0.921.071.090.8910 - max (I:90/92;F:02,03,04)fr./kg1.752.272.422.5538 USAfr./kg1.29 TomatesCHfr./kg3.733.753.673.29-4 EU-5 (UE-4 avec B)fr./kg3.603.583.603.21-4 - min (F:90/92;D:02,03,04)fr./kg3.332.972.802.42-18 - max (I:90/92,02,03,04)fr./kg4.414.454.724.513 USA (en plein champs)fr./kg3.294.544.484.4036
Panierstandard (ani.+vég.)3CHfr./panier22712277232123432 UE-4/5fr./panier1573137514301459-10
■■■■■■■■■■■■■■■■ Textes légaux
Lois
– Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture,LAgr,RS 910.1)
– Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR,RS 211.412.11)
– Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA,RS 221.213.2).
– Loi fédérale du 8 octobre 1982 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays,LAP,RS 531)
– Loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés (RS 632.111.72)
– Loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD,RS 632.10)
– Loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales (RS 232.16)
– Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA,RS 836.1)
– Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire,LAT,RS 700)
– Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires,LDAI,RS 817.0)
– Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux,RS 814.20)
– Loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des animaux (LPA,RS 455)
– Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN,RS 451)
– Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement,LPE,RS 814.01)
Ordonnances
Généralités
– Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole,OTerm,RS 910.91)
– Ordonnance du 7 décembre 1998 sur le relevé et le traitement de données agricoles (Ordonnance sur les données agricoles, RS 919.117.71)
– Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'évaluation de la durabilité de l'agriculture (RS 919.118)
– Ordonnance du 7 décembre 1998 sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones (Ordonnance sur les zones agricoles,RS 912.1)
Production et ventes
– Ordonnance du 30 octobre 2002 sur l’extension des mesures d’entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs;OIOP,RS 919.117.72)
– Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'aide à la promotion des ventes de produits agricoles (Ordonnance sur la promotion des ventes de produits agricoles,RS 916.010)
– Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles et des produits agricoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP,RS 910.12)
– Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l’agriculture biologique,RS 910.18)
– Ordonnance du DFE du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique (RS 910.181)
– Ordonnance du 3 novembre 1999 relative à la déclaration de produits agricoles issus de modes de production interdits en Suisse (Ordonnance agricole sur la déclaration;OagrD,RS 916.51)
– Ordonnance générale du 7 décembre 1998 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr,RS 916.01)
– Ordonnance du 7 décembre 1998 concernant le contingentement de la production laitière (Ordonnance sur le contingentement laitier,OCL,RS 916.350.1)
– Ordonnance du 10 novembre 2004 sur l’exemption du contingentement laitier (OECL,RS 916.350.4)
– Ordonnance du 7 décembre 1998 concernant les suppléments et les aides dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait,OSL,RS 916.350.2)
ANNEXE A1
– Ordonnance du DFE du 7 décembre 1998 concernant le montant des aides pour les produits laitiers et les dispositions relatives à l’importation de poudre de lait entier (RS 916.350.21)
– Ordonnance du 7 décembre 1998 concernant l'assurance et le contrôle de la qualité dans l'économie laitière (Ordonnance sur la qualité du lait,OQL,RS 916.351.0)
– Ordonnance du DFE du 13 avril 1999 réglant à l'assurance de la qualité dans l'exploitation de production laitière (RS 916.351.021.1)
– Ordonnance du DFE du 13 avril 1999 réglant à l’assurance de la qualité dans l’entreprise industrielle de transformation du lait (RS 916.351.021.2)
– Ordonnance du DFE du 13 avril 1999 réglant l’assurance de la qualité pour la transformation artisanale du lait (RS 916.351.021.3)
– Ordonnance du DFE du 13 avril 1999 réglant l’assurance de la qualité pendant l’affinage et le préemballage du fromage (RS 916.351.021.4)
– Ordonnance du 8 mars 2002 sur l’importation et l’exportation de fromage entre la suisse et la Communauté européenne (Ordonnance sur le commerce de fromage avec la CE,RS 632.110.411)
– Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'importation de lait et de produits laitiers,d'huiles et de graisses comestibles,ainsi que de caséines et de caséinates (Ordonnance sur l'importation de lait et d'huiles comestibles,OILHGC,RS 916.355.1)
– Ordonnance de l'OFAG du 30 mars 1999 concernant l'importation de beurre (RS 916.357.1)
– Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'importation d'animaux de l'espèce chevaline (Ordonnance sur l'importation de chevaux, OIC,RS 916.322.1)
– Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB,RS 916.341)
– Ordonnance de l’OFAG du 23 septembre 1999 sur l’estimation des animaux de l’espèce porcine ainsi que sur l’utilisation des appareils techniques destinés à la taxation de la qualité (RS 916.341.21)
– Ordonnance de l’OFAG du 23 septembre 1999 sur l’estimation et la classification des animaux des espèces bovine,chevaline,ovine et caprine (RS 916.341.22)
– Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les effectifs maximums dans la production de viande et d'oeufs (Ordonnance sur les effectifs maximums,OEM,RS 916.344)
– Ordonnance du 26 novembre 2003 concernant la mise en valeur de la laine de mouton du pays (RS 916.361)
– Ordonnance du 26 novembre 2003 sur le marché des oeufs (Ordonnance sur les oeufs,OO,RS 916.371)
– Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les contributions à la surface et à la transformation dans la culture des champs (Ordonnance sur les contributions à la culture des champs OCCC,RS 910.17)
– Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la fixation de droits de douane et sur l'importation de céréales,de matières fourragères,de paille et de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux (Ordonnance sur l'importation de céréales et de matières fourragères,RS 916.112.211)
– Ordonnance du DFE du 7 décembre 1998 sur le régime douanier préférentiel accordé aux aliments pour animaux et aux oléagineux (RS 916.112.231)
– Ordonnance du 7 décembre 1998 concernant la mise en valeur ainsi que l'importation et l'exportation de pommes de terre (Ordonnance sur les pommes de terre,RS 916.113.11)
– Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la culture et la transformation des betteraves sucrières (Ordonnance sur le sucre, RS 916.114.11)
– Ordonnance de l’OFAG du 6 décembre 2004 sur la libération du contingent tarifaire de blé panifiable (Ordonnance sur la libération du contingent de blé panifiable,RS 916.111.4)
– Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'importation et l'exportation de légumes,de fruits et de plantes horticoles (OIELFP,RS 916.121.10)
– Ordonnance de l’OFAG du 12 janvier 2000 sur la fixation des périodes et des délais ainsi que sur l’autorisation de parties de contingent tarifaire de légumes frais,de fruits frais et de fleurs coupées fraîches (Ordonnance sur l’autorisation des importations relative à l’OIELFP,RS 916.121.100)
– Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les mesures en faveur du marché des fruits et des légumes (Ordonnance sur les fruits et les légumes,RS 916.131.11)
– Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin,RS 916.140)
– Ordonnance de l'OFAG du 7 décembre 1998 sur l'assortiment des cépages et l'examen des variétés (RS 916.143.5)
A2 ANNEXE
– Ordonnance de l’OFAG du 7 décembre 1998 concernant le contrôle des moûts de raisin,jus de raisin et vins destinés à l’exportation (RS 916.145.211)
– Ordonnance du 28 mai 1997 sur le contrôle du commerce des vins (RS 916.146)
Paiements directs
– Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD,RS 910.13)
– Ordonnance du DFE du 7 décembre 1998 sur les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux (Ordonnance SST,RS 910.132.4)
– Ordonnance du DFE du 7 décembre 1998 sur les sorties régulières en plein air d'animaux de rente (Ordonnance SRPA, RS 910.132.5)
– Ordonnance du 29 mars 2000 sur les contributions d'estivage (OCest,RS 910.133)
– Ordonnance du 4 avril 2001 sur la promotion régionale de la qualité et de la mise en réseau des surfaces de compensation écologique dans l’agriculture (Ordonnance sur la qualité écologique,OQE,RS 910.14)
Amélioration des bases de production
– Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles,OAS,RS 913.1)
– Ordonnance de l’OFAG du 26 novembre 2003 sur les aides à l’investissements et les mesures d'accompagnement social dans l’agriculture (OIMAS,RS 913.211)
– Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture (OMAS,RS 914.11)
– Ordonnance du 26 novembre 2003 sur la vulgarisation agricole et la vulgarisation en économie familiale rurale (Ordonnance sur la vulgarisation agricole,RS 915.1)
– Ordonnance du 26 novembre 2003 sur la recherche agronomique (ORAgr,RS 915.7)
– Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la production et la mise en circulation du matériel végétal de multiplication (Ordonnance sur les semences,RS 916.151)
– Ordonnance du DFE du 7 décembre 1998 sur les semences et les plants des espèces de grandes cultures et de plantes fourragères (Ordonnance du DFE sur les semences et plants,RS 916.151.1)
– Ordonnance du DFE du 11 juin 1999 sur la production et la mise en circulation du matériel de multiplication et des plants d'espèces fruitières et de vigne certifiés (Ordonnance du DFE sur les plants d’espèces fruitières et de vigne,RS 916.151.2)
– Ordonnance de l'OFAG du 7 décembre 1998 sur le catalogue des variétés de céréales,de pommes de terre,de plantes fourragères, de plantes oléagineuses et à fibres ainsi que de betteraves (Ordonnance sur le catalogue des variétés,RS 916.151.6)
– Ordonnance du 18 mai 2005 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh,RS 916.161)
– Ordonnance du 10 janvier 2001 sur la mise en circulation des engrais (Ordonnance sur les engrais,OEng,RS 916.171)
– Ordonnance du DFE du 28 février 2001 sur la mise en circulation des engrais (Ordonnance sur le Livre des engrais,OLen, RS 916.171.1)
– Ordonnance du 28 février 2001 sur la protection des végétaux (OPV,RS 916.20)
– Ordonnance du 26 mai 1999 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux,RS 916.307)
– Ordonnance du DFE du 10 juin 1999 sur la production et la mise dans le commerce des aliments pour animaux,des additifs destinés à l'alimentation animale,des agents d'ensilage et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux,OLAIA,RS 916.307.1)
– Ordonnance de l'OFAG du 1er février 2005 sur la liste des aliments OGM pour animaux (RS 916.307.11)
– Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'élevage (RS 916.310)
Les textes légaux peuvent être consultés ou obtenus de la manière suivante:
– Accès par Internetwww.admin.ch/ch/f/rs/rs.html
– Commande à l‘OFCL,Diffusion publications
– par Internetwww.publicationsfederales.ch/
– par fax031/325 50 58
ANNEXE A3
Définitions et méthodes
Définitions
Biens publics: biens caractérisés par la non-rivalité et la non-exclusion.Non-rivalité signifie en l’occurrence que la consommation d’un bien n’entrave nullement la possibilité des autres de le consommer à leur tour.Non-exclusion signifie que personne ne peut être empêché d’avoir part aux biens publics.Par biens publics,on entend,par exemple,la défense nationale,la forêt comme cadre de loisirs ou l’attrait d’un paysage.Comme il n’existe pas de marché,ces biens n’ont pas de valeur marchande.Il incombe donc à l’Etat ou à ses mandataires de veiller à ce qu’ils soient à la disposition de la collectivité.
Dispersion, variance (valeur statistique):dispersion des observations ou des valeurs autour de la moyenne.
Effets externes: effets secondaires ou externalités positifs ou négatifs sur des tiers ou sur la collectivité,résultant des processus de consommation et de production de certains acteurs.N’étant pas saisis par le marché et n’ayant donc pas de prix,ils provoquent des distorsions du marché et une allocation inappropriée de biens et de facteurs de production.Une politique économique rationnelle doit viser à internaliser les effets externes.
Exemples d’effets externes:
Effetsexternesnégatifs(coûtssociaux)
Effetsexternespositifs(utilitésociale)
ProductionConsommation
Pollution de l’eau potable et des
Coûts élevés de santé publique eaux souterraines et superficielles occasionnés par la consommation par une fumure inadéquateexcessive d’alcool et de tabac
Conservation et entretien du paysage Baisse des coûts de santé publique grâce rural par la production agricoleaux sports de masse pratiqués à titre de loisirs
Equivalent de lait: un équivalent de lait correspond à la teneur moyenne d’un kg de lait cru en matière grasse et en protéines (73 g) et sert d’étalon pour le calcul de la quantité de lait contenue dans un produit laitier.
Evaluation (synonyme de contrôle des résultats):L’évaluation est une méthode servant à calculer et à évaluer l’effectivité (réalisation des objectifs),l’efficacité (rapports de cause à effet) et l’efficience (rentabilité) de mesures ou d’instruments,en référence à des objectifs définis préalablement.On s’en sert surtout pour faire des comparaisons:comparaison avec des groupes de contrôle,comparaison «avantaprès»,comparaisons intrasectorielles.
Indicateur agro-environnemental: saisie représentative de données concernant une cause,un état,un changement ou un risque environnemental liés à l’activité agricole,importantes pour les décideurs (p.ex.degré d’érosion du sol;définition de l’OCDE).
Marge du marché: différence entre le prix à la consommation et le prix à la production (valeur absolue),ou part des dépenses du consommateur revenant aux échelons transformation et commerce (valeur relative).Le terme de marge est synonyme.
Médiane: valeur centrale (donnée statistique);valeur située au milieu d’une série (p.ex.de mesures),de sorte à séparer un même nombre de valeurs supérieures et inférieures.
Monitoring: observation continue d’un objet durant une certaine période,à l’aide d’indicateurs et sans analyse des relations de cause à effet.Le monitoring permet de mettre en évidence des évolutions.Exemples:évolution de la surface agricole utile ou de populations d’oiseaux.
ANNEXE A1 ■■■■■■■■■■■■■■■■
Moyenne: moyenne arithmétique (valeur statistique):somme des valeurs d’une série divisée par le nombre de ces valeurs.
Multifonctionnalité de l’agriculture: multiples fonctions remplies par l’agriculture,notamment prestations fournies au-delà de la production agricole proprement dite.Ces dernières comprennent la sécurité alimentaire,l’entretien du paysage rural,la préservation des bases de production et de la diversité biologique ainsi que la contribution de l’agriculture à la viabilité économique et sociale du milieu rural.Une agriculture multifonctionnelle contribue substantiellement à un développement durable.Ses multiples tâches sont mentionnées dans la Constitution fédérale (art.104).
Prix-cible: valeur de référence fixée par le Conseil fédéral pour un kg de lait commercialisé contenant en tout 73 g de matière grasse et de protéines.Ce prix devrait pouvoir être atteint pour le lait transformé en produits à forte valeur ajoutée et commercialisé dans de bonnes conditions.Il dépend notamment de l’appréciation de la situation régnant sur le marché et des moyens disponibles pour le soutien du marché.Le supplément de non-ensilage n’est pas pris en compte.
Propriétés abiotiques: propriétés chimiques et physiques d’un espace,telles que facteurs climatiques (lumière,température,etc.), propriétés du sol,conditions hydrologiques et relief.
Propriétés biotiques: propriétés d’un espace déterminées par les plantes et les animaux qu’il abrite.
Quartile, quart (valeur statistique):subdivision en quatre parties d’une suite de valeurs classées par ordre décroissant.
«Schoggigesetz»: loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés (RS 632.111.72).Application du Protocole 2 de l’accord de libre-échange Suisse – CE de 1972.Compensation de la différence entre les prix des matières premières en Suisse et le prix du marché mondial pour les produits agricoles de base (exportation:subventions à l’exportation / importation: éléments mobiles).
Trafic de perfectionnement: les marchandises importées temporairement en Suisse à des fins de transformation ou de réparation donnent droit,à certaines conditions,à une réduction ou à une exemption des droits de douane.Les produits et les matières de base agricoles bénéficient du trafic de perfectionnement,si des marchandises suisses équivalentes ne sont pas disponibles en quantité suffisante ou que le handicap de l’industrie alimentaire ne peut être compensé par d’autres mesures appropriées.
D’autres termes se trouvent dans:
–«Définitions et terminologie d’économie rurale» (commandes:Landwirtschaftliche Lehrmittelzentrale,Länggasse 79,3052 Zollikofen).
–Ordonnance sur la terminologie agricole (RS 910.91).
A2 ANNEXE
Méthodes
Relevé du prix du lait
L’OFAG relève mensuellement les prix à la production et publie les résultats dans le «bulletin du marché du lait».Pour ce faire,il se fonde sur quatre références:quantité de lait totale,lait industriel,lait transformé en fromage et lait biologique.Ces données sont saisies pour toute la Suisse,mais aussi ventilées selon cinq régions: Région I: Genève,Vaud,Neuchâtel,Jura et les parties francophones du canton de Berne (districts de La Neuveville,Courtelary et Moutier). Région II: Berne (sauf les district de la région I),Lucerne,Unterwald (Obwald. Nidwald),Uri,Zoug et une partie du canton de Schwytz (district de Schwytz et de Küssnacht). Région III: Bâle-Campagne et Bâle-Ville, Argovie et Soleure. Région IV: Zurich,Schaffhouse,Thurgovie.Appenzell (Rhodes intérieures et Rhodes extérieures),Saint-Gall,une partie du canton de Schwytz (districts d’Einsiedeln,March et Höfe),Glaris,Grisons. Région V: Valais et Tessin.
Les cinq régions du relevé des prix
Source: OFAG
Conformément à l’ordonnance sur la réorganisation du marché laitier,les prix payés aux producteurs doivent être relevés auprès des utilisateurs de lait.Tous les transformateurs industriels de poids ainsi qu’un choix représentatif de fromageries participent au relevé.Celui-ci porte ainsi sur plus de 60% de la quantité produite.D’après l’ordonnance précitée,on entend,par prix du lait,le prix payé sur les lieux du relevé (au centre collecteur ou à la ferme),compte tenu des suppléments et déductions usuels dans la localité.Par contre,le supplément de non-ensilage,de même que les cotisations volontaires aux fédérations et les déductions pour le petit-lait ne sont pas compris.
ANNEXE A3
I II III IV V
Calcul des marges brutes de transformation-distribution
Lait et produits laitiers
Pour déterminer la marge brute totale sur le lait et les produits laitiers,il faut,dans un premier temps,procéder au calcul théorique de la valeur ajoutée dans les segments lait de consommation,fromage,beurre,crème de consommation et yoghourt.Cette valeur étant déterminée par kg de lait cru utilisé pour les divers produits,des comparaisons sont possibles.Elle correspond à la différence entre le prix payé au producteur et le prix de vente du produit final par kg de lait utilisé.
Dans un deuxième temps,cette valeur doit être corrigée en fonction des propriétés spécifiques des produits.Pour calculer les marges brutes individuelles,on tient en effet compte des aides allouées par la Confédération,des déductions ou suppléments ainsi que de la valeur des sous-produits issus de la transformation.Ainsi,la marge brute totale sur le lait et les produits laitiers est la résultante de la valeur ajoutée et des propriétés spécifiques de chaque produit.Elle réunit les marges brutes des groupes de produits lait de consommation,fromage,beurre,crème de consommation et yoghourt qui,à leur tour,découlent des calculs effectués pour les produits servant d’indicateurs.
La quantité de lait cru transformée annuellement en Suisse sert de référence pour le calcul de la marge brute totale et des marges brutes individuelles précitées,chaque mode d’utilisation et chaque produit étant pondéré conformément à sa part.
Pour calculer la marge brute,on ne tient compte que de la valeur ajoutée des produits laitiers fabriqués et consommés en Suisse.On déduit donc les exportations de la quantité totale.
Pour le relevé des prix à la consommation,on distingue trois canaux de distribution:grands distributeurs,discounts et magasins spécialisés.Ils sont pondérés d’après les parts de marché,conformément aux indications fournies par l’Institut d'analyse marketing,Hergiswil (IHA · GfK).
Marge brute Emmental (octobre 2000)
A4 ANNEXE
PV1/kg Emmental PV1/kg Lait cru Prix du lait Marge brute Emmental Rendement: 8%Aides,
Valeur des sous-produits, etc. fr. / kg
taxes
1 PV = prix de vente 0 20.44 1.64 0.81
Source: OFAG
Viande
La marge brute de transformation-distribution est une estimation de la marge réelle sur la viande vendue dans le commerce (à l’exclusion des ménages collectifs et de la restauration).C’est une valeur exprimée en termes réels (prix constants de 01.99) et hors TVA.Elle indique la différence entre les recettes nettes et le prix de revient.On compte un délai de 4 semaines (de 1999 à 2001) en moyenne ou de 3 semaines (depuis 2002) entre l’achat du bétail ou des matières premières servant à la fabrication de produits carnés et la vente dans les commerces de détail.La marge brute sur la viande fraîche est exprimée en fr./kg poids mort (PM) chaud.La marge brute des paniers de charcuterie et de saucisses ainsi que du panier de viande fraîche,charcuterie et saucisses est indiquée en fr./kg poids prêt à la vente (PP).
Le prix de revient est un prix réel (01.99),hors TVA (hTVA).Dans le prix de revient (PRC) du bœuf,du veau et du porc,tous les avantages procurés par les importations dans le cadre des contingents tarifaires (TAI) sont déduits.Le prix de revient de la viande d’agneau ne correspond pas au prix du bétail de boucherie payé au producteur,mais au prix des morceaux partiels (viande prête à la vente) à l’échelon du grossiste.Il est défini par kilo poids mort standardisé pondéré (indigène et importé).Pour les paniers-types de charcuterie et/ou de saucisses,le prix de revient s’entend comme le prix du commerce de gros pour la matière première (cuisse,poitrine,chair à saucisses) servant à la fabrication d’un kg de poids prêt à la vente (PP).Les paniers-types se basent sur une composition fixe (consommation mensuelle moyenne des ménages privés entre 01.1997 et 11.2000).
Les recettes nettes constituent le rendement brut au prix réel (01.99) hors TVA,diminué des coûts d’élimination,de la RPLP,du marketing de base et des pertes de la transformation.Cela correspond à une forme simplifiée du prix à la consommation observé.Le rendement brut est équivalent au chiffre d’affaires du secteur de la transformation-distribution ou aux dépenses du consommateur (ménages privés et grossistes).Il comprend la vente de la viande fraîche à la consommation ainsi que la mise en valeur de la viande à saucisse, de la peau et des abats (prix au grossiste).Les recettes nettes de la viande fraîche sont exprimées par kilo de poids mort (PM) chaud.Les recettes nettes du panier de charcuterie et de saucisses sont exprimées en fr./kg poids prêt à la vente (PP).Les coûts d’élimination,la RPLP,le marketing de base et les pertes ne sont pas pris en compte dans ces deux paniers.
Rendement brut (RB) (= fr. du cons.): 16.74 fr./kg PM
Coûts variables totaux: 8.46 fr./kg PM
Remarque: les proportions de la figure ne correspondent pas à la réalité. Les prix indiqués constituent un exemple pour le calcul de la marge brute sur la viande crue de bœuf en 2000. Ce sont des francs par kilo de carcasse chaude (poids mort, PM), à prix constants (ou réels 1.1999) et hors TVA. Source: OFAG
La marge brute de transformation – distribution est définie plus en détail dans les numéros spéciaux du «Bulletin du marché de la viande» de janvier 2001 et d’avril 2002 (numéros 140 et 155) publiés par la section Observation du marché de l’OFAG.Ces numéros sont disponibles sur demande.
ANNEXE A5
Viandes crues d'étal (prix au detail) 15.54 fr./kg PM Recette nette (POC) 16.62 fr./kg PM Prix de revient corrigé (PRC) 8.34 fr./kg
Imp. (TAI) 0.77 fr./kg PM Marge brute (MB2) 8.28 fr./kg PM Viandes à saucisse (prix de gros) 0.56
Abats vendables (prix au détail) 0.64
PM Abats
Prix de revient
(PRO) 9.11
PM
fr./kg PM
fr./kg
et os à brûler taxe RPLP, Marketing, 0.12 fr./kg PM
observé
fr./kg PM
Fruits et légumes
La marge brute transformation-distribution sur les fruits et les légumes équivaut à la différence entre le prix de revient d’un produit au premier échelon du commerce,déduction faite des frais d’emballage,et le prix de vente final (frais d’emballage inclus).Aussi bien les données relatives au marché suisse que celles concernant les importations sont prises en compte,de même que,pour ces dernières, les prélèvements à la frontière.Le calcul porte sur sept fruits et sept légumes importants,permettant de réaliser un chiffre d’affaires élevé. Fruits:pommes (Golden Delicious et principales variétés de garde,telles que Granny Smith,importations,pondération quantitative);poires (suisses et importées,sans les variétés Abate et Nashi,pondération quantitative);fraises,nectarines,cerises,abricots et oranges.Légumes: tomates (charnues et rondes,pondération quantitative),chou-fleur,oignons jaunes,carottes,chicorée Witloof,concombres et pommes de terre.Les chiffres utilisés pour les pondérations quantitatives sont fournis par l’IHA·GfK,la Centrale suisse de la culture maraîchère (CCM), Fruit-Union suisse (FUS),l’Office fédéral de la statistique (OFS) et la Direction générale des douanes (DGD).
Marge brute sur les légumes
Le prix de revient des divers produits correspond au prix franco chargeur (les frais d’entreposage des produits de garde sont pris en compte) pour ce qui est de la marchandise suisse et,pour les importations,à la valeur d’importation franco frontière,une pondération quantitative étant effectuée dans les deux cas.Les prix à la consommation sont déterminés à l’aide des données des principaux gros distributeurs et des marchés hebdomadaires.Les canaux de distribution sont pondérés selon leur part de marché,conformément aux indications de l’IHA·GfK.Finalement,on additionne les marges individuelles pour obtenir la marge du marché globale sur les légumes.
Marge brute sur les fruits
Le calcul de cette marge est un peu spécial en raison de l’apparition de courte durée de certains fruits saisonniers sur le marché.Elle donne néanmoins de précieux renseignements,surtout dans une comparaison pluriannuelle.
Le prix de revient des produits suisses correspond au prix à la production franco centre collecteur,celui des importations à la valeur d'importation franco frontière,dédouané,une pondération quantitative étant effectuée dans les deux cas.Les frais de stockage et les intérêts sont pris en compte.Les prix à la consommation sont déterminés à l’aide des données des principaux gros distributeurs et des marchés hebdomadaires.Les canaux de distribution sont pondérés selon leur part de marché,conformément aux indications de l’IHA · GfM.La marge du marché globale sur les fruits résulte de l’addition des marges individuelles.
A6 ANNEXE
Marge brute fruits et légumes
P importation P revient P dans le pays P vente finale
Marge brute
Source: OFAG
Comptes économiques de l’agriculture – nouvelle méthodologie
Les comptes économiques de l’agriculture (CEA) sont établis par l’OFS,avec l’appui du secrétariat de l’USP,conformément au système européen des comptes généraux de l'économie publique (Eurostat).La nouvelle méthode se fonde sur la nomenclature CEA97 d’Eurostat (auparavant CEA89) et permet de nouveau de comparer directement les résultats avec ceux de l’UE.
Nous décrivons ci-après les changements qu’apporte la nouvelle méthode et illustrons à l’aide d’un exemple leurs répercussions sur le plan quantitatif.La révision implique un remaniement radical.De fait,les résultats ne sont pas comparables avec ceux des années précédentes,tels qu’ils ont été publiés dans les rapports agricoles 2000 à 2002.
Nous distinguons deux types d’adaptation.D’une part,les modifications méthodologiques au sens strict du terme et,d’autre part,une série d’adaptations concernant l’univers des exploitations agricoles saisies dans l’analyse,ainsi que les produits et services pris en considération.
Modifications méthodologiques au sens strict du terme
Abandon de la notion de «ferme nationale»
L’ancien système considérait l’agriculture comme «boîte noire».Les CEA incluaient ainsi uniquement les flux de marchandises et de services entre l’agriculture et les autres secteurs économiques.Désormais,l’analyse prend aussi en compte les flux entre les unités constitutives de la branche d’activité agricole et,lorsque deux branches de production sont concernées,les flux internes au sein des exploitations (p.ex.production de fourrages comme intrant de la production de lait ou de viande).
Redéfinition des prix
Le «prix de base» se substitue au «prix départ ferme».La différence consiste à prendre aussi en considération les subventions directement attribuées à un produit (p.ex.supplément de non-ensilage,contributions à l’exportation d’animaux,soutien de la mise en valeur de pommes de terre).De même,les prix des biens d’approvisionnement («prix d’acquisition») sont corrigés en conséquence (p.ex.prise en compte du remboursement des droits de douane perçus sur les carburants).
ANNEXE A7
Agriculture
Unités agricoles CEA89 (ancienne méthode) CEA97 (nouvelle méthode)
CEA89, ancienne méthodeCEA97, nouvelle méthode
Prix au producteur
Prix départ ferme
+ Impôts sur produits
Prix au producteur + Subventions sur produits
Prix de base – Impôts sur produits
Plantations
Les plantations et l’augmentation de leur valeur jusqu’à la maturité sont saisies aussi bien dans la production que dans la formation brute de capital fixe.Une fois les plantations arrivées à maturité,la consommation de capital fixe est également imputée à cette valeur.D’après l’ancienne méthode,on n’enregistrait que les variations des plantations (extension ou diminution de la surface totale) sans tenir compte des plantations de remplacement.
CEA89, ancienne méthodeCEA97, nouvelle méthode
Surface du vignoble 2001
Surface du vignoble 2002
FBCF: formation brute de capital fixe
FNCF: formation nette de capital fixe
Production = FBCF
Surface du vignoble 2001
Surface du vignoble 2002
Renouvellement
Production = FBCF
FNCF CCF
A8 ANNEXE
Extension Extension
Adaptation de l’univers des exploitations agricoles et des produits et services pris en considération
Les domaines ci-après sont désormais inclus dans les CEA:
–horticulture ornementale (plantes et fleurs,plants de pépinières);
–services offerts par des entreprises spécialisées (p.ex.travaux à façon,insémination artificielle) ou par des agriculteurs (p.ex.travaux à façon);
–activités secondaires non agricoles directement liées à l’activité agricole (activités secondaires non agricoles non séparables).Font partie de cette catégorie la transformation de matières premières agricoles,mais aussi l’utilisation de facteurs de production agricoles à d’autres fins (p.ex.services de déneigement,prise en pension d’animaux);
–vin:la valorisation des raisins se fait désormais selon la mise en valeur visée (vin de table et de qualité,raisins de table,moût);selon l’ancien système CEA89,la récolte de raisins tout entière était valorisée au prix du moût.
Les petits producteurs n’atteignant pas les valeurs seuil ne sont pas pris en compte dans l’univers des exploitations agricoles.Il s’agit surtout d’une partie des producteurs de vins,des apiculteurs et des éleveurs de lapins.
Nouveau CEA97
–Petits producteurs
Quantification des adaptations
Production agricole des exploitations couvertes par l'ancien CEA89
+ Horticulture ornementale
+ Services agricoles des unités spécialisées
+ Valorisation du vin à partir du propre raisin
+ Services agricoles (secondaires)
+ Activités non agricoles non séparables
Le tableau ci-après met en comparaison les résultats selon l’ancienne méthode (CEA89) et selon la nouvelle méthode (CEA97) pour la moyenne des années 1999/2001.A chaque échelon des CEA,les écarts sont attribués aux trois raisons possibles «adaptations méthodologiques au sens strict du terme»,«influence de l’horticulture» ou «autres influences».Les adaptations conduisent à un relèvement des valeurs à tous les échelons.
L’abandon du concept de «ferme nationale» est particulièrement manifeste (prise en compte de certains flux au sein des exploitations et entre les unités agricoles) au niveau de la valeur de production et des consommations intermédiaires.L’inclusion de l’horticulture et des services influe également sur ces deux postes.La prise en considération de l’horticulture a en outre une incidence très forte sur la rémunération des salariés.Les activités secondaires non agricoles sont intégrées à la valeur de production et influent aussi sur le montant de la rémunération totale des salariés,mais guère sur les consommations intermédiaires bien évidemment.
Le passage à de nouveaux prix de base a lui aussi un impact non négligeable.Concernant les prix,la prise en considération des subventions liées aux produits signifie aussi que ces deniers ne figurent plus sous la rubrique «Autres subventions sur la production».
L’ensemble de ces adaptations a pour effet de relever le revenu d’entreprise d’environ 30%.
ANNEXE A9
A10 ANNEXE CEACEAEffetsEffetsAutresEffet 8997méthodehorticultureeffetstotal mio.fr.mio.fr.mio.fr.%mio.fr.%mio.fr.%mio.fr.% (ø1999–(ø1999–(ø1999–(ø1999–(ø1999–(ø1999–2001)2001)2001)2001)2001)2001) Valeurdeproduction738110483197663,778625,3341113102100 Intraconsommation et flux intrabranche (fourrages,litière)01 2681 26810000001 268 40,9 Horticulture ornementale,pépinières0786007861000078625,3 Services agricoles05415411000000541 17,4 Biens de capital fixe pour compte propre100116161000000160,5 Activités secondaires non agricoles (non séparables)03503501000000350 11,3 Prix de base:ajout des subventions sur produits010710710000001073,5 Prix de base:déduction des impôts sur produits1500-1501000000-150-4,8 Valorisation du vin022900002291002297,4 Petits producteurs,ménages non agricoles1560-1561000000-156-5,0 Autres effets nets de la révision011100001111001113,6 Consommationsintermédiaires38645733174193,129115,6-163-8,71870100 Intraconsommation et flux intrabranche (fourrages,litière)01 2681 26810000001 268 67,8 Services agricoles05415411000000541 28,9 Horticulture ornementale,pépinières0291002911000029115,6 Vinification,encavage065000065100653,5 Prix d’acquisition:impôts-restitutions sur les carburants670-671000000-67-3,6 Frais d’entretien et de réparation en machines et installations8695160000-354100-354 -18,9 Autres effets nets de la révision012600001261001266,7 Valeurajoutéebrute351747502351949440,150340,91232100 Consommation de capital fixe1 8651 982120102,23328,4-36-30,6117100 Valeurajoutéenette1653276711510,346141,353948,41115100 Rémunérationdessalariés72111496114,331072,45713,3428100 Autresimpôtssurlaproduction1851211-1,92-2,8-67104,7-64100 Autres impôts sur la production (sans sous-compensation TVA)85541-45-17,6-37121,6-3147,7 Sous-compensation TVA (nette)1006700-410,8-3089,2-3452,3 Subventions24962352-175120,80030-20,8-145100 Subventions sur produits1070-1071000000-107 74,3 Restitutions droits carburants670-671000000-67 46,5 Autres subventions2 3222 35200003010030 -20,8 Excédentnetd’exploitation/ revenumixtenet32423849-123-20,215024,658095,6607100 Fermages à payer2252080000-17100-17100 Intérêts de la dette à payer50436523-16,521-15-182131,5-138100 Revenunetd’entreprise25133276-145-19,112916,9779102,2762100
Comptes économiques de l’agriculture
Composition de la valeur de production
Intraconsommation
Production du secteur économique agricole
Autres subventions
Transformation par les producteurs
Autoconsommation par les ménages agricoles
Ventes à d’autres unités agricoles
Ventes hors agriculture, en Suisse et à l’étranger
Subventions sur produits
Production du secteur économique agricole
Valeur ajoutée brute aux prix de base
Valeur ajoutée nette aux prix de base
Revenu des facteurs
Excédent net d’exploitation / revenu mixte net
Revenu net d’entreprise 1
Fermages et intérêts dus Rémunération des salariés Autres impôts sur la production
1 est désigné comme bénéfice net d’entreprise dans la littérature et dans la méthodologie Eurostat
Biens de capital fixe pour compte propre
Variations des stocks
Consommation de capital fixe
Consommations intermédiaires
Source: OFS
ANNEXE A11
Dépouillement centralisé de Agroscope FAT Tänikon
Nouvelle méthode
La méthode du dépouillement centralisé a changé fondamentalement dès les bilans de clôture de 1999.Par le passé,on déterminait le revenu d’exploitations-témoins répondant à des critères stricts (p.ex.limitation du revenu accessoire,exigence d’une formation spécialisée).Comme il s’agissait d’une sélection sciemment positive,les résultats ne pouvaient être extrapolés.En revanche,le nouveau système des «exploitations de référence»,représentatives,permet de faire des constatations concernant l’agriculture tout entière.
Aperçu des changements méthodologiques concernant le dépouillement centralisé –Sont considérées comme population toutes les exploitations suisses pouvant,en principe,servir de référence pour le dépouillement centralisé.Elles doivent à cet effet atteindre certains seuils.Ainsi,une exploitation comptant une surface d’au moins 10 ha ou gardant au moins 6 vaches appartient automatiquement à la population.Celle-ci comprend quelque 57'000 exploitations,ce qui correspond à quelque 90% de la surface exploitée et à quelque 90% de la production.
–Dans cette population on choisit quelque 3'500 exploitations de référence.
–Comme les structures de ces exploitations de référence diffèrent de celles de l’agriculture prise dans son ensemble,on procède à une pondération des résultats comptables.On se sert,à cet effet,des données concernant la répartition des exploitations selon la grandeur et le type et d’après les zones.Les résultats comptables des petites exploitations,sous-représentées dans le groupe de référence,acquièrent ainsi le poids qui leur revient.
–On a aussi introduit une nouvelle typologie des exploitations,qui distingue mieux les types importants du point de vue de la politique agricole.Environ deux tiers des exploitations peuvent être attribuées à sept types spécialisés se concentrant sur certaines branches de la production végétale ou de l’élevage.Le dernier tiers comprend quatre types d’exploitations combinées (cf.ci-après).
Grâce à la représentativité accrue et à la pondération,les résultats du dépouillement centralisé concernant l’ensemble de l’agriculture sont plus informatifs.Il est aussi plus facile de comparer les données comptables au plan international.Par contre,les changements méthodologiques ont rendu impossible la comparaison des données récentes avec d’anciens rapports sur le dépouillement centralisé.Afin de pouvoir,malgré tout,établir des comparaisons pluriannuelles,nous avons appliqué rétroactivement la nouvelle méthode aux données comptables des années précédentes.
La nouvelle typologie des exploitations FAT99
Dans le cadre des modifications méthodologiques proposées par Agroscope FAT Tänikon (Station fédérale de recherches en économie et technologie agricoles),l’ancienne typologie des exploitations,fondée sur les travaux de la «Commission verte» (1966),a été remplacée par une nouvelle typologie (FAT99).Outre son utilisation dans la présentation des résultats,FAT99 sert à la sélection des exploitations et à la pondération de leurs données.
La répartition des exploitations selon la nouvelle typologie se fait exclusivement sur la base des critères «surfaces» et «UGB» concernant les différentes catégories animales.Dix chiffres-clés ou huit quotients par exploitation permettent une répartition différenciée et claire.
A12 ANNEXE
Définition de la nouvelle typologie des exploitations FAT99
DomainesTyped'exploitationUGB/TO/CS/UGBB/VL/VA/ChMC/PVol/Autres SAUSAUSAUUGBUGBBUGBBUGBUGBconditions
11ProductionGrandes culturesau max.plus demax. végétale170%10%
12Cultures spécialesau max.plus de 110%
21GardeLait commercialiséau max.au max.plus de plus de au max. d’animaux25%10%75%25%25%
22Vaches allaitantesau max.au max.plus de au max.plus de 25%10%75%25%25%
23Autres bovinsau max.au max.plus deni 21 25%10%75%ni 22
31Chevaux/moutons/au max.au max.plus de chèvres25%10%50%
41Perfectionnementau max.au max.plus de 25%10%50%
51DomainesLait commercialisé/plus deplus deplus deau max.pas combinésgrandes cultures40%75%25%25%11–41
52Vaches allaitantesplus deau max.plus depas 75%25%25%11–41
53Perfectionnementplus depas 25%11–41
54Autres pas 11–53
Les exploitations doivent satisfaire à tous les critères prévus dans une ligne.
Abréviations:
UGBunités de gros bétail
SAUsurface agricole utile en ha
UGB/SAUcharge en bétail par ha de SAU
TO/SAUpourcentage de terres ouvertes par rapport à la SAU
CS/SAUpourcentage de cultures spéciales par rapport à la SAU
UGBB/UGBpourcentage d’UGB bovines par rapport au cheptel total
VL/UGBBpourcentage de vaches laitières par rapport à l’effectif de bovins VA/UGBBpourcentage de vaches allaitantes par rapport à l’effectif de bovins ChMC/UGBpourcentage de chevaux,de moutons et de chèvres par rapport au cheptel total PVol/UGBpourcentage de porcs et de volaille par rapport au cheptel total
Source:Agroscope FAT Tänikon
On distingue sept types d’exploitations spécialisées et quatre types combinés.Les exploitations spécialisées en production végétale (11 et 12) ont un chargement en bétail inférieur à une UGB par ha de SAU.Le pourcentage de terres ouvertes dépasse 70% de la SAU dans les exploitations vouées aux grandes cultures et 10% dans celles qui pratiquent des cultures spéciales.Quant aux exploitations spécialisées en production animale (21–41),leur surface de terres ouvertes et de cultures spéciales ne doit pas dépasser 25% et 10% respectivement.Des exploitations sont considérées comme étant spécialisées dans la production de lait commercialisé ou,au contraire, dans la garde de vaches mères,lorsque les vaches laitières ou les vaches mères représentent plus de 25% du cheptel bovin.Le groupe restant («autres bovins») réunit surtout des exploitations gardant des vaches laitières sans contingent (exploitations de montagne,spécialisées dans l’engraissement de veaux et dans l’élevage).Quant aux exploitations vouées au perfectionnement,les porcs et la volaille représentent plus de la moitié de leurs effectifs.Enfin,les exploitations ne pouvant être attribuées à aucun des sept types précités,sont qualifiées de combinées (51–54).
ANNEXE A13
Présentation des résultats
Conformément à l’art.7 de l’ordonnance sur l’évaluation de la durabilité,la situation économique doit aussi être appréciée selon les régions.A cet effet,trois régions ont été définies en référence à l’ordonnance sur les zones agricoles:
–région de plaine:zone de grandes cultures et zones intermédiaires –région des collines:zone des collines et zone de montagne I –région de montagne:zones de montagne II à IV
Délimitation des régions de plaine, des collines et de montagne (Communes en fonction de leur attribution à une zone prépondérante)
Région de plaine
Région des collines
Région de montagne
Afin de pouvoir apprécier la dispersion de certains chiffres-clés de manière différenciée,nous avons réparti les exploitations considérées en quartiles,en nous fondant sur le revenu du travail par unité de main-d’œuvre familiale UTAF.Chaque quartile (0–25% / 25–50% / 50 –75% / 75–100%) comprend un quart des exploitations de la population.
La représentation en quartiles permet une appréciation différenciée du point de vue économique.Par contre,on a renoncé à une différenciation écologique,car la part d’exploitations de référence ne fournissant pas les prestations écologiques requises est inférieure à 3%, et la différence des revenus du travail est minime.
L’art.5 LAgr exige l’appréciation de la situation économique «en moyenne pluriannuelle».C’est la raison pour laquelle les évolutions sont représentées sur plusieurs années.Quant aux considérations plutôt statiques,elles se basent sur la moyenne la plus récente de trois ans (en l’occurrence 1998/2000).
A14 ANNEXE
Source: données SIPA 1998 OFAG Limites communales © OFS GEOSTAT
Comparaison des revenus
En vue de la comparaison des revenus,on détermine le revenu du travail des agriculteurs,d’une part,et le salaire annuel brut des autres groupes de la population,d’autre part.La situation salariale de ces derniers est saisie tous les deux ans par l’OFS à l’aide de son enquête sur la structure des salaires.Dans les années intermédiaires,les données sont actualisées au moyen de l’indice de l’évolution des salaires. L’enquête sur leur structure donne un aperçu représentatif de la situation salariale des employés de l’industrie (secteur secondaire) et des services (secteur tertiaire).
Composantes salariales saisies (enquête de l’OFS sur la structure des salaires)
Salaire brut du mois d’octobre (y compris cotisations de l’employé aux assurances sociales,prestations en nature,parts de primes,de chiffre d’affaires ou de provision régulièrement versées),indemnisations pour travail par équipes,travail de nuit et du dimanche, 1⁄12 du 13e salaire et 1⁄12 des paiements spéciaux annuels.
Standardisation: conversion des cotisations (y compris charges sociales) en un temps de travail uniforme de 4 1⁄3 semaines à 40 heures.
Les chiffres de l’enquête sur la structure des salaires sont convertis en salaires annuels bruts.Ensuite,on détermine,pour chaque région, la médiane de tous les employés des secteurs secondaire et tertiaire.
On calcule,pour l’agriculture,le revenu du travail agricole par UTAF,qui est le pendant des salaires annuels bruts.Une UTAF se base sur 280 journées de travail,une personne correspondant au maximum à 1,0 UTAF.
Calcul du revenu du travail agricole
Revenu agricole
–intérêts servis sur le capital propre engagé dans l’exploitation (taux d’intérêt moyen des obligations de la Confédération)
=revenu du travail réalisé par la famille du chef d’exploitation
:nombre d’unités de main-d’œuvre familiale (UTAF) (base:280 journées de travail)
= revenu du travail par UTAF
ANNEXE A15
Exigences requises pour l’octroi de paiements directs (état août 2005)
Exigences générales
A droit aux paiements directs l’exploitant qui gère une exploitation agricole pour son compte et à ses risques et périls et qui a son domicile civil en Suisse.N’y ont pas droit les exploitations de la Confédération,des cantons et des communes,ni les exploitants dont les cheptels dépassent les plafonds fixés dans l’ordonnance sur les effectifs maximums.Sont également exclues les personnes morales,sauf s’il s’agit d’exploitations familiales (art.2,OPD).
Prestations écologiques requises (PER)
L’exploitant qui sollicite des paiements directs doit prouver aux autorités cantonales compétentes qu’il gère l’ensemble de son exploitation selon les exigences liées aux PER ou selon les règles reconnues par l’OFAG (cf.les explications ci-dessous).
Autres exigences
Le droit aux contributions est encore lié à d’autres critères structurels et sociaux.Le schéma ci-après récapitule en quelques mots clés les conditions liées à l’octroi des paiements directs.
Conditions requises pour l’octroi des paiements directs
Besoinminimalentravail
Main-d’œuvrepropreàl’exploitation
0,25 unité de main-d’oeuvre standard (UMOS)
Au moins 50% des travaux nécessaires à l’exploitation effectués à l'aide de la main-d'œuvre propre à l'exploitation (famille et employés).
Âgedel’exploitant Jusqu’à 65 ans
Plafonnementdescontributions
–EchelonnementSurface en haNombre d’animaux,Taux en % en UGB jusqu’à3045100 30–6045–9075 60–9090–13550 plus de901350
–Montant maximum par UMOS 65 000 fr.
–Revenu déterminant (revenu imposable réduit de 40 000 fr.pour les couples Somme des paiements directs réduite dès 80 000 fr. d’agriculteurs mariés)de revenu déterminant
–Fortune déterminante (fortune imposable réduit de 240 000 fr.Somme des paiements directs réduite dès 800 000 fr.de fortune par UMOS et de 300 000 fr.pour les couples d’agriculteurs mariés)déterminante;suppression des paiements directs si la fortune déterminante dépasse fr.1 million.
Source:ordonnance sur les paiements directs
A16 ANNEXE
Terrains en pente dans la région de montagne et des collines0,015 UMOS par ha Culture biologique Comme pour la SAU,plus 20% Arbres fruitiers haute-tige 0,01 UMOS/10 arbres
Source:ordonnance sur la terminologie agricole
Le calcul des UMOS se fait à l’aide de facteurs de conversion pour la SAU et les animaux de rente.Des suppléments sont versés pour certains modes d’exploitation tels que la culture biologique,qui demande plus de travail.Ces facteurs sont dérivés du relevé standard des processus de l’économie du travail.Ils ont été simplifiés pour l’exécution des paiements directs et pour les mesures relevant des améliorations structurelles.Ils ne se prêtent pas au calcul du besoin en travail effectif puisque celui-ci dépend des particularités de l’exploitation telles que la configuration du terrain,le regroupement des terres,les bâtiments ou le degré de mécanisation.
Echelonnement des contributions selon art. 20 OPD
L’échelonnement en pour-cent vaut pour tous les types de contributions,à l’exception de celles qui sont allouées pour l’estivage et pour la protection des eaux.
ANNEXE A17 SurfaceagricoleutileUMOS/ha SAU sans les cultures spéciales 0,028 Cultures spéciales 0,300 Surfaces viticoles en forte pente et en terrasses 1,000 AnimauxderenteUMOS/UGB Vaches laitières,brebis laitières et chèvres laitières 0,043 Porcs à l’engrais 0,007 Porcs d’élevage 0,04 Autres animaux de rente 0,03
Suppléments
Surfaces 1–30 ha>30–60 ha>60–90 ha>90 ha % du taux de contribution Cheptel / Animaux de rente 1–45 UGBFG>45–90 UGBFG>90–135 UGBFG>135 UGBFG % du taux de contribution 0 100 75 50 0 100 75 50
Prestations écologiques requises (PER)
Les PER visent une approche globale des systèmes agro-écologiques et des exploitations agricoles.C’est à cette fin que les critères développés pour la production intégrée (PI) ont été repris,et que les PER ont vu le jour.Par ailleurs,les exploitants doivent prouver qu’ils respectent les prescriptions de la législation sur la protection des animaux.La PI,complétée par lesdites prescriptions,est ainsi devenue la norme de l’agriculture suisse.Les paiements directs sont versés seulement aux exploitants qui fournissent les PER.L’instauration des PER a permis d’intégrer les charges liées à la production intégrée (PI,état 1996).L’instauration de paiements directs a exercé une influence considérable sur les systèmes d’exploitation et,partant,sur l’écologie,ce qui se traduit entre autres par l’important accroissement des surfaces exploitées selon les directives PER et bio.Si au début de la première étape de la réforme agricole en 1993,leur part représentait 20% à peine,elle concerne aujourd’hui quelque 96% de la SAU.C’est grâce à des incitations financières ciblées qu’il a été possible de réaliser une participation aussi importante des exploitations.On signalera par ailleurs que certaines exploitations telles que les domaines de l’Etat ou les personnes morales ne bénéficient pas du système de paiements directs,même si elles répondent aux exigences des PER ou de l’agriculture biologique.
Les PER comprennent les points suivants:
–Devoir d’enregistrement et de preuve:pour avoir droit aux paiements directs,l’exploitant doit prouver qu’il fournit les PER dans l’ensemble de son exploitation,au moyen d’une attestation délivrée par l’organisation de contrôle cantonale.Pour recevoir celle-ci,il tiendra à jour des enregistrements concernant la gestion de l’exploitation.
–Garde des animaux de rente respectueuse de l’espèce:les dispositions de l’ordonnance sur la protection des animaux doivent être observées,le renversement du fardeau de la preuve étant valable en l’occurrence,c’est-à-dire que l’exploitant doit prouver qu’il respecte la loi sur la protection des animaux.
–Bilan de fumure équilibré:pour réduire les pertes d’éléments nutritifs dans l’environnement et garder le cycle de ces éléments aussi fermé que possible,les apports d’azote et de phosphore doivent être calculés en fonction du besoin des plantes et du potentiel de production de l’exploitation (une tolérance de 10% est assurée).Dans le bilan de fumure,les engrais de ferme sont pris en compte de manière prioritaire;le recours aux engrais minéraux et aux engrais à base de déchets n'est justifié qu’en cas de besoin.
–Des analyses du sol doivent être effectuées par parcelle au moins tous les dix ans,pour que l’on puisse connaître les réserves du sol en nutriments et adapter en conséquence les engrais nécessaires au maintien de la fertilité du sol.
–Part équitable de surfaces de compensation écologique (SCE):au moins 3,5% de la SAU dans le cas des cultures spéciales,et 7% pour le reste de la SAU.Des bandes herbeuses d'une largeur minimale de 0,5 m doivent être maintenues le long des chemins,et d’une largeur de 3 m le long des cours d’eau,des plans d’eau,des haies,des bosquets champêtres,des berges boisées et des lisières de forêt.
–Assolement régulier:pour maintenir la fertilité du sol et assurer un bon état sanitaire des plantes,le plan d’assolement annuel doit comprendre un minimum de quatre cultures différentes dans les exploitations comptant plus de 3 ha de terres ouvertes.Des parts maximales des cultures principales aux terres ouvertes ou des pauses entre les cultures sont également prescrites.
A18 ANNEXE
–Sélection et utilisation ciblée des produits de traitement des plantes:ces produits peuvent atteindre l’air,le sol et l’eau et entraîner des effets négatifs non souhaitables sur certains organismes.On leur préférera des mécanismes de régulation naturels et des procédés biologiques.Certains traitements sont interdits en culture des champs et en culture fourragère (p.ex.herbicides en prélevée pour le froment).Pour les cultures spéciales,les produits autorisés avec certaines restrictions d’utilisation sont régulièrement actualisés sur des listes.
ANNEXE A19 Exemplesdepartsmaximalesdeculturesen%desterresassolées – Céréales (sans le maïs et l’avoine) 66 – Blé et épeautre 50 – Maïs 40 – Avoine 25 – Betteraves 25 – Pommes de terre 25
Observation des lois
Si l’exploitant viole les prescriptions pertinentes de la loi sur la protection des eaux,de la loi sur la protection de l’environnement et de la loi sur la protection de la nature et du paysage,il risque non seulement une amende mais encore une réduction ou une suppression des paiements directs.
Voici quelques exemples de prescriptions dont la violation peut entraîner des sanctions:
–Devoir de diligence destiné à empêcher toute atteinte nuisible aux eaux (art.3 LEaux);
–Interdiction d’introduire ou d’infiltrer dans une eau des substances de nature à la polluer et de déposer et d’épandre de telles substances s’il existe un risque concret de pollution de l’eau (art.6 LEaux);
–Non-respect des valeurs limites relatives aux UGBF fixées à l’art.14 LEaux (en fonction de la surface agricole utile fertilisable);
–Capacité de stockage insuffisante pour les engrais de ferme selon l’art.14 LEaux;
–Destruction ou endommagement d’un biotope protégé par la Confédération ou le canton,notamment de roselières et de marais, de haies,de bosquets champêtres et de prairies sèches,d’une curiosité naturelle ou d’un monument protégés,d’un site protégé évocateur du passé,d’un site naturel protégé (sites marécageux compris),lorsque l’exploitation agricole en est la cause (art.24, al.1,let.a,LPN en combinaison avec l’art.18,al.1bis,LPN).
–Infractions à l'interdiction d'incinérer des déchets (art.26a OPair)
Les infractions à ces prescriptions sont traitées individuellement en fonction des faits antérieurs et compte tenu des conséquences qu’elles entraînent.Elles sont attribuées à l’une des trois catégories suivantes:
–Infraction unique sans effets durables.Exemple:épandage unique de purin,contraire à la législation sur la protection des eaux (réduction de 5 à 25%,et de 2’500 fr.au max.).
–Infractions uniques aux effets persistants,agissements ou omissions s’étendant sur plusieurs jours,semaines ou mois.Exemple:tas de fumier non consolidé;épandages successifs de purin à des jours différents,contraires à la législation sur la protection des eaux (réduction de 10 à 50%,et de 10’000 fr.au max.).
–Infractions répétées dans les trois ans contre les mêmes dispositions ayant trait à l’agriculture.Sont déterminants les incidents à partir de l’année 1999 (réduction de 20 à 100%).
A20 ANNEXE
Comparaison des comptabilités au sein de l’UE
Qu’est-ce que le RICA?
Le réseau d'information comptable agricole de l’Union européenne (RICA) a été créé en 1965.Il a pour but de recueillir les données comptables nécessaires à la constatation annuelle des revenus dans les exploitations agricoles et à l'analyse du fonctionnement économique d'exploitations agricoles.
L’échantillon annuel comprend en ce moment quelque 60'000 exploitations permettant de représenter plus de 90% de l’ensemble de la SAU et de la production agricole de l’UE.
La plupart des pays membres disposent aussi de réseaux comptables nationaux,dont les données RICA peuvent être prélevées pour la Commission de l’EU.Le RICA est la seule source fournissant des résultats économiques comparables sur le plan de l’Union pour les exploitations agricoles.
Application de la méthode RICA
Dans plusieurs domaines,la saisie et l’évaluation des données dans le RICA diffèrent de la méthode appliquée dans le dépouillement centralisé des données comptables de la FAT.Afin de rendre les résultats comptables suisses comparables aux données RICA,la FAT convertit les données suisses à plusieurs niveaux.Les résultats des exploitations suisses présentés ci-après ne sont donc pas assimilables aux résultats des exploitations-témoins comptables.
L’exclusion de la maison d’habitation entraîne des adaptations en ce qui concerne les frais de bâtiment,amortissements compris, le produit de la location de bâtiments,de même qu’une réduction proportionnelle des intérêts débiteurs,des fermages pour les exploitations entièrement affermées,ainsi que des actifs et des passifs.
Les valeurs comptables et les amortissements sont corrigés selon le coût d’acquisition actuel:machines +5%,bâtiment +20%.Quant aux sols et aux autres actifs,on a repris les données du dépouillement centralisé (en Allemagne et en Irlande,il est aussi fait exception à l’appréciation aux prix du marché).Quant au compte des résultats (appréciation des animaux corrigée),au bilan et aux indicateurs relatifs au financement,on calcule des variables RICA standard.Une limite inférieure est fixée pour 16 unités de dimension économique européennes en vue du relevé des données suisses.Près de 50'000 exploitations couvrant plus de 90% de la surface et de la production peuvent représentées lorsqu’on emploie la typologie des exploitations de l’UE et une pondération analogue.La FAT a appliqué pour la première fois la méthode RICA aux exploitations suisses en 1996.
ANNEXE A21
Différences méthodologiques entre le RICA et le dépouillement centralisé
Réseaud'informationcomptableagricoledel'UE
Définitiondel’exploitation
Exploitation agricole sans le bâtiment d’habitation.
Appréciationetamortissement
Sols,animaux,réserves et livraisons en nature aux prix du marché, installations au coût d’acquisition actuel.
Amortissements appréciés en fonction du coût d’acquisition actuel; ruptures de bilan régulières.
Comptedesrésultats
Production totale et consommation intermédiaire,mouvements internes; pour les animaux d’élevage,les variations de la valeur ne se répercutent sur les résultats qu’en cas de modification quantitative.
Typologiedesexploitations
Typologie de l’UE:le chiffre relatif à chaque branche (ha ou nombre d’animaux) est multiplié par une marge brute standard (MBS). L’orientation technico-économique (OTE) résulte de la composition de la MBS relative à l’ensemble de l’exploitation.La somme de MBS donne la dimension économique de l’exploitation en unités de dimension européenne(UDE;1 UDE = 1200 Euro MBS).
Populationetéchantillon
Le RICA représente les unités exploitées à titre principal. Celles-ci doivent se situer en dessus d’un seuil économique (en UDE). Ces seuils varient selon le pays.Les pays voisins de la Suisse appliquent le plus souvent le seuil de 8 UDE,l’Italie,2 UDE.
Pondérationdesrésultats
Fondement:stratification des exploitations selon le type d’exploitation (OTE), dimension économique en UDE) et région RICA (p.ex. länder allemands).
Dépouillementcentralisé,exploitations-témoins
Le bâtiment d’habitation fait partie de l’exploitation;location théorique à la famille du chef d’exploitation
Appréciation selon le principe du prix de revient,soit:sol apprécié le plus souvent à la valeur de rendement;chiffres indicatifs pour les animaux,les réserves et les livraisons en nature.
Amortissement des coûts d’acquisition nets historiques;constance du bilan.
Compte des rendements bruts et des charges réelles sans mouvements internes.
Toute variation de l’appréciation des animaux a une incidence sur le résultat.
Typologie des exploitations FAT99:le type d’exploitation est défini en fonction des critères matériels (utilisation du sol et composition de l’effectif de bétail). La classification établie selon la typologie FAT99 est plus constante dans le temps que celle de l’UE.
C’est le plus souvent la surface agricole utile qui sert à mesurer la dimension de l’exploitaiton.
La population des exploitations-témoins est délimitée à l’aide des seuils d’ordre matériel;elle englobe plus de 55'000 exploitations,comprenant de nombreuses unités exploitées à titre accessoire.
Fondement:stratification des exploitations selon le type d’exploitation (FAT99),classe de grandeur (SAU) et région (de plaine,des collines,de montagne,en fonction des zones de production).
Sources:Commission de l’UE,Agroscope FAT Tänikon
A22 ANNEXE
Organisation/institution
AFDAdministration fédérale des douanes,Berne
DFEDépartement fédéral de l’économie,Berne
DGDDirection générale des douanes,Berne
EPFZEcole polytechnique fédérale,Zurich
FALStation fédérale de recherches en écologie et agriculture,Zurich-Reckenholz
FAMStation fédérale de recherches laitières,Liebefeld-Berne
FAOOrganisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture,Rome
FATStation fédérale de recherches en économie et technologie agricoles,Tänikon
FAWStation fédérale de recherches en arboriculture,viticulture et horticulture,Wädenswil
IERInstitut d’économie rurale,Zurich
IRABInstitut de recherche en agriculture biologique,Frick
LBLLandwirtschaftliche Beratungszentrale,Lindau (Centrale de vulgarisation agricole de Lindau)
OCDEOrganisation de coopération et de développement économique,Paris
OFAEOffice fédéral pour l’approvisionnement économique du pays,Berne
OFAGOffice fédéral de l’agriculture,Berne
OFASOffice fédéral des assurances sociales,Berne
OFEFPOffice fédéral de l’environnement,des forêts et du paysage,Berne
OFFTOffice fédéral de la formation professionnelle et de la technologie,Berne
OFSOffice fédéral de la statistique,Neuchâtel
OFSPOffice fédéral de la santé publique,Berne
OMC Organisation mondiale du commerce,Genève
OVFOffice vétérinaire fédéral,Berne
PSLProducteurs Suisses de Lait,Berne
RACStation fédérale de recherches en production végétale,Changins
RAPStation fédérale de recherches en production animale,Posieux
secoSecrétariat d'Etat à l'économie,Berne
SRVAService romand de vulgarisation agricole,Lausanne
TSMFiduciaire de l'économie laitière S.àr.l,Berne
UEUnion européenne
USPUnion suisse des paysans,Brougg
ZMPZentrale Markt- und Preisberichtstelle für Erzeugnisse der Land-,Forst- und Ernährungswirtschaft S.àr.l,Bonn
Unités de mesure
ct.centime
dtdécitonne = 100 kg fr.franc
hahectare = 10'000 m2 hlhectolitre kcalkilocalorie kgkilogramme
ANNEXE A65
■■■■■■■■■■■■■■■■ Abréviations
hheure
llitre
kmkilomètre
mmètre
m2 mètre carré
m3 mètre cube
mio.million
mrd.milliard
pcepièce
ttonne
%pour cent
Ømoyenne
Notion/désignation
AGPappellation géographique protégée
AOCappellation d’origine contrôlée
AVSassurance-vieillesse et survivants
CO2 dioxyde de carbone
ESBencéphalopathie spongiforme bovine («maladie de la vache folle»)
IVassurance-invalidité
LAgrloi sur l’agriculture
MPRmatières premières renouvelables
Nazote
OGMorganismes génétiquement modifiés
Pphosphore
PVpoids vif
PACpolitique agricole commune de l’UE
PERprestations écologiques requises
PIproduction intégrée
PMpoids à l’abattage
PTPproduit de traitement des plantes
SAUsurface agricole utile
SCEsurface de compensation écologique
SIPASystème d’Information de Politique Agricole
SRPAsorties régulières en plein air
SSTsystème de stabulation particulièrement respectueux des animaux
TCtaux du contingent
THCtaux hors contingent
TVAtaxe sur la valeur ajoutée
UGBunité de gros bétail
UGBFGunité de gros bétail fourrages grossiers
UMOSunité de main-d’œuvre standard
UTAunité de travail annuel
UTAFunité de travail annuel de la famille
ZM I,II,..zone de montagne I,II,....
Référence à d’autres informations en annexe (p.ex.tableaux)
A66 ANNEXE
Commission européenne,Direction générale de l'agriculture,2001.
Cadre pour des indicateurs relatifs aux dimensions économique et sociale d'une agriculture et d'un développement rural durables.
gfs-zürich,2005.
Perception subjective et indice de la qualité de vie de la population agricole – Comparaison avec le reste de la population et avec les résultats de 2001.
Rapport final sur la base d’une enquête téléphonique représentative mandatée par l’Office fédéral de l'agriculture.
Groupe de projet «Agrobiodiversität entwickeln»,2004.
Agrobiodiversität.
Institut für ökologische Wirtschaftsforschung,Berlin.
Herzog F.,Walter T.et al.,2005.
Evaluation des mesures écologiques dans le domaine de la biodiversité.
Agroscope FAL,Reckenholz.
HOTSPOT (périodique),édition avril 2005.
Biodiversité des terres cultivées.
Forum Biodiversité Suisse,Berne.
Mauch Consulting,INFRAS,Ernst Basler und Partner AG,2001.
Politique du développement durable en Suisse,bilan et perspectives (commandé par le CIRio).
Office fédéral de l'agriculture (OFAG),diverses années.
Rapport agricole 2000 / 2001 / 2002 / 2003 / 2004.
Office fédéral de l'agriculture (OFAG),2003.
Evaluation des données sur le contingentement laitier;année laitière 2002/2003
Office fédéral de l'agriculture (OFAG),2004.
Publication de l'attribution des contingents tarifaires
Selon point 2 du rapport du Conseil fédéral du 11 février 2004 concernant les mesures tarifaires 2003,tiré à part.
Office fédéral de la statistique (OFS),2003. Le développement durable en Suisse – Indicateurs et commentaires.
Office fédéral de la statistique (OFS),Office fédéral de l’environnement,des forêts et du paysage (OFEFP), Office fédéral du développement territorial (ARE),2003.
MONET (Monitoring du développement durable). Rapport final,méthodes et résultats.
Office fédéral de la statistique (OFS),diverses années.
Reflets de l'agriculture suisse,Neuchâtel.
Office fédéral du développement territorial (ARE),2004.
Evaluation de la durabilité:Conception générale et bases méthodologiques.
Union suisse des paysans (USP),diverses années. Statistiques et évaluations concernant l'agriculture et l'alimentation,Brougg.
ANNEXE A67 ■■■■■■■■■■■■■■■■
Bibliographie










 ■ Marge brute:lait et produits laitiers
■ Marge brute:lait et produits laitiers





 Prix de vente final Prix à la production
Prix de vente final Prix à la production












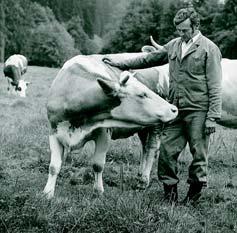

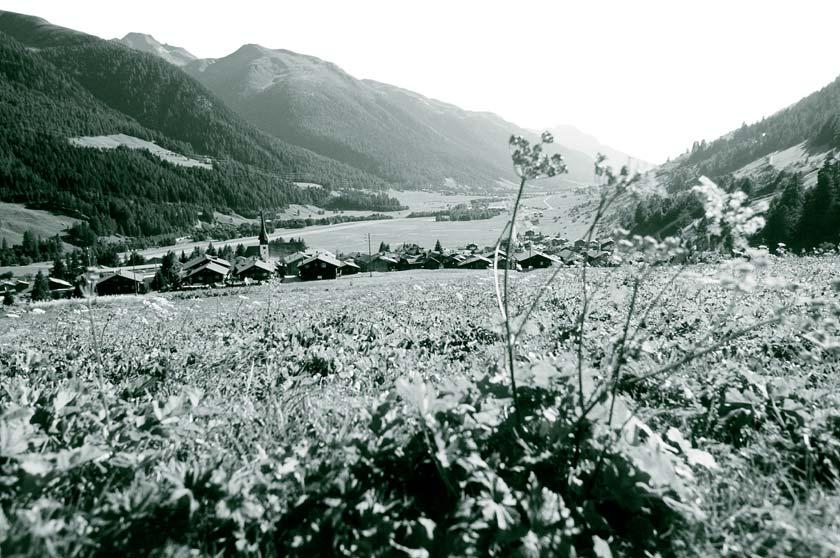
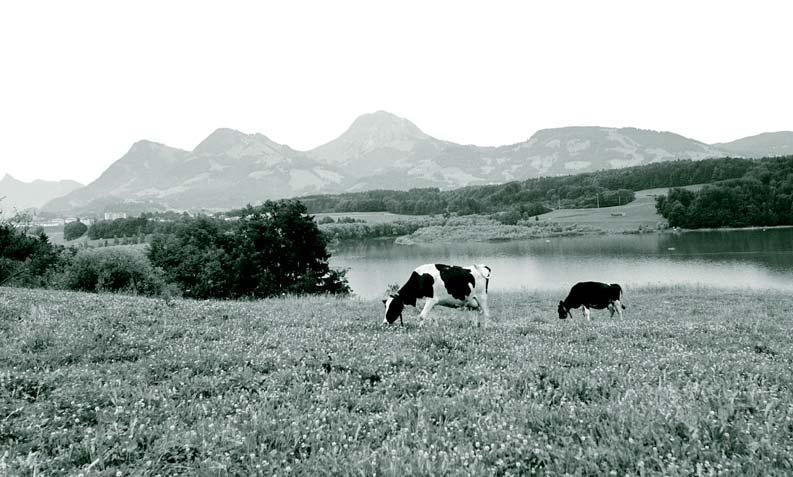
















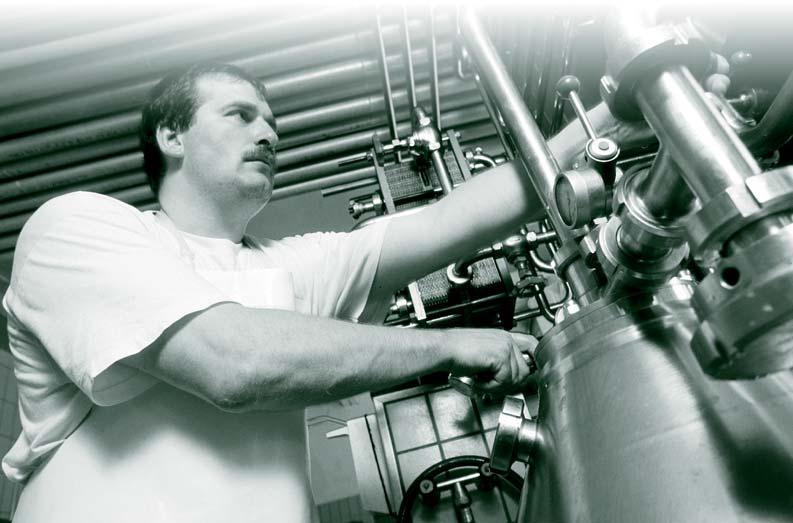


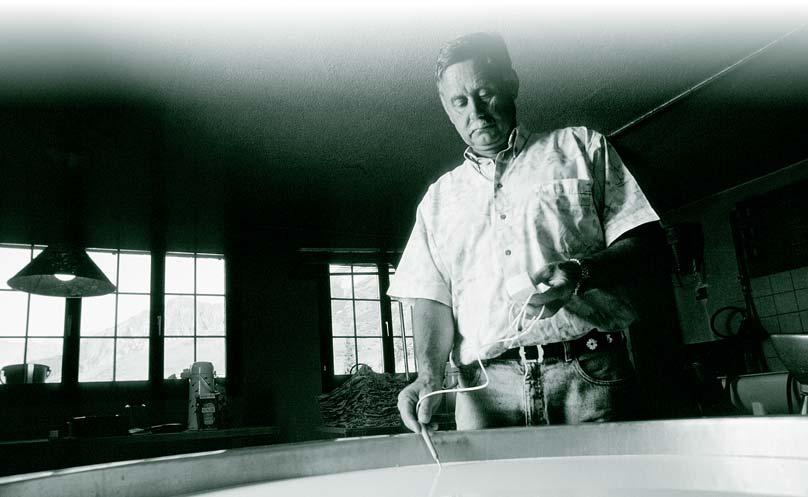



 Nombre de places de marchés publics par canton en 2004
Nombre de places de marchés publics par canton en 2004