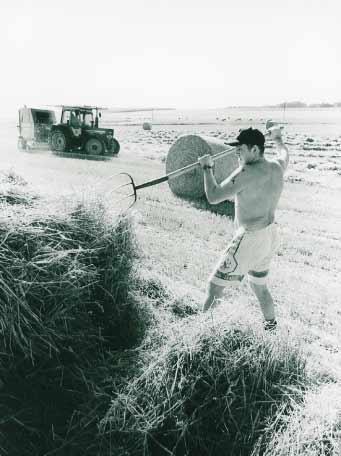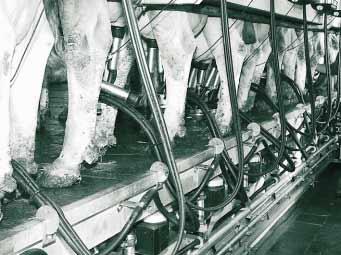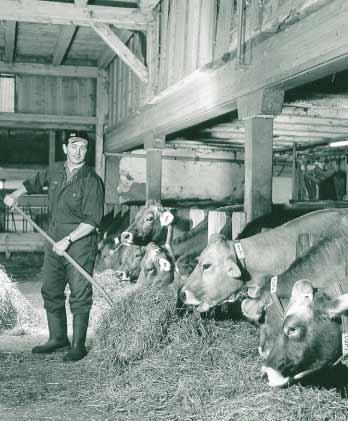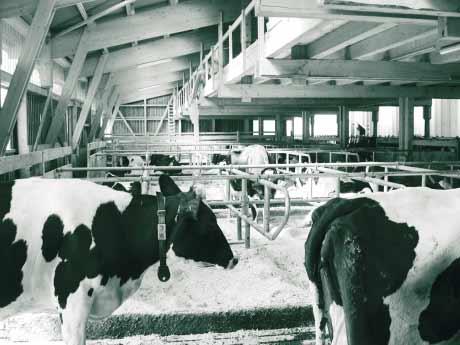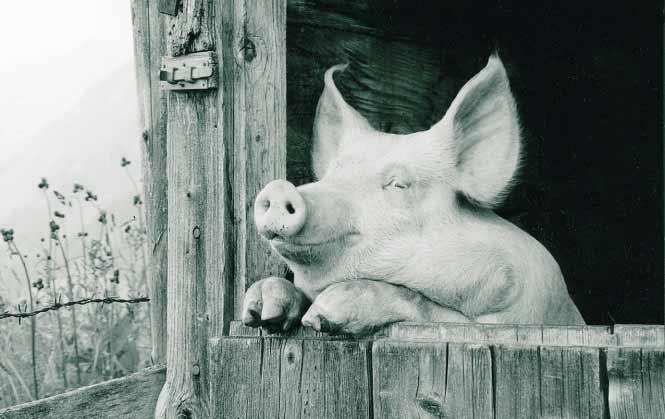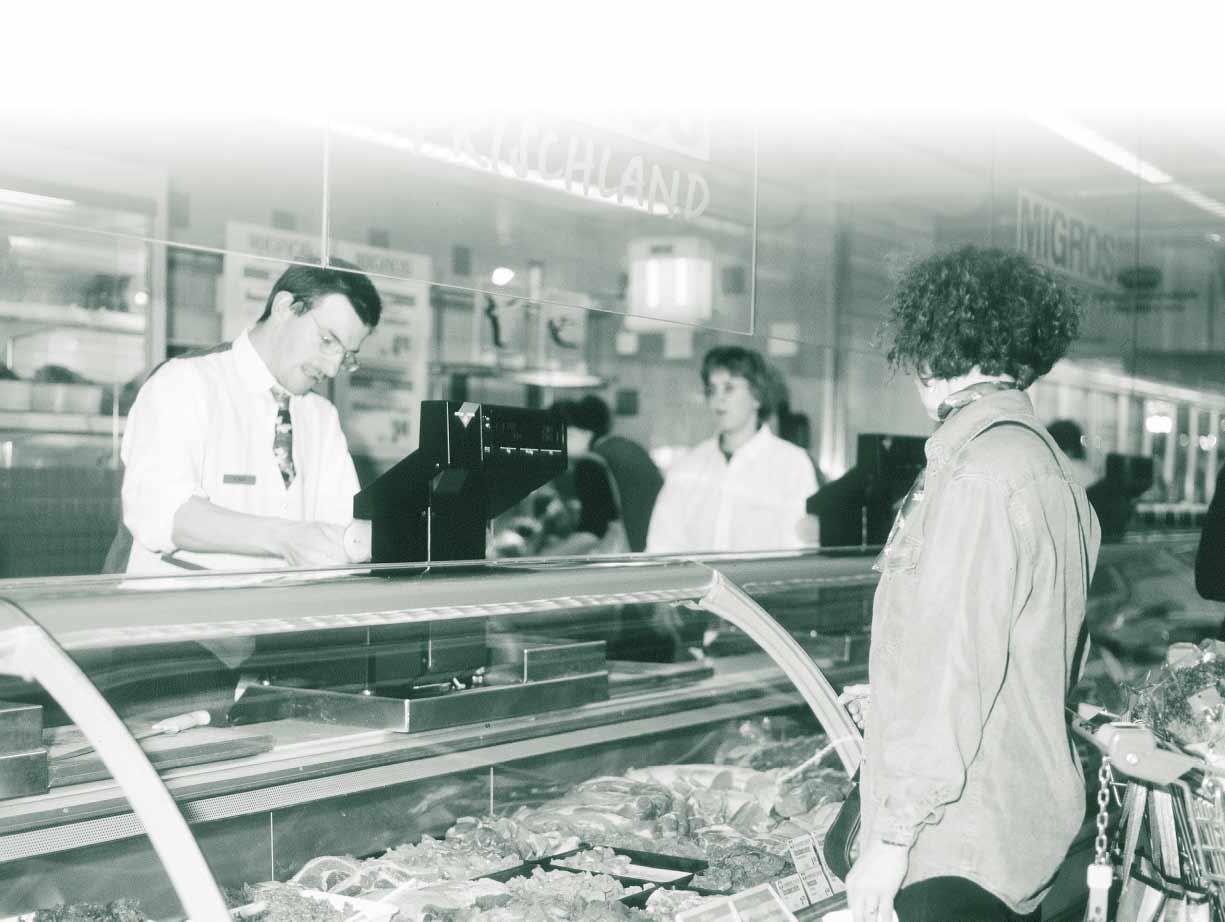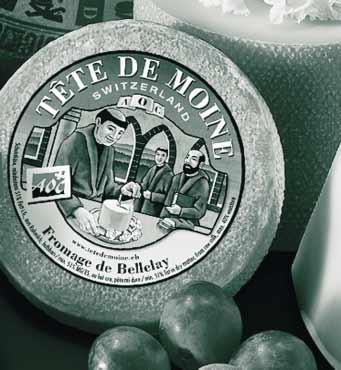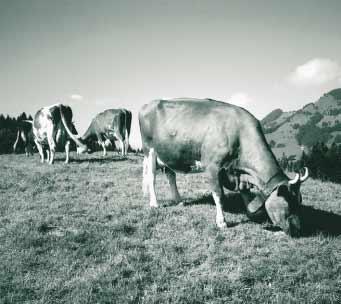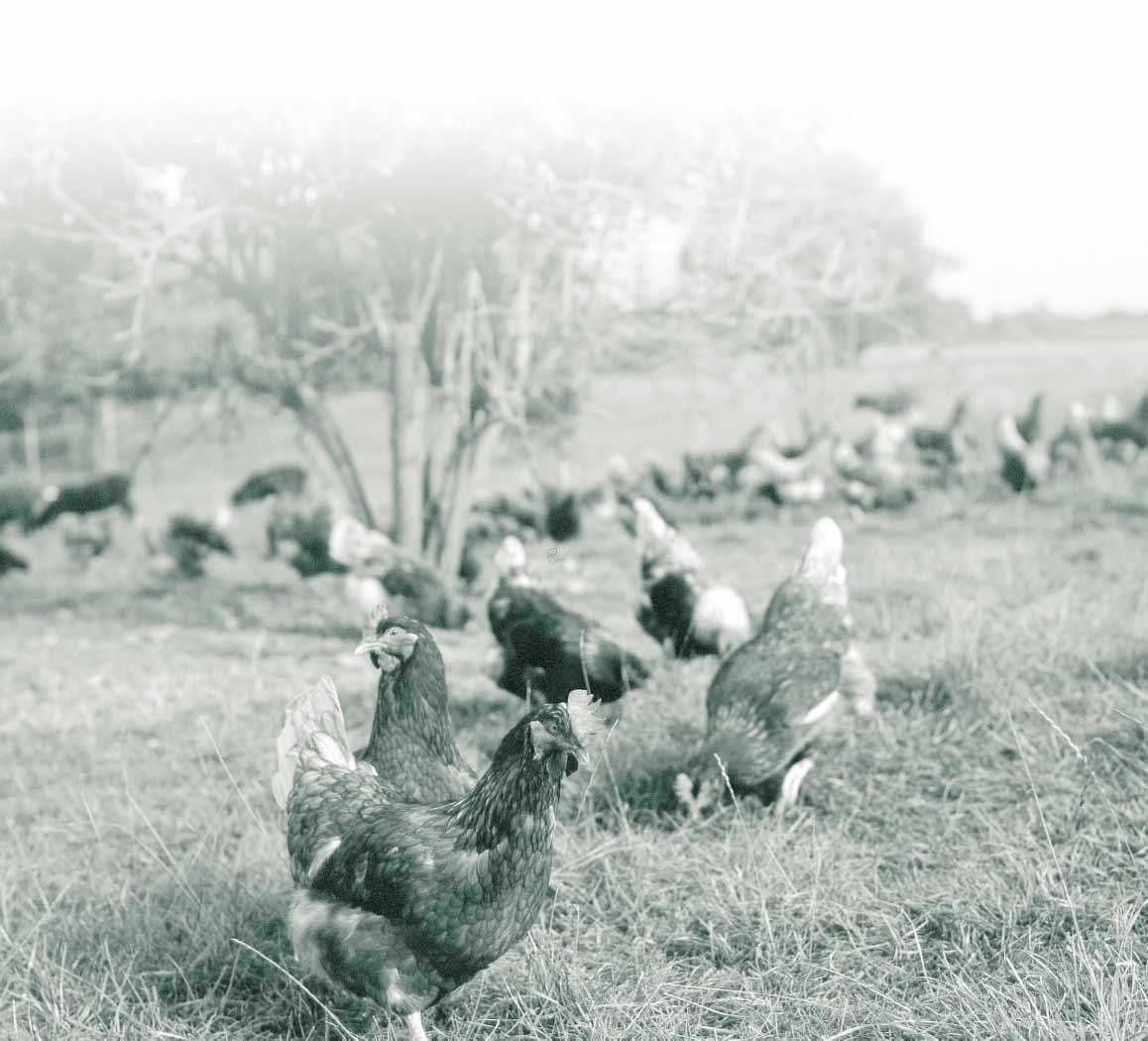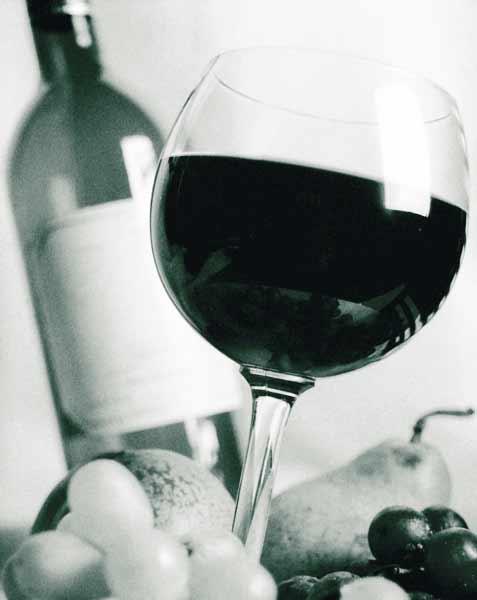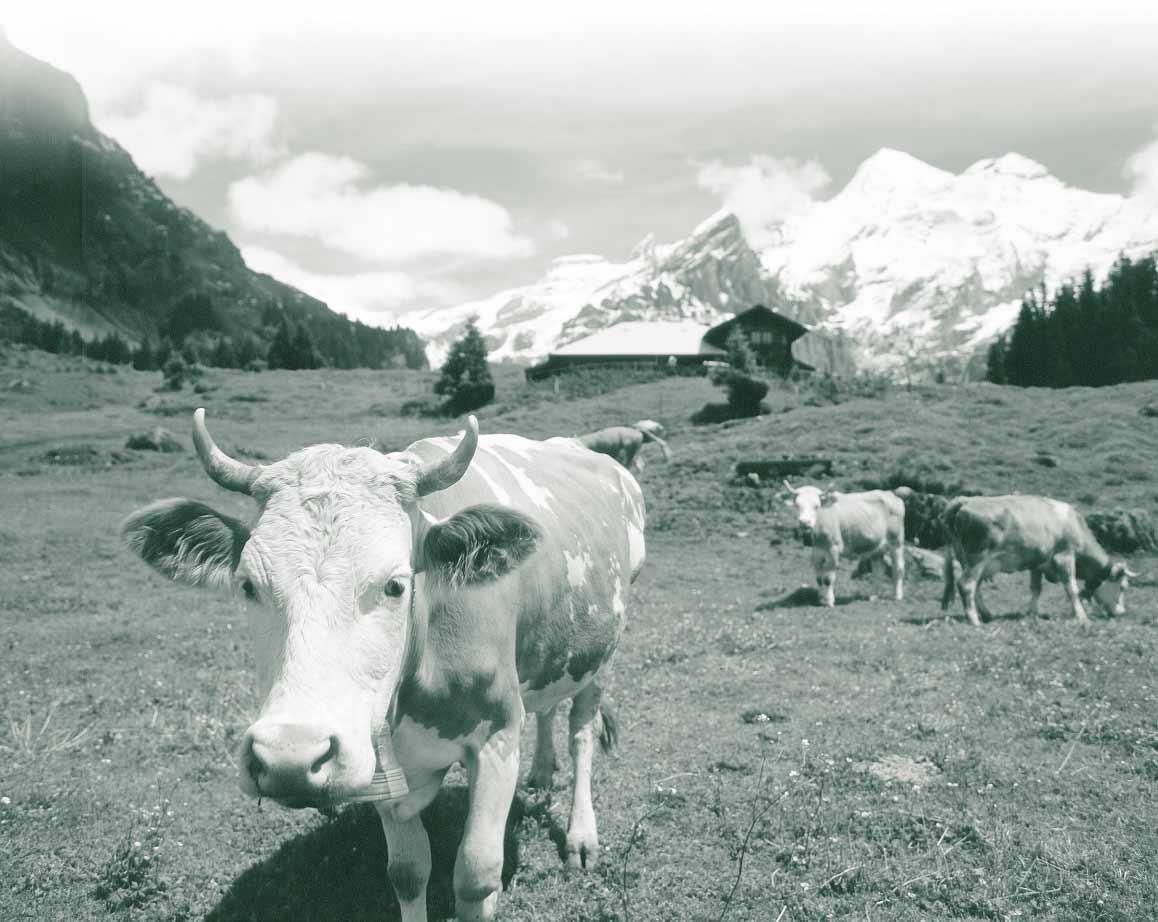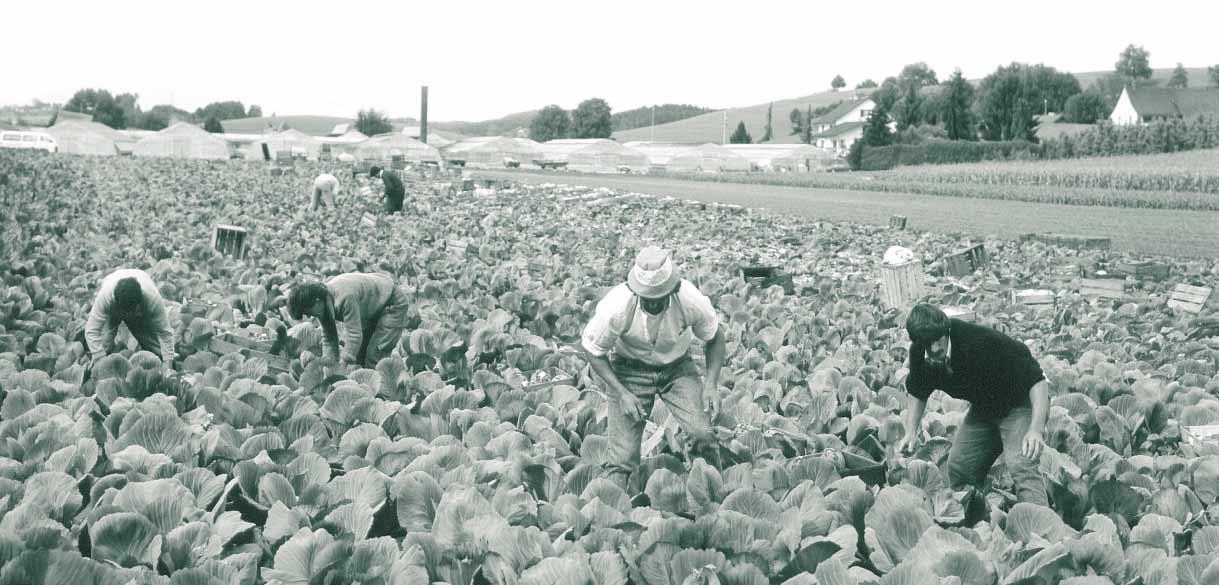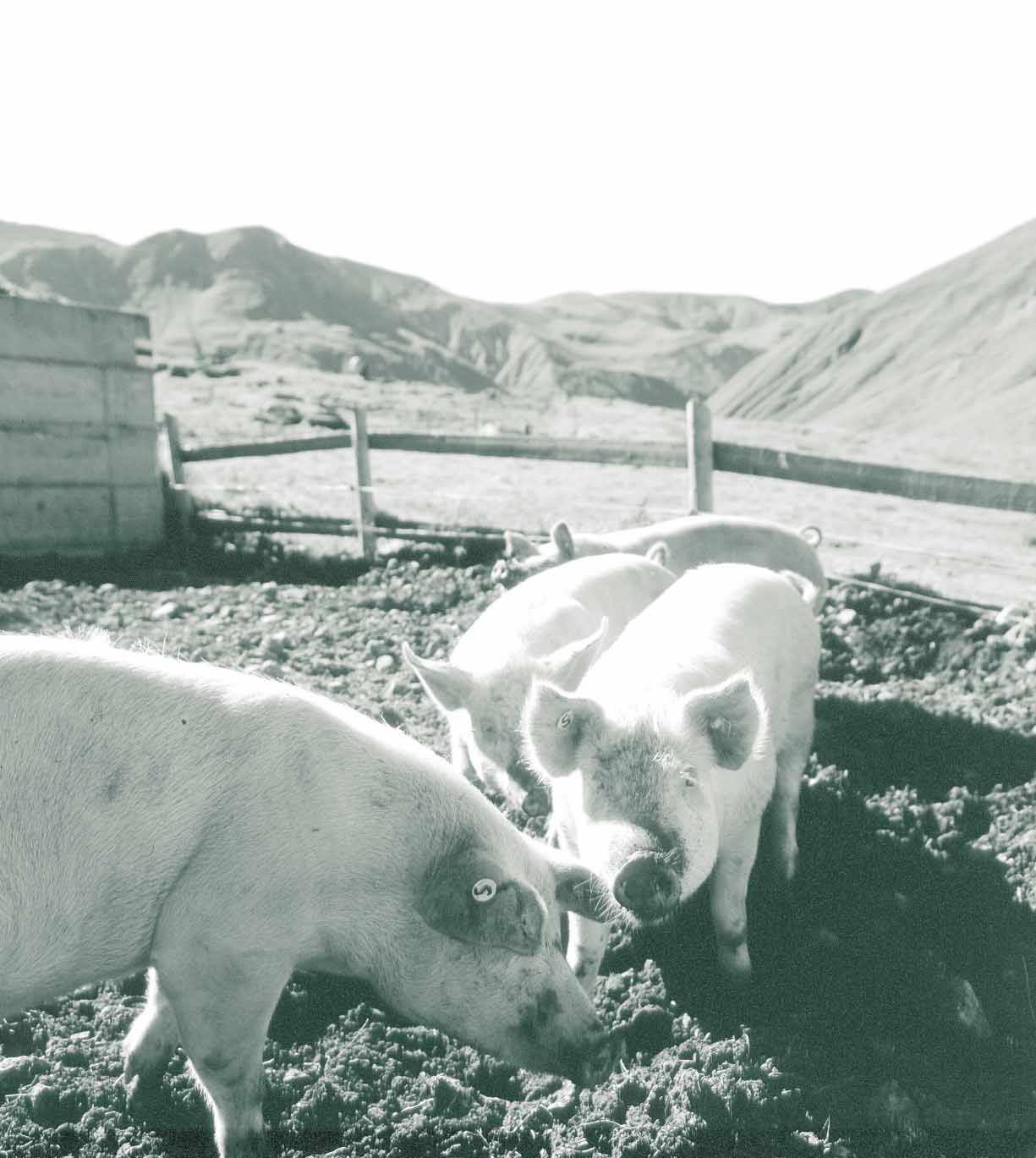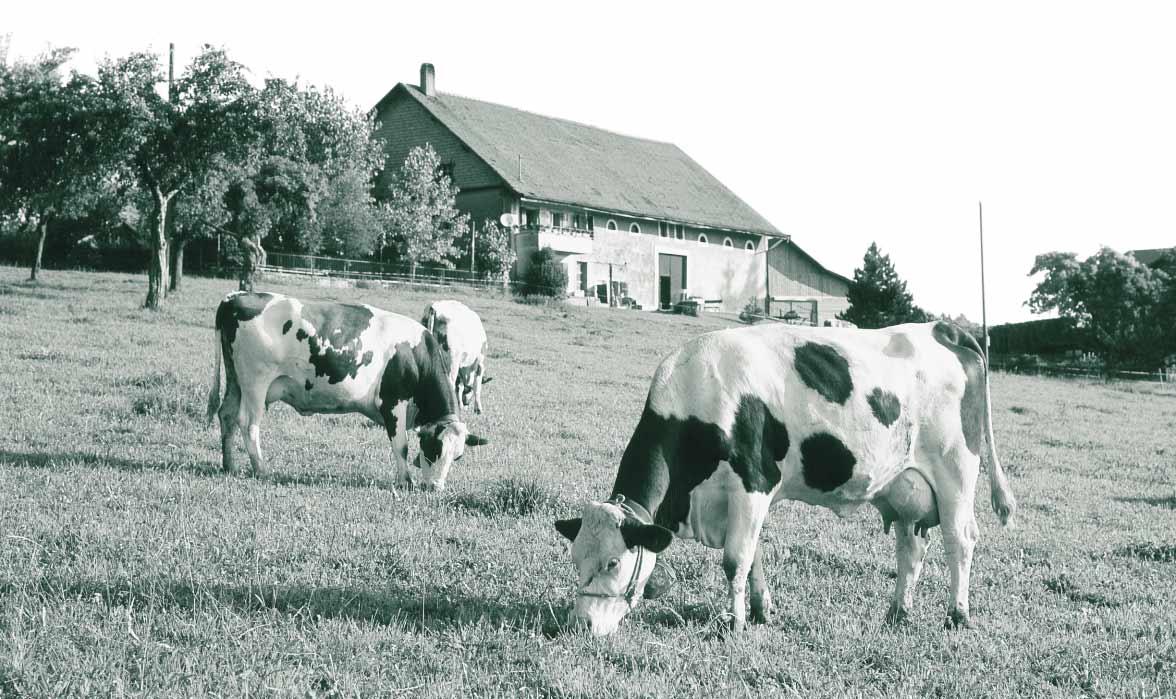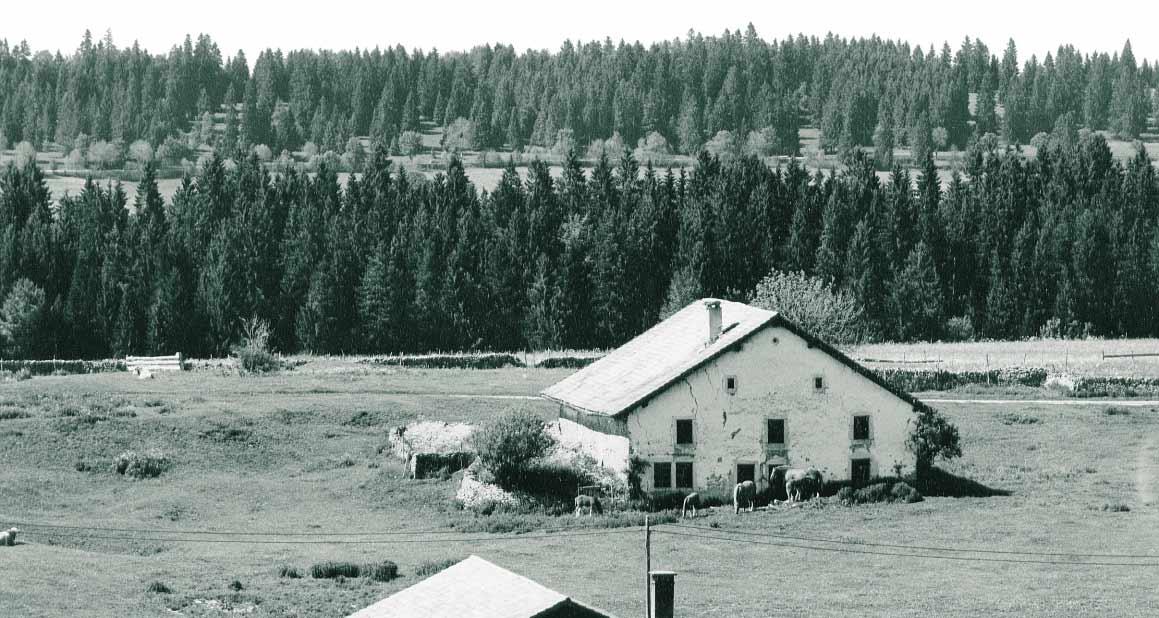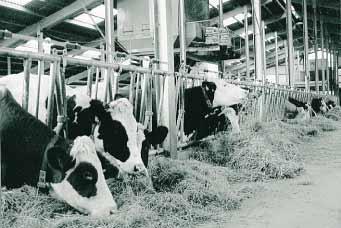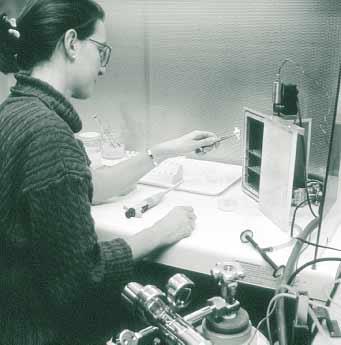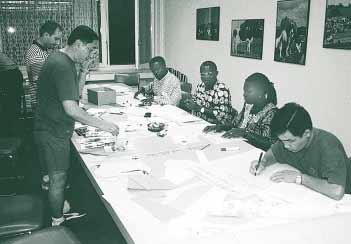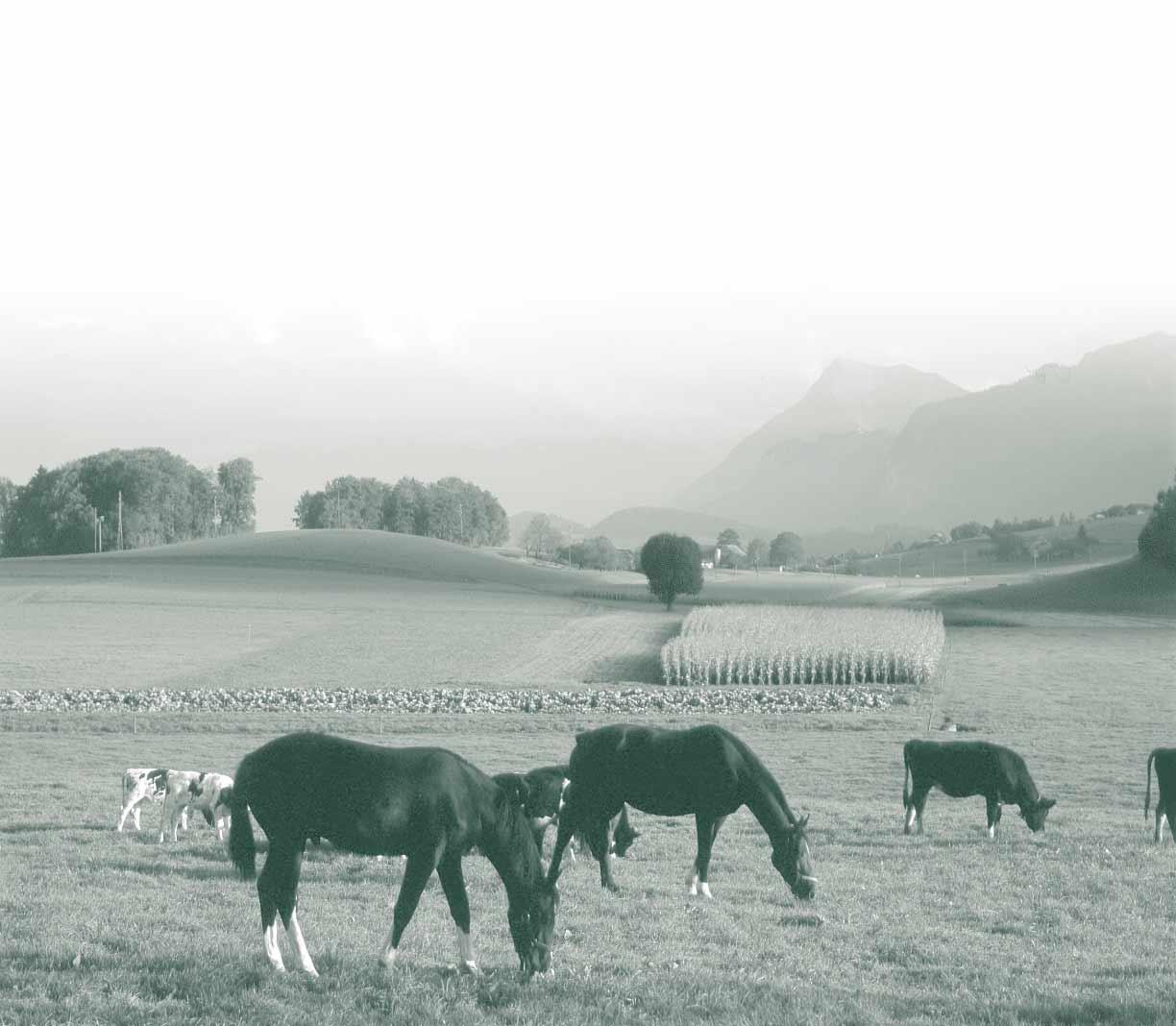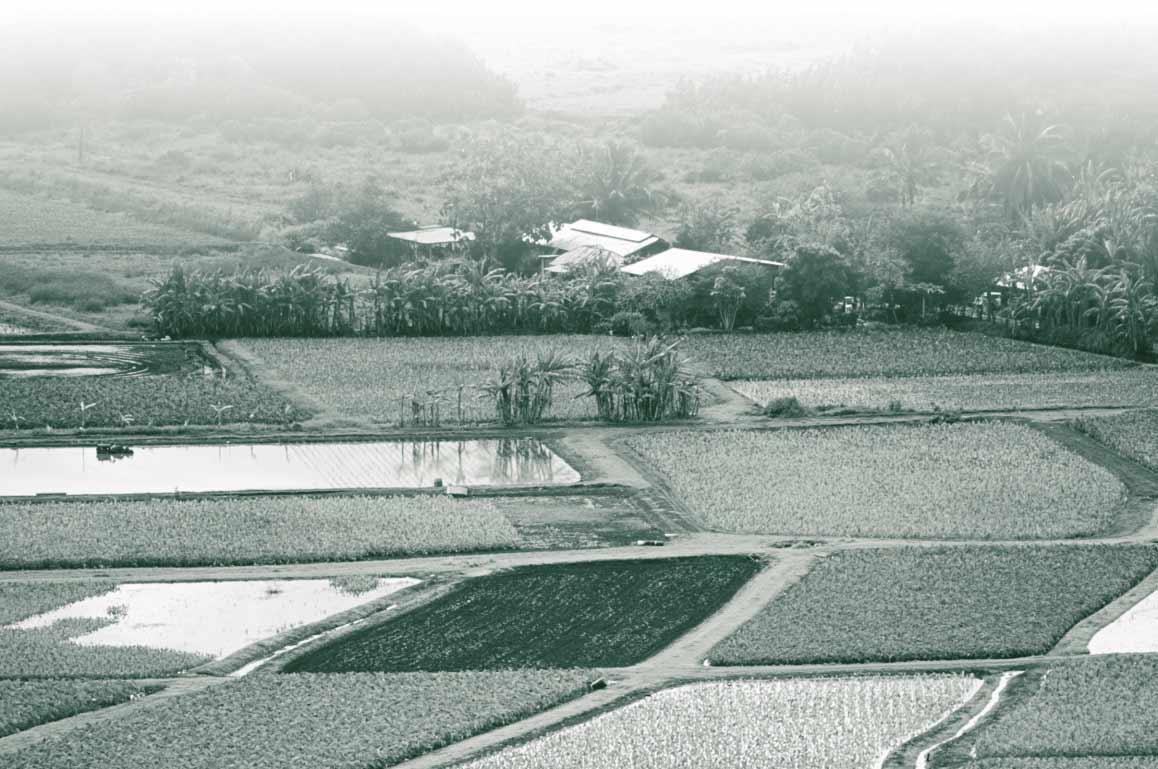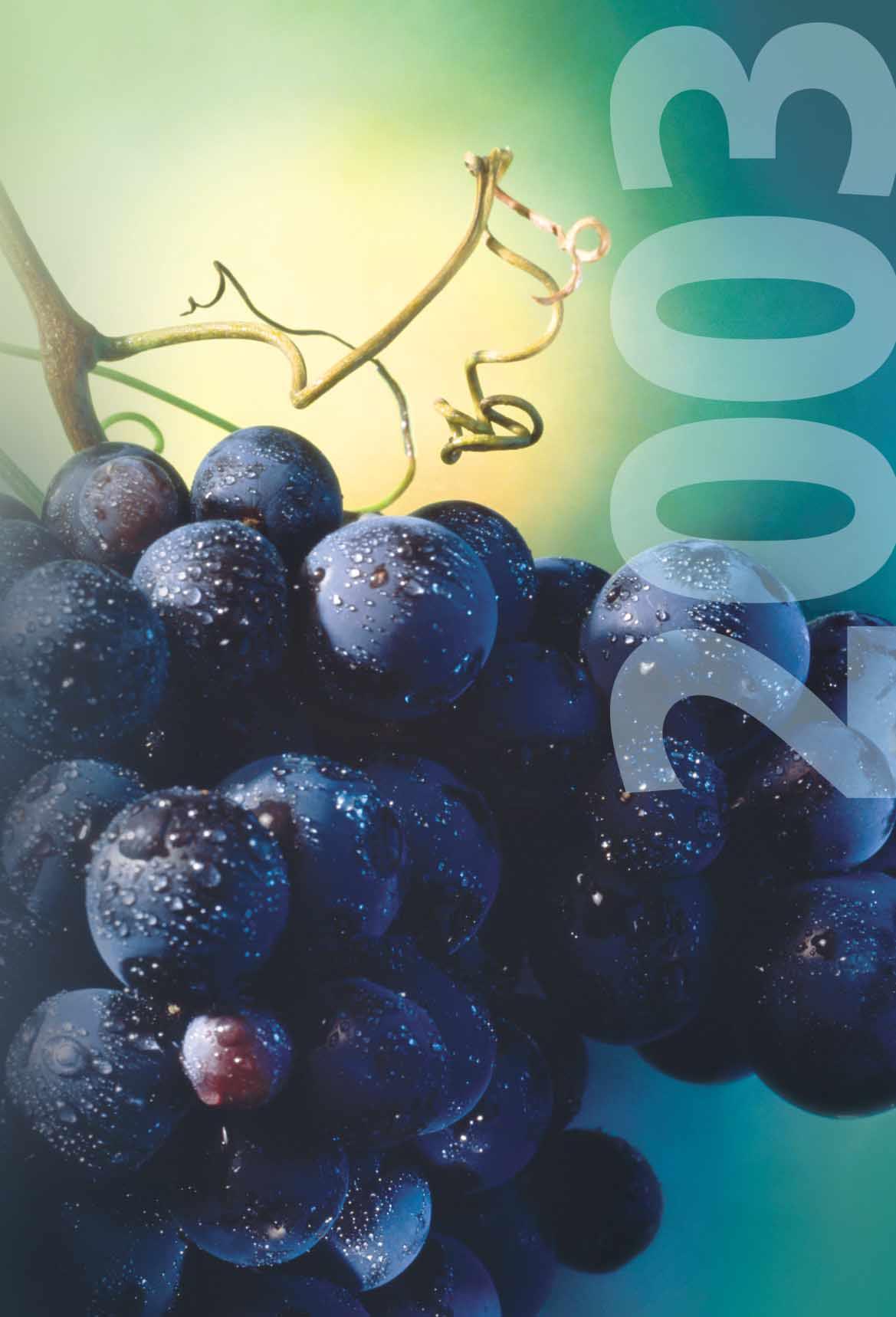
RAPPORT AGRICOLE
für Landwirtschaft
fédéral de l’agriculture
federale dell’agricoltura
federal d’agricultura
Bundesamt
Office
Ufficio
Uffizi
Rapport agricole 2003 de l’Office fédéral de l’agriculture
1
■■■■■■■■■■■■■■■■
Editeur
Office fédéral de l’agriculture (OFAG)
CH-3003 Berne
Tél.:031 322 25 11
Fax:031 322 26 34
Internet:www.blw.admin.ch
Copyright:OFAG,Berne 2003
Layout et graphisme
Artwork,Grafik und Design,Saint-Gall
Impression
RDV,Berneck
Photos
–Archives d’illustrations Agrofot
–Christof Sonderegger,photographe
–FAL Station fédérale de recherches en agroécologie et agriculture
–FAT Station fédérale de recherches en économie et technologie agricoles
–LBL Landwirtschaftliche Beratungszentrale Lindau
–Markus Redier,LID
–OFAG Office fédéral de l’agriculture
–Peter Mosimann,photographe
–Peter Studer,photographe
–PhotoDisc Inc.
–Photothèque Incolor
–Prisma Dia-Agentur
–PSL Fédération des Producteurs
Suisses de Lait
–Switzerland Cheese Marketing AG
–Tobias Hauser,photographe
–USP Union suisse des paysans
– Zefa Blue Planet
Diffusion
OFCL,Diffusion publications
CH-3003 Berne
No de commande:
français:730.680.03 f
10.2003 1400 103409
allemand:730.680.03 d
10.2003 2800 103409
italien:730.680.03 i
10.2003 200 103409
Fax:031 325 50 58
Internet:www.publicationsfederales.ch
ACHEVÉ D’IMPRIMER 2
■■■■■■■■■■■■■■■■ Table des matières Préface 4 ■ 1.Rôle et situation1.1Economie 9 de l‘agriculture 1.1.1L’agriculture,partie intégrante de l‘économie 10 1.1.2Marchés 25 1.1.3 Situation économique du secteur agricole 51 1.1.4 Situation économique des exploitations 57 1.2Aspects sociaux et société 77 1.2.1 Aspects sociaux 78 1.2.2 Société 106 1.3Ecologie et éthologie 111 1.3.1 Ecologie 111 1.3.2 Ethologie 128 1.4Appréciation de la durabilité 133 ■ 2.Mesures de politique2.1Production et ventes 139 agricole 2.1.1Instruments transversaux 141 2.1.2Economie laitière 155 2.1.3 Economie animale 163 2.1.4 Production végétale 171 2.1.5 Examen des mesures 181 2.2Paiements directs 185 2.2.1 Importance des paiements directs 186 2.2.2 Paiements directs généraux 194 2.2.3 Paiements directs écologiques 203 2.3Amélioration des bases de production 223 2.3.1 Améliorations structurelles et aide aux exploitations 224 2.3.2 Recherche,vulgarisation,formation professionnelle,CIEA,haras 234 2.3.3 Moyens de production 243 2.3.4 Elevage 249 2.4 Section Inspectorat des finances 251 2.5 Résultats de la Politique agricole 2007 254 2.6 Sécheresse et programme d’allégement 2003 258 ■ 3.Aspects internationaux3.1Développements internationaux 263 3.2 Comparaisons internationales 281 ■ Annexe Tableaux A2 Textes légaux relevant du domaine de l‘agriculture A64 Définitions et méthodes A67 Abréviations A87 Bibliographie A89 TABLE DES MATIÈRES 3
L’année 2002 s’est ressentie du contexte difficile dans lequel a évolué l’économie laitière.Il a cependant été possible d'en limiter l'impact sur l'agriculture grâce à l'engagement de tous les intéressés.Dans l’ensemble,les résultats économiques enregistrés en 2002 sont comparables à ceux de l’année précédente.Vers la fin de l’année 2002, les prix du lait ont baissé d’environ 5 ct.le kilo,réduction qui ne déploiera pleinement ses effets qu’en 2003.A cela s’ajoutent les pertes dues à la canicule et à la sécheresse de cet été.Selon les estimations des Comptes économiques de l’agriculture,les revenus 2003 devraient baisser de 13% par rapport à 2002.

L’année 2003 a vu un certain nombre de sujets d'importance pour l’agriculture figurer à l’ordre du jour tant de la politique intérieure que de la politique extérieure.Citons,sur le plan domestique,les décisions relatives à la politique agricole 2007 et le programme d’allégement 2003 visant à assainir les finances fédérales et,sur le plan extérieur,le cycle de négociations de l’OMC à Cancun ainsi que les négociations avec l’UE portant sur la compensation des différences de prix des matières premières pour les produits agricoles transformés.Les décisions adoptées en politique intérieure donnent en quelque sorte un regain de sécurité à l’agriculture pour les années à venir.Désormais, il est clair que le contingentement laitier sera aboli en 2009,mais au plus tard en 2011.Sont également fixés les moyens financiers dont l’agriculture pourra disposer au cours des quatre prochaines années.Le Parlement a approuvé trois enveloppes financières pour un montant de 14,092 milliards de francs,dont sera déduite la contribution que l’agriculture doit fournir au titre de l’assainissement des finances fédérales.Quand bien même elle est nécessaire d'un point de vue global,cette contribution fait mal.En ce qui concerne la situation au sein de l’OMC,son évolution est moins évidente que celle de la politique intérieure.Les négociations de Cancun ont échoué,mais il serait trompeur d’en déduire que l’agriculture sera épargnée par d’autres vagues de libéralisation.Au contraire,il faut s’attendre à ce que la pression continue de croître,que ce soit au niveau de l’OMC ou dans le cadre d’accords bilatéraux.Dans l'ensemble,l’agriculture restera soumise à de fortes contraintes d’ajustement dans les années à venir.
Ce quatrième Rapport agricole met en évidence que ces dernières années,l’évolution dans l’agriculture a été assez constante.Ainsi,l’évolution structurelle enregistrée entre 2000 et 2002 (2,2%) est comparable à celle des années 1990 à 2000.Quant aux paramètres micro-économiques,ils n’ont guère changé.Le ratio d’endettement a stagné à 41%;les investissements varient d’une année à l’autre,certes,mais aucune tendance à la baisse ne se profile à l’horizon.L’évaluation des données collectées lors des trois enquêtes sur la santé ne révèle aucune augmentation des problèmes de santé ou des troubles psychiques parmi la population paysanne en 2002 par rapport à 1997 ou à 1992.Autre fait indéniable,les revenus affichés dans l’agriculture sont bas,en moyenne,si on les compare à ceux réalisés dans les autres secteurs de l’économie. D'ailleurs,l’écart s’est plutôt creusé ces dernières années.Néanmoins,un nombre significatif d’exploitations continue de dépasser le revenu de référence et ce,nettement parfois.La productivité du travail est de loin le facteur le plus important qui distingue les exploitations performantes des exploitations moins rentables,ainsi qu'il ressort d'une analyse approfondie effectuée par l’EPF de Zurich dans le cadre du projet «Performance dans l’agriculture».Autrement dit,il reste encore un potentiel considérable à exploiter pour l'amélioration des résultats économiques.
PRÉFACE ■■■■■■■■■■■■■■■■ Préface
4
Le processus d'adaptation des structures devrait donc se poursuivre au même rythme durant les prochaines années.Il ne doit pas signifier pour autant la cessation de l'activité agricole dans un cas individuel.Mais les exploitations qui ne sont pas en mesure de générer des revenus suffisants avec la seule agriculture devront nécessairement améliorer la productivité du travail afin de dégager du temps libre pour exercer une activité accessoire.Il n'existe pas de recette toute faite indiquant la voie à suivre par les exploitations en général.Agir de manière responsable suppose que l'on ne ferme pas les yeux devant des changements inéluctables.De même,il est essentiel d'analyser ses atouts et ses faiblesses,ses désirs et ses moyens en toute sincérité avant de prendre une décision.
Les années à venir seront,sans nul doute,tout sauf simples pour l'agriculture.Aussi,les paysans qui perçoivent l'avenir non pas comme une menace mais comme un défi, continueront d'être le principal soutien d'une agriculture compétitive,orientée vers la production durable.
Manfred Bötsch
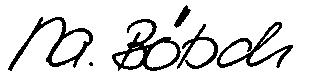 Directeur de l’Office fédéral de l’agriculture
Directeur de l’Office fédéral de l’agriculture
PRÉFACE
5
6
■■■■■■■■■■■■■■■■ 1.Rôle et situation de l’agriculture

1 7
Conformément à l’art.104 Cst.,la Confédération veille à ce que l’agriculture,par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché,contribue substantiellement:
a.à la sécurité de l’approvisionnement de la population;
b.à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural;
c.à l'occupation décentralisée du territoire.
Les buts ancrés dans la Constitution indiquent clairement que l’agriculture remplit des tâches qui vont au-delà de la seule production de denrées alimentaires.On parle à ce propos de multifonctionnalité de l’agriculture.L’entretien du paysage,le maintien des bases naturelles de l’existence et l’occupation décentralisée du territoire sont des prestations d’intérêt public qui ne peuvent être compensées que partiellement par le marché.
En 1996,la Constitution a introduit la notion de durabilité.Celle-ci constitue,depuis la Conférence sur l'environnement et le développement durable de 1992,à Rio de Janeiro,une ligne directrice majeure en matière de politique.
Le Conseil fédéral entend suivre les effets de la nouvelle politique agricole.Il a créé les conditions indispensables pour ce faire dans son ordonnance sur l'évaluation de la durabilité de l'agriculture.Les dispositions de l’art.1,al.1,de ladite ordonnance prévoient que la politique agricole et les prestations de l’agriculture soient régulièrement appréciées sous l’angle de la durabilité,celles de l’art.2 que les conséquences économiques,sociales et écologiques soient évaluées.L’OFAG a reçu mandat de présenter chaque année un rapport présentant les résultats des analyses;il y répond par la rédaction du rapport agricole.
Les trois dimensions de la durabilité constituent la structure de base des informations contenues dans la 1ère partie du rapport agricole,partie consacrée au rôle et à la situation de l’agriculture.
8 1.RÔLE ETSITUATION DE L’AGRICULTURE 1
1.1 Economie
Pour pouvoir apporter les prestations que l’on attend d’elle,l’agriculture doit disposer d’une base économique suffisante.La représentation des incidences économiques de la politique agricole constitue de ce fait une partie importante du rapport.Elle fournit notamment des informations sur les résultats économiques des exploitations agricoles, l’évolution des structures,les liens financiers au reste de l’économie ainsi que les relations aux différents marchés.
Les paragraphes qui suivent présentent la place économique de l’agriculture en tant que pan de l’économie,quelques informations quant à la production,la consommation,le commerce extérieur,les prix à la production et à la consommation sur les différents marchés,la situation économique du secteur dans son ensemble et celle des exploitations individuelles,ainsi que le deuxième volet de l’étude «Performance dans l'agriculture suisse».

■■■■■■■■■■■■■■■■
9 1.1 ECONOMIE 1
1.1.1
L’agriculture,partie intégrante de l'économie

Evolutions structurelles
L’agriculture est étroitement liée avec le reste de l’économie.Si les mutations socioéconomiques ont des incidences sur l’agriculture,celle-ci influe de son côté sur les autres secteurs de l’économie.L’agriculture se procure en amont les moyens de production,tandis que les entreprises de transformation et de commerce lui achètent en aval ses produits et ses prestations.Les évolutions structurelles tant dans l’agriculture que dans des entreprises sélectionnées en amont et en aval sont présentées ci-après.
L’activité des agriculteurs génère des emplois dans les entreprises qui opèrent en amont et en aval de l’agriculture.En l’absence d’une agriculture productive,les activités seraient appelées à disparaître partiellement ou complètement.
De 1995 à 2001,le nombre de personnes employées,d’une part,dans l’agriculture, ainsi que,d’autre part,dans les entreprises en amont et en aval a diminué à parts égales de 50'000 au total.Seul le nombre des personnes employées dans les entreprises en amont est resté stable.
En 2001,l’agriculture et les secteurs qui lui sont étroitement liés occupaient directement environ 12% des personnes actives.Les entreprises en aval employaient pour leur part environ 215'000 personnes,celles en amont environ 60'000 personnes. Quelque 200'000 personnes ont été occupées dans l’agriculture.
10 1.1 ECONOMIE 1 ■■■■■■■■■■■■■■■■
Entreprises en amontAgricultureEntreprises en aval Nombre 1995 1 19982001 Sources: OFS, USP, OFAG 1 agriculture 1996 0 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000
Evolution du nombre d'employés dans le secteur agricole
Évolution du nombre d’exploitations selon la classe de grandeur Classe de Nombre VariationNombreVariation grandeurd’exploitations1990–2000d’exploitations2000–2002 par anpar an en %en %
Entre 1990 et 2000,22'278 exploitations ont été abandonnées au total.Dans la moitié des cas environ,il s’agissait de mini-exploitations comptant une surface de 0 à 3 ha.Leur nombre a baissé d’environ 60% au cours de cette période.L’abandon de ces exploitations n’a toutefois libéré que 16'546 ha,soit environ 1,5% de la SAU.De même,les exploitations des classes de grandeurs 3–10 ha et 10–20 ha sont en net recul.En revanche,une augmentation a été enregistrée pour les exploitations de plus de 20 ha,dont le nombre a surtout progressé dans la classe de 30 à 50 ha.On peut en déduire que la ligne de partage entre le recul et l’accroissement du nombre des exploitations se situe autour de 20 ha pour l’ensemble de la Suisse.
De 2000 à 2002,le nombre d’exploitations a diminué de 3'116 unités,soit de 2,2% par an.Cela dit,le taux de variation a été plus faible que dans les années 1990 à 2000 pour les exploitations comptant une surface de 3 ha et moins.Par contre,ce taux a affiché une hausse pour les exploitations de plus de 3 ha,passant de 1,6 % à 2,1%.
Evolution du nombre d’exploitations selon la région
Le nombre d’exploitations a reculé,de 1990 à 2000,d’environ 10'000 unités dans la région de plaine et de 5'500 et 6'500 unités respectivement dans celles des collines et de montagne.Le taux de réduction a été comparable dans les trois régions durant cette décennie.
1.RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 1.1 ECONOMIE 11 1
In ha1990200020012002 0–3 19 8198 371 –8,37 9977 784 –3,6 3–1027 09218 542 –3,717 52516 700 –5,1 10–2031 63024 984 –2,324 19923 640 –2,7 20–3010 04111 6741,511 77511 7890,5 30–503 5495 7595,06 0126 1333,2 > 506841 2075,81 2761 3756,8 Total92 81570 537 –2,768 78467 421 –2,2 > 3 72 99662 166 –1,660 78759 637 –2,1 Source:OFS
Région Nombre VariationNombreVariation d’exploitations1990–2000d’exploitations2000–2002
1990200020012002 Région de plaine 41 59031 612 –2,730 62130 186 –2,3 Région des collines24 54118 957 –2,518 58418 242 –1,9 Région de montagne26 68419 968 –2,919 57918 993 –2,5 Total92 81570 537 –2,768 78467 421 –2,2 Source:OFS
par anpar an en %en %
■ Agriculture
Tableau 1,page A2
Dans les trois régions,la diminution annuelle a été un peu plus faible de 2000 à 2002 que durant la décennie précédente.
Évolution du nombre de personnes occupées CatégorieNombre de VariationNombre deVariation personnes 1990–2000personnes2000–2002 occupéespar anoccupéespar an en %en %
En 2000,l’agriculture occupait dans l’ensemble 49'768 personnes de moins qu’en 1990,réduction qui a concerné exclusivement la main-d’œuvre familiale.La part de la main-d’œuvre non familiale a,quant à elle,légèrement progressé.
Un nouveau recul du nombre des personnes occupées a été observé de 2000 à 2002. Le taux de diminution a cependant été plus faible que celui de la précédente décennie. Une nouvelle fois,la part de la main-d’œuvre familiale et celle de la main-d’œuvre non familiale ont toutes deux régressé.

1990200020012002 Main-d’œuvre familiale217 477165 977 –2,7163 094160 834 –1,6 dont chefs d’exploitation88 88974 724 –1,772 64271 217 –2,4 cheffes d’exploitation3 9262 346 –5,02 2872 293 –1,1 Main-d’œuvre non familiale36 08437 8160,536 58136 102 –2,3 Total253 561203 793 –2,2199 675198 936 –1,2 Source:OFS
Tableau 2,page A2 1.1 ECONOMIE 1 12
■ Secteurs en amont et en aval
Les structures en amont et en aval ont connu une évolution variable selon le secteur.
Evolution des entreprises sélectionnées en amont de l'agriculture Fabrication
Fabrication de machines agricoles
Commerce en gros de céréales, de semences et d'aliments fourragers
199519982001
Sources: OFS, USP, OFAG
L’analyse des secteurs sélectionnés en amont durant la période 1995 à 2001 montre, en ce qui concerne la fabrication d'aliments pour animaux et de machines agricoles, une stagnation ou une légère augmentation tant pour les entreprises que pour les personnes occupées.Dans le commerce de gros de céréales,semences et aliments pour animaux,le nombre de personnes occupées a progressé alors que celui d'entreprises a diminué
Evolution du nombre d'employés dans les entreprises sélectionnées en amont de l'agriculture
Fabrication de machines agricoles
Commerce en gros de céréales, de semences et d'aliments fourragers
199519982001
Sources: OFS, USP, OFAG
d'aliments
fourragers pour animaux de rente
Nombre
0 700 100 200 300 400 500 600
Fabrication d'aliments fourragers pour animaux de rente
Nombre
0 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 1.RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 1.1 ECONOMIE 1 13
Pour les secteurs sélectionnés en aval,l’analyse met en relief une concentration pour cette même période 1995 à 2001.En 1995,10'171 personnes travaillaient dans 282 entreprises du secteur de l’abattage et de la transformation de la viande.Six ans plus tard,on dénombrait 10'683 employés (+5%) dans 262 entreprises (–7%).Pour ce qui est du secteur de la transformation du lait,tant le nombre des entreprises que celui des employés ont baissé durant cette période.Alors que 11'091 personnes trouvaient du travail dans 1'445 entreprises en 1995,elles n’étaient plus que 10'058 au bénéfice d’un emploi dans 1'148 entreprises en 2001.Quant au commerce de gros et au commerce de détail (produits alimentaires,boissons et tabac),ils ont eux aussi enregistré un recul de ces deux chiffres pour la période considérée.
Evolution des entreprises sélectionnées en aval l'agriculture
Transformation du laitAbattage et transformation de la viande
Fabrication de pain et d'articles de boulangerie
199519982001
Commerce en gros de denrées alimentaires, de boissons et de tabac
Commerce de détail spécialisé en denrées alimentaires, boissons et tabac
Sources: OFS, USP, OFAG
Evolution du nombre d'employés dans les entreprises sélectionnées en aval de l'agriculture
Transformation du laitAbattage et transformation de la viande
Fabrication de pain et d'articles de boulangerie
199519982001
Commerce en gros de denrées alimentaires, de boissons et de tabac
Commerce de détail spécialisé en denrées alimentaires, boissons et tabac
Sources: OFS, USP, OFAG
14 1.1 ECONOMIE 1
Nombre
0 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000
Nombre
0 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 Tableau
3,page A3
■ Exploitations laitières Les structures de la production laitière ont profondément changé au cours des années 1990/91 à 2001/02.L’introduction du commerce des contingents en 1999 a encore accéléré le processus d’adaptation.
Evolution des exploitations laitières
ParamètreTotal
1990/912001/02
ProducteursNombre50 33436 231 Contingent Ø kg58 86183 407 Surface Ø ha16,519,6
Sources:OFAG,OFS
Evolution des exploitations de l'économie laitière
Le nombre d’exploitations laitières dans la région de plaine a diminué de près d’un tiers entre 1990/91 et 2001/02.Dans le même temps,le contingent moyen a augmenté de 50%,tandis que la SAU mise en valeur par exploitation s’est accrue d’environ 20%, passant de 17,2 à 20,6 ha.
15 1.1 ECONOMIE 1 1.RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE
dans
région de plaine 1 1990/912001/02 Nombre, kg ha Sources: OFAG, OFS 1 zone des grandes cultures, zones intermédiaires, zone des collines Producteurs Contingent Ø Surface Ø 0 30 25 20 15 10 5 0 80 000 60 000 20 000 40 000 100 000 30 076 66 903 20 771 98 197
la
Evolution des exploitations de l'économie laitière dans la région de montagne 1
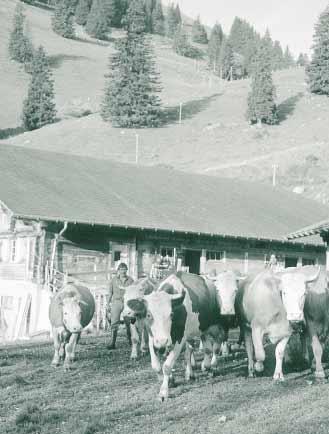
Le nombre d’exploitations laitières dans la région de montagne a diminué d’un quart durant ces onze années,tandis que le contingent moyen progressait de 30%.La SAU mise en valeur par exploitation a augmenté de 17%,passant de 15,6 à 18,2 ha.
Evolution des exploitations laitières depuis l’introduction du commerce des contingents
L’introduction du commerce de contingents en 1999 a accéléré l’abandon de la production laitière par les agriculteurs,ce qui a permis aux exploitations restantes à la fois d’augmenter leur contingent et d’étendre la SAU.Ainsi,le contingent par exploitation s’est accru de 5,1% par an entre 1999/2000 et 2001/02 (soit de près de 8'000 kg au total);la SAU,quant à elle,a augmenté de 3,5% chaque année (1,3 ha au total).
16 1.1 ECONOMIE 1
1 montagne 2 1999/2001/021999/2001/021999/2001/02 200020002000 ProducteursNombre39 89036 23123 03520 77116 85515 460 Contingent Ø kg75 68983 40788 33598 19758 40663 535 Surface Ø ha18,319,619,220,617,118,2 1zone de
2zones de
I à IV
ParamètreTotalRégion de Région de plaine
grandes cultures,zones intermédiaires,zone des collines
montagne
Sources:OFAG,OFS
1990/912001/02 Nombre, kg ha Sources: OFAG, OFS 1 zones de montagne I–IV Producteurs Contingent Ø Surface Ø 0 30 25 20 15 10 5 0 80 000 60 000 20 000 40 000 100 000 20 258 46 922 15 460 63 535
Evolution des contingents laitiers 1999/2000–2001/02
Les variations des contingents laitiers entre 1999/2000 et 2001/02 montrent que le commerce des contingents répondait aux attentes des producteurs de lait.Ce sont principalement les régions situées dans la partie occidentale de la Suisse qui en ont profité.Deux facteurs en particulier ont favorisé cette évolution:des solutions de mise en valeur pertinentes pour le lait et des contingents relativement bas à l’hectare.Par contre,les régions marquées par des contingents élevés à l’hectare et par une forte densité d’animaux ont été plutôt gênées dans leurs perspectives de développement. Si les régions ayant bénéficié d’augmentations de contingents sont majoritaires,cela tient au fait que le Conseil fédéral a relevé les quantités de contingents pour l’année laitière 2001/02 (+3%).
17 1.1 ECONOMIE 1.RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 1
Source: OFAG, données cartographiques GG25 © Swisstopo (BA035290)
kg / ha 1 < –1000 –1000 – 0 0 – 1000 > 1000 pas de lait Région d'estivage
1 par communes; contingent 2001/02 moins contingent 1999/2000 divisé par la SAU totale
■ Valeur ajoutée brute
Paramètres économiques
Valeur ajoutée brute des trois secteurs économiques,de 1999 à 2001
Secteurs199920002001 1 Part en Variation 20011999/2001 en mio.de fr.en %
Secteur primaire,4 9064 6584 5551,1 –7,2 dont l’agriculture3 4603 7173 3750,8 –2,5
Secteur secondaire100 368102 168105 79826,05,4
Secteur tertiaire276 563292 752297 46972,97,6
Total381 837399 584407 821100,06,8
1 provisoire Sources:OFS,USP

La valeur ajoutée brute aux prix du marché de l’ensemble de l’économie s’est élevée à 407’821 millions de francs en 2001,en légère augmentation par rapport à l’année précédente.La part du secteur primaire est restée faible avec 1,1%,l’agriculture représentant le plus gros morceau de celui-ci avec 74,1%.
■ Commerce extérieur de produits agricoles
Conséquence du ralentissement conjoncturel et de l’attentisme qui s’est installé,allant de pair avec un recul des investissements dans la construction et les équipements,les importations ont enregistré dans l’ensemble une baisse 8,2% au cours de l’exercice sous revue,reculant de 141,9 à 130,2 milliards de francs,et les exportations de 1,4% en tout,régressant de 138,5 à 136,6 milliards de francs.Quant au commerce de produits agricoles,il a lui aussi légèrement diminué,les importations passant 8,6 à 8,5 milliards de francs et les exportations de 3,6 à 3,5 milliards de francs.
Au cours de l’année sous revue,74,1% des importations agricoles (6,3 milliards de francs) provenaient de l’UE,tandis que 66,2% de nos exportations représentant une valeur totale de 2,3 milliards de francs lui étaient destinées.En comparaison de l’exercice précédent,les importations ont progressé de près de 150 millions de francs alors que les exportations ont diminué de 10 millions de francs.
18 1.1 ECONOMIE 1
Commerce extérieur agricole avec l'UE en 2002
Importations Excédents d'importations Exportations
Source: DGD
En termes de valeur,c’est de France que la Suisse a importé la majeure partie de ses produits agricoles,soit environ un quart de l’ensemble des importations en provenance de l’UE.Comme l’année précédente,c’est aussi d’Autriche que la Suisse a le moins importé.La plupart des exportations ont pris la destination de l’Allemagne.Le bilan de notre pays est cependant fortement négatif avec la France,les Pays-Bas,l’Espagne et l’Italie,mais équilibré,quoique à un niveau relativement bas,avec l’Autriche.
Importations et exportations de produits agricoles et de produits transformés, par catégorie, en 2002
Tabac et divers (13, 14, 24)
Produits laitiers (4)
Denrées alimentaires (20, 21)
Produits d'agrément (9, 17, 18)
Aliments pour animaux, déchets (23)
Céréales et préparations (10, 11, 19)
Oléagineux, graisses et huiles (12, 15)
Plantes vivantes, fleurs (6)
Légumes (7)
Fruits (8)
Produits animaux, poissons (1, 2, 3, 5, 16)
Boissons (22)
5001000 ( ): Numéro du tarif des douanes
Importations Excédents d'importations ou d'exportations
Exportations
Source: DGD
1.1 ECONOMIE 19 1.RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 1
Allemagne France Italie Autriche Espagne Pays-Bas Autres pays 719 1107 415 1625 266 1372 191 220 71 476 124 772 556 752 2000150010005000 en mio. de fr. 5001000
644 395 548 392 859 874 665 746 147 344 410 646 28 353 3 569 4 579 5 856 59 1311 163 1463
en mio. de fr.
2000150010005000
Grande importatrice,la Suisse a surtout importé des boissons et des produits animaux (y compris des poissons) au cours de l’exercice sous revue.Les importations de boissons se sont composées d’environ 67% de vin et d’environ 10% de spiritueux et autant d’eaux minérales.De toutes les importations appartenant à la catégorie «produits animaux»,environ 40% sont attribuables au secteur de la viande,30% au secteur des poissons et les 30% restants au secteur des viandes préparées et des conserves de viande.
Ont figuré en tête des exportations les denrées alimentaires et les produits d’agrément. La plus grande part des denrées alimentaires exportées a concerné les aliments élaborés,les extraits de café,les soupes et les sauces.Dans la catégorie «produits d’agrément» ont principalement été exportés du café torréfié,des sucreries ainsi que du chocolat.Pour ce qui est des fruits,des légumes et des produits animaux,les exportations sont restées modestes.
Des excédents d’exportation ont été réalisés dans la catégorie «tabac et divers» ainsi qu’avec les produits laitiers.L’augmentation passagère de la production suisse à très haute valeur ajoutée (cigarettes et mélanges bruts de tabac fabriqués en Suisse pour l’exportation) a conduit à un important excédent d’exportation pour le tabac (chapitre du tarif douanier n° 24),qui souligne nettement l’importance de l’industrie du tabac pour l’exportation.Dans ce contexte,il convient toutefois de noter que ces exportations peuvent connaître de très fortes variations d’une année à l’autre.

20 1.1 ECONOMIE 1
En vertu de la Constitution,l’agriculture helvétique a pour mandat de fournir, à travers sa production,une contribution essentielle à l’approvisionnement sûr de la population en denrées alimentaires.Par degré d’autosuffisance,on entend généralement la part de la production indigène à la consommation totale du pays.
Au cours de la dernière décennie,l’agriculture suisse a produit en moyenne 61,3% des denrées alimentaires (exprimés en calories) consommées dans le pays.Cette valeur s’est établie à 43,3% pour la catégorie des denrées alimentaires végétales et à 95,0% pour les denrées alimentaires d’origine animale.Les fluctuations constatées d’une année à l’autre sont principalement dues aux rendements réalisés dans la production végétale et qui dépendent fortement des conditions atmosphériques.C’est ainsi que de grands écarts ont été enregistrés en particulier dans la seconde partie de la dernière décennie.
En 2001,le taux d’autosuffisance s’est établi à 59%,soit 3 % de moins qu’en 2000. Cet écart s’explique par les récoltes beaucoup plus faibles obtenues dans la production végétale,qui ont fait baisser de 47 à 41% la part des denrées alimentaires produites en Suisse dans ce domaine.Concernant les produits animaux,la part indigène s’est élevée à 94% en 2001 contre 91% en 2000.
21 1.1 ECONOMIE 1.RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 1
Evolution
199019911992199319941995199619971998199920002001 part en %, exprim é e en calories Denrées alimentaires d'origine animale Total des denrées alimentaires Denrées alimentaires d'origine végétale Source:
0 100 80 60 40 20
■ Taux d’autosuffisance
du taux d'autosuffisance
USP
Tableau 14,page A13
■ Evolution des indices des prix
A l’exception de la hausse intermittente en 2000,l’indice des prix à la production a continuellement baissé dans les années 1990 à 1999.De même,au cours de l’année sous revue,l’indice a poursuivi sa baisse (0,9%) par rapport à 2001.Les baisses de prix ont été sensibles pour les producteurs notamment en ce qui concerne les céréales,le moût de raisins,le lait,les porcs de boucherie et les œufs.
L’indice suisse des prix à la consommation reflète,entre autres,les coûts et les marges relatifs à la transformation et au commerce des denrées alimentaires,les prix mondiaux de ces denrées et des matières premières servant à leur fabrication (env.40% des denrées alimentaires consommées,exprimés en calories,sont importés),le cours de change du franc suisse et, à raison d’un septième,les prix à la production suisses.Par rapport à 2001 (106,9),cet indice a progressé de 2,4 points.
Evolution des prix à la production, à la consommation et à l'importation pour les denrées alimentaires, ainsi que de l'indice des prix pour les moyens de production agricoles
Indice des prix à l'importation pour les denrées alimentaires 1
Indice national des prix à la consommation, sous-groupe denrées alimentaires et boissons
Indice des prix pour les moyens de production agricoles
Indice des prix à la production, agriculture
1 Base mai 1993 = 100. Il n'existe pas de série chronologique plus ancienne pour cet indice. Dans l'indice des prix à l'importation, le groupe «denrées alimentaires» englobe les sous-groupes «viande», «autres denrées alimentaires» et «boissons». Ceux-ci comprennent des produits choisis et ne reflètent pas l'ensemble des importations de denrées
Sources: OFS, USP
L’indice des prix relatif aux moyens de production agricoles mesure en premier lieu les prix des aliments pour animaux,des semences et des plants,des engrais,des produits d’amendement du sol et des produits phytosanitaires,ainsi que le coût des investissements dans les constructions et les équipements.En outre,il subit en partie l’influence de l’indice suisse des prix à la consommation,notamment pour ce qui est de l’énergie (carburants, électricité),du téléphone,de l’eau,des frais d’entretien et de réparation. En 2002,l’indice a ainsi baissé de 0,3 point par rapport à l’année précédente (99,9).
Pour établir l’indice des prix à l’importation de denrées alimentaires,on ne considère pas tout le panier des produits importés destinés à l’alimentation.Cet indice est dès lors moins significatif que ceux des prix à la production et des prix à la consommation. Après être resté au niveau de 111,8 points pendant deux ans,l’indice a augmenté au cours de l’exercice considéré,passant à 112,8 points.
22 1.1 ECONOMIE 1
Indice (1990/92 = 1000)
75 80 85 90 95 100 105 110 115 1990–92199319941995199619971998199920002001 2002
■
Dépenses
Les dépenses totales de la Confédération se sont élevées à 50,715 milliards de francs en 2002,en hausse de 1% par rapport à 2001.Celles réservées à l’agriculture et à l’alimentation se sont montées pour leur part à 4,067 milliards de francs,se situant toujours en cinquième position après la prévoyance sociale (12,797 milliards de fr.),les finances et les impôts (9,472 milliards de fr.),les transports (8,091 milliards de fr.) et la défense nationale (4,788 milliards de fr.).
Evolution des dépenses de la Confédération pour l'agriculture et l'alimentation
La part de l’agriculture et de l’alimentation à l’ensemble des dépenses de la Confédération a atteint 8 % en 2002,soit pratiquement le niveau des deux années précédentes.
L’évolution des dépenses dans le domaine de la production et des ventes est conforme aux dispositions transitoires de l’art.187,al.12,LAgr,selon lesquelles les fonds fédéraux octroyés pour le soutien du marché doivent diminuer d’un tiers par rapport aux dépenses de 1998 dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi.Cela représente un montant de quelque 400 millions de francs sur l’ensemble de la période.En 1998,les dépenses pour la production et les ventes se montaient à 1,203 milliard de francs,alors qu’elles n’étaient plus que de 979 millions de francs en 2002.La hausse de 77 millions de francs par rapport à 2001 est imputable à des dépenses extraordinaires dans le secteur laitier (notamment en liaison avec la faillite de Swiss Dairy Food).Sans ces dépenses extraordinaires,les dépenses engagées pour la production et les ventes n’auraient atteint que 826 millions de francs.
1.RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 23 1.1 ECONOMIE 1
Dépenses pour l’agriculture et l’alimentation
1990/921993199419951996199719981999200020012002 en mio. de fr. en % en chiffres absolus (mio. de fr.) en % des dépenses totales Source: Compte d'Etat 0 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 7,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 3 048 3 416 3 496 3 547 3 953 3 908 3 926 4 197 3 727 3 962 4 067
Tableau 51,page A58
Evolution des dépenses de la Confédération pour l’agriculture et l’alimentation
Remarque:la répartition des moyens financiers entre les différents domaines d’activité repose sur le compte d’Etat 1999. Les dépenses pour la mise en valeur des pommes de terre et des fruits,par exemple,ou celles liées à l’Administration fédérale des blés en 1990/92,ont été intégrées aux dépenses de l’OFAG,alors que les comptes étaient encore séparés dans la période de référence.Les chiffres pour 1990/92 ne correspondent donc pas aux indications dans le compte d’Etat.
1Les dépenses extraordinaires dans le secteur laitier sont incluses dans ce montant et ont été prélevées sur les montants attribués à d’autres secteurs comme les améliorations structurelles et l’économie animale.
Sources:Compte d’Etat,OFAG
En ce qui concerne les paiements directs,les dépenses enregistrées en 2002,en hausse de quelque 100 millions de francs par rapport à 2001,sont imputables au relèvement des limites quant aux contributions versées pour la garde d’animaux consommant des fourrages grossiers dans des conditions difficiles,ainsi qu’à l’accroissement de la participation aux programmes écologiques tels que Bio,SST et SRPA.
Le recul des dépenses entre 2001 et 2002 dans le domaine de l’amélioration des bases de production doit être mis en relation avec le blocage d’une partie des fonds (env.50 millions de francs) que des mesures extraordinaires ont absorbés dans le secteur laitier.
Domaine de dépenses1990/92200020012002 en mio.de fr. Production et ventes1 685955902979 1 Paiements directs7722 1142 3342 429 Amélioration des bases de production207246277223 Autres dépenses384412449435 Total agriculture et alimentation3 0483 7273 9624 067
1.1 ECONOMIE 1 24
Marquée par un printemps doux suivi d’un été pluvieux,l’année agricole 2002 a été synonyme de turbulences pour l’économie laitière en raison des problèmes de débouché rencontrés par l’emmental et de la déconfiture de Swiss Dairy Food (SDF). Les mesures adoptées par la Confédération ont toutefois contribué à stabiliser la situation.Les prix du bétail de boucherie sont demeurés bas,notamment ceux de la viande de porc du fait de l’offre surabondante.Concernant les céréales panifiables,il a fallu déclasser en céréales fourragères d’importantes quantités de blé ayant germé sur pied. Quant à la récolte de cerises,elle a dépassé de 80% celle de l’année précédente.
La production de biens agricoles (cf.les explications concernant la nouvelle méthodologie appliquée pour les comptes économiques de l’agriculture au ch.1.1.3 et à l’annexe A73) a augmenté de 180 millions de francs (+1,9%) en 2002 par rapport à 2001.Alors que la production végétale s’est accrue de 228 millions de francs (+5,2%), la production animale a régressé de 48 millions (–0,9%).

■■■■■■■■■■■■■■■■
1.1.2 Marchés
1.1 ECONOMIE 25 1
Tableau 15,page A14
Lait et produits laitiers

L’année 2002 a été difficile pour l’économie laitière:perte de parts sur les marchés fromagers à l’étranger,stocks de fromage supérieurs à la moyenne, évolution dans la mise en valeur du lait marquée par une baisse de la production fromagère et un accroissement de la fabrication de beurre,de poudre de lait écrémé et de lait entier, sans oublier le sursis concordataire de SDF,le plus grand transformateur de lait.
Au cours de l’année sous revue,la production totale de lait s’est élevée à 3,93 millions de t,dont 744’000 t ont servi à l’autosuffisance ou à l’affouragement dans l’exploitation.Par rapport à 2001,la performance laitière s’est encore améliorée de 30 kg par vache pour atteindre 5’570 kg.
Evolution des effectifs de vaches laitières et performance
Vaches dont le lait est commercialisé Performance
Les producteurs ont vendu 3,19 millions de t de lait.Cette quantité a été produite par 605’404 vaches.L’effectif de vaches dont le lait est commercialisé a cependant régressé en 2002 (605’404 animaux contre 614’608 en 2001).Mais grâce à l’amélioration génétique, à la meilleure alimentation des animaux et à l’optimisation des méthodes de gestion,la quantité de lait produite est néanmoins demeurée stable.
léger recul
Tableaux 4–13,pages A4–A12 ■ Production en
laitière
Nombre de vaches kg de lait par vache
1990200020012002
laitière par vache Sources: USP, OFS 500 000 550 000 5 700 5 600 5 400 5 500 5 300 5 200 5 100 5 000 4 900 4 800 4 700 4 600 700 000 650 000 600 000 750 000 1.1 ECONOMIE 1 26
Livraisons de lait par mois 2001 et 2002
■ Mise en valeur: moins de fromage
De février à mars et de juin à septembre,les livraisons mensuelles de lait ont atteint un niveau a peu près équivalent à celui de l’année précédente.En mai,les quantités de lait livrées ont été plus importantes qu’en 2001 alors qu’elles ont été moindres en janvier, ainsi que d’octobre à décembre.La légère baisse des livraisons de lait (–18’657 t ou –0,6%) est imputable à trois facteurs:
la réduction du contingent laitier de 104,5% à 102,5% du contingent de base;
– l’écoulement difficile de nos fromages sur les marchés à l’exportation;
– la situation délicate du marché laitier après l’effondrement de SDF.
La totalité du lait commercialisé (3,19 millions de t) au cours de l’année sous revue a été transformée de la façon suivante (en t de lait):
lait de consommation et autres produits laitiers:1’123’000 t (+5,3%)
fromage:1’298’000 t(–8,6%)
crème/beurre:769’000 t (+6,2%)
Janvier F é vrier Mars Avril Mai Juin Juillet Ao û t Septembre Octobre Novembre D é cembre en 1 000 t Livraisons de lait 2002 Livraisons de lait 2001 Source: TSM 220 230 250 240 270 260 280 290 300 310
–
1.RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 1.1 ECONOMIE 27 1
■ Commerce extérieur: répercussions de l’Accord agricole bilatéral
Evolution de la transformation du lait commercialisé
La quantité de fromage fabriquée a diminué de 6,9% par rapport à 2001.Cette baisse a atteint 14,6% pour les fromages à pâte dure (68’881 t),1,5% pour les fromages à pâte mi-dure (47’435 t) et 0,4% pour les fromages à pâte molle (6’949 t).Seul le volume de production de fromage frais et de produits spéciaux (fromage de brebis et fromage de chèvre) a connu une évolution légèrement positive.Quant au fromage fondu,il a lui aussi vu ses débouchés se restreindre considérablement.
Par rapport à l’année précédente,la production de beurre est restée quasiment inchangée (42’226 t ou +0,8%).
En revanche,la production de lait en poudre a fait un bond de quelque 22,6% (passant de 44’527 t à 54’569 t) durant cette période.L’augmentation la plus notable (44,2%) a concerné la poudre de lait écrémé,dont la production a grimpé de 18’736 t à 27’017 t.Conséquence de la forte diminution de la production de fromage,les quantités de lait ainsi dégagées ont dû être en grande partie déshydratées.
Le bilan du commerce extérieur n’a pas connu de changement fondamental au cours de l’année sous revue.En termes de volumes,la Suisse a exporté plus de fromage,de lait en poudre,de yoghourt et de crème qu’elle n’en a importé.Par contre,certains développements ne sont pas passés inaperçus:la forte croissance des exportations de poudre de lait,les exportations notables de beurre pour la première fois et le recul des exportations de fromages.
Les exportations de poudre de lait se sont élevées à 16’168 t en 2002,en augmentation de 11’263 t ou de 329% par rapport à 2001.De leur côté,les importations ont progressé de 784 t à 837 t.Conçues comme mesure d’allégement,les exportations de beurre ont atteint 1’306 t alors que les importations chutaient à 1’982 t (soit –3’547 t ou –64%).
Le 1er juin 2002 a marqué l’entrée en vigueur de l’Accord bilatéral entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles. Une analyse des douze premiers mois depuis l’entrée en vigueur de l’accord sur le fromage permet de dresser le tableau suivant:
1990/92200020012002 en 1000 t de lait Autres produits laitiers Crème Beurre Sources: TSM, USP Fromages Lait de consommation 0 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500
1.1 ECONOMIE 1 28
Les importations de fromage en provenance de l’UE ont régressé de 2,2% entre juin 2002 et mai 2003 par rapport à la même période 2001/02.De même,les exportations à destination de l’UE ont baissé d’environ 4,6% dans cet intervalle de temps.
Utilisation des contingents tarifaires de fromages de Suisse entre juin 2002 et mai 2003
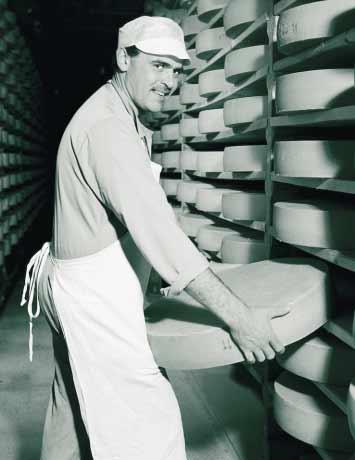
ProduitNo
Les contingents à droit zéro de la Suisse n’ont pas été entièrement utilisés.Sur les 12’000 t accordées la première année,8’999 t au total ont été attribuées par voie d’adjudication.Les cinq contingents à droit zéro ont suscité un intérêt contrasté.Pour les deux contingents 119 (mozzarella) et 120 (fromages frais et à pâte molle),les offres ont sensiblement dépassé la quantité contingentaire,de sorte qu’il a été possible d’attribuer l’ensemble du contingent,soit 1’500 t.Par contre,le volume attribué des trois autres contingents est resté en-deçà de la quantité contingentaire.
L’octroi de contingents à droit zéro pour l’importation de fromage de l’UE n’a guère influé sur les importations effectives,qui n’ont pas augmenté pour autant.
En vertu de l’accord,3’000 t de fromage (la première année 3’354 t) peuvent être exportées en franchise de douane vers l’UE.Or,cette possibilité d’accès au marché est peu utilisée jusqu’à présent.Au premier semestre (juillet à décembre 2002),les exportations à destination de l’UE se sont élevées à 436 t sur les 1’677 t que la branche aurait pu vendre à l’étranger.Par conséquent,les quantités à disposition pour le second semestre 2002/03,y compris les contingents inutilisés au premier semestre, atteignaient 2’918 t de fromage,sur lesquelles l’UE a attribué en janvier 2003 les licences demandées,portant sur 302 t seulement (environ 10% du contingent disponible).
du ContingentQuantité Quantité contingentattribuée effectivement importée en ten ten t Mozzarella119500500510 Fromages frais et à pâte molle1201 0001 0001 186 Asiago,Bitto,Brà, Fontal,Montasio 1215 0002 7191 846 Provolone12250021145 Fromages à pâte dure et mi-dure1235 0004 5693 209 Source:OFAG
1.1 ECONOMIE 1.RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 29 1
La consommation de lait et de produits laitiers par habitant a stagné dans l’ensemble. En comparaison de l’année précédente,la consommation de yoghourt,de séré,de fromage et de beurre est pratiquement restée inchangée en 2002.
Evolution de la consommation par habitant
kg par habitant
Beurre Séré 0,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 14,0 16,0 18,0 20,0
Quant à la consommation de fromage frais par habitant,elle s’est établie à 5,9 kg en 2002,soit au même niveau que l’année précédente.Par contre,la demande en lait de consommation a accusé un nouveau recul,passant de 84,4 kg à 81,4 kg (–3,6%).

1.1 ECONOMIE 1 30
1990/92200020012002 Fromages (sans séré) Yoghourt
Source: USP
■ Consommation stagnante
■ Prix à la production: tendance à la baisse
D’une manière générale,une légère baisse des prix à la production a été enregistrée en 2002 par rapport à 2001.Le prix-cible de 77 ct.a néanmoins été dépassé au cours de l’année sous revue.Aussi,au 1er novembre 2002,le Conseil fédéral a-t-il abaissé de 77 à 73 ct.le prix-cible du kilo de lait contenant au total 73 g de matière grasse et de protéine.
Prix du lait 2002,pour toute la Suisse et selon les régions
En 2002,le prix moyen du lait en Suisse a baissé de 1,5 ct./kg par rapport à 2001,pour s’établir à 78,39 ct.Simultanément,les différences régionales se sont accentuées pour le lait industriel et le lait transformé en fromage,atteignant jusqu’à 2,77 ct.pour le premier et 5,77 ct.pour le second.Quant au prix du lait bio,il a également fléchi, passant en moyenne à 93,17 ct./kg (–2,15 ct.ou –2,3%),un prix néanmoins supérieur de 14,8 à 16 ct. à celui de l’autre lait.
■ Prix à la consommation: stable ou en légère hausse
Les prix à la consommation ont légèrement augmenté ou sont demeurés stables au cours de l’année sous revue, à l’exception de l’Emmental pour lequel le consommateur a payé en moyenne 20,33 fr.le kilo,soit 26 ct.de moins que l’année précédente.En revanche,pour 1 kg de Gruyère,il a dû payer 51 ct.(20,88 fr.) de plus qu’en 2001.
Evolution des indices de consommation pour le lait et les produits laitiers
1990/92200020012002
En 2002 également,les indices des prix à la consommation du fromage,du beurre et d’autres produits laitiers ont continué d’afficher une tendance à la hausse.Comme en 2001,c’est l’indice du beurre qui a connu la plus forte augmentation (2,3 points ou 2,4%) tandis que les indices du lait et de la crème restaient inchangés.
1.1 ECONOMIE 1.RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 31 1
ct./kgCHRégion
IVRégion V Prix global78,3978,7878,4578,6777,3779,90 Lait industriel77,1677,6676,9477,7675,9578,72 Lait transformé en fromage78,5680,1677,9778,1777,6983,46 Lait biologique93,1793,3193,4993,4992,10 non relevé Source:OFAG
IRégion IIRégion IIIRégion
Indice (mai 1993 = 100) Lait Fromages Beurre Source:
Crème Autres produits laitiers 75 85 80 90 95 100 105
OFS
En novembre et décembre 2002,la marge brute de transformation-distribution sur le lait a enregistré les valeurs les plus basses de l’année sous revue.La baisse des marges brutes sur le fromage et le lait de consommation s’explique essentiellement par les nombreuses offres promotionnelles pratiquées par les distributeurs.En ce qui concerne la crème de consommation et le yoghourt,elle est imputable à la hausse du prix de la matière première.Malgré la baisse du prix du lait cru,la marge brute totale sur le lait et les produits laitiers est restée pour ainsi dire stable en décembre par rapport à novembre,et ce en raison des ventes promotionnelles de fromages et de beurre.
 ■ Marge brute sur le lait
■ Marge brute sur le lait
Janvier F é vrier Mars Avril Mai Juin Juillet Ao û t Septembre Octobre Novembre D é cembre Indice (janvier 1997 = 100) Source: OFAG 110 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 32 1.1 ECONOMIE 1
Evolution de la marge brute sur le lait et les produits laitiers 2002
■ Production:progression du cheptel de vaches mères et nourrices
Animaux et produits animaux
En 2002,la consommation de viande et de poisson a presque atteint le niveau antérieur à la première crise de l’ESB en 1996,pour s’établir à 60,39 kg par habitant. Défiant tous les pronostics,la consommation de viande bovine a enregistré une hausse réjouissante.Conséquence de cette évolution,les producteurs ont vendu leurs génisses,bœufs et taureaux 5% plus cher que l’année précédente malgré une offre domestique plus étoffée.
Des contrôles effectués sur la viande de volaille importée de Chine ont révélé la présence de résidus d’antibiotiques,si bien que les autorités suisses ont immédiatement stoppé les importations de viande de volaille chinoise.Au terme d’analyses et d’un renforcement des mesures de sécurité,cette restriction a pu être en partie levée. Ces événements n’ont pas pour autant empêché la consommation de volaille d’augmenter de 1%.
Le nombre de cas d’ESB a nettement reculé en 2002:seuls 24 cas ont été diagnostiqués alors qu’on en avait encore recensés 42 en 2001.La Suisse est ainsi l’un des rares pays au monde à enregistrer un tel recul de l’épizootie.Ces résultats des plus satisfaisants montrent que les mesures mises en œuvre portent leurs fruits.Le 4 juillet 2002, la Pologne a également aboli les restrictions commerciales qu’elle avait décidées à l’encontre des bovins d’élevage et de rente suisses en raison de l’ESB.Si l’embargo avait déjà été levé fin 2001 et début 2002 sur les principaux marchés que constituent l’Allemagne et la France,il restait par contre maintenu sur le marché italien.
Oscillant autour de 1,6 million de têtes ces trois dernières années,le cheptel bovin dépend essentiellement de la quantité du contingent laitier et de la performance laitière des vaches.Le nombre de vaches gardées en 2002 s’élevait à 716’000,dont 85% étaient destinées à la production de lait commercialisé,7% à l’engraissement des veaux (vaches traites dont le lait n’est pas commercialisé) et 8% à la production extensive de viande (vaches mères et nourrices).En tant qu’alternative à la production de lait,la garde de vaches allaittantes est une tendance qui se développe depuis quelques années.Par rapport à 1990,l’effectif a quadruplé et atteint 58’000 têtes en 2002. Cette évolution n’a cependant pas débouché sur une production de viande plus importante car l’effectif de vaches laitières dont le lait est commercialisé a diminué de 121’000 unités (–16,7%) au cours de la même période.
Tableaux 4–13,pages A4–A12
1.RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 1.1 ECONOMIE 33 1
Les effectifs de volaille à l’engrais,de moutons,de chèvres et de chevaux n’ont cessé de s’accroître ces trois dernières années.Pour ce qui est de la volaille à l’engrais,l’augmentation de l’effectif est principalement attribuable à la forte hausse de la consommation de viande de volaille tandis que pour les chevaux,elle est probablement due à l’utilisation accrue que l’on en fait comme animaux de loisir.Consommant des fourrages grossiers et considérés comme des animaux peu exigeants,les chèvres et les moutons sont idéalement adaptés à l’exploitation extensive des surfaces en forte pente.L’orientation ciblée des mesures de politique agricole vers la promotion des animaux consommant des fourrages grossiers a sans doute largement contribué à l’augmentation des effectifs de moutons (+21%) et de chèvres (+8%) depuis 1990. Par suite du recul à long terme de la consommation d’œufs en coquille et de l’amélioration continuelle des performances de ponte,les effectifs de poules pondeuses et de poules d’élevage ont diminué de 28% par rapport à 1990.
Grâce à la demande soutenue,la production de viande de volaille a progressé de 8,7% par rapport à 2001.Mais la part de la viande de volaille suisse à la consommation s’est maintenue à un bas niveau (43,1%).Quant à la viande de bœuf,de porc,de cheval et de mouton,la production domestique est restée relativement constante.Si la part de la production suisse s’élève seulement à 12,5% pour la viande de cheval,elle atteint 97,2% pour la viande de veau.

1.1 ECONOMIE 1 34 Evolution des effectifs Espèce animale19902000200120021990–2000/02 en 1 000en 1 000en 1 000en 1 000% Bovins1 8581 5881 6111 594 –14,01 – Vaches dont le lait est commercialisé 726616615605 –15,70 – Vaches traites, dont le lait n’est pas commercialisé 515455535,88 – Vaches mères et nourrices14455158266,66 Porcs1 7761 4981 5481 561 –13,53 Moutons35542142043019,34 Chèvres616263664,37 Chevaux3850505132,46 Volaille à l’engrais2 8783 8083 9934 29840,13 Poules pondeuses et d’élevage2 7952 1502 0692 012 –25,69 Source:OFS
■ Commerce extérieur: l’Allemagne et l’Autriche, nos premiers fournisseurs de viande de porc
Indice (1990/92 = 100)
Evolution de la production animale 1990/92200020012002
Par rapport à 2001,la production d’œufs a augmenté de 3% pour atteindre 703 millions d’unités.Près d’un tiers de la production est commercialisé en vente directe, les deux autres tiers étant repris par les grossistes.
Les exportations de viande et de produits carnés suisses,minimes depuis des années, se sont élevées à 1’500 t seulement en 2002.Les principaux acheteurs des 967 t de viande séchée que nous exportons,traditionnellement notre produit d’exportation le plus connu,sont des entreprises de France (87%) et d’Allemagne (10%).
Les importations de viande bovine,qui consistent en grande partie de morceaux parés de la cuisse de bœuf et de morceaux spéciaux tels que filets,entrecôtes,rumsteak et bœuf américain,ont progressé de 5’900 t à 6’900 t grâce à la plus forte demande.Les morceaux parés de la cuisse de bœuf sont utilisés pour la fabrication de viande séchée tandis que les morceaux spéciaux sont essentiellement destinés à la restauration.Les principaux fournisseurs sont le Brésil (78%),l’Afrique du Sud (8%) et les Etats-Unis (7%).Si la viande de veau provient surtout des Pays-Bas (47%),presque l’intégralité de la viande de porc importée est originaire d’Allemagne et d’Autriche.La préférence accordée à ces deux pays s’explique sans doute par la qualité équivalente de la viande, par les systèmes de garde respectueux des animaux,ainsi que par les courtes distances de transport.Les importations de viande de porc ont également progressé en raison de l’intensification de la demande,passant de 6’500 t à 8’600 t.Les premiers exportateurs de viande de mouton et d’agneau en Suisse ont été la Nouvelle-Zélande (47%) et l’Australie (36%);quant à la viande de cheval,elle provient du Canada (37%),des Etats-Unis (29%) et d’Australie (14%).Environ 70% des importations de viande de volaille viennent de France,d’Allemagne et de Hongrie.En raison des problèmes liés aux résidus d’antibiotiques,la part de la Chine,notre principal fournisseur en 2000 et 2001,a chuté à 9%.
Ont également été importés au cours de l’année sous revue 200 ânes,mulets et bardots,ainsi qu’environ 2’950 chevaux et petits poneys,soit 3% de plus qu’en 2001. Les principaux pays fournisseurs ont été l’Allemagne (33%) et la France (24%).En contrepartie,la Suisse a exporté 832 chevaux,dont les deux tiers environ ont pris la direction de l’Allemagne et de la France.
1.1 ECONOMIE 1.RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 35 1
Viande de bœuf Viande de mouton Viande de volaille Sources: Proviande et GalloSuisse Viande de veau Viande de chèvre Œufs en coquille 70 160 150 140 130 120 110 100 90 80 Viande de porc Viande de cheval
■ Reprise de la consommation de viande bovine
Par rapport à 2001,la consommation de viande et de poisson a augmenté de 1,6% au cours de l’année sous revue pour atteindre 450’000 t.La reprise de la consommation a été particulièrement nette pour la viande de bœuf (+10%) et le gibier (+8,2%). A cette hausse fait pendant un recul de la consommation des autres viandes:lapin (–17,3%),cheval (–7,1%),poissons et crustacés (–5%) ainsi que mouton (–3,7%).
■ Prix à la production: redressement des prix pour le bétail d’étal
1990/92200020012002
Après avoir déjà augmenté de 0,3% en 2001,la consommation de viande et de poisson a encore progressé de 1% en 2002,pour s’établir à 60,39 kg par habitant,chiffre qui renoue presque avec celui enregistré en1996 avant la première crise de l’ESB.Par ordre de préférence,les consommateurs suisses ont acheté du porc (25,48 kg),du bœuf (10,64 kg) et de la volaille (9,71 kg).Toujours marginale,la consommation de viande de mouton,de chèvre,de cheval,de gibier et de lapin s’est établie à quelque 3 kg seulement par habitant.
Les prix des vaches et des porcs se sont maintenus au niveau de 2001 par suite d’une offre constante et d’une demande inchangée en ces sortes de viande.La consommation de viande de bœuf par les ménages,en hausse de 13%,explique probablement à elle seule les augmentations de prix pour le bétail d’étal (taureaux,bœufs et génisses). En vendant à 7,23 francs le kilo PM pour les taureaux de qualité moyenne (classe commerciale T3),les producteurs de bétail d’étal ont certes réalisé 5% de plus de recettes que l’année précédente,mais toujours 20% de moins qu’en 2000.Les stocks de viande de bœuf qui atteignaient 2’000 t fin 2001 ont pu être écoulés sur le marché domestique jusqu’à la fin de l’année sous revue,sans mettre véritablement sous pression les prix à la production.Pour les agneaux de qualité moyenne (classe commerciale T3),le prix payé au kilo PM s’est élevé à 12,61 francs en 2002,soit près de 2% de plus que l’année précédente.
1.1 ECONOMIE 1 36
Evolution de la consommation de viande et d'œufs par habitant
Indice (1990/92 = 100) Viande de bœuf Viande de porc Viande de chèvre Sources: Proviande et GalloSuisse Viande de volaille Viande de veau Viande de mouton 70 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 Viande de cheval Œufs en coquille (pce)
Comme à l’accoutumée,des variations de prix saisonnières sont apparues pour les porcs et les animaux de l’espèce bovine.A la suite de la forte demande en viande de porc pour les grillades,les prix avaient monté en juin et juillet pour atteindre 4,60 francs le kilo PM,mais dès septembre ils retombaient sous la barre des 4 francs le kilo PM.De septembre à décembre,le prix des veaux a grimpé de 10,50 francs à 14 francs le kilo PM en raison de l’offre limitée.Il faut dire que,depuis novembre 2000, les prix pour le bétail d’étal étaient fortement mis sous pression en raison de la reprise du débat autour de l’épizootie ESB.Pour les taureaux de qualité moyenne (classe commerciale T3),par exemple,le prix payé par kilo PM ne s’est parfois élevé qu’à 6,10 francs.A partir de septembre 2002,le marché du bétail d’étal s’est nettement calmé et les prix ont grimpé d’environ 30% par rapport à leur niveau le plus bas absolu.
Pour toutes les catégories d’animaux,les prix moyens à la production enregistrés ces trois dernières années ont été inférieurs de 15 à 25% à ceux de 1990–1992.Les prix des vaches ont même dégringolé de près de 52%.Différentes raisons expliquent sans doute cette évolution à long terme:la demande en animaux de l’espèce bovine et en porcs a diminué plus sensiblement que l’offre.C’est ainsi que l’offre indigène en viande de porc a reculé de 13% tandis que la consommation par habitant s’effondrait de 22%.A cela s’ajoutent,pour les animaux de l’espèce bovine,la hausse des frais d’élimination des déchets d’abattoir et des déchets de viande,ainsi que la baisse des recettes pour certains abats et sous-produits (peau,os).Ces frais et ces diminutions de recettes ont été inclus du moins en partie dans le calcul des prix à la production des entreprises de transformation de viande.
Le prix des œufs vendus dans les centres collecteurs a augmenté de 0,32 ct.la pièce pour atteindre 23,44 ct,soit 2 ct.de plus qu’en 2000,le plus bas niveau enregistré dans le passé.Le prix de la viande de poulet a poursuivi sa baisse entamée en 1990 et qui est probablement due à la réduction des frais d’affouragement.

1.1 ECONOMIE 1.RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 37 1
Fr./kg PM
Porcs
Vaches
Source: USP 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 Janvier F é vrier Mars Avril Mai Juin Juillet Ao û t Septembre Octobre Novembre D é cembre
Prix mensuels de bétail de boucherie et de porcs charnus 2002, à la ferme
Veaux cl. commerciale T3 Taureaux cl. commerciale T3
charnus légers
cl. commerciale T2/3
Conséquence de la hausse des prix à la production de la viande bovine,les prix à la consommation ont eux aussi augmenté de 1 à 3 francs le kilo par rapport à l’année précédente.La tendance à la hausse enregistrée depuis des années en ce qui concerne les produits carnés et les poulets frais indigènes s’est confirmée par ailleurs.Pour ce qui est de la viande de porc,en revanche,les prix à la consommation sont demeurés stables.Pour tous les morceaux de viande analysés,les consommateurs ont dû payer entre 1 et 32% de plus par kilo au cours des trois dernières années,comparé à la moyenne des années 1990/92.Contrairement à cette évolution,les prix à la production ont chuté de 15 à 52% par kg PM.
La marge brute nominale de transformation-distribution a augmenté en moyenne de 4 à 11% en 2002 pour toutes les catégories de viande analysées.Comparée à la période de référence allant de février à avril 1999,la viande de porc a enregistré la plus forte croissance (+31,4%).La marge brute de transformation-distribution a aussi été sensiblement supérieure à celle de la période de référence pour la viande de bœuf (17%),d’agneau (16%) et de veau (15%) ainsi que pour le panier de la ménagère comprenant plusieurs sortes de viande fraîche,des produits carnés et de la charcuterie (16%).Quant à la viande d’agneau,c’est elle qui a connu les plus fortes fluctuations mensuelles avec un indice se situant entre 101 et 128,1 points.
■ Prix à la consommation: viande de bœuf en hausse
Indice f é vrier –avril 1999 = 100) Porc Bœuf Veau Mouton Viande fraîche, produits carnés et charcuterie Source: OFAG 140 130 135 125 120 115 110 105 100 95 Janvier F é vrier Mars Avril Mai Juin Juillet Ao û t Septembre Octobre Novembre D é cembre 1.1 ECONOMIE 1 38
■ Marge brute sur la viande Evolution des marges brutes sur la viande 2002
■ Situation météorologique:temps capricieux avec de fréquentes précipitations
Production végétale et produits végétaux
Au terme d’une période caractérisée par un froid sec,le thermomètre est remonté dès la mi-janvier,atteignant des températures douces pour la saison.Le mois de février s’est distingué par des précipitations supérieures à la moyenne.A un printemps doux, moyennement arrosé,a ensuite succédé un mois de mai pluvieux.Le mois de juin a, dans l’ensemble, été très chaud grâce à un temps relativement sec et ensoleillé.Les mois d’été qui ont suivi ont enregistré des températures à peu près conformes aux moyennes saisonnières.Cependant,les précipitations relevées en juin et juillet font apparaître des différences régionales considérables.Le mois d’août a été ensoleillé mais pluvieux.L’automne a fait son apparition dès septembre avec des températures fraîches et de fréquentes précipitations.Comparés à la moyenne des dernières années, octobre et novembre nous ont valu des températures douces accompagnées d’importantes précipitations.Sur le Plateau,ces dernières ont dépassé de 85% la moyenne des dernières années pour le mois d’octobre et de 124% pour le mois de novembre.Dans le canton des Grisons et sur le versant sud des Alpes,en particulier,ces précipitations extrêmes ont causé de gros dégâts dus aux glissements de terrain et aux inondations. Le mois de décembre a,quant à lui,connu des précipitations conformes à la normale saisonnière et des températures plutôt douces,mais la durée d’ensoleillement a été bien inférieure à la moyenne sur le versant nord des Alpes.
■ Production:plus de légumes,moins de céréales et de vin
La diminution des surfaces emblavées de céréales n’a pas été intégralement compensée par les autres cultures,d’où une réduction des terres ouvertes de 0,9% par rapport à 2001.La surface emblavée de céréales fourragères a reculé d’environ 7% en 2002 par rapport à l’année précédente.Les surfaces de triticale,en augmentation,n’ont pas permis non plus de compenser la réduction des surfaces d’orge et de maïs-grain.Quant aux surfaces de légumineuses,elles se sont accrues d’un tiers du fait de l’extension des surfaces de pois protéagineux.La part des surfaces cultivées a augmenté pour tous les oléagineux,les surfaces de soja ayant triplé par rapport à l’année précédente.
 Tableaux 4–13,pages A4–A12
Tableaux 4–13,pages A4–A12
1.1 ECONOMIE 39 1
Composition des terres ouvertes 2002
Total 287 634 ha
Maïs d'ensilage et maïs vert
40 202 ha 14%
Légumes de plein champ
8 437 ha 3%
Colza 15 310 ha
5%
Betteraves sucrières 18 175 ha
6%
Autres cultures 18 568 ha
7%
Céréales 173 482 ha
60%
Pommes de terre 13 460 ha
5%
Source: USP
Une surface de 23’848 ha,soit de 2,2% de la SAU,a été affectée aux cultures pérennes,dont 15’014 ha de vignes,6’663 ha de cultures fruitières et 276 ha de baies.
Jamais autant de légumes n’avaient été cultivés avant 2002.Les surfaces recensées (cultures successives comprises) par la Centrale suisse de la culture maraîchère (CCM) se sont élevées à 13'500 ha,en augmentation de 800 ha par rapport à 2001.Les taux de croissance les plus importants ont été observés pour les cultures sous serre (+21%) ainsi que pour les légumes saisonniers (+11%).L’accroissement des surfaces cultivées a été le plus notable pour les oignons (+143 ha),suivis par le poireau,la lollo et la salade iceberg (env.100 ha chacun).
Les vergers de pommiers occupaient encore une surface de 4'565 ha en 2002.En dépit de l’accroissement des surfaces affectées aux variétés Gala,Braeburn,Topaz et Pinova (+86 ha),la surface des cultures de pommiers a diminué au total de 140 ha par rapport à 2001.La surface des vergers de poiriers est restée inchangée avec 940 ha.Toujours à la mode,les cultures de fruits à noyau et de baies ont vu leurs surfaces une nouvelle fois augmenter quelque peu pour atteindre respectivement 1'260 ha et 635 ha.

1.1 ECONOMIE 1 40
Evolution de la structure d'âge de cultures de pommes
1–56–1011–15
Age des cultures en années 16–2021–25>25
1990/931999/2002
Source: OFAG
Concernant l’âge des cultures de pommiers,58% d’entre eux avaient moins de dix ans. La part des jeunes vergers a donc progressé de quelques pour cent au cours des dix dernières années.Pour ce qui est des poiriers,la part des jeunes vergers âgés de 1 à 10 ans s’élevait à 39%.La structure d’âge des poiriers témoigne elle aussi d’un rajeunissement des vergers de quelques pour cent durant la dernière décennie.
De son côté,la surface viticole a atteint 15'014 ha en 2002,soit 72 ha de moins que l’année précédente.Cette surface était plantée de cépages blancs sur 6'965 ha (–90 ha) et de cépages rouges sur 8'049 ha (+18 ha).
Evolution des rendements à la surface de divers produits des champs
Indice (1990/92 = 100)
1990/92200020012002
Produits (rendements 2002)
Blé d'automne (61,8 dt/ha)
Pommes de terre (390,9 dt/ha)
Colza (33,9 dt/ha)
Orge (65,1 dt/ha)
Betteraves sucrières (782,4 dt/ha)
Source: USP
Surface en ha
0 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200
70 140 130 120 110 100 90 80 1.1 ECONOMIE 1.RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 41 1
Les rendements moyens des principales cultures des champs ont augmenté par rapport à 2001.Le rendement moyen des cultures d’orge (65 q à l’ha),très élevé,montre que les conditions climatiques ont été favorables dans l’ensemble.Du fait de la réduction des surfaces cultivées,les terres moins productives n’ont manifestement plus été utilisées.La part d’orge de printemps à l’ensemble de la récolte d’orge s’est élevée à environ 5%.Malgré les conditions de récolte difficiles,la production de sucre a augmenté en 2002,s’établissant à 221'865 t.Ce bon résultat est notamment attribuable à l’extension des surfaces affectées à la betterave sucrière (+418 ha) qui ont atteint 18'175 ha (+2%).La récolte de pommes de terre a pu être rentrée en peu de temps dans des conditions optimales.Toutes les variétés de pommes de terre ont été récoltées en quantité suffisante,mais la grosseur des tubercules était inférieure à la moyenne.
Bien que les surfaces affectées aux céréales aient diminué de 3% en 2002,la production céréalière a globalement augmenté grâce aux meilleurs rendements réalisés;elle s’est chiffrée à 1,081 million de t.La période de mauvais temps qui a sévi fin juillet a retardé la récolte de blé,ce qui a entraîné la germination d’environ 15% des plantes et des pertes de qualité.Autre constat:les agriculteurs ont dans l’ensemble tendance à cultiver des céréales panifiables,une évolution qui pourrait avoir des répercussions sur les prix à la production en cas d’importante récolte.
D’une manière générale,le gel,la grêle et les abondantes précipitations n’ont pas empêché la réalisation de très bonnes récoltes de légumes (309'000 t) et de fruits de table (133'000 t) en 2002,lesquelles ont enregistré une hausse appréciable de 16% et de 12%,respectivement,par rapport à 2001.L’accroissement a été particulièrement net pour les salades et les fruits à noyau.
Les volumes du marché pour les variétés de légumes et de fruits pouvant être cultivés en Suisse ont dépassé de beaucoup la moyenne des quatre dernières années pour atteindre 522'000tet 183'000 t,respectivement (légumes +8%,fruits de table +7%). En ce qui concerne les légumes,la part indigène (+12%) a bien plus contribué à l’augmentation des volumes que les quantités importées (+3%).La part des légumes suisses au volume du marché a ainsi pu progresser de 2% pour s’établir à 59%.Quant aux fruits,la part indigène et la part importée ont augmenté dans la même proportion, celle des fruits suisses représentant 73% du volume du marché
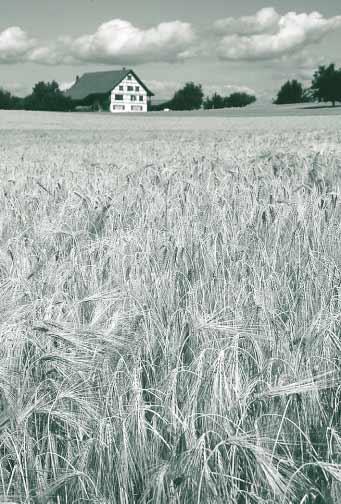
1.1 ECONOMIE 1 42
Evolution de la production céréalière 1990/92200020012002 en 1000 t Blé Triticale Source: OFAG Seigle Avoine Epeautre Maïs-grain Orge 0 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 547 561 456 245 218 501 247 189 274 212 342 211
Cerises de table: déroulement saisonnier des récoltes
21222324252627
1991/941999/2002
Framboises: déroulement saisonnier des récoltes
212325272931
Les récoltes de fruits à noyau et de baies suivent traditionnellement une courbe saisonnière.Les deux graphiques portant sur la répartition des récoltes montrent que les périodes de récolte des cerises de table et des framboises n’ont pas pu être prolongées au cours des dix dernières années.Contrairement à celle des cerises de tables,la courbe de récolte des framboises s’est modifiée:en automne,on récolte aujourd’hui nettement plus de framboises.
Face à la situation difficile régnant sur le marché viticole,les restrictions de quantité décidées pour la récolte 2002 – notamment dans les grands cantons viticoles Vaud, Valais et Genève – ont eu l’effet escompté.La récolte totale de l’année 2002 s’est élevée à 111,3 millions de l (6,1 millions de l de moins qu’en 2001),dont 56,6 millions de l de moûts de raisin blanc et 54,7 millions de l de moûts de raisin rouge.Les rendements moyens des vignes européennes – c’est-à-dire sans les hybrides producteurs directs – se sont élevés à 81,5 hl à l’hectare pour les cépages blancs et 68,3 hl à l’hectare pour les cépages rouges.Ils sont donc nettement plus bas que les rendements maximaux fixés par le Conseil fédéral dans l’ordonnance sur le vin,soit 112 et 96 hl à l’hectare.
1.1 ECONOMIE 1.RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 43 1
Semaine
282930313233
0 600 500 400 300 200 100 Quantit é s r é colt é es en t
Source: Fruit-Union suisse
Semaine 3335373941
Source:
0 120 100 80 60 40 20 Quantit é s r é colt é es en t
1991/941999/2002
Fruit-Union suisse
■ Mise en valeur: récolte de fruits à cidre inférieure à la moyenne des 4 dernières années
La taille des pommes de terre récoltées,inférieure à la moyenne,a conduit en 2002 à une pénurie de grosses tubercules,la matière première spécialement destinée au perfectionnement.En outre,la qualité de nombreux lots de pommes de terre réservés à la transformation a fait l’objet de réclamations car leur pouvoir agglutinant était parfois insuffisant pour la fabrication de pommes chips et de pommes frites en raison de la basse teneur en amidon.Des rendements inférieurs ont également été observés lors de la multiplication des plants de pommes de terre.Le temps chaud enregistré au printemps a en effet conduit à une forte prolifération des pucerons qui,en suçant le jus des plantes,propagent les virus de la pomme de la terre.L’état sanitaire relativement mauvais de nombreuses tubercules a nécessité une mise en valeur des pommes de terre inadéquates pour la production de matériel de multiplication.
D’après le principe de l’alternance,on s’attendait en 2002 à ce que la récolte de fruits à cidre soit relativement bonne.Or,la quantité de pommes à cidre récoltée et transformée dans les cidreries s’est élevée à 115'600 t et celles des poires à cidre à 16'300 t. De fait,comparée à l’estimation préalable de l’USP,la récolte a chuté de 25% pour les pommes à cidre et de 51% pour les poires à cidre.Cependant,pour les pommes à cidre elle a atteint un taux de couverture de 147% par rapport aux besoins annuels qui s’élèvent à 78'700 t,tandis que pour les poires à cidre,elle n’a dépassé les besoins annuels (15'700 t) que de 4%.Concernant la production de boissons,la tendance à la hausse que l’on enregistre depuis l’an 2000 pour les boissons non fermentées à base de jus de fruits s’est encore légèrement renforcée en 2002.
■ Commerce extérieur: taux d’autosuffisance bas pour les huiles et graisses végétales
Le colza,le tournesol et le soja cultivés en Suisse sont destinés à la production d’huile. Le taux d’autosuffisance en huiles et graisses végétales se monte à environ 20%.
Le marché des huiles alimentaire et fourragère est marqué par l’huile de tournesol importée à raison de 90% pour couvrir les besoins.L’huile de colza est la plupart du temps d’origine domestique à la différence de l’huile de soja dont la production suisse couvre seulement 2% des besoins.En fonction des prix pratiqués sur le marché mondial,des produits de substitution peuvent être parfois utilisés pour les huiles destinées à l’industrie de transformation.

1.1 ECONOMIE 1 44
Dans le cadre de l’Accord GATT/OMC,la Suisse s’est engagée à concéder un accès minimal de 5% au marché des pommes de terre.L’accès est accordé sous la forme du contingent tarifaire n° 14 qui a été augmenté en six étapes et se monte,depuis 2000, à 22'250 t de pommes de terre.Cette quantité équivaut à 5% du volume du marché qui, à l’époque,avait été évalué à 445'000 t.Entre-temps,la consommation domestique a reculé et est estimée aujourd’hui à 350'000 t.Ce volume englobe 30'000 t de plants de pommes de terre,180'000 t de pommes de terre de table et 140'000 t de pommes de terre destinées à la transformation.De fait,la Suisse accorde aujourd’hui un accès minimal au marché correspondant à un peu plus de 6%.Depuis 1998,les quantités de pommes de terre importées au taux du contingent ont dépassé l’accès minimal au marché exigé.Chaque année,le contingent devait être provisoirement revu à la hausse pour assurer l’approvisionnement du marché.Les besoins supplémentaires ont été motivés en grande partie par le caractère insuffisant tant des récoltes réalisées en Suisse que de la qualité des plants et des pommes de terre destinées à la transformation.
Bilan des huiles végétales 2002 Huile de tournesol Huile de colza Huile de palme Huile d'arachide Huile d'olives Huile de coco Huile de soja Autres huiles végétales en 1 000 t Production suisse Importations Consommation Exportations Sources: DGD, swiss granum 0 50 40 30 20 10
de l'accès minimal au marché et des importations effectives de pommes de terres 1996199719981999dès 2000 1996199719981999200020012002 Accès minimal au marché Volumes effectifs d'importation en 1 000 t Produits à base de pommes de terre Pommes de terre destinées à la transformation Sources: DGD, OFAG Pommes de terre de table Plants de pommes de terre 0 50 40 30 20 10
Evolution
1.1 ECONOMIE 1.RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 45 1
■ Consommation: l’huile de colza en vogue
214‘000 t de légumes frais et 51'000 t de fruits frais ont été importées en Suisse,soit 3% de plus pour les premiers et 6% de plus pour les seconds par rapport à la moyenne des quatre dernières années.Les quantités exportées ont atteint le même ordre de grandeur que les années précédentes,soit 400 t pour les légumes et 1'000 t pour les fruits.Sont comprises dans ces quantités les variétés de légumes et de fruits cultivés en Suisse.
Les importations de vins de table (y compris celles au taux hors contingent) se sont montées en tout à 161,1 millions de l,dont 137 millions de l de vin rouge et 24,1 millions de l de vin blanc,auxquels se sont ajoutés 12,4 millions de l de mousseux, 8,3 millions de l de vins industriels et 1,7 million de l de vins liquoreux.Par rapport à 2001,les importations de vin rouge sont en recul de 5,2 millions de l tandis que celles de vin blanc ont de nouveau augmenté (+1,6 million de l) tout comme celles de mousseux (+0,2 million de l).Quant aux exportations de vins suisses,elles sont en retrait et n’ont plus atteint que 586'000 l en 2002.
Le marché domestique des oléagineux est marqué par la demande en huile alimentaire et en huile fourragère,ainsi qu’en tourteaux riches en protéines.L’huile de colza présente une composition en acides gras intéressante pour l’alimentation humaine.Du fait de ses bonnes propriétés physiologiques et des gros efforts consentis au niveau de l’information,elle est de plus en plus utilisée dans la cuisine suisse.L’huile de soja a vu son image ternie par la culture de variétés de soja génétiquement modifié,pratiquée à grande échelle à l’étranger,si bien que la demande à des fins alimentaires est très faible en Suisse.Plus de 90% de l’huile de soja importée contre 0,5% seulement pour l’huile de tournesol sont destinés à l’affouragement.Pour l’industrie fourragère,la qualité de la graisse – teneur en acides gras non saturés – contenue dans les tourteaux riches en protéines en limite l’utilisation dans les aliments pour animaux.Par rapport aux tourteaux d’extraction importés,les tourteaux obtenus en Suisse présentent un rapport protéines-graisse défavorable,ce qui réduit les possibilités d’utilisation dans une alimentation équilibrée.La demande en tourteaux a pour effet de limiter la culture de tournesol et de colza en Suisse et la préférence accordée aux huiles alimentaires à haute valeur ajoutée relègue au second plan la culture de soja.
En avril 2002,les résultats de chercheurs suédois ont inquiété les consommateurs de produits à base de pommes de terre.Ceux-ci avaient en effet constaté que l’acrylamide pouvait se former lorsque des denrées alimentaires contenant de l’amidon étaient chauffées à haute température.De son côté,l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a qualifié l’acrylamide de substance potentiellement cancérigène.Ont principalement défrayé la chronique les produits de transformation frits et les plats de pommes de terre sautées.Les travaux de recherche suisses sur l’acrylamide sont coordonnés par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).Entre-temps,une étude de l’université de Lausanne datée de juin 2003 vient d’infirmer l’effet cancérigène de l’acrylamide.A l’issue de diverses analyses préliminaires,les stations fédérales de recherches démarreront un vaste projet en 2004 pour analyser les facteurs influençant la formation d’acrylamide.
La consommation de légumes et de fruits a de nouveau augmenté en Suisse en 2002. Elle s’est élevée par habitant à 72 kg de légumes frais et à 25 kg de fruits de table (sans les fruits tropicaux),soit une hausse de 1 kg pour les légumes et 4 kg pour les fruits par rapport à la moyenne des années 1998/2001.
46 1.1 ECONOMIE 1
■ Prix à la production: recettes stables pour les grandes cultures
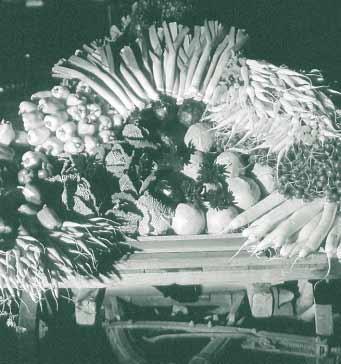
La consommation de vin rouge et de vin blanc (sans les vins industriels) s’est chiffrée à quelque 280 millions de l pendant l'année viticole 2001/02,en baisse d’environ 5,7 millions de l par rapport à l'année précédente.Alors que la consommation de vin rouge étranger était en retrait (–6,2 millions de l),celle de vin rouge suisse a connu une légère hausse (+0,5 million de l).Quant à la consommation de vin blanc d’origine étrangère,elle est demeurée stable (–0,1 million de l) tandis que celle de vin blanc suisse augmentait d’environ 0,2 million de l.La part de marché détenue par les vins suisses a progressé d’un peu plus de 1% pour atteindre 42,2% en 2002.La part des vins blancs est restée constante,s’élevant à quelque 76%,celle des vins rouges s’est accrue de 1%,pour se chiffrer à 30%.La consommation totale de vin,y compris les vins de transformation,a représenté 288,3 millions de l,dont 69% de vins rouges.
Evolution des recettes des producteurs pour des produits des champs
1990/92200020012002
Prix à la production 2002
Blé cl. I, 56.63 fr./dt
Betteraves sucrières, 11.64 fr./dt Colza, 78.56 fr./dt
Orge, 44.88 fr./dt
Pommes de terre, 34.94 fr./dt
Source: FAT
Les prix payés au producteur des principales cultures des champs se sont en grande partie maintenus au niveau de 2001.Par suite de la production record de sucre suisse, qui a entraîné un report de quotas sur l’année sucrière 2003,le prix moyen payé au producteur est tombé à 11,64 francs le quintal.L’élargissement de l’offre en seigle panifiable a comprimé les prix à la production au cours de l’année sous revue. Aussi,afin de soutenir les prix,la Fédération suisse des producteurs de céréales (FSPC) a-t-elle déclassé 7'700 t de seigle en aliment fourrager au printemps 2003.Par ailleurs, en raison de la germination sur pied observée sur le blé,l’offre en blé indigène panifiable a été limitée,d’où une légère hausse des prix.
Concernant les fruits et les légumes,l’offre importante s’est traduite le plus souvent par un léger tassement des prix payés au producteur en comparaison avec 2001. Le prix moyen des légumes (emballé,franco grande distribution) s’est ainsi élevé à 2,36 francs le kilo,soit 4% de moins qu’en 2001 et 6% de plus que les trois années précédentes.Dans le secteur des fruits,les cerises en particulier ont atteint des prix réjouissants:quand bien même la récolte a été bonne en termes de volume,l’excellente qualité des fruits a permis de maintenir les prix au niveau de 2001.
47 1.1 ECONOMIE 1 1.RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE
Ecart en %
–40 –50 –60 –70 –30 –20 –10 0
Lollo rouge: offre et prix 2001 et 2002
L’exemple de la lollo rouge montre comment l’importance de l’offre se répercute sur les prix et sur les recettes.En 2002,l’offre en lollo rouge du pays a été de 37% supérieure à celle de 2001,atteignant 3'200 t.Dans la foulée,le prix indigène a chuté de 24%, passant de 4,20 francs en moyenne en 2001 à 3,20 francs le kilo en 2002.En conséquence,les recettes ont pu augmenter de 6% seulement,soit de 8,8 à 9,3 millions de francs.Les quantités importées n’ont joué qu ’ un rôle secondaire durant ces deux années:leur part au marché était de 4% en 2002 et de 8% l’année d’avant.

Prix 2001Prix 2002
91113151719212325272931333537394143454749 Offre 2001 Semaine Sources: Union maraîchère suisse, Centrale suisse de la culture maraîchère Offre 2002 0 140 120 100 60 40 20 80 en t fr./kg 0 7 5 4 6 3 2 1
48 1.1 ECONOMIE 1
■ Prix à la consommation: renchérissement des fruits et légumes
Prix
à la consommation fruits et légumes 1 2002 en comparaison à 1998/2001
Total panier 1998–2001Total panier 2002
1 Prix à la consommation additionnés (indépendamment de l origine, suisse ou étrangère, des marchandises) des aubergines (250 g), champignons (250 g), fenouils (500 g), carottes (1 kg), chou-fleur (1 kg), chou chinois (350 g), chou blanc (500 g), côtes de bettes (250 g), poireaux verts (250 g), poivrons (200 g), céleri-pomme (600 g), tomates rondes (2 kg), courgettes (600 g), oignons comestibles (500 g), chicorées witloof (500 g), concombres (1 kg), laitue pommée (1 pièce), radis (2 bottes), pommes de terre (2,5 kg), pommes (1 kg), oranges (1 kg), bananes (1 kg), kiwis (4 pièces), raisins (1 kg).
Source: OFAG
Evolution des prix à la consommation de fruits et légumes
Le panier de fruits et légumes a connu un renchérissement notable de 4,3% pour l’année sous revue.Des prix à la consommation particulièrement élevés,en hausse de plus de 30% par rapport à 2001,ont été observés au premier trimestre.Le gel et l’humidité qui ont sévi dans les pays d’origine ont sensiblement affecté les récoltes et expliquent les augmentations de prix survenues dans toute l’Europe.Le mois de juillet a été la seule période durant laquelle les prix ont été inférieurs à la moyenne des années 1998–2001.
3579111315171921232527293133353739414345474951 1 Semaine Total en fr.
48 82 80 78 74 76 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50
sélectionnés fr./kg
1993199419951996199719981999200020012002 48 66 64 62 58 56 60 54 52 50 54.96 56.52 57.85 56.49 58.10 58.90 59.33 59.53 62.22 64.92
Source: OFAG
1.RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 49 1.1 ECONOMIE 1
Les conditions climatiques,nettement meilleures en 2002 qu’au cours de l’année précédente,ont eu un effet bénéfique sur la récolte de cerises qui a été légèrement plus précoce et plus abondante.La récolte indigène de cerises de table a fait un bond de 60% et a ainsi atteint 2'045 t,tandis que les importations (seulement en été) augmentaient de 8%.La part des marchandises indigènes au volume de vente a progressé de 10 points pour s’établir à 63%.Tant le prix de revient (–2,4%) que le prix à la consommation (–4%) ont pâti de cette évolution.Au final,la marge brute a baissé de 25 ct.,s’établissant à 4,13 francs le kilo.

1.1 ECONOMIE 1 50
■ Marge brute:en baisse pour les cerises de table
MaiJuinJuillet fr./kg
Marge brute sur les cerises de table sans qualité extra 2002
0 14 2 4 6 8 10 12
Marge brutePrix de revientPrix à la consommation Source: OFAG
■ Deux systèmes d'indicateurs pour évaluer la situation économique
1.1.3Situation économique du secteur agricole
Conformément à l’art.5 LAgr,les mesures de politique agricole doivent permettre aux exploitations remplissant les critères de durabilité et de performance économique de réaliser,en moyenne pluriannuelle,un revenu comparable à celui de la population active dans les autres secteurs économiques d’une même région.
L’évaluation est réglée dans l'ordonnance sur l'évaluation de la durabilité (art.3 à 7) et se fait à l’aide de deux systèmes d’indicateurs.Une évaluation sectorielle repose sur les Comptes économiques de l’agriculture suisse (CEA) qui sont établis par l’OFS avec le soutien du secrétariat de l’USP (cf.ch.1.1.3).Quant à l'évaluation individuelle des exploitations,elle se fonde sur les résultats comptables du dépouillement centralisé effectué par la FAT (cf.ch.1.1.4).
■ Comptes économiques de l'agriculture:méthodologie remaniée
Dans le cadre du projet SAKO-1 (comptes satellites du secteur primaire),l’OFS a remanié l’établissement des CEA en étroite collaboration avec l’USP.Cette révision qui, en fait,est une adaptation globale permet la comparaison directe des résultats avec ceux de l’UE.
Par conséquent,les résultats ne sont pas comparables avec ceux des années précédentes,tels qu’ils ont été publiés dans les rapports agricoles 2000 à 2002.Afin de pouvoir néanmoins porter un jugement sur l’évolution,la nouvelle méthode a également été appliquée aux comptes des années antérieures.Jusqu’à présent,nous disposons des résultats pour les années 1997 à 2003 (2003 en tant qu’estimation).Pour le rapport agricole 2004,il est prévu de présenter les comptes depuis 1990 selon la nouvelle méthodologie.On peut ainsi distinguer deux types d’adaptation.D’une part, les adaptations au sens classique qui ont été apportées à la méthodologie.En font partie la redéfinition des prix servant à évaluer les prestations de production de l’agriculture,ainsi que l’abandon de la notion de «ferme nationale».Cela signifie que les nouveaux CEA englobent plus d’éléments que les seuls échanges entre l’agriculture et les autres parts de l’économie.Désormais,ils incluent aussi une évaluation des flux de marchandises et de services tant au niveau interne des exploitations qu’au niveau inter-entreprises.D’autre part,les adaptations concernent l’univers des exploitations agricoles saisies dans l’analyse,ainsi que les produits et services pris en considération. Parmi les plus importants figurent dorénavant la prise en compte de l’horticulture, des services agricoles et des activités annexes non agricoles directement liées à l’agriculture.
Définitions et méthodes,page A73
Les adaptations sont décrites plus en détail dans l’annexe.Un exemple est également donné pour illustrer leurs répercussions sur le plan quantitatif.
1.1 ECONOMIE 1 51 ■■■■■■■■■■■■■■■■
■ Revenu sectoriel 2002
En 2002,le revenu net d’entreprise du secteur agricole s’est élevé à 3,242 milliards de francs,soit environ 1% en-deçà de celui de la période1999/2001.Au niveau des coûts, la hausse des dépenses consacrées à la consommation intermédiaire,qui s’est chiffrée à 229 millions de francs (+4%),a été un facteur déterminant.Du côté des recettes, l’augmentation des autres subventions (paiements directs non liés à des produits,pour la plupart),de l’ordre de 196 millions de francs (+8,3%),n’est pas tout à fait parvenue à compenser l’accroissement des coûts liés à la consommation intermédiaire.
La valeur du revenu net d’entreprise a progressé de 146 millions de francs (+4,7%) par rapport à 2001.Le revenu plus élevé du secteur est notamment attribuable à la hausse de 188 millions de francs (+1,8%) enregistrée dans la production de la branche agricole et à l’augmentation du poste autres subventions (+100 millions de francs,soit +4,1%).Dans l’ensemble,ces améliorations ont été plus importantes que l’accroissement des coûts.A la valeur plus élevée de la consommation intermédiaire,de l’ordre de 159 millions de francs (+2,7%),a fait pendant une diminution de la rémunération des salariés (–27 millions de francs ou –2,4%).Les autres postes relatifs aux coûts sont pratiquement restés inchangés.
Quant au revenu sectoriel,il reflète fidèlement les fluctuations du revenu agricole de ces dernières années:après le recul enregistré en 1999 par rapport à l’année d’avant, une embellie a suivi en 2000.Cette évolution en dents de scie s’est à nouveau répétée en 2001 (recul considérable) et 2002 (progression).Conformément aux estimations pour l’année 2003,le revenu du secteur devrait sensiblement baisser,et ce au plus bas niveau enregistré jusqu’à présent.
1Etat au 1er septembre 2003.En raison de l’application pour la première fois de la nouvelle méthodologie,les valeurs ne sont pas encore définitives
2003
2003
des comptes économiques de l'agriculture suisse Indications en prix courants,en millions de fr. 1998 1 1999 1 2000 1 2001 1 2002 2 2003 3 Production de la branche agricole11 13110 24710 90910 29210 4809 902 – Consommations intermédiaires5 9025 523 5 8745 8035 9625 777 Valeur ajoutée brute aux prix de base5 228 4 724 5 035 4 4894 5184 124 – Consommation de capital fixe1 996 1 984 1 9681 994 1 999 2 010 Valeur ajoutée nette aux prix de base3 232 2 740 3 0682 494 2 5192 114 – Autres impôts sur la production109115117131135135 + Autres subventions (non liées à des produits)2 170 2 3952 213 2 4482 5482 527 Revenu des facteurs5 293 5 0205 1644 8124 9324 506 – Rémunération des salariés1 217 1 172 1 151 1 124 1 097 1 075 Excédent net d’exploitation / Revenu mixte4 0763 847 4 012 3 687 3 8353 430 – Fermages212213209202202200 – Intérêts à payer371341366389390395 Revenu net d’entreprise3 4933 293 3 437 3 096 3 2422 835
Résultats
2Chiffres provisoires, état au 1er septembre
3Estimation, état au 1er septembre
Source:OFS
52 1.1 ECONOMIE 1
Tableaux 15–16,pages A14–A15
Autres

Production
1 Etat au 1.9.2003. Les valeurs ne sont pas encore définitives en raison de la nouvelle méthode
pour la première fois
Source: OFS
des Comptes économiques de l'agriculture 19981 19991 20001 20011 20022 20033 Indications en prix courants, en millions de francs
Evolution
subventions sur la production
de la branche agricole
à
net d'entreprise
Dépenses (consommations intermédiaires, autres impôts sur la production, consommation de capital fixe, rémunération des salariés, fermages, intérêts à payer moins les intérêts
recevoir) Revenu
2 Valeurs provisoires, état au
3 Estimation, état au 1.9.2003 0 12 000 14 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000
appliquée
1.9.2003
53 1.1 ECONOMIE 1
■ Estimation du revenu sectoriel 2003
L’été 2003 a été marqué par des températures caniculaires et par la sécheresse.Outre en Suisse romande et sur une grande partie du Plateau,les cultures agricoles ont souffert dans les cantons de Schaffhouse et des Grisons,ainsi qu’au Tessin.
La valeur de la production 2003 est estimée à 9,902 milliards de francs,en baisse de 6,2% par rapport à la moyenne triennale 2000/02.Ce résultat s’explique par la diminution des recettes en production végétale par suite de la sécheresse persistante.
La production végétale (y compris l’horticulture) est estimée à 4,067 milliards de francs,en recul de 11,1% par rapport à la moyenne triennale.La sécheresse a particulièrement affecté les céréales,les pommes de terre et les plantes fourragères.
Bien que de meilleure qualité,la récolte de céréales 2003 a été nettement inférieure à la moisson 2002 en termes de quantité.Le blé et le maïs-grain principalement ont vu leur croissance ralentie par les conditions climatiques défavorables.Une grande partie du maïs-grain a ainsi été récoltée de bonne heure et utilisée comme maïs ensilage. Selon les estimations,la récolte de céréales 2003 devrait être inférieure de 20,8% à la moyenne triennale.
En ce qui concerne les betteraves,de premières analyses permettent de tabler sur une récolte moyenne tant en termes de quantité que de teneur en sucre.Quant à la valeur du soja et du tournesol,on estime qu’elle sera supérieure à celle de l’année précédente grâce à l’extension des surfaces.Le rendement inférieur de colza laisse escompter une baisse minime de la valeur de production.Dans l’ensemble,la valeur de production des plantes industrielles ne devrait être que légèrement inférieure à celle de l’année précédente.
Les plantes fourragères ont particulièrement souffert de la chaleur et de la sécheresse. Après une récolte de foin bonne sur les plans qualitatif et quantitatif,les fauches suivantes ont été supprimées complètement ou en partie dans les régions victimes de la sécheresse.La valeur de la production en plantes fourragères qui figure également dans la consommation intermédiaire en tant que contre-écriture est inférieure de 23,2% à celle de la moyenne triennale.
Comparés à 2001,les rendements des produits maraîchers ont diminué du fait de la sécheresse.La valeur de la production maraîchère englobe également celle des champignons.L’Europe toute entière a été touchée par la sécheresse de sorte que les prix ont fortement augmenté durant les mois d’été.En raison des volumes plus faibles récoltés pour les légumes de garde,les prix devraient se maintenir à un niveau élevé.Aussi s’attend-on dans l’ensemble à une bonne année légumière,comparable à 2002.Par rapport à la moyenne triennale,la valeur de la production 2003 est en hausse de 4,8%.
L’horticulture,qui comprend la production des pépinières et des exploitations dans le secteur des plantes ornementales,y compris les arbres de Noël,mais non les services horticoles,est partiellement intégrée désormais dans les comptes économiques de l’agriculture.Après avoir connu une phase d’expansion dans les années 1990,l’horticulture est sous pression depuis 2001.Aussi,selon les estimations,la valeur de la production 2003 sera inférieure à la moyenne triennale.
54 1.1 ECONOMIE 1
Quant aux pommes de terre,on s’attend à une récolte plus faible et de moins de bonne qualité bien que la surface ait augmenté de 3,5% par rapport à 2002.Comparée aux années précédentes,la part de pommes de terre de table n’a jamais été évaluée à un niveau aussi bas.Les prix devraient donc se situer dans la partie supérieure de la fourchette.
Pour ce qui est des fruits,on peut tabler cette année sur une récolte au-dessous de la moyenne et comparable à celle de 1997,mais inférieure de 9,5% à la moyenne triennale.Outre les fruits frais (poires,pommes,fruits à noyau et baies),ce poste englobe également les raisins.
En viticulture,la valeur de la production est en partie influencée par les stocks constitués les années précédentes.Pour 2003,la valeur estimée sera inférieure de 7,4% à celle de la moyenne triennale,marquée par les deux grandes récoltes 1999 et 2000. Si l’on s’attend à une récolte plus faible,le millésime devrait être de bonne pour ne pas dire d’excellente qualité
Dans une comparaison pluriannuelle,la production animale enregistre une baisse de 3,2%.D’après les estimations,la production de bétail de rente et de bétail de boucherie devrait augmenter de 1,7% alors que la valeur de la production de lait et d’œufs devrait chuter de 7,3%.Les craintes de voir le prix des vaches de boucherie mis sous pression en raison de la sécheresse et de la situation tendue régnant sur le marché laitier ne se sont pas confirmées lors des estimations.
En ce qui concerne les porcs,le marché a été équilibré.En raison du recul de la demande,les prix à la production ont baissé vers la fin de l’été,comme on s’y attendait.L’augmentation de la production de volaille et la stabilité des prix permettent de déduire que la valeur de la production dépassera celle des années précédentes.
La valeur de la production laitière,en baisse,a été influencée par les prix plus bas et par la réduction des livraisons de lait.Quant aux oeufs,on s’attend à une hausse des prix mais aussi à une production moindre qu’en 2001.
Le poste production de services agricoles est nouveau sous cette forme dans les comptes économiques de l’agriculture.Celle-ci est estimée à 581 millions de francs pour 2003,en hausse de 2,2% dans une comparaison pluriannuelle.Si l’on s’attend à ce que les travaux à façon pour l’agriculture restent au niveau de 2001,la location de quotas laitiers devrait enregistrer,en revanche,une légère augmentation.
Figurent également pour la première fois dans les comptes économiques de l’agriculture les activités secondaires non agricoles non séparables,dont la valeur est estimée à 321 millions de francs.Comparée aux années précédentes,cette valeur devrait baisser d’environ 1,2% notamment en raison de la diminution du volume de fruits à cidre transformés.Par contre,les services tels que élagage et entretien des bords de routes,garde d’animaux en pension et nuitées sur la paille,qui sont proposés en dehors de la branche agricole,devraient enregistrer une croissance de 4,2% par rapport à la moyenne triennale.
Les dépenses liées aux consommations intermédiaires sont estimées à 5,777 milliards de francs en 2003,soit 1,7% en deçà de la moyenne triennale.Ceci s’explique
1.RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 55 1.1 ECONOMIE 1
essentiellement par le recul des dépenses concernant les aliments pour animaux par suite de la petite récolte de fourrages grossiers.Ces fourrages produits et consommés à l’intérieur de l’exploitation sont passés en contre-écriture dans la consommation intermédiaire.En revanche,les dépenses concernant les achats d’aliments pour animaux industriels ont augmenté,et ce malgré la baisse des prix des aliments composés. Autre facteur ayant également contribué à la baisse des coûts:les semences.Ainsi, principalement dans le secteur des pépinières et la production de plantes ornementales,on s’attend à un recul de la demande en plants,allant de pair avec une baisse des prix.
Pour la valeur ajoutée brute aux prix de base,on table sur une diminution de 11,9% dans une comparaison pluriannuelle.Les dépenses liées aux consommations intermédiaires,en légère baisse,ne devraient pas suffire à compenser le recul de la valeur de la production de la branche agricole.
La consommation de capital fixe devrait,selon les estimations,s’établir à 2,010 milliards de francs,en hausse de 1,2% dans une comparaison pluriannuelle.Ce poste est fortement influencé par les investissements opérés au cours des années précédentes.
La progression des autres impôts sur la production,de l’ordre de 5,9%,est surtout imputable à la sous-compensation de la TVA.D’une part,les taux de TVA sont passés en 2001 de 2,3 à 2,4% pour les biens primaires et de 7,5 à 7,6% pour les autres biens.D’autre part,dans la composition du poste consommations intermédiaires,il y a eu un certain report des postes soumis à un bas taux de TVA (semences, engrais,aliments pour animaux,etc.) vers les postes soumis à un taux de TVA élevé (réparations et entretien,autres services).De plus,ont augmenté les dépenses liées aux taxes sur les véhicules et aux droits de timbre.
Les autres subventions sur la production englobent tous les paiements directs (contributions générales et contributions fournies pour les prestations écologiques),les intérêts calculés pour des prêts publics sans intérêts (crédits d’investissement,aide aux exploitations paysannes) et les autres contributions versées par les cantons et les communes.Mais elles n’incluent pas les subventions sur les biens,lesquelles ont déjà été prises en compte dans la valeur de la production (p.ex.contributions à la culture). Les autres subventions sur la production devraient se monter à 2,527 milliards de francs,soit une augmentation de 5,2% par rapport à la moyenne triennale.Comparée à l’année précédente,cette valeur est toutefois en retrait de 0,8%.
La rémunération des salariés (frais de main-d’œuvre) est estimée en 2003 à 1,075 milliard de francs,en diminution de 4,3% par rapport à la moyenne pluriannuelle.Le recul particulièrement prononcé des salariés dans les pépinières et les exploitations spécialisées dans la production de plantes ornementales (transfert des salariés vers les services horticoles) a eu une incidence plus forte que l’accroissement des frais salariaux (cotisations sociales comprises) par unité de main-d’œuvre annuelle.
Pour le poste fermages,il faut s’attendre à une diminution de 2,1% par rapport à la moyenne triennale.Quant aux intérêts à payer,ils seront en hausse de 3,5% selon les estimations.
Le solde du revenu net d’entreprise s’établit à 2,835 milliards de francs,soit une baisse de 13% par rapport aux années précédentes et de 13% en comparaison de 2001.
56 1.1 ECONOMIE 1
1.1.4Situation économique des exploitations
L’appréciation de la situation économique des exploitations se fonde sur les résultats du dépouillement centralisé des données comptables effectué par la FAT.La méthode utilisée par celle-ci a été revue de fond en comble en 1999.En plus des diverses grandeurs de revenu,des indicateurs relatifs,par exemple, à la stabilité financière ou à la rentabilité fournissent de précieux renseignements sur la situation économique des exploitations.Ces indicateurs sont mentionnés à l’annexe.Ils seront étudiés plus en détail ci-après.Sera par ailleurs présentée la deuxième partie d’une étude de l’Institut d’économie rurale de l’EPF de Zurich sur le thème des prestations («Performance») de l’agriculture suisse.

■■■■■■■■■■■■■■■■
Définitions et méthodes,page A78 57 1.1 ECONOMIE 1
■ Revenu 2002
Revenu et chiffres-clés économiques
Evolution des revenus des exploitations agricoles: moyenne de toutes les régions

1990/921999200020012002
Les résultats économiques enregistrés en 2002 s’inscrivent en léger retrait par rapport à 2001.Comparé aux trois années précédentes,le recul du revenu agricole par exploitation s’élève à 10%.Le rendement brut a pu s’accroître d’à peine 2% par rapport à celui des années 1999/2001.La production végétale a enregistré une diminution des recettes (–8%) qui s’explique en partie par les conditions climatiques,mais aussi par la baisse des prix.Quant au rendement brut de la garde d’animaux,il est demeuré stable pour ainsi dire.En dépit de la crise qui a secoué la branche laitière,les recettes provenant du lait ont légèrement augmenté (+2,3%) par rapport aux trois années précédentes.Par contre,les résultats réalisés dans le secteur du bétail bovin ont chuté (–16%),principalement en raison de la correction apportée à l’évaluation des effectifs, compte tenu de la situation du marché pour le bétail de boucherie et le bétail de rente. De son côté,la garde de porcs et de volaille affiche des résultats en hausse de +3,8% et de 14,1% respectivement,et ce surtout en raison de l’augmentation des effectifs. Les paiements directs ont progressé de 12,8% par rapport aux trois années précédentes,une augmentation attribuable,outre à l’agrandissement des exploitations (surface +3,3%,animaux +2,5%),aux adaptations apportées au système des paiements directs,ainsi qu’aux changements survenus dans les modes de production. En 2002,les charges réelles ont été supérieures d’environ 6% à celles de la période 1999/2001.Mais cette hausse s’explique,là aussi,en partie par l’agrandissement des exploitations.Ce sont surtout les coûts concernant les aliments pour animaux (+10,4%) et les bâtiments (+14,2%),ainsi que les frais généraux d’exploitation (+9,5%) qui ont augmenté tandis que les frais de main-d’œuvre ont diminué de 4,4%.
Le revenu agricole correspond à la différence entre le rendement brut et les charges réelles.S’inscrivant en légère baisse par rapport à l’année précédente,ce revenu aurait été un peu plus élevé sans la correction apportée à l’évaluation des effectifs de bovins. Le revenu agricole rémunère,d’une part,le travail de 1,3 unité de main-d’œuvre familiale en moyenne et,d’autre part,les fonds propres investis dans l’exploitation et qui s’élèvent en moyenne à 400’000 francs.
58 1.1 ECONOMIE 1
fr. par exploitation Revenu accessoire Revenu agricole Source: dépouillement centralisé, FAT 0 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 16 264 62 822 1,39 UTAFUnités de travail annuel de la famille 18 638 53 789 1,29 19 208 64 675 1,30 18 633 52 434 1,29 18 577 51 500 1,28
Tableaux 17–26,pages A16–A26
En comparaison avec la période 1999/2001,le revenu agricole a baissé en 2002 de 6% dans la région de plaine,de 11% dans la région des collines et de 14% dans la région de montagne.De même,le revenu accessoire a régressé tant dans la région de plaine que dans la région des collines (–4% et –7%).En revanche,il s’est accru de 8% dans la région de montagne.Ainsi,le revenu total a été inférieur à la moyenne des années 1999/2001,en diminution de 6% en plaine,de 10% dans les collines et de 8% en montagne. Revenu des exploitations agricoles,selon les régions
La part des paiements directs au rendement brut a atteint,en 2002,17% dans les exploitations de plaine,24% dans les exploitations de la région des collines et 42% en montagne.Elle est donc un peu plus élevée qu’en 1999/2001 dans les trois régions,ce qui s’explique surtout par l’augmentation du montant total des paiements directs en 2002.
59 1.1 ECONOMIE 1.RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 1
Revenu,selon les régionsUnité 1990/9219992000200120021999/2001–2002 % Région de plaine Surface agricole utileha16,6619,33 19,4119,9320,685,7 Main-d’œuvre familialeUTAF1,361,26 1,261,261,25 –0,8 Revenu agricolefr.73 79461 968 77 73862 45363 402 –5,9 Revenu accessoirefr.16 42917 580 17 80517 04316 743 –4,2 Revenu totalfr.90 22379 548 95 54379 49680 145 –5,6 Région des collines Surface agricole utileha15,3017,19 17,8317,9518,092,5 Main-d’œuvre familialeUTAF1,401,28 1,291,261,24 –2,9 Revenu agricolefr.59 83849 885 58 72547 49646 257 –11,1 Revenu accessoirefr.14 54419 849 21 81420 55719 369 –6,6 Revenu totalfr.74 38269 734 80 53968 05365 626 –9,8 Région de montagne Surface agricole utileha15,7618,06 18,6318,8518,550,2 Main-d’œuvre familialeUTAF1,421,37 1,391,381,35 –2,2 Revenu agricolefr.45 54143 392 47 72140 13537 512 –14,3 Revenu accessoirefr.17 85319 250 19 01119 41420 7487,9 Revenu totalfr.63 39462 642 66 73259 54958 260 –7,5 Source:dépouillement centralisé,FAT
Tableaux 17–20,pages A16–A19
La situation en termes de revenus laisse toutefois apparaître de grandes différences entre les 11 types d’exploitations (branches de production).
Revenu des exploitations agricoles,selon le type,2000/02
Si l’on considère la moyenne des années 2000/02,ce sont les exploitations pratiquant la culture des champs et les cultures spéciales ainsi que certaines exploitations combinées (lait commercialisé/cultures des champs,combinées transformation) qui ont affiché le revenu agricole le plus élevé.Et avec les exploitations combinées/vaches mères,ce sont aussi elles qui ont réalisé le plus gros revenu total.Inversement,les exploitations ayant enregistré les plus bas revenu agricole et revenu total appartiennent aux types «Chevaux/ovins/caprins» et «Autre bétail bovin»
Type d'entrepriseSurface Main-d'œuvre RevenuRevenuRevenu agricole utilefamilialeagricoleaccessoiretotal haUTAFfr.fr.fr. Moyenne de toutes les exploitations19,091,2956 20318 80675 009 Cultures des champs24,231,1069 49222 20091 693 Cultures spéciales12,571,3673 16314 90788 070 Lait commercialisé 18,651,3450 19218 21568 406 Vaches mères17,271,1039 81131 24771 058 Autre bétail bovin15,901,2733 66521 32554 990 Chevaux/ovins/caprins13,641,2021 76729 55951 326 Perfectionnement11,301,1564 00917 09081 099 Exploitations combinées: grandes cultures + lait24,941,3370 40514 36984 774 Exploitations combinées: vaches mères21,791,1657 70326 96684 669 Combiné transformation19,391,2969 75215 97785 730 Combiné autres20,291,2756 65819 53876 197 Source:dépouillement centralisé,FAT
60 1.1 ECONOMIE 1
Tableaux 21a–21b,pages A20–A21
Le revenu du travail des exploitations agricoles (revenu agricole après déduction des intérêts relatifs aux fonds propres investis dans l’exploitation) indemnise la maind’œuvre familiale non salariée.Par rapport à la moyenne triennale 1999/2001,le revenu du travail (médiane) par unité de main-d’œuvre familiale s’est détérioré de 10% en 2002,stagnant au niveau de celui enregistré en 2001.
Autre constat,ce revenu varie fortement d’une région à l’autre.En moyenne,il est toutefois sensiblement plus élevé en région de plaine que dans la région de montagne. Les écarts entre quartiles sont eux aussi importants.Ainsi,pour la période 2000/02,le revenu du travail par unité de main-d’œuvre familiale du premier quartile a atteint 23% dans la région de plaine et celui du quatrième quartile 196% de la moyenne de toutes les exploitations de la région.La dispersion est similaire dans les autres régions.
Revenu du travail des exploitations agricoles,2000/02: selon les régions et quartiles

Revenu du travail 1 en fr.par UTAF 2
1Rémunération des fonds propres au taux moyen des obligations de la Confédération:2000:3,95%;2001:3,36%; 2002:3,22%
2Unités de travail annuel de la famille:base 280 journées de travail
Source:dépouillement centralisé,FAT
MédianeValeurs moyennes Région1er quartile2e quartile3e quartile4e quartile (0–25%)(25–50%)(50–75%)(75–100%) Région de plaine38 3659 35431 20646 07381 115 Région des collines28 5304 67822 40434 97760 302 Région de montagne19 9091 44715 77425 39146 205
Tableaux 22–25,pages A22–A25
61 1.1 ECONOMIE 1
■ Revenu du travail identique à celui de 2001
■ Stabilité financière
Dans la région de plaine et la région des collines,les exploitations du quatrième quartile ont réalisé,en 2000/02,un montant équivalent ou supérieur au salaire annuel brut correspondant du reste de la population.Quant à la région de montagne,le revenu moyen du travail s’est situé dans le 4e quartile à quelque 9’000 francs en dessous de la valeur comparative.
Salaire comparatif 2000/02,selon les régions
RégionSalaire comparatif 1 en fr.par année
Région de plaine65 515
Région des collines60 108
Région de montagne55 001

1Médiane des salaires annuels bruts de tous les employés des secteurs secondaire et tertiaire
Sources:OFS,FAT
Lorsque le revenu accessoire est pris en compte dans l’appréciation,la situation des ménages agricoles se présente nettement mieux que si l’on compare uniquement le revenu du travail avec le salaire de référence.Les revenus accessoires se situaient en moyenne autour de 19’000 francs en 2000/02.
La part des capitaux étrangers à l’ensemble du capital (ratio d’endettement) renseigne sur le financement d’une exploitation par des tiers.En considérant aussi bien ce paramètre que la formation de fonds propres,on peut juger si les dettes d’une exploitation sont supportables.Une exploitation ayant un ratio d’endettement élevé et une formation de fonds propres négative n’est pas viable à la longue.
Au vu de ces critères,les exploitations sont réparties en quatre groupes en fonction de la stabilité financière.
Répartition des exploitations en quatre groupes
Exploitations dont Ratio d’endettement faible (<50%) élevée (>50%) positive...bonne...autonomie financière Formation desituation financièrelimitée fonds propres négative...revenu ...situation financière insuffisantprécaire
Source:De Rosa
62 1.1 ECONOMIE 1
■ Formation de fonds propres,investissements et ratio d’endettement
L’appréciation de la stabilité financière montre une situation similaire dans les trois régions.Près de la moitié des exploitations se trouve dans une bonne situation financière,alors que l’on peut qualifier cette dernière de problématique pour un peu plus de 30% des exploitations (formation de fonds propres négative).Par rapport aux années 1999/2001,la situation dans ces trois régions s’est légèrement détériorée.
Appréciation de la stabilité financière 2000/02: d'après les régions
% situation financière précaire revenu insuffisant autonomie financière limitée bonne situation financière
Région de plaineRégion des collinesRégion de montagne
centralisé,
Les investissements des exploitations de référence FAT ont diminué en 2002 en comparaison avec la période 1999/2001 (–2,4%).Quant à la marge brute d’autofinancement (cash-flow),elle a baissé elle aussi (–3,2%).En conséquence,le rapport entre le cash-flow et les investissements n’a guère changé (–1,4%).De même,la formation de fonds propres (revenu total moins consommation privée) est très inférieure à celle de la période de référence (–51%).En revanche,le ratio d’endettement n’a pas changé
Evolution de la formation des fonds propres,des investissements et du ratio d’endettement
–1,4
1 investissements bruts (sans prestations propres),moins les subventions et les désinvestissements
2 rapport entre cash-flow (formation de fonds propres plus amortissements,plus/moins variations des stocks et du cheptel vif) et investissements
Source:dépouillement centralisé,FAT
63 1.1 ECONOMIE 1.RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 1
Paramètre1990/9219992000200120021999/2001–2002 % Formation de fonds propresfr.19 51313 20721 2337 2886 840 –50,8 Investissements 1 fr.46 91441 85644 96547 46943 695 –2,4 Rapport entre cash-flow et investissements 2 %951011028394
Ratio d’endettement%43414141410
Part d'exploitations en
Source: dépouillement
FAT 0 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 16 20 18 46 17 16 23 44 16 20 19 45
■ Evolution des coûts par exploitation
Evolution des coûts ces dix dernières années

L’évolution des coûts à la charge des exploitations agricoles est représentée,par exploitation et par hectare, à partir des résultats du dépouillement centralisé.
Evolution du rendement brut et des coûts réels par exploitation
1990/922000/02
Source: dépouillement centralisé, FAT
Dans les années nonante,les charges réelles ont augmenté de 14% et le rendement brut de 6%.La forte hausse des charges réelles a entraîné dans le même temps une réduction de 11% des revenus agricoles.
Evolution des coûts réels par exploitation
1990/922000/02
Source: dépouillement centralisé, FAT
L’accroissement des charges réelles est principalement imputable aux coûts structurels1 (p.ex.coûts des bâtiments et des machines,frais généraux d’exploitation).De leur côté, les coûts matériels de la production animale ont également enregistré une hausse. Les coûts matériels en production végétale et les coûts structurels 2 externes (maind’œuvre,intérêts) ont diminué en revanche.
1.1 ECONOMIE 1 64
fr.
Rendement brutCoûts réels 0 250000 200000 150000 100000 50000
fr.
Coûts matériels production végétale 0 80000 60000 70000 50000 30000 40000 10000 20000 Coûts matériels garde d'animaux Charges de structure 1 Charges de structure 2
Variation 1990/92–2000/02 selon groupes de coûts par exploitation
Coûts matériels production végétale
Coûts matériels garde d'animaux
Travaux effectués par des tiers, location de machines
Part de coûts d'automobiles
Machines et appareils
Amortissements végétaux
Installations fixes
Bâtiments
Améliorations foncières et chemins
Coûts d'exploitation généraux
Coûts de personnel
Source: dépouillement centralisé, FAT
Une autre ventilation fait apparaître une hausse sensible pour les cinq postes suivants: coûts des bâtiments,frais généraux d’exploitation,coûts matériels liés à la garde d’animaux,coûts des machines et appareils,ainsi que travaux exécutés par des tiers (y compris la location de machines).Concernant les coûts des bâtiments,l’accroissement est essentiellement dû aux amortissements.Les intérêts,en particulier,ont connu une forte diminution,la baisse étant un peu moins prononcée pour les frais de maind’œuvre et les coûts matériels en culture végétale.
■ Evolution des coûts par hectare
Entre 1990/92 et 2000/02,la surface des exploitations de référence s’est agrandie de 3 ha en moyenne,passant de 16,1 à 19,1 ha.Le tableau suivant montre comment cette croissance s’est répercutée sur l’évolution des coûts.
Coûts matériels garde d'animaux Charges de structure 1 Charges de structure 2
1990/922000/02
Source: dépouillement centralisé, FAT
1.1 ECONOMIE 1.RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 1 65
Fermages Intérêts à payer –1 323 3 526 2 491 836 3 054 90 886 6 708 440 4 825 –1 733 574 –3 061 –4000 –200002000 fr. 40006000 8000
fr.
Evolution des coûts réels par ha
Coûts matériels production végétale 0 4000 3000 3500 2500 1500 2000 500 1000
Si l’on observe l’évolution des coûts par ha,on constate que seuls les coûts structurels1 ont augmenté.Les autres postes ont affiché en 2000/02 des soldes inférieurs à ceux de 1990/1992.Il en va de même du montant total des charges réelles qui ont été inférieures de 4% au niveau enregistré dix ans plus tôt.
Coûts matériels production végétale
Coûts matériels garde d'animaux
Travaux effectués par des tiers, location de machines
Part de coûts d'automobiles
Machines et appareils
Amortissements végétaux Installations fixes
Einfuhren Import-
Source: dépouillement centralisé, FAT
Si l’on observe maintenant le niveau inférieur,on constate que,par ha,seuls les coûts des bâtiments,les frais généraux d’exploitation,ainsi que les coûts des travaux exécutés par des tiers (y compris la location des machines) ont sensiblement progressé
Globalement,le tableau met en évidence que,compte tenu de l’effet de croissance,les charges réelles de l’agriculture n’ont pas augmenté au cours des dix dernières années. Il convient toutefois de noter que les coûts n’ont pas pu être réduits dans la même proportion que les exploitants ont vu leurs recettes diminuer.
1.1 ECONOMIE 1 66
bzw.Exportüberschuss
Variation 1990/92–2000/02 selon groupes de coûts par ha
fr.
Bâtiments Améliorations foncières et chemins Coûts d'exploitation généraux Coûts de personnel Fermages Intérêts à payer –196 –111 92 18 –35 2 24 235 15 179 –227 –272 –20 –400 –300 –2000–100100200 300
Tableau de financement
Le tableau de financement montre tous les flux (entrées et sorties) de fonds d’une entreprise ou d’un ménage et comprend trois volets.Le volet Flux de fonds entreprise et privé regroupe les flux de fonds découlant de l’activité professionnelle des membres du ménage agricole (flux de fonds de l’agriculture et flux de fonds hors exploitation), ainsi que les sorties de fonds imputables à la consommation privée du ménage.La différence entre les deux valeurs correspond au cash-flow (flux de fonds entreprise et privé).Le volet Investissements englobe les flux de fonds liés aux investissements opérés par l’entreprise (y compris les flux de fonds provenant de désinvestissements). Si le cash-flow généré suffit à couvrir les investissements,on obtient un excédent de financement ou,dans le cas contraire,un déficit de financement.Un déficit de financement est possible car l’exploitation dispose,outre du cash-flow,d’autres sources de financement qui sont indiquées dans le volet Flux de financement externes.Celui-ci regroupe les flux de fonds résultant de l’emprunt et/ou du remboursement de capitaux tiers et de capitaux privés des membres du ménage (mouvement financier avec le compte privé).Le solde des flux de fonds entreprise et privé,des investissements et des flux de financement externes correspond à la variation des actifs circulants monétaires nets.
Tableau de financement 1999/2001

1.1 ECONOMIE 1.RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 1 67
Flux de fonds entreprise et privé Revenu agricole56 966 Amortissements (tableau de financement)30 169 Variation des stocks et des actifs en bétail –1 809 Diverses corrections –10 553 Flux de fonds de l’agriculture74 773 Flux de fonds hors exploitation19 535 Flux de fonds avant prélèvements privés94 308 Prélèvement privés –51 752 Cash-flow (flux de fonds entreprise et privé)42 557 Investissements Machines et outils –11 445 Bâtiments et installations fixes (sans les propres prestations) –24 340 Autres investissements –8 978 Excédent/déficit de financement –2 206 Flux de financement externes Variation des crédits d’investissement –60 Variation des autres capitaux externes3 874 Mouvement financier avec le compte privé (apports nets)2 005 Variation des actifs circulants monétaires nets3 613 Source:dépouillement centralisé,FAT
■ Structure du tableau de financement
■ Flux de fonds provenant de l’agriculture et du revenu agricole
Le flux de fonds de l’agriculture est, à côté du flux de fonds hors exploitation et des prélèvements privés,une composante des flux de fonds entreprise et privé dans le tableau de financement.Pour calculer le flux de fonds de l’agriculture,il convient de corriger le revenu agricole en soustrayant toutes les opérations comptables sans effets sur les liquidités (amortissements,variation des stocks et des actifs en bétail,autoapprovisionnement,bail calculé pour l’appartement,etc.).
■ Les flux de fonds entreprise et privé et les investissements, à la lumière du cycle d’exploitation
Au fil des années,le flux de fonds de l’agriculture a moins fluctué que le revenu agricole.Les fortes fluctuations enregistrées par le revenu agricole sont dues en premier lieu aux variations de l’inventaire concernant les actifs en bétail et les stocks. C’est surtout la hausse des amortissements qui fait apparaître une plus grande différence entre le flux de fonds et le revenu agricole.
Tant le montant du flux de fonds provenant de des activités interne et externe à l’exploitation que les investissements sont tributaires du cycle d’exploitation et du cycle familial.Les écarts constatés s’expliquent en grande partie par l’âge car les exploitations des quatre classes d’âge représentées se différencient très peu au niveau de la taille et de l’altitude.
Flux monétaires et utilisation selon les classes d'âge 1990/92
moins de 35 ans35–45 ans45–55 ans plus de 55 ans
Age du chef/de la cheffe d'exploitation
Source: dépouillement centralisé, FAT
1.1 ECONOMIE 1 68
Evolution des flux monétaires et revenus fr. par exploitation Flux monétaires agriculture Revenu agricole
dépouillement centralisé, FAT 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 199019911992199319941995199619971998199920002001 2002
Source:
en 1 000 fr. par exploitation
monétaires avant prélèvements
Cash-flow (excédent / manque monétaire avant investissement)
privés Investissements totaux
Flux
privés
Prélèvements
0 120 100 80 60 40 20
Flux monétaires et utilisation selon les classes d'âge 1999/2001
moins de 35 ans35–45 ans45–55 ansplus de 55 ans
Age du chef/de la cheffe d'exploitation
Flux monétaires avant prélèvements privés Cash-flow (excédent / manque monétaire avant investissement)
Prélèvements privés Investissements totaux
Source: dépouillement centralisé, FAT
C’est la classe d’âge des 35–45 ans qui a réalisé pendant la période 1999/2001 les plus importants flux de fonds avant prélèvements privés.Pour les exploitants les plus jeunes et les plus âgés,le montant moindre du flux de fonds avant prélèvements privés est étroitement lié aux frais de main-d’œuvre qui culminent pour ces deux classes d’âge.Ce constat peut s’expliquer par la collaboration accrue tant de la génération qui se retire (avant d’avoir atteint l’âge AVS),dans les entreprises dirigées par des exploitants appartenant à la classe d’âge des – de 35 ans,que des descendants adultes dans les entreprises dirigées par des exploitants plus âgés.Aujourd’hui,ces derniers sont généralement rémunérés comme des employés.Dans la classe des + de 55 ans,le fait qu’il s’agit d’exploitations un peu plus petites en moyenne n’est pas sans importance. Quant aux prélèvements privés,ils sont les plus faibles pour la classe des – de 35 ans. Ceci est vraisemblablement lié à la taille des familles,encore petite dans cette phase de vie,et au coût de la vie,lequel est comparativement moins élevé pour les jeunes enfants.Le montant des investissements décroît au fur et à mesure que l’âge augmente,ce qui permet de déduire que les exploitations ne s’apprêtent généralement à relever de nouveaux défis qu‘après la reprise de l’exploitation.
Par rapport à la période 1990/92,on relève un certain nombre de différences.A cette époque,la taille des exploitations augmentait avec l’âge tandis que,pour la période 1999/2002,c’est le contraire qui se produit.En 1990–1992,les entreprises dirigées par des chefs d’exploitation âgés de moins de 35 ans disposaient de 15,4 ha et possédaient 23,1 UGB alors que,pour la période 1999–2001,elles comptaient une surface de 19,7 ha et possédaient 25,6 UGB.
En 1990/92,le flux de fonds avant prélèvements privés était comparable pour toutes les classes d’âge à partir de 35 ans,alors qu’il a baissé au cours de la période 1999/2001 à partir de la classe d’âge des 35 ans.Cette évolution se reflète également dans les investissements.En 1990/92,ceux-ci étaient pour ainsi dire constants,quelle que soit la classe d’âge considérée,alors que,pendant la période 1999/2001,ils ont sensiblement diminué au fur et à mesure que l’âge augmentait.
1.1 ECONOMIE 1.RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 1 69
0 120 100 80 60 40 20 en 1 000 fr. par exploitation
■ Rassemblement et formation de capitaux, à la lumière du cycle d’exploitation
Le montant et la composition des capitaux investis dans l’exploitation varient considérablement au cours du cycle d’exploitation.
Composition du capital selon les classes d'âge 1990/92
moins de 35 ans35–45 ans
Capital propre
Age du chef / de la cheffe d'exploitation plus de 55 ans
ans
Divers capitaux étrangers à moyen et à long terme
Prêts hypothécaires
Crédits d'investissements
Droit d'habitation
Capital étranger à court terme
Source: dépouillement centralisé, FAT
Composition du capital selon les classes d'âge 1999/2001
moins de 35 ans35–45 ans
Age du chef / de la cheffe d'exploitation plus de 55 ans 45–55 ans
Capital propre
Divers capitaux étrangers à moyen et à long terme
Prêts hypothécaires
Crédits d'investissements
Droit d'habitation
Capital étranger à court terme
Source: dépouillement centralisé, FAT
1.1 ECONOMIE 1 70
45–55
en 1 000 fr. par exploitation
0 800 700 600 500 400 300 200 100
en 1 000 fr. par exploitation
0 800 700 600 500 400 300 200 100
La classe des – de 35 ans affichait en 1999/2001 les fonds propres les plus bas,les capitaux externes les plus élevés et,en même temps,le capital total le plus faible.La classe des 35–45 ans et celle des 45–55 ans disposaient d’un capital total sensiblement plus élevé pour des fonds propres en hausse et une part de capitaux externes en diminution.Quant à la classe des + de 55 ans,le capital total a de nouveau légèrement diminué en raison de la taille des exploitations et des plus faibles investissements opérés.Si les divers capitaux externes empruntés à moyen et à long terme,les crédits d’investissement et les droits d’habitation diminuent,les crédits hypothécaires augmentent au début pour se stabiliser par la suite.Le montant des capitaux externes empruntés à court terme demeure pratiquement inchangé
Par rapport à 1999/2001,on constate pour la période 1990/92 que ce sont avant tout les exploitations se trouvant en début de cycle (groupe des – de 35 ans) qui utilisaient nettement moins de capitaux.Ceci est vraisemblablement dû au fait que ces exploitations étaient plus petites à l’époque qu’aujourd’hui.Contrairement à la période 1999/2001,la dotation en capitaux externes a moins fortement diminué pour toutes les classes d’âges.
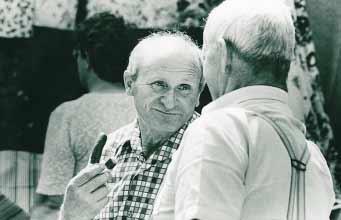
Partant de cette analyse,on ne saurait déceler une tendance selon laquelle les exploitations ne sont plus en mesure d’amortir leurs dettes au cours du cycle d’exploitation.
Facteurs déterminants de la performance des exploitations agricoles suisses
L’Institut d’économie rurale (IER) de l’EPF de Zurich a développé en 2002,sur mandat de l’OFAG,ce qu’il appelle un «Monitoring Tool Performance Schweizer Landwirtschaftsbetriebe».Il s’agit d’un instrument permettant de classer les exploitations agricoles suisses en ce qui concerne leur performance en économie d’entreprise dans des conditions-cadre données et face à la pression concurrentielle qu’elles subiraient dans le contexte européen.
Il ressort des résultats publiés dans le Rapport agricole 2002 que la performance varie fortement selon le groupe d’exploitations et la classe de surface,mais aussi à l’intérieur des groupes d’exploitations.L’IER a approfondi la question en identifiant les facteurs qui déterminent la performance (cf.www.blw.admin.ch).
L’étude de l’IER s’est fondée sur les résultats du dépouillement centralisé des données comptables effectué par la FAT en 2000.1'718 exploitations représentatives de l’agriculture suisse ont formé l’unité d’analyse.
1.1 ECONOMIE 1.RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 1 71
■ Données et méthode
■ Facteurs déterminants
Dans un premier temps,les groupes d’exploitations de l’unité d’analyse ont été subdivisés en dix groupes d’analyse.La deuxième opération a consisté à définir, à l’aide d’analyses statistiques descriptives et à la suite d’entretiens avec des spécialistes,49 facteurs déterminants de la performance.Enfin,la méthode de la régression linéaire multiple a été appliquée afin d’identifier,pour chacun des groupes d’analyse,une série de facteurs déterminants qui influent de manière significative sur la performance.
Performance des groupes d’analyse
Performance en % –8 –6 –4 –202468101214
Transformation sans vaches mères, plaine / collines / zones de montagne 1+2
Culture des champs, plaine
Combinaison lait commercialisé / culture des champs, plaine
Lait commercialisé, plaine
Vaches mères, toutes les régions
Lait commercialisé, collines
Lait commercialisé, zone de montagne 1
Lait commercialisé, zone de montagne 2
Lait commercialisé, zone de montagne 3
Lait commercialisé, zone de montagne 4
Ecart-type
Source: IER
En moyenne,la performance est la plus élevée dans le groupe «transformation sans vaches mères» et la plus basse dans le groupe «lait commercialisé,zone de montagne 4».Elle varie toutefois fortement à l’intérieur des groupes.
L’analyse de régression a permis de sélectionner,parmi les 49 facteurs retenus initialement,29 facteurs ayant une incidence déterminante dans un ou plusieurs groupes d’analyse.
Le tableau précise par des couleurs si un facteur déterminant a une incidence positive (vert) ou négative (gris).Lorsque l’incidence est positive,une hausse de la valeur du facteur concerné conduit à une augmentation de la performance et inversement pour l’incidence négative.Le coefficient de détermination R2 indique la mesure dans laquelle la variance de performance peut être expliquée par le modèle de régression,c’està-dire par la variance des facteurs déterminants.Ce coefficient est généralement supérieur à 80%,ce qui signifie que les différences de performance peuvent pour la plupart être expliquées à l’aide des modèles de régression.
1.1 ECONOMIE 1 72
Facteurs déterminants
Groupes d'analyse
Transf. sans vaches mères, plaine/ collines/zones de montagne 1+2
Nombre d'exploitations
R 2 en %
Nombre de facteurs d é terminants du groupe
Part des frais de main-d' œ uvre au chiffre d'affaires
g é n é raux d'exploitation au chiffre d'affaires
Part des frais
Efficience dans la garde d'animaux
Part des frais de b â timents au chiffre d'affaires
Part des frais de machines au chiffre d'affaires
Part du co û t de travaux effectu é s par des tiers au chiffre d'affaires
Surface fourrag è re principale par animal cons. des fourrages grossiers
Exploitation afferm é e
Part de divers rendements bruts au chiffre d'affaires
laiti è re moyenne
Performance
Garde de porcs
Main-d' œ uvre non familiale
Prairies artificielles
Culture de betteraves sucri è res Frais de main-d' œ uvre moyens par unit é de main-d' œ uvre
Engraissement de veaux
Groupe d'exploitations « volaille »
Garde de volaille
Part des bovins d' é levage aux bovins
Exploitation de for ê t
Garde de bovins destin é s à l'engraissement de gros b é tail
Mode d'exploitation bio
Dreschkulturenanbau?????
Part des paiements directs au chiffre d'affaires
Classe de formation Part d'herbages
Vente directe
Efficience en production v é g é tale
Part de prairies naturelles à la surface fourrag è re principale
Fréquence avec laquelle le facteur est déterminant
R 2: part de la variance de performance pouvant être expliquées par les facteurs déterminants
Source: IER
Le facteur «efficience dans la garde d’animaux» (rendement brut et coûts matériels) est un facteur déterminant de performance positif dans neuf des dix groupes d’analyse, tandis que le facteur «part des frais de main-d’œuvre au chiffre d’affaires» est négatif dans les dix groupes.Les facteurs négatifs ci-après sont également observés assez souvent comme facteurs de performance déterminants: «part des frais généraux d’exploitation au chiffre d’affaires», «part des frais de bâtiments au chiffre d’affaires», «part des frais de machines au chiffre d’affaires» et «part des frais de travaux de tiers au chiffre d’affaires»
1.1 ECONOMIE 1.RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 1 73
Culture des champs, plaine Lait commercialisé, plaine Vaches mères, toutes les régions Lait commercialisé, collines Lait commercialisé, zone de montagne 1 Lait commercialisé, zone de montagne 2 Lait commercialisé, zone de montagne 3 Lait commercialisé, zone de montagne 4 Combinaison lait commercialisé / culture des champs, plaine 70 105 349 217 53 177 263 323 101 60 81 72 85 82 81 82 86 85 87 90 7 7 11 9 4 9 10 9 9 5 109987553222111111111111111111
déterminants de la performance facteur déterminant avec incidence positive facteur déterminant avec incidence négative
Facteurs
■ Frais de main-d’œuvre: principale cause des différences de performance
L’analyse de régression permet notamment de quantifier l’influence des divers facteurs déterminants.Pour faciliter l’interprétation et la représentation graphique des résultats,il est nécessaire de transformer les degrés d’influence des facteurs déterminants d’un groupe d’analyse,qui ont été mesurés statistiquement.A cet effet,on a fixé à 10 la valeur absolue des degrés d’influence additionnés de tous les facteurs déterminants d’un groupe d’analyse.
Les résultats mettent en évidence qu’en Suisse,la productivité du travail (chiffre d’affaires / frais de la main-d’œuvre familiale et non familiale) est la cause principale des différences de performance.
A titre d’exemple,nous exposons ci-après les résultats du groupe d’analyse «combinaison lait commercialisé / culture des champs plaine».Comptant 349 exploitations,ce groupe est le plus grand des dix.On y a identifié onze facteurs déterminants,dont cinq sont positifs et six négatifs.C’est le facteur «part des frais de main-d’œuvre au chiffre d’affaires» qui a de loin la plus forte incidence sur la performance.Le facteur «efficience dans la garde d’animaux» vient en deuxième position.Ces deux facteurs exercent la plus grande influence dans tous les groupes analysés.
Résultats du groupe d’analyse «combinaison lait commercialisé / culture des champs plaine»
–5 –4 –3 –2 –1012
Efficience dans la garde d'animaux
Vente directe
Efficience en production végétale
Main-d'œuvre non familiale
Surface fourragère principale par animal cons. des fourrages gross.
Part des frais de main-d'œuvre au chiffre d'affaires
Part des frais de machines au chiffre d'affaires
Part du coût de travaux effectués par des tiers au chiffre d'affaires
Part des frais généraux d'explo- itation au chiffre d'affaires
Part des frais de bâtiments au chiffre d'affaires
Part de prairies naturelles à la surface fourragère principale
1.1 ECONOMIE 1 74
Incidence:négativepositive
Source: IER
■
Nous résumons ci-après,sous la forme de recommandations,les conclusions que l’on peut tirer des principaux résultats pour améliorer la performance des exploitations.
Notons en passant qu’une augmentation des capacités de production et/ou la conversion à une autre branche principale permettent d’améliorer la performance.Les résultats publiés dans le Rapport agricole 2002 l’ont confirmé
Productivité du travail
L’augmentation de la productivité du travail est le premier objectif à fixer pour améliorer la performance des exploitations agricoles en Suisse.Le potentiel étant plutôt faible en ce qui concerne la hausse du chiffre d’affaires – les prix de la plupart des produits agricoles ne cessent de baisser et les rendements physiques de l’agriculture ont tendance à stagner – le seul moyen d’accroître la productivité du travail est la diminution des frais de main-d’œuvre.
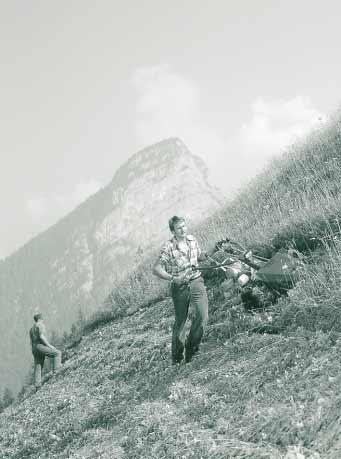
Les exploitations doivent analyser précisément le procédé de production pour chaque produit,afin de pouvoir détecter les points faibles et la manière de réduire les frais de main-d’œuvre.Il se pose souvent la question de savoir s’il est préférable de fabriquer soi-même ou d’acheter («make or buy»).Est-il indiqué d’acheter le produit d’un procédé de production partiel ou un produit en amont ou vaut-il la peine de le fabriquer et de l’offrir soi-même? L’acquisition en commun d’un tel produit est également une option.Pour juger des variantes envisageables,on peut se servir du critère de l’efficience,c’est-à-dire mettre en rapport la quantité ou la valeur commerciale d’une unité du produit en question avec les frais occasionnés (output / input).Pour déterminer les frais de la main-d’œuvre familiale,il faut faire certains choix.Selon le principe des coûts d’opportunité,on peut se fonder sur le salaire horaire versé pour une activité de substitution.Lorsqu’un travail,par exemple l’ensemencement de céréales,est effectué par des tiers,il faut calculer les frais en tenant compte non seulement du montant à payer à l’entreprise mandatée,mais aussi,le cas échéant,des coûts du semoir appartenant à l’exploitant qui n’est alors pas utilisé.L’extensification du travail peut offrir la possibilité de réaliser un gain en engageant ailleurs les capacités de travail libérées de la famille,dans l’exploitation même ou à l’extérieur.
Efficience dans la garde d’animaux et en production végétale
Hormis la productivité du travail,il est aussi possible d’augmenter l’efficience dans la garde d’animaux et la production végétale.La solution consiste là aussi à réduire les intrants (aliments concentrés,engrais,etc.),en l’occurrence les coûts matériels.Mais on peut aussi optimiser l’achat d’équipement en l’organisant au niveau interentreprises,ce qui permet de négocier des prix plus avantageux.Les exploitations commercialisant du lait,quant à elles,peuvent réduire les coûts matériels en passant à une production à faibles intrants.Celle-ci permet parfois aussi de diminuer les frais de main-d’œuvre.
1.1 ECONOMIE 1.RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 1 75
Conclusions
■ Conclusion
Spécialisation
Certains indices portent à croire qu’une concentration des exploitations sur leurs compétences-clés – qui dans le présent contexte peut signifier une orientation de la production conforme aux conditions locales – influe favorablement sur la performance. Il est recommandé d’analyser avec précision les forces et les faiblesses d’une exploitation et d’établir le plan d’exploitation en conséquence.
Charges de structure (sans les frais de main-d’œuvre)
Un désinvestissement est difficile en ce qui concerne les biens immeubles.En revanche, on peut veiller à ce que les bâtiments soient utilisés de manière optimale,en louant par exemple des espaces d’entreposage à d’autres agriculteurs ou à des artisans,pour autant que ce soit conforme à la zone.Les frais de machines peuvent être réduits par une utilisation en commun.Il est éventuellement même plus rentable de vendre certaines machines et de confier les travaux correspondants à des tiers.
Qualification
La formation de la main-d’œuvre peut influer sur la performance,surtout celle du chef ou de la cheffe d’exploitation.Il importe donc que celui-ci ou celle-ci se réserve suffisamment de temps pour se perfectionner et s’informer sur les évolutions récentes.
Ecologisation

L’écologisation de l’agriculture suisse peut également produire un effet positif en matière de performance.Il convient donc d’examiner,pour chaque exploitation,si la conversion à l’agriculture biologique ou à un autre mode de production respectueux de l’environnement et des animaux est suceptible d’augmenter la performance.
L’étude de l’IER sur la performance a permis de confirmer certaines hypothèses et des rapports de cause à effet connus, à l’aide d’une méthode d’analyse statistique et de l’analyse de régression.La conclusion essentielle que l’agriculture suisse peut en tirer est que les gros écarts de performance s’expliquent surtout par les différences concernant la productivité du travail et le plus souvent aussi par les divers degrés d’efficience en production animale.La concentration sur les compétences-clés,la formation et le perfectionnement des chefs et cheffes d’exploitation ainsi qu’une extensification de l’exploitation peuvent également améliorer la performance.
76 1.1 ECONOMIE 1
1.2 Aspects sociaux et société
Les aspects sociaux sont l’un des trois piliers de la durabilité;de ce fait,le rapport sur les répercussions des mesures de politique agricole leur accorde une place à part.Le rapport sur les aspects sociaux dans l’agriculture s’articule en trois domaines:revenu et consommation,relevés périodiques de cinq thématiques sociales prioritaires,études de cas concernant des sujets sociaux.Les aspects de société ont aussi leur importance pour l'agriculture,comme la contribution de cette dernière aux maintien des structures sociales dans le milieu rural.Elles sont traitées au sous-chapitre société.
Le sous-chapitre sur les aspects sociaux ci-après présente des données sur le revenu et la consommation des ménages agricoles,tirées du dépouillement centralisé des données comptables effectué par la FAT,un relevé concernant le domaine de la santé et une analyse de la charge de travail dans l’agriculture.Le sous-chapitre sur la société enfin comprend un passage sur le milieu rural.
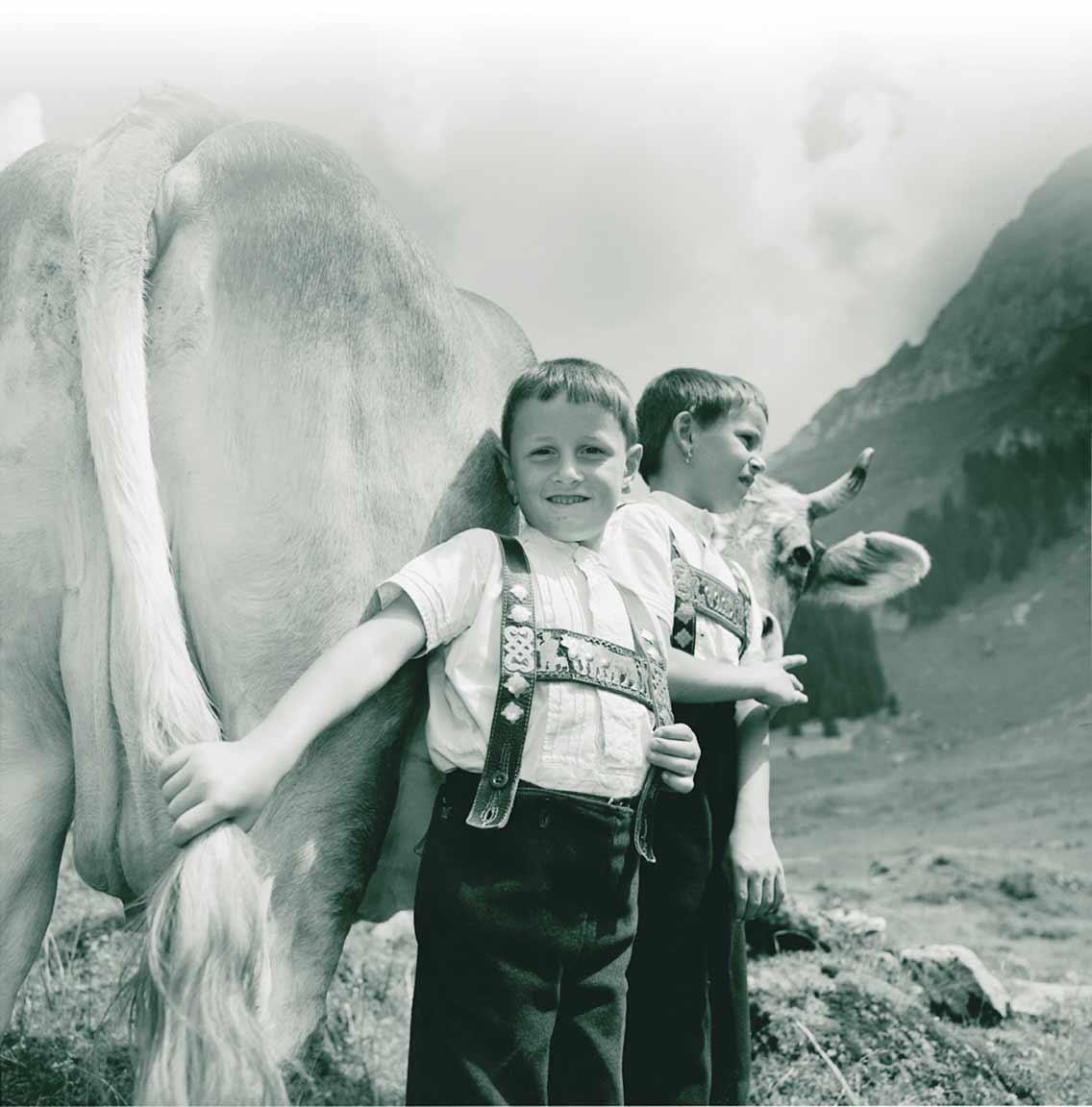
1.2 ASPECTS SOCIAUX ET SOCIÉTÉ 1 77 ■■■■■■■■■■■■■■■■
■ Revenu total et consommation privée
1.2.1Aspects sociaux
Revenu et consommation
Revenu et consommation sont des paramètres importants pour l’appréciation de la situation sociale des familles d’agriculteurs.En ce qui concerne la dimension économique de la durabilité,le revenu est intéressant surtout par rapport à la performance des exploitations.S’agissant de la dimension sociale,l’intérêt se porte avant tout sur la situation du revenu des ménages agricoles.C’est pourquoi le revenu accessoire est pris en compte dans l’analyse.Outre le revenu total,l’évolution de la consommation privée est également suivie.
En moyenne des années 2000 à 2002,le revenu total,qui comprend le revenu agricole et le revenu accessoire,se situait entre 61’500 et près de 85’100 francs par exploitation,selon la région.Les exploitations de montagne ont atteint environ 72% du revenu total de celles de plaine.Source de revenu supplémentaire importante,le revenu accessoire d’entre 17’200 et 20’600 francs a représenté 20% du revenu total des exploitations dans la région plaine,29% dans la région des collines et 32% dans la région de montagne.En chiffres absolus,le revenu accessoire a été le plus élevé dans la région des collines,atteignant 20'600 francs.
Revenu total et consommation privée par exploitation 2000/02
en fr.
0 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000
Selon la région,la consommation privée représente entre 83 et 86% du revenu total; elle est supérieure au revenu agricole.A l’instar du revenu total,elle est,en chiffres absolus,la plus élevée dans la région de plaine et la plus basse dans celle de montagne.
En 2002,le revenu total par exploitation de quelque 70’100 francs en moyenne n’a pas atteint la moyenne des années 1999/2001 (fr.75’800),tandis que la consommation privée a augmenté de 1’350 francs pour passer à 63’200 francs.
1.2 ASPECTS SOCIAUX ET SOCIÉTÉ 1 78 ■■■■■■■■■■■■■■■■
Région de plaineRégion des collinesRégion de montagne Consommation privée Revenu accessoire Revenu agricole
Source: dépouillement centralisé de la FAT
Revenu total et consommation privée par unité de consommation, en fonction des quartiles 1,2000/02
1er quartile2e quartile3e quartile4e quartileEnsemble des ex-
1Quartiles selon le revenu du travail par unité de travail annuel de la famille
2 Unité de consommation = membre de la famille âgé de 16 ans ou plus,participant toute l’année à la consommation de la famille
Source:dépouillement centralisé de la FAT
Dans la période 2000/02,le revenu total par unité de consommation n’a pas suffi à couvrir la consommation des familles dont l’exploitation fait partie du premier quartile. Ces exploitations ont donc dû puiser dans les moyens financiers destinés à des investissements de remplacement, à de nouveaux investissements ou à la prévoyance vieillesse.Leur formation de capital est dès lors négative.En revanche,les dépenses privées ont été inférieures au revenu total pour ce qui est des exploitations classées dans les autres quartiles.Les exploitations du premier quartile ont atteint 43% du revenu total par unité de consommation des exploitations du quatrième quartile.
La consommation privée par unité de consommation a représenté environ 112% du revenu total dans le premier quartile et 68% dans le quatrième.La différence entre les deux quartiles est ainsi nettement plus faible qu’en ce qui concerne le revenu total. En effet,la consommation des exploitations du premier quartile a représenté 71% de celle des exploitations du quatrième quartile.
En 2002,le revenu total par unité de consommation a été inférieur aux trois années précédentes,1999 à 2001,et cela dans tous les quartiles.La différence la plus marquée est enregistrée dans le premier quartile,la plus faible dans le quatrième.Quant à la consommation privée,elle a légèrement fléchi par rapport à la moyenne des années 1999/2001 dans le premier quartile,tandis qu’elle a légèrement augmenté dans les autres,comme les années précédentes.
Une analyse approfondie,notamment des exploitations que le revenu du travail classe dans les quartiles inférieurs,sera présentée dans le prochain rapport agricole.
1.2 ASPECTS SOCIAUX ET SOCIÉTÉ 1 1.RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 79
ploitations Revenu total par UC2 (fr.)13 81917 69322 54431 94821 494 Consommation privée par UC (fr.)15 42916 46718 82221 78418 116
■ Etat de santé général
Santé
L’activité professionnelle a des incidences sur la santé,qui est une des cinq thématiques sociales dont nous faisons le point tous les cinq ans.A cet effet,nous comparons la vie des agriculteurs avec celle des autres groupes de la population en ce qui concerne les avantages et les inconvénients en matière de santé.L’Enquête suisse sur la santé fournit les données nécessaires.
Depuis 1992,l’Enquête suisse sur la santé (ESS) est effectuée tous les cinq ans par l’Office fédéral de la statistique.Elle comprend des données concernant l'état de santé, les habitudes et le comportement de la population qui influent sur la santé,la protection de la santé,les conditions de vie,la sécurité sociale,ainsi que le recours aux prestations de santé publique.En 2002,environ 19’700 personnes choisies au hasard dans l'annuaire téléphonique ont été interrogées,oralement et par écrit.L'univers de base de l’ESS est constitué par les résidents permanents, âgés de 15 ans au moins et vivant dans un ménage privé
Lors de l’ESS 2002,218 agriculteurs et 150 paysannes ont été interrogés.Pour pouvoir comparer les résultats de ce groupe avec ceux des autres groupes de la population,on a attribué à chacun des agriculteurs et à chacune des paysannes,deux personnes du même âge et du même sexe habitant dans la même région,choisie au hasard dans le reste de l’univers de base (env.19'300 personnes).Il en est résulté deux groupes témoins,un comprenant 436 hommes et l’autre 300 femmes.C’est l’analyse de ces groupes qui a conduit aux résultats présentés ci-après.
Il ressort d’études scientifiques que les êtres humains sont capables d’apprécier leur état de santé de manière réaliste.Leur perception subjective permet donc d’apprécier de manière fiable l’état de santé de la population.Les deux facteurs de risque que sont la surcharge pondérale et l’hypertension sont également traités ci-après.
 ■ Enquête suisse sur la santé
■ Enquête suisse sur la santé
1.2 ASPECTS SOCIAUX ET SOCIÉTÉ 1 80
Les hommes du groupe témoin perçoivent un peu plus favorablement leur état de santé que les agriculteurs.En revanche,la perception subjective de leur état de santé par les paysannes est légèrement plus positive que celle du groupe témoin.De manière générale,les femmes considèrent leur état de santé un peu plus défavorablement que les hommes.
L’indice de masse corporelle est le quotient du poids du corps (kg) d’une personne et de sa taille en mètres carrés (m2).Il ressort de la comparaison que les agriculteurs notamment,mais aussi les paysannes,souffrent plus souvent de surpoids que les groupes témoins respectifs.Ils encourent donc un risque plus élevé de souffrir d’une maladie cardio-vasculaire.
Perception subjective de l'état de santé en % moyen mauvais très mauvais Source: OFS AgriculteursGroupe témoin «hommes» PaysannesGroupe témoin «femmes» 0 25 20 10 15 5
Poids (indice de masse corporelle IMC) surpoids (25<=IMC<30) fort surpoids (30<=IMC) 0 70 60 50 30 20 40 10 en % Source: OFS AgriculteursGroupe témoin «hommes» PaysannesGroupe témoin «femmes» 1.2 ASPECTS SOCIAUX ET SOCIÉTÉ 1 1.RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 81
Un tiers environ des paysannes interrogées a une tension artérielle trop élevée;ce chiffre est de 5% supérieur à celui du groupe témoin.Parmi les agriculteurs et dans le groupe témoin,environ 20% sont touchés.Les agriculteurs et les paysannes sont bien plus nombreux que les autres personnes à ne pas connaître leur tension artérielle, peut-être parce qu’ils subissent moins d’examens médicaux préventifs.
L’état émotionnel est une composante importante de la santé psychique.Il se compose des facteurs «abattement», «sérénité», «nervosité» et «optimisme et énergie».Les indications se réfèrent à l’état dans la semaine précédant l’interview.
Tension artérielle ne sais pas hypertension 0 40 35 30 25 15 10 20 5 en %
Source: OFS
AgriculteursGroupe témoin «hommes»
PaysannesGroupe témoin «femmes»
Etat émotionnel (dans la semaine précédant le sondage) moyen bas 0 45 40 35 30 25 15 10 20 5 en %
Source: OFS
AgriculteursGroupe témoin «hommes»
■ Etat de santé psychique 1.2 ASPECTS SOCIAUX ET SOCIÉTÉ 1 82
PaysannesGroupe témoin «femmes»
■ Etat de santé physique
L’état émotionnel des hommes (agriculteurs et groupe témoin) est légèrement meilleur que celui des femmes (paysannes et groupe témoin).L’indice «bas» est moins fréquent chez les agriculteurs (11%) que dans le groupe témoin (15%).Le constat est inverse pour les paysannes et leur groupe témoin (21% et 16%).
Une grande charge de travail peut provoquer des symptômes corporels et psychosomatiques.
Maux de dos ou des reins (dans les quatre semaines précédant le sondage)
Les agriculteurs souffrent davantage de maux de dos ou des reins que les hommes du groupe témoin.Ces maux sont encore légèrement plus fréquents chez les paysannes et les femmes du groupe témoin.C’est parmi les paysannes que la part de personnes ayant de fortes douleurs est la plus élevée (15%).

légers forts 0 50 40 30 10 20 en %
Source: OFS
AgriculteursGroupe témoin «hommes»
PaysannesGroupe témoin «femmes»
1.2 ASPECTS SOCIAUX ET SOCIÉTÉ 1 83
Maux de tête ou de visage (dans les quatre semaines précédant le sondage)
La fréquence de maux de tête est environ la même pour les agriculteurs et le groupe témoin.S’agissant des femmes,les paysannes sont un peu moins touchées que le groupe témoin,dont un tiers s’est plaint de maux de tête.
Faiblesse, fatigue (dans les quatre semaines précédant le sondage)
L'enquête a révélé que les agriculteurs constatent plus souvent de la faiblesse et de la fatigue que le groupe témoin,alors que pour les paysannes et leur groupe témoin,c'est le contraire.Globalement,la faiblesse et la fatigue sont nettement plus marquées chez les femmes que chez les hommes.
1.2 ASPECTS SOCIAUX ET SOCIÉTÉ 1 84
légers forts 0 35 30 25 10 5 15 20 en %
Source: OFS
AgriculteursGroupe témoin «hommes»
PaysannesGroupe témoin «femmes»
légères importantes 0 50 40 45 30 35 10 5 15 20 25 en %
Source: OFS
AgriculteursGroupe témoin «hommes»
PaysannesGroupe témoin «femmes»
■ Comportement favorable à la santé
De forts troubles du sommeil frappent bien moins les agriculteurs (1%) que les hommes du groupe témoin (9%).Ces troubles sont plus fréquents chez les femmes. En effet,environ la moitié des paysannes interrogées et des femmes du groupe témoin ont beaucoup ou quelque peine à s’endormir et mentionnent des insomnies plus ou moins prononcées.Cependant,la part de personnes souffrant fortement d’insomnies est plus faible chez les paysannes que dans le groupe témoin.
Un comportement favorable à la santé, à savoir une alimentation équilibrée et des activités physiques régulières,contribue au bien-être et à la santé et peut atténuer les conséquences d’une maladie.
Souci de l'alimentation
je fais attention à certains aspects
Il est étonnant de constater que 46% seulement des agriculteurs interrogés se préoccupent de leur alimentation;avec 66%,cette part est bien plus élevée dans le groupe témoin.Comme l’on pouvait s’y attendre,les femmes sont plus sensibilisées à ce sujet,en particulier celles du groupe témoin (paysannes:73%;groupe témoin:83%).
1.2 ASPECTS SOCIAUX ET SOCIÉTÉ 1 1.RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 85 Difficultés à s'endormir et insomnies (dans les quatre semaines précédant le sondage) légères fortes 0 50 40 45 30 35 10 5 15 20 25 en %
Source: OFS
AgriculteursGroupe témoin «hommes»
PaysannesGroupe témoin «femmes»
en %
Source: OFS AgriculteursGroupe témoin «hommes» PaysannesGroupe témoin «femmes» 0 90 70 80 60 20 10 30 40 50
appréciation subjective
Les agriculteurs et les paysannes (env.80%) sont bien plus nombreux que les personnes des groupes témoin à répondre par l’affirmative à la question «Pensez-vous que vous pratiquez suffisamment d’activités physiques pour votre santé?»
Les paysannes consomment beaucoup moins souvent de l’alcool que les femmes du groupe témoin.La moitié d’entre elles sont abstinentes,alors que dans le groupe témoin,ce ne sont que 30% et 10% pour les hommes (agriculteurs et groupe témoin). Une consommation fréquente d'alcool (tous les jours ou plusieurs fois par jour) est enregistrée à peu près aussi souvent chez les agriculteurs que dans le groupe témoin, mais moins souvent chez les paysannes que dans leur groupe témoin.
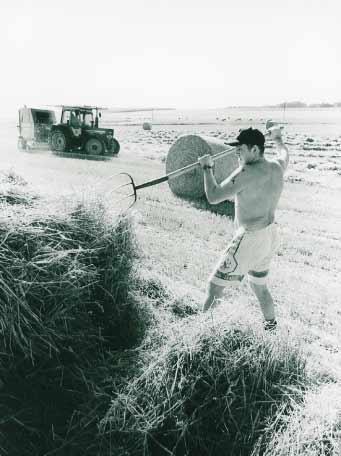
1.2 ASPECTS SOCIAUX ET SOCIÉTÉ 1 86
Mouvement,
j'ai suffisamment de mouvement Source: OFS 0 90 70 80 60 20 10 30 40 50 en %
AgriculteursGroupe témoin «hommes»
Consommation d'alcool 1 fois par jour 2 fois par jour 3 fois par jour ou plus Source: OFS 0 40 30 35 15 25 20 5 10 en % AgriculteursGroupe
PaysannesGroupe témoin «femmes»
témoin «hommes»
PaysannesGroupe témoin «femmes»
■ Recours aux services médicaux et consommation de médicaments
On suppose en général que les agriculteurs vont moins souvent chez le médecin et qu’ils préfèrent les remèdes «de grand-mère» lorsqu’ils ne se sentent pas bien.Pour évaluer le recours aux services médicaux et la consommation de médicaments,on s’est fondé sur le nombre de visites chez le médecin au cours des douze mois précédant l’interview et sur la consommation d’analgésiques pendant la semaine précédant l’interview.
Nombre de visites chez le médecin (dans les douze mois précédant le sondage)
Les résultats de l’enquête ont confirmé la supposition que notamment les agriculteurs se rendent moins facilement chez le médecin que les hommes des autres groupes de la population.
Consommation d'analgésiques (dans la semaine précédant le sondage) environ 1 fois par semaine
La consommation d’analgésiques des agriculteurs est légèrement plus faible que celle du groupe témoin et nettement plus faible que celle du groupe témoin en ce qui concerne les paysannes.90% des hommes interrogés ont affirmé ne jamais prendre d’analgésiques.La consommation la plus élevée a été enregistrée dans le groupe témoin femmes,dont 23% avaient pris des analgésiques pendant la période considérée.
1.2 ASPECTS SOCIAUX ET SOCIÉTÉ 1 1.RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 87
1
4 à
10 visites et plus 0 80 60 70 30 50 40 10 20 en %
à 3 visite(s)
9 visites
Source: OFS
AgriculteursGroupe témoin «hommes» PaysannesGroupe témoin «femmes»
plusieurs
chaque jour 0 25 20 10 15 5 en %
fois par semaine
Source: OFS
AgriculteursGroupe témoin «hommes» PaysannesGroupe témoin «femmes»
■ Conclusion
La santé des agriculteurs et des paysannes diffère sur plusieurs points de celle des autres groupes de la population,les différences positives et négatives étant à peu près équilibrées.Ainsi,les agriculteurs et les paysannes ont plus souvent du surpoids et des maux du dos que les personnes des groupes témoins;ils sont en revanche moins concernés par de fortes insomnies.Les agriculteurs et les paysannes attachent moins d’attention à l’alimentation,mais les paysannes sont bien plus souvent abstinentes ou consomment moins d’alcool que les autres femmes.En comparaison avec les groupes témoins,les agriculteurs vont plus rarement voir un médecin.
Les différences en matière de santé entre les sexes sont les mêmes dans l’agriculture que dans les autres groupes de la population.De manière générale,les femmes considèrent leur état de santé un peu plus défavorablement que les hommes.Les paysannes et les femmes du groupe témoin ont plus fréquemment une tension artérielle trop élevée et souffrent davantage de faiblesse et de fatigue que les hommes.Environ la moitié des femmes ont de la peine à s’endormir et se plaignent d’insomnies,tandis que quelque 70% des hommes ne connaissent pas de troubles du sommeil.La part de femmes ne buvant pas d’alcool est nettement plus élevée.

1.2 ASPECTS SOCIAUX ET SOCIÉTÉ 1 88
■ Postulat Bugnon: Charge de travail et conséquences sociales de la politique agricole
Charge de travail dans l’agriculture
Le 21 juin 2002,le conseiller national Bugnon a déposé un postulat portant le titre «Rapport sur la pénibilité du travail et les conséquences sociales de la nouvelle politique agricole» (02.3355),que le Conseil fédéral a accepté
Postulat Bugnon du 21 juin 2002:libellé
Afin de bien comprendre les effets pervers qu’entraîne la nouvelle politique agricole et pour pouvoir en mesurer les conséquences dans le but d’apporter, le cas échéant,et dans la mesure du possible des solutions à cette problématique, il est important d’en connaître tout d’abord l’ampleur.C’est pourquoi je dépose ce postulat demandant au Conseil fédéral de faire une étude sur la question,ceci de 1990 à nos jours,et de nous fournir un rapport sur le travail effectué et ses conclusions.
Nous traitons ci-après les questions soulevées dans le postulat sous plusieurs angles: d’une part,en montrant l’évolution des heures de travail annuelles dans l’agriculture, à l’aide d’une statistique de l’OFS et,d’autre part,en faisant une comparaison entre diverses branches.Des modélisations de la FAT permettent par ailleurs de déterminer les heures de travail et la charge de travail physique dans plusieurs branches de production et types d’exploitations.Enfin,nous abordons divers aspects sociaux en nous servant à la fois des enquêtes réalisées par l’OFS sur la santé et des recensements de la population.
■ Grand nombre d’heures de travail annuelles dans l’agriculture
La Statistique du volume du travail,que l’OFS établit depuis 1991,renseigne sur les heures de travail annuelles effectives,compte tenu des heures supplémentaires et des absences.
Le nombre annuel des heures effectives de travail des hommes et des femmes travaillant dans l’agriculture et la sylviculture – il n’existe pas de chiffres concernant uniquement l’agriculture – a légèrement diminué entre 1991 et 2001,notamment pour ce qui est du travail à plein temps.Dans les entreprises exploitées à titre accessoire,qui représentaient environ 30% des exploitations tant en 1991 qu’en 2001,la charge en termes d’heures s’est quelque peu accrue pendant cette période.
1.2 ASPECTS SOCIAUX ET SOCIÉTÉ 1 1.RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 89
Heures de travail annuelles d’indépendants dans diverses branches 1
de travail effectives
Alors que le graphique ci-dessus trace,de 1991 à 2001,l’évolution des heures de travail annuelles des hommes et des femmes travaillant dans l’agriculture et la sylviculture en fonction du taux d’occupation,le tableau indique les différences selon le statut d’activité (indépendants) dans les six branches enregistrant le nombre le plus élevé d’heures de travail annuelles.Pendant la période considérée,la durée de travail des agriculteurs et gardes-forestiers indépendants a diminué,en particulier de 1991 à 1996,mais en comparaison avec les autres branches,elle reste la plus élevée. L’hôtellerie et la restauration sont les seuls autres secteurs où la durée du travail est nettement plus longue que dans les autres branches.

1.2 ASPECTS SOCIAUX ET SOCIÉTÉ 1 90
h par personne occup é e 199119962001 Source: OFS 0 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500
Heures de travail annuelles effectives dans l'agriculture et la sylviculture
Hommes plein temps temps partiel
Femmes plein temps temps partiel
Heures annuelles
199119962001 (h par personne occupée) Agriculture et sylviculture2 9242 6632 603 Hôtellerie et restauration2 7392 6492 372 Commerce,réparation d’objets2 0422 0851 985 Construction2 0202 0491 926 Transports et communications2 0041 9372 058 Industries;production d’énergie et d’eau1 9811 8711 996 Total indépendants2 0682 0111 912
Sections économiques
Source:OFS
d’indépendants
1
NOGA (Nomenclature générale des activités économiques)
■ Charge et résistance
Qu’entend-on par charge et par résistance? Du point de vue de l’économie du travail, la première se compose de la charge psychique et de la charge physique;quant à la résistance,elle comprend la volonté et la capacité de performance.Lorsque la charge est supérieure à la résistance,il y a logiquement surcharge et surmenage.Si ces derniers persistent,ils peuvent provoquer une sensibilité accrue à divers facteurs de charge, voire entraîner des difficultés relationnelles et des problèmes de santé
ChargeRésistance
Charge psychiqueManque de résistance (solde)
Davantage de travaux de bureau Surcharge ou surmenage
Faible revenu du travail
Baisse des prix à la productionVolonté de performance
Concurrence accrueAutonomie
Tâches quotidiennes à heures fixes dans la garde d’animauxTravail avec/dans la nature
Nécessité de prendre des décisionsTravail avec la famille
Pénurie d’argentDurabilité du travail
Peur de l’avenirReconnaissance,identité Problèmes relationnelsFoi,espoir etc.etc.
Charge physiqueCapacité de performance
Travail pénible (charge de travail physique)Santé
Posture de travail défavorableCompétence professionnelle
Longues heures de travailCompétence de conduite
Peu de temps pour les loisirs/vacancesCompétence sociale Froid,chaleur,poussière,bruitAptitude à s’autogérer etc.etc.
Source:FAT
Comme dans les autres secteurs économiques,les facteurs de charge psychiques gagnent en importance.Il est toutefois possible d’atténuer l’incidence des facteurs dits «tendres» par une augmentation des compétences correspondantes,c’est-à-dire de la capacité de performance.Ainsi,les exigences de plus en plus élevées en matière de gestion de l’exploitation n’équivalent pas forcément à une charge accrue.Le point de surcharge ou de surmenage est moins vite atteint chez les chefs et cheffes d’exploitation ayant bénéficié d’une bonne formation et/ou étant expérimentés.Ils maîtrisent plus facilement les nouvelles exigences.
La recherche de la FAT en matière d’économie du travail a développé le budget de travail,un instrument important pour apprécier la charge en termes de temps.Il existe par ailleurs,dans le domaine de l’ergonomie,des méthodes de mesure et des valeurs limites pour les facteurs de charge au travail.Ces instruments permettent de quantifier les charges physiques.Par contre,les charges psychiques étant plus complexes,la science du travail n’est pas encore à même d’offrir des auxiliaires et des valeurs de calcul comparables.
1.RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 1.2 ASPECTS SOCIAUX ET SOCIÉTÉ 1 91
Manque de résistance (solde) Surcharge
■ La technique réduit la durée et la charge physique du travail
Le paragraphe suivant traite des heures de travail et de la charge de travail physique dans plusieurs branches de production et divers types d’exploitations.
Les calculs de la durée du travail ont tous été effectués à l’aide du système de modélisation et du budget de travail détaillé développés par la FAT.On y distingue le travail à investir dans les activités directement liées à la production,telles que le labourage et la traite,et les travaux complémentaires concernant des tâches d’entretien et d’organisation.Dans les calculs,on admet que les travaux complémentaires sont constants. Pour calculer la durée du travail dans les années 1990 et 1996,on s’est fondé sur des procédés de travail qui sont représentatifs conformément aux relevés des structures agricoles réalisés par l’OFS.Pour 2001 et pour le pronostic relatif à l’an 2010,on a interogé des experts.
Les sept graphiques ci-dessous montrent le développement technique et l’évolution de la durée du travail dans les branches de production céréales,betteraves sucrières, pommes de terre,cultures fourragères en plaine et en montagne,ainsi que garde de bétail laitier dans des étables à stabulation entravée et à stabulation libre.Pour les quatre années considérées,le nombre d’hectares et de vaches par branche de production est resté inchangé.Quant aux valeurs de référence,elles ont été choisies de sorte à être réalistes tant pour 1990 que pour 2010.
Temps de travail requis pour la culture de céréales h par ha
1990199620012010
Charrue bisoc Herse, 2,5 m
Semoir, 2,5 m
Pulvérisateur, 10 m
Moissonneusebatteuse, 3 m
Paille en balles haute densité et en balles rondes
Charrue trisoc Herse, 3 m Semoir, 3 m
Pulvérisateur, 12 m
Moissonneusebatteuse, 4,5 m
Paille en balles haute densité et en balles rondes
Travaux complémentaires
Céréales
Surface de référence: 11 ha
Charrue trisoc Herse, 3 m
Semoir, 3 m
Pulvérisateur, 15 m
Moissonneusebatteuse, 5 m
Paille en balles haute densité et en balles rondes
Charrue à 4 socs Herse, 3 m
Semoir, 3 m
Pulvérisateur, 18 m
Moissonneusebatteuse, 5 m
Paille en balles haute densité et en balles rondes
Source: FAT
1.2 ASPECTS SOCIAUX ET SOCIÉTÉ 1 92
0 50 40 35 45 20 15 30 25 10 5
h par ha
Temps de travail requis pour la culture de betteraves sucrières
1990199620012010
Charrue bisoc Herse, 2,5 m Semoir à betteraves, 6 rangs
Démariage à la main Pulvérisateur, 10 m Arracheuse à un rang, tractée
Charrue trisoc Herse, 3 m
Semoir à betteraves, 6 rangs
Démariage à la main Pulvérisateur, 12 m
Arracheuse à 2 rangs, tractée
Travaux complémentaires
Betteraves sucrières
Surface de référence: 3 ha
Charrue trisoc Herse, 3 m
Semoir à betteraves, 6 rangs
Semis à la distance définitive
Pulvérisateur, 15 m
Arracheuse à 6 rangs, automotrice
Charrue à 4 socs Herse, 3 m
Semoir à betteraves, 6 rangs
Semis à la distance définitive Pulvérisateur, 18 m
Arracheuse à 6 rangs, automotrice
Temps de travail requis pour la culture de pommes de terre h par ha
Source: FAT
1990199620012010
Charrue bisoc Herse, 2,5 m Planteuse de pommes de terre, 4 rangs, semiautomatique Butteuse, 4 rangs

Pulvérisateur, 10 m
Défaneuse, 1,5 m
Arracheuse à un rang, tractée
Charrue trisoc Herse, 3 m
Planteuse de pommes de terre, 4 rangs, semiautomatique
Butteuse, 4 rangs
Pulvérisateur, 12 m
Défaneuse, 3 m
Arracheuse à un rang, tractée
Travaux complémentaires
Pommes de terre
Surface de référence: 1,7 ha
Charrue trisoc Herse, 3 m
Planteuse de pommes de terre, 2 rangs, automatique
Butteuse, 4 rangs
Pulvérisateur, 15 m
Défaneuse, 3 m
Arracheuse à un rang, tractée
Charrue à 4 socs Herse, 3 m
Planteuse de pommes de terre, 4 rangs, automatique
Butteuse, 4 rangs
Pulvérisateur, 18 m
Défaneuse, 3 m
Arracheuse à 2 rangs, automotrice
Source: FAT
1.RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 1.2 ASPECTS SOCIAUX ET SOCIÉTÉ 1 93
0 180 160 140 120 100 80 60 40 20
0 400 350 300 250 200 150 100 50
Temps de travail requis pour la culture fourragère dans la région de plaine h par ha
1990199620012010
Faucheuse rotative, 1,8 m
Pirouette, 4 m
Giro-andaineur, 2,8 m Autochargeuse 13 m3
Souffleuse avec distributeur téléscopique
Faucheuse rotative, 2,1 m
Pirouette, 5,5 m
Giro-andaineur, 3,5 m
Autochargeuse 15 m3 Installation de dosage, souffleuse avec distributeur téléscopique
Travaux complémentaires
Cultures fourragères
Faucheuse rotative, 2,4 m
Pirouette, 6,5 m
Giro-andaineur, 3,5 m
Autochargeuse 20 m3
Grue à griffe
Faucheuse rotative, 3,5 m
Pirouette, 8,5 m
Giro-andaineur, 9 m
Autochargeuse 30 m3
Grue à griffe
Surface de référence: 20 ha 4 fauches, moyennement intensif, foin ventilé, y compris entretien des prairies et fumure
Source: FAT
Temps de travail requis pour la culture fourragère dans la région de montagne h par ha
1990199620012010
Motofaucheuse, 1,9 m
Pirouette, 4,5 m
Râteau-faneur, 2,8 m
Transporteur, 9 m3
Souffleuse avec distributeur téléscopique
Faucheuse à 2 essieux 2,2 m
Pirouette, 5 m
Râteau-faneur, 2,8 m
Transporteur, 11 m3
Souffleuse avec distributeur téléscopique
Travaux complémentaires
Cultures fourragères
Surface de référence: 25 ha
Déclivité 18–25%, 3 fauches, moyennement intensif, foin ventilé, y compris entretien des prairies et fumure
Faucheuse à 2 essieux 2,5 m
Pirouette, 5 m
Râteau-faneur, 3 m
Transporteur, 15 m3
Souffleuse avec distributeur téléscopique
Faucheuse à 2 essieux 2,8 m
Pirouette, 5 m
Râteau-faneur, 3 m
Transporteur, 18 m3
Grue à griffe
Source: FAT
1.2 ASPECTS SOCIAUX ET SOCIÉTÉ 1 94
0 70 60 50 40 30 20 10
0 80 70 60 50 40 30 20 10
Pour les quatre années considérées,on enregistre un progrès technique dans toutes les branches de production et,partant,un recul du temps de travail nécessaire.Ce recul est particulièrement impressionnant dans la culture des pommes de terre,où l’on passera, selon toute probabilité,d’environ 380 heures par ha en 1990 – la surface de référence étant de 1,7 ha – à 275 heures en 2010.C’est dans la culture de céréales,qui était déjà fortement mécanisée en 1990,que le recul est le plus faible.
Dans la garde du bétail laitier,en plus du temps de travail nécessaire,on a tenu compte de la charge de travail physique à l’aide d’un système de modélisation de la FAT.A cet effet,on a calculé,pour les différentes opérations,la proportion entre le temps du travail manuel à effectuer dans une posture déterminée – il existe en tout 84 codes de posture – et les masses impliquées,les valeurs obtenues étant ensuite additionnées.
Temps requis et charge de travaux manuels pour le bétail laitier en stabulation entravée h par vache t par vache
1990199620012010
Couche courte
Installation de traite à pots 2 unités trayeuses Motofaucheuse, autochargeuse 120 jours de pâture
Alimentation par portions
Préparation du fourrage à la main Distribution du fourrage à la main
Masse par vache: Traite 39 t Affouragement 41 t Evacuation du fumier 0,4 t
Couche courte Installation de traite à pots 2 unités trayeuses Motofaucheuse, autochargeuse 120 jours de pâture
Affouragement à discrétion avec distribution deux fois par jour
Préparation du fourrage à la main Distribution du fourrage à la main
Masse par vache: Traite 39 t Affouragement 41 t Evacuation du fumier 0,4 t
Evacuation du fumier
Affouragement
Travaux complémentaires
Traite
Référence: 20 vaches laitières

Couche courte Installation de traite en lactoduc 2 unités trayeuses Motofaucheuse, autochargeuse 180 jours de pâture
Affouragement à discrétion avec distribution deux fois par jour Grue à griffe
Couche courte Installation de traite en lactoduc 3 unités trayeuses Faucheuse frontale, autochargeuse 180 jours de pâture
Remorque mélangeuse Grue à griffe
Masse par vache: Traite 5 t Affouragement 33 t Evacuation du fumier 0,3 t
Masse par vache: Traite 5 t Affouragement 15 t Evacuation du fumier 0,3 t
Masse par vache
Source: FAT
1.RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 1.2 ASPECTS SOCIAUX ET SOCIÉTÉ 1 95
0 120 100 60 40 80 20 0 120 100 60 40 80 20
■ Temps requis et charge de travaux manuels dans des groupes d’exploitations choisis
Temps requis et charge de travaux manuels pour le bétail laitier en stabulation libre h par vache t par vache
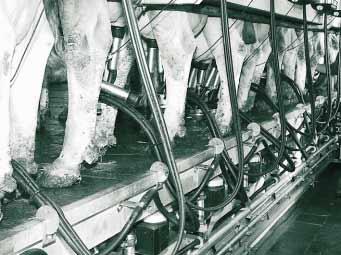
1990199620012010
Stabulation libre à logettes
Salle de traite en épi, 1 x 4 Motofaucheuse, autochargeuse 120 jours de pâture Affouragement par portions Préparation du fourrage à la main Distribution du fourrage à la main
Masse par vache: Traite 3 t Affouragement 33 t Evacuation du fumier 0,4 t
Stabulation libre à logettes
Salle de traite tandem 2 x 2 Motofaucheuse, autochargeuse 170 jours de pâture Affouragement à discrétion avec distribution deux fois par jour Grue à griffe
Masse par vache: Traite 2 t Affouragement 23 t Evacuation du fumier 0,4 t
Evacuation du fumier Affouragement
Travaux complémentaires
Traite
Stabulation libre à logettes
Salle de traite tandem 2 x 2 Faucheuse frontale, autochargeuse 180 jours de pâture Remorque mélangeuse
Stabulation libre à logettes
Salle de traite en épi, 2 x 4 Faucheuse frontale, autochargeuse 180 jours de pâture
Remorque mélangeuse
Masse par vache: Traite 2 t Affouragement 15 t Evacuation du fumier 0,4 t
Masse par vache
Source: FAT Référence: 35 vaches laitières
Dans la branche de production «garde du bétail laitier» également,le temps de travail nécessaire est en recul durant la période d’observation.Grâce au progrès technique,les masses à manipuler physiquement par une unité de main-d’oeuvre en 2010 seront bien plus faibles qu’en 1990 à cheptel égal.Le remplacement de l’installation de traite à pots par une installation en lactoduc réduit de moitié la charge de travail physique dans une étable à stabulation entravée.L’allégement du travail résultant de l’installation d’une salle de traite dans une étable à stabulation libre est encore plus important. C’est l’alimentation des animaux qui requiert l’essentiel du travail physique à fournir et qui permet donc de réaliser les économies les plus substantielles par l’utilisation d’une remorque mélangeuse et par la prolongation des sorties au pâturage.
Quels sont les effets de ces développements techniques sur la charge de travail dans les exploitations? Pour répondre à cette question,on a effectué des modélisations pour les catégories «exploitation moyenne,toutes régions confondues», «exploitation de grandes cultures,région de plaine» et «exploitation commercialisant du lait,région de plaine».Les calculs se fondent sur les données,pondérées,relatives aux structures des exploitations de référence qui sont tirées du dépouillement centralisé des données comptables de la FAT.
1.2 ASPECTS SOCIAUX ET SOCIÉTÉ 1 96
Masse par vache: Traite
Affouragement 6 t Evacuation du fumier 0,4 t 0 120 100 60 40 80 20 0 120 100 60 40 80 20
1 t
Pour le calcul du temps de travail requis dans la garde du bétail laitier,on applique une valeur mixte,en additionnant les parts de vaches gardées respectivement dans des étables à stabulation entravée et à stabulation libre.En 1990,97% des vaches étaient gardées dans des étables à stabulation entravée et 3% dans des étables à stabulation libre,proportion qui passé à 93% contre 7% en 1996 et à 82% contre 18% en 2001. Une proportion de 60% contre 40% est pronostiquée pour 2010.Les opérations de travail ayant servi de base aux calculs sont indiquées dans les figures ci-dessus.
Temps requis «exploitation moyenne, toutes les régions»
1990199620012010
12,7 vaches Masse par troupeau: 811 t
Céréales 2,7 ha
Betteraves sucrières 0,3 ha
Pommes de terre 0,4 ha
Cultures fourragères 10,6 ha
13,2 vaches
Masse par troupeau: 817 t
Céréales 2,8 ha
Betteraves sucrières 0,3 ha Pommes de terre 0,4 ha
Cultures fourragères 12,1 ha
Travail/expl. bétail laitier
Travail/expl. cultures fourragères
Travail/expl. pommes de terre
Travail/expl. betteraves sucrières
Travail/expl. céréales
13,6 vaches
Masse par troupeau: 371 t
Céréales 2,7 ha
Betteraves sucrières 0,4 ha Pommes de terre 0,3 ha
Cultures fourragères 13,5 ha
15,2 vaches
Masse par troupeau: 217 t
Céréales 2,8 ha
Betteraves sucrières 0,5 ha Pommes de terre 0,3 ha
Cultures fourragères 16,5 ha
Source: FAT
Dans une «exploitation moyenne,toutes régions confondues»,une partie importante du temps de travail est consacrée à la traite et à l’alimentation du bétail laitier.Malgré l’accroissement du cheptel,cette partie diminue toutefois au cours des quatre années d’observation grâce au progrès technique.Par contre,dans les cultures fourragères, l’évolution technique ne suffit pas à compenser le surplus de travail résultant de l’extension des surfaces.En 2010,la charge de travail en culture fourragère,dans une exploitation moyenne,se rapprochera ainsi de celle qu’exige la garde de bétail laitier. Si l’évolution structurelle se poursuit au même rythme que ces dix dernières années et que les agriculteurs continuent d’investir dans la technique la plus récente,on peut s’attendre à ce que dans l’ensemble,le temps de travail requis par exploitation diminue légèrement par rapport à 2001.Quant à la charge physique,une nouvelle baisse significative est probable.
1.RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 1.2 ASPECTS SOCIAUX ET SOCIÉTÉ 1 97
h par exploitation
0 3 300 3 000 2 700 2 400 2 100 1 800 1 500 1 200 900 600 300
Temps requis «exploitation de grandes cultures, région de plaine» h
1990199620012010
4,5 vaches
Masse par troupeau: 287 t
Céréales 10,0 ha
Betteraves sucrières
1,7 ha
Pommes de terre 1,1 ha
Cultures fourragères 2,7 ha
4,4 vaches
Masse par troupeau: 272 t
Céréales 9,5 ha
Betteraves sucrières 2,1 ha
Pommes de terre 1,1 ha
Cultures fourragères 3,4 ha
Travail/expl. bétail laitier Travail/expl. cultures fourragères Travail/expl. pommes de terre Travail/expl. betteraves sucrières Travail/expl. céréales
2,9 vaches
Masse par troupeau: 79 t
Céréales 9,5 ha
Betteraves sucrières 2,4 ha
Pommes de terre 1,4 ha

Cultures fourragères 4,2 ha
2 vaches
Masse par troupeau: 29 t
Céréales 11,0 ha
Betteraves sucrières
3,0 ha
Pommes de terre
1,7 ha
Cultures fourragères 5,7 ha
Source: FAT
Le temps de travail qui est nécessaire dans les «exploitations de grandes cultures, région de plaine» a également reculé jusqu’en 2001.Il devrait toutefois légèrement augmenter d’ici à 2010,le progrès technique ne permettant pas de compenser l’extension des surfaces dans toutes les cultures.Cependant,en comparaison des autres types d’exploitations,le temps de travail requis demeure dans l’ensemble à un niveau nettement inférieur.
par
exploitation
0 3 300 3 000 2 700 2 400 2 100 1 800 1 500 1 200 900 600 300
1.2 ASPECTS SOCIAUX ET SOCIÉTÉ 1 98
L’examen des «exploitations commercialisant du lait» se limite à celles situées en plaine,car dans la région de montagne,il faudrait prendre en compte les travaux liés à l’estivage du bétail.Or,il manque des données suffisamment précises à cet égard.
Temps requis «exploitation commercialisant du lait, région de plaine»
1990199620012010
18,3 vaches
Masse par troupeau: 1168 t par vache: traite 39 t affouragement 24 t évacuation du fumier 0,4 t
Céréales 0,65 ha
Betteraves sucrières 0,02 ha
Pommes de terre 0,04 ha
Cultures fourragères 12,04 ha
19,3 vaches
Masse par troupeau: 1195 t par vache: traite 37 t affouragement 24 t évacuation du fumier 0,4 t
Céréales 0,80 ha
Betteraves sucrières 0,03 ha
Pommes de terre 0,06 ha
Cultures fourragères 13,79 ha
Travail/expl. évacuation du fumier
Travail/expl. affouragement
21,7 vaches
Masse par troupeau: 590 t par vache: traite 5 t affouragement 22 t évacuation du fumier 0,4 t
Céréales 0,94 ha
Betteraves sucrières 0,04 ha
Pommes de terre 0,05 ha
Cultures fourragères 15,37 ha
Travail/expl. travaux complémentaires Travail/expl. traite Travail/expl. cultures fourragères
26,5 vaches
Masse par troupeau: 380 t par vache: traite 4 t affouragement 10 t évacuation du fumier 0,4 t
Céréales 1,20 ha
Betteraves sucrières 0,06 ha
Pommes de terre 0,05 ha
Cultures fourragères 18,50 ha
Travail/expl. pommes de terre Travail/expl. betteraves sucrières Travail/expl. céréales
Source: FAT
Le temps de travail requis dans les «exploitations commercialisant du lait,région de plaine» est de loin le plus élevé de tous les types d’exploitations.Comme on s’en doutait,c’est la garde du bétail laitier qui occasionne le plus de travail.Globalement, le temps de travail a quelque peu diminué depuis 1996,malgré l’accroissement du cheptel.Les raisons en sont,d’une part,la mise à profit systématique du progrès technique et,d’autre part,la garde plus fréquente des vaches laitières en stabulation libre.D’ici à 2010,on s’attend à ce qu’environ 40% des vaches laitières soient gardées dans ce type d’étable,l’effectif moyen étant de 30 vaches.Les exploitations pourront ainsi sensiblement s’agrandir sans devoir assumer davantage de travail et bénéficiant même d’une réduction considérable de la charge physique.
h par exploitation
0 3 300 3 000 2 700 2 400 2 100 1 800 1 500 1 200 900 600 300 1.RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 1.2 ASPECTS SOCIAUX ET SOCIÉTÉ 1 99
■ Evolution récente sur les plans de la santé et du social
Ces dernières années,l’agriculture a subi une pression économique croissante.Il nous intéresse donc de savoir si les changements intervenus dans la charge professionnelle des agriculteurs et des paysannes se répercutent sur la santé et les conditions sociales. Les données proviennent des enquêtes suisses sur la santé (1992,1997 et 2002) et des recensements de la population (1970,1980,1990 et 2000) effectués par l'OFS.
Perception subjective de l'état de santé
Bien que la part d’agriculteurs considérant leur état de santé comme moyen,mauvais ou très mauvais ait continuellement diminué au cours des dix dernières années,ils perçoivent encore leur état de santé moins favorablement que les autres hommes,dont l’appréciation est restée stable depuis 1992.
1.2 ASPECTS SOCIAUX ET SOCIÉTÉ 1 100
en % moyen mauvais très mauvais
Source: OFS
199219972002199219972002 0 20 10 15 5
AgriculteursGroupe témoin «hommes»
en % moyen mauvais très mauvais
Perception subjective de l'état de santé
Source: OFS
199219972002199219972002 0 30 10 15 20 25 5
PaysannesGroupe témoin «femmes»
Contrairement aux agriculteurs,ce sont les paysannes qui,parmi les femmes,jugent leur état de santé plus favorablement.Si en 1997,tant les paysannes que les femmes du groupe témoin avaient considéré subjectivement leur état de santé comme moins bon qu'en 1992 et 2002,l’appréciation «très mauvais» est néanmoins extrêmement rare chez les paysannes.
En 1992,33% des agriculteurs interrogés ont indiqué avoir été abattus au moins un jour pendant la semaine qui précédait l'enquête;en 2002,ils étaient 28% à donner cette réponse.Dans le groupe témoin,cette part a diminué de manière similaire, passant de 28% en 1992 à 24% en 2002.
S’agissant des paysannes,39% d’entre elles ont souffert d’abattement au moins un jour pendant la semaine précédant l’enquête en 1992 et 31% en 2002.Dans le groupe témoin,ce chiffre a passé de 31% à 25% pendant la même
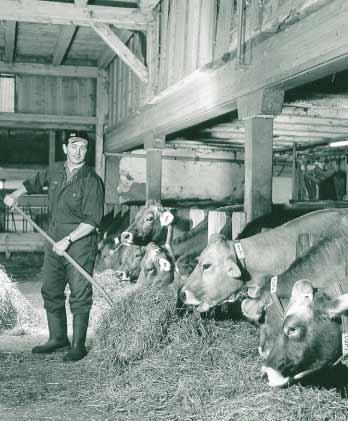
1.2 ASPECTS SOCIAUX ET SOCIÉTÉ 1 1.RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 101
période.
en %
Abattement (dans la semaine précédant le sondage) 199219972002199219972002 0
1 35 30 15
ou 2 jour(s) par semaine 25 20 5 10
3
ou 4 jours par semaine pratiquement chaque jour
Source:
OFS
AgriculteursGroupe témoin «hommes»
en %
Abattement (dans la semaine précédant le sondage)
1
ou 2 jour(s) par semaine
3
ou 4 jours par semaine pratiquement chaque jour Source: OFS
199219972002199219972002 0 40 35 30 15 25 20 5 10
PaysannesGroupe témoin «femmes»
Difficultés à s'endormir et insomnies (dans les quatre semaines précédant le sondage)
Chez les agriculteurs,les fortes insomnies ont diminué entre 1992 et 2002,tandis qu’elles ont plutôt augmenté dans le groupe témoin.
Difficultés à s'endormir et insomnies (dans les quatre semaines précédant le sondage)
En ce qui concerne les paysannes et les femmes du groupe témoin,on a surtout observé une augmentation des insomnies légères en 1997 par rapport à 1992,mais cette tendance s’est inversée par la suite.En 2002,presque 50% des femmes interrogées ont toutefois indiqué souffrir de troubles du sommeil,10 à 15% même de fortes insomnies.
1.2 ASPECTS SOCIAUX ET SOCIÉTÉ 1 102
en % légères fortes Source:
AgriculteursGroupe
199219972002199219972002 0 35 30 15 25 20 5 10
OFS
témoin «hommes»
en % légères fortes
PaysannesGroupe
199219972002199219972002 0 70 60 30 50 40 10 20
Source: OFS
témoin «femmes»
De 1992 à 2002,la consommation d’alcool des agriculteurs a légèrement augmenté, tandis qu’elle a légèrement reculé dans le groupe témoin;elle ne différait plus guère entre les deux groupes en 2002.
Le nombre de paysannes ne buvant jamais d’alcool a sensiblement augmenté, à 50% en 2002.On observe la même tendance dans le groupe témoin,mais à un niveau inférieur.
1.2 ASPECTS SOCIAUX ET SOCIÉTÉ 1 1.RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 103 Consommation d'alcool en % 1 fois par jour 2 fois par jour 3 fois par jour ou plus Source: OFS AgriculteursGroupe témoin «hommes» 199219972002199219972002 0 40 35 30 15 25 20 5 10
Consommation d'alcool en % 1 fois par jour 2 fois par jour 3 fois par jour ou plus Source: OFS PaysannesGroupe témoin «femmes» 199219972002199219972002 0 15 5 10
La situation professionnelle et une charge de travail élevée peuvent restreindre l’intégration sociale.En l’occurrence,la participation à la vie sociale est mesurée par le biais de la vie associative.
Les agriculteurs participent un peu moins à la vie associative que les autres hommes. Environ la moitié d’entre eux a indiqué être membre d’une association,tant en 1992 qu’en 2002.Dans le groupe témoin,la part de ceux qui était membre d’une association a légèrement diminué entre 1992 et 2002.
associative 50 40 30 10
20
Participation à la vie PaysannesGroupe témoin «femmes» 199219972002199219972002 0

1.2 ASPECTS SOCIAUX ET SOCIÉTÉ 1 104 Participation à la vie associative en % Plus rarement Environ 1 fois par mois Environ 1 fois par semaine Participation presque quotidienne Source: OFS AgriculteursGroupe témoin «hommes» 199219972002199219972002 0 60 50 40 30 10 20
Les femmes font moins souvent partie d’une association que les hommes.Chez les paysannes,elles étaient 45% à indiquer une affiliation en 1992 et 37% en 2002.Dans le groupe témoin,cette part a passé de 29% à 31% pendant la même période.Les paysannes sont par ailleurs plus actives dans la vie associative que les femmes des autres groupes de la population. en % Plus rarement Environ 1 fois par mois Environ 1 fois par semaine Participation presque quotidienne Source: OFS
Divorces dans l’agriculture
Le taux des divorces n’est pas établi par profession;cependant,on peut procéder à une analyse des recensements de la population sur la base des catégories de professions et de l’état civil.
Nombre d’hommes divorcés 1970198019902000
Agriculteurs409532799951
Le nombre d’agriculteurs divorcés a continuellement augmenté depuis 1970,mais on ne constate pas une augmentation particulière entre 1990 et 2000,suite à la riforme agricole.La part des agriculteurs divorcés est nettement plus faible en comparaison aux autres hommes actifs:2% contre 6% en 2000.
Le temps de travail requis par ha a diminué sensiblement entre 1990 et 2001 et diminuera probablement encore d’ici à 2010 pour tous les processus liés à la culture des champs et à la culture fourragère.S’agissant des travaux à la ferme,on constate une diminution marquante du temps de travail par vache laitière.Les études montrent également qu’en moyenne,le temps de travail est resté quasiment stable,malgré la croissance des exploitations.La situation peut toutefois être bien différente dans certains cas.Ainsi,l’agrandissement peut faire considérablement augmenter le temps de travail à investir,s’il ne s’accompagne pas d’adaptations techniques ou organisationnelles (engagement d’un entrepreneur de travaux agricoles,abandon d’une autre branche de production,etc.).La charge de travaux manuels,aussi bien par vache que par exploitation,a également évolué à la baisse entre 1990 et 2001.Cette tendance devrait se poursuivre jusqu’en 2010.La charge de travail physique s’est ainsi allégée au cours des dix dernières années.Globalement,grâce au progrès technique,la croissance des exploitations due à l’évolution structurelle ne devrait,en moyenne,pas faire augmenter la durée de travail d’ici à 2010;de même,on peut s’attendre à ce que la charge de travail physique de l’agriculteur continue de diminuer.
L’évaluation des données tirées des enquêtes sur la santé montrent que l’état de santé des agriculteurs et des paysannes s’est plutôt amélioré dans l’ensemble.Ainsi,les agriculteurs se sont sentis en meilleure santé en 2002 qu’il y a dix ans.Il en va de même pour ce qui est des indicateurs qui représentent l'état psychique,les résultats étant meilleurs qu’en 1992 autant chez les agriculteurs que chez les paysannes.Les enquêtes ont par ailleurs révélé qu’en 2002,les agriculteurs participaient encore aussi souvent à la vie publique,en l’occurrence à la vie associative,que dix ans auparavant, alors qu’on observe une tendance au recul en ce qui concerne les paysannes.Ces dernières sont néanmoins plus souvent affiliées à une association que les femmes du groupe témoin.Le nombre d’agriculteurs divorcés s’est constamment accru depuis 1970,mais on n’observe pas d’augmentation particulière,attribuable à la réforme agricole,dans les années nonante.
1.2 ASPECTS SOCIAUX ET SOCIÉTÉ 1 1.RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 105
Autres hommes actifs 35 68469 464100 558124 919 Source:Recensements de la population
■ Conclusion concernant la charge de travail
1.2.2Société
Milieu rural
Ces dernières années ont révélé que les concepts,les mesures et les instruments concernant le milieu rural (comme le service public,la nouvelle politique régionale,la politique agricole) suscitaient un vif intérêt dans l’opinion publique et donnaient lieu à un débat approfondi.Pourtant,il n’existe pas à proprement parler de «politique du milieu rural» à la fois globale et consistante,mais plutôt une palette de politiques ciblées par secteur ou par matière qui,toutes,influent à des degrés divers sur le développement de cet espace.Dans le rapport «Politique des agglomérations de la Confédération» paru fin 2001,le Conseil fédéral a souligné qu’il entendait dorénavant promouvoir davantage le développement durable des agglomérations suisses.Le projet a démarré entre-temps,lançant par là-même un défi aux acteurs du milieu rural pour qu’ils formulent une politique à partir d’une approche globale pour ces régions.
Parmi les facteurs qui ont profondément transformé les conditions-cadre économiques au cours des dernières décennies figurent les innovations technologiques,la baisse des coûts liés à la mobilité,ainsi que la mondialisation qui est allée de pair avec une libéralisation des marchés.Conséquences de cette évolution:les frontières sont devenues plus perméables,les marchés plus vastes,la concurrence plus vive entre les entreprises et les sites de production,tandis que l’efficacité et l’innovation se muaient en diktat et que l’autonomie nationale perdait du terrain.Ces défis lancés aux économies dans leur ensemble concernent aussi les milieux ruraux.En effet,c’est là qu’ils apparaissent parfois de façon plus accentuée,d’autant que l’économie de ces régions se caractérise plutôt par une faible valeur ajoutée et par de petites structures.La pression migratoire augmente,et ce sont avant tout les jeunes et les personnes qualifiées qui,faute d’alternatives sur le marché du travail,partent définitivement ou choisissent de faire la navette entre leurs lieux de travail et de domicile.Les disparités se renforcent entre les centres et la périphérie,tandis que l’abolition des monopoles étatiques ou paraétatiques modifie l’offre de l’approvisionnement de base.A cela s’ajoutent les glissements intervenus dans les structures démographiques et qui se traduisent par un certain vieillissement de la population.D’où un risque de déstabilisation des structures villageoises et des valeurs socio-culturelles qui s’y rattachent.De son côté,la mutation des structures agricoles a un impact sur les entreprises artisanales en amont et en aval, de même que sur l’habitat et le paysage:bâtiments d’exploitation vides et inutilisés, surfaces agricoles abandonnées.Bref,la dispersion des constructions et la destruction du paysage continuent,notamment dans les régions proches des agglomérations ou présentant un attrait touristique.
Pour relever ces défis,la Confédération a récemment mis en chantier plusieurs révisions de texte et entrepris de nombreuses réformes.Quelques unes ont d’ores et déjà été menées à bonne fin et entrent en vigueur.
1.2 ASPECTS SOCIAUX ET SOCIÉTÉ 1 106 ■■■■■■■■■■■■■■■■
■ Le milieu rural et ses enjeux
■ Premières réactions
Projets en cours ou achevés
DomaineObjectifRemarques
Politique régionale
NPR = nouvelle politique régionale
Changement de stratégie:redistribution interrégionale abandonnée au profit d’une promotion de la compétitivité des régions.Le but recherché est d’orienter dorénavant la politique régionale vers des programmes et des projets qui soutiennent le patronat et l’innovation dans les régions.Il faut veiller à ce que le milieu rural et les régions de montagne profitent davantage de la dynamique générée par les puissants centres nationaux et régionaux.
Etat des travaux (automne 2003)
Rapport d’experts: publié le 6 février 2003.
Préparation d’un message au Parlement en 2004.
Forêt / politique forestière
WAP = programme forestier
Péréquation financière
NPF = nouvelle péréquation financière
Le WAP doit décrire comment se présentera la forêt en 2015 grâce aux mesures prises par l’Etat. Des mesures concrètes de l’Etat seront définies en vue de la mise en œuvre du programme.
La NPF a pour but de démêler de manière judicieuse et autant que faire se peut l’écheveau des tâches,des compétences et des flux financiers entre la Confédération et les cantons.Les responsabilités de part et d’autre doivent être clarifiées selon le principe de subsidiarité et le principe de l’équivalence fiscale.L’objectif visé consiste à renforcer la Confédération et les cantons en attribuant à chaque niveau étatique les tâches qu’elle/ils remplissent le mieux.
Fin 2003:l’OFEFP soumettra au chef du département le rapport final avec les propositions de mesures correspondantes.
Procédure en deux étapes: – 1er message du Conseil fédéral (14 novembre 2001) concernant la réforme de la péréquation financière (NPF) et la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons,ainsi que toutes les révisions de la Constitution et la révision totale de la loi fédérale concernant la péréquation financière (LPF).Débats parlementaires en cours – 2e message concernant la NPF avec les adaptations apportées à d’autres lois fédérales (en suspens).
Agriculture
Politique agricole 2007
En adoptant les révisions relatives à la Politique agricole 2007,le Conseil fédéral poursuit résolument les réformes initiées dans les années nonante.Les mesures de politique agricole seront optimisées dans la perspective des nouveaux défis,pour créer les conditions permettant d’améliorer encore la compétitivité de l’agriculture.
Révision de la LAgr:achevée (20 juin 2003).
La LAgr révisée entrera en vigueur le 1er janvier 2004.
1.2 ASPECTS SOCIAUX ET SOCIÉTÉ 1 1.RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 107
Projets en cours ou achevés
DomaineObjectifRemarques
Tourisme
InnoTour
Pour encourager l’innovation et la coopération dans le tourisme,un crédit d’engagement de 35 millions de francs a été alloué pour la période 2003–2007.L’arrêté fédéral d’octobre 1997 encourageant l’innovation et la coopération dans le tourisme vise à adapter aussi vite que possible et de manière ciblée l’offre touristique de la Suisse aux nouvelles conditions du marché mondial. Combinées,la concurrence et la coopération doivent engendrer des innovations et déboucher sur de nouvelles structures.
Etat des travaux (automne 2003)
Message du Conseil fédéral: 20 septembre 2002.
Débats parlementaires achevés.
Environnement
Nouveau concept de parcs
Révision partielle de la loi sur la protection de la nature et du paysage (LPN):dans plusieurs régions,la population,des communes et des collectivités régionales examinent à l’heure actuelle la création de parcs naturels et paysagers. Ce faisant,elles entendent protéger et entretenir des milieux précieux et intégrer dans les circuits économiques régionaux les paysages d’une beauté particulière pour les proposer sur le marché de l’éco-tourisme.
Consultation achevée.
L’OFEFP prépare un message concernant la révision de la loi (automne 2003).
Aménagement du territoire
Révision partielle de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (OAT)
L’OAT est complétée par un article qui précise dans quelle mesure des bâtiments d’habitation initialement utilisés à des fins agricoles pourront être transformés en habitations sans rapport avec l’agriculture.
Entrée en vigueur au 1er juillet 2003

1.2 ASPECTS SOCIAUX ET SOCIÉTÉ 1 108
■ Il n’existe pas de définition du milieu rural
Lorsque l’on évoque le milieu rural,les avis sont unanimes.Tous,nous voulons jouir d’un milieu rural qui soit intact sur les plans économique, écologique,social et culturel et offre un cadre de vie agréable.Marqués par leur appartenance géographique,historique,culturelle et économique,les divers espaces de la Suisse se distinguent par une étonnante diversité.Mais la question demeure:Qu'est-ce que le «milieu rural»?
Impossible d’en donner une définition uniforme,applicable à toutes les régions du milieu rural.Ni la densité de la population ou des emplois,ni la proximité des centres ou la qualité des réseaux de transport et de communication sont des critères suffisants pour le définir de manière univoque.De même,l’approche qui,selon la statistique des agglomérations,consiste à définir le milieu rural comme milieu non urbain et comme grandeur résiduelle est réductrice,car elle ignore la dynamique,la diversité et l’autonomie du milieu rural.L’extrême diversité des activités et les divers niveaux du développement économique en Suisse laissent supposer qu’il n’existe pas un milieu rural mais plusieurs milieux ruraux différents.Ceci s’explique par l’histoire,l’évolution démographique,la situation géographique,le caractère du paysage,la structure d’implantation, le mode d’exploitation agricole,la structure économique non agraire,l’imbrication des flux pendulaires,les langues,les traditions et les mentalités des gens vivant ici.
■ ...pas plus qu’il n’existe une coordination des nombreuses politiques en faveur du milieu rural
Presque chaque politique influe directement ou indirectement sur le milieu rural. Quelques textes légaux sont même explicitement liés à un seul champ d’application territorial.Les politiques sectorielles,en particulier,dans l’agriculture et la sylviculture, le tourisme,la protection de la nature et du paysage mettent l’accent sur les surfaces. A cela s’ajoutent les politiques ciblées sur une matière comme l’aménagement du territoire,la politique régionale ou la politique des transports ainsi que la péréquation financière.Par ailleurs,les unités territoriales telles que les cantons et les communes possèdent des compétences étendues en matière de réglementation (p.ex.impôts et promotion économique).Il en résulte un système très complexe de politiques régionales et autres qui se complètent,se recoupent,se concurrencent et se contredisent aussi parfois.Autre facteur aggravant:les tendances affichées par le développement territorial ces dernières années qui ignore les barrières institutionnelles;en d’autres termes,la partition politique du territoire et les réalités socio-économiques et spatiales évoluent en sens contraire.De toute évidence,des mesures s’imposent,notamment dans la coordination des politiques importantes sur le plan territorial,et ce tant du point de vue horizontal (au sein des agglomérations) que vertical (entre la Confédération,les cantons et les villes,voire les communes).
■ Le milieu rural et ses atouts
Le milieu rural n’est pas seulement un fournisseur de matières premières ou un simple arrière-pays pour les citadins en mal de repos.Bien au contraire,il s’entend comme un espace complémentaire qui est doté de nombreux atouts pour faire face aux défis évoqués précédemment.Le milieu rural a donc une chance de se développer de manière dynamique sans être contraint de reproduire le schéma des grandes villes et de leurs environs.D’où la nécessité de se montrer créatif tant dans le développement continu de structures typiques propres aux régions que dans la mobilisation des forces endogènes.De même,il convient de tirer parti des formes de coopération possibles avec les villes et les agglomérations.
1.2 ASPECTS SOCIAUX ET SOCIÉTÉ 1 1.RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 109
■ Un axe d’action de la PA 2007:renforcer le milieu rural!
Le développement du milieu rural ne peut se faire sans l’agriculture qui,de loin,représente le premier utilisateur des surfaces en Suisse.Mais en même temps l’agriculture est dépassée pour créer toute seule une dynamique économique en milieu rural.Selon les régions,le secteur agricole offre entre 2 et 10% des emplois seulement.Aussi le développement agricole doit-il être perçu comme une tâche complexe qui dépasse le cadre de la seule agriculture.
L’un des axes d’action considérés lors de la révision de la LAgr (voir aussi le chapitre sur la Politique agricole 2007) consiste à renforcer le milieu rural.De fait,il a été décidé d’élargir les possibilités d’encouragement – notamment dans le domaine des améliorations structurelles – de manière à pouvoir générer une valeur ajoutée tant au niveau local que régional.Sont également envisagées des coopérations avec différents secteurs comme le tourisme,les arts et métiers,l’artisanat,les services,etc.
■ Réseau fédéral: développement du milieu rural

C’est au niveau fédéral que la «Politique du milieu rural» est approfondie.La création d’un réseau,qui a débuté au printemps 2003,tente d’améliorer la coordination des politiques importantes à cet égard et,ainsi,d’assurer une cohérence au sein du milieu rural.Ce réseau se conçoit comme une plate-forme destinée à promouvoir l’information entre les services fédéraux.Il entend être à l’écoute du milieu rural et intégrer ses attentes dans une approche globale.Par ailleurs,il a pour but de nouer des contacts avec les représentants des cantons,des régions et des organisations.
Le réseau est placé sous l’égide de la Conférence sur l’aménagement du territoire de la Confédération (CAT) qui,en tant qu’organe supra-départemental et supra-office, s’occupe des questions d’information et de coordination de la politique d’organisation du territoire.Elle réunit des représentants de toutes les entités administratives auxquelles ont été confiées des tâches qui,au sens large du terme,peuvent être considérées comme importantes pour la politique d’organisation du territoire.Comme l’exécution de ces tâches est toujours étroitement liée aux aspects financiers,un représentant du Département fédéral des finances (DFF) figure également parmi les membres de la CAT.La CAT est dirigée en commun par les services spécialisées du Secrétariat à l’économie (seco) et de l’Office fédéral du développement territorial (ODT),lesquels sont compétents en matière de politique régionale et d’aménagement du territoire.
1.2 ASPECTS SOCIAUX ET SOCIÉTÉ 1 110
1.3 Ecologie et éthologie
1.3.1 Ecologie
Le présent rapport agricole approfondit,outre les données de base concernant l’utilisation du sol et les moyens de production,les sujets climat,air et énergie.Chaque année,les activités humaines émettent dans l’atmosphère de grandes quantités de gaz,d’aérosols et de poussières plus ou moins nocifs.Cela a conduit,depuis les années cinquante surtout,à une pollution considérable et persistante de l’environnement, laquelle a des répercussions sur l’homme,les animaux et les plantes.La majeure partie des nuisances provient des domaines trafic,chauffages,industrie,artisanat,agriculture et ménages.Selon la substance nocive,le pourcentage de chacun de ces domaines dans la totalité des émissions varie beaucoup.
L’agriculture est la principale source d’ammoniac (NH3),de méthane (CH4) et de gaz hilarant (N2O),mais aussi de poussières fines dont le volume est inférieur à 10 µm (PM 10).L’impact de CH4 et N2O,gaz à effet de serre,leurs sources et les mesures prises pour les réduire sont décrits en détail dans le chapitre sur le climat.Les émissions de NH3 ainsi que celles de suie du diesel (notamment des tracteurs) ont un lien direct avec la formation dans l’air de poussières fines toxiques portant atteinte à l’environnement (PM 10).Des informations à ce sujet figurent dans le chapitre sur l’air.Le chapitre sur l’énergie est consacré à la consommation et à l’exploitation des ressources énergétiques.

■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■
1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 111
Utilisation des terres et moyens de production
Le mode d’utilisation des terres et des moyens de production fournit des indications sur les développements dans la production agricole qui ont des effets sur l’environnement. On ne saurait toutefois en déduire l’impact environnemental de cette production.
Evolution de la part de surface exploitée selon des modes ménageant le sol
en % de la SAU exploitation respecteuse de l'environnement 1 dont bio Source: OFAG 1 1993 à 1998: PI + bio; dès 1999: PER 1993199419951996199719981999200020012002 0 100 80 60 40 20 Evolution des surfaces de compensation écologique 1 1993199419951996199719981999200020012002200320042005 en 1 000 ha ZM III – ZM IV ZM I – ZM II ZGC – ZC Source: OFAG 1 sans les arbres fruitiers haute-tige 0 120 100 80 60 40 20 Objectif après PA 2007: 108 000 ha au total 1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 112

Evolution des effectifs d'animaux 19901996199719981999200020012002 en 1 000 UGB 1 Autres Porcs Bovins Source: OFS 1 UGB: unité de gros bétail 0 1 600 1 200 800 400 Evolution de l'utilisation d'engrais minéraux en 1 000 t N (charge)P205 (charge) Source: USP 1990/9219941996199820002002 0 80 70 60 50 30 40 20 10 1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 113
1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 114 Evolution des importations d'aliments concentrés en 1 000 t Source: USP 1990 0 600 700 500 400 200 300 100 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Evolution des ventes de produits phytosanitaires en t Source: Société suisse de l'industrie chimique 1990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005 0 2 500 2 000 1 500 1 000 500 Objectif selon politique agr.: env. 1 500 t
■ L’effet de serre naturel est vital

Climat




La température sur la Terre dépend de l’effet de serre naturel.Les ondes courtes du rayonnement solaire pénètrent dans l’atmosphère terrestre en rencontrant relativement peu d’obstacles.La surface terrestre absorbe ces ondes courtes et les renvoie dans l’atmosphère,en partie sous forme d’ondes longues (rayonnement thermique). Vapeur d’eau (H2O),dioxyde de carbone (CO2),méthane (CH4),gaz hilarant (N2O) et autres gaz absorbent dans l’atmosphère ce rayonnement thermique et en renvoient une grande partie à la surface terrestre.Sans cet effet de serre naturel,qui rend possible la vie sur la Terre,la température moyenne serait globalement de –18° C,et non pas de +16° C,comme c’est le cas aujourd’hui.
Fonctionnement de l’effet de serre
L’homme renforce de plus en plus l’effet de serre naturel.Les émissions de CO2,CH4, N2O et autres gaz contribuent à réchauffer la surface terrestre et la couche inférieure de l’atmosphère.La température moyenne de la Terre a augmenté de 0,6° C au cours des 100 dernières années.Durant la même période,l’atmosphère s’est réchauffée en Suisse de 1 à 1,6° C,selon la région.D’après certains pronostics,la température moyenne pourrait encore augmenter globalement au cours des 100 prochaines années de 1,4 à 5,8° C.Le réchauffement conduit à une intensification du cycle hydrologique de l’atmosphère ce qui,sous nos latitudes,peut avoir pour conséquences davantage de précipitations,d’intempéries et d’inondations.
1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 1.RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 115
La surface de la Terre réfléchit des rayons thermiques infrarouges
Atmosphère Surface de la Terre
Source: OFS
La surface de la Terre absorbe la majeure partie des rayons et se réchauffe
Le rayonnement solaire traverse l'atmosphère
Une partie du rayonnement solaire est réfléchie par l'atmosphère et par la Terre
Une partie des rayons infrarouges est absorbée et réfléchie par les gaz à effet de serre. C'est ce qui permet de chauffer la couche inférieure de l'atmosphère et la surface de la Terre.
■ Convention sur les changements climatiques et Protocole de Kyoto
En raison du risque que le climat change,154 pays ont adopté en 1992 la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques,qui vise à stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, à un niveau où l’activité humaine ne perturbe plus le climat d’une manière dangereuse.Ce niveau devrait être atteint dans un laps de temps permettant aux écosystèmes de s’adapter naturellement aux changements climatiques,de sorte que la production alimentaire ne soit pas compromise et qu’un développement économique conforme aux principes de la durabilité puisse se poursuivre.
En 1997,les partenaires internationaux ont signé le Protocole de Kyoto,se rapportant à la Convention sur les changements climatiques.Les signataires s’y engagent à réduire,d’ici à la période 2008 à 2012,les émissions de gaz à effet de serre d’un certain pourcentage par rapport à l’année de référence 1990.La Suisse,tout comme l’UE,est tenue de réduire ces émissions de 8% globalement.A ce jour,aucun pourcentage spécifique n’a été fixé pour les différentes sources d’émissions.Conformément au message du Conseil fédéral relatif à la ratification du Protocole de Kyoto,ce sont notamment la loi sur le CO2,la loi sur l’énergie et le Programme SuisseEnergie y relatif, d’autres mesures prises dans les domaines de la politique des transports,de l’agriculture et de la sylviculture ainsi que des mesures liées à la loi sur la protection de l’environnement qui joueront un rôle important dans sa mise en œuvre.
■ Emissions de gaz à effet de serre d’origine agricole
En Suisse,les émissions de gaz à effet de serre s’élèvent à plus de 50 millions de t par année (convertis en équivalents CO2).La principale source de gaz à effet de serre anthropogène est le trafic.D’autres émetteurs importants sont les ménages et l’industrie.La production agricole,quant à elle,est responsable de près de 12% de ces émissions.
1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 116
Emissions de gaz à effet de serre selon les émetteurs 2001 Trafic 31,1% Gestion des déchets 6,5% Agriculture 11,6% Source: OFEFP Total 53,46 mio. de t CO2 eq Ménages 21,7% Secteur tertiaire 10,8% Industrie 18,1%
Les émissions de gaz à effet de serre d’origine agricole sont liées essentiellement à la production animale.Le CH4 et le N2O qui en émanent contribuent à l’effet de serre et, partant,au changement du climat.Les émissions de CO2,que l’agriculture occasionne également dans une faible mesure par l’utilisation de véhicules à moteur,sont enregistrées à des fins statistiques dans le cadre des émissions dites «offroad» et figurent dans l’Inventaire suisse des émissions de gaz à effet de serre.Elles sont inférieures à 2% de la totalité des émissions de CO2.
Les émissions de CH4 ont représenté en 2000 une part de quelque 8% de la totalité des émissions de gaz à effet de serre du pays.Avec une part de 63%,l’agriculture est l’émetteur principal.Environ 86% des émissions agricoles de CH4 se forment dans le tube digestif des animaux de rente,par la fermentation microbienne des hydrates de carbone contenues dans les fourrages (fermentation entérique).Les 14% restants s’échappent lors de l’entreposage et de l’épandage des engrais de ferme.

En 2000,les émissions de N2O ont contribué à raison de quelque 7% aux émissions de gaz à effet de serre de la Suisse,dont 72% sont d’origine agricole.Le N2O est libéré lors de la transformation (nitrification,dénitrification),par des micro-organismes du sol,des composés azotés qui pénètrent dans le sol par la fumure (engrais de ferme et engrais minéraux) ou sous la forme de résidus végétaux.Ce gaz provient aussi du stockage et du traitement des engrais de ferme.Les émissions de N2O augmentent en fonction des excédents d’azote,qui à leur tour sont surtout observés aux endroits où un cheptel nombreux produit de grandes quantités d’engrais de ferme.
Pour pouvoir mieux comparer,on convertit les valeurs des émissions de CH4,N2O et gaz synthétiques en équivalents CO2 (CO2eq),compte tenu de leur potentiel en matière de réchauffement climatique:1 kg de méthane (CH4) correspond à 21 kg de dioxyde de carbone (CO2) et 1 kg de protoxyde d’azote (N2O) à 310 kg de CO2 (facteurs de conversion selon le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat [GIEC], 1996,avec un horizon de 100 ans).
1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 1.RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 117
■ Méthane et gaz hilarant
CO2
N2OAutres en % CO 2 eq Emissions de gaz à effet de serre Part de l'agriculture Source: OFEFP (): Part (en %) de l'agriculture par gaz à effet de serre 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 84 (2) 8 (66)7 (72)1 (0)
Principaux gaz à effet de serre en Suisse 2001
CH4
■ Emissions d’origine agricole en recul
Les émissions de gaz à effet de serre d'origine agricole ont continuellement diminué au cours des dix dernières années.Ce recul est notamment le résultat du bilan de fumure équilibré exigé dans le cadre des prestations écologiques requises,de l’extension des surfaces de compensation écologique peu ou pas fertilisées ainsi que de la diminution des cheptels.Cela a permis de réduire la production d’engrais de ferme.Simultanément,les agriculteurs ont utilisé plus parcimonieusement les engrais de commerce azotés (–23%).
■ Emissions de gaz à effet de serre dites «grises»
Grâce à ces succès,l’agriculture a déjà apporté une contribution substantielle à la réduction des émissions en question, à laquelle la Suisse s’est engagée dans le cadre du Protocole de Kyoto,ce qui est d’autant plus important que d’autres secteurs ont davantage de difficultés à réduire leurs émissions.C’est la raison pour laquelle le bilan global n’indique pas encore de recul général.
Tous les produits agricoles consommés dans le pays ne sont pas suisses.Afin d’obtenir une image plus proche de la réalité des émissions de gaz à effet de serre auxquelles la Suisse contribue dans le secteur alimentaire,on a examiné celles dites «grises»,c’està-dire produites au-delà des frontières.Pour en tenir compte,on a dressé un bilan incluant aussi bien les émissions liées à la production, à la transformation, à l’emballage et au transport que les divers produits préliminaires (engrais,produits phytosanitaires,aliments pour animaux,etc.).
En 1998,on a ainsi enregistré,dans le secteur alimentaire,un excédent d’importation de gaz à effet de serre gris d’environ 4,3 millions de t de CO2eq par an.Ce chiffre correspond à quelque 11% des émissions grises occasionnées par la Suisse à l’étranger.Or,pour le système climatique global,il importe guère où les activités humaines génèrent des émissions de gaz à effet de serre.
1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 118
Evolution des émissions de gaz à effet de serre 199019911992199319941995199619971998199920002001 Indice 1990=100 Emissions brutes suisses CH4 agriculture N2O agriculture Objectif de Kyoto Source: OFEFP 0 110 100 90
Comparaison des émissions de gaz à effet de serre grises du secteur alimentaire avec les émissions directes du secteur agricole en Suisse, liées au besoin d'énergie
Si l’on compare les émissions grises imputées aux produits importés avec les émissions de l’agriculture suisse,c’est la quantité de CO2 émise pour la production des premiers qui saute aux yeux,quantité attribuable avant tout aux transports.Ces émissions sont bien plus importantes que celles provenant de l’agriculture suisse,bien que la production indigène couvre environ 60% des denrées alimentaires consommées.La situation est inverse en ce qui concerne les émissions de CH4 et de N2O,dont la part en Suisse est relativement élevée par rapport aux importations.Cela s’explique par le degré d’autosuffisance de notre pays pour ce qui est des produits à base de viande.La Suisse importe en effet essentiellement des produits végétaux causant des émissions de CH4 et N2O en plus faible quantité.On constate ainsi que la production et la commercialisation régionale des produits agricoles ont des incidences positives sur le climat.Il ne faut toutefois pas oublier que si la Suisse parvient à réduire les émissions en produisant moins de viande et de lait sans que pour autant la consommation diminue,les émissions seront néanmoins produites,mais à l’étranger.Etant donné que dans ces conditions,les importations augmenteraient,il en résulterait des émissions accrues de CO2
1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 1.RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 119
Solde émissions grises du secteur alimentaire
Emissions de l'agriculture CH
Emissions
Mio. de t CO 2 eq CO2 CH4 N2O Sources:
0 8 7 6 5 4 3 1 2 19901998
Solde émissions grises du secteur alimentaire
de l'agriculture CH
OFEFP, USP
Emissions de gaz à effet de serre grises du secteur
Produits d'origine animale et aliments pour animaux
et autres produits
En ce qui concerne les produits animaux,on enregistre non seulement des importations mais également un volume considérable d’exportations (notamment de fromage). Dans l’ensemble,aussi bien les importations que les exportations ont légèrement reculé entre 1990 et 1998.S’agissant des importations d’émissions de gaz à effet de serre grises,elles ont nettement baissé pour ce qui est des moyens de production.C’est un succès de la politique agricole suisse,qui vise à réduire l’utilisation d’engrais et de produits phytosanitaires.Alors que l’on a observé une légère diminution des importations et une augmentation des exportations de produits céréaliers,les émissions à effet de serre grises se sont accrues entre 1990 et 1998 pour les fruits,les légumes et les autres produits végétaux,ainsi que pour les boissons issues de la production agricole.
Le stockage de carbone dans les sols (séquestration du carbone) est une des possibilités de ralentir l’accumulation de CO2 dans l’atmosphère,et donc d’atténuer quelque peu les changements climatiques globaux.Une étude a estimé à quelque 170 millions de t les réserves totales de carbone contenues dans les sols agricoles suisses (Leifeld et al.,2003).Elle a aussi montré que le potentiel maximum de fixation d’un sol diffère selon le mode d’exploitation et l’assolement.Une couverture du sol durable (p.ex.par des herbages),une productivité élevée (apport élevé de carbone dans le sol),un travail du sol minimal (moins de pertes de carbone oxydatives) et des conditions limitant la dégradation du carbone contribuent à une teneur croissante ou élevée de carbone dans le sol.
Import 1990Import 1998Export 1990Export 1998Solde 1990Solde 1998 Mio. de t CO 2 eq
alimentaire
Moyens de production
Céréales
Fruits, légumes
végétaux Boissons Transports Source: OFEFP 0 6 5 4 3 2 1
et produits céréaliers
1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 120
■ Sols agricoles en tant que puits de carbone
■ Conclusion
La part de 12% que représente la production agricole dans les émissions de gaz à effet de serre n’est pas sans importance,même si ces émissions ont diminué continuellement dans les années nonante.Ce recul contribue substantiellement à la réalisation des objectifs du Protocole de Kyoto.Il est néanmoins possible de réduire encore les émissions par une alimentation des animaux de haute qualité et conforme à leurs besoins,des techniques d’entreposage et d’épandage des engrais de ferme permettant de limiter les émissions,la prévention des excédents d’azote et l’application de modes d’exploitation ménageant le sol.La diminution des émissions de gaz à effet de serre dans la production agricole se heurte toutefois à certaines limites.Une autre possibilité consisterait à diminuer le nombre d’animaux.Mais si les habitudes alimentaires ne changent pas,il en résulterait une augmentation des importations de viande et,au bout du compte,un déplacement des émissions vers l’étranger.Les habitudes alimentaires et le comportement d’achat des consommateurs influent de manière tout aussi significative sur l’ampleur des émissions de gaz à effet de serre de la chaîne alimentaire dans son ensemble.En choisissant délibérément des denrées régionales, produites selon des normes écologiques clairement définies,les consommateurs peuvent contribuer sensiblement à faire baisser ces émissions.

1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 121
Air
L’air pur est une base de l’existence indispensable pour les végétaux,les animaux et les hommes et fait partie d’un environnement intact.Aujourd’hui,nous respirons un mélange d’air enrichi,plus ou moins fortement,de gaz et de particules issus des activités humaines.L’émission de polluants peut représenter,près de la source ou à grande distance,une charge considérable et persistante pour l’homme et son environnement.Ci-après,nous traitons certains aspects des polluants de l’air qui ont de l’importance dans l’agriculture.Nous n’évoquerons cependant pas les émissions d’ammoniac où l’agriculture joue un rôle-clé.Celles-ci feront l’objet du prochain rapport agricole.
Parmi les principaux polluants de l’air,on compte les poussières fines,PM10,qui constituent un mélange physico-chimique complexe de particules avec un diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 10 micromètres.Ce mélange comprend des composantes d’émissions primaires et secondaires d’origine naturelle et anthropogène (p.ex.suie,matériel géologique,particules d’abrasion,matériel biologique) et sa composition peut être très variée.En raison de la petitesse des particules,les PM 10 peuvent pénétrer aisément dans l’appareil respiratoire et provoquer une maladie des voies respiratoires ou de l’appareil cardiovasculaire.
Près de la moitié des PM 10 sont formés de composantes dites secondaires,résultant de la transformation de précurseurs à l’état gazeux,tels que le dioxyde de soufre (SO2), les oxydes d’azote (p.ex.NOx),l’ammoniac (NH3) ainsi que les composés organiques volatils.
L’agriculture et la sylviculture sont, à côté des machines de chantier et de l’aviation, une source essentielle pour les émissions de PM 10 primaires en Suisse,leur part en la matière s’élevant à quelque 24% (environ 6’700 t par an).

1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 122
■ Production agricole en tant que source de polluants de l’air Bilan d'émission PM10 1995 Trafic 36,4% Agriculture/sylviculture 23,7% Source: OFEFP Total PM10 1995: 28 222 t Ménages 4,5% Approvisionnement en énergie 0,4% Industrie/artisanat 35,0%
Emissions de suie de diesel 1995 et pronostic pour 2020
La suie contenue dans les gaz d’échappement des moteurs diesel est une source importante de poussières fines (PM 10).Au moyen de filtres à particules,il est possible actuellement de réduire de 95% ces particules de solides ultrafines.Dans les nouvelles machines de chantier,ces filtres sont aujourd’hui en général la norme.Les émissions «offroad» des domaines non agricoles devraient ainsi fortement diminuer d’ici à 2020. De même,si l’on équipait,d’ici à 2020,tous les moteurs diesel utilisés dans l’agriculture et la sylviculture de filtres à particules,les émissions annuelles de suie pourraient passer de 966 t à 49 t.A l’heure actuelle,les fabricants de machines agricoles et sylvicoles y renoncent cependant pour des raisons financières.Or,vu le danger que les PM 10 représentent pour la santé,il serait indiqué d’exiger,dans notre propre intérêt, que toutes les machines soient équipées de tels filtres.
D’autres polluants de l’air provenant pour une part essentielle du secteur «offroad» sont les oxydes d’azote (env.19% de la totalité des émissions de NOx),les hydrocarbures (env.13% de la totalité des émissions de HC) et le monoxyde de carbone (env. 16% de la totalité des émissions de CO).S’agissant des HC et du CO,ils concernent notamment l’agriculture et le secteur du jardinage et des loisirs avec leurs nombreux petits moteurs à essence très polluants (avant tout moteurs à deux temps).
1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 1.RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 123
1995 Emissions «onroad» Emissions «offroad»1 202019952020 Suie de diesel en t Autres secteurs Agriculture
1 Emissions de véhicules en dehors du trafic routier ordinaire (p.ex. véhicules agricoles et forestiers, machines de chantier) 0 3 000 2 500 1 500 500 2 000 1 000
Source: OFEFP
■ Efficience énergétique stable depuis 1990
Energie
Comme dans d’autres secteurs,l’utilisation de la technique et de substances auxiliaires a beaucoup augmenté dans l’agriculture au cours des 100 dernières années.D’où une consommation accrue d’énergie.
La part de l’agriculture à la consommation totale d’énergie est,certes,relativement faible,mais il ne faut pas oublier que ces 100 dernières années,l’efficience énergétique des systèmes agricoles,c’est-à-dire la proportion entre dépense d’énergie sous forme de facteurs de production et rendement énergétique dans les produits agricoles,a sensiblement diminué
L’électricité ainsi que les agents énergétiques fossiles,tels que le diesel,l’essence et le mazout,représentent environ 50% de l’énergie consommée par l’agriculture.L’énergie grise contenue dans les machines et les bâtiments,chiffrée à quelque 40%,atteint également une part importante.Environ 6% de l’énergie sont absorbés pour la fabrication de moyens de production,par exemple engrais,produits phytosanitaires, aliments pour animaux et semences.
La consommation d’énergie dans l’agriculture a augmenté jusqu’en 1990.Depuis lors, elle est restée stable.Ce sont notamment la baisse des importations d’aliments concentrés et l’utilisation plus parcimonieuse d’engrais minéraux qui ont contribué à ce résultat.
Evolution de la consommation agricole d'énergie 197019721974197619781980198219841986198819901992199419961998 MJ/ha Pesticides Aliments pour animaux importés Semences importées Engrais Energie fossile Electricité Machines Bâtiments Source: Rossier 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 124
Evolution de l'énergie consommée et de l'énergie contenue dans les denrées agricoles

Efficience énergétique en % Energie à des fins de production Energie
L’énergie contenue dans les produits agricoles suit une évolution parallèle à celle de la consommation d’énergie;elle a donc augmenté,mais moins (+20%) que la consommation d’énergie.L’efficience énergétique s’est ainsi détériorée en diminuant de plus de 10 points entre 1970 et 1990 pour se stabiliser depuis.En effet,l’évolution au cours de la dernière décennie montre que le rapport entre l’énergie consommée pour la production et l’énergie contenue dans les denrées agricoles n’a plus empiré.La tendance «davantage d’énergie pour chaque unité alimentaire produite» a pu être stoppée.
Terrajoule en %
197019801985199019951998 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 60 50 40 30 20 10 0
Source: Rossier
1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 125
dans les denrées agricoles
■ Consommation d’énergie pour la production de viande et de végétaux
Après avoir étudié de plus près la consommation d’énergie pour la production laitière dans le rapport agricole 2001,nous présentons cette fois-ci celle qu’implique la production de viande et de végétaux.Comme en 2001,nos calculs se fondent sur un bilan écologique simplifié qui porte sur 52 exploitations pratiquant des branches de production diverses et situées dans différentes zones de production.
Consommation d'énergie par kg de viande 1998
A l’instar de la production laitière,la consommation d’énergie non renouvelable varie considérablement dans la production de viande.Les différences entre les exploitations sont imputables à plusieurs facteurs,mais il n’est pas encore possible de fournir une explication exhaustive à ce sujet.Un projet «Dépouillement centralisé – bilan écologique» (enquête et évaluation de données écologiques détaillées de 300 exploitations et connexion avec les résultats comptables),que l’OFAG a décidé de réaliser et dont le coup d’envoi a été donné en 2003,fournira des informations précieuses permettant de mieux comprendre les causes de ces différences.
MJé quivalent/kg viande kg viande/exploitation
Numéro d'exploitation Bâtiments Machines Agents énergétiques Engrais Pesticides Semences Aliments pour animaux achetés Autres inputs Production carnée par exploitation 29 13 30 1 34 36 31 17 6 4 28 26 33 11 8 49 39 20 19 38 Moyenne 0 6080 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 40 50 30 20 10 1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 126
Source: FAL
De même,de grandes différences d’une exploitation à l’autre sont observées en matière de consommation d’énergie dans le domaine de la culture des champs.Le choix de la culture joue un rôle essentiel.Ce sont avant tout les machines,les engrais et les semences qui en l’occurrence absorbent de l’énergie et moins les bâtiments.

d'énergie
MJé quivalent/kg MS culture des champs t de mati è re s è che / ha Source: FAL Numéro d'exploitation Bâtiments Machines Agents énergétiques Engrais Pesticides Semences Autres inputs MS/ha 23 24 36 34 52 25 37 22 26 40 42 31 39 28 27 30 49 41 38 35 5 33 12 Moyenne 0 1412 10 8 6 4 2 0 10 12 8 6 4 2
Consommation
par kg de matière sèche en culture des champs 1998
1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 127
1.3.2 Ethologie
Participation aux programmes de garde d’animaux SRPA et SST
Les deux programmes «Sorties régulières en plein air» (SRPA) et «Systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux» (SST) visent à encourager la garde d'animaux de rente particulièrement respectueuse de l'espèce.Le premier est essentiellement axé sur les sorties au pâturage,au parcours ou dans l’aire à climat extérieur pour la volaille.Le second pose surtout des exigences qualitatives en matière d’aires de repos.La participation à ces programmes est facultative.
Depuis l’instauration de SRPA en 1993 et de SST en 1996,la participation à ces programmes de garde n’a cessé de croître.En 2002,elle a été presque huit fois supérieure à celle de 1993 pour SRPA (passant d’environ 4’500 à 34'800 exploitations) et a presque quadruplé pour SST (passant d’environ 4'500 à quelque 16'700 exploitations).
Par rapport à l’effectif total d’animaux de rente en Suisse,la part d’UGB gardées selon les règles SRPA et SST a représenté,en 1996,19% et 9% respectivement.En 2002, cette part a atteint 61% pour le programme SRPA et 30% pour le programme SST; il s’agit de valeurs moyennes des quatre catégories d’animaux concernées (bovins, autres herbivores,porcs,volaille).
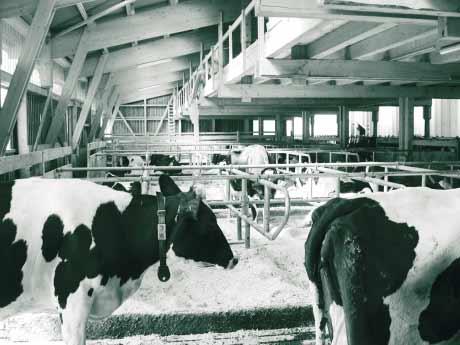
1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 128 ■■■■■■■■■■■■■■■■
Tableaux 38–39,pages A43–A44
Part d'UGB en % SRPASST Source: OFAG 1996199719981999 0 60 70 50 40 30 20 10 2000 2001 2002
Evolution de la participation aux programmes SRPA et SST
La ventilation de la participation au programme SRPA selon la catégorie d’animal et le nombre d’exploitations montre qu’en ce qui concerne les bovins,le nombre d’animaux inclus est légèrement inférieur à celui des exploitations.S’agissant des autres catégories,ce sont les exploitations détenant des effectifs supérieurs à la moyenne qui ont participé au programme SRPA.
Le nombre d’animaux des exploitations SST gardant de la volaille,des herbivores autres que des bovins,ainsi que des porcs a dépassé encore davantage la moyenne suisse que dans le programme SRPA.C’est notamment le cas de la volaille:15% des exploitations ont gardé,en 2002,quelque 76% des animaux détenus conformément aux prescriptions SST.A l’inverse,la part des exploitations a été plus élevée que le nombre d’animaux pour ce qui est des bovins.

1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 1.RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 129
Participation
en % Part d'animaux
d'exploitations Source:
BovinsAutres herbivores PorcsVolaille 0 70 80 60 50 40 30 20 10 Participation
en % Part d'animaux (en UGB)Part d'exploitations Source: OFAG BovinsAutres herbivores PorcsVolaille 0 80 70 60 50 40 30 20 10
au programme SRPA en 2002
(en UGB)Part
OFAG
au programme SST en 2002
La participation au programme SRPA a considérablement augmenté de 1996 à 2002, et cela pour toutes les catégories d’animaux à l’exception de la volaille.Le recul dans cette catégorie après 1999 s’explique probablement par l’exclusion des poulets de chair dont l’engraissement dure moins de 56 jours.

de la participation au programme SST
Une des caractéristiques de la participation au programme SST est la part importante de la volaille.Les exigences SST sont en effet un préalable de l’utilisation de nombreux labels.Le programme SST n’a été introduit pour les porcs qu’en 1997,et le développement a également été réjouissant dans ce domaine,le nombre de porcs gardés dans des étables SST s’étant multiplié par six depuis lors.
1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 130
Evolution
Part d'UGB en % Source: OFAG Bovins Autres herbivores PorcsVolaille 199619971998199920012002 2000 0 70 80 50 60 40 30 20 10 Evolution
Part d'UGB en % Source: OFAG Bovins Autres herbivores PorcsVolaille 199619971998199920012002 2000 0 80 50 60 70 40 30 20 10
de la participation au programme SRPA
Bien-être des animaux grâce aux programmes SST et SRPA
L’analyse de l’impact des programmes de garde a pour objectif de montrer les effets que ceux-ci ont dans la pratique sur la santé et le bien-être des animaux de rente.Les études ont porté sur les vaches laitières et les porcs à l’engrais.Les résultats finaux relatifs aux vaches laitières ont été présentés dans le Rapport agricole 2002.Ils sont bien meilleurs dans les exploitations SST et SRPA que dans celles ne participant à aucun programme.Le programme SRPA à lui seul permet certaines améliorations,mais ne sont significatives que celles concernant la boiterie et les blessures aux trayons. Nous présentons ci-après les résultats finaux de l’analyse consacrée aux porcs à l’engrais.
La santé et le bien-être des porcs à l’engrais ont été évalués à l’aide des indicateurs suivants:toux,diarrhées,boiterie,signes de cannibalisme de la queue,blessures ou coups de soleil.A également été enregistré un comportement singulier comme la position «du chien» ou l’agressivité envers l’enquêteur.En outre,on a procédé à des examens individuels d’une altération de la peau.Au total,47 exploitations SST et SRPA et 37 ne participant à aucun programme ont fait l’objet de cette étude.Dans toutes les exploitations,deux groupes à l’engrais ont été observés,chaque groupe étant examiné peu après la mise à la porcherie et peu avant l’abattage.
1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 1.RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE 131
Bien-être des porcs à l’engrais avec et sans programmes SST et SRPA Taux d'animaux en % sans programmeSST+SRPA Sources: OFAG, OVF Blessure à la queue Pointe de la queue absente 0 3 2 1 Taux d'animaux en % Altération du groin 0 40 30 20 10 Taux d'animaux en % Altération aux articulations du carpe Altération aux articulations du tarse 0 80 70 60 50 40 30 20 10 Taux d'animaux en % Position du chien 0 7 6 4 3 5 2 1 Paralysie 0,0 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1
L’état de santé des porcs à l’engrais examinés était très bon dans l’ensemble.Les cas d’altérations de la queue pour cause de cannibalisme étaient nettement plus rares dans les exploitations SST + SRPA que dans les exploitations ne participant à aucun programme.Le nombre de porcs demeurant en position du chien ou incapables de se lever était également bien inférieur dans les exploitations SST et SRPA.Les altérations de la peau aux articulations telles que blessures,hyperkératose prononcée ou callosités ont été beaucoup plus rarement constatées dans les exploitations SST + SRPA.Par ailleurs,les exploitations SST + SRPA avaient tendance à adjoindre moins d’antibiotiques dans l’aliment de démarrage pour traiter ou prévenir les maladies.Toutefois, cette différence n’était pas significative.
Comme l’on s’y attendait,des coups de soleil n’ont été observés que dans les exploitations SST + SRPA,mais ils ne concernaient en général que quelques animaux isolés. Ce problème peut être évité par la couverture partielle de l’aire d’exercice.
A l’intérieur des deux groupes d’exploitation,de grandes différences ont été relevées entre certaines exploitations.C’est ainsi que,d’une part,on a recensé des exploitations ne participant à aucun programme mais où les porcs à l’engrais étaient en très bonne santé.D’autre part,on a aussi observé dans certaines exploitations SST + SRPA un plus grand nombre d’animaux présentant des altérations.Cela montre que les programmes de garde SST + SRPA ont une influence positive sur la santé et le bien-être des animaux, à condition qu’ils soient mis en pratique de manière optimale.
Concernant les maladies des voies respiratoires,la diarrhée,la boiterie,les abcès,les altérations des organes lors de l’abattage,la contamination par des parasites de l’intestin et la propreté des animaux,aucune différence n ’ a été constatée entre les exploitations SST + SRPA et les autres.Ces derniers points sont confirmés par une autre étude qui a examiné des porcs dans des exploitations SST + SRPA quant à la contamination par des agents zoonotiques.Des différences statistiques significatives entre les deux modes de production n’ont été observées pour aucun des agents pathogènes considérés.Les résultats confirment qu’il est possible de produire,dans des conditions SST + SRPA,de la viande de porc répondant aux exigences qualitatives les plus élevées en matière de santé
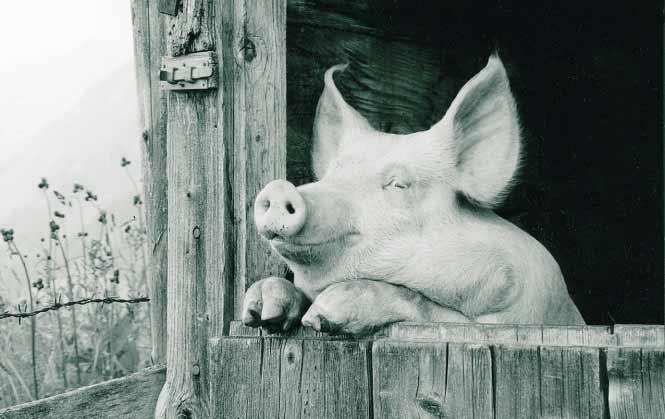
1.3 ECOLOGIE ET ÉTHOLOGIE 1 132
1.4 Appréciation de la durabilité
L’ordonnance sur l'évaluation de la durabilité de l'agriculture prévoit que l’OFAG soumette les résultats des analyses à une évaluation sous l’angle de la durabilité et les publie dans le rapport agricole.Cela signifie que,avant de les évaluer,il doit passer au peigne fin la situation économique,sociale et écologique de l’agriculture de même que les répercussions de la politique agricole.L’appréciation qui suit se fonde sur les chiffres à disposition aujourd’hui.Reposant sur le concept relatif à l’évaluation de la durabilité présenté dans le rapport agricole 2001,les travaux en rapport avec l’évolution des indicateurs quantitatifs ont été poursuivis en 2002 et seront intégrés à l’avenir à l’appréciation de la durabilité.
Les résultats économiques de l’année 2002 sont comparables à ceux de la moyenne triennale 1999/2001.Quant à la production du secteur agricole,elle est restée pratiquement stable par rapport à cette même période de référence.La diminution du revenu net d’entreprise (–1%) est imputable à la hausse des dépenses pour les consommations intermédiaires (+4%) que l’accroissement des autres subventions (principalement des paiements directs non liés aux produits) (+8%) n’a pu entièrement compenser.Les estimations pour l’année 2003 font apparaître un recul qui résulte, d’une part,de la diminution des recettes provenant de la production laitière et,d’autre part,de la canicule et de la sécheresse enregistrées durant l’été.Le revenu net d’entreprise devrait s’élever à 2,835 milliards de francs,soit 13% de moins qu’en 2002. Les résultats des exploitations provenant du dépouillement centralisé des données comptables montrent que les valeurs du revenu agricole pour les années 2000/02 sont inférieures de 11% à celles de la période 1990/92.Les coûts réels (+14%) ont progressé plus fortement que le rendement brut (+6%) durant cette période,augmentation qui s’explique par la croissance des exploitations.Le niveau des coûts réels à l’hectare est toutefois inférieur de 4% à celui de 1990/92.Néanmoins,la réduction des coûts a été trop faible pour pouvoir compenser le recul des recettes.Une analyse de l’EPF Zurich portant sur les performances des exploitations révèle que la productivité du travail est de loin le facteur le plus important qui distingue les entreprises performantes de celles réalisant de mauvais résultats.Toutes les possibilités visant à l’amélioration des résultats économiques ne sont donc pas encore épuisées.
La diminution du revenu agricole entre 1990 et 1999 a pu être partiellement compensée par l’augmentation des revenus accessoires.Les revenus totaux des années 2000/02 ne se situent que 5% au-dessous du niveau des années 1990/92.Les investissements et la quote-part de capitaux étrangers sont pratiquement demeurés au même niveau qu’au début des années nonante:léger fléchissement de 46'900 francs à 45'400 francs pour les investissements et petite baisse de 43 à 41% pour le degré de financement étranger.Comparée au début des années 1990,la capacité de remboursement des emprunts au cours d’une génération n’a pas diminué,ainsi que le montrent les résultats d’une analyse correspondante réalisée par la FAT.
1.4 APPRÉCIATION DE LA DURABILITÉ 1 133 1.RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE ■■■■■■■■■■■■■■■■
■ Economie
Cela ne change rien au fait que,comme au début des années nonante,il existe des exploitations qui sont menacées dans leur existence à long terme.En considérant la moyenne triennale 2000/02,environ 30% des exploitations se trouvaient dans une situation financière précaire pour assurer leur existence à long terme.
Globalement,pour la moyenne des exploitations,l’analyse des paramètres microéconomiques des dernières années ne révèle aucune variation notable par rapport aux valeurs enregistrées au début des années 1990.Cependant,il existe toujours des exploitations dont l’existence à long terme est menacée.L’analyse des performances réalisée par l’EPF met en relief l’existence d’un potentiel important dans la productivité du travail,lequel reste à exploiter pour améliorer durablement les résultats économiques.

134 1.4 APPRÉCIATION DE LA DURABILITÉ 1
Le revenu total déterminant des ménages agricoles a reculé de 8% en 2002,en regard de la moyenne des trois années 1999/2001.Cela n’a pas empêché la consommation privée d’augmenter de 2% en moyenne,soit de 1'350 francs par ménage,un léger recul ayant toutefois été constaté pour les exploitations du premier quartile – contrairement à celles des autres quartiles.
L’Enquête suisse sur la santé (ESS) que l’Office fédéral de la statistique (OFS) a effectuée en 2002 met en évidence que,dans le domaine de la santé,il existe certaines différences entre les agriculteurs ou les paysannes et le reste de la population.Si les agriculteurs et les paysannes présentent plus souvent un excédent de poids et souffrent plus fréquemment de maux de dos que les groupes témoins,ils sont,en revanche,moins concernés par de fortes insomnies.Quant à la consommation d’alcool, les paysannes interrogées notamment sont bien plus souvent abstinentes que les personnes des groupes témoins.Autre constat intéressant:en comparaison avec les groupes témoins,les agriculteurs et les paysannes sont beaucoup moins soucieux de leur alimentation et ils consultent plus rarement un médecin.En outre,les différences entre les hommes (agriculteurs et groupe témoin) et les femmes (paysannes et groupe témoin) sont souvent plus marquées.
Concernant le postulat Bugnon,l’évolution de la pénibilité du travail dans l’agriculture a fait l’objet d’une analyse tandis que les données sur l’état de santé des agriculteurs et des paysannes ont été évaluées.Comparée à celle des autres branches,la durée annuelle du travail est la plus élevée pour les agriculteurs et gardes-forestiers indépendants.Des calculs modélisés de la FAT montrent également que,malgré la croissance des exploitations,le temps de travail par exploitation est resté quasiment stable en moyenne.Dans certains cas,la situation peut toutefois être bien différente.C’est ainsi qu’un agrandissement de l’exploitation peut conduire à des contraintes de temps plus importantes s’il ne s’accompagne pas d’adaptations sur les plans technique et organisationnel.Quant à la pénibilité du travail physique dans la garde des vaches laitières, elle a diminué entre 1990 et 2001.L’évaluation des données recueillies lors des enquêtes sur la santé met en évidence que l’état de santé,tant physique que psychique,des agriculteurs et des paysannes s’est plutôt amélioré dans l’ensemble au cours de la dernière décennie.Les enquêtes font en outre ressortir que le pourcentage d’agriculteurs participant à la vie associative est le même en 2002 qu’en 1992,alors qu’il a reculé pour les paysannes.Ces dernières sont néanmoins plus souvent actives dans ce domaine que les femmes du groupe témoin.Enfin,le nombre des divorces n’a cessé d’augmenter depuis 1970 dans l’agriculture également,mais on n’a pu observer aucune progression particulière,attribuable à la réforme agricole,dans les années nonante.
Au vu des évaluations effectuées sur la pénibilité du travail et sur l’état de santé,rien ne laisse augurer que la réforme agricole a engendré des évolutions qui sont inacceptables sur le plan social.
1.4 APPRÉCIATION DE LA DURABILITÉ 1 135 1.RÔLE ET SITUATION DE L’AGRICULTURE
■ Aspects sociaux
■
Les prestations écologiques de l’agriculture ont de nouveau augmenté par rapport à l’année précédente.En 2002,la région de plaine (zones de grandes cultures et zone des collines) comptait 48'800 ha de surfaces de compensation écologique donnant droit à des contributions,soit 3% de plus qu’en 2001.De leur côté,les entreprises biologiques exploitaient au total 9% de la SAU,soit 1% de plus que l’année précédente.Le pourcentage d’UGB gardées selon les règles définies pour les programmes SRPA s’est élevé à 61% en 2002 contre 56% l’année d’avant.30% des UGB sont gardées conformément aux dispositions du programme SST,ce qui correspond à une augmentation de 3% par rapport à 2001.
Les atteintes à l’environnement causées par l’agriculture ont fortement diminué depuis le début des années nonante jusqu’en 1998.Si l’utilisation de l’azote et du phosphore a de nouveau légèrement progressé depuis 1998,l’emploi de produits phytosanitaires a tendance à stagner.Les émissions de gaz à effet de serre par l’agriculture ont reculé d’environ 10% entre 1990 et 2000.Grâce à ces progrès,l’agriculture a déjà apporté une contribution substantielle à la réduction desdites émissions,conformément aux engagements pris par la Suisse dans le cadre du Protocole de Kyoto.Ont contribué à cette amélioration le bilan de fumure équilibré exigé dans le cadre des prestations écologiques requises,l’extension des surfaces de compensation écologique peu ou pas fertilisées,la réduction des cheptels et la diminution des engrais de commerce utilisés. D’autres solutions recèlent également un potentiel pour réduire à l’avenir ces émissions,comme l’alimentation appropriée et de haute qualité des animaux,le recours à des techniques d’entreposage et d’épandage des engrais de ferme causant peu d’émissions,la prévention des excédents d’azote,ainsi que l’application de méthodes d’exploitation ménageant le sol.Cependant,les habitudes alimentaires et le comportement d’achat des consommateurs influent de manière tout aussi significative sur le volume des émissions de gaz à effet de serre que produit la chaîne alimentaire dans son ensemble.
L’efficacité énergétique des produits agricoles,c’est-à-dire le rapport entre l’intrant énergétique et le rendement obtenu,est resté stable depuis 1990.Un bilan écologique simplifié montre que,comme dans la production laitière,il existe dans la production de viande et les grandes cultures des différences considérables entre les exploitations quant à l’intrant énergétique.Il y a donc,là aussi,un potentiel d’amélioration.
D’une manière générale,on peut qualifier de réjouissante l’évolution de la durabilité dans le domaine écologique,notamment sous l’angle des prestations.Quant aux charges sur l’environnement,il est nécessaire de poursuivre les efforts entrepris jusqu’à présent.Et là aussi,c’est surtout au niveau local ou régional qu’il faut commencer.
136 1.4 APPRÉCIATION DE LA DURABILITÉ 1
Ecologie

■■■■■■■■■■■■■■■■ 2.Mesures
agricole 137 2
de politique
On a rangé les mesures de politique agricole dans trois domaines:
– Production et ventes: les mesures prises dans ce domaine visent à créer de bonnes conditions-cadres pour la production et l’écoulement des denrées alimentaires.La loi prescrit que,cinq ans après être entrée en vigueur,les dépenses de la Confédération affectées à la production et à la commercialisation devront avoir été réduites d’un tiers par rapport à celles de 1998.En 2003,ce ne seront plus que quelque 800 millions qui pourront être consacrés à ces mesures.
– Paiements directs: ces paiements sont considérés comme une rétribution des prestations en faveur de la collectivité,au rang desquelles figurent l’entretien du paysage,la sauvegarde des bases naturelles de l’existence,la contribution à une occupation décentralisée du territoire ainsi que des prestations écologiques particulières.Les prix payés pour les denrées alimentaires ne comprennent pas ces prestations car le marché correspondant est inexistant.Par le biais des paiements directs, l’Etat s’assure le concours de l’agriculture pour fournir des prestations d’intérêt général.
– Amélioration des bases de production: ces mesures permettent à la Confédération de promouvoir et de soutenir une production de denrées alimentaires respectueuse de l’environnement,sûre et efficiente.Elles concernent l’amélioration des structures,les domaines de la recherche et de la vulgarisation,ainsi que ceux des matières auxiliaires et de la protection des végétaux et des variétés.
Le Parlement a approuvé,le 25 juin 2003,le projet relatif à l'évolution future de la politique agricole (Politique agricole 2007).La décision de supprimer le contingentement laitier au 1er mai 2009 constitue le point central de la révision de la LAgr.Dans le même temps,le Parlement a inscrit 14,092 milliards de francs au budget de l’agriculture pour les années 2004 à 2007.Selon le débat parlementaire lors de la session d’automne,l’agriculture devra toutefois contribuer au programme d’allégement 2003 dans le cadre de l’assainissement des finances fédérales.
138 2.MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE 2
2.1 Production et ventes
Conformément à l’art.7 LAgr,qui définit les objectifs relatifs à la production et à la vente de produits agricoles,l’agriculture doit être en mesure,d’une part,de produire de manière durable et peu coûteuse et,d’autre part,de tirer de la vente des produits des recettes aussi élevées que possible.Pour ce faire,elle peut prendre des mesures dans les domaines qualité,promotion des ventes et désignation,importations et exportations,économie laitière,économie animale,production végétale et économie viti-vinicole.

■■■■■■■■■■■■■■■■
2.1 PRODUCTION ET VENTES 139 2
■ Moyens financiers en 2002
En 2002,quelque 826 millions de francs ont été consacrés à la promotion de la production et des ventes,soit une réduction des dépenses d’environ 76 millions de francs ou de 8 % par rapport à l’année précédente.
Dépenses pour la production et les ventes
Comptes 2002Budget 2003 1
Domaine de dépensesMontantPartMontantPart mio.de fr.%mio.de fr.%
Promotion des ventes597,1597,2
Economie laitière60172,756568,8
Economie animale202,5445,4
Production végétale (viticulture comprise)14617,715318,6
Total826100821100
1 blocage des crédits pris en compte
■ Perspectives
Sources:Compte d’Etat,OFAG
Des dépenses extraordinaires s’élevant à environ 153 millions de francs ont été engagées à titre complémentaire afin d’atténuer les turbulences apparues sur le marché du lait.
Dans le cadre de l’enveloppe financière 2000–2003,une nouvelle réduction est prévue en 2003 dans le domaine de la production et des ventes.A cela s’ajoute une coupe budgétaire de 1% (blocage de crédit) pour les différents postes.
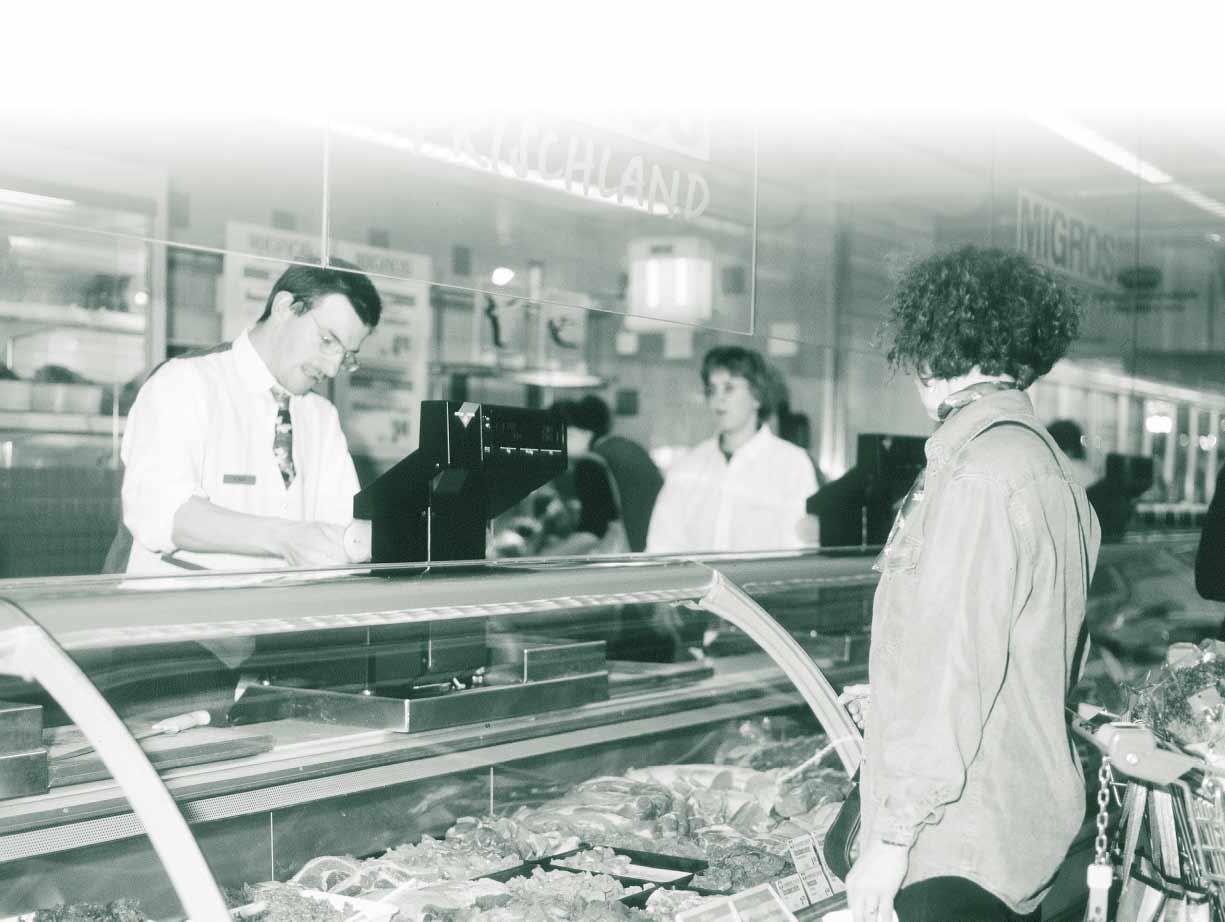
2.1 PRODUCTION ET VENTES 2 140
■ Premières expériences
2.1.1 Instruments transversaux
Interprofessions et organisations de producteurs
Les interprofessions et les organisations de producteurs jouent un rôle essentiel dans le processus de libéralisation des marchés agricoles en servant de plate-forme d’information,de négociation et de coordination aux entreprises du secteur alimentaire.Les décisions portant sur le marketing-mix des produits et sur certaines règles de fonctionnement des marchés doivent permettre de trouver des solutions cohérentes au niveau collectif pour augmenter la valeur ajoutée et développer les parts de marché des produits agricoles suisses.
Les organisations agricoles font preuve d’un véritable dynamisme dans la mise en place des interprofessions et des organisations de producteurs.Toutefois dans la réalité,elles se voient confrontées aux situations les plus diverses,et le succès n’est pas toujours au rendez-vous.La constitution de structures performantes reste fondamentalement liée à l’aptitude des opérateurs à définir des objectifs communs,ainsi qu’à leur volonté de trouver des solutions acceptables pour tous.A ce niveau-là,la Confédération n’a guère d’influence quand bien même l’OFAG conseille les organisations qui en font la demande.
Dans le cadre de la législation agricole,le Conseil fédéral peut,sous certaines conditions,rendre obligatoires pour les non-membres des interprofessions et des organisations de producteurs des mesures concernant l’amélioration de la qualité,la promotion des ventes et l’adaptation de l’offre à la demande.On parle alors «d’extension des mesures».A l’heure actuelle,trois organisations de producteurs (Union suisse des paysans,Producteurs suisses de lait,GalloSuisse) et trois interprofessions (Interprofession du Gruyère,Interprofession du Vacherin fribourgeois,Emmentaler Switzerland) sont au bénéfice d’une telle extension arrêtée par le Conseil fédéral.
■ Les principaux éléments de la révision
Au vu des premières expériences faites par l’OFAG dans le traitement des demandes d’extension,le Conseil fédéral a révisé,fin 2002,l’ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs.C’est ainsi que les exigences posées à la personnalité juridique des organisations,à leur caractère représentatif et à leurs processus décisionnels ont été définies plus précisément.
Entrée en vigueur le 1er janvier 2003,l’ordonnance révisée a pour avantage de clarifier plusieurs points.Elle permet aussi d’atténuer les réserves émanant des minorités puisque les représentants sont élus par la base et que les décisions doivent être prises à la majorité des deux tiers au sein des assemblées des délégués.Le fonctionnement démocratique des interprofessions et des organisations de producteurs est donc encouragé.Ces changements contribuent à renforcer la légitimité des organisations qui demandent au Conseil fédéral une extension des mesures d’entraide.De leur côté, les non-membres pourront également bénéficier à l’avenir d’une meilleure information.
■■■■■■■■■■■■■■■■
2.1 PRODUCTION ET VENTES 2.MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE 141 2
■ Promotion des ventes au niveau régional
Le système relatif à l’extension des accords interprofessionnels est un instrument de politique agricole en constante évolution.De nouvelles demandes allant dans ce sens ont été présentées au cours de l’année 2003.L’OFAG suivra avec attention la mise en place des mesures d’extension,car celles-ci doivent impérativement servir à l’ensemble des entreprises d’un secteur ou d’une filière et ne pas fausser le jeu de la concurrence entre les différents acteurs du marché.
Promotion des ventes
Les organisations ayant pour tâche de promouvoir les ventes des spécialités régionales ont également la possibilité de faire appel au soutien de la Confédération,comme l’a rappelé le Conseil fédéral dans son message concernant la réforme de la Politique agricole 2002.Ce soutien vise à étayer le développement d’une politique régionale coordonnée.
Dans le cadre de la promotion des ventes agricoles,l’OFAG a fourni depuis 1999 une aide financière pour un montant total de 17,3 millions de francs à 24 projets régionaux.Conçue comme une aide initiale et limitée à quatre ans au maximum par projet, cette aide financière est déjà arrivée à son terme pour plusieurs projets ou devrait prendre fin prochainement.
La procédure de demande,étroitement liée au programme REGIO PLUS (arrêté fédéral instituant une aide à l’évolution structurelle en milieu rural) a fait ses preuves.Dans le but de rassembler des informations sur l’exécution et ses premiers effets,la promotion des ventes de produits agricoles a,en même temps que le programme REGIO PLUS,fait l’objet d’une évaluation intermédiaire (évaluation intermédiaire Interface/Evaluanda 02) au premier semestre 2002.Les résultats de cette évaluation au niveau régional sont présentés ci-après.
■ Un premier bilan positif
Le bilan de l’évaluation intermédiaire est globalement positif et les deux programmes d’encouragement sont jugés comme étant «en adéquation avec le problème et porteurs d’avenir».La mise sur pied de réseaux en milieu rural,en particulier,est considérée comme un précieux instrument.De l’avis des personnes chargées de l’exécution et des responsables de projet interrogés dans le cadre de l’évaluation,le soutien des coopérations associant de façon transversale communes,filières et produits et visant des objectifs communs est un facteur décisif pour tirer parti des potentiels de développement régionaux.L’exécution par les autorités cantonales et fédérales est,dans l’ensemble,qualifiée d’exemplaire.
L’aide financière octroyée à la promotion des ventes régionale a généré des impulsions sans susciter toutefois d’effets secondaires pervers.En d’autres termes,ne sont pas cofinancés les projets qui auraient de toute façon été réalisés sans aide financière. Les responsables de projet sont partisans de cette aide initiale en tant que système d’incitation de la Confédération.
2.1 PRODUCTION ET VENTES 2 142
■ Perspectives
■ Améliorations possibles

Bien souvent,la qualité des demandes présentées n’a pas satisfait d’emblée aux exigences requises,inhabituelles pour les requérants.Ainsi,une partie des demandes a dû être remaniée sitôt le premier examen.Des difficultés sont apparues notamment en ce qui concerne la formulation des objectifs qualitatifs et quantitatifs mesurables.
L’évaluation intermédiaire montre que,jusqu’à présent,les activités des projets soutenus ont surtout encouragé la sensibilisation et la mise sur pied de réseaux.Il est toutefois difficile de prouver si les projets ont des retombées économiques directes.
Les résultats de l’évaluation mettent en relief les caractéristiques suivantes comme facteurs de réussite:capacité de management suffisante,perspectives de financement à long terme,planification fondée sur des objectifs mesurables et un contrôle des résultats,orientation interrégionale,partenariats stables et solide ancrage régional.Ils soulignent en outre que,pour les projets au sens de l’ordonnance sur l’aide à la promotion des ventes de produits agricoles notamment,l’orientation économique doit l’emporter sur l’orientation de la politique régionale.De surcroît,la réalisation unilatérale de mesures de communication ne suffit pas.Les résultats seront pris en compte pour l’examen des futures demandes en ce sens que les aspects économiques et organisationnels des projets seront davantage passés au crible et analysés sous l’angle des différents instruments du marketing-mix.
Après avoir bénéficié d’un soutien pendant quatre ans,la plupart des projets n’atteignent en effet pas la taille critique leur permettant de subsister de manière autonome, aspect qui a été quelque peu négligé avec l’orientation économique parfois insuffisante des projets.Divers acteurs en ont pris conscience et commencent à s’organiser à l’échelle interrégionale.La modification de l’ordonnance sur l’aide à la promotion des ventes de produits agricoles doit également permettre de tenir compte de cette évolution.L’ordonnance révisée prévoit ainsi que les projets seront désormais soutenus pendant une phase de consolidation de quatre années,mais avec une participation financière réduite de la Confédération.Par ailleurs,elle mentionne explicitement la possibilité d’octroyer une aide financière pour des projets interrégionaux axés sur la promotion des spécialités régionales.
2.1 PRODUCTION ET VENTES 2.MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE 143 2
■ Sondage représentatif sur l’origine suisse
La promotion des ventes a pour but de susciter auprès des consommateurs une attitude positive envers les produits agricoles suisses et,partant,d’influencer leur comportement d’achat.Les personnes en charge d’un ménage doivent être davantage sensibilisées au critère d’origine,mieux connaître les avantages des produits suisses et accorder la préférence à ces derniers.Depuis 1999,l’OFAG soutient les mesures prises par des acteurs de l’agriculture dans le domaine de la communication-marketing et de la prospection du marché.Dans un sondage effectué à intervalles réguliers,on cherche à déterminer l’efficacité de ces mesures.
Le sondage représentatif réalisé,début 2003,sur mandat de l’OFAG a lieu tous les deux ans depuis 1998.L’intérêt se focalise sur le comportement d’achat de la population suisse envers les produits agricoles.On analyse en particulier si l’acheteur a été attentif à l’origine des différents produits et dans quelle mesure il a donné la préférence aux produits suisses sur les produits étrangers.
En outre,le tout dernier sondage a porté sur le niveau d’information des consommateurs quant au lieu d’origine de leurs achats et sur leurs attentes en ce qui concerne l’indication de provenance des produits agricoles suisses.Ces questions sont liées à l’introduction prévue d’un label d’origine uniforme pour les produits suisses.Enfin, l’attitude de la population face à l’agriculture suisse a une nouvelle fois été analysée.
■ Préférence accordée aux produits suisses
Pour ce qui est de la prise en considération générale de l’origine suisse,on observe un léger fléchissement peut-être imputable au fait que les produits importés sont eux aussi de haute qualité et que le choix est dicté par la comparaison des prix.D’où la nécessité de promouvoir plus activement les produits agricoles suisses.
Les résultats du sondage révèlent que,pour les consommateurs attentifs à l’origine des produits,la préférence pour les produits suisses n’a pas évolué de manière significative au cours des quatre dernières années.On peut donc en déduire que les consommateurs font preuve d’une certaine continuité dans leur comportement d’achat.Ces mêmes résultats ont en revanche confirmé que,lors de l’achat de produits alimentaires d’origine animale tels que œufs,viande,miel,fromage,laits et produits à base de lait frais,les consommateurs privilégiaient les produits venant de Suisse.Quant aux produits issus de la culture végétale comme les céréales ou l’huile domestique,l’origine suisse n’est pas synonyme de bonus.Pour ce qui est des produits non alimentaires tels que les fleurs coupées,la laine et les plantes en pot,l’origine ne joue qu’un rôle secondaire dans la décision de l’acheteur.
■ Désignation de l’origine suisse
Jusqu’à maintenant,il n’existe pas de label d’origine uniforme et largement utilisé pour les produits agricoles suisses.Aussi la question de savoir comment les personnes en charge d’un ménage s’informent sur l’origine des produits suisses mérite-t-elle un intérêt particulier.
2.1 PRODUCTION ET VENTES 2 144
■ Importance de l’étiquetage de l’origine des produits agricoles
Préférence accordée aux produits suisses

Oeufs (454)
Lait et produits laitiers frais (491)
Viande (sans charcuterie) (468)
Pommes de terre (449)
Miel (352)
Charcuterie (423)
Fromage (489)
Fruits/baies (475)
Légumes (484)
Produits céréaliers (453)
Sucre (458)
Prod. à base de p. de terre (313)
Huile comestible (465)
Vin (414)
Fleurs coupées (367)
Plantes en pots (296)
Laine (101)
toujours/presque toujours le plus souvent de temps à autre rarement jamais ne sais pas/pas de réponse
La plupart des consommateurs reconnaissent les produits agricoles suisses à une indication figurant dans le magasin,sur le rayonnage,sur la marchandise ou son emballage.Ils sont aussi quelques uns à se renseigner directement auprès du personnel de vente.Aux yeux de 56% des acheteurs,le marquage des produits indigènes est très important tandis que 32% le considèrent comme relativement important.Un nombre étonnamment élevé de personnes interrogées attachent donc une grande importance à l’indication de l’origine.
Importance de la désignation de provenance de produits agricoles
ne sais pas 1% peu important 7%
sans importance 4% très important 56%
assez important 32% Source: DemoScope 2003
2.1 PRODUCTION ET VENTES 2.MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE 145 2
en % Source:
2003 0203010405060708090100
DemoScope
10910144017 1089114319 111014103916 12122922214 20101814317 25158112912 2686123414 26171511229 4028155102 4024186111 4523154112 4521116125 5416115131 571366144 60226372 701143102 7994161
Attitude
Environ 80% des personnes interrogées salueraient aussi l’introduction d’un label d’origine uniforme pour les produits agricoles suisses.Et seulement la moitié des consommateurs estime que,aujourd’hui,les produits indigènes sont suffisamment reconnaissables.Quant à la question de savoir si les consommateurs prêtaient attention à ce que la région soit aussi indiquée comme origine,trois quarts d’entre eux ont donné une réponse positive.
La majorité des personnes interrogées attendent d’un produit portant le label d’origine suisse qu’il provienne effectivement à 100% de Suisse.De plus,elles associent le marquage des produits à d’autres caractéristiques telles que la fraîcheur,la haute qualité,l’absence d’OGM,ainsi que le système de garde d’animaux adapté à l’espèce et les méthodes de culture respectueuses de l’environnement.
Le sondage se penche aussi à intervalles réguliers sur l’attitude du consommateur face à l’agriculture et à son image.Dans leur majorité,les consommateurs continuent d’accorder leur confiance à l’agriculture suisse.Ils la décrivent comme un secteur empreint de professionnalisme,proche des consommateurs,moderne,respectueux de l’environnement et compétitif.Néanmoins,les résultats du dernier sondage révèle une certaine insécurité parmi les consommateurs.En 2000,la part des consommateurs ayant nettement dit oui aux caractéristiques précitées était plus élevée qu’en 2002.
Etiquetage
■ Registre des appellations d’origine contrôlée (AOC) et des indications géographiques protégées (IGP)
En 1997 est entrée en vigueur l’ordonnance concernant la protection des appellations d’origine et des indications géographiques des produits agricoles et des produits agricoles transformés (ordonnance sur les AOP et les IGP).Il ne s’agissait pas d’une véritable innovation puisque,depuis 1962,un registre sectoriel existe pour les fromages.
Les appellations d’origine contrôlée ou protégées (AOC,AOP les deux termes sont identiques) et les indications géographiques protégées (IGP) utilisent des noms de régions ou de lieux pour des produits agricoles dont la qualité et les principales caractéristiques sont déterminées par leur origine géographique.Dans le cas de l’appellation d’origine,toutes les phases de production doivent se dérouler dans la même région alors que,pour l’IGP,le rapport avec la région géographique est moins strict:il suffit que la production ou la transformation ou l’élaboration ait lieu dans ladite aire géographique.
2.1 PRODUCTION ET VENTES 2 146
■
face à l'agriculture suisse
Ce registre permet aux professionnels concernés par l’élaboration d’un produit agricole traditionnel de définir et de protéger ses particularités.Il est réservé à des produits pour lesquels un lien existe entre la qualité et l’origine géographique dans ses dimensions humaines (savoir-faire des artisans) et naturelles (altitude,nature des sols, flore bactérienne,etc.).Les règles collectives permettant l’utilisation de l’AOC ou de l’IGP sont définies dans un cahier des charges et concernent la description du produit, la définition de l’aire géographique,le mode de production,de transformation et d’élaboration.Des organismes de certification accrédités contrôlent en toute indépendance si les règles volontairement définies par la profession sont respectées,et garantissent ainsi que les AOC et IGP ne sont utilisées que pour des produits satisfaisant aux critères dudit cahier des charges.L’objectif à moyen terme est de faire reconnaître notre registre par l’UE et,partant,d’obtenir une protection de ces appellations sur notre principal marché d’exportation.Jusqu’à la date du 31 décembre 2002,l’OFAG a traité 24 demandes d’AOC et IGP,dont 8 ont conduit à l’enregistrement.
Etat du registre des AOC et IGP au 31 décembre 2002
AppellationProtectionExploitations Exploitations Volumes de Organismes agricoles(transfor-productionde certifimation/ certifiés cation élaboration)en 2002
Fromage
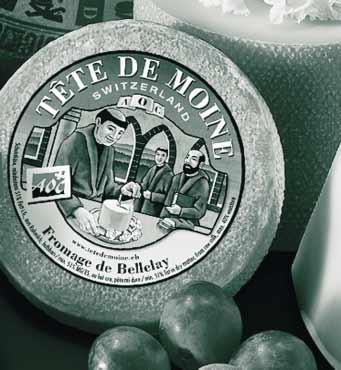
L’EtivazAOC861355OIC 1 reGruyèreAOC3 45224526 300OIC 1
SbrinzSbrinzAOC24135
de MoineTête de MoineAOC16512
Procert
OIC 1
Produits carnés Viande des GrisonsIGP-18645Procert Saucisse d’AjoieIGP-11
Eau-de-vie de poire du ValaisAOC62010
Autres produits Rheintaler RibelAOC11227Procert Total 1 Organisme Intercantonal de Certification
2 Pas de production certifiée en 2002
2.1 PRODUCTION ET VENTES 2.MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE 147 2
NombreNombret
2
2
te
2
OIC 1 Spiritueux
2 OIC 1
Source:OFAG
Inventaire du patrimoine culinaire de la Suisse

Ces dernières années,nombre de pays européens ont dressé un inventaire de leurs spécialités culinaires.En Suisse,aucun recueil systématique des produits traditionnels et typiques des régions n’existe à ce jour,quand bien même la Confédération encourage et soutient le patrimoine culturel de notre pays sous les formes les plus diverses. Fort de cette constatation,le conseiller national Josef Zisyadis a présenté le 6 octobre 2000 un postulat intitulé «Inventaire du patrimoine culinaire» dans lequel il demandait au Conseil fédéral de créer un tel inventaire.Ce postulat a été accepté le 15 décembre 2000.
En décembre 2001,l’OFAG a contacté les offices cantonaux de l’agriculture en leur demandant de participer à l’établissement d’un inventaire pilote.Dix-neuf cantons se sont déclarés prêts à collaborer pendant la phase pilote prévue jusqu’en août 2002. Les participants du groupe de travail intercantonal ont alors élaboré plusieurs descriptions de produits complètes et dressé la liste d’autres produits potentiels.La plupart des personnes ayant participé au projet ont tiré un bilan largement positif de leur travail et sont tombées d’accord pour poursuivre le projet et l’étendre à l’avenir à tous les cantons.L’intérêt d’un tel inventaire est de permettre l’identification des particularités de nos produits locaux traditionnels et de faciliter leur compréhension.Autre avantage:il peut contribuer à relancer des productions jusqu’alors négligées et/ou à consolider des productions existantes.C’est aussi un instrument des plus utiles pour nous aider à conserver notre patrimoine culinaire et à promouvoir la vente des produits agricoles suisses.De par le lien étroit entre l’agriculture et les régions,l’inventaire s’intègre parfaitement dans le contexte des politiques agricole et régionale.Une organisation privée a d’ores et déjà fait part de son intérêt pour utiliser le recueil dans le futur et en assumer la direction.Selon l’art.12 LAgr et l’ordonnance sur l’aide à la promotion des ventes de produits agricoles,un cofinancement subsidiaire par la Confédération est possible.
148 2.1 PRODUCTION ET VENTES 2
■ Inventaire pilote avec 19 cantons
Instruments du commerce extérieur
En vue de soutenir l’agriculture productive,des mesures tarifaires douanières régulent les importations de produits agricoles.Ainsi,des droits de douane à l’importation appliqués de deux manières différentes servent d’instrument de régulation.Dans le cas du prix-seuil que l’on utilise pour les aliments fourragers,des droits de douane variables permettent d’atteindre un prix à l’importation qui se situe dans une fourchette déterminée.D’autres produits agricoles font l’objet de contingents tarifaires:les volumes d’importation pouvant être introduits en Suisse à un bas taux du contingent sont limités.Des importations en dehors du contingent tarifaire sont toutefois possibles mais elles sont frappées de droits de douane nettement plus élevés.Pour la plupart des contingents tarifaires,la répartition des périodes et des volumes d’importation relève de la compétence de l’OFAG.Les appels d’offres concernant les mises en adjudication et les répartitions sont publiés dans la Feuille officielle suisse du commerce.Dans le tiré à part consacré au rapport du Conseil fédéral sur les mesures tarifaires douanières «Publication de l’attribution des contingents tarifaires»,le lecteur intéressé trouvera un tableau détaillant les quantités attribuées et leur utilisation par les importateurs.De son côté,l’Administration fédérale des douanes (AFD) attribue les contingents tarifaires qui sont répartis dans l’ordre des dédouanements (système du «fur et à mesure à la frontière»).L’utilisation de ces contingents tarifaires peut être consultée sur le site www.zoll.admin.ch.
Lors de la répartition des contingents tarifaires,il importe que le jeu de la concurrence soit respecté.Pour ce faire,le plus simple consiste à répartir les quantités par le biais d’une mise aux enchères ou en appliquant le système du fur et à mesure à la frontière (ou par l’autorité délivrant les permis d’importation).Ces deux procédures allient la simplicité et l’efficacité dans l’exécution,d’où leur application croissante.Si la répartition des parts de contingent tarifaire se fait sur la base de la prestation en faveur de la production suisse ou des importations effectuées jusqu’alors par le requérant,ce système s’accompagne de mesures permettant à de nouveaux importateurs d’acquérir des droits d’importation.Garantir la concurrence exige aussi que les mêmes règles s’appliquent à tous les acteurs.La mise en place de réglementations transparentes et une information ciblée contribuent à empêcher les infractions.Si des irrégularités se produisent néanmoins,les importateurs ont tout intérêt à les faire constater et à les éliminer rapidement en évitant si possible de longues procédures.
De plus amples indications sont données ci-après sur les importations et exportations de produits transformés,ainsi que sur les recouvrements des droits à l’importation, deux domaines dans lesquels des mesures ont été mises en œuvre au cours de l’exercice sous revue pour améliorer l’efficacité.La première partie est consacrée au critère d’attribution «en fonction de la part de marché l’année précédente»
2.1 PRODUCTION ET VENTES 2.MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE 149 2
■ Réglementations d’importations placées sous le signe de l’efficacité
■ Comparaison de l’attribution des contingents tarifaires avant et après la prise en compte de la prestation en faveur de la production suisse
Pour la plupart des fruits frais et pour les légumes,l’attribution des parts de contingent tarifaire se fonde sur les importations de l’année précédente.Quant aux quatre produits – pommes,concombres à salade,tomates charnues et tomates ordinaires –depuis 2000,c’est la part de marché détenue l’année précédente qui sert de base de calcul.En d’autres termes,les importations et les prestations annoncées en faveur de la production suisse sont additionnées et, à partir de ce chiffre,on calcule et répartit les parts en pour cent entre les différents détenteurs de parts de contingent.Cela dit, l’achat de produits similaires directement auprès de l’exploitation de production indigène est considérée comme prestation en faveur de la production suisse.Les parts exprimées en pour cent servent au détenteur à calculer la part qui lui revient dans une partie de contingent tarifaire libérée.
L’attribution fondée sur la part de marché incite les intéressés à prendre en charge des marchandises suisses,en particulier pendant les périodes libres et les périodes de libération des contingents tarifaires.Reste à noter que ce mode d’attribution a l’inconvénient de demander un gros travail administratif lié aux procédures de déclaration et de contrôle ainsi qu’à l’enregistrement des déclarations.Avec la prestation en faveur de la production suisse,des entreprises commerciales qui auparavant opéraient exclusivement dans le commerce intérieur réussissent désormais à acquérir des droits d’importation.Comment ces droits sont-ils utilisés? Le tableau suivant montre une comparaison des parts de pommes et de tomates attribuées pour les périodes contingentaires 1999 et 2003,1999 étant la dernière période pour laquelle l’attribution des parts s’est faite exclusivement en fonction des importations de l’année précédente.
Attribution des parts de contingent tarifaire pour les pommes et les tomates en 1999 et 2003
CaractéristiquePommesTomates
Rapport prestation-importation pour le calcul des parts0:10088:120:10037:63
Entreprises / personnes détenant des parts de contingent tarifaireNombre189158189199 dont uniquement sur la base des importationsNombre-76-108 dont uniquement sur la base de la prestation en faveur de la production suisseNombre-20-20
Parts cédées à fins d’utilisation 1 %-52-26
Détenteurs ayant ensemble 75% des parts avant ou après la cession à fins d’utilisation 1 Nombre815/ 11 2129/ 23
Cumul des dix plus grandes parts avant et après la cession de parts à fins d’utilisation 1 %8063/ 73 5748/ 58
Remarque:L’attribution des parts pour la période contingentaire 1999 se fonde sur les importations de 1996 à 1998 pour les pommes et de 1998 pour les tomates,tandis que l’attribution des parts pour la période contingentaire 2003 repose sur les parts de marché en 2002 (pour les pommes,la période allant du 1er septembre 2001 au 31 août 2002,et non pas l’année civile,sert de base de calcul pour la prestation en faveur de la production suisse).
1 Depuis 1999,l’art.14 de l’ordonnance sur les importations agricoles autorise le transfert de parts de contingent tarifaire.Cette possibilité n’est toutefois effective que depuis 2000.Ne sont pas mentionnées les parts quantitatives qui sont cédées à fins d’utilisation lors de la libération de parties de contingent tarifaire.
Source:OFAG
2.1 PRODUCTION ET VENTES 2 150
1999200319992003
A la lumière de ce tableau,on observe les tendances suivantes:la concentration des droits d’importer est,avant la cession des parts de contingent non utilisées,plus faible qu’autrefois;par contre,elle atteint un niveau similaire et même en partie plus élevé après la cession.Les firmes détenant les plus grandes parts,en particulier,ont accaparé une plus grande partie du gâteau qu’auparavant.Pour les quatre produits concernés par le système d’attribution fondé sur la part de marché,la possibilité de céder des droits d’importation est beaucoup plus utilisée qu’en ce qui concerne la plupart des autres produits pour lesquels l’attribution repose sur les importations de l’année précédente.Pour ces derniers,le taux de cession ne dépasse qu’exceptionnellement les 10%;il est par exemple de 8,7% pour les abricots et de 6,8% pour le chou-fleur.En revanche,il s’élève à 25% pour les concombres à salade,les tomates charnues et les tomates ordinaires,respectivement.Quant aux pommes,c’est là que les parts quantitatives de contingent tarifaire sont le plus cédées à fins d’utilisation, à savoir plus de 50%.Cette évolution est en rapport direct avec la part indigène relativement importante qui atteint 88%.De manière générale,il est frappant de constater à quel point les parts attribuées sur la base d’activités commerciales enregistrées sont modifiées après coup par les accords de droit privé.Cette évolution est imputable aux marchands en bout de chaîne qui exigent des intermédiaires et des entreposeurs,en partie ou en totalité,la cession des droits d’importation que ceux-ci se voient attribuer en raison de la prise en charge directe des produits chez le producteur.Les entreprises commerciales proches des producteurs disposent néanmoins de droits d’importation plus élevés qu’auparavant.Le fait qu’elles cèdent de nombreuses parts s’explique,outre par les conditions de livraison précitées,peut-être aussi par les faibles besoins d’importation de ces entreprises.Au bout du compte,les grands distributeurs,qui sont aussi les plus grands marchands en bout de chaîne,possèdent les parts de contingent les plus importantes,principalement du fait de la cession des droits d’importation qui n’est devenue possible qu’à partir de 1999.D’un autre côté,les entreprises d’importation spécialisées sont les perdantes du nouveau système.
Après les événements de 2001,les exportations de produits transformés n’ont repris que timidement en 2002.A la fin de l’exercice sous revue,elles étaient au total en hausse de 4% par rapport à l’année précédente,un accroissement essentiellement attribuable aux produits transformés pur sucre.Le sucre qui sert à la fabrication de produits transformés destinés à l’exportation est presque exclusivement importé et exporté dans le cadre du trafic de perfectionnement.
Les exportations de beurre sous forme de produits transformés sont demeurées stables.Suite au maintien du système mixte pour le beurre (transformation du beurre dans le trafic de perfectionnement ou contributions à l’exportation),des contributions à l’exportation ont été sollicitées pour un beaucoup plus grand nombre d’exportations de beurre transformé.Le montant de 114,9 millions de francs inscrit au budget fédéral pour les contributions à l’exportation – et qui correspond au plafond fixé par l’OMC –, a non seulement été entièrement épuisé,mais en janvier 2003,il a fallu imputer sur le nouveau compte de l’année 2003 des paiements pour des exportations effectuées en décembre,s’élevant à environ 3,8 millions de francs.
La situation économique et le conflit irakien n’ont pas permis aux exportations de produits transformés d’évoluer de façon très positive.Les prix pratiqués dans le secteur laitier en Suisse et à l’étranger devraient suivre une tendance à peu près parallèle de
2.1 PRODUCTION ET VENTES 2.MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE 151 2
■
Importation et exportation de produits transformés («Schoggigesetz»)
sorte que la fourchette des prix pour les matières premières suisses et étrangères ne devrait pas s’ouvrir davantage.La hausse de prix survenue en Suisse pour la farine panifiable n’a eu qu’une incidence minime sur les contributions à l’exportation.
Sont également inclus dans les volumes d’exportation le beurre,la semoule de blé dur et le sucre qui sont importés et exportés dans le trafic de perfectionnement.

Quantités exportées en t Sources: AFD, OFAG 0 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 92 000 212 000 238 000 247 000 1991/92200020012002 Contributions à l'exportation en mio. de fr. Sources: AFD, OFAG 0 200 150 100 50 180 112 98 115 1991/92200020012002
2.1 PRODUCTION ET VENTES 2 152
■ Recouvrement des droits de douane par l’OFAG
En 2002,l’OFAG a facturé pour la première fois les recouvrements des droits de douane dus (y compris la TVA),et ce sur mandat de l’AFD.Des recouvrements échoient lorsque des entreprises d’importation dépassent les parts de contingent tarifaire qui leur ont été attribuées,ou importent des marchandises soumises à contingent sans disposer de parts pour ce faire.Cette délégation de tâches a donc pour objectif d’accélérer et de simplifier la procédure administrative.Le nouvel instrument permet avant tout aux importateurs faillibles,par l’acquittement des droits de douane dus,d’éliminer sans retard une grande part des irrégularités survenues lors de l’importation de produits agricoles.Le paiement des factures de l’OFAG est volontaire,celles-ci étant établies sans possibilité de recours et donc considérées au niveau procédural comme droit d’être entendu.Selon le régime des produits,les règles de conduite en matière de paiements sont respectées,de longues échéances ayant été accordées au cours de l’année transitoire 2002.Le tableau ci-après récapitule les principaux résultats de cette première période de recouvrement.
Recouvrement des droits à l'importation en 2002
Le nouveau système a conduit à réduire sensiblement le nombre des irrégularités devant être transmises à l’AFD pour la suite à donner.Concernant les régimes d’importation pour lesquels des factures mensuelles sont établies,on constate d’ores et déjà une amélioration quant au soin apporté aux déclarations douanières.En outre,les entreprises d’importation réagissent plus rapidement et font plus souvent usage de la possibilité qui leur est offerte d’intenter un recours dans les délais auprès de l’AFD en cas de dédouanements erronés.Certaines faiblesses du nouveau système sont encore apparues dans ce domaine (établissement des factures par l’OFAG parallèlement à la procédure de correction en cours à l’AFD).Pour prévenir les doublons,deux mesures
Groupe de produitsFactures dont factures en %transmises à FacturesFacturesen % OFAGpayéesl’AFD pour OFAGpayées encaissement1 fr.fr.%fr.NombreNombre% Fromage25 45825 458100,0044 100,0 Animaux de boucherie,viande506 379214 15742,3292 222362877,8 Produits de charcuterie 29 94513 61545,515 06810770,0 Viande de volaille84 21311 69313,972 5204250,0 Animaux de l’espèce chevaline253 403 115 69245,7137 711452248,9 Céréales panifiables8 9520 00200 Pommes de terre,y compris pommes de terre de semence et produits à base de pommes de terre82 90481 42298,21 482111090,9 Fleurs coupées357 05914 8994,2342 160211152,4 Fruits,légumes1 084 776918 20884,6141 37448944991,8 Légumes congelés1 5941 594100,0022 100,0 Fruits à cidre, produits de fruits26 1033 21812,3010220,0 Total2 460 7861 399 95656,91 002 53763453784,7
Sources:OFAG,AFD
1A l expiration du délai de paiement,l OFAG transmet les factures impayées à l AFD qui rend une décision sur le recouvrement des droits dus.Parmi ces cas,14 en tout portant sur un montant de 34 000 francs ont été liquidés suite au paiement (état au 19 septembre 2003).
2.1 PRODUCTION ET VENTES 2.MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE 2 153
■ Perspectives
s’imposent donc:l’accélération de la procédure de recours et une transmission plus rapide des corrections pour les déclarations douanières approuvées.On éviterait ainsi largement le remboursement de paiements.
Conformément aux art.7 et 13 de l’ordonnance sur l’importation et l’exportation de légumes,de fruits et de plantes horticoles,l’OFAG peut,dans le cas des fruits et des légumes frais,obliger l’importateur à s’acquitter du taux hors contingent pour les marchandises ayant été importées en trop lors du passage d’une période assortie d’importations au taux du contingent,illimitées en termes de volumes, à une période assortie de quantités limitées.En 2002,l’OFAG a constaté dans 21 cas que les stocks de carottes,de salades iceberg,de pommes ou d’abricots étaient trop importants et a édicté des décisions pour exiger le paiement de la différence entre le taux du contingent et le taux hors contingent,soit au total 57’776 francs.
A l’avenir,l’administration des parts individuelles de contingent tarifaire attribuées par l’OFAG devra se faire directement à la frontière.L’AFD a mis sur pied un projet en vue de moderniser et d’étendre le dédouanement électronique (redesign du dédouanement selon le modèle 90 ou déclaration électronique e-dec).Ce projet vise,entre autres, à empêcher que les importations de produits agricoles contingentés excèdent la part de contingent tarifaire d’un importateur.Le système doit être conçu de manière que,en pareils cas,une déclaration douanière soit impossible.L’administration des contingents pourra probablement se faire sous cette forme dès 2006.Ce changement de système va permettre la perception des droits de douane effectivement dus lorsque la marchandise passe la frontière de sorte que la longue et complexe procédure de recouvrement sera caduque.
Au plus tard lorsque le contrôle des contingents sera opérationnel à la frontière avec le système de déclaration électronique,il est prévu de supprimer le critère d’attribution «prestation fournie au fur et à mesure en faveur de la production suisse» qui est encore utilisé actuellement pour quelques produits.Il ne sera donc plus possible d’obtenir des droits d’importation par la prise en charge de produits similaires en Suisse pendant la même période.Ce mode d’attribution des parts de contingent tarifaire se caractérise non seulement par un important volume de travail administratif pour tous les intéressés,mais surtout par le fait qu’il n’est pas adapté à la gestion électronique des contingents au moment de l’importation.
Dans la procédure d’adjudication,il est envisagé de renoncer à l’avenir à la fixation, par personne,de parts maximales de contingent tarifaire.L’égalité de traitement dans l’exécution d’une telle limitation n’est pas possible en raison de l’imbrication fréquente entre les personnes physiques et morales,par exemple dans le cas de société mère et de sociétés affiliées.En outre,une telle limitation n’a guère de sens si,dans le même temps,des accords portant sur l’utilisation de parts de contingent tarifaire peuvent être conclus.Enfin,du point de vue du droit de la concurrence,il est également plus approprié de renoncer à cette restriction.
2.1 PRODUCTION ET VENTES 2 154
Mesures 2002/03
2.1.2Economie laitière
Conséquence des mauvais débouchés notamment à l’exportation,les organisations de l’économie laitière ont proposé en 2002 de réduire de 2% la quantité du contingent laitier.La modification de la LAgr décidée par le Parlement par voie d’urgence a permis au Conseil fédéral de mettre rapidement en œuvre cette mesure.La réduction du soutien,préimposée par l’enveloppe financière,s’est intégralement répercutée sur les aides,dont certains taux (aides accordées dans le pays pour le fromage) ont été ramenés à zéro.
ProduitFromageBeurreLait écrémé Poudre de laitLait de consommation, crème,produit à base de lait frais
1pour utilisations particulières seulement
2 en cas de renonciation à l importation seulement
3 différenciées selon les sortes de fromage et la destination (UE/autres pays)
4 pas pour le lait de consommation
Source:OFAG
Avec le supplément pour le lait transformé en fromage et le supplément de nonensilage,les mesures de soutien restent focalisées sur le fromage.

■■■■■■■■■■■■■■■■
Mesure Protection douanière ■■■■■ Suppléments ■ Aides accordées dans le pays ■ 1 ■ 1 ■ 2 Aides à l’exportation ■ 3 ■■ 4
2.1 PRODUCTION ET VENTES 155 2
■ Moyens financiers en 2002

La Confédération a encore réduit ses dépenses en faveur de l’économie laitière en 2002.C’est ainsi que le montant disponible,soit 600,6 millions de francs,a diminué de quelque 66 millions de francs (–10%) par rapport à l’année précédente.Au cours de l’exercice considéré,la Confédération a adopté différentes mesures qui ont nécessité l’allocation de moyens supplémentaires s’élevant à 152,9 millions de francs (cf.turbulences sur le marché du lait).
Répartition des moyens en 2002
Total 600,6 mio. de fr.
1%
Suppléments 60%
Source: OFAG
Le soutien des prix dans le domaine laitier a requis un montant total de 600,6 millions de francs,dont 410,1 millions de francs (68,3%) ont été alloués au secteur du fromage.Le beurre a bénéficié de 92,9 millions de francs (15,5%),contre 90,6 millions (15,1%) pour la fabrication de lait en poudre et d’autres produits laitiers.Comme l’année précédente,les charges administratives se sont montées à 7,0 millions de francs (1,1%).
Aides dans le pays 26%
Aides à l'exportation 13%
2.1 PRODUCTION ET VENTES 2 156
Administration
■ Une année difficile pour l’économie laitière
Turbulences sur le marché du lait
En 2002,la branche laitière s’est trouvée confrontée à des enjeux de taille,dont les répercussions se font encore ressentir cette année:
– pertes notables de parts de marché sur les marchés fromagers à l’étranger;
– stocks de fromage supérieurs à la moyenne;
–évolution dans la mise en valeur du lait,marquée par une baisse de la production fromagère et un accroissement de la fabrication de beurre ainsi que de poudre de lait écrémé et entier;
– stocks de beurre et de poudre de lait écrémé supérieurs à la moyenne;
– manque de possibilité pour des importations de beurre;
– difficultés financières de Swiss Dairy Food SA,le plus grand utilisateur de lait,qui a demandé un sursis concordataire le 22 septembre 2002.
Le contexte difficile dans lequel a évolué l’économie laitière a également incité la Confédération à prendre les mesures extraordinaires suivantes:
– en liaison avec la prorogation du délai de remboursement,report d’une année pour la tranche d’amortissement annuelle de 30,6 millions de francs concernant les prêts servant à financer les stocks de fromage;
– octroi de prêts productifs d’intérêt et remboursables pour un montant de 65 millions de francs aux interprofessions afin de réduire les stocks excessifs de fromage et de poudre de lait;
– prise en charge du versement de la paie du lait à plusieurs milliers de fournisseurs laitiers de Swiss Dairy Food SA entre le 1er août et le 22 septembre 2002,pour un montant de 57,3 millions de francs.La démarche de la Confédération a reçu le soutien des banques qui ont consenti un crédit à la masse,permettant ainsi après le 22 septembre 2002 la mise en valeur du lait et la cession de parties de l’entreprise au cours de la procédure de sursis concordataire.Les travaux de liquidation ont pu être en grande partie bouclés au printemps 2003.Ces mesures ont été financées par des moyens financiers non épuisés,prélevés sur d’autres secteurs.
■ Message concernant la modification de la loi sur l’agriculture par voie d’urgence
Au vu de la situation difficile régnant sur le marché du lait,une étape intermédiaire s’imposait dans la mise en œuvre de la Politique agricole 2007 afin de pouvoir accorder à la filière une plus grande marge de manœuvre et lui confier les responsabilités en conséquence.Pour le Conseil fédéral,l’objectif consistait à rendre,dans certaines conditions,les décisions et propositions de la filière plus contraignantes en ce qui concerne les quantités de lait.
Le 16 octobre 2002,le Conseil fédéral a donc proposé au Parlement une révision de l’art.31 LAgr qui permet une adaptation différenciée de la quantité de lait aux besoins du marché.Le message concernant la modification de la LAgr par voie d’urgence montre deux solutions possibles pour l’adaptation du contingent laitier.D’une part, l’ensemble de la branche peut présenter au Conseil fédéral une proposition collective en vue d’adapter le contingent,mais seulement pour les années laitières 2002/03 et 2003/04.D’autre part,les diverses interprofessions peuvent proposer leurs contingents séparément.Le Parlement a approuvé ces modifications durant la session d’hiver 2002.
2.1 PRODUCTION ET VENTES 2.MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE 157 2
Fin 2002,il était évident que l’ensemble de la branche avait besoin d’une adaptation des contingents.Une telle mesure limitée dans le temps selon le droit d’urgence implique toutefois que les décisions des organisations tant des utilisateurs de lait que des producteurs aillent dans le même sens.Du fait de la modification de la loi,les acteurs de la filière du lait sont associés plus tôt à l’adaptation du contingent et en partagent aussi la responsabilité plus tôt.
L’ensemble de la filière,c’est-à-dire la Fédération des Producteurs Suisses de Lait (PSL), l’Association de l’industrie laitière suisse (AIL) et Fromarte,a saisi cette occasion pour adapter le volume total de lait.En décembre 2002,la demande collective portant sur une réduction de 2% de la quantité de lait pour l’année laitière 2002/03 a été présentée au Conseil fédéral.
En avril 2003,la PSL,l’AIL et Fromarte ont proposé une autre réduction de 2,5% de la quantité de lait pour l’année laitière 2003/04.Ces deux demandes ont permis de réduire la quantité de lait de 104,5 à 100% des contingents de base.

La deuxième réglementation,nouvelle elle aussi,prévoit par exemple que l’interprofession d’un fromage déterminé décide de modifier les quantités et que le Conseil fédéral concrétise cette décision dans l’ordonnance sur le contingentement laitier.Ceci sera possible si
– la décision de l’interprofession satisfait aux exigences de la LAgr;
– la garantie existe que la quantité fixée sera mise en valeur et commercialisée sous la responsabilité de l’interprofession;
– la garantie existe que l’interprofession prend en compte les conditions régnant sur les différents marchés partiels tels que le marché bio ou les marchés régionaux.
Aucune interprofession n’a eu recours à cette mesure jusqu’à l’été 2003.Dans le cadre de la Politique agricole 2007,cette possibilité sera aussi laissée aux diverses interprofessions.Après la modification de la LAgr au 1er janvier 2004,le droit d’urgence sera transposé dans le droit ordinaire.
2.1 PRODUCTION ET VENTES 2 158
Fromarte AIL Utilisateurs Producteurs PSL Modification de l'OCL par le CF Demande au CF Décision commune Source: OFAG Entente
Lait industrielLait produit sans ensilage
■ Le commerce des contingents laitiers garde son attrait
Contingentement laitier
Durant l’année laitière 2001/02,36’231 producteurs ont commercialisé du lait,soit une baisse de 4,9% par rapport à l’année précédente.Ce taux est presque deux fois plus élevé que le taux de recul moyen de 2,5% au cours des périodes 1995/1996 à 1999/2000.Quant au contingent moyen par exploitation,il a pour la première fois dépassé le seuil des 80'000 kg dans toute la Suisse,s’établissant à 83'407 kg.En augmentation de 4'226 kg ou de 5,3% par rapport à l’année précédente,celui-ci est supérieur de plus d’un quart à celui de la période 1995/96.
En dépit de l’augmentation générale des quantités,de l’ordre de 3%,au cours de l’année laitière 2001/02,les surlivraisons dépassant la quantité contingentaire de plus de 5'000 kg et assujetties à la taxe ont atteint la quantité record de 7'341 t.Les taxes ainsi perçues au profit de la caisse fédérale se sont élevées à quelque 4,4 millions de francs.
Le commerce des contingents reste une mesure très appréciée:3’948 producteurs ont acheté des contingents durant l’année laitière 2002/03 tandis que 8’806 producteurs en ont loués.La quantité transférée a atteint environ 234’506 t,soit 7,8% du contingent de base.A la fin de l’année laitière,115’861 t de contingents loués ont été retournés à leur propriétaire.
1 données définitives
2 données
Depuis l’introduction du commerce des contingents en 1999,quelque 208'100 t de contingents ont été définitivement achetées.Au cours de l’année laitière 2001/02,la quantité contingentaire louée s’est élevée en tout à 380'500 t.Dans l’ensemble,ce sont donc 588'600 t ou près de 20% du contingent de base qui ont été traits par d’autres producteurs du fait d’un transfert de contingent indépendant de la surface.
2.1 PRODUCTION ET VENTES 2.MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE 159 2
Commerce des contingents 2000/01 1 2001/02 1 2002/03 2 VenteUnité Producteurs concernésNombre2 8202 4552 655 Quantité totale de laitmio.de kg73,572,491,8 par transfertkg26 07229 49034 592 Location Producteurs concernésNombre7 8137 3166 684 Quantité totale de laitmio.de kg155,8140,8142,7 par transfertkg19 94719 24521 345
provisoiresSource:OFAG
■ Administration des contingents supplémentaires
Introduit avec le contingentement laitier,le système du contingent supplémentaire pour les animaux achetés dans la région de montagne,qui s’élève actuellement à 2000 kg de lait,a été légèrement modifié à l’avantage des agriculteurs.
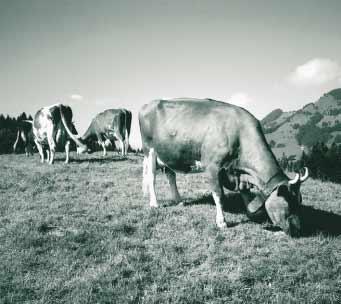
L’extension de la période d’achat à l’année entière,de même que la renonciation à l'inscription obligatoire des animaux achetés au herd-book et une modification des fonctions assumées par les teneurs de registres généalogiques au 1er janvier 2002 ont rendu plus difficile le contrôle des exigences auxquelles doivent satisfaire les animaux achetés.
Les services cantonaux compétents et l’OFAG ont donc décidé de gérer à l’avenir les contingents supplémentaires sur la base des données disponibles dans la Banque de données sur le trafic des animaux (BDTA) et dans le système d'information sur la politique agricole (SIPA).Avec la modification de l’ordonnance sur le contingentement laitier entrée en vigueur le 1er janvier 2003,le Conseil fédéral a consacré ce changement de système.
Depuis le 1er janvier 2003,des contingents laitiers pour les animaux achetés dans la région de montagne peuvent désormais être demandés auprès de la BDTA.
La BDTA contient en principe toutes les données nécessaires à un historique complet des animaux (traçabilité de tous les séjours).Cependant,en raison d'annonces incomplètes,la banque de données présente actuellement certaines lacunes de sorte qu'un contrôle électronique exhaustif s'avère encore impossible.Si l'historique des animaux est incomplet,il est néanmoins possible,en 2003,de fournir aux cantons une copie des documents d’accompagnement prouvant que l’animal a été gardé,avant l’achat,au moins 22 mois sans interruption dans la région de montagne.Les services cantonaux transmettent à l’OFAG les pièces justificatives accompagnant le préavis d’approbation ou de rejet.Une fois la demande contrôlée,c'est la fédération laitière qui attribue le contingent supplémentaire.
La nouvelle réglementation en matière de demandes vise,d’une part, à simplifier la gestion et,d'autre part, à améliorer la discipline en ce qui concerne les notifications faites à la BDTA.C’est pourquoi la réglementation transitoire ne sera applicable qu’en 2003.A partir du 1er janvier 2004,les acheteurs ne pourront faire valoir le droit à un contingent supplémentaire que si la traçabilité intégrale de l’animal est assurée.
Soutien du marché par le biais des aides et des suppléments
L'instrumentaire utilisé pour le soutien du marché n'a pas changé durant l'année sous revue.Il n'en demeure pas moins que la réduction du soutien a donné lieu à des coupes parfois sévères dans les aides accordées.La dégradation de la situation sur le marché laitier au cours de l'année 2002 et le recul des exportations de fromages ne sont toutefois pas imputables à cette réduction du soutien.Des adaptations de prix qui,au fond,auraient été nécessaires en raison de la situation de plus en plus tendue sur le marché n'ont pas été effectuées ou sont survenues trop tardivement.Dans ce contexte,le Conseil fédéral a émis un signal en abaissant de 77 à 73 centimes le prixcible du kilogramme de lait contenant en tout 73 g de matière grasse et de protéines.
2.1 PRODUCTION ET VENTES 2 160
■ Activités de contrôle dans le domaine laitier
Les activités de contrôle de l'OFAG,des plus diverses,touchent à de nombreux domaines.Outre les contrôles effectués par l'inspectorat interne à l'office,les sections spécialisées assument des fonctions de contrôle dans deux secteurs.
Ainsi,elles vérifient l'exécution du contingentement laitier,laquelle est confiée aux services administratifs du contingentement laitier (généralement,il s'agit des fédérations laitières régionales).Ce contrôle comprend aussi bien une vérification de l'activité de ces services au sens strict,comme les contrôles périodiques de l'accomplissement des tâches définies dans le mandat de prestations,que le contrôle des résultats découlant de l'application des dispositions d'exécution.
C'est le deuxième volet qui est plus spécialement abordé dans le présent rapport. Il s'agit en l'occurrence des activités de contrôle intervenant dans le cadre des mesures de soutien du prix du lait.Là aussi,le mandat relatif à la gestion des suppléments et aides a été confié à un service externe, à savoir la Fiduciaire de l'économie laitière S.à.r.l.(TSM),lors de la réorganisation du marché laitier au 1er mai 1999.Parallèlement aux contrôles de l'inspectorat,les sections spécialisées assument de vastes tâches pour superviser le mandat de prestations et liquider les irrégularités constatées.Les montants en jeu sont considérables;il s'agit chaque mois d'environ 50 millions de francs qui sont versés aux utilisateurs de lait et aux exportateurs.Cet ordre de grandeur rend nécessaire l'exercice d'un contrôle sans failles et aussi efficace que possible à différents niveaux.
Fonction de surveillance de l'OFAG
La section spécialisée vérifie par sondage le travail de la TSM pour s'assurer que celleci a saisi correctement les données des utilisateurs de lait soumis à déclaration et que les divers requérants existent bel et bien et sont habilités à présenter une demande. C'est ainsi que 25 demandes sélectionnées au hasard sont vérifiées chaque mois.Ces contrôles n'exigent que rarement des retours d'information ou des corrections;en d'autres termes,la TSM exécute avec soin et diligence les tâches qui lui ont été confiées.
Contrôle approximatif par la TSM
L'administration des suppléments et des aides a nécessité le développement d'un système TED pour permettre à la TSM d'enregistrer toutes les données des requérants, c'est-à-dire des utilisateurs et des exportateurs.A ce niveau déjà ont lieu les premiers contrôles (respect des délais,dossier complet,erreurs manifestes,etc.).Dans le cadre des préparatifs de paiement par la TSM,le système effectue automatiquement une série d'analyses pour contrôler minutieusement toutes les personnes soumises à déclaration.Ces analyses servent aussi à préparer le travail des inspecteurs et sont à la disposition des sections spécialisées qui procèdent aux contrôles complémentaires. Avec le système TED,il est possible d'effectuer des calculs de plausibilité en vérifiant l’exactitude de certaines indications ou de détecter des défauts et leurs répercussions (p.ex.suppléments ou aides perçus à tort).Enfin,ces analyses livrent de précieux indices à l'inspectorat qui peut alors procéder à des contrôles ciblés.
2.1 PRODUCTION ET VENTES 2.MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE 161 2
Contrôle sur place par l'inspectorat
Si des infractions aux dispositions du contingentement laitier ou au soutien du prix du lait sont finalement constatées dans les exploitations contrôlées,l'inspectorat dresse un rapport de contrôle.Les cas sans importance sont directement liquidés par l'inspectorat qui envoie une communication aux intéressés.Les dossiers dénotant des infractions qui exigent des mesures administratives sont transmis aux sections spécialisées.
Les sections spécialisées enregistrent les cas litigieux et effectuent un contrôle des affaires afin de clarifier si et quelles sanctions doivent être prises à l'encontre des personnes faillibles.Pour garantir l'égalité de traitement,un catalogue de sanctions a été établi.Celui-ci énonce les règles comme le rétablissement de l'état conforme au droit en cas d'infractions aux dispositions de l'économie laitière et les sanctions à prendre.Avant qu'une décision soit rendue,les intéressés ont le droit d'être entendu, mais une fois que la décision est entrée en force,la section spécialisée veille à imposer par exemple le remboursement des aides perçues à tort ou la réduction d'un contingent.
Contrôles
CaractéristiqueNombre Rapports de l'inspectorat comportant des réclamations207
Cas liquidés154 dont cas ayant fait l'objet d'un contrôle insuffisant de l'utilisation du lait91 dont cas comportant des indications erronées dans la demande de suppléments ou d'aides45 dont cas dénotant une infraction au contingentement laitier18
Cas en cours de traitement38
Cas en suspens15
Demandes de remboursement
Cas20
Montant en fr.53 754
Emoluments perçus
Cas34
Montant en fr.6 580
Source:OFAG
Cette activité de contrôle a pour principal objectif de faire respecter les prescriptions et d’assurer que les deniers publics utilisés pour le soutien du marché laitier soient sollicités et répartis conformément à la loi.Elle contribue aussi à garantir le bon fonctionnement des mesures.Le caractère exhaustif et la bonne qualité des données sont d'une importance cruciale non seulement pour le versement des suppléments et des aides mais aussi pour la fiabilité des statistiques dans le domaine laitier.C'est pourquoi l'OFAG ne souhaite pas simplement créer un état conforme au droit et prendre à l'encontre des intéressés les mesures administratives fixées mais,par des mesures modérées,inciter les intéressés à faire preuve d'une meilleure discipline en matière d'annonces dans les cas ne faisant pas l'objet d'actes punissables.
2.1 PRODUCTION ET VENTES 2 162
de la section spécialisée en 2002
Mesures 2002
2.1.3 Economie animale
La protection douanière sous la forme de droits de douane et de contingents tarifaires est le principal instrument appliqué dans le soutien de la production de viande suisse. Des aides sont en outre versées pour le marché de la viande et celui des œufs ainsi que pour l'exportation d'animaux d'élevage et de rente.
1 bétail d’élevage et de rente uniquement Source:OFAG
Des contributions pour la construction et la transformation de systèmes de stabulation respectueux de l’espèce,servant à la garde de volaille destinée à la production d'œufs, ont été versées pour la première fois en 2002.Par contre,les contributions aux frais de ramassage et de calibrage des œufs de consommation ont été supprimées au terme d'une période transitoire de cinq ans, échue le 31 décembre 2001.
Grâce à la situation favorable sur le marché,il n’a pas été nécessaire de prendre certaines des mesures d'allégement envisageables:Proviande a ainsi renoncé aux mesures de dégagement des abattoirs pour les animaux des espèces bovine,chevaline et porcine.De plus,aucune aide financière de la Confédération n’a été requise,ni pour le stockage de viande de bœuf et de porc,ni pour la vente à prix réduits de viande de veau et de porc.
2.1 PRODUCTION ET VENTES 2.MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE 163 2
■■■■■■■■■■■■■■■■
Animal/produitBovinVeauPorcChevalMoutonChèvreVolaille Œufs Mesure Protection douanière ■■■■■■■■ Dégagement des marchés publics ■■■ Dégagement des abattoirs ■■■■■ Campagnes de stockage ■■■ Campagnes de vente à prix réduits ■■■ Essais axés sur la pratique ■ Contributions à la reconversion ■ Contributions à l’investissement pour la construction de poulaillers ■ Campagnes d’œufs cassés et mesures de commercialisation ■ Contributions à la mise en valeur de la laine de mouton ■ Contributions à l’exportation 1 ■■■■ Effectifs maximums ■■■■
■ Moyens financiers en 2002
Sur les 46,3 millions de francs inscrits au budget fédéral pour les mesures en faveur de l'économie animale,seul un montant de 20,3 millions de francs a été dépensé.Les fonds restants ont en grande partie été alloués à d'autres secteurs par le biais de crédits supplémentaires:2 millions de francs ont été octroyés à la campagne en vue de la mise en valeur non alcoolique de raisins,6 millions de francs à l'élimination des déchets d'abattage et de viande et 10,8 millions de francs ont servi à acquitter les créances de paie du lait des fournisseurs de Swiss Dairy Food.En vertu de l'ordonnance sur les œufs,3 millions de francs ont par ailleurs été affectés au cofinancement de paiements directs alloués pour la garde de poules pondeuses particulièrement respectueuse des animaux.Le recul des dépenses dans l'économie animale est principalement attribuable à la situation réjouissante prévalant sur le marché de la viande et sur celui des œufs,ainsi qu'aux restrictions concernant l’exportation d'animaux d'élevage et de rente.Certes,l'Allemagne et la France autorisent depuis le 30 novembre 2001 et le 3 mai 2002 respectivement l'importation de bétail suisse,mais l'Italie,jadis notre meilleur client,maintient toujours son interdiction d'importer.Grâce à la consommation de viande bovine en hausse de quelque 10%,il n'a pas été nécessaire d’intervenir sur le marché comme cela était habituellement le cas au second semestre.En outre,les fonds disponibles pour des mesures saisonnières de mise en valeur des œufs sur le marché n'ont pas été entièrement utilisés.

Répartition des fonds 2002
Total 20,3 mio. de fr.
Contributions destinées au soutien de la production d'œufs suisses 18%
Contributions à la mise en valeur de laine de mouton 4%
Contributions au stockage et à la réduction des prix de viande de bœuf et de veau 30%
Sources: Compte d'Etat, OFAG
Aides à l'exportation de bétail d'élevage et de rente 11%
Convention de prestations Proviande 37%
2.1 PRODUCTION ET VENTES 2 164
■ Bétail de boucherie et viande:conventions de prestations
Depuis le 1er janvier 2000,Proviande fournit des prestations de services sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande pour le compte de l'OFAG.Les mandats sont financés par le biais du fonds «viande»
1.Taxation neutre de la qualité dans les abattoirs et sur les marchés publics surveillés
Le service de classification de Proviande a taxé 80 à 90% des animaux abattus ainsi que tous les animaux sur pied admis sur les marchés publics.Plus d’une centaine de collaborateurs de Proviande employés à plein temps ou à temps partiel ont accompli cette mission qui a nécessité plus de 53'000 heures de travail.
Concernant la classification des carcasses de porcs,quatre entreprises en Suisse se servent déjà d’Autofom pour apprécier le pourcentage de viande maigre comme critère de qualité.L’Autofom est un appareil de classification très complexe fonctionnant de façon entièrement automatique,qui permet d’estimer le pourcentage de viande maigre sur la base de plusieurs centaines de mesures.L’emploi des autres appareils autorisés dans la classification des carcasses de porcs,tels que le Fat-O-Meater ou le CSB-UltraMeater exige une main-d’œuvre plus importante.La valeur moyenne de la proportion de viande maigre relevée dans un échantillon de 850'000 abattages (30% de tous les abattages) s’est élevée à 55%.
L’évaluation de la qualité des animaux abattus des espèces bovine,ovine,caprine et chevaline se base sur l’impression visuelle des carcasses.La classe de charnure et celle de tissu gras sur la carcasse est évaluée au moyen d’illustrations de référence.L’échelle CH-TAX pour l’évaluation de la charnure comporte cinq classes:C = très bien en viande,H = bien en viande,T = charnure moyenne,A = charnure faible,X = très décharné.Cinq classes ont également été déterminées pour évaluer la couverture de graisse.Pour les animaux sur pied des espèces bovine et ovine,des experts en classification utilisent les touches habituelles afin de déterminer la qualité selon le système CH-TAX.
L’évaluation d’un échantillon de données provenant des résultats de la taxation de la qualité en 2002 fait apparaître des différences manifestes entre les taureaux et les vaches.Les données fournies proviennent de 10 abattoirs réalisant au total quelque 40% de tous les abattages de bovins.S’agissant des taureaux,33% des animaux ont été attribués aux classes supérieures C et H,61% à la classe moyenne T et 6% seulement aux moins bonnes classes que sont A et X.Pour ce qui est des vaches,par contre, seuls 2% ont atteint les deux meilleures classes C et H,alors que 42% répondaient aux critères de la classe moyenne T et 56% à ceux des deux dernières classes.Les agneaux ont majoritairement (57%) été attribués à la classe des carcasses de charnure moyenne (T),et deux tiers des cabris abattus ont été classés par les experts comme bien en viande (H).
2.1 PRODUCTION ET VENTES 2.MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE 165 2
Ventilation des carcasses en fonction des classes de charnure 2002
2.Surveillance des abattoirs et allégement du marché
En collaboration avec des organisations paysannes et/ou des autorités cantonales, Proviande a organisé sur 75 places des marchés de gros bétail,sur 19 places des marchés de veaux et sur 101 places des marchés de moutons dans 19,7 et 16 cantons respectivement.Des marchés,organisés sur d’autres places disposant d’une infrastructure appropriée,ont par ailleurs eu lieu entre le 15 novembre 2001 et le 15 mars 2002 pour les troupeaux transhumants de moutonset d’agneaux.Les marchés de gros bétail servent en premier lieu au commerce de vaches laitières.Les taureaux et les bœufs sont moins nombreux,car les agriculteurs les vendent en général directement au commerce ou aux abattoirs.S’agissant du nombre d’animaux admis sur les marchés,il a augmenté de 15% par rapport à 2001 en ce qui concerne les ovins et a baissé de 5% pour le gros bétail,alors que le nombre de veaux est resté stable.En regard de l’année dernière,Proviande a attribué environ un tiers d’animaux en moins aux détenteurs de parts de contingents tarifaires ayant l’obligation de participer au dégagement du marché,soit 2'029 têtes de gros bétail et 1'614 moutons et agneaux.Quant aux marchés de veaux,il n’est resté que 139 animaux à prendre en charge.
2.1 PRODUCTION ET VENTES 2 166
en %
C
VachesTaureauxVeaux Classe de charnure AgneauxCabris 0 70 50 60 40 30 20 10
Source: Proviande
H T A X
Chiffres concernant les marchés publics surveillés en 2002
ParamètreUnité VeauxGros bétailMoutons
Marchés publics surveillésNombre473899308
Animaux admisTêtes52 96069 13375 937
Part d’animaux admis à tous les abattages%171826
Animaux attribués
(dégagement du marché)Têtes1392 0291 614
Source:Proviande
Par rapport à 2001,la situation sur le marché de la viande de bœuf s’est améliorée durant l’année considérée.Des aides étatiques ont été allouées pour le stockage de 1'061 t de viande de veau et pour la vente à prix réduit de quelque 4'500 cuisses de bœuf.Proviande a surveillé le respect des prescriptions pertinentes et l’OFAG a versé des contributions pour un montant de 6 millions de francs.Tous les stocks de viande,y compris les 2'200 t de viande de bœuf datant de 2001,pourront être écoulés d’ici la fin de l’année sous rapport.

3.Enregistrement et contrôle des demandes de parts de contingents tarifaires
En 2002,les demandes ont une fois de plus reculé en regard de l’année précédente (–886 ou –5%).Proviande a vérifié les annonces concernant les prestations fournies en faveur de la production suisse quant à leur exactitude et à leur plausibilité.Elle a contrôlé la quantité des morceaux parés salés de la cuisse de bœuf une fois dans chaque exploitation,tandis que les autres prestations,telles que les abattages et les achats d’aloyaux,ont fait l’objet de contrôles par échantillonnage.Les données concernant les prestations en faveur de la production suisse saisies et vérifiées par Proviande ont été transmises à l’OFAG,qui s’en est servi pour attribuer,par voie de décision,des parts de contingents tarifaires à 872 personnes physiques et morales le 21 novembre 2002:745 parts de viande de bovins (sans morceaux parés de la cuisse de bœuf), 450 de viande de porc,203 de viande d’ovins,155 parts de morceaux parés de la cuisse de bœuf,36 de viande d’équidés et 34 de viande de caprins.14 demandes déposées tardivement ou ne répondant pas aux exigences relatives à la prestation en faveur de la production suisse n’ont pas été acceptées.
2.1 PRODUCTION ET VENTES 2.MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE 167 2
■ Mise en valeur de la laine
La garde de moutons produit,en Suisse,quelque 900 t de laine annuellement,dont 40 à 45% sont pris en charge et commercialisés par la Centrale suisse de la laine indigène de la Fédération suisse d'élevage ovin.Un tiers environ est éliminé comme déchet et le dernier quart est écoulé en vente directe par les éleveurs de moutons. Depuis toujours,la laine est utilisée comme matière première pour la fabrication de textiles.Elle peut aussi servir de matériau d’isolation et d’insonorisation.La demande de l’industrie textile suisse étant insuffisante,la laine collectée,triée et pressée par la Centrale de la laine indigène est en majeure partie exportée au prix du marché mondial.En 2002,la Confédération a octroyé à la Centrale 0,8 million de francs pour la mise en valeur de la laine suisse.Un quart de ce montant a été utilisé pour couvrir une partie des coûts d’exploitation,le reste a été versé aux producteurs pour la laine livrée.
■ Évolution structurelle dans le commerce de viande et de produits carnés
A l’instar de l’agriculture,certains secteurs des branches de la viande en aval subissent une évolution structurelle considérable.Ainsi,le nombre de boucheries dont l’activité principale est la vente de viande et de produits carnés a baissé de 2'659 en 1991 à 1'871 en 2001 (–29,6%).Durant la même période,le nombre de personnes employées dans ces entreprises a reculé d’un tiers,passant à 9'300.Ces chiffres ne comprennent pas les magasins ne pratiquant pas la vente de viande et de produits carnés comme activité principale,c’est-à-dire surtout les grands distributeurs ou les épiceries offrant une large palette de produits (lait,légumes,fruits,viande,etc.).Seuls 40% environ des boucheries abattent chaque année plus de 30 têtes de gros bétail ou 100 porcs.Deux tiers en abattent moins,voire pas du tout et s’approvisionnent en viande principalement auprès des abattoirs professionnels.L’abattage de bovins,porcs,moutons, chèvres et chevaux a été l’activité principale de 97 entreprises en 2001,l’abattage de volaille de 10 et la transformation de viande de 155 entreprises.Dans ces branches,le nombre d’entreprises est relativement stable depuis 1995.Les entreprises d’abattage et de transformation ont occupé quelque 11'000 personnes en 2001.
■ Pêche et pisciculture: petits secteurs
En vertu de la LAgr,les pouvoirs publics soutiennent des améliorations structurelles et la promotion de la qualité et des ventes dans les secteurs de la pêche professionnelle et de la pisciculture.Ils n’allouent cependant pas de fonds pour l’allégement du marché ni des paiements directs.Suite à une réorganisation du recensement statistique en 2000,on comptait 83 lieux de travail pour la pisciculture et 224 pour la pêche exercée à titre professionnel.Dans la même année,les deux branches employaient 644 personnes,dont 437 à plein temps.
2.1 PRODUCTION ET VENTES 2 168
■ Œufs:soutien de la production suisse et mesures de mise en valeur
La caisse de compensation des prix des œufs et des produits à base d'œufs est alimentée par des parts de droits de douane à affectation spéciale.Dans l’année sous rapport,12,5 millions de francs étaient ainsi disponibles pour le soutien de la production d’œufs suisses et des mesures de mise en valeur.
Depuis le 1er janvier 2002,l’OFAG octroie des contributions à l’investissement pour la transformation et la construction de poulaillers conformes aux besoins des animaux. Ces contributions,versées uniquement pour la volaille destinée à la production d’œufs, ne sont pas grevées d’intérêts ni remboursables.L’OFAG a ainsi accordé un soutien à 17 exploitations de pondeuses,5 exploitations de poulettes et 1 exploitation détenant des pondeuses et des poulettes,pour un total de 415'000 francs dont 248'000 francs ont été versés durant l’exercice considéré.Les exploitations concernées gardent en moyenne environ 3'800 animaux.Les agriculteurs ont surtout aménagé des aires à climat extérieur (ACE),qui doivent présenter une surface couverte avec suffisamment de litière à l’extérieur du poulailler.L’ACE est exigée en rapport avec les programmes SST et SRPA.
La demande d’œufs suisses est particulièrement faible après Pâques et durant les mois d’été,comparé aux périodes précédant Noël et Pâques.Pour atténuer les effets de ces variations saisonnières,l’OFAG a débloqué 3 millions de francs pour des mesures de mise en valeur.Les fabricants de produits à base d'œufs ont cassé 18,6 millions d'œufs suisses excédentaires.Ils ont reçu à cet effet une contribution de 9 centimes par œuf. Les fournisseurs ont vendu 12,6 millions d’œufs à prix réduit au profit des consommateurs,grâce à un soutien de 5 centimes par pièce.L’OFAG a vérifié par des contrôles à domicile et l’examen de justificatifs que les dispositions relatives aux campagnes d’œufs cassés et de ventes à prix réduit étaient observées.
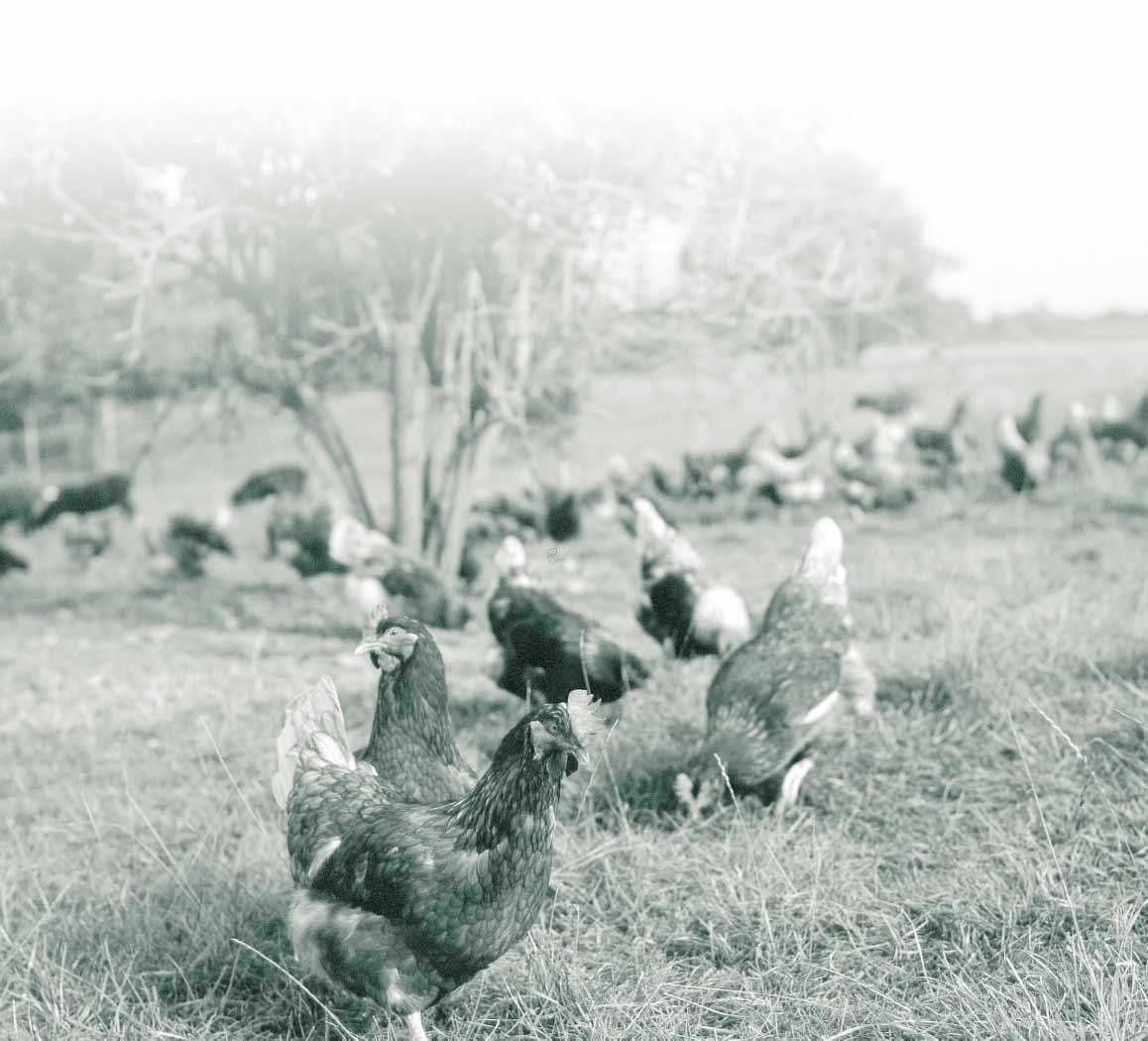
2.1 PRODUCTION ET VENTES 169 2
En 2002,l’OFAG a contribué financièrement à des essais axés sur la pratique dans le domaine de la volaille,ainsi qu’à la diffusion des résultats dans le cadre de la formation et de la vulgarisation,en allouant un montant de 319'000 francs.Ce soutien a été accordé à l’Aviforum à Zollikofen,au Centre spécialisé dans la détention convenable de la volaille et des lapins à Zollikofen et à l’Irab à Frick.Plusieurs projets ont ainsi bénéficié de fonds prélevés sur la caisse de compensation des prix des œufs et des produits à base d'œufs:optimisation de la garde de poules pondeuses avec sortie sur prairie / gestion et élevage;rognage du bec chez les poussins d’un jour de poules pondeuses en Suisse:fréquence des malformations consécutives à l’intervention; répercussions de l’alimentation des poulettes avec du froment entier sur les pondeuses;comparaison des effets du coupage et de l’épointage des becs des poussins d’un jour sur le développement et le rendement des poulettes et pondeuses brunes; épreuves de performance de ponte des pondeuses en détention au sol.
La suppression au 31 décembre 2001 des contributions aux frais de ramassage et de calibrage a réduit le soutien du marché des œufs de quelque 3,3 millions de francs par an.Contrairement aux pronostics des acheteurs d’œufs,cette réduction n’a pas provoqué de pression sur les prix à la production;ceux-ci ont même augmenté d’environ 1 centime par pièce.On peut en conclure que les contributions aux frais de ramassage et de calibrage n’ont pas été une mesure de soutien efficace.
L’OFAG a publié et mis en adjudication le contingent tarifaire «Animaux de l'espèce chevaline (sans les animaux d'élevage,les ânes,les bardots et les mulets)» en deux tranches de 1'461 têtes chacune.Les deux fois,plus de 200 personnes ont fait des offres pour un total de plus de 2'000 têtes.Le prix d’adjudication moyen s’est monté à 360 francs par cheval de rente et de sport.Les recettes de 1 million de francs ont été versées dans la caisse fédérale.Depuis le 1er janvier 2002,le contingent partiel «Ânes, bardots et mulets» de 200 têtes est attribué selon la méthode du fur à mesure à la frontière;il était épuisé dès le mois d’août.

2.1 PRODUCTION ET VENTES 2 170
■ Chevaux de rente et de sport:mise aux enchères de parts de contingent tarifaire
2.1.4Production végétale
Dans le domaine de la production végétale,2002 a été une année de consolidation après que la mise en œuvre de la PA 2002 a pu être menée à bonne fin en 2001.Pour toutes les grandes cultures,la protection douanière constitue la principale mesure de soutien des prix en Suisse.La coordination de la production et des ventes,qui est passée des mains de la Confédération à celle de l’interprofession de la pomme de terre, des oléagineux et des céréales a,dans l’ensemble,conduit à une orientation marché de la production quant aux quantités récoltées et aux qualités des produits.

Pour ce qui est des fruits,des légumes et des fleurs coupées,la protection douanière représente également une mesure essentielle.Par ailleurs,on mentionnera pour les fruits la participation financière à la mise en valeur des fruits à cidre et les mesures de dégagement du marché pour les fruits à noyau.
1Selon l’utilisation ou le numéro du tarif,le prélèvement à la frontière est réduit ou nul
2Ne concerne que des parties de la quantité récoltée (affouragement à l’état frais ou déshydratation de pommes de terre,réserve de marché pour concentrés de fruits à pépins)
3Pour les produits à base de pommes de terre destinés à des fins alimentaires
4Seulement pour les plants de pommes de terre
5Utilisation non alcoolique des raisins
Source:OFAG
■■■■■■■■■■■■■■■■
en 2002 Mesure Protection douanière 1 ■■■■■■■■ Contributions à la transformation ■■ 2 ■■ 2 ■ 5 ■ 2 Contributions à la culture ■■■ Contributions à l’exportation ■ 3 ■ 4 ■
Mesures
Culture C é r é ales L é gumineuses à graines Ol é agineux Pommes de terre Betteraves sucri è res Semences L é gumes,fleurs coup é es, viticulture Fruits 2.1 PRODUCTION ET VENTES 171 2
■ Moyens financiers
Par rapport à 2001,le soutien direct du marché a augmenté de 16,9 millions de francs. Les contributions à la culture des champs ont progressé de 5,0 millions de francs pour les oléagineux et de 2,4 millions de francs pour les légumineuses à graines.En 2002, la convention de prestations en matière d’oléagineux a pour la première fois grevé le compte des contributions à la transformation et à la mise en valeur,avec un montant de 8,5 millions de francs.Par rapport à 2001,le soutien renforcé apporté à la production suisse d’oléagineux a généré des dépenses supplémentaires de l’ordre de 3,7 millions de francs.La mise en valeur des plants de pommes de terre et l’encouragement de la production de semences de maïs et de plantes fourragères ont nécessité en tout 3,9 millions de francs.Quant aux mesures de soutien en faveur de la mise en valeur des pommes de terre (hormis les plants de pommes de terre),elles ont coûté 19 millions de francs et celles pour la transformation des betteraves sucrières 45 millions de francs.
Total 146 mio de fr.
Contributions à l'exportation 13%
Divers 1%
Primes de culture 27%
Source: Compte d'Etat
L’augmentation des fonds alloués pour les légumineuses à graines résulte de la hausse des contributions à la culture en janvier 2002,lesquelles sont passées de 1'260 à 1'500 francs à l’hectare,et de l’extension des surfaces en raison de l’attrait économique croissant qu’offrent les cultures riches en protéines.Le relèvement des contributions à la transformation pour les oléagineux ainsi que l’extension des surfaces de culture ont influé de manière déterminante sur la hausse des dépenses.A cela s’ajoute le paiement de contributions pour l’utilisation d’oléagineux à des fins techniques dans des installations pilotes et de démonstration qui grève le budget de la convention de prestations pour les oléagineux.Jusqu’à 2001,ces montants étaient imputés à la rubrique matières premières renouvelables.

Contributions à la transformation et à la mise en valeur 59%
Répartition des moyens financiers 2002
2.1 PRODUCTION ET VENTES 2 172
Répartition des moyens financiers selon les cultures
Source: Compte d'Etat
Pour alléger le marché de la viticulture,une partie de la récolte de raisins,soit 3,47 millions de l de jus de raisin,a été destinée à l’utilisation non alcoolique.La contribution fédérale extraordinaire s’est élevée à 6,96 millions de francs pour cette mise en valeur.
Dépenses pour les fruits en 2002
Total 18,2 mio. de fr.
Exportations d'autres produits à base de fruits à pépins 3,4%
Exportations de cerises
2,2%
Mise en valeur de pommes et de poires dans le pays
5,8%
Autres 2,1% dont allégement du marché des cerises et des pruneaux 1,3%
Exportations de concentré de jus de pommes 70,1%
Exportations de concentré de jus de poires 16,4%
Source: OFAG
L’exportation de produits de fruits a bénéficié d’un soutien qui s’est élevé à 16,36 millions de francs,soit 89,8% des deniers publics utilisés pour les fruits.Pour les cerises et les quetsches,les mesures d’allégement du marché sont revenues à 0,63 million de francs.
mio. de fr. 200020012002
Betteraves sucrières Pommes de terre CéréalesLégumineuses à graines OléagineuxMatières premières renouvelables Production de semences FruitsViticulture 0 45 50 40 35 30 25 20 15 10 5
2.1 PRODUCTION ET VENTES 2 2.MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE 173
■ Rétrospective
Cultures des champs
Grâce au volume important des exportations de bétail,de fromage et de fruits,l’agriculture helvétique a joué au XIXe siècle un rôle de premier plan dans l’économie de notre pays.Avec le développement des bateaux et trains à vapeur,la production européenne s’est vue concurrencée par des céréales bon marché venus des Etats-Unis, ce qui entraîna l’effondrement des prix payés aux producteurs à partir de 1850 et le recul des surfaces consacrées à la culture céréalière en Suisse qui atteignaient environ 150'000 ha à la fin du XIXe siècle.Pour faire face à cette première crise agricole,la Confédération est intervenue à la fin du XIXe siècle,mettant en place un système de soutien interne des prix pour les produits agricoles,une protection à l’importation sous forme de droits de douane et la promotion de la recherche agronomique.
En dépit des mesures de politique agricole adoptées à ce moment-là,le taux d’autosuffisance en céréales n’atteignait que 20% environ au début de la Première guerre mondiale alors que le marché était pénalisé par des excédents de lait dus à des restrictions à l’exportation.En édictant des prescriptions pour les cultures de céréales et de pommes de terre et en garantissant pour la première fois les prix et les ventes de céréales (monopole des importations de céréales détenu par la Confédération),la diminution des cultures ouvertes a pu être stoppée jusqu’après la guerre (a).La reprise du trafic international des marchandises a mis sur le marché des produis importés bon marché et ainsi contribué à réduire encore les surfaces de culture (b).Après l’abandon du monopole de l’Etat en 1926,la loi sur le blé de 1929 accordait aux producteurs une nouvelle garantie de prix et de prise en charge.La prévention des crises avant la Seconde guerre mondiale a fonctionné et avec la «Bataille des champs» déclenchée en 1939,la surface de culture a augmenté de manière notable jusque après la fin de la guerre (c).Par suite de la mécanisation croissante des techniques de culture et de conservation,la culture du maïs n ’ a cessé de gagner en importance à partir des années soixante tandis que la surface de culture des betteraves sucrières allait en s’étendant (d) avec la mise en service de la sucrerie de Frauenfeld en 1963 (Aarberg en 1899).Du fait du contingentement laitier en 1977 et après l’introduction des effectifs maximums dans la production de viande en 1980,la production s’est davantage tournée vers les grandes cultures.La surface des emblavures a ainsi augmenté de manière significative au cours des années huitante (e).Cependant,les excédents de céréales panifiables ont
en 1 000 ha
Maïs d'ensilage Colza Betteraves sucrières Pommes de terre Autres céréales Maïs-grain Epeautre Blé
Evolution des terres ouvertes (sans prairies artificielles)
1880190019101920193019401950196019701980199020002002
Autres cultures
a c b d e f 0 50 100 150 200 250 300 350 2.1 PRODUCTION ET VENTES 2 174
Sources: Statistique historique de la Suisse, Manuel statistique de l'agriculture suisse (H. Brugger), USP
dû être déclassés en céréales fourragères,opération à la charge de la caisse fédérale, si bien qu’il a fallu procéder à des adaptations dans le régime céréalier.Depuis 1990, la surface des emblavures diminue de nouveau (f).
Le rendement des principales cultures a plus que doublé au cours du XXe siècle suite aux travaux de sélection, à l’optimisation des techniques de culture, à un meilleur approvisionnement en substances nutritives et à l’intensification de la protection phytosanitaire.La comparaison des rendements à l’hectare montre que, à partir des années huitante,le blé a supplanté l’épeautre,car ce sont surtout les critères de qualité exigés par le marché qui décident de la valeur culturale d’une plante.Les rendements moyens de l’ordre de 60 dt à l’hectare obtenus pour les variétés de blé d’automne provenant du catalogue national des variétés montrent que le potentiel de rendement n’est pas encore épuisé si on le compare à celui des régions pratiquant des cultures céréalières plus intensives (comme la Hesse qui affiche pour le blé d’automne un rendement moyen de 74 dt à l’hectare pour la période 1995 à 2000).La production intégrée (à partir de 1993) et les prestations écologiques requises (à partir de 1999), ainsi que les programmes de culture extensive pour les céréales et le colza,ont entraîné une réduction des substances nutritives utilisées et une plus faible augmentation du rendement des cultures.
des rendements et principales substances nutritives

Evolution
Rendement (indice 1921/30 = 100) Engrais achet é s en 1 000 t
Azote (N) Phosphore (P205) Potassium (K20) 1921/30 1931/40 1941/50 1951/60 1961/70 1971/80 1981/90 1991/00 0 300 100 125 150 175 200 75 50 25 0 250 350 400 150 200 100 50
2.1 PRODUCTION ET VENTES 2 175 ■ Rendement
Source: Manuel statistique de l'agriculture suisse (H. Brugger), USP
MaïsBlé
d'automnePommes de terreEpeautre
■ Importations de vins blancs depuis l’application des accords de l’OMC
En ce qui concerne les céréales fourragères,le niveau du prix-seuil devra baisser jusqu’à la fin de l’année 2007.Cette réduction entraînera une diminution des recettes dans les grandes cultures,mais une amélioration de la compétitivité des secteurs de production «volaille» et «porcs» en raison du prix plus bas des aliments fourragers.Il est probable que la baisse du prix des aliments fourragers doive être en grande partie répercutée sur le commerce et les consommateurs par le biais d'une baisse des prix de vente pour les produits d'origine animale.

Conformément aux mesures fixées dans la PA 2007,la régulation des quantités doit être également confiée à la branche dans la production sucrière.La quantité maximale fixée pour la production de sucre doit être supprimée.La responsabilité concernant l’utilisation optimale des capacités de traitement existantes et la réalisation de recettes appropriées pour les planteurs de betteraves est ainsi reportée sur la branche.Dans l’intérêt d’une utilisation efficace des moyens financiers limités,il convient néanmoins d’éviter les excédents de production qui nécessitent une transformation onéreuse à la charge des planteurs de betteraves.
L’offre domestique en pommes de terre et le contingent tarifaire fixé dans le passé pour ce produit n’ont pas suffi à couvrir les besoins,raison pour laquelle le manque de pommes de terre a été comblé par une augmentation provisoire du contingent tarifaire.Jusqu’à présent,le contingent tarifaire de pommes de terres était attribué sur la base de la prestation fournie en faveur de la production suisse.Dans les structures de marché existantes marquées par une concurrence insuffisante,ce systèmepeut conduire à des rentes contingentaires.C’est pourquoi un changement de la réglementation d’importation est examiné
Cultures spéciales
L’actuel système des importations de vins est un compromis entre la libéralisation complète des importations qui a été exigée par les uns en vertu du référendum contre l’arrêté fédéral sur la viticulture,approuvé en 1990,et la protection maximale à la frontière compatible avec les accords du GATT/OMC,dont le maintien est réclamé par les autres.Au départ,la Confédération avait notifié trois contingents tarifaires dans la liste de ses engagements GATT/OMC:un contingent de vins rouges s’élevant à 1,62 million hl,un contingent de vins blancs en vrac de 30'600 hlet un contingent de vins blancs en bouteilles de 45'000 hl.De concert avec la branche,il fut décidé de regrouper les deux contingents de vins blancs en un seul lors de l’application de l’accord.La quantité totale des contingents tarifaires correspondait à la somme des contingents ouverts pendant les années de référence.
176 2.1 PRODUCTION ET VENTES 2
■ Perspectives
Evolution des importations de vin blanc dans le contingent tarifaire
Le doublement du contingent en 1996 qui a été suivi d’une augmentation annuelle de 10'000 hl et du regroupement des contingents de vins blancs et de vins rouges au 1er janvier 2001 a entraîné une augmentation des importations de vins blancs, lesquelles ont finalement atteint environ 240'000 hl en 2002.La hausse des importations a eu une incidence négative sur la consommation des vins blancs suisses: depuis l’application des accords du GATT/OMC,celle-ci a régressé de 656'954 hl (1995–1996) à 625'705 hl (2001–2002).La tendance qui était apparue au tout début des années nonante s’est ainsi confirmée.Il est à noter que le recul de la consommation a été plus sensible avant l’entrée en vigueur des accords du GATT/OMC que par la suite (cf.Rapport agricole 2002,p.168 ss).Dans l’ensemble,les importations de vins blancs et de vins rouges au taux du contingent se sont élevées à 1,64 million hl en 2001 et à 1,61 million hl en 2002.
Principales importations de vins blancs en Suisse (2002)
2.1 PRODUCTION ET VENTES 2 177 2.MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE
Pays d’importationQuantité Montant lfr. France6 354 85732 513 722 Italie6 305 96024 798 281 Afrique du Sud4 335 1033 662 546 USA1 599 8819 752 696 Espagne1 554 2133 994 482 Chili1 028 9063 481 582 Australie837 8134 312 388 Allemagne518 5814 052 239 Source:DGD
en mio. de l Vin blanc en bouteilles Total vin Vin blanc en vrac Source: DGD 1994 0 25 20 15 10 5 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Entrée
Regroupement des contingents
en vigueur des accords de l'OMC
de vin blanc et de vin rouge
■ Comparaison des importations de vins en vrac et en bouteilles
Vin blanc
Les importations de vins tant en vrac qu’en bouteilles sont en progression depuis 1997.Compte tenu de l’augmentation du volume des importations,le pourcentage des vins en bouteilles a continuellement régressé,passant de 55% à 42%.Il n’empêche que,comparé à la valeur globale des importations de vins,ce pourcentage est pratiquement resté constant.Quant au prix moyen du litre pour les vins blancs en bouteilles,il est pour ainsi dire demeuré stable.
Concernant les vins en vrac,les quantités importées ont tout aussi sensiblement augmenté que la valeur des vins titrant au maximum 13 volume d’alcool a diminué Partiellement comparables aux vins suisses,ces produits concurrencent directement la production indigène.Les prix moyens du litre de vin affichent ainsi une tendance persistante à la baisse:de 1,74 franc le l en 1997,ils sont tombés à 0,74 franc le l en 2002.Pour étonnante qu’elle soit,on ne saurait déduire de cette évolution que la qualité du vin a baissé dans le même temps.L’évolution des prix s’explique en partie par les importants excédents enregistrés sur les marchés internationaux,en particulier européens (30 à 40 millions hl par an).Une autre raison réside dans la mondialisation du commerce,car les frais de transport n’ont qu’une incidence minime sur le prix des produits.La surproduction mondiale persiste et aucun signe ne semble annoncer un revirement de cette tendance.
Ont également augmenté les importations de vins blancs en bouteilles.A la différence des vins en vrac,leurs prix se sont stabilisés à un niveau relativement élevé.Dans l’ensemble,les importations de vins en vrac ont davantage progressé que celle des vins en bouteilles.Cette forte concurrence a également une incidence sur la production suisse de vins blancs,et ce tant sur les quantités que sur les prix des vins et,par conséquent,sur la récolte.
Les vins bon marché importés proviennent en premier lieu de France,d’Italie, d’Espagne et d’Afrique du Sud.Quant aux vins du Nouveau Monde,ils affichent un prix unitaire nettement plus élevé bien qu’on les rende souvent responsables d’inonder le marché suisse de
2.1 PRODUCTION ET VENTES 2 178
vin.
en mio. de l fr./l Vin en bouteilles Prix/l de vin en bouteille Vin en vrac Prix/l de vin en vrac
1
titrant au maximum 13 volumes d'alcool 2 Les chiffres des importations de 1996 sont faussés par l'application du système
et à mesure cette année, qui a entraîné d'importantes importations de vin blanc en vrac. 1994 0 1410.00 9.00 8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 12 10 8 6 2 4 1995 1996 2 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Evolution des importations et des prix du vin blanc en bouteilles et en vrac 1
Source: DGD
Produits
du fur
Vin rouge
En ce qui concerne les importations de vins en bouteilles,les quantités et les prix n’ont cessé d’augmenter,leur volume ayant plus que doublé entre 1995 et 2002.Après une hausse considérable dans un premier temps,le prix moyen du litre de vin est retombé au cours des deux dernières années.Mais contrairement au vin blanc,ce sont les importations de vin rouge en bouteilles,plus cher mais aussi sans doute de meilleure qualité,qui ont enregistré une hausse sensible.
Les importations de vins rouges en vrac titrant au maximum 13 volume d’alcool sont en constante diminution aussi bien en termes de quantité que de valeur.Cependant, le prix moyen du litre est resté relativement stable.Ces deux facteurs combinés ont permis au vin rouge suisse de connaître une évolution positive et même de gagner des parts de marché.
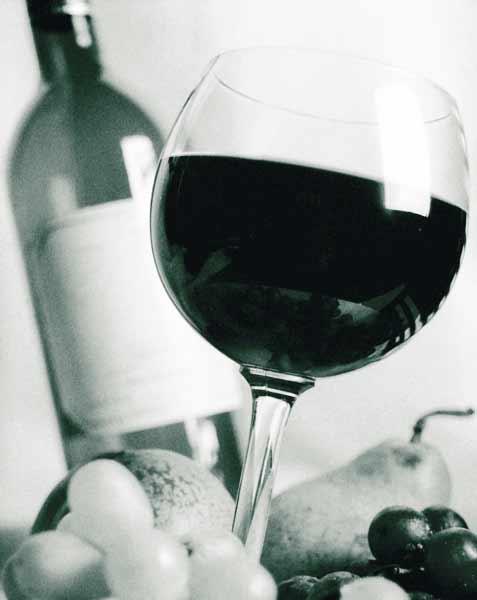
2.1 PRODUCTION ET VENTES 2 179 2.MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE
en mio. de l fr./l
Vin
Source: DGD 1 Produits titrant au maximum 13 volume d'alcool 1994 0 14012.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 120 100 80 60 20 40 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Evolution des importations et des prix pour le vin rouge en bouteilles et en vrac 1
Vin en bouteilles Prix/l de vin en bouteilles
en vrac Prix/l de vin en
vrac
■ Perspectives
Conscient de la phase difficile que traverse actuellement la viticulture suisse,le Conseil fédéral a élaboré avec l’interprofession une stratégie pour la PA 2007,qui se décline en trois points:reconversion des surfaces viticoles suisses par l’arrachage des surfaces excédentaires plantées de Chasselas et de Müller-Thurgau et leur remplacement par d’autres cépages répondant aux besoins du marché,soutien de la promotion des ventes en Suisse lié à certaines conditions,ainsi que poursuite de la promotion des ventes à l’exportation.Il s’agit donc de mesures structurelles et de mesures de promotion des ventes visant à combattre la surproduction.Elles ont toutes pour objectif de faire évoluer la viticulture suisse de telle sorte que, à moyen ou à long terme,celle-ci soit en mesure d’offrir une production équilibrée pour satisfaire la demande du marché.Au terme de cette phase d’adaptation,les vins suisses,qui représentent environ 40% du marché,devront s’imposer sans aide face aux vins étrangers,même si ces derniers sont importés à des prix très bas.La viticulture est globalement capable de relever ce défi:une partie du secteur viticole est d’ores et déjà en mesure d’offrir ses vins à des prix tout à fait intéressants.

2.1 PRODUCTION ET VENTES 2 180
2.1.5Examen des mesures
Etudes sur le soutien du marché
Dans le cadre du mandat de recherche de l’OFAG «Redistribution du soutien du prix du lait»,les deux autres sous-projets «Production de lait dans la région de plaine» et «Répercussions d’une suppression du contingent sur le secteur laitier» peuvent maintenant être présentés.Les résultats des quatre sous-projets ont été regroupés dans un rapport de synthèse intitulé «Effekte einer Aufhebung der Milchkontingentierung und einer Umlagerung der Milchpreisstützung» (Effets d’une suppression du contingentement laitier et d’une redistribution du soutien du prix du lait).Ce rapport de synthèse – qui n’est disponible qu’en allemand – peut être consulté sur le site Internet de l’OFAG www.blw.admin.ch.
Quatre scénarios ont été examinés dans des modélisations et ont servi de fondement pour évaluer les répercussions d’une suppression du contingentement laitier et d’une redistribution du soutien du prix du lait:
– Contingent65: scénario de référence,maintien du contingentement laitier et du soutien du marché,prix du lait payé au producteur:65 ct.
– Marché60: scénario de référence 2,suppression du contingentement laitier, maintien du soutien du marché,prix du lait payé au producteur:60 ct.
– Bœuf42: suppression du contingentement laitier,soutien du prix du lait transformé en soutien UGBFG,ce qui signifie qu’une contribution pour animaux consommant des fourrages grossiers,d’un montant de 900 francs,est versée pour les vaches laitières (plus aucune déduction pour le lait commercialisé).Prix du lait payé au producteur:42 ct.
– Herbages42: suppression du contingentement laitier,soutien du prix du lait transformé en soutien des surfaces herbagères,ce qui signifie le paiement de contributions d’un montant de 1'000 francs par hectare de surface herbagère.Prix du lait payé au producteur:42 ct.
Ces scénarios décrivent quatre possibilités d’évolution des conditions-cadre pour l’agriculture suisse jusqu’en 2007.
Les résultats de l’enquête comprennent des comparaisons entre les structures de production actuelles et celles calculées dans les différents scénarios,ainsi que des estimations du potentiel de production en ce qui concerne le lait et les veaux (base de calcul pour la production de viande) dans la région de plaine.Eu égard à la production laitière,une distinction est faite entre les trois types de vache suivants (classes de performance):vache de pâturage produisant 5'800 kg de lait,vache produisant 7'800 kg de lait et vache à haute performance produisant 10'800 kg de lait.
L’enquête révèle que la suppression du contingentement laitier (Marché60) entraîne la création d’exploitations de production laitière qui,par rapport aux grandes exploitations actuelles,produisent nettement plus de lait.Si le soutien du produit est transféré au facteur de production Animaux (Boeuf42),on assiste à une adaptation des structures d’exploitation en ce sens que d’importants effectifs de vaches laitières sont
■■■■■■■■■■■■■■■■
2.1 PRODUCTION ET VENTES 2 181 2.MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE
■ Production laitière dans la région de plaine
gardés et que ces dernières consomment principalement du fourrage herbager pendant la période de végétation.Il en résulte une réduction de la charge de travail par animal mais,en contrepartie,une productivité moindre des animaux (performance laitière).Si le soutien est transféré au facteur de production Surface (Herbages42),on assiste à une adaptation des structures d’exploitation en ce sens qu’une optimisation est recherchée entre la réduction au minimum de la charge de travail et la maximisation de la gestion des surfaces herbagères et cultivées.Comparée aux autres scénarios, la production de lait ou de veaux est moindre.
Dans les trois scénarios – Marché60,Boeuf42 et Herbages42 –,le développement de la production laitière dans la région de plaine dépend fortement du type de vaches (classes de performance).En prenant pour hypothèse une répartition uniforme des trois types de vaches,le potentiel de production laitière progresse de 75% en cas de suppression du contingentement laitier (Marché 60) ;dans les deux scénarios de transfert,il demeure au niveau actuel (Boeuf42) ou régresse même (Herbages42: –25%). Les variations de la compétitivité et leurs répercussions sur le potentiel de production laitière découlent directement des potentiels de production des différents types de vache.Dans le scénario Marché60,le potentiel de production augmente de quelque 120% en cas d’orientation unilatérale sur la production laitière avec des vaches à haute performance,alors qu’en cas de changement de système et de paiement de contributions par UGBFG ou de contributions pour surfaces herbagères,il augmente dans des proportions nettement plus faibles quand il ne régresse pas.En cas d’orientation unilatérale sur la garde de vaches de pâturage,les potentiels de production sont au contraire nettement plus bas et même légèrement en recul.
Production laitière et revenu selon la taille des exploitations, types de vache laitière et scénarios
2.1 PRODUCTION ET VENTES 2 182
kg de lait Part du revenu rel. au Cont65 pour le type 10800 Source: IER 15ha 27ha 39ha 5800W RevenuProduction laitière 7800 Types de vaches Contingent65 10800 0 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 130 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 0 15ha 27ha 39ha 15ha 27ha 39ha kg de lait Part du revenu rel. au Cont65 pour le type 10800 15ha 27ha 39ha 5800W7800 Types de vaches Marché60 10800 0 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 130 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 0 15ha 27ha 39ha 15ha 27ha 39ha
Production laitière et revenu selon la taille des exploitations, types de vache laitière et scénarios
Le graphique montre la quantité de lait produite (axe vertical de gauche,colonnes vertes) dans des exploitations de trois tailles différentes (15,27 et 39 ha avec 50% de surfaces cultivables) en fonction des systèmes de production,et le revenu réalisé (axe vertical de droite,colonnes grises).Le revenu des exploitations gardant des vaches du type 10800 dans le scénario Contingent65 sert de base de comparaison pour le revenu (= 100%).La compétitivité des différents systèmes de production ressort clairement du graphique.Dans le cas d’un maintien du contingentement (Contingent65),les exploitations de 15 ha ne produisent plus de lait (colonnes manquantes de la production laitière).Pour les exploitations dont la surface est comprise entre 27 et 39 ha,les vaches de pâturage du type 5800 W permettent de réaliser le revenu le plus élevé. En cas de suppression du contingentement laitier (Marché60),toutes les exploitations, à l’exception de celles comptant 15 ha et gardant des vaches du type 7800,produisent du lait;les exploitations de 15 ha en particulier peuvent compenser leurs inconvénients au niveau des coûts par une forte augmentation de la production laitière.Dans les scénarios de transfert (Boeuf42 et Herbages42),tant les exploitations de 15 ha qu’une partie des exploitations de 27 ha abandonnent la production laitière.La vache de pâturage est de loin la plus compétitive.
2.1 PRODUCTION ET VENTES 2 2.MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE 183
kg de lait Part du revenu rel. au Cont65 pour le type 10800 Source: IER 15ha 27ha 39ha 5800W RevenuProduction laitière 7800 Types de vaches Boeuf42 10800 0 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 130 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 0 15ha 27ha 39ha 15ha 27ha 39ha kg de lait Part du revenu rel. au Cont65 pour le type 10800 15ha 27ha 39ha 5800W7800 Types de vaches Herbages42 10800 0 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 130 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 0 15ha 27ha 39ha 15ha 27ha 39ha
■
Les effets,tant sur le plan régional que sectoriel,de la suppression du contingentement laitier et de la redistribution du soutien ont été analysés au moyen du Système d’information et de pronostic sectoriel pour l’agriculture suisse (SILAS).Il importait de répondre à cinq questions de la recherche concernant le développement de la production de lait et de viande de bœuf,le transfert régional de la production,le revenu,les dépenses de la Confédération en faveur de l’agriculture et l’efficacité des mesures d’encouragement.Pour ce faire,on a eu recours au système de modélisation avec lequel la FAT a déjà réalisé au printemps 2002 des calculs sur les effets de la PA 2007 (SILAS 2002).
Les modélisations ont été effectuées pour les quatre scénarios précités.En outre,les prix et les paiements directs utilisés dans les calculs relatifs aux effets de la PA 2007 (SILAS 2002) ont été appliqués aux quatre scénarios.
Voici en résumé les résultats de ces analyses:
– La suppression du contingentement laitier (Marché60) conduit à une augmentation de la production laitière de 13 à 16% dans la région de plaine.La région des collines enregistre une croissance de la production laitière de 3 à 6% tandis que la région de montagne connaît une diminution de 5 à 8%.Pour le secteur dans son ensemble,il en résulte un accroissement de 5 à 8%.
– Dans tous les scénarios sans contingentement,l’utilisation du lait produit connaît des changements:la vente de lait augmente de plus de 20% pour l’ensemble du secteur tandis que l’engraissement au lait frais recule de plus de 50%.En cas de baisse du prix de la poudre de lait écrémé,on peut s’attendre à ce que la poudre de lait se substitue au lait frais.
– La division du travail entre la région de plaine et la région de montagne s’accentue. La région de plaine augmente son effectif de vaches laitières et restreint principalement l’engraissement de gros bétail et de veaux dans les scénarios de transfert du soutien Boeuf42 et Herbages42.La région de montagne se spécialise dans l’élevage de bovins et l’engraissement de veaux et limite l’effectif de vaches laitières.Le mode de gestion de la région de plaine devient plus intensif,celui de la région de montagne plus extensif.
Dans tous les scénarios de suppression du contingentement,il faut s’attendre à ce que le revenu du secteur recule.Si les pertes de revenu sont les plus faibles pour le scénario Boeuf42,elles sont les plus élevées pour le scénario Herbages42.La région de plaine profite financièrement plutôt des contributions UGBFG (Bœuf 42) que des contributions pour surfaces herbagères (Herbages42),alors que la région de montagne profite plutôt des contributions pour surfaces herbagères que des contributions UGBFG allouées pour les vaches laitières.
– Quant au contribuable,c’est le scénario Marché60 qui est le plus intéressant pour lui sur le plan financier,puisqu’il permet de réaliser les plus importantes économies. Dans le scénario Herbages42,l’augmentation des paiements directs correspond approximativement aux moyens économisés pour le soutien des prix,tandis que, dans le scénario Bœuf42,il faut s’attendre selon les modélisations à ce que les économies réalisées dans le soutien du marché ne suffisent pas à couvrir la demande supplémentaire en paiements directs.
–
184 2.1 PRODUCTION ET VENTES 2
Effets sectoriels d’une suppression du contingent
2.2 Paiements directs
Les paiements directs sont un des principaux éléments de la politique agricole.Ils permettent,d’une part,de séparer la politique des prix et celle des revenus et,d’autre part,de rétribuer les prestations fournies à la demande de la collectivité.Il convient de distinguer les paiements directs généraux et les paiements directs écologiques.

Dépenses au titre des paiements directs
Domaine de dépenses1999200020012002 mio.de fr.mio.de fr.mio.de fr.mio.de fr.
Paiements directs généraux1 7791 8041 9291 995
Paiements directs écologiques326361413452
Réductions24231721
Total 2 0812 1422 3252 426
Remarque:une comparaison directe avec les données du compte d’Etat est impossible.Les valeurs indiquées sous 2.2 «Paiements directs» se rapportent à l’ensemble de l’année de contributions,alors que le compte d’Etat indique les dépenses d’une année civile.Les réductions sont celles effectuées sur la base de limites et de sanctions légales et administratives.
Source:OFAG
■■■■■■■■■■■■■■■■
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 185
■ Rétribution de prestations fournies dans l’intérêt général
2.2.1Importance des paiements directs
D’utilité publique,les prestations de l’agriculture sont rétribuées au moyen des paiements directs généraux.En font partie les contributions à la surface et les contributions pour les animaux consommant des fourrages grossiers,contributions qui ont pour objectif d’assurer l’exploitation et l’entretien de toute la surface agricole.Dans la région des collines et de montagne,les agriculteurs touchent en outre des contributions pour des terrains en pente et d’autres pour la garde d’animaux dans des conditions difficiles.Il est ainsi tenu compte des difficultés d’exploitation dans ces régions. Les prestations écologiques requises (PER) sont une condition préalable pour l’octroi de tous les paiements directs (contributions d’estivage exceptées).

■ Rétribution de prestations écologiques particulières
Les paiements directs écologiques servent d’incitation à fournir des prestations écologiques particulières dépassant le cadre des PER.En font partie les contributions écologiques,les contributions à la qualité écologique,les contributions d’estivage et celles qui sont allouées pour la protection des eaux.On entend par là préserver et accroître la diversité des espèces dans les régions agricoles,diminuer la pollution des eaux par les nitrates et les phosphates,tout en soutenant les systèmes de garde d’animaux de rente particulièrement respectueux de l’espèce et en encourageant l’exploitation durable de la région d’estivage.
■■■■■■■■■■■■■■■■
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 186
■ Importance économique des paiements directs en 2002
En 2002,les paiements directs ont représenté environ les deux tiers des dépenses de l’OFAG.59% de ces paiements sont allés à la région des collines et de montagne.
1Non compris dans le total des contributions:BE,VD:données incomplètes;GR,UR,TI:données non fournies à temps
Remarque:
une comparaison directe avec les données du compte d’Etat est impossible.Les valeurs indiquées sous 2.2 «Paiements directs» se rapportent à l’ensemble de l’année de contributions,alors que le compte d’Etat indique les dépenses d’une année civile.Les réductions sont celles effectuées sur la base de limites et de sanctions légales et administratives.
Source:Rapports cantonaux sur les activités de contrôle et les sanctions
Paiements directs en 2002 Type de contributionTotalRégion de Région desRégion de plainecollinesmontagne 1 000 fr. Paiements directs généraux1 994 838733 047518 051733 689 Contributions à la surface1 316 183649 864327 726338 593 Contributions pour la garde d’animaux consommant des fourrages grossiers283 22176 71473 489133 018 Contributions pour la garde d’animaux dans des conditions difficiles289 5724 15782 449202 966 Contributions générales pour des terrains en pente95 8112 31134 38859 112 Contributions pour les surfaces viticoles en forte pente et en terrasses10 051 Paiements directs écologiques452 448181 180100 13278 075 Contributions écologiques359 387181 180100 13278 075 Contributions à la compensation écologique122 34770 22331 21520 909 Contributions au sens de l'ordonnance sur la qualité écologique (OQE)8 934 1 2 6563 5002 778 Contributions pour la culture extensive de céréales et de colza (culture extensive)31 93821 7319 267941 Contributions pour la culture biologique25 4847 7055 34312 436 Contributions pour la garde d’animaux de rente particulièrement respectueuse de l’espèce (SST,SRPA)170 68478 86450 80841 012 Contributions d’estivage89 561 Contributions pour la protection des eaux3 500 Réductions21 143 Total paiements directs2 426 144914 226618 183811 764 Paiements directs par exploitation en fr.41 82137 35339 26045 625
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 187 2.MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE
■ Exigences requises pour l’octroi de paiements directs
La région de montagne et des collines est défavorisée sur le plan des conditions de production.En voici les principaux inconvénients:

–période de végétation plus courte,d’où des rendements réduits et des dépenses plus élevées pour la conservation des aliments pour animaux,périodes de travail très intensif;
–exploitation des terrains en pente plus difficile,mécanisation plus chère et moins performante;
–voies de communication généralement moins favorables,d’où prolongation des trajets et surcroît de dépenses pour les transports,les marchés,les acquéreurs de produits,les achats,etc.
Part des paiements directs au rendement brut d’exploitations de référence, selon la région,en 2002
Définitions et méthodes,page A82
L’exploitation plus difficile de ces régions est compensée par l’octroi de contributions pour la garde d’animaux dans des conditions difficiles et de contributions pour des terrains en pente.Il s’ensuit que la somme des paiements directs par hectare augmente proportionnellement aux difficultés d’exploitation.Etant donné les plus faibles rendements en montagne,la part des paiements directs au rendement brut y est également plus élevée qu’en plaine.
Pour toucher des paiements directs,les agriculteurs doivent satisfaire à de nombreuses exigences.Celles-ci comprennent des conditions générales telles que forme juridique, domicile de droit civil,etc.;s’y ajoutent des critères structurels et sociaux,eux aussi déterminants,tels que la taille minimale de l’exploitation,le besoin minimal en travail de 0,3 unité de main-d'œuvre standard (UMOS),l’âge de l’exploitant,le revenu et la fortune.Enfin,mentionnons les charges écologiques spécifiques qui sont regroupées sous la notion de prestations écologiques requises (PER).Ces dernières comprennent un bilan de fumure équilibré,une part équitable de surfaces de compensation écologique,un assolement régulier,une protection appropriée du sol,l’utilisation ciblée de produits phytosanitaires,ainsi que la garde d’animaux de rente respectueuse de l’espèce.Toute infraction aux prescriptions pertinentes entraîne des sanctions sous forme d’une réduction ou d’un refus des paiements directs.
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 188
ParamètreUnitéTotalRégion deRégiondesRégion de plainecollinesmontagne Exploitationsnombre2 3791 006698675 SAU en Øha19,3820,6818,0918,55 Paiements directs générauxfr.36 53530 56135 19447 404 Contributions écologiquesfr.7 1688 2497 3255 287 Total paiements directsfr.43 70438 81042 51952 691 Rendement brutfr.194 365242 450179 713131 524 Part des paiements directs au rendement brut%22,516,023,740,1 Source:FAT
Tableaux 41a–42,pages A46–A49
■ Système d'information sur la politique agricole
La plupart des données statistiques sur les paiements directs proviennent de la banque de données SIPA (système d'information sur la politique agricole) développée par l’OFAG.Ce système est alimenté par les relevés annuels des données structurelles qui sont compilés et transmis par les cantons,ainsi que par les indications relatives aux versements (surfaces,cheptels et contributions pertinentes) de chaque type de paiement direct.La banque de données sert en premier lieu au contrôle administratif des montants versés aux exploitants par les cantons,mais elle permet aussi d’établir des statistiques générales sur les paiements directs.Grâce à cette mine d’informations et à l’existence de moyens informatiques performants,bon nombre de questions de politique agricole peuvent être éclairées sous des angles différents.
Sur les 67'544 exploitations enregistrées dans le SIPA,58'013 ont touché des paiements directs en 2002.La plupart des 9'531 exploitations restantes sont trop petites pour avoir droit à des contributions;en d’autres termes,elles n’atteignent pas les minimums fixés en matière de surface et d’UMOS.
■ Répercussions des échelonnements et des limitations
Les échelonnements et les limitations ont un effet sur la répartition des paiements directs.Pour ce qui est des limitations,il s’agit des limites de revenu et de fortune ainsi que du montant maximum alloué par UMOS;les échelonnements dégressifs concernent,quant à eux,les surfaces et les animaux.
Effets des limites d’octroi de paiements directs en 2002
LimitationExploitations Montant total Part au total des Part à la concernéesdes réductionscontributionssomme des paiedes exploitationsments directs
Source:OFAG
Les limites d’octroi entraînent des réductions de paiements directs,surtout pour les 185 exploitants dont la fortune est trop élevée.Quelque 950 exploitations ont été touchées par les limites de revenu en 2002.La réduction de leurs paiements directs s’est chiffrée à 10,9% en moyenne.Globalement,les limites d’octroi ont conduit à des réductions de 9 millions de francs,ce qui correspond à 0,37% du montant total.
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 2.MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE 189
nombrefr.%% par UMOS (55 000 fr.)236627 7137,370,03 en fonction du revenu9544 597 20310,910,19 en fonction de la fortune1853 816 89168,160,16
Effets de l’échelonnement des contributions en fonction de la surface ou du nombre d’animaux en 2002
En tout,7'888 exploitations sont concernées par les échelonnements prévus dans l’ordonnance sur les paiements directs.Dans la plupart des cas,les réductions portent sur diverses mesures et se chiffrent globalement à 31,6 millions de francs.Comparée à l’ensemble des paiements directs dégressifs,la part de toutes les réductions opérées équivaut à 1,5%.Les échelonnements dégressifs ont un effet notable sur les contributions à la surface et concernent plus de 6'800 exploitations (près de 12% de l’ensemble des exploitations touchant des paiements directs.Quant aux exploitations qui bénéficient de contributions pour la garde d'animaux consommant des fourrages grossiers,les réductions concernent 177 d’entre elles;en effet,d’autres limitations telles que la limite d’octroi et la déduction pour le lait commercialisé entrent ici en jeu dès avant l’échelonnement des paiements directs.Les paiements directs écologiques font eux aussi l’objet de réductions.Ainsi,ceux qui sont octroyés pour la garde d’animaux particulièrement respectueuse de l’espèce (SRPA et SST) ont été réduits en moyenne de 7,6% (SRPA) et de 9,7% (SST) respectivement pour quelque 3'450 exploitations.Environ 631 exploitations bio ont touché des paiements réduits de 7,2% en moyenne.
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 190
MesureExploitations Surface/effectif Réduction Part aux Part
la concernéespar exploitationcontributions
nombreha ou UGBfr.%% Contributions à la surface6 800 41,627 786 8967,32,11 Contributions pour la garde d’animaux consommant des fourrages grossiers17757,6472 8565,50,17 Contributions générales pour des terrains en pente7134,332 3563,10,03 Contributions pour les vignes en forte pente et en terrasses00,000,00,00 Contributions à la compensation écologique442,616 71912,40,01 Contributions pour la culture extensive de céréales et de colza (culture extensive)3336,621 3774,50,07 Contributions pour la culture biologique63139,6461 4847,21,81 Contributions pour les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux (SST)1 39465,81 134 9609,72,91 Contributions pour sorties régulières en plein air (SRPA)2 06162,21 720 6327,61,31 Total7 888 1 31 647 2807,31,54 1sans doubles comptes Source:OFAG
à
somme totale desdes paiements exploitationsdirects
■ Exécution et contrôle
L’art.66 de l’ordonnance sur les paiements directs (OPD) délègue aux cantons la tâche de contrôler les PER.Ceux-ci peuvent y associer des organisations présentant toutes garanties de compétence et d'indépendance,ainsi que des organisations accréditées. Ils sont tenus de surveiller l’activité de contrôle par sondage.Les exploitations bio qui ont droit aux paiements directs doivent non seulement respecter les exigences de la culture biologique,mais aussi fournir les PER et garder leurs animaux de rente selon les prescriptions SRPA.Elles font l’objet de contrôles par un organisme de certification accrédité,sous la surveillance des cantons.L’art.66,al.4,OPD précise selon quels critères les cantons ou les organisations associées sont tenus de contrôler les exploitations.
Doivent être assujetties à un contrôle: –toutes les exploitations qui demandent des contributions pour la première fois; –toutes les exploitations dans lesquelles des manquements ont été constatés lors de contrôles effectués l’année précédente;et –au moins 30% du reste des exploitations,choisis au hasard.
En cas d’infractions en matière de PER,telles que fausses indications par exemple,les exploitations sont sanctionnées selon des critères uniformes.La Conférence des directeurs de l’agriculture a édicté un dispositif de sanctions à cet effet.
■ Contrôles et sanctions en 2002
En 2002,les cantons ou les organismes mandatés ont effectué environ 39'881 contrôles d’exploitations,dont 5'869 exploitations bio,pour vérifier si les PER étaient fournies.En outre,les contrôles ont porté sur 23'075 des 35'562 exploitations participant au programme SRPA (65%) et sur 12'229 des 18'528 exploitations participant au programme SST (66%).
Au total,les contrôleurs ont constaté plus de 8'800 infractions,qui ont entraîné des réductions de contributions de près de 11 millions de francs.La plupart des infractions aux prescriptions d’autres législations,applicables à l’agriculture,concernaient la loi sur la protection des eaux.Les contrôleurs ont par ailleurs observé très peu d’infractions aux autres lois de protection,aux directives concernant la culture biologique et au programme de culture extensive.
Les infractions relevées dans les exploitations d’estivage contrôlées avaient principalement trait à l’inobservation des exigences concernant l’exploitation et à des écarts trop importants entre l’effectif des animaux et la charge usuelle.
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 2.MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE 191
Récapitulation des infractions et des sanctions en 2002
CatégorieInfractionsSanctionsRaisons principales nombrefr.
Données de base6151 309 047Annonces tardives,fausses données concernant les surfaces, l’exploitation ou l’exploitant,fausses indications sur l’effectif d’animaux,l’estivage et le contingent laitier
Protection des eaux153504 367Pas d’indication possible
Protection de la nature et 1315 470Pas d’indication possible du paysage
Protection de l'environnement3357 890Pas d’indication possible
PER4 9256 506 503Annonces tardives,enregistrements lacunaires,garde d’animaux de rente non respectueuse de l’espèce, compensation écologique insuffisante,bordures tampons inadéquates,bilan de fumure non équilibré,analyses du sol manquantes,assolement régulier non respecté,protection du sol inadéquate,manquements dans la sélection et l’utilisation ciblée des produits phytosanitaires
SCE 716303 096Annonces tardives,utilisation avancée ou non autorisée, fausses données concernant les surfaces,inobservation de la durée minimale de 6 ans,envahissement par les mauvaises herbes,fumure et protection phytosanitaire non autorisées, fausses indications sur le nombre d’arbres
Culture extensive 7025 298Annonces tardives,récolte pas faite à maturité pour la graine, fausses données concernant les surfaces,produits phytosanitaires interdits
Bio 9477 622Données fausses,analyses du sol manquantes,compensation écologique insuffisante,manquements concernant la protection des eaux,la date de la fauche pour les SCE, annonces tardives,emploi d’engrais et de produits phytosanitaires non autorisés dans la culture biologique
SST 579371 509Annonces tardives,garde non conforme de certains animaux d’une même catégorie,absence de système de stabulation à aires multiples;aire de repos,éclairage de l’étable et litière non conformes
SRPA
1 0951 179 298Nombre insuffisant de jours de sortie,enregistrements lacunaires,garde non conforme de certains animaux de la même catégorie,parcours insuffisant,annonces tardives
Estivage525569 807Annonces tardives,charge usuelle en bétail non atteinte ou dépassée,gestion incorrecte des pâturages,utilisation de surfaces non pacables,fausses indications concernant les surfaces,les effectifs d’animaux,les données et la durée d’estivage
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2
Total8 81810 919 907
Source:Rapports cantonaux sur les activités de contrôle et les sanctions
192
Tableaux 43a–43b,pages A50–A51
■ PER non fournies pour cause de force majeure
Selon l’art.15,al.2,OPD,le canton peut admettre des exceptions lorsque,pour des raisons de force majeure,les exploitants ne sont pas en mesure de fournir les PER.Les exploitants concernés ne gardent toutefois leur droit aux paiements directs que s’ils ont présenté une demande et que celle-ci a été approuvée.En 2002,les cantons ont approuvé 231 de ces demandes.La plupart de celles-ci ont été présentées après les intempéries qui ont surtout touché les cantons de Thurgovie et de Saint-Gall.
■ Autorisations spéciales dans le domaine de la protection des végétaux

Dans certains cas,l’utilisation de produits phytosanitaires ou le recours à des traitements non admis dans le cadre des PER sont autorisés pour protéger les cultures lorsque les conditions météorologiques ou le site l’exigent.Les services cantonaux de protection des plantes peuvent donc délivrer des autorisations spéciales en vertu de l’annexe 6.4 de l'OPD.En 2002,ils en ont accordé 2'521 pour 5'659 ha de SAU. Comme les années précédentes,la plupart d'entre elles ont été délivrées afin de permettre le traitement des mauvaises herbes dans des prairies naturelles ou le réensemencement des prairies artificielles.Il s’agissait avant tout de lutter contre les renoncules,les chardons des champs,le pâturin commun et le rumex.Depuis 2001,une autorisation spéciale n’est plus requise pour les prairies artificielles.
Autorisations spéciales accordées dans le domaine de la protection des végétaux en 2002
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2
Moyen de lutteAutorisationsSurface Nombre%ha% Herbicides en prélevée1726,8745,6813,2 Insecticides29811,8730,8912,9 Micro-granulés pour le maïs662,6287,825,1 Micro-granulés pour les betteraves25110,0725,6912,8 Herbicides pour prairies1 41756,22 428,5642,9 Autres31712,6740,5613,1 Total2 5211005 659,2100 Source:OFAG
193
■ Objectif visé:exploitation de toute la surface agricole
2.2.2 Paiements directs généraux
Contributions à la surface
Les contributions à la surface servent à rétribuer les prestations fournies dans l'intérêt général telles que la protection et l’entretien du paysage rural,la garantie de la production alimentaire et la préservation du patrimoine naturel.Depuis 2001,une contribution supplémentaire pour les terres ouvertes et les cultures pérennes est venue s’y ajouter.Elle doit permettre de rétribuer la part des prestations fournies,en culture des champs,dans l'intérêt général,et ne pouvant être indemnisées autrement par suite de la réduction du prix-seuil et de la libéralisation du marché des céréales.Dans la région des collines et de montagne,où les conditions sont plus difficiles,les agriculteurs reçoivent en outre des contributions pour des terrains en pente,ainsi que pour la garde d’animaux dans des conditions difficiles.
Tableaux 32a–32b,pages A32–A33
Taux de 2002fr./ha 1
– Jusqu’à 30 ha1 200
– De 30 à 60 ha900
– De 60 à 90 ha600

– Plus de 90 ha0
1La contribution supplémentaire allouée pour les terres ouvertes et les cultures pérennes s’élève à 400 fr./ha et par an;elle est également soumise à l’échelonnement en fonction des surfaces
Pour les surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère,les taux de tous les paiements directs liés aux surfaces sont réduits de 25%.Il s’agit en tout de 5'122 ha,exploités dans la zone limitrophe depuis 1984.
■■■■■■■■■■■■■■■■
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 194
Contributions à la surface versées en 2002 (contribution supplémentaire comprise)
Région desRégion de Total plainecollinesmontagne
La contribution supplémentaire a été versée pour 275'374 ha de terres ouvertes et 17'584 ha de cultures pérennes.
Répartition des exploitations et de la SAU en fonction des classes de grandeur en 2002
Quelque 7,8% de la SAU sont touchés par la dégression des contributions.Au titre de la contribution à la surface,il est versé en moyenne un montant de 1'286 francs par ha (contribution supplémentaire incluse).Les exploitations comptant jusqu’à 10 ha couvrent en tout 9,7% de la SAU.Seul 0,9% de l’ensemble des exploitations dispose de plus de 60 ha;elles exploitent 3,5% de la SAU.
ParamètreUnitéRégion
Surfaceha475 734262 061286 0241 023 819 Exploitationsnombre24 35315 71317 78457 850 Surface par exploitationha19,516,716,117,7 Contribution par exploitationfr.26 68520 85719 03922 752 Total des contributions1 000 fr.649 864327 7261 316 183 Total des contributions 20011 000 fr.643 489325 919338 5931 303 881 Source:OFAG
de
Source: OFAG Classes de grandeur en ha Exploitations SAU < 30 30 < SAU < 60 60 < SAU < 90 SAU > 90 30 20 2010 020103040 plus de 90 60–90 30–60 20–30 15–20 10–15 5–10 jusqu'à 5 1,51,50,5 19,8 27,7 18,1 15,3 8,1 11,6 0,9 0,0 0,0 0,0 20,1 18,3 21,6 18,7 1,6 5,8 Exploitations en %SAU en % 8,7 2.MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE 2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 195
■ Surfaces utilisées comme herbages
Contributions pour la garde d’animaux consommant des fourrages grossiers
Cette mesure vise à préserver la compétitivité des producteurs de viande disposant d’une base fourragère et,en même temps, à assurer l’exploitation de l’ensemble des terres agricoles de la Suisse,pays à vocation herbagère.
Les contributions pour la garde d’animaux consommant des fourrages grossiers sont versées pour des animaux gardés dans l’exploitation durant la période d’affouragement d’hiver (période de référence:du 1er janvier au jour de référence de l’année de contributions).Sont considérés comme animaux consommant des fourrages grossiers les bovins et les équidés,ainsi que les moutons,les chèvres,les bisons,les cerfs,les lamas et les alpagas.Les contributions sont versées pour les surfaces herbagères permanentes et pour les prairies artificielles.Les diverses catégories d’animaux sont converties en unités de gros bétail fourrage grossier (UGBFG).
Limites d’encouragementUGBFG/ha
Zone de grandes cultures,zone intermédiaire élargie et zone intermédiaire2,0
– Zone des collines1,6
– Zone de montagne I1,4
Zone de montagne II1,1
– Zone de montagne III0,9
– Zone de montagne IV0,8
L'échelonnement de la limite des contributions selon les zones correspond,d’une part, à la charge en bétail maximale prévue dans les instructions pratiques pour la protection des eaux dans l'agriculture;d’autre part,il tient compte du potentiel de rendement décroissant.Ainsi,ces contributions n’ont pas d’effet sur la production,mais concourent à l’exploitation de toute la surface agricole.
A droit aux contributions quiconque garde au moins une UGBFG dans son exploitation et satisfait aux conditions de base et aux exigences minimales de l’OPD.
Les contributions sont plus élevées pour les animaux exigeant davantage de travail et d'investissements dans les bâtiments.De fait,les UGBFG sont réparties entre deux groupes de contributions.Pour les bovins, équidés,bisons,chèvres et brebis laitières, le taux est de 900 francs par UGBFG,alors qu’il est fixé à 400 francs pour les chèvres et moutons ainsi que pour les cerfs,les lamas et les alpagas.
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 196
–
–
Contributions versées en 2002 pour la garde d’animaux consommant des fourrages grossiers

ParamètreUnité Région de Région desRégion de Total plainecollinesmontagne
UGBFG
UGBFG
Ces contributions ont remplacé celles versées jusqu’en 1998 aux détenteurs de vaches ne commercialisant pas de lait.Elles sont allouées non seulement pour les vaches dont le lait n’est pas commercialisé,mais encore pour les autres animaux consommant des fourrages grossiers.Pour ce qui est des producteurs de lait bénéficiaires des contributions,ils ont des exploitations plutôt extensives.En outre,ils gardent une proportion relativement importante d’animaux d’élevage et d’engraissement par rapport à leur effectif de vaches et disposent d’une surface herbagère suffisante.En 2002,leur effectif de bétail donnant droit aux contributions a été réduit d'une UGBFG par 4’400 kgde lait livrés l'année précédente.Le relèvement de ce chiffre de 200 kg par rapport à l’année précédente a fait augmenter d’environ 11 millions de francs les contributions complémentaires octroyées aux producteurs de lait.Comparé à 2001,le montant des contributions versées a progressé d’environ 15 millions de francs,hausse imputable d’une part au relèvement du volume servant de base à la déduction pour le lait commercialisé et,d’autre part, à la reconversion vers une production sans commercialisation,ainsi qu’à l’optimisation des contributions.
Contributions versées en 2002 aux exploitations avec et sans lait commercialisé
ParamètreUnité Exploitations avec Exploitations sans commercialisation commercialisation
ExploitationsNombre21 62116 923
Animaux par exploitationUGBFG23,512,5
Déduction pour limitation des contributions en fonction de la surface herbagèreUGBFG1,31,2
Déduction pour lait commercialisé UGBFG15,80,0
Animaux donnant droit aux contributionsUGBFG6,411,3
Contributions par exploitationfr.5 6499 518
Source:OFAG
Certes,les exploitations qui commercialisent du lait touchent environ 3'900 francs de moins de contributions UGBFG que celles qui ne le font pas.Mais elles bénéficient en revanche de mesures de soutien du marché laitier (p.ex.supplément pour le lait transformé en fromage).
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 2.MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE 197
donnant droit aux contributionsnombre88 54684 998156 158329 702 Exploitationsnombre11 01911 48716 03838 544
donnant droit aux contributions par exploitationnombre8,07,49,78,6 Contributions par exploitationfr.6 9626 3988 2947 348 Total des contributions1 000 fr.76 71473 489133 018283 221 Total des contributions 20011 000 fr.71 28667 240129 746268 272
Source:OFAG
■ Compensation des difficultés de production
Contributions pour la garde d’animaux dans des conditions difficiles
Ces contributions servent à compenser les conditions de production difficiles des éleveurs dans la région de montagne et dans la zone des collines.Cette mesure comporte aussi des aspects sociaux et structurels et vise des objectifs relevant de l’occupation du territoire.Tel n’est pas le cas des contributions «générales» allouées pour la garde d’animaux de rente consommant des fourrages grossiers,qui sont destinées en premier lieu à promouvoir l’exploitation et l’entretien des herbages.Les contributions sont versées aux agriculteurs qui exploitent au moins 1 ha de SAU dans la zone des collines ou dans la région de montagne et qui détiennent au moins une UGBFG. Donnent droit aux contributions les mêmes catégories d’animaux que dans le cas des contributions versées pour la garde d’animaux consommant des fourrages grossiers.
Le nombre limite d’UGB donnant droit aux contributions par exploitation a été porté de 15 à 20 UGB pour l’année de contributions 2002.Le relèvement de cette limite permet,d’une part,d’améliorer les revenus dans l’agriculture de montagne et,d’autre part,d’atténuer les effets structurels défavorables de la limitation.Les taux des contributions sont différenciés selon les zones.
Zone de montagne IV1 190
Contributions versées en 2002 pour la garde d’animaux dans des conditions difficiles
ParamètreUnité Région de Région desRégion de Total plaine 1 collinesmontagne UGBFG donnant droit
342
Total des contributions1 000 fr.4 15782 449202 966289 572
Total des contributions 20011 000 fr.3 24569 981177 029250 255
1 Entreprises exploitant une partie des surfaces dans la région de montagne et des collines
Source:OFAG
Les contributions pour la garde d’animaux dans des conditions de production difficiles ont augmenté de près de 40 millions de francs par rapport à 2001,suite au relèvement de la limite qui est passée de 15 à 20 UGB.De fait,les UGBFG donnant droit aux contributions enregistrent une augmentation de quelque 78'000 unités.Le nombre d’exploitations a,par contre,continué à reculer,en l’occurrence de 870 unités.
Taux par UGBFG en 2002fr./ UGB – Zone des collines260 – Zone de montagne I440 – Zone de montagne II690 – Zone de montagne III930 –
aux
908 Exploitationsnombre2
UGBFG
exploitationnombre17,915,914,315,3 Contributions par exploitationfr.1
contributionsnombre46 319238 058245 531529
58814 94217 18134 711
par
6065 51811 8138
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 198
Répartition des animaux consommant des fourrages grossiers dans des conditions de production difficiles selon les classes de grandeur – 2002 45–90
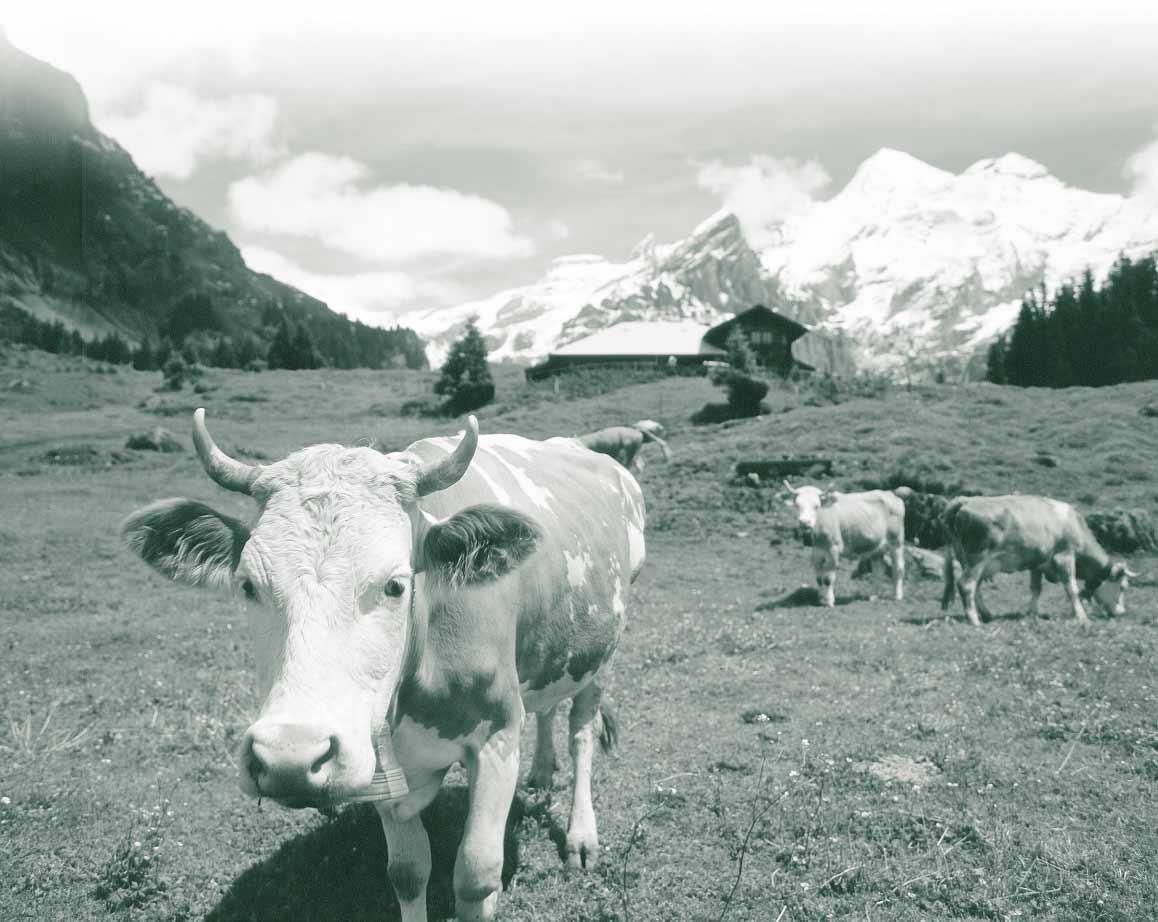
Exploitations (en 100)Animaux en UGBFG (en 1 000)
Source: OFAG
Environ 84% du cheptel UGBFG donnant droit aux contributions ont été concernés par cette limitation durant l’année de contributions 2002.Avec le relèvement de la limite de 15 à 20 UGBFG,l’effectif d’animaux donnant droit aux contributions a augmenté de 11% par rapport à 2001 pour s’élever à 72% en tout.
30 –45 20 –30 15–20 10–15 5–10 jusqu'à 5
Classes de grandeur en UGBFG
Animaux (en 1 000) avec contribution Animaux (en 1 000) sans contribution 30 20 0 50100 150200250 4877 10078 163 1024 67 39 8 84 49 22 60 55 53 22 43
Exploitations (en 100)
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 199
■ Contributions générales pour des terrains en pente:compensation des difficultés dans l’exploitation des surfaces
Contributions pour des terrains en pente
Les contributions générales pour des terrains en pente compensent l’exploitation des terres dans des conditions difficiles en région des collines ou celle de montagne.Elles ne sont versées que pour les prairies,les surfaces à litière et les terres assolées.Les prairies et les surfaces à litière doivent être fauchées au moins une fois par an.Par contre,les contributions ne sont pas octroyées pour les haies et les bosquets champêtres,ni pour les pâturages et les vignobles.

Ont droit aux contributions pour les terrains en pente les exploitants qui satisfont aux conditions de base et aux exigences minimales de l’OPD.Celle-ci précise que la surface en pente doit dépasser 50 ares en tout et 5 ares par parcelle d’exploitation.On distingue deux degrés de déclivité:
Taux de 2002fr./ ha
– Déclivité de 18 à 35%370
– Déclivité de plus de 35%510
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 200
Contributions versées en 2002 pour des terrains en pente
ParamètreUnité Région de Région desRégion de Total plaine 1 collinesmontagne
1Exploitations englobant des surfaces situées dans la région de montagne et des collines Source:OFAG
Exploitations ayant reçu en 2002 des contributions pour terrains en pente
L’étendue des surfaces annoncées se modifie d’une année à l’autre, évolution qui dépend surtout des conditions climatiques et de leur impact sur le type d’exploitation (plus ou moins de pâturages ou de prairies de fauche).
contributions: – déclivité de
44366 99473 838145 275 – déclivité de
de 35%ha1 30818 83062 37982 518 Totalha5 75185 825136 217227 793 Exploitationsnombre2 10714 03216 57632 715 Contribution par exploitationfr.1 0972 4513 5662 929 Total des contributions1 000 fr.2 31134 38859 11295 811 Total des contributions 20011 000 fr.2 27934 79159 57396 643
Surfaces donnant droit aux
18 à 35%ha4
plus
Déclivité
Déclivité de 18 à 35% 26% Déclivité de 35% et plus 15% Total
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 2.MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE 201
Source: OFAG
inférieure à 18% 59%
556 906 ha
■ Contributions pour des terrains en pente: préservation des surfaces viticoles en forte pente et en terrasses
Les contributions octroyées pour les surfaces viticoles en pente contribuent à la préservation des vignobles plantés en pente et en terrasses.Il convient de faire la distinction entre,d’une part,les fortes et les très fortes pentes et,d’autre part,les terrasses aménagées sur des murs de soutènement.Pour les vignobles,les contributions ne sont allouées qu’à partir d’une déclivité de 30%.
Les vignobles en terrasses sont des surfaces viticoles composées de paliers réguliers, épaulés par des murs de soutènement,et qui remplissent les conditions suivantes:
– densité minimale de terrasses,c’est-à-dire distance maximale de 30 m entre les murs de soutènement;
– aménagement en terrasses,devant couvrir un périmètre de 1 ha au moins;
– murs de soutènement devant mesurer au moins 1 m de hauteur,les murs ordinaires en béton n’étant pas pris en compte.
Ont droit aux contributions les exploitants qui remplissent les conditions de base et les exigences minimales fixées dans l’OPD et dont l’exploitation comprend une surface en pente dépassant 10 ares en tout et 2 ares par parcelle d’exploitation.Les taux des contributions sont fixés indépendamment des zones.
Contributions versées en 2002 pour les vignes en forte pente et en terrasses
La part des surfaces viticoles en forte pente et en terrasses représente quelque 26% de la surface viticole totale,et le nombre d’exploitations 49% du total des exploitations viticoles.
Taux de 2002fr./ ha – Surface de 30 à 50% de déclivité 1 500 – Surface de plus de 50% de déclivité 3 000 – Surfaces en terrasses5 000
Unité Surfaces donnant droit à la contribution,totalha3 276 Forte pente,déclivité de 30 à 50%ha1 632 Forte pente,déclivité de plus de 50%ha311 Aménagements en terrassesha1 334 Nombre d’exploitationsnombre2 740 Surface par exploitationha1,2 Contribution par exploitationfr.3 668 Total des contributions1 000 fr.10 051 Total des contributions 20011 000 fr.10 043 Source:OFAG
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 202
2.2.3Paiements directs écologiques

Contributions écologiques
Les paiements directs écologiques rétribuent des prestations écologiques particulières qui dépassent le cadre des PER.Les exploitants peuvent choisir librement de participer aux différents programmes qui leur sont offerts.Ceux-ci sont indépendants les uns des autres,et les contributions peuvent être cumulées.
359,4 millions de fr.
Source: OFAG
■■■■■■■■■■■■■■■■
Compensation
Culture
SRPA 37% SST 11% Culture
OQE 2% 2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 203
Tableaux 33a–33b,pages A34–A35 Répartition des contributions écologiques entre les divers programmes en 2002
Total
écologique 34%
extensive 9%
biologique 7%
Compensation écologique
Par la compensation écologique,on entend préserver et,si possible, étendre l’espace vital de la faune et de la flore suisses dans les régions agricoles.La compensation écologique contribue aussi au maintien des structures et des éléments paysagers typiques.Certains éléments de la compensation écologique sont rétribués à l’aide de contributions et peuvent en même temps être imputés à la compensation écologique obligatoire des PER,alors que d’autres sont imputables à cette dernière mais ne donnent pas droit aux contributions.
Eléments de la compensation écologique,donnant droit ou non à des contributions
Eléments imputables aux PER Eléments imputables aux PER et donnant droit aux contributions sans donner droit aux contributions prairies extensivespâturages extensifs prairies peu intensivespâturages boisés surfaces à litièrearbres isolés indigènes adaptés au site et allées d’arbres haies,bosquets champêtres et fossés humides,mares, étangs berges boisées jachères floralessurfaces rudérales,tas d’épierrage et affleurements rocheux jachères tournantesmurs de pierres sèches bandes culturales extensiveschemins naturels non stabilisés arbres fruitiers haute-tigesurfaces viticoles à haute diversité biologique autres surfaces de compensation écologique faisant partie de la SAU,définies par le service cantonal de protection de la nature
Ces surfaces doivent mesurer au moins 5 ares et ne peuvent,selon les zones, être utilisées avant la mi-juin ou la mi-juillet pendant une période de six ans.La fauche tardive doit garantir que les semences arrivent à maturité et que leur dispersion naturelle favorise la diversité des espèces.Elle laisse par ailleurs suffisamment de temps aux oiseaux nichant au sol et à d’autres petits mammifères pour leur reproduction.La fumure est interdite,de même que l’utilisation de produits phytosanitaires, à l’exception du traitement plante par plante des mauvaises herbes qui posent des problèmes.
Les contributions versées pour les prairies extensives,les surfaces à litière,les haies et les bosquets champêtres sont réglées de manière uniforme et échelonnées selon la zone où se trouve la surface.La part des prairies extensives n’a cessé d’augmenter au cours des dernières années.
Taux de 2002fr./ha
Zone de grandes cultures et zones intermédiaires1 500
– Zone des collines1 200
Zones de montagne I et II700
– Zones de montagne III et IV450
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 204
–
–
Tableaux 34a–34d,pages A36–A39
■ Prairies extensives
■ Surfaces à litière
Contributions versées en 2002 pour les prairies extensives
■ Haies,bosquets champêtres et berges boisées
Par surfaces à litière,on entend les surfaces exploitées d'une manière extensive,se trouvant dans les lieux humides et marécageux et qui,en règle générale,sont fauchées en automne ou en hiver pour la production de litière.Les prescriptions d’exploitation sont en principe les mêmes que pour les prairies extensives.La fauche n’est toutefois autorisée qu’à partir du 1er septembre.
Contributions versées en 2002 pour les surfaces à litière
Par haies,bosquets champêtres et berges boisées,on entend les haies basses,les haies arbustives et arborées,les brise-vents,les groupes d’arbres,les talus et les berges boisées.Ces surfaces doivent mesurer au moins 5 ares et être utilisées de manière appropriée pendant une période de six ans sans interruption.Elles doivent aussi être entretenues convenablement.La fumure et l’utilisation de produits phytosanitaires sont interdites.Une bande herbeuse,non fertilisée,d'une largeur de 3 m au moins,doit être aménagée le long des bandes boisées touffues.
Contributions versées en 2002 pour les haies,bosquets champêtres et berges boisées
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 2.MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE 205
ParamètreUnité Région de Région desRégion de
plainecollinesmontagne Exploitationsnombre18 2019 0499 67936 929 Surfaceha22 7839 22214 06646 071 Surface par exploitationha1,251,021,451,25 Contribution par exploitationfr.1 8361 0317681 359 Contributions1 000 fr.33 4179 3327 43650 186 Contributions en 20011 000 fr.31 6538 8257 19147 669 Source:OFAG
Total
ParamètreUnité Région de Région
Exploitationsnombre1 7051 8303 0996 634 Surfaceha1 7111 4233 4376 571 Surface par exploitationha1,000,781,110,99 Contribution par exploitationfr.1
Contributions1 000 fr.2 5201 3752 1666 061 Contributions en 20011 000 fr.2 1121 0671 4074 586 Source:OFAG
desRégion de Total plainecollinesmontagne
478751699914
ParamètreUnité
Exploitationsnombre5 3232 6281 0438 994 Surfaceha1 3087112982 317 Surface par exploitationha0,250,270,290,26 Contribution par exploitationfr.364277188318 Contributions1 000 fr.1 9377271962 860 Contributions en 20011 000 fr.1 8996982012 797 Source:OFAG
Région de Région desRégion de Total plainecollinesmontagne
■ Prairies peu intensives

Les prairies peu intensives peuvent être légèrement fertilisées avec du fumier ou du compost.En outre,elles sont assujetties aux mêmes règles d’utilisation que les prairies extensives.
Taux de 2002fr./ ha
– Zone de grandes cultures à zone des collines650
– Zones de montagne I et II450
– Zones de montagne III et IV300
Contributions versées en 2002 pour les prairies peu intensives
■ Jachères florales
Par jachères florales,on entend les bordures pluriannuelles de 3 m de largeur au moins, ensemencées d'herbacées sauvages indigènes.Leur fertilisation est interdite.Des traitements chimiques plante par plante sont autorisés contre les mauvaises herbes posant des problèmes,pour autant qu'il soit impossible de les combattre par des moyens mécaniques sans une charge disproportionnée.Dès l'année suivant celle de la mise en place,la jachère florale peut être fauchée pour moitié entre le 1er octobre et le 15 mars.Cette jachère sert à protéger les herbacées sauvages menacées.Elle offre également habitat et nourriture aux insectes et autres petits animaux.De surcroît,elle sert de refuge aux lièvres et aux oiseaux.
Les jachères florales donnent droit à une contribution de 3'000 fr./ha,qui est octroyée dans la région de grandes cultures,y compris la zone des collines.
ParamètreUnité Région de Région desRégion de Total plainecollinesmontagne Exploitationsnombre9 2258 89910 58928 713 Surfaceha8 1218 09120 71536 928 Surface par exploitationha0,880,911,961,29 Contribution par exploitationfr.565502666582 Contributions1 000 fr.5 2104 4647 04916 724 Contributions en 20011 000 fr.5 6074 6747 30717 588
Source:OFAG
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 206
Contributions versées en 2002 pour les jachères florales
ParamètreUnité Région de Région desRégion de Total plainecollinesmontagne1
1Il s’agit d’entreprises exploitant des surfaces dans la zone des collines ou la région de plaine
■ Jachères tournantes
Source:OFAG
Dans le contexte de la libéralisation du marché des céréales,les jachères florales sont devenues une solution de substitution intéressante aux cultures des champs.
Par jachères tournantes,on entend des surfaces ensemencées,pendant un ou deux ans,d'herbacées sauvages indigènes accompagnatrices de cultures;elles doivent présenter une largeur de 6 m au moins et couvrir au minimum 20 ares.Les jachères tournantes offrent un habitat aux oiseaux couvant au sol,aux lièvres et aux insectes. L’enherbement naturel est également possible à des endroits propices,mais la fertilisation est interdite.Des traitements chimiques plante par plante sont autorisés contre les mauvaises herbes posant des problèmes,pour autant qu'il soit impossible de les combattre par des moyens mécaniques sans une charge disproportionnée.La surface mise en jachère tournante ne peut être fauchée qu’entre le 1er octobre et le 15 mars.
Les jachères tournantes donnent droit à une contribution de 2'500 fr./ha qui,comme pour les jachères florales,est octroyée dans la région de grandes cultures,y compris la zone des collines.
Contributions versées en 2002 pour les jachères tournantes
ParamètreUnité Région de Région desRégion de Total plainecollines1 montagne1
Exploitationsnombre8301362968
Surfaceha1 15217111 325
Surface par exploitationha1,391,260,681,37
Contribution par exploitationfr.3 4713 1471 6883 421
Contributions1 000 fr.2 88142833 312
Contributions en 20011 000 fr.2 78841233 203
1Il s agit d entreprises situées dans la région des collines et de montagne,mais exploitant une partie de leurs surfaces dans la région de plaine
Source:OFAG
Exploitationsnombre2 10739552 507 Surfaceha1 95332812 283 Surface par exploitationha0,930,830,260,91 Contribution par exploitationfr.2 7822 4957862 733 Contributions1
fr.5 86198546 850 Contributions en 20011
fr.5 01086765 883
000
000
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 2.MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE 207
■
Bandes culturales extensives
Les bandes culturales extensives offrent un espace de survie aux herbacées accompagnant traditionnellement les cultures.On entend par là des bandes de cultures des champs (céréales,colza,tournesols,pois protéagineux,féveroles et soja,sans le maïs), d’une largeur de 3 à 12 m et exploitées de manière extensive.L’utilisation d’engrais azotés et d’insecticides ainsi que le traitement de surface chimique ou mécanique contre les mauvaises herbes sont interdits.Des traitements chimiques plante par plante sont autorisés contre les mauvaises herbes posant des problèmes,pour autant qu'il soit impossible de les combattre par des moyens mécaniques sans une charge disproportionnée.
En 2002,un montant de 1'500 francs a été versé par hectare.Les contributions ne sont allouées que pour les surfaces situées en plaine et dans la zone des collines.
Contributions versées en 2002 pour les bandes culturales extensives
ParamètreUnité Région de Région desRégion de Total plainecollinesmontagne1
Exploitationsnombre120331154
Surfaceha2960.135
Surface par exploitationha0,240,170,100,23
Contribution par exploitationfr.367251150341
Contributions1 000 fr.448052
Contributions en 20011 000 fr.598066
1Il s’agit d’entreprises exploitant des surfaces situées en plaine ou dans la région des collines
■ Arbres fruitiers haute-tige
Source:OFAG
La Confédération verse des contributions pour les arbres haute-tige de fruits à noyau ou à pépins ne faisant pas partie d’une culture fruitière,ainsi que pour les châtaigneraies et les noiseraies entretenues.Le tronc doit présenter une hauteur minimale de 1,2 m pour les arbres de fruits à noyau et de 1,6 m pour les autres arbres.L’utilisation d’herbicides pour dégager le tronc est interdite,sauf pour les arbres âgés de moins de cinq ans.Il faut 20 arbres au moins pour qu’il y ait un droit aux contributions.Les contributions pour les arbres fruitiers haute-tige peuvent être cumulées avec celles qui sont versées pour les prairies extensives ou peu intensives et avec celles qui sont octroyées en vertu de l’ordonnance sur la qualité écologique.En 2002,un montant de 15 frans a été alloué par arbre annoncé
Contributions versées en 2002 pour les arbres fruitiers haute-tige
ParamètreUnité Région de Région desRégion de Total plainecollinesmontagne Exploitationsnombre17 34512 9835 50635 834 Arbresnombre1 223 574926 273270 1672 420 014 Arbres par exploitationnombre70,5471,3549,0767,53 Contribution par exploitationfr.1 0581 0707361 013 Contributions1 000 fr.18 35313 8944 05336 300 Contributions en 20011 000 fr.18 70113 9693 94336 613 Source:OFAG
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 208
Répartition des surfaces de compensation écologique1 en 2002
Total 95 527 ha
Jachères tournantes 1,4%
Jachères florales 2,4%
Prairies peu intensives 38,7%
Bosquets champêtres et berges boisées 2,4%
Bandes culturales extensives 0,1%
Prairies extensives 48,2%
Surfaces à litière 6,9%
Source: OFAG 1 sans arbres fruitiers haute-tige

2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 209
■ Situation actuelle en matière de surfaces de compensation écologique (SCE)

Evolution des surfaces de compensation écologique
Depuis l’instauration en 1993 de la compensation écologique en tant que programme écologique distinct,la part des SCE à l’ensemble de la SAU n’a fait que s’accroître. Cette augmentation a surtout été déclenchée par l’exigence,en rapport avec la production intégrée (PI),d’une part minimale de 7% de ces surfaces (3,5% pour les cultures spéciales).La surface affectée à la compensation écologique et donnant droit aux contributions recouvre aujourd’hui plus de 95'000 ha,soit près de 9% de la SAU. Autre élément important de la compensation écologique:les arbres fruitiers haute-tige qui sont au nombre de 2,4 millions actuellement.La Confédération soutient ces SCE à raison de quelque 122 millions de francs (pour l’évolution des surfaces,cf.chiffre 1.3.1).
Répartition des SCE en fonction des éléments et des régions en 2002 1
Région de Région des Région de plainecollinesmontagne en haen % deen haen % deen haen % de Elémentsla SAUla SAUla SAU Jachères florales1 9530,393280,1210 Jachères tournantes1 1520,231710,0610 Prairies peu intensives8 1211,68 0912,9220 7157,23 Bosquets champêtres et berges boisées1 3080,267110,262980,10 Bandes culturales extensives290,01600,10 Prairies extensives22 7834,509 2223,3314 0664,91 Surfaces à litière1 7110,341 4230,513 4371,20 Total37 0577,3319 9527,2038 518,113,44 1Sans les arbres fruitiers haute-tigeSources:OFAG,OFS 2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 210
Ordonnance sur la qualité écologique
L’ordonnance sur la promotion régionale de la qualité et de la mise en réseau des surfaces de compensation écologique dans l’agriculture (ordonnance sur la qualité écologique;OQE;RS 910.14) s’applique depuis le 1er mai 2001.
Afin de conserver et d’encourager la richesse naturelle des espèces,la Confédération alloue des aides financières pour les surfaces de compensation écologique (SCE) d’une qualité biologique particulière aménagées sur la SAU et pour leur mise en réseau.Les exigences que doivent remplir les surfaces donnant droit à des contributions selon l’OQE sont fixées par les cantons.De son côté,la Confédération vérifie les prescriptions cantonales sur la base de critères minimaux.Dans la mesure où les prescriptions cantonales sont conformes aux exigences minimales de la Confédération et que le cofinancement régional est assuré,la Confédération accorde aux cantons des aides financières destinées aux agriculteurs.En fonction de la capacité financière du canton,le montant de ces aides se situe entre 70 et 90% des contributions imputables,les 10 à 30% restants devant être pris en charge par des tiers (cantons,communes,particuliers, organismes).Les contributions à la qualité biologique peuvent être cumulées avec celles versées pour la mise en réseau.L’OQE se fonde sur le volontariat,sur des incitations financières et sur la prise en considération des différences régionales eu égard à la biodiversité
Taux imputables
Taux de 2002fr.
– Pour la qualité biologique500.–/ha
– Pour la qualité biologique des arbres fruitiers haute-tige20.–/arbre
– Pour la mise en réseau500.–/ha
Source:OFAG
Une surface de compensation écologique contribue au maintien et à la promotion de la biodiversité,surtout lorsqu'elle présente des espèces indicatrices ou des éléments de structure déterminés,ou encore lorsque son emplacement est judicieux du point de vue écologique.L'exploitant peut annoncer directement sa surface de compensation écologique au titre de la qualité biologique;par contre,la mise en réseau des surfaces exige une stratégie portant sur un ensemble qui justifie cette mesure des points de vue paysager et écologique.
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 2.MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE 211
Tableau 35,page A40
Objectif de la qualité biologique
Surfaces de compensation écologique
Prairies extensives (type 1)
Prairies peu intensives (type 4)
Surfaces à litière (type 5)
Arbres fruitiers haute-tige (type 8) Haies,bosquets champêtres et berges boisées (type 10)
Objectif
Maintenir et promouvoir des prairies riches en espèces végétales et animales caractéristiques de la région.
Maintenir et promouvoir les insectes et les oiseaux dépendants des arbres fruitiers haute-tige. Maintenir et promouvoir,dans les haies,les bosquets champêtres et les berges boisées,la diversité faunistique et floristique,précieuse au plan biologique et caractéristique de la région.
Source:OFAG
Objectif de mise en réseau
Objectif
Maintenir et promouvoir les espèces végétales et animales caractéristiques de la région grâce à une mise en réseau ciblée des surfaces de compensation écologique
Exigences auxquelles doivent satisfaire les surfaces de compensation écologique
Les surfaces de compensation écologique et les habitats semi-naturels doivent être agencés,mis en valeur et complétés de manière à ce que
les espèces animales caractéristiques à promouvoir disposent d'un espace vital suffisamment grand et approprié pour la recherche de nourriture,la reproduction et l'hivernage et disposent des espèces végétales nécessaires à leur établissement et à l'accroissement de leur population;
– les conditions propices au flux génétique et à la propagation des espèces animales et des espèces végétales soient réunies;et
– les particularités paysagères d'une région soient prises en compte.
Le choix des types de SCE à mettre en réseau dépend des espèces que l’on entend promouvoir.De plus,les exigences écologiques des espèces et les conditions liées à leur propagation déterminent l'emplacement des SCE,leur étendue,la distance entre les SCE et le mode d’exploitation.
Source:OFAG
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 212
–
Contributions versées en 2002 en vertu de l'ordonnance sur la qualité écologique 1
ParamètreUnité Région de Région desRégion de Total plainecollinesmontagne
Exploitationsnombre3 3563 4803 54110 377
Surface 2 ha3 8845 1606 50815 552
Surface 2 par exploitationha1,161,481,841,50
Contribution par exploitationfr.7921 006784861
Contributions1 000 fr.2 6563 5002 7788 934
1BE,VD:les données sont incomplètes,GR,UR,TI:les données ne nous sont pas parvenues à temps 2Conversion des arbres haute-tige:1 arbre = 1 are

Contributions versées en 2002 pour la qualité biologique et la mise en réseau
ParamètreUnité Qualité Mise en Qualité biologique réseaubiologique et mise en réseau 1
Prairies extensives,prairies peu intensives et surfaces à litière
406328960
000 fr.4 1381041 525
Haies,bosquets champêtres et berges boisées
Surfaceha7114449
Contributions1 000 fr.295834
Arbres fruitiers haute-tige Exploitationsnombre2 29989454
Arbrespièce130 5991 53233 316
Contributions1 000 fr.2 0836624
Autres éléments Exploitationsnombre05960
Surfaceha08930
Contributions1 000 fr.03320
1les deux programmes combinés
Source:OFAG
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 2.MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE 213
Source:OFAG
Exploitationsnombre7
Surfaceha10
Contributions1
2952712 175
Exploitationsnombre310355155
Culture
extensive
de céréales et de colza
Cette mesure a pour objectif d’inciter les cultivateurs à renoncer,dans la culture de céréales et de colza,aux régulateurs de croissance,aux fongicides,aux stimulateurs chimiques de synthèse des défenses naturelles et aux insecticides.L’ensemble de la surface affectée aux céréales panifiables et fourragères et au colza doit répondre aux exigences y relatives.

La part des céréales panifiables cultivées selon les exigences de la production extensive constitue 44% de la production totale.Elle s’élève à 58% pour les céréales fourragères (sauf le maïs-grain) et à 33% pour le colza.
En 2002,un montant de 400 francs a été versé par ha.
Culture extensive de céréales et de colza en 2002
Répartition des surfaces de culture extensive en 2002
Total 80 140 ha
Colza 6%
Céréales fourragères 42%
Céréales panifiables 52%
Source: OFAG
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 214
ParamètreUnité Région de Région desRégion de Total plainecollinesmontagne Exploitationsnombre10 8556 58396518 403 Surfaceha54 58923 1982 35280 140 Surface par exploitationha5.033.522.444.35 Contribution par exploitationfr.2 0021 4089751 735 Contributions1 000 fr.21 7309 26694031 938 Contributions en 20011 000 fr.21 7379 7431 04632 526 Source:OFAG
Tableau 36,page A41
Agriculture biologique
En complément des recettes supplémentaires réalisables sur le marché,la Confédération encourage l’agriculture biologique en tant que mode de production particulièrement respectueux de l’environnement.Pour obtenir des contributions,les exploitants doivent,au minimum,satisfaire aux exigences de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique,révisée en août 2000.
L'agriculture biologique renonce complètement aux matières auxiliaires chimiques de synthèse telles qu'engrais de commerce ou pesticides.Cela permet d'économiser de l'énergie et préserve l'eau,l'air et le sol.La prise en considération des cycles et procédés naturels revêt donc une importance toute particulière pour l’agriculteur.Les agriculteurs bio,il est vrai,utilisent davantage d'énergie pour l'infrastructure et pour les machines.Globalement,cependant,l'agriculture biologique exploite les ressources existantes de manière plus efficace.Cette efficacité est un indicateur important de la durabilité du système de production.
Le fait de renoncer aux herbicides favorise le développement d'espèces messicoles. Les surfaces présentant une flore diversifiée offrent de la nourriture à un plus grand nombre de petits organismes.Ceux-ci constituent, à leur tour,une proie pour les prédateurs aux membres articulés tels les carabidés,ce qui crée de bonnes conditions pour la lutte naturelle contre les parasites.Les plantes,les animaux et les micro-organismes étant présents en plus grand nombre,l'écosystème est plus résistant aux perturbations et au stress.
L'agriculteur bio épand de la fumure organique,travaille le sol avec ménagement, renonce aux produits phytosanitaires et favorise de ce fait le développement de la population des organismes du sol,en nombre et en espèces.L’activité biologique augmente la fertilité du sol,car il se forme une couche d'humus,la structure du sol s'améliore et l'érosion diminue.
Pour faire co-exister de manière harmonieuse les plantes,le sol,les animaux et l'homme,l'agriculteur bio veille à ce que les circuits d'éléments nutritifs dans son exploitation soient fermés,notamment en assurant que la base fourragère de son exploitation soit conforme au nombre d’animaux qu’il détient.La culture de légumineuses améliore l'offre en azote dans le sol.Les engrais de ferme et le matériel organique provenant des engrais verts et des résidus de récolte garantissent aux plantes un approvisionnement équilibré en éléments nutritifs par le biais des organismes du sol.
L'élevage des animaux de rente doit satisfaire aux exigences du programme SRPA qui, en agriculture biologique,sont considérées comme un minimum à observer.Autres mesures:le recours à un appareil à décharges électriques (dresse-vaches) et l'administration d'aliments médicamenteux aux animaux sont interdits.Les animaux étant nourris pour l'essentiel avec des fourrages produits dans l'exploitation,leur rendement est raisonnable et ils sont en bonne santé.Au besoin,l'agriculteur bio a recours en premier lieu à des méthodes thérapeutiques naturelles.
En 2002,9,6% de la SAU totale ont été cultivés selon les règles de l’agriculture biologique.
2.MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE 2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 215
versées en 2002 pour l’agriculture biologique
Part de la surface de culture biologique selon les régions – 2002
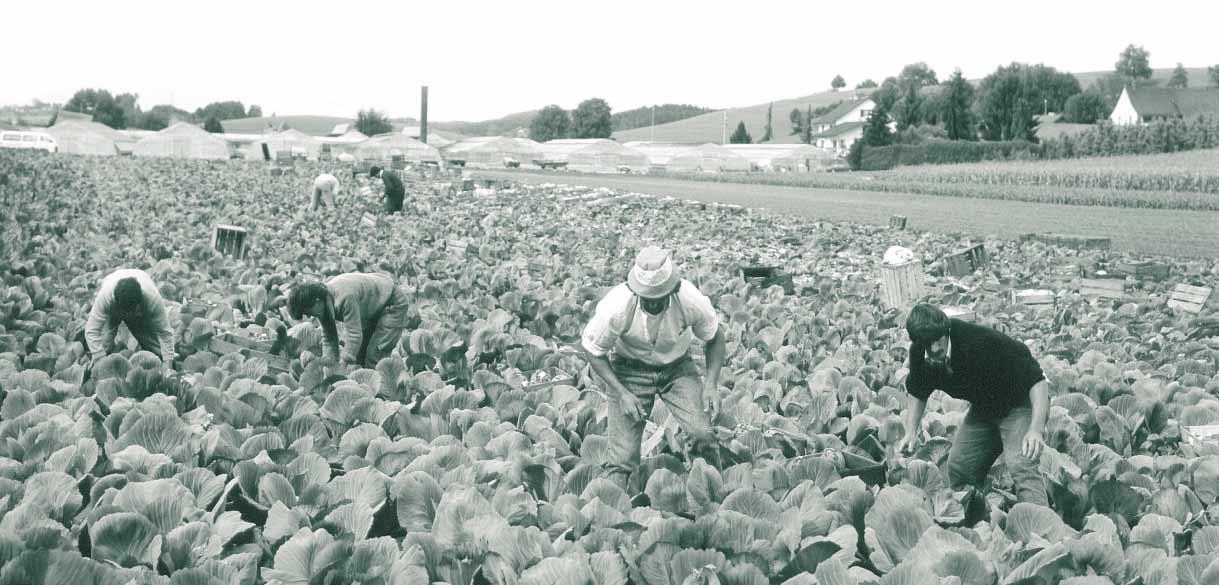
Taux de 2002fr./ ha – cultures spéciales1 200 – terres ouvertes,cultures
– surfaces herbagères et surfaces
Contributions
ParamètreUnité Région de Région desRégion de Total plainecollinesmontagne Exploitationsnombre1 1181 3463 4345 898 Surfaceha19 38621 80161 614102 802 Surface par exploitationha17,3416,2017,9417,43 Contribution par exploitationfr.6 8923 9703 6214 321 Contributions1 000 fr.7 7055 34312 43625 484 Contributions en 20011 000 fr.7 3314 94611 21123 488 Source:OFAG
spéciales exceptées800
à litière200
Tableau 33a,page A34
Région de plaine 19% Région de montagne 60% Source: OFAG Total
Région des collines 21% 2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 216
102 802 ha
■ Systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux (SST)
Garde d’animaux de rente particulièrement respectueuse de l’espèce
Ce titre résume les deux programmes SST et SRPA,qui sont décrits ci-dessous (cf.aussi paragraphe 1.3.2).
La Confédération encourage les agriculteurs à garder les animaux dans des systèmes de stabulation répondant à des exigences qui dépassent largement le niveau requis dans la législation relative à la protection des animaux.Les principes suivants sont applicables:
– les animaux sont gardés librement en groupes;
– ils ont la possibilité de se reposer,de se mouvoir et de s'occuper d’une manière adaptée à leur comportement naturel;
– les étables bénéficient d’une lumière du jour suffisante.
Taux de 2002fr./UGB – bovins,chèvres,lapins90
■ Sorties régulières en plein air (SRPA)
Contributions versées en 2002 pour les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux
ParamètreUnité Région de Région desRégion de Total plainecollinesmontagne Exploitationsnombre8 1585 2123 21116 581
UGBnombre201 58397 17247 008345 763
UGB par exploitationnombre24,7118,6414,6420,85
Contribution par exploitationfr.2 8032 1531 5392 354
Contributions1 000 fr.22 86611 2244 94039 030
Contributions en 20011 000 fr.20 0069 8344 19434 034
Source:OFAG
La Confédération encourage les sorties régulières des animaux de rente en plein air, c’est-à-dire sur un pâturage,dans une aire d'exercice ou à climat extérieur,conformément aux besoins des animaux.Les exigences suivantes sont fixées pour les différentes espèces:
Animaux consommant des fourrages grossiers
– au moins 26 sorties réglementaires au pâturage par mois pendant la période de végétation
– au moins 13 sorties réglementaires au pâturage par mois pendant la période d'affouragement d'hiver.
– porcs155
volaille180
–
Tableau 37,page A42
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 217 2.MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE
Porcs
porcs à l'engrais,animaux de renouvellement et verrats d'élevage:sorties quotidiennes – truies taries:au moins 3 sorties réglementaires par semaine.
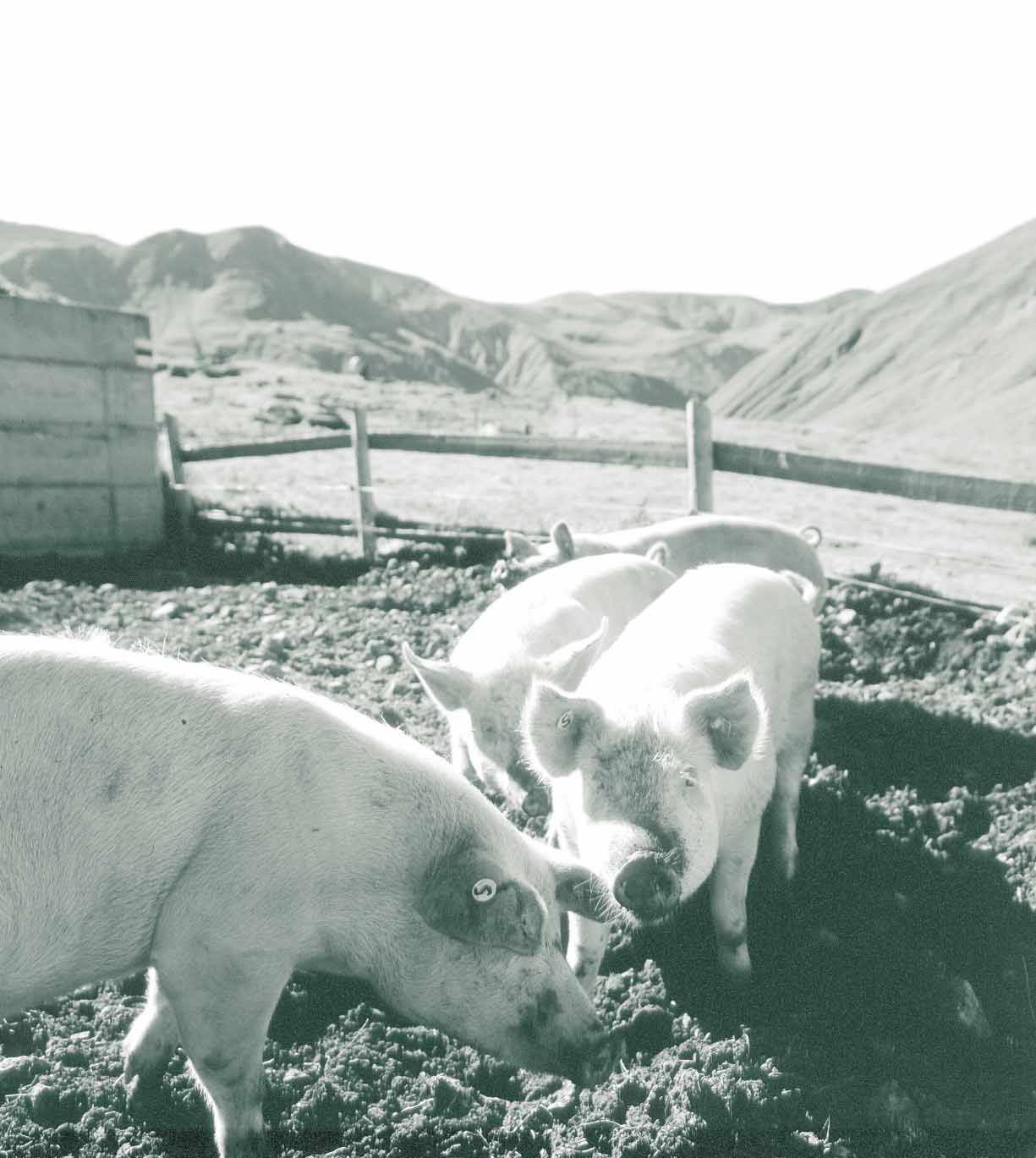
Volaille – sorties quotidiennes
Taux de 2002fr./UGB – bovins et équidés,bisons,moutons,chèvres, daims et cerfs rouges,lapins180
porcs155 – volaille180
Contributions versées en 2002 pour les sorties régulières en plein air
–
–
ParamètreUnité Région de Région desRégion de Total plainecollinesmontagne Exploitationsnombre12 93010 26511 62934 824 UGBnombre319 070222 537201 386742 993 UGB par exploitationnombre24,6821,6817,3221,34 Contribution par exploitationfr.4 3313 8563 1023 781 Contributions1 000 fr.55 99839 58436 072131 654 Contributions en 20011 000 fr.51 44336 53233 447121 422 Source:OFAG Tableau
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 218
37,page A42
■ Exploitation durable des régions d’estivage
Tableaux 40a–40b,page A45
Contributions d’estivage
Les contributions d’estivage ont pour objectif d’assurer l’exploitation et l’entretien de nos vastes pâturages d'estivage dans les Alpes,les Préalpes et le Jura.La région d’estivage s’étend sur quelque 600'000 ha,utilisés et entretenus par plus de 300'000 UGB. Ont droit aux contributions les exploitants qui estivent des animaux dans une exploitation d'estivage,de pâturage ou de pâturages communautaires.
Les exploitations doivent être gérées convenablement et d’une manière respectueuse de l’environnement pour bénéficier de contributions,et respecter les prescriptions cantonales,communales ou de coopératives.Les contributions d'estivage sont versées par pâquier normal (PN) ou par UGB.Un PN correspond à l’estivage d’une UGB pendant 100 jours.
Le taux de contribution pour les autres animaux consommant des fourrages grossiers a été augmenté de 40 fr./PN par rapport à l’année précédente.Grâce à cette augmentation des contributions,les régions d'estivage ont bénéficié d'une amélioration du revenu s'élevant à quelque 9 millions de francs.
Taux de 2002
– vaches traites,chèvres et brebis laitières,par UGB (56 à 100 jours d’estivage)300
– moutons,brebis laitières exceptées,par PN120
– autres animaux consommant des fourrages grossiers,par PN300
Contributions d’estivage 2002
ParamètreContributionsExploitationsUGB
Total89 5617 527 1
Total 200180 5247 607 1
1Il s’agit ici du total des exploitations d’estivage ayant droit aux contributions (sans doubles comptes)Source:OFAG
ou PN 1 000 fr.nombre nombre Vaches traites,chèvres laitières, brebis laitières18 5172 53343 389 Moutons,brebis laitières exceptées3 0391 01723 944 Autres animaux consommant des fourrages grossiers68 0056 947224 277
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 219 2.MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE
■ Eviter le lessivage et le ruissellement de substances
Contributions pour la protection des eaux
L’art.62a de la loi sur la protection des eaux habilite la Confédération à indemniser les mesures prises par les agriculteurs pour éviter le lessivage et le ruissellement de substances dans les eaux superficielles et souterraines.L’accent est mis sur la réduction des charges en nitrates dans l’eau potable et des charges en phosphore dans les eaux superficielles,là où les PER,l’agriculture biologique,les interdictions et les prescriptions contraignantes ou les programmes volontaires encouragés par la Confédération (production extensive,compensation écologique) ne sont pas suffisants.
L’ordonnance sur la protection des eaux oblige les cantons à délimiter une aire d’alimentation pour les captages d’eaux souterraines et de surface,et à déterminer les mesures nécessaires à un assainissement,si la qualité des eaux est insuffisante.Ces mesures peuvent,par rapport à l’état de la technique,considérablement restreindre l’utilisation du sol et causer des pertes financières qui ne sont pas supportables pour les exploitations du point de vue économique.Les contributions fédérales aux coûts sont fixées à 80% pour les adaptations structurelles et à 50% pour les mesures d’exploitation.En 2002,un montant de quelque 3,6 millions de francs a été versé
■ Stratégie de communication concernant le programme «nitrates»
La Confédération soutient depuis 1999 les projets cantonaux (projets nitrates) visant la réduction ciblée de la charge en nitrates des nappes phréatiques.A l'échelon fédéral, c'est le groupe de travail (GT) Nitrates qui est responsable de la mise en oeuvre des projets.Le comité comprend des spécialistes de l'OFAG,de l'OFEFP ainsi que de l'OFSP. La mise en oeuvre conceptuelle et opérationnelle des projets incombe aux cantons.
Le GT Nitrates a pour objectif d'améliorer la communication entre les divers acteurs que sont les services fédéraux,les cantons et les communes et de sensibiliser la population au problème des nitrates.Il importe d’améliorer les connaissances et la motivation des services cantonaux spécialisés et des services de vulgarisation et d’augmenter le taux de participation au programme «nitrates» de la Confédération.Des stratégies de communication englobant un travail approfondi d'information du public,des platesformes d'information et d'échange de savoir et l'organisation de forums,ont encouragé le dialogue et la communication.
En raison de la participation accrue au programme «nitrates»,les contributions versées par la Confédération ont été plus élevées que l'année précédente.
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 220
■ Evolution des teneurs en éléments nutritifs dans la zone d’étude Wohlenschwil
Aperçu des projets 2002
Depuis 2001,le projet Wohlenschwil (AG) fait l’objet de contributions fédérales, conformément à l’art.62a de la loi sur la protection des eaux.Dans le cadre d’un projet pilote,quelque 18 hectares de terres ouvertes ont été transformés en 1996 en prairies extensives non fertilisées.Cette mesure qui, économiquement,n’aurait pas été possible sans indemnisation,a permis d’améliorer la qualité de l’eau potable.Depuis, l’adaptation de l’exploitation agricole dans l’aire d’alimentation et dans le périmètre du captage des eaux «Frohberg» a conduit à une réduction appréciable des apports de substances nutritives.La pollution par les nitrates a baissé de 53 mg/l en 1996 à 25 mg/l en 2003.
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 221 2.MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE
CantonRégion,Durée Région visée Coûts totaux Contributions communeprobablepar le projetprévusversées en du projet2002 Annéehafr.fr. LULac de Sempach1999–2004 1 4 6218 811 1661 064 702 LULac de Baldegg2000–2005 1 5 6009 559‘6941 048 439 LU/AGLac de Hallwil2001–2006 1 3 7865 029906875 052 AGWohlenschwil2001–200962547 69634 679 AGBirrfeld2002–20078131 909 50045 703 VDThierrens1999–200817138 55917 614 VDMorand2000–2008391785 75673 872 ZHBaltenswil2000–2008130712 00029 530 BEWalliswil2000–2005 98539 000200 446 SHKlettgau2001–20063571 811 870104 934 FRAvry-sur-Matran2000–2005 37200 75527 463 FRMiddes2000–2006 45159 99623 471 SOGäu2000–2005 6581 207 05091 478 Total 16 6153 637 383 Total 200114 4862 254 500 1 Prolongation nécessaire
Source:OFAG
Le bassin d’approvisionnement de la nappe phréatique lié au captage des eaux «Frohberg» est affecté essentiellement à l’exploitation agricole.Jusqu’en 1996,la culture des champs y dominait en raison des conditions naturelles idéales.Le bassin d’approvisionnement couvre une surface d’environ 102 ha,dont 62 ha (61%) de SAU, 39 ha (39%) de forêts et 1 ha d’une surface utile non agricole (avant tout bâtie).
12 exploitations agricoles situées dans cinq communes sont concernées par la zone d’étude Wohlenschwil,mais pas toutes dans la même mesure.Certains domaines n’y exploitent que quelques parcelles,tandis que d’autres voient une partie importante de leur SAU incluse dans ladite zone.
Un bon quart de la SAU est constitué de terres ouvertes.La part représentée par les prairies artificielles et naturelles est de 73%.Grâce à l’abandon des cultures,une grande partie des prairies est exploitée de manière extensive.Plus de la moitié des terres ouvertes sont affectées à des cultures sarclées comme le colza,les betteraves sucrières et le maïs.Les cultures posant problème en matière de nitrate,telles que les légumes et les pommes de terre,qui occasionnent des pertes d’azote élevées,ne sont pas représentées en 2003.
Afin que le niveau de 25 mg/l atteint grâce à la réduction des nitrates puisse être maintenu,il convient de reconduire les mesures qui impliquent des prestations supplémentaires de la part des agriculteurs concernés.
2.2 PAIEMENTS DIRECTS 2 222
F é vrier 96 Juin 96 Octobre 96 F é vrier 97 Juin 97 Octobre 97 F é vrier 98 Juin 98 Octobre 98 F é vrier 99 Juin 99 Octobre 99 F é vrier 00 Juin 00 Octobre 00 F é vrier 01 Juin 01 Octobre 01 F é vrier 02 Juin 02 F é vrier 03 Juin 03 Octobre 02 Teneur en nitrate (mg/l) Source: Christoph Ziltener, LBBZ Liebegg 0 60 50 40 30 20 10
Evolution de la teneur en nitrate dans le projet Wohlenschwil (AG)
2.3Amélioration des bases de production
Les mesures prises à ce titre encouragent et soutiennent les agriculteurs en vue d’une production de denrées alimentaires efficiente et respectueuse de l’environnement, ainsi que de l’accomplissement de leurs multiples tâches.
Aides financières octroyées pour l’amélioration des bases de production
MesureComptes Comptes Budget 200120022003 mio.de fr.
Contributions pour améliorations structurelles10290102
Crédits d’investissements987079
Aide aux exploitations30935
Vulgarisation et contributions à la recherche232424
Lutte contre les maladies et parasites des plantes294
Sélections végétale et animale212123
Total277223267
Source:OFAG
Ces mesures visent à atteindre les objectifs suivants:
– amélioration de la compétitivité par l’abaissement des coûts de production;
– promotion du milieu rural;
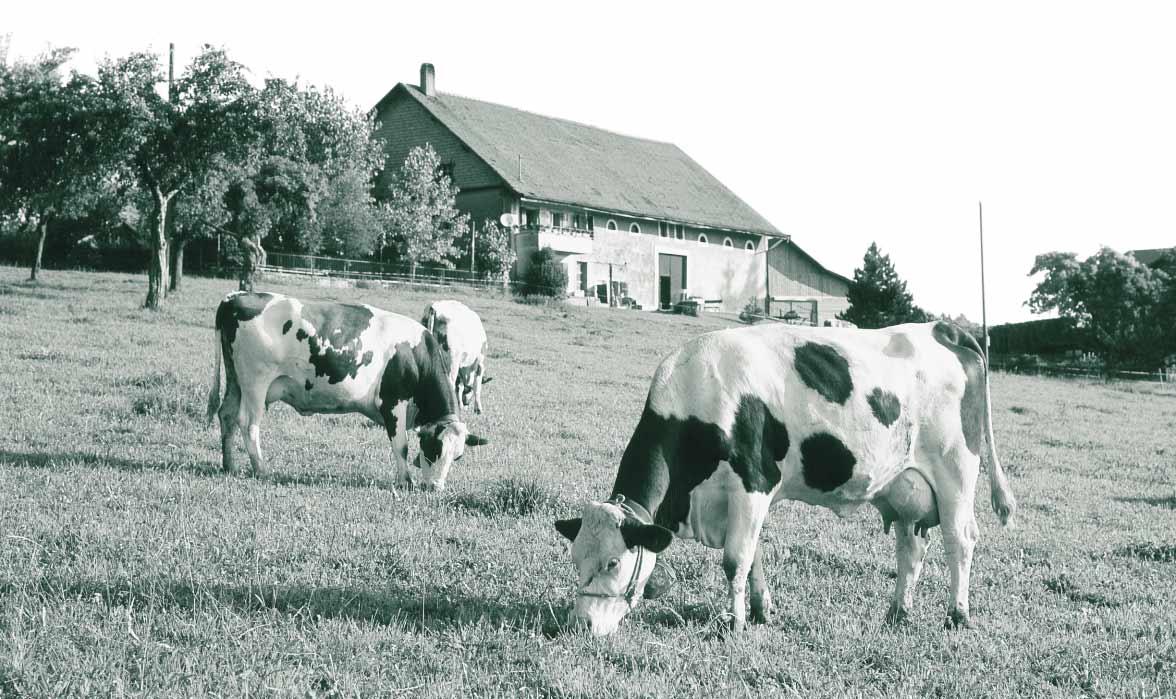
– structures d’exploitation modernes et surfaces agricoles utiles bien desservies;
– production efficiente et respectueuse de l’environnement;
– variétés à rendement élevé,aussi résistantes que possible,et produits de haute qualité;
– protection de la santé humaine et animale et de l’environnement;
– diversité génétique.
■■■■■■■■■■■■■■■■
223 2.3 AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2
2.3.1Améliorations structurelles et aide aux exploitations
Améliorations structurelles
Les mesures prises dans le domaine des améliorations structurelles contribuent à améliorer les conditions de vie et les conditions économiques du monde rural.Cela vaut en particulier pour la montagne et les zones périphériques.
Nous disposons à cet effet de deux types d’aides à l’investissement: –les contributions (à fonds perdu) impliquant la participation des cantons; –les crédits d’investissements octroyés sous la forme de prêts sans intérêts.
Les aides à l’investissement permettent aux agriculteurs de développer et de maintenir des structures compétitives sans devoir pour cela s’endetter excessivement.D’autres pays,notamment des membres de l’UE,comptent également ces aides parmi les principales mesures de promotion du milieu rural.
Les aides à l’investissement sont accordées aussi bien pour des mesures individuelles que collectives.
En cette «Année internationale de l’eau 2003»,ce sujet revêt aussi une actualité particulière pour les améliorations structurelles qui,à cet égard,interviennent surtout dans les domaines.
–Intempéries:
Ces dernières années,la réfection d’infrastructures et de terres cultivées ayant subi des dégâts a gagné en importance.
–Eau potable:
Même en Suisse,la disponibilité d’eau potable impeccable dans les régions à habitat décentralisé ne va pas de soi.
–Ecologie:
Les améliorations structurelles permettent de promouvoir efficacement le maintien et la valorisation de biotopes et de petits cours d’eau.

–Fertilité du sol:
Les installations d’irrigation et le renouvellement de drainages contribuent à préserver la fertilité du sol des meilleures terres et,partant,à assurer les rendements dans les années aux conditions climatiques extrêmes.
224 2.3AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2 ■■■■■■■■■■■■■■■■
■ Moyens financiers destinés aux contributions
En 2002,90 millions de francs étaient disponibles pour les améliorations foncières et les constructions rurales.L’OFAG a approuvé de nouveaux projets qui ont déclenché un volume global d’investissements de 355 millions de francs et qui correspondent à des contributions fédérales de 77 millions de francs au total.Cette somme ne correspond pas à celle budgétisée dans la rubrique «améliorations structurelles agricoles»,car il est rare qu’une contribution allouée soit versée la même année;les crédits sont par ailleurs souvent accordés par tranche.Ainsi,en 2002,les engagements pris l’année précédente,particulièrement élevés en raison des intempéries de 2000,ont été acquittés pour une bonne partie.
Contributions fédérales 2002
Remaniements parcellaires et mesures d'infrastructure
Construction de chemins
Adductions d'eau
Intempéries et autres mesures de génie civil Bâtiments d'expl. pour animaux cons. des fourr. grossiers
Autres mesures de constructions rurales
Les moyens financiers engagés en 2002 par la Confédération sous la forme de contributions ont baissé de 12% par rapport à l’année précédente.En comparaison avec la moyenne des années 1992/94,la somme des contributions est de 11% inférieure. Dans les budgets 2000 et 2001,les crédits fédéraux dans les rubriques ordinaires avaient été majorés compte tenu des dégâts causés par les intempéries.
225 2.3 AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2.MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE 2
Tableaux 44–45,pages A52–A53
Région de plaine Région des collines Région de montagne 22,7 05101520253035 9,2 5,6 5,7 31,4 2,6 Source: OFAG 59% 18% 23%
mio. de fr.
Les cantons ont accordé 2'498 crédits d’investissements en 2002,pour un montant total de 314 millions de francs,dont 85% étaient consacrés à des mesures individuelles et 15% à des mesures collectives.Dans la région de montagne,des crédits de transition d’une durée maximale de trois ans,appelés «crédits de construction», peuvent en outre être consentis pour des mesures collectives.
Crédits
Les crédits destinés aux mesures individuelles ont notamment été alloués au titre d’aide initiale ainsi que pour la construction,la transformation ou la rénovation de maisons d’habitation,de bâtiments d’exploitation ou de bâtiments alpestres.Ils sont remboursés dans un délai de 14 ans en moyenne.
Quant aux crédits alloués pour des mesures collectives,ils ont permis notamment de soutenir la réalisation d’améliorations foncières et de mesures de construction (bâtiments alpestres, étables communautaires,bâtiments et équipements destinés à la mise en valeur et au stockage de produits agricoles).
Le fonds de roulement,alimenté depuis 1963,représente 1,9 milliard de francs environ. Chaque année,la Confédération met une certaine somme à la disposition des cantons; en 2002,elle s’est chiffrée à 70 millions de francs.Avec les remboursements courants, cette somme est utilisée pour l’octroi de nouveaux crédits.
d’investissements en 2002 AffectationCasMontantPart Nombremio.defr.% Mesures individuelles2 276268,185 Mesures collectives,sans crédits de construction15015,35 Crédits de construction7230,310 Total2 498313,7100
Source:OFAG
fédérales
améliorations foncières et constructions
1992/9419951996199719981999200020012002 mio. de fr. Source: OFAG 0 20 40 60 80 100 120 101858582757587102 90
Contributions
pour
rurales 1992/94–2002
■ Moyens financiers destinés aux crédits d’investissements
226 2.3AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2
Tableaux 46–47,pages A54–A55
Crédits d'investissements 2002 par catégorie de mesures, sans crédits de construction

Bâtiments d'exploitation
Aide initiale
Maisons d'habitation
Achat en commun de cheptel vif/mort, transformation et stockage de produits agricoles
Achat de l'exploitation par le fermier
Améliorations foncières mio. de fr. Région de plaine Région des collines Région de montagne 128,2 020406080100120140 89,5 44,9 10,6 5,5 4,7 Source: OFAG 25,7% 47,6% 26,7% 227 2.3 AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2
■ 2.3AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2
Intempéries 2002
En 2002,les intempéries ont provoqué,dans toute l’Europe,des inondations occasionnant d’énormes dégâts.Si la Suisse n’a pas été touchée dans la même mesure que ses pays voisins,plusieurs régions ont néanmoins connu des intempéries d’une rigueur extraordinaire:
–à mi-juillet,de fortes précipitations dans les Préalpes ont causé de considérables dommages dans les cantons de Berne et de Lucerne;

–à fin août,des glissements de grande étendue et de gros dégâts à certaines installations se sont produits en Suisse orientale après une période de pluie prolongée, hormis dans les cantons de St.Gall et d’Appenzell Rhodes Intérieures,surtout dans celui d’Appenzell Rhodes Extérieures;
–à mi-novembre,les intempéries ont en premier lieu frappé le canton des Grisons.Des précipitations persistantes et des températures élevées ont déclenché des glissements de grande ampleur causant d’énormes dommages.
Le montant des dégâts enregistré dans le domaine public,estimé à 260 millions de francs (état février 2003),dépasse de loin celui des années moyennes.L’agriculture a, elle aussi,subi de gros dommages aux infrastructures et aux terres cultivées,sans parler des pertes de rendement.En appliquant le principe de la proportionnalité,on compte avec des coûts de 39 millions de francs pour la réfection des chemins agricoles et des adductions d’eau,ainsi que pour le nettoyage et la remise en état des terres agricoles.La majeure partie de ces coûts concerne les cantons des Grisons (21,3 mio. de fr.),d’Appenzell Rhodes Extérieures (4,2 mio.de fr.),de Lucerne (3,9 mio.de fr.) et de Berne (3,6 mio.de fr.).Conformément aux estimations plus récentes des cantons,le montant définitif des dommages sera probablement plus élevé

La part de réfection des dégâts à supporter par la Confédération dans le domaine de l’agriculture est estimée à 18 millions de francs.Certains projets de réfection,notamment ceux liés aux intempéries des mois de juillet et août,ont été traité au cours de 2002 ou pris en compte par une redistribution des crédits dans le budget ordinaire de 2003.En outre,un crédit supplémentaire de 7 millions de francs a été approuvé par le Parlement pour 2003,avant tout en rapport avec les événements majeurs de novembre.L’art.95 de la loi sur l’agriculture concernant l’octroi de contributions supplémentaires pour remédier aux conséquences particulièrement graves d'événements naturels exceptionnels est applicable en l’occurrence. 228
Aide aux exploitations
L’aide aux exploitations paysannes est octroyée sous la forme de prêts sans intérêt.Il s’agit d’une mesure d’accompagnement social servant à parer ou à remédier à des difficultés financières passagères dont les requérants ne sont pas responsables.Elle fait office de mesure de désendettement individuelle.
2
PRODUCTION
DE
BASES
financiers DES
Des prêts au titre de l’aide aux exploitations ont été accordés dans 270 cas en 2002, pour un montant total de 35,2 millions de francs.Comparé aux 304 cas enregistrés l’année précédente,le nombre de prêts a légèrement reculé,ce qui s’explique partiellement par le bas niveau des intérêts en général.Le montant moyen des prêts,qui seront remboursés dans un délai de 14 ans,a passé de 113'200 à 130'237 francs.
Prêts au titre de l’aide aux exploitations 2002
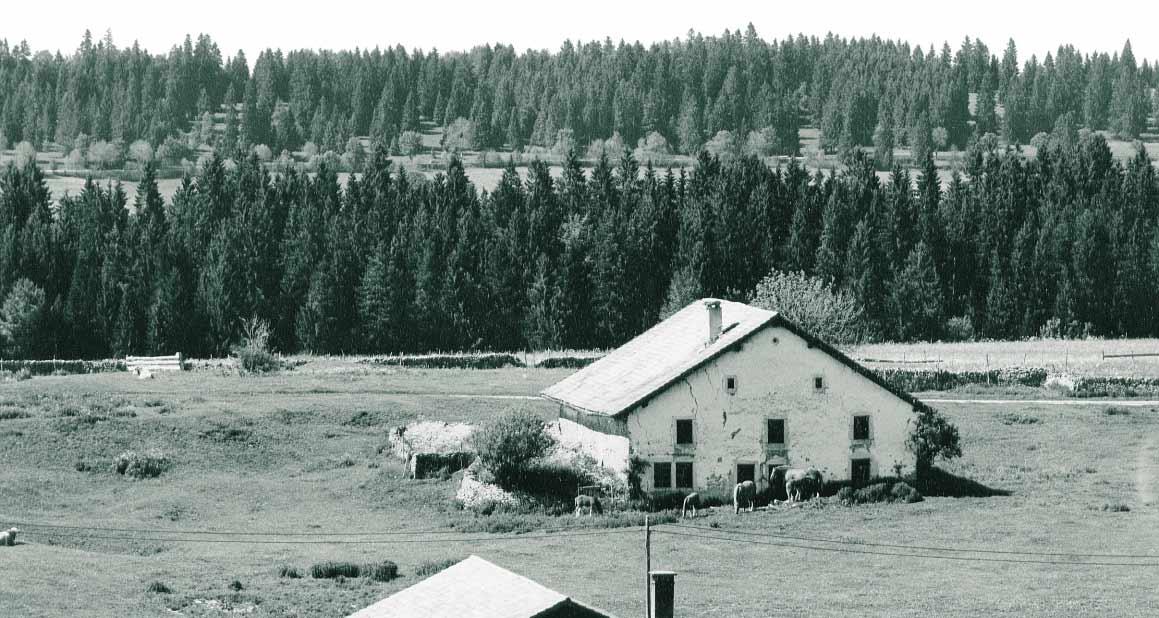
Répartition des moyens AMÉLIORATION
Source:OFAG
■ 2.3
AffectationCasMontant Nombremio.de fr. Conversion de dettes existantes26334,6 Difficultés financières extraordinaires à surmonter70,6 Total27035,2
Alimenté depuis 1963 au moyen de fonds accordés par la Confédération et de remboursements,le fonds de roulement contient environ 173 millions de francs,y compris les parts des cantons.Les nouvelles ressources mises à la disposition de ces derniers en 2002 se montent à 9 millions de francs.L'octroi de prêts présuppose une prestation équitable des cantons laquelle,suivant leur capacité financière,varie entre 20 et 80% de l’aide fédérale.Ajoutés aux remboursements courants,les montants accordés par les pouvoirs publics sont utilisés pour l’octroi de nouveaux prêts. Tableau 48,page A56 229
■ Les constructions sontelles meilleur marché à l’étranger?

Besoins d’investissements pour bâtiments d’exploitation agricoles – étude sur les frais de construction
Les investissements dans des constructions rurales font parfois fortement augmenter les coûts de production d’une exploitation.Il importe donc de les modérer,en trouvant un équilibre entre frais de construction et allégements souhaités du travail.On parle souvent de constructions et de solutions prétendument bon marché.Sur mandat de l’OFAG,la Station de recherches en économie et technologie agricoles (FAT) a établi les d’investissements requis pour des bâtiments d’exploitation agricoles et comparé les frais de construction en Suisse et dans les pays voisins.Pour se faire,elle s’est fondée sur les étables à stabulation libre pour le bétail laitier,qui répondent au standard actuel.
On estime souvent,en Suisse,que les constructions rurales coûtent moins à l’étranger. D’où la décision de confirmer ou d’infirmer ce constat par des comparaisons de coûts réalisées avec la collaboration de services administratifs dans nos pays voisins,notamment en France,en Allemagne et en Autriche.
L’étude a montré que l’on construit effectivement meilleur marché dans ces pays.La différence s’explique par les salaires et les coûts de matériaux moins élevés,ainsi que par la construction de bâtiments en série ou préfabriqués,moins onéreux.En outre,les hivers sont généralement plus courts dans lesdits pays,ce qui laisse davantage de temps pour la construction.
Toutefois,il convient de relativiser le niveau moins élevé des coûts.Dans les pays considérés,ce sont souvent les services administratifs qui se chargent de l’étude des projets et de la direction des travaux, à des conditions extrêmement avantageuses,ce qui équivaut en principe à une aide financière indirecte.Par ailleurs,les agriculteurs fournissent,eux-mêmes,généralement bien plus de prestations qu’en Suisse.Comme seuls les coûts attestables ont été pris en considération dans la comparaison,la différence s’amenuise si l’on tient compte de ces prestations.Ces dernières ont du reste un inconvénient :en cas de défauts,de dommages ou de pertes,l’agriculteur ne peut pas faire valoir la responsabilité de tiers.Enfin,il faut aussi prendre en compte le résultat d’exploitation et le contexte personnel dans la situation tendue qui règne pendant la construction.
Les auteurs de l’étude ont aussi examiné la manière dont les prescriptions légales influent sur les frais de construction.Ils concluent que ces prescriptions ne renchérissent guère les bâtiments en comparaison avec l’étranger.Il y a en effet peu de différence en ce qui concerne les prescriptions relatives à la protection des eaux et des animaux.Des différences n’ont été constatées qu’en matière de protection de la nature et du paysage,mais les charges dans ce domaine ne sont pas déterminantes pour les bâtiments ayant fait l’objet de l’étude.
230 2.3AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2
■ Différences en Suisse également
L’étude réalisée en Suisse a été menée en plaine et dans la région de montagne;elle portait sur trois groupes d’exploitations – jusqu’à 35 unités de gros bétail (UGB),entre 35 et 55 UGB et plus de 55 UGB – et concernait des constructions permettant la production de lait sans ensilage lors de la fabrication de fromage,ou la production de lait de consommation et de lait industriel avec ensilage.Au total,quelque 71 exploitations ont été analysées.
L’étude a révélé qu’il existe également de grandes différences au niveau des coûts.Les principaux facteurs expliquant ces différences sont la taille des bâtiments,l’orientation prise par l’exploitation (avec ou sans ensilage) et le standard des installations.
C’est la taille des bâtiments qui influe le plus sur les frais spécifiques de construction (fr./UGB).La dégression des coûts est plus marquée jusqu’à 50 UGB et fléchit sensiblement ensuite.Des constructions n’offrant pas de places au jeune bétail affichent des coûts plus bas par UGB.Cet écart s’explique toutefois en partie par les facteurs de conversion, étant donné qu’une vache est comptée comme 1,0 UGB et qu’une génisse nécessitant le même espace n’est comptée que comme 0,6 UGB.Par contre,des installations complexes telles que salle de traite onéreuse,robot de traite et dispositifs mécaniques d’alimentation des animaux font grimper les coûts.
231 2.MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE 2.3 AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2
Dégression des coûts toutes tailles d’exploitations fr./UGB Lisier Fourrage Etable Source: FAT 1 UGB (nombre d'exploitations) 25 (11) 1 46 (16) 1 82 (18) 1 5 000 11 600 7 200 3 700 22 500 8 700 4 300 2 700 15 700 8 600 2 300 2 600 13 500 10 000 15 000 20 000 25 000
Comparaison des coûts entre des exploitations avec et sans ensilage
ExploitationsExploitations sans ensilage (25) 1 avec avec ensilage (17) 1 sans séchage du foin en grangeséchage du foin en grange fr.%fr.%
Etable10 000528 60066
Stockage du fourrage5 900312 10016
Engrais de ferme3 300172 40018
Total19 20010013 100100
sans ensilageavec ensilage en moyenne:en moyenne: 41 UGB,dont 31 vaches72 UGB,dont 59 vaches

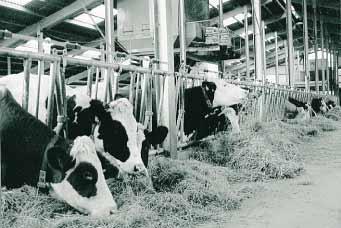
1(nombre d’exploitations)
Source:FAT
Des différences considérables existent entre les exploitations sans ensilage et celles avec ensilage.Pour une exploitation de même taille,elles atteignent 3'000 à 4'000 francspar UGB.Les exploitations pratiquant l’ensilage tirent souvent partie d’éléments d’installations existants et ne doivent par conséquent pas réaliser l’ensemble du programme d’aménagement.Des appareillages mobiles et la charge de travail plus importante liée au stockage et à la préparation des fourrages dans les exploitations avec ensilage (tracteurs,désileuse,char mélangeur,etc.) ne sont toutefois pas inclus dans les coûts de construction.
Le lieu d’implantation (plaine,région des collines,région de montagne) et le système de stabulation (logettes ou litière profonde) de l’exploitation n’ont pas d’influence notable sur les coûts.Bien que les exploitations situées dans la région de montagne se caractérisent par une durée de stockage plus longue pour les fourrages et les engrais de ferme et qu’elles doivent en outre remplir des exigences statiques plus élevées,la construction de grandes unités est aussi possible à des coûts avantageux,pour autant que la configuration du terrain et de longs trajets de transport n’entraînent pas de frais supplémentaires.
Les installations mobiles ne sont pas prises en compte dans la comparaison.S’agissant des grandes exploitations,on constate que nombre d’entre elles investissent plutôt dans ce genre d’installations,ce qui relativise un peu la dégression des coûts.
Les investissements opérés pour le programme d’ensemble – étable,stockage des fourrages et entreposage des engrais de ferme – varient très fortement selon la solution de construction choisie;ils s’élèvent en moyenne à 13'500 fr./UGB même pour les grandes exploitations (82 UGB) recourant à l’ensilage dans la région de plaine.
232 2.3AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2
■ Des solutions minimales ont aussi leurs limites
L’analyse des surfaces de bâtiment montre que,par UGB,
13 à 20 m2 de surface couverte et bétonnée ont été construits pour satisfaire aux exigences d’une garde respectueuse des animaux (aire de repos,aire d’affouragement,fourragère et aire de traite);
– l’espace de stockage nécessaire pour le foin ventilé est de 30 m3 dans les exploitations sans silos ou de 12 m3 dans les exploitations pratiquant l’ensilage;
– il faut aménager un volume de stockage de 12 m3 pour les engrais de ferme.
Un calcul fondé sur les surfaces minimales nécessaires révèle que les frais s’élèvent de 10'400 à 15'500 fr.par UGB même pour les grandes exploitations qui ont opté pour des solutions globales simples.Ce montant n’inclut pas les suppléments pour conditions difficiles,pour l’aménagement extérieur et pour les dessertes.C’est pourquoi il convient d’être prudent et de vérifier des indications de coûts inférieures à 10'000 fr. par UGB pour des solutions globales.D’un autre côté,des coûts supérieurs à 20'000 fr. par UGB méritent également d’être examinés de plus près.Dans chaque cas,il y a lieu de clarifier quelles parties de construction sont incluses dans les coûts respectifs.
Besoins d'investissements minimaux
Exploitation sans ensilageExploitation avec ensilage
EtableFourrageLisierTotal
Remarque: les besoins d'investissements minimaux sont calculés pour les dimensions suivantes: sol 15 m2, paroi 15 m2, toit 20 m2, lisier 12 m3
■ Construction de bonne qualité à bas prix
Source: FAT
Les bâtiments d’exploitation examinés dans l’étude comprenaient pour la plupart des étables non isolées voire ouvertes;la bonne qualité de ces constructions permet de tabler sur une longue durée de vie.De même,la conception architecturale et fonctionnelle des bâtiments était satisfaisante.Aucun défaut grave n’a été constaté au niveau de la technique ou de la physique de construction.
La Constitution fédérale et la loi sur l’agriculture exigent que la protection de la nature et du paysage soit prise en compte.Les incidences financières des prescriptions en la matière sur les bâtiments agricoles n’ont pas spécialement été analysées dans le cadre de l’étude;elles ne devraient toutefois présenter de l’importance que dans des cas isolés.
233 2.MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE 2.3 AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2
–
fr./UGB
0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000 Foin séché en grange 30 m3 Ensilage 12 m3
■ Objectifs atteints à 93%
2.3.2 Recherche,vulgarisation,formation professionnelle,CIEA,haras
Recherche agronomique
Selon la Constitution fédérale,la Confédération peut encourager la recherche agronomique,afin de soutenir une agriculture multifonctionnelle.
Les stations fédérales de recherches agronomiques sont regroupées au sein de l'unité Recherche agronomique (URA) et subordonnées à l'OFAG.Environ 60% des fonds disponibles servent aux activités de recherche appliquée,les quelque 40% restants étant alloués aux tâches légales et de contrôle.Le lien existant entre la recherche appliquée et les tâches légales et de contrôle précités garantit l’utilisation optimale du savoir-faire le plus récent et d’une infrastructure de haute qualité.
Les prestations de recherche sont évaluées à l’aide de normes et d’indicateurs concrets.De fait,les objectifs définis ont été atteints à raison de 93%.L’URA est donc parvenue à maintenir le niveau de prestation élevé atteint l’an passé.Seuls quelques projets n’ont pu être réalisés,soit par manque de personnel spécialisé ou en raison de changements de priorités qui se sont imposés en cours d’année.
■ BSC:Un outil de pilotage moderne
L’URA a mis en place un outil de gestion plus complet:le «Balanced Scorecard» (BSC). Il s’agit d’un outil de pilotage de la performance et de gestion stratégique.On emploie le terme «système de tableau de bord» en français,car comme un tableau de bord,le BSC nous fournit les principales données permettant la conduite et la gestion de l’unité
Ainsi une vingtaine de chiffres-clés forme ce tableau de bord qui nous permet de décliner la vision et la mission de l’organisation sous l’angle de quatres perspectives interreliées:
1.La perspective «financière» reflète l’évolution et la répartition des ressources financières.
2.La perspective «prestations et client» met en évidence notre «output» (par exemple publications,conférences,enseignement).
3.La perspective «processus» met en évidence la coopération avec les autres institutions.
4.La perspective «potentiel» englobe le personnel et la formation.
Ces quatre perspectives sont étroitement liées les unes aux autres et l’évaluation du tableau de bord (chiffres-clés) fournit des indications gestionnelles permettant d’évoluer continuellement pour satisfaire au mieux le client.Le BSC de l'URA évolue en fonction de l'expérience acquise et est adapté continuellement en fonction des nouveaux besoins.
234 2.3AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2 ■■■■■■■■■■■■■■■■
■ Fusion RAP – FAM
Eléments du tableau de bord de performance
Finances
«Quelle est l'atteinte des objectifs contractuels?»
➞ Informations contractuelles
Potentiel
«Quels potentiels internes devons-nous développer pour atteindre nos buts?»

➞ Information de potentiel
Buts / Vision
«Comment remplir nos devoirs?»
➞ Stratégie
Prestations et clients
«Comment optimiser la satisfaction du client à travers le produit?»
➞ Gestion du comportement
Processus
«Quel processus devons-nous maîtriser pour satisfaire nos clients?»
➞ Information interne stimulante
Le tableau de bord de performance relie l’ensemble des perspectives et sert ainsi à mettre en oeuvre de manière optimale la vision et la stratégie d’une entreprise.C’est un outil de gestion interne qui s’appuie essentiellement sur les besoins du client pour faire évoluer l’institution.
Depuis 2000,la Station de recherches laitières de Liebefeld-Berne (FAM) et la Station de recherches en production animale de Posieux (RAP) constituent le centre de compétences pour la «production animale et les denrées alimentaires d’origine animale».Ces deux sites sont maintenus mais seront subordonnés à une seule direction dès le début de la nouvelle période du mandat de prestations 2004–2007.
235 2.MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE 2.3 AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2
■ Raccordement au réseau international
La recherche agronomique s’internationalise de plus en plus.Aussi l’URA entend-elle participer activement au 6e programme-cadre de recherche de l’UE et affronter la concurrence des organismes de recherche qui existent dans toute l’Europe.Elle a surmonté le premier obstacle avec succès.C’est ainsi que,conjointement avec des partenaires de recherche venant des pays de l’UE,elle s’est associée à pas moins de 87 déclarations d’intérêt (Expressions of Interest) pour des dépôts de projets de recherche.Une partie des idées élaborées au travers de ces déclarations seront concrétisées ces prochaines années dans des propositions de projets.
Participer à des projets de recherche sur le plan international exige la création de réseaux avec plusieurs partenaires internationaux.Une collaboration fructueuse implique toujours un donnant,donnant.De même,il faut envisager,dans les relations entre institutions scientifiques,une situation où il n’y a que des gagnants.Cela signifie que seuls des groupes de recherche hautement qualifiés peuvent être des partenaires de réseau demandés.
Hormis les réseaux concernant des projets de recherche européens,l’URA collabore avec des instituts partenaires étrangers au développement de projets transfrontaliers. Ces efforts visent à intensifier les projets «Interreg» qu’encourage aussi la Confédération.Par ailleurs,le programme européen COST (coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique),la FAO et l’OCDE offrent d’autres possibilités de collaboration.Autant d’éléments confirmant que la recherche agronomique suisse s’est nettement internationalisée.
■ Plan directeur de recherche pour l’agriculture
Dans le cadre du message relatif à l’encouragement de la formation,de la recherche et de la technologie dans les années 2004–2007,des plans directeurs de recherche ont été élaborés pour quelques 12 orientations politiques.L’agriculture a été placée pour sa part sous la houlette de l’OFAG.
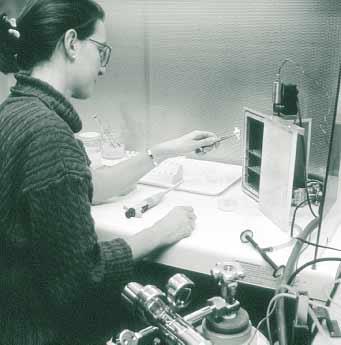
A l’instar de la politique agricole,le plan directeur de recherche «Agriculture» doit s’inspirer de l’idée directrice de la durabilité.Cela signifie qu’il faut envisager une approche globale du système.A cet effet,il est indispensable de développer la recherche interdisciplinaire.Il est également nécessaire de mettre en réseau la recherche afin de pouvoir aborder le plus tôt possible les thèmes de l’avenir.
Les connaissances représentent une ressource décisive sur le plan de la compétitivité et leur gestion est un facteur de réussite déterminant.Pour parvenir à une gestion systématique des connaissances,il devient toujours plus important de définir une approche et une méthode pratiques.Cela concerne aussi bien les processus internes aux entreprises que l’échange de connaissances avec l’extérieur.
Compte tenu de ces idées fondamentales,ainsi que de l’analyse des développements de la politique agricole et de son contexte,la recherche de la Confédération dans le domaine politique «agriculture» devra s’axer sur les objectifs ci-après pendant la période 2004–2007.
– Un secteur agricole performant sur le plan économique:compétitivité et innovation, sécurité et qualité des denrées alimentaires à des prix répondant aux besoins du marché,coûts de production plus bas et valeur ajoutée plus élevée.
236 2.3AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2
– Un secteur agricole assumant ses responsabilités sur le plan écologique:préservation et gestion durable des ressources naturelles que sont le sol,l’eau,l’air et le paysage,ainsi que biodiversité,compréhension des interrelations dans les écosystèmes, évaluation des effets de la technologie, écotoxicologie dans le secteur agricole,prestations écologiques de l’agriculture,garde des animaux respectueuse de l’espèce.
– Une évolution du secteur agricole acceptable sur le plan social:revenus en rapport avec la qualité de vie,dynamique des structures,possibilités d’adaptation et conséquences sur le milieu rural.
– Détection avancée:la recherche agronomique doit anticiper l’évolution dans les secteurs de l’alimentation et de la santé,de l’innovation en matière de produits,des normes de qualité contre flux de marchandises et dans la gestion des cycles fermés.
– Recherche transdisciplinaire:rechercher une solution effective à un problème implique souvent une approche interdisciplinaire et la participation active de toute la filière (chaîne de production) jusqu’au consommateur.






– Transfert des connaissances:les résultats de la recherche devront être mis à la disposition des utilisateurs conformément à leurs besoins.Mise à profit des nouvelles possibilités et technologies de l’information.La recherche doit entrer en dialogue avec le grand public de manière transparente et médiatique.
Buts de la recherche agronomique Transfert
A partir du plan directeur de recherche «Agriculture»,un nouveau mandat de prestations de l’URA a été élaboré pour la période 2004–2007,lequel a été soumis aux commissions parlementaires concernées par le Conseil fédéral.Le nouveau mandat de prestations entrera en vigueur dès le 1er janvier 2004.
237 2.MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE 2.3 AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2
des connaissances Détection avancée
■ Axes prioritaires de la vulgarisation
Vulgarisation en agriculture et en économie familiale rurale
La Confédération alloue des aides financières aux services cantonaux de vulgarisation agricole et de vulgarisation en économie familiale rurale,aux services de vulgarisation spéciaux des organisations agricoles opérant à l’échelle nationale et aux centrales de vulgarisation agricole de l’Association suisse pour le conseil en agriculture.
Dépenses pour la vulgarisation en 2002
DestinatairesMontant mio.de fr.
Services cantonaux de vulgarisation agricole8,8
Services cantonaux de vulgarisation en économie familiale rurale0,8

Services de vulgarisation spéciaux des organisations agricoles1,0 Association suisse pour le conseil en agriculture8,4
Total19,0
Source:Compte d’Etat
Ces deux dernières années,les questions financières ont occupé le devant de la scène. Cela va des devis usuels sur les besoins d'investissement et de crédit d'investissements jusqu'aux analyses stratégiques en rapport avec les reprises d'exploitation et la collaboration interentreprises.Aujourd’hui les cas sont souvent plus complexes et le nombre d’exploitations à problèmes s ’accroît.L'optimisation de la production laitière et la production de denrées de qualité et sous label gagnent en importance.
238 2.3AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2
■ Formation initiale
Formation professionnelle agricole
L’Union suisse des paysans (USP) défend les intérêts de la formation professionnelle agricole.Au terme d’une période transitoire,qui a duré une bonne année,le passage du témoin entre l’Association agricole suisse (SLV) et l’USP a définitivement eu lieu au cours de l’exercice sous revue.Le 28 mai 2002,les délégués de la SLV se sont prononcés simultanément en faveur de la fusion avec l’USP et de la dissolution de leur propre organisation avec effet rétroactif au 1er janvier 2002.Le secteur Formation de l’USP s’est donc vu attribuer l’ensemble des tâches liées au domaine de la formation professionnelle et qui,aux yeux de l’association professionnelle,nécessitent un suivi.Ses tâches se répartissent entre les trois domaines suivants:formation initiale (degré secondaire II),formation professionnelle supérieure (degré tertiaire) et formation pour adultes (degré quaternaire).Les activités se limitent à la Suisse alémanique pour autant qu’il s’agisse d’une collaboration entre les prestataires de cycles de formation (écoles d’agriculture,cantons).En Suisse romande,c’est l’Association des Groupements et Organisations Romands de l’Agriculture (AGORA) qui assume les tâches correspondantes.
Concernant l’apprentissage professionnel,le projet «Champ professionnel des métiers verts» a été poursuivi.Les activités déployées dans ce domaine ont servi de préparatifs à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la formation professionnelle.Au printemps 2002,il est apparu que la vision d’un vaste champ professionnel dans lequel la formation initiale pour les métiers de l’agriculture,de l’horticulture et de la sylviculture et celle concernant les professions agricoles spéciales pouvaient être partiellement proposées en commun,n’était guère transposable dans les faits.Le projet de l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) relatif au 2e arrêté sur les places d’apprentissage n’a donc pas été achevé pour cette raison,mais poursuivi sous une forme modifiée.A l’échelle de la Suisse,la collaboration entre la profession agriculteur/agricultrice et les professions spéciales de l’agriculture a toutefois lieu,mais dans le cadre d’un champ professionnel plus restreint.
Au cours de l’exercice 2002,le secteur Formation de l’USP a consacré l’essentiel de ses activités au développement de nouveaux modèles pour la formation initiale.Les affaires courantes ont quant à elles été traitées par la nouvelle commission de formation professionnelle de l’USP.La gestion de cet organe,dans lequel les formations pratique et scolaire sont représentées de façon paritaire,a été assumée par Werner Wyss,maître d’apprentissage venant du canton de Berne.
La consultation des milieux concernés a permis de mettre en évidence la nécessité d’introduire,dans la formation agricole de base,un modèle de formation uniforme, valable pour toute la Suisse.La formation scolaire,d’au moins 1600 leçons,doit être répartie progressivement sur les trois années de formation.Les milieux concernés insistent sur le principe de l’apprentissage professionnel dual.

239 2.MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE 2.3 AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2
■ Formation professionnelle supérieure
Conçue selon un système modulaire,la formation professionnelle supérieure a connu un réel engouement au cours de l’exercice considéré,les participants appréciant beaucoup le fait de pouvoir composer leur «propre» menu de formation continue sous l’angle du temps.Quant à l’examen professionnel,1679 modules ont été conclus en Suisse alémanique,dont 1453 ont été menés à bonne fin.287 diplômés ont obtenu un minimum de 10 points et réussi l’examen professionnel,c’est-à-dire le brevet fédéral d’agriculteur.Ils remplissaient donc les conditions pour se présenter à l’examen de maîtrise agricole en 2003.Parmi les 184 candidats qui se sont présentés en 2002 à l’examen final de maître agriculteur,161 candidats ont surmonté les difficultés avec brio et se sont vus décerner leur diplôme de maîtrise le 19 septembre 2002 à l’Expoagricole,dans le cadre d’une fête associant toutes les régions de la Suisse.
Centre international d’études agricoles (CIEA)
■ Offre de l’OFAG en matière de formation continue
Quelque 2000 heures de travail sont nécessaires à la planification et à l’organisation d’un séminaire de formation continue de deux semaines s’adressant à 80 participants de 40 pays différents.Dans le cadre de l’initiative de formation continue du CIEA, l’OFAG participe depuis de nombreuses années à des activités associant des experts en vulgarisation et en formation agricole,venant des quatre coins du monde.
Il s’agit en l’occurrence de la gestion d’un centre de formation qui a été fondé en 1956 sur l’initiative de F.T.Wahlen,alors directeur de la division agricole de la FAO à Rome, et de la Direction du développement et de la coopération (DDC).Dès 1958,des questions d’actualité concernant la pédagogie,la méthodologie,des modèles de formation,des concepts de formation continue et la vulgarisation dans l’agriculture ont pu être traitées et discutées à intervalles réguliers.Au nombre des participants figuraient des spécialistes intéressés venant des pays industrialisés et des pays en développement de sorte que chaque séminaire du CIEA servait de cadre à un vaste échange d’idées et d’expériences au-delà des frontières.
■ Un réseau d’experts en vulgarisation et en formation
L’idée initiale qui consistait à apporter une pierre à l’édifice de la coopération au développement a débouché ces dernières années sur la création d’un réseau d’experts en vulgarisation et en formation.Un bref coup d’œil jeté sur les thèmes abordés dans le passé révèle que le CIEA accordait et accorde toujours une très grande attention au traitement des questions d’actualité dans les domaines les plus divers.Ont ainsi été examinés,par exemple,des problèmes afférents à des «qualifications-clés», à «l’évaluation», à la «communication interne et externe» ainsi qu’à la «gestion des connaissances».Ce dernier sujet justement a permis de s’attaquer aux défis auxquels l’agriculture est confrontée dans son ensemble.La gestion d’une grande quantité de connaissances et la nécessité de tenir continuellement à jour ses propres connaissances sont sans aucun doute un sujet de préoccupation pour tout professionnel.
240 2.3AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2
■ Utilité aux multiples facettes
Il importe donc de connaître les principes essentiels de la gestion des connaissances. Davenport et Prusak citent ainsi, à titre d’exemple,les principes suivants que le CIEA prend en compte dans le cadre de ses activités:
– le savoir naît et demeure dans l’esprit de tout être humain;
– l’utilisation commune des connaissances nécessite la confiance;
l’échange de connaissances devrait être encouragé et récompensé;
– la connaissance est indissociable de la créativité;son développement dans des directions insoupçonnées mérite d’être soutenu.
Le séminaire 2002 visait concrètement à montrer comment les spécialistes agricoles acquièrent de bonnes connaissances approfondies,comment ils peuvent utiliser efficacement ce savoir et le transmettre de manière appropriée.Outre les bases fondamentales de la gestion des connaissances,des exemples d’application concrets comme «L’approche du savoir au sein des institutions de formation», «Les réseaux – un nouveau mode de collaboration s’impose» ou «La gestion des connaissances au moyen d’auxiliaires techniques» ont été abordés durant ce séminaire.Un tour d’horizon de la formation agricole dans la pratique et une visite d’exploitations agricoles dans le canton de Berne ont complété le programme.
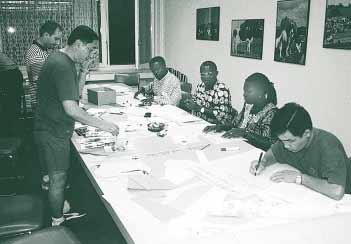
En tant que petit centre de compétences de deux offices fédéraux (OFAG et DDC),le CIEA est soucieux de mettre en oeuvre une grande diversité de principes didactiques et méthodologiques dans les années à venir,et ce au profit de l’agriculture suisse et internationale ainsi que dans l’intérêt de la vulgarisation et de la formation agricole. Pour tous les intéressés,l’utilité de cette démarche est patente à différents niveaux.
Le CIEA permet:
– de se pencher sur les connaissances actuelles et sur les perspectives de développement dans les domaines de la vulgarisation et de la formation agricole;
– d’avoir un aperçu des nouvelles techniques et méthodes de travail;
– d’adopter une approche interdisciplinaire dans la manière de penser et de travailler aux interfaces entre agriculture,pédagogie et développement;
– d’établir des contacts nationaux et internationaux avec des experts en vulgarisation et en formation et,partant,de se positionner par rapport aux autres.
Des évaluations intermédiaires et des évaluations à la fin des divers séminaires ont montré que les objectifs visés avaient été atteints dans une large mesure.Le taux de satisfaction élevé des participants et les bons résultats des évaluations sont l’expression non seulement de la qualité du contenu des séminaires et de la diversité des méthodes utilisées,mais aussi de la bonne organisation des manifestations.Par ailleurs,l’engagement sans faille des participants a été un facteur de succès décisif.A cela s’ajoute le fait que,au fil des séminaires,les intéressés originaires des quatre coins du monde sont parvenus à former une véritable communauté de savoir.
Pour de plus amples informations sur le CIEA ainsi que sur les activités à venir,le lecteur est invité à consulter le site www.ciea.ch.
241 2.MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE 2.3 AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2
–
■ Séminaire CIEA 2002
■ Création d’un bureau de conseils
Haras fédéral
Depuis 1996,le cheptel de chevaux en Suisse s’est accru de plus de 17%.Or,si l’on utilise toujours plus de chevaux,force est de constater que les connaissances nécessaires à leur garde et à leur utilisation font souvent défaut.
Questions adressées bureau de conseils pour les chevaux en 2002
Divers 4%
Alimentation 5%
Construction d'écuries / infrastructure 17%
Médecine vétérinaire 14%
Questions juridiques 17%
Achat de chevaux / informations sur les races 5%
Soins aux chevaux / soins aux sabots 2%
Origines / accouplements 8%
Formation des chevaux et des cavaliers 2%
Stud-book / épreuves d'élevage 8%
Economie d'entreprise 18%
Source: Haras fédéral
Pour pallier à ce phénomène,les responsables du Haras fédéral ont,en collaboration avec les organisations existantes,mis sur pied un bureau de conseils pour la garde et l’élevage du cheval.Celui-ci fournit de précieuses informations dans de nombreux domaines: élevage,garde respectueuse des animaux,alimentation,hygiène et maladie, blessures et soins aux sabots,fertilité et méthodes de reproduction.Premier bilan du bureau de conseils:l’offre a été vivement utilisée au cours de l’exercice sous revue.
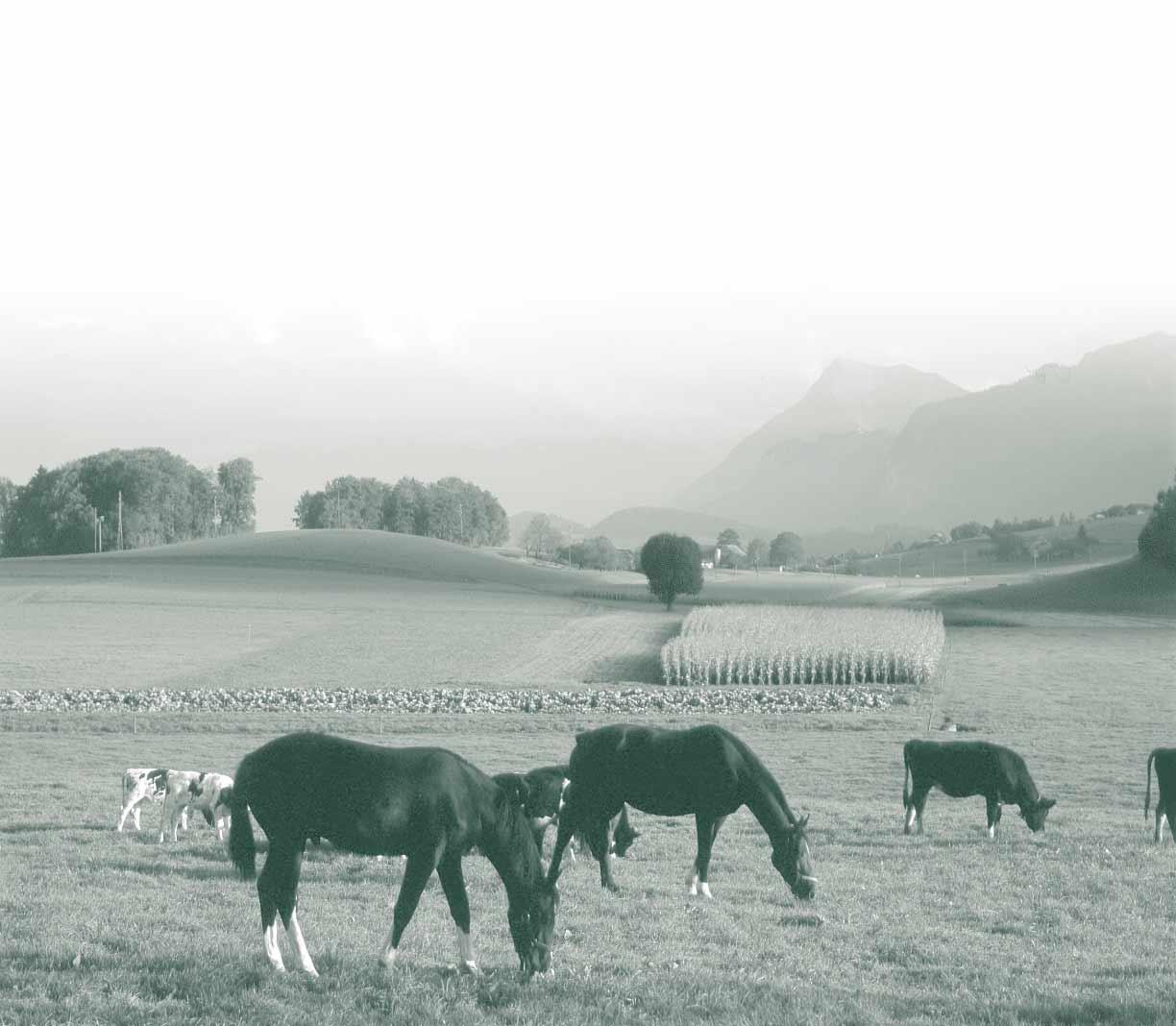
242 2.3AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2
■ Norme de qualité élevée grâce à la certification des plants et semences
2.3.3 Moyens de production
Semences et plants
La certification de semences et de plants fournit à l’agriculture du matériel de multiplication de haute qualité,correspondant aux caractéristiques variétales recherchées et dont l’état phytosanitaire est irréprochable.Grâce à l’application d’un schéma de multiplication et à l’utilisation de matériel initial sain,la contamination par des organismes phytopathogènes altérant la qualité est réduite dans la production végétale. Lors de la certification,l’accent est mis sur la qualité phytosanitaire et l’authenticité variétale.
Le matériel initial est testé de manière approfondie pour vérifier l’absence de viroses, de mycoplasmes et de bactéries;ce matériel doit en outre remplir des exigences propres à l’espèce comme le respect des règles de filiation,l’authenticité variétale ou l’état sanitaire des parcelles enregistrées pour la production.La documentation de l’ensemble du processus sert à garantir un bon état sanitaire tout au long du flux de marchandises.
Par le choix ciblé de caractéristiques phytogénétiques,la sélection végétale moderne contribue à élargir la palette de caractéristiques variétales disponibles.Il est ainsi possible d’obtenir,par exemple,une meilleure résistance aux organismes nuisibles,une utilisation réduite d’engrais et de produits phytosanitaires ou encore une tolérance accrue aux facteurs de stress abiotiques.
Les caractéristiques d’une variété peuvent être altérées par des mutations naturelles, par des repousses ou par des croisements spontanés avec d’autres types.La sélection conservatrice garantit le maintien des performances d’une variété.C’est ainsi que les semences propres au type variétal sont semées dans des parcelles de pré-multiplication.Elles représentent la première génération (semences de pré-base) à partir de laquelle se développent les différents stades de multiplication (semences de base, semences certifiées).
Les semences de base produites selon les règles de la sélection conservatrice doivent obligatoirement être certifiées.Directement issues des semences pré-base,elles constituent le matériel pour la production ultérieure de semences certifiées.L’authenticité variétale doit être garantie.Les conditions exigées pour les parcelles de production et l’état phytosanitaire des semences sont nettement plus strictes que pour les semences certifiées.
■■■■■■■■■■■■■■■■
2.MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE 243 2.3 AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2
Evolution des surfaces de semences et plants reconnues

Les semences proprement dites utilisées pour les productions alimentaire et fourragère sont des semences certifiées.Elles sont issues de semences de base et font l’objet, avant la vente,de contrôles officiels (visite des cultures sur les parcelles de multiplication,analyse de la pureté et de la faculté germinative).
Pour chaque espèce végétale,il existe une procédure de contrôle spécifique.En fonction de la catégorie de semences produites,les contrôles sont effectués par le Service fédéral des semences et plants ou par des agents agréés de l’établissement multiplicateur.Seul peut être mis en circulation comme semences certifiées le matériel de multiplication qui satisfait aux exigences élevées de la législation et présente ainsi la qualité requise.
199619971998199920002001 en ha Maïs hybride Plantes fourragères Légumineuses à graines Céréales Source: Agrarforschung 2002 7 800 8 000 8 200 8 400 8 600 8 800 9 000 9 200 9 400 9 600 9 800 244 2.3AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2
■ Moins de nouvelles homologations
Produits phytosanitaires
En raison des conditions d’homologation plus sévères (exigences internationales, dossiers complets),la tendance à la baisse s’est poursuivie en ce qui concerne le nombre des demandes déposées et des nouvelles autorisations de produits phytosanitaires.

Evolution des demandes et des nouvelles homologations de produits phytosanitaires
AnnéeNouvelles demandesProduits nouvellement homologués
1 y compris les autorisations se fondant sur des demandes de l’année précédente Remarque:Ne sont pas incluses les demandes déposées en raison d'une modification de l'activité professionnelle (fusions,vente de produits,de substances actives ou de branches d'activité) du détenteur de l'autorisation
■ Interdiction de substances dans l’UE
L’évolution de la situation dans l’UE mérite à ce propos une attention particulière.En effet,dans les mois à venir,environ la moitié des substances qui,au milieu de l’année 1993, étaient encore sur le marché dans au moins un des Etats membres ne seront plus utilisées.L’OFAG a élaboré un programme allant dans ce sens pour maîtriser les effets de ces mesures en Suisse;sa mise en oeuvre s’aligne sur les mesures adoptées dans l’UE.
NombreNombre
199912142 200010091 20017075 1 20026750 1
1998126110
245 2.3 AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2
■ Principal fournisseur: les engrais de ferme
Evolution de la fumure dans l’agriculture

Du fait de la croissance des plantes,les substances nutritives que sont l’azote (N) et le phosphore (P exprimé sous la forme de P2O5) sont prélevées dans le sol et doivent être remplacées.C’est la raison pour laquelle on emploie,dans l’agriculture,outre des engrais de ferme, également des engrais de recyclage et des engrais commerciaux.La consommation d’engrais azotés et phosphatés est un critère servant à mesurer l’intensité de la production agricole.Les engrais de ferme (constitués surtout de fumier et de lisier) sont la principale source d’apport en azote et en phosphore,notamment dans les régions à forte densité de bétail.Parallèlement,l’agriculture utilise des engrais minéraux azotés et phosphatés.
Les engrais de ferme couvrent plus de 60% des besoins de nos cultures,la majeure partie étant fournie par le gros bétail et les porcs.Concernant le gros bétail,le nombre des effectifs a légèrement diminué depuis 1960,tandis que celui des porcs a continuellement augmenté jusqu’en 1980,pour baisser néanmoins de manière significative depuis lors.
Parts de N et de P2O5 dans les différents types d’engrais
Source: USP
Les boues d’épuration et le compost ont été les principaux engrais de recyclage utilisés ces dernières années dans l’agriculture.La quantité de substances nutritives apportées par ces engrais a toutefois été inférieure à 11% de l’ensemble du bilan de fumure.La part des boues d’épuration recyclées dans l’agriculture a considérablement diminué au cours des années nonante.Depuis 2003,les boues d’épuration ne doivent plus être utilisées pour les cultures maraîchères et sur les surfaces fourragères et, à partir de 2006,elles seront bannies de l’agriculture,vu le risque élevé qu’elles représentent.
2.3AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2 246
N P2O5 Engrais de ferme 68% Engrais minéraux 28% Boues d'épuration et compost 4% Engrais de ferme 72% Engrais minéraux 17% Boues d'épuration et compost 11%
■ Forte diminution de la consommation d’engrais minéraux
Au cours des dernières décennies,l’approvisionnement optimal des sols en substances nutritives et la prudente utilisation des engrais de ferme par les agriculteurs ont conduit à une forte diminution de la consommation d’engrais minéraux.C’est ainsi que,en comparaison des décennies précédentes,la consommation de phosphore a baissé de plus de la moitié entre 1996 et 2000.
Par un épandage mesuré d’engrais,mais aussi par des méthodes d’exploitation agricole axées sur la durabilité comme l’assolement approprié et la culture de plantes couvre-sol,il est possible de réduire la pollution de l’environnement imputable aux substances nutritives.La nouvelle politique agricole a joué un rôle déterminant dans la réduction des quantités d’engrais utilisées par les agriculteurs.
Contrôle des aliments pour animaux
La Station fédérale de recherches en production animale de Posieux (RAP) effectue le contrôle officiel des matières premières,des aliments pour animaux et de leurs producteurs à l’échelle de toute la Suisse.A l’aide de méthodes analytiques,elle vérifie les teneurs,ainsi que certaines propriétés des aliments pour animaux,et compare les résultats avec les désignations correspondantes figurant sur l’emballage,de même qu’avec les matières premières et les additifs homologués.Au total,1’414 échantillons ont été analysés en 2002,soit 17% de plus que l’année d’avant.
Des erreurs mineures relevées dans la déclaration sur les étiquettes d’aliments pour animaux ou des écarts relatifs au seuil de tolérance constatés entre la teneur déclarée et celle analysée (p.ex.teneur en protéines brutes) donnent généralement lieu à de simples réclamations.A raison de 41%,le taux de réclamations est resté pratiquement identique à celui de l’année précédente (42%).
Dans 13% des cas (contre 15% l’an passé),des réclamations ont généré des frais à la charge des intéressés.Celles-ci concernaient par exemple le dépassement du seuil de tolérance ou un étiquetage insuffisant.La cause de ces réclamations doit être éliminée dans un délai approprié
2.3 AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2 247
1956/601966/701976/801986/901996/2000 en t NP Source: USP 0 20 000 40 000 60 000 80 000
Consommation d'engrais minéraux 1956–2000
■ Contrôles de la présence de résidus de matériel animal
En présence de défauts graves,une plainte pénale est déposée.Tel est le cas s’il faut s’attendre à un effet négatif sur la qualité des denrées alimentaires d’origine animale – lait,viande,oeufs – ou sur l’environnement.Comme l’an dernier,les tribunaux ont été saisis dans 9 cas (0,6%).
Depuis début 2001,l’utilisation de matériel d’origine animale est également interdite dans les aliments destinés aux porcs et à la volaille.Dans le cadre du mandat de prestations confié à l’unité ESB,les aliments pour animaux ont fait l’objet de contrôles renforcés pour déceler la présence de résidus de matériel d’origine animale.Parmi les 1'251 échantillons analysés en 2002,19 échantillons présentaient de telles impuretés. Le nombre d’échantillons positifs a néanmoins diminué,passant de 14% en 2000 à 2,9% en 2001 et à 1,5% au cours de l’exercice sous revue.Les moulins fourragers sont désormais pratiquement exclus comme sources de contamination pour l’ESB.
■ Contrôles de la présence d’OGM
En 2002,254 aliments pour animaux ont été analysés quant à la présence de composants génétiquement modifiés.Selon la liste des matières premières génétiquement modifiées et des aliments simples génétiquement modifiés pour animaux,homologués (RS 916.307.11),la limite à partir de laquelle la présence d’OGM doit être déclarée est fixée à 3% pour les aliments simples et à 2% pour les matières premières et les aliments composés.Trois échantillons ont donné lieu à des réclamations,soit un de plus qu’en 2001.Dans les trois cas,la déclaration correspondante faisait défaut.
■ Contrôles d’entreprises
A l’occasion de ces contrôles,les activités des entreprises sont recensées et l’on vérifie si elles remplissent les exigences légales correspondantes et peuvent continuer d’y satisfaire.Font partie de ces exigences celles posées aux locaux,installations et procédés, à l’hygiène et aux compétences,ainsi qu’à l’obligation de tenir une comptabilité et au droit de livrer des additifs et des pré-mélanges.La majorité des entreprises répondent aux critères requis ou ont pu redresser la situation dans le courant de l’année.
En commun avec les cantons,qui sont compétents pour le contrôle des denrées alimentaires,167 centres collecteurs ont été contrôlés afin de savoir si une contamination était possible entre les céréales panifiables,les céréales fourragères et les oléagineux,d’une part,et les aliments pour animaux d’origine animale,d’autre part. Simultanément,des échantillons de céréales ont été prélevés et analysés.Dans sept échantillons d’aliments pour animaux provenant de six entreprises,des traces de matériel animal ont été décelées,ce qui a entraîné le rappel et la destruction des produits.
2.3AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2 248
■
Le maintien d’un élevage indépendant en Suisse est le principal objectif de l’aide octroyée par l’Etat.La valeur ajoutée de cette activité doit être réalisée dans le pays.En versant une contribution annuelle d’environ 39 millions de francs,la Confédération et les cantons soutiennent les éleveurs dans leurs efforts en vue d’assurer une production économique,de haute qualité et respectueuse de l’environnement.

Au nombre des mesures de soutien figurent en premier lieu les mesures visant à l'amélioration des bases de production telles que la tenue du herd-book,les épreuves de productivité,l'estimation de la valeur d'élevage et les programmes destinés à la préservation des races autochtones.Les aides sont allouées aux organisations d’élevage reconnues qui peuvent ainsi offrir à leurs membres les services nécessaires à un travail efficace.
Dépenses de la Confédération pour l’élevage en 2002
■■■■■■■■■■■■■■■■
2.3.4Elevage
Catégorie d’animauxMontant mio.de fr. Bovins14,40 Chevaux1,12 Porcs1,67 Moutons1,10 Chèvres0,82 Races indigènes (préservation)0,63 Total19,74 Source:Compte d’Etat
Elevage suisse indépendant
2.3 AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2 249
Tableau 50,page A57
■ Importation d'animaux d'élevage et de semence de bovins
L’administration des contingents tarifaires et l’importation d’animaux d’élevage ou de semence de taureaux sont du ressort de la Confédération.Les parts de contingent tarifaire pour les chevaux d’élevage,les porcs,les moutons,les chèvres et la semence de taureaux sont attribuées selon la procédure dite du fur et à mesure par le service compétent;quant à celles de bovins d’élevage,elles doivent,depuis le 1er janvier 2001, être acquises lors d’une mise aux enchères.En raison des incertitudes concernant l’évolution de l’ESB en Europe,il avait été renoncé à une mise aux enchères des contingents tarifaires en 2001 et au premier semestre de 2002.Des contingents de 600 bovins d’élevage ont été mis aux enchères pour la première fois au second semestre 2002.40 personnes ont déposé des offres pour un total de 1'256 animaux.Le prix de l’adjudication s’est élevé en moyenne à 175 francs,et les recettes de la mise aux enchères d’un montant de quelque 105'000 francs ont été créditées à la caisse fédérale.Alors que la demande de menu bétail et de chevaux d’élevage provenant de l’étranger est en recul depuis quelques années,la semence de taureaux étrangers – notamment la semence d’origine américaine – a toujours la cote auprès de nos éleveurs.
Importations à l’intérieur du contingent tarifaire 2002
■ Exportation de bovins d’élevage
■ Ressources zoogénétiques
Organisation du marché
ImportationsContingent tarifaire NombreNombre Chevaux d’élevageAnimaux113200
BovinsAnimaux491600
PorcsAnimaux4100
Moutons / chèvresAnimaux203600 Semence de bovinsDoses645 702800 000
Source:Rapport sur les mesures tarifaires du Conseil fédéral
Depuis 1996,l’exportation de bovins d’élevage n’était plus possible vu la situation sur le front de l’ESB.Les cas d’ESB recensés en Allemagne et en France et l’apparition de la fièvre aphteuse dans divers pays de l’UE ont encore aggravé la situation.Des efforts particuliers ont dû être consentis afin de rétablir la confiance des pays étrangers dans notre élevage bovin.Fin 2001,l’Allemagne a été le premier pays de l’UE à rouvrir ses frontières aux bovins d’élevage suisses,exemple que d’autres pays ont suivi début 2002.Au total,2'038 animaux ont pu être exportés l’an dernier vers l’Allemagne,la France,l’Irlande,la Pologne et le Kosovo,moyennant le respect de conditions sévères. Cependant,la frontière vers l’Italie,autrefois le premier acheteur de bovins d’élevage suisses,reste fermée.
Bénéficiant du soutien de la Confédération et des cantons depuis 1999,le concept relatif à la préservation de la diversité des races de rente en Suisse a déjà largement été appliqué et a commencé à porter ses fruits.En 2002,un groupe de travail pluridisciplinaire a,sur mandat de l’OFAG et à l’attention de la FAO,analysé et évalué la situation et montré dans quels domaines des mesures s’imposaient encore.Outre les programmes de préservation spécifiques à une race,déjà en cours,il importe d’élaborer un plus grand nombre de stratégies afin de garantir également la biodiversité de nos animaux de rente à long terme.Ainsi,l’accent est mis en priorité sur des projets concernant par exemple la création d’une banque génétique nationale et une meilleure commercialisation des produits spécifiques à une race.
250 2.3AMÉLIORATION DES BASES DE PRODUCTION 2
2.4 Section Inspectorat des finances
La section comprend les ressorts inspectorat des finances (révisions internes) et contrôles sur le terrain.Le programme des inspections de l’inspectorat est coordonné avec le Contrôle fédéral des finances,car il s'agit d'éviter les chevauchements et les doubles emplois.
Inspectorat des finances
En 2002,les révisions suivantes ont été effectuées:
–révisions externes approfondies chez dix bénéficiaires de prestations ou de subventions ainsi que chez les personnes chargées de l'exécution; –contrôle interne d'une section de l'OFAG; –contrôles périodiques des pièces justificatives au sein de l’office,stations de recherches et Haras national compris; –révisions finales chez neuf bénéficiaires de subventions.
Les examens externes et internes ont donné,dans l'ensemble,de bons résultats.En règle générale,les moyens financiers sont utilisés de manière efficace et ciblée.Les instruments de gestion sont,dans un grand nombre de cas,adaptés à la situation et efficients.Chez un bénéficiaire de prestations,les enregistrements manquaient de transparence et étaient difficilement compréhensibles.Si nécessaire,des recommandations relatives au développement des systèmes de contrôle interne ont été faites et discutées avec les instances concernées.
Dans l’ensemble,les résultats des révisions finales sont bons;des différences importantes sont toutefois apparues dans la qualité des enregistrements et on a relevé un certain nombre d’insuffisances.Cependant,la régularité et la légalité des enregistrements ont pu être confirmées à une exception près.Un meilleur suivi des travaux par l'office serait souhaitable.Cela permettrait d'évaluer équitablement les travaux et les prestations fournies et de procéder à des changements s’il y a lieu.
2.4 SECTION INSPECTORAT DES FINANCES 2 251 2.MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE ■■■■■■■■■■■■■■■■
■ Rapport de gestion annuel
Secrétariat
Support juridique
Inspectorat des finances
Contrôles sur le terrain
Chef de section
Suppléant
■ Activités de contrôle pendant l’ année considérée
L'utilisation efficiente des ressources doit également être l'objectif prioritaire de l'Inspectorat des finances.C'est pourquoi,il est indiqué de mettre sur pied des instruments de travail adaptés,qui optimisent l'efficience et l'efficacité de ce travail et suffisent aux exigences en matière de révision.L'élaboration d'un manuel s'appuie essentiellement sur les normes et principes de révision applicables aux niveaux national et international.
Contrôles sur le terrain
Les inspecteurs chargés des contrôles sur le terrain effectuent,pour les services de l’OFAG,des contrôles,examens,investigations et enquêtes dans tous les domaines de la production et des ventes régis par la législation agricole.En 2002,l'équipe des inspecteurs a procédé à 1003 contrôles dans les secteurs suivants:
– lait et produits laitiers:778 contrôles;
culture des champs et culture fourragère:64 contrôles;
– légumes,fruits,fleurs coupées et concentrés de fruits:132 contrôles;
– viande et œufs:26 contrôles et 1 contrôle des décomptes;
– produits agricoles transformés:2 contrôles.
Concernant les contrôles effectués dans le secteur du lait et des produits laitiers,des irrégularités ont été constatées dans 24% des cas.Il ne s’agissait en général pas de cas graves entraînant une enquête approfondie.Le plus souvent,les réclamations ont porté sur une comptabilité incomplète ou fautive.Les irrégularités révèlent néanmoins l’importance des contrôles et leur caractère préventif – tout particulièrement à une époque difficile pour bien des exploitations,marquée par le rétrécissement des marges et des perspectives d’avenir incertaines.
Un peu plus de la moitié des contrôles effectués à domicile dans le secteur des fruits et légumes frais ont fait apparaître des fautes.Ont été sanctionnés 21 importateurs qui avaient mal indiqué leurs stocks et quatre importateurs qui avaient fait une fausse annonce au sujet de la prestation en faveur de la production suisse.
Dans les autres secteurs,les contrôles n’ont pas suscité de remarques particulières.
2.4 SECTION INSPECTORAT DES FINANCES 2 252
–
■ Infractions
Les examens,enquêtes et interrogatoires requis en cas d’infractions aux dispositions de la législation agricole sont réalisés en collaboration avec les autorités d’instruction fédérales,cantonales et communales,des organisations privées et d’autres instances d’entraide judiciaire.Durant l’exercice sous revue,21 procédures pénales ont été ouvertes et transmises aux instances compétentes.En tout,30 cas ont été définitivement réglés.La statistique en la matière se présente comme suit:
cas en suspens le 31 décembre 200112 procédures pénales ouvertes en 200221 cas transmis par la Section Inspectorat des finances ou liquidés directement30 cas en suspens le 31 décembre 20023
■ Travaux préparatoires pour l’ accréditation des contrôles sur le terrain
Pour préparer le ressort des contrôles sur le terrain aux futurs développements,l’OFAG a fixé comme premier objectif l’ accréditation du domaine «soutien du prix du lait».Les travaux préparatoires ont si bien avancé jusqu’en octobre 2002 qu’il a été possible de soumettre une proposition en la matière au Service d’ accréditation suisse (SAS) de l'Office fédéral de métrologie et d'accréditation (METAS).Une direction de projet a été désignée qui a pour tâche de mener à bien ce dernier d’ici à fin 2003.
2.4 SECTION INSPECTORAT DES FINANCES 2 253 2.MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE
■ Suppression du contingentement laitier
2.5Résultats de la Politique agricole 2007
Le 20 juin 2003,à l’issue des délibérations consacrées au message concernant l'évolution future de la politique agricole (Politique agricole 2007),le Parlement a donné son feu vert à la modification de six lois fédérales et au nouvel arrêté fédéral sur les moyens financiers destinés à l'agriculture pour la période 2004–2007.Ces modifications entreront en vigueur le 1er janvier 2004.Il n’en demeure pas moins que la Politique agricole 2007 s’inscrit dans la droite ligne de la PA 2002:séparation des politiques en matière de prix et de revenu ainsi que réalisation des objectifs écologiques par des incitations économiques.Au centre de la Politique agricole figure ainsi l’amélioration de la compétitivité de l’agriculture et de l’industrie agro-alimentaire.Le lecteur trouvera ci-après,sous forme condensée,les principaux éléments de la Politique agricole 2007.
La suppression du contingentement laitier a été fixée au 1er mai 2009.En principe,la gestion des quantités de lait relevant du droit public sera maintenue jusqu’à cette date. Il est toutefois possible que les premières mesures d’assouplissement soient prises dans l’intervalle.A titre d’exemple,les différentes organisations fromagères pourront demander au Conseil fédéral une augmentation du volume de leurs producteurs, conformément à l’art.31 LAgr.Autre mesure d’assouplissement:l'exemption anticipée des organisations assumant elles-mêmes la gestion de leurs quantités selon l’art.36a, al.2,LAgr.Par ailleurs,les organisations de producteurs coopérant avec un important utilisateur régional et avec des interprofessions pourront se retirer du contingentement relevant du droit public dès le 1er mai 2006.Afin d’élucider à temps les questions liées à la suppression du contingentement laitier,le DFE établira en 2005 un rapport sur l’économie laitière.
Etapes de l’abandon du contingentement laitier
Suppression du contingentement
Art. 36b LAgr
Interprofessions
Exécution p. Conféd.
Obligation contractuelle Regroupement de l’offre Soutien des mesures de sanction Interprofessions Groupements de producteurs Utilisateur de lait régional
Art. 36a, al. 2, LAgr
Organisations gérant leurs propres quantités Interprofessions Org. de product. coopérant avec d’importants utilisateurs de lait régionaux
2.5 RÉSULTATS DE LA POLITIQUE AGRICOLE 2007 2 254 ■■■■■■■■■■■■■■■■
1.5.041.5.061.5.09 1.5.12
PA 2007
Fixation autonome des quantités (Art. 31, al. 2, LAgr)
Exécution privée
■ Mise aux enchères des contingents d’importation de viande
Afin d’éviter une désorganisation du marché du lait après le passage à la régulation des quantités relevant du droit privé,le Parlement a décidé de prendre des mesures d’accompagnement jusqu’en 2012,conformément à l’art.36b LAgr.En font partie la durée minimale d’ un an prévue pour les contrats d’achat de lait et la possibilité de demander au Conseil fédéral des sanctions de portée générale en cas de violation de dispositions contractuelles.
La suppression du contingentement s’accompagne de l’abolition du prix-cible du lait. Ce prix n’a joué qu ’ un rôle négligeable à ce jour,car la Confédération se désengage progressivement des marchés et transfère la responsabilité aux partenaires commerciaux.
A l’heure actuelle,les contingents d’importation de viande sont répartis en fonction d’une prestation en faveur de la production suisse,devant être fournie au préalable.Or, le Parlement a décidé de remplacer progressivement ce système, à partir de 2004,par la mise aux enchères des parts de contingent tarifaire pour le bétail de boucherie et la viande.En conséquence,tous les acteurs du marché auront accès aux droits d’importation.
Cependant,afin de pouvoir garantir l’écoulement du bétail provenant de la région de montagne,des droits d’importation seront fixés pour les achats de bétail sur des marchés publics.Ainsi,10% des parts de contingents tarifaires pour la viande bovine et ovine seront attribués d’ après le nombre d’animaux achetés aux enchères sur ces marchés.Cette concession faite à la région de montagne a contribué substantiellement à l’acceptation de la mise aux enchères.
■ Promotion de la création de valeur ajoutée dans les régions rurales
Dans la région de montagne,il sera possible dès 2004 d’octroyer des contributions pour soutenir la construction,par les producteurs,de bâtiments communautaires destinés à la commercialisation de produits régionaux.Des contributions forfaitaires seront également accordées pour la remise en état périodique d’ améliorations foncières.
De même,des crédits d’investissements pourront être alloués dès 2004 en vue de diversifier les activités dans l’agriculture et ses branches connexes ou,sous forme d’aide initiale,pour la création d’organisations paysannes d’entraide s’engageant en faveur d’une production conforme aux besoins du marché.En complément aux propositions du Conseil fédéral,le Parlement a aussi créé une base légale pour les crédits d’investissements servant à soutenir des projets de développement régional et de promotion de produits suisses et régionaux dans lesquels l’agriculture est largement impliquée.
2.5 RÉSULTATS DE LA POLITIQUE AGRICOLE 2007 2 2.MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE 255
■ Mesures d’accompagnement social
En plus de l’aide accordée aux exploitations en difficulté sans faute de leur part,le processus de changement sera accompagné de mesures sociales telles que la possibilité de convertir les dettes,l’aide à la reconversion professionnelle offerte aux paysans et aux paysannes désireux d’abandonner leur exploitation agricole,ainsi que l’adaptation des modalités d'imposition des gains de liquidation.Cette dernière mesure d’allégement n’était pas directement incluse dans la Politique agricole 2007,mais elle est prévue dans le cadre de la réforme de l’impôt sur les sociétés pour faciliter les cessations d’activité dans l’agriculture.L’introduction d’une rente de cessation d’exploitation a toutefois été rejetée par le Parlement.
■ Le principe de précaution inscrit dans la loi
La gestion des risques est en passe de devenir un élément-clé de l’économie rurale.Au vu des expériences les plus récentes,la sécurité alimentaire doit être comprise comme la surveillance d’un processus allant des moyens de production utilisés dans l’exploitation agricole aux denrées alimentaires offertes à l’étalage.
Aussi envisage-t-on de promouvoir la sécurité des denrées alimentaires par l’inscription du principe de la sécurité des produits aux titres 2 et 7 LAgr,par l’adaptation des moyens de production (mesures de précaution,prescriptions relatives à la fabrication et à l’utilisation) et par la mise sur pied d’un service central de détection des fraudes, ainsi que par l’application de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE),RS 916.40 (cf.partie IV du message).Dans ce contexte,les autorités compétentes s’emploient à optimiser la mise en œuvre des mesures relevant des différentes lois fédérales et à améliorer la communication.
Des mesures de précaution peuvent être décidées à titre temporaire si la probabilité est grande que la santé des hommes,des animaux et des végétaux ou l’environnement soient menacés et à condition que les hypothèses de risques soient plausibles du point de vue scientifique.
La possibilité de prendre des mesures de précaution est ainsi inscrite dans la loi par le biais de la Politique agricole 2007.Aux niveaux national et international,le principe de précaution a surtout été appliqué,jusqu’à présent,dans le domaine de la protection de l’environnement.Suite aux problèmes posés par l’ESB,les consommateurs ont de plus en plus souvent exigé son application en rapport avec la production de denrées alimentaires et de moyens de production.

256 2.5 RÉSULTATS DE LA POLITIQUE AGRICOLE 2007 2
■ Autres adaptations Le Parlement a approuvé un assouplissement de la réglementation concernant les importations de beurre.Le cercle des importateurs de beurre peut être élargi et les parts de contingent tarifaire ne sont plus réservées aux producteurs de beurre,aux fabricants de fromage fondu et à l’industrie alimentaire.De son côté,le Conseil fédéral a l’intention de maintenir l’actuel système de répartition aussi longtemps que les importateurs jouent le rôle de soupape régulatrice du marché
Désormais,les groupements de producteurs et les interprofessions pourront fixer,aux niveaux national et régional,des prix indicatifs convenus entre fournisseurs et acquéreurs.Cependant,aucune entreprise ne pourra être contrainte de respecter ce prix.En comparaison avec les dispositions de la loi sur les cartels,les organisations agricoles se voient concéder un droit spécial,qui n’ a pas été contesté lors des délibérations parlementaires et qui se justifie en raison des dissymétries souvent observées sur le marché
Afin d’adapter l’offre aux exigences du marché,l’arboriculture fruitière et la viticulture bénéficieront de contributions de reconversion jusqu’en 2011.Ce soutien n’est prévu, dans l’arboriculture,que pour des mesures collectives convenues au sein d’ un groupement de producteurs en vue de remplacer lesdites cultures par des cultures novatrices ou des variétés précoces ou tardives ayant de bonnes chances sur le marché
Enfin,le Parlement a supprimé l’échelonnement des paiements directs selon la surface et le nombre d’animaux.Par contre,les limites de revenu et de fortune sont maintenues en dépit des propositions du Conseil fédéral.Pour les exploitants mariés,des limites plus élevées déjà fixées dans l’ordonnance en 2001,ont été inscrites dans la loi.
■ Enveloppe financière 2004–2007 approuvée par le Parlement
Le Parlement a adopté,en même temps que les modifications de lois,les trois enveloppes financières destinées à l’agriculture dans les quatre prochaines années. Désormais,le Conseil fédéral a la possibilité de transférer les fonds du soutien des marchés aux paiements directs si de nouvelles obligations sont contractées dans le cadre de l’OMC,mais il n’en a pas encore fait usage concrètement.
Enveloppes financières pour la période 2004–2007
Dans son message du 2 juillet 2003 concernant le programme d’allégement 2003,le Conseil fédéral a proposé de réduire les enveloppes financières de 40 millions de francs pour 2004,de 110 millions de francs pour 2005 et de 160 millions de francs à partir de 2006.Cette mesure devrait accélérer l’évolution structurelle dont le taux estimé à 2,5% ou 3% pourrait atteindre 4% par an.
20042005200620072004–072000–03 Amélioration des bases de production et mesures sociales2762802842891 1291 037 Production et ventes7697497207082 9463 490 Paiements directs2 4872 4922 5002 53810 0179 502 Total3 5323 5213 5043 53514 09214 029
2.5 RÉSULTATS DE LA POLITIQUE AGRICOLE 2007 2 257 2.MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE
■ Mesures visant à atténuer l’impact de la sécheresse
2.6Sécheresse et programme d’allégement 2003
Le programme d’allégement destiné à l’assainissement des finances fédérales et la sécheresse ont été,en 2003,deux sujets qui ont fortement préoccupé les milieux agricoles.Nous abordons brièvement,ci-après,les décisions qui ont été prises à cet égard.
Sécheresse
Depuis 1976,la Suisse n’avait jamais connu de sécheresse aussi forte,notamment dans le Jura et le Seeland,en Argovie,dans les Grisons et au Tessin.Au mois d’août,les précipitations n’ont atteint que 20 à 50% de la normale dans l’ensemble de la Suisse, et au cours de l’été,on n’a enregistré que 45–65% de la quantité de pluie correspondant à la moyenne pluriannuelle.Quant à la température moyenne de l’été,elle s’est élevée à 21–23°C en plaine et à 24,5°C dans le Sud.Ici ou là,elle a ainsi dépassé de 4 à 6°C la moyenne pluriannuelle.
La sécheresse persistante a occasionné des pertes de rendement parfois considérables dans la plupart des régions touchées,aussi bien en culture des champs qu’en culture fourragère.A plusieurs endroits,la production de fourrages n’a pas suffi à assurer l’alimentation des animaux.Les agriculteurs ont donc été contraints d’acheter des aliments ou d’abattre des animaux.Les conséquences de la sécheresse se répercuteront probablement aussi sur les résultats économiques de 2003.Selon les estimations de l’OFS pour le secteur dans son ensemble,les rendements seront plus bas qu’en 2002 dans la production végétale,tandis que les frais seront plus élevés en raison des achats de fourrages et de l’irrigation des terres.
Toute une série de mesures ont été prises dans le courant de l’année pour atténuer l’impact de la sécheresse.
Protection à la frontière
–Le droit de douane perçu sur le foin a été abaissé de 6 fr./100 kg le 1er août et ramené à zéro au 1er septembre.
–Les prix à l’importation des céréales fourragères et des aliments pour animaux protéiques ayant augmenté,les droits de douane ont été réduits en deux étapes.
–Ceux applicables aux balles d'ensilage d'herbe et au maïs d'ensilage ont carrément été supprimés au 21 août 2003.
Paiements directs
–Le 26 septembre 2003,le Conseil fédéral a décidé que la réduction des paiements directs conditionnée par la diminution des effectifs de bétail due à la sécheresse sera en partie compensée en 2004,lorsque cela s’avère justifié.
–Dans les zones de montagne III et IV,la date de fauche fixée pour les prairies extensives et peu intensives a été avancée de dix jours.
2.6 SÉCHERESSE ET PROGRAMME D’ALLÉGEMENT 2003 2 258 ■■■■■■■■■■■■■■■■
–Les cantons ont été habilités à autoriser les pâtures sur lesdites prairies et sur des jachères tournantes.Quant aux exploitations d’estivage,elles ont eu le droit,lorsque les circonstances le justifiaient,de dépasser le nombre d’animaux correspondant à la charge usuelle ou de rester au-dessous de celle-ci concernant la durée.En outre, l’utilisation de fourrage acheté était autorisée sur les alpages.
–La date de fauche pour les terrains à litière fixée au 1er septembre a été annulée le 19 août 2003,sauf dans les cas où des réglementations contraires avaient été convenues avec le canton.
–Les agriculteurs ont pu faire valoir la disposition de l'art.15 de l'ordonnance sur les paiements directs relative à la force majeure,s’ils ne parvenaient pas à fournir les PER en raison de la sécheresse.Ils devaient l’annoncer au service cantonal de l’agriculture,en documentant l’impossibilité de fournir lesdites prestations.
–Dans les régions concernées,les exploitants bio ont été autorisés à acheter jusqu’à concurrence de 40% au lieu de 10% des fourrages grossiers provenant d’exploitations traditionnelles.
Crédits d’investissements et aide aux exploitations
–Il a été possible d’octroyer des prêts au titre de l’aide aux exploitations dans les cas de rigueur.
–Lors de sa séance du 26 septembre 2003,le Conseil fédéral a prévu d'accorder, selon une procédure simplifiée,des prêts remboursables destinés à surmonter de graves problèmes de liquidités.
–Une autre mesure a consisté à différer le remboursement de crédits d’investissements.
Mesures diverses
–Les producteurs de lait n’épuisant pas leurs contingents durant l’année laitière en cours peuvent reporter plus de 5'000 kg à l’année suivante.
–L’OFAG a aussi prévu,dans les cas justifiés,des réglementations d’exception simples concernant le transfert temporaire de contingents laitiers de la région de montagne à celle de plaine ainsi que l’attribution de contingents supplémentaires.Ces réglementations ont été appliquées lorsque des animaux devaient quitter l’alpage ou descendre en plaine plus tôt que prévu.
–L’armée,quant à elle,a amené de l’eau aux alpages touchés par la sécheresse et a également participé aux transports de foin.
–La Confédération a accordé des fonds pour le stockage de viande de vache,ce qui a permis de stabiliser les prix des vaches de boucherie.
Programme d’allégement 2003
Au début de l’année,on s’est rendu compte qu’il fallait prendre des mesures pour combler le gros écart entre dépenses et recettes qui apparaissait dans les finances de l’Etat.Le Conseil fédéral a adopté,le 2 juillet 2003,le message concernant le programme d’allégement 2003 du budget de la Confédération,dans lequel il propose des mesures permettant de réduire substantiellement la croissance des dépenses. Comparé au plan financier du 30 septembre 2002,la situation s’améliorerait de près de 3,3 milliards de francs en 2006.
2.6 SÉCHERESSE ET PROGRAMME D’ALLÉGEMENT 2003 2 2.MESURES DE POLITIQUE AGRICOLE 259
■ Proposition du Conseil fédéral pour l’agriculture
L’agriculture n’a pas été épargnée par les mesures d’économies.Les propositions du Conseil fédéral entraînent des écarts considérables par rapport au plan financier 2004–2006 du 30 septembre 2002.
Programme d’allégement 2003:réductions dans l’agriculture
Domaine2004200520062007
Les moyens financiers disponibles pour la période 2004–2007 diminuent ainsi de 470 millions de francs.Au lieu de s’élever à 14,092 milliards,comme le prévoyaient les enveloppes financières approuvées par le Parlement le 5 juin 2003,ils seraient limités à 13,639 milliards.Etant donné que le Conseil fédéral avait déjà proposé une réduction de 28 millions de francs pour 2004 dans le cadre du budget,la réduction totale pour l’année prochaine atteint 68 millions.
Le Parlement a débattu le programme d’allégement 2003 lors de sa session d’automne. La divergence encore présente entre le Conseil national et le Conseil des États permet cependant d’entrevoir que la somme économisée dans l’agriculture sera plus faible que ne le laissait entendre la proposition du Conseil fédéral.L’élimination des divergences se fera lors de la session d’hiver.
■ Conséquences
Les mesures d’allégement prévues en rapport avec l’amélioration des bases de production et les mesures sociales restreindront,sur le plan financier,les possibilités des agriculteurs d’adapter les structures et les infrastructures aux nouvelles exigences.Les mesures d’économie affecteront le potentiel de rationalisation et les possibilités d’abaisser les frais de production et,partant,la compétitivité du secteur agricole. S’agissant du soutien du marché,les réductions de crédits en 2006 se traduiront,pour les agriculteurs,par une perte de recettes directe d’environ 63 millions de francs,dont trois quarts,soit 48 millions,toucheront l’économie laitière.En ce qui concerne les paiements directs,il est prévu de renoncer à la suppression des échelonnements jusqu’au 1er janvier 2008.
Les réductions se répercuteront directement sur les recettes des exploitations agricoles, dont la diminution en 2006 est estimée à 120 millions de francs.La pression exercée sur le secteur agricole continuera donc d’augmenter.Il sera impossible de compenser les pertes et de maintenir les revenus à leur niveau nominal actuel,à moins que l’évolution structurelle ne s’accélère considérablement,ce qui est plutôt invraisemblable.En moyenne des exploitations,il faut dès lors s’attendre à un recul du revenu nominal.
260 2.6 SÉCHERESSE ET PROGRAMME D’ALLÉGEMENT 2003 2
mio.de fr.
Soutien
Paiements directs–50,057,057,0 Administration,recherche1,52,66,56,5 Total40,0110,0160,0160,0
Mesures structurelles et sociales28,519,448,548,5
du marché10,038,048,048,0
Tableaux Résultats économiques
A14 ANNEXE
Tableau 15 Production de la branche agricole,en 1000 fr. 199711998119991200012001120022200332000/02–2003 % Productiondebiensagricoles105096791029791793668399995250941315295930048999632-6.9 Productionvégétale5056321493227044618414796657434790845754814066526-11.1 Céréales (semences comprises)771 372749 681623 577618 563490 428512 744428 279-20.8 Blé431 145422 064345 606349 727274 051285 996242 670-20.0 Orge186 203178 152145 321130 73290 784101 72489 136-17.3 Maïs grain84 51685 23281 39884 33478 04667 90147 517-38.1 Autres céréales69 50964 23351 25253 77147 54757 12348 956-7.3 Plantes industrielles288 893277 818244 919262 341238 124289 013284 0097.9 Oléagineux et fruits oléagineux (semences comprises)97 10389 41877 48365 24267 04584 44186 62019.9 Plantes protéagineuses (semences comprises)10 5898 6137 6268 3738 71512 83417 63076.8 Tabac brut15 72521 32816 55417 99020 66922 50024 62420.8 Betteraves sucrières161 664154 526139 138165 774136 683164 162150 060-3.5 Autres plantes industrielles3 8133 9344 1184 9615 0115 0765 0751.2 Plantes fourragères1 446 2891 276 2611 052 7831 232 5621 101 4041 221 023910 194-23.2 Maïs fourrager202 152168 720147 362171 648148 758101 847123 955-11.9 Plantes sarclées fourragères25 33322 11518 78121 00714 61312 65912 240-23.9 Autres plantes fourragères1 218 8031 085 426886 6401 039 906938 0331 106 517773 999-24.7 Produits maraîchers et horticoles1 425 5341 414 9541 344 0561 369 3571 323 6831 368 6291 323 282-2.3 Légumes frais509 180463 354444 035487 241504 908534 996533 5674.8 Plantes et fleurs916 354951 600900 021882 116818 775833 633789 715-6.5 Pommes de terre (plants compris)229 564201 261191 437207 017191 807193 933177 859-10.0 Fruits531 643619 529573 366657 560552 308560 859533 996-9.5 Fruits frais275 207355 463280 073365 283289 397310 310290 412-9.7 Raisins256 436264 066293 293292 277262 911250 549243 584-9.3 Vin336 360361 515401 069421 194428 760407 017387 816-7.4 Autres produits végétaux26 66731 25030 63628 06321 39422 26221 092-11.8 Productionanimale5453358536564849049975198593506524450175234933106-3.2 Bovins1 028 2611 042 096939 0511 128 114931 964962 9621 015 8760.8 Porcs1 227 7181 111 5811 033 0391 081 2451 084 4871 045 4651 082 4471.1 Equidés11 84213 9298 6757 0438 5126 7286 172-16.9 Moutons et chèvres63 79963 89956 57054 97359 48257 11057 7421.0 Volaille171 148167 247168 022175 761179 864192 429201 74410.4 Autres animaux18 33419 67113 31912 64210 94416 64015 62116.5 Lait2 737 0852 750 8442 507 9692 558 7082 604 6672 544 1012 359 545-8.2 Oeufs189 892189 579171 360173 305175 304185 241184 3843.6 Autres produits animaux5 2776 8016 9936 80310 0216 8489 57621.4 Productiondeservicesagricoles4801774826785001715600305625725814875808092.2 Prestations de services agricoles480 177482 678470 955529 405525 845543 199540 5951.5 Location de contingents laitiers0029 21730 62636 72738 28840 21414.2 Productionagricole10989856107805969867010105552809975724101744919580441-6.4 Activitéssecondairesnonagricoles (nonséparables)365897350106380449354085315966305164321145-1.2 Transformation de produits agricoles265 134240 080195 239193 359186 835189 253180 214-5.1 Autres activités secondaires non séparables (biens et services)100 763110 027185 210160 727129 131115 911140 9304.2 Productiondelabrancheagricole1135575311130702102474591090936510291690104796559901585-6.2 1 Etat au 1er septembre 2003.En raison de l'application pour la première fois de la nouvelle méthodologie,les valeurs ne sont pas encore définitives. 2 Provisoire,état au 1er septembre 2003 3Estimation,état au 1er septembre 2003 Source:OFS
ANNEXE A15 Tableau 16 Comptes économiques de l'agriculture,aux prix courants,en 1000 fr. 199711998119991200012001120022200332000/02–2003 % Productiondelabrancheagricole1135575311130702102474591090936510291690104796559901585-6.2 Consommationsintermédiaires,total6091080590226555231295873971580279159617015777424-1.7 Semences et plants387 874343 496327 378345 473315 648317 022314 300-3.6 Energie,lubrifiants361 138353 925358 668395 473388 436390 221391 6580.1 Engrais et produits d'amendement du sol158 005144 272145 737141 956146 673149 140150 6283.2 Produits de traitement des plantes et pesticides124 470124 326128 785132 552138 178131 820131 185-2.2 Vétérinaire et médicaments154 541160 718157 737160 913163 676165 354167 0082.3 Aliments pour animaux2 946 1982 778 9332 471 0032 704 8232 588 9112 670 0582 489 632-6.2 Entretien de machines et d'appareils388 033413 426380 205377 772392 567415 992411 8244.1 Entretien d'installations de construction149 231154 918122 767120 352153 713166 229162 41410.7 Prestations de services agricoles480 177482 678500 171560 030562 572581 487580 8092.2 Autres biens et services941 411945 573930 677934 627952 418974 379977 9662.5 Valeurajoutéebrute auxprixdebase5264673522843747243315035395448889945179544124161-11.9 Consommation de capital fixe2 013 6941 996 2791 984 1091 967 8011 994 4201 999 0292 010 3161.2 Biens d'équipement1 061 5661 059 0371 049 7781 019 3911 016 0821 026 4661 034 0601.3 Constructions847 009828 266819 845828 696851 539840 662838 440-0.2 Plantations95 69296 32598 322100 437104 822104 910105 8502.4 Autres9 42812 65016 16419 27721 97726 99131 96540.5 Valeurajoutéenetteauxprixdebase3250979323215827402213067593249447925189252113845-21.5 Autres impôts sur la production103 768109 176115 136117 430130 529135 150135 2245.9 + Autres subventions (non liées à la production)2 117 3162 170 4462 394 6192 213 3702 447 5932 547 9882 527 2555.2 Revenudesfacteurs5264527529342850197045163533481154449317634505876-9.3 Rémunération des salariés1 208 9391 217 4421 172 4831 151 2311 124 0771 097 2331 075 433-4.3 Excédentnetd'exploitation/ revenumixte4055588407598738472214012302368746738345313430443-10.8 Fermages payés212 767212 172213 120209 308201 994202 218200 285-2.1 Intérêts payés424 261371 156340 902365 646389 473390 393395 2713.5 Intérêts reçus 00000000.0 Revenunetd'entreprise3418560349265932931993437348309600032419192834886-13.0 1 Etat au 1er septembre 2003.En raison de l'application pour la première fois de la nouvelle méthodologie,les valeurs ne sont pas encore définitives. 2 Chiffres provisoires,état au 1er septembre 2003 3Estimation,état au 1er septembre 2003 Source:OFS
Tableau 17
Résultats d'exploitation:toutes les régions
1Taux d'intérêt moyen des obligations de la Confédération (1990:6.40%;1991:6.23%;1992:6.42%;1999:3.02%; 2000:3.95%;2001:3.36%;2002:3.22%)
2Investissements bruts (sans prestations propres),déduction faite des subventions et des désinvestissements
3Formation de capital propre (sans prestations propres),plus amortissements,plus/moins changements stocks et actif bétail
4Rapport entre cash flow et total des investissements
5Part d'exploitations avec cash flow > total des investissements
6Part de capitaux étrangers <50% et formation de capital propre positive
7Part de capitaux étrangers >50% et formation de capital propre positive
8Part de capitaux étrangers <50% et formation de capital propre négative
9Part de capitaux étrangers >50% et formation de capital propre négative
10Rapport entre (service de la dette plus bénéfice/perte calculés plus intérêts sur le capital propre) et actifs de l'exploitation
11Rapport entre (bénéfice/perte calculés plus intérêts sur le capital propre) et capital propre de l'exploitation
12Rapport entre (revenu agricole moins intérêts sur le capital propre) et unités de travail annuel de la famille (UTAF)Source:dépouillement centralisé,FAT
A16 ANNEXE
CaractéristiqueUnité1990/9219992000200120021999/2001–2002 % Exploitations de référenceNombre4 302 3 494 3 419 3 067 2 379 -28.5 Exploitations représentéesNombre62 921 54 906 53 896 52 470 51 421 -4.3 Structured'exploitation Surface agricole utileha16.06 18.41 18.78 19.10 19.38 3.3 Terres ouvertesha4.90 5.08 5.17 5.17 5.25 2.1 Main-d'oeuvre de l'exploitationUTA1.88 1.70 1.70 1.68 1.65 -2.6 dont main-d'oeuvre familialeUTAF1.39 1.29 1.30 1.29 1.28 -1.0 Vaches,totalNombre12.9 13.4 13.5 14.0 13.9 2.0 Animaux,totalUGB23.2 23.5 23.8 24.7 24.6 2.5 Structureducapital Actifs totauxfr.606 321 689 619 716 645 732 058 734 566 3.1 dont:actifs circulantsfr.116 932 135 278 144 196 140 469 133 572 -4.6 dont:actif bétailfr.60 662 41 172 44 706 45 448 43 507 -0.6 dont:immobilisationsfr.428 727 513 169 527 743 546 141 557 487 5.4 dont:actifs de l'exploitationfr.558 933 636 990 662 417 680 487 692 767 5.0 Part de capitaux étrangers%43 41 41 41 41 0.0 Intérêt calculé du capital propre de l'exploitation 1 fr.19 808 11 089 15 193 13 319 12 880 -2.4 Compted'exploitation Rendement brut totalfr.184 762 181 702 199 145 192 972 194 365 1.6 dont:paiements directsfr.13 594 38 872 39 307 43 162 45 630 12.8 Charges matériellesfr.91 735 102 844 108 460 114 173 117 279 8.1 Revenu de l'exploitationfr.93 027 78 858 90 685 78 799 77 086 -6.9 Frais de main-d'oeuvrefr.13 775 12 128 12 369 12 097 11 661 -4.4 Service de la dettefr.11 361 7 405 8 001 8 492 8 411 5.6 Fermagesfr.5 069 5 536 5 640 5 776 5 514 -2.4 Charges réellesfr.121 941 127 912 134 470 140 539 142 865 6.4 Revenu agricolefr.62 822 53 789 64 675 52 434 51 500 -9.6 Revenu accessoirefr.16 264 18 638 19 208 18 633 18 577 -1.3 Revenu totalfr.79 086 72 427 83 883 71 067 70 077 -7.5 Consommation de la famillefr.59 573 59 220 62 650 63 779 63 237 2.2 Formation de capital proprefr.19 513 13 207 21 233 7 288 6 840 -50.8 Investissementsetfinancement Total des investissements 2 fr.46 914 41 856 44 964 47 469 43 695 -2.4 Cash flow 3 fr.44 456 42 238 46 043 39 389 41 177 -3.2 Rapport entre cash flow et investissements 4 %95 101 102 83 94 -1.4 Exploitations avec excédent de financement 5 %66 66 67 60 66 2.6 Stabilitéfinancière Exploitations en situation financière saine 6 %52 47 52 42 41 -12.8 Exploitations avec faible autonomie financière 7 %26 21 25 17 18 -14.3 Exploitations avec faible revenu 8 %10 17 12 22 22 29.4 Exploitations en situation financière précaire 9 %12 15 11 19 20 33.3 Relationrevenudel'exploitation/facteursutilisés Revenu de l'exploitation par main-d'oeuvrefr./UTA49 473 46 376 53 426 47 027 46 648 -4.7 Revenu de l'exploitation par ha surface agricole utilefr./ha5 796 4 282 4 829 4 125 3 977 -9.9 Relation revenu de l'exploitation/actifs de l'exploitation%16.7 12.4 13.7 11.6 11.1 -11.7 Rentabilité Rentabilité du capital total 10 %0.8 -2.3 -0.6 -2.7 -2.9 55.4 Rentabilité du capital propre 11 %-2.2 -5.9 -3.2 -6.8 -7.0 32.1 Revenudutravaildelamain-d'oeuvrefamiliale12fr./UTAF3102533050380993035630262-10.6 (moyenne) Revenudutravaildelamain-d'oeuvrefamiliale12fr./UTAF2946529770344102741727420-10.2 (médiane)
Résultats d'exploitation:région de plaine*
1Taux d'intérêt moyen des obligations de la Confédération (1990:6.40%;1991:6.23%;1992:6.42%;1999:3.02%; 2000:3.95%;2001:3.36%;2002:3.22%)
2Investissements bruts (sans prestations propres),déduction faite des subventions et des désinvestissements
3Formation de capital propre (sans prestations propres),plus amortissements,plus/moins changements stocks et actif bétail
4Rapport entre cash flow et total des investissements
5Part d'exploitations avec cash flow > total des investissements
6Part de capitaux étrangers <50% et formation de capital propre positive
7Part de capitaux étrangers >50% et formation de capital propre positive
8Part de capitaux étrangers <50% et formation de capital propre négative
9Part de capitaux étrangers >50% et formation de capital propre négative
10Rapport entre (service de la dette plus bénéfice/perte calculés plus intérêts sur le capital propre) et actifs de l'exploitation
11Rapport entre (bénéfice/perte calculés plus intérêts sur le capital propre) et capital propre de l'exploitation
12Rapport entre (revenu agricole moins intérêts sur le capital propre) et unités de travail annuel de la famille (UTAF)
*Région de plaine:zone de grandes cultures et zones intermédiaires
Source:dépouillement centralisé,FAT
ANNEXE A17
Tableau 18
CaractéristiqueUnité1990/9219992000200120021999/2001–2002 % Exploitations de référenceNombre2 356 1 565 1 517 1 376 1 006 -32.3 Exploitations représentéesNombre29 677 25 499 25 094 24 183 23 072 -7.4 Structured'exploitation Surface agricole utileha16.66 19.33 19.41 19.93 20.68 5.7 Terres ouvertesha8.34 9.05 9.13 9.26 9.82 7.4 Main-d'oeuvre de l'exploitationUTA2.05 1.83 1.80 1.77 1.78 -1.1 dont main-d'oeuvre familialeUTAF1.36 1.26 1.26 1.26 1.25 -0.8 Vaches,totalNombre12.8 13.4 13.3 13.8 13.8 2.2 Animaux,totalUGB22.9 23.4 23.5 24.7 25.1 5.2 Structureducapital Actifs totauxfr.706 406 778 173 814 917 832 078 852 833 5.5 dont:actifs circulantsfr.149 871 165 188 179 657 172 076 168 801 -2.0 dont:actif bétailfr.61 461 41 791 44 637 45 969 44 560 1.0 dont:immobilisationsfr.495 074 571 194 590 623 614 033 639 472 8.0 dont:actifs de l'exploitationfr.642 757 712 424 746 171 773 158 797 415 7.2 Part de capitaux étrangers%41 40 39 40 41 3.4 Intérêt calculé du capital propre de l'exploitation 1 fr.23 633 12 686 17 549 15 362 14 923 -1.8 Compted'exploitation Rendement brut totalfr.225 249 218 369 242 054 233 144 242 450 4.9 dont:paiements directsfr.7 248 32 359 32 944 38 399 40 791 18.0 Charges matériellesfr.110 193 122 085 129 262 135 711 143 609 11.3 Revenu de l'exploitationfr.115 056 96 284 112 792 97 433 98 841 -3.3 Frais de main-d'oeuvrefr.20 784 18 194 18 330 17 349 17 799 -0.9 Service de la dettefr.13 463 8 424 9 051 9 835 10 147 11.5 Fermagesfr.7 015 7 698 7 673 7 796 7 493 -3.0 Charges réellesfr.151 456 156 400 164 316 170 690 179 048 9.3 Revenu agricolefr.73 794 61 968 77 738 62 453 63 402 -5.9 Revenu accessoirefr.16 429 17 580 17 805 17 043 16 743 -4.2 Revenu totalfr.90 223 79 548 95 543 79 496 80 145 -5.6 Consommation de la famillefr.67 985 66 577 69 756 70 993 71 999 4.2 Formation de capital proprefr.22 238 12 971 25 787 8 503 8 146 -48.3 Investissementsetfinancement Total des investissements 2 fr.56 951 46 615 52 271 52 828 50 533 -0.1 Cash flow 3 fr.52 079 45 807 53 548 45 267 47 438 -1.6 Rapport entre cash flow et investissements 4 %92 98 102 86 94 -1.4 Exploitations avec excédent de financement 5 %64 64 69 61 65 0.5 Stabilitéfinancière Exploitations en situation financière saine 6 %52 47 54 42 41 -14.0 Exploitations avec faible autonomie financière 7 %24 17 23 17 15 -21.1 Exploitations avec faible revenu 8 %12 20 13 23 23 23.2 Exploitations en situation financière précaire 9 %12 16 10 18 21 43.2 Relationrevenudel'exploitation/facteursutilisés Revenu de l'exploitation par main-d'oeuvrefr./UTA56 050 52 755 62 635 55 134 55 395 -2.5 Revenu de l'exploitation par ha surface agricole utilefr./ha6 908 4 981 5 810 4 889 4 779 -8.6 Relation revenu de l'exploitation/actifs de l'exploitation%17.9 13.5 15.1 12.6 12.4 -9.7 Rentabilité Rentabilité du capital total 10 %2.1 -1.2 0.9 -1.3 -1.3 143.8 Rentabilité du capital propre 11 %0.0 -4.1 -0.5 -4.4 -4.4 46.7 Revenudutravaildelamain-d'oeuvrefamiliale12fr./UTAF3692439210478913752338758-6.7 (moyenne) Revenudutravaildelamain-d'oeuvrefamiliale12fr./UTAF3618636114445613467135855-6.7 (médiane)
Tableau 19
Résultats d'exploitation:région des collines*
1Taux d'intérêt moyen des obligations de la Confédération (1990:6.40%;1991:6.23%;1992:6.42%;1999:3.02%; 2000:3.95%;2001:3.36%;2002:3.22%)
2Investissements bruts (sans prestations propres),déduction faite des subventions et des désinvestissements
3Formation de capital propre (sans prestations propres),plus amortissements,plus/moins changements stocks et actif bétail
4Rapport entre cash flow et total des investissements
5Part d'exploitations avec cash flow > total des investissements
6Part de capitaux étrangers <50% et formation de capital propre positive
7Part de capitaux étrangers >50% et formation de capital propre positive
8Part de capitaux étrangers <50% et formation de capital propre négative
9Part de capitaux étrangers >50% et formation de capital propre négative
10Rapport entre (service de la dette plus bénéfice/perte calculés plus intérêts sur le capital propre) et actifs de l'exploitation
11Rapport entre (bénéfice/perte calculés plus intérêts sur le capital propre) et capital propre de l'exploitation
12Rapport entre (revenu agricole moins intérêts sur le capital propre) et unités de travail annuel de la famille (UTAF)
*Région des collines:zone des collines et zone de montagne ISource:dépouillement centralisé,FAT
A18 ANNEXE
CaractéristiqueUnité1990/9219992000200120021999/2001–2002 % Exploitations de référenceNombre1 125 1 029 1 017 907 698 -29.1 Exploitations représentéesNombre17 397 14 967 14 588 14 343 13 946 -4.7 Structured'exploitation Surface agricole utileha15.30 17.19 17.83 17.95 18.09 2.5 Terres ouvertesha3.08 2.99 3.15 3.04 2.85 -6.9 Main-d'oeuvre de l'exploitationUTA1.81 1.62 1.62 1.60 1.54 -4.5 dont main-d'oeuvre familialeUTAF1.40 1.28 1.29 1.26 1.24 -2.9 Vaches,totalNombre14.4 14.7 15.3 15.8 16.0 4.8 Animaux,totalUGB26.0 26.0 27.0 27.8 27.9 3.6 Structureducapital Actifs totauxfr.553 876 655 042 677 784 686 002 685 062 1.8 dont:actifs circulantsfr.95 672 116 937 122 136 122 814 110 023 -8.8 dont:actif bétailfr.66 366 44 452 49 901 49 611 48 151 0.3 dont:immobilisationsfr.391 838 493 653 505 747 513 577 526 888 4.5 dont:actifs de l'exploitationfr.516 933 602 991 626 182 628 230 650 611 5.1 Part de capitaux étrangers%46 45 45 44 44 -1.5 Intérêt calculé du capital propre de l'exploitation 1 fr.17 271 9 825 13 318 11 653 11 650 0.4 Compted'exploitation Rendement brut totalfr.170 201 167 340 183 249 178 588 179 713 1.9 dont:paiements directsfr.15 415 37 996 39 135 41 649 43 917 10.9 Charges matériellesfr.85 602 96 378 102 222 108 086 111 844 9.4 Revenu de l'exploitationfr.84 599 70 962 81 027 70 502 67 870 -8.5 Frais de main-d'oeuvrefr.9 943 9 037 9 183 9 655 8 446 -9.1 Service de la dettefr.10 915 7 618 8 330 8 265 8 045 -0.3 Fermagesfr.3 903 4 422 4 789 5 086 5 121 7.5 Charges réellesfr.110 363 117 455 124 525 131 092 133 456 7.3 Revenu agricolefr.59 838 49 885 58 725 47 496 46 257 -11.1 Revenu accessoirefr.14 544 19 849 21 814 20 557 19 369 -6.6 Revenu totalfr.74 382 69 734 80 539 68 053 65 626 -9.8 Consommation de la famillefr.55 272 55 890 59 963 61 333 60 218 2.0 Formation de capital proprefr.19 110 13 844 20 576 6 720 5 408 -60.6 Investissementsetfinancement Total des investissements 2 fr.41 428 39 227 39 674 47 007 40 781 -2.8 Cash flow 3 fr.41 445 40 759 43 650 37 263 39 152 -3.5 Rapport entre cash flow et investissements 4 %100 104 110 79 96 -1.7 Exploitations avec excédent de financement 5 %68 67 68 58 68 5.7 Stabilitéfinancière Exploitations en situation financière saine 6 %50 46 50 43 39 -15.8 Exploitations avec faible autonomie financière 7 %30 26 31 19 20 -21.1 Exploitations avec faible revenu 8 %8 13 8 18 22 69.2 Exploitations en situation financière précaire 9 %12 15 11 20 20 30.4 Relationrevenudel'exploitation/facteursutilisés Revenu de l'exploitation par main-d'oeuvrefr./UTA46 654 43 842 50 119 44 191 44 049 -4.3 Revenu de l'exploitation par ha surface agricole utilefr./ha5 533 4 128 4 545 3 927 3 753 -10.6 Relation revenu de l'exploitation/actifs de l'exploitation%16.4 11.8 12.9 11.2 10.4 -13.1 Rentabilité Rentabilité du capital total 10 %0.4 -2.5 -1.1 -3.3 -3.5 52.2 Rentabilité du capital propre 11 %-3.3 -7.0 -4.5 -8.4 -8.5 28.1 Revenudutravaildelamain-d'oeuvrefamiliale12fr./UTAF3033531292353362845827817-12.2 (moyenne) Revenudutravaildelamain-d'oeuvrefamiliale12fr./UTAF2952029459331562660425797-13.3 (médiane)
Tableau 20
Résultats d'exploitation:région de montagne*
1Taux d'intérêt moyen des obligations de la Confédération (1990:6.40%;1991:6.23%;1992:6.42%;1999:3.02%; 2000:3.95%;2001:3.36%;2002:3.22%)
2Investissements bruts (sans prestations propres),déduction faite des subventions et des désinvestissements
3Formation de capital propre (sans prestations propres),plus amortissements,plus/moins changements stocks et actif bétail
4Rapport entre cash flow et total des investissements
5Part d'exploitations avec cash flow > total des investissements
6Part de capitaux étrangers <50% et formation de capital propre positive
7Part de capitaux étrangers >50% et formation de capital propre positive
8Part de capitaux étrangers <50% et formation de capital propre négative
9Part de capitaux étrangers >50% et formation de capital propre négative
10Rapport entre (service de la dette plus bénéfice/perte calculés plus intérêts sur le capital propre) et actifs de l'exploitation
11Rapport entre (bénéfice/perte calculés plus intérêts sur le capital propre) et capital propre de l'exploitation
12Rapport entre (revenu agricole moins intérêts sur le capital propre) et unités de travail annuel de la famille (UTAF)
*Région de montagne:zones de montagne II à IV
Source:dépouillement centralisé,FAT
ANNEXE A19
CaractéristiqueUnité1990/9219992000200120021999/2001–2002 % Exploitations de référenceNombre821 900 885 784 675 -21.2 Exploitations représentéesNombre15 847 14 440 14 214 13 944 14 403 1.4 Structured'exploitation Surface agricole utileha15.76 18.06 18.63 18.85 18.55 0.2 Terres ouvertesha0.44 0.25 0.28 0.26 0.25 -5.1 Main-d'oeuvre de l'exploitationUTA1.63 1.57 1.60 1.60 1.55 -2.5 dont main-d'oeuvre familialeUTAF1.42 1.37 1.39 1.38 1.35 -2.2 Vaches,totalNombre11.4 11.9 11.8 12.4 11.8 -1.9 Animaux,totalUGB20.5 21.1 21.0 21.5 20.6 -2.8 Structureducapital Actifs totauxfr.476 486 569 082 583 036 605 967 593 049 1.2 dont:actifs circulantsfr.78 573 101 469 104 230 103 814 99 941 -3.1 dont:actif bétailfr.52 902 36 681 39 497 40 263 37 323 -3.8 dont:immobilisationsfr.345 011 430 932 439 309 461 890 455 785 2.6 dont:actifs de l'exploitationfr.448 089 539 022 551 742 573 520 565 949 2.0 Part de capitaux étrangers%45 40 40 40 40 0.0 Intérêt calculé du capital propre de l'exploitation 1 fr.15 432 9 580 12 957 11 491 10 798 -4.8 Compted'exploitation Rendement brut totalfr.124 931 131 838 139 707 138 099 131 524 -3.7 dont:paiements directsfr.23 476 51 279 50 719 52 979 55 041 6.5 Charges matériellesfr.63 905 75 569 78 140 83 081 80 364 1.8 Revenu de l'exploitationfr.61 026 56 269 61 567 55 018 51 161 -11.2 Frais de main-d'oeuvrefr.4 860 4 619 5 116 5 500 4 940 -2.7 Service de la dettefr.7 918 5 386 5 808 6 397 5 984 2.1 Fermagesfr.2 707 2 872 2 922 2 986 2 725 -6.9 Charges réellesfr.79 390 88 445 91 986 97 964 94 013 1.3 Revenu agricolefr.45 541 43 392 47 721 40 135 37 512 -14.3 Revenu accessoirefr.17 853 19 250 19 011 19 414 20 748 7.9 Revenu totalfr.63 394 62 642 66 732 59 549 58 260 -7.5 Consommation de la famillefr.48 548 49 678 52 865 53 783 52 126 0.0 Formation de capital proprefr.14 846 12 964 13 867 5 766 6 133 -43.6 Investissementsetfinancement Total des investissements 2 fr.34 138 36 177 37 494 38 648 35 562 -5.0 Cash flow 3 fr.33 482 37 469 35 247 31 384 33 108 -4.6 Rapport entre cash flow et investissements 4 %98 104 94 81 93 0.0 Exploitations avec excédent de financement 5 %70 70 65 60 66 1.5 Stabilitéfinancière Exploitations en situation financière saine 6 %54 50 51 41 42 -11.3 Exploitations avec faible autonomie financière 7 %26 23 23 16 19 -8.1 Exploitations avec faible revenu 8 %8 15 14 25 21 16.7 Exploitations en situation financière précaire 9 %12 12 12 18 18 28.6 Relationrevenudel'exploitation/facteursutilisés Revenu de l'exploitation par main-d'oeuvrefr./UTA37 418 35 950 38 532 34 399 33 018 -9.0 Revenu de l'exploitation par ha surface agricole utilefr./ha3 874 3 115 3 304 2 919 2 758 -11.4 Relation revenu de l'exploitation/actifs de l'exploitation%13.6 10.4 11.2 9.6 9.0 -13.5 Rentabilité Rentabilité du capital total 10 %-2.3 -4.4 -3.8 -5.1 -5.7 28.6 Rentabilité du capital propre 11 %-7.4 -9.2 -8.2 -10.5 -11.4 22.6 Revenudutravaildelamain-d'oeuvrefamiliale12fr./UTAF2120124747250642080919816-15.8 (moyenne) Revenudutravaildelamain-d'oeuvrefamiliale12fr./UTAF2070722991228511848418355-14.4 (médiane)
Tableau 21a
Résultats d'exploitation selon les types d'exploitations* – 2000/02
1Taux d'intérêt moyen des obligations de la Confédération (2000:3.95%;2001:3.36%;2002:3.22%)
2Investissements bruts (sans prestations propres),déduction faite des subventions et des désinvestissements
3Formation de capital propre (sans prestations propres),plus amortissements,plus/moins changements stocks et actif bétail
4Rapport entre cash flow et total des investissements
5Part d'exploitations avec cash flow > total des investissements
6Part de capitaux étrangers <50% et formation de capital propre positive
7Part de capitaux étrangers >50% et formation de capital propre positive
8Part de capitaux étrangers <50% et formation de capital propre négative
9Part de capitaux étrangers >50% et formation de capital propre négative
10Rapport entre (service de la dette plus bénéfice/perte calculés plus intérêts sur le capital propre) et actifs de l'exploitation
11Rapport entre (bénéfice/perte calculés plus intérêts sur le capital propre) et capital propre de l'exploitation
12Rapport entre (revenu agricole moins intérêts sur le capital propre) et unités de travail annuel de la famille (UTAF)
*Nouvelle typologie de la FAT «FAT99» (cf.annexe:«Définitions et méthodes»)Source:dépouillement centralisé,FAT
A20 ANNEXE
ProductionvégétaleElevage MoyenneLait CaractéristiqueUnitédetoutesGrandesCulturescommer-VachesAutres lesexpl.culturesspécialescialisémèresbovins Exploitations de référenceNombre2 955 113 70 1 210 67 142 Exploitations représentéesNombre52 596 3 312 3 185 18 943 1 733 3 761 Structured'exploitation Surface agricole utileha19.09 24.23 12.57 18.65 17.27 15.90 Terres ouvertesha5.20 19.86 5.85 0.97 0.80 0.24 Main-d'oeuvre de l'exploitationUTA1.68 1.43 2.34 1.63 1.25 1.40 dont main-d'oeuvre familialeUTAF1.29 1.10 1.36 1.34 1.10 1.27 Vaches,totalNombre13.8 3.2 1.6 16.6 15.5 9.4 Animaux,totalUGB24.3 7.9 2.9 25.1 20.4 16.7 Structureducapital Actifs totauxfr.727 756 759 135 805 793 662 697 665 630 532 474 dont:actifs circulantsfr.139 412 164 460 252 598 116 390 117 972 95 804 dont:actif bétailfr.44 554 16 287 7 621 45 731 42 240 35 468 dont:immobilisationsfr.543 790 578 388 545 573 500 575 505 417 401 201 dont:actifs de l'exploitationfr.678 557 717 511 739 310 620 509 634 732 500 349 Part de capitaux étrangers%41 37 30 42 40 41 Intérêt calculé du capital propre de l'exploitation 1 fr.13 797 15 526 17 751 12 362 13 230 10 141 Compted'exploitation Rendement brut totalfr.195 494 222 787 245 842 161 783 126 275 113 967 dont:paiements directsfr.42 700 44 617 23 398 43 099 56 953 53 745 Charges matériellesfr.113 304 124 007 119 990 91 645 72 121 69 440 Revenu de l'exploitationfr.82 190 98 780 125 852 70 138 54 154 44 527 Frais de main-d'oeuvrefr.12 042 11 400 38 643 7 729 4 295 3 166 Service de la dettefr.8 301 8 727 7 218 7 529 7 100 5 645 Fermagesfr.5 643 9 160 6 829 4 688 2 948 2 051 Charges réellesfr.139 291 153 295 172 680 111 591 86 464 80 302 Revenu agricolefr.56 203 69 492 73 163 50 192 39 811 33 665 Revenu accessoirefr.18 806 22 200 14 907 18 215 31 247 21 325 Revenu totalfr.75 009 91 693 88 070 68 406 71 058 54 990 Consommation de la famillefr.63 222 76 010 78 542 57 654 58 142 50 596 Formation de capital proprefr.11 787 15 682 9 528 10 753 12 916 4 394 Investissementsetfinancement Total des investissements 2 fr.45 376 42 267 33 124 41 600 41 601 30 569 Cash flow 3 fr.42 203 49 885 39 576 37 966 39 339 25 892 Rapport entre cash flow et investissements 4 %93 123 121 91 94 84 Exploitations avec excédent de financement 5 %64 64 68 65 69 60 Stabilitéfinancière Exploitations en situation financière saine 6 %45 45 40 45 56 38 Exploitations avec faible autonomie financière 7 %20 18 15 22 18 21 Exploitations avec faible revenu 8 %19 21 30 18 15 23 Exploitations en situation financière précaire 9 %16 16 15 15 11 18 Relationrevenudel'exploitation/facteursutilisés Revenu de l'exploitation par main-d'oeuvrefr./UTA49 034 68 886 53 546 43 143 43 344 31 759 Revenu de l'exploitation par ha surface agricole utilefr./ha4 310 4 078 9 997 3 764 3 134 2 806 Relation revenu de l'exploitation/actifs de l'exploitation%12.1 13.8 17.0 11.3 8.5 8.9 Rentabilité Rentabilité du capital total 10 %-2.1 0.9 -1.0 -3.4 -2.6 -6.4 Rentabilité du capital propre 11 %-5.7 -0.6 -2.9 -8.1 -6.3 -13.1 Revenudutravaildelamain-d'oeuvrefamiliale12fr./UTAF329064902640617282312412018432 (moyenne)
Tableau 21b
Résultats d'exploitation selon les types d'exploitations* – 2000/02
1Taux d'intérêt moyen des obligations de la Confédération (2000:3.95%;2001:3.36%;2002:3.22%)
2Investissements bruts (sans prestations propres),déduction faite des subventions et des désinvestissements
3Formation de capital propre (sans prestations propres),plus amortissements,plus/moins changements stocks et actif bétail
4Rapport entre cash flow et total des investissements
5Part d'exploitations avec cash flow > total des investissements
6Part de capitaux étrangers <50% et formation de capital propre positive
7Part de capitaux étrangers >50% et formation de capital propre positive
8Part de capitaux étrangers <50% et formation de capital propre négative
9Part de capitaux étrangers >50% et formation de capital propre négative
10Rapport entre (service de la dette plus bénéfice/perte calculés plus intérêts sur le capital propre) et actifs de l'exploitation
11Rapport entre (bénéfice/perte calculés plus intérêts sur le capital propre) et capital propre de l'exploitation
12Rapport entre (revenu agricole moins intérêts sur le capital propre) et unités de travail annuel de la famille (UTAF)
*Nouvelle typologie de la FAT «FAT99» (cf.annexe:«Définitions et méthodes»)Source:dépouillement centralisé,FAT
ANNEXE A21
ElevageExploitationscombinées MoyennesChevaux,Grandes CaractéristiqueUnitédetoutesovins,Trans-cultures+VachesTranslesexpl.caprinsformationlaitmèresformationAutres Exploitations de référenceNombre2 955 28 52 364 25 547 338 Exploitations représentéesNombre52 596 1 262 1 191 5 469 482 6 022 7 235 Structured'exploitation Surface agricole utileha19.09 13.64 11.30 24.94 21.79 19.39 20.29 Terres ouvertesha5.20 0.47 1.14 13.30 9.48 6.80 6.65 Main-d'oeuvre de l'exploitationUTA1.68 1.33 1.51 1.90 1.47 1.80 1.70 dont main-d'oeuvre familialeUTAF1.29 1.20 1.15 1.33 1.16 1.29 1.27 Vaches,totalNombre13.8 1.8 11.5 19.3 17.4 15.7 14.9 Animaux,totalUGB24.3 12.0 46.1 29.3 24.7 38.9 26.8 Structureducapital Actifs totauxfr.727 756 456 832 869 766 850 591 797 723 878 441 767 270 dont:actifs circulantsfr.139 412 72 465 117 499 173 614 160 843 153 857 142 118 dont:actif bétailfr.44 554 22 326 63 953 53 685 50 353 62 595 54 398 dont:immobilisationsfr.543 790 362 041 688 314 623 292 586 526 661 989 570 754 dont:actifs de l'exploitationfr.678 557 437 215 835 949 790 565 726 662 818 462 701 847 Part de capitaux étrangers%41 40 47 40 44 42 44 Intérêt calculé du capital propre de l'exploitation 1 fr.13 797 9 047 15 337 16 222 14 066 16 377 13 634 Compted'exploitation Rendement brut totalfr.195 494 89 475 290 601 248 565 199 474 274 750 205 029 dont:paiements directsfr.42 700 42 238 28 595 44 300 63 134 39 927 42 498 Charges matériellesfr.113 304 57 872 200 400 142 052 112 795 172 301 119 793 Revenu de l'exploitationfr.82 190 31 603 90 201 106 514 86 679 102 449 85 236 Frais de main-d'oeuvrefr.12 042 2 744 11 198 17 256 10 713 16 007 13 019 Service de la dettefr.8 301 5 720 12 599 9 552 9 137 10 309 9 360 Fermagesfr.5 643 1 371 2 395 9 302 9 125 6 380 6 198 Charges réellesfr.139 291 67 708 226 592 178 160 141 770 204 997 148 371 Revenu agricolefr.56 203 21 767 64 009 70 405 57 703 69 752 56 658 Revenu accessoirefr.18 806 29 559 17 090 14 369 26 966 15 977 19 538 Revenu totalfr.75 009 51 326 81 099 84 774 84 669 85 730 76 197 Consommation de la famillefr.63 222 49 689 65 844 68 826 68 363 68 993 65 641 Formation de capital proprefr.11 787 1 637 15 255 15 948 16 307 16 737 10 556 Investissementsetfinancement Total des investissements 2 fr.45 376 32 958 50 807 61 563 52 223 61 993 45 009 Cash flow 3 fr.42 203 24 226 55 553 52 591 47 123 54 408 42 509 Rapport entre cash flow et investissements 4 %93 79 180 86 99 89 98 Exploitations avec excédent de financement 5 %64 58 66 64 67 63 64 Stabilitéfinancière Exploitations en situation financière saine 6 %45 43 39 49 48 47 43 Exploitations avec faible autonomie financière 7 %20 14 20 19 18 19 20 Exploitations avec faible revenu 8 %19 16 17 17 14 17 18 Exploitations en situation financière précaire 9 %16 27 23 15 21 16 19 Relationrevenudel'exploitation/facteursutilisés Revenu de l'exploitation par main-d'oeuvrefr./UTA49 034 23 426 59 878 55 942 58 814 57 020 50 058 Revenu de l'exploitation par ha surface agricole utilefr./ha4 310 2 296 7 988 4 277 3 973 5 286 4 211 Relation revenu de l'exploitation/actifs de l'exploitation%12.1 7.2 10.8 13.5 12.2 12.5 12.2 Rentabilité Rentabilité du capital total 10 %-2.1 -9.4 0.7 -0.8 -1.1 -0.1 -1.9 Rentabilité du capital propre 11 %-5.7 -18.1 -1.5 -3.4 -4.3 -2.4 -5.9 Revenudutravaildelamain-d'oeuvrefamiliale12fr./UTAF32906102674242840656372824124433830 (moyenne)
Tableau 22
Résultats d'exploitation par quartile:toutes les régions – 2000/02
(moyenne)
Revenudutravaildelamain-d'oeuvrefamiliale12fr./UTAF29752 (médiane)
1Taux d'intérêt moyen des obligations de la Confédération (2000:3.95%;2001:3.36%;2002:3.22%)
2Investissements bruts (sans prestations propres),déduction faite des subventions et des désinvestissements
3Formation de capital propre (sans prestations propres),plus amortissements,plus/moins changements stocks et actif bétail
4Rapport entre cash flow et total des investissements
5Part d'exploitations avec cash flow > total des investissements
6Part de capitaux étrangers <50% et formation de capital propre positive
7Part de capitaux étrangers >50% et formation de capital propre positive
8Part de capitaux étrangers <50% et formation de capital propre négative
9Part de capitaux étrangers >50% et formation de capital propre négative
10Rapport entre (service de la dette plus bénéfice/perte calculés plus intérêts sur le capital propre) et actifs de l'exploitation
11Rapport entre (bénéfice/perte calculés plus intérêts sur le capital propre) et capital propre de l'exploitation
12Rapport entre (revenu agricole moins intérêts sur le capital propre) et unités de travail annuel de la famille (UTAF)Source:dépouillement centralisé,FAT
A22 ANNEXE
ventiléesselonlerevenudutravail CaractéristiqueUnitéMoyenne1erquartile2equartile3equartile4equartile (0–25%)(25–50%)(50–75%)(75–100%) Exploitations de référenceNombre2 955 628 748 786 793 Exploitations représentéesNombre52 596 13 158 13 146 13 148 13 144 Structured'exploitation Surface agricole utileha19.09 14.41 17.05 19.82 25.08 Terres ouvertesha5.20 2.67 3.18 5.41 9.52 Main-d'oeuvre de l'exploitationUTA1.68 1.56 1.67 1.68 1.80 dont main-d'oeuvre familialeUTAF1.29 1.26 1.36 1.33 1.20 Vaches,totalNombre13.8 10.6 13.4 14.7 16.4 Animaux,totalUGB24.3 18.8 22.6 25.2 30.8 Structureducapital Actifs totauxfr.727 756 662 245 651 521 737 425 859 923 dont:actifs circulantsfr.139 412 108 311 116 129 153 712 179 534 dont:actif bétailfr.44 554 35 430 41 624 46 109 55 062 dont:immobilisationsfr.543 790 518 504 493 767 537 604 625 327 dont:actifs de l'exploitationfr.678 557 624 962 609 805 678 978 800 555 Part de capitaux étrangers%41 41 42 40 42 Intérêt calculé du capital propre de l'exploitation 1 fr.13 797 12 775 12 224 14 131 16 061 Compted'exploitation Rendement brut totalfr.195 494 132 021 163 383 202 495 284 151 dont:paiements directsfr.42 700 36 830 40 866 42 675 50 434 Charges matériellesfr.113 304 93 311 98 812 113 515 147 603 Revenu de l'exploitationfr.82 190 38 711 64 571 88 980 136 548 Frais de main-d'oeuvrefr.12 042 8 815 9 046 11 082 19 231 Service de la dettefr.8 301 7 933 7 575 7 894 9 804 Fermagesfr.5 643 2 997 4 110 6 065 9 405 Charges réellesfr.139 291 113 055 119 543 138 557 186 043 Revenu agricolefr.56 203 18 967 43 840 63 938 98 108 Revenu accessoirefr.18 806 28 621 18 171 15 535 12 888 Revenu totalfr.75 009 47 588 62 011 79 473 110 996 Consommation de la famillefr.63 222 53 107 57 742 66 314 75 738 Formation de capital proprefr.11 787 -5 519 4 269 13 159 35 258 Investissementsetfinancement Total des investissements 2 fr.45 376 39 960 38 244 42 530 60 777 Cash flow 3 fr.42 203 24 139 32 090 42 897 69 706 Rapport entre cash flow et investissements 4 %93 61 84 102 115 Exploitations avec excédent de financement 5 %64 53 63 68 73 Stabilitéfinancière Exploitations en situation financière saine 6 %45 29 41 52 57 Exploitations avec faible autonomie financière 7 %20 12 18 21 29 Exploitations avec faible revenu 8 %19 33 21 15 7 Exploitations en situation financière précaire 9 %16 26 20 13 7 Relationrevenudel'exploitation/facteursutilisés Revenu de l'exploitation par main-d'oeuvrefr./UTA49 034 24 875 38 786 52 789 75 913 Revenu de l'exploitation par ha surface agricole utilefr./ha4 310 2 697 3 788 4 493 5 452 Relation revenu de l'exploitation/actifs de l'exploitation%12.1 6.2 10.6 13.1 17.1 Rentabilité Rentabilité du capital total 10 %-2.1 -7.6 -5.0 -1.5 4.0 Rentabilité du capital propre 11 %-5.7 -15.2 -10.9 -4.5 4.8 Revenudutravaildelamain-d'oeuvrefamiliale12fr./UTAF329064883231603751268236
Tableau 23
Résultats d'exploitation par quartile:région de plaine* – 2000/02
(moyenne)
Revenudutravaildelamain-d'oeuvrefamiliale12fr./UTAF38365 (médiane)
1Taux d'intérêt moyen des obligations de la Confédération (2000:3.95%;2001:3.36%;2002:3.22%)
2Investissements bruts (sans prestations propres),déduction faite des subventions et des désinvestissements
3Formation de capital propre (sans prestations propres),plus amortissements,plus/moins changements stocks et actif bétail
4Rapport entre cash flow et total des investissements
5Part d'exploitations avec cash flow > total des investissements
6Part de capitaux étrangers <50% et formation de capital propre positive
7Part de capitaux étrangers >50% et formation de capital propre positive
8Part de capitaux étrangers <50% et formation de capital propre négative
9Part de capitaux étrangers >50% et formation de capital propre négative
10Rapport entre (service de la dette plus bénéfice/perte calculés plus intérêts sur le capital propre) et actifs de l'exploitation
11Rapport entre (bénéfice/perte calculés plus intérêts sur le capital propre) et capital propre de l'exploitation
12Rapport entre (revenu agricole moins intérêts sur le capital propre) et unités de travail annuel de la famille (UTAF)
*Région de plaine:zone de grandes cultures et zones intermédiairesSource:dépouillement centralisé,FAT
ANNEXE A23
ventiléesselonlerevenudutravail CaractéristiqueUnitéMoyenne1erquartile2equartile3equartile4equartile (0–25%)(25–50%)(50–75%)(75–100%) Exploitations de référenceNombre1 300 296 330 339 334 Exploitations représentéesNombre24 116 6 034 6 053 6 016 6 014 Structured'exploitation Surface agricole utileha20.01 15.89 17.59 20.75 25.84 Terres ouvertesha9.40 6.85 7.82 9.17 13.79 Main-d'oeuvre de l'exploitationUTA1.78 1.69 1.75 1.80 1.90 dont main-d'oeuvre familialeUTAF1.25 1.21 1.34 1.29 1.17 Vaches,totalNombre13.6 11.3 13.1 15.2 15.0 Animaux,totalUGB24.4 20.4 22.2 26.0 29.0 Structureducapital Actifs totauxfr.833 276 819 371 749 598 837 428 927 165 dont:actifs circulantsfr.173 511 144 719 160 222 180 974 208 233 dont:actif bétailfr.45 056 38 966 41 327 47 357 52 617 dont:immobilisationsfr.614 709 635 686 548 049 609 097 666 315 dont:actifs de l'exploitationfr.772 248 767 962 685 213 773 291 863 091 Part de capitaux étrangers%40 41 40 38 41 Intérêt calculé du capital propre de l'exploitation 1 fr.15 945 15 759 14 029 16 420 17 580 Compted'exploitation Rendement brut totalfr.239 216 182 334 204 851 243 470 326 626 dont:paiements directsfr.37 378 30 160 32 487 38 576 48 348 Charges matériellesfr.136 194 123 683 120 571 134 200 166 466 Revenu de l'exploitationfr.103 022 58 651 84 280 109 270 160 159 Frais de main-d'oeuvrefr.17 826 16 513 13 766 16 047 25 018 Service de la dettefr.9 678 10 439 8 441 8 945 10 894 Fermagesfr.7 654 4 577 6 258 8 331 11 471 Charges réellesfr.171 351 155 212 149 036 167 523 213 849 Revenu agricolefr.67 865 27 122 55 815 75 947 112 777 Revenu accessoirefr.17 197 25 891 16 294 14 845 11 729 Revenu totalfr.85 061 53 013 72 109 90 792 124 506 Consommation de la famillefr.70 916 62 218 66 562 71 940 82 986 Formation de capital proprefr.14 145 -9 204 5 547 18 852 41 520 Investissementsetfinancement Total des investissements 2 fr.51 877 47 852 41 877 58 392 59 446 Cash flow 3 fr.48 751 26 590 37 150 52 731 78 674 Rapport entre cash flow et investissements 4 %94 57 89 90 132 Exploitations avec excédent de financement 5 %65 52 65 67 75 Stabilitéfinancière Exploitations en situation financière saine 6 %46 27 42 56 58 Exploitations avec faible autonomie financière 7 %18 9 16 21 28 Exploitations avec faible revenu 8 %20 35 22 14 8 Exploitations en situation financière précaire 9 %16 29 20 9 7 Relationrevenudel'exploitation/facteursutilisés Revenu de l'exploitation par main-d'oeuvrefr./UTA57 721 34 788 48 275 60 696 84 010 Revenu de l'exploitation par ha surface agricole utilefr./ha5 159 3 696 4 811 5 266 6 221 Relation revenu de l'exploitation/actifs de l'exploitation%13.4 7.7 12.3 14.2 18.6 Rentabilité Rentabilité du capital total 10 %-0.6 -5.4 -3.4 0.0 5.4 Rentabilité du capital propre 11 %-3.1 -11.6 -8.0 -1.8 7.2 Revenudutravaildelamain-d'oeuvrefamiliale12fr./UTAF413919354312064607381115
Résultats d'exploitation par quartile:région des collines* – 2000/02
(moyenne)
Revenudutravaildelamain-d'oeuvrefamiliale12fr./UTAF28530 (médiane)
1Taux d'intérêt moyen des obligations de la Confédération (2000:3.95%;2001:3.36%;2002:3.22%)
2Investissements bruts (sans prestations propres),déduction faite des subventions et des désinvestissements
3Formation de capital propre (sans prestations propres),plus amortissements,plus/moins changements stocks et actif bétail
4Rapport entre cash flow et total des investissements
5Part d'exploitations avec cash flow > total des investissements
6Part de capitaux étrangers <50% et formation de capital propre positive
7Part de capitaux étrangers >50% et formation de capital propre positive
8Part de capitaux étrangers <50% et formation de capital propre négative
9Part de capitaux étrangers >50% et formation de capital propre négative
10Rapport entre (service de la dette plus bénéfice/perte calculés plus intérêts sur le capital propre) et actifs de l'exploitation
11Rapport entre (bénéfice/perte calculés plus intérêts sur le capital propre) et capital propre de l'exploitation
12Rapport entre (revenu agricole moins intérêts sur le capital propre) et unités de travail annuel de la famille (UTAF)
*Région des collines:zone des collines et zone de montagne ISource:dépouillement centralisé,FAT
A24 ANNEXE
Tableau 24
ventiléesselonlerevenudutravail CaractéristiqueUnitéMoyenne1erquartile2equartile3equartile4equartile (0–25%)(25–50%)(50–75%)(75–100%) Exploitations de référenceNombre874 168 217 238 252 Exploitations représentéesNombre14 292 3 586 3 576 3 563 3 566 Structured'exploitation Surface agricole utileha17.96 13.11 15.99 18.69 24.06 Terres ouvertesha3.01 1.79 2.30 3.24 4.73 Main-d'oeuvre de l'exploitationUTA1.58 1.46 1.58 1.59 1.71 dont main-d'oeuvre familialeUTAF1.26 1.20 1.33 1.30 1.22 Vaches,totalNombre15.7 12.2 14.9 16.5 19.1 Animaux,totalUGB27.5 20.4 25.2 28.1 36.5 Structureducapital Actifs totauxfr.682 949 623 268 643 750 676 437 788 666 dont:actifs circulantsfr.118 324 98 733 104 037 120 228 150 364 dont:actif bétailfr.49 221 37 578 45 440 50 476 63 453 dont:immobilisationsfr.515 404 486 958 494 273 505 733 574 849 dont:actifs de l'exploitationfr.635 008 582 612 599 856 620 126 737 708 Part de capitaux étrangers%44 45 43 44 45 Intérêt calculé du capital propre de l'exploitation 1 fr.12 207 11 073 11 719 12 073 13 968 Compted'exploitation Rendement brut totalfr.180 517 125 060 159 474 182 764 255 133 dont:paiements directsfr.41 567 32 721 37 354 42 687 53 566 Charges matériellesfr.107 384 90 280 99 358 103 457 136 556 Revenu de l'exploitationfr.73 133 34 780 60 116 79 307 118 577 Frais de main-d'oeuvrefr.9 095 7 189 7 069 8 090 14 047 Service de la dettefr.8 213 7 897 7 727 7 871 9 361 Fermagesfr.4 999 2 950 3 696 5 789 7 575 Charges réellesfr.129 691 108 316 117 850 125 208 167 539 Revenu agricolefr.50 826 16 744 41 624 57 556 87 594 Revenu accessoirefr.20 580 34 657 19 298 14 558 13 727 Revenu totalfr.71 406 51 401 60 922 72 114 101 321 Consommation de la famillefr.60 504 53 427 57 079 61 050 70 515 Formation de capital proprefr.10 901 -2 026 3 843 11 064 30 806 Investissementsetfinancement Total des investissements 2 fr.42 487 40 998 35 980 39 825 53 151 Cash flow 3 fr.40 021 27 195 31 403 38 348 63 224 Rapport entre cash flow et investissements 4 %95 67 88 98 120 Exploitations avec excédent de financement 5 %65 56 63 67 73 Stabilitéfinancière Exploitations en situation financière saine 6 %43 32 40 48 53 Exploitations avec faible autonomie financière 7 %23 15 19 25 34 Exploitations avec faible revenu 8 %16 26 22 13 4 Exploitations en situation financière précaire 9 %17 28 18 14 9 Relationrevenudel'exploitation/facteursutilisés Revenu de l'exploitation par main-d'oeuvrefr./UTA46 119 23 784 37 880 49 986 69 432 Revenu de l'exploitation par ha surface agricole utilefr./ha4 075 2 683 3 758 4 241 4 926 Relation revenu de l'exploitation/actifs de l'exploitation%11.5 6.0 10.0 12.8 16.1 Rentabilité Rentabilité du capital total 10 %-2.6 -8.1 -5.1 -2.0 3.2 Rentabilité du capital propre 11 %-7.1 -17.4 -11.4 -5.9 3.5 Revenudutravaildelamain-d'oeuvrefamiliale12fr./UTAF305374678224043497760302
Tableau 25
Résultats d'exploitation par quartile:région de montagne* – 2000/02
(moyenne)
Revenudutravaildelamain-d'oeuvrefamiliale12fr./UTAF19909 (médiane)
1Taux d'intérêt moyen des obligations de la Confédération (2000:3.95%;2001:3.36%;2002:3.22%)
2Investissements bruts (sans prestations propres),déduction faite des subventions et des désinvestissements
3Formation de capital propre (sans prestations propres),plus amortissements,plus/moins changements stocks et actif bétail
4Rapport entre cash flow et total des investissements
5Part d'exploitations avec cash flow > total des investissements
6Part de capitaux étrangers <50% et formation de capital propre positive
7Part de capitaux étrangers >50% et formation de capital propre positive
8Part de capitaux étrangers <50% et formation de capital propre négative
9Part de capitaux étrangers >50% et formation de capital propre négative
10Rapport entre (service de la dette plus bénéfice/perte calculés plus intérêts sur le capital propre) et actifs de l'exploitation
11Rapport entre (bénéfice/perte calculés plus intérêts sur le capital propre) et capital propre de l'exploitation
12Rapport entre (revenu agricole moins intérêts sur le capital propre) et unités de travail annuel de la famille (UTAF)
*Région de montagne:zones de montagne II à IV
Source:dépouillement centralisé,FAT
ANNEXE A25
ventiléesselonlerevenudutravail CaractéristiqueUnitéMoyenne1erquartile2equartile3equartile4equartile (0–25%)(25–50%)(50–75%)(75–100%) Exploitations de référenceNombre781 168 182 213 219 Exploitations représentéesNombre14 187 3 557 3 562 3 534 3 534 Structured'exploitation Surface agricole utileha18.68 13.70 15.84 19.27 25.95 Terres ouvertesha0.26 0.10 0.16 0.36 0.42 Main-d'oeuvre de l'exploitationUTA1.58 1.54 1.63 1.59 1.56 dont main-d'oeuvre familialeUTAF1.37 1.31 1.48 1.40 1.29 Vaches,totalNombre12.0 9.3 10.7 12.7 15.5 Animaux,totalUGB21.0 16.4 18.6 22.2 26.9 Structureducapital Actifs totauxfr.594 017 562 784 545 704 581 510 686 568 dont:actifs circulantsfr.102 662 75 100 96 509 104 469 134 781 dont:actif bétailfr.39 028 30 775 34 756 41 199 49 468 dont:immobilisationsfr.452 328 456 909 414 439 435 842 502 320 dont:actifs de l'exploitationfr.563 737 540 851 519 025 552 528 642 964 Part de capitaux étrangers%40 40 37 41 41 Intérêt calculé du capital propre de l'exploitation 1 fr.11 749 11 250 11 302 11 289 13 158 Compted'exploitation Rendement brut totalfr.136 443 101 263 117 286 142 275 185 322 dont:paiements directsfr.52 913 42 117 48 293 55 454 65 883 Charges matériellesfr.80 528 74 034 72 034 81 648 94 507 Revenu de l'exploitationfr.55 915 27 229 45 253 60 627 90 815 Frais de main-d'oeuvrefr.5 185 5 337 3 549 4 590 7 277 Service de la dettefr.6 063 6 494 5 034 6 020 6 710 Fermagesfr.2 878 2 179 2 051 3 115 4 178 Charges réellesfr.94 654 88 043 82 667 95 372 112 672 Revenu agricolefr.41 789 13 219 34 619 46 903 72 650 Revenu accessoirefr.19 725 28 175 17 336 17 032 16 322 Revenu totalfr.61 514 41 395 51 955 63 935 88 972 Consommation de la famillefr.52 925 44 964 50 290 53 958 62 555 Formation de capital proprefr.8 589 -3 569 1 665 9 977 26 416 Investissementsetfinancement Total des investissements 2 fr.37 235 30 638 33 236 37 713 47 428 Cash flow 3 fr.33 246 21 768 24 481 34 470 52 408 Rapport entre cash flow et investissements 4 %89 72 74 92 111 Exploitations avec excédent de financement 5 %63 56 59 68 72 Stabilitéfinancière Exploitations en situation financière saine 6 %45 29 38 52 60 Exploitations avec faible autonomie financière 7 %19 11 16 23 28 Exploitations avec faible revenu 8 %20 32 29 11 6 Exploitations en situation financière précaire 9 %16 27 17 14 6 Relationrevenudel'exploitation/facteursutilisés Revenu de l'exploitation par main-d'oeuvrefr./UTA35 316 17 578 27 698 38 126 58 215 Revenu de l'exploitation par ha surface agricole utilefr./ha2 994 1 981 2 861 3 151 3 497 Relation revenu de l'exploitation/actifs de l'exploitation%9.9 5.0 8.7 11.0 14.1 Rentabilité Rentabilité du capital total 10 %-4.9 -9.8 -8.0 -4.4 1.3 Rentabilité du capital propre 11 %-10.0 -18.6 -14.4 -9.3 0.5 Revenudutravaildelamain-d'oeuvrefamiliale12fr./UTAF218961447157742539146205
Résultats des exploitations selon la région,le type d'exploitation et le quartile:1990/92–2000/02
UnitéExploitationsExploitationsExploitationsAutres combinées:combinées:combinées:exploitations grandescultures+laitvaches-mèrestransformationcombinées
UnitéIquartileIIquartileIIIquartileIVquartile (0–25%)(25–50%)(50–75%)(75–100%)
A26 ANNEXE
Tableau 26
UnitéTouteslesRégiondeplaineRégiondescollinesRégiondemontagne
Revenuselonlarégion1990/922000/021990/922000/021990/922000/021990/922000/02 Surface agricole utileha16.06 19.09 16.66 20.01 15.30 17.96 15.76 18.68 Main-d'oeuvre familialeUTAF1.39 1.29 1.36 1.25 1.40 1.26 1.42 1.37 Revenu agricolefr.62 822 56 203 73 794 67 865 59 838 50 826 45 541 41 789 Revenu accessoirefr.16 264 18 806 16 429 17 197 14 544 20 580 17 853 19 725 Revenu totalfr.79 086 75 009 90 223 85 061 74 382 71 406 63 394 61 514 Revenudutravailparunitéde main-d'oeuvredelafamillefr./UTAF3102532906369244139130335305372120121896 UnitéGrandesculturesCulturesspécialesLaitcommercialiséVaches-mères Revenuselonletyped'exploitation1990/922000/021990/922000/021990/922000/021990/922000/02 Surface agricole utileha21.23 24.23 8.92 12.57 15.30 18.65 15.32 17.27 Main-d'oeuvre familialeUTAF1.08 1.10 1.29 1.36 1.42 1.34 1.20 1.10 Revenu agricolefr.60 284 69 492 67 184 73 163 53 923 50 192 36 627 39 811 Revenu accessoirefr.26 928 22 200 21 555 14 907 16 044 18 215 33 558 31 247 Revenu totalfr.87 212 91 693 88 739 88 070 69 967 68 406 70 185 71 058 Revenudutravailparunitéde main-d'oeuvredelafamillefr./UTAF3437549026303344061726471282311734824120 UnitéAutreChevaux/moutons/Transformation bétailbovinchèvres Revenuselonletyped'exploitation1990/922000/021990/922000/021990/922000/02 Surface agricole utileha14.20 15.90 Seules sept13.64 9.34 11.30 Main-d'oeuvre familialeUTAF1.37 1.27 exploitations1.20 1.35 1.15 Revenu agricolefr.38 407 33 665 disponibles21 767 86 288 64 009 Revenu accessoirefr.20 570 21 325 29 559 14 614 17 090 Revenu totalfr.58 977 54 990 51 326 100 902 81 099 Revenudutravailparunitéde main-d'oeuvredelafamillefr./UTAF1679318432102674818242428
exploitations
Revenuselonletyped'exploitation1990/922000/021990/922000/021990/922000/021990/922000/02 Surface agricole utileha20.37 24.94 17.93 21.79 15.59 19.39 17.24 20.29 Main-d'oeuvre familialeUTAF1.45 1.33 1.24 1.16 1.40 1.29 1.43 1.27 Revenu agricolefr.75 368 70 405 51 161 57 703 84 363 69 752 66 705 56 658 Revenu accessoirefr.11 802 14 369 20 475 26 966 12 032 15 977 15 000 19 538 Revenu totalfr.87 170 84 774 71 636 84 669 96 395 85 730 81 705 76 197 Revenudutravailparunitéde main-d'oeuvredelafamillefr./UTAF3642040656274563728242927412443273233830
Revenuselonlequartile(revenudutravail)1990/922000/021990/922000/021990/922000/021990/922000/02 Surface agricole utileha14.68 14.41 15.30 17.05 15.78 19.82 18.47 25.08 Main-d'oeuvre familialeUTAF1.36 1.26 1.49 1.36 1.42 1.33 1.27 1.20 Revenu agricolefr.26 883 18 967 52 294 43 840 69 198 63 938 102 975 98 108 Revenu accessoirefr.27 789 28 621 14 629 18 171 12 064 15 535 10 557 12 888 Revenu totalfr.54 672 47 588 66 923 62 011 81 262 79 473 113 532 110 996 Revenudutravailparunitéde main-d'oeuvredelafamillefr./UTAF43674883235922316036016375126266568236 Source:dépouillement centralisé,FAT
■■■■■■■■■■■■■■■■ Tableaux Dépenses de la Confédération
Dépenses Production et ventes
ANNEXE A27
Tableau 27 Promotion des ventes:fonds attribués Secteurs/domaineproduit-marchéComptes2001Comptes20022Fondsattribués2003 fr.fr.fr. Productionlaitière405592783368202439866830 Fromage,étranger26 879 40119 825 65224 534 790 Fromage,Suisse4 795 7923 705 3725 481 040 Lait8 884 08510 151 0009 851 000 Productionanimale308734329312455069962 Viande2 202 3431 796 0003 770 125 Œufs650 000626 000650 000 Poissons7 00016 5008 250 Animaux vivants228 000472 745641 587 Miel 020 0000 Productionvégétale595686967518338396594 Légumes1 684 7461 692 7472 690 107 Fruits1 901 9842 381 7112 703 987 Céréales753 373885 503695 000 Pommes de terre750 000705 0001 127 500 Oléagineux224 820286 872380 000 Plantes ornementales641 946800 000800 000 Mesuresprisesencommun435523751371466981357 Mesuressuprasectorielles(bio,PI)171253721735423125187 Réservé pour le décompte final et les engagements à long terme1 564 4954 826 324 National572357595550211463439'930 Régional1274648332963623000000 Total599822425879847666439930 1 Budget,planification continue 2 après décompte provisoire Source:OFAG
Tableau 28
Dépenses en économie laitière
fonds extraordinaires
152,9 mio.de fr.que la Confédération a engagés pour diverses mesures pendant les turbulences sur le marché laitier.
A28 ANNEXE
DésignationComptes2001Comptes20021Budget20032 fr.fr.fr. Soutiendumarché(supplémentsetaides) Supplément pour le lait transformé en fromage331 835 957318 644 295307 959 000 Supplément de non-ensilage48 713 85244 808 18042 200 000 Aides pour le beurre accordées dans le pays104 277 84692 936 17689 800 000 Aides pour le lait écrémé et la poudre de lait accordées dans le pays59 106 42259 235 68354 400 000 Aides pour le fromage accordées dans le pays10 755 3151 404 7840 Aides à l'exportation de fromage94 833 53145 264 64827 300 000 Aides à l'exportation d'autres produits laitiers9 927 07731 356 23131 200 000 659450000593649997552859000 Soutiendumarché(administration) Commissions de recours «Contingentement laitier»53 88066 05280 000 Administration de la mise en valeur du lait et du contingentement laitier6 644 8816 933 5157 040 000 669876169995677120000 Total666148761600649564559979000 1 viennent s'y ajouter les
2 blocage des crédits
Sources:Compte d’Etat,OFAG
de
pris en compte
Tableau 29
Dépenses en économie animale
ANNEXE A29
DésignationComptes2001Comptes2002Budget20031 fr.fr.fr. Fonds«viande» Indemnités versées à des organisations privées du bétail de boucherie et de la viande7 365 6567 596 262 Achat de viande de bœuf destinée à l'aide humanitaire16 612 751177 802 Contributions au stockage de viande de veau4 355 8603 963 567 Contributions au stockage de viande de bœuf provenant d'animaux d'étal (taureaux,génisses,bœufs)6 710 1401 734 769 Contributions au stockage de viande de bœuf provenant d'animaux destinés à la transformation (vaches)358 40820 911 Contributions destinées à réduire le prix des cuisses de bœuf3 212 903256 173 Campagne d'information sur le bœuf suisse649 6740 392653921374948415764000 Caissedecompensationdesprixdesœufsetdesproduitsàbased'œufs Contributions de reconversion pour les élevages particulièrement respectueux des pondeuses1 369 312342 398 Contributions aux frais de ramassage et de calibrage3 265 103378 880 Actions de cassage d'œufs du pays667 5091 671 524 Campagnes de vente à prix réduits425 298627 618 Essais pratiques sur la volaille255 702319 314 Contributions d'investissement pour la construction de poulaillers0247 964 5982924358769810395000 Contributionsàl'exportationdebétaild'élevageetderente321650220000016830000 Contributionsàlamiseenvaleurdelalainedemouton8000008000005940000 Total463699662033718243583000 1 blocage des crédits pris en compte Sources:Compte d’Etat,OFAG
Tableau 30
Dépenses pour la production végétale
A30 ANNEXE
DésignationComptes2001Comptes2002Budget20032 fr.fr.fr. Contributionsàlaculturedeschamps317821393902251544550000 Contributions à la surface pour oléagineux27 156 01532 176 19236 887 400 Contributions à la surface pour légumineuses à graines3 954 9226 378 0517 177 500 Contributions à la surface pour plantes à fibres489 234468 272485 100 Primes de culture pour céréales fourragères181 96800 Contributionsàlatransformationetàlamiseenvaleur917199669458199696030000 Transformation de betteraves sucrières45 000 00045 000 00044 550 000 Transformation d'oléagineux4 284 4808 509 0008 415 000 Transformation de pommes de terre18 972 00018 972 11718 810 000 Production de semences3 812 6603 867 5843 861 000 Mise en valeurs de fruits19 075 05318 217 44519 131 750 Transformation de matières premières renouvelables575 77315 8501 262 250 Promotiondusecteurviti-vinicole55375271229657312160908 Dépenses d'équipement82 36483 02482 908 Promotion de la viticulture1 098 612869 2251 089 000 Mesures de valorisation 1 4 356 5514 387 81410 989 000 Utilisation non alcoolique des raisins06 956 5100 Total129039632145901084152740908 1 Promotion de la vente de vins à l'étranger 2 blocage des crédits pris en compte Sources:Compte d’Etat,OFAG
Dépenses Paiements directs
n'est pas possible de comparer ces chiffres avec ceux du compte d'Etat.Ceux concernant les paiements directs se réfèrent à toute l'année de contribution, alors que ceux du compte d'Etat correspondent aus dépenses effectuées pendant l'année civile.Les déductions sont celles effectuées sur la base de limites et de sanctions légales et administratives.
ANNEXE A31
Tableau 31 Evolution des paiements directs 1999200020012002 Typedecontribution 1000fr.1000fr.1000fr.1000fr. Paiementsdirectsgénéraux1778807180365819290941994838 Contributions à la surface1 163 0941 186 7701 303 8811 316 183 Contributions pour la garde d'animaux consommant des fourrages grossiers254 624258 505268 272283 221 Contributions pour la garde d'animaux dans des conditions difficiles255 882251 593250 255289 572 Contributions générales pour des terrains en pente95 88296 71496 64395 811 Contributions pour les surfaces viticoles en forte pente et en terrasses9 32510 07610 04310 051 Paiementsdirectsécologiques326520361309412664452448 Contributions écologiques258 788278 981329 886359 387 Contributions à la compensation écologique100 674108 130118 417122 347 Contributions au sens de l'ordonnance sur la qualité écologique (OQE)---8 934 Contributions pour la culture extensive de céréales et de colza (culture extensive)35 13533 39832 52631 938 Prairies extensives aménagées sur des terres assolées gelées (dispositions transitoires limitées à fin 2000)17 65217 150-Contributions pour la culture biologique11 63712 18523 48825 484 Contributions pour la garde d'animaux de rente particulièrement respectueuse de l'espèce93 690108 118155 455170 684 Contributionsd'estivage67571812388052489561 Contributionspourlaprotectiondeseaux161109022543500 Réductions24366225421676321143 Totalpaiementsdirects2080961214242523249952426143 Remarque:Il
Source:OFAG
Tableau 32a
Paiements directs généraux – 2002
ContributionsàlasurfaceContributionspouranimauxconsommantdesfourragesgrossiers
A32 ANNEXE
ExploitationsSurfaceTotalcontributionsExploitationsUGBFGTotalcontributions Nombrehafr.NombreNombrefr. Canton ZH3 62669 30793 255 8301 93615 15213 114 826 BE12 807187 716243 582 8358 90061 41154 603 604 LU5 17077 12897 179 9613 17221 88719 684 629 UR6806 7318 079 9496375 3374 541 853 SZ1 69223 74528 464 7351 49313 69911 704 409 OW7047 8919 479 0376193 9643 502 355 NW4956 0287 238 3794062 4262 089 376 GL4187 1588 588 7914013 6183 173 588 ZG58410 49812 990 5614103 0962 719 929 FR3 30875 31098 319 8452 19617 76215 748 505 SO1 42731 42441 114 7619829 0267 803 345 BL96121 33127 243 7846876 3305 488 571 SH58514 02519 507 6092542 4222 106 353 AR77912 14814 514 2786394 8124 242 202 AI5827 2998 742 9753862 3512 226 059 SG4 36671 32986 772 3873 29127 77923 797 113 GR2 78151 31261 678 9402 66935 48629 120 121 AG3 09557 36878 209 7521 63813 66311 795 391 TG2 72049 13065 357 1719626 4275 320 189 TI91712 73515 440 6507237 2125 535 769 VD4 009105 202143 919 2641 99521 06718 464 223 VS3 77236 44045 903 6782 35518 96813 672 951 NE95433 06038 957 0317418 4717 521 915 GE31410 60014 162 768971 2481 051 471 JU1 10438 90447 477 64395516 08714 192 506 Suisse578501023819131618261438544329702283221253 Zone1 Plaine24 353475 734649 863 60411 01988 54676 714 305 Collines8 180142 595182 018 5205 45141 31135 565 761 ZM I7 533119 465145 707 0906 03643 68737 922 936 ZM II9 158154 877182 531 3217 62269 38461 148 507 ZM III5 69285 613101 906 3035 53057 61448 350 502 ZM IV2 93445 53454 155 7762 88629 16023 519 242 1 Assignation de la surface en fonction de la part principale de la SAU qu'une entreprise exploite dans une zone donnée Source:OFAG
Tableau 32b
Paiements directs généraux – 2002
Garded'animauxdansdesconditionsContributionsgénéralesContributionspourdesterresenforte difficilespourlesterrainsenpentepenteetenterrassesenviticulture
ANNEXE A33
TotalTotalTotal ExploitationsUGBFGcontributionsExploitationsSurfacecontributionsExploitationsSurfacecontributions NombreNombrefr.Nombrehafr.Nombrehafr. Canton ZH78713 1014 054 1447815 2242 145 102191170318 930 BE9 112132 92473 136 4788 47947 74720 034 7396496330 173 LU3 16648 65321 435 9363 32721 7929 093 662101427 270 UR6748 1237 012 7606324 7672 260 293111 245 SZ1 51322 44412 928 2911 47810 0454 296 574111122 125 OW67410 4135 999 4366464 7242 175 826112 500 NW4627 1693 775 2754443 8181 705 525000 GL3695 7704 329 7283723 3351 510 750127 950 ZG3806 3352 948 6673733 0751 258 18110930 FR1 90335 58613 080 2791 5917 3942 921 942171420 328 SO60710 0833 846 5575854 9561 900 035000 BL68911 2073 159 8266846 0192 316 421403662 220 SH1231 861313 943144833312 49112398161 310 AR77512 4647 170 5727726 6412 793 73041030 400 AI5738 8535 877 8275583 3931 414 618000 SG2 96848 60122 401 4282 91725 11010 468 9006593279 895 GR2 67440 40938 803 6032 60631 32113 671 597281942 810 AG1 14718 0823 593 8041 1847 7782 985 555127160278 055 TG1672 934983 8921521 195527 99780100151 020 TI6958 2266 648 2495823 1511 389 462175137277 045 VD1 31022 8429 830 4041 0035 7972 299 0363705822 138 375 VS2 34123 21321 093 4092 22212 4965 594 8661 3371 6015 660 420 NE81315 5269 283 7765873 5531 333 8334774147 115 GE000000445788 470 JU78915 0897 863 3495963 6301 399 733322 835 Suisse3471152990828957163332715227793958108682740327610051421 Zone1 Plaine2 58846 3194 157 2742 107575 1372 311 3341 7202 2376 834 118 Collines7 645123 37631 712 0027 1303 819 40814 937 779191255666 538 ZM I7 297114 68250 736 5476 9024 763 04819 450 045167199564 170 ZM II8 638132 90890 736 6048 1096 127 80525 868 8175125321 787 550 ZM III5 63275 64970 031 9285 5664 814 19221 162 39211044164 445 ZM IV2 91136 97442 197 2782 9012 679 72912 080 501401034 600 1Assignation de la surface en fonction de la part principale de la SAU qu'une entreprise exploite dans une zone donnée Source:OFAG
Tableau 33a
Contributions écologiques – 2002
A34 ANNEXE
Compensationécologique1Culturebiologique ExploitationsSurfaceTotalcontributionsExploitationsSurfaceTotalcontributions Nombrehafr.Nombrehafr. Canton ZH3 6148 68812 268 2063376 4232 011 786 BE12 51818 68417 828 2201 37019 6874 748 079 LU5 1428 2509 317 8062814 2571 068 606 UR6781 222626 93241511102 527 SZ1 6633 1522 773 8401482 185444 779 OW6991 104906 0301882 356472 759 NW492925730 06458773157 881 GL4141 062657 400921 610320 627 ZG5871 5851 713 348811 426311 580 FR3 2426 5997 138 7181001 948672 568 SO1 4264 1855 182 9461052 785718 018 BL9593 4064 493 2211302 920784 348 SH5641 5912 394 68616349146 153 AR718857690 8441402 351471 917 AI466520371 4923145189 980 SG4 3368 1088 548 0694848 1771 756 303 GR2 74314 3245 751 3551 30326 1665 414 450 AG3 0957 3499 900 6982073 7531 342 170 TG2 6925 1137 149 9732193 7101 357 187 TI8441 6141 173 384961 500371 365 VD3 8169 80612 715 5401132 209757 809 VS2 1845 3233 062 4412433 6761 045 295 NE7461 9221 651 684401 129285 348 GE3081 1742 004 09845154 618 JU1 0693 1673 295 518712 398578 267 Suisse55015119729122346510589810280225484420 Zone2 Plaine23 38849 29570 223 3371 11819 3867 705 221 Collines8 08517 49420 823 7535709 7682 667 465 ZM I7 27211 72110 390 87877612 0322 675 641 ZM II8 18414 89510 374 1371 24420 8724 229 220 ZM III5 29514 2606 139 2211 30123 6564 802 309 ZM IV2 79112 0654 395 18688917 0863 404 564 1Arbres fruitiers haute-tige convertis en ares 2Assignation de la surface en fonction de la part principale de la SAU qu'une entreprise exploite dans une zone donnée Source:OFAG
Tableau 33b
Contributions écologiques – 2002
CultureextensivedecéréalesGarded'animauxderenteparticulièrement etdecolzarespectueusedel'espèce
ANNEXE A35
ExploitationsSurfaceTotalcontributionsExploitationsUGBTotalcontributions Nombrehafr.NombreNombrefr. Canton ZH1 6056 2552 495 6371 97162 7639 560 051 BE5 56017 2036 881 2538 728205 50233 384 814 LU1 3073 3531 341 1523 779142 97521 636 695 UR0003895 598931 590 SZ243313 08893321 1403 454 685 OW241 40843610 0811 644 481 NW0002546 7471 074 467 GL229042896 9861 166 154 ZG8618574 08439313 7692 111 348 FR1 3616 3582 543 3342 51794 28615 000 809 SO8214 2761 704 9981 03730 6664 721 746 BL6833 3971 339 77752919 3652 959 287 SH3382 487976 00425810 4651 489 801 AR00059314 6852 488 280 AI00041711 0971 954 261 SG378821322 7662 62184 44313 691 901 GR284808323 0842 31954 2628 696 588 AG1 7357 2672 905 1931 74858 2968 843 877 TG8402 7961 118 2281 69663 9999 698 259 TI70266106 42469213 4622 126 612 VD1 96314 3605 738 2661 98273 86411 231 240 VS118338133 1011 06013 9702 328 934 NE4192 8591 142 52760523 7373 662 010 GE2253 2661 259 355622 178313 038 JU5823 8071 517 67790744 4886 513 181 Suisse184038014031938260362151088823170684109 Zone1 Plaine10 85554 58921 730 60513 846520 70478 864 271 Collines4 33815 7966 306 4755 520178 45528 094 270 ZM I2 2457 4022 960 5155 097141 26922 713 381 ZM II7962 146858 1605 910144 15223 723 359 ZM III14718774 8133 84870 44211 666 825 ZM IV22197 6921 99433 8015 622 003
1 Assignation de la surface en fonction de la part principale de la SAU qu'une entreprise exploite dans une zone donnée
Source:OFAG
Tableau 34a
Contributions à la compensation écologique – 2002 PrairiesextensivesPrairiespeuintensives
A36 ANNEXE
ExploitationsSurfaceTotalcontributionsExploitationsSurfaceTotalcontributions Nombrehafr.Nombrehafr. Canton ZH3 0384 1975 952 3851 104998633 806 BE7 0966 4756 458 5267 8516 6343 213 381 LU3 9263 3223 633 8842 2381 616836 676 UR373452218 811493604190 894 SZ883736541 245632548228 928 OW578644398 25321212653 246 NW366466291 96221517675 314 GL377739443 94016920878 192 ZG340307360 143265201109 848 FR1 9372 3753 088 0272 1172 8181 641 890 SO1 1672 0672 596 659623802460 361 BL7371 1441 370 806455566346 216 SH5159101 273 662184181117 525 AR359185134 613421280126 874 AI278190133 61915510748 301 SG2 6842 2372 352 1962 1801 571855 419 GR2 0444 8992 395 4822 4129 0142 777 424 AG2 5023 5754 834 2481 2971 090701 736 TG1 7701 5342 249 7231 183808522 268 TI503629516 009435744260 235 VD3 0654 8926 631 2501 3762 4111 266 736 VS8911 295817 0101 6003 2971 116 463 NE473766809 901424935434 326 GE3018401 260 150132013 308 JU7261 1931 423 8626591 175614 760 Suisse369294607150186364287133692816724127 Zone1 Plaine18 20122 78333 417 1019 2258 1215 210 405 Collines5 2145 8406 855 8484 5974 3822 753 508 ZM I3 8353 3822 476 7254 3023 7091 710 507 ZM II4 4694 5443 072 2014 6645 6772 490 575 ZM III3 3085 6492 607 5653 5787 2272 207 079 ZM IV1 9023 8731 756 9232 3477 8112 352 054 1Assignation de la surface en fonction de la part principale de la SAU qu'une entreprise exploite dans une zone donnée Source:OFAG
Tableau 34b
Contributions à la compensation écologique – 2002
ANNEXE A37
SurfacesàlitièreHaies,bosquetschampêtresetbergesboisées ExploitationsSurfaceTotalcontributionsExploitationsSurfaceTotalcontributions Nombrehafr.Nombrehafr. Canton ZH1 1131 2611 713 071919182263 155 BE751565353 9961 967412437 417 LU417289262 12344989118 832 UR554943 77521457 SZ8651 141911 19330459 OW1437972 3661421 330 NW1179782 5051411 209 GL574632 5911221 188 ZG297510395 4961985152 000 FR814443 138762234313 431 SO111 80030790111 254 BL0002587591 903 SH1068 7152286488 464 AR266191134 6225096 360 AI194169118 36364128 134 SG1 6891 7401 473 1062955661 888 GR754321 9701102722 940 AG11271105 3091 046299389 710 TG16089128 40147299147 511 TI283545 0401444 700 VD12611082 6221 070357483 002 VS42129 2821694534 281 NE442 5481224139 369 GE358 2351113653 970 JU281310 347338129127 865 Suisse663465716060612899423172860826 Zone1 Plaine1 7051 7112 519 8335 3231 3081 937 134 Collines791625748 7741 693449538 822 ZM I1 039798626 158935262188 562 ZM II2 0522 4891 720 171763240168 575 ZM III779688327 3262244722 596 ZM IV268260118 35056115 139 1Assignation de la surface en fonction de la part principale de la SAU qu'une entreprise exploite dans une zone donnée
Source:OFAG
Tableau 34c
Contributions à la compensation écologique – 2002
1 Assignation de la surface en fonction de la part principale de la SAU qu'une entreprise exploite dans une zone donnée
A38 ANNEXE
JachèresfloralesJachèrestournantes ExploitationsSurfaceTotalcontributionsExploitationsSurfaceTotalcontributions Nombrehafr.Nombrehafr. Canton ZH415313939 300143161403 450 BE297227681 917114128320 104 LU5335104 550101332 275 UR000000 SZ113 000000 OW000000 NW000000 GL000000 ZG101339 090225 750 FR170187561 3285380199 587 SO6384250 8904250126 150 BL141109327 4806589223 575 SH158127380 7303771176 950 AR000000 AI000000 SG383089 8804511 675 GR121029 3403819 175 AG376175524 370132138345 925 TG147115344 0104357142 575 TI101544 40052357 750 VD4116091 825 830184285712 500 VS3941123 48071331 475 NE4549147 630142563 725 GE6588264 42079128319 325 JU5656168 8403148120 000 Suisse25072283685048596813253311966 Zone1 Plaine2 1071 9535 861 1758301 1522 880 638 Collines381309926 125132167417 405 ZM I142059 2554410 548 ZM II413 540213 375 ZM III10390000 ZM IV000000
Source:OFAG
Tableau 34d
Contributions à la compensation écologique – 2002
ANNEXE A39
BandesculturalesextensivesArbresfrutiershaute-tige ExploitationsSurfaceTotalcontributionsExploitationsArbresTotalcontributions Nombrehafr.NombreNombrefr. Canton ZH1323 7202 560157 2882 359 320 BE3269 4948 528423 5596 353 385 LU711 6354 353288 5224 327 831 UR00024911 533172 995 SZ101501 03572 5911 088 865 OW00047225 389380 835 NW00035218 605279 075 GL0001526 766101 490 ZG00052250 068751 021 FR734 6331 99885 7791 286 685 SO1411 9121 165108 9281 633 920 BL922 310916142 0622 130 931 SH4046038823 212348 180 AR00034119 225288 375 AI000774 20563 075 SG712 1453 089246 7843 701 760 GR1021059932 321484 815 AG1133 9602 627199 6962 995 440 TG1445 7602 258240 6893 609 725 TI00022916 348245 250 VD241015 0002 133113 2401 698 600 VS00081962 030930 450 NE1013518910 270154 050 GE404501125 61684 240 JU5052567155 288829 319 Suisse154355249935834242001436299632 Zone1 Plaine1202944 05117 3451 223 57418 353 000 Collines3068 1597 108571 6748 575 112 ZM I301395 875354 5995 318 985 ZM II101503 986194 3702 915 550 ZM III0001 28964 951974 265 ZM IV00023110 846162 720 1 Assignation de la surface en fonction de la part principale de la SAU qu'une entreprise exploite dans une zone donnée
Source:OFAG
Tableau 35
Contributions versées en 2002 pour la qualité biologique et la mise en réseau
A40 ANNEXE
Seulementqualitébiologique1Seulementmiseenréseau1QualitébiologiqueetContributionsfédérales miseenréseau1 ExploitationsSurfaceExploitationsSurfaceExploitationsSurfaceExploitationsTotaldes contributions NombrehaNombrehaNombrehaNombrefr. Cantons ZH682892111983431775405 218 BE 2 6707700000670 490 709 LU1 5671 58300001 5671 395 836 UR 3 SZ8831 4540000883 670 144 OW244349201545125283223 126 NW2122950000212 105 139 GL19036417311849210178 256 ZG3586650000358 351 412 FR268276284233290159 773 SO2815130000281 205 152 BL9492219514486760614894 867 SH124179000012477 928 AR184115342079209244147 792 AI0000000 SG1 8712 296313513251 8941 035 292 GR 3 AG2882843694733781 3546671 620 020 TG4943250000494 380 400 TI3 VD 2 VS3666490000366 292 353 NE220257569600251147 841 GE17130000174 403 JU1773000000177 148 125 Suisse919011672885132410562556103778933786 Zone Plaine2 9932 9393523892605573 3562 656 346 Collines1 4011 3573294095161 2961 9382 342 971 ZM I1 4031 5851062231252901 5421 156 886 ZM II2 1313 248812791243122 2511 638 128 ZM III8431 6489192379861734 065 ZM IV41989586822429 405 390 1 arbres fruitiers haute-tige convertis en ares 2 données incomplètes 3 données pas fournies à temps
Source:OFAG
Tableau 36
Contributions pour la culture extensive de céréales et de colza – 2002
ANNEXE A41
CéréalespanifiablesCéréalesfourragèresColzaTotal ExploitationsSurfaceExploitationsSurfaceExploitationsSurfaceContributions NombrehaNombrehaNombrehafr. Canton ZH1 2164 0991 0411 8081953472 495 637 BE3 3088 0514 6498 7302684226 881 253 LU8251 4879991 692911741 341 152 UR0000000 SZ4322291113 088 OW231101 408 NW0000000 GL002200904 ZG34676310851074 084 FR8133 1981 1002 7801353802 543 334 SO5932 1706941 902992031 704 998 BL5131 7135941 555531291 339 777 SH3231 95916940068128976 004 AR0000000 AI0000000 SG1482962914901935322 766 GR1403582504122138323 084 AG1 4734 3701 3132 6321602652 905 193 TG7031 936500758601011 118 228 TI20806118136106 424 VD1 1277 2531 4985 1187181 9895 738 266 VS89235599815133 101 NE1748433981 828641891 142 527 GE1952 093192901672721 259 355 JU3101 6084901 908862901 517 677 Suisse120104182114386333352114498431938260 Zone1 Plaine8 15732 7287 64017 7591 6944 10321 730 605 Collines2 7906 8983 7228 1833537156 306 475 ZM I8871 9202 1175 323621592 960 515 ZM II1342397471 89958858 160 ZM III34321381550074 813 ZM IV832216007 692
1 Assignation de la surface en fonction de la part principale de la SAU qu'une entreprise exploite dans une zone donnée
Source:OFAG
Tableau 37
Contributions pour la garde d'animaux de rente particulièrement respectueuse de l'espèce – 2002
SystèmesdestabulationparticulièrementSortiesrégulièresenpleinair respectueuxdesanimaux
A42 ANNEXE
ExploitationsUGBTotalcontributionsExploitationsUGBTotalcontributions NombreNombrefr.NombreNombrefr. Canton ZH1 06522 8642 428 8961 84639 8577 131 155 BE3 33653 2156 359 1808 477152 28727 025 634 LU2 48356 0146 811 4543 59686 96114 825 241 UR8289487 9183864 704843 672 SZ3034 924545 68791716 2172 908 998 OW1752 713320 1774247 3671 324 304 NW1272 310292 4862424 437781 981 GL661 202125 9582895 7841 040 196 ZG2114 828518 5093768 9411 592 839 FR1 44428 9513 323 6002 38565 33511 677 209 SO56810 0481 082 70496920 6183 639 042 BL3077 013754 04951212 3522 205 238 SH1865 528642 6502114 937847 151 AR1682 444292 48759112 2412 195 793 AI1402 675440 3854108 4221 513 876 SG1 04723 1992 752 9532 55761 24410 938 948 GR65012 2691 155 9352 31941 9937 540 653 AG1 03223 5002 679 1471 60934 7716 164 730 TG90424 3422 692 5351 59339 6577 005 724 TI2093 160291 62268610 3011 834 990 VD1 11527 1652 814 1851 84846 6998 417 055 VS1512 086199 3261 05011 8842 129 608 NE2587 044711 80759116 6932 950 203 GE2882881 388591 349231 650 JU52616 5481 624 93888127 9404 888 243 Suisse165813457633902997634824742993131654133 Zone1 Plaine8 158201 58322 865 95912 930319 07055 998 312 Collines3 01759 9937 060 0845 272118 45021 034 186 ZM I2 19537 1794 163 7744 993104 08718 549 607 ZM II1 92029 8733 320 6785 822114 27720 402 681 ZM III90811 8631 132 0713 82258 57910 534 754 ZM IV3835 272487 4101 98528 5305 134 593 1 Assignation de la surface en fonction de la part principale de la SAU qu'une entreprise exploite dans une zone donnée
Source:OFAG
Tableau 38
Participation au programme SST – 2002
Base1ParticipationSST
ANNEXE A43
CatégorieanimaleUGBExploitationsUGBExploitationsUGBExploitations NombreNombreNombreNombre%% Animaux d'élevage et de rente: Vaches laitières637 54140 037121 2265 10219.012.7 Génisses de plus d'un an149 88838 15633 5176 71022.417.6 Taureaux de plus d'un an5 2508 0101 2401 56523.619.5 Jeune bétail femelle,4 à 12 mois33 22830 1877 5395 32222.717.6 Jeune bétail mâle,4 à 12 mois1 9563 8851933539.89.1 Veaux d'élevage,de moins de 4 mois24 53326 4387 2156 32329.423.9 Vaches allaitantes: Vaches mères et nourrices avec leurs veaux52 3585 00039 4992 83075.456.6 Engraissement: Génisses,taureaux et bœufs de plus de quatre mois36 9407 31319 2302 31152.131.6 Veaux de moins de 4 mois4 0446 4141 9961 59149.424.8 Veaux à l'engrais11 10618 6444 6983 82042.320.5 Totalbovins956844463872363531381224.729.8 Chèvres7 9946 1561 85553523.28.7 Lapins3 3733 968891022.62.6 Totalautresanimauxconsommantdesfourragesgrossiers113679233194460917.16.6 Porcs d'élevage,de plus de 6 mois,et porcelets56 6455 40525 6411 54145.328.5 Porcs de renouvellement,jusqu'à 6 mois,et porcs à l'engrais93 88810 33653 7583 55957.334.4 Totalporcs1505331254379399426852.734.0 Poules et coqs d'élevage9792 0361666517.03.2 Poules pondeuses16 38114 39511 7581 64571.811.4 Poulettes,jeunes coqs et poussins1 8555231 1019959.418.9 Poulets de chair16 8241 02213 81969282.167.7 Dindes2 0363011 94710195.633.6 Totalvolaille380751607328791243475.615.1 Totaltouteslescatégories1156819496263464881667230.033.6 1 Exploitations ayant droit aux contributions (exploitations ayant touché des paiements directs) Source:OFAG
Tableau 39
Participation au programme SRPA – 2002
A44 ANNEXE
Base1ParticipationSRPA CatégorieanimaleUGBExploitationsUGBExploitationsUGBExploitations NombreNombreNombreNombre%% Animaux d'élevage et de rente: Vaches laitières637 54140 037417 62623 88065.559.6 Génisses de plus d'un an149 88838 15690 13421 01260.155.1 Taureaux de plus d'un an5 2508 0102 2333 47342.543.4 Jeune bétail femelle,4 à 12 mois33 22830 18717 02915 35551.250.9 Jeune bétail mâle,4 à 12 mois1 9563 8854661 04023.826.8 Veaux d'élevage,de moins de 4 mois24 53326 4385 8966 04824.022.9 Vaches allaitantes: Vaches mères et nourrices avec leurs veaux52 3585 00047 0533 91889.978.4 Engraissement: Génisses,taureaux et bœufs de plus de quatre mois36 9407 31314 1862 64838.436.2 Veaux de moins de 4 mois4 0446 4149011 18622.318.5 Veaux à l'engrais11 10618 6449451 6268.58.7 Totalbovins956844463875964692933662.363.2 Equidés31 11911 52624 5447 69078.966.7 Moutons36 6599 94327 1086 36073.964.0 Chèvres7 9946 1565 3332 79566.745.4 Daims et cerfs rouges53815243311180.473.0 Bisons1681016810100.0100.0 Lapins3 3733 9681201423.63.6 Totalautresanimauxconsommantdesfourragesgrossiers7985223718577061373772.357.9 Porcs d'élevage,de plus de 6 mois,et porcelets56 6455 40524 7581 64243.730.4 Porcs de renouvellement,jusqu'à 6 mois,et porcs à l'engrais93 88810 33649 6113 54852.834.3 Totalporcs1505331254374369437649.434.9 Poules et coqs d'élevage9792 036732997.514.7 Poules pondeuses16 38114 3959 5773 45958.524.0 Poulettes,jeunes coqs et poussins1 85552321512211.623.3 Poulets de chair16 8241 0222 85322417.021.9 Dindes2 0363011 93812695.241.9 Totalvolaille380751607314656383038.523.8 Totaltouteslescatégories1225304527837432003482860.766.0 1 Exploitations ayant droit aux contributions (exploitations ayant touché des paiements directs)
Source:OFAG
Tableau 40a
Contributions d'estivage – 2002
CantonsMoutons,Vaches,brebislaitières,AutresanimauxconsommantExploitationset brebislaitièresexceptéeschèvreslaitièresdesfourragesgrossierscontributionsTotal
ANNEXE A45
ExploitationsPâquiersExploitationsUGBExploitationsPâquiersExploitationsContributions normauxnormaux NombreNombreNombreNombreNombreNombreNombrefr. ZH00001048510 145 683 BE1882 11356211 2001 63046 7051 72918 879 095 LU4738254332506 0632551 984 851 UR821 5092311 2762454 8933582 284 110 SZ382732721 36342810 3264543 767 320 OW25267582962598 0422772 730 652 NW119312441203 9371361 254 502 GL1962061471136 7431202 123 011 ZG0019102041063 873 FR5577714158160221 2046407 099 748 SO26217602 37761743 838 BL00001041010 122 988 SH00001100129 889 AR00282821182 406119825 733 AI10891061 1321392 1421451 021 028 SG381 1361562 82644015 5254516 501 081 GR2138 21341312 65889231 8541 04915 195 897 AG2180073968 130 168 TG0000269223 103 TI781 688863 9411943 9812592 653 178 VD328242847265629 0646729 889 934 VS1715 6641436 80543812 2985237 260 721 NE275183051483 9811541 344 360 GE1850000110 169 JU4112228011 073833 476 341 Total1018239442319433896852224277752789561273 Source:OFAG
40b Contributions d'estivage – 2002 CantonsVachestraitesChèvreslaitièresBrebislaitièresAutresmoutonsAutresanimaux consommantdes fourragesgrossiers ZH0000795 BE28 7103 7849925 72469 645 LU1 20614802 5808 905 UR4 129563116 2916 750 SZ3 94377008 41018 177 OW4 48919002 5947 366 NW1 58418302 1674 473 GL3 53611604 1935 905 ZG32000314 FR8 665720145 71327 415 SO10200994 049 BL0300764 SH0000150 AR1 363173042 781 AI1 72337805683 054 SG9 772762012 76727 950 GR21 9884 00749858 98784 881 AG0000310 TG0000122 TI5 5226 112216 8907 401 VD11 995339451 1 31 525 VS12 940208053 32116 177 NE927109926 193 GE0007430 JU3 015102499 654 Total125641184581065212293344756 1 données pas correctement saisies et transmises Source:OFAG
Tableau
Tableau 41a
Paiements directs par exploitation 1:selon les zones et les classes de grandeur – 2002
A46 ANNEXE
ParamètreUnité10–2020–3030–5010–2020–3030–50 haSAUhaSAUhaSAUhaSAUhaSAUhaSAU Exploitations de référenceNombre49827910918610627 Exploitations retenuesNombre9 3335 5712 8773 5041 409636 Surface agricole utileha15.1624.0336.1114.7424.0036.25 Paiements directs selon l'ordonnance
directs
Paiementsdirectsgénérauxtotalfr.228613520252491273084465160517 Contributions à la surfacefr.20 56132 46948 00717 97630 80446 165 Contributions pour animaux consommant des fourrages grossiersfr.2 0692 4934 0213 0905 7776 856 Contributions pour la garde d'animaux dans des conditions difficilesfr.1191292544 3434 8464 248 Contributions pour des terrains en pentefr.1111102081 8993 2243 248 Contributionsécologiquestotalfr.655396041303665411030012826 Compensation écologiquefr.2 4683 2614 8661 8333 8884 047 Culture extensivefr.6759691 8425878162 082 Culture biologiquefr.311440811415378362 Garde d'animaux de rente particulièrement respectueuse de l'espècefr.3 1004 9355 5173 7065 2196 336 Total paiements directs selon OPDfr.29 41344 80665 52633 85054 95173 343 Rendement brutfr.183 263274 908338 357158 966246 021317 530 Part des paiements directs selon OPD au rendement brut%16.016.319.421.322.323.1 Autres paiements directs 2 fr.1 3171 5424 5591 0912 8043 872 Total paiements directsfr.30 73046 34870 08534 94157 75577 215 Part des paiements directs total au rendement brut%16.816.920.722.023.524.3 1Les résultats se fondent sur les données du dépouillement centralisé de la FAT 2Contributions d'estivage,primes de culture,contributions des cantons et de particuliers Source:FAT
ZonedeplaineZC
sur les paiements
(OPD)
Tableau 41b
Paiements directs par exploitation 1:selon les zones et les classes de grandeur – 2002
ANNEXE A47
ZMIZMII ParamètreUnité10–2020–3030–5010–2020–3030–50 haSAUhaSAUhaSAUhaSAUhaSAUhaSAU Exploitations de référenceNombre15987281659553 Exploitations retenuesNombre2 9701 2576742 9681 445975 Surface agricole utileha15.4224.0434.7915.1724.3736.31 Paiements directs selon l'ordonnance sur les paiements directs (OPD) Paiementsdirectsgénérauxtotalfr.350004834359605400765428169005 Contributions à la surfacefr.18 48029 30743 88717 70428 37840 439 Contributions pour animaux consommant des fourrages grossiersfr.4 6616 1274 2726 5217 98510 548 Contributions pour la garde d'animaux dans des conditions difficilesfr.8 3299 0567 81111 83313 28714 087 Contributions pour des terrains en pentefr.3 5293 8533 6354 0184 6313 931 Contributionsécologiquestotalfr.6255912310640476277479332 Compensation écologiquefr.1 5432 3021 9131 3501 7002 167 Culture extensivefr.1944971 94232141433 Culture biologiquefr.7208853947001 2901 293 Garde d'animaux de rente particulièrement respectueuse de l'espècefr.3 7995 4396 3912 6804 6175 439 Total paiements directs selon OPDfr.41 25557 46670 24444 83962 02878 337 Rendement brutfr.151 321210 850259 658128 205180 196211 774 Part des paiements directs selon OPD au rendement brut%27.327.327.135.034.437.0 Autres paiements directs 2 fr.1 2871 5702 3411 9503 0973 436 Total paiements directsfr.42 54259 03672 58546 78965 12681 773 Part des paiements directs total au rendement brut%28.128.028.036.536.138.6 1Les résultats se fondent sur les données du dépouillement centralisé de la FAT 2Contributions d'estivage,primes de culture,contributions des cantons et de particuliers Source:FAT
Paiements directs par exploitation 1:selon les zones et les classes de grandeur – 2002
1Les résultats se fondent sur les données du dépouillement centralisé de la FAT
A48 ANNEXE
Tableau 41c
ZMIIIZMIV ParamètreUnité10–2020–3030–5010–2020–3030–503 haSAUhaSAUhaSAUhaSAUhaSAUhaSAU Exploitations de référenceNombre885515662816 Exploitations retenuesNombre1 8149611 499578 Surface agricole utileha14.8624.5114.4823.15 Paiements directs selon l'ordonnance
Paiementsdirectsgénérauxtotalfr.47356648654698964225 Contributions à la surfacefr.17 43628 63017 04625 768 Contributions pour animaux consommant des fourrages grossiersfr.10 20711 8498 85211 502 Contributions pour la garde d'animaux dans des conditions difficilesfr.14 75417 82116 18220 571 Contributions pour des terrains en pentefr.4 9596 5664 9086 384 Contributionsécologiquestotalfr.4152651439186911 Compensation écologiquefr.1 2301 6961 2652 249 Culture extensivefr.0000 Culture biologiquefr.6931 4928221 989 Garde d'animaux de rente particulièrement respectueuse de l'espècefr.2 2293 3261 8312 673 Total paiements directs selon OPDfr.51 50871 37950 90771 135 Rendement brutfr.107 404153 10294 586133 267 Part des paiements directs selon OPD au rendement brut%48.046.653.853.4 Autres paiements directs 2 fr.2 4253 1131 9604 186 Total paiements directsfr.53 93374 49352 86775 321 Part des paiements directs total au rendement brut%50.248.755.956.5
d'estivage,primes
3L'échantillon étant trop restreint,nous
Source:FAT
sur les paiements directs (OPD)
2Contributions
de culture,contributions des cantons et de particuliers
ne présentons pas de résultats
Tableau 42
Paiements directs par exploitation 1:selon les régions – 2002
ANNEXE A49
ParamètreUnitéTouteslesRégionRégionRégion exploitationsdeplainedescollinesdemontagne Exploitations de référenceNombre2 3791 006698675 Exploitations retenuesNombre51 42123 07213 94614 403 Surface agricole utileha19.3820.6818.0918.55 Paiements directs selon l'ordonnance sur les paiements directs (OPD) Paiementsdirectsgénérauxtotalfr.36535305613519447404 Contributions à la surfacefr.24 39127 63922 19921 310 Contributions pour animaux consommant des fourrages grossiersfr.4 6482 6094 2538 297 Contributions pour la garde d'animaux dans des conditions difficilesfr.5 4441255 98613 439 Contributions pour des terrains en pentefr.2 0531892 7574 358 Contributionsécologiquestotalfr.7168824973255287 Compensation écologiquefr.2 3613 0872 1321 420 Culture extensivefr.59692959265 Culture biologiquefr.577408457964 Garde d'animaux de rente particulièrement respectueuse de l'espècefr.3 6353 8244 1452 837 Total paiements directs selon OPDfr.43 70438 81042 51952 691 Rendement brutfr.194 365242 450179 713131 524 Part des paiements directs selon OPD au rendement brut%22.516.023.740.1 Paiements directs par hafr./ ha2 2551 8772 3502 840 Autres paiements directs 2 fr.1 9271 9811 3992 350 Total paiements directsfr.45 63040 79143 91755 041 Part des paiements directs total au rendement brut%23.516.824.441.8 1Les résultats se fondent sur les données du dépouillement centralisé de la FAT 2Contributions d'estivage,primes de culture,contributions des cantons et de particuliers Source:FAT
Tableau 43a
Evaluation de l'exécution et du contrôle (PER)
A50 ANNEXE
CantonExploitationsExploitationsRéclamationsTotaldes ayantdroitcontrôléesréclamations auxPD NombreNombreNombreNombre ZH3 6981 54606180313330200201 BE12 9496 788517226457469691120716 LU5 3265 20770402011139359185213560 UR6803100128310000327 SZ1 699972418321200001150 OW705278118017061141800162507 NW495233310212012001462 GLn.d.30745 351119 ZG5152421028153030000793 FR3 4441 375124929419420249359 SO1 4351 43502110430614632816228 BL9689682476066210198 SH58749811071079261053 AR7803200372170000089154 AIn.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d. SG4 4341 75411139525319261283 GR1 4627691047218151025160179 AG3 1543 18511118929123573552344 TG2 9451 7520913138120941562280 TI9614950433100125055 VDn.d.2 4775062301910119131178 VS3 7931 9608507145292322 NE955490422050101583792 GE3193185100120141327 JU1 1143331924105222138 CH524183401216411871430408171247152782748144925 n.d.:non disponible
indications se fondent sur les informations des cantons concernant l'exécution et les sanctions Source:rapports cantonaux sur les activités de contrôle et les sanctions Annonces tardives Garde des animaux de rente respectueuse de l'espèce Enregistrements Bilan de fumure équilibré Part appropriée de surfaces de compensation écologique Bandes tampons et bandes herbeuses Assolement régulier Protection appropriée du sol Sélection et utilisation ciblée des produits de traitement des plantes Autres
Remarque:les
Evaluation de l'exécution et du contrôle (PER)
CantonRéclamationsparRéclamationsExploitationsayantTotaldesContributionsSanctionsen% 100exploitationsaccompagnéessubidessanctionssanctions(fr.)àlasurfacedescontributions ayantdroitauxPDdesanctionspar100exploitationsàlasurface ayantdroitauxPD
Remarque:les indications
Source:rapports
fondent sur les informations des cantons concernant l'exécution et les sanctions
sur les activités de contrôle et les sanctions
ANNEXE A51
Tableau 43b
%Nombre%fr.fr.% ZH5.441253.4n.d.93 255 830n.d. BE5.532361.8494 175243 582 8350.20 LU10.511072.0300 00097 179 9610.31 UR3.9710.11 9208 079 9490.02 SZ2.94422.5290 00028 464 7351.02 OW71.919914.096 0449 479 0371.01 NW12.53234.628 1847 238 3790.39 GLn.d.n.d.n.d.16 1808 588 7910.19 ZG18.06305.892 96512 990 5610.72 FR10.4235910.41 041 23598 319 8451.06 SO15.89483.382 55041 114 7610.20 BL10.12353.6124 69927 243 7840.46 SH9.03284.899 92719 507 6090.51 AR19.740.044 75114 514 2780.31 AIn.d.n.d.n.d.n.d.8 742 975n.d. SG6.381082.4543 05086 772 3870.63 GR12.241389.4495 41761 678 9400.80 AG10.912156.8453 95678 209 7520.58 TG9.51662.2116 01565 357 1710.18 TI5.72555.7124 69115 440 6500.81 VDn.d.178n.d.821 902143 919 2640.57 VS8.49n.d.n.d.1 063 42445 903 6782.32 NE9.63151.677 84438 957 0310.20 GE8.4651.635 00214 162 7680.25 JU3.41403.662 57247 477 6430.13 CH9.4019533.7650650313161826140.49 n.d.:non disponible
se
cantonaux
Dépenses Amélioration des bases de production
Tableau 44
Montants versés aux cantons – 2002
A52 ANNEXE
CantonAméliorationsfoncièresConstructionsruralesTotaldescontributions fr.fr.fr. ZH1 192 129346 3001 538 429 BE6 456 8955 304 30011 761 195 LU3 715 5341 699 1005 414 634 UR842 000804 0001 646 000 SZ1 741 7851 128 0002 869 785 OW193 5001 023 3001 216 800 NW194 000260 735454 735 GL226 828774 5001 001 328 ZG 540 440540 440 FR5 631 8503 652 5609 284 410 SO910 280191 6001 101 880 BL225 344654 600879 944 SH 78 30078 300 AR80 995576 900657 895 AI227 108570 500797 608 PM4 048 6214 148 3258 196 946 GR11 226 8533 962 20015 189 053 AG800 971615 6001 416 571 TG1 295 3301 295 330 TI1 172 1021 184 3002 356 402 VD7 524 4571 139 1008 663 557 VS3 715 7192 974 8006 690 519 NE734 4352 265 0002 999 435 GE193 387193 387 JU2 287 5921 419 8753 707 467 Divers48 00048 000 Total546857153531433590000050 Source:OFAG
Tableau 45
Contributions pour des projets approuvés,par mesure et par région – 2002
ANNEXE A53
MesureContributionsCoût total RégionRégionRégionTotalTotal deplainedescollinesdemontagne 1000fr. Améliorationsfoncières Remaniements parcellaires (y compris infrastructures)11 5755 1525 96022 68768 297 Constructions de chemins7231 0997 4219 24332 316 Autres installations de transport4204201652 Mesures concernant le régime hydrique du sol1 2933341 3082 93510 387 Adductions d'eau1 5733 9935 56623 003 Raccordements au réseau électrique394625012 418 Réfection et préservation de différents objets1314151 1381 6845 750 Documentation732546144422 Total1379586372074843180144245 Constructionsrurales Bâtiments d'exploitation destinés aux animaux consommant des fourrages grossiers9 34722 06331 410193 025 Bâtiments alpestres 2 3042 30414 253 Bâtiments communautaires servant à la transformation et au stockage1251953203 702 Total94722456234034210980 Entout13795181094531077214355225 Source:OFAG
Crédits d'investissements approuvés par les cantons – 2002
A54 ANNEXE
Tableau 46
CantonMesuresMesuresTotal collectivesindividuelles CréditsdeconstructionCréditsd'investissementsCréditsd'investissements Nombre1000fr.Nombre1000fr.Nombre1000fr.Nombre1000fr. ZH28313918 68214118 765 BE112 820161 69744751 20247455 719 LU72 020151 47323125 83625329 329 UR1100160171 529191 689 SZ131 5979469546 197768 263 OW 282 981282 981 NW15002294111 294142 088 GL 101 203101 203 ZG 243 053243 053 FR1167111 12220225 55821426 847 SO13503286526 070566 706 BL5240465 466515 706 SH 162 235162 235 AR 343 124343 124 AI1113403 105413 218 SG61 30671 73321824 40023127 439 GR1919 085228011113 28113232 646 AG498614016 16814417 154 TG 12018 27212018 272 TI3682111 212243 437385 331 VD2385231 93416318 79918821 118 VS61 171282 570323 426667 167 NE2265404 680424 945 GE316632806446 JU6400747 865808 265 Total72302961501527022762681422498313709 Source:OFAG
Crédits d'investissements accordés en 2002 par catégorie de mesures (sans les crédits de construction)
ANNEXE A55
Tableau 47
CantonAideAchatBâtimentBâtimentAchatdeTransformationAméliorationsTotal initialed'exploitationd'habitationd'exploitationcheptelenetstockagefoncières parlefermiercommundeproduits agricoles 1000fr. ZH6 500302 3599 793483518 765 BE19 4001 8029 54920 4511 30239552 899 LU6 4002538 22910 95456490927 309 UR570180779601 589 SZ2 4001 7782 0192302396 666 OW4801 2301 2712 981 NW390570334942001 588 GL4302205531 203 ZG1 7702501508833 053 FR8 5804982 36414 1168536067726 680 SO3 0905405051 9351861006 356 BL2 4305402 346302105 556 SH1 1101501 1252 385 AR1 3506111 1633 124 AI6307821 6933 105 SG7 2005564 61812 0261 50123226 133 GR3 040572 4487 73628013 561 AG5 8501152 7127 4918090617 154 TG4 82099112 46118 272 TI6605102 2671 0921204 649 VD8 2803002 4187 80172973147420 733 VS4504509031 6231 8697015 996 NE1 2901204652 804302354 945 GE260202640100446 JU2 1404147344 57675802458 264 Total89520553544866128220107395104687283412 Source:OFAG
Tableau 48
Prêts autorisés par les cantons au titre de l'aide aux exploitations – 2002 (parts de la Confédération et du canton)
A56 ANNEXE
CantonNombreMontantsParcasDuréederemboursement 1000fr.1000fr.Ans ZH8 98012315 BE24 3 17913215 LU30 4 53515119 UR SZ6 96416114 OW NW6 63210512 GL2 1356818 ZG1 1201208 FR13 1 82514010 SO9 1 07111914 BL3 1876213 SH3 185628 AR10 7507512 AI SG24 2 64411014 GR5 3957918 AG10 1 21012114 TG2 26413213 TI5 65013015 VD69 10 70915513 VS21 3 22715412 NE5 55011011 GE JU14 952687 Total27035164Ø:130Ø:14 Source:OFAG
ANNEXE A57 Tableau 49a Aperçu des contributions MesureProjetsapprouvésen1000fr. 200020012002 Contributions820449569077214 Remaniements parcellaires avec aménagement de l'infrastructure27 12427 41622 687 Constructions de chemins12 15712 0539 243 Adductions d'eau 8 6855 9685 566 Autres ouvrages de génie civiles8 68119 2855 684 Bâtiments d'exploitation pour animaux consommant des fourrages grossiers23 66728 48331 410 Autres mesures liées aux constructions rurales1 7302 4852 624 Source:OFAG Tableau 49b Aperçu des crédits d'investissements et des prêts à titre d'aide aux exploitations MesureCréditsautorisés,en1'000fr.. 200020012002 Créditsd'investissements1241951265105283412 Aide initiale 71 38569 98489 520 Achat de l'exploitation par le fermier2 7375 1735 535 Maisons d'habitation 47 08244 36044 866 Bâtiments d'exploitation113 710132 921128 221 Achat de cheptel,transformation et stockage de produits agricoles en commun418211 52610 583 Améliorations foncières 2 8551 1414 687 Prêtsautitredel'aideauxexploitations1310623441335164 1autorisés par le canton Source:OFAG Tableau
Aides financières allouées pour
EspèceanimaleetmesuresMontantAnimauxinscritsOrganisations auherd-bookd'élevage fr.Nombre Bovins143890005638968 Tenue du herd-book2 819 000 Contrôles de performance laitière et carnée10 833 000 Appréciations de la conformation737 000 Chevaux11225004812122 Porcs1677500163582 Moutons1094000854502 Chèvresetbrebislaitières824000302184 Elevage d'animaux inscrits au herd-book595 000 Contrôles de performance laitière 228 000 Racesmenacéesd'extinction6280005 Total19735000700734 1 poulains identifiés Sources:Compte d'Etat / Organisations d'élevage
50
l'élevage – 2002
répartition des moyens financiers entre les différents domaines d'activité repose sur le compte d'Etat 1999.
C'est ainsi que les dépenses pour la mise en valeur des pommes de terre et des fruits ou celles de l'Administration des blés de 1990/92 ont été englobées dans les dépenses de l'OFAG,alors qu'à l'époque,les comptes étaient encore séparés. Les chiffres pour 1990/92 ne coïncident donc pas avec les données du compte d'Etat.
L'augmentation des dépenses administratives s'explique notamment par le fait que certaines prestations, par exemple celles à la caisse de pensions,ne sont plus centralisées,mais attribuées aux offices concernés.
1Les dépenses extraordinaires dans le secteur laitier sont incluses dans le montant.Elles ont été mises à la charge d'autres domaines, tels que les améliorations structurelles et l'économie animale.
Sources:Compte d'Etat,OFAG
A58 ANNEXE
51 Dépenses de la Confédération pour l'agriculture et l'alimentation,en 1000 fr. Domainedesdépenses1990/922000200120021990/92–2000/02 % DépensesOFAG269944233591613565776368370231.0 Productionetventes16849949546969015579786191-43.9 Promotion des ventes59 52159 99858 798 Economie laitière1 127 273716 156666 149753 583-36.8 Economie animale133 90226 19346 37020 337-76.9 Production végétale423 819152 826129 040145 901-66.4 Paiementsdirects772258211447023335752428673196.8 Paiements directs généraux758 3321 758 9851 916 5801 981 432148.7 Paiements directs écologiques13 926355 485416 995447 2412819.5 Améliorationdesbasesdeproduction20876124550327658822282018.9 Améliorations structurelles133 87988 000102 05890 000-30.3 Crédits d'investissements27 136100 00098 18070 000229.4 Aide aux exploitations paysannes9527 75330 0009 0001537.0 Vulgarisation et contributions à la recherche21 47622 01523 03923 7376.8 Lutte contre les maladies et parasites des plantes1 4496 7352 1198 996310.6 Sélections végétale et animale23 86921 00021 19221 087-11.6 Administration3342944492540565359051.7 Autresdépenses3481633683293964463834979.9 Contributions à l'exportation pour produits agricoles transformés93 867111 84298 355114 90015.4 Allocations familiales dans l'agriculture77 99691 23091 44780 40012.4 Stations de recherches agronomiques96 431117 619122 127118 29723.8 Haras6 8436 5147 0087 1960.9 Autres73 02654 68777 50962 704-11.0 Totalagricultureetalimentation304760537274903962222406719928.6 Remarque:la
Tableau
■■■■■■■■■■■■■■■■
Tableaux Aspects internationaux
UE-4:comprend les pays voisins Allemagne (D),France (F),Italie (I) et Autriche (A)
UE-5:UE-4 plus Pays-Bas (NL) ou Belgique (B)
UE-6:UE-4 plus Pays-Bas (NL) et Belgique (B)
D:République fédérale d'Allemagne (incluant l'ex-RDA à partir de 1991)
Note:les chiffres en italique sont calculés sur la base d'indices (Eurostat)
Sources:OFAG,OFS,USP,Banque Nationale Suisse,Eurostat,ZMP,Agreste,U.S.Department of Agriculture
ANNEXE A59
Tableau 52
ProduitPaysUnité1990/922000200120021990/92–2000/02 % LaitCHct./kg104.9779.4179.9078.39-25 UE-5ct./kg56.5549.0250.7146.87-14 - Dct./kg 57.28 49.2052.1746.21-14 - Fct./kg48.6747.1747.5344.95-4 - Ict./kg68.7653.22 53.1051.94 -23 - Act./kg66.6445.1849.9546.27-29 - NLct./kg57.9349.5151.8848.01-14 USA ct./kg40.5745.7955.8141.5518 TaureauxCHfr./kgPM9.288.856.857.23-18 UE-4fr./kg PM5.594.503.544.13-27 - Dfr./kg PM5.224.183.203.78-29 - Ffr./kg PM5.564.403.484.13-28 - Ifr./kg PM5.834.883.874.46-24 - Afr./kg PM6.494.403.704.04-38 USAfr./kg PM4.354.895.114.3810 VeauxCHfr./kgPM14.3913.1312.0311.77-14 UE-5fr./kg PM8.658.067.387.13-13 - Dfr./kg PM8.989.388.198.50-3 - Ffr./kg PM8.948.858.428.03-6 - Ifr./kg PM8.817.056.786.40-23 - A (depuis 92)fr./kg PM9.607.366.386.22-31 - NLfr./kg PM7.837.356.136.00-17 USAfr./kg PM5.056.796.835.7128 PorcsCHfr./kgPM5.834.694.544.47-22 UE-6fr./kg PM2.932.162.471.93-25 - Dfr./kg PM2.882.202.521.98-22 - Ffr./kg PM2.842.172.491.90-23 - Ifr./kg PM3.48 2.522.992.40 -24 - Afr./kg PM 3.18 1.872.151.66-40 - NLfr./kg PM2.641.912.001.61-30 - Bfr./kg PM3.012.172.551.96-26 USAfr./kg PM1.882.022.081.44-2 PouletsCHfr./kgPV3.722.812.762.72-26 UE-5fr./kg PV1.491.131.171.07-24 - Dfr./kg PV1.431.081.171.05-23 - Ffr./kg PV1.301.021.071.00-21 - Ifr./kg PV1.891.501.421.28-26 - Afr./kg PV2.291.221.231.18-47 - NLfr./kg PV1.360.941.090.93-28 USAfr./kg PV0.981.341.471.0731 OeufsCHfr./100pces33.2921.4623.1223.44-32 UE-5fr./100 pces10.679.328.688.48-17 - Dfr./100 pces 13.12 10.669.719.64-24 - Ffr./100 pces8.607.076.756.18-23 - Ifr./100 pces12.86 12.6611.5411.62 -6 - Afr./100 pces12.6713.4713.5013.366 - NLfr./100 pces7.946.846.526.41-17 USAfr./100 pces7.559.108.667.8213
Prix à la production des produits animaux Suisse – divers pays
Prix à la production des produits végétauxSuisse – divers pays
UE-4:comprend les pays voisins Allemagne (D),France (F),Italie (I) et Autriche (A)
UE-5:UE-4 plus Pays-Bas (NL) ou Belgique (B)
UE-6:UE-4 plus Pays-Bas (NL) et Belgique (B)
D:République fédérale d'Allemagne (incluant l'ex-RDA à partir de 1991)
1 Moyenne des 4 années (pour cause d'alternance) 1990/93 et variation 1990/93–1998/2001
Note:les chiffres en italique sont calculés sur la base d'indices (Eurostat)
Sources:OFAG,OFS,USP,Banque Nationale Suisse,Eurostat,ZMP,Agreste,U.S.Department of Agriculture
A60 ANNEXE
Tableau 53a
ProduitPaysUnité1990/922000200120021990/92–2000/02 % BléCHfr./100kg99.3466.3555.6556.63-40 UE-4fr./100 kg28.5918.1117.4915.64-40 - Dfr./100 kg26.8118.0516.8514.88-38 - Ffr./100 kg28.3717.6717.3415.64-40 - Ifr./100 kg35.92 23.4223.4220.98 -37 - Afr./100 kg43.3017.2115.9014.00-64 USA fr./100 kg15.3215.8817.5519.2515 OrgeCHfr./100kg70.2448.5245.0844.88-34 UE-4fr./100 kg25.9716.9415.7313.57-41 - Dfr./100 kg24.4715.9714.8912.72-41 - Ffr./100 kg25.6717.6216.1613.92-38 - Ifr./100 kg34.52 22.9421.8619.88 -38 - Afr./100 kg36.0515.1914.4212.88-61 USAfr./100 kg12.3013.1513.6413.9810 Maïs-grainCHfr./100kg73.5447.6543.3345.17-38 UE-4fr./100 kg33.7220.2119.0318.05-43 - Dfr./100 kg30.4418.5717.5515.86-43 - Ffr./100 kg29.6319.2918.2716.78-39 - Ifr./100 kg40.80 22.6821.2621.39 -47 - Afr./100 kg36.3717.2015.4214.11-57 USAfr./100 kg12.7612.2312.5313.10-1 PommesdeterreCHfr./100kg38.5536.1235.1534.94-8 UE-6fr./100 kg16.9910.7714.3415.18-21 - Dfr./100 kg13.699.569.8512.41-22 - Ffr./100 kg15.5010.5213.3515.10-16 - Ifr./100 kg43.79 40.7649.2849.09 6 - Afr./100 kg30.3617.3413.8012.63-52 - NLfr./100 kg16.315.4113.2912.69-36 - Bfr./100 kg12.496.4212.268.58-27 USAfr./100 kg18.0821.3122.5227.5832 BetteravessucrièresCHfr./100kg14.8411.5813.3011.64-18 UE-4fr./100 kg7.376.466.975.94-13 - Dfr./100 kg7.896.437.646.52-14 - Ffr./100 kg5.845.685.944.91-6 - Ifr./100 kg9.598.27 8.107.05 -19 - A (depuis 92)fr./100 kg9.217.287.066.85-23 USAfr./100 kg----ColzaCHfr./100kg203.6761.2679.5778.56-64 UE-4fr./100 kg48.7128.4733.7033.13-35 - Dfr./100 kg55.4527.9632.9432.26-44 - Ffr./100 kg41.7729.3534.8634.46-21 - Ifr./100 kg52.5322.4823.2323.86-56 - A (depuis 92)fr./100 kg53.6922.7028.9826.88-51 USAfr./100 kg----Pommes:GoldenDelicious1CHfr./kg1.120.861.040.82-19 UE-5fr./kg0.790.460.500.61-34 - Dfr./kg 1.07 0.490.550.61-49 - Ffr./kg0.680.46 0.400.56 -30 - Ifr./kg0.75 0.470.580.63 -25 - A (div.)fr./kg1.020.400.491.09-35 - Bfr./kg0.800.440.440.42-46 USA (div.)fr./kg0.660.730.660.8212
Prix à la production des produits végétaux Suisse – divers pays
- Amio.de fr./an4362280829552790-35 USAmio.de fr./an255129013267260315
UE-4:comprend les pays voisins Allemagne (D),France (F),Italie (I) et Autriche (A)
UE-5:UE-4 plus Pays-Bas (NL) ou Belgique (B)
UE-6:UE-4 plus Pays-Bas (NL) et Belgique (B)
UE-4/6:Etats membres de l'UE limitrophes de la Suisse (D,F,I,A) plus,pour certains produits,la Belgique (B) et/ou les Pays-Bas (NL).
D:République fédérale d'Allemagne (incluant l'ex-RDA à partir de 1991)
1 Moyenne des 4 années (pour cause d'alternance) 1990/93 et variation 1990/93–1998/2001
2 Le «panier type» est composé des principaux volumes produits en Suisse en moyenne des années 1998 à 2000.
Note:les chiffres en italique sont calculés sur la base d'indices (Eurostat)
Sources:OFAG,OFS,USP,Banque Nationale Suisse,Eurostat,ZMP,Agreste,U.S.Department of Agriculture
ANNEXE A61
Tableau 53b
ProduitPaysUnité1990/922000200120021990/92–2000/02 % PoiresI1CHfr./kg1.330.881.170.92-26 UE-5fr./kg0.960.700.770.71-25 - Dfr./kg 1.10 0.560.740.60-42 - Ffr./kg1.090.950.981.07-8 - Ifr./kg0.900.62 0.690.66 -27 - A (depuis 92)fr./kg1.200.600.680.50-50 - Bfr./kg0.950.780.880.43-27 USAfr./kg0.570.580.710.6110 CarottesCHfr./kg1.091.151.201.2811 UE-6fr./kg0.520.520.640.5610 - Dfr./kg 0.48 0.310.480.44-13 - Ffr./kg0.440.470.680.5226 - Ifr./kg0.830.88 1.021.11 21 - Afr./kg0.420.280.320.29-29 - NLfr./kg0.390.510.400.16-8 - Bfr./kg0.360.150.290.31-30 USAfr./kg0.410.510.660.6850 OignonsCHfr./kg0.891.021.191.2128 UE-5fr./kg0.540.400.570.46-11 - Dfr./kg 0.30 0.160.280.25-23 - Ffr./kg0.600.66 1.060.72 36 - Ifr./kg0.700.380.410.42-43 - Afr./kg0.250.160.220.23-19 - Bfr./kg0.210.190.290.3733 USAfr./kg0.400.450.520.4621 TomatesCHfr./kg2.422.151.902.32-12 UE-6fr./kg0.980.860.730.79-19 - Dfr./kg 0.89 1.100.971.1721 - Ffr./kg1.311.38 1.111.35 -2 - Ifr./kg0.900.740.650.65-25 - A (depuis 92)fr./kg0.390.920.830.99131 - NLfr./kg1.251.170.911.21-12 - Bfr./kg1.221.391.121.283 USAfr./kg1.001.171.161.1215 Paniertype2CHmio.defr./an7200563554585376-24 UE-4/6mio.de fr./an3683300430752840-19 - Dmio.de
-
fr./an3716304531352851-19 - Fmio.de fr./an3376296529962800-14
Imio.de fr./an4411339534793304-23
Prix
- max (I:90/92,00,01,02)fr./kg6.175.896.315.90-2 USAfr./kg2.743.994.113.6843
ŒufsCHfr./pces0.570.580.600.615 EU-4 (UE-4 avec B,sans F)fr./pces0.250.250.250.24-1 - min (B:90/92,00,01,02)fr./pces0.220.210.220.22-4
- max (A:90/92,00,01,02)fr./pces0.330.340.350.343
USAfr./pces0.100.150.160.1443
UE-4:comprend les pays voisins Allemagne (D),France (F),Italie (I) et Autriche (A)
Rubrique «Pays»:min.et max.-> prix minimal et prix maximal observés durant une année dans un pays donné
Note:la part des labels (Bio,M-7,Coop Natura Plan) présente dans les magasins,notamment dans le domaine de la viande,est plus élevée en Suisse qu’à l'étranger
Sources:OFAG,OFS,ZMP,services statistiques nationaux de F,B,A,USA,service statistique de la ville de Turin (I)
A62 ANNEXE
Tableau 54
ProduitPaysUnité1990/922000200120021990/92–2000/02 % LaitdeconsommationCHfr./l1.851.551.551.56-16 EU-4fr./l1.301.091.131.13-14 - min (D:90/92,00,01,02)fr./l1.070.860.910.89-17 - max (I:90/92,00,01,02)fr./l1.821.771.821.83-1 USAfr./l1.041.241.291.1318 FromageCH-Emmentalfr./kg20.1520.1820.5920.331 EU-4 (UE-4 avec B,sans F)fr./kg15.9812.6512.5412.38-22 - min (D:90/92,00,01,02)fr./kg13.5210.0910.069.90-26 - max (I:90/92,B:00,01,02)fr./kg20.6817.1317.1317.00-17 USA (Cheddar)fr./kg11.1414.2614.9914.4731 BeurreCHfr./kg13.7611.7612.1212.24-13 EU-4fr./kg9.048.018.077.64-13 - min (D:90/92,00,01,02)fr./kg6.815.705.925.16-18 - max (I:90/92,00,01,02)fr./kg12.9012.0111.6611.40-9 USAfr./kg5.969.3812.2810.5480 CrèmeCHfr./1⁄4l3.582.792.792.79-22 EU-3 (UE-4 avec B,sans F et I)fr./ 1⁄4 l1.250.950.980.95-23 - min (D:90/92,00,01,02)fr./ 1⁄4 l1.130.870.910.86-22 - max (A:90/92,B:00,01,02)fr./ 1⁄4 l2.531.641.621.59-36 USAfr./ 1⁄4 l---RôtidebœufCHfr./kg26.3427.7325.9626.351 EU-4fr./kg16.0014.9214.8414.40-8 - min (F:90/92,00,01,02)fr./kg11.8511.7611.7811.69-1 - max (A:90/92,00,01,02)fr./kg24.3223.9323.1022.68-4 USAfr./kg9.2610.9511.9511.9526 RôtideporcCHfr./kg18.4318.6019.3119.354 EU-4fr./kg11.8010.9912.0211.20-3 - min (A:90/92,01;D:00,02)fr./kg10.009.6610.439.59-1 - max (I:90/92,00,01,02)fr./kg13.6712.4313.7013.25-4 USAfr./kg---CôtelettesdeporcCHfr./kg19.8819.8020.7420.402 EU-4fr./kg10.629.2410.189.39-10 - min (D:90/92,00,01,02)fr./kg9.718.399.538.54-9 - max (I:90/92,01;A:00,02)fr./kg12.4310.3611.0610.36-15 USAfr./kg10.0212.5413.1111.6724 JambonCHfr./kg25.5627.1328.4930.2412 EU-4fr./kg22.1319.7020.9920.20-8 - min (D:90/92,00,01,02)fr./kg20.3818.6319.8018.65-7 - max (I:90/92,00,01,02)fr./kg27.1523.1723.4923.99-13 USAfr./kg8.8510.3910.209.6714 PouletfraisCHfr./kg8.418.499.139.357 EU-4fr./kg5.724.935.395.05-10 - min (F:90/92,00,01,02)fr./kg4.843.864.134.07-17
à la consommation des produits animaux
Suisse – divers pays
Prix à la consommation des produits végétaux
Panierstandardfr./k
Moyenne basse de l'UEfr./kg-----
de
UE-4:comprend les pays voisins Allemagne (D),France (F),Italie (I) et Autriche (A)
1Moyenne des 4 années (pour cause d'alternance) 1990/93 et variation 1990/93–1998/2001
Rubrique «Pays»:min.et max.-> prix minimal et prix maximal observés durant une année dans un pays donné
Sources:OFAG,OFS,ZMP,services statistiques nationaux de F,B,A,USA,service statistique de la ville de Turin (I)
ANNEXE A63
Tableau 55
Suisse –
pays ProduitPaysUnité1990/922000200120021990/92–2000/02 % FarineblancheCHfr./kg2.051.751.671.60-18 EU-4 (UE-4 avec B,sans F)fr./kg1.100.910.930.92-16 - min (D:90/92;B:00,01,02)fr./kg0.790.790.780.77-1 - max (A:90/92,00,01,02)fr./kg1.671.001.101.10-36 USAfr./kg0.751.081.131.0745 PainblancCHfr./1⁄2kg2.091.831.751.74-15 EU-4fr./ 1⁄2 kg1.491.501.481.47-1 - min (D:90/92,00,01,02)fr./ 1⁄2 kg1.160.990.970.94-16 - max (A:90/92,00,01,02)fr./ 1⁄2 kg2.982.982.962.90-1 USAfr./ 1⁄2 kg1.121.731.861.7459 PommesdeterreCHfr./kg1.431.872.032.0839 EU-5 (UE-4 avec B)fr./kg0.921.001.101.0614 - min (B:90/92;D:00,01,02)fr./kg0.560.720.790.7737 - max (A:90/92;F:00,01,02)fr./kg1.271.501.621.5823 USAfr./kg1.041.411.451.6946 SucreCHfr./kg1.651.411.421.47-13 EU-3 (UE-4 avec B,sans D,F)fr./kg1.751.541.491.44-15 - min (B:90/92,00,01,02)fr./kg1.671.461.411.38-15 - max (A:90/92,00,01,02)fr./kg1.891.661.661.60-13 USAfr./kg1.221.521.561.4423 HuilevégétaleCH-tournesolfr./l5.053.963.753.88-24 «EU-4» (UE-4 avec B,sans D)fr./l2.812.342.262.32-18 - min (I:90/92,00,01,02)fr./l1.942.122.012.026 - max (F:90/92;F:00,01,02)fr./l3.562.512.452.46-31 USA - huile à saladefr./l2.263.253.293.7051 PommesGoldenDelicious1CHfr./kg3.153.403.413.818 EU-4 (F et A:diverses sortes)fr./kg3.162.372.502.59-21 - min (A:90/92;I:00,01,02)fr./kg2.941.972.122.19-27 - max (D:90/92;F:00,01,02)fr./kg3.252.722.792.99-14 USAfr./kg2.583.423.233.2525 Poires1CHfr./kg3.253.363.463.605 EU-4fr./kg3.432.752.752.87-20 - min (D:90/92,02;I:00,01)fr./kg3.322.402.482.64-25 - max (F:90/92,00,01,02)fr./kg3.623.173.073.36-13 USAfr./kg2.523.593.603.4237 BananesCHfr./kg2.522.832.863.0616 EU-4fr./kg2.612.172.332.14-15 - min (D:90/92,00,01,02)fr./kg1.891.992.161.917 - max (I:90/92;A:00,01,02)fr./kg3.562.462.582.51-29 USAfr./kg1.451.871.891.7426 CarottesCHfr./kg1.911.782.112.094 EU-5 (UE-4 avec B)fr./kg1.711.321.521.43-17 - min (B:90/92,00,01,02)fr./kg1.060.941.161.101 - max (I:90/92,00,01,02)fr./kg2.321.551.671.75-29 USAfr./kg1.352.072.071.9150 OignonsCHfr./kg1.861.942.292.5622 EU-5 (UE-4 avec B)fr./kg1.541.481.671.654 - min (B:90/92,00,01,02)fr./kg0.920.920.991.077 - max (I:90/92;F:00,01,02)fr./kg1.751.922.082.2719 USAfr./kg1.29---
EU-5 (UE-4
B)fr./kg3.603.373.143.46-8 - min
USA
divers
TomatesCHfr./kg3.733.503.213.75-7
avec
(F:90/92;D:01,02;A:00)fr./kg3.332.952.772.93-13 - max (I:90/92,00,01,02)fr./kg4.413.813.734.45-9
(en plein champs)fr./kg3.295.154.924.5448
g-----
UE-4/5fr./kg-----
fr./kg-----
Moyenne haute
l'UEfr./kg----USA
■■■■■■■■■■■■■■■■ Textes légaux relevant du domaine de l‘agriculture
Lois
– Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture,LAgr,RS 910.1)
– Loi fédérale du 20 mars 1959 sur l'approvisionnement du pays en blé (Loi sur le blé,RS 916.111.0)
– Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR,RS 211.412.11)
– Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA,RS 221.213.2).
– Loi fédérale du 8 octobre 1982 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays,LAP,RS 531)
– Loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés (RS 632.111.72)
– Loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD,RS 632.10)
– Loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales (RS 232.16)
– Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA,RS 836.1)
– Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire,LAT,RS 700)
– Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (loi sur les denrées alimentaires,LDAI,RS 817.0)
– Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux,RS 814.20)
– Loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des animaux (LPA,RS 455)
– Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN,RS 451)
– Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement,LPE,RS 814.01)
Ordonnances
Généralités
– Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole,OTerm,RS 910.91)
– Ordonnance du 7 décembre 1998 sur le relevé et le traitement de données agricoles (Ordonnance sur les données agricoles, RS 919.117.71)
– Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'évaluation de la durabilité de l'agriculture (RS 919.118)
Ordonnance du 7 décembre 1998 sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones (Ordonnance sur les zones agricoles,RS 912.1)
Production et ventes
– Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les interprofessions et les organisations de producteurs (RS 919.117.72)
– Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'aide à la promotion des ventes de produits agricoles (Ordonnance sur la promotion des ventes de produits agricoles,RS 916.010)
– Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles et des produits agricoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP,RS 910.12)
– Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits végétaux et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique,RS 910.18)
Ordonnance du 3 novembre 1999 relative à la déclaration de produits agricoles issus de modes de production interdits en Suisse (Ordonnance agricole sur la déclaration;OagrD,RS 916.51)
– Ordonnance générale du 7 décembre 1998 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles,OIA,RS 916.01)
– Ordonnance du 7 décembre 1998 concernant le contingentement de la production laitière (Ordonnance sur le contingentement laitier,OCL,RS 916.350.1)
– Ordonnance du 7 décembre 1998 concernant le prix-cible,les suppléments et les aides dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait,OSL,RS 916.350.2)
A64 ANNEXE
–
–
– Ordonnance du DFE du 7 décembre 1998 concernant le montant des aides pour les produits laitiers et les dispositions relatives au secteur beurrier et à la poudre de lait entier (RS 916.350.21)
– Ordonnance du 7 décembre 1999 concernant la réorganisation du marché laitier (Ordonnance de transition dans le domaine du lait,RS 916.350.3)
– Ordonnance du 7 décembre 1998 concernant l'assurance et le contrôle de la qualité dans l'économie laitière (Ordonnance sur la qualité du lait,OQL,RS 916.351.0)
– Ordonnance du 13 avril 1999 relative à l'assurance de la qualité dans l'exploitation de production laitière (RS 916.351.021.1)
– Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'importation de lait et de produits laitiers,d'huiles et de graisses comestibles,ainsi que de caséines et de caséinates (Ordonnance sur l'importation de lait et d'huiles comestibles,OILHGC,RS 916.355.1)
– Ordonnance de l'OFAG du 30 mars 1999 concernant l'importation de beurre (RS 916.357.1)
– Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'importation d'animaux de l'espèce chevaline (Ordonnance sur l'importation de chevaux,OIC,RS 916.322.1)
– Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie,OBB,RS 916.341)
– Ordonnance du DFE du 7 décembre 1998 sur la volaille (RS 916.341.61)
– Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les effectifs maximums dans la production de viande et d'oeufs (Ordonnance sur les effectifs maximums,OEM,RS 916.344)
– Ordonnance du 7 juillet 1971 concernant la mise en valeur de la laine de mouton du pays (RS 916.361)
– Ordonnance du 7 décembre 1998 sur le marché des oeufs (Ordonnance sur les oeufs,OO,RS 916.371)
– Ordonnance du DFE du 18 juin 1996 sur les oeufs (RS 916.371.1)
– Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les contributions à la surface et à la transformation dans la culture des champs (Ordonnance sur les contributions à la culture des champs OCCC,RS 910.17)
– Ordonnance générale du 16 juin 1986 concernant la loi sur le blé (RS 916.111.01)
– Ordonnance du DFEP du 16 juin 1986 sur l'approvisionnement du pays en blé (RS 916.111.011)
– Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la fixation de droits de douane et sur l'importation de semences de céréales,de matières fourragères,de paille et de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux (Ordonnance sur l'importation de semences de céréales et de matières fourragères,RS 916.112.211)
– Ordonnance du 7 décembre 1998 concernant la mise en valeur ainsi que l'importation et l'exportation de pommes de terre (Ordonnance sur les pommes de terre,RS 916.113.11)
– Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la culture et la transformation des betteraves sucrières (Ordonnance sur le sucre,RS 916.114.11)
– Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'importation et l'exportation de légumes,de fruits et de plantes horticoles (OIELFP,RS 916.121.10)
– Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les mesures d'allégement du marché des fruits à noyau et sur la mise en valeur des fruits à pépins (Ordonnance sur les fruits,RS 916.131.11)
– Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin,RS 916.140)
– Ordonnance de l'OFAG du 7 décembre 1998 sur l'assortiment des cépages et l'examen des variétés (RS 916.143.5)
Paiements directs
– Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs,OPD,RS 910.13)
– Ordonnance du DFE du 7 décembre 1998 sur les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux (Ordonnance SST,RS 910.132.4)
– Ordonnance du DFE du 7 décembre 1998 sur les sorties régulières en plein air d'animaux de rente (Ordonnance SRPA,RS 910.132.5)
– Ordonnance du 29 mars 2000 sur les contributions d'estivage (Ocest,RS 910.133)
– Ordonnance du 4 avril 2001 sur la promotion régionale de la qualité et de la mise en réseau des surfaces de compensation écologique dans l’agriculture (Ordonnance sur la qualité écologique,OQE,RS 910.14)
ANNEXE A65
Amélioration des bases de production
– Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles,OAS,RS 913.1)
– Ordonnance de l'OFAG du 7 décembre 1998 sur l'échelonnement des taux forfaitaires de l'aide à l'investissement (OFOR,RS 913.211)
– Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'aide aux exploitations accordée au titre de mesure d'accompagnement social (Ordonnance sur l'aide aux exploitations OAEx,RS 914.11)
– Ordonnance du 8 novembre 1995 sur la recherche agronomique (ORA,RS 426.10)
– Ordonnance du 13 décembre 1993 sur la formation professionnelle agricole (OFPA,RS 915.1)
– Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'élevage (RS 916.310)
– Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la production et la mise en circulation du matériel végétal de multiplication (Ordonnance sur les semences,RS 916.151)
– Ordonnance du DFE du 7 décembre 1998 sur les semences et les plants des espèces de grandes cultures et de plantes fourragères (Ordonnance du DFE sur les semences et plants,RS 916.151.1)
– Ordonnance du DFE du 11 juin 1999 sur la production et la mise en circulation du matériel de multiplication et des plants d'espèces fruitières et de vigne certifiés (RS 916.151.2)
– Ordonnance de l'OFAG du 7 décembre 1998 sur le catalogue des variétés de céréales,de pommes de terre, de plantes fourragères et de chanvre (Ordonnance sur le catalogue des variétés,RS 916.151.6)
– Ordonnance du 23 juin 1999 sur l'homologation de produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires,RS 916.161)
– Ordonnance du 26 janvier 1994 sur la mise dans le commerce des engrais et des produits assimilés aux engrais (O sur les engrais,RS 916.171)
– Ordonnance du 28 février 2001 sur la protection des végétaux (OPV,RS 916.20)
– Ordonnance du DFE du 25 janvier 1982 sur la déclaration obligatoire des ravageurs et des maladies présentant un danger général (RS 916.201)
– Ordonnance du 28 avril 1982 sur la lutte contre le pou de San José,le feu bactérien et les viroses des arbres fruitiers présentant un danger général (RS 916.22)
– Ordonnance du 26 mai 1999 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux,RS 916.307)
– Ordonnance du DFE du 10 juin 1999 sur la production et la mise dans le commerce des aliments pour animaux, des additifs destinés à l'alimentation animale,des agents d'ensilage et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux,OLAA,RS 916.307.1)
– Ordonnance de l'Office fédéral de l'agriculture du 16 juin 1999 sur la liste des aliments OGM pour animaux (RS 916.307.11)
Les textes légaux peuvent être consultés ou obtenus de la manière suivante:
– Accès par Internetwww.admin.ch/ch/f/rs/rs.html
– Commande à l‘OFCL,Diffusion publications
– par Internetwww.publicationsfederales.ch
– par fax031 325 50 58
A66 ANNEXE
Définitions et méthodes
Définitions
Biens publics: biens caractérisés par la non-rivalité et la non-exclusion.Non-rivalité signifie en l’occurrence que la consommation d’un bien n’entrave nullement la possibilité des autres de le consommer à leur tour.Non-exclusion signifie que personne ne peut être empêché d’avoir part aux biens publics.Par biens publics,on entend,par exemple,la défense nationale,la forêt comme cadre de loisirs ou l’attrait d’un paysage.Comme il n’existe pas de marché,ces biens n’ont pas de valeur marchande.Il incombe donc à l’Etat ou à ses mandataires de veiller à ce qu’ils soient à la disposition de la collectivité.
Dispersion, variance (valeur statistique):dispersion des observations ou des valeurs autour de la moyenne.
Effets externes: effets secondaires ou externalités positifs ou négatifs sur des tiers ou sur la collectivité,résultant des processus de consommation et de production de certains acteurs.N’étant pas saisis par le marché et n’ayant donc pas de prix,ils provoquent des distorsions du marché et une allocation inappropriée de biens et de facteurs de production.Une politique économique rationnelle doit viser à internaliser les effets externes.
Exemples d’effets externes:
Effetsexternesnégatifs(coûtssociaux)
Effetsexternespositifs(utilitésociale)
ProductionConsommation
Pollution de l’eau potable et des
Coûts élevés de santé publique eaux souterraines et superficielles occasionnés par la consommation par une fumure inadéquateexcessive d’alcool et de tabac
Conservation et entretien du paysage Baisse des coûts de santé publique grâce rural par la production agricoleaux sports de masse pratiqués à titre de loisirs
Equivalent de lait: un équivalent de lait correspond à la teneur moyenne d’un kg de lait cru en matière grasse et en protéines (73 g) et sert d’étalon pour le calcul de la quantité de lait contenue dans un produit laitier.
Evaluation (synonyme de contrôle des résultats):L’évaluation est une méthode servant à calculer et à évaluer l’effectivité (réalisation des objectifs),l’efficacité (rapports de cause à effet) et l’efficience (rentabilité) de mesures ou d’instruments,en référence à des objectifs définis préalablement.On s’en sert surtout pour faire des comparaisons:comparaison avec des groupes de contrôle,comparaison «avantaprès»,comparaisons intrasectorielles.
Indicateur agro-environnemental: saisie représentative de données concernant une cause,un état,un changement ou un risque environnemental liés à l’activité agricole,importantes pour les décideurs (p.ex.degré d’érosion du sol;définition de l’OCDE).
Marge du marché: différence entre le prix à la consommation et le prix à la production (valeur absolue),ou part des dépenses du consommateur revenant aux échelons transformation et commerce (valeur relative).Le terme de marge est synonyme.
Médiane: valeur centrale (donnée statistique);valeur située au milieu d’une série (p.ex.de mesures),de sorte à séparer un même nombre de valeurs supérieures et inférieures.
Monitoring: observation continue d’un objet durant une certaine période,à l’aide d’indicateurs et sans analyse des relations de cause à effet.Le monitoring permet de mettre en évidence des évolutions.Exemples:évolution de la surface agricole utile ou de populations d’oiseaux.
ANNEXE A67 ■■■■■■■■■■■■■■■■
Moyenne: moyenne arithmétique (valeur statistique):somme des valeurs d’une série divisée par le nombre de ces valeurs.
Multifonctionnalité de l’agriculture: multiples fonctions remplies par l’agriculture,notamment prestations fournies au-delà de la production agricole proprement dite.Ces dernières comprennent la sécurité alimentaire,l’entretien du paysage rural,la préservation des bases de production et de la diversité biologique ainsi que la contribution de l’agriculture à la viabilité économique et sociale du milieu rural.Une agriculture multifonctionnelle contribue substantiellement à un développement durable.Ses multiples tâches sont mentionnées dans la Constitution fédérale (art.104).
Prix-cible: valeur de référence fixée par le Conseil fédéral pour un kg de lait commercialisé contenant en tout 73 g de matière grasse et de protéines.Ce prix devrait pouvoir être atteint pour le lait transformé en produits à forte valeur ajoutée et commercialisé dans de bonnes conditions.Il dépend notamment de l’appréciation de la situation régnant sur le marché et des moyens disponibles pour le soutien du marché.Le supplément de non-ensilage n’est pas pris en compte.
Propriétés abiotiques: propriétés chimiques et physiques d’un espace,telles que facteurs climatiques (lumière,température,etc.), propriétés du sol,conditions hydrologiques et relief.
Propriétés biotiques: propriétés d’un espace déterminées par les plantes et les animaux qu’il abrite.
Quartile, quart (valeur statistique):subdivision en quatre parties d’une suite de valeurs classées par ordre décroissant.
«Schoggigesetz»: loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés (RS 632.111.72).Application du Protocole 2 de l’accord de libre-échange Suisse – CE de 1972.Compensation de la différence entre les prix des matières premières en Suisse et le prix du marché mondial pour les produits agricoles de base (exportation:subventions à l’exportation / importation: éléments mobiles).
Trafic de perfectionnement: les marchandises importées temporairement en Suisse à des fins de transformation ou de réparation donnent droit,à certaines conditions,à une réduction ou à une exemption des droits de douane.Les produits et les matières de base agricoles bénéficient du trafic de perfectionnement,si des marchandises suisses équivalentes ne sont pas disponibles en quantité suffisante ou que le handicap de l’industrie alimentaire ne peut être compensé par d’autres mesures appropriées.
D’autres termes se trouvent dans:
–«Définitions et terminologie d’économie rurale» (commandes:Landwirtschaftliche Lehrmittelzentrale,Länggasse 79,3052 Zollikofen).
–Ordonnance sur la terminologie agricole (RS 910.91).
A68 ANNEXE
Méthodes
Relevé du prix du lait
L’OFAG relève mensuellement les prix à la production et publie les résultats dans le «bulletin du lait».Pour ce faire,il se fonde sur quatre références:quantité de lait totale,lait industriel,lait transformé en fromage et lait biologique.Ces données sont saisies pour toute la Suisse,mais aussi ventilées selon cinq régions: Région I: Genève,Vaud,Neuchâtel,Jura et les parties francophones du canton de Berne (districts de La Neuveville,Courtelary et Moutier). Région II: Berne (sauf les district de la région I),Lucerne,Unterwald (Obwald. Nidwald),Uri,Zoug et une partie du canton de Schwytz (district de Schwytz et de Küssnacht). Région III: Bâle-Campagne et Bâle-Ville, Argovie et Soleure. Région IV: Zurich,Schaffhouse,Thurgovie.Appenzell (Rhodes intérieures et Rhodes extérieures),Saint-Gall,une partie du canton de Schwytz (districts d’Einsiedeln,March et Höfe),Glaris,Grisons. Région V: Valais et Tessin.
Les cinq régions du relevé des prix
Source: OFAG
Conformément à l’ordonnance sur la réorganisation du marché laitier,les prix payés aux producteurs doivent être relevés auprès des utilisateurs de lait.Tous les transformateurs industriels de poids ainsi qu’un choix représentatif de fromageries participent au relevé.Celui-ci porte ainsi sur plus de 60% de la quantité produite.D’après l’ordonnance précitée,on entend,par prix du lait,le prix payé sur les lieux du relevé (au centre collecteur ou à la ferme),compte tenu des suppléments et déductions usuels dans la localité.Par contre,le supplément de non-ensilage,de même que les cotisations volontaires aux fédérations et les déductions pour le petit-lait ne sont pas compris.
ANNEXE A69
I II III IV V
Calcul des marges brutes de transformation-distribution
Lait et produits laitiers
Pour déterminer la marge brute totale sur le lait et les produits laitiers,il faut,dans un premier temps,procéder au calcul théorique de la valeur ajoutée dans les segments lait de consommation,fromage,beurre,crème de consommation et yoghourt.Cette valeur étant déterminée par kg de lait cru utilisé pour les divers produits,des comparaisons sont possibles.Elle correspond à la différence entre le prix payé au producteur et le prix de vente du produit final par kg de lait utilisé.
Dans un deuxième temps,cette valeur doit être corrigée en fonction des propriétés spécifiques des produits.Pour calculer les marges brutes individuelles,on tient en effet compte des aides allouées par la Confédération,des déductions ou suppléments ainsi que de la valeur des sous-produits issus de la transformation.Ainsi,la marge brute totale sur le lait et les produits laitiers est la résultante de la valeur ajoutée et des propriétés spécifiques de chaque produit.Elle réunit les marges brutes des groupes de produits lait de consommation,fromage,beurre,crème de consommation et yoghourt qui, à leur tour,découlent des calculs effectués pour les produits servant d’indicateurs.
La quantité de lait cru transformée annuellement en Suisse sert de référence pour le calcul de la marge brute totale et des marges brutes individuelles précitées,chaque mode d’utilisation et chaque produit étant pondéré conformément à sa part.
Pour calculer la marge brute,on ne tient compte que de la valeur ajoutée des produits laitiers fabriqués et consommés en Suisse.On déduit donc les exportations de la quantité totale.
Pour le relevé des prix à la consommation,on distingue trois canaux de distribution:grands distributeurs,discounts et magasins spécialisés.Ils sont pondérés d’après les parts de marché,conformément aux indications fournies par l’Institut d'analyse marketing,Hergiswil (IHA GfM).
Marge brute Emmental (octobre 2000)
A70 ANNEXE
PV1/kg Emmental PV1/kg Lait cru Prix du lait Marge brute Emmental Rendement:
des sous-produits, etc. fr. / kg
8%Aides, taxes Valeur
1 PV = prix de vente 0 20.44 1.64 0.81
Source: OFAG
Viande
La marge brute de transformation-distribution sur la viande crue à la consommation en magasin est une valeur réelle (aux prix de janvier 1999) hors TVA (hTVA).Exprimée en francs par kg de «poids mort» (PM),elle correspond à la différence entre le rendement brut et les coûts variables totaux.Cette valeur est aussi la différence entre les recettes nettes et le prix de revient corrigé
Le rendement brut équivaut au chiffre d’affaires du secteur de transformation-distribution ou,en d’autres termes,aux dépenses du consommateur (ménages privés et grossistes).Il comprend la vente de la viande crue à la consommation,ainsi que la mise en valeur de la viande à saucisse,de la peau et des abats par les grossistes.
Les coûts variables totaux englobent plusieurs éléments:premièrement le prix de revient corrigé du bétail – un prix moyen pondéré (conventionnel,labels) franco abattoir
qui inclut donc une éventuelle marge de négociant ou des frais de transport mais qui est diminué du total de l’avantage que procurent les importations à l’intérieur des contingents tarifaires;deuxièmement,les frais d’élimination des abats,de la tête et des pieds,la taxe de transport (RPLP) et la cotisation au marketing de base de Proviande.
Viandes crues d'étal (prix au detail) 15.54 fr./kg PM
Recette nette (POC) 16.62 fr./kg PM
Prix de revient observé (PRO) 9.11 fr./kg PM
Marge brute (MB2) 8.28 fr./kg PM
Viandes à saucisse (prix de gros) 0.56 fr./kg PM Abats vendables (prix au détail) 0.64 fr./kg PM
Abats et os à brûler taxe RPLP, Marketing, 0.12 fr./kg PM
Imp. (TAI) 0.77 fr./kg PM
Prix de revient corrigé (PRC) 8.34 fr./kg PM
Remarque: les proportions de la figure ne correspondent pas à la réalité. Les prix indiqués constituent un exemple pour le calcul de la marge brute sur la viande crue de boeuf en 2000. Ce sont des francs par kilo de carcasse chaude (poids mort, PM), à prix constants (ou réels 01.1999) et hors TVA. Source: OFAG
La marge brute de transformation – distribution est définie plus en détail dans les numéros spéciaux du «Bulletin du marché de la viande» de janvier 2001 et d’avril 2002 (numéros 140 et 155) publiés par la section Observation du marché de l’OFAG.Ces numéros sont disponibles sur demande.
ANNEXE A71
–
Rendement brut (RB) (= fr. du cons.): 16.74 fr./kg PM Co û ts variables totaux: 8.46 fr./kg PM
Fruits et légumes
La marge brute transformation-distribution sur les fruits et les légumes équivaut à la différence entre le prix de revient d’un produit au premier échelon du commerce,déduction faite des frais d’emballage,et le prix de vente final (frais d’emballage inclus).Aussi bien les données relatives au marché suisse que celles concernant les importations sont prises en compte,de même que,pour ces dernières,les prélèvements à la frontière.Le calcul porte sur sept fruits et sept légumes importants,permettant de réaliser un chiffre d’affaires élevé Fruits:pommes (Golden Delicious et principales variétés de garde,telles que Granny Smith,importations,pondération quantitative);poires (suisses et importées,sans les variétés Abate et Nashi,pondération quantitative);fraises,nectarines,cerises,abricots et oranges.Légumes: tomates (charnues et rondes,pondération quantitative),chou-fleur,oignons jaunes,carottes,chicorée Witloof,concombres et pommes de terre.Les chiffres utilisés pour les pondérations quantitatives sont fournis par l’IHA GfM,la Centrale suisse de la culture maraîchère (CCM),Fruit-Union suisse (FUS),l’Office fédéral de la statistique (OFS) et la Direction générale des douanes (DGD).
Marge brute sur les légumes
Le prix de revient des divers produits correspond au prix franco chargeur (les frais d’entreposage des produits de garde sont pris en compte) pour ce qui est de la marchandise suisse et,pour les importations, à la valeur d’importation franco frontière,une pondération quantitative étant effectuée dans les deux cas.Les prix à la consommation sont déterminés à l’aide des données des principaux gros distributeurs et des marchés hebdomadaires.Les canaux de distribution sont pondérés selon leur part de marché,conformément aux indications de l’IHA GfM.Finalement,on additionne les marges individuelles pour obtenir la marge du marché globale sur les légumes.
Marge brute sur les fruits
Le calcul de cette marge est un peu spécial en raison de l’apparition de courte durée de certains fruits saisonniers sur le marché.Elle donne néanmoins de précieux renseignements,surtout dans une comparaison pluriannuelle.
Le prix de revient des produits suisses correspond au prix à la production franco centre collecteur,celui des importations à la valeur d'importation franco frontière,dédouané,une pondération quantitative étant effectuée dans les deux cas.Les frais de stockage et les intérêts sont pris en compte.Les prix à la consommation sont déterminés à l’aide des données des principaux gros distributeurs et des marchés hebdomadaires.Les canaux de distribution sont pondérés selon leur part de marché,conformément aux indications de l’IHA GfM.La marge du marché globale sur les fruits résulte de l’addition des marges individuelles.
A72 ANNEXE
Marge brute fruits et légumes
P importation P revient P dans le pays P vente finale
Marge brute
Source: OFAG
Comptes économiques de l’agriculture – nouvelle méthodologie
Les comptes économiques de l’agriculture (CEA) sont établis par l’OFS,avec l’appui du secrétariat de l’USP,conformément au système européen des comptes généraux de l'économie publique (Eurostat).La nouvelle méthode se fonde sur la nomenclature CEA97 d’Eurostat (auparavant CEA89) et permet de nouveau de comparer directement les résultats avec ceux de l’UE.
Nous décrivons ci-après les changements qu’apporte la nouvelle méthode et illustrons à l’aide d’un exemple leurs répercussions sur le plan quantitatif.La révision implique un remaniement radical.De fait,les résultats ne sont pas comparables avec ceux des années précédentes,tels qu’ils ont été publiés dans les rapports agricoles 2000 à 2002.
Nous distinguons deux types d’adaptation.D’une part,les modifications méthodologiques au sens strict du terme et,d’autre part,une série d’adaptations concernant l’univers des exploitations agricoles saisies dans l’analyse,ainsi que les produits et services pris en considération.
Modifications méthodologiques au sens strict du terme
Abandon de la notion de «ferme nationale»
L’ancien système considérait l’agriculture comme «boîte noire».Les CEA incluaient ainsi uniquement les flux de marchandises et de services entre l’agriculture et les autres secteurs économiques.Désormais,l’analyse prend aussi en compte les flux entre les unités constitutives de la branche d’activité agricole et,lorsque deux branches de production sont concernées,les flux internes au sein des exploitations (p.ex.production de fourrages comme intrant de la production de lait ou de viande).
Redéfinition des prix
Le «prix de base» se substitue au «prix départ ferme».La différence consiste à prendre aussi en considération les subventions directement attribuées à un produit (p.ex.supplément de non-ensilage,contributions à l’exportation d’animaux,soutien de la mise en valeur de pommes de terre).De même,les prix des biens d’approvisionnement («prix d’acquisition») sont corrigés en conséquence (p.ex.prise en compte du remboursement des droits de douane perçus sur les carburants).
ANNEXE A73
CEA97
Agriculture
Unités agricoles CEA89 (ancienne méthode)
(nouvelle méthode)
CEA89, ancienne méthodeCEA97, nouvelle méthode
Prix au producteur
Prix départ ferme
+ Impôts sur produits
Prix au producteur + Subventions sur produits
Prix de base
Impôts sur produits
Plantations
Les plantations et l’augmentation de leur valeur jusqu’à la maturité sont saisies aussi bien dans la production que dans la formation brute de capital fixe.Une fois les plantations arrivées à maturité,la consommation de capital fixe est également imputée à cette valeur.D’après l’ancienne méthode,on n’enregistrait que les variations des plantations (extension ou diminution de la surface totale) sans tenir compte des plantations de remplacement.
CEA89, ancienne méthodeCEA97, nouvelle méthode
Surface du vignoble 2001
Surface du vignoble 2002
FBCF: formation brute de capital fixe
FNCF: formation nette de capital fixe
Extension
Production = FBCF
Surface du vignoble 2001
Surface du vignoble 2002
Renouvellement
Extension
Production = FBCF
FNCF CCF
A74 ANNEXE
–
Adaptation de l’univers des exploitations agricoles et des produits et services pris en considération
Les domaines ci-après sont désormais inclus dans les CEA:
horticulture ornementale (plantes et fleurs,plants de pépinières);
– services offerts par des entreprises spécialisées (p.ex.travaux à façon,insémination artificielle) ou par des agriculteurs (p.ex.travaux à façon);
– activités secondaires non agricoles directement liées à l’activité agricole (activités secondaires non agricoles non séparables).Font partie de cette catégorie la transformation de matières premières agricoles,mais aussi l’utilisation de facteurs de production agricoles à d’autres fins (p.ex.services de déneigement,prise en pension d’animaux);
– vin:la valorisation des raisins se fait désormais selon la mise en valeur visée (vin de table et de qualité,raisins de table,moût);selon l’ancien système CEA89,la récolte de raisins tout entière était valorisée au prix du moût.
Les petits producteurs n’atteignant pas les valeurs seuil ne sont pas pris en compte dans l’univers des exploitations agricoles.Il s’agit surtout d’une partie des producteurs de vins,des apiculteurs et des éleveurs de lapins.
Nouveau CEA97
–Petits producteurs
Quantification des adaptations
Production agricole des exploitations couvertes par l'ancien CEA89
+ Horticulture ornementale
+ Services agricoles des unités spécialisées
+ Valorisation du vin à partir du propre raisin
+ Services agricoles (secondaires)
+ Activités non agricoles non séparables
Le tableau ci-après met en comparaison les résultats selon l’ancienne méthode (CEA89) et selon la nouvelle méthode (CEA97) pour la moyenne des années 1999/2001.A chaque échelon des CEA,les écarts sont attribués aux trois raisons possibles «adaptations méthodologiques au sens strict du terme», «influence de l’horticulture» ou «autres influences».Les adaptations conduisent à un relèvement des valeurs à tous les échelons.
L’abandon du concept de «ferme nationale» est particulièrement manifeste (prise en compte de certains flux au sein des exploitations et entre les unités agricoles) au niveau de la valeur de production et des consommations intermédiaires.L’inclusion de l’horticulture et des services influe également sur ces deux postes.La prise en considération de l’horticulture a en outre une incidence très forte sur la rémunération des salariés.Les activités secondaires non agricoles sont intégrées à la valeur de production et influent aussi sur le montant de la rémunération totale des salariés,mais guère sur les consommations intermédiaires bien évidemment.
Le passage à de nouveaux prix de base a lui aussi un impact non négligeable.Concernant les prix,la prise en considération des subventions liées aux produits signifie aussi que ces deniers ne figurent plus sous la rubrique «Autres subventions sur la production»
L’ensemble de ces adaptations a pour effet de relever le revenu d’entreprise d’environ 30%.
ANNEXE A75
–
A76 ANNEXE CEACEAEffetsEffetsAutresEffet 8997méthodehorticultureeffetstotal mio.fr.mio.fr.mio.fr.%mio.fr.%mio.fr.%mio.fr.% (ø1999–(ø1999–(ø1999–(ø1999–(ø1999–(ø1999–2001)2001)2001)2001)2001)2001) Valeurdeproduction738110483197663,778625,3341113102100 Intraconsommation et flux intrabranche (fourrages,litière)01 2681 26810000001 268 40,9 Horticulture ornementale,pépinières0786007861000078625,3 Services agricoles05415411000000541 17,4 Biens de capital fixe pour compte propre100116161000000160,5 Activités secondaires non agricoles (non séparables)03503501000000350 11,3 Prix de base:ajout des subventions sur produits010710710000001073,5 Prix de base:déduction des impôts sur produits1500-1501000000-150-4,8 Valorisation du vin022900002291002297,4 Petits producteurs,ménages non agricoles1560-1561000000-156-5,0 Autres effets nets de la révision011100001111001113,6 Consommationsintermédiaires38645733174193,129115,6-163-8,71870100 Intraconsommation et flux intrabranche (fourrages,litière)01 2681 26810000001 268 67,8 Services agricoles05415411000000541 28,9 Horticulture ornementale,pépinières0291002911000029115,6 Vinification,encavage065000065100653,5 Prix d’acquisition:impôts-restitutions sur les carburants670-671000000-67-3,6 Frais d’entretien et de réparation en machines et installations8695160000-354100-354 -18,9 Autres effets nets de la révision012600001261001266,7 Valeurajoutéebrute351747502351949440,150340,91232100 Consommation de capital fixe1 8651 982120102,23328,4-36-30,6117100 Valeurajoutéenette1653276711510,346141,353948,41115100 Rémunérationdessalariés72111496114,331072,45713,3428100 Autresimpôtssurlaproduction1851211-1,92-2,8-67104,7-64100 Autres impôts sur la production (sans sous-compensation TVA)85541-45-17,6-37121,6-3147,7 Sous-compensation TVA (nette)1006700-410,8-3089,2-3452,3 Subventions24962352-175120,80030-20,8-145100 Subventions sur produits1070-1071000000-107 74,3 Restitutions droits carburants670-671000000-67 46,5 Autres subventions2 3222 35200003010030 -20,8 Excédentnetd’exploitation/ revenumixtenet32423849-123-20,215024,658095,6607100 Fermages à payer2252080000-17100-17100 Intérêts de la dette à payer50436523-16,521-15-182131,5-138100 Revenunetd’entreprise25133276-145-19,112916,9779102,2762100
Comptes économiques de l’agriculture
Composition de la valeur de production
Intraconsommation
Production du secteur économique agricole
Autres subventions
Transformation par les producteurs
Autoconsommation par les ménages agricoles
Ventes à d’autres unités agricoles
Ventes hors agriculture, en Suisse et à l’étranger
Subventions sur produits
Production du secteur économique agricole
Valeur ajoutée brute aux prix de base
Valeur ajoutée nette aux prix de base
Revenu des facteurs
Excédent net d’exploitation / revenu mixte net
Revenu net d’entreprise 1
Fermages et intérêts dus Rémunération des salariés Autres impôts sur la production
1 est désigné comme bénéfice net d entreprise dans la littérature et dans la méthodologie Eurostat
Biens de capital fixe pour compte propre
Variations des stocks
Consommation de capital fixe
Consommations intermédiaires
Source: OFS
ANNEXE A77
Dépouillement centralisé de la FAT
Nouvelle méthode
La méthode du dépouillement centralisé a changé fondamentalement dès les bilans de clôture de 1999.Par le passé,on déterminait le revenu d’exploitations-témoins répondant à des critères stricts (p.ex.limitation du revenu accessoire,exigence d’une formation spécialisée).Comme il s’agissait d’une sélection sciemment positive,les résultats ne pouvaient être extrapolés.En revanche,le nouveau système des «exploitations de référence»,représentatives,permet de faire des constatations concernant l’agriculture tout entière.
Aperçu des changements méthodologiques concernant le dépouillement centralisé
Sont considérées comme population toutes les exploitations suisses pouvant,en principe,servir de référence pour le dépouillement centralisé.Elles doivent à cet effet atteindre certains seuils.Ainsi,une exploitation comptant une surface d’au moins 10 ha ou gardant au moins 6 vaches appartient automatiquement à la population.Celle-ci comprend quelque 57'000 exploitations,ce qui correspond à quelque 90% de la surface exploitée et à quelque 90% de la production.
Dans cette population on choisit quelque 3'500 exploitations de référence.
– Comme les structures de ces exploitations de référence diffèrent de celles de l’agriculture prise dans son ensemble,on procède à une pondération des résultats comptables.On se sert, à cet effet,des données concernant la répartition des exploitations selon la grandeur et le type et d’après les zones.Les résultats comptables des petites exploitations,sous-représentées dans le groupe de référence,acquièrent ainsi le poids qui leur revient.
– On a aussi introduit une nouvelle typologie des exploitations,qui distingue mieux les types importants du point de vue de la politique agricole.Environ deux tiers des exploitations peuvent être attribuées à sept types spécialisés se concentrant sur certaines branches de la production végétale ou de l’élevage.Le dernier tiers comprend quatre types d’exploitations combinées (cf.ci-après).
Grâce à la représentativité accrue et à la pondération,les résultats du dépouillement centralisé concernant l’ensemble de l’agriculture sont plus informatifs.Il est aussi plus facile de comparer les données comptables au plan international.Par contre,les changements méthodologiques ont rendu impossible la comparaison des données récentes avec d’anciens rapports sur le dépouillement centralisé.Afin de pouvoir,malgré tout, établir des comparaisons pluriannuelles,nous avons appliqué rétroactivement la nouvelle méthode aux données comptables des années précédentes.
La nouvelle typologie des exploitations FAT99
Dans le cadre des modifications méthodologiques proposées par la FAT (Station fédérale de recherches en économie et technologie agricoles),l’ancienne typologie des exploitations,fondée sur les travaux de la «Commission verte» (1966),a été remplacée par une nouvelle typologie (FAT99).Outre son utilisation dans la présentation des résultats,FAT99 sert à la sélection des exploitations et à la pondération de leurs données.
La répartition des exploitations selon la nouvelle typologie se fait exclusivement sur la base des critères «surfaces» et «UGB» concernant les différentes catégories animales.Dix chiffres-clés ou huit quotients par exploitation permettent une répartition différenciée et claire.
A78 ANNEXE
–
–
Définition de la nouvelle typologie des exploitations FAT99
DomainesTyped'exploitationUGB/TO/CS/UGBB/VL/VA/ChMC/PVol/Autres SAUSAUSAUUGBUGBBUGBBUGBUGBconditions
11ProductionGrandes culturesau max.plus demax. végétale170%10%
12Cultures spécialesau max.plus de 110%
21GardeLait commercialisé au max.au max.plus de plus de au max. d’animaux25%10%75%25%25%
22Vaches allaitantesau max.au max.plus de au max.plus de 25%10%75%25%25%
23Autres bovinsau max.au max.plus deni 21 25%10%75%ni 22
31Chevaux/moutons/au max.au max.plus de chèvres25%10%50%
41Perfectionnementau max.au max.plus de 25%10%50%
51DomainesLait commercialisé/plus deplus deplus deau max.pas combinésgrandes cultures40%75%25%25%11– 41
52Vaches allaitantesplus deau max.plus depas 75%25%25%11– 41
53Perfectionnementplus depas 25%11– 41
54Autres pas 11– 53
Les exploitations doivent satisfaire à tous les critères prévus dans une ligne.
Abréviations:
UGBunités de gros bétail
SAUsurface agricole utile en ha
UGB/SAUcharge en bétail par ha de SAU
TO/SAUpourcentage de terres ouvertes par rapport à la SAU
CS/SAUpourcentage de cultures spéciales par rapport à la SAU
UGBB/UGBpourcentage d UGB bovines par rapport au cheptel total
VL/UGBBpourcentage de vaches laitières par rapport à l’effectif de bovins
VA/UGBBpourcentage de vaches allaitantes par rapport à l effectif de bovins
ChMC/UGBpourcentage de chevaux,de moutons et de chèvres par rapport au cheptel total
PVol/UGBpourcentage de porcs et de volaille par rapport au cheptel total
Source:FAT
On distingue sept types d’exploitations spécialisées et quatre types combinés.Les exploitations spécialisées en production végétale (11 et 12) ont un chargement en bétail inférieur à une UGB par ha de SAU.Le pourcentage de terres ouvertes dépasse 70% de la SAU dans les exploitations vouées aux grandes cultures et 10% dans celles qui pratiquent des cultures spéciales.Quant aux exploitations spécialisées en production animale (21–41),leur surface de terres ouvertes et de cultures spéciales ne doit pas dépasser 25% et 10% respectivement.Des exploitations sont considérées comme étant spécialisées dans la production de lait commercialisé ou,au contraire, dans la garde de vaches mères,lorsque les vaches laitières ou les vaches mères représentent plus de 25% du cheptel bovin.Le groupe restant («autres bovins») réunit surtout des exploitations gardant des vaches laitières sans contingent (exploitations de montagne,spécialisées dans l’engraissement de veaux et dans l’élevage).Quant aux exploitations vouées au perfectionnement,les porcs et la volaille représentent plus de la moitié de leurs effectifs.Enfin,les exploitations ne pouvant être attribuées à aucun des sept types précités,sont qualifiées de combinées (51–54).
ANNEXE A79
Présentation des résultats
Conformément à l’art.7 de l’ordonnance sur l’évaluation de la durabilité,la situation économique doit aussi être appréciée selon les régions.A cet effet,trois régions ont été définies en référence à l’ordonnance sur les zones agricoles:
région de plaine:zone de grandes cultures et zones intermédiaires – région des collines:zone des collines et zone de montagne I – région de montagne:zones de montagne II à IV
Délimitation des régions de plaine, des collines et de montagne (Communes en fonction de leur attribution à une zone prépondérante)
Région de plaine
Région des collines
Région de montagne
Afin de pouvoir apprécier la dispersion de certains chiffres-clés de manière différenciée,nous avons réparti les exploitations considérées en quartiles,en nous fondant sur le revenu du travail par unité de main-d’œuvre familiale UTAF.Chaque quartile (0–25% / 25–50% / 50 –75% / 75–100%) comprend un quart des exploitations de la population.
La représentation en quartiles permet une appréciation différenciée du point de vue économique.Par contre,on a renoncé à une différenciation écologique,car la part d’exploitations de référence ne fournissant pas les prestations écologiques requises est inférieure à 3%, et la différence des revenus du travail est minime.
L’art.5 LAgr exige l’appréciation de la situation économique «en moyenne pluriannuelle».C’est la raison pour laquelle les évolutions sont représentées sur plusieurs années.Quant aux considérations plutôt statiques,elles se basent sur la moyenne la plus récente de trois ans (en l’occurrence 1998/2000).
A80 ANNEXE
–
Source: données SIPA 1998 OFAG Limites communales © OFS GEOSTAT
Comparaison des revenus
En vue de la comparaison des revenus,on détermine le revenu du travail des agriculteurs,d’une part,et le salaire annuel brut des autres groupes de la population,d’autre part.La situation salariale de ces derniers est saisie tous les deux ans par l’OFS à l’aide de son enquête sur la structure des salaires.Dans les années intermédiaires,les données sont actualisées au moyen de l’indice de l’évolution des salaires. L’enquête sur leur structure donne un aperçu représentatif de la situation salariale des employés de l’industrie (secteur secondaire) et des services (secteur tertiaire).
Composantes salariales saisies (enquête de l’OFS sur la structure des salaires)
Salaire brut du mois d’octobre (y compris cotisations de l’employé aux assurances sociales,prestations en nature,parts de primes,de chiffre d’affaires ou de provision régulièrement versées),indemnisations pour travail par équipes,travail de nuit et du dimanche, 1⁄12 du 13e salaire et 1⁄12 des paiements spéciaux annuels.
Standardisation: conversion des cotisations (y compris charges sociales) en un temps de travail uniforme de 4 1⁄3 semaines à 40 heures.
Les chiffres de l’enquête sur la structure des salaires sont convertis en salaires annuels bruts.Ensuite,on détermine,pour chaque région, la médiane de tous les employés des secteurs secondaire et tertiaire.
On calcule,pour l’agriculture,le revenu du travail agricole par UTAF,qui est le pendant des salaires annuels bruts.Une UTAF se base sur 280 journées de travail,une personne correspondant au maximum à 1,0 UTAF.
Calcul du revenu du travail agricole
Revenu agricole
– intérêts servis sur le capital propre engagé dans l’exploitation (taux d’intérêt moyen des obligations de la Confédération)
=revenu du travail réalisé par la famille du chef d’exploitation
:nombre d’unités de main-d’œuvre familiale (UTAF) (base:280 journées de travail)
= revenu du travail par UTAF
ANNEXE A81
Exigences requises pour l’octroi de paiements directs (état août 2003)
Exigences générales
A droit aux paiements directs l’exploitant qui gère une exploitation agricole pour son compte et à ses risques et périls et qui a son domicile civil en Suisse.N’y ont pas droit les exploitations de la Confédération,des cantons et des communes,ni les exploitants dont les cheptels dépassent les plafonds fixés dans l’ordonnance sur les effectifs maximums.Sont également exclues les personnes morales,sauf s’il s’agit d’exploitations familiales (art.2,OPD).
Prestations écologiques requises (PER)
L’exploitant qui sollicite des paiements directs doit prouver aux autorités cantonales compétentes qu’il gère l’ensemble de son exploitation selon les exigences liées aux PER ou selon les règles reconnues par le Conseil fédéral (cf.les explications ci-dessous).
Autres exigences
Le droit aux contributions est encore lié à d’autres critères structurels et sociaux.Le schéma ci-après récapitule en quelques mots clés les conditions liées à l’octroi des paiements directs.
Conditions requises pour l’octroi des paiements directs
Tailleminimaledel’exploitation
Besoinminimalentravail
Main-d’œuvrepropreàl’exploitation
1 ha
Cultures spéciales:50 ares Surfaces viticoles en forte pente et en terrasses:30 ares
0,3 unité de main-d’oeuvre standard (UMOS)
Au moins 50% des travaux nécessaires à l’exploitation effectués à l'aide de la main-d'œuvre propre à l'exploitation (famille et employés).
Âgedel’exploitant Jusqu’à 65 ans
Plafonnementdescontributions
EchelonnementSurface en haNombre d’animaux,Taux en % en UGB jusqu’à 3045100
30–6045–9075
60–9090–13550 plus de901350
Montant maximum par UMOS
55 000 fr.
Revenu déterminant (revenu imposable réduit de 30 000 fr.pour les couples Somme des paiements directs réduite dès 80 000 fr. d’agriculteurs mariés)de revenu déterminant
Fortune déterminante (fortune imposable réduit de 200 000 fr.Somme des paiements directs réduite dès 800 000 fr.de fortune par UMOS et de 200 000 fr.pour les couples d’agriculteurs mariés)déterminante;suppression des paiements directs si la fortune déterminante dépasse fr.1 million.
Source:ordonnance sur les paiements directs
A82 ANNEXE
–
–
–
–
Terrains en pente dans la région de montagne et des collines0,02 UMOS par ha Culture biologique Comme pour la SAU,plus 20% Arbres fruitiers haute-tige 0,01 UMOS/10 arbres
Source:ordonnance sur la terminologie agricole
Le calcul des UMOS se fait à l’aide de facteurs de conversion pour la SAU et les animaux de rente.Des suppléments sont versés pour certains modes d’exploitation tels que la culture biologique,qui demande plus de travail.Ces facteurs sont dérivés du relevé standard des processus de l’économie du travail.Ils ont été simplifiés pour l’exécution des paiements directs et pour les mesures relevant des améliorations structurelles.Ils ne se prêtent pas au calcul du besoin en travail effectif puisque celui-ci dépend des particularités de l’exploitation telles que la configuration du terrain,le regroupement des terres,les bâtiments ou le degré de mécanisation.
Echelonnement des contributions selon art. 20 OPD
L’échelonnement en pour-cent vaut pour tous les types de contributions, à l’exception de celles qui sont allouées pour l’estivage et pour la protection des eaux.
ANNEXE A83 SurfaceagricoleutileUMOS/ha SAU sans les cultures spéciales 0,035 Cultures spéciales 0,400 Surfaces viticoles en forte pente et en terrasses 1,000 AnimauxderenteUMOS/UGB Vaches laitières,brebis laitières et chèvres laitières 0,05 Porcs à l’engrais 0,01 Porcs d’élevage 0,02 Autres animaux de rente 0,04
Suppléments
Surfaces 1–30 ha>30–60 ha>60–90 ha>90 ha % du taux de contribution Cheptel / Animaux de rente 1–45 UGBFG>45–90 UGBFG>90–135 UGBFG>135 UGBFG % du taux de contribution 0 100 75 50 0 100 75 50
Prestations écologiques requises (PER)
Les PER visent une approche globale des systèmes agro-écologiques et des exploitations agricoles.C’est à cette fin que les critères développés pour la production intégrée (PI) ont été repris,et que les PER ont vu le jour (état 1996).Par ailleurs,les exploitants doivent prouver qu’ils respectent les prescriptions de la législation sur la protection des animaux.La PI,complétée par lesdites prescriptions,est ainsi devenue la norme de l’agriculture suisse.Les paiements directs sont versés seulement aux exploitants qui fournissent les PER.Ceux qui ne satisfont pas aux exigences des PER ont touché des paiements réduits jusqu’au 31 décembre 2001.L’instauration des PER a permis d’intégrer les charges liées à la production intégrée (PI, état 1996).L’instauration de paiements directs a exercé une influence considérable sur les systèmes d’exploitation et,partant,sur l’écologie,ce qui se traduit entre autres par l’important accroissement des surfaces exploitées selon les directives PER et bio.Si au début de la première étape de la réforme agricole en 1993,leur part représentait 20% à peine,elle concerne aujourd’hui plus de 99% de la SAU.C’est grâce à des incitations financières ciblées qu’il a été possible de réaliser une participation aussi importante des exploitations.On signalera par ailleurs que certaines exploitations telles que les domaines de l’Etat ou les personnes morales ne bénéficient pas du système de paiements directs,même si elles répondent aux exigences des PER ou de l’agriculture biologique.
Les PER comprennent les points suivants:
– Devoir d’enregistrement et de preuve:pour avoir droit aux paiements directs,l’exploitant doit prouver qu’il fournit les PER dans l’ensemble de son exploitation,au moyen d’une attestation délivrée par l’organisation de contrôle cantonale.Pour recevoir celle-ci,il tiendra à jour des enregistrements concernant la gestion de l’exploitation.
– Garde des animaux de rente respectueuse de l’espèce:les dispositions de l’ordonnance sur la protection des animaux doivent être observées,le renversement du fardeau de la preuve étant valable en l’occurrence,c’est-à-dire que l’exploitant doit prouver qu’il respecte la loi sur la protection des animaux.
– Bilan de fumure équilibré:pour réduire les pertes d’éléments nutritifs dans l’environnement et garder le cycle de ces éléments aussi fermé que possible,les apports d’azote et de phosphore doivent être calculés en fonction du besoin des plantes et du potentiel de production de l’exploitation.Dans le bilan de fumure,on utilise essentiellement les engrais de ferme;le recours aux engrais minéraux et aux engrais à base de déchets n'est justifié qu’en cas de besoin,et une tolérance de 10% est assurée.
– Des analyses du sol doivent être effectuées par parcelle au moins tous les dix ans,pour que l’on puisse connaître les réserves du sol en nutriments et adapter en conséquence les engrais nécessaires au maintien de la fertilité du sol.
– Part équitable de surfaces de compensation écologique (SCE):au moins 3,5% de la SAU dans le cas des cultures spéciales,et 7% pour le reste de la SAU.Des bandes herbeuses d'une largeur minimale de 0,5 m doivent être maintenues le long des chemins,et d’une largeur de 3 m le long des cours d’eau,des plans d’eau,des haies,des bosquets champêtres,des berges boisées et des lisières de forêt.
Assolement régulier:pour maintenir la fertilité du sol et assurer un bon état sanitaire des plantes,le plan d’assolement annuel doit comprendre un minimum de quatre cultures différentes dans les exploitations comptant plus de 3 ha de terres ouvertes.Des parts maximales des cultures principales aux terres ouvertes ou des pauses entre les cultures sont également prescrites.
A84 ANNEXE
–
– Protection appropriée du sol:un indice de protection du sol est défini pour chaque culture.Afin de réduire l’érosion du sol et les pertes d’éléments nutritifs ou de produits de traitement des plantes,les exploitations de plus de 3 ha de terres ouvertes sont tenues d’atteindre un certain nombre de points pour l’indice moyen de protection.Pour les cultures des champs,cet indice est de 50 points, contre 30 points pour les cultures maraîchères.Les dates des relevés sont le 15 novembre et le 15 février.
Sélection et utilisation ciblée des produits de traitement des plantes:ces produits peuvent atteindre l’air,le sol et l’eau et entraîner des effets négatifs non souhaitables sur certains organismes.On leur préférera des mécanismes de régulation naturels et des procédés biologiques.Certains traitements sont interdits en culture des champs et en culture fourragère (p.ex.herbicides en prélevée pour le froment).Pour les cultures spéciales,les produits autorisés avec certaines restrictions d’utilisation sont régulièrement actualisés sur des listes.
ANNEXE A85 Exemplesdepartsmaximalesdeculturesen%desterresassolées – Céréales (sans le maïs et l’avoine) 66 – Blé et épeautre 50 – Maïs 40 – Avoine 25 – Betteraves 25 – Pommes de terre 25
Exemplesdel’indicedeprotectiondusolenculturedeschampsPoints Colza 80 Orge d’automne,triticale,seigle,avoine d’automne 50 Blé d’automne, épeautre 40 Prairie artificielle jusqu’au 15 novembre 80 Prairie artificielle jusqu’au 15 février 100 –
Observation des lois
Si l’exploitant viole les prescriptions pertinentes de la loi sur la protection des eaux,de la loi sur la protection de l’environnement et de la loi sur la protection de la nature et du paysage,il risque non seulement une amende mais encore une réduction ou une suppression des paiements directs.
Voici quelques exemples de prescriptions dont la violation peut entraîner des sanctions:
– Devoir de diligence destiné à empêcher toute atteinte nuisible aux eaux (art.3 LEaux);
Interdiction d’introduire ou d’infiltrer dans une eau des substances de nature à la polluer et de déposer et d’épandre de telles substances s’il existe un risque concret de pollution de l’eau (art.6 LEaux);
– Non-respect des valeurs limites relatives aux UGBF fixées à l’art.14 LEaux (en fonction de la surface agricole utile fertilisable);
Capacité de stockage insuffisante pour les engrais de ferme selon l’art.14 LEaux;
– Destruction ou endommagement d’un biotope protégé par la Confédération ou le canton,notamment de roselières et de marais, de haies,de bosquets champêtres et de prairies sèches,d’une curiosité naturelle ou d’un monument protégés,d’un site protégé évocateur du passé,d’un site naturel protégé (sites marécageux compris),lorsque l’exploitation agricole en est la cause (art.24, al.1,let.a,LPN en combinaison avec l’art.18,al.1bis,LPN).
– Infractions à l'interdiction d'incinérer des déchets (art.26a OPair)
Les infractions à ces prescriptions sont traitées individuellement en fonction des faits antérieurs et compte tenu des conséquences qu’elles entraînent.Elles sont attribuées à l’une des trois catégories suivantes:
Infraction unique sans effets durables.Exemple: épandage unique de purin,contraire à la législation sur la protection des eaux (réduction de 5 à 25%,et de 2’500 fr.au max.).
Infractions uniques aux effets persistants,agissements ou omissions s’étendant sur plusieurs jours,semaines ou mois.Exemple:tas de fumier non consolidé; épandages successifs de purin à des jours différents,contraires à la législation sur la protection des eaux (réduction de 10 à 50%,et de 10’000 fr.au max.).
– Infractions répétées dans les trois ans contre les mêmes dispositions ayant trait à l’agriculture.Sont déterminants les incidents à partir de l’année 1999 (réduction de 20 à 100%).
A86 ANNEXE
–
–
–
–
Organisation/institution
AFDAdministration fédérale des douanes,Berne
DFEDépartement fédéral de l’économie,Berne
DGDDirection générale des douanes,Berne
EPFZEcole polytechnique fédérale,Zurich
FALStation fédérale de recherches en écologie et agriculture,Zurich-Reckenholz
FAMStation fédérale de recherches laitières,Liebefeld-Berne
FAOOrganisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture,Rome
FATStation fédérale de recherches en économie et technologie agricoles,Tänikon
FAWStation fédérale de recherches en arboriculture,viticulture et horticulture,Wädenswil
IERInstitut d’économie rurale,Zurich
IRABInstitut de recherche en agriculture biologique,Frick
LBLLandwirtschaftliche Beratungszentrale,Lindau (Centrale de vulgarisation agricole de Lindau)
OCDEOrganisation de coopération et de développement économique,Paris
OFAEOffice fédéral pour l’approvisionnement économique du pays,Berne
OFAGOffice fédéral de l’agriculture,Berne
OFASOffice fédéral des assurances sociales,Berne
OFEFPOffice fédéral de l’environnement,des forêts et du paysage,Berne
OFFTOffice fédéral de la formation professionnelle et de la technologie,Berne
OFSOffice fédéral de la statistique,Neuchâtel
OFSPOffice fédéral de la santé publique,Berne
OMC Organisation mondiale du commerce,Genève
OVFOffice vétérinaire fédéral,Berne
PSLProducteurs Suisses de Lait,Berne
RACStation fédérale de recherches en production végétale,Changins
RAPStation fédérale de recherches en production animale,Posieux
secoSecrétariat d'Etat à l'économie,Berne
SRVAService romand de vulgarisation agricole,Lausanne
TSMFiduciaire de l'économie laitière S.àr.l,Berne
UEUnion européenne
USPUnion suisse des paysans,Brougg
ZMPZentrale Markt- und Preisberichtstelle für Erzeugnisse der Land-,Forst- und Ernährungswirtschaft S.àr.l,Bonn
Unités de mesure
ct.centime
dtdécitonne = 100 kg fr.franc
hahectare = 10'000 m2 hlhectolitre kcalkilocalorie kgkilogramme
ANNEXE A87
■■■■■■■■■■■■■■■■ Abréviations
hheure
llitre
kmkilomètre
mmètre
m2 mètre carré
m3 mètre cube
mio.million
mrd.milliard
pcepièce
ttonne
%pour cent
Ømoyenne
Notion/désignation
AGPappellation géographique protégée
AOCappellation d’origine contrôlée
AVSassurance-vieillesse et survivants
CO2 dioxyde de carbone
ESBencéphalopathie spongiforme bovine («maladie de la vache folle»)
IVassurance-invalidité
LAgrloi sur l’agriculture
MPRmatières premières renouvelables
Nazote
OGMorganismes génétiquement modifiés
Pphosphore
PVpoids vif
PACpolitique agricole commune de l’UE
PERprestations écologiques requises
PIproduction intégrée
PMpoids à l’abattage
PTPproduit de traitement des plantes
SAUsurface agricole utile
SCEsurface de compensation écologique
SIPASystème d’Information de Politique Agricole
SRPAsorties régulières en plein air
SSTsystème de stabulation particulièrement respectueux des animaux
TCtaux du contingent
THCtaux hors contingent
TVAtaxe sur la valeur ajoutée
UGBunité de gros bétail
UGBFGunité de gros bétail fourrages grossiers
UMOSunité de main-d’oeuvre standard
UTAunité de travail annuel
UTAFunité de travail annuel de la famille
ZM I,II,..zone de montagne I,II,....
Référence à d’autres informations en annexe (p.ex.tableaux)
A88 ANNEXE
Demoscope,2003.
Leistungs- und kommunikationsbedingte Vor- und Nachteile von schweizerischen Landwirtschaftsprodukten,3.Welle 2003.
Fuhrer J.,2001.
Klimaschonende Landwirtschaft.
UFA-Revue 9/01.
Interface/Evaluanda,2002.
Zwischenevaluation Regio Plus und Landwirtschaftliche Absatzförderungsverordnung. Luzern.
Lehmann B.,Gerwig C.,(Institut d’économie rurale,EPF-Zurich),2002.
Betriebswirtschaftliche Analyse der Umlagerung der Stützung vom Produkt zu Produktionsfaktoren im Milchsektor (Talgebiet).
Suite de l’étude «Umlagerung der Milchpreisstützung»,partie 1
Leifeld J.,Bassin S.and Fuhrer J.,2003. Carbon stocks and carbon sequestration potentials in agricultural soils in Switzerland. Cahiers de la FAL no 44,Zurich-Reckenholz.
Luder W.,2003.
Arbeitsbelastung:was sind Ursachen?
Agil 7,Lindau.
Mack G.,Mann St.,Pfefferli St.,(Station fédérale de recherches en économie et technologie agricoles,FAT),2003.
Sektorale Auswirkungen der Aufhebung der Milchkontingentierung und Umlagerung der Stützung. Suite de l’étude «Umlagerung der Milchpreisstützung»,partie 4.
Membres du groupe d’accompagnement IER,FAT,OFAG,PSL et USP. Effekte einer Aufhebung der Milchkontingentierung und einer Umlagerung der Milchpreisstützung. Synthèse de la suite de l’étude «Umlagerung der Milchpreisstützung»,parties 1 à 4.
OcCC,2002.
Le climat change,en Suisse aussi.
Office fédéral de l’agriculture (OFAG),2000.
Rapport agricole 2000.
Office fédéral de l’agriculture (OFAG),2001.
Rapport agricole 2001.
Office fédéral de l’agriculture (OFAG),2002. Evaluation des données sur le contingentement laitier,année laitière 2001/2002.
Office fédéral de l’agriculture (OFAG),2002. Rapport agricole 2002.
ANNEXE A89 ■■■■■■■■■■■■■■■■
Bibliographie
Office fédéral de l’agriculture (OFAG),2002. Rapport «Inventaire du patrimoine culinaire de la Suisse». donnant suite au postulat no 00.3556 du conseiller national Zisyadis du 6 octobre 2000.
Office fédéral de l’agriculture (OFAG),2002.
Evaluation des mesures écologiques et des programmes de garde d’animaux. Rapport final pour la catégorie vaches laitières,Berne.
Office fédéral de l’agriculture (OFAG),2003.
Evaluation des mesures écologiques et des programmes de garde d’animaux. Rapport final pour la catégorie porcs à l’engrais.
Office fédéral de l’agriculture (OFAG),2003.
Publication de l'attribution des contingents tarifaires. selon le point 2 du rapport du Conseil fédéral du 19 février 2003 sur les mesures tarifaires douanières 2002,tiré à part.
Office fédéral de la statistique (OFS),2001.
Reflets de l'agriculture suisse,édition 2001, Neuchâtel.
Office fédéral de la statistique (OFS),2002. Environnement Suisse,statistiques et analyses.
Office fédéral de l’énergie (OFEN),1999
Statistique globale suisse de l’énergie.
Office fédéral de l’environnement,des forêts et du paysage (OFEFP),2000.
Graue Treibhausgas-Emissionen des Energie- und des Ernährungssektors der Schweiz 1990 und 1998.
Document environnement no 128,Berne.
Office fédéral de l’environnement,des forêts et du paysage (OFEFP),2001.
Böden der Schweiz.Schadstoffgehalte und Orientierungswerte (1990–1996).
Document environnement no 139,Berne.
Office vétérinaire fédéral (OVF),2003.
Prävalenz latenter Zoonoseerreger in tierfreundlicher Schweinproduktion.
Pro Clim,2002.
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC):Klimaänderung 2001, Zusammenfassung für Politische Entscheidungsträger (version française en préparation).
Putaud J.P.,Van Dingenen R.and Raes F.,2002.
Submicron aerosol mass balance at urban and semirural sites in the Milan area (Italy).
Journal of Geophysical Research,Vol.107,No.D22,8198,doi:10.1029/2000JD000111.
Rossier D.,1999.
Evaluation simplifiée de l’impact environnemental de l’agriculture suisse.
Schick M.,Riegel M.,2003. Arbeitsqualität in der Milchviehhaltung. AGRARForschung 10 (4),Posieux.
A90 ANNEXE
SRVA/FAL/FAT,2000. Bilan écologique de l’exploitation agricole.
Swiss Confederation,2002.
Swiss Greenhouse Gas Inventory 2000.
UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC),2001. Third National communication of Switzerland 2001,Swiss Confederation,2001. Edited and published by Swiss Agency for the Environment,Forests and Landscape.
Union suisse des paysans (USP),diverses années. Statistiques et évaluations concernant l’agriculture et l’alimentation, Brougg.
ANNEXE A91
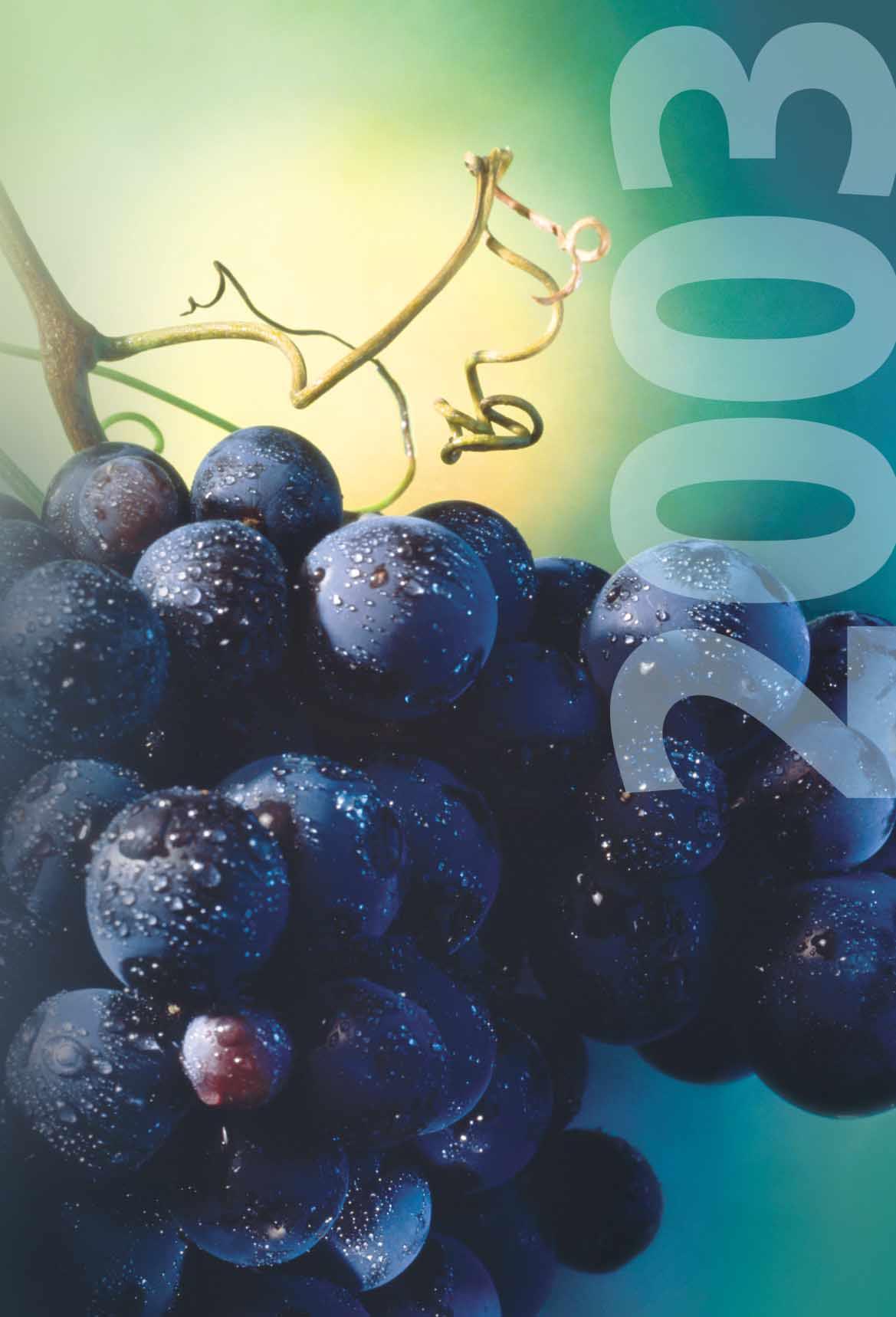

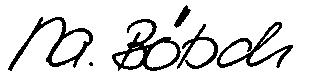 Directeur de l’Office fédéral de l’agriculture
Directeur de l’Office fédéral de l’agriculture




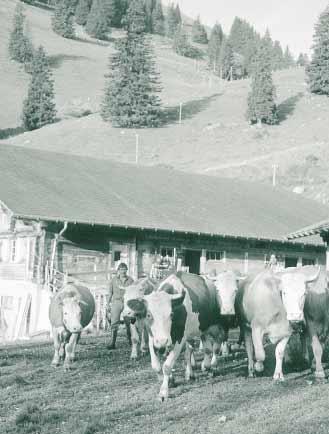




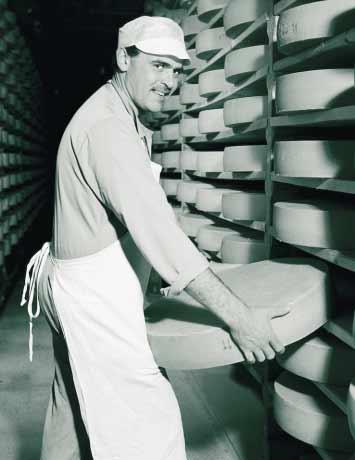

 ■ Marge brute sur le lait
■ Marge brute sur le lait


 Tableaux 4–13,pages A4–A12
Tableaux 4–13,pages A4–A12

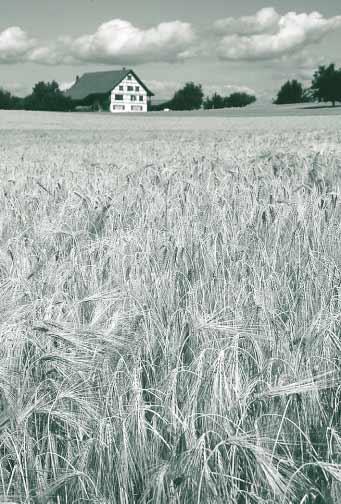

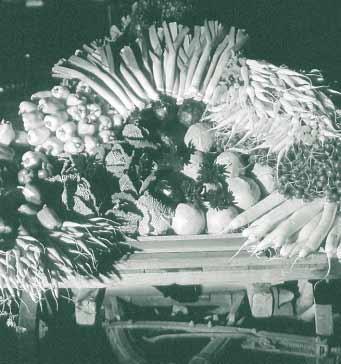










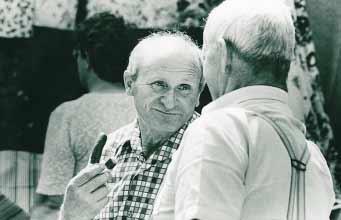
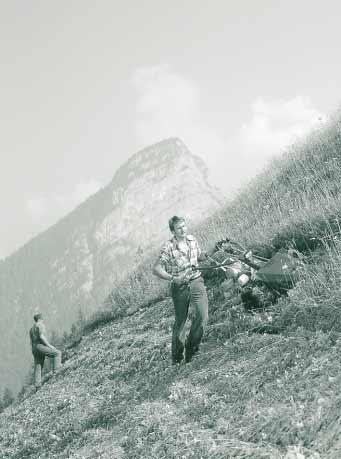

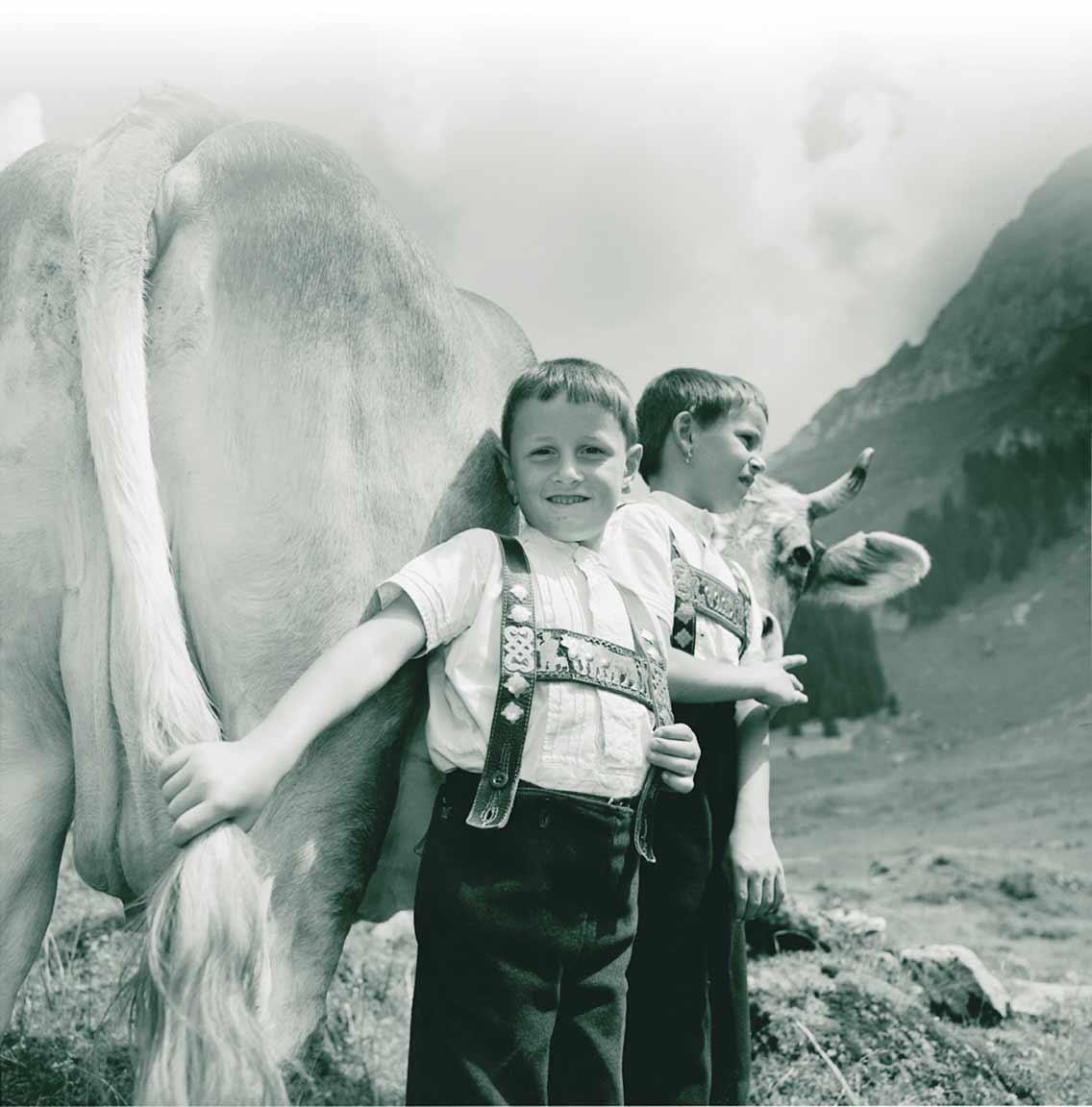
 ■ Enquête suisse sur la santé
■ Enquête suisse sur la santé