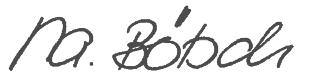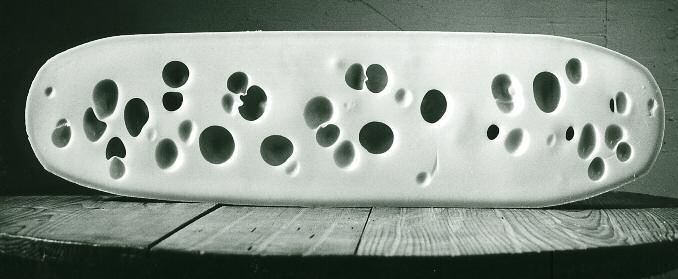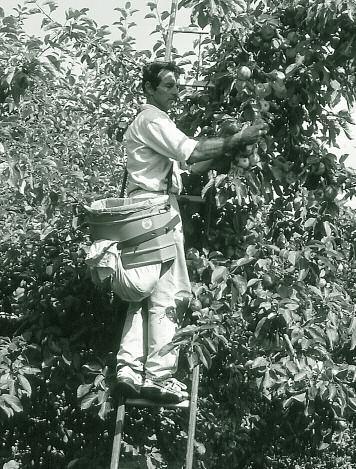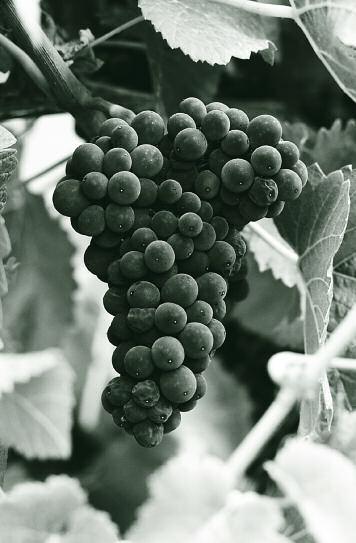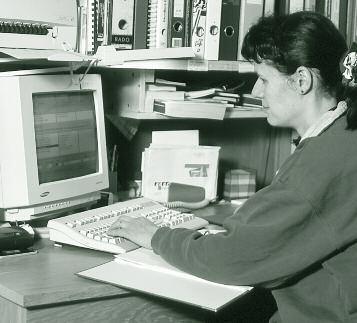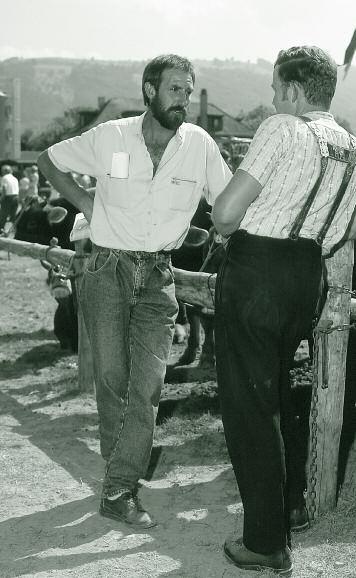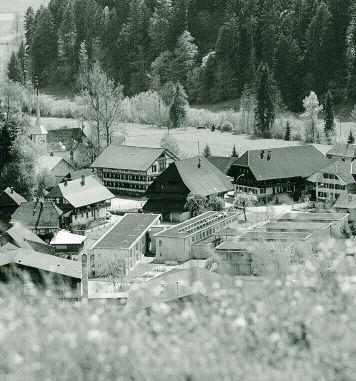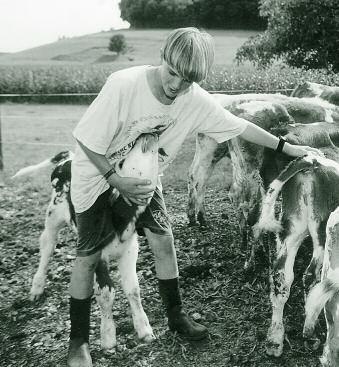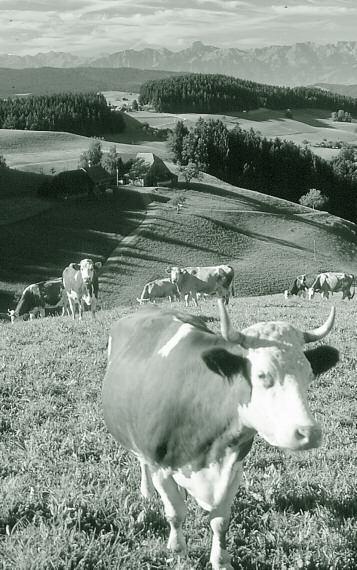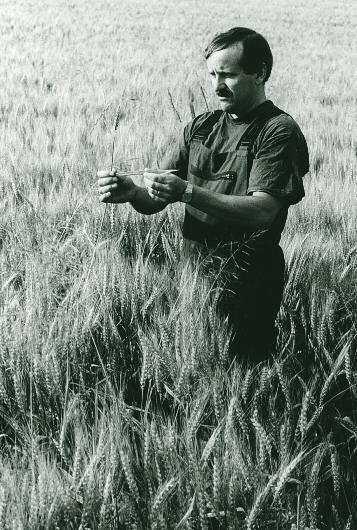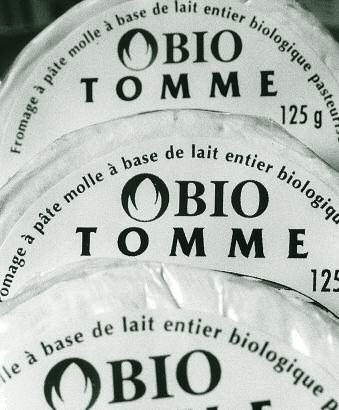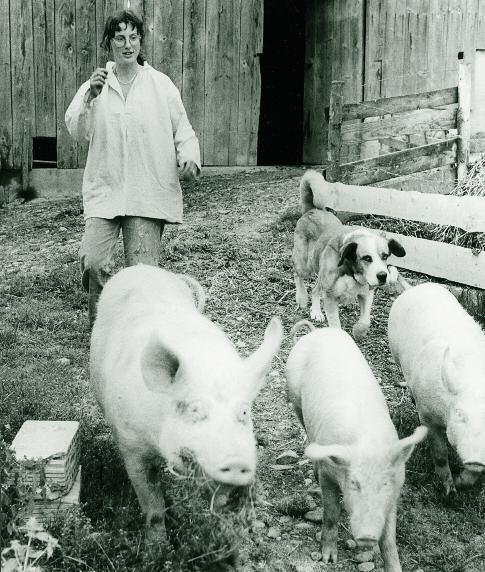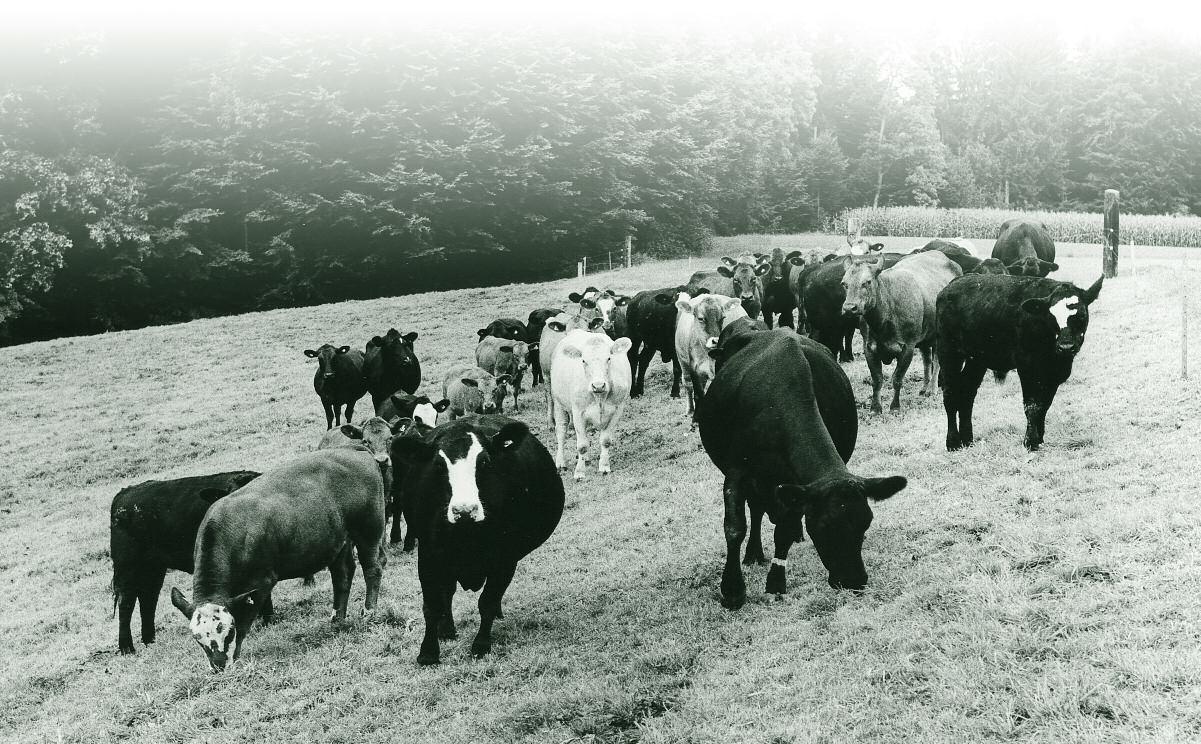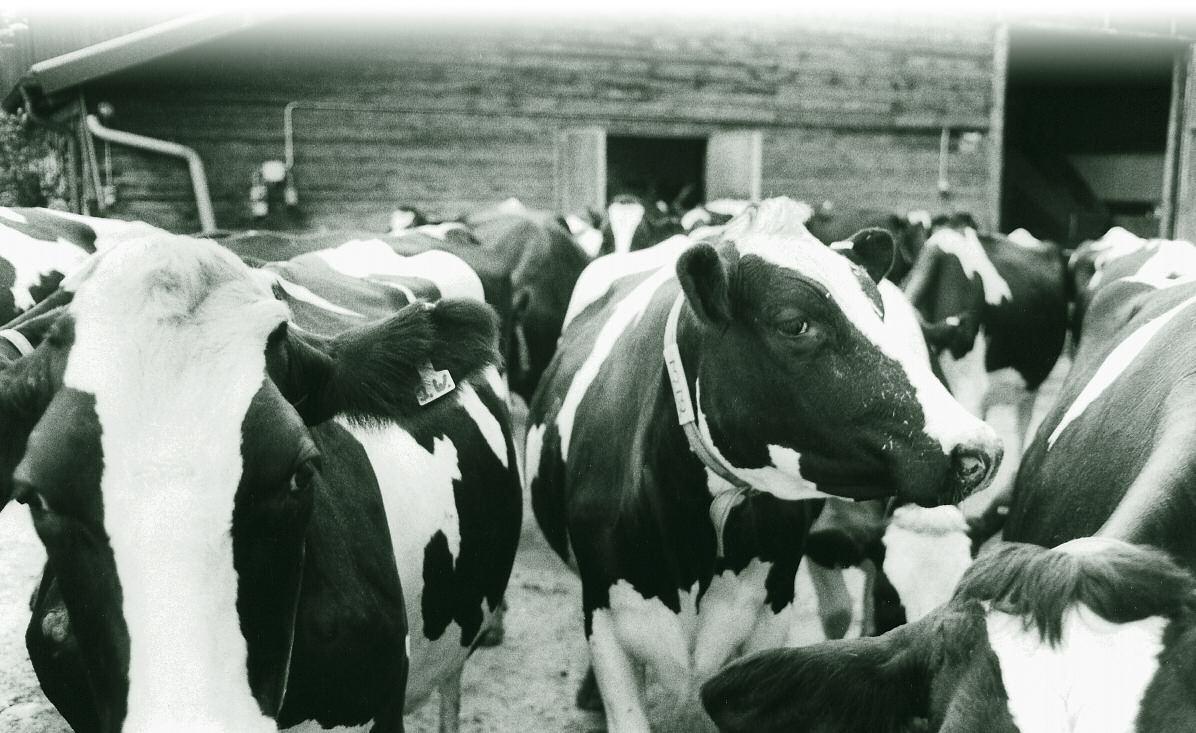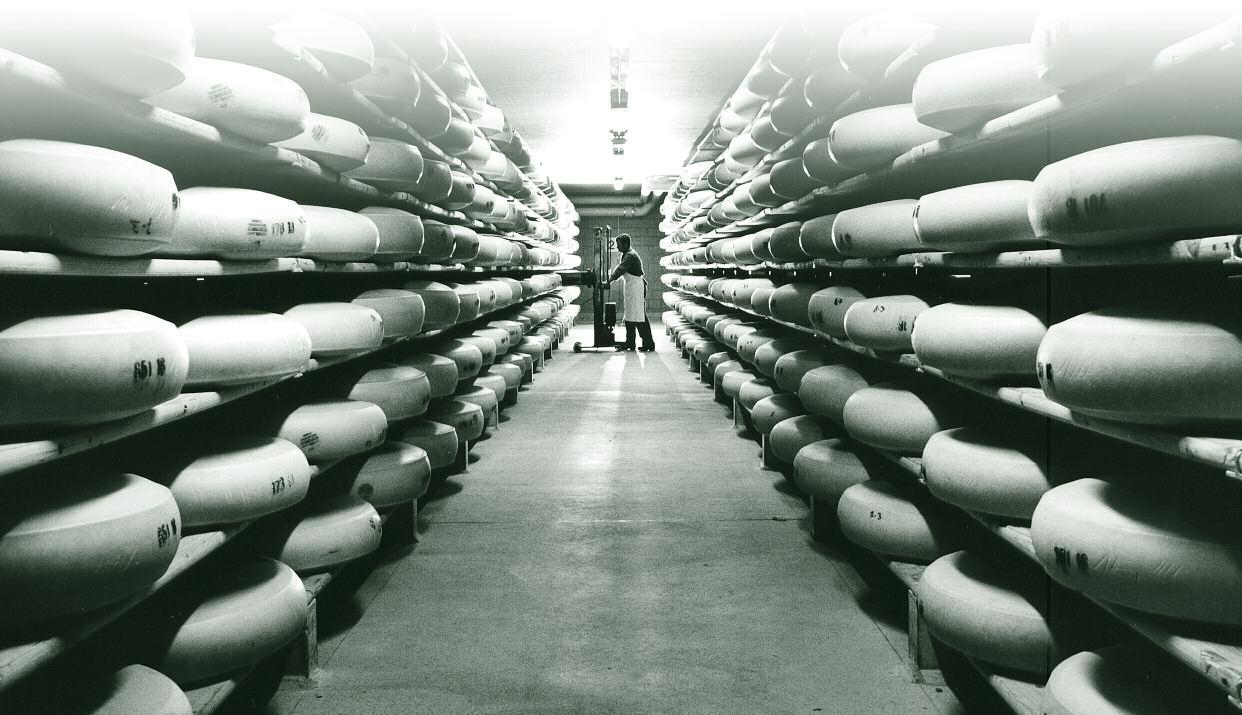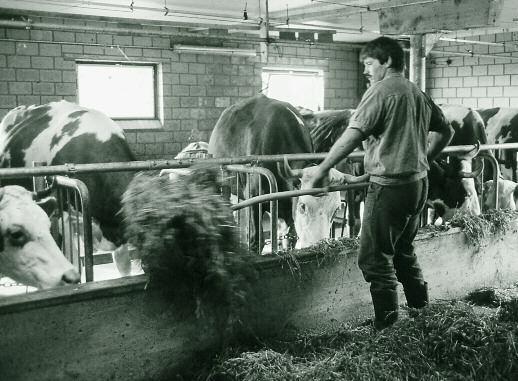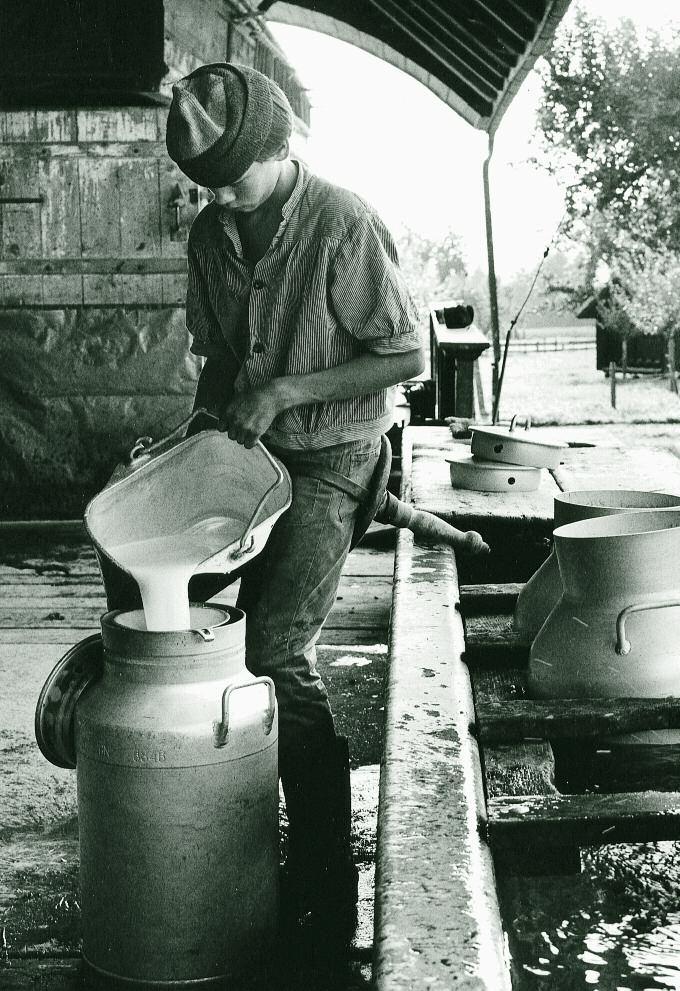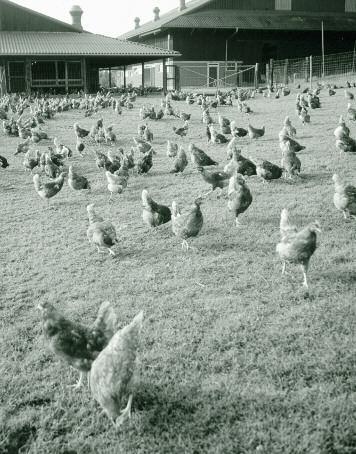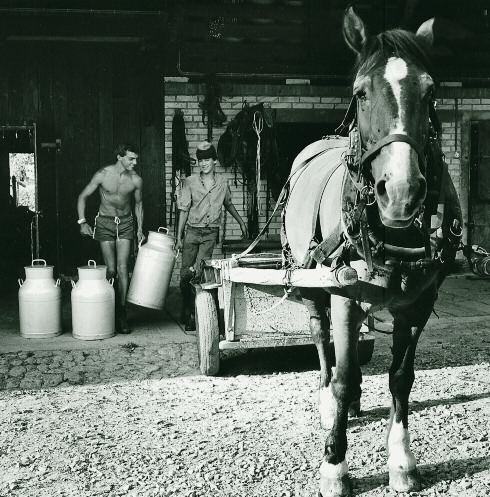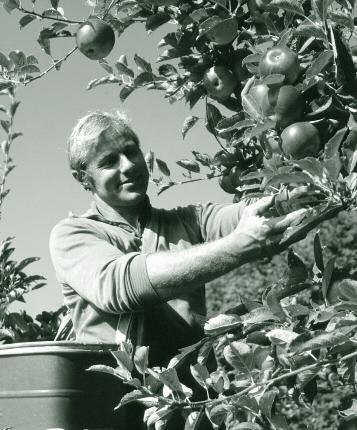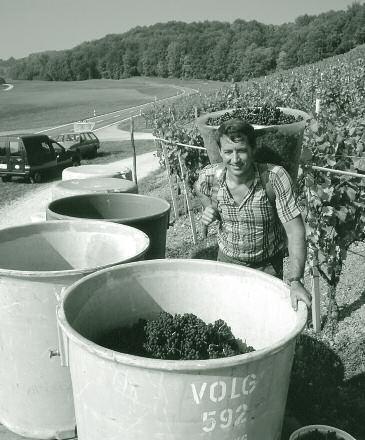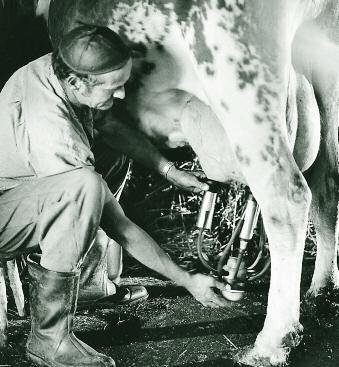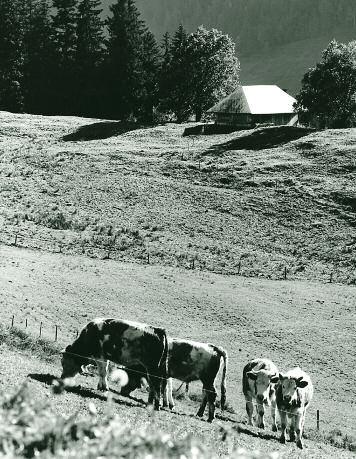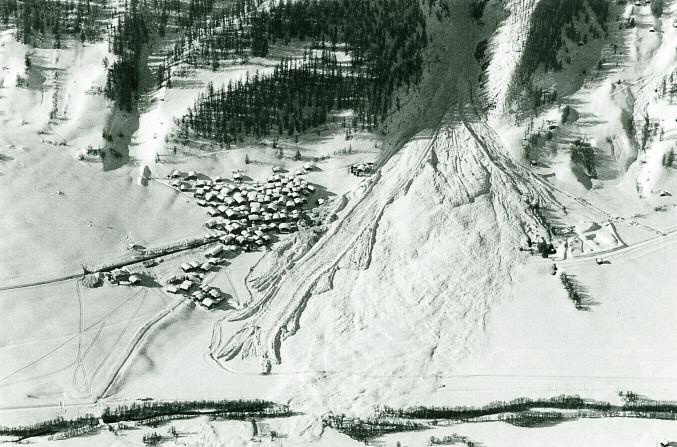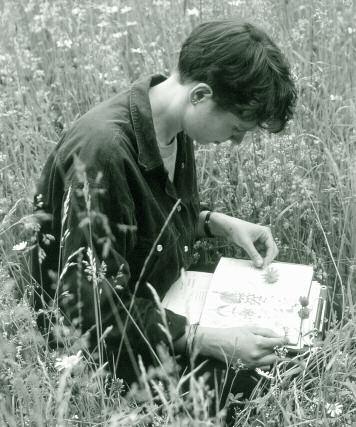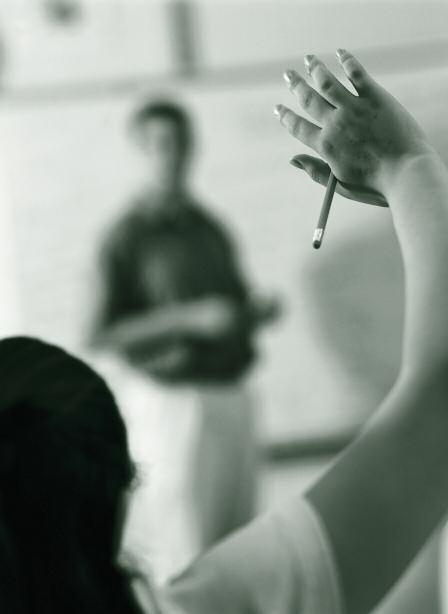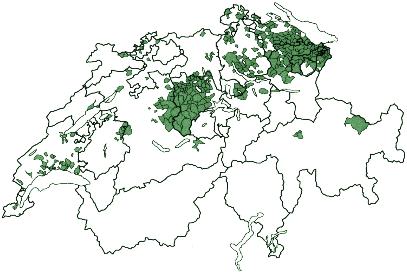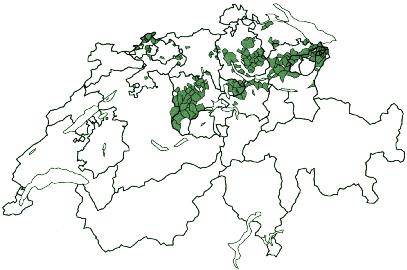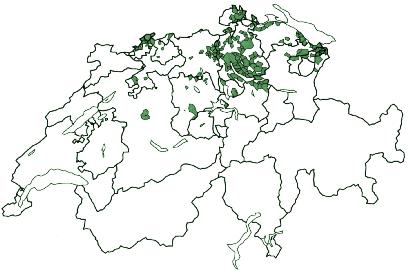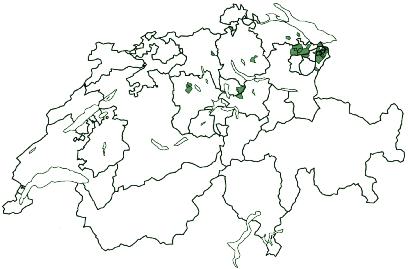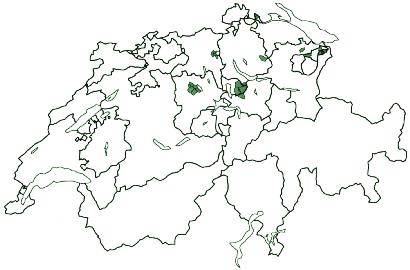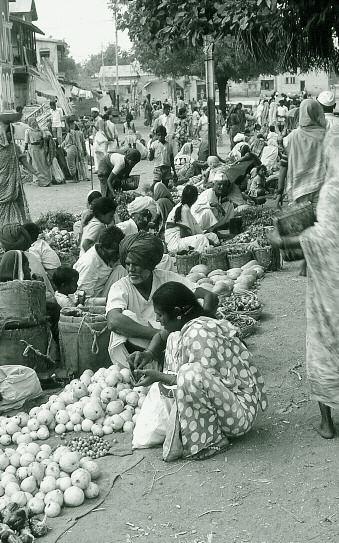R A P P O R T A G R I C O L E Bundesamt für Landwirtschaft Office fédéral de l’agriculture Ufficio federale dell’agricoltura Uffizi federal d’agricultura
Editeur
Office fédéral de l’agriculture (OFAG)
3003 Berne
Tél : 031 322 25 11
Fax: 031 322 26 34
Internet: www blw admin ch
Copyright: OFAG, Berne 2001
Layout et graphisme
Artwork, Grafik und Design, Saint-Gall
Impression Bruhin AG, Freienbach
Photos
Aebi & Co AG, Maschinenfabrik
Bavaria Bildagentur
Blue Planet Bild
– FAL Station fédérale de recherches en agroécologie et agriculture
– FAW Station fédérale de recherches en arboriculture, viticulture et horticulture
Hans Kern, photographe
Incolor AG
Keystone Archive
– Markus Jenni
– OFAG Office fédéral de l’agriculture
– Peer Schilperoord
– Peter Mosimann, photographe
Peter Studer, photographe
PhotoDisc Inc
Photothèque Agrofot
Prisma Dia-Agentur
– PSL Fédération des Producteurs
Suisses de Lait
– Roger Corbaz
– Ruedi Bosshart
Switzerland Cheese Marketing AG
Diffusion
OFCL/OCFIM, 3003 Berne
No de commande:
français: 730 680 01 f
10 2001 1600 62454
allemand: 730 680 01 d
10 2001 3000 62454
italien: 730 680 01 i
10 2001 300 62454
Fax: 031 325 50 58
Internet: www admin ch/edmz
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
A C H E V É D ’ I M P R I M E R 2
■■■■■■■■■■■■■■■■ Table des matières Préface 4 ■ 1. Rôle et situation 1.1 Economie 9 de l‘agriculture 1 1 1 L’agriculture, partie intégrante de l‘économie 10 1 1 2 Marchés 25 1.1.3 Situation économique du secteur agricole 52 1 1 4 Situation économique des exploitations 55 1.2 Aspects sociaux 65 1 2 1 Concept d’information sur le social dans l’agriculture 66 1 2 2 Revenu et consommation 69 1 2 3 Enquête sur la qualité de vie 72 1 2 4 Aide aux enfants et aux jeunes à Eggiwil 79 1 3 Ecologie 83 1 3 1 Indicateurs agro-environnementaux 84 1 3 2 Thèmes spécifiques 110 1.4 Appréciation de la durabilité 117 1 4 1 Appréciation actuelle de la durabilité 118 1 4 2 Concept d’évaluation globale de la durabilité 120 ■ 2 Mesures de politique 2 1 Production et ventes 129 agricole 2 1 1 Instruments de caractère global 131 2 1 2 Economie laitière 146 2 1 3 Economie animale 152 2.1.4 Production végétale 158 2 1 5 Examen des mesures 167 2.2 Paiements directs 185 2 2 1 Importance des paiements directs 186 2 2 2 Paiements directs généraux 199 2 2 3 Paiements directs écologiques 208 2.3 Amélioration des bases de production 227 2 3 1 Améliorations structurelles et aide aux exploitations 228 2 3 2 Recherche, vulgarisation, formation professionnelle, haras 238 2 3 3 Matières auxiliaires de l’agriculture, protection des végétaux et des variétés 245 2.3.4 Elevage 255 2.4 Evolution future de la politique agricole 257 ■ 3 Aspects internationaux 3 1 Développements internationaux 265 3.2 Comparaisons internationales 287 ■ Annexe Tableaux A2 Cartes A60 Textes légaux relevant du domaine de l‘agriculture A72 Définitions et méthodes A75 Abréviations A93 Bibliographie A95 T A B L E D E S M A T I È R E S 3
Préface

L’année sous revue a été bonne pour l’agriculture suisse d’une manière générale. Les recettes ont augmenté par rapport à 1999, tant dans la production végétale qu ’ en économie animale La production finale, quant à elle, s ’est accrue de 344 millions de francs, soit d’environ 5% Mais la situation se présente sous un jour nettement moins favorable en 2001 Selon les estimations, on escompte un résultat comparable à celui de 1999 pour l’exercice en cours Les fluctuations plus marquées sur le marché, auxquelles on s ’attendait suite à la nouvelle politique agricole, sont donc bien réelles
Au mois de juillet de l’année considérée, l’OFAG a lancé l’évolution future de la politique agricole en publiant le document stratégique «Horizon 2010» Le 21 septembre 2001, le Conseil fédéral a habilité le DFE à ouvrir une large consultation sur le projet consacré à cette évolution, appelé «PA 2007». Dans l’intervalle, une discussion approfondie des futures étapes de la réforme a été menée dans tous les milieux concernés
Il en est résulté un projet destiné en premier lieu à l’optimisation des mesures existantes Le mandat constitutionnel, les grandes lignes et les objectifs de la politique agricole 2002 ne sont pas remis en question Les adaptations prévues portent avant tout sur des modifications relatives au contingentement laitier, en vue d’une suppression de ce dernier à moyen terme Je saisis l’occasion pour remercier toutes les personnes ayant contribué à ce projet
Le deuxième Rapport agricole suit la même orientation de base que le premier Il fournit des informations sur les incidences économiques, sociales et écologiques de la politique agricole, sur l’évolution des mesures de cette politique et sur des aspects internationaux Quelques domaines y sont plus étoffés que l’année précédente Le chapitre 1.2, par exemple, décrit en détail la manière d’apprécier la situation sociale des agricultrices et agriculteurs et le chapitre 1 4 présente un système servant à apprécier la durabilité de l’agriculture à l’aide d’indicateurs En outre, le rapport résume, au chapitre 2.1.5, les résultats obtenus lors de l’analyse des effets de diverses mesures dans le domaine du marché Le perfectionnement constant des instruments de suivi et l’évaluation des effets de certaines mesures permettent d’affiner encore les analyses et, partant, d’améliorer les bases de décision
En moyenne, la situation économique des exploitations peut être qualifiée de stable Les résultats du dépouillement central des données comptables effectué par la FAT montrent qu ’elle s ’est nettement améliorée après sa détérioration au milieu des années nonante. La majeure partie des exploitations sont à même de constituer suffisamment de capital propre pour assurer leur viabilité On ne saurait toutefois se fonder uniquement sur des moyennes Il ressort en effet d’une analyse plus poussée que ces dernières années, le nombre d’exploitations confrontées à des difficultés financières s ’est accru Par ailleurs, un quart des entreprises enregistrant les résultats les plus mauvais ont vu leur base économique s ’affaiblir Il faudra donc suivre de près leur situation sociale L’écart entre ces exploitations et celles qui réalisent les meilleurs résultats se creuse On s ’ y attendait, car dans le contexte de la nouvelle politique agricole, l’esprit d’entreprise des exploitants a encore davantage de poids.
P R É F A C E ■■■■■■■■■■■■■■■■
4
Comme les années précédentes, les prestations écologiques de l’agriculture ont de nouveau augmenté Les agriculteurs ont délimité plus de surfaces pour favoriser la biodiversité; ils ont aussi fait sortir plus souvent leurs animaux et en ont gardé davantage dans des étables à stabulation libre respectueuses de l’espèce. Par ailleurs, les quantités d’engrais minéraux et de produits phytosanitaires utilisées n ’ont pas augmenté en 1999 et en 2000 Enfin, les mesures visant à réduire l’administration d’antibiotiques dans l’agriculture ont également produit un effet favorable, qui se traduit par un recul de 50% depuis 1995
Le Rapport agricole 2000 a été bien accueilli dans l’ensemble Je remercie ceux d’entre vous qui ont fait des remarques et suggestions constructives Elles sont toujours bienvenues. Les réactions positives à la première édition nous ont motivés à faire en sorte que nous puissions de nouveau, cette année, vous fournir un rapport intéressant et complet Je vous souhaite une agréable lecture
Manfred Bötsch
Directeur de l’Office fédéral de l’agriculture
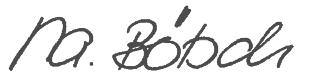
P R É F A C E
5
6
■■■■■■■■■■■■■■■■ 1. Rôle et situation de l’agriculture

1 7
Selon l’art. 104 de la Constitution fédérale, «la Confédération veille à ce que l’agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
a. à la sécurité de l’approvisionnement de la population;
b à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural;
c à l'occupation décentralisée du territoire»
Les buts ancrés dans la Constitution indiquent clairement que l’agriculture remplit des tâches qui vont au-delà de la seule production de denrées alimentaires On parle à ce propos de multifonctionnalité de l’agriculture L’entretien du paysage, la sauvegarde des bases naturelles de l’existence et l’occupation décentralisée du territoire sont des tâches d’intérêt public qui ne sont que partiellement rétribuées par le marché.
C’est en 1996 que la notion de durabilité a été introduite dans la Constitution pour la première fois. Elle représente, depuis la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (CNUED) de 1992, à Rio de Janeiro, une ligne directrice majeure en matière de politique
Le Conseil fédéral entend suivre les effets de la nouvelle politique agricole Il a créé les conditions indispensables pour ce faire dans son ordonnance sur l'évaluation de la durabilité de l'agriculture Les dispositions de l’art 1, al 1, de ladite ordonnance prévoient que la politique agricole et les prestations de l’agriculture doivent être régulièrement évaluées sous l’angle de la durabilité, alors qu ’ en vertu de l’art. 2 ce sont les conséquences économiques, sociales et écologiques qui doivent être évaluées L’OFAG publiera chaque année un rapport sur les résultats des analyses
Les trois dimensions de la durabilité constituent la structure de base des informations contenues au chapitre 1 du Rapport agricole, chapitre consacré au rôle et à la situation de l’agriculture
8 1 . R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E 1
1.1 Economie
Dans le passé, les rapports sur l’agriculture traitaient pour l’essentiel les aspects économiques de l’agriculture Signalons par exemple que les données comptables fournies par des entreprises choisies renseignaient sur le revenu des exploitations individuelles et que les comptes économiques de l’agriculture reflétaient la situation de tout le secteur Les recensements des exploitations agricoles, effectués en règle générale tous les cinq ans, livraient des informations sur le développement des structures dans l’agriculture De plus, on collectait de nombreuses données sur la production et les prix Dans le domaine économique, on disposait de bases très complètes pour la rédaction du rapport.
Ce chapitre présente la place économique de l’agriculture en tant que pan de l’économie et fournit des informations sur la production, la consommation, le commerce extérieur, les prix à la production et à la consommation sur les différents marchés, de même que sur la situation économique du secteur dans son ensemble et sur les exploitations individuelles

■■■■■■■■■■■■■■■■
9 1 . 1 E C O N O M I E 1
1.1.1 L’agriculture, partie intégrante de l’économie
Evolution structurelle des exploitations agricoles
Le recensement agricole qui a été réalisé durant l’année 2000 permet de procéder à une analyse approfondie de la structure des exploitations au fil de la décennie 1990 à 2000 Afin d’illustrer l’évolution numérique des exploitations agricoles, la période 1985 à 1990 a été prise en compte elle aussi
Depuis 1995, le recensement des entreprises agricoles et horticoles porte sur un domaine défini selon des normes internationales, fondées sur la Nomenclature générale des activités économiques (NOGA), laquelle s ’appuie sur la Nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés européennes (NACE) qu ’applique l’UE. Conformément à cette nomenclature des activités économiques, l’Office fédéral de la statistique (OFS) recense toutes les exploitations qui correspondent aux normes (adaptées aux conditions existantes en Suisse) du recensement des structures agricoles de l’UE Il s ’ensuit que, pour entrer dans le recensement des exploitations agricoles, une entreprise doit remplir au moins l’une des six conditions énumérées ci-après:

– 1 ha de surface agricole utile (SAU);
30 ares voués aux cultures spéciales;
– 10 ares de cultures sous abri;
– 8 truies;
80 porcs à l’engrais; ou
– 300 têtes de volaille
■■■■■■■■■■■■■■■■
–
–
10 1 . 1 E C O N O M I E 1
■ Les changements structurels touchent surtout les petites exploitations
Les évolutions structurelles de ces dernières décennies ont touché tous les secteurs de l’économie, et l’agriculture n ’ a pas fait exception
Evolution du nombre d’exploitations agricoles
On a dénombré, en l’an 2000, près de 28'200 exploitations de moins qu ’ en 1985 Dans la moitié des cas, il s ’agissait de petites entreprises exploitant entre 0 et 3 ha. Le nombre de ces exploitations a pratiquement été divisé par trois durant la période considérée
Entre 1985 et 1990, le nombre des exploitations d’une surface inférieure ou égale à 3 ha a régressé de 3’354 unités, soit un recul de 3,1% par an. Durant la même période, le nombre des exploitations de plus de 3 ha a chuté de 2’590 unités, ce qui correspond à un recul de 0,7% par an
De 1990 à 1996, l’évolution structurelle s ’est encore accélérée pour les exploitations d’une surface maximale de 3 ha: les entreprises de cette taille disparaissaient au rythme de 7,8% par an Les exploitations plus grandes, quant à elles, n ’ont régressé pendant la même période que de 1,3% par an
Dans la période allant de 1996 à 2000, le nombre des exploitations de la classe de grandeur «jusqu’à 3 ha» a de nouveau diminué de 3’796 unités La baisse des effectifs est donc de 8,9%, contre 2,0% par an pour les entreprises de plus de 3 ha.
Au cours de la décennie 1990 à 2000, le nombre des exploitations dont la SAU était comprise entre 3 et 10 ha a régressé fortement Par conséquent, les recensements des agricoles ne permettent pas d’étayer les hypothèses selon lesquelles les paiements directs encourageraient de nombreuses exploitations plutôt petites à poursuivre leur activité
■ Les exploitations de plus de 20 ha deviennent plus nombreuses
Vue sous l’angle des classes de grandeur, l’évolution que connaissent les exploitations depuis dix ans révèle un transfert au profit des exploitations de plus grande taille: le nombre des exploitations d’une surface allant jusqu’à 20 ha diminue, tandis que celui des exploitations plus grandes s ’accroît Au cours de cette période, le nombre des exploitations dont la SAU n ’atteint pas 20 ha a perdu 26'644 unités, alors que celui des entreprises dont la SAU dépassait 20 ha en gagnait 4'366 Parmi les exploitations de plus grande superficie, c ’est la classe de grandeur «30 à 50 ha» qui, en valeur absolue, a fait le plus grand bond en avant, passant de 3'549 unités en 1990 à 5'759 pendant l’année sous revue Au cours de la même décennie, les exploitations de 20 à 30 ha ont passé de 10'041 à 11'674 unités; les exploitations de plus de 50 ha, quant à elles, ont passé de 684 à 1'207 unités.
Classe de grandeur Nombre d’exploitations En ha 1985 1 1990 1996 2000 0–3 23 173 19 819 12 167 8 371 > 3 75 586 72 996 67 312 62 166 Total 98 759 92 815 79 479 70 537
1 déduction faite des très petites exploitations afin d’assurer la comparabilité avec les données concernant les années ultérieures
Source: OFS
Tableau 1, page A2 1 . 1 E C O N O M I E 11 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E 1
Lorsque l’on compare la période allant de 1990 à 1996 à celle de 1996 à l’an 2000, il apparaît que la progression numérique des exploitations rangées dans la classe de grandeur «20 à 30 ha » a ralenti, passant de plus de 2% par an à moins de 1% Il en va de même pour les exploitations de 30 à 50 ha: leur progression numérique est tombée de près de 6% par an à moins de 4%. Seules les exploitations de plus de 50 ha ont maintenu leur progression, qui s ’est même légèrement accrue pour passer à 6% par an
Au cours de la décennie 1990 à 2000, la SAU de la Suisse n ’ a subi que des changements mineurs C’est plutôt la répartition de la surface entre les exploitations de diverses classes de grandeur qui s ’est globalement modifiée Ainsi, en 1990, l’ensemble des exploitations de la classe «0 à 10 ha» travaillaient 19% de la SAU; en 2000, cette classe de grandeur n ’avait plus accès qu’à 12% de la SAU. Les exploitations de moins de 3 ha travaillaient en 1990 26'723 ha, ce qui correspond à 3% de la SAU totale En l’an 2000, elles n ’exploitaient globalement plus que 10'197 ha, soit 1% de la SAU. Les surfaces exploitées par des entreprises de la classe «10 à 20 ha» ont elles aussi diminué, passant de 42 à 34% Ces défections ont profité aux classes de grandeur supérieures à 20 ha, qui exploitaient en l’an 2000 54% de la surface utile, contre 39% en 1990
Evolution de la SAU selon la classe de grandeur 19901996 2000 e n h a 0–10 ha Source: OFS 10–20 ha >20 ha 0 1 200 000 1 050 000 900 000 750 000 600 000 450 000 300 000 150 000 415 463 452 659 200 369 522 866 404 615 155 395 576 220 356 673 130 601
19901996 2000 N o m b r e 0–3 ha Source: OFS 10–20 ha >20 ha 0 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 14 274 31 630 27 092 19 819 17 361 27 877 22 074 12 167 18 640 24 984 18 542 8 371 3–10 ha 12 1 . 1 E C O N O M I E 1 Tableau 1,
Evolution du nombre des exploitations agricoles selon la classe de grandeur
page A2
Au cours de la décennie 1990 à 2000, le cheptel total d’unités de gros bétail (UGB) a diminué de 130'000 unités Dans les exploitations des classes de grandeur allant jusqu’à 20 ha, le recul était de quelque 292'000 UGB, tandis que dans les exploitations plus grandes, on recensait un accroissement de 162'122 UGB. En dépit de ce bilan négatif, le cheptel moyen par exploitation est demeuré à peu près constant Le cheptel moyen recensé en 1990 dans les exploitations des classes «0 à 10 ha» et «10 à 20 ha» était respectivement de 7,9 et de 20 UGB Dix ans plus tard, il est respectivement de 8,6 et de 19,1 UGB Les exploitations de plus de 20 ha détenaient en 1990 un cheptel moyen de 30 UGB, contre 31,7 en 2000 Ces chiffres permettent d’affirmer qu’il n ’ y a eu ni «intensification» dans les exploitations d’assez petite taille, ni «extensification» dans les plus grandes exploitations

Evolution du nombre d'UGB selon la classe de grandeur 19901996 2000 N o m b r e 0–10 ha Source: OFS 10–20 ha >20 ha 0 1 500 000 1 350 000 1 200 000 1 050 000 750 000 900 000 600 000 450 000 300 000 150 000 428 400 632 086 369 273 526 558 541 388 268 243 590 522 478 145 230 844
Le
13 1 . 1 E C O N O M I E 1 Tableau 1,
■
cheptel par exploitation varie à peine
page A2
■ Parts relatives des entreprises exploitées à titre principal/à titre accessoire: pas de changement
La proportion d’entreprises exploitées à titre principal (70%) par rapport à celles qui sont exploitées à titre accessoire (30%) est restée, dans l’ensemble, assez stable durant les dix dernières années En 1990, comme au cours de l’année sous revue, près de la moitié des exploitations à titre principal se trouvait dans la région de plaine, un quart dans celle des collines et un quart dans celle de montagne
Evolution numérique des entreprises exploitées à titre principal ou à titre accessoire
De 1990 à 1996, puis de 1996 à 2000, les entreprises agricoles ont connu une évolution numérique différente selon la région de leur implantation et selon qu ’elles étaient exploitées à titre principal ou à titre accessoire.
En ce qui concerne les entreprises exploitées à titre principal, le recul constaté dans la région de plaine a été nettement plus fort entre 1990 et 1996 que pendant la période allant de 1996 à 2000 Dans la région de montagne, c ’est l’inverse qui s ’est produit
Pour ce qui est des entreprises exploitées à titre accessoire, celles de la plaine ont vu leur nombre régresser bien davantage de 1996 à 2000 que de 1990 à 1996 En montagne, le recul important constaté entre 1990 et 1996 a fait place, au cours de la période allant de 1996 à 2000, à une progression de plus de 5% Dans la région des collines enfin, l’évolution numérique a été semblable, mais moins marquée
14 1 . 1 E C O N O M I E 1
Nombre d’exploitations 1990 1996 2000 Variation en % 1990–1996 1996–2000 à titre principal 64 242 55 951 49 239 -12,9 -12,0 plaine 1 30 139 25 475 23 536 -15,5 -7,6 collines 2 17 452 15 636 13 793 -10,4 -11,8 montagne 3 16 651 14 840 11 910 -10,9 -19,7 à titre accessoire 28 573 23 528 21 298 -17,7 -9,5 plaine 1 11 451 10 302 8 076 -10,0 -21,6 collines 2 7 089 5 594 5 164 -21,1 -7,7 montagne 3 10 033 7 632 8 058 -23,9 5,6 Total 92 815 79 479 70 537 -14,4 -11,3
2
3
1 zone de grandes cultures et zones intermédiaires
zone des collines et zone de montagne I
zones de montagne II à IV Source: OFS
Entreprises exploitées à titre principal, variation 1990/2000

Entreprises exploitées à titre accessoire, variation 1990/2000
Recul
Au cours de la décennie écoulée, le nombre d’entreprises agricoles exploitées à titre principal s ’est comprimé dans tous les cantons sans exception S’agissant des entreprises exploitées à titre accessoire, on constate certes un tassement dans de nombreux cantons, mais il y a eu aussi une progression dans plusieurs cantons de Suisse centrale, à savoir NW, OW, SZ, UR, LU, ainsi que dans celui d’AI
15 1 . 1 E C O N O M I E 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E 1
VS GE VD NE FR JU SO BL BS AG LU BE TI GR UR NW SZ ZH TG SH SG AI AR GL ZG OW >25% 20–25% 0–20% Recul en % Source: OFS
>25% 20–25% 0–20% Augmentation
en
Source: OFS
%
VS GE VD NE FR JU SO BL BS AG LU BE TI GR UR NW SZ ZH TG SH SG AI AR GL ZG OW
Selon la définition qu ’ en donne l’OFS, on appelle personnes actives dans le secteur de l’agriculture les personnes âgées de 15 ans au moins qui exercent un emploi au sein d’une exploitation agricole On distingue les postes à plein temps, où travaillent des personnes qui consacrent 75% ou plus de leur activité professionnelle à l’exploitation agricole, et les postes à temps partiel, occupés par des personnes qui y consacrent moins de 75%
Le nombre d’emplois dans l’agriculture a fortement reculé au cours de la décennie sous revue: de 253'561 personnes en 1990, l’effectif total des actifs est tombé à 203'793, ce qui correspond à un recul de 2,2% en moyenne annuelle Cette évolution va de pair avec la contraction du nombre des exploitations durant la même période Il convient de souligner que l’évolution numérique des effectifs a été différente selon la période étudiée (1990 à 1996 ou 1996 à 2000) et selon le taux d’occupation des personnes considérées Ainsi, la régression des effectifs travaillant à plein temps a été modérée durant la première moitié de la décennie, et assez marquée pendant la seconde Parmi les actifs à temps partiel, les effectifs ont diminué fortement entre 1990 et 1996, avant de connaître une légère remontée entre 1996 et l’an 2000 Cette évolution est sans doute très liée aux fluctuations conjoncturelles des années nonante
De 64'242 en 1990, le nombre de chefs d’exploitation exerçant leur activité à titre principal est tombé à 49'239 en l’an 2000, soit un recul de 23% environ

16 1 . 1 E C O N O M I E 1
■ L’activité
Evolution des emplois à plein temps et à temps partiel 19901996 2000 N o m b r e Personnes occupées à plein temps Source: OFS 0 300 000 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 Personnes occupées à temps partiel Tableau 2,
à temps partiel gagne du terrain face au travail à plein temps
page A3
Evolution de la part des chefs d'exploitation à plein temps, selon la classe d'âge
Lorsque l’on compare la structure par âges des exploitants agricoles à titre principal en 1990 et en 2000, deux phénomènes ne manquent pas de frapper D’abord la division par quatre du nombre des chefs d’exploitation âgés de plus de 65 ans: cette tranche d’âge comptait encore 4'926 personnes au début de la décennie, contre 1'102 en l’an 2000 Cette chute vertigineuse s ’explique pour l’essentiel par l’introduction en 1999 d’une limite d’âge pour les ayants droit aux paiements directs. Il y a en outre le recul significatif des chefs d’exploitation de moins de 35 ans Ces deux phénomènes ont conduit, au cours de la décennie sous revue, à un renforcement numérique de 8,1% de la tranche d’âge des 35 à 49 ans parmi les chefs d’exploitation à titre principal.
Evolution de la part des chefs d'exploitation à temps partiel, selon la classe
L’effectif des exploitants à titre accessoire a lui aussi diminué, passant de 28'573 en 1990 à 21'298 en l’an 2000 L’évolution par tranches d’âge est comparable à celle qui vient d’être décrite pour les exploitants à titre principal, mais en moins marqué
1 . 1 E C O N O M I E 17 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E 1
Pas d'indication > 65 1990 2000 50–65 35–49 < 35 Source: OFS 40 200 20 40 60 5 0 5 8 2 2 7 7 33 9 35 7 16 8 35 0 43 8 14 0 en %
Pas d'indications > 65 1990 2000 50–65 35–49 < 35 Source: OFS 40 20 30100 en % 10 30 20 40 3 9 12 1 15 1 20 4 30 0 27 0 10 5 37 4 33 3 10 3
d'âge
A l’agriculture sont étroitement liées d’autres branches économiques dont les activités se situent soit en amont, comme l’industrie des machines agricoles, la production d’engrais, de produits phytosanitaires et de fourrages, soit en aval, comme l’industrie agro-alimentaire.
Les dernières données chiffrées disponibles concernant les personnes actives dans l’agriculture et la sylviculture, ainsi que dans les branches situées en amont et en aval, portent sur les années 1995 et 1998 Dans l’ensemble, rien n ’ a changé au fil de ces trois ans Les branches situées en aval occupaient quelque 220'000 personnes, soit 5,8% de la population active en Suisse Le secteur de la mise en valeur est le plus gros employeur, puisque les branches de l’abattage, de la transformation de viande et de lait, ainsi que de la production de pain, d’articles de boulangerie, de biscuiterie et de biscotterie occupent chacune plus de 10'000 personnes Mais d’autres branches fournissent encore davantage de travail: le commerce de gros, le commerce de détail et les détaillants spécialisés dans le domaine alimentaire comptent au total près de 160'000 salariés La proportion d’actifs travaillant dans les branches situées en amont est plus petite (1,5%, soit quelque 58'000 personnes) Globalement, l’agriculture et les branches apparentées assurent leur subsistance à plus de 12% des personnes actives

18 1 . 1 E C O N O M I E 1
■ La valeur ajoutée brute de l’agriculture
Production, prix et commerce extérieur
La valeur ajoutée brute aux prix du marché sert à mesurer les performances d’une économie. Dans le cas de l’agriculture, elle correspond à la différence entre la valeur de la production brute et celle de la consommation intermédiaire
La valeur ajoutée brute des trois secteurs économiques, en 1998 et en 1999
■ L’évolution des indices des prix
En 1999, la valeur ajoutée brute aux prix du marché s ’est chiffrée, pour l’ensemble de l’économie suisse, à 381'887 millions de francs. Elle a donc légèrement augmenté en comparaison de l’année précédente La contribution du secteur primaire est modeste (1,3%) par rapport à l’ensemble de l’économie On notera que l’agriculture fournit à elle seule 70% de la valeur ajoutée dudit secteur.
Cependant, les prestations de l’agriculture vont au-delà de la valeur des denrées produites La valeur ajoutée brute aux prix du marché ne tient compte ni des prestations d’intérêt général, ni des fonctions écologiques du secteur agricole
L’introduction de la nouvelle politique agricole a entraîné la suppression de toutes les garanties de prix et d’écoulement des produits. Les forces du marché interviennent désormais de manière plus directe sur les prix, et les produits de la vente sont plus fluctuants que par le passé L’indice des prix à la production agricole, qui n ’avait cessé de régresser entre 1990 et 1999 (perdant plus de 20 points au cours de la décennie), a gagné 3,5 points durant l’année 2000 Cette hausse s ’explique pour l’essentiel par les prix élevés de la viande (en particulier de bœuf et de veau) Mais vers la fin de l’année, les prix à la production ont accusé à nouveau un net fléchissement
19 1 . 1 E C O N O M I E 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E 1
Secteur économique 1998 1999 1 Part pour Différence 1999 entre 1998/99 mio de fr % Secteur primaire 5 484 4 906 1,3 -10,5 part de l’agriculture 4 038 3 443 1,0 -14,7 Secteur secondaire 99 422 100 503 26,3 1,1 Secteur tertiaire 271 117 276 478 72,4 2,0 Total 376 022 381 887 100,0 1,5 1 données provisoires Sources: OFS, USP
Evolution de l'indice des prix à la production, à la consommation et à l'importation de denrées alimentaires ainsi que de l'indice des prix des moyens de production agricole
Indice des prix à l'importation de denrées alimentaires 1 Indice suisse des prix à la consommation, sous-groupe des denrées alimentaires, boissons et tabac Indice des prix des moyens de production agricole Indice des prix à la production agricole
1 Référence: mai 1993 = 100 Les données portant sur les périodes antérieures ne sont pas disponibles pour cet indice Quant à l’indice des prix à l’importation, le groupe «Denrées alimentaires» comprend les sous-groupes «Viande», «Autres denrées alimentaires» et «Boissons». Ceux-ci englobent des produits choisis et ne reflètent pas l’ ensemble des importations de denrées alimentaires
Sources: OFS, USP
En ce qui concerne les denrées alimentaires et les boissons, l’indice suisse des prix à la consommation a enregistré, entre 1990/92 et l’an 2000, une progression de 5,6 points; de 1999 à 2000, la progression a même été de 1,6 point Or cet indice des prix n ’est influencé par les prix intérieurs à la production qu’à hauteur d’un septième Il dépend bien davantage des prix du marché mondial pour les denrées alimentaires et pour les matières premières qu ’elles contiennent (la Suisse importe près de 40% de sa consommation de produits alimentaires, exprimés en calories), du taux de change du franc suisse ainsi que des coûts et des marges enregistrés dans la transformation et dans le commerce des denrées alimentaires
L’indice des prix des moyens de production agricole reflète d’abord les prix des aliments pour animaux, des semences et des plants, des engrais, des produits utilisés pour l’amendement du sol, des produits phytosanitaires, sans oublier les investissements dans les bâtiments et les équipements En outre, une partie des évolutions de prix mesurées au moyen de l’indice national des prix à la consommation est directement prise en compte dans l’indice concerné. Ce mode de calcul touche notamment l’énergie (carburants, électricité), le téléphone, l’eau, ainsi que les frais d’entretien et de réparation
Après avoir augmenté de 4 points entre 1990/92 et 1993, l’indice des prix des moyens de production agricole a baissé jusqu’en 1999, puis est légèrement remonté au cours de l’année 2000 (+1,2 point)
L’indice des prix à l’importation des denrées alimentaires a baissé de 2,6 points de 1994 à 1995, avant de progresser de 13,6 points de 1995 à 1999 En l’an 2000, il a reculé de 0,5 point Il faut rappeler cependant que cet indice ne porte pas sur la totalité du «panier» des denrées alimentaires effectivement importées; il est donc moins représentatif que l’indice des prix à la production et celui des prix à la consommation
20 1 . 1 E C O N O M I E 1
I n d i c e ( 1 9 9 0 / 9 2 = 1 0 0 )
75 1990-921993 1994 1995 1996 1997 1998 19992000 115 110 105 100 95 90 85 80
■ Le taux d’auto-approvisionnement fluctue au gré de l’évolution de la production végétale
Au cours de l’année sous revue, le commerce extérieur de la Suisse a connu une croissance d’une vigueur peu commune Les importations ont augmenté de 16% par rapport à 1999, tandis que les exportations progressaient de 13% Les échanges se sont intensifiés également en ce qui concerne les produits agricoles: les importations ont augmenté de 4,2%, les exportations de 7,1%
Dans le domaine agricole, l’UE reste le principal partenaire commercial de la Suisse Au cours de l’année sous revue, 70,6% des importations de produits agricoles provenaient de l’UE (6,0 mrd. de fr.), et 65,2% des exportations de la Suisse étaient destinées à l’Europe communautaire (2,3 mrd de fr )
Bon an, mal an, l’agriculture suisse produit près de 60% des denrées alimentaires (exprimées en calories) qui sont consommées dans le pays. Cela n ’exclut pas les fluctuations d’une année à l’autre Ainsi en 1999, l’auto-approvisionnement atteignait 58%, soit 6 points de moins que 1998 Cette différence avait pour seule cause un auto-approvisionnement plus faible en ce qui concerne les produits végétaux. Pour l’année sous revue, les calculs ne sont pas encore achevés Mais tout porte à croire que pour l’an 2000, qui a été un bon millésime pour la production végétale, le taux précité sera comparable à celui de 1998 Dans le domaine des produits animaux, la part produite en Suisse s ’est établie à 95% en 1998 et en 1999, et l’on s ’attend à une progression d’un point en 2000, ce qui porterait le taux à 96%, alors qu ’ en production végétale, il devrait atteindre le niveau de 1998 (47%)

21 1 . 1 E C O N O M I E 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E 1
Part des produits agricoles dans l'ensemble des importations et des exportations
e n m r d d e f r Agriculture Economie nationale Source: DGD 0 20 40 60 80 100 120 160 140 6,9 94,7 8,5 139,4 2,7 89,5 3,6 136,0 Importation Exportation
1990/9220001990/922000
■ Commerce extérieur et produits agricoles
Tableau 13, page A13
Dépenses
On désigne par consommation intermédiaire de l’agriculture les dépenses faites pour acheter des semences et des plants, des engrais et des produits phytosanitaires, des suppléments de fourrage, et pour payer l’énergie, l’entretien des machines et des bâtiments d’exploitation, ainsi que des services
La valeur de la consommation intermédiaire a diminué globalement de 250 millions de francs entre 1990/92 et l’an 2000 Les agriculteurs ont dépensé nettement moins pour les fourrages, les semences et les plants, le bétail ainsi que les engrais et les produits phytosanitaires Par contre, leurs dépenses pour les services et pour l’énergie se sont accrues.
Les investissements effectués par l’agriculture ont vu leur volume baisser entre 1990 (1'525 mio de fr ) et 1999 (1'420 mio de fr ) Ce recul n ’ a qu ’ une seule cause: la diminution (-7%) des investissements dans la construction Les investissements consacrés à l’équipement ont en revanche augmenté de 3%
1 . 1 E C O N O M I E 1 22
■ Consommation intermédiaire du secteur agricole Evolution des dépenses liées à la production dans l'agriculture
e n m i o d e f r Semences et plants, bétail Energie Prestations de services E
taires Matériel ainsi qu'entretien des machines et des bâtiments d' exploitation Aliments pour animaux Source: USP 0 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 Evolution des dépenses pour les investissements dans l'agriculture
e n m i o d e f r Investissements dans les bâtiments Investissements dans les équipements Source: USP 0 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 ■ Investissements du secteur agricole
1990/922000
ngrais, produits phytosani
1990/921999
Au cours de l’année sous revue, la Confédération a dépensé au total 47'131 millions de francs, soit 3,2% de plus qu ’ en 1999 Sur cette somme, 3'727 millions de francs ont été consacrés à l’agriculture et à l’alimentation Ce groupe de tâches conserve donc sa cinquième position, derrière les dépenses pour la prévoyance sociale (12'281 mio. de fr ), pour les finances et les impôts (9'413 mio de fr ), pour les transports (6'630 mio de fr ) et pour la défense nationale (5'004 mio de fr )
Sur l’ensemble des dépenses de la Confédération, la part consacrée à l’agriculture et à l’alimentation a atteint 7,9% en l’an 2000: jamais ce taux n ’avait été si bas au cours des dernières décennies
Les dépenses pour la production et les ventes sont subordonnées à une obligation énoncée à l’art. 187, al. 12, de la nouvelle LAgr (dispositions transitoires): les fonds destinés au soutien du marché doivent être réduits d’un tiers par rapport aux dépenses de 1998 dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi Cette réduction devrait atteindre un montant de près de 400 millions de francs; jusqu’à présent, ledit soutien a diminué de 248 millions de francs

1 . 1 E C O N O M I E 23 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E 1
Dépenses pour l’agriculture et l’alimentation Evolution des dépenses de la Confédération pour l’agriculture et l’alimentation 1990/921993 3 416 3 496 3 547 3 9533 908 3 926 4 197 3 727 3 048 1994 1995 1996 1997 1998 19992000 e n m i o d e f r e n % en % des dépenses totales Source: Compte d'Etat 0 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 7,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 Tableau 46,
■
page A54
Evolution des dépenses de la Confédération pour l’agriculture et l’alimentation

Remarque: la répartition des moyens financiers entre les différents domaines est fondée sur le Compte d’Etat 1999 Les dépenses pour la mise en valeur des pommes de terre et des fruits ou celles pour l administration des blés 1990/92 ont par conséquent été englobées dans celles de l’OFAG même si à l’époque les comptes étaient encore séparés
Il s ’ensuit que les chiffres pour 1990/92 et pour 1998 ne coïncident pas avec les données du Compte d’Etat
Sources: Compte d’Etat, OFAG
La nouvelle ordonnance sur les paiements directs est entrée en vigueur le 1er janvier 1999 Comme il était difficile de faire une estimation réaliste des besoins financiers avant l’introduction de ces nouvelles dispositions, les taux de contributions ont été fixés avec prudence pour les exercices 1999 et 2000 De plus, on a souvent enregistré ces dernières années des excédents de paiements, notamment en raison de la forte croissance du nombre d’exploitations participant aux programmes écologiques Pour tenir compte de ces incertitudes, pour résorber et pour éviter de nouveaux excédents de paiements, il a été décidé de fixer notamment la contribution à la surface un peu en dessous du montant possible selon les estimations Cette prudence s ’est soldée par une économie de 172 millions de francs par rapport à 1999, et le Conseil fédéral en a tenu compte le 10 janvier 2001 dans ses arrêtés pour l’année 2001 C’est ainsi que le taux de diverses contributions allouées dans le cadre des paiements directs a été révisé à la hausse. Les dépenses au titre des paiements directs devraient donc en 2001 dépasser de plus de 200 millions de francs celles de l’an 2000
Les dépenses affectées à l’amélioration des bases de production, qui n ’avaient guère varié de 1998 à 1999, se sont accrues de près de 100 millions de francs pour l’année sous revue Cette progression est due avant tout à l’extension des crédits d’investissements (aide initiale) et à l’augmentation de l’aide aux exploitations
1 . 1 E C O N O M I E 1 24
Domaine des dépenses 1990/92 1998 1999 2000 en mio de fr Production et ventes 1 685 1 203 1 318 955 Paiements directs 772 2 126 2 286 2 114 Amélioration des bases de production 207 147 148 246 Autres dépenses 384 450 445 412 Total agriculture et alimentation 3 048 3 926 4 197 3 727
1.1.2 Marchés
En 2000, les périodes de beau temps ont alterné avec les périodes d’intempéries. Succédant à un hiver froid et enneigé, la chaleur du printemps a permis à la végétation de prendre quelque deux semaines d’avance sur une année normale Le foin et les céréales engrangés étaient de bonne qualité grâce à un début d’été chaud et sec La récolte de blé panifiable a pour sa part joué de malchance vu la pluviosité du mois de juillet; la part de germination sur pied y a pris une ampleur disproportionnée En revanche, les récoltes abondantes de betteraves sucrières et de cerises ont largement dépassé les mauvais rendements de l’année précédente
Les productions laitière et fromagère se sont inscrites à la hausse dans l’année sous revue Le marché du bétail de boucherie s ’est bien porté jusqu’en automne, où les prix avaient rejoint le niveau d'avant la crise de l'ESB de 1996. Suite aux cas d’ESB apparus en France et en Allemagne, la maladie a repris le devant de la scène en novembre 2000, avec à la clé un effondrement des prix allant jusqu’à 30%
Composition
la production finale 2000
Autres produits d'origine végétale 3%
Fruits, légumes 10% Moût de raisin 7%
Pommes de terre, betteraves sucrières 4%
Céréales 7%
Dans les comptes économiques de l’agriculture, la valeur des denrées produites par l’agriculture est présentée comme production finale Pendant l’année sous revue, celleci a progressé de 4,8% en regard de l’année précédente La valeur totale des végétaux et produits végétaux a augmenté de 3,9% (86 mio. de fr.), celle des animaux et produits animaux de 5,2% (259 mio de fr )
1 . 1 E C O N O M I E 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E 25 1 ■■■■■■■■■■■■■■■■
de
Lait 33% Porcs 14% Bétail bovin 15%
.
. 1
Source: USP 1 estimation, état hiver 2000/2001 Total 7 583 mio
de fr
Volaille, œufs 5%
Autres produits d'origine animale 2%
14
Tableau
page A14
■ Une bonne année laitière
Lait et produits laitiers
Les laiteries et fromageries ont transformé environ 3,2 millions de t de lait en l’an 2000. La production dans les secteurs du fromage, des produits au lait frais et du lait en poudre a fortement augmenté La situation stable sur les marchés internationaux a permis d’écouler ce volume sans aucun problème
■ Production: hausse des livraisons de lait

La production totale, y compris le lait mis en valeur dans les exploitations, a augmenté de 28'000 t durant l’année sous revue pour atteindre 3,88 millions de t La production laitière par vache a également poursuivi sa croissance, de 90 kg en moyenne sur un an, pour s’établir à 5'470 kg.
Les producteurs ont vendu 3,17 millions de t de lait Cette quantité a été produite par 708'000 vaches. Le cheptel a marqué un recul de 1% (7'000 animaux) par rapport à l’année précédente
Les livraisons de lait mensuelles dans l’année écoulée étaient toutes plus élevées qu ’ en 1999, excepté pendant le mois de janvier Ce sont les mois d’avril et de septembre à décembre qui ont vu la plus forte progression des livraisons L’évolution est à mettre au compte de la bonne qualité du fourrage et de la demande croissante des fromageries et des utilisateurs de lait La situation difficile observée sur les marchés du bétail de boucherie durant les derniers mois de l’exercice a contribué à l’augmentation du nombre de vaches gardées dans les exploitations, qui a eu une incidence positive sur les livraisons de lait
1 . 1 E C O N O M I E 1 26
J a n v i e r F é v r i e r M a r s A v r i l M a i J u i n J u i l l e t A o û t S e p t e m b r e O c t o b r e N o v e m b r e D é c e m b r e e n 1 0 0 0 t Livraisons de lait 2000 Livraisons de lait 1999 Sources: TSM, USP 200 220 240 280 260 300
Livraisons de lait ventilées selon les mois, 1999 et 2000
Tableaux 3–13, pages A4-A13
La totalité du lait commercialisé (3,17 mio. de t) dans l’exercice sous revue a été transformée en (en t de lait):
lait de consommation et autres produits laitiers: 1'055'000 t
fromage: 1'410'000 t
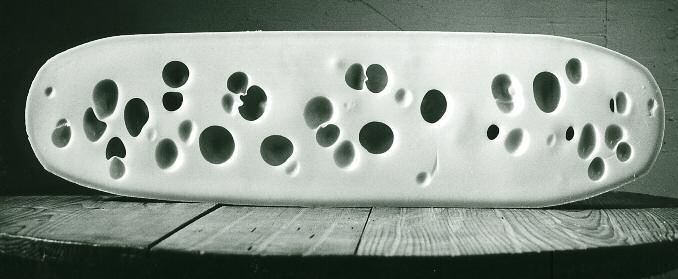
crème/beurre: 711'000 t
La quantité de fromage produite a progressé de 24,6% par rapport à l’année précédente Cette forte croissance ne s ’explique que partiellement par une hausse de la production Elle résulte aussi de l’adoption d’une nouvelle méthode de relevé statistique: avant le 1er mai 1999, le volume de production de la plupart des fromages était déterminé sur la base du lait utilisé. Ainsi, le fromage maigre (fromage sans graisse) n'était pas saisi La nouvelle méthode prend dorénavant en compte le fromage effectivement fabriqué Par ailleurs, la production de séré, de sérac brut (Rohziger), de caillé de fromage frais et de fromage d'alpage a été comprise dans la production de fromage en 2000 (part à la production totale de fromage: env 13%)
Pour la première fois depuis de nombreuses années, la production de fromage à pâte dure s ’est accrue dans l’année sous revue Elle a augmenté de 12% par rapport à l’année précédente Le volume de production de fromage frais tel que mozzarella, ainsi que de fromage à pâte molle et mi-dure poursuit, lui aussi, sa tendance à la hausse Comparé à l’année précédente, la mozzarella a vu sa production progresser de 20%, passant ainsi de 9'634 t à 11'582 t en 2000.
1 . 1 E C O N O M I E 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E 27 1
■ Mise
Evolution de la transformation de lait commercialisé 1990/921998 19992000 e n 1 0 0 0 t d e l a i t Autres produits laitiers Crème Beurre Sources: TSM, USP Fromage Lait de consommation 0 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500
en valeur: production de fromage en hausse
La tendance à la baisse enregistrée dans la production de beurre a persisté en 2000, bien que moins marquée qu ’ en 1999 Le recul dans l’exercice sous revue a atteint 1,7% La production de beurre de choix ne s ’est monté qu ’ a 7'142 t contre 33'222 t un an auparavant. Cette différence de taille est due à une modification dans le choix des paramètres utilisés pour établir la statistique Environ les 3⁄4 de la production suisse satisfont aux critères définis pour le beurre de choix Seuls quelque 20% toutefois sont finalement vendus comme tel, le reste servant de matière première à une transformation supplémentaire soit en «Le beurre», soit en spécialités ou en beurre déshydraté Pour l’année 2000, on n ’ a enregistré sous cette dénomination que le beurre effectivement vendu comme «beurre de choix» Les années précédentes, le beurre de choix était saisi sous cette dénomination même s’il subissait une transformation ultérieure
La quantité de lait en poudre produite dans l’exercice a progressé de 19% Cette évolution s ’explique par la demande accrue de lait entier en poudre suisse de la part de l’industrie du chocolat et par celle de lait maigre en poudre des fabricants de succédanés du lait

Le secteur laitier présente un bilan du commerce extérieur positif A l’exception du lait frais et du beurre, la Suisse a exporté plus de produits laitiers qu ’elle n ’ en a importés.
En 2000, les exportations de yoghourt ont progressé de 133% à 2'694 t La possibilité de conquérir de nouveaux marchés a été mise à profit. Les importations, au contraire, sont restées relativement constantes En ce qui concerne le lait en poudre, les exportations ont chuté de 21,3% à 13'992 t et les importations ont également reculé Par contre, les importations de beurre ont enregistré une hausse de 47,7% pour atteindre 7'370 t en l’an 2000 En comparaison de l’année précédente, les exportations de fromage ont accusé une baisse de 9'479 t (-15%) Celle-ci s ’explique principalement par les exportations extraordinaires de l’Union suisse du commerce de fromage effectuées l’année précédente dans le cadre de la dissolution de l’ancienne organisation du marché laitier. Enfin, pour ce qui est des exportations de fromage à pâte dure, on a enregistré une diminution de 18% à 40'588 t
1 . 1 E C O N O M I E 1 28
■ Commerce extérieur: baisse des exportations de fromage Evolution des importations et des exportations de fromage 1990/921998 19992000 e n t Exportations Importations Bilan commercial Sources: DGD, OFAG 0 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000
Si l’on se base sur la consommation par habitant, on observe des évolutions diverses selon les produits En 2000, la consommation de lait a augmenté de 2,2 kg par rapport à 1999 pour passer à 88,8 kg, alors qu ’elle avait continuellement diminué les années précédentes.
Pendant l’exercice sous revue, la consommation de fromage par habitant s ’est accrue de 6,4% à 16,6 kg, celle de fromage frais à elle seule de 2,9 kg à 3,3 kg. Dans le même intervalle, une tendance à la hausse se dessinait dans la consommation de fromage à pâte dure Après l’évolution positive de l’écoulement de la crème au cours des dernières années, un léger recul s ’est fait sentir en 2000
Depuis un peu plus d’une année, le prix au producteur est déterminé par la protection douanière, les mesures de soutien du marché et les forces du marché Il n ’est plus accordé qu ’ une importance secondaire au prix-cible déterminé par le Conseil fédéral, qui sert encore de valeur de référence Celui-ci est actuellement fixé à 77 ct par kg de lait pour une teneur totale cumulée de protéines et de graisse de 73 g
1 . 1 E C O N O M I E 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E 29 1
■ Consommation: fromage frais à la hausse ■ Prix à la production: prix-cible encore dépassé
19992000 k g / h a b i t a n t Fromage Yoghourt
Evolution de la consommation de produits laitiers par habitant 1990/921998
Séré Beurre 0 12 10 8 6 4 2 14 16 18 20 Prix du lait 1999 et 2000 Total
c t p a r k g d e l a i t 1999 Source: OFAG 2000 0 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10
Source: USP
Lait industriel Lait transformé en fromage Lait biologique
■ Prix à la consommation
En 2000, le prix-cible a encore été dépassé. Par rapport à l’année écoulée, le prix moyen du lait en Suisse a diminué de 1,52 ct par kg passant ainsi à 79,41 ct Les prix du lait industriel et du lait transformé en fromage ont également affiché une légère baisse. Le prix du lait biologique, quant à lui, a poursuivi son ascension, avec une augmentation de 2,7% l’établissant à 94,05 ct /kg
Prix du lait 2000, pour toute la Suisse et selon les régions
Considérées à l’échelon de la Suisse, les différences de prix sont relativement faibles En revanche, le prix d’un kg de lait biologique a dépassé de jusqu’à 16 ct celui du lait industriel ou du lait transformé en fromage
En 2000, le consommateur a payé, en moyenne, 2 fr 97 pour 200 g de beurre de choix, soit près de 10 ct. de plus qu ’ un an auparavant.
Les indices des prix à la consommation pour le lait et les produits laitiers ont suivi la même tendance depuis 1998. Alors que l’indice du lait diminuait de 5,7 points et celui de la crème de 7,9 points, celui du fromage en perdait 2,3 L’indice du beurre en revanche
1 . 1 E C O N O M I E 1 30
ct /kg CH Région I Région II Région III Région IV Région V Quantité totale 79,41 79,25 79,98 79,48 78,93 78,43 Lait industriel 78,29 78,40 78,49 78,61 77,73 77,91 Lait transformé en fromage 79,14 79,78 79,22 79,66 78,14 79,01 Lait biologique 94,05 93,88 94,63 93,26 94,02 pas relevé Source: OFAG
progressait
Evolution des indices des prix à la consommation du lait et des produits laitiers 1990/921998 19992000 I n d i c e ( m a i 1 9 9 3 = 1 0 0 ) Lait Fromage Beurre Source: OFS Crème Autres produits laitiers 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 105,0
Définitions et méthodes, page A77
■ Marge du marché
Définitions et méthodes, page A78
Depuis le 1er janvier 1997, la marge du marché dans le domaine du lait et des produits laitiers est calculée sur la base des prix à la production et à la consommation Comparé aux autres marchés agricoles, comme ceux de la viande ou des fruits et légumes, le marché du lait se comporte de manière plutôt statique. Les raisons principales sont les suivantes:
prix à la production Jusqu’au passage à la nouvelle organisation du marché laitier, le prix payé au producteur était fixé par l’Etat Depuis lors, les contrats de livraison entre les producteurs et les transformateurs sont renégociés chaque année
A l’échelon du producteur, le niveau des prix est donc relativement stable sur douze mois, mises à part les fluctuations saisonnières prévisibles – aides publiques. Comme par le passé, ces aides influent fortement sur les prix de vente En règle générale, les modifications ou adaptations sont décidées pour le début de l’année laitière, si bien que les aides restent fixes au moins pour la durée d’un an.
– contingentement laitier En raison du contingentement, la quantité de lait disponible, soit l’offre, est en principe déterminée d’avance
Conformément à ces données préalables, les marges de marché nominales des segments lait de consommation, fromage, crème de consommation et beurre ont évolué à un niveau relativement constant les dernières années Les fluctuations à court terme ont presque toutes été occasionnées par des ventes promotionnelles Depuis l’introduction de la nouvelle organisation de marché, les variations saisonnières du prix du lait – bas au printemps, élevé en automne – ont également influé sur les marges des divers groupes de produits
1 . 1 E C O N O M I E 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E 31 1
–
f r / k g Lait Fromage Beurre Crème Total Source: OFAG F e b 9 7 A p r 9 7 J u n 9 7 A u g 9 7 O k t 9 7 D e z 9 7 F e b 9 8 A p r 9 8 J u n 9 8 A u g 9 8 O k t 9 8 D e z 9 8 F e b 9 9 A p r 9 9 J u n 9 9 A u g 9 9 O k t 9 9 D e z 9 9 F e b 0 0 A p r 0 0 J u n 0 0 A u g 0 0 O k t 0 0 D e z 0 0 0 00 1.60 1.40 1 20 1 00 0 80 0 60 0 40 0 20
Evolution des marges du marché de janvier 1997 à décembre 2000, par kg de lait cru transformé
Dans le segment du lait de consommation, ce sont principalement des ventes promotionnelles qui ont été à l’origine des fluctuations de la marge La baisse des prix à la production liée au passage à la nouvelle organisation de marché a été répercutée sur les prix à la consommation. La brève hausse au mois de mai 1999 s ’explique par la vente de certains produits aux anciens prix Les taxes sur le lait écrémé ayant été supprimées au 1er mai 1999, la marge s ’ en est retrouvée légèrement plus élevée
La marge sur le fromage a subi une évolution des plus disparates Il faut toutefois prendre en considération que, vu la durée de stockage, les fluctuations du prix du lait ou les changements concernant les aides ne se font sentir qu ’ avec un certain retard Dans l’ensemble, la marge de marché sur le fromage affiche une légère tendance à la hausse. Elle s ’est notamment accrue au mois de septembre 2000, au moment où l’augmentation du supplément pour le lait transformé en fromage, qui avait passé de 12 à 20 ct le 1er mai 2000, commençait à produire son effet sur les marges La réduction du prix de la matière première transformée en fromage n ’ a donc pas été entièrement ristournée aux consommateurs
La marge sur la crème de consommation est restée relativement constante jusqu’en mai 1999, mises à part quelques brèves fluctuations La hausse de mai 1999 est due, comme pour le lait de consommation, à des produits étiquetés aux anciens prix. A partir de juin 1999, la marge s ’est à nouveau stabilisée à un niveau légèrement plus bas

La marge de marché sur le beurre était également stable jusqu’au passage à la nouvelle organisation du marché laitier Diverses aides dans le domaine du beurre ont alors été réduites, voire supprimées, si bien que la marge sur le beurre s ’est rétrécie dès le mois de mai 1999 Cette baisse est à mettre au seul compte de la réduction des aides étatiques.
La marge totale sur le lait et les produits laitiers s ’est accrue de 4,52 ct entre janvier 1997 et décembre 2000, passant de 78,86 à 83,38 ct./kg de lait cru transformé. Au début 2001, davantage de hausses des prix à la consommation ont été observées En considération de la stabilité ou même de l’augmentation des prix du lait et de la suppression du soutien dès le 1er mai 2001, on doit s 'attendre, pour l’année laitière 2001/2002, à de nouvelles hausses de prix dans le commerce
32 1 . 1 E C O N O M I E 1
■ Estimations 2001
La situation sur le marché laitier se présente sous de bons augures en 2001. Les ventes de produits laitiers dans le pays et à l’étranger se développent de façon réjouissante, particulièrement dans le secteur fromager
La production de fromage poursuivra probablement son évolution positive en 2001 Selon les données disponibles, il en est de même des produits à base de lait frais La production de spécialités comme le yoghourt, les desserts et les boissons au lait devrait dépasser les résultats de l’année précédente Côté beurre, il faut s ’attendre à une légère augmentation de la production
La situation du marché favorable dans l’ensemble devrait à nouveau garantir des prix stables aux producteurs. Les chiffres du premier semestre 2001 semblent indiquer que le prix du lait devrait vraisemblablement, en moyenne annuelle, à nouveau dépasser le prix-cible de 77 ct /kg La tendance des prix à la consommation des produits laitiers au cours des derniers mois s ’affiche à la hausse. Compte tenu des prix du lait inchangés, voire en hausse, et du démantèlement du soutien dès le 1er mai 2001, on doit en principe s 'attendre à de nouvelles majorations de prix, en particulier pour ce qui est du beurre et du fromage
Selon les estimations 2001 pour les comptes économiques de l’agriculture (cf. ch. 1 1 3), la production finale de lait pourrait bien augmenter de quelque 40 millions de francs (+1,5%) en 2001 par rapport à l’année précédente Ce résultat réjouissant est imputable à la stabilité du prix du lait ainsi qu’à la décision du Conseil fédéral d’augmenter le volume contingentaire global de 3% à partir du 1er mai 2001

1 . 1 E C O N O M I E 33 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E 1
Tableau 14, page A14
Tableaux 3–13, pages A4-A13
Animaux et produits animaux
Le retour de l’ESB sur le devant de la scène en fin d’année a perturbé le marché de la viande. Le premier cas d’ESB en Allemagne, jusque-là considérée comme indemne de l’épizootie, ainsi que les nombreux comptes rendus critiques des médias dans toute l’Europe ont inquiété les consommateurs Cela a induit, en Suisse, une baisse de la consommation de viande de bœuf atteignant 20% et une chute des prix à la production d’environ 30% Vu la proximité de la France, la Suisse romande a réagi de manière particulièrement forte Cette période a cependant été propice à la consommation de viande de volaille et d’agneau
En janvier de l’exercice déjà, l’apparition de la peste aviaire dans neuf provinces d’Italie du Nord a provoqué une grande inquiétude Dans l’intervalle, la Suisse a interdit l’importation de volaille vivante, de viande de volaille et d’autres produits en provenance d’Italie.
Par une modification de l’ordonnance fédérale sur les épizooties, le 20 décembre 2000, le Conseil fédéral a entériné une interdiction générale d'affouragement de farines animales Cette décision a été justifiée par l’apparition de cas d’ESB chez des vaches nées après le renforcement, en mai 1996, des mesures dans le domaine des aliments pour animaux, ainsi que par certains indices scientifiques Les graisses dites d’extraction, issues de la production des farines animales, tombent également sous le coup de l’interdiction, entrée en vigueur le 1er janvier 2001. La Confédération participe à raison de 75% (env 28 mio de fr ) aux coûts supplémentaires liés à l’élimination par incinération
■ Production: bœuf, veau et porc en baisse
Par rapport à l’année précédente, le cheptel bovin a diminué de 1,3% et l’effectif de pondeuses de 3,3% La tendance à long terme s ’est ainsi confirmée Au contraire, l’effectif des volailles à l’engrais poursuit sa progression entamée en 1990 et dépasse ainsi, dans l’année sous revue, de 32,3% la valeur de 1990, la demande de volaille du pays étant montée en flèche Le nombre de porcs, moutons, chèvres et chevaux détenus est resté relativement stable de 1998 à 2000
1 . 1 E C O N O M I E 1 34
Evolution des effectifs Catégorie d’animaux 1990 1998 1999 2000 1990–1998/00 en 1 000 en 1 000 en 1 000 en 1 000 % Bovins 1 858 1 641 1 609 1 588 -13,17 Porcs 1 776 1 487 1 453 1 498 -16,84 Moutons 355 422 424 421 18,78 Chèvres 61 60 62 62 0,55 Chevaux 38 46 49 50 26,32 Volailles à l’engrais 2 878 3 502 3 747 3 808 28,01 Poules pondeuses et d’élevage 2 795 2 270 2 223 2 150 -20,78
Source: OFS
La production de viande de bœuf a reculé de 13,3% par rapport à 1999, celle de viande de veau de 10,4% En effet, le nombre de veaux passés à l’engraissement de gros bétail a augmenté, vu les prix intéressants du bétail d’étal L’offre de viande de mouton a également été de 12,5% plus faible qu ’ un an auparavant. La demande animée de volaille suisse, quant à elle, a induit une croissance de 7,7% de la production

Par rapport à l’année précédente, la production d’œufs a diminué de 4,1% pour s’établir à 652 millions de pièces
Les importations de viande de veau se sont élevées à 2'007 t dans l’exercice, soit 662 t de plus que l’année précédente L’offre en Suisse ayant été exceptionnellement réduite au cours du premier semestre, plus de 600 t ont été importées durant cette période déjà. Nos principaux fournisseurs sont les Pays-Bas, l’Italie et la France. Pour ce qui est des quelque 13'000 t de viande de bœuf importée, il s ’agissait avant tout de morceaux spéciaux (aloyaux, «High-Quality-Beef» et morceaux parés de la cuisse de bœuf destinés à la fabrication de viande séchée)
Au total, 96 ânes, mulets et bardots ainsi que 2'646 chevaux et petits poneys ont aussi été importés dans l’année sous revue, ce qui représente une régression par rapport à 1999 En outre, la Suisse a importé 23'597 t d’œufs en coquille, dont 55% étaient destinés au commerce de détail et à la restauration et 45% à la transformation sous la forme d’œufs cassés Considérant un poids moyen de 60,289 g, ce sont 391 millions d’œufs en coquille qui ont été importés Depuis 1990/92, les importations d’œufs de consommation ont reculé de 25%, en bonne partie à cause de la préférence donnée aux œufs suisses On constate l’inverse pour les produits à base d’œufs, puisque les importations ont augmenté de 26% durant la même période
1 . 1 E C O N O M I E 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E 35 1
1990/921998 19992000 I n d i c e ( 1 9 9 0 / 9 2 = 1 0 0 ) Viande de boeuf Viande de mouton Volaille Source: Proviande Viande de veau Viande de chèvre Oeufs en coquille 70 140 130 120 110 100 90 80 Viande de porc Viande de cheval ■ Commerce extérieur:
de viande
hausse
Evolution de la production animale
importations
en
■ Consommation de viande et de poisson encore en baisse
En ce qui concerne la viande (toutes les catégories) et les œufs, la Suisse n ’exporte pas du tout ou alors seulement une faible part de sa production Le plus gros volume d’exportation, soit 969 t, concerne la viande séchée d’animaux de l’espèce bovine (viande séchée des Grisons), destinée essentiellement à deux pays voisins, l’Allemagne et la France
Comme ce fut le cas en 1999, aucun bovin n ’ a pu être exporté vers les pays de l’Union européenne Les cas d’ESB en Allemagne et en France et la fièvre aphteuse ont encore aggravé la situation Une campagne humanitaire mise sur pied l’automne dernier par la Direction du développement et de la coopération (DDC) a permis d’exporter 1’296 vaches et génisses vers le Kosovo Supervisée et suivie par des spécialistes, la campagne a suscité un large écho, tant en Suisse qu'à l'étranger. Au total 2'604 bovins vivants ont été importés pour l’élevage, dont une majorité des races Holstein (676 têtes) et Jersey (896 têtes) Plus de 90% des animaux provenaient d’Allemagne, du Danemark ou de France.
En 2000, la part de la consommation de viande de veau et de porc suisse s ’est élevée à environ 92% Pour ce qui est de la viande de cheval et de lapin, comme pour le poisson, la part de la production suisse se situe en dessous de 15%. En revanche, la part de la viande de volaille du pays s ’est de nouveau accrue en 2000, atteignant environ 43% 68% seulement de la consommation totale de viande et de poisson, qui s ’est chiffrée à 438'425 t, ont été produits en Suisse (1999: 70%).
La consommation de viande et de poisson a baissé de 1,6% par rapport à l’année précédente pour s’établir à 59,65 kg par habitant La tendance à la baisse persiste depuis 1998, mais la consommation des diverses catégories de viande par habitant a évolué de façon disparate; celle de porc et de bœuf a reculé de plus de 20%, tandis que celle de volaille a augmenté de 16% Avec plus de 25 kg par habitant et par an, la viande de porc est toujours en tête. La consommation de viande de mouton, de cheval, de chèvre et de lapin, par contre, reste faible et relativement constante
1 . 1 E C O N O M I E 1 36
Evolution de la consommation de viande et d'œufs par habitant 1990/921998 19992000 I n d i c e ( 1 9 9 0 / 9 2 = 1 0 0 ) Viande de bœuf Viande de porc Viande de chèvre Source: Proviande Volaille Viande de veau Viande de mouton 70 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 Viande de cheval Oeufs en coquille (pces)
■ Prix à la production: prix de la viande en hausse
De janvier à octobre 2000, les producteurs de viande de bœuf et de veau ont réalisé des prix jamais vu depuis 1995 L’offre restreinte de viande de veau a même entraîné une évolution atypique du prix, qui est resté constant à environ 13 fr /kg PM pendant le premier semestre, alors qu ’ en raison de l'offre généralement élevée en cette saison, il subit d’ordinaire une forte pression De même, la viande de porc a été payée en moyenne 7% de plus qu ’ en 1999, soit 4,69 fr /kg PM La viande d’agneau a suivi une évolution similaire avec une augmentation de 10% à 12,60 fr /kg PM L’évolution à la hausse observée pendant les dix premiers mois de l’exercice a été stoppée net par la reprise des débats sur l’ESB Vers la fin de l’année, les prix des taureaux de qualité moyenne (classe commerciale T3) ont chuté de 30% à 6,90 fr /kg PM
Sur le marché des œufs, les prix des œufs vendus aux centres collecteurs ont continué de baisser Ils ont diminué de 6% par rapport à 1999 pour s’établir à 21 ct la pièce Les mesures ciblées prises pour alléger le marché après les fêtes de Pâques ont toutefois permis d’atténuer la chute des prix saisonnière en été.
mensuels du bétail de boucherie et des porcs charnus,

■ Prix à la consommation: prix de la viande de bœuf et de veau en hausse
L’augmentation des prix au producteur pour la viande de bœuf et de veau a entraîné une hausse des prix à la consommation de 2 à 5 fr /kg Le niveau de ces derniers a même dépassé celui de la période de référence 1990/92 Les consommateurs ont aussi dû débourser plus pour la viande de porc et d’agneau, tandis que les prix des poulets frais du pays restent stables depuis plusieurs années
1 . 1 E C O N O M I E 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E 37 1
en 2000, à la ferme f r p a r k g P M Vaches cl comm T2/3 Taureaux cl comm T3 Veaux cl comm T3 Porcs charnus, légers Source: USP 0 00 2.00 4 00 6 00 8 00 10 00 12 00 14 00 16 00 J a n v i e r F é v r i e r M a r s A v r i l M a i J u i n J u i l l e t A o û t S e p t e m b r e O c t o b r e N o v e m b r e D é c e m b r e
Prix
■
La méthode de calcul de la marge de transformation-distribution sur la viande fraîche a été entièrement révisée et appliquée avec effet rétroactif au mois de janvier 1990 Pour la viande fraîche, l’OFAG calcule désormais la «marge brute de transformationdistribution» en fr./kg PM (TVA exclue). La marge est définie comme écart entre le rendement brut (ou chiffre d’affaires) et les coûts variables du secteur de transformation et de distribution Les valeurs annuelles sont calculées sur la moyenne des valeurs mensuelles, pondérées en fonction de la consommation Concernant l’évolution de la marge brute nominale, il faut tenir compte d’une inflation de 15% entre 1990 et 2000
■ Estimations 2001
Alors que pour les producteurs, l’année 2000 peut être qualifiée de bonne, les estimations concernant l’année suivante prévoient de fortes variations L’offre indigène de viande de bœuf et de veau devrait augmenter de 5 à 15%, tout en restant plus faible en chiffres absolus que celle de 1999 Les prix moyens des taureaux et des bovins de qualité moyenne devraient baisser à environ 7,00 fr /kg PM (-20%) En moyenne annuelle, ceux des veaux devraient également reculer à environ 12 fr./kg PM (-10%). Quant à la viande de porc, l’offre de produits suisses reste stable, ce qui devrait permettre de réaliser un prix moyen de 4,40 fr /kg PM
En raison de la situation tendue sur le marché du bétail de boucherie, les importations de viande de bœuf, de veau et de porc devraient accuser un recul sensible
A long terme, la tendance observée dans les effectifs de bovins et de volailles devrait se poursuivre. Ainsi le nombre de volailles à l’engrais devrait bientôt atteindre les 4 millions, et l’effectif de bovins à la baisse approcher le million et demi
La production finale d’animaux et de produits d’origine animale, sans le lait, pourrait bien être inférieure de plus de 8% à celle de l’année sous revue, un recul dû presque exclusivement à la production bovine, dont la valeur baisserait à quelque 930 millions de francs (-18,4%) Il s ’ensuit qu ’ avec une valeur de 1 milliard de francs, stable par rapport à l’an 2000, la production porcine pourrait à nouveau atteindre la part la plus importante pour ce qui est des animaux et des produits d’origine animale. Selon les estimations, aucune modification substantielle n ’est attendue dans les autres branches de la production animale
Marge brute sur la viande
I n d i c e ( 1 9 9 0 / 9 2 = 1 0 0 ) Total Boeuf Veau Porc Source: OFAG 70 90 90 100 110 120 130 140 150 1990199119921993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
1 . 1 E C O N O M I E 1 38
Evolution de la marge brute de transformation-distribution de viande fraîche (prix nominaux) 1990–2000
Tableau 14, page A14
■ Production: bonne année pour la production végétale

Production végétale et produits végétaux
Un premier semestre 2000 particulièrement chaud et ensoleillé dans l’ensemble a été suivi d’un mois de juillet humide et frais, marqué par de nombreux orages accompagnés de grêle, qui ont causé de gros dommages ponctuels aux cultures Ce n ’est qu’à la mi-août que des conditions estivales, soit un temps chaud et sec, ont refait leur apparition Les fortes précipitations du mois d’octobre sur les sols gorgés d’eau, en Valais principalement, mais aussi dans d’autres régions, ont provoqué des coulées de boue et des inondations locales sur de grandes surfaces L’hiver qui a suivi cette année 2000 déjà exceptionnellement chaude a été doux avec des températures dépassant 0° C jusqu’à plus de 1'000 m d’altitude
La météo chaude et les précipitations normales en moyenne annuelle ont été favorables aux cultures spéciales: les récoltes ont été précoces, importantes et de bonne qualité. Celle des cerises en particulier a commencé plus tôt que jamais et la qualité a été exceptionnelle grâce à de bonnes conditions météorologiques en début de récolte Le vin a, lui aussi, amplement bénéficié de la chaleur, ce qui fait du millésime 2000 l’un des meilleurs des dernières années
Les parts de surfaces des diverses cultures n ’ont pas grandement changé par rapport à l’année précédente Les terres ouvertes ont diminué de 1'339 ha au total Couvrant presque les deux tiers, la surface céréalière joue toujours le premier rôle. La surface vouée aux oléagineux n ’ a que peu diminué; la part des tournesols a augmenté et celles du colza et du soja ont été réduites par rapport à l’année précédente En raison de la réduction de plus de 50% des prix à la production, la culture d’oléagineux a perdu de son intérêt économique, malgré l’introduction d’une contribution spécifique à la surface. Par ailleurs, une garantie limitée en matière de prix et de prise en charge du blé panifiable était encore en vigueur dans l’année sous revue Les prix payés aux producteurs pour les oléagineux et le blé panifiable se situaient donc dans la même fourchette, soit entre 60 et 70 fr./dt. La surface cultivée en pommes de terre et en betteraves sucrières a, par contre, augmenté très légèrement
1 . 1 E C O N O M I E 39 1
Tableaux 3–13, pages A4-A13
Composition des terres ouvertes 2000
Total 292 548 ha
Maïs d'ensilage et maïs vert 14% 40 486 ha
Cultures maraîchères de plein champ 3% 8 459 ha
Colza 5% 14 343 ha
Betteraves sucrières 6% 17 725 ha
Autres cultures 5% 14 713 ha
Céréales 62% 182 669 ha
Pommes de terre 5% 14 153 ha
Source: USP
Dans les grandes cultures, les rendements varient beaucoup selon les cultures; ils ont toutefois été nettement plus élevés que l’année précédente, bien qu’ils n ’aient pu égaler les bons résultats de 1998 La culture de céréales panifiables a atteint des rendements satisfaisants, tout en laissant à désirer quant à la qualité Les précipitations abondantes du mois de juillet ont fait germer sur pied une grande partie du blé panifiable Les rendements de colza ont été modestes, alors que les 1,4 million de t de betteraves sucrières représentent un record La récolte de pommes de terre s ’est située juste en dessous de la moyenne pluriannuelle.
1990/921998
Produits (rendements 2000)
Blé d'automne (60 dt/ha) Pommes de terre (424 dt/ha)
19992000
Colza (27 dt/ha) Orge (60 dt/ha)
Betteraves sucrières (795 dt/ha)

Source: USP
Les cultures pérennes constituent 2,3% de la SAU, à savoir 24'229 ha, dont 6'984 de cultures fruitières, 250 de baies et 15'058 de vignes. La surface viticole est restée constante bien que le rapport entre les vignes à raisin rouge (7'958) et celles à raisin blanc (7'100) ait basculé en faveur des variétés rouges (+44 ha)
1 . 1 E C O N O M I E 1 40
Evolution des rendements à la surface de
produits des champs
divers
I n d i c e ( 1 9 9 0 / 9 2 = 1 0 0 )
70 140 130 120 110 100 90 80
Les cultures maraîchères couvertes de vlies ou de feuilles de plastique servant à forcer ou à rallonger la période de culture ont presque doublé ces dix dernières années, atteignant actuellement environ 2000 ha La surface sous serre ou sous tunnel ne s ’est par contre accrue que de quelques ha pendant la même période (2000; 820 ha).
Les cultures de pommes couvraient une surface de 4'812 ha, soit 203 ha de moins que l’année précédente. Les prix à la production médiocres de la saison 1998/99 ont poussé les arboriculteurs à diminuer la surface de leurs cultures 90 ha supplémentaires ont été sacrifiés en l’an 2000 lors des campagnes d’arrachage de la Fruit-Union suisse (FUS), financées à l’aide du fonds d’entraide des producteurs Comme en 1990/92, les variétés principales Golden Delicious, Idared, Jonagold, Maigold et Gala ont compté pour plus de la moitié de la surface des cultures de pommes. Une certaine concentration sur ces variétés a été constatée au cours des dix dernières années; leur part à la surface totale est passée de 53% à 62% La principale responsable est la variété Gala, dont la surface cultivée a quadruplé durant cette période. Elle occupe désormais le deuxième rang après la Golden Delicious De même, les surfaces affectées aux variétés Rubinette, Braeburn et Topaz ont continuellement pris de l’ampleur
Les volumes de marché des espèces de légumes et de fruits cultivables en Suisse se sont élevés à respectivement 485'800 t et 173'900 t en moyenne des trois dernières années La part des légumes suisses correspond à 58% de ce volume Les légumes de garde tels que carottes, céleris-pommes, betteraves rouges, choux rouges et blancs, choux de Milan et oignons, ainsi que les salades Lollo, doucette et feuille de chêne, ont affiché des parts indigènes remarquables de plus de 85% Pour ce qui est des fruits, la part au marché des produits du pays s ’est montée en moyenne à 73% au cours des quatre dernières années. Avec 92%, cette part a été particulièrement importante en ce qui concerne les pommes, contrairement aux abricots, pour lesquels elle ne s ’est élevée qu’à 19%
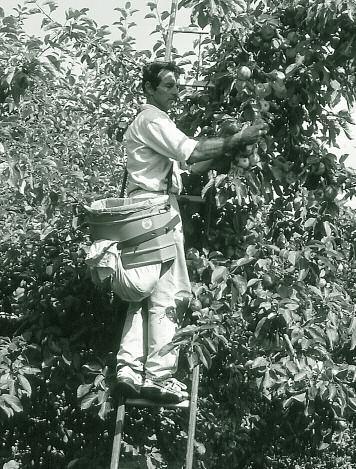
1 . 1 E C O N O M I E 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E 41 1
Evolution
pommes 1990/921998 19992000 e n h a Golden Delicious Idared Gala Source: OFAG Glockenapfel Maigold Gloster 0 1 500 1 000 500 Groupe Jonagold Groupe Jonathan
des surfaces de variétés de
6'600 t de champignons de Paris produits en Suisse ont été commercialisés à l’état frais Cette quantité correspond à la moyenne des trois dernières années et à une part de marché de 80% Par contre, seules 350 t de ces champignons ont servis à la préparation de conserves; il s ’agit en fait des invendus de champignons destinés au marché frais La part de marché de champignons de conserve suisses a diminué, comme l’année précédente, et s ’est établie à 5%
La récolte de raisins en 2000 a permis une production de 127,6 millions de litres de vin, soit 3,4 millions de litres de moins que l’année précédente 60,6 millions de litres sont issus de variétés de raisin rouge et 67 millions de litres de variétés de raisin blanc
Vu la pluviosité élevée du mois de juillet, la moisson s ’est faite dans de mauvaises conditions Un quart du blé panifiable pris en charge par la Confédération a germé sur pied et n ’ a donc pu être utilisé que dans l’alimentation des animaux. La qualité du blé panifiable se prêtant à la mouture se situait dans la moyenne, et l’offre a tout juste couvert la demande en blé panifiable suisse En considérant l’évolution de la mise en valeur des céréales au cours des dernières dix années, on constate que les fluctuations de l’offre dans le pays sont atténuées par le biais du secteur des aliments pour animaux. Grâce à la prise en charge par la Confédération, il a toujours été possible de vendre du blé panifiable en quantité constante
Les sucreries d’Aarberg et de Frauenfeld ont produit 218'511 t de sucre Comme leur mandat de transformation ne porte que sur 185'000 t, il a fallu soit reporter à la campagne suivante le solde de 33'511 t de sucre dit sucre C, soit en écouler une certaine quantité aux prix du marché mondial Ces derniers ayant été élevés, de nombreux producteurs de betteraves ont préféré décompter la quantité dépassant le contingent (betteraves C), afin de bénéficier de la quantité contingentaire intégrale (betteraves A et B) l’année suivante

1 . 1 E C O N O M I E 1 42
■ Mise en valeur: beaucoup de céréales germées sur pied Evolution de l'utilisation de la récolte de céréales 199019911992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 e n 1 0 0 0 t Quantité garantie céréales panifiables Céréales germées (déclassées) Autres céréales panifiables déclassées Céréales fourragères yc céréales panifiables non livrées Source: OFAG Céréales panifiables prises en charge par la Confédération 0 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200
Les poires de table suisses, à l’instar des pommes de table, proviennent presque exclusivement des cultures fruitières Alors que les quantités annuellement commercialisées de ces dernières sont relativement stables, des fluctuations assez importantes sont observées d’année en année pour les poires. La production suisse de poires destinées à être consommées à l’état frais varie depuis 1993 entre 11'000 t et 16'000 t Contrairement aux pommes, la mise en valeur technique ne sert pas de tampon au marché des fruits de table. Les poires récoltées dans les cultures fruitières sont commercialisées exclusivement sur le marché des fruits frais, à l’exception de la variété Williams, dont le débouché majeur est la distillation Les pommes et poires provenant des vergers traditionnels, fortement soumis à des fluctuations naturelles de rendement (alternance), sont exclusivement transformées dans les cidreries
La tendance à la baisse observée depuis plusieurs années à l’intérieur du pays dans l’écoulement des boissons à base de jus de fruits fermentés ou non fermentés semble s’inverser. En 2000, la vente de jus de fruits fermentés a ainsi égalé celle de l’année précédente, et on a même constaté une légère croissance dans l’écoulement des jus non fermentés
La boisson de saison «jus de fruits frais du pressoir» a aussi légèrement augmenté sa part de marché, bien qu ’ aucune action promotionnelle particulière n ’ait été lancée
Un peu moins de 200'000 t d’oléagineux ont été transformés en Suisse dans l’année sous rapport, dont 109'000 t de fèves de soja provenant principalement d’importations 14'825 t d’huile de soja ont été réexportées dans le cadre du trafic de perfectionnement. S’y sont ajoutés 3'000 t d’huile de colza du pays exportées dans le cadre de l’aide humanitaire Suite à la maigre récolte, 1'700 t d’huile de colza ont été importées à des fins alimentaires ainsi que près de 2'000 t de graines de colza pour assurer l’utilisation des capacités de production de biodiesel La transformation en huile comestible d’oléagineux importés devrait sensiblement diminuer à l’avenir, car la fermeture de l’huilerie de Horn (TG) à la fin 2000 a réduit les capacités de transformation d’environ deux tiers
1 . 1 E C O N O M I E 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E 43 1
■ Commerce extérieur: soja importé Evolution de l'utilisation des récoltes de poires 1993/961997 1998 1999 2000 e n 1 0 0 0 t Vergers traditionnels Cultures fruitières Poires à cidre Poires à distiller Poires de table Source: OFAG 0 120 100 80 60 40 20
suisse et importations de produits sélectionnés, en 2000
Pour la première fois, l’accès minimal au marché de 5% notifié auprès de l’OMC pour le contingent tarifaire de pommes de terre a dû être concédé dans l’année sous revue Il s ’agit d’une quantité totale de 22'250 t de pommes de terre et de produits à base de pommes de terre En raison de la faible récolte en 1999, le contingent a été augmenté afin d’assurer la jonction avec la récolte 2000. La production suisse n ’ a notamment pas suffi à couvrir le besoin en matière première de perfectionnement pour la fabrication de chips, frites, etc
Depuis le début des années nonante, l’approvisionnement en sucre indigène n ’ a cessé de croître pour atteindre plus de 80% de la consommation nette Parallèlement, les échanges (importations et exportations) avec l’UE dans le cadre du trafic de perfectionnement ont progressé Les limonades constituent la majeure partie de ces exportations de sucre sous la forme de produits transformés, l’UE ayant réduit, en faveur de la Suisse, les droits de douane grevant les positions tarifaires y relatives (Protocole 2 de l'Accord de libre-échange de 1972)
L’approvisionnement du pays en aliments pour animaux protidiques reste largement tributaire des importations, qui couvrent plus des trois quarts des besoins Le soja, avec 170'000 t, se taille la part du lion.

1 . 1 E C O N O M I E 1 44
Production
Céréales panifiables Céréales fourragères Sucre Oléagineux Pommes de terre Légumes Fruits (sans fruits tropicaux) e n 1 0 0 0 t Importations Production suisse Sources: USP, Fruit-Union suisse, Centrale suisse de la culture maraîchère, DGD, Sucreries Aarberg et Frauenfeld 0 100 200 300 400 500 600 700 Evolution du bilan de sucre 1990/921998 19992000 e n 1 0 0 0 t Importations Production suisse Exportations Consommation nette Source: Office fiduciaire des importateurs suisses de denrées alimentaires 0 450 400 350 300 250 200 150 100 50
Depuis le début 2001, l’interdiction des protéines animales (farine de viande, farine de viande et d’os, farine de cretons, tourteau de cretons, farine d’os dégraissée destinée à l’alimentation animale, farine de sang, gélatine issue de déchets d’abattage de ruminants, farine de volaille et de plumes) s ’applique à tous les animaux de rente. Cette mesure n ’ a toutefois qu ’ un impact réduit sur les importations, étant donné que pendant l’exercice sous revue, à peine 2% des aliments pour animaux protidiques étaient d’origine animale et que désormais, seuls les aliments d’origine végétale sont autorisés L’utilisation de farines animales dans l’alimentation des animaux de rente est d’ailleurs en baisse constante depuis 1990
Les importations de légumes et de fruits également cultivables en Suisse, soit 206'300t et 48'200 t respectivement, sont de 2% inférieures à celles de l’année précédente. Les légumes et fruits d’importation les plus courants sont ceux généralement cultivés sous des feuilles en plastique ou sous serre, tels que les tomates, les poivrons, les concombres à salade et les fraises. Ces produits frais représentent à eux seuls un tiers des importations Plus des deux tiers des légumes et fruits importés proviennent d’Italie, d’Espagne et de France Les autres pays exportateurs jouant un rôle important sont la Hollande pour les légumes, le Maroc pour les tomates et l’Afrique du Sud pour les poires Alors que les légumes sont surtout importés en hiver (68%), les importations de fruits s ’effectuent en premier lieu durant l’été (67%) Depuis 1998, on constate une croissance particulière des importations de cerises et de pruneaux à distiller y c sous forme de moût
Les importations de vins de bouche ont atteint 142,5 millions de litres pour le rouge et 17,8 millions pour le blanc, auxquels se sont ajoutés environ 10,7 millions de litres de vins mousseux, 8,4 millions de litres de vins industriels et 1,5 million de litres de vins doux Quant aux exportations de vin suisse, elles se sont chiffrées à quelque 700'000 litres, comme l’année précédente Comparé à 1999, on constate un recul des importations de 5 millions de litres pour le vin rouge et de 2,3 millions de litres pour le vin mousseux Quant au vin blanc et au vin doux, les importations sont restées stables
1 . 1 E C O N O M I E 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E 45 1
1990/921998 19992000 e n 1 0 0 0 t
Sourc
Production
t
végét
Production suisse produits animaux 0 450 400 350 300 250 200 150 100 50
Evolution de l'approvisionnement en aliments protidiques pour animaux
Importations produits végétaux Importations produits animaux
es: OFAG, DGD
suisse produi
s
aux
■ Consommation: plus de courges

La consommation moyenne de légumes et de fruits frais produits en Suisse s ’est élevée à 68 kg de légumes par personne pour les années 1998/2000 et à 24 kg de fruits pour les années 1997/2000 Cela correspond à une augmentation de la consommation de légumes de 7 kg par rapport aux années 1990/92 et à une baisse de celle de fruits de 1 kg par personne en comparaison des quatre années de référence 1990/93
Habitudes alimentaires en évolution: la consommation de courges suisses a affiché une forte hausse en 2000 La quantité consommée a plus que doublé par rapport à l’année précédente pour s’établir à 4'432 t S’agissant des tomates en grappes (tomates rondes et cherry) et de la salade feuille de chêne suisses, on a également enregistré une forte progression d’environ 50% par rapport à l’année précédente Depuis plusieurs années, la consommation de salades iceberg, de chicorée pain de sucre, de brocoli et d’oignons en bottes augmente continuellement
La consommation de nouvelles variétés de fruits à noyau de gros calibre est en expansion Il s ’agit, par exemple, des variétés de pruneaux d’un diamètre de 33 mm, Cacaks Schöne, Hanita et Elena, des cerises Kordia, Star et Regina ainsi que des abricots Jumbo Cot et Goldrich Les surfaces affectées à ces cultures se sont accrues depuis deux à trois ans L’offre suisse devrait donc encore augmenter au cours des prochaines années
Consommation de vin rouge et blanc durant l'année viticole 1999/2000
Vin blanc étranger 8%Vin blanc: 30%
Vin rouge: 70%
295,8 mio. de litres = 100%
Vin blanc suisse 22%
Vin rouge suisse 20%
Vin rouge étranger 50%
Sources: DGD, OFAG, cantons
La consommation de vin en Suisse a connu une nouvelle hausse de 1,2 million de litres durant l’année viticole 1999/2000, pour s’établir à 295,8 millions de litres La part de la production suisse a progressé de 1%, passant ainsi à 42,1% La consommation de vins suisses s ’est ainsi accrue de 2,6 millions de litres pour atteindre 125 millions de litres. S’agissant du vin rouge, la consommation totale (vins industriels compris) s ’est élevée à 205,6 millions de litres, ce qui équivaut à une progression de 2,1 millions de litres Celle de vin blanc, au contraire, a subi un léger recul, le total de 90,2 millions de litres étant de 0,7 million inférieur à celui de l’année précédente.
46 1 . 1 E C O N O M I E 1
■ Prix à la production: diminution dans les grandes cultures
Le recul des prix à la production dans les grandes cultures s ’est poursuivi pour la plupart des cultures Les prix des oléagineux ont chuté de 50 à 70% Une partie des pertes de revenu ont pu être compensées grâce aux nouvelles contributions à la surface de 1'500 fr./ha introduites pour les oléagineux. Les prix des céréales panifiables ont également été adaptés à la baisse dans l’optique de la libéralisation envisagée Vu la réduction simultanée des primes de culture octroyées pour les céréales fourragères, la parité des recettes a été maintenue dans une large mesure A partir du 1er juillet 2001, toutes les garanties de prix et de prise en charge ont été abolies pour les produits des champs

19992000 E c a r t e n % Prix à la production 2000 Blé, 66.40 fr./dt Betteraves sucrières, 11.60 fr /dt Colza, 61.30 fr /dt Source: FAT Orge, 48 50 fr /dt Pommes de terre, 36.10 fr /dt -40 -50 -60 -70 -30 -20 -10 0 47 1 . 1 E C O N O M I E 1
Evolution des prix à la production de produits des champs
1990/921998
En ce qui concerne les légumes, les producteurs ont obtenu des gains supérieurs aux années précédentes pour la plupart des variétés Le prix au kilo moyen a dépassé de 10% environ la moyenne des trois années précédentes Grâce aux prix plus élevés et aux récoltes moyennes, les producteurs ont réalisé des gains d’environ 7% supérieurs aux années 1997/1999 Les prix et les gains plus élevés doivent cependant être relativisés dans le contexte de l’évolution des coûts Sur mandat de l’Union maraîchère suisse (UMS), la Station fédérale de recherches en économie et technologie agricoles de Tänikon (FAT) a fait une expertise de l’évolution des coûts de 1999 à 2001 dans cinq exploitations maraîchères spécialisées, de tailles moyenne à grande, gérées de façon professionnelle Il en ressort une augmentation des frais de production de 8,5% entre 1999 et 2000 et de 5,8% entre 2000 et 2001 Cette forte croissance résulte en premier lieu des postes suivants: coûts de main-d'œuvre, frais de transport (redevance sur les poids lourds liée aux prestations), frais d’énergie et frais supplémentaires occasionnés par la conversion à de nouveaux emballages
Pour la première fois, le prix des cerises de la catégorie Extra à gros fruits a été calculé indépendamment de la classe 1 Ainsi, les cerises de la classe Extra, provenant généralement de cultures couvertes, ont permis d’obtenir jusqu’à 1 fr 70 de plus que celles de la classe 1

La branche s ’est mise d’accord sur un prix de référence des cerises à distiller de 93 ct /kg pour 18 degré Brix (teneur en sucre) Le prix a pu être réalisé malgré l’importation de grandes quantités de cerises fraîches à distiller. Les marchés ressentiront encore durant plusieurs années les conséquences de ce volume considérable d’importations
Les prix des fruits à cidre abaissés de manière générale de 10 francs par t en 1998 n ’ont pas changé en 2000 L’objectif de la branche, soit que chaque producteur de fruits à cidre puisse obtenir le même prix, indépendamment du lieu de production, lors de la livraison de ses fruits à la cidrerie la plus proche, est maintenu La récolte 2000 dépassant la moyenne, les producteurs ont dû s ’acquitter de retenues se situant entre 70 et 80 francs par t de fruits à cidre. Il manque néanmoins quelque 8 millions de francs pour la transformation des excédents et l’écoulement intégral des stocks de concentrés Par conséquent, des retenues élevées devront encore être perçues ces prochaines années
48 1 . 1 E C O N O M I E 1
■ Prix à la consommation: marge sur les tomates à la hausse
Les produits lancés tôt sur le marché permettent d’obtenir de meilleurs prix. C’est le cas des framboises, cerises, pêches jaunes, salade pommée et rhubarbe, qui ont atteint des prix primeurs plus élevés qu ’ un an auparavant
Evolution des prix à la consommation de fruits primeurs à l'exemple des cerises
Les prix des tomates ordinaires (tomates rondes) et des tomates charnues ont atteint des sommets en 2000 Cela s ’explique par des prix d’achat plus élevés, mais aussi par une augmentation temporaire de la marge
Prix à la consommation des tomates ordinaires et des tomates charnues
19981999 2000
49 1 . 1 E C O N O M I E 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E 1
19931994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 f r / k g Cerises Source: OFAG 0 00 16 00 14 00 12.00 10.00 8 00 6 00 4 00 2.00
f r / k g Tomates charnues Tomates ordinaires Source: OFAG 2 00 6 00 5 50 5 00 4 50 4 00 3 50 3 00 2 50
En 1993, la marge nominale des prix réalisée sur les tomates se montait encore à 1,61 fr /kg Elle a progressé continuellement depuis lors pour atteindre aujourd’hui
1,95 fr /kg La part de la marge au prix à la consommation s ’est constamment accrue et a passé de 48% en 1993 à 55% en 2000. La marge absolue sur un grand nombre de légumes et de fruits a légèrement augmenté au cours des dernières années, sans que sa part au prix à la consommation grossisse pour autant
En 2000, les commerçants de boissons n ’ont que très peu majoré le prix des jus de pomme et d’autres fruits
Les conditions climatiques très humides et froides de ce printemps ont eu des répercussions négatives sur la plupart des grandes cultures La météo ensoleillée et chaude de la deuxième moitié du mois de juillet a permis d’effectuer la moisson dans des conditions bonnes voire très bonnes. D’une manière générale, les prix de référence pour les céréales ont pu être atteints vu la belle qualité des céréales et la quantité quelque peu plus faible que l’année précédente Les parts de contingent tarifaire de céréales panifiables pour le premier semestre 2001, mises aux enchères pour la première fois et s’élevant à 35'000 t au total seront probablement entièrement utilisées Des importations sont nécessaires pour couvrir la demande, notamment en ce qui concerne les céréales biologiques et le froment à biscuits
Alors que la récolte de pommes de terre nouvelles a chuté pour atteindre un plancher record, les variétés mi-tardives et tardives ont profité de conditions nettement plus favorables On escompte ainsi une récolte moyenne Le contingent tarifaire de pommes de terre a été augmenté afin de satisfaire à l’excès de demande en pommes de terre destinées à une consommation à l’état frais et à l’industrie de transformation
50 1 . 1 E C O N O M I E 1
19931994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 f r / k g Revient Vente Marge Source: OFAG 0 4 00 3 50 3 00 2 50 2 00 1 50 1 00 0 50
Evolution des prix des tomates ordinaires et des tomates charnues
■ Estimations 2001
Les betteraves sucrières ont été semées avec environ un mois de retard dans la plupart des cas Vu la période de végétation plus courte, la récolte de 2001 ne suffira pas à atteindre le volume de sucre maximal de 185'000 t
En maints endroits, les champs de colza se sont étonnamment bien remis de la forte pluviosité du printemps On a ainsi souvent enregistré des rendements élevés avoisinant les 40 dt/ha La production n ’ a toutefois atteint que 38'300 t au lieu des 42'000 t visées par l’interprofession swiss granum, vu la surface mise en culture trop faible Les prix d’importation pour les oléagineux et les huiles et graisses végétales ayant affiché une hausse, celle-ci s ’est répercutée sur les prix des produits indigènes 3'000 t d’huile de colza ont dû être importées au cours du premier semestre en raison de la demande excédentaire. La récolte mondiale de colza devrait se situer env. 1,4% au-dessous de celle de l’année passée
Les pluies importantes du printemps ont empêché le semis et la plantation de légumes. Du côté des fruits, le temps froid et humide a gêné la fécondation et provoqué un retard de végétation
L’offre en légumes suisses durant le premier semestre s ’est située 12'600 t (22%) audessous de celle de l’année précédente. Les légumes à feuilles ont été particulièrement touchés par les mauvaises conditions météorologiques Les déficits indigènes ont été compensés par une hausse des quantités importées Durant le 1er semestre, les importations ont présenté 9'200 t, soit 7% de plus qu ’ un an auparavant. Les pertes de rendement sur les surfaces maraîchères suisses ont été presque compensées par des prix plus élevés Le revenu semestriel de 159 millions de francs s’établissait à juste 1 million de francs au-dessous de celui de 2000
Pour les fruits, en comparaison des années précédentes, la récolte a été jugée moyenne Les quantités estimées sont pour la plupart nettement au-dessous de celles de la bonne année précédente Pour les pommes et les poires provenant des cultures fruitières, les estimations se situent à 130'400 t et 23'300 t respectivement, soit 12 et 3% au-dessous de la moyenne des quatre dernières années
En ce qui concerne le vin, vu la limitation supplémentaire des rendements décidée dans les cantons du Valais, de Vaud et de Genève, on escompte une récolte de 120 millions de litre de moût de raisin de bonne qualité
Selon les estimations 2001 pour les comptes économiques de l’agriculture (cf ch 1.1.3), les recettes totales devraient, en production végétale, être inférieures de 200 millions de francs (-9,1%) à celles de l'an 2000
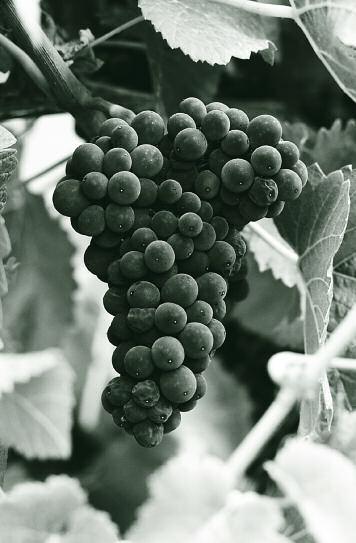
51 1 . 1 E C O N O M I E 1
1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E
Tableau 14, page A14
1.1.3 Situation économique du secteur agricole
Conformément à l’art. 5 LAgr, les mesures de politique agricole doivent permettre aux exploitations remplissant les critères de durabilité et de performance économique de réaliser, en moyenne pluriannuelle, un revenu comparable à celui de la population active dans les autres secteurs économiques d’une même région
La situation économique est évaluée en application des art 3 à 7 de l’ordonnance sur l’évaluation de la durabilité de l’agriculture Deux systèmes d’indicateurs sont utilisés à cette fin: d’une part, l’évaluation sectorielle, qui se fonde sur les comptes économiques de l’agriculture établis par le Secrétariat de l’USP sur mandat et sous la surveillance de l’OFAG et de l’OFS (cf ch 1 1 3); d’autre part, l’appréciation de la situation économique des exploitations prises individuellement, qui se fonde sur les résultats comptables du dépouillement centralisé effectué par la FAT (cf. ch. 1.1.4).
Le revenu net issu de l’activité agricole de la main-d’œuvre familiale s ’est chiffré à environ 2,6 milliards de francs pour l’année sous revue, contre quelque 2,4 milliards de francs en 1999. Cette amélioration (+9%) est d’abord le fruit de l’indéniable progression (+5%) de la production finale: l’année a été favorable pour la production végétale, les résultats atteints dans les secteurs bovin et porcin se sont améliorés, tandis que les coûts sont demeurés stables. Si la consommation intermédiaire, les amortissements et les intérêts se sont inscrits en hausse (respectivement +3%, +1% et +8%), il y a eu un recul de la rémunération de la main-d’œuvre non familiale (-3%) et des impôts liés à la production (-37%) Enfin, les transferts publics pour le secteur agricole (à savoir pour l’essentiel des paiements directs indépendants de la production) n ’ont pratiquement pas varié.
52 1 . 1 E C O N O M I E 1 ■■■■■■■■■■■■■■■■
Résultats des comptes économiques de l’agriculture suisse Données exprimées en prix courants, en mio de fr 1990/92 1997 1998 1999 1 2000 2 2001 3 Production finale 9 902 7 931 7 894 7 239 7 583 7 200 + contributions des pouvoirs publics (subventions) 1 317 2 547 2 439 2 424 2 417 2 679 - consommation intermédiaire 4 173 3 865 3 855 3 796 3 923 3 954 - impôts liés à la production, compensation TVA 123 300 273 218 174 167 Valeur ajoutée brute au coût des facteurs 6 923 6 313 6 204 5 648 5 904 5 758 - amortissements 2 031 1 857 1 853 1 837 1 859 1 899 - fermages et intérêts 845 729 700 691 729 759 - rémunération de la main-d’œuvre non familiale 827 798 764 738 715 715 Revenu net de l’activité agricole pour la main-d’œuvre familiale 3 221 2 930 2 888 2 383 2 600 2 385 1 chiffres provisoires, état hiver 2000/2001 2 estimation, état hiver 2000/2001 3 estimation, état été 2001 Source: USP ■ Deux systèmes d’indicateurs permettent d’évaluer la situation économique ■ Revenu sectoriel en l’an 2000
Définitions et méthodes page A81
■ Estimation du revenu sectoriel pour 2001
Le revenu de la main-d’œuvre familiale travaillant dans l’agriculture a diminué de quelque 18% entre 1990/92 et 1998/2000 Au cours de la même période, l’effectif des salariés membres de la famille de l’exploitant a subi lui aussi une forte baisse: le recensement de l’agriculture de l’année 2000 a révélé un recul de près de 24% par rapport à l’année 1990
Contributions des pouvoirs publics (subventions) Production finale Dépenses (intrants agricoles, impôts liés à la production, amortissements, coûts d'affermage, intérêts et frais de personnel) Revenu net tiré de l'activité agricole de la main-d' oeuvre familiale
1 Provisoire, état hiver 2000/2001
2 Estimation, état hiver 2000/2001
3 Estimation, état été 2001
L’estimation pour 2001 (effectuée en août) est fondée non pas sur les estimations pour l’an 2000, mais sur les données encore provisoires concernant l’exercice 1999 Cette manière de faire permet d’éviter de reporter sur l’année en cours les éventuelles imprécisions figurant dans les estimations pour l’an 2000. Les données concernant 2001 seront comparées avec celles des années 1998/2000 (moyenne triennale)
Selon l’estimation, la production finale atteindrait en 2001 7,2 milliards de francs, soit près de 5% de moins que la moyenne triennale La comparaison avec l’estimation pour 2000 aboutit au même pronostic: -5% Ce recul s ’explique pour l’essentiel par la chute des prix des céréales, suite à la libéralisation du marché et par les faibles prix de la viande de bœuf Le point 1 1 2 présente, dans la rubrique intitulée «Estimations 2001», une évaluation de la situation actuelle des divers secteurs de la production agricole
53 1 . 1 E C O N O M I E 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E 1
Evolution des comptes économiques de l’agriculture 1990/921997 1998 1999 1 2000 2 20013 I n d i c a t i o n s e n p r i x c o u r a n t s, e n m i o . d e f r .
Source: USP
0 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000
Tableaux 14-15, pages A14-A15
Tableaux 14-15, pages A14-A15
Pour ce qui est de la production finale végétale, on table sur une diminution de 10% par rapport aux deux années précédentes, et de 9% par rapport à l’année 2000 Pour toutes les cultures, on s ’attend à des rendements soit comparables, soit moins bons qu ’ en 2000. La libéralisation du marché des céréales a entraîné une forte chute des prix C’est la raison pour laquelle la valeur de la production céréalière de 2001 est estimée à 26% au-dessous de la moyenne triennale Les rendements de la culture maraîchère, décevants en raison des fortes précipitations des mois d’avril et mai, ont pu être compensés par les prix favorables enregistrés au cours des mois d’avril, mai et juin, de sorte que la valeur de la production maraîchère a même connu une légère croissance en comparaison des années précédentes (+3%) La récolte de fruits de 2001 sera inférieure à celle de l’an 2000 Résultat: baisse (13%) de la valeur de production par rapport à la valeur moyenne des trois années antérieures.
Dans le secteur animal, la valeur de la production fléchira de quelque 3% aussi bien par rapport à l’an 2000 qu ’ en comparaison avec les trois années antérieures. Les nouveaux cas d’ESB constatés en Europe ont provoqué à la fin de l’an 2000 une forte baisse des prix pour la viande bovine, et cette tendance s ’est maintenue en 2001 La valeur de la production du secteur bovin (marché laitier non compris) sera probablement inférieure de 9% à la moyenne triennale et inférieure de 18% à la valeur enregistrée en l’an 2000.
La consommation intermédiaire est estimée à 3,95 milliards de francs, ce qui représente une progression de près de 3% par rapport aux années précédentes. Pratiquement tous les postes de la comptabilité ont joué un rôle dans cette progression; les seules dépenses à avoir diminué concernent les semences et les plants, les importations de bétail et les services
Le budget fédéral 2001 fait état d’un accroissement de 10% environ, par rapport à la moyenne triennale 1998/2000, des transferts publics en faveur du secteur agricole Quant aux impôts liés à la production, ils devraient baisser de 52%
Les amortissements, qui sont évalués dans les comptes économiques de l’agriculture aux prix de remplacement, s’inscrivent en hausse de près de 3% par rapport aux années 1998/2000

L’augmentation des dépenses liées aux fermages et aux intérêts a été déclenchée par le relèvement des taux d’intérêts, qui est estimé à quelque 11% par rapport à la moyenne triennale 1998/2000
Cette année, l’effectif des unités de main-d’œuvre non familiale (des saisonniers pour la plupart) diminue, tandis que les coûts salariaux augmentent Comme ces deux grandeurs évoluent en sens contraire, les dépenses pour la rémunération des employés demeurent stables Elles se maintiennent donc au niveau de l’année dernière Mais en comparaison avec la moyenne triennale, les dépenses salariales baissent de près de 3%
Le revenu net issu de l’activité agricole de la main-d’œuvre familiale est estimé à 2,39 milliards de francs pour l’année en cours, soit un fléchissement de 9% en comparaison avec la moyenne des années 1998/2000
54 1 . 1 E C O N O M I E 1
1.1.4 Situation économique des exploitations
L’évaluation de la situation économique des exploitations agricoles est fondée sur les résultats comptables du dépouillement centralisé de la FAT Rappelons que la base méthodologique de ce dépouillement centralisé a été révisée du tout au tout en 1999 Des informations de première importance quant à la situation économique des exploitations sont tirées de diverses grandeurs liées au revenu et d’un certain nombre d’indicateurs de stabilité financière, de productivité et de rentabilité Une présentation détaillée des indicateurs se trouve en annexe Dans les pages qui suivent, nous nous arrêterons plus longuement sur certains de ces indicateurs, puis nous commenterons deux études réalisées par la FAT. L’une examine la répartition des exploitations en quartiles en fonction du revenu du travail et se demande si cette répartition est stable au cours du temps; l’autre établit un rapport entre la taille des exploitations et leur réussite économique.
Comparée aux années précédentes, 2000 a été une année économique favorable Grâce aux bons résultats de la production végétale (bonne année pour les pommes de terre, extension des cultures de maïs-grain, amélioration du rendement des cultures fruitières, bonne récolte de fourrages grossiers) et de la production animale, le rendement brut a fait un bond en avant (+8%) Dans le secteur animal, les pertes subies en ce qui concerne le lait ont pu être compensées par les bons résultats obtenus dans la garde de bovins et de porcins. Les chutes de prix pour la garde de bovins survenues en novembre ont eu assez peu d’impact sur le résultat annuel 2000 Les paiements directs ont augmenté modérément (+2%) par rapport à la moyenne triennale 1997/99, notamment suite au développement des exploitations Les coûts externes ont augmenté de 4% par rapport à la même période La progression est frappante en ce qui concerne les charges matérielles, qu ’elles soient liées à la production végétale (+6%) ou animale (+9%) L’ampleur prise par les charges salariales et les frais de location de machines (progression supérieure à 18%) découle de l’utilisation interentreprises plus fréquente des machines.
55 1 . 1 E C O N O M I E 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E 1 ■■■■■■■■■■■■■■■■
■ 2000, un bon millésime pour l’agriculture
Tableaux 16-25 pages A16-A26 Evolution du revenu des exploitations agricoles: moyenne de toutes les régions 1990/921997 1998 19992000
Définitions et méthodes, page A82 f r p a r e x p l o i t a t i o n Revenu accessoire Revenu agricole Source: dépouillement centralisé, FAT
0
90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000
16 264 18 627 18 254 18 638 62 822 57 974 53 079 53 789
1,39
UTAF Unités de travail annuel de la famille 1,321,311,29
19 208 64 675
1,30
La tendance ascendante observée depuis plusieurs années en ce qui concerne l’amortissement des bâtiments s ’est maintenue à 8% (comme pour les années 1997/99) Le coût de la main-d’œuvre a baissé de 4% par rapport auxdites années, bien qu ’ une timide remontée soit perceptible par rapport à 1999.
On appelle revenu agricole la différence entre le rendement brut et les coûts externes Comparé aux années 1997/99, le revenu agricole a gagné 18% Les exploitations ont aussi pu améliorer leur revenu accessoire (+4% en moyenne) Dans l’ensemble, le revenu total a progressé de 14%
Le revenu agricole a fléchi de quelque 5’600 fr (-9%) entre 1990/92 et 1998/2000 En revanche, le revenu accessoire s ’est étoffé durant la même période (+2'400 fr. env., soit +15%) Le revenu total a ainsi baissé de 3’200 fr (-4%)
L’amélioration du revenu agricole par rapport aux années 1997/99 est un peu plus marquée dans la région de plaine (+19%) que dans celle des collines (+17%) et celle de montagne (+15%), ce qui tient au fait que la production végétale joue un rôle moins déterminant dans les exploitations situées à plus haute altitude
Quant au revenu accessoire, s’il n ’ a pas augmenté en plaine au cours de la période considérée (-0,7%), il a enregistré une petite hausse en montagne (+2%) et une forte hausse dans la région des collines (+13%) C’est donc cette région qui a obtenu la plus forte amélioration de son revenu total (+16%); la progression est moins bonne pour la plaine (+15%) et pour la zone de montagne (+11%)
56 1 . 1 E C O N O M I E 1
Revenu des exploitations agricoles, par région Revenu par région unité 1990/92 1997 1998 1999 2000 1997/99–2000 % Plaine Surface agricole utile ha 16,66 18,91 18,90 19,33 19,41 1,9 Unités de travail annuel de la famille UTAF 1,36 1,30 1,27 1,26 1,26 -1,6 Revenu agricole fr 73 794 69 270 64 885 61 968 77 738 18,9 Revenu accessoire fr 16 429 18 703 17 507 17 580 17 805 -0,7 Revenu total fr 90 223 87 973 82 392 79 548 95 543 14,7 Collines Surface agricole utile ha 15,30 16,92 17,07 17,19 17,83 4,5 Unités de travail annuel de la famille UTAF 1,40 1,30 1,29 1,28 1,29 0,0 Revenu agricole fr 59 838 53 740 47 420 49 885 58 725 16,6 Revenu accessoire fr 14 544 18 973 19 283 19 849 21 814 12,6 Revenu total fr. 74 382 72 713 66 703 69 734 80 539 15,5 Montagne Surface agricole utile ha 15,76 17,28 17,67 18,06 18,63 5,4 Unités de travail annuel de la famille UTAF 1,42 1,39 1,38 1,37 1,39 0,7 Revenu agricole fr 45 541 43 137 38 101 43 392 47 721 14,9 Revenu accessoire fr 17 853 18 139 18 505 19 250 19 011 2,0 Revenu total fr 63 394 61 276 56 606 62 642 66 732 10,9 Source: dépouillement centralisé, FAT
Tableaux 16-19, pages A16-A19
Durant l’année sous revue, la part des paiements directs au rendement brut a représenté 14% dans la région de plaine, 21% dans celle des collines et 36% dans celle de montagne Si ces pourcentages sont tous plus bas que ceux de 1999, c ’est que le rendement brut moyen a été plus élevé en l’an 2000.
On constate entre les onze types d’exploitations (ou branches de production) de grands écarts quant à la situation des revenus
Revenu des exploitations agricoles, par type d’exploitation, pour les années 1998/2000
La moyenne des années 1998/2000 fait apparaître que les revenus agricoles les plus élevés ont été réalisés par les exploitations pratiquant les grandes cultures et les cultures spéciales et par certaines exploitations combinées (grandes cultures et lait, transformation combinée) Ces quatre types d’exploitation ont en outre atteint, de même que les exploitations combinées avec garde de vaches mères, le revenu total le plus élevé. Le revenu agricole le plus modeste a été obtenu par les exploitations appartenant au type «chevaux/moutons/chèvres» (entreprises à faible coefficient de travail) et au type «garde d’autres bovins»
Les types d’exploitation «grandes cultures», «cultures spéciales», «lait commercialisé», «garde d’autres bovins», «exploitations combinées grandes cultures et lait», «autres exploitations combinées» ont réussi, pour les unes, à maintenir, et pour les autres, à augmenter très légèrement leur revenu total par rapport à celui des années 1990/92. Les exploitations du type «garde de vaches mères» et surtout celles du type «combinées: vaches mères» sont parvenues à améliorer leur revenu, tandis que les entreprises de transformation et les entreprises de transformation combinées affichent des baisses (leur revenu était élevé au départ).
57 1 . 1 E C O N O M I E 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E 1
Type d’exploitation Surface Unités de Revenu Revenu Revenu agricole utile travail annuel agricole accessoire total de la famille ha UTAF fr fr fr Moyenne des exploitations 18,42 1,30 57 181 18 700 75 881 Grandes cultures 22,34 1,04 65 853 23 652 89 505 Cultures spéciales 12,80 1,33 72 405 19 334 91 739 Lait commercialisé 17,86 1,35 50 295 17 946 68 241 Garde de vaches mères 17,07 1,11 44 406 32 486 76 892 Garde d’autres bovins 14,89 1,29 34 299 20 915 55 214 Chevaux/ovins/caprins 13,33 1,14 22 784 30 162 52 946 Transformation 11,05 1,12 57 572 16 151 73 723 Exploitations combinées: lait + grandes cultures 23,98 1,35 71 330 13 507 84 837 Exploitations combinées: vaches mères 23,87 1,22 62 804 23 281 86 085 Transformation combinée 18,53 1,31 72 357 16 154 88 511 Autres exploitations combinées 19,58 1,29 58 563 19 814 78 377 Source: dépouillement centralisé, FAT
Tableaux 20a-20b, pages A20-A21
■ Amélioration du revenu du travail
Tableaux 21-24, pages A22-A25
Le revenu du travail obtenu par les exploitations agricoles (revenu agricole moins les intérêts pour le capital propre investi dans l’entreprise) sert à rémunérer le travail de la main-d’œuvre familiale non salariée Comparé à la moyenne triennale 1997/99, le revenu du travail par unité de main-d’œuvre familiale (médiane) a progressé en 2000 de 12,6% La moyenne triennale 1998/2000 a augmenté de 6,7% par rapport à 1990/92
Le revenu du travail par unité de main-d’œuvre familiale varie beaucoup d’une région à l’autre Il est en moyenne nettement plus élevé en plaine qu ’ en montagne De même, le contraste est très marqué d’un quartile à l’autre En plaine par exemple, le revenu par unité de main-d’œuvre familiale va de 27% (1er quartile) à 194% (4e quartile) de la moyenne des exploitations de la région. La dispersion a été semblable dans les autres régions
Revenu du travail des exploitations agricoles pour les années 1998/2000, par région et par quartile
Revenu du travail 1 en fr par UTAF 2
1 Intérêts sur le capital propre au taux moyen des obligations de la Confédération: 1998: 2,81%; 1999: 3,02%; 2000: 3,95%
2 Unités de travail annuel de la famille: base de 280 journées de travail
Source: dépouillement centralisé FAT
En plaine et dans les collines, les exploitations du 4e quartile ont réalisé dans les années 1998/2000 un salaire annuel brut supérieur ou égal à celui du reste de la population Dans la région de montagne, le revenu moyen du travail dans le 4e quartile est d’environ 7’000 francs inférieur à la valeur comparative Par rapport à la période 1997/99, la situation s ’est légèrement améliorée dans les trois régions, et tout particulièrement dans les collines
Salaire comparable pour les années 1998/2000, par région
1 Médiane des salaires bruts annuels de tous les employés actifs dans les secteurs secondaire et tertiaire
Sources: OFS, FAT
58 1 . 1 E C O N O M I E 1
Médiane Moyennes Région 1er quartile 2e quartile 3e quartile 4e quartile (0–25%) (25–50%) (50–75%) (75–100%) Région de plaine 39 955 11 620 32 505 48 391 83 341 Région des collines 30 439 7 607 24 504 36 833 60 296 Région de montagne 22 157 5 156 17 987 26 956 46 094
Région Salaire comparable 1 fr par année Région de plaine 62 866 Région des collines 57 080 Région de montagne 53 163
■ Distribution des exploitations en quartiles:
Lorsque l’évaluation prend en compte le revenu accessoire (qui atteint près de 19’000 fr en moyenne), la situation des ménages agricoles se présente sous un jour bien meilleur que lorsque l’on se borne à comparer le revenu du travail agricole et le salaire comparable.
La FAT s ’est donnée pour tâche de déterminer si la distribution des exploitations entre les quatre quartiles était stable Elle a donc étudié les données relatives à la période allant de 1997 à 1999 en focalisant son attention sur les 1er et 4e quartiles Sa conclusion est que les entreprises qui, une année déterminée, se trouvent dans le premier ou dans le dernier quartile ont 40% de chances de changer de quartile l’année suivante Parmi les exploitations du 1er ou du 4e quartile, moins de la moitié restera plus de trois ans dans le même quartile Ainsi, 58% des exploitations qui étaient dans le 1er quartile en 1997 s ’ y trouvent encore ou de nouveau en 1999 C’est dire que 42% de ces exploitations ont pu grimper dans un quartile supérieur, à savoir le plus souvent dans le 2e, voire (mais c ’est moins courant) dans le 3e ou le 4e quartile
La FAT a aussi analysé, pour la région de plaine, l’évolution du revenu du travail dans les exploitations qui étaient en 1997 soit dans le 1er, soit dans le 4e quartile Celles qui, en 1997, étaient dans le quartile inférieur (courbe qui se trouve tout en haut sur le graphique), ont réalisé en 1998 et en 1999 un revenu du travail qui, en moyenne, dépassait le revenu moyen réalisé au cours de la même période par l’ensemble des exploitations du quartile inférieur. En d’autres termes: les entreprises sous revue ont beaucoup amélioré leur situation Pour celles qui sont restées dans le 1er quartile tout au long des trois ans considérés (courbe du bas, sur le graphique), le revenu du travail s’inscrit par contre un peu en dessous de la moyenne des entreprises
Exploitations de référence dans la région de plaine: Analyse du premier quartile
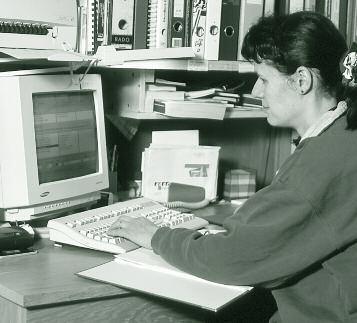
59 1 . 1 E C O N O M I E 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E 1
stabilité
le temps
dans
19971998 1999 R e v e n u d u t r a v a i l p a r u n i t é d e t r a v a i l a n n u e l d e a f a m i l l e, e n f r Dans le 1er quartile en 1997 1er quartile, recalculé chaque année Dans le 1er quartile de 1997 à 1999 Source: dépouillement centralisé, FAT 0 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000
Pour ce qui est du quartile supérieur, la situation est inversée: les exploitations qui sont restées trois ans de suite dans le 4e quartile (courbe supérieure sur le graphique) ont obtenu un revenu du travail plus élevé que les entreprises qui n’étaient dans le 4e quartile que pendant une année Les exploitations de référence qui étaient dans le 4e quartile en 1997 (courbe inférieure sur le graphique) ont déclaré cette année-là un revenu du travail de près de 85'000 francs Au fil des deux années suivantes, le montant était inférieur à 70'000 francs en moyenne, alors que les exploitations qui se trouvaient dans le 4e quartile en 1998 et en 1999 ont réalisé un revenu nettement supérieur (80'000 fr ; courbe centrale) Raison: près de 40% des entreprises qui étaient dans le 4e quartile en 1997 sont passées dans des quartiles inférieurs.

Exploitations de référence dans la région de plaine: Analyse du quatrième quartile 19971998 1999 R e v e n u d u t r a v a i l p a r u n i t é d e t r a v a i l a n n u e l d e l a f a m i l l e, e n f r Dans le 4e quartile de 1997 à 1999 4e quartile, recalculé chaque année Dans le 4e quartile en 1997 Source: dépouillement centralisé, FAT 0 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 60 1 . 1 E C O N O M I E 1
La part de capitaux étrangers dans l’ensemble du capital renseigne sur l’endettement de l’entreprise En combinant cet indicateur avec la constitution de capital propre, on peut établir si l’endettement de l’exploitation n ’est pas trop lourd En effet, lorsqu’une exploitation affiche pendant de nombreuses années à la fois une part élevée de capitaux étrangers et une valeur négative pour la constitution de capital propre, elle n ’est pas viable à long terme
Ces raisonnements ont conduit à répartir les exploitations en quatre groupes selon leur stabilité financière:
Répartition des exploitations en quatre groupes selon leur stabilité financière
Exploitations avec ... Part de capitaux étrangers basse (<50%) élevée (>50%) positive situation financière faible Constitution de saine autonomie financière capital propre négative revenu situation financière insuffisant préoccupante
Source: De Rosa
La stabilité financière des exploitations agricoles est assez semblable dans les trois régions. La moitié à peine des exploitations connaît une situation financière saine, tandis que près d’un tiers est dans une situation préoccupante (entreprises dont la constitution de capital propre est négative) En comparaison avec la période 1997/99, la situation dans les régions de plaine et des collines s ’est légèrement améliorée, tandis qu ’elle est restée stable dans la région de montagne
Appréciation de la stabilité financière en 1998/2000,
■ Légère amélioration de la stabilité financière
selon la région Région de plaineRégion des collines Région de montagne P a r t d e s e x p l o i t a t i o n s, e n % Situation financière difficile Revenu insuffisant Indépendance financière restreinte Bonne situation financière Source: dépouillement centralisé FAT 0 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 13 18 20 49 14 12 27 47 14 16 22 48 61 1 . 1 E C O N O M I E 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E 1
■ Constitution de capital propre, investissements et part de capitaux étrangers
Dans les exploitations de référence de la FAT, les investissements et la part de fonds empruntés (capitaux étrangers) n ’ont guère changé entre 1997/99 et l’an 2000 Ces deux valeurs n ’ont pas davantage changé par rapport à 1990/92 En ce qui concerne la constitution de capital propre (revenu total moins la consommation des familles), on constatera pour 2000 une amélioration notable en comparaison de la période 1997/99 et même de la période 1990/92 Le cash flow parvient en l’an 2000 à couvrir complètement les investissements Pour ce qui est du rapport cash flow / investissements, il est plus favorable en l’an 2000 qu ’ en 1997/99 (+6,6%) et qu ’ en 1990/92 (+7,4%)

Evolution de la constitution de capital propre, des investissements et de la part de capitaux étrangers
1 Investissements bruts (sans les prestations propres), déduction faite des subventions et des désinvestissements
2 Cash flow (constitution de capital propre, plus les amortissements, plus/moins la variation des stocks et de la fortune en bétail) par rapport aux investissements
Source: dépouillement centralisé FAT
1 . 1 E C O N O M I E 1
Variable 1990/92 1997 1998 1999 2000 1997/99–2000 % Constitution de capital propre fr. 19 513 15 833 9 330 13 207 21 233 66,0 Investissements 1 fr 46 914 40 922 49 585 41 856 44 964 1,9 Rapport cash-flow / investissements 2 % 95 105 81 101 102 6,6 Part de capitaux étrangers % 43 42 41 41 41 -0,8
62
Sur la base des résultats comptables de 1999, la FAT a étudié, dans le cadre d’une évaluation ciblée de ces données, le lien existant entre la taille d’une entreprise et sa réussite économique La taille des entreprises a été quantifiée en fonction de la SAU Les entreprises de transformation et celles qui pratiquent les cultures spéciales n ’ont pas été prises en compte, car la SAU est une unité de mesure peu fiable pour ces deux types d’exploitations agricoles Les résultats présentés concernent la région de plaine, mais les commentaires s ’appliquent également aux exploitations implantées dans les deux autres régions Ont été écartées en outre les exploitations de plus de 50 ha, car les entreprises de ce type sont trop peu nombreuses
La présentation des résultats prend en compte les entreprises de 10 à 20 ha qui sont tour à tour considérées comme 100% de l’échantillon. C’est dans cette catégorie que se situent la plupart des entreprises, et les moyennes (structure et indicateurs économiques) correspondent souvent assez exactement à la moyenne suisse
Lorsque l’on compare les entreprises de 30 à 50 ha et celles de 10 à 20 ha, il apparaît que les premières investissent à peu près autant de travail propre (UTAF) que les secondes; dans l’ensemble, les premières fournissent 45% de travail (UTA) de plus que les secondes Par ailleurs, les premières nommées gardent près de 80% d’animaux (exprimés en UGB) de plus que les secondes et exploitent plus du double de SAU
Dans le groupe des exploitations de 30 à 50 ha, le revenu de l’exploitation atteint le double de celui du groupe de 10 à 20 ha. Les grandes exploitations consacrant une part assez importante de leur revenu aux fermages, aux intérêts débiteurs et aux salaires des employés, l’écart avec les exploitations plus petites s ’amenuise d’autant, et les premières comptabilisent un revenu agricole représentant 165% de celui des secondes Même si la productivité de la surface (revenu de l’exploitation/SAU) diminue à mesure que la taille de l’entreprise s ’accroît, la productivité du travail de l’ensemble des personnes travaillant dans l’exploitation (revenu de
1 . 1 E C O N O M I E 1
l’exploitation/UTA) accuse une forte augmentation ■ Taille
exploitations agricoles et réussite économique Structures des exploitations selon la classe de grandeur 19991 <1010 –20 Classes de grandeur en ha 20 –30 30 –50 231 177 145 106 e n % SAU (10 –20 = 100%) UGB (10 –20 = 100%) Source: dépouillement centralisé, FAT 1 Evalua
UTA (10 –20 = 100%) UTAF (10 –20 = 100%) 0 250 200 150 100 50 63
des
tion pour la région de plaine
L’amélioration de la productivité du travail se traduit en fin de compte par un relèvement du revenu du travail de la main-d’œuvre familiale (revenu du travail/UTAF) Si la rémunération par unité de main-d’œuvre familiale est chiffrée à 54'000 francs, le revenu du travail par unité de comparaison dépasse de 60% celui du groupe.
L’analyse présentée ci-dessus montre l’incidence de la taille de l’entreprise sur sa réussite économique Mais il convient de préciser que cette étude est une sorte d’instantané et que les conclusions qu ’ on en a tirées se fondent sur des moyennes Il va sans dire qu’il existe aussi des exploitations agricoles plus petites qui, ayant su conjuguer des conditions propices, des structures appropriées et une gestion d’entreprise sans faille, réalisent des performances éblouissantes. Autrement dit, la présente analyse ne permet pas de conclure que la seule stratégie indiquée pour une entreprise d’assez petite taille est la croissance
64 1 . 1 E C O N O M I E 1
<1010 –20 Classes de grandeur en ha 20 –30 30 –50 200 165 160 138 86 e n % RE (10 –20 = 100%) RA (10 –20 = 100%) RT/UTAF (10 –20 = 100%) Source: dépouillement centralisé, FAT 1
RE/UTA (10 –20 = 100%) RE/SAU (10 –20 = 100%) 40 220 200 180 160 140 120 100 80 60
Chiffres clés économiques selon la classe de grandeur1
E
valuation pour la région de plaine
1.2 Aspects sociaux
Le Rapport agricole 2000 indiquait que l’observation de la situation sociale dans l’agriculture en était à ses balbutiements Il n ’ a donc pas présenté un concept d’information arrêté à ce sujet
Entre-temps, le travail s ’est poursuivi: le Rapport agricole 2001 expose un concept de base d’information sur le social dans l’agriculture Le travail n ’ en est pas pour autant terminé Dans une prochaine étape, il y a lieu de développer des indicateurs concrets pour certains domaines
Outre ce concept d’information, le Rapport agricole 2001 donne un aperçu des domaines suivants: revenu et consommation dans le secteur agricole, sur la base du dépouillement centralisé des données comptables effectué par la FAT; résultats de l’enquête menée par l'institut de recherche SRS sur la perception subjective de la situation par la population agricole par rapport aux autres groupes sociaux; projets concernant l’aide aux enfants et aux jeunes, réalisés dans la commune d’Eggiwil dans l’Emmental

■■■■■■■■■■■■■■■■
1 . 2 A S P E C T S S O C I A U X 1 65
■ Revenu et consommation
1.2.1 Concept d’information sur le social dans l’agriculture
Il n ’est pas facile de décrire et de délimiter le social tant sont floues les frontières entre l’économie, qui se réfère à l’exploitation, et le social, focalisé sur l’être humain, son environnement et le ménage agricole Ainsi, le revenu est principalement une valeur économique, mais il n ’est pas sans importance pour l’appréciation de la situation sociale La partie «Aspects sociaux» soulève donc aussi, sous un autre angle, la question du revenu
L’information sur le social dans l’agriculture porte en tout sur les trois domaines suivants:

Revenu et consommation: Premièrement, on appréciera tous les ans la situation sociale de l’agriculture en fonction des paramètres économiques «revenu» et «consommation», d’après le dépouillement centralisé des données comptables de la FAT
Relevés portant sur la situation sociale: Deuxièmement, on procédera tous les cinq ans, par sondage, à des relevés portant sur cinq thématiques centrales pour la description de la situation sociale Une seule thématique sera présentée dans les rapports annuels Le choix s ’est porté sur la périodicité de cinq ans, car les changements et les développements ne seraient guère perceptibles à plus court terme; en outre, des enquêtes déjà institutionnalisées sont également effectuées à ce rythme
Etudes de cas: Troisièmement, on présentera chaque année des études de cas approfondissant un thème ou projet déterminé dans le domaine social
Le revenu et la consommation sont des indicateurs importants pour l’appréciation de la situation sociale de l’agriculture. Puisque cette appréciation a trait au ménage d’agriculteurs et pas à l’exploitation, il s ’agit de tenir compte du revenu accessoire en plus de celui qui est tiré de l’agriculture Dans ce domaine, il est notamment prévu de confronter la situation du revenu (revenu total, revenu du travail) de l’ensemble du secteur agricole dans les régions de plaine, des collines et de montagne avec le salaire de référence (revenu du travail) des autres secteurs économiques On accordera une attention particulière à l’évolution du revenu et de la consommation dans la moitié inférieure des exploitations classées selon le revenu du travail
1 . 2 A S P E C T S S O C I A U X 1 66 ■■■■■■■■■■■■■■■■
■ Relevés portant sur la situation sociale
Les relevés périodiques se baseront pour la plupart sur des enquêtes déjà institutionnalisées Des indicateurs adéquats pour la présentation de la situation sociale dans le Rapport agricole sont en cours d’élaboration Ces études représentatives, réalisées en partie sous forme d’enquêtes, permettent une comparaison avec le reste de la population (groupe de contrôle) Les études porteront sur les cinq domaines suivants couvrant les aspects essentiels du social:
– Qualité de la vie: Ce relevé repose sur un concept de l’EPF Zurich, développé dans le cadre d’une étude de fond pour l’information future sur la situation sociale de l’agriculture suisse Les enquêtes seront menées par un institut de sondages d'opinion sur mandat de l’OFAG Le concept de qualité de la vie permet de montrer la satisfaction des personnes interrogées dans les sphères importantes de la vie telles que le niveau de vie et la famille
Travail et formation: L’enquête suisse sur la population active (ESPA), effectuée par l’Office fédéral de la statistique (OFS), met en évidence la situation des personnes actives, des chômeurs et des personnes sans activité professionnelle, selon des critères socio-économiques Elle fournit notamment des données sur les conditions de travail et le taux d’occupation ainsi que sur la première formation, le niveau de formation, la situation familiale, l’éducation des enfants, la situation du logement ou encore, sur le revenu
–

Santé: L’enquête suisse sur la santé (ESS) de l’OFS fournit notamment des informations sur l’état de santé et les facteurs qui le déterminent, les conséquences des maladies ou le recours aux services de la santé Ces enquêtes sont des outils se prêtant à étudier l’état de santé dans le contexte global de la vie
– Revenu et consommation: L’enquête sur les revenus et la consommation (ERC) de l’OFS rend compte en détail des recettes des ménages privés et analyse la consommation en fonction de différents paramètres sociaux et démographiques
– Recours aux prestations sociales: L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) fournit des indications sur le montant de la rente AVS ou AI, la part des bénéficiaires, etc Ces données permettent de comparer les recours aux assurances sociales dans la population paysanne et dans les autres groupes sociaux
1 . 2 A S P E C T S S O C I A U X 1 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E 67
–
■
Etudes de cas
Les études de cas porteront chaque année sur un aspect du social ou sur un projet novateur à caractère social Ces prochaines années, on devrait approfondir les thèmes suivants:
– Le Groupe de travail de la FAO sur la femme et la famille dans le développement rural devant se réunir en 2002 en Suisse, une étude de cas approfondira le rôle des femmes dans l’agriculture Quelle est leur situation? Quelles sont leurs tâches?
En outre, on peut envisager les thèmes suivants:
Pauvreté et agriculture: La pauvreté n ’est pas nouvelle dans les familles paysannes Elle est souvent dissimulée, des familles paysannes vivant dans des conditions très modestes et rongeant le capital de l’exploitation Pour l’instant, les paysans ne bénéficient guère de l’aide sociale: un élément principal de l’identité paysanne est la volonté d’autonomie et d’indépendance Comment perçoit-on la pauvreté? Comment s ' en accommode-t-on?
– Situation des employés agricoles: D’après une étude réalisée en 1999 par le syndicat SIB, les saisonniers employés dans l’agriculture doivent travailler durement, souvent contre un maigre salaire Qu’est-ce qui a été fait entre-temps?
Vieillesse et prévoyance vieillesse: Où et comment les paysans âgés vivent-ils leur vieillesse? Mais aussi: les agriculteurs sont-ils convenablement assurés?
Evolution structurelle: Dans quelle mesure les structures des exploitations ontelles changé? Quand l’évolution structurelle est-elle acceptable sur le plan social? Quel est l’impact de l’évolution structurelle sur l’occupation décentralisée du territoire? Quelles structures permettent d’assurer l’accomplissement des tâches à l’avenir?
1 . 2 A S P E C T S S O C I A U X 1 68
–
–
–
■ Prise en considération du revenu total dans l’appréciation de la situation sociale
Revenu et consommation

Le revenu et la consommation sont des indicateurs importants pour l’appréciation de la situation sociale de l’agriculture Quant à la dimension économique de la durabilité, le revenu est avant tout intéressant en ce qui concerne la performance des exploitations Selon l'art 5 LAgr, celles qui remplissent les critères de performance économique doivent être en mesure de réaliser un revenu comparable à celui de la population active dans les autres secteurs économiques de la même région En ce qui concerne la dimension sociale de la durabilité, il s ’agit avant tout de la situation du revenu sur le plan sectoriel On accorde à cet égard une attention particulière à l’évolution du revenu des exploitations se trouvant dans la moitié inférieure pour ce qui est de leur revenu du travail En outre, les observations ne se limitent pas au revenu tiré de l’activité agricole Le revenu accessoire des ménages est aussi pris en considération, de même que la consommation de la famille.
La confrontation des résultats comptables fournis par le dépouillement centralisé de la FAT avec les salaires de référence et la consommation privée des autres groupes sociaux ne permet de formuler que des conclusions limitées sur la situation réelle en matière de revenu et de consommation de la population agricole par rapport aux autres groupes sociaux: les résultats comptables permettent notamment de suivre l’évolution des différentes composantes du revenu et de la consommation des exploitations agricoles. L’enquête sur les revenus et la consommation de l’OFS donne des informations supplémentaires concernant le reste de la population et de meilleures données comparatives, qui seront présentées en détail dans le Rapport agricole, probablement en 2004, dans le cadre des cinq thématiques faisant l’objet des relevés périodiques
Le revenu du travail – médiane – par unité de main-d’œuvre familiale dans l’agriculture a atteint, en moyenne des années 1998/2000, 64% du salaire de référence dans la région de plaine, 53% dans celle des collines et 42% dans celle de montagne; l’écart par rapport à ce salaire est donc manifeste dans toutes les régions Il en était déjà de même en moyenne des années 1990/92, avec des chiffres respectifs de 63, 57 et 37% L’écart ne s ’est creusé que dans la région des collines On constate en général que dans les années nonante, le revenu du travail a évolué de la même façon que les salaires des autres groupes de la population
Revenu total, revenu du travail et consommation privée de la famille de 1998 à 2000
Région Revenu Consomma- Unités de Revenu du Salaire de total tion privée main-d’œuvre travail référence familiale (médiane) (médiane)
1 . 2 A S P E C T S S O C I A U X 1 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E 69 ■■■■■■■■■■■■■■■■ 1.2.2
fr fr UTAF 1 fr par UTAF 1 fr par UTAF 1 Plaine 85 828 69 004 1 26 39 955 62 866 Collines 72 325 57 873 1 29 30 439 57 080 Montagne 61 994 51 207 1 38 22 157 53 163 1 Unités de travail annuel de la famille Source: dépouillement centralisé, FAT
Le revenu du travail, rémunérant le travail agricole, est toutefois insuffisant pour apprécier la situation des ménages agricoles en matière de revenu: d’une part, il est tributaire du taux d’intérêt et, de l’autre, il ne permet pas de prendre en considération toutes les recettes d’un ménage agricole. Puisque l’appréciation de la situation sociale a trait au ménage d’agriculteurs et pas à l’exploitation, il convient de tenir compte du revenu total pour cette estimation
En moyenne des années 1998/2000, les exploitations agricoles ont tiré un montant d’environ 19'000 francs d’un revenu accessoire, qui revêt donc de l’importance comme source de revenu supplémentaire Ce revenu est nettement supérieur dans les exploitations du premier quartile (revenu du travail le moins élevé: 27’000 fr ) que dans celles des autres. Dans ceux-ci, le revenu accessoire n ’ a en moyenne pas tout à fait atteint 16'000 francs La différence concernant le revenu total entre le premier et le quatrième quartile est donc nettement moins marquée que l’écart de revenu du travail
En comparaison des années 1990/92, le revenu total par unité de consommation a baissé dans toutes les exploitations, le plus fortement dans celles du premier quartile, où il a passé d’environ 16'000 à tout juste 14'000 francs En revanche, la consommation privée en 1998/2000 n ’ a été inférieure à celle de 1990/92 que dans le premier quartile.
Evolution du revenu total et de la consommation privée
1 unité de consommation = membre de la famille âgé de 16 ans ou plus, participant toute l’année à la consommation de la famille
Source: dépouillement centralisé, FAT
En 1998/2000, le revenu total n ’ a pas suffi à couvrir la consommation des familles dont l’exploitation appartient au premier quartile Elles ont dû entamer leur capital et/ou avoir recours à ce que l’on appelle la compensation privée. Leur capacité de financer les investissements de remplacement ou les nouveaux investissements, ou encore la prévoyance-vieillesse, s ’ en trouve limitée Le revenu total de ces exploitations dépassait encore légèrement la consommation privée dans les années 1990/92. En revanche, les dépenses privées étaient inférieures au revenu total dans les exploitations des autres quartiles Alors qu ’ en 1990/92, les exploitations du premier quartile atteignaient encore 48% du revenu total par unité de consommation enregistré dans celles du quatrième quartile, ce chiffre a baissé à 43% en 1998/2000

1990/1992 1998/2000 fr fr 1er quartile Revenu total par UC 1 15 974 13 952 Consommation privée par UC 15 894 14 897 2e quartile Revenu total par UC 19 013 18 092 Consommation privée par UC 15 479 16 001 3e quartile Revenu total par UC 23 063 22 855 Consommation privée par UC 16 947 18 075 4e quartile Revenu total par UC 33 328 32 694 Consommation privée par UC 20 442 21 731
1 . 2 A S P E C T S S O C I A U X 1 70
La différence entre ces deux quartiles est nettement plus faible en ce qui concerne la consommation privée que pour ce qui est du revenu total En 1998/2000, la consommation privée n ’ a représenté, pour les exploitations du premier quartile, que 70% de celle des exploitations du quatrième. Cette proportion était encore de 78% dans les années 1990/92 La consommation privée des exploitations du premier quartile a diminué, en 1998/ 2000, de 1’000 francs en comparaison des années 1990/92, pour passer à 15'000 francs par unité de consommation Pendant la même période, les dépenses par unité ont au contraire augmenté d’entre 500 et 1'300 francs dans les autres quartiles
En résumé, on constate que la situation des exploitations du premier quartile, qui réalisent les revenus du travail les plus bas, s ’est détériorée entre 1990/92 et 1998/2000, tandis que celle des autres est restée assez stable

1 . 2 A S P E C T S S O C I A U X 1 71
■ L’EPF Zurich élabore un concept de qualité de la vie
1.2.3 Enquête sur la qualité de la vie
Le domaine de qualité de la vie est l’une des thématiques principales faisant l’objet d’une enquête, effectuée tous les cinq ans au moyen de sondages représentatifs
L’OFAG avait chargé en 1999 l’Institut d'économie rurale (IER) de l’EPF Zurich de développer les bases pour l’information sur la situation sociale de l’agriculture suisse
Le travail de l’EPF portait en premier lieu sur le concept de qualité de la vie, combinant conditions d’existence objectives et bien-être subjectif: la qualité de la vie est bonne si, en fonction de son système d’objectifs, une personne donne une appréciation subjective favorable de ses conditions d’existence objectives Dans le cadre de l’étude réalisée par l’EPF, on a évalué les résultats d’une enquête menée au printemps 2000 auprès de quelque 500 agriculteurs du canton de Berne, abstraction faite des autres groupes de la population Certains de ces résultats ont été présentés dans le Rapport agricole 2000
■ Enquête menée par l'Institut de recherche SRS au printemps 2001
L'OFAG a chargé la Société suisse de recherches sociales (SRS) de mener une enquête portant sur le bien-être subjectif de la population agricole en comparaison avec les autres groupes sociaux A cet effet, la SRS a repris largement le concept de l’EPF, pour réaliser l’enquête précitée de la mi-février à la mi-mars 2001. Elle a posé des questions sur la satisfaction des interlocuteurs dans diverses sphères de la vie, sur les avantages et inconvénients de la profession d’agriculteur ainsi que sur leurs peurs
L’objectif a consisté à comparer la situation, ou la qualité de la vie, des paysannes et paysans avec celle du reste de la population (groupe de référence) vivant soit dans des agglomérations, soit dans des communes rurales En ce qui concerne la population agricole, un échantillon représentatif a été tiré de la liste des exploitations ayant droit aux paiements directs. Quant aux groupes de référence, on a également établi, à partir d’un échantillon tiré de façon aléatoire de l’annuaire téléphonique électronique, des quotas représentatifs en fonction de la région, du sexe, de l’activité professionnelle et de la classe d’âge
Ce sondage a eu lieu à une période où tant la population agricole que les consommateurs étaient captivés par des sujets d’actualité tels que l’ESB et la fièvre aphteuse Cette situation a peut-être influé sur les résultats
Ceux-ci mettent en évidence la complexité du bien-être subjectif de la population agricole en comparaison aux autres groupes sociaux Les domaines principaux sont la satisfaction, les avantages et les inconvénients du métier d’agriculteur ainsi que les craintes
1 . 2 A S P E C T S S O C I A U X 1 72 ■■■■■■■■■■■■■■■■
■ Degré de satisfaction comparable
La question concernant le degré de satisfaction dans diverses sphères de la vie a révélé que la part d’agriculteurs satisfaits de leur niveau de vie est aussi grande que celle des autres groupes sociaux (90%) Dans certains domaines, la population agricole se montre légèrement plus satisfaite: travail professionnel, formation initiale et perfectionnement, santé et famille Par contre, les agriculteurs sont nettement moins satisfaits pour ce qui est de la stabilité des conditions-cadre (30 / 57%), le revenu (42 / 68%) et les loisirs (61 / 79%)
Satisfaction dans différentes sphères de la vie
Activité professionnelle, agriculteurs Référence
Formation, agriculteurs Référence
Perfectionnement, agriculteurs Référence
Revenu, agriculteurs Référence
Niveau de vie général, agriculteurs Référence
Famille, agriculteurs Référence
Contexte social, agriculteurs Référence
Stabilité des conditions-cadre, agri. Référence
Loisirs, agriculteurs Référence

Santé, agriculteurs Référence
Assez de temps, agriculteurs Référence
Offre culturelle, agriculteurs Référence
très satisfait indéterminé
très insatisfait
satisfait insatisfait ne sait pas/pas de réponse
Source: Société suisse de recherches sociales
1 . 2 A S P E C T S S O C I A U X 1 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E 73
en %
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Possibilité de faire des économies dans les trois années à venir
Les agriculteurs sont aussi sensiblement moins satisfaits que les autres groupes sociaux quant à la possibilité de faire des économies dans les trois prochaines années Environ un tiers d’entre eux croit pouvoir épargner plutôt moins, alors que seuls 12% des personnes de référence sont de cet avis.
Evolution de la situation financière dans les 12 prochains mois
En ce qui concerne l’évolution future de la situation financière des ménages, les agriculteurs ont une appréciation nettement moins favorable que les autres groupes sociaux Un quart à peu près des agriculteurs interrogés s ’attendent à ce que leur situation se détériore dans les douze prochains mois A peine un dixième de la population paysanne croit à une amélioration durant cette période, contre près d’un quart des personnes de référence
plutôt moins à peu près autant plutôt davantage ne sait pas / pas de réponse en % Source: Société suisse de recherches sociales 0 10 32 12 38 56 9 18 21 14 20 30 40 50 60 Agriculteurs Référence
amélioration statu quo détérioration ne sait pas / pas de réponse en % Source: Société suisse de recherches sociales 0 10 9 23 48 61 26 9 17 7 20 30 40 50 60 70 Agriculteurs Référence 1 . 2 A S P E C T S S O C I A U X 1 74
■ Appréciation de la profession d’agriculteur
A ce propos, les représentants de la population agricole et des autres groupes sociaux ont été sondés sur les avantages et inconvénients de la profession d’agriculteur Les questions étaient non directives, les personnes interrogées ne s’étant pas vu soumettre un modèle de réponse. Les réponses montrent que les appréciations des avantages données de l’intérieur et de l’extérieur ne sont pas les mêmes

Appréciation des avantages du métier d'agriculteur
Indépendance, liberté dans la gestion du temps
Proximité de la nature
Travail et contact avec les animaux
Etre avec la famille, les enfants
Exploitation familiale
Contenu ou mode de travail: autres arguments
Produits de l'exploitation, auto-approvisionnement
Ainsi, les paysans eux-mêmes considèrent l’indépendance et la possibilité de gérer librement leur temps (63%) et le lien avec la nature (60%) comme des avantages Les personnes de référence ont le plus souvent choisi comme avantage l’indépendance (42%), mais elles n ’ont jamais mentionné le lien avec la nature.
en % Source: Société suisse de recherches sociales 0 10 63 42 60 0 18 16 12 7 11 4 5 12 6 11 20 30 40 50 60 70 Agriculteurs Référence 1 . 2 A S P E C T S S O C I A U X 1 75
■ Moins de craintes dans l’agriculture
Appréciation des inconvénients du métier d'agriculteur Longue
Aux yeux des agriculteurs, les principaux inconvénients sont la longue durée du travail, la pléthore de prescriptions, les revenus modestes et l’effondrement des prix. Les représentants des autres groupes sociaux citent la longue durée du travail ainsi que les vacances et loisirs réduits Il est intéressant de constater que les agriculteurs jugent plus sévèrement la longue durée de présence que la pléthore normative et les revenus modestes
Les réponses concernant les peurs ont, dans l’ensemble, révélé que les agriculteurs se sentent moins menacés que le reste de la population (4,0 points contre 4,2).
1 . 2 A S P E C T S S O C I A U X 1 76
travail
bénéfice ou revenu Effondrement des prix, pression du marché Peu de loisirs ou de vacances Contenu ou mode de travail: autres arguments Divers autres en % Source: Société suisse de recherches sociales 0 5 36 28 25 10 21 21 20 7 18 28 7 14 6 7 10 15 20 25 35 30 40 Agriculteurs Référence
durée de
ou de présence Pléthore normative, conditions-cadre changeantes Faible
Indicateurs des craintes
Echelle: 1 = pas de danger / 10 = grand danger
Pollution de l’air et des eaux, changements climatiques
Risques liés au génie génétique
Interdépendance économique mondiale croissante (fusions)
Maladies incurables (p. ex cancer, SIDA) Surnombre d’étrangers et de réfugiés
Inflation, hausses de prix
Egoïsme humain
Contamination nucléaire
Trop peu d’argent pour vivre
Changements politiques, mouvements radicaux
Pénurie d'énergie
Accidents graves, invalidité
Evolution technique et bouleversements dans tous les domaines Difficultés économiques dans la vieillesse
Relâchement général des mœurs dû à la dégradation constante de la morale
Sentiment de n’être plus qu’un rouage insignifiant
Construction des routes et des îlots urbains, déstructuration du paysage
Guerre
Déclin du rôle de la religion
Criminalité/agressions
Sentiment de ne plus se sentir chez soi en Suisse
Peur de perdre l'emploi ou de ne pas trouver un emploi
Problèmes personnels (conflit des générations)
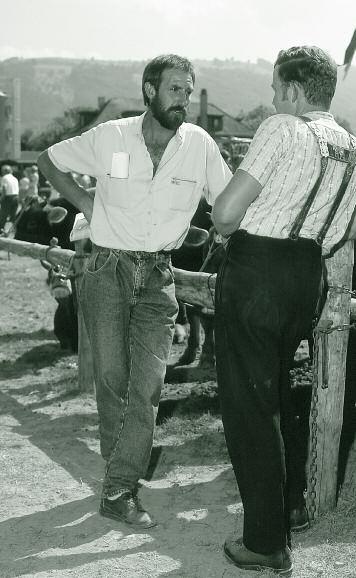
Problèmes personnels (enfants)
Peur d'être seul/de ne pas avoir d'amis
Problèmes personnels (couple)
Peur de perdre le logement
1 . 2 A S P E C T S S O C I A U X 1 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E 77
: Société suisse de recherches
01,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 5,7 6,1 5,6 5,4 5,3 5,4 5,0 6,0 4,9 4,9 4,8 4,6 4,7 4,7 4,7 5,0 5,6 5,3 4,5 4,4 4,4 5,0 4,6 4,4 4,2 4,4 4,5 4,2 4,0 4,0 3,9 3,6 3,6 3,6 3,6 3,5 3,4 3,3 2,7 2,6 2,6 2,5 2,5 2,2 1,9 1,9 2,5 2,6 2,7 3,4 2,7 3,1 3,5 4,1 7,0
Source
sociales
Agriculteurs Référence
La population paysanne a moins peur de la criminalité et de la guerre. Elle se sent aussi nettement moins menacée en ce qui concerne l’intégrité physique (peur de maladies incurables ou de graves accidents) Quant aux craintes touchant au domaine socioéconomique, celle de ne pas avoir assez d’argent pour vivre est plus forte dans la population agricole que dans les autres groupes sociaux Cependant, les agriculteurs ont moins peur de perdre leur emploi La crainte de difficultés économiques dans la vieillesse est la même dans les deux groupes En dépit des différences, les agriculteurs et le reste de la population ont la même appréciation du danger principal: les personnes interrogées le situent dans le domaine écologique, témoignant de leur peur du changement climatique et de la pollution de l’air et de l’eau
La population paysanne est légèrement plus satisfaite que les autres groupes pour ce qui est des différentes sphères de la vie (famille, santé, formation et perfectionnement ainsi qu ’activité professionnelle). Par contre, les agriculteurs sont nettement moins satisfaits en ce qui concerne le revenu, la stabilité des conditions-cadre et les loisirs Ils sont plus pessimistes quant à l’évolution future du revenu Dans l’ensemble, les différences entre les deux groupes ne sont pas très marquées Ceux-ci donnent par exemple la même appréciation du niveau de vie général

Pour ce qui est du métier d’agriculteur, les paysans considèrent l’indépendance et le lien avec la nature comme des avantages Les personnes de référence citent aussi le plus souvent l’indépendance. La longue durée du travail est le principal inconvénient aux yeux des agriculteurs; les groupes de référence nomment aussi le plus souvent cet aspect-là, ainsi que les loisirs réduits
En ce qui concerne les craintes, la population paysanne se sent quelque peu moins menacée que les autres. Dans le domaine des indicateurs concernant le marché du travail, la peur du chômage est notamment bien moindre parmi les paysans En dépit des différences, les agriculteurs et le reste de la population ont la même appréciation du danger principal: peur des conséquences du changement climatique et de la pollution de l’air et de l’eau
1 . 2 A S P E C T S S O C I A U X 1 78
■ Différences dans la satisfaction
■ Rôle pionnier d’Eggiwil
1.2.4 Aide aux enfants et aux jeunes à Eggiwil
La commune emmentaloise d’Eggiwil joue un rôle pionnier dans le domaine du développement durable Son engagement pour l’aide aux enfants et aux jeunes est exemplaire, ainsi que l’encouragement de la coopération entre ville et campagne et du développement de la région comme espace réservé à la récréation, comme fournisseur d’énergie, de bois et d’eau potable propre Le «Colloque d’Eggiwil», destiné à tracer la voie permettant la réalisation de ces visions à l’avenir, a été organisé déjà pour la quatrième fois en 2001 En outre, l’«Institut Eggiwilois du développement systémique communal et régional» a été fondé afin de promouvoir le développement durable en matière de formation, de recherche et de développement, dans le cadre de l’Agenda 21 local de Rio
Portrait de la commune d’Eggiwil
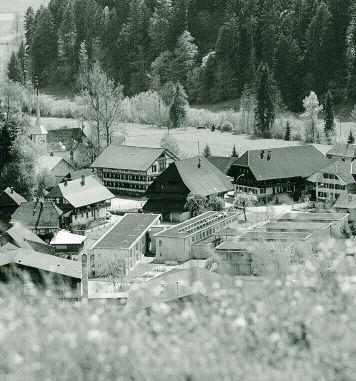
Personnes
Personnes actives dans le secteur secondaire 24%
Personnes actives dans le secteur tertiaire 16%
Ecoles 9, dont 3 supérieures
Elèves 410
Depuis 1990, l’«Atelier pour le développement systémique communal et régional, développement de projets et d’organisations» (ASPOS à Regensdorf) travaille dans les domaines du social et de la santé. En juin 1996, ASPOS a cherché une commune partenaire par voie d’annonces Il a pu conclure un contrat de coopération avec le Conseil communal d’Eggiwil en décembre 1996 De 1996 à 1998, ASPOS a développé, en collaboration avec Eggiwil, un projet destiné à tester des formes novatrices en vue du développement communal et régional durable au sens de l’Agenda 21 local et à tracer de nouvelles voies pour le partenariat entre ville et campagne
1 . 2 A S P E C T S S O C I A U X 1 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E 79 ■■■■■■■■■■■■■■■■
Emplacement District de Signau/région Oberes Emmental Habitants 2'614 Surface 60 km2 SAU 33,4 km2 Exploitations agricoles 240
actives dans le secteur primaire 60%
■ Projet «intégration»
Cette collaboration a donné naissance au projet «intégration», dont le promoteur est une association d’utilité publique à Eggiwil Il s ’agit là d’un réseau d’aide à la jeunesse offrant aux enfants et aux jeunes en danger psycho-social des agglomérations de Zurich, Bâle, Berne, Lucerne et Schaffhouse des espaces de vie et de développement proches de la nature avec un soutien de thérapie systémique et sociopédagogique
Dans le cadre de ce projet, les enfants et jeunes en danger trouvent depuis 1998 un nouveau chez-soi dans des familles paysannes d’Eggiwil Les raisons d’un placement vont de la surcharge des parents aux mauvais traitements infligés aux enfants Les enfants devraient reprendre pied auprès d’une famille emmentaloise qualifiée, dans un environnement naturel Les familles partenaires sont choisies avec soin Elles doivent à cet effet répondre aux critères de l’Organisation mondiale de la santé (OMS): famille saine avec enfants en âge préscolaire ou scolaire, espace habitable suffisant, animaux de compagnie et/ou de rente gardés conformément aux besoins de l’espèce, ressources économiques suffisantes pour vivre. Des supervisions et entretiens réguliers sont au programme En cas de problème, les responsables de projet d’ASPOS sont disponibles en tout temps En outre, les enfants sont suivis par un médecin et un psychiatre Les enfants et jeunes vont en règle générale à l’école dans un des établissements publics de la commune d’Eggiwil Des objectifs didactiques individuels sont convenus avec les enseignants et contrôlés périodiquement. ASPOS et d’autres professionnels accompagnent et soutiennent la collaboration entre l’école et la famille partenaire
Du point de vue économique, l’accueil d’un «enfant d’intégration» représente un revenu équivalant à un emploi à mi-temps pour la famille paysanne Seules les familles dont l’exploitation n ’est pas menacée dans son existence sont habilitées à héberger un enfant; la dépendance économique serait autrement trop grande Douze familles paysannes au plus peuvent participer à l’«intégration». Le Conseil communal a fixé cette limite considérant que les structures disponibles ne pouvaient pas supporter davantage Les jeunes placés en permanence chez une famille partenaire à Eggiwil se voient ensuite offrir un stage ou un apprentissage approprié. L’Emmental possède une riche palette d’entreprises dans les secteurs de l’industrie, de l’artisanat et des services
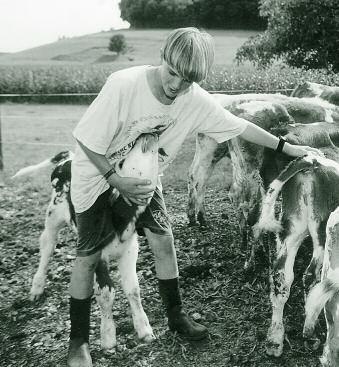
1 . 2 A S P E C T S S O C I A U X 1 80
■
Le projet «thérapie de milieu» complète depuis février 2000 l’offre dans le domaine de l’aide aux enfants et aux jeunes Il est réalisé en collaboration avec le «Juvenat» des Franciscains de Flüeli-Ranft, ancien internat transformé en établissement scolaire et thérapeutique systémique avec l’aide d’ASPOS. Flüeli-Ranft et Eggiwil entretenaient des relations dès avant le lancement de ce projet: les jeunes du «Juvenat» peuvent passer les week-ends et les vacances chez les familles partenaires de l’association «intégration» à Eggiwil
Le nouveau projet a pour objectif de permettre aux jeunes encore inaptes à s’intégrer dans un groupe de se stabiliser et de se socialiser dans un cadre à l’échelle humaine Outre les familles partenaires, une école d’enseignement par petits groupes joue à cet égard un rôle capital. Elle n ’est pas liée aux écoles publiques. Quatre enseignants donnent des cours individuels ou en petits groupes Hormis l’accueil chez une famille partenaire pendant les week-ends et les vacances, l’accueil permanent auprès d’une famille est indispensable, dans le cadre du projet, aux jeunes du «Juvenat» souffrant de graves problèmes de comportement Le «Juvenat» offre des journées de formation supplémentaires aux familles partenaires qui prennent en charge ses pupilles Le groupe «Familles partenaires du Juvenat» s ’est agrandi pour atteindre sept membres en 2000; quatre jeunes sont placés en permanence
Comparé aux offres traditionnelles équivalentes d’aide stationnaire aux jeunes, le projet «intégration» est nettement moins onéreux. En moyenne, les coûts totaux sont de 30% inférieurs pour les mêmes prestations de qualité égale Ils sont couverts par les instances d’assignation
La «thérapie de milieu» est aussi financée par ces instances, ainsi que via la «fondation Juvenat». Celle-ci, reconnue par le canton d’Obwald comme réseau d’aide aux jeunes, bénéficie d’un soutien dans le cadre de la Convention intercantonale relative aux institutions
La «thérapie de milieu» venant s ’ajouter au projet «intégration», tout comme le besoin croissant en places d’accueil pour les week-ends et vacances auprès de familles, ont conduit encore une fois à la création de nouveaux postes:

1 . 2 A S P E C T S S O C I A U X 1 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E 81
Nombre de personnes employées à fin 2000 Collaborateurs sociopédagogiques (familles paysannes) 16 Thérapeutes systémiques 2 Pédagogues sociaux, assistants sociaux 2 Secrétaire 1 Enseignants 4
Projet «thérapie de milieu»
■
■ Financement des projets
Bilan positif
La commune d’Eggiwil considère les projets «intégration» et «thérapie de milieu» comme une tâche collective d’importance En effet, le but consiste non seulement à aider les enfants et les jeunes en danger, mais aussi à déclencher un processus de développement, tout en permettant de sauvegarder et de renouveler une partie de l’infrastructure dans une région mise au défi par l’évolution structurelle économique et menacée de dépeuplement De plus, de nouveaux emplois sont créés dans la commune qui subit le changement des structures agricoles Effort et engagement s’imposent toutefois à toutes les parties prenantes Toujours est-il que le bilan des premières années est positif et encourageant pour les enfants et les jeunes, pour la commune d’Eggiwil et pour les familles paysannes

1 . 2 A S P E C T S S O C I A U X 1 82
L’agriculture est étroitement liée à l’environnement par des rapports à la fois multiples et complexes Utilisant une grande partie des terres, elle joue un rôle capital dans l’écosystème de l’espace rural Ses tâches ne consistent donc pas seulement à produire des denrées alimentaires, mais aussi à utiliser de manière durable les ressources naturelles et à entretenir le paysage rural
A son tour, l’agriculture subit de multiples influences Le marché, les exigences imposées pour l’obtention de paiements directs, les dispositions légales, de même que le comportement des consommateurs influent sur la manière dont les agriculteurs exploitent les ressources naturelles Le présent chapitre documente les incidences écologiques de la politique agricole Celles-ci sont saisies à l’aide d’indicateurs agroenvironnementaux. Des mesures et domaines posant des problèmes sont par ailleurs examinés et soumis à une analyse ciblée

■■■■■■■■■■■■■■■■
1.3 Ecologie
1 . 3 E C O L O G I E 1 83
1.3.1 Indicateurs agro-environnementaux
Dans le premier rapport agricole, nous avons décrit les indicateurs agro-environnementaux servant à évaluer la situation Ces indicateurs donnent des informations utiles aux milieux chargés d’élaborer et de mettre en œuvre la politique agricole Ils doivent en particulier permettre:
– d’identifier les principales questions agro-environnementales;
de comprendre, de suivre et d’évaluer la relation entre les pratiques agricoles et leurs effets bénéfiques ou nuisibles sur l’environnement;
de juger, dans quelle mesure la politique agricole favorise une agriculture ménageant les ressources;
– d’informer les décideurs politiques et l’opinion publique;
de suivre et d’évaluer la contribution environnementale de l’agriculture durable au niveau local;
– de comparer la situation en Suisse à celle dans d’autres pays
Afin d’analyser les incidences du secteur agricole sur l’environnement, on place les exigences écologiques dans un système «agriculture – homme – environnement», l’agriculture occupant ici l’avant-plan Les indicateurs ne reflètent donc pas l’évolution générale de la qualité de l’environnement dans l’espace rural; ils mettent uniquement en évidence l’impact de l’activité agricole.
1 . 3 E C O L O G I E 1 84 ■■■■■■■■■■■■■■■■
–
–
–
Système «agriculture-homme-environnement» Climat, air Sols Relief Eaux Flore, faune Environnement / nature Alimentation, santé Economie, travail Délassement, loisirs Transports, mobilité Urbanisation, habitation Homme Engrais Produits phytosanitaires Aliments pour animaux Machines 1 Climat, air, eaux Fertilité du sol 3 Biodiversité agricole Habitat pour espèces sauvages Paysage Comportement envers l‘environnement 4 Comportement envers les animaux Bien-être des animaux 5 Azote Energie Phosphore 2 Agriculture Mode d‘utilisation du sol
Il existe cinq groupes d’indicateurs. Quatre d’entre eux comprennent des indicateurs agro-environnementaux à proprement parler, tandis que les indicateurs du cinquième concernent le comportement vis-à-vis des animaux de rente et le bien-être de ces animaux. Les indicateurs agro-environnementaux fournissent des informations sur:
– la consommation de moyens de production agricoles qui ont des incidences potentielles sur l’environnement, tels que les engrais, les produits phytosanitaires, les aliments pour animaux et les médicaments vétérinaires;
– les processus agricoles dans le système agraire, tels que les bilans d’azote, de phosphore et d’énergie ainsi que le bilan écologique Ils servent à apprécier l’évolution et la compatibilité écologique de l’agriculture;
– les incidences de l’activité agricole sur l’environnement, p ex émissions dans l’air, dans l’eau et dans le sol, émissions de gaz à effet de serre, ainsi que sur la biodiversité et le paysage;
l’influence du comportement de la collectivité, des habitudes des consommateurs et de la pratique des agriculteurs sur une exploitation des surfaces ménageant l’environnement.
Les indicateurs ne sont pas tous au même stade de développement Les deux premiers groupes (moyens de production et processus agricoles) sont déjà assez perfectionnés. Généralement, on connaît les méthodes, et les données sont disponibles et interprétables
Le troisième groupe exige encore des précisions quant à la méthode, et les données sont lacunaires.
Les indicateurs du compartiment 4, à l’exception de l’attitude des consommateurs, doivent encore faire l’objet d’une réflexion approfondie.

1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E 1 . 3 E C O L O G I E 1 85
–
■
Le
Moyens de production
En Suisse, l’agriculture couvre la majeure partie de ses besoins en substances nutritives par les engrais de ferme L’évolution des effectifs d’animaux est donc un facteur important.
1 . 3 E C O L O G I E 1 86
Une valeur standard permettant d’évaluer la quantité d’engrais de ferme a été établie en fonction de l’espèce animale et du poids des animaux, à savoir l’unité de gros bétail-fumure (UGBF) Une UGBF correspond à l’apport de 15 kg de phosphore (P) et de 105 kg d’azote (N) qu ’ une vache produit en moyenne par année. nombre d’animaux
a diminué
Environnement / nature Homme Engrais Produits phytosanitaires Aliments pour animaux Machines 1 3 4 5 2 Agriculture Evolution du nombre d'animaux 19901996 1997 1998 1999 2000 e n 1 0 0 0 U G B F 1 Total UGBF Autres Source: OFS 1 UGBF: unité de gros bétail-fumure Porcs Bovins 0 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200
Système «agriculture-homme-environnement»
En termes d’UGB, les effectifs d’animaux ont continuellement baissé de 1990 à 2000. Le recul était assez marqué de 1990 à 1996, mais il s ’est affaibli par la suite Il a surtout frappé les bovins En 2000, on a compté quelque 250'000 têtes de moins qu ’ en 1990. L’effectif des porcs a aussi reculé. A l’instar des bovins, les effectifs on très nettement diminué jusqu’en 1996 pour s ’accroître à nouveau par la suite Le nombre de moutons, quant à lui, est resté stable ces dix dernières années Le 75% des UGB sont comptées dans la garde de bovins, qui prédomine ainsi dans la production d’engrais de ferme
Vingt-trois cantons comptaient, en 2000, de plus petits effectifs d’animaux que dix ans auparavant.
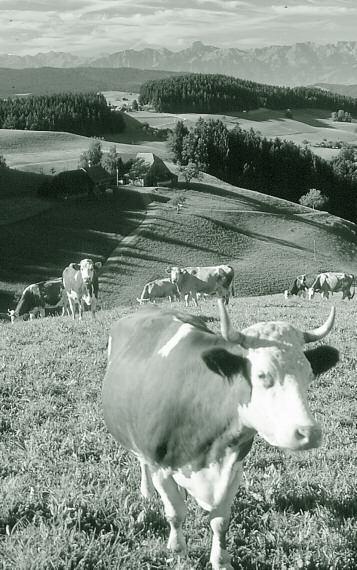
1 . 3 E C O L O G I E 1 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E 87
Evolution des UGB selon les cantons ZH BE LU UR SZ OW NW GL ZG FR SO BS/BL SH AR AI SG GR AG TG TI VD VS NE GE JU Source: OFS 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 1990 2000
■ L’utilisation d’engrais minéraux se stabilise
Depuis le début des années nonante, l’utilisation totale d’engrais minéraux n ’ a cessé de diminuer On a en effet enregistré un recul de plus de 75% d’engrais phosphatés utilisés dans l’agriculture pendant cette période, la diminution étant moins marquée pour les engrais azotés (env. 25%). Après 1998, l’utilisation de ces engrais n ’ a toutefois plus régressé et s ’est même légèrement accrue en 1999 et en 2000 par rapport à cette année-là
■ L’agriculture utilise 400'000 t d’engrais à base de déchets
Sources: USP, Office
des détenteurs suisses de stocks obligatoires d'engrais
L’agriculture utilise environ 400'000 t d’engrais à base de déchets convertis en matière sèche (MS).
1 . 3 E C O L O G I E 1 88
Evolution de l'utilisation d'engrais minéraux 1946/501956/601966/701976/801986/901990/92 1993 1994 2000 1 1999 1998 1997 1996 1995 N
1 données provisoires P 0 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 e n t Evolution de l'utilisation d'engrais à base de déchets dans l'agricultcure
de l'industrie alimentaire (provenant p.ex. de la transformation de betteraves sucrières)
destinés au compostage Boues d'épuration Restes de bois, écorce Cendres, autres déchets e n 1 0 0 0 t M S Source: FAL 1988/90 1998/99 0 20 40 60 80 100 120 140 160
fiduciaire
Déchets
Déchets
■ Produits phytosanitaires: chute des ventes de 30% par rapport à 1990
Au cours des dix dernières années, on a observé de considérables changements. Alors que la quantité de boues d’épuration a été ramenée de 116'000 à 84'000 t, celle du compost de déchets végétaux a plus que doublé, passant d’environ 65'000 à environ 150'000 t de MS. Quelque 75% du compost produit dans les installations de compostage sont utilisés dans l’agriculture Aucune indication fiable pour la période considérée n ’est disponible en ce qui concerne les autres catégories de déchets
La quantité totale de produits phytosanitaires vendus, exprimée en tonnes de substance active, a diminué de plus de 30% de 1990 à 2000 En ce qui concerne les deux groupes de substances appliquées le plus fréquemment, les fongicides et les herbicides, on a enregistré une baisse de 27 et de 21% respectivement. Le recul le plus prononcé (-76%) a été observé pour les régulateurs de croissance Cela ne signifie pas que le risque environnemental ait diminué d’autant, car la réduction de la quantité a en partie été compensée par l’utilisation de substances plus efficaces. Il n ’existe pas encore de données détaillées, sur le plan national, concernant la présence des substances dans les diverses sphères de l’environnement
■ Utilisation d’antibiotiques
Entre 1995 et 2000, l’utilisation d’antibiotiques dans l’agriculture a diminué de 50%, passant ainsi de 80 à 39 t Tel est le résultat d’une statistique menée pour le compte de la Confédération et portant sur l’utilisation d’antibiotiques dans le domaine vétérinaire. La limitation volontaire des antibiotiques, dans la production animale, comme stimulateurs de performances et leur interdiction définitive en 1999 ont été les deux principales raisons de cette réduction Ces mesures à elles seules ont contribué à réduire de 34 t l’utilisation des antibiotiques dans l’agriculture
Actuellement, les antibiotiques ne peuvent être utilisés que sous contrôle vétérinaire. On distingue deux formes d’application: entre les années 1995 et 2000, on a enregistré un recul de 44% (de 31 t à 17 t) en ce qui concerne le traitement préventif ou thérapeutique d’un troupeau (aliments médicamenteux). Pour ce qui est de la deuxième forme d’application – le traitement cas par cas d’animaux nécessitant des soins –, on a constaté durant la même période une augmentation de 7 t (utilisation en 2000: 22 t) Ces chiffres permettent de conclure que de nos jours les antibiotiques sont utilisés d’une manière plus ciblée que par le passé
1 . 3 E C O L O G I E 1 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E 89
L’analyse de la consommation d’énergie met en évidence que l’électricité, le diesel et l’essence représentent aujourd’hui plus de 50% des agents énergétiques non renouvelables utilisés dans l’agriculture Se chiffrant à quelque 40%, l’énergie grise contenue dans les machines et les bâtiments est également un facteur important. La fabrication de moyens de production tels que les engrais, les produits phytosanitaires et les semences absorbe environ 6% de l’énergie

1 . 3 E C O L O G I E 1 90
■ Stabilisation de la consommation d’énergie Evolution de la consommation d'énergie 197019771984 19911998 M J / h a Pesticides
nimaux importés
ants et semences importés Engrais Energie fossile Electricité Machines Bâtiments Source: FAL 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000
Aliments pour a
Pl
Processus agricoles
Système «agriculture-homme-environnement»
L’azote joue un rôle important dans l’environnement Cette substance nutritive protéiforme est essentielle à la vie, mais elle peut aussi être nocive à l’environnement L’azote étant indispensable dans l’agriculture, celle-ci engendre des combinaisons azotées qui influent sur l’environnement Par conséquent, l’azote est un indicateur primordial à l’intérieur du système agricole
Pour apprécier ce système du point de vue qualitatif, on se fonde sur le bilan d’azote établi selon la méthode «bilan azoté à la surface du sol» appliquée par l'OCDE. Ce bilan mesure la différence entre les quantités totales d’éléments azotés apportés au sol (engrais de ferme, engrais à base de déchets, engrais minéraux, fixation biologique, dépositions atmosphériques) et les quantités d’azote quittant le sol sous forme de produits de la culture des champs et de la culture fourragère
Toutefois, cette méthode ne permet pas à elle seule de déterminer d’une manière définitive les pertes d’azote effectives provenant de l’agriculture Ces pertes dépendent fortement du mode d’utilisation des surfaces, de la garde d’animaux et des techniques de production (p ex systèmes de stabulation, stockage et épandage des engrais de ferme) La méthode de l’OCDE ne tient pas compte des pertes occasionnées lors du stockage et de l’épandage des engrais de ferme.
1 . 3 E C O L O G I E 1 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E 91
■ Excédents d’azote en baisse
Environnement / nature Homme 1 3 4 5 Azote Energie Phosphore 2 Agriculture
Fixation de N biologique Dépositions atmosphériques
de fer
Exportation par les grandes cultures Exportation par les cultures fourragères
Les apports d’azote ont globalement régressé L’utilisation d’engrais minéraux a reculé de plus de 15'000 t d’azote en moyenne des années 1989/91 et 1998/99 Les effectifs d'animaux ayant diminué, les engrais de ferme apportent à leur tour 13'000 t d’azote de moins Au contraire, on a observé un accroissement de quelque 2'500 t des apports liés à la fixation biologique, en raison de l'extension des cultures de légumineuses
La baisse du bilan d’azote de plus 8'000 t n’égale pas le changement dans les apports Cela s ’explique par l’extensification dans la production végétale, notamment par l’aménagement des surfaces de compensation écologique Les exportations d’azote ont ainsi diminué de plus de 16'000 t dans les cultures fourragères et de près de 1'500 t dans les grandes cultures.
Il faut éviter autant que possible les bilans excédentaires Cependant, certaines pertes dans le système agricole sont inévitables.
Les charges d'azote se répercutant sur l'environnement sont une valeur importante pour apprécier l’effet environnemental des pertes d’azote provenant de l’agriculture
On entend par là toutes les combinaisons azotées qui polluent l’air et les eaux et ont un effet négatif sur le climat (ammoniac, gaz hilarant, oxyde d'azote, nitrates, ammonium) Pour déterminer les charges précitées, on attribue le potentiel de pertes d’azote aux diverses formes de cet élément. Ce potentiel comprend les pertes d’engrais de ferme dans l’étable ainsi que lors du stockage et de l’épandage, de même que l’azote qui parvient dans le sol, mais n ’est pas absorbé par les plantes L’Institut d’économie rurale de l’EPF Zurich (IER) a calculé les pertes d’azote provenant de l’agriculture et se répercutant sur l’environnement pour les années 1994 et 1998

1 . 3 E C O L O G I E 1 92
Evolution du bilan d'azote e n 1 0 0 0 t N -200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 250 300
Bilan
E
grais
me Engrais m
éraux 1998/99 1989/91 1998/99 1989/91 1998/99 1989/91 Input Output Bilan Source: OFS ■
nitrate
de l’ammoniac
n
in
Recul plus marqué du
que
■ Pertes d’azote augmentant avec les cheptels
Les principales substances à cet égard sont l’ammoniac (NH3), les nitrates (NO3) et le gaz hilarant (N2O) L’évolution de ces charges montre que la volatilisation d’ammoniac (4%) a baissé moins fortement, au plan national aussi bien que dans les zones prises individuellement, que les pertes de nitrates et de gaz hilarant (plus de -11% toutes les deux). Jusqu’à 1998, on avait enregistré une réduction de 7'000 t d’azote sur tout le territoire suisse L’objectif fixé pour 2002 (-22'000 t N) sera ainsi difficile à atteindre
La fumure excédant les besoins des plantes est désignée comme variation standard De même que la quantité d’engrais azotés et le potentiel de pertes d’azote, elle augmente lorsque les cheptels s ’accroissent (UGB/ha)
1 . 3 E C O L O G I E 1 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E 93
Part des types d'azote aux charges se répercutant sur l'environnement 1998 e n 1 0 0 0 t N 1994 0 20 40 60 80 100 8,1 51 36,8 7,2 49,1 32,6 Source: IER-EPF NO3 NH3 N2O Pertes d'azote résultant d'effectifs en hausse k g N / h a Fumure azotée Potentiel de pertes N Variation standard Source: IER-EPF 0 50 100 150 200 250 >3,0 2,01–3,0 1,51–2 Effectifs (UGB/ha) 1,01–1,5 0–1
■ Gros progrès dans le bilan de phosphore
Pour calculer le bilan de phosphore, on considère l’agriculture suisse comme une exploitation L'apport de phosphore comprend les teneurs en P des aliments pour animaux importés, des engrais minéraux et des engrais à base de déchets, des semences importées et des dépositions atmosphériques. Les exportations englobent les denrées alimentaires végétales et animales ainsi que d’autres produits fournis par l’agriculture Cette méthode n ’exige pas que l’on calcule les cycles internes de l’agriculture, tels que la production d’aliments pour animaux et l’apport d’engrais de ferme
Les apports de phosphore ont diminué de près de 10'000 t entre 1990/92 et 1997/99, surtout grâce à l'important recul des engrais minéraux phosphatés. Dans la même période, les exportations de phosphore se sont accrues de plus de 800 t, principalement parce que les farines de viande et d’os, riches en phosphore, ne sont plus utilisées dans l’agriculture en raison de l’ESB. Le bilan de phosphore s ’est ainsi amélioré de plus de 10'000 t, mais il reste néanmoins positif Le phosphore continue donc de s ’ accumuler dans le sol à certains endroits Cependant, les réserves augmentent plus lentement que par le passé
1 . 3 E C O L O G I E 1 94
Evolution du bilan de phosphore e n t P 1997/99 1990/92 1997/99 1990/92 1997/99 1990/92 Input Output Source: FAL Bilan -10 000 -5 000 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 Dépositions (précipitations) Compost, autres engrais, plants et semences Boues d'épuration Engrais minéraux Aliments pour animaux importés Produits d'origine animale Produits d'origine végétale Bilan
Incidences de l’agriculture sur l’environnement

Le maintien de l’équilibre climatique fait partie des objectifs primordiaux de la politique environnementale globale La limitation et la réduction à long terme des émissions de gaz à effet de serre induites par l’homme sont donc reconnues comme tâche importante L’agriculture y apporte une contribution substantielle
Les principaux gaz à effet de serre sont, du point de vue quantitatif, le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4) et le protoxyde d'azote (N2O) Pour pouvoir faire des comparaisons, on convertit les divers types de gaz en équivalents CO2 La combustion d’énergies fossiles est à l’origine de 84% des gaz à effet de serre émis en Suisse Moins de 1,5% de ces émissions proviennent du secteur agricole Le solde de 16% se compose de méthane et de gaz hilarant.
1 . 3 E C O L O G I E 1 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E 95
Système
Environnement / nature Homme 1 Climat, air, eaux Fertilité du sol 3 Biodiversité agricole Habitat pour espèces sauvages Paysage 4 5 2 Agriculture Evolution des émissions de gaz à effet de serre dans l'agriculture 19901998 e n 1 0 0 0 t 1 Source: OFEFP 1 équivalents CO2 N2O CH4 CO2 0 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000
■ Emissions de gaz à effet de serre
«agriculture-homme-environnement»
Les émissions de méthane et de gaz hilarant méritent un examen approfondi, d’autant que, sur une période de 100 ans, leur potentiel de réchauffement climatique est 21 fois (méthane), voire 310 fois (gaz hilarant) supérieur à celui du dioxyde de carbone En Suisse, ces deux gaz proviennent de l’agriculture à raison de 75% (méthane) et de 62% (gaz hilarant)
Au cours des dix dernières années, on a enregistré une baisse des émissions de 11%, aussi bien pour le méthane que pour le gaz hilarant. L’agriculture y a contribué surtout grâce au recul du nombre d’animaux, à l’utilisation réduite d’engrais minéraux et à l’application de techniques appropriées pour le stockage et l’épandage des engrais de ferme Partant du principe que chaque émetteur de gaz à effet de serre en Suisse doit contribuer à la réduction de ces émissions conformément au Protocole de Kyoto de la Convention sur les changements climatiques (-8%), l’agriculture suisse a d’ores et déjà atteint son objectif

19901995 2000 e n % ( 1 9 9 0 = 1 0 0 ) Emissions de gaz hilarant Emissions de méthane Source: FAL 50 60 70 80 90 100 110 1 . 3 E C O L O G I E 1 96
■
Réduction de 11% des émissions de méthane et de gaz hilarant
Evolution des émissions de gaz hilarant et de méthane
■ Surfaces de compensation écologique (SCE)
Par surfaces de compensation écologique donnant droit aux contributions, on entend les éléments suivants: prairies extensives et peu intensives; prairies extensives aménagées sur des terres assolées gelées; surfaces à litière; haies et bosquets champêtres; jachères florales et tournantes; bandes culturales extensives et arbres fruitiers hautetige Le but consiste à atteindre, d’ici à 2005, une SCE totale de 65'000 ha en plaine, soit environ 10% de la SAU
Les SCE donnant droit aux contributions ont gagné 4'300 ha (5%) de 1999 à 2000 S’élevant à 3'300 ha, la progression la plus marquante a été observée dans la région de plaine (de la zone de grandes cultures à la zone des collines) En l’an 2000, les SCE donnant droit aux contributions ont occupé 47'000 ha en tout dans cette région

Evolution des SCE 1 19921993 1994 1995 1996 1997 1998 19992000 e n 1 0 0 0 h a 1 sans arbres fruitiers haute-tige Source: OFAG 0 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Evolution de la part de SCE
e n % d e l a S A U Source: OFAG 1 zone de grandes cultures à zone des collines 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 0 25 20 15 10 5 1 . 3 E C O L O G I E 1 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E 97
ZGC–ZC1
ZM I –ZM II ZM III –ZM IV
Compensation écologique1 sans arbres fruitiers haute-tige 2000
en % de la SAU 1
Région d’estivage
1 Par commune, ha compensation écologique donnant droit aux contributions divisée par ha SAU
Compensation écologique1 avec arbres fruitiers haute-tige 2000
en % de la SAU 1
Région d’estivage
1 Par commune, ha compensation écologique donnant droit aux contributions divisée par ha SAU
Les arbres fruitiers haute-tige sont un élément important du paysage Ils jouent un rôle prépondérant dans la compensation écologique C’est notamment dans la région du Lac de Constance, dans le nord-ouest de la Suisse (surtout BL) et dans certaines régions des cantons de Berne, Lucerne, Vaud et Zurich qu’ils y apportent une contribution substantielle
1 . 3 E C O L O G I E 1 98
Source: OFAG, Données cartographiques GG25 © Office fédéral de topographie (BA013557)
0 <10 10–19,9 20–29,9 ≥30
Source: OFAG, Données cartographiques GG25 © Office fédéral de topographie (BA013557)
0 <
≥
10 10–19,9 20–29,9
30
■ Exploitation respectueuse de l’environnement sur presque tout le territoire
Comportement envers l’environnement
Depuis 1999, les agriculteurs doivent fournir les prestations écologiques requises (PER) pour avoir droit aux paiements directs Les modes d’exploitation dits production intégrée et agriculture biologique répondent à ces critères.
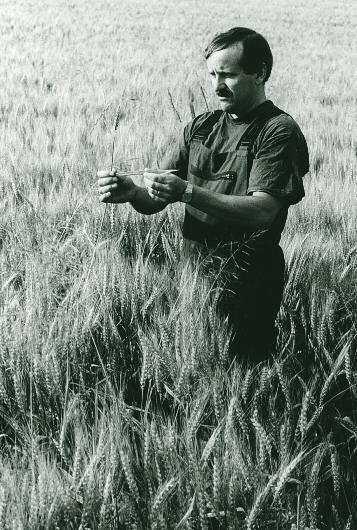
Evolution de la part de surfaces exploitées de manière respectueuse de l'environnement
Le nombre d’exploitations respectueuses de l’environnement est passé de 11’000 à 57’000 entre 1993 et 2000 Celui des exploitations biologiques que la Confédération a soutenues tout particulièrement par les paiements directs est passé dans la même période de 1’200 à 5’000 unités Enfin, la part de la SAU exploitée selon les exigences PER est pratiquement la même qu ’ en 1999 La surface cultivée selon les règles de l’agriculture biologique et bénéficiant des paiements directs versés par la Confédération a avoisiné 8% en 2000
1 . 3 E C O L O G I E 1 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E 99
Environnement / nature Homme 1 3 Comportement envers l‘environnement 4 5 2 Agriculture
Système «agriculture-homme-environnement»
e n % d e l a S A U Exploitation respectueuse de l'environnement1 dont bio Source: OFAG 1 1993 à 1998: PI+bio, dès 1999: PER 1993 1994 1995 1999 2000 1997 1998 1996 0 100 80 60 40 20
■ Différences régionales en matière de culture biologique
Les exploitations bio sont bien représentées surtout en montagne. C’est le canton des Grisons qui emporte la palme Par contre, la part d’exploitations biologiques est faible sur le Plateau suisse et surtout en Suisse romande
Surface exploitée selon les règles de la production biologique 2000
■ Surfaces agricoles sous pression
L’Office fédéral de la statistique (OFS) suit l’utilisation actuelle du sol et son évolution au moyen de la statistique dite de la superficie Les deux derniers relevés (1979 à 1985 et 1992 à 1997) ont été effectués sur la base de photographies aériennes Les surfaces agricoles comprennent les surfaces utiles destinées à l’arboriculture, la viticulture et l’horticulture, les prairies et les terres assolées, les pâturages attenants à la ferme et les surfaces utilisées dans le cadre de l’économie alpestre La définition donnée dans la statistique de la superficie diffère sensiblement de la notion définie dans l’ordonnance sur la terminologie agricole Selon cette dernière, les alpages en particulier ne font pas partie de la SAU, mais constituent une catégorie distincte dite pâturages d’estivage
1 . 3 E C O L O G I E 1 100
Source: OFAG, Données cartographiques GG25 © Office fédéral de topographie (BA013557)
en % de la SAU 1 0 <10 10–19,9 20–29,9 ≥30 Région d’estivage
1 Par commune, ha de surface en culture biologique divisée par SAU
Evolution de la surface agricole Source: OFS
Occupant 37% du territoire suisse, les surfaces agricoles constituent l’utilisation principale du sol, même si on constate leur recul constant: selon la statistique de la superficie, les surfaces agricoles ont régressé de 3% entre 1979/85 et 1992/97. En 1979/85, elles représentaient 1,57 million d’ha (2’500 m2 par habitant), alors qu ' en 1992/97, elles n’étaient plus que de 1,52 million d'ha (2’200 m2 par habitant)

Réaffectations nettes de surfaces agricoles à d'autres fins entre 1979/85 et 1992/97 (sans surfaces alpestres)
Aires de bâtiments Aires industrielles
aces d'infrastructure
ale
aces verts et lieux
e détente
ace de transport
1 . 3 E C O L O G I E 1 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E 101
–1,9 % –2,2 % –6,0 % –10,0 % –2,8 % –3,0 %
e n h a
Esp
d
Surf
Alp
Autr
Forêt Surfaces improductives Source: OFS 0 2 0001 5 9 1 23 2 3 03 1 3 04 3 5 1 1 1 4 31 3 4 61 0 0 35 5 51 9 3 0 -2 000 -4 000 -6 000 -8 000 -10 000 -12 000 -14 000 -16 000 -18 000
Surf
spéci
ages
es surfaces boisées
Réaffectations de surfaces alpestres à d'autres fins entre 1979/85 et 1992/97
Surfaces de circulation
es surfaces d'habitat
aces agricoles
n de plaine)
es surfaces boisées
Broussailles, arbustes
ation improductive
aces sans végétation, lacs et cours d'eau
Si les terres sont convoitées dans les régions propices, de larges espaces utilisés dans le cadre de l’économie alpestre sont, au nord comme au sud des Alpes, touchés par le recul de l’exploitation agricole du sol, à des degrés divers selon la région Pendant la période sous revue, les surfaces agricoles ont reculé de quelque 50'000 ha en tout Si l’on ne compte pas les alpages, le rétrécissement a représenté 31'500 ha, dont 94% ont été utilisés pour l’habitat La régression des alpages, quant à elle, s ’explique en premier lieu par l'embroussaillement des surfaces cultivées

De par leurs décisions en matière d’achat, les consommateurs exercent une influence sur l’offre et, partant, sur les modes de production L’observation de l’attitude des consommateurs donne des indications précieuses sur leurs habitudes d’achat
Sont utilisées comme bases prévisionnelles dans ce domaine :
– le sondage représentatif de l’Institut pour les assurances sociales et la médecine préventive (ISMP) de l’Université de Bâle, effectué tous les trois ans à la demande de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP);
– le sondage représentatif de l’institut de sondages d'opinion Univox effectué chaque année sur le comportement des consommateurs;
– le sondage représentatif de BIO SUISSE parmi 500 consommateurs
1 . 3 E C O L O G I E 1 102
e n h a
Surf
(régio
Autr
Forêt
Autr
Source: OFS 0 2 000 -2 000 -4 000 -6 000 -8 000 -10 0006 9 55 5 81 1 4 32 1 9 63 6 5 58 5 6 71 4 0 1 3 5 5
Végét
Surf
■ Comportement des consommateurs
Influence des consommateurs sur l'agriculture
ne sait pas 16%
inexistante 7% très forte/assez forte 55%
guère perceptible 22%
Sources: ISMP / IHA · GfM
Selon le sondage de l’ISMP, 55% des personnes consultées sont convaincues de l’influence très forte à forte des consommateurs sur les modes de production agricole; seuls 7% n ’ y croient pas
Prise en compte du mode de production lors des achats
toujours/le plus souvent 24% rarement
Sources: ISMP / IHA · GfM
Même si les consommateurs savent que la façon de pratiquer l’agriculture dépend de leur comportement, seul un quart d’entre eux vérifient toujours ou le plus souvent le mode de production des denrées au moment de leurs achats
1 . 3 E C O L O G I E 1 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E 103
21
26%
% jamais
parfois 29%
Prise en compte de la provenance lors des achats
Source: BIO SUISSE / IHA · GfM
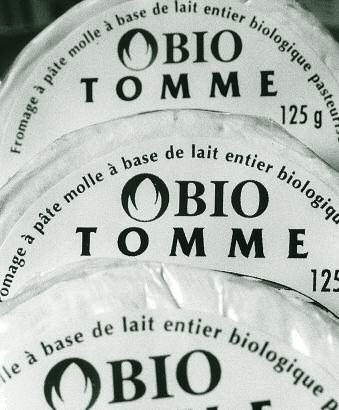
Selon le sondage effectué sur mandat de BIO SUISSE, ce pourcentage serait de 34% en ce qui concerne la provenance des aliments On peut en déduire que celle-ci joue un rôle un peu plus prépondérant que le mode de production Mais globalement, le mode de production et l’origine ne paraissent importants lors de l’achat qu’à 30% des consommateurs
L’un des préalables d’un achat ciblé et conscient est l’information des consommateurs sur la désignation des produits agricoles.
En matière de labels bio, 35% des personnes interrogées dans le cadre du sondage de BIO SUISSE ont répondu qu ’elles connaissaient la production bio de la Migros, 33% la production Naturaplan de la Coop et 18% le label du bourgeon; 10% ont reconnu
’ en connaître aucun
1 . 3 E C O L O G I E 1 104
n
toujours/le plus souvent 34% rarement 18% jamais 19% parfois 29% Connaissances sur les désignations biologiques P r o d u c t i o n b i o d e M i g r o s N a t u r a p a n d e C o o p P r o d u c t i o n s a n o d e M g r o s L e B o u r g e o n d e B I O S U I S S E N a t u r a L i n e C o o p N a t u r a B e e f A g r i N a t u r a K A G p l e i n a i r F i d e i ob i o p l e i n a i r Source: BIO SUISSE / IHA GfM 0 40 35 30 25 20 15 10 5 e n % ■ Label bio trop peu connu
■ Conformité entre production et désirs des consommateurs
Selon le sondage Univox, 80% des personnes consultées sont d’avis que la plupart ou une grande partie des agriculteurs s ’attachent à produire ce que souhaite le consommateur
Concordance de la production agricole avec les voeux des consommateurs

Minorité/faible minorité 17%
ne sait pas/pas de réponse 3%
Majorité/grande majorité 80%
Source: Univox
1 . 3 E C O L O G I E 1 105
Comportement envers les animaux, bien-être des animaux
Les deux programmes «Systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux» (SST) et «Sorties régulières en plein air» (SRPA) visent à encourager la garde d'animaux de rente particulièrement respectueuse de l'espèce Le premier pose surtout des exigences qualitatives en matière d’aires de repos Le second est essentiellement axé sur les sorties au pâturage, au parcours ou dans l’aire à climat extérieur pour la volaille La participation à ces programmes est facultative
Depuis l’instauration de SRPA en 1993 et de SST en 1996, la participation à ces programmes de garde n ’ a cessé de croître Ainsi, pour le premier, le nombre d'adhérents a plus que sextuplé de 1993 à 2000 pour passer d’environ 4'500 à 30'000 exploitations et pour le second, il a presque triplé, passant de moins de 4'500 à quelque 13'000 exploitations
1 . 3 E C O L O G I E 1 106
Environnement / nature Homme 1 3 4 Comportement
■ Programmes de garde SRPA et SST 5
Système «agriculture-homme-environnement» 2
envers les animaux Bien-être des animaux Agriculture
P a r t d ' U G B e n % SRPA SST Source: OFAG; référence: OFS jusqu'en 1998, SIPA à partir de 1999 1993 1994 1995 1999 2000 1997 1998 1996 0 50 60 30 40 20 10
Evolution de la participation aux programmes SRPA et SST
Par rapport à l’ensemble du cheptel de rente suisse, la proportion d’UGB gardées selon les règles SST ou SRPA représentait initialement 7%, contre 51% en 2000 pour les SRPA et 23% pour les SST Le nombre d’animaux de rente gardés dans le cadre de ces deux programmes croissant plus rapidement que la progression numérique des exploitations, on peut en conclure qu’ils sont pratiqués surtout dans les grandes entreprises agricoles
En ce qui concerne les SRPA, la participation s ’est sensiblement accrue pour toutes les catégories d’animaux de rente En 2000, plus de 51% des effectifs de bovins et d’autres animaux consommant des fourrages grossiers étaient gardés de cette façon Quant à la volaille, cette part se situait à 43% Le pourcentage le plus bas (28%) concerne les porcs, ce qui s ’explique avant tout par les investissements souvent très élevés d’une part et par la pression assez faible du marché de l’autre
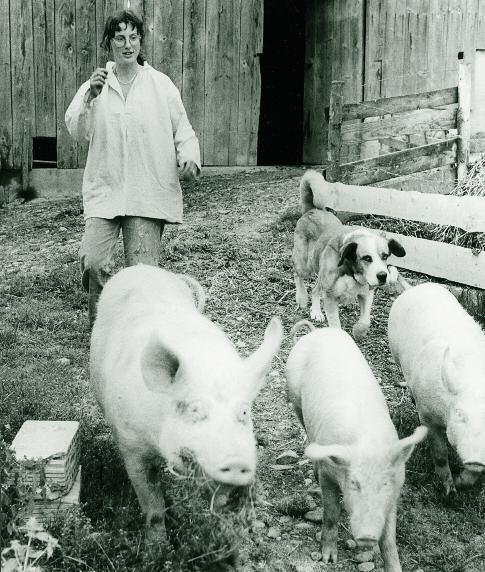
1 . 3 E C O L O G I E 1 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E 107
P a r t d ' U G B e n %
Evolution de la participation au programme SRPA, selon la catégorie d'animaux
Bovins Autres animaux consommant des fourrages grossiers VolaillePorcs 1993 1994 1995 1996 1997 19981999 2000 0 10 20 30 40 50 60 70
Source: OFAG; référence: OFS jusqu'en 1998, SIPA à partir de 1999
Evolution de la participation au programme SST, selon la catégorie d'animaux

Pour ce qui est du programme SST, on remarquera la part importante de la volaille En 2000, près de deux tiers des effectifs étaient gardés dans des poulaillers respectueux de l’espèce La pression du marché est, en l’occurrence, importante Les exigences SST fixées dans l’ordonnance sur les paiements directs constituent la condition de base pour de nombreux labels Les parts ont été plus modestes pour les bovins, les autres animaux consommant des fourrages grossiers et les porcs Le programme SST n ’ a été introduit pour les porcs qu ’ en 1997, et le développement est réjouissant dans ce domaine aussi Certes, la participation est bien inférieure à celle notée pour la volaille (un tiers de moins), mais par rapport à l’année de l’introduction du système on compte trois fois plus d’animaux gardés en porcheries SST
Les recherches scientifiques relatives aux programmes de garde sont entre autres destinées à démontrer leur effet sur le bien-être et la santé des animaux dans la pratique. Ces recherches ont d’abord porté sur les vaches laitières, qui jouent un rôle économique prépondérant
Pour chaque catégorie d’animaux, on a eu recours à des indicateurs concernant la santé et le bien-être, pouvant être mesurés sans exiger trop de temps et livrant des résultats comparables lors de mesures répétées
Pour les vaches laitières, les indicateurs utilisés sont la boiterie, l’altération des jarrets, les blessures à la peau et aux trayons, les callosités, la propreté et la condition générale, le comportement au lever et au coucher ainsi que le nombre de traitements administrés par le vétérinaire ou l’agriculteur Les enquêteurs ont rendu trois visites en deux ans (1999 et 2000) à 45 exploitations n ’adhérant à aucun programme, à 45 exploitations SRPA et à 45 autres pratiquant les SRPA et le SST
P a r t d ' U G B e n %
Bovins Autres animaux consommant des fourrages grossiers VolaillePorcs 1996 1997 19981999 2000 0 70 50 60 40 30 20 10
Source: OFAG; référence: OFS jusqu'en 1998, SIPA à partir de 1999
1 . 3 E C O L O G I E 1 108
■ Bien-être des animaux accru grâce aux programmes SST et SRPA
Les examens permettent de constater que les trois variantes ne montrent pas toujours d’écarts substantiels pour tous les indicateurs, les divergences significatives portant sur la boiterie, l’altération des jarrets, les callosités et la fréquence des traitements Les programmes de garde d’animaux augmentent sensiblement le bien-être des animaux, et plus particulièrement la combinaison SRPA et SST Le second de ces deux systèmes récolte aussi le meilleur score pour ce qui est du nombre des traitements et l’utilisation d’antibiotiques: deux traitements annuels par dix vaches, dont un aux antibiotiques, pour les exploitations SST et SRPA contre six traitements, dont cinq aux antibiotiques, pour les entreprises n ’adhérant à aucun de ces programmes
Les exploitations SRPA se distinguent essentiellement par un plus grand nombre de sorties en hiver, ce qui exerce une influence favorable sur les résultats des examens médicaux: les vaches laitières boitent moins
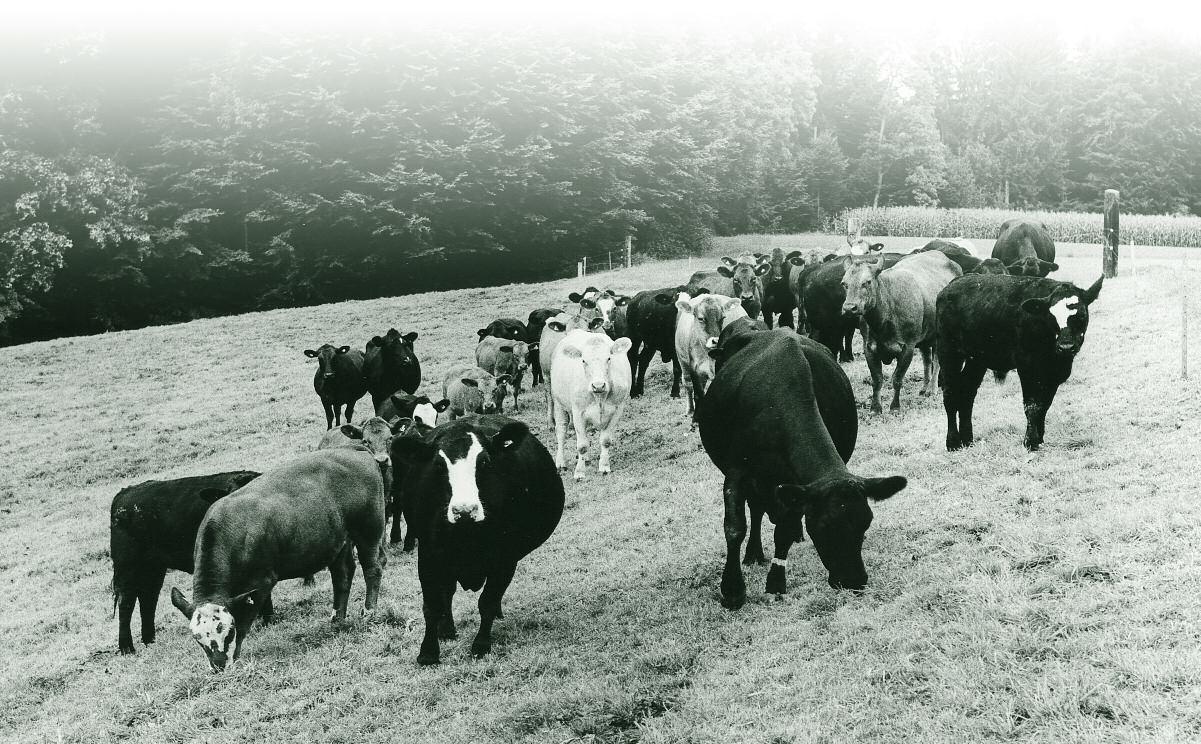
e n %
Bien-être des vaches laitières avec et sans participation aux programmes SRPA et SST
Boiterie Al
Callos
Sans programme SRPA SST+SRPA 1999 2000 1999 2000 1999 2000 0 70 50 60 40 30 20 10 1 . 3 E C O L O G I E 1 109
Source: OFAG
tération des jarrets
ités
1.3.2 Thèmes spécifiques
Consommation d’énergie pour la production laitière
C’est à l’aide d’un bilan écologique simplifié que l’OFAG a fait examiner les effets exercés par l’agriculture sur l’environnement pour l’obtention de divers produits, l’examen portant sur 52 exploitations pratiquant différentes productions et situées dans diverses zones Ont participé à l’étude la station fédérale de recherches en agroécologie et agriculture (FAL), la station fédérale de recherches en économie et technologie rurales (FAT), le Service romand de vulgarisation agricole (SRVA), la centrale de Lindau (LBL) et l’Institut de recherche en agriculture biologique (IRAB).
La consommation d’énergie non renouvelable pour la production laitière varie fortement d’une exploitation à l’autre Celles qui en consomment le moins par kg de lait font état d’une efficience trois fois supérieure à celle des exploitations qui en consomment le plus Pour produire 100 litres de lait, la consommation énergétique moyenne équivaut à 16 l de diesel Environ 50% vont au compte de l’énergie «grise» (bâtiments, machines). Il ressort de l’analyse des exploitations considérées que le résultat n ’est déterminé ni par la taille des troupeaux ni par la zone de la production laitière, contrairement au mode d’utilisation des moyens de production, bien plus décisif La vulgarisation pourra, en l’occurrence, expliquer de quelle manière le chef d’exploitation peut économiser de l’énergie et de l’argent en optimisant, par exemple, ses achats de machines et en les utilisant avec plus d’efficience (p ex utilisation en commun avec d’autres exploitations)
Utilisation d'énergie par kg de lait en 1998

1 . 3 E C O L O G I E 1 110 ■■■■■■■■■■■■■■■■
■ Grosses différences en matière de consommation d’énergie
E q u i v a l e n t s M J / k g l a i t k g l a i t / v a c h e Source: FAL Numéro d'exploitation Bâtiments Plants et semences Machines Achat d'aliments pour animaux Agents énergétiques Autres intrants Engrais Production laitière par vache 3 1 1 7 3 2 1 0 3 0 2 4 3 5 2 3 2 2 2 7 2 8 9 2 9 1 4 3 1 6 1 9 2 6 1 1 8 1 3 3 4 1 2 2 1 5 5 4 7 6 1 8 1 2 0 2 5 2 1 3 3 M o y e n n e 0 14 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 10 12 6 8 4 2 Pesticides
■ Boues d’épuration: charge en métaux lourds plus faible que jamais
Evaluation du recours aux engrais à base de déchets
En production végétale, les déchets sont utilisés comme engrais (surtout boues d’épuration, compost, déchets de l’industrie alimentaire). Le recyclage de déchets biogènes dans le cycle des substances ménage les ressources naturelles limitées, telles que les réserves mondiales de phosphate Le recours aux engrais à base de déchets est toutefois lié à l’émission de polluants dans l’environnement et à un risque sur le marché Un projet conduit par la station fédérale de recherches en agroécologie et agriculture (FAL) avait pour objectif d’évaluer leur compatibilité avec l'environnement et leur utilité en production végétale Une analyse de risques en faisait également partie
Parmi les risques, on citera surtout l’apport de métaux lourds et de substances organiques nuisibles dans le sol, ainsi que leurs effets sur la santé de l’homme et les écosystèmes terrestres. Il convient par ailleurs d’évaluer l’émission d’agents pathogènes dans l’environnement Le risque sur le marché pèse lui aussi dans la balance En effet, les consommateurs peuvent, par leur comportement en matière d’achats, exercer une influence indirecte sur l’utilisation d’engrais à base de déchets
La charge en métaux lourds des boues d’épuration a diminué de manière sensible et constante depuis les années quatre-vingt Entre-temps, la teneur en métaux lourds est pour la plupart inférieure à la moitié de la valeur limite fixée par la loi Ont notamment contribué à cette amélioration l’assainissement des sources (industrie), les restrictions de tout ordre (p. ex. concernant l’utilisation du cadmium) et la généralisation de l’essence sans plomb
Les teneurs en métaux lourds dans le compost d’une part et dans les farines animales et déchets alimentaires de l’autre se situent, elles aussi, à plus de 50% en dessous des valeurs admises, tandis que les substances présentes dans les cendres de bois dépassent en partie les limites fixées pour le nickel et le cadmium
1 . 3 E C O L O G I E 1 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E 111
Evolution des teneurs en métaux lourds des boues d'épuration e n % 1 CdCu Pb Zn Source: FAL 1 en % des valeurs limites de l'Osubst Hg 0 50 100 150 200 1975 1980 1984 1989 1994 1999
Les connaissances présentent des lacunes considérables pour ce qui est de la charge en substances organiques toxiques des engrais à base de déchets L’explication réside dans l’énorme diversité de ce groupe de substances Les polluants difficilement dégradables les plus connus sont les groupes toxiques et parfois cancérigènes des biphényles polychlorés (PCB), des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et des dioxines Leur présence dans les boues d’épuration ne fait pas l’objet de mesures de routine, mais elle a été mise en évidence par des études Toujours selon des études, leurs apports dans le sol ne mettent pas en danger la santé de l’homme, l’absorption par les plantes étant très minime Par contre, selon l’OFSP, la pollution par la dioxine a d’ores et déjà atteint le plafond admissible pour l’homme Il convient donc d’éviter les charges supplémentaires L’évaluation écotoxicologique des substances organiques toxiques présente elle aussi des lacunes.
Il n ’ y a risque de contamination par des virus et des bactéries que si les prescriptions en matière d'hygiénisation ne sont pas observées.
Quant aux risques liés au marché, ils se sont accrus en raison de la sensibilisation croissante des consommateurs Ils sont assumés par les seuls agriculteurs, c ’est-à-dire par les utilisateurs des engrais à base de déchets Mais il est difficile d’évaluer le comportement des consommateurs, leurs réactions étant très différentes par rapport à des risques objectifs comparables
Du phosphore dans les eaux en raison de ruissellements en provenance des herbages

Les apports de phosphore agricole dans les eaux proviennent principalement de ruissellements en provenance des herbages et de l’érosion du sol sur les terres assolées Dans tout le bassin d’alimentation du Lippenrütibach (LU), on a étudié les effets des mesures écologiques sur la pollution des eaux par le phosphore Sur 270 parcelles, on a saisi les données concernant l’emplacement, l’exploitation et l’épandage d’engrais, puis examiné les liens de cause à effet avec celles mesurées dans le ruisseau C’est la station fédérale de recherches en agroécologie et agriculture (FAL) qui a pris la direction des travaux
Les évaluations de l’année 1998 ont indiqué une diminution de 55% de la charge de P dans le ruisseau de Lippenrüti par rapport au début des années nonante Mais si l’on tient compte des précipitations enregistrées cette année-là, on peut admettre sur la base de modélisations que seuls 20% de ce recul sont imputables à des changements survenus dans le mode d’exploitation et d’épandage d’engrais La pollution par le phosphore aurait donc été, en 1998, de 13% inférieure à celle enregistrée pendant la période de référence 1988/1992, avant l’instauration des mesures écologiques.
Les premiers résultats du projet de la FAL montrent que l’ampleur et la période des précipitations exercent une influence décisive sur le ruissellement des substances On ne pourra donc se prononcer que lorsqu’on aura suffisamment de recul pour l’analyse et l’interprétation des données.
1 . 3 E C O L O G I E 1 112
Du phosphore dans les eaux en raison de l’érosion du sol
Dans la région de Frienisberg (BE), on examine les liens entre les mesures écologiques prises dans l’agriculture et la pollution des eaux par le phosphore liée à l’érosion du sol Ce projet est lui aussi conduit par la FAL
D’après les mesures effectuées sur le terrain en 1998/99, les pertes de sol ont augmenté de 22% et l’apport de phosphore dans les eaux de 27%, en comparaison avec les données relevées en 1987/89 L’explication réside dans les précipitations exceptionnellement abondantes de la période 1998/99

Selon les modélisations, le risque d’érosion constaté durant de nombreuses années a diminué de 27% entre 1987/89 et 1998/99, et la pollution des eaux par le phosphore (pour cause d’érosion) de 22%, cela avant tout en raison des changements apportés à la rotation des cultures et aux modes de production. Ainsi, le pourcentage des cultures intercalaires a plus que doublé, passant de 11 à 25%, alors que les techniques d’exploitation respectueuses du sol (ensemencement direct, ensemencement en bandes fraisées ou semis sous litière) sont passées de 0 à 14% Toutes ces techniques réduisent de beaucoup l’érosion du sol
Ici encore, les apports de P dans les eaux sont étroitement liés à l’ampleur et à la période des précipitations Les relevés cartographiques et les modélisations seront poursuivis jusqu’en 2005, afin de corroborer les résultats et de dégager l’évolution future
1 . 3 E C O L O G I E 1 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E 113
Semis direct / ensemencement en bandes fraisées Semis sous litière Autres procédés sans charrue Charrue t / h a e t a n n é e en surface linéaire Source: FAL 1 Mesures dans la région de Frienisberg 1998/99 0,0 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2
Erosion du sol avec divers procédés de travail du sol1
La biodiversité: le projet «Perdrix»
En 1991, la Station ornithologique suisse de Sempach a lancé un projet de dix ans visant à relever des données concernant les effets de la compensation écologique et à promouvoir des espèces d’oiseaux des champs menacées – la perdrix en particulier –ainsi que le lièvre
Le choix s ’est porté sur les régions de la Champagne genevoise et de Klettgau (SH), refuges des dernières perdrix de Suisse
On est cependant intervenu trop tard dans la seconde de ces régions, les dernières perdrix ayant disparu peu après le début du projet. Quant à Genève, s’il a certes été possible de ralentir le rythme fulgurant de disparition, la population de ces animaux ne compte plus que quelques individus
Depuis 1998, des essais scientifiques de remise en liberté ont lieu à Klettgau (région de Widen) sur une superficie de 4,3 km2 Selon de premiers résultats, les perdrix utiliseraient les nouvelles jachères de manière intensive et profiteraient de la revalorisation du paysage champêtre Même constat pour certaines espèces d’oiseaux couveurs typiques des champs.
Evolution du nombre des oiseaux couveurs choisis à Klettgau (SH)
1
Source: Station ornithologique suisse
Pour ce qui est de la Champagne genevoise, caractérisée par un climat doux et sec, certaines espèces d’oiseaux couveurs ont réagi favorablement, par un fort accroissement de population, dans la région bien revalorisée et mise en réseau autour de Laconnex (6,1 km2) Le nombre de couples de traquets pâtres est passé de 11 à 49 entre 1991 et 1999 Quant à la fauvette grise, elle occupait 6 territoires en 1991, contre 62 en 1999 ; pour le bruant proyer, ce nombre est passé de deux à 36. En 1997, la caille a atteint de très fortes densités avec dix coqs par km2 Il est cependant difficile d’interpréter leur évolution, compte tenu d’une «invasion» dans toute l’Europe centrale. C’est surtout depuis 1995 que l’hypolaïs polyglotte s ’est installé plus souvent dans des bandes en jachère (13 territoires en 1995, 38 en 1999)

1 . 3 E C O L O G I E 1 114
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Perdrix 42000003 1 4 1 Caille 2 10 11 17 16 8 34 26 13 Vanneau 321400000 Alouette des champs –2 –2 –2 –2 150 130 167 198 182 Bruant proyer 3577987 10 8
oiseaux
remis en liberté
2 pas de relevé
Sur les surfaces bien revalorisées de Laconnex (GE) et de Widen (SH), les populations de bruants proyers et de cailles se sont développées de manière très analogue entre 1991 et 1999, des densités plus fortes ayant toutefois été enregistrées en Champagne genevoise. Les données de la Station ornithologique de Sempach valables pour toute la Suisse ne font cependant pas apparaître une telle analogie Contrairement à ce qui s ’est passé en Champagne genevoise, l’établissement des traquets pâtres et des fauvettes grises est resté très modeste à Klettgau Les écarts constatés entre les deux régions s ’expliquent par des différences aux plans de la structure de l’habitat et de la dissémination des espèces Les espèces nichant dans les haies arbustives (pie-grièche écorcheur, rousserolle verderolle) ont réagi favorablement à la revalorisation et à la mise en réseau des terres cultivées avec des biotopes linéaires en bordure des champs
Au début des années quatre-vingt, la perdrix était encore relativement bien représentée dans tout le canton de Genève, alors qu ’ en 1996, on ne la retrouvait plus que près de Laconnex, sur les surfaces revalorisées dans le cadre du projet Perdrix.
1 . 3 E C O L O G I E 1 115 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E
du nombre d'oiseaux couveurs choisis à Laconnex (GE) N o m b r e P a r t d e j a c h è r e s f l o r a l e s p a r h a d e S A U e n % Source: Station ornithologique suisse Traquet pâtre Hypolais polyglotte Fauvette grise Bruant proyer 199019911992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 0 70 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 50 60 30 40 20 10 Part de jachères florales par ha de SAU
Evolution
Evolution de la présence de la perdrix dans le canton de Genève
Le projet de la Station de Sempach montre que certaines espèces menacées d’oiseaux couveurs peuvent être encouragées de manière décisive par des mesures de compensation écologique, aux conditions suivantes:
– surfaces de compensation riches en espèces et structures botaniques (p. ex. jachères florales ensemencées et spontanées);
– au moins 5% de la SAU présentant un intérêt écologique;
– surfaces revalorisées constituant, avec les structures existantes, un réseau cohérent de biotopes de valeur
1 . 3 E C O L O G I E 1 116
6
1989 1993 199
1977– 82
1.4 Appréciation de la durabilité
Les principes du développement durable ont été adoptés en 1992, lors de la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement En 1997, le Conseil fédéral approuvait une première stratégie de durabilité pour la Suisse La nouvelle Constitution fédérale expressément axée sur un développement durable au sens large du terme, adoptée par le peuple et les cantons en 1999, jette une base importante pour l’intégration des réflexions sur la durabilité dans tous les domaines de la politique Le principe de durabilité est ancré dans l’article constitutionnel sur l’agriculture depuis 1996 déjà
L’ordonnance sur l'évaluation de la durabilité de l'agriculture prévoit que dans le rapport agricole, le Conseil fédéral évalue les résultats des analyses sous l’angle de la durabilité. Cela signifie que la situation économique, sociale et écologique de l’agriculture et les répercussions de la politique agricole doivent être observées et évaluées Dans le premier rapport agricole, l’évaluation a été faite par des constats de nature qualitative
Le présent rapport formule encore une fois des constatations surtout qualitatives (cf. ch 1 4 1) Il présente par ailleurs aussi un concept sur la manière d’évaluer le développement à l’avenir, à l’aide d’indicateurs quantitatifs choisis (cf ch 1 4 2)
Le concept de base est proche de celui qui est à l’origine du rapport «Politique du développement durable en Suisse: analyse de la situation et perspectives» Ce rapport avait été rédigé sur mandat du Comité interdépartemental de Rio (CIRio) comme base pour l’élaboration de la stratégie du Conseil fédéral en 1997 Les travaux effectués dans le cadre du projet «Monet» (un projet de l’OFS et de l’OFEFP visant à mettre en place un suivi du développement durable) partent également de définitions semblables Enfin, c ’est aussi la même idée de base qui se retrouve dans un document de travail de la Commission de l’UE sur le développement durable dans l’agriculture, publié en février 2001
1 . 4 A P P R É C I A T I O N D E L A D U R A B I L I T É 1 117 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E ■■■■■■■■■■■■■■■■
■ Aspects sociaux
1.4.1 Appréciation actuelle de la durabilité
Nous décrivons dans le présent Rapport agricole le concept selon lequel la situation de l’agriculture sera périodiquement appréciée à l’avenir sous l’angle de la durabilité, au moyen d’indicateurs quantitatifs (cf ch 1 4 2) Dans les lignes qui suivent, nous présentons la durabilité en l’an 2000 sur la base de données portant sur les aspects de l’économie, du social et de l’écologie
L’an 2000 a été meilleur que l’année précédente dans le domaine du marché, grâce à l’équilibre entre l’offre et la demande Tant la production végétale que la garde d’animaux ont contribué à une hausse de 5% de la production finale. L’effondrement des prix du bétail de boucherie survenu à la fin de l’année en raison de la détection de cas d’ESB en France et en Allemagne n ’ a plus exercé une influence décisive sur les résultats globalement favorables.
D’après le dépouillement centralisé des données comptables de la FAT, les exploitations du quartile présentant les meilleurs résultats économiques sont parvenues, en moyenne des années 1998/2000, à un revenu du travail comparable à celui des autres groupes de la population Les chiffres pertinents ont été supérieurs au salaire de référence dans la région de plaine et des collines et inférieurs dans la région de montagne
Le 30% des exploitations ont enregistré une diminution de capital propre en moyenne des années 1998/2000 Dans une analyse de la stabilité de la distribution des quartiles, la FAT arrive à la conclusion que les exploitations concernées ne sont pas les mêmes d’année en année Moins de la moitié des exploitations est restée par exemple dans le quartile inférieur de 1997 à 1999 La part des exploitations dont le capital propre diminue à long terme devrait donc être nettement inférieure à 30% Malgré tout, il est à supposer, compte tenu de la formation de capital propre des exploitations des premier et deuxième quartiles, que l’existence d’environ un tiers des entreprises ne soit pas garantie à long terme
Le nombre d’exploitations agricoles a reculé d’environ 22'000 unités (-24%) entre 1990 et 2000 Il s ’agit là en majorité d’exploitations dont la SAU est inférieure à 10 ha (89%) ou de petites exploitations de moins de 3 ha (50%) Cette situation indique que la réorientation du soutien agricole consistant à rétribuer davantage les prestations par les paiements directs n ’ a pas entravé d’une manière décisive l’évolution structurelle La situation économique de l’agriculture suisse ne s ’est pas substantiellement détériorée en moyenne des années 1998/2000 par rapport à la période 1990/92 Le revenu total a certes baissé de 4%, mais la plupart des exploitations peuvent comme avant constituer un capital propre suffisant pour assurer leur existence en tant qu ’ entreprises Le rapport du cashflow aux investissements n ’ a pratiquement pas changé (95% en 1990/92; 94% en 1998/2000) Le taux d'endettement a même fléchi entre 1998/2000 et 1990/92.
Le revenu total et la consommation des ménages agricoles sont des indicateurs importants pour l’appréciation de la situation sociale de l’agriculture. Les exploitations du quartile inférieur ont obtenu, en moyenne des années 1998/2000, un revenu total ne permettant pas de couvrir entièrement les dépenses pour la consommation privée C’est un signe d’une situation économique et sociale difficile. Relevons cependant
118 1 . 4 A P P R É C I A T I O N D E L A D U R A B I L I T É 1
■■■■■■■■■■■■■■■■
■ Economie
■
encore une fois que la composition du quartile inférieur change au fil du temps: seule la moitié des exploitations demeure plus de trois ans dans ce quartile Or, le revenu total a été nettement supérieur aux dépenses pour la consommation privée dans les trois autres quartiles. La consommation privée a baissé en 1998/2000 dans le quartile inférieur en comparaison à la période 1990/92, où les exploitations concernées ont été encore en mesure d’en couvrir les frais Ainsi, dans les exploitations du quartile inférieur, la base économique nécessaire pour satisfaire les besoins de la famille s ’est détériorée Pour vivre, ces exploitations rongent leur capital durant une période prolongée
Un sondage représentatif réalisé au printemps 2001 a porté sur la perception subjective de la situation par la population agricole, en comparaison des autres groupes de la population dans l'espace rural Il permet de constater que le degré de satisfaction est comparable dans l’agriculture et dans le reste de la population en ce qui concerne l’appréciation du niveau de vie général La population paysanne est légèrement plus satisfaite de l’activité professionnelle, de la vie familiale, de la santé ainsi que de la formation et du perfectionnement Elle est moins satisfaite de sa situation en matière de revenu, de la stabilité des conditions-cadre et des loisirs
Les prestations écologiques de l’agriculture ont de nouveau progressé par rapport à l’année précédente Comparé à 1999, le nombre d’exploitations biologiques ayant droit aux contributions a augmenté de 3% et les surfaces de compensation écologique de 4%; quant aux programmes de garde d’animaux, l’effectif d’UGB s ’est accru de 14% pour SRPA et de 17% pour SST
Les exploitations biologiques ont exploité, en l’an 2000, 8% de la SAU Environ 47'000 ha de surfaces de compensation écologique ont donné droit à la contribution dans la région de plaine (zones de grandes cultures et des collines) Respectivement 51% et 23% des UGB ont été gardées selon les règles SRPA et SST L’objectif fixé pour 2005, une participation aux programmes de garde d’animaux correspondant à 50% des UGB, a donc déjà été atteint dans l’année sous revue

1 . 4 A P P R É C I A T I O N D E L A D U R A B I L I T É 1 119 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E
Les atteintes à l’environnement causées par l’agriculture ont fortement baissé depuis le début des années nonante jusqu’en 1998 Une stagnation est par contre apparue en 1999 et 2000 L’utilisation d’engrais minéraux a également connu un recul considérable jusqu’en 1998, avant d’augmenter de nouveau un peu en 1999 et en 2000 Il en va de même pour les ventes de produits phytosanitaires, exprimées en t de substance active: elles ont diminué de 30% de 1990 à 1999, pour se stabiliser au niveau atteint à ce moment-là Les excédents d’azote ont baissé de 7'000 t entre 1994 et 1998 Il sera difficile d’atteindre l’objectif fixé en la matière, soit la réduction de 22'000 t jusqu’en 2002 Quant aux excédents de phosphore, ils ont passé de 20'000 à 9'000 t entre 1990/92 et 1998 Nous avons donc d’ores et déjà dépassé notre objectif, qui consistait à les réduire de 50% jusqu’en 2005. Les effets de la limitation des atteintes et de la progression des prestations sur le sol ou sur l’eau, sur le bien-être des animaux ou sur la diversité des espèces font actuellement l’objet d’analyses des effets D’après leurs résultats intermédiaires, l’évolution ne dépend pas seulement des mesures analysées, mais aussi de nombreux autres facteurs Les analyses portant sur le phosphore montrent par exemple que l’intensité et le moment des précipitations exercent une influence décisive sur le lessivage de cette substance Ecologie
1.4.2 Concept d’évaluation globale de la durabilité

Concept de durabilité
Un concept de durabilité doit être axé sur l’avenir et les ressources et englobe les trois dimensions que constituent l’économie, le social et l’écologie L’objectif est que les générations futures puissent jouir d’un niveau de prospérité au moins comparable à l’actuel Par prospérité nous entendons le bien-être découlant de la satisfaction des besoins humains, tant matériels qu’immatériels Les générations futures doivent disposer à cette fin d’une certaine quantité de ressources d’une qualité définie Par ressources, on entend les ressources naturelles, humaines (savoir) et investies (capital financier investi dans l’immobilier)
Comme les besoins quantitatifs et qualitatifs des générations futures ne sont pas connus et qu’il n ’est pas possible de prévoir comment le progrès technique influencera la productivité des ressources et dans quelle mesure celles-ci pourront se substituer les unes aux autres, il n ’est pas non plus possible de déterminer, à l'heure actuelle, la quantité et le genre des ressources qu'il convient de transmettre aux générations futures. C’est en particulier au niveau des ressources naturelles que se situe l’insécurité Dans ce domaine, une priorité élevée doit être attribuée au principe de précaution
Il convient de ménager les ressources naturelles et de tendre vers une substitution active des ressources naturelles non renouvelables par des ressources naturelles renouvelables Ces dernières doivent par ailleurs être utilisées de telle sorte qu ’elles puissent se régénérer et les ressources humaines (savoir) comme les ressources investies être renouvelées activement et continuellement La pénurie de toutes les formes de ressources nous en impose finalement une utilisation efficace
Ces critères de durabilité sont nécessaires, sans toutefois être suffisants Leur respect permet d'atteindre un état de bien-être maximal, mais il ne peut empêcher que certains déséquilibres apparaissent au niveau de la répartition. Un des éléments-clés de la durabilité est donc la répartition équitable du bien-être, non seulement entre la génération actuelle et celles à venir, mais aussi au sein de la génération actuelle L’équité à l’intérieur de la génération actuelle concerne tant la répartition à l’intérieur de la Suisse que celle entre les pays industrialisés et les pays en développement L’équité entre les générations et la transmission d’une combinaison de ressources sont étroitement liées; la première constitue un objectif et la deuxième un moyen pour atteindre cet objectif
1 . 4 A P P R É C I A T I O N D E L A D U R A B I L I T É 1 120 ■■■■■■■■■■■■■■■■
■ Ressources
Le concept de développement durable fixe les priorités suivantes:
– Utilisation des ressources naturelles avec préservation de réserves minimales Substitution des ressources naturelles non renouvelables par des ressources naturelles renouvelables Renouvellement continu de toutes les ressources naturelles renouvelables, des ressources humaines (savoir) et des ressources investies
– Efficience dans le processus de transformation entre intrants et extrants à tous les niveaux du processus d’apport de prestations
– Répartition équitable du bien-être à l’intérieur de la génération et entre les générations
Agriculture durable
Le développement durable nous concerne tous Chacun peut y apporter sa contribution, aussi bien que l’économie et la politique L’agriculture considérée comme secteur peut apporter un soutien maximal lorsque les conditions-cadre sont posées de telle sorte qu ’ un développement durable soit possible Les conditions ci-après sont en outre nécessaires en rapport avec les thèmes centraux que sont les ressources, l’efficience et l’équité:
Le rôle de l’agriculture est exprimé dans le mandat constitutionnel de l’agriculture (art 104, al 1, cst); celui-ci exige d’elle une contribution à la sécurité de l’approvisionnement de la population, à la conservation des ressources naturelles, à l’entretien du paysage rural et à l’occupation décentralisée du territoire En fournissant ces prestations, l’agriculture contribue à la prospérité de la société.
Trois groupes de protagonistes doivent entrer en scène pour que l’agriculture puisse remplir ce mandat:
Les agriculteurs
Il est indispensable que les agriculteurs prennent soin des ressources nécessaires à leur prestation La capacité de régénération des ressources environnementales doit être maintenue (fertilité du sol, biodiversité) Ils doivent renouveler régulièrement leurs ressources investies sous forme de machines et bâtiments en fonction de leurs moyens financiers Enfin, il est de leur tâche de maîtriser le savoir essentiel pour une exploitation durable et de le mettre à jour régulièrement.
Les consommateurs
Le comportement des consommateurs au niveau de la demande joue un rôle décisif pour la contribution de l’agriculture à un développement durable Il importe que leurs habitudes alimentaires créent une demande de produits issus d’une agriculture durable Les consommateurs doivent développer une préférence pour de tels produits mais aussi être prêts à en payer le prix
1 . 4 A P P R É C I A T I O N D E L A D U R A B I L I T É 1 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E 121
■ Efficience
L’Etat
La tâche de l’Etat est double: elle consiste, d’une part, à s ’ engager au niveau international pour ouvrir la voie au développement durable et, d’autre part, à élaborer et à maintenir au plan national des conditions-cadre permettant à l’agriculture d’apporter une contribution maximale à un développement durable
Des actions étatiques coordonnées à l’échelle internationale doivent promouvoir l’intégration des coûts externes au prix final des produits, comme celle des prestations de services de toutes les branches économiques Cette internalisation est doublement importante pour l’agriculture: tout d’abord, elle signifierait une diminution de la pression des autres branches économiques sur les ressources naturelles co-utilisées par l’agriculture (air, eau, sol, biodiversité); ensuite, elle impliquerait que les prix des produits concurrents importés englobent leurs vrais coûts de production, de transformation et de commercialisation La compétitivité de l’agriculture suisse s ’ en trouverait améliorée, et la pression sur les ressources naturelles serait atténuée.
Au niveau national, l’Etat doit veiller à ce que les prestations d'utilité publique non indemnisées par le marché et fournies par l’agriculture soient rétribuées L’entretien du paysage rural en est un exemple; il offre un profit direct à la génération actuelle et constitue simultanément un héritage pour les générations futures. Les frais supplémentaires engendrés par les modes de production ménageant les ressources naturelles doivent être indemnisés par l’Etat tant que les coûts externes ne seront pas entièrement internalisés. La protection douanière, par exemple, peut également y apporter sa contribution; elle permet d’atteindre en Suisse des prix au producteur dépassant le niveau du marché mondial Les indemnisations sous forme de paiements directs et par l’intermédiaire des prix doivent garantir à l’agriculture de pouvoir obtenir, par une utilisation efficace des facteurs de production, une rétribution du facteur de production «travail» qui soit adaptée à la moyenne suisse.
Par ailleurs, l’Etat doit encourager, par des mesures de formation et de vulgarisation, des comportements de production et de consommation durables.
Le concept de durabilité exige de l’agriculture – comme du reste de l’économie – une gestion efficace des ressources dont elle a besoin pour fournir ses prestations Ceci s ’avère aussi indispensable pour accroître au maximum la compétitivité sur les marchés Seule une agriculture efficiente et compétitive peut remplir son mandat constitutionnel concernant l’approvisionnement de la population, l’occupation décentralisée du territoire et, partant, la viabilité de l’espace rural.
1 . 4 A P P R É C I A T I O N D E L A D U R A B I L I T É 1 122
■ Exigences liées aux indicateurs
En maintenant son potentiel de production, l’agriculture contribue à l’équité entre les générations Font partie de ce mandat une gestion soigneuse des ressources naturelles, le renouvellement régulier des machines et des bâtiments et une formation continue ciblée.
L’agriculture peut aussi promouvoir l’équité à l’intérieur de la génération en apportant, grâce à ses propres efforts et à l’aide de conditions-cadre adéquates, une contribution aux emplois, au revenu, à l’infrastructure et à la qualité de vie dans le milieu rural C’est également une manière d’atténuer la différence des niveaux de vie entre les populations citadine et rurale
Indicateurs pour une agriculture durable
Le concept de durabilité est complexe, notamment parce qu’il a trait au futur. L’état final «durabilité» n ’existe pas Les indicateurs relatifs à la durabilité ne peuvent véritablement donner qu ’ une évaluation permettant de savoir si une évolution définie prend la bonne voie Il est tout à fait concevable que certains d’entre eux montrent des directions différentes, ce qui ne doit pas être caché par leur agrégation en un indicateur global synthétique de durabilité. En fait, la véritable utilité des indicateurs relatifs à la durabilité est de permettre de déceler les possibilités de substitution entre les divers indicateurs et, en particulier, entre les trois dimensions que constituent l’économie, le social et l’écologie, pour créer les bases nécessaires aux décisions politiques.
Les indicateurs d’évaluation de la durabilité doivent satisfaire à un certain nombre de critères:
– avoir une importance politique (l’indicateur doit être en rapport avec des objets d’étude prioritaires au plan politique);
– avoir une base analytique solide (l’indicateur doit donner une image représentative de l’objet d’étude);
– être déterminant pour la pratique (l’indicateur doit permettre de se faire une idée des mesures nécessaires);
– être défini à un niveau d’agrégation adapté;
– se baser sur des données statistiques fiables;
– être communicable; – offrir un rapport coût-utilité adéquat
1 . 4 A P P R É C I A T I O N D E L A D U R A B I L I T É 1 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E 123
■ Equité
■ Groupes d’indicateurs pour l’agriculture
Les indicateurs relatifs à la durabilité en agriculture montrent dans quelle mesure celleci contribue au développement durable de la Suisse en fonction du comportement alimentaire des consommateurs et des conditions-cadre définies par l’Etat Les indicateurs doivent appréhender les thèmes centraux (ressources, efficience, équité) et être développés pour les diverses dimensions d’une agriculture durable; économie, sociale, écologie Les thèmes centraux n ’ont naturellement pas le même poids selon la dimension considérée La question des ressources joue un rôle primordial dans les trois dimensions (ressources naturelles, humaines et investies) Pour l’écologie et l’économie se pose en outre la question essentielle de l’efficience, alors que dans le social, l’équité se situe au premier plan
Groupes d’indicateurs
Indicateurs de ressources
Comme la transmission d’un certain volume de ressources aux générations futures est le principe de base du concept, ce sont les indicateurs relatifs aux ressources qui doivent former le noyau des indicateurs choisis pour apprécier la durabilité En parlant de ressources, il convient de différencier entre celles qui sont renouvelables et celles qui ne le sont pas Pour ce qui est des ressources renouvelables, les indicateurs doivent montrer si leur exploitation ne dépasse pas le taux de régénération En ce qui concerne les ressources humaines (savoir) et les ressources investies, les indicateurs doivent révéler dans quelle mesure et à quelle vitesse celles-ci sont renouvelées et quelle est leur qualité
Indicateurs d’efficience
La combinaison des divers types de ressources est à l’origine d’extrants commerciaux et non commerciaux Les indicateurs d’efficience dans le domaine de l’économie créent le lien entre intrants et extrants de ressources Dans le domaine de l’écologie, les indicateurs d’efficience se rapportent aux conséquences sur l’environnement par unité d’énergie alimentaire produite
Pour l’économie, les indicateurs d’efficience doivent être complétés par des indicateurs de compétitivité et de viabilité Le potentiel de production du secteur ne pourra être maintenu à long terme que si celui-ci est compétitif et si les facteurs de production sont suffisamment indemnisés.

1 . 4 A P P R É C I A T I O N D E L A D U R A B I L I T É 1 124
Economie Aspects sociaux Ecologie Ressources ■■■ Efficience ■■ Equité ■
■ Objectifs de la durabilité
Indicateurs d’équité
Les indicateurs dans ce domaine doivent mettre en évidence la comparaison entre la situation sociale dans l’agriculture et celle qui prévaut dans la population non agricole
Ce type d’équité peut par exemple être mesuré sur la base d’une étude comparative de l’accès au savoir (formation, formation continue), de la charge en travail et des conditions de travail ou de revenu
Afin de pouvoir apprécier la politique agricole sous l’angle de la durabilité, il faut comparer des données relatives aux indicateurs avec une valeur-cible Ni les besoins des générations futures ni le progrès technique ne peuvent être pronostiqués, raison pour laquelle l’état final «durabilité» n ’existe pas. Il n ’est donc pas possible de considérer les valeurs-cible comme une grandeur fixe; elles doivent être adaptées périodiquement à l’état actuel des connaissances Dans certains domaines, il est en outre probablement difficile de fixer de telles valeurs. Il peut alors être utile d’indiquer la direction souhaitée
Les objectifs n’étant pas des grandeurs invariables, il convient de parler d’objectifs intermédiaires
La formulation d’objectifs à atteindre avec la politique agricole ou avec des mesures de politique agricole n ’est pas nouvelle Elle existe tant dans le domaine économique qu’écologique. En fixant dorénavant des objectifs intermédiaires pour l’évaluation de la durabilité de l’agriculture, on l’étend au domaine social et l’oriente vers un développement considéré sous l’angle de la durabilité
■ Présentation synoptique
Une représentation visuelle doit permettre de déterminer rapidement si l’agriculture évolue vers la durabilité aujourd’hui Pour ce faire, on entend présenter dans un tableau les valeurs-cible (objectifs intermédiaires) correspondant à chaque indicateur et les valeurs effectives, des nuances de gris indiquant l’ampleur de l’écart. Les lecteurs pourront ainsi facilement se faire une idée de l’état du développement durable en agriculture
1 . 4 A P P R É C I A T I O N D E L A D U R A B I L I T É 1 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E 125
Evaluation de la durabilité de l’agriculture
Indicateurs Objectif intermédiaire Situation actuelle Evaluation (direction à suivre) (valeur) (en couleurs)* n+x (années) n n+x n+x
Les indicateurs concrets des trois domaines que constituent l’économie, le social et l’écologie seront définis, dans une prochaine étape, conformément au concept présenté Ensuite, il s ’agira de fixer des objectifs intermédiaires pour les indicateurs choisis Il est prévu de procéder à l’évaluation périodiquement, au rythme des enveloppes financières agricoles, et d’en présenter les résultats dans les Rapports agricoles.
126 1 . 4 A P P R É C I A T I O N D E L A D U R A B I L I T É 1
Economie (1) (2)
(1) (2) Ecologie (1) (2)
Aspects sociaux
* gris clair = dans le domaine-cible (DC) gris souris = évolution en dehors du DC/positive gris foncé = évolution en dehors du DC/négative
■ Suite des opérations

■■■■■■■■■■■■■■■■
127 2
2. Mesures de politique agricole
La loi sur l’agriculture du 29 avril 1998 contient des réglementations destinées à concrétiser l’art 104 de la Constitution fédérale de 1996 Suite à l’adoption de la nouvelle loi sur l’agriculture et de ses ordonnances, on a mis en oeuvre la réforme de la politique agricole, connue sous la désignation «Politique agricole 2002». La «Politique agricole 2002» a permis d’élaguer notablement la densité législative, en particulier les interventions étatiques directes sur le marché par les garanties de prix et de débouchés
Les mesures de politique agricole peuvent être classées dans les trois domaines suivants:
– Production et vente: les mesures prises dans ce domaine visent à créer de bonnes conditions-cadre pour la production et le placement de denrées alimentaires. La loi prévoit que, cinq ans après son entrée en vigueur, les dépenses de la Confédération affectées à la production et au placement devront avoir été réduites d’un tiers par rapport à celles de 1998. En 2003, ce ne seront plus que quelque 800 millions qui pourront être consacrés à ces mesures
Paiements directs: ces paiements sont considérés comme une rétribution de l’agriculture pour ses prestations en faveur de la collectivité, au rang desquelles figurent l’entretien du paysage, la sauvegarde des bases naturelles de l’existence, la contribution à une occupation décentralisée du territoire ainsi que des prestations écologiques particulières Les prix payés pour les denrées alimentaires ne comprennent pas ces prestations car, pour elles, il n ’ y a pas de marché. Par le biais des paiements directs, l’Etat s ’ assure le concours de l’agriculture pour fournir ces prestations d’intérêt général
– Amélioration des bases de production: ces mesures permettent à la Confédération de promouvoir et de soutenir une production de denrées alimentaires respectueuse de l’environnement, sûre et efficiente Ces mesures concernent l’amélioration des structures, le domaine de la recherche et de la vulgarisation, les matières auxiliaires et la protection des végétaux et des variétés.
Le DFE a ouvert le 21 septembre 2001 la consultation sur l’évolution future de la politique agricole Le projet intitulé «Politique agricole 2007» a pour but une nouvelle optimisation des conditions générales pour l’agriculture suisse Les objectifs définis dans la constitution et les grandes lignes de la réforme selon «Politique agricole 2002» ne changent pas pour autant Un aperçu du document mis en consultation figure à la fin du présent chapitre
128 2 . M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E 2
–
2.1 Production et ventes
Dans le domaine de la production et des ventes, la Confédération fixe les conditionscadre permettant à l’agriculture de produire de manière durable et à un coût raisonnable, et de tirer des recettes aussi élevées que possible de la vente de ses produits
La durabilité de la production est assurée avant tout par les exigences liées à l’octroi des paiements directs Dans le cadre des conditions générales en matière de production et de ventes, elle peut être encouragée par le biais de dispositions relatives à la qualité et à la désignation des produits Celles-là servent cependant en premier lieu à réaliser une forte valeur ajoutée à partir de la production.

■■■■■■■■■■■■■■■■
2 . 1 P R O D U C T I O N E T V E N T E S 129 2
■ Moyens financiers en 2000
Quelque 955 millions de francs ont servi en 2000 à promouvoir la production et les ventes, soit un quart de moins que l’année précédente Ce montant est conforme à la réduction prévue à l’art 187, al 12, LAgr des moyens financiers destinés à la promotion de la production et des ventes. L’importance de cette réduction par rapport à 1999 s ’explique surtout par les dépenses extraordinaires que la liquidation de l’Union suisse du commerce du fromage SA et de la Butyra, organisations semi-étatiques, avait entraînées cette année-là
Dépenses pour la production et les ventes
■ Perspectives
En vertu des décisions budgétaires du Parlement, le domaine de la production et des ventes bénéficie, en 2001, de 30 millions de francs de plus que le montant prévu au plan financier, ce qui permet d’atténuer la réduction des moyens financiers dans l’économie laitière
Les effets des mesures de politique agricole dans les domaines de la production et des ventes sont évalués dans le cadre de divers mandats de recherche L’état actuel des travaux est présenté dans la section 2 1 5 «Examen des mesures»
2 . 1 P R O D U C T I O N E T V E N T E S 2 130
%
de fr % Promotion des ventes 60 6,2 60 6,6 Economie laitière 716 75,0 666 72,7 Production animale 26 2,7 47 5,13 Production végétale 153 16,0 143 15,6 (viticulture comprise) Total 955 100,0 916 100,0
Compte d’Etat
Comptes 2000 Budget 2001 Domaine des dépenses Montant Part Montant Part mio de fr
mio
Source:
■ Demandes de soutien
2.1.1 Instruments de caractère global
Organisations de producteurs et interprofessions
La modification de l’art 9 LAgr, dans le cadre de l’adaptation de notre législation aux accords sectoriels conclus avec l’Union européenne (accords bilatéraux), est entrée en vigueur le 1er janvier 2001 Elle permet désormais à la Confédération d’étendre aux non-membres l’obligation de financer des mesures d’entraide prises par des interprofessions ou des organisations de producteurs Lorsqu’une organisation perçoit des contributions de ses membres pour financer les mesures définies dans la loi, le Conseil fédéral peut étendre l’obligation du versement de ces contributions à l’ensemble des producteurs, des transformateurs et, le cas échéant, des commerçants concernés par le même produit ou groupe de produits
La nouvelle politique agricole demande à l’agriculture d’atteindre une forte valeur ajoutée et de tirer de la vente des produits des recettes aussi élevées que possible (art 7 LAgr) Dans ces circonstances, il est primordial que les efforts de la majorité des exploitations d’une filière ou d’un secteur pour mieux positionner et promouvoir leur produit ne soient pas remis en cause par une minorité d’entreprises qui profitent des mesures collectives sans en supporter les coûts
Suite à la modification de l’art. 9 LAgr, l’OFAG a reçu dix demandes de soutien dans le courant du printemps 2001 Il a examiné la conformité de ces demandes à la législation sur les interprofessions et les organisations de producteurs et a porté un jugement favorable sur la moitié d’entre-elles Les cinq demandes retenues concernent le financement du marketing de base de l’agriculture suisse, la création d’un fonds de soutien pour les produits laitiers, la promotion des œufs suisses, le financement du marketing de l’emmental et le respect de normes de qualité dans la filière du gruyère
Les expériences acquises dans le traitement des différents dossiers ont révélé la nécessité, pour l’OFAG, de renforcer ses efforts de communication et de vulgarisation au niveau des interprofessions et des organisations de producteurs En effet, selon la législation en vigueur, le Conseil fédéral ne peut soutenir qu ’ un nombre limité de mesures dans le domaine de la qualité des produits, de la promotion des ventes et de l’adaptation de l’offre aux exigences du marché Certaines mesures, dont le soutien a été demandé, ne rentraient pas dans ce contexte D’autres demandes ont été déposées par des organisations dont la structure et les activités ne correspondaient pas aux exigences de la législation. Il importe, en effet, qu ’ une interprofession soit organisée autour de familles professionnelles indépendantes à chaque échelon de la filière, de manière à représenter efficacement les divers intérêts en présence Pour les mêmes raisons, la LAgr exige qu ’ une interprofession ou une organisation de producteurs n ’ exerce pas elle-même d’activités dans les secteurs de la production, de la transformation et de la vente, de manière à ne pas créer de conflits entre les intérêts privés des entreprises
Il est primordial, pour l’agriculture suisse, de mettre en place des interprofessions et des organisations de producteurs crédibles et performantes
2 . 1 P R O D U C T I O N E T V E N T E S 2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E 131 2 ■■■■■■■■■■■■■■■■
Tableaux 26/29 pages A27/A30
Promotion des ventes
La vente des produits découle directement de la stratégie de l’entreprise, constat qui vaut aussi pour l’agriculture. Une bonne image de marque, la confiance des consommateurs dans la production et la provenance des denrées alimentaires, ainsi qu ’ une conception optimale des produits et du marché se répercutent favorablement sur les débouchés et les chiffres d’affaires Un concept de marketing judicieux est donc indispensable Gestion des produits, de l’assortiment et de la qualité, formation des prix, distribution et communication sont autant d’instruments qu’il convient d’harmoniser
La promotion des ventes visée à l’art. 12 LAgr ne porte cependant que sur les tâches de communication et, en partie, sur la prospection du marché
Une bonne commercialisation des produits est décisive pour le succès d’une entreprise Pour cela, il faut bien sûr que les produits gagnent la faveur du public L’agriculture suisse a donc tout intérêt à s ’ assurer une préférence maximale des consommateurs pour, par exemple, son fromage, sa viande, ses pommes ou ses carottes L’objectif est au fait d’augmenter la valeur ajoutée réalisée en faveur de l’agriculture. Il faut donc faire connaître les produits suisses sur le marché Ainsi, ils seront bien accueillis et les consommateurs les achèteront Il faut également que l’image de marque de l’agriculture suisse soit bonne. En résumé, le consommateur sait pourquoi il accorde la préférence aux produits agricoles suisses Sont utilisés à cette fin les instruments de la communication marketing tels que la publicité, les campagnes de promotion des ventes, le travail d’information du public, le sponsoring, etc
La Confédération soutient cette communication à titre subsidiaire. Au cours de l’année sous revue, 61 projets de promotion lancés à l’échelon suprarégional, national ou international ont bénéficié de cette aide fédérale; 36 requérants se sont partagé 54 millions de francs disponibles dans ce contexte, tandis que quelque 2,5 millions ont été alloués en faveur de promotions de spécialités régionales; 4,6 millions de francs du fonds viticole ont été affectés à la promotion des ventes de vin à l’étranger
L’initiative doit partir des intéressés, car dans ce système décentralisé, les objectifs sont fixés de manière très individuelle Les campagnes de promotion peuvent ainsi être alignées sur les besoins spécifiques du moment ou être conçues en tant que mesure collective visant à améliorer l’image de l’agriculture Les projets bénéficiant d’un soutien sont évalués à l’aune de l’objectif principal de cette mesure de politique agricole, lequel consiste à assurer la promotion des produits suisses
Sur mandat de l’OFAG, des sondages représentatifs sont du reste effectués parmi les consommateurs Tous les deux ans, des personnes représentant des ménages fournissent des renseignements sur leur attitude face à certains produits et à l’agriculture en général Des relevés réguliers avec les mêmes questions permettent de dégager l’évolution parcourue
2 . 1 P R O D U C T I O N E T V E N T E S 2 132
■ Communication marketing dans l’agriculture
■ Communication marketing: mesure de politique agricole
■ Le poids accordé à la provenance varie selon les produits

Ces derniers temps, la production alimentaire retient plus que jamais l’attention du public Ce sont surtout les produits animaux qui font la une des journaux Rien d’étonnant dès lors que le consommateur attache plus d’importance à leur provenance qu’à celle des produits végétaux, auxquels il est moins sensibilisé. Il ressort des sondages que l’ordre d’importance de la provenance du produit n ’ a pas changé ces deux dernières années Restent en tête les œufs suisses suivis immédiatement du lait et des produits laitiers On ne peut toutefois affirmer avec certitude que le consommateur d’aujourd’hui accorde, au moment de l’achat, davantage d’attention à la provenance des produits Les résultats des deux sondages doivent donc se lire avec une certaine marge d’erreur
Modification des préférences pour les produits suisses
2 . 1 P R O D U C T I O N E T V E N T E S 2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E 133 2
Oeufs 2000 1998 Lait et produits 2000 au lait frais 1998 Viande (sans charcuterie) 2000 1998 Pommes de terre 2000 1998 Miel 2000 1998 Fromage 2000 1998 Légumes 2000 1998 Produits de charcuterie 2000 1998 Fruits 2000 1998 Produits à base 2000 de céréales 1998 Produits à base de 2000 pommes de terre 1998 Huile comestible 2000 1998 Sucre 2000 1998 Vin 2000 1998 Laine 2000 1998 en % Source: DemoScope 1998/2000 020 40 6080100 toujours la plupart du temps de temps en temps rarement jamais aucune réponse
■ Préfère-t-on les produits suisses?
L’évolution des préférences pour les produits suisses est le facteur déterminant de leur succès Les écarts entre les sondages de 1998 et de 2000 sont encore trop faibles pour dégager une tendance nette Il est évident que la cote du fromage suisse est à la hausse. Désormais, quelque 75% des personnes interrogées le choisissent le plus souvent On relèvera toutefois à ce propos que cette préférence est moins marquée chez les Romands, qui apprécient aussi les fromages français
■ Ce que pensent de l’agriculture suisse les personnes représentant les ménages
Les sondages périodiques effectués auprès des consommateurs montrent aussi l’évolution de l’image de l’agriculture suisse au sein de la population Quelque 90% des personnes consultées estiment aujourd’hui qu ’elle est digne de confiance De même, les avis sont favorables pour ce qui est du professionnalisme et de la proximité du consommateur Plus de 80% ont répondu par «oui» ou «plutôt oui» aux critères «adaptée à notre époque» et «respectueuse de l’environnement» La compétitivité recueille par contre de moins bonnes notes: moins de 60% des personnes interrogées considèrent l’agriculture suisse comme compétitive
Ce que pensent de l’agriculture les personnes à la tête d'un ménage
■ Perspectives
compétitive e n
respectueuse de l'environnement
adaptée à notre époque % Source: DemoScope
Les frontières s ’ouvrent progressivement, ce qui accroît la pression concurrentielle sur le marché suisse En contrepartie, l’accord bilatéral avec l’UE assurera prochainement un accès plus facile au marché européen pour certains produits suisses Un positionnement clair de l’agriculture suisse et de sa production est donc nécessaire Les événements liés à la crise de l’ESB dans les pays voisins montrent par ailleurs que seule une communication soutenue avec les consommateurs permet d’éviter un effondrement du marché, aussi dans les pays qui ne sont pas directement touchés En outre, la communication marketing agricole devra se focaliser sur une poignée de messages clés A cette fin, l’agriculture doit prendre conscience de ses forces (proximité, fraîcheur, qualité, etc ) Elle devra présenter une image plus homogène et, pour ce faire, réunir ses forces et ses moyens Dans le domaine de la promotion des ventes, la Confédération intensifiera ses efforts pour répondre à cet objectif et à la nouvelle donne
digne de confiance professionnelle proche du consommateur
2000
10 0 100 90 80 70 60 50 40 30 20 2 . 1 P R O D U C T I O N E T V E N T E S 2 134
oui plutôt oui plutôt non non ne sait pas
■ Production biologique: intégration de la garde d’animaux
Promotion de la qualité
L’intégration de la garde d’animaux dans l’ordonnance sur l’agriculture biologique prémunit les consommateurs contre les tromperies et protège les producteurs; d’où une plus grande sécurité sur le marché biologique Pour le commerce, il importe que les adaptations soient compatibles avec les réglementations de l’UE
La révision porte tant sur l’ordonnance du Conseil fédéral, qui contient les principales dispositions de fond relatives à l’agriculture biologique, que sur l’ordonnance du DFE, qui règle certaines modalités techniques en vertu des délégations de compétence arrêtées par le Conseil fédéral
Dans la mesure du possible, les ordonnances en vigueur ont été intégrées et reprises, ce qui permet d’éviter aux producteurs une surenchère de réglementations et d’assurer une structure claire des dispositions. Les exigences en matière de protection des animaux, de SRPA, de SST et d’agriculture biologique ont été coordonnées dans un système modulaire Voici les principales exigences requises pour la garde d’animaux en agriculture biologique: sorties régulières en plein air; alimentation à base d’aliments biologiques, conforme aux besoins de l’espèce; restrictions sévères quant à l’administration de médicaments. Tant les animaux que les aliments qu’ils consomment doivent en principe être issus de la production biologique Mais comme il n ’est pas encore possible d’appliquer ce système intégralement, des exceptions et des dispositions transitoires sont prévues.
La désignation rigoureuse des denrées biologiques issues de la garde d’animaux de rente, donc de la viande, du lait et des œufs ainsi que de tous les produits dérivés, permet de les positionner clairement et d’accroître ainsi leur acceptation par les consommateurs et d’élargir le marché.
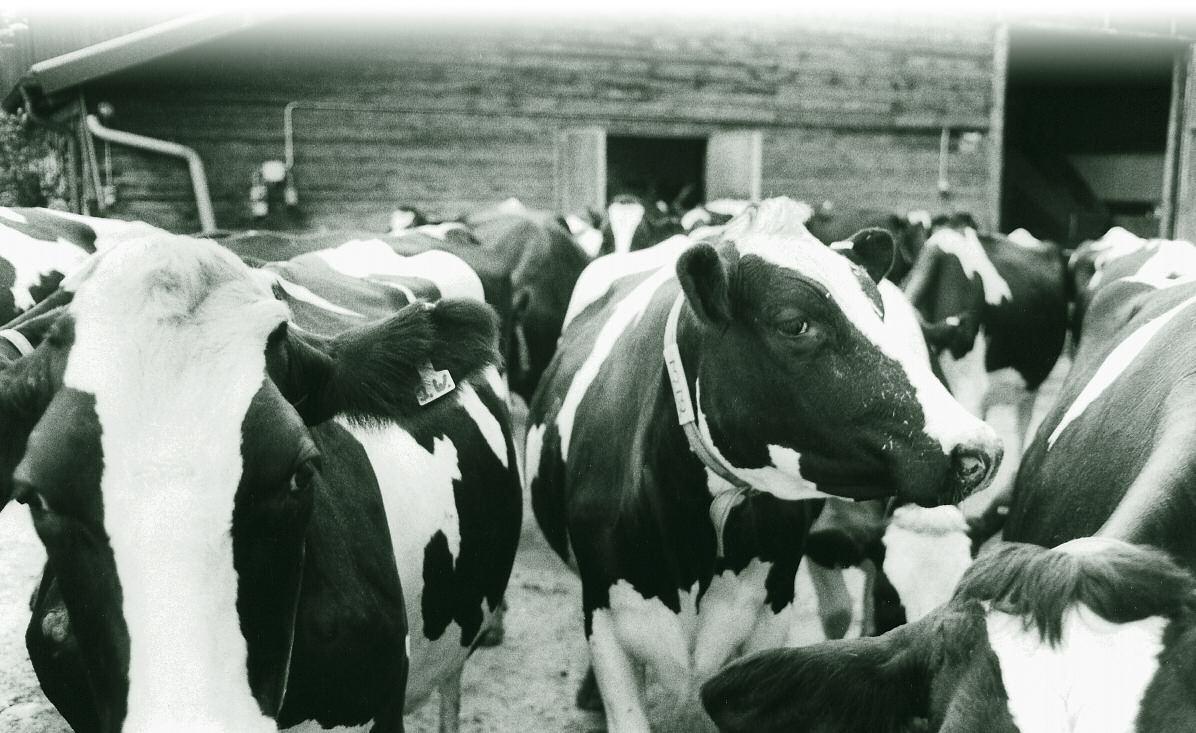
2 . 1 P R O D U C T I O N E T V E N T E S 135 2
■ Ordonnance sur les denrées alimentaires: indication du pays de production
Données concernant les denrées alimentaires
La loi sur les denrées alimentaires (LDAl) vise à protéger les consommateurs contre les denrées alimentaires et les objets usuels pouvant mettre la santé en danger et contre les tromperies relatives aux denrées alimentaires (art 1 LDAl) Quant à la désignation des denrées alimentaires, l’art 21, al 1, LDAl habilite le Conseil fédéral à exiger des indications propres à protéger la santé ou à empêcher la tromperie, ainsi que d’autres données répondant aux besoins légitimes du consommateur en matière d’information De telles prescriptions étant une entrave au principe de la liberté économique consacré à l’art 27 de la constitution fédérale (cst ), elles doivent non seulement reposer sur une base légale, mais encore être justifiées par un intérêt public prépondérant et, surtout, être conformes au principe de la proportionnalité (art. 36 cst.).
Les dispositions suisses relatives à l’indication du pays de production de denrées alimentaires sont déjà strictes Pour les denrées préemballées, une indication écrite est en principe obligatoire, alors que pour les produits non emballés, elle est impérative lorsqu’elle est exigée dans une ordonnance du Département fédéral de l’intérieur (DFI) En ce qui concerne la viande et les produits carnés, la déclaration écrite du pays de production est requise pour les denrées préemballées et les ventes en vrac ainsi que dans les établissements tels que cafés-restaurants, hôpitaux et établissements à restauration collective
■ Ordonnance sur l’indication de la provenance des matières de base: indication de la matière de base principale
La réglementation selon laquelle un traitement et une transformation suffisants permettent de qualifier une denrée de «produite en Suisse» est conforme au régime international des indications de la provenance Cela peut toutefois prêter à confusion chez le consommateur, qui établit tout naturellement un lien avec la production agricole ou la production de la matière de base L’ordonnance sur l’indication de la provenance des matières de base, entrée en vigueur le 1er avril 2000, vise précisément à éviter ce genre d’erreur. Une consultation des milieux concernés montre qu’il est ardu d’édicter un règlement qui satisfasse les besoins d’information du consommateur, offre une protection contre les tromperies, tienne compte du droit international et de la législation des principaux partenaires commerciaux et qui, de surcroît, puisse être appliqué conformément au principe de la proportionnalité C’est la raison pour laquelle la réglementation en vigueur exige non pas l’indication du pays de production de toutes les matières de base, mais uniquement de la principale d’entre elles Cela permet pour le moins d’éviter les cas de tromperie les plus scandaleux En vertu des dispositions transitoires, les denrées alimentaires peuvent être désignées selon la législation actuelle jusqu’au 31 décembre 2000 et être vendues sous cette forme pendant deux ans encore (jusqu’au 31 décembre 2002) Ainsi, pour le kirsch de Zoug, fabriqué depuis le 1er janvier 2001 à partir de plus de 50% de cerises hongroises, on devra signaler cette provenance Il en est de même pour la viande des Grisons, les palettes, le jambon roulé, le jambon cru et autres denrées désignées comme étant produites en Suisse, si la matière de base principale ne provient pas de notre pays

2 . 1 P R O D U C T I O N E T V E N T E S 2 136
La Suisse interdit, dans l’alimentation des animaux, l’utilisation des hormones, des antibiotiques ou autres stimulateurs de performance antimicrobiens, tout comme l’élevage des poules pondeuses en batteries Le Conseil fédéral a mis en vigueur l’ordonnance agricole sur la déclaration (OAgrD) au 1er janvier 2000 afin de régler la déclaration de la viande fraîche importée et des œufs de consommation issus de ces modes de production interdits en Suisse Pour en faciliter l’exécution, l’OFAG a publié sur Internet une fiche d’information concernant l’OAgrD et une liste des pays ayant édicté des interdictions équivalentes, que vous trouverez à l’adresse suivante: (http://www blw admin ch/themen/aw/deklarat/f/index htm)
Cette déclaration n ’est pas exigée si le pays de livraison a adopté une interdiction légale équivalente ou si le vendeur peut prouver d’une manière crédible que le produit n ’est pas issu d’un mode de production interdit L’OFAG s ’est procuré les législations des principaux pays fournisseurs pour en vérifier l’équivalence avec le droit suisse La liste citée plus haut indique les résultats de cette comparaison. Quant à la preuve à fournir par le vendeur final, un spécimen est donné à l’annexe de la fiche d’information
Les services officiels chargés du contrôle des denrées alimentaires ont intensifié leur activité sur le plan de l’exécution après avoir clarifié certains points. Les dispositions pertinentes ont suscité un regain d’intérêt dans le public à l’occasion des nouveaux débats portant sur l’ESB Ce sont les preuves à fournir pour la viande importée qui posent le plus de problèmes: L’observation des valeurs résiduelles maximales autorisées pour les stimulateurs de performance dans la viande (programme d’évaluation dans les abattoirs) ou des délais minimaux d’utilisation à respecter avant l’abattage ne libère pas de l’obligation de les déclarer La preuve, crédible, doit se référer uniquement au processus de production entre la naissance et l’abattage des animaux C’est ici que l’on exige des directives de production interdisant explicitement le recours aux stimulateurs de performances, avec certification du respect de l’interdiction par des instances indépendantes (autorité ou organisation accréditée) Les preuves peuvent être déposées de manière centralisée auprès des importateurs, la traçabilité devant toutefois être assurée par les vendeurs finaux
Comme la Suisse interdit d’autres modes de production, il convient d’examiner une extension du champ d’application de l’OAgrD Tel est notamment le cas pour la viande de porc et de volaille provenant d’animaux nourris à la farine animale ou pour le lait, les produits laitiers et les œufs provenant de vaches et de poules ayant consommé des stimulateurs de performance antimicrobiens En matière de protection des animaux, certaines normes suisses sont sensiblement plus rigoureuses qu’à l’étranger, de sorte que là encore, les déclarations doivent faire l’objet d’un examen minutieux
2 . 1 P R O D U C T I O N E T V E N T E S 2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E 137 2
■ Ordonnance agricole sur la déclaration: déclaration des modes de production interdits en Suisse
Viande de porc française vendue au détail dans les boucheries: le pays de production «France» doit être indiqué par écrit dans la vitrine de vente Il convient d’y ajouter «peut avoir été produit avec des antibiotiques et/ou autres stimulateurs de performance antimicrobiens». Cette indication n ’est pas nécessaire s’il peut être prouvé de manière crédible que ces substances n ’ont pas été utilisées
US-Beef (viande de bœuf) au restaurant: le pays de production (USA) doit être indiqué par écrit sous une forme adéquate (menu ou pancarte) On indiquera par ailleurs: «peut avoir été produit avec des hormones comme stimulateurs de performance» et/ou «peut avoir été produit avec des antibiotiques et/ou d’autres stimulateurs de performance antimicrobiens» Ces indications ne sont pas nécessaires s’il peut être prouvé de manière crédible que ces substances n ’ont pas été utilisées.
Jambon roulé préemballé vendu au détail, fabriqué en Suisse avec de la viande de porc autrichienne: l’emballage doit porter l’indication du pays de production «Suisse» et préciser impérativement la provenance autrichienne de la matière de base
Oeufs de consommation allemands vendus au détail: le pays de production «Allemagne» doit figurer non seulement sur l’emballage mais aussi sur chaque œuf L’abréviation usuelle (D) peut également être utilisée. Si les œufs proviennent d’un élevage en batterie, l’emballage devra le mentionner et préciser que «ce mode de production est interdit en Suisse»

138 2 . 1 P R O D U C T I O N E T V E N T E S 2
■ Exemples de déclaration: pays de production et modes de production interdits
■ Les réglementations d’importation soutiennent une agriculture productive
Instruments du commerce extérieur
Conformément aux dispositions GATT/OMC, la régulation des importations ne peut se faire que par des mesures tarifaires, c ’est-à-dire par le prélèvement de droits de douane sur les produits importés En revanche, il est possible de diviser, à l’intérieur de ce que l’on appelle les contingents tarifaires, les quantités importées en deux parts, soumises à des droits de douane plus élevés et plus faibles respectivement Cela permet d’importer à des prix parfois très proches du niveau des prix étrangers Les parts en question sont donc très recherchées Il existe des contingents tarifaires notamment pour la viande, les produits laitiers, les pommes de terre, les fruits, les légumes, le blé panifiable et le vin
Les quantités contingentaires sont réparties selon divers procédés: par mise aux enchères, en fonction des achats de produits suisses, proportionnellement aux importations effectuées précédemment ou dans l’ordre d’arrivée des demandes auprès de l’autorité qui délivre les permis Les quantités libérées et celles qui ont effectivement été importées au taux du contingent (TC) sont publiées dans le Rapport annuel du Conseil fédéral concernant les mesures tarifaires L’utilisation des parts de contingent varie selon les produits
Les importations de certains produits, p ex celles d’aliments pour animaux, sont gérées uniquement par les droits de douane Ces derniers sont fixés compte tenu de l’approvisionnement en Suisse et des débouchés existants pour des produits similaires, de même que de l’intérêt général de l’agriculture Ils sont adaptés périodiquement à l’évolution des prix franco frontière suisse selon le système des prix-seuils
La protection à la frontière ne comporte pas seulement un aspect quantitatif mais aussi un aspect qualitatif, car elle sert à garantir que les marchandises importées ne présentent pas de risques pour la santé (sécurité des aliments)
2 . 1 P R O D U C T I O N E T V E N T E S 2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E 139 2
Evolution du prix-seuil de l'orge Janv. 96 Avril 96 Juill 96 Oct 96 Janv. 97 Avril 97 Juill 97 Oct 97 Janv. 98 Avril 98 Juill 98 Oct 98 Janv. 99 Avril 99 Juill 99 Oct 99 Janv. 00 Avril 00 Juill 00 Oct 00 f r / d t Source: OFAG 0 80 70 60 50 40 30 20 10 Prélèvements à la frontière Limite Prix-seuil Prix à l'importation dédouané Prix franco frontière suisse
■ Utilisation de contingents tarifaires
Les critères d’attribution déterminent dans une certaine mesure le degré d’utilisation des contingents Ceux qui sont mis aux enchères sont généralement épuisés, à condition que la demande dans le pays soit suffisante Par contre, lorsque les critères d'attribution ont une composante historique (p.ex. importations antérieures) ou que les contingents sont attribués sur demande, les parts ne sont parfois pas entièrement ou que peu utilisées La disponibilité et le prix des produits à l’étranger, ainsi que la demande dans le pays, jouent également un rôle
Enfin, la durée du droit d’importer (période contingentaire) influe elle aussi sur le degré d’utilisation des contingents Dans le cas des fruits et des légumes, il n ’est pas rare que les importations de certains produits représentent moins de la moitié des quantités libérées. Le grand nombre d’importateurs et le fractionnement correspondant des droits d’importer accentuent encore ce phénomène Il arrive en outre que les branches demandent la libération de gros volumes pour garantir que les importateurs puissent entièrement mettre à profit ces droits.
1 Les importations supplémentaires sont considérées comme dépassement du contingent

2 Y compris les attributions aux nouveaux importateurs
Le degré le plus bas (25%) a été enregistré pour les contingents supplémentaires de fleurs coupées attribués selon les prestations annoncées en faveur de la production suisse Ce chiffre est toutefois relativisé par le degré d’utilisation élevé du contingent de base, qui est attribué d’après les importations effectuées l’année précédente.
2 . 1 P R O D U C T I O N E T V E N T E S 2 140
Utilisation de quantités libérées
Produit Mode d’attribution Quantité Quantité attribuée importée en t brut en t brut Charcuterie, total Mise aux enchères 3 136 2 913 Charcuterie, Allemagne Mise aux enchères 1 103 110 Charcuterie, France Mise aux enchères 125 94 Charcuterie, Hongrie Mise aux enchères 52 24 Charcuterie, Italie Mise aux enchères 2 856 2 685 Salade iceberg Importations de 121 725 l’année précédente 1 Choux-fleurs Importations de 917 413 l’année précédente Tomates Part de marché de 4 118 2 971 l’année précédente Pommes de table Part de marché de 4 768 3 871 l’année précédente Fraises Importations de 2 365 815 l’année précédente Fleurs coupées, total Mixte 16 156 7 409 Fleurs coupées Importations de 4 707 4 590 l’année précédente 2 Fleurs coupées Prestation en faveur de 11 449 2 819 la production suisse
en 2000
Source:
OFAG
■ Transfert de parts de contingents: instrument très apprécié
Utilisation de parties de contingent tarifaire attribuées selon différents critères, en 2000
Charcuterie, total, E Charcuterie, Italie, E
Charcuterie, Hongrie, E Salade iceberg, IP Choux-fleurs, IP
Tomates, rondes, PM
Pommes de table, PM
Fraises, IP
Fleurs coupées, total
Fleurs coupées, PPS
Fleurs coupées, IP
Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance sur les importations agricoles, le 1er janvier 1999, il est possible de transférer des parts de contingent tarifaire Selon l’art 14 de cette ordonnance, le détenteur d’une part de contingent tarifaire peut en effet convenir avec d’autres ayants droit que leurs importations soient imputées à sa part de contingent Cette disposition permet de répartir les droits d'importer selon les besoins Elle donne par ailleurs aux importateurs sans part de contingent (p ex nouveaux importateurs) la possibilité de bénéficier néanmoins du TC. Les importateurs ont très souvent recours à ce nouvel instrument, notamment dans les domaines où le système prévoit des libérations fréquentes et où les détenteurs de parts de contingents sont nombreux, tels que les fruits, les légumes et les fleurs coupées Ils parviennent ainsi à simplifier la procédure aux plans logistique (transports collectifs) et administratif Au contraire, les transferts sont plus rares lorsque les parts de contingents sont attribuées par une mise aux enchères ou sur demande, comme c ’est le cas des légumes destinés à la transformation
Il existe deux types de conventions en ce qui concerne les fruits et les légumes:
– le détenteur de la part de contingent tarifaire cède entièrement ou partiellement les parts qui lui ont été attribuées pour un an, avant que les parties de contingent correspondantes soient libérées (solution choisie surtout lorsque les parts de contingents sont réparties en fonction des parts de marché);
le détenteur cède une certaine quantité lors de la libération d'une partie de contingent
2 . 1 P R O D U C T I O N E T V E N T E S 2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E 141 2
–
en %
Mode d'attribution: E: enchères IP: importation année précédente.; PM: part de marché; PPS: prestations en faveur de la production CH 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Utilisation Attribution
Source: OFAG
Cessions de parts de contingent tarifaire en 2000

Une conférence de l’ONU sur le commerce et le développement a eu lieu à Bruxelles en mai 2001 Son objectif était d’aider les 49 pays en développement les moins avancés (PMA) à accélérer leur intégration à l’économie mondiale. La Suisse a accepté de fournir une aide substantielle D’autres mesures mises à part, il s ’agit d’accorder auxdits pays des préférences tarifaires supplémentaires leur facilitant l’accès aux marchés des pays industrialisés.
Il y a longtemps que la Suisse ne perçoit plus de droits de douane sur les produits industriels provenant des PMA En ce qui concerne les produits agricoles, cette exemption n ’est concédée que dans certains cas (p ex fruits tropicaux) Dorénavant, les PMA devraient bénéficier de nouveaux avantages considérables. Une première phase, qui selon la décision du Conseil fédéral du 27 juin 2001 devrait débuter le 1er janvier 2002, consistera à concéder, pour les produits agricoles, des droits de douane préférentiels qui seront, en moyenne, de 30% inférieurs au tarif normal en vigueur.
Concessions supplémentaires dans le domaine agricole en faveur des pays en développement les moins avancés
Groupe de produits Réduction du tarif (selon les chapitres 1 à 24 du tarif des douanes) normal en %
Animaux, viande (y compris préparations), œufs, aliments pour animaux, céréales, oléagineux, huiles et graisses végétales
Lait et produits laitiers -30
Plantes, fleurs coupées, légumes, fruits, huiles animales, sucre, produits transformés -50
2 . 1 P R O D U C T I O N E T V E N T E S 2 142
-10
Source: OFAG
Fleurs coupées Charcuterie Salade iceberg Choufleur Tomates Pommes de table Fraises e n t b r u t N o m b r e Parts annuelles calculées en t Quantités cédées Nombre de conventions Source: OFAG 0 2 500 450 421 37 52 26 174 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2 000 1 500 1 000 500 45 150 ■
Droits de douane préférentiels pour les pays en développement les moins avancés
(«Schoggigesetz»)
Il existe d’ores et déjà un régime douanier préférentiel pour les pays en développement Dans les cas où les concessions actuelles sont plus importantes que celles prévues dans les conventions conclues en faveur des pays PMA, les premières restent applicables. Ainsi, la concession en vigueur pour tous les pays en développement s'élève à 22 fr /100 kg de sucre, tandis que celle de 50% prévue pour les PMA n'équivaut qu'à une réduction de 20 fr /100 kg
D’après le calendrier approuvé par le Conseil fédéral, une réduction supplémentaire des droits de douane est prévue en 2004 pour les PMA Une demande de prorogation de la décision concernant le régime douanier préférentiel devra être soumise au Parlement au plus tard le 1er mars 2007 Il conviendra de déterminer sur la base des expériences acquises d’ici à 2005 à quelle date l’objectif des droits zéro pourra être atteint pour toutes les importations provenant des PMA
Il importe que ces concessions bénéficient effectivement aux pays en développement les plus pauvres A cet effet, il faut empêcher les resquilleurs potentiels d’en profiter et lutter efficacement contre les opérations élusives C’est pourquoi, il est prévu de contrôler les flux de marchandises provenant des pays bénéficiaires à l’aune de leur potentiel de production Lorsque, par exemple, un pays n ’ayant jamais exporté de roses auparavant se met subitement à en exporter, on présume une opération élusive. S’il résulte de la vérification que le droit de douane préférentiel a été accordé à tort, on demande le versement du taux normal Le traitement préférentiel peut par ailleurs être suspendu pour les pays ne collaborant pas suffisamment dans le domaine des certificats d’origine
Cependant, il faut aussi protéger l’agriculture suisse d’un afflux de produits excédant la demande dans le pays et risquant donc de perturber le marché intérieur Dans ces cas, le chef du DFE a la possibilité de suspendre le traitement préférentiel des PMA pour un certain temps
En accordant des contributions à l’exportation pour un total de 112,1 millions de francs, la Suisse est restée légèrement au-dessous du plafond de 114,9 millions fixé par l’OMC Elle y est surtout parvenue parce que le beurre et le blé dur utilisés pour la fabrication de produits d’exportation ont été importés et réexportés dans le cadre du trafic de perfectionnement, ce qui a permis d’économiser quelque 21 millions de francs de contributions à l’exportation (env 15 mio pour le beurre et env 6 mio pour le blé dur) Le blé dur n ’est pas cultivé en Suisse pour des raisons climatiques Quant au beurre, il a fallu en importer pour satisfaire la demande dans le pays. La quantité totale de matières premières exportées sous la forme de produits transformés a passé de 83'500 t en 1999 à 88'800 t en l’an 2000, ce qui correspond à une augmentation de quelque 6%.
2 . 1 P R O D U C T I O N E T V E N T E S 2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E 2 143
■ Importation et exportation de produits transformés
La plupart des réglementations d’importation ne subiront probablement pas de changements fondamentaux dans un proche avenir Le groupe de travail «marchés» institué par la Commission consultative agricole a réexaminé les critères applicables à l’attribution des contingents tarifaires pour quelques organisations de marché. Plusieurs adaptations découlant de cet examen pourraient être mises en œuvre dès le 1er janvier 2002
En ce qui concerne la réglementation d’importation de vin blanc, on est passé, le 1er janvier 2001, du système de la mise aux enchères à l’attribution dans l'ordre des dédouanements (fur et à mesure à la frontière) Les premières expériences acquises avec cette méthode de gestion déjà utilisée pour le vin rouge sont conformes aux attentes. Toutefois, la chute des prix à l’étranger fausse l’image. Nous procéderons à une évaluation détaillée pour le prochain Rapport agricole Depuis le deuxième semestre 2001, le contingent tarifaire de blé panifiable est réparti non plus selon le système de la contrepartie, mais par adjudication.
Quant aux engagements pris dans le cadre de l’accord agricole bilatéral conclu avec l’UE sous la forme de contingents tarifaires, on envisage une répartition dans l’ordre des dédouanements sauf pour le fromage, la viande et les plants d’arbres fruitiers Les contingents de fromage et de viande devraient être attribués par mise aux enchères, celui des plants d’arbres fruitiers selon l'ordre de réception des demandes de permis (procédure du fur et à mesure auprès de l’autorité délivrant les permis)

2 . 1 P R O D U C T I O N E T V E N T E S 2 144
Perspectives
exportées 1991/921998 19992000 e n t Source: OFAG 94 000 92 000 90 000 88 000 86 000 84 000 82 000 80 000 92 000 85 000 84 000 89 000 Contributions à l'exportation 1991/921998 19992000 m i o . d e f r . Source: OFAG 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 180 137 130 112
■
Quantités
■ Activité de contrôle pendant l’année considérée
Contrôles, révisions et enquêtes
En 2000, la section Inspectorat, unité indépendante de l’OFAG, a effectué des contrôles non seulement en ce qui concerne les mesures liées à des produits spécifiques, mais aussi dans les domaines aliments pour animaux, produits phytosanitaires et élevage Elle ne donne pas de préavis, sauf si elle entend procéder aussi à une révision financière, mais alors le délai est très bref Un préavis s’impose dans ces cas, car les dossiers sont très souvent conservés auprès d’une fiduciaire Toutes les révisions purement financières sont donc annoncées Selon la taille de l’entreprise et le montant des moyens financiers alloués par la Confédération, elles peuvent durer plusieurs jours Les révisions de grande ampleur sont toujours effectuées conjointement par deux inspecteurs.
Pendant l’année considérée, l’inspectorat a procédé à 1'767 contrôles et révisions dont 12 révisions purement financières Les principaux domaines étaient les suivants:
céréales, 226 contrôles et 5 révisions financières;
– sucre, 1 révision financière;
– pommes de terre, 246 contrôles et 2 révisions financières;
– légumes, fruits et fleurs coupées, 97 contrôles et 1 révision financière;
– lait et produits laitiers, 1'147 contrôles et révisions financières;
– viande et œufs, 39 contrôles et 2 révisions financières;
– matières premières renouvelables, 1 contrôle
■ Infractions
L’inspectorat procède aux contrôles, révisions financières et enquêtes sur mandat des sections concernées. Selon les résultats, les dossiers sont transmis pour traitement:
– aux sections ayant donné le mandat pour qu ’elles prennent des mesures administratives et/ou
– à la section Droit et procédures, lorsqu’il s ’agit d’apprécier des éléments constitutifs d’une infraction
Durant l’année sous revue, l’inspectorat a réglé sur place, en vertu de la loi fédérale sur la procédure pénale, 30 cas concernant les contingents laitiers par procédure simplifiée Les inspecteurs sont en effet habilités à conclure eux-mêmes certains cas impliquant une amende maximale de 500 francs en décernant un «mandat de répression par procédure simplifiée»; dans ces cas, il n ’ y a plus de voie de droit une fois que le mandat est signé Les autres cas pénaux sont transmis à la section Droit et procédures La préparation et la réalisation de l’enquête, l’interrogation des personnes concernées et la constitution des dossiers peuvent occuper un ou plusieurs inspecteurs pendant des jours, voire des semaines
2 . 1 P R O D U C T I O N E T V E N T E S 2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E 145 2
–
2.1.2
Economie laitière
Les conditions-cadre mises en place suite à la réorganisation du marché laitier et destinées à permettre l’écoulement d’une quantité maximale de lait et de produits laitiers sur les marchés intérieurs et extérieurs, n ’ont pas changé dans l’exercice 2000 Les mesures de soutien du marché sont conçues de telle sorte que les forces vives du marché puissent s ’exprimer au mieux sur les plans de la production, de la transformation et du commerce Mesures
Le contingentement laitier contribue encore à créer des conditions prévisibles sur le marché laitier Les mesures de soutien répondent principalement aux impératifs du marché du fromage, comme auparavant.
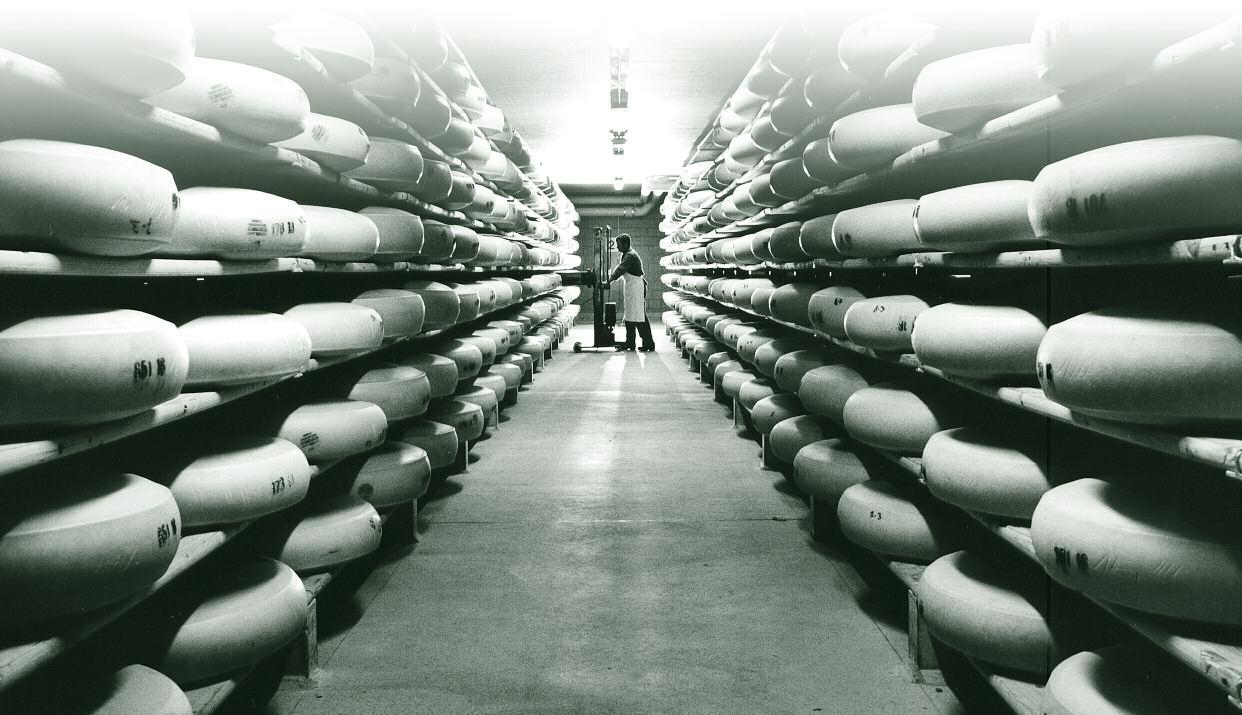
■■■■■■■■■■■■■■■■
Produit Fromage Beurre Lait écrémé Lait en poudre Lait de consommation Crème, produits à base de lait frais Mesure Protection douanière ■■■■■ Suppléments ■ Aides accordées dans le pays ■ 1 ■ 2 ■ 2 ■ 3 Aides à l’exportation ■ 4 ■■ 5 1 certains fromages seulement 2 utilisations particulières seulement 3 transformation en Suisse seulement 4 différenciées selon la sorte de fromage et la destination (UE/autres pays) 5 lait de consommation exclu Source: OFAG
2000/2001
2 . 1 P R O D U C T I O N E T V E N T E S 2 146
■ Moyens financiers en 2000
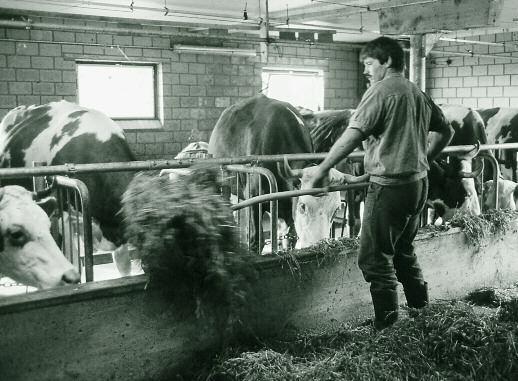
Le Compte d’Etat 2000 présente notamment les dépenses correspondant à la nouvelle organisation du marché laitier Les parallèles avec l’année précédente (ancienne organisation du marché) sont difficiles à mettre en évidence Toutefois, les dépenses de la Confédération en faveur de l’économie laitière ont diminué en 2000 par rapport à l’année précédente Plus aucune mesure transitoire de durée limitée et aucuns frais de liquidation n ’ont en particulier dû être financés dans l’année sous revue
Répartition des fonds en 2000
Source: OFAG
Les dépenses de la Confédération dans le domaine laitier se sont élevées au total à 716,1 millions de francs. Près de la moitié de ce montant a été dépensé sous forme de suppléments Il ressort de la répartition par produits que 517,5 millions de francs (72%) sont revenus au seul secteur du fromage Le beurre a bénéficié de 108,5 millions de francs (15%), contre 82,7 millions (12%) pour la fabrication de lait en poudre Les charges administratives se sont montées à 7,4 millions de francs (1%) Les dépenses liées aux suppléments ont augmenté: le montant du supplément versé depuis le 1er mai 2000 pour le lait transformé en fromage est passé de 12 à 20 ct /kg de lait transformé
Dans l’enveloppe financière 2000 à 2003, une réduction de 80 millions de francs avait été prévue pour 2001 Un déplacement budgétaire dans l’enveloppe financière «promotion de la production et des ventes» de quelque 30 millions de francs entraînera une réduction plus faible des mesures destinées à soutenir le prix du lait
Aides accordées dans le pays 27%
Total 716,1 mio de fr
Aides à l’ exportation 26%
Adminis
2 . 1 P R O D U C T I O N E T V E N T E S 2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E 147 2
Suppléments 46%
tration 1% Tableau 27, page A28
Contingentement laitier
Les données concernant le contingentement laitier 1999/2000 offrent un aperçu des conditions structurelles dans la production laitière. Elles indiquent, par exemple, que le nombre de producteurs a reculé de 50’334 dans l’année laitière 1990/91 à 39’890 en 1999/2000 Pendant cette même période, le contingent moyen d’une exploitation est passé de 58’861 kg à 75’698 kg, ce qui équivaut à une progression annuelle moyenne de 2,8%
Commerce des contingents
1 données définitives
2 données provisoires Source: OFAG

L’interdiction de transférer des contingents de la montagne à la plaine a eu l’effet escompté Les producteurs de montagne ont acheté environ 3’560 t de plus qu’ils n ’ en ont vendu et pris quelque 2’240 t de plus en location qu’ils n ’ en ont cédé A l’inverse, 4’100 t sont revenues à la région de plaine, les agriculteurs de montagne assurant en échange l’élevage des animaux La montagne a donc gagné quelque 1’700 t de contingents supplémentaires Une redistribution s ’est en revanche opérée à l’intérieur de la région de montagne. Elle a touché avant tout les régions relevant de la compétence des fédérations laitières du Tessin et du Valais
Le nouveau système de décompte des contingents a passé l’épreuve du feu La possibilité de reporter un maximum de 5’000 kg à l’année suivante a considérablement réduit le montant des taxes à verser par les producteurs pour dépassement du contingent Ce montant atteint encore près de 700’000 francs pour l’année laitière 1999/2000 et 243’835 francs pour l’exercice 2000/2001
Les producteurs qui ont dépassé leur contingent dans l’année laitière 1999/2000 ont dû compenser environ 1'800 kg en 2000/2001 A l’opposé, ceux qui ne l’ont pas épuisé pourront livrer environ 2'700 kg de plus.
2 . 1 P R O D U C T I O N E T V E N T E S 2 148
Unité 1999/2000
Vente décisions nombre 2 207 quantité totale de lait mio. de kg 62,9 par transfert kg
Location décisions nombre 9 768 quantité totale de lait mio de kg 302,3 par transfert kg 30
1 2000/2001 2
28 508
950
■ Le commerce des contingents laitiers est intéressant
■ Contingents laitiers augmentés de 3%
Une quantité supplémentaire de quelque 90’000 t peut être produite dans l’année laitière 2001/2002 La situation favorable sur les marchés des produits laitiers persistant, transformateurs et producteurs de lait ont estimé qu ’ une adaptation de la quantité totale était acceptable; ils ont donc déposé la demande d’augmentation en mai 2001 Une modification apportée à l’ordonnance sur le contingentement laitier offre aux producteurs une quantité supplémentaire de 3% du contingent qui leur a été attribué au début de l’année laitière 2000/2001
■ Modifications concernant les contingents supplémentaires
Depuis la mise en place du contingentement laitier, un contingent supplémentaire de 1’500 kg est attribué par animal acheté en région de montagne Cette mesure encourage, aussi dans le nouveau contexte de la politique agricole, la répartition des tâches entre la montagne et la plaine Les années passées, cette mesure a permis d’écouler par ce biais quelque 17’000 animaux par an vers les régions de plaine
Vu l’augmentation du nombre de contrats d’élevage conclus entre les producteurs de montagne et ceux de la plaine dans le cadre de la répartition du travail entre ces deux régions, la période d’achat a été étendue à toute l’année dès le 1er mai 2001
Selon l’ancien droit, les producteurs qui se voyaient attribuer un contingent supplémentaire devaient garder les animaux provenant de la région de montagne dans leur exploitation au moins jusqu’au 15 avril de l’année suivant l’achat L’extension de la période d’achat à l’année civile entière requiert une adaptation de la durée de détention, d’où le nouveau délai de garde de six mois après l’achat Ces modifications sont entrées en vigueur le 1er mai 2001
Les contingents supplémentaires ont eux aussi été relevés au 1er mai Le producteur qui s ’est rendu acquéreur de bétail en provenance de la région de montagne dans le courant de l’année se voit désormais attribuer une quantité de 2’000 kg au lieu de 1’500 kg pour l’année laitière 2002/2003
■ Perspectives
Pour l’année laitière 2000/2001, les sur-livraisons dépassant 5’000 kg ont pu être reportées sans taxe à l’année suivante Cette mesure a atténué la pression poussant les producteurs de lait à vendre des vaches; il est ainsi tenu compte de la situation particulière liée à l’ESB
Les quantités reportées devront être compensées dans l’année laitière 2001/2002 Grâce aux contingents supplémentaires, la production peut se maintenir au même niveau qu ’ en 2000/2001
2 . 1 P R O D U C T I O N E T V E N T E S 2 L E S M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E 149 2
■ www.milchstatistik.ch
Soutien du marché à l’aide de suppléments et d’aides
Deux ans après l’introduction des nouvelles conditions-cadre, on constate que l’organisation du marché laitier a fait ses preuves. Le prix-cible de 77 ct. par kg de lait a été dépassé dans l’ensemble La mise en application fonctionne bien: les décomptes des suppléments et des aides sont établis dans les délais et les montants versés de même Le système du dépôt des demandes est généralement bien accepté par les utilisateurs de lait et les producteurs
Un système d’information sur le lait disponible sur Internet a été élaboré dans le cadre du projet informatique «aides accordées dans le domaine du lait». Il livre des données sur la transformation du lait et sur les suppléments et aides versés
De nouvelles dispositions légales régissent l’administration et le versement des suppléments et aides pour les produits laitiers dans la nouvelle organisation du marché Quiconque souhaite bénéficier des suppléments et des aides doit déposer une requête auprès de la Fiduciaire de l’économie laitière (TSM) Sous la surveillance de l’OFAG et conformément aux règles régissant la protection des données, TSM relève et traite tous les mois les données du système d’information sur le lait à partir des demandes des utilisateurs de lait et des bénéficiaires des suppléments et des aides
Depuis le 1er mai 1999, les données fournies dans les demandes sont saisies sur support électronique Elles sont ensuite disponibles dans la base de données et peuvent servir au système d’information sur le lait Une partie des informations concerne les données sur la transformation du lait qui ont fait l’objet d’une évaluation statistique; on peut les trouver sur le site www milchstatistik ch Ces évaluations ont été réalisées en collaboration avec les acteurs de la filière. Les statistiques mensuelles sont publiées avec 45 jours de retard D’autres évaluations statistiques peuvent faire l’objet d’une publication
www milchstatistik ch offre les informations suivantes:
– commercialisation du lait par mois et selon l’origine;
production des divers produits laitiers comme le fromage, le beurre, le lait en poudre et le lait condensé, le lait de consommation et les spécialités laitières;
– transformation du lait, en équivalents de lait;
suppléments et aides en fonction des mesures (statistique annuelle)
■ Modifications en 2000
Dès le 1er mai, le supplément pour le lait transformé en fromage a été relevé de 12 à 20 ct /kg Cette augmentation a l’effet d’une baisse du prix de la matière première servant à la fabrication de fromage. Considérant le cadre budgétaire 2000, les taux des aides ont dû être abaissés La réduction des aides pour le fromage est compensée par l’augmentation du supplément versé pour le lait transformé en fromage Les taux pour les mélanges de beurre ont été réduits de 2 fr /kg, passant à 0,71 franc pour les petits emballages et à 2 fr 25 pour les grands emballages
2 . 1 P R O D U C T I O N E T V E N T E S 2 150
–
–
■ Cadre 2001
Au vu des décisions de politique financière prises par le Parlement pour le budget 2001 et de la situation favorable sur le marché du lait, le Conseil fédéral a maintenu le prixcible du lait (77 ct /kg) Le prix obtenu par les producteurs résulte toutefois des négociations entre les partenaires commerciaux. En outre, le domaine d’application du supplément pour le lait transformé en fromage a été étendu; dès le 1er mai 2001, le lait de brebis ou de chèvre transformé en fromage donne également droit à un supplément Les aides accordées dans le pays et celles à l’exportation ont été réduites en fonction des moyens financiers disponibles
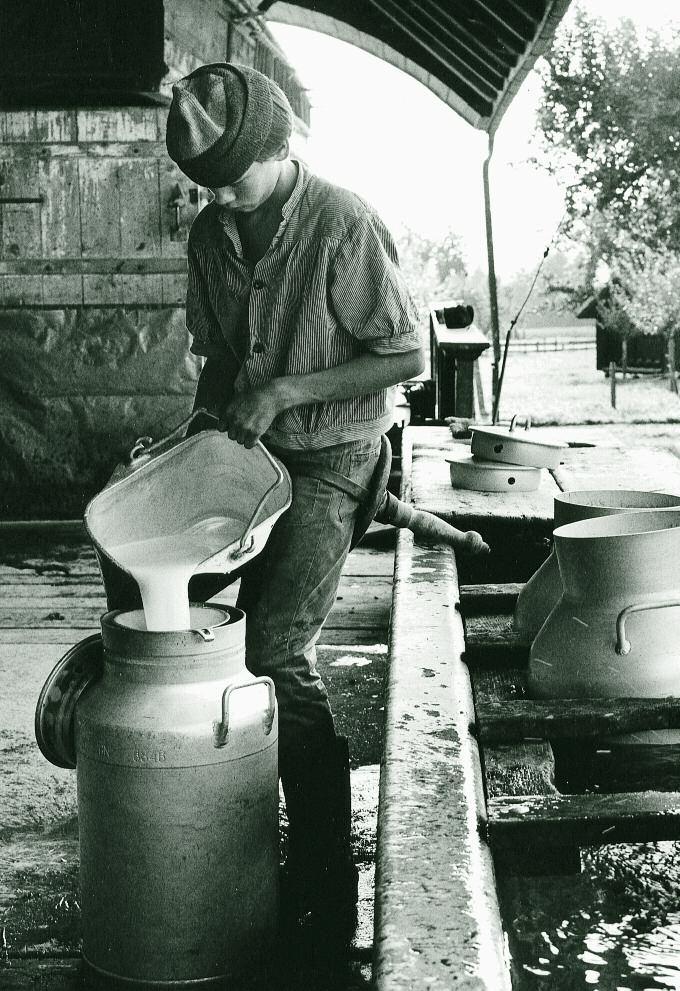
■ Perspectives
Selon l’enveloppe financière 2000 à 2003, 560 millions de francs sont prévus en 2002 pour le soutien du prix du lait, soit une coupe de 99 millions. Cela engendrera une nouvelle réduction des aides et éventuellement des suppléments en 2002
2 . 1 P R O D U C T I O N E T V E N T E S 2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E 151 2
■■■■■■■■■■■■■■■■ 2.1.3 Economie animale
Les mesures à la frontière représentent le soutien principal de la production de viande, alors que pour la production d’œufs, les aides versées dans le pays viennent au premier plan Seuls 2,9% des fonds destinés au soutien du marché (économie laitière et animale ainsi que production végétale, sans promotion des ventes) sont versés à l’économie animale
Aucun dégagement des abattoirs n ’ a eu lieu dans l’année sous revue Par ailleurs, la viande de porc n ’ a pas bénéficié de ventes à prix réduits ou de contributions pour stockage

2 . 1 P R O D U C T I O N E T V E N T E S 2 152
Mesures 2000 Animal/produit Bovins Veaux Porcs Chevaux Moutons Chèvres Volaille Oeufs Mesure Protection douanière ■■■■■■■■ Dégagement des marchés publics ■■■ Dégagement des abattoirs ■■■■■ Campagnes de stockage ■■■ Campagnes de vente à prix réduits ■■■ Essais pratiques ■ Contributions de reconversion ■ Contributions aux frais de ramassage et de calibrage ■ Campagnes d’œufs cassés et mesures de commercialisation ■ Contributions à la mise en valeur de la laine de mouton ■ Contributions à l’exportation 1 ■■■■ Effectifs maximums ■■■■ 1 bétail d’élevage et de rente uniquement Source:
OFAG
■ Moyens financiers en 2000
En 2000, la Confédération a budgétisé 49,1 millions de francs en faveur de mesures relevant de l’économie animale Quelque 60% de ces fonds proviennent de droits de douane à affectation spéciale perçus sur les importations de viande, d’œufs et de produits à base d’œufs; ils alimentent le fonds de la viande ainsi que la caisse de compensation des prix des œufs et des produits à base d’œufs Les dépenses se sont élevées à 26,2 millions de francs, 22,9 millions n ’ayant pas été utilisés, surtout en raison des restrictions imposées à l’exportation de bétail d’élevage et de rente Par ailleurs, la reconversion à la garde de pondeuses respectueuse de l’espèce a exigé des dépenses réduites, car un grand nombre d’aviculteurs avaient déjà obtenu des contributions de reconversion pendant trois années, soit de 1997 à 1999
Répartition des fonds en 2000
Total 26,2 mio de fr
Contributions à la mise en valeur de la laine de mouton, 4%
Aides à l’ exportation de bétail d’élevage et de rente 11%
Contributions destinées à soutenir la production suisse d’œufs, 35%
■ Bétail de boucherie et viande: mandats de prestations
Mandat de prestations de Proviande, 28%
Sources: Compte d’Etat, OFAG
L’ensemble des mesures prises dans le secteur du bétail de boucherie et de la viande est financé par le fonds de la viande. Depuis le 1er janvier 2000, Proviande fournit, sur mandat de l’OFAG, les prestations suivantes:
1. Taxation neutre de la qualité dans les abattoirs et sur les marchés publics surveillés
Proviande a taxé la qualité de plus de 1’200 unités d’abattage (par exemple 1’200 vaches ou 6’000 porcs) dans 43 abattoirs La qualité des animaux de l’espèce bovine, chevaline et ovine ainsi que des cabris est caractérisée par la classe commerciale, une combinaison de la classe de charnure avec celle des tissus gras Elle est déterminée visuellement L’élément décisif pour la qualité des animaux de l’espèce porcine est le pourcentage de viande maigre. Celui-ci est mesuré à l’aide d’un appareil technique. L’OFAG a homologué le Fat-O-Meater, le CSB-Ultra-Meater, l’AUTOFOM et le pied à coulisse Sur les marchés publics surveillés, Proviande a déterminé la classe commerciale des animaux des espèces bovine et ovine. Plus de 100 personnes au total ont collaboré au service de classification de Proviande, dont une majorité à temps partiel Pour garantir que la taxation, exigeante, soit accomplie de manière compétente, Proviande a fait de la formation de base et du perfectionnement une priorité dans l’année sous revue La taxation neutre de la qualité permet de recenser 80 à 90% de tous les animaux abattus ainsi que tous les animaux présentés sur les marchés publics surveillés
2 . 1 P R O D U C T I O N E T V E N T E S 2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E 153 2
Contributions de stockage et de réduction des prix de la viande de bœuf et de veau, 22% Tableau 28, page A29
■ Mesures de lutte contre l’ESB
2. Surveillance des marchés publics et des abattoirs et mesures destinées à alléger le marché
Proviande a organisé 992 marchés de gros bétail, 492 marchés de veaux et 296 marchés de moutons en collaboration avec les organisations paysannes et/ou les services cantonaux Les animaux de boucherie non vendus sont attribués par Proviande aux détenteurs de parts de contingents tarifaires aux prix usuels du marché (dégagement du marché) Du fait de l’offre réduite, le nombre d’attributions a baissé par rapport à l’année précédente à 2’917 têtes de gros bétail (-925 têtes) et à 168 têtes de veaux (-1’624 têtes) En revanche, 292 moutons et agneaux de pâturage ont été attribués, alors qu ’ aucune attribution n ’avait été effectuée l’année précédente

Les chiffres des marchés publics surveillés 2000
En novembre et décembre, 1’061 t de viande d’animaux d’étal et de fabrication ont été stockées pour un total de 4,02 millions de francs En mai, 1,47 million de francs ont été nécessaires au stockage de 328 t de viande de veau. Les campagnes de stockage ont été organisées et supervisées par Proviande
3. Enregistrement et contrôle des demandes de parts de contingents tarifaires
A la fin octobre, Proviande a communiqué à l’OFAG environ un millier de demandes d’attribution de parts de contingent tarifaire pour l’année 2001, enregistrées sur support électronique et contrôlées L’OFAG a ensuite calculé les parts de contingent tarifaire pour les différentes catégories de viande et de produits carnés à l’aide d’un nouveau logiciel et les a communiquées le 28 novembre 2000 par voie de décision Le calcul se basait la première fois sur les nouveaux critères servant à déterminer la prestation fournie en faveur de la production suisse. La modification la plus notable touche le régime d’importation de la viande de chèvre et de mouton ou d’agneau, désormais soumise à une prestation préalable en faveur de la production suisse
Par une modification de l’ordonnance fédérale sur les épizooties, le Conseil fédéral a entériné le 20 décembre une interdiction générale d’affouragement des farines animales Les graisses dites d’extraction, issues de la production des farines animales, sont également tombées sous le coup de l’interdiction, entrée en vigueur le 1er janvier 2001. La Confédération participe jusqu’à concurrence de 75% aux coûts supplémentaires engendrés par l’élimination au moyen de l’incinération
2 . 1 P R O D U C T I O N E T V E N T E S 2 154
Unité Veaux Gros bétail Ovins Marchés publics surveillés Nombre 492 992 296 Animaux admis Nombre 52 261 79 108 65 935 Part d’animaux admis à tous les abattages % 18 22 26 Animaux attribués (dégagement du marché) Nombre 168 2 917 292 Source: Proviande
■ Œufs: mesures visant à soutenir la production suisse
Le 14 février 2001, le Conseil fédéral décidait de débloquer 7 millions de francs pour l’achat de bœuf frais suisse destiné à l’exportation dans le cadre de l’aide alimentaire
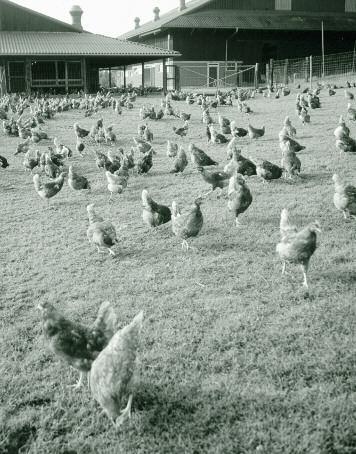
Un budget maximum de deux millions de francs a été ouvert pour une campagne d’information sur la viande de bœuf suisse. Jusqu’à fin mars, Proviande a acheté environ 713 t de viande de bœuf sur le marché La Direction du développement et de la coopération s ’est ensuite chargée du transport et de la distribution de la viande de bœuf en Corée du Nord
En date du 28 février, le Conseil fédéral a également décidé de créer une unité de contrôle de l’ESB, tout d’abord pour une durée de 6 ans (2001–2006), dans le but de soutenir les cantons dans l’application des mesures En outre, 1,1 million de francs a été débloqué pour des recherches supplémentaires sur les maladies à prions et sur leur mode de transmission
L’arrêté du Conseil fédéral du 2 mai a permis de débloquer 8,5 millions de francs pour acheter un deuxième lot de 700 t au moins de bœuf frais suisse destiné à l’aide alimentaire internationale Le solde pourra servir au stockage de viande de veau
Le 27 juin 2001, le Conseil fédéral a approuvé un montant de 8 millions de francs pour des mesures supplémentaires destinées à alléger le marché. La moitié de cette somme a été utilisée pour le troisième achat de 400 t de viande de boeuf Un montant de 2 millions de francs a servi à financer des actions de stockage et de réduction des prix en vertu de l’ordonnance sur le bétail de boucherie. En outre, le DFE s ’est vu attribuer la compétence d’utiliser le solde de 2 millions de francs pour des mesures garantissant un maximum d’efficience
Toutes les mesures prises dans le secteur des œufs sont financées par la Caisse de compensation des prix des œufs et des produits à base d’œufs, alimentée par les parts de droits de douane à affectation spéciale Cette caisse sert à soutenir la production d’œufs dans les exploitations paysannes de notre pays et à financer les mesures de mise en valeur des œufs suisses
Le Conseil fédéral avait déjà adopté le 1er septembre 1996 deux mesures transitoires, arrivant à terme à fin 2001
1 L’OFAG verse des contributions aux frais de ramassage et de calibrage pour la prise en charge d’œufs de consommation produits par d’anciennes exploitations protégées. Ces contributions, qui se montent à 3,9 millions de francs pour 124,14 millions d’œufs, ont servi aussi dans l’année sous revue au soutien des prix et de l’écoulement
2 La garde de pondeuses respectueuse de l’espèce (SRPA ou SST) est par ailleurs encouragée En plus des contributions SST et SRPA, les producteurs d’œufs touchent des contributions de reconversion 340 exploitations détenant au total 451’800 pondeuses ont obtenu des contributions de reconversion s’élevant à 3,39 millions de francs. La réduction de 2,45 millions par rapport à l’année précédente est due à l’extinction du droit à ces contributions d’un grand nombre d’exploitations dans l’année sous revue, cette mesure étant limitée à trois années
2 . 1 P R O D U C T I O N E T V E N T E S 2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E 155 2
■ Chevaux de rente et de sport: mise aux enchères de parts de contingent tarifaire
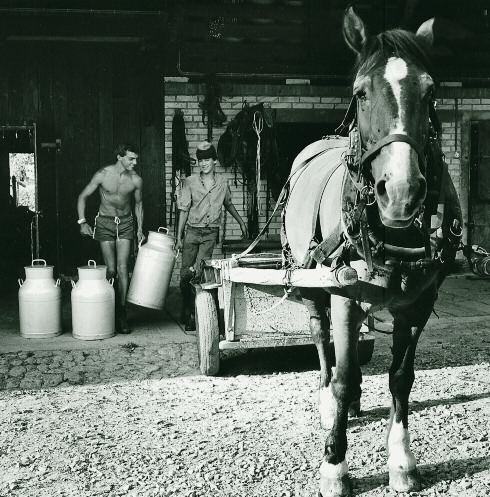
En plus des mesures transitoires, les fonds de la caisse de compensation peuvent servir à financer les campagnes d’œufs cassés ainsi que les mesures de commercialisation lorsque l’offre saisonnière d’œufs de poules suisses est excédentaire L’objectif est de stabiliser les prix. D’entente avec les milieux intéressés, l’OFAG a alloué 2,5 millions de francs au maximum pour ces opérations en 2000, qui ont débuté après Pâques et se sont étendues jusqu’à fin octobre La demande d’œufs de consommation baisse en effet très rapidement après les fêtes, alors qu’il est difficile de réduire l’offre à court terme dans les mêmes proportions Au total, 16 millions d’œufs suisses excédentaires ont été cassés pour être transformés, alors que 14,6 millions ont été vendus au consommateur à prix réduit Ces mesures, qui ont coûté 1,93 million de francs, ont contribué, au moins partiellement, à stabiliser les prix
D’autres fonds servent par ailleurs à co-financer des essais pratiques dans le secteur de la volaille et à en diffuser les résultats dans les milieux de la formation et de la vulgarisation. En 2000, l’OFAG a signé avec l’IRAB et l’école d’aviculture de Zollikofen des contrats portant sur la réalisation de tels essais, dont une partie se prolonge jusqu’en 2001 Les résultats sont présentés régulièrement lors de séances d’information et publiés dans des revues spécialisées, ce qui contribue à améliorer les systèmes de garde de la volaille Au total, 122’000 francs sont sortis de la caisse de compensation pour ces essais dans l’année sous revue.
L’OFAG a publié et mis aux enchères le contingent tarifaire «animaux de l’espèce chevaline (sans les animaux d’élevage)» pour l’an 2000 en deux parts égales de 1’516 chevaux chacune, en septembre 1999 et avril 2000 Des personnes physiques et morales ou des communautés de personnes dont le domicile ou le siège social est situé sur le territoire douanier suisse ont soumis des offres portant globalement sur 8’236 chevaux. Au total, l’OFAG a attribué des parts de contingent tarifaire à 346 personnes pour la période contingentaire 2000 Les recettes de 1,3 million de francs ont été versées dans la caisse fédérale
2 . 1 P R O D U C T I O N E T V E N T E S 2 156
Le Conseil fédéral a décidé le 21 septembre 2001 des modifications concernant le marché de la volaille et des chevaux Suite à cet arrêté du Conseil fédéral, les paiements directs SRPA et SST pour la volaille destinée à la production d’œufs seront relevés de 100 francs par UGB; par ailleurs, la Confédération accordera, jusqu’en 2006, une contribution d’investissement de 600 francs par UGB pour la transformation et la construction de systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux En ce qui concerne les poulets de chair et les dindes, les paiements directs pour SRPA augmentent de 100 francs par UGB Dès à présent, les contingents tarifaires partiels pour les œufs de consommation et de fabrication ainsi que le contingent «ânes, mulets et bardots» seront attribués selon le système du fur et à mesure Les deux contingents tarifaires partiels «petits poneys» et «chevaux de rente, de sport et de loisirs» seront regroupés en un seul contingent. En outre, le Conseil fédéral a relevé le contingent tarifaire partiel «œufs de fabrication» de 2500 t Cette augmentation est compensée par une diminution du contingent «œufs de consommation» Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2002.
L’abaissement des taxes douanières perçues sur les aliments pour animaux contribue à améliorer la compétitivité de la production suisse de viande et d’œufs face à la concurrence étrangère

2 . 1 P R O D U C T I O N E T V E N T E S 2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E 157 2
■ Perspectives
■■■■■■■■■■■■■■■■ 2.1.4 Production végétale
La mise en œuvre de la politique agricole 2002 dans la production végétale s ’est poursuivie en 2000 Les modifications au regard de l’année précédente ont principalement touché la culture des champs L’introduction de la contribution à la surface pour les oléagineux en lieu et place de la garantie limitée de prix et de placement existant jusqu’alors a représenté la principale nouveauté Le changement de système consistant à remplacer la contribution à la mise en valeur par le mandat de prestations pour le sucre avait déjà commencé avec la récolte 1999 Le premier décompte de la nouvelle organisation du marché est toutefois tombé dans l’exercice 2000 Pour les cultures spéciales, seules des adaptations mineures ont été adoptées.

1 selon l’utilisation ou le numéro du tarif, le prélèvement à la frontière est réduit ou nul
2 administration et versement des contributions dans le cadre d’un mandat de prestations à des organisations privées
3 ne concerne pas la totalité de la récolte (compensation de rendement en faveur des entreprises de pressage pour la production d’huile comestible, contributions aux installations pilotes ou de démonstration pour les MPR, affouragement à l’état frais et déshydratation de pommes de terre, réserve de marché de concentrés de jus de fruits à pépins)
4 uniquement pour les pommes de terre
2 . 1 P R O D U C T I O N E T V E N T E S 2 158
Mesures 2000 Mesure Protection douanière 1 ■■■■■■■■ Garantie limitée en matière de prix et de placement ■ Contributions à la transformation ■ 3 ■ 2 3 ■ 2 ■ 2 ■ 3 Contributions à la surface spécifiques ■■■ 2 Contributions à l’exportation ■■ 2 4 ■
Source: OFAG C u l t u r e B l é p a n i f i a b l e C é r é a l e s f o u r r a g è r e s, l é g u m i n e u s e s à g r a i n e s, p l a n t e s à f i b r e s O l é a g i n e u x P o m m e s d e t e r r e B e t t e r a v e s s u c r i è r e s S e m e n c e s F r u i t s L é g u m e s, f l e u r s c o u p é e s
■ Moyens financiers en 2000
La moitié des fonds destinés au soutien du marché dans la production végétale ont été alloués à la transformation, à la mise en valeur et au stockage Un peu plus d’un tiers du soutien du marché a été octroyé directement aux producteurs sous forme de contributions à la surface. Le reste a été versé sous forme de contributions à l’exportation. Avec la Politique agricole 2002, un plus grand nombre d’organisations privées sont mandatées pour des tâches d’exécution Dans l’année sous revue, 45% des fonds octroyés par la Confédération ont été gérés et versés dans le cadre de mandats de prestations Les deux mandats principaux ont été la transformation de betteraves confiée aux sucreries et la mise en valeur de pommes de terre confiée à Swisspatat
Tableau 29, page A30
En regard de l’année précédente, les dépenses dans la production végétale ont été réduites de 30 millions de francs au total La faible récolte de fruits et la réduction des contributions à la surface pour les céréales fourragères ont permis d’économiser 20 millions de francs chacune. Par contre, les dépenses pour les betteraves sucrières ont augmenté de 14 millions de francs dans l’exercice, car les recettes douanières sur le sucre importé ont été versées pour la première fois intégralement dans la caisse fédérale, et l’affectation spéciale a été supprimée. La récolte 1999 a été comptabilisée dans l’exercice 2000 L'indemnisation pour le mandat de transformation du sucre se monte à 45 millions de francs par an jusque en 2003 Vu l’effondrement des prix du sucre sur le marché mondial, les sucreries ont obtenu une indemnisation supplémentaire de 1,8 million de francs A partir de la récolte 2001, elles ont la possibilité de produire du sucre biologique dans le cadre du mandat de transformation La quantité est toutefois limitée à 2’000 t Cette modification fait augmenter la quantité maximale de sucre suisse de 1%
Dans le compte 1999, on constate que seule la moitié de l’indemnisation du mandat de transformation des pommes de terre a été utilisée Le reste a été porté aux dépenses 2000. L’indemnisation se monte à 18 millions de francs. Les autres dépenses au profit de la mise en valeur des pommes de terre vont au compte du mandat de transformation des plants et des contributions à l’exportation de produits à base de pommes de terre
Les dépenses faibles pour les céréales sont imputables à la réduction des primes de culture pour les céréales fourragères Du côté des légumineuses à graines, les lupins ont donné pour la première fois droit aux contributions Dans l’année sous revue, cette contribution a été versée pour 36 ha.
2 . 1 P R O D U C T I O N E T V E N T E S 2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E 159 2
Primes à l'exportation 13% Contributions pour la transformation et la mise en valeur 46% Source: Compte d’Etat Contributions à la surface 37% Total 152,8 mio. de fr. Divers 4%
Répartition des fonds en 2000
Compte
Les surfaces cultivées ainsi que les rendements du colza et du soja inférieurs à la moyenne en 2000 ont eu une incidence directe sur les dépenses de la Confédération
Les producteurs d’oléagineux ont touché 27,1 millions de francs en contributions à la surface, alors que 1,4 million a été dépensé pour la compensation des rendements des entreprises de pressage
Pour ce qui est des matières premières renouvelables (MPR), des contributions à hauteur de 1,2 million de francs ont été versées Le soutien comprenait les contributions à la surface de 2’000 fr./ha pour les plantes à fibres et les contributions à la transformation allouées à des installations pilotes et de démonstration pour les oléagineux ainsi que les contributions à la production d’éthanol à partir de la biomasse Ces dernières sont encore modestes Les dépenses de la Confédération pour les MPR ont diminué: le colza bénéficiant désormais des contributions à la surface allouées pour les oléagineux, seules les contributions complémentaires à la transformation ont été affectées au soutien des MPR
Dépenses pour la mise en valeur des fruits en 2000
Total 19,3 mio de fr
Exportation de cerises 5,6%
Mise en valeur des fruits à pépins en Suisse 6,9%
Autres 2,1% dont allégement du marché (cerises et pruneaux) 1,3%
Exportation de jus concentrés de poire 11,3%
Exportation de jus concentrés de pomme 70,1%
Exportation d'autres produits de fruits à pépins 4,0%
Source: OFAG
2 . 1 P R O D U C T I O N E T V E N T E S 2 160 Répartition des moyens financiers selon les cultures m i o d e f r 1999 2000
P
de
C
O
M
Fruits Viticulture 0 45 50 40 35 30 25 20 15 10 5
Source:
d’Etat Betteraves sucrières
ommes
terre
éréales Légumineuses à graines
léagineux
PR Production de semences
■ Réorganisation du marché céréalier: derniers préparatifs
La Confédération participe financièrement à la mise en valeur des fruits à cidre et aux mesures d’allégement du marché des fruits à noyau
Au début de l’année 2000, les 5'400 t de jus concentrés de pomme et de poire restant à exporter provenaient des récoltes 1998 et 1999 La Confédération a alloué 15,7 millions de francs pour l’écoulement de ces stocks et des 3'700 t de jus concentrés de pomme exportées en 1999, mais financées par le budget 2000 La branche a fourni, en plus, 1,8 million de francs sous forme d’entraide Cependant, la transformation des 256'000 t de fruits à cidre de la récolte 2000 a mis à disposition de l’exportation 18'500 t de jus concentrés de fruits à pépins Vu la saturation des marchés internationaux consécutive à l’abondance de la récolte 2000, les stocks nouvellement constitués n ’ont pu être réduits au cours des derniers mois de l’année sous revue.
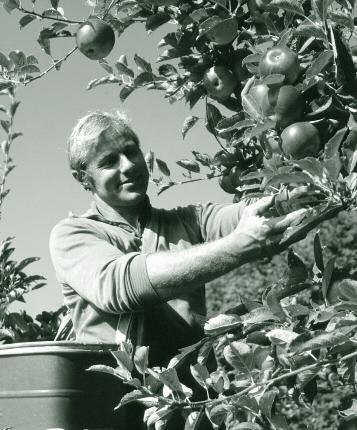
Les mesures d’allégement du marché des cerises, y compris les contributions à l’exportation, et du marché des pruneaux ont absorbé 1,3 million de francs.
Cultures des champs
Dans les grandes cultures, on a continué à consolider les mesures prises dans le cadre de la Politique agricole 2002 pour les betteraves sucrières et les pommes de terre, institué de nouvelles mesures pour les oléagineux et les MPR et préparé des mesures pour les céréales.
En 2000, les céréales panifiables ont bénéficié la dernière fois de la garantie limitée de prix et de prise en charge de la Confédération, qui a vendu aux meuniers la quantité garantie de 382’200 t au prix de revient. Le reste du blé panifiable a été déclassé et mis aux enchères comme aliments pour animaux Les producteurs ont couvert les coûts du déclassement par une contribution à la mise en valeur de 6,85 fr /dt
En vue de la libéralisation, les prix à la production ont été réduits de 7 fr /dt par rapport à l’année précédente, s’élevant encore à 75 fr /dt pour le froment de la classe 1 La prime de culture pour céréales fourragères a été ramenée de 770 à 400 fr /ha Elle est supprimée dès l’année de récolte 2001 La culture du blé panifiable est ainsi restée compétitive vis-à-vis des céréales fourragères durant la période transitoire Les contributions à la surface pour légumineuses à graines ont été reconduites sans changement Sur le plan de l’économie d’entreprise, l’attractivité des pois protéagineux, féveroles et lupins a augmenté face aux céréales.
Afin de permettre aux producteurs suisses de viande et d’œufs de préserver leurs parts de marché face à une concurrence accrue, le prix-seuil de l’orge (céréales fourragères) sera réduit de 5 fr /100kg, passant à 46 fr /100kg au 1er juillet 2001 Le prix-seuil des aliments protéiques pour animaux a été réduit proportionnellement Une contribution complémentaire de 400 fr /ha destinée aux terres ouvertes et aux cultures pérennes permet de rétribuer, dans le secteur de la culture des champs, la part des prestations d’intérêt général qui, en raison de l’abaissement des prix-seuils et de la libéralisation du marché céréalier, ne peut plus être rétribuée par le biais des prix
2 . 1 P R O D U C T I O N E T V E N T E S 161 2 2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E
■ Nouvelle organisation du marché des oléagineux: premières expériences
Les cultivateurs ont pu demander pour la première fois la contribution à la surface de 1500 fr /ha pour la culture de colza, de soja, de tournesol et de chanvre Le prix du marché intérieur a remplacé les prix garantis des oléagineux La Confédération a affecté 2’600 t d’huile de colza à l’aide alimentaire, afin que la réorganisation du marché se fasse dans de bonnes conditions La liquidation de l’ancien régime a été chose faite en été 2001 (révision finale du compte du colza)
La compensation de rendement pour les entreprises de pressage, qui vient d’être instituée, est un mandat de transformation Elle permet de soutenir le prix des oléagineux suisses destinés à la fabrication d’huile comestible et transformés par les entreprises Florin AG, Muttenz (BL) et Oleificio SABO, Manno (TI) Objectif: offrir une compensation financière à ces huileries de pressage, dont les rendements sont inférieurs à ceux des huileries d’extraction Cette mesure met sur un pied d’égalité les oléagineux importés et suisses, des montants différents étant prélevés à la frontière selon l’affectation Les taux de la compensation des rendements ont varié de 5,90 fr./dt (minimum: soja) et 9,15 fr /dt (maximum: tournesol) Ils sont tributaires du taux de droit de douane perçu sur les denrées fourragères, lequel est régulièrement adapté aux prix du marché mondial dans le système du prix-seuil L’entreprise d’extraction de la maison LiptonSais, qui disposait de deux tiers de la capacité de transformation disponible dans le pays, a été fermée en novembre 2000. Le procédé d’extraction ayant pratiquement disparu en Suisse, la compensation des rendements ne joue plus le même rôle que naguère
Les partenaires commerciaux assument désormais la coordination du marché des oléagineux au sein de l’interprofession swiss granum Producteurs et huileries concluent désormais chaque année un nouvel accord interprofessionnel
Les installations pilotes et de démonstration qui transforment des oléagineux à des fins techniques ont reçu pour la première fois la contribution de transformation de 30 fr /dt Elles fabriquent avant tout du biodiesel et des lubrifiants facilement biodégradables La contribution s’élève à 20 fr./dt à partir de la récolte 2001.

Les courges à huile donnent droit à la même contribution à la surface que les oléagineux dès la récolte 2001 Cette mesure vise à promouvoir la production de graines de courge Les courges comestibles et ornementales ne donnent pas droit à la contribution
En outre, le Conseil fédéral a décidé de soutenir l’approvisionnement régulier du marché intérieur en colza au moyen de la compensation de récolte: en cas de faible récolte, le colza cultivé comme MPR peut être affecté à la production d’huile comestible. Les installations pilotes et de démonstration prêtes à accepter cette compensation peuvent demander la contribution de transformation pour la quantité équivalente de colza importé, jusqu’à concurrence de 3’000 t par installation et par récolte.
2 . 1 P R O D U C T I O N E T V E N T E S 2 162
Dans la session de printemps de 2000, le Parlement a approuvé la loi fédérale du 24 mars 2000 sur l’abrogation de la loi sur le blé avec effet au 1er juillet 2001 Depuis la récolte 2001, la Confédération s ’est désengagée du marché des céréales panifiables L’obligation de livraison et celle de prise en charge ont été supprimées, tout comme les prix de base garantis Céréales panifiables et fourragères ne forment plus qu ’ un seul marché Le canal d’écoulement et le prix sont pour l’essentiel fonction de la qualité La fonction de compensation des primes de culture perd sa nécessité suite à la mise en place du marché céréalier unique Les mesures prises à la frontière ont ainsi gagné en importance pour la production céréalière Tant que la récolte ne dépasse pas les besoins du pays, ce sont les prix du marché mondial et les prélèvements perçus à la frontière qui déterminent le niveau des prix La réglementation de l’importation a été adaptée avec effet au 1er juillet 2001.
L’OFAG attribue le contingent tarifaire de blé panifiable (70’000 t) aux enchères Seuls les importateurs disposant d’une part de contingent tarifaire peuvent importer du blé panifiable au taux du contingent En outre, l’obligation de prendre en charge 85% de blé indigène a été supprimée
La décision de ne plus administrer le contingent tarifaire de blé dur de 110’000 t garde sa validité. L’obligation de prendre en charge du blé panifiable indigène prévue auparavant lorsque la farine de blé dur importée était utilisée dans le secteur du blé panifiable est supprimée La loi sur les douanes réglemente la transformation et l’utilisation du blé dur. Celui-ci ne peut être importé au taux préférentiel ou pris en charge que lorsque l’acheteur s ’est engagé envers l’Administration fédérale des douanes à respecter les rendements minimaux et les utilisations particulières prescrits Le blé dur importé devra servir à fabriquer au moins 64% de produits de la mouture, qui doivent être utilisés comme semoule de cuisine pour l’alimentation de l’homme ou comme fins finots pour la fabrication de pâtes alimentaires. Les fins finots doivent servir à fabriquer au moins 96% de pâtes alimentaires Si les rendements ne sont pas atteints, on s ’acquittera, sur la différence par rapport au rendement minimal, des droits de douane au taux hors contingent (THC) dus au moment de la naissance de l’obligation de payer (actuellement 74 fr /dt) Si les rendements ne peuvent pas être atteints pour des raisons qualitatives, les droits de douane dus sont ceux applicables à la farine fourragère (actuellement 27 fr /dt) Le contrôle et l’encaissement incombent à l’Administration des douanes Les produits de la mouture dépassant le rendement minimal de 64% peuvent être utilisés à d’autres fins et sans conditions supplémentaires dans le secteur du blé panifiable ou dans celui des aliments pour animaux
La gestion des stocks obligatoires de blé dur et de blé tendre a été transférée de l’OFAG à Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE) Compte tenu des changements touchant le marché céréalier, l’organisation des réserves de céréales a connu aussi certaines modifications au sens du rapport sur les stocks obligatoires de 1999 Il a notamment été possible de réduire le nombre des détenteurs de stocks

2 . 1 P R O D U C T I O N E T V E N T E S 2 2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E 163
■ Nouvelle organisation du marché céréalier
■ Perspectives: mandats de prestations en matière d’oléagineux
Suite à la libéralisation du marché des oléagineux, il s ’est révélé que les prix pratiqués sur le marché suisse varient considérablement Raisons: la protection douanière est différenciée selon l’utilisation, et les rendements en huile sont inégaux Ces différences de prix influent sur l’attractivité des cultures considérées. Notamment la culture de soja destiné à la production d’huile comestible a fortement reculé en raison du prix bas pratiqué sur le marché et des problèmes liés aux OGM entachant son image
des oléagineux à l'importation en 2000 (non transformés)
Vu la situation du marché, il convient de pondérer les objectifs relevant des politiques de l’approvisionnement et du revenu dans la fixation des contributions de soutien A cet égard, la question est de savoir dans quelle mesure le soutien du marché des oléagineux devrait être échelonné selon la culture et l’utilisation
Le 21 septembre 2001, le Conseil fédéral a décidé de charger l'interprofession swiss granum, par mandat de prestations, de répartir les contributions de transformation pour oléagineux dès 2002 Cela permettrait de trouver, au sein de l’interprofession, un consensus viable sur l’allocation de ces fonds fédéraux. Les contributions actuelles versées aux huileries (compensation des rendements) et aux installations pilotes et de démonstration sont intégrées dans le mandat de prestations précité En revanche, le soutien de base en faveur des oléagineux sera comme auparavant accordé sous la forme d’une contribution unique à la surface
En même temps, la contribution à la surface allouée pour les légumineuses à graines, les pois protéagineux, les féveroles et les lupins passe de 1'260 à 1'500 francs par ha Elle se situe ainsi au même niveau que celle octroyée pour les oléagineux. L’augmentation de la contribution à la surface allouée pour les légumineuses à graines et la convention de prestations pour les oléagineux améliorent les conditions-cadre régissant la production d’aliments pour animaux protidiques en Suisse.

2 . 1 P R O D U C T I O N E T V E N T E S 2 164
Prix
Huile comestible colza
Colza MPR Huile comestible tournesol
Huile comestible soja
Huile fourragère soja
f r / d t Sources: DGD,
0 100 80 60 40 20
Soja fourrager
OFAG P
rix franco frontière Prix à l’importation
■ Fruits et légumes: la protection à la frontière, élément clé de l’organisation de marché
Cultures spéciales
Marquée par la mise en oeuvre de la dernière des six réductions des droits de douane prévues par les engagements en matière d’accès aux marchés GATT/OMC, l’année sous revue n ’ a pas réservé de surprises La protection à la frontière reste la principale disposition économique en faveur de l’écoulement des fruits et des légumes frais indigènes Durant la période où l’offre de produits du pays est traditionnellement réduite ou inexistante, il est toujours possible d’importer au taux bas (taux du contingent ou TC) En dehors de cette période, les importations par le contingent tarifaire sont échelonnées dans le temps en fonction de l’offre des produits indigènes semblables Les importations complètent ainsi la production suisse selon les besoins du marché. Lorsque ceux-ci sont couverts par la production du pays, aucune partie de contingents tarifaires n ’est autorisée Dans cette phase d’auto-approvisionnement, les importations s ’effectuent, le cas échéant, à un taux s’établissant entre le THC et le TC
L’introduction au 1er juillet 1999 du taux d’imposition unique pour les spiritueux suisses et étrangers (29 fr /l d’alcool pur) met l’offre de fruits à distiller indigènes dans des conditions de concurrence accrue En conséquence, l’équivalent de 15'000 t de fruits, selon les estimations, ont été nouvellement importées sous la forme de fruits à distiller, de moûts de fruits et de spiritueux, ces deux derniers produits bénéficiant de droits insignifiants à l’importation durant toute l’année Parallèlement, les prix à la production des fruits à distiller ont baissé
■ Économie viti-vinicole: moins de moyens à disposition pour la promotion des ventes
Les mesures prises dans ce secteur servent à promouvoir les ventes à l’étranger, à maintenir les vignobles en forte pente et en terrasses, à améliorer la qualité (limitations quantitatives, exigences minimales) et à assurer les contrôles nécessaires
Le contingent d’importation de vins blancs a été utilisé à 92,5% en 2000 Comme l’année précédente, la part des vins en bouteille a augmenté, atteignant 51,5% Le regroupement des contingents de vins rouges et de vins blancs agendé au 1er janvier 2001 et le système du fur et à mesure prévu pour leur attribution ont probablement eu pour effet que seul le volume nécessaire a été importé dans l’année sous rapport
Le contingent de vin rouge a été utilisé à 94% Les importations ont reculé de quelque 50’000 hl comparées à l’année précédente La part des vins en bouteille a également augmenté, passant à 34,4% Les importations de vins mousseux, doux et industriels s ’ajoutent à celles des vins de bouche rouges et blancs
Les contributions en faveur de l’économie viti-vinicole se sont élevées à 5,7 millions de francs, dont un peu plus d’un million a été affecté au contrôle de la vendange et 4,6 millions à la promotion des ventes (publicité et relations publiques) à l’étranger. En raison principalement de la réduction des contributions pour la promotion des ventes (abaissement à 60% des dépenses imputables), ce montant a été inférieur d’environ 1,5 million de francs à celui de l’année précédente
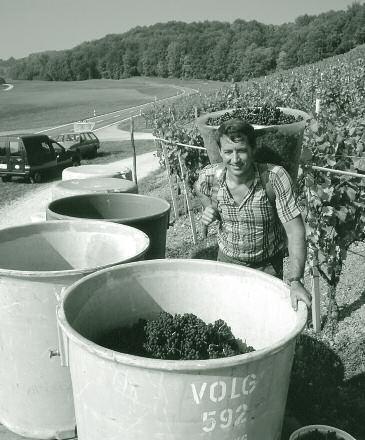
2 . 1 P R O D U C T I O N E T V E N T E S 2 2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E 165
■ Perspectives
Les contributions à l’exportation nécessaires pour assurer l’écoulement des excédents de fruits à cidre récoltés en 2000 représentent plus du double des montants budgétisés pour 2001, équivalant à la limite supérieure annuelle selon les engagements pris dans le cadre de GATT/OMC. Les mesures d’entraide pour la mise en valeur de la récolte 2000 ne suffisent pas à combler ce déficit de financement C’est pourquoi il sera inévitable de reporter une partie des exportations à l’année 2002 Même si les estimations laissent présager, en 2001, une récolte de fruits à cidre atteignant deux tiers de la moyenne des quatre dernières années, il est urgent de réexaminer les mesures en faveur de ce secteur
Le regroupement des contingents de vins rouges et de vins blancs au 1er janvier 2001 et leur attribution selon la procédure du fur et à mesure se traduiront probablement par une augmentation des importations de vins blancs Les chiffres du premier semestre 2001 confirment cette hypothèse, mais il convient de les considérer avec toute la prudence requise. Les importations de vins rouges ont connu un léger recul, de sorte que le volume d’importation total de cette période est légèrement supérieur à celui de l’année précédente

166 2 . 1 P R O D U C T I O N E T V E N T E S 2
■ Appréciation de la définition des SPM
2.1.5 Examen des mesures
L’art 187, al 13, LAgr exige l’examen des principales mesures du domaine de la production et des ventes. L’OFAG a ainsi commandé plusieurs études sur l’efficacité de divers instruments et mesures Nous présentons ci-après brièvement les résultats de celles qui sont déjà achevées Il s ’agit d’études sur la promotion des ventes, le contingentement laitier, le soutien du marché et l’accès au marché
Etudes sur la promotion des ventes
La promotion des ventes est un élément important de la nouvelle politique agricole. Un montant annuel de 60 millions de francs est disponible à ce titre Selon l’art 12, al 4, LAgr, il incombe au Conseil fédéral de fixer les critères régissant la répartition de ces fonds. Une procédure spéciale, décrite dans l’ordonnance sur l’aide à la promotion des ventes, a été développée à cet effet Elle consiste à classer les produits agricoles en domaines, aussi indépendants que possible les uns des autres, que l’on appelle secteurs produit-marché (SPM) Une analyse de portefeuille permet d’apprécier l'intérêt qu'ils présentent pour un investissement Les résultats servent ensuite d’indicateurs pour calculer l’aide financière maximale pouvant être accordée par SPM.
A fin 2000, l’OFAG a commandé deux études, dont les auteurs (Bösch, Kuster et König, Senti) étaient chargés d’examiner la méthode prévue pour la répartition des fonds. Ils ont notamment répondu aux questions suivantes:
– Les SPM ont-ils été définis sur la base de critères appropriés?
L’analyse du portefeuille utilisée est-elle une méthode adéquate pour apprécier l’intérêt d’un investissement?
– Est-il judicieux de répartir les moyens financiers entre les SPM en fonction du seuil d’efficacité?
La formation de SPM indépendants fait partie de la méthode utilisée pour attribuer les moyens financiers affectés à la promotion des ventes Elle permet une attribution selon le succès potentiel A l’exception du fromage, les SPM actuels ont été définis à l’échelon générique, c ’est-à-dire lait, viande, céréales, etc Dans les deux études, la formation de SPM est en principe considérée comme utile
L’étude König, Senti recommande toutefois une subdivision plus précise Le SPM viande, par exemple, devrait comprendre les groupes boeuf, veau, porc et volaille. Les auteurs estiment qu ’ une définition trop large risque d’aboutir au regroupement de produits dont la position sur le marché est trop différente L’efficacité de la mesure serait ainsi compromise.
2 . 1 P R O D U C T I O N E T V E N T E S 2 167 ■■■■■■■■■■■■■■■■
–
2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E
L’étude Bösch, Kuster propose de remplacer l’approche actuelle, qui est ciblée sur les entreprises, par une méthode se fondant en premier lieu sur la branche Celle-ci considère le contexte dans lequel se développe une entreprise, alors que l’approche appliquée actuellement part de l’optique d’une entreprise développant une politique d’affaires et de marketing Cette optique est ensuite reportée sur tout le SPM Un des arguments de Bösch et Kuster est que leur proposition permettrait de mieux tenir compte des atouts nationaux de compétitivité
Cette approche méthodologique est également considérée comme judicieuse dans les deux études L’analyse de portefeuille sert, d’une part, à évaluer l’attrait de divers marchés partiels pour la vente de produits agricoles et, d’autre part, à apprécier par des indicateurs la position qu ’ y détiennent les produits agricoles suisses La combinaison des deux résultats permet de désigner les produits méritant de bénéficier en priorité de la promotion des ventes.

Comme le confirment les études, la qualité de l’analyse est déterminée par les données, mais surtout par les indicateurs, c ’est-à-dire par le type de données utilisées et par le choix des domaines dont elles proviennent Leur transposition sur une échelle appropriée joue également un rôle important.
Lorsque les données sont combinées, il faut créer de nouvelles catégories, ce qui implique une certaine perte d’information et un nivellement des données. Les valeurs «volume du marché» et «croissance du marché» sont ainsi réunies dans la catégorie «importance du SPM» Il en résulte une nouvelle valeur sur l’échelle Cet inconvénient des portefeuilles multi-indicateurs est connu A ce propos, l’étude Senti, König fait remarquer que les résultats de l’analyse indiquent encore exactement l’ordre des SPM, mais qu’il y a distorsion dans l’ordre de grandeur des différences. Il est donc recommandé de renoncer à une catégorisation et de maintenir l’information générale jusqu’à la fin des calculs
La valeur des indicateurs retenus ressort de l’évaluation de statistiques, de l’avis d’experts et, dans un seul cas, d’un sondage Le maillon faible semble être l’avis d’experts En effet, les déclarations sont trop peu différenciées et accordent trop de poids à la dimension partielle de la croissance du marché L’étude König, Senti recommande de mieux tenir compte, dans le choix des indicateurs, de la concurrence des importations et des possibilités d’exporter Quant à l’étude Bösch, Kuster, elle propose de renforcer la valeur informative de l’analyse par une différenciation claire et nette des deux axes.
L’analyse de portefeuille permet aussi à une entreprise d’exclure des SPM peu porteurs et d’en prévoir de nouveaux. Tel n ’est pas le cas du portefeuille de l’OFAG. En effet, deux catégories de promotion sont prévues Les études constatent que cela rend difficile la différenciation des SPM quant à leur attrait, notamment parce que la décision d’attribuer des ressources par portefeuille est de nature politique Il est donc indiqué de renoncer aux catégories de promotion et de répartir les moyens selon les appréciations effectives.
2 . 1 P R O D U C T I O N E T V E N T E S 2 168
■ Appréciation de l’analyse de portefeuille
■ Conformité aux objectifs du seuil d’efficacité: appréciation
Les instruments de la communication marketing sont efficaces lorsque le message est perçu par le public-cible et que celui-ci réagit en conséquence Une certaine intensité d’intervention est nécessaire à cet effet Les instruments utilisés et les fonds disponibles déterminent dans une large mesure si le seuil d’efficacité peut être atteint. Selon la méthode actuelle, on alloue aux SPM, dans une première étape, 50% de la somme requise pour atteindre ce seuil
Selon les deux études, il n ’est pas judicieux de procéder de cette manière pour répartir les aides financières entre les SPM En outre, ce seuil joue un rôle trop important dans la distribution des ressources Par ailleurs, le seuil d’efficacité dépend d’un grand nombre d’éléments Il est donc difficile et peu sûr d’un point de vue méthodologique de procéder à une appréciation au niveau des SPM existants. Dans la pratique du marketing, cet instrument est utilisé à l’échelon du marketing-mix (plan d’application d’outils tels que publicité, promotion des ventes, etc ) et non pas sur le plan stratégique.
Dans le modèle de calcul existant, environ la moitié des moyens financiers est distribuée en fonction du seuil d’efficacité L’attrait des investissements qui ressort de l’analyse de portefeuille s ’ en trouve relativisé La répartition des fonds selon cet attrait est donc remise en question; son utilité comme critère d’efficacité de l’allocation des ressources est incertaine
■ Conséquences
Les études montrent que la méthode de planification stratégique choisie se prêterait bien à la promotion des ventes Par contre, des faiblesses apparaissent lorsqu’on s’écarte de la méthode, notamment lorsqu’on utilise en parallèle un seuil d’efficacité D’autres études s’imposent donc pour compléter l’analyse de portefeuille Le présent point de la situation sert de base à cette fin.
Une révision périodique de l’analyse de portefeuille est en l’occurrence prévue: l’attrait des investissements sera déterminé au moins tous les quatre ans. Si des SPM sont créés ou réévalués, on doit s ’attendre à une redistribution des fonds disponibles pour la promotion des ventes
2 . 1 P R O D U C T I O N E T V E N T E S 2 169
2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E
■ Analyse des objectifs
Etude sur le contingentement laitier
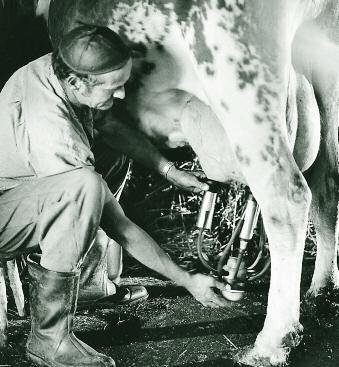
La mise en oeuvre de PA 2002 a bouleversé les organisations de marché et les mesures de soutien en Suisse. L’entrée en vigueur des accords bilatéraux entre la Suisse et l’UE entraînera d’autres changements encore dans le secteur agricole L’économie laitière est tout particulièrement touchée, puisque les échanges de fromage entre notre pays et l’Union seront libéralisés cinq ans après leur entrée en vigueur Dans ce contexte, on peut se demander comment seront gérées, à l’avenir, les quantités de lait produites en Suisse Le contingentement laitier, datant de 1977, est notamment remis en question, d’autant que l’UE a décidé de réexaminer ses quotas laitiers en 2003 et de les supprimer éventuellement en 2006
En 1999, l’OFAG a mandaté l’Institut d'économie rurale de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (prof B Lehmann) pour étudier la problématique du contingentement laitier. Les résultats d’une étude préliminaire ont été présentés dans le premier rapport agricole Les considérations ci-après font état des résultats les plus importants de l’étude principale
Celle-ci analyse, dans la perspective actuelle, les conséquences d’une éventuelle suppression du contingentement laitier ainsi que des nouvelles conditions économiques générales sur l’agriculture suisse, en fonction du degré de réalisation des objectifs de la politique agricole (analyse de l’effectivité) et de l’efficience de la gestion des quantités de lait produites. Elle présente par ailleurs des propositions concernant la réglementation de cette gestion après la suppression du contingentement (dispositions transitoires incluses)
Il est indispensable d’examiner et de rendre opérationnels les objectifs de la politique agricole suisse liés au contingentement laitier si l’on souhaite effectuer une analyse d’effectivité L’analyse des objectifs fait apparaître quatre faisceaux d’objectifs pertinents: compétitivité; aspects sociaux individuels; aspects sociaux régionaux; aspects écologiques et éthiques Les quatre faisceaux ont été subdivisés en objectifs partiels et rendus opérationnels au moyen d’indicateurs afin de mesurer l’impact de la suppression du contingentement laitier sur la réalisation des objectifs Les objectifs partiels et les indicateurs sont présentés en détail dans l’étude
2 . 1 P R O D U C T I O N E T V E N T E S 2 170
■ Modification de la demande de la matière première «lait»
La modification estimée de la demande joue un rôle dans la mesure où, en cas de suppression du contingentement laitier, de nouvelles conditions générales régiront la transformation du lait Il convient de prendre en considération cette évolution du marché pour déterminer l’effectivité et l’efficience de la mesure. On part du principe que la demande variera essentiellement suite à la mise en oeuvre des accords bilatéraux avec l’UE et à la réduction du soutien des prix en Suisse Ces nouvelles conditionscadre seront déjà en place au moment de la suppression du contingentement (date probable: cinq ans après l’entrée en vigueur des accords) Dix-huit interviews menés dans de grandes entreprises de transformation du lait ont permis d’établir la quantité potentielle de matière première «lait» pouvant être écoulée et le prix d’achat escompté (échelon producteur) En outre, douze experts du commerce de détail et des interprofessions ont été consultés.
Les entreprises sondées estiment que le prix de la matière première se situera dans une fourchette de 62 à 65 ct./kg de lait cru une fois le contingentement aboli. A leur avis, il en résultera une demande supplémentaire de 448'000 t de lait cru (+14% en comparaison avec le lait transformé en 2000, dont 29% vendus en Suisse et 71% exportés)
■ Trois variantes
Situation initiale avec contingentement laitier «aCL2000»: On la représente par des modélisations de dix types représentatifs d’exploitations. L’extrapolation des résultats donne une quantité de lait de 2,9 millions de t pour un prix de 80 ct /kg (structures d’exploitation données)
Variante de référence plausible «aCLR»: Dans ce cas de figure, le contingentement laitier est maintenu. Le prix du lait tombe à 65 ct./kg. Il s ’agit là d’un état estimé des prix et de paramètres économiques et techniques relatifs à la production en cas de maintien du contingentement laitier, mais à la condition de la réduction prévue du soutien et de l’ouverture du marché du fromage envers l’UE.
Variante sans contingentement laitier «sCL»: En l’espèce, la production de lait est de 3,8 millions de t, le prix variant entre 60 et 63 ct /kg de lait cru (structures d’exploitation optimisées à long terme) La différenciation des prix découle de l’écart des coûts de collecte et de transport (60 ct en montagne, 61 ct dans la zone des collines et 63 ct en plaine) Cette variante présuppose une grande élasticité des prix, impliquant un équilibre du marché (prix et quantités)
Si les modifications sont modélisées en termes régionaux, la production augmente d’environ 0,8 million de t (74%) en plaine et d’environ 0,3 million de t (30%) dans la zone des collines, alors qu ’elle diminue de 0,2 million de t (18%) en montagne
2 . 1 P R O D U C T I O N E T V E N T E S 2 171
2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E
L’analyse de la réalisation des objectifs permet d’apprécier les trois variantes précitées en termes d’écarts et d’indicateurs servant à rendre opérationnels les faisceaux d’objectifs et, partant, de constater si la réalisation des objectifs s ’améliore ou se détériore en fonction des alternatives retenues.
Une comparaison de la variante «sCL» avec la situation initiale «aCL2000» indique les changements résultant d’une suppression du contingentement laitier:
– La variante «sCL» améliore légèrement la compétitivité de l’agriculture par rapport à la situation initiale «aCL2000» La production augmente, de même que la variété des produits laitiers et la qualité du lait Par ailleurs, la baisse de la marge brute et du revenu des exploitations est minime.

– Quant à la situation dans le domaine social individuel, la variante «sCL» entraîne une faible détérioration par rapport à la situation initiale. Le revenu agricole baisse légèrement, car la suppression du contingentement laitier implique des coûts d’adaptation élevés pour les exploitations
– De même, la réalisation des objectifs ne se détériore que très peu pour le faisceau social régional par rapport à la situation initiale. Un certain appauvrissement des traditions agricoles et de la culture rurale est le prix à payer pour une meilleure collaboration au sein de l’agriculture
– Une suppression du contingentement produit un effet favorable sur la réalisation des objectifs écologiques et éthiques par rapport à la situation initiale Certes, la part des surfaces extensives diminue et le cheptel augmente, mais la surface des terres ouvertes diminue elle aussi et la part des systèmes de garde respectueux des animaux (SST) augmente.
Si l’on compare la variante «sCL» à la variante de référence plausible «aCLR», on arrive aux résultats suivants:
– En ce qui concerne la compétitivité, la réalisation des objectifs est en général meilleure sans contingentement
– Dans le domaine social individuel, la variante sans contingentement permet de mieux atteindre les objectifs que la variante «aCLR» Selon cette dernière, l’augmentation de la quantité produite dans l’exploitation ne suffit pas à compenser la baisse du prix, qui passe de 80 à 65 ct. C’est pourquoi le revenu se porte mieux en cas de suppression du contingentement que dans la variante de référence Seuls les coûts d’adaptation sont plus élevés dans le premier que dans le second cas de figure. A long terme, on peut toutefois s ’attendre à des coûts d’ajustement structurel plus importants même si le contingentement laitier est maintenu
2 . 1 P R O D U C T I O N E T V E N T E S 2 172
■ Analyse de la réalisation des objectifs
■ Analyse d’efficience
– Pour ce qui est du domaine social et régional, la situation sans contingentement est similaire à celle de la variante «aCLR» La collaboration interentreprises se développe davantage en cas de suppression Cependant, l’appauvrissement des traditions agricoles et de la culture rurale est plus marqué.
– La réalisation des objectifs écologiques et éthiques est analogue pour les deux variantes Les prairies extensives reculent davantage en cas de suppression du contingentement laitier, de même que les terres ouvertes La densité des cheptels augmente dans la variante «sCL» Les SST, quant à eux, progressent davantage sans contingentement
Une comparaison des rentes de producteurs, des rentes d’acheteurs et des dépenses de l’Etat avant et après la suppression du contingentement laitier permet d’établir l’efficience de la gestion des quantités produites. Le calcul porte sur l’ensemble du secteur laitier La somme des trois éléments précités donne la variation de la prospérité nette
Une suppression du contingentement laitier détériore la rente de producteurs L’augmentation du volume produit ne compense pas la baisse des prix. Par contre, la rente d’acheteurs augmente Enfin, les dépenses de l’Etat dans le secteur laitier diminuent Globalement, l’augmentation de la rente d’acheteurs et l’amélioration des finances de l’Etat font contrepoids à la réduction de la rente de producteurs.
■ Appréciation récapitulative
Les résultats de l’étude mènent aux conclusions suivantes:
Selon les analyses, une solution sans contingentement laitier paraît plus favorable en ce qui concerne la réalisation des objectifs de politique agricole et l’efficience sur le plan de l’économie nationale.
– La suppression du contingentement – engagée prudemment sous forme de réglementation transitoire – conduirait plus rapidement à des structures compétitives et rentables de la production laitière dans un cadre de concurrence (marché du fromage ouvert par rapport à l’UE et réduction du soutien lié à la production)
Grâce à un régime sans contingentement, la région de montagne continuera de jouer un rôle important dans la production laitière, à condition que les structures soient adaptées et que les débouchés soient mis à profit
– L’actuelle amélioration des débouchés est propice à la suppression du contingentement laitier dans les années à venir
2 . 1 P R O D U C T I O N E T V E N T E S 2 173
–
–
2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E
■ Réglementations après la suppression du contingentement laitier
L’étude propose aussi des mesures d’accompagnement consécutives à la suppression du contingentement laitier Fondamentalement, il convient de viser un système de gestion des quantités produites donnant un maximum de liberté aux partenaires commerciaux pour ce qui est des livraisons. On veillera en même temps à ce que ce système tienne raisonnablement compte des particularités des marchés agricoles Dans ce contexte, on propose, pour la période suivant la suppression du contingentement, un régime de contrats pluriannuels de livraison et d’achat En complément, des contrats à terme ou d'option fixes mais négociables devraient être introduits pour de plus brèves échéances Ce régime a pour objectif de promouvoir la stabilité et de battre en brèche les incertitudes En outre, un service d’information devrait assurer la transparence en matière de conditions contractuelles Il convient également d’examiner si une différenciation des aides de l’Etat entre la montagne et la plaine et un soutien de la répartition des tâches entre ces deux régions doivent être maintenus (référence supplémentaire: politique régionale) De plus, la Confédération pourrait au besoin soutenir les acteurs du marché laitier en versant une contribution forfaitaire unique par exploitation ou par société de laiterie leur permettant d’obtenir des conseils ciblés Les organisations du secteur laitier pourraient, dans ce nouveau contexte, assumer de nombreuses fonctions (p ex recommandations pour la mise au point des contrats, statistique et information, consultation)
■ Dispositions transitoires et suppression anticipée du contingentement
L’étude propose aussi des dispositions transitoires visant à éviter des réactions non souhaitables à court terme qui provoqueraient de fortes fluctuations de prix et de quantités sur le marché laitier, suite à la suppression des contingents au terme de la période transitoire La mise en oeuvre des dispositions transitoires repose sur l’hypothèse, bien fondée, selon laquelle les prix de la matière première «lait» baisseront ces prochaines années en Suisse même sans suppression du contingentement laitier (raisons: entrée en vigueur des accords bilatéraux, nouvelle réduction des aides dans la production laitière) La suppression du contingentement laitier crée donc la souplesse nécessaire à une production laitière moins onéreuse à l’échelon de l’exploitation agricole.
On peut s ’attendre à ce qu’à l’avenir les exploitations de plaine produisent, avec des structures rentables, entre 150'000 et 300'000 kg de lait Afin d’augmenter en conséquence le contingent moyen des exploitations, il est prévu de maintenir le commerce contingentaire pendant la période transitoire Pour chaque transfert de contingent, la Confédération permet à l’acheteur de demander une quantité supplémentaire de l’ordre de 40% des quantités achetées (év mise aux enchères, les ventes en cascade de contingents étant interdites). Ce pourcentage résulte du rapport entre la quantité de transfert souhaitée et la progression des ventes escomptée ces prochaines années Dans la région de montagne, la Confédération peut en outre augmenter les contingents pour la transformation sur place en fonction des débouchés potentiels supplémentaires On pourrait aussi envisager une telle mesure en cas de succès commercial pour certains créneaux fromagers (p ex contrats de livraison avec les transformateurs, portant sur des quantités dépassant les contingents pour des fromages AOC) Un service d'information devrait assurer la transparence et il est prévu d’octroyer des contributions pour des conseils ciblés.
2 . 1 P R O D U C T I O N E T V E N T E S 2 174
■ Bases théoriques
Ce régime transitoire permettrait d’augmenter sensiblement la quantité contingentaire transférée, et les droits de production iraient aux exploitations laitières porteuses d’avenir En outre, les exploitations qui ne misent pas sur la production laitière seraient incitées à céder leur contingent.
Il importe que les mesures transitoires proposées ne soient prises que dans la perspective d’une décision définitive sur la suppression du contingentement laitier, sans quoi elles seraient contreproductives Dans une prochaine étape, il convient d’élaborer les conditions juridiques et des plans d’action détaillés en vue d’une éventuelle suppression
Etudes sur le soutien du marché
Les mesures de soutien du marché avaient fait l’objet d’intenses discussions dans le cadre de la politique agricole 2002 En 1998, le Parlement a décidé de réduire d’un tiers les moyens financiers dans un délai de cinq ans à partir de l’entrée en vigueur de la nouvelle LAgr et de revoir lesdites mesures
L’OFAG a chargé l’Institut d'économie rurale de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (prof P Rieder), d’étudier les mesures de soutien du marché Sous le titre «Marktanalysen AP 2002» (MAAP 2002), les marchés du lait, de la viande et des œufs ont été étudiés en détail quant à la question du soutien du marché. Nous présentons brièvement ci-après les bases théoriques des études, puis les résultats des analyses déjà achevées pour le marché de la viande et celui des œufs
Les MAAP 2002 ont pour but d’analyser les influences économiques, écologiques et sociales de la politique agricole sur les marchés agricoles Les centres de gravité des recherches découlent des objectifs spécifiques formulés pour chaque marché Toutes les analyses prennent comme point de départ le marché qui, vu sous l’angle d’une maximisation de la prospérité, forme un système de référence On ne devrait théoriquement déroger à cette règle qu ’ en cas de défaillance du marché Celle-ci peut résulter des facteurs suivants: effets externes indésirables, biens publics, concurrence imparfaite, adaptation insuffisante et crises structurelles, carences dans l’information et comportements irrationnels des acteurs Les interventions de l’Etat sont nécessaires pour remédier aux carences (p ex lorsque ce sont des aspects de distribution et non d’efficience qui se situent au premier plan), mais ne doivent pas conduire à une défaillance de l’Etat.

2 . 1 P R O D U C T I O N E T V E N T E S 2 175
2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E
Une analyse complète des marchés agricoles doit prendre en compte les incertitudes en fonction de leur importance Vu les préférences de risque, les coûts d’adaptation et les éventuels coûts de mauvaises décisions politiques, il convient d’utiliser un ensemble de méthodes tenant compte de ces incertitudes lors de l’évaluation des instruments de politique agricole Les affirmations sur la légitimité, l’efficacité et l’efficience des instruments jouent un rôle capital L’évaluation de la politique au moyen de l’analyse du degré de réalisation des objectifs, de l’efficacité et de l’exécution, est le concept d’évaluation approprié pour MAAP 2002 Des méthodes descriptives ou empiriques sont appliquées pour apporter des réponses concrètes à certaines questions de la recherche (appréciation qualitative basée sur la théorie, statistique, économétrie, etc ) Les méthodes sont choisies de manière à trouver une réponse ciblée à un problème de recherche donné.
Objectif partiel 1
Objectif partiel 4
Objectif partiel 2 Objectif partiel 3
Sélection des questions de recherche
Choix de la théorie: théorie de la prospérité
Choix et application de la méthode
Evaluation de la politique
– Analyse du degré de réalisation des objectifs
Analyse d’impact
– Analyse d’application
Méthode au sens large
Evaluation qualitative basée sur la théorie
– Analyse statistique des données (ex post)
– Modèles économétriques (ex post)
Divers modèles (ex ante)
Analyse et interprétation des résultats
Conclusions
– Questions de recherches
(Pertinence de la théorie) – (Choix de la méthode)
descriptif
empirique
Source: Koch, Rieder
2 . 1 P R O D U C T I O N E T V E N T E S 2 176
MAAP 2002
Définition des objectifs MAAP 2002
Objectif principal
–
–
–
–
Méthodes
au sens strict
■ Marché de la viande: soutien étatique du stockage
Les marchés agricoles constituant des systèmes relativement complexes, il convient de porter une attention particulière au choix de leurs éléments, à leurs structures et à leur délimitation, ainsi qu ’ aux relations externes qui en résultent MAAP 2002 se fonde principalement sur des modèles économico-mathématiques partiels. D’une part, on utilise des modèles selon lesquels une situation donnée et son évolution doivent être expliquées (analyse ex post) D’autre part, des modèles d’équilibre et d’optimisation sont mis en œuvre, lorsque des constats doivent être faits sur des mesures politiques de substitution Un certain nombre de simulations sont effectuées à l’aide de ces derniers, car diverses incertitudes persistent si l’on utilise la modélisation des marchés ex ante
En ce qui concerne le marché de la viande, l’effet économique des stockages et déstockages, pour lequels des contributions sont allouées, revêt une grande importance Les art. 13 et 50 LAgr constituent la base autorisant des mesures de stabilisation des prix en cas d’affaiblissement saisonnier et temporaire
Une stabilisation efficace des prix par le soutien étatique du stockage exige des organes décisionnels qui puissent évaluer autant que faire se peut l’évolution future du marché. Par ailleurs, l’entreposage et le déstockage doivent être très souples pour que l’on puisse réagir rapidement aux fluctuations du marché Le soutien de l’Etat au stockage fausse fréquemment l’attrait des activités d’entreposage privées En outre, des mesures servant au départ à stabiliser peuvent, sous la pression d’intérêts politiques, mener à une politique de soutien des prix à long terme, ce qui ne correspond pas à l’objectif d’une politique étatique de stabilisation des prix L’influence du soutien du stockage a été analysée à l’aide de modèles de régression établis sur la base des données des années précédentes
En ce qui concerne les veaux de boucherie, on a étudié l’incidence des quantités produites, consommées, stockées et importées sur le prix mensuel au producteur Les plus grandes répercussions ont été relevées pour le volume de production escompté le mois suivant (-0,49), puis pour le volume de production du mois courant (-0,26) Ainsi, lorsque l’on s ’attend à un volume de production de 10% plus élevé pour le mois suivant, il en résulte une baisse de 4,9% sur le prix au producteur dans le mois courant (et vice versa) Ce résultat n ’est pas surprenant, car les partenaires commerciaux connaissent d’expérience l’évolution de l’offre saisonnière de la viande de veau Les volumes de consommation et d’importation n ’ont par contre qu ’ une faible incidence sur le prix des veaux de boucherie Il est intéressant de constater que l’augmentation des quantités stockées induit une baisse des prix au producteur. L’influence reste toutefois minime Une augmentation de 10% des stocks n ’entraîne qu ’ une réduction de prix de 0,06%
Cet effet a également été observé dans l’analyse relative aux taureaux Ici également, des volumes de stockage plus élevés ont pour conséquence des prix au producteur plus bas Pour les vaches par contre, on n ’observe aucune influence significative du volume de stockage sur les prix
2 . 1 P R O D U C T I O N E T V E N T E S 2 177
2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E
■ Marché des œufs: campagnes d'œufs cassés
Les entreposages de viande de veau subventionnés par l’Etat ont pour objectif de soutenir les prix au producteur pour les veaux de boucherie Les modèles de régression choisis n ’ont pas pu démontrer d’action positive sur les prix à la production: le marché de la viande de veau est constitué des deux marchés partiels «viande d’étal» et «viande à saucisse», et les actions d’entreposage concernent principalement le dernier La viande se prêtant à la consommation et à la transformation se compose à 80% de viande d’étal et à seulement 20% de viande à saucisse On peut donc douter que l’allégement du marché partiel «viande à saucisse» soutenu par l’Etat exerce une action favorable significative sur les prix au producteur pour les veaux de boucherie Cette interprétation vaut également pour l’entreposage de viande de taureau, de génisse et de bœuf L’étude indique que les stockages soutenus par l’Etat ne sont pas adaptés pour soutenir de manière significative les prix au producteur.
L’analyse du marché des œufs étudie le fonctionnement économique des mesures étatiques mises en œuvre sur le marché des œufs. Par ailleurs, l’intégration verticale fréquente entre les producteurs d’œufs et le commerce de gros est prise en compte dans l’analyse
L’objectif de la campagne d'œufs cassés est d’inciter les acheteurs à utiliser une partie des œufs de consommation produits dans le pays comme œufs de fabrication, du moment que la production saisonnière dépasse la demande Il s 'agit en l'occurrence d'une division classique du marché: pour une partie des œufs de consommation, le prix peut être maintenu au niveau de départ malgré le recul de la demande L’autre partie doit être vendue à bas prix pour une transformation de moindre valeur D’où des coûts pris en charge par l’Etat dans l’organisation actuelle du marché des œufs Du point de vue du bien-être, la campagne d'œufs cassés induit une augmentation du revenu du producteur tout en diminuant la rente d’achat de l’acheteur. Les rentes absolues dépendent du comportement des fournisseurs et des acheteurs en ce qui concerne les prix, donc de l’élasticité de l’offre et de la demande Une campagne d'œufs cassés permet, en situation de concurrence parfaite, de transférer une partie des rentes des acheteurs (ou consommateurs) vers les producteurs L’étude arrive à la conclusion que ces actions représentent une mesure relativement économique de soutien provisoire des prix au producteur
■ Marché des œufs: campagnes de ventes à prix réduits
L’Etat peut, à l’aide de campagnes de ventes à prix réduits, favoriser l’écoulement des œufs en période de demande faible Lorsque il y a intérêt à maintenir le prix à un certain niveau malgré un recul de la demande, on peut réduire les prix de l’offre au lieu de diviser le marché Il en résulte un transfert des fonds publics vers les producteurs et les acheteurs qui, en fin de compte, sont les consommateurs lorsque la concurrence est parfaite. L’élasticité de l’offre et de la demande est décisive pour l’attribution des fonds publics aux producteurs et aux consommateurs Les campagnes de ventes à prix réduits servant à soutenir les prix à la production sont des mesures relativement onéreuses sur des marchés inélastiques, comme c ’est le cas du marché suisse des œufs
2 . 1 P R O D U C T I O N E T V E N T E S 2 178
■ Marché des œufs: contributions aux frais de ramassage et de calibrage
Les entreprises qui prennent en charge des œufs auprès d’anciens producteurs protégés obtiennent, jusqu’à fin 2001, des contributions pour les frais de ramassage et de calibrage plus élevés qui en résultent Selon le nombre de places d’animaux utilisées, nombre allant de 500 à 12'000 places, les contributions se situent entre 6 et 1 ct /œuf L’étude considère ces contributions comme problématiques, car elles ont permis, ces dernières années, d’entretenir des structures qui, au vu des coûts de production et de ramassage élevés, n’étaient plus rentables et ne seront pas non plus compétitives à l’avenir Autre inconvénient: les contributions ne sont pas versées pour tous les œufs, mais uniquement aux producteurs protégés auparavant Le maintien de la mesure n ’est donc pas recommandé sous la forme actuelle

■ Marché des œufs: contributions de reconversion
Les contributions de reconversion sont versées jusqu’à fin 2001 aux exploitations gardant au minimum 500, mais au maximum 2'400 pondeuses Cette limite supérieure est jugée problématique par l’étude, en raison de son impact sur l’orientation des structures Elle a notamment motivé de petites exploitations à adopter les programmes SST et SRPA, l’indemnisation de 7 fr 50 par pondeuse et par année étant une incitation assez intéressante Il n ’est cependant pas certain que ces exploitations, ayant investi dans des systèmes de stabulation respectueux des animaux sur incitation de l’Etat, puissent rester compétitives.
■ Marché des œufs: production verticale sous contrat
Par production verticale sous contrat, nous entendons la collaboration garantie par contrat entre exploitations agricoles et entreprises des échelons économiques situés en amont et en aval de l’agriculture Elle a gagné en importance sur le marché des œufs au cours des dernières années
Les producteurs et les acheteurs tirent un certain nombre d’avantages de tels contrats de prise en charge: la production est adaptée au marché, divers risques de production et de marché peuvent être réduits, de même que les coûts de transaction (frais de recherche, de convention etc.). En ce qui concerne le marché des œufs, les commerçants ont intérêt à disposer de directives strictes régissant la production d’œufs en Suisse, vu les importantes variations saisonnières de la demande et les divers risques de production (p ex salmonelles) Dans le cadre de l’analyse des conditions contractuelles, la répartition du risque lié à la fluctuation des prix entre producteur et acheteur présente un avantage particulier L’étude arrive à la conclusion que selon les contrats conclus dans le secteur suisse des œufs le risque lié à la fluctuation des prix incombe presque totalement aux producteurs dans un grand nombre de cas Ceux-ci sont généralement pénalisés par ce système.
2 . 1 P R O D U C T I O N E T V E N T E S 2 179
2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E
■ Modifications des droits de douane et des volumes de contingents tarifaires
Etudes d’accès au marché
Les études d’accès au marché ont été mandatées par l’OFAG en 1999 dans le contexte du nouveau cycle de négociations de l’OMC. L’Institut d'économie rurale de l’EPFZ a été chargé de cette tâche (R Jörin) Le projet aborde trois questions:
Quel est l’impact des modifications des droits de douane et de la taille des contingents tarifaires sur le marché intérieur?
– Quelles répercussions les modifications du mode de répartition des contingents tarifaires ont-elles sur l’accès au marché?
– Quelles sont les alternatives aux dispositions actuelles en matière d’accès au marché?
D’une part, les divers instruments régissant cet accès ont fait l’objet d’une analyse générale. D’autre part, les domaines spécifiques des divers marchés ont été étudiés plus en détail Nous présentons ci-après les principaux résultats concernant tous les marchés Viennent ensuite les résultats existants à ce jour pour les marchés des céréales et du vin
Dans le domaine de l’accès au marché, l’accord de l’OMC de 1994 englobe, outre les droits de douane, les contingents tarifaires Ces deux instruments permettent d’assurer une certaine protection agricole. L’analyse effectuée sous l’angle du bien-être dans le cadre de l’étude de l’EPFZ montre que la protection de l’agriculture au moyen de droits de douane uniformes est moins onéreuse pour l’économie nationale que la gestion des importations à l’aide de contingents tarifaires C’est en particulier le cas lorsque le THC est relativement élevé Si les importations sont très entravées, les échelons en aval de la filière agricole bénéficient également de la protection, ce qui fait obstacle à la concurrence Lorsque la situation de concurrence ne se vérifie plus à tous les échelons du secteur agro-alimentaire, des marges supplémentaires apparaissent, au détriment des consommateurs et des producteurs. L’absence de concurrence engendre une perte d’efficacité et des frais pour l’économie nationale (problème d’efficience) Le système des contingents tarifaires devrait alors être remplacé par des droits de douane
■ Système des prix-seuils pour la réglementation de l’accès au marché
Les droits de douane variables permettent de maintenir des prix-seuils fixes et, partant, d’obtenir des prix à la production stables Or, l’expérience montre que la stabilité des prix, c ’est-à-dire des risques faibles, incitent à accroître l’offre C’est ainsi que l’UE, importateur net auparavant, est devenue dans les années septante exportateur net grâce à son système de prélèvement et ses subventions à l’exportation C’est précisément à cause de ces effets négatifs sur le commerce mondial que les systèmes des droits de douane variables sont contraires aux objectifs de l’OMC. Malgré cela, même après le cycle de l'Uruguay, des systèmes stabilisant les prix intérieurs à la production sont encore appliqués Les systèmes de prix-seuils ont donc été étudiés plus précisément comme alternative possible dans les études de marchés individuels
2 . 1 P R O D U C T I O N E T V E N T E S 2 180
–
■ Procédures administratives versus mise en adjudication de contingents tarifaires
D’un point de vue économique, les mises en adjudication offrent, par rapport aux procédures administratives, les avantages suivants:
Toutes les entreprises intéressées ont accès aux droits d’importation. Vu sous l’angle de la concurrence, généralement compromise par les dispositions d’importation quantitatives, cette caractéristique revêt une importance particulière Or, moins il y a de concurrence, plus la répartition devient inefficace (problème d’efficience) La mise aux enchères permet à l’Etat de prélever les rentes contingentaires qui, dans le cas des procédures administratives, sont réalisées par les importateurs Si aucune prestation ne correspond à ces recettes, ce type de répartition devient délicat (problème de répartition) L’adjudication devrait principalement s ’appliquer aux contingents tarifaires pour lesquels il existe une demande importante.
■ Cas particulier «prestation fournie en faveur de la production suisse»
Dans le système de la répartition liée à une prestation en faveur de la production suisse, seules les entreprises achetant des produits indigènes obtiennent un droit d’importation La concurrence sur le marché suscite aussi une concurrence dans la répartition des droits d’importation En cela, le système des prestations en faveur de la production indigène se distingue des procédures administratives La principale question est toutefois de déterminer si la concurrence est effective. La forte concentration aux échelons situés en aval de l’agriculture et l’accès limité aux droits d’importation (critères concernant les prestations à fournir en faveur de la production suisse) expliquent pourquoi la concurrence n ’est pas parfaite. Or, une concurrence imparfaite engendre non seulement des rentes contingentaires, mais aussi des marges supplémentaires, au détriment des consommateurs et des producteurs

2 . 1 P R O D U C T I O N E T V E N T E S 2 181
2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E
■ Marché des céréales

L’étude individuelle sur les céréales devait évaluer les répercussions de la nouvelle organisation du marché en fonction des systèmes douaniers possibles L’accent de l’étude a été mis sur un pronostic du prix des céréales panifiables et fourragères dans les années 2001 à 2005 aux conditions suivantes:
– conserver le contingent tarifaire pour les céréales panifiables et le système de prixseuil pour les céréales fourragères;
– mettre en place un système de prix-seuil pour les céréales panifiables et fourragères; et
– introduire un système de droit de douane unique pour les céréales panifiables et fourragères
Sur la base de considérations théoriques, l’étude arrive à la conclusion que la dissociation d’un marché agricole du marché mondial ne conduit pas automatiquement à une situation stable sur le marché intérieur. Dans un petit pays subissant des variations de l’offre et de la demande, bénéficiant d’un degré d'autosuffisance élevé, mais ne disposant pas de possibilités d’exportation suffisantes, l’isolement peut au contraire être à l’origine d’instabilités du marché
Des influences significatives sur l’évolution moyenne du rendement n ’ont pu être démontrées que pour le progrès biologique et technique et pour la météo L’introduction du programme de cultures extensives de la Confédération n ’ a eu aucune répercussion négative. L’approche choisie n ’ a pas confirmé l’hypothèse selon laquelle la culture des céréales se serait concentrée sur les régions présentant les meilleurs rendements à la suite des baisses de prix dans les dernières années
Les calculs utilisant des modèles indiquent que le système des droits de douane revêtira une importance capitale en 2005, tant pour les prix des céréales panifiables que pour ceux des céréales fourragères Outre le système même, le montant des droits de douane et le volume des contingents tarifaires ont une influence sur les prix escomptés et sur leurs fourchettes de variation. Si le contingent tarifaire devait être maintenu, les variations les plus importantes seraient certainement enregistrées au niveau des prix des céréales panifiables indigènes
La libéralisation du marché suisse des céréales a des répercussions tant sur le commerce de ces produits que sur la transformation et la garde d’animaux Vu les exigences diverses en matière de production et des labels différents pour les céréales bio et PI, on peut parler d’une division du marché des céréales panifiables en trois marchés partiels (bio, PI et conventionnel).
Les surcapacités laissent présager, pour les années à venir, une accentuation de l’évolution structurelle des moulins à céréales panifiables et de la branche des aliments composés par rapport à la dernière décennie La concurrence acharnée entre les transformateurs des deux branches accélérera ce processus Compte tenu de la baisse des coûts des aliments composés, les frais de production devraient diminuer de 6% au plus jusqu’en 2005 dans la garde d’animaux traditionnelle
2 . 1 P R O D U C T I O N E T V E N T E S 2 182
En vertu de la législation (art. 55 LAgr) et en raison des inconvénients de coûts absolus et relatifs, la culture des céréales suisse bénéficie de paiements directs et d’une protection à l’importation appropriée L’étude recommande, à brève échéance, de poursuivre de manière conséquente le regroupement du marché des céréales panifiables et fourragères entamé avec PA 2002 et d’utiliser le même système de droits de douane pour les deux types de céréales On peut éliminer les incertitudes sur le marché céréalier suisse liées aux variations des prix du marché mondial et des taux de change en remplaçant le contingent tarifaire par un système de prix-seuil A moyen et à long terme, on devra toutefois adopter un système à droit unique, car il faudra s ’attendre à une stabilisation globale des prix des céréales suite à l’intégration des marchés nationaux au marché mondial
L’étude individuelle sur le vin portait sur les deux questions suivantes:
– Quel impact aurait, sur le marché suisse, une augmentation ou une suppression du contingent tarifaire?
Quelles seraient les conséquences d’une harmonisation des droits de douane sur les différentes catégories de vins importés?
Le contingent global de vins rouges et de vins blancs n ’est pas limitatif, vu la situation du marché Dans ces conditions, le choix du système du fur et à mesure est approprié pour la répartition des contingents tarifaires, notamment parce qu’il est plus simple du point de vue administratif que celui des ventes aux enchères Toutefois, si le contingent reste inchangé et que la situation sur le marché évolue, c ’est-à-dire que les importations augmentent, ce contingent pourrait devenir contraignant Cela donnerait lieu à des rentes contingentaires, qui auraient des conséquences négatives pour l’économie Si à l’avenir, les conditions du marché devaient connaître d’importantes mutations, le contingent tarifaire devrait à nouveau être mis aux enchères, pour des raisons liées à la politique de la concurrence C’est pourquoi, il est essentiel que le marché soit continuellement observé avec toute l’attention requise.
Une étude menée par l’EPFZ sur les conséquences d’une augmentation ou d’une suppression du contingent global a donné les résultats suivants: si, dans des conditions normales, le prix pratiqué sur le marché intérieur est soutenu grâce au taux du contingent (TC), une augmentation du contingent tarifaire n ’ a pas d’influence sur la formation du prix Etant donné l’ampleur du volume importé, qui pour le vin représente 60% du marché, le soutien du prix par le biais du TC produit son effet, même en cas de récolte abondante. Toutefois, cet effet sera réduit pour le vin blanc, étant donné la part aux importations plus faible que pour le vin rouge
2 . 1 P R O D U C T I O N E T V E N T E S 2 183
–
2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E
■ Marché vinicole
Dans la pratique, les premières expériences acquises après le regroupement des contingents ont permis de constater que le prix du vin blanc suisse subissait de fortes pressions Les prix à l’importation baissent, ce qui occasionne une suppression partielle de la protection tarifaire. Sur le marché mondial, on peut obtenir des vins rouges ou blancs à des prix largement inférieurs à un franc le litre Une observation précise de l’évolution, en 2001, des quantités importées et des prix à l’importation permettra d’en savoir davantage
Une harmonisation des droits de douane pour le vin en bouteilles et en fûts d’une valeur de 50 fr /hl ne devrait pas, d’après l’étude de l’EPFZ, grever davantage les importations La baisse relative des droits de douane pour le vin en bouteille (jusqu’ici plus élevés) correspond exactement à l’augmentation relative des droits de douane pour le vin en fûts La question de savoir dans quelle mesure les droits de douane peuvent être majorés au sein de l’OMC, même lorsque cela est compensé ailleurs (vin en bouteilles), reste en suspens. Quoi qu’il en soit, une harmonisation accentuerait encore la propension à importer du vin en bouteilles

184 2 . 1 P R O D U C T I O N E T V E N T E S 2
2.2 Paiements directs
Les paiements directs sont l’élément principal de la politique agricole. Ils permettent de séparer la politique des prix de celle des revenus et, surtout, de rétribuer les prestations fournies à la demande de la collectivité On fait une distinction entre les paiements directs généraux et les paiements directs écologiques
Dépenses pour les paiements directs
Remarque: une comparaison directe avec les données du Compte d’Etat est impossible Les valeurs indiquées sous 2 2 «Paiements directs» se rapportent à l’ensemble de l’année de contributions, alors que le Compte d’Etat indique les dépenses d’une année civile

■■■■■■■■■■■■■■■■
Domaine des dépenses 1999 2000 mio de fr mio de fr Paiements directs généraux 1 779 1 804 Paiements directs écologiques 326 361 Total 2 105 2 165
Source: OFAG 2 . 2 P A I E M E N T S D I R E C T S 2 185
■ Rétribution de prestations fournies dans l’intérêt général
2.2.1 Importance des paiements directs
Ces prestations de l’agriculture sont rétribuées au moyen des paiements directs généraux En font partie les contributions à la surface et les contributions pour les animaux consommant des fourrages grossiers, contributions qui ont pour objectif d’assurer l’exploitation et l’entretien de toute la surface agricole Dans la région des collines et de montagne, les agriculteurs touchent en outre des contributions pour des terrains en pente et d’autres pour la garde d’animaux dans des conditions difficiles Il est ainsi tenu compte des difficultés d’exploitation dans ces régions Les prestations écologiques requises (PER) sont le préalable de l’octroi de tous les paiements directs (contributions d’estivage exceptées).

■ Rétribution de prestations écologiques particulières
Les paiements directs écologiques sont une incitation à fournir des prestations écologiques particulières qui dépassent le cadre des PER En font partie les contributions écologiques, les contributions d’estivage et celles qui sont allouées pour la protection des eaux On entend par là préserver et accroître la diversité des espèces dans les régions agricoles, diminuer la pollution des eaux par les nitrates et par les phosphates, tout en soutenant les systèmes de garde d’animaux de rente particulièrement respectueux de l’espèce et en favorisant l’exploitation durable de la région d’estivage
■■■■■■■■■■■■■■■■
2 . 2 P A I E M E N T S D I R E C T S 2 186
■ Importance économique des paiements directs en 2000
directs en 2000
En 2000, les paiements directs ont représenté quelque 64% des dépenses de l’OFAG. Le 64% de tous les paiements directs sont allés à la région des collines et de montagne
Remarque: une comparaison directe avec les données du Compte d’Etat est impossible Les valeurs indiquées sous 2 2 «Paiements directs» se rapportent à l ensemble de l année de contributions, alors que le Compte d’Etat indique les dépenses d’une année civile
La région des collines et de montagne est défavorisée sur le plan des conditions de production. En voici les principaux inconvénients:
– période de végétation plus courte, d’où des rendements réduits et des dépenses plus élevées pour la conservation des aliments pour animaux, périodes de travail très intensif;
– exploitation des terrains en pente plus difficile, mécanisation plus chère et moins performante;
– voies de communication généralement moins favorables, d’où prolongation des trajets et surcroît de dépenses pour les transports, les chemins d’école, les marchés, les acquéreurs de produits, les achats, etc
Paiements
Type de contribution Total Région Région Région de plaine des collines de montagne 1 000 fr Total paiements directs 2 164 967 Paiements directs généraux 1 803 658 625 598 475 026 692 957 Contributions à la surface 1 186 770 552 878 305 495 328 397 Contributions pour la garde d’animaux consommant des fourrages grossiers 258 505 67 444 64 265 126 795 Contributions pour la garde d’animaux dans des conditions difficiles 251 593 2 989 70 423 178 181 Contributions générales pour des terrains en pente 96 714 2 287 34 843 59 584 Contributions pour les surfaces viticoles en forte pente et en terrasses 10 076 Paiements directs écologiques 361 309 Contributions écologiques 278 981 151 359 76 123 51 500 Contributions à la compensation écologique 108 130 58 885 29 378 19 867 Contributions pour la culture extensive de céréales et de colza (culture extensive) 33 398 22 103 10 128 1 168 Prairies extensives aménagées sur des terres assolées gelées (dispositions transitoires limitées à fin 2000) 17 150 14 861 2 243 46 Contributions pour la culture biologique 12 185 4 585 2 520 5 080 Contributions pour la garde d’animaux de rente particulièrement respectueuse de l’espèce 108 118 50 925 31 855 25 339 Contributions d’estivage 81 238 Contributions pour la protection des eaux 1 090
Source: OFAG
2 . 2 P A I E M E N T S D I R E C T S 2 187 2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E
Part des paiements directs au rendement brut des exploitations, selon la région, en 2000
L’exploitation plus difficile de ces régions est compensée à l’aide de contributions pour la garde d’animaux dans des conditions difficiles, de contributions pour des terrains en pente et de contributions d’estivage Il s ’ensuit que la somme des paiements directs par ha augmente proportionnellement aux difficultés d’exploitation Comme les rendements sont inférieurs en montagne, la part des paiements directs au rendement brut y occupe une place d’autant plus importante par rapport à la plaine
Pour toucher des paiements directs, les agriculteurs doivent satisfaire à de nombreuses exigences Celles-ci comprennent des conditions générales telles que forme juridique, domicile de droit civil, etc ; s ’ y ajoutent des critères structurels et sociaux, eux aussi déterminants, tels que la taille minimale de l’exploitation, le besoin minimal en travail de 0,3 unité de main-d'oeuvre standard, l’âge de l’exploitant, le revenu et la fortune. Enfin, mentionnons les charges écologiques spécifiques qui concernent le domaine de l’environnement et sont regroupées sous la notion d’exigences PER En font partie le bilan de fumure équilibré; la part équitable de surfaces de compensation écologique; l’assolement régulier; la protection appropriée du sol; la sélection et l’utilisation ciblée des produits de traitement des plantes ainsi que la garde d’animaux de rente respectueuse de l’espèce Toute infraction aux prescriptions pertinentes entraîne des sanctions sous forme d’une réduction ou d’un refus des paiements directs
2 . 2 P A I E M E N T S D I R E C T S 2 188
Caractéristique Unité Total Région de Région des Région de plaine collines montagne Exploitations Nombre 3 419 1 517 1 017 885 SAU en Ø ha 18,78 19,41 17,83 18,63 Paiements directs généraux fr 31 858 24 416 31 976 44 876 Contributions écologiques fr 5 542 6 560 5 607 3 677 Total paiements directs fr 37 400 30 976 37 583 48 553 Rendement brut fr 199 145 242 054 183 249 191 707 Part des paiements directs au rendement brut % 18,8 12,9 20,5 34,8 Source: FAT
Tableaux 37a-38, pages A43-A46
Définitions et méthodes, page A86
■ Exigences requises pour l’octroi de paiements directs
■ Distribution des paiements directs dans l’optique des bénéficiaires
La plupart des données statistiques sur les paiements directs à l’appui du présent chapitre proviennent de la banque de données SIPA (système d'information pour la politique agricole) développée par l’OFAG Ce système est alimenté, d’une part, par les relevés annuels des données structurelles lesquels sont compilés et transmis par les cantons et, d’autre part, par les indications relatives aux versements (surfaces, cheptels et contributions pertinentes) de chaque type de paiement direct La banque de données sert en premier lieu au contrôle administratif des montants versés aux exploitants par les cantons Autre fonction du système: établir des statistiques générales sur les paiements directs Grâce à la richesse d’informations et à l’existence de moyens informatiques performants, bon nombre de questions de politique agricole peuvent être éclairées sous des angles différents A la demande de la Commission de gestion du Conseil des Etats, nous abordons ci-après la répartition des paiements directs du point de vue des bénéficiaires Les aspects suivants présentent un intérêt particulier:
importance des restrictions juridiques dans le domaine des paiements directs;
– répercussions des échelonnements et des limitations prévus dans l’ordonnance sur les paiements directs;
– répartition des paiements directs selon les critères du mode de production, du type d’exploitation, du nombre d’UMOS et de l’âge;
– régions bénéficiaires des paiements directs.
Sur les 72’930 exploitations enregistrées dans le SIPA, 60’702 ont touché des paiements directs en 2000. La plupart des 12'228 exploitations restantes sont trop petites pour avoir droit à des contributions, parce qu ’elles disposent de trop peu de surface ou de trop peu d’UMOS
■ Répercussions des échelonnements et des limitations
Les échelonnements et les limitations ont un effet sur la répartition des paiements directs Pour ce qui est des limitations, il s ’agit de limites de revenu et de fortune ainsi que du montant maximum par UMOS; les échelonnements dégressifs concernent, quant à eux, les surfaces et les animaux.
Effets des limites d’octroi de paiements directs en 2000
Limitation Entreprises Montant Part au total Part à la somme concernées total des contributions totale des réductions des exploitations paiements concernées directs (CH)
Source: OFAG
2 . 2 P A I E M E N T S D I R E C T S 2 2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E 189
–
Nombre fr %% par UMOS (45 000 fr.) 1 555 2 035 911 3,44 0,09 en fonction du revenu 2 692 9 742 376 10,74 0,45 en fonction de la fortune 428 5 107 741 47,91 0,24
Les limites d’octroi entraînent des réductions de paiements directs, surtout pour les 428 entreprises dont la fortune est trop élevée Quelque 2’700 exploitations ont été touchées par les limites de revenu en 2000 La réduction de leurs paiements directs s ’est montée à 10% en moyenne. Globalement, les limites d’octroi ont conduit à des réductions de près de 17 millions de francs, ce qui représente 0,78% du montant total
Effets de l’échelonnement des contributions en fonction de la surface ou du nombre d’animaux
En tout, 7'091 exploitations sont concernées par les échelonnements prévus dans l’ordonnance sur les paiements directs Dans la plupart des cas, les réductions portent sur diverses mesures Elles se chiffrent globalement à près de 25 millions de francs et se répercutent notamment sur les contributions à la surface, pour lesquelles des échelonnements sont appliqués à plus de 6’000 exploitations (10% de toutes les exploitations touchant des paiements directs). Quant aux exploitations au bénéfice de contributions pour la garde d'animaux consommant des fourrages grossiers, les réductions concernent 126 d’entre elles; en effet, d’autres limitations telles que la limite d’octroi et la déduction pour le lait commercialisé entrent ici en jeu dès avant l’échelonnement des paiements directs Les paiements directs écologiques sont eux aussi concernés par les réductions de contributions Ainsi, les contributions pour la garde d'animaux particulièrement respectueuse de l'espèce (SRPA, SST) sont réduites de 7 à 10% pour environ 2'300 exploitations, alors que quelque 500 exploitations bio touchent des paiements directs réduits de 8%. Ces réductions représentent 1,34% du montant total des paiements directs
2 . 2 P A I E M E N T S D I R E C T S 2 190
Mesure Entreprises Surface ou Réduction Part dans la Part à la
par contribution somme exploitation totale Nombre ha ou UGB fr %% Contributions à la surface 6 362 41,4 22 478 139 7,2 1,89 Contributions pour la garde d’animaux consommant des fourrages grossiers 126 60,6 430 206 6,9 0,02 Contributions générales pour des terrains en pente 68 34,9 33 381 3,4 0,03 Contributions pour les vignes en forte pente et en terrasses 0 0,0 0 0,0 0,00 Contributions à la compensation écologique 6 39,8 20 440 9,3 0,02 Contributions pour la culture extensive de céréales et de colza (culture extensive) 30 38,4 24 725 5,5 0,07 Contributions pour la culture biologique 481 39,4 222 748 7,8 1,83 Contributions pour les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux 902 65,3 602 266 9,8 2,43 Contributions pour les sorties régulières en plein air 1 414 61,3 881 947 7,3 1,06 Total 7 091 1 24 693 852 7,2 1,34 1 sans cumul Source: OFAG
concernées effectif
■ Répartition des paiements directs selon le mode de production
Pour l’évaluation des modes de production, on opère les distinctions suivantes: exploitations fournissant les PER; entreprises fournissant non seulement les PER mais observant en plus les règles de l’agriculture biologique (exploitations bio); exploitations bénéficiaires de paiements directs sans qu ’elles ne fournissent les PER (exploitations dites «traditionnelles»)

Paiements directs versés en 2000 aux exploitations PER
Paiements directs versés en 2000 aux exploitations bio
2 . 2 P A I E M E N T S D I R E C T S 2 2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E 191
0 –5 0 0 0 1 0 0 0 1 –1 5 0 0 0 2 0 0 0 1 –2 5 0 0 0 3 0 0 0 1 –3 5 0 0 0 4 0 0 0 1 –4 5 0 0 0 5 0 0 0 1 –5 5 0 0 0 6 0 0 0 1 –6 5 0 0 0 7 0 0 0 1 –7 5 0 0 0 8 0 0 0 1 –8 5 0 0 0 9 0 0 0 1 –9 5 0 0 0 1 0 0 0 0 1 –1 0 5 0 0 0 1 1 0 0 0 1 –1 1 5 0 0 0 1 2 0 0 0 1 –1 2 5 0 0 0 1 3 0 0 0 1 –1 3 5 0 0 0 1 4 0 0 0 1 –1 4 5 0 0 0 1 5 0 0 0 1 –1 5 5 0 0 0 N o m b r e N o m b r e c u m u l é e n % Paiements directs en francs Moyenne = 34 701 fr Source: OFAG 7 500 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 6 750 6 000 5 250 4 500 3 750 3 000 2 250 1 500 750 0
0 –5 0 0 0 1 0 0 0 1 –1 5 0 0 0 2 0 0 0 1 –2 5 0 0 0 3 0 0 0 1 –3 5 0 0 0 4 0 0 0 1 –4 5 0 0 0 5 0 0 0 1 –5 5 0 0 0 6 0 0 0 1 –6 5 0 0 0 7 0 0 0 1 –7 5 0 0 0 8 0 0 0 1 –8 5 0 0 0 9 0 0 0 1 –9 5 0 0 0 1 0 0 0 0 1 –1 0 5 0 0 0 1 1 0 0 0 1 –1 1 5 0 0 0 1 2 0 0 0 1 –1 2 5 0 0 0 1 3 0 0 0 1 –1 3 5 0 0 0 1 4 0 0 0 1 –1 4 5 0 0 0 1 5 0 0 0 1 –1 5 5 0 0 0 N o m b r e N o m b r e c u m u l é e n % Paiements
ncs Moyenne = 44 813 fr Source: OFAG 500 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0
directs en fra
Paiements directs versés en 2000 aux exploitations traditionnelles
En 2000, 60'702 exploitations ont touché des paiements directs, dont 51'822 exploitations PER, 4'904 exploitations bio et 3'976 exploitations dites traditionnelles. Avec 44'800 francs en moyenne, ce sont les exploitations bio qui ont touché le plus de paiements directs par exploitation, en l’occurrence quelque 10'000 francs de plus que les exploitations PER. Quant au montant moyen versé aux exploitations traditionnelles, il s ’est chiffré à 11’000 francs environ Il s ’agit généralement d’entreprises de taille modeste (8 ha en moyenne, contre 16 et 17 ha respectivement pour les exploitations bio et PER), qui peuvent prétendre à des paiements directs jusqu’à fin 2001 en vertu des mesures transitoires
Les paiements directs sont concentrés sur les entreprises respectueuses de l’environnement dans leurs modes d’exploitation En 2000, 98% des paiements directs ont été alloués aux exploitations PER et aux entreprises combinant celles-ci avec l’agriculture bio

0 –5 0 0 0 1 0 0 0 1 –1 5 0 0 0 2 0 0 0 1 –2 5 0 0 0 3 0 0 0 1 –3 5 0 0 0 4 0 0 0 1 –4 5 0 0 0 5 0 0 0 1 –5 5 0 0 0 6 0 0 0 1 –6 5 0 0 0 7 0 0 0 1 –7 5 0 0 0 8 0 0 0 1 –8 5 0 0 0 9 0 0 0 1 –9 5 0 0 0 1 0 0 0 0 1 –1 0 5 0 0 0 1 1 0 0 0 1 –1 1 5 0 0 0 1 2 0 0 0 1 –1 2 5 0 0 0 1 3 0 0 0 1 –1 3 5 0 0 0 1 4 0 0 0 1 –1 4 5 0 0 0 1 5 0 0 0 1 –1 5 5 0 0 0 N o m b r e N o m b r e c u m u l é e n % Paiements directs en francs Moyenne = 10 966 fr Source: OFAG 1 500 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1 350 1 200 1 050 900 750 600 450 300 150 0 2 . 2 P A I E M E N T S D I R E C T S 2 192
■ Répartition des paiements directs selon le type d’exploitation
Pour son dépouillement centralisé des données comptables, la FAT se réfère à 11 types d’exploitation différents Cette typologie peut aussi s ’appliquer aux exploitations saisies dans le SIPA
Répartition des paiements directs selon le type d'exploitation, en 2000
Lait commercialisé
Combiné autres
Combiné transformation
Combiné lait commercialisé/grandes cultures
Autre bétail bovin
Chevaux/moutons/ chèvres
Cultures spéciales
Grandes cultures
Vaches mères
Combiné vaches mères
L’importance de la production laitière pour l’agriculture suisse est évidente. Quelque 20'000 exploitations se sont en effet spécialisées dans cette branche En tout, 750 millions de francs de paiements directs leur sont alloués, soit 37’500 francs en moyenne Touchant des montants respectifs de 54'300 et de 45'900 francs par unité, les exploitations «combinées vaches mères» et «vaches mères» reçoivent sensiblement plus A l’autre bout, on trouve les exploitations pratiquant les cultures spéciales qui touchent 15'500 francs en moyenne
T y p e s d ' e x p l o i t a t i o n F A T
Transformation
Nombre Source: OFAG 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 Nomb
d'exploitations Somme des paiements directs 0 100 200 300 400 500 mio de fr 600 700 800 900 1 000 2 . 2 P A I E M E N T S D I R E C T S 2 2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E 193
re
■ Répartition selon les unités de main-d’oeuvre standard
Les paiements directs ne sont versés que si l’exploitation exige le travail d’au moins 0,3 UMOS.
Répartition des paiements directs pas UMOS, en 2000
Il ressort du classement des exploitations par UMOS que 5'279 exploitations agricoles utilisent entre 0,3 et 0,5 UMOS, ce qui représente environ 8,7% de toutes les entreprises agricoles ayant droit aux paiements directs Par contre, la part de paiements directs versés par la Confédération en 2000 n ’ a été que de 2,7%. A peine 3% des paiements directs alloués en 2000 ont bénéficié aux plus grandes exploitations, utilisant plus de 5 UMOS Le suivi de cette statistique dans les années à venir montrera les effets de PA 2002 sur le développement des structures d’entreprise
2 . 2 P A I E M E N T S D I R E C T S 2 194 Type d’exploitation 1 Paiements directs par exploitation fr Exploitation combinées: vaches mères 54 276 Vaches mères 45 902 Autres bovins 38 684 Lait commercialisé 37 318 Exploitations combinées: grandes cultures + lait 37 117 Autres exploitations combinées 33 966 Transformation combinée 33 868 Grandes cultures 31 093 Perfectionnement 27 746 Chevaux/moutons/ chèvres 21 391 Cultures spéciales 15 518
1 Ces types d’exploitations correspondent aux catégories de la typologie FAT Source: OFAG
< 0 , 5 0 0 , 5 0 –0 , 9 9 1 , 0 0 –1 , 4 9 1 , 5 0 –1 , 9 9 2 , 0 0 –2 , 4 9 2 , 5 0 –2 , 9 9 3 , 0 0 –3 , 4 9 3 , 5 0 –3 , 9 9 4 , 0 0 –4 , 4 9 4 , 5 0 –4 , 9 9 5 , 0 0 –5 , 4 9 5 , 5 0 –5 , 9 9 6 , 0 0 –6 , 4 9 6 , 5 0 –6 , 9 9 7 , 0 0 –7 , 4 9 7 , 5 0 –7 , 9 9 e t d a v a n t a g e N o m b r e d ' e x p l o i t a t i o n s P a i e m e n t s d i r e c t s c u m u l é s, e n % UMOS Moyenne = 1,759 UMOS Source: OFAG Nombre d' exploitations Paiements directs cumulés, en % 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0
■ Répartition des paiements directs selon l’âge
Pour cette évaluation, il n ’ a été tenu compte que des formes juridiques «personnes physiques» ou «société de personnes», soit de quelque 58'372 exploitations sur les 60'702 ayant droit aux contributions
Répartition des paiements directs selon la classe d'âge, en 2000
■ Répartition des paiements directs selon les régions bénéficiaires
Pour ce qui est des bénéficiaires, c ’est la classe d’âge entre 35 et 55 ans qui domine. Le 45% des paiements directs ont en l’occurrence été alloués à des exploitants de moins de 40 ans
L’élaboration de cartes dressées à l’aide d’un système d'information géographique (SIG) et des données SIPA correspondantes permet de donner une vue d’ensemble de l’importance régionale des paiements directs Les deux premières cartes illustrent la structure d’exploitation (moyenne de SAU et d’UGB dans la commune) et servent de base pour l’interprétation des cartes suivantes Celles-ci indiquent pour chaque type de paiement direct (mesure) la densité des bénéficiaires dans la commune concernée (somme des contributions versées pour la mesure, divisée par le nombre total des exploitations touchant des paiements directs)
2 . 2 P A I E M E N T S D I R E C T S 2 2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E 195
≤ 2 0 2 1 –2 5 2 6 –3 0 3 1 –3 5 3 6 –4 0 4 1 –4 5 4 6 –5 0 5 1 –5 5 5 6 –6 0 6 1 –6 5 > 6 5 N o m b r e d ' e x p l o i t a t i o n s P a i e m e n t s d i r e c t s c u m u l é s, e n % Classe d'âge Moyenne = 46 ans Source: OFAG Nombre d'exploitations Paiements directs cumulés, en % 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 Cartes
1–12, pages A60-A71
■ Exécution et contrôle
L’art. 66 OPD délègue aux cantons la tâche de contrôler les PER. Les cantons peuvent y associer des organisations présentant toutes garanties de compétence et d'indépendance après les avoir préalablement contrôlées par sondage L’al 4 précise selon quels critères les cantons ou les organisations associées sont tenus de contrôler les exploitations
Doivent être assujetties à un contrôle:
– toutes les exploitations qui demandent des contributions pour la première fois;
– toutes les exploitations dans lesquelles des manquements ont été constatés lors de contrôles effectués l’année précédente; et
– au moins 30% d’autres exploitations choisies au hasard
Les exploitants qui fournissent des données fallacieuses concernant l’exploitation ou qui ne remplissent pas ou que partiellement les exigences liées à l’octroi des contributions sont sanctionnés selon des critères uniformes. La Conférence des directeurs cantonaux de l'agriculture a édicté un dispositif de sanctions harmonisant, entre les cantons, la réduction des paiements directs prévue lorsque l'exploitant ne satisfait pas intégralement aux conditions requises pour l'octroi des contributions
■ Contrôles effectués en 2000
En 2000, les cantons ou les organismes mandatés ont procédé à environ 39'100 contrôles d’exploitations, dont 4'900 exploitations bio, pour vérifier si les PER étaient fournies. Ont par ailleurs été contrôlées 15'300 exploitations (79%) qui font sortir régulièrement leurs animaux en plein air (SRPA), ainsi que 7'900 autres (83%), qui les gardent dans des systèmes particulièrement respectueux de l’espèce (SST)
Au total, plus de 8'000 infractions ont été constatées, ce qui a entraîné des réductions de contributions de 5,1 millions de francs. Ne sont pas compris dans ce montant les contributions non versées pour données fallacieuses dans la déclaration, ni les retenues auprès des exploitants n 'ayant pas droit aux contributions Les infractions ont concerné essentiellement les domaines suivants: exigences PER, programmes SRPA et SST, compensation écologique, conditions générales de la protection des eaux, exigences de base, cultures extensives Les infractions aux prescriptions générales de la législation sur la protection de la nature et du paysage et sur la protection de l’environnement, ainsi qu ’ aux règles de l’agriculture biologique ont en revanche été peu nombreuses
2 . 2 P A I E M E N T S D I R E C T S 2 196
Récapitulation des infractions
de
283 532 500
tardives, fausses données concernant les surfaces, fausses données concernant les effectifs d’animaux, fausses données concernant l’exploitation ou l’exploitant
404 3 484 600
lacunaires, garde d’animaux de rente non respectueuse de l’espèce, analyses du sol manquantes, compensation écologique insuffisante, bilan de fumure non équilibré, bordures tampons, sélection et utilisation ciblée des produits de traitement des plantes
279 300
avancée ou non autorisée, fausses données concernant les surfaces, inobservation de la durée minimale de six ans
fausses, analyses du sol manquantes, compensation écologique insuffisante, absence de rapport de contrôle, protection des eaux, date de la fauche pour les SCE, annonces tardives
100
de repos non conforme, garde non conforme de certains animaux d’une même catégorie, absence de système de stabulation à aires multiples, annonces tardives
SRPA 866 444 600 Nombre insuffisant de jours de sortie, enregistrements lacunaires, garde non conforme de certains animaux de la même catégorie, annonces tardives, parcours insuffisant
■ Autorisations spéciales dans le domaine de la protection des végétaux
Source: OFAG
Dans certains cas, l’utilisation de produits phytosanitaires ou des traitements non autorisés dans le cadre des PER doivent être autorisés pour protéger les cultures lorsque les conditions météorologiques ou le site l’exigent Les services phytosanitaires cantonaux peuvent donc délivrer des autorisations spéciales fondées sur l'OPD. En 2000, ils en ont accordé 4’302 pour 8’027 ha de SAU La forte augmentation du nombre de ces autorisations par rapport à 1999 s ’explique par une meilleure saisie des données dans les cantons.
La plupart d’entre elles ont été délivrées pour permettre de traiter les mauvaises herbes dans des prairies naturelles ou de réensemencer des prairies artificielles, mais surtout de lutter contre le rumex
2 . 2 P A I E M E N T S D I R E C T S 2 2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E 197
Catégorie
Données
Protection des eaux 311
Protection
et
paysage 5
Protection
13
PER 5
SCE 454
Culture extensive 174 32
Annonces
Bio 22
SST 480 71
Infractions Sanctions Raisons principales Nombre fr.
base
Annonces
181 500 Pas d’indication possible
de la nature
du
13 400 Pas d’indication possible
de l’environnement
15 200 Pas d’indication possible
Enregistrements
Utilisation
300
tardives, récolte pas faite à maturité pour la graine
28 900 Données
Aire
Total 8 012 5 083
400
Autorisations spéciales accordées en 2000

2 . 2 P A I E M E N T S D I R E C T S 2 198
Moyen de lutte Autorisations Surface Nombre % ha % Herbicides en prélevée 183 4,3 505,2 6,3 Insecticides 393 9,1 1 231 15,3 Granulés dans le maïs 135 3,1 454 5,7 Granulés dans les betteraves 247 5,7 603 7,5 Herbicides pour prairies 3 299 76,7 5 153 64,2 Autres 45 1,0 80,5 1,0 Total 4 302 100 8 027 100 Source:
OFAG
■ L’objectif d’une exploitation de toute la surface agricole
2.2.2 Paiements directs généraux
Contributions à la surface
Les contributions à la surface servent à rétribuer les prestations fournies dans l'intérêt général telles que la protection et l’entretien du paysage rural, la préservation des fonctions de l'espace rural et la sécurité alimentaire Elles ne sont pas différenciées selon l’utilisation des surfaces ou les régions Dans la région des collines et de montagne, où les conditions sont plus difficiles, les agriculteurs touchent en outre des contributions pour des terrains en pente et d’autres pour la garde d’animaux dans des conditions difficiles.
Pour les surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère, les taux de tous les paiements directs liés aux surfaces sont réduits de 25%. Il s ’agit en tout de 5'128 ha, exploités dans la zone limitrophe depuis 1984
Contributions à la surface en 2000
2 . 2 P A I E M E N T S D I R E C T S 2 2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E 199 ■■■■■■■■■■■■■■■■
Taux de 2000 fr./ha – jusqu’à 30 ha 1 200 – de 30 à 60 ha 900 – de 60 à 90 ha 600 – plus de 90 ha 0
Caractéristique Unité Total Région de Région des Région de plaine collines montagne Surface ha 481 194 263 090 285 615 1 029 899 Exploitations nombre 25 615 16 358 18 500 60 473 Surface par exploitation ha 18,8 16,1 15,4 17,0 Contribution par exploitation fr 21 584 18 676 17 751 19 625 Total des contributions 1 000 Fr 552 878 305 495 328 397 1 186 770 Total des contributions 1999 1 000 Fr 545 168 300 104 317 822 1 163 094 Source: OFAG
Tableaux 31a-31b, pages A32-A33
Le 7,6% de la SAU sont touchés par la dégression des contributions En moyenne, la contribution à la surface versée par ha se chiffre à 1’152 francs Les entreprises comptant jusqu’à 10 ha exploitent ensemble 10,8% de la SAU Celles qui comprennent plus de 60 ha ne représentent que 0,8% et exploitent 3,7% de la SAU
Contributions pour la garde d’animaux consommant des fourrages grossiers
Cette mesure a pour objectif de préserver la compétitivité des producteurs de viande disposant d’une base fourragère et d’assurer en même temps l’exploitation de l’ensemble des terres agricoles de la Suisse, pays à vocation herbagère
Les contributions pour la garde d'animaux consommant des fourrages grossiers sont versées pour des animaux gardés dans l'exploitation durant la période d'affouragement d'hiver (période de référence: entre le 1er janvier et le jour de référence de l'année de contributions) Par animaux consommant des fourrages grossiers, on entend les bovins et les équidés, ainsi que les moutons, les chèvres, les bisons, les cerfs, les lamas et les alpagas Les contributions sont versées pour les surfaces herbagères permanentes ou pour les prairies artificielles: les diverses catégories d’animaux sont converties en unités de gros bétail-fourrage grossier (UGBFG)
2 . 2 P A I E M E N T S D I R E C T S 2 200
Limites d’encouragement UGBFG/ha – zone de grandes cultures, zone intermédiaire élargie et zone intermédiaire 2,0 – zone des collines 1,6 – zone de montagne I 1,4 – zone de montagne II 1,1 – zone de montagne III 0,9 – zone de montagne IV 0,8 – prairies de fauche situées en région d’estivage 0,7 Répartition des exploitations et de la SAU selon la classe de grandeur, en 2000 plus de 90 Exploitations en % SAU en % 60 – 90 30 –60 20 – 30 15 – 20 10 –15 5 –10 moins de 5 Source: OFAG C l a s s e s d e g r a n d e u r, e n h a SAU avec contributions entières SAU concernée par la dégression 30 20 10 0 10 20 30 0,2 0,2 1,2 0,4 18,2 27,0 18,6 16,3 8,8 10,4 0,7 0,1 19,0 18,2 22,3 19,7 9,6 2,0 5,3
■ Surfaces utilisées comme herbages
D’une part, l'échelonnement selon les zones de la limite fixée pour l'octroi des contributions correspond à celui de la charge en bétail maximale prévue dans les instructions pratiques pour la protection des eaux dans l'agriculture; d’autre part, il tient compte du potentiel de rendement décroissant. Ainsi, ces contributions n ’ont pas d’effet sur la production, mais contribuent substantiellement à l’exploitation de toute la surface agricole
A droit aux contributions celui qui garde au moins une UGBFG dans son exploitation et qui satisfait aux conditions de base et aux exigences minimales de l’OPD
Les UGBFG sont réparties entre deux groupes de contributions Pour les bovins, équidés, bisons, chèvres et brebis laitières, le taux est de 900 fr./UGBFG, alors qu’il est fixé à 400 francs pour les autres chèvres et moutons ainsi que pour les cerfs, les lamas et les alpagas Les contributions sont plus élevées pour les animaux exigeant davantage de travail et d'investissements dans les bâtiments.
Contributions pour la garde d’animaux consommant des fourrages grossiers en 2000
Ces contributions ont remplacé celles qui ont été versées jusqu’en 1998 aux détenteurs de vaches ne commercialisant pas de lait Elles sont allouées non seulement pour les vaches dont le lait n ’est pas commercialisé, mais encore pour les autres animaux consommant des fourrages grossiers Les producteurs de lait qui touchent les contributions gardent une proportion relativement importante d’animaux d’élevage et d’engraissement par rapport à leur effectif de vaches et disposent d’une surface herbagère suffisante; il s ’agit donc d’exploitations plutôt extensives En 2000, leur effectif de bétail donnant droit aux contributions a été réduit d'une UGBFG par 4’000 kg de lait livrés l'année précédente.
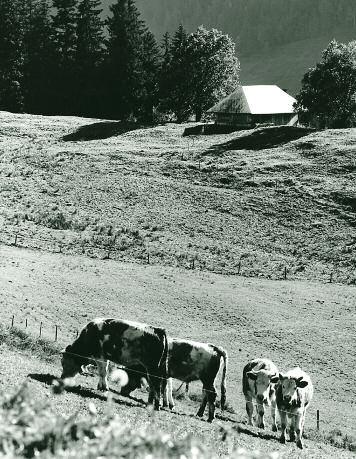
2 . 2 P A I E M E N T S D I R E C T S 2 2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E 201
Caractéristique Unité Région de Région des Région de Total plaine collines montagne UGBFG donnant droit aux contributions Nombre 77 507 73 614 146 990 298 112 Exploitations Nombre 10 899 11 392 16 555 38 846 UGBFG donnant droit aux contributions par exploitation Nombre 7,1 6,5 8,9 7,7 Contributions par exploitation Fr 6 188 5 641 7 659 6 655 Total des contributions 1 000 Fr 67 444 64 265 126 795 258 505 Total des contributions 1999 1 000 Fr 65 568 62 745 126 312 254 624 Source:
OFAG
Contributions versées en 2000 aux exploitations avec et sans lait commercialisé
Caractéristique Unité Exploitations avec Exploitations sans commercialisation commercialisation
Certes, les entreprises qui commercialisent du lait touchent environ 4'000 francs de moins de contributions UGBFG que celles qui ne le font pas Elles bénéficient en revanche des mesures de soutien du marché laitier (p ex supplément pour le lait transformé en fromage).
Contributions pour la garde d’animaux dans des conditions de production difficiles
Ces contributions servent à compenser les conditions de production difficiles des éleveurs dans la région de montagne et dans celle des collines C’est une mesure qui comporte aussi des aspects sociaux et structurels et vise des objectifs relevant de l’occupation du territoire Tel n ’est pas le cas des contributions «générales» allouées pour la garde d’animaux de rente consommant des fourrages grossiers, qui sont destinées en premier lieu à promouvoir l’exploitation et l’entretien des herbages. Les contributions sont versées aux agriculteurs qui exploitent au moins 1 ha de SAU dans la zone des collines ou dans la région de montagne et qui détiennent au moins une UGBFG Donnent droit aux contributions les mêmes catégories d’animaux que dans le cas des contributions versées pour la garde d’animaux consommant des fourrages grossiers Les contributions étant octroyées pour un maximum de 15 UGBFG par exploitation, cette mesure favorise les plus petites d’entre elles Les taux des contributions sont différenciés selon les zones
2 . 2 P A I E M E N T S D I R E C T S 2 202
Exploitations Nombre 23 109 15 737 Animaux par exploitation UGBFG 22,1 11,8 Déduction pour limitation des contributions en fonction de la surface herbagère UGBFG 1,1 1,3 Déduction pour lait commercialisé UGBFG 15,3 0,0 Animaux donnant droit aux contributions UGBFG 5,7 10,6 Contributions par exploitation fr 5 057 9 001 Source: OFAG
Taux par UGBFG en 2000 fr / UGB – zone des collines 260 – zone de montagne I 440 – zone de montagne II 690 – zone de montagne III 930 – zone de montagne IV 1 190
■ Compensation des handicaps
Contributions pour la garde d’animaux dans des conditions difficiles en 2000
1 Entreprises exploitant une partie des surfaces dans la région de montagne ou dans celle des collines

Dans la région des collines et de montagne, les agriculteurs ont touché quelque 4 millions de francs de moins que l’année précédente en raison du recul des cheptels donnant droit aux contributions pour la garde d'animaux dans des conditions difficiles.
Répartition, selon la classe de grandeur, des animaux consommant des fourrages grossiers dans des conditions de production difficiles, en 2000 Source:
Par rapport au cheptel des exploitations bénéficiaires, la part d’UGBFG n ’ y donnant pas droit a été de 36,8%. Environ 82% de l’effectif UGBFG a été gardé dans des exploitations touchées par la limitation des contributions à 15 UGBFG Le pourcentage de ces dernières ne donnant pas droit aux contributions a, en l’occurrence, représenté 44,7%
2 . 2 P A I E M E N T S D I R E C T S 2 2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E 203
Caractéristique Unité Région de Région des Région de Total plaine collines montagne UGBFG donnant droit aux contributions nombre 32 727 202 919 214 666 450 313 Exploitations nombre 2 303 15 501 17 903 35 707 UGBFG par exploitation nombre 14,2 13,1 12,0 12,6 Contributions par exploitation fr 1 298 4 543 9 953 7 046 Total des contributions 1 000 fr 2 989 70 423 178 181 251 593 Total des contributions 1999 1 000 fr. 2 723 72 037 181 121 255 882
Source: OFAG
C l a s s e s d e g r a n d e u r, e n U G B F G UGBFG avec contribution UGBFG sans contribution 100 500 50150 100 200 250 45–90 30–45 20–30 15–20 10–15 5–10 moins de 5 30 73 95 127 95 17 72 42 9 85 47 18 65 59 58 25 80 65 Exploitations en centaines Animaux en milliers d'UGBFG
OFAG
■ Contributions générales pour des terrains en pente: compensation des difficultés dans l’exploitation des surfaces
Contributions pour des terrains en pente

Les contributions générales pour des terrains en pente compensent l’exploitation des terres dans des conditions difficiles. Elles ne sont versées que pour les prairies, les surfaces à litière et les terres assolées Les prairies et les surfaces à litière doivent être fauchées au moins une fois par an Par contre, les contributions ne sont pas octroyées pour les haies et les bosquets champêtres, ni pour les pâturages et les vignobles
Ont droit aux contributions les exploitants qui respectent les conditions de base et les exigences minimales fixées dans l’OPD et dont l’exploitation comprend une surface en pente, située dans la région des collines ou de montagne et dépassant 50 ares en tout et 5 ares par parcelle d’exploitation. On distingue deux degrés de déclivité:
Taux de 2000 fr./ha – déclivité de 18 à 35% 370 – déclivité de plus de 35% 510
2 . 2 P A I E M E N T S D I R E C T S 2 204
■ Contributions pour des terrains en pente: préservation des surfaces viticoles en forte pente et en terrasses
Contributions versées en 2000 pour des terrains en pente
Exploitations ayant droit aux contributions pour des terrains en pente, en 2000
Déclivité de 35% et davantage 15%
Déclivité de moins de18% 58% Déclivité de 18 à 35% 27%
Source: OFAG
Les terrains en pente ont gagné quelque 1'000 ha par rapport à l’année précédente L’étendue des surfaces annoncées se modifie d’une année à l’autre, ce qui dépend surtout des conditions climatiques et de leur impact sur le type d’exploitation (plus ou moins de pâturages ou de prairies de fauche)
Les contributions octroyées pour les surfaces viticoles en pente contribuent à la préservation des vignobles plantés en pente et en terrasses Il convient de faire la distinction entre, d’une part, les fortes et les très fortes pentes et, d’autre part, les terrasses aménagées sur des murs de soutènement. Ces caractéristiques augmentent l’attrait du paysage, mais elles rendent aussi l’exploitation plus difficile Pour les vignobles, les contributions sont allouées à partir d’une déclivité de 30%

Caractéristique Unité Région de Région des Région de Total plaine 1 collines montagne Surfaces donnant droit aux contributions : – déclivité de 18–35% ha 4 419 67 872 74 089 146 380 – plus de 35% de déclivité ha 1 277 19 087 63 123 83 487 Total ha 5 696 86 959 137 212 229 867 Exploitations nombre 2 113 14 515 17 252 33 880 Contribution par exploitation fr 1 082 2 400 3 454 2 855 Total des contributions 1 000 Fr. 2 287 34 843 59 584 96 714 Total des contributions 1999 1 000 Fr 2 227 34 761 58 894 95 882
Source:
1 Exploitations englobant des surfaces situées dans la région de montagne et des collines
OFAG
2 . 2 P A I E M E N T S D I R E C T S 2 2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E 205
Total 551 857 ha
Sont réputées vignobles en terrasses (déclivité de 30% et plus) les surfaces viticoles composées de paliers réguliers, épaulés par des murs de soutènement, lesquelles remplissent les conditions suivantes:
– densité minimale de terrasses, c ’est-à-dire distance maximale de 30 m entre les murs de soutènement;
aménagement en terrasses, devant couvrir un périmètre de 1 ha au moins;
– murs de soutènement devant mesurer au moins 1 m de hauteur, les murs en béton ordinaires n’étant pas pris en compte
Ont droit aux contributions les exploitants qui remplissent les conditions de base et les exigences minimales fixées dans l’OPD et dont l’exploitation comprend une surface en pente dépassant 10 ares en tout et 2 ares par parcelle d’exploitation Les taux des contributions sont fixés indépendamment des zones
Contributions versées en 2000 pour les vignes en forte pente et en terrasses
La part des surfaces viticoles en forte pente et en terrasses représente quelque 33% de la surface viticole totale, et le nombre d’exploitations 60% du total des exploitations viticoles.

2 . 2 P A I E M E N T S D I R E C T S 2 206
–
Taux de 2000 fr /ha – surface de 30 à 50% de déclivité 1 500 – surface de plus de 50% de déclivité 3 000 – surfaces en terrasses 5 000
Unité Surfaces donnant droit à la contribution, total ha 3 352 Forte pente, déclivité de 30 à 50% ha 1 710 Forte pente, déclivité de plus de 50% ha 349 Aménagements en terrasses ha 1 293 Nombre d’exploitations nombre 2 833 Surface par exploitation ha 1,2 Contribution par exploitation fr 3 557 Total des contributions 1 000 fr 10 076 Total des contributions 1999 1 000 fr 9 325
Source: OFAG
Innovations 2001
Le 10 janvier 2001, le Conseil fédéral a pris des décisions dans le domaine agricole, décisions qui concernent aussi les paiements directs généraux.
Une contribution supplémentaire de 400 fr /ha a pour la première fois été versée en 2001 pour les terres ouvertes et les cultures pérennes (art 27, al 2, OPD) Elle sert à rétribuer la part des prestations fournies, en culture des champs, dans l'intérêt général, et qu’il n ’est plus possible d’indemniser autrement en raison de la réduction du prixseuil et de la libéralisation du marché des céréales La limite des paiements directs par UMOS a été relevée de 10'000 francs, passant à 55'000 francs (art 21 OPD), afin que 25% de la SAU puissent être aménagés en surfaces de compensation écologique sans baisse des paiements directs

S’agissant des contributions pour la garde d’animaux consommant des fourrages grossiers, la déduction pour le lait commercialisé est passée de 4'000 à 4’200 kg/ UGBFG (art 31 OPD) En profitent avant tout les exploitations laitières ayant une production de lait plutôt extensive
Une autre modification concerne les limites de revenu et de fortune: les exploitants mariés peuvent désormais déduire un montant de 30'000 francs (art 22, al 2, OPD), dans le calcul du revenu déterminant En ce qui concerne la limite de fortune, la déduction par UMOS a été augmentée de 80'000 francs pour passer à 200'000 francs. Par ailleurs, une déduction de 200'000 francs sera concédée sur la fortune des couples mariés (art 23, al 1, OPD) Cette nouvelle limite, fixée en fonction de l’état civil, permet de prendre en considération les critiques en partie justifiées concernant le revenu de l’épouse, ainsi que la difficulté de fixer des limites de revenu et de fortune lorsqu’il s ’agit de rétribuer des prestations fournies dans l’intérêt général ou de nature écologique
2 . 2 P A I E M E N T S D I R E C T S 2 2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E 207
2.2.3 Paiements directs écologiques
Contributions écologiques

Les paiements directs écologiques rétribuent des prestations écologiques particulières qui dépassent le cadre des PER Les exploitants peuvent choisir librement de participer aux différents programmes qui leur sont offerts Ceux-ci sont indépendants les uns des autres, et les contributions peuvent être cumulées Les taux de contributions n ’ont pas changé de 1999 à 2000 Les différences entre les contributions versées en 2000 et celles de l’année précédente s ’expliquent uniquement par l’augmentation ou la diminution du nombre des participants.
Répartition des contributions écologiques entre les différents programmes, en 2000
2 . 2 P A I E M E N T S D I R E C T S 2 208 ■■■■■■■■■■■■■■■■
Tableaux 32a-32b, pages A34-A35
Compensation écologique 41% Production extensive de céréales et de colza 13% SRPA 32% SST 9% Culture biologique 5% Source: OFAG
Total 261,8 mio. de fr.
Compensation écologique
En encourageant la compensation écologique, on entend préserver et, si possible, étendre l’espace vital de la faune et de la flore suisses dans les régions agricoles. La compensation écologique contribue aussi au maintien des structures et des éléments paysagers typiques Certains éléments sont rétribués à l’aide de contributions et peuvent en même temps être imputés à la compensation écologique obligatoire des PER D’autres ne peuvent par contre être imputés qu’à la compensation écologique des PER
Eléments de la compensation écologique donnant droit ou non à des contributions
Eléments imputables aux PER Eléments imputables aux PER et donnant droit aux contributions sans donner droit aux contributions
Prairies extensives
Prairies peu intensives
Surfaces à litière
Pâturages extensifs
Pâturages boisés
Arbres isolés indigènes adaptés au site et allées d’arbres
Haies, bosquets champêtres et Fossés humides, mares, étangs berges boisées
Jachères florales Surfaces rudérales, tas d’épierrage et affleurements rocheux
Jachères tournantes Murs de pierres sèches
Bandes culturales extensives Chemins naturels non stabilisés
Arbres fruitiers haute-tige Surfaces viticoles à haute diversité biologique
Autres surfaces de compensation écologique définies par le service cantonal de protection de la nature
Ces surfaces doivent mesurer au moins 5 ares et ne peuvent être utilisées avant la mijuin pendant une période de six ans La fauche tardive doit garantir que les semences arrivent à maturité et que leur dispersion naturelle favorise la diversité des espèces Elle laisse par ailleurs suffisamment de temps aux oiseaux nichant au sol et à d’autres petits mammifères pour leur reproduction La fumure est interdite, de même que l’utilisation de produits de traitement des plantes, à l’exception du traitement plante par plante des mauvaises herbes qui posent des problèmes.
Des contributions identiques, échelonnées selon les zones, sont versées pour les prairies extensives, les surfaces à litière, les haies et les bosquets champêtres.
2 . 2 P A I E M E N T S D I R E C T S 2 2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E 209
Taux de 2000 fr /ha – zone de grandes cultures et zones intermédiaires 1 500 – zone des collines 1 200 – zones de montagne I et II 700 – zones de montagne III et IV 450
Tableaux 33a-33d, pages A36-A39
■ Prairies extensives
Exploitations et surfaces ayant donné droit aux contributions; montant des contributions en 2000
Par surfaces à litière, on entend les surfaces cultivées d'une manière extensive et se trouvant dans des lieux humides et marécageux et qui, en règle générale, sont fauchées en automne ou en hiver pour la production de litière Les prescriptions d’exploitation sont en principe les mêmes que pour les prairies extensives La fauche n ’est toutefois autorisée qu’à partir du 1er septembre

Exploitations et surfaces ayant donné droit aux contributions; montant des contributions en 2000
Le léger recul des surfaces à litière peut s ’expliquer par le fait que certaines d’entre elles ont été annoncées comme prairies extensives
2 . 2 P A I E M E N T S D I R E C T S 2 210
Caractéristique Unité Région de Région des Région de Total plaine collines montagne Exploitations nombre 16 974 8 650 9 230 34 854 Surface ha 16 804 8 052 13 816 38 672 Surface par exploitation ha 0,99 0,93 1,50 1,11 Contribution par exploitation fr 1 447 923 786 1 142 Total des contributions 1 000 fr 24 567 7 986 7 256 39 809 Total des contributions 1999 1 000 fr 21 494 6 978 6 462 34 934 Source: OFAG
Caractéristique Unité Région de Région des Région de Total plaine collines montagne Exploitations nombre 1 392 1 213 1 911 4 516 Surface ha 1 299 863 1 549 3 712 Surface par exploitation ha 0,93 0,71 0,81 0,82 Contribution par exploitation fr 1 387 681 477 812 Total des contributions 1 000 fr 1 930 826 911 3 668 Total des contributions 1999 1 000 fr. 2 116 956 1 396 4 468 Source: OFAG
■ Surfaces à litière
■ Haies, bosquets champêtres et berges boisées
Par haies, bosquets champêtres et berges boisées, on entend les haies basses, les haies arbustives et arborées, les brise-vents, les groupes d’arbres, les talus et les berges boisées Ces surfaces doivent mesurer au moins 5 ares et être utilisées de manière appropriée pendant une période de six ans sans interruption. Elles doivent aussi être entretenues convenablement La fumure et l’utilisation de produits de traitement des plantes sont interdites Une bande herbeuse, non fertilisée, d'une largeur de 3 m au moins, doit être aménagée le long des bandes boisées touffues
Exploitations et surfaces ayant donné droit aux contributions; montant des contributions en 2000
■ Prairies peu intensives
Les prairies peu intensives peuvent être légèrement fertilisées avec du fumier ou du compost Au demeurant, elles sont assujetties aux mêmes règles d’utilisation que les prairies extensives
Exploitations et surfaces ayant donné droit aux contributions; montant des contributions en 2000
2 . 2 P A I E M E N T S D I R E C T S 2 2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E 211
Caractéristique Unité Région de Région des Région de Total plaine collines montagne Exploitations nombre 5 129 2 493 1 121 8 743 Surface ha 1 260 685 330 2 275 Surface par exploitation ha 0,25 0,27 0,29 0,26 Contribution par exploitation fr 364 280 190 318 Total des contributions 1 000 fr 1 865 698 214 2 777 Total des contributions 1999 1 000 fr 1 847 690 230 2 767 Source: OFAG
Taux de 2000 fr /ha – zone de grandes cultures à zone des collines 650 – zones de montagne I et II 450 – zones de montagne III et IV 300
Caractéristique Unité Région de Région des Région de Total plaine collines montagne Exploitations nombre 10 499 9 504 11 100 31 103 Surface ha 9 164 8 713 22 228 40 106 Surface par exploitation ha 0,87 0,92 2,00 1,29 Contribution par exploitation fr. 560 505 684 587 Total des contributions 1 000 fr 5 884 4 797 7 589 18 269 Total des contributions 1999 1 000 fr 6 032 4 806 7 607 18 445 Source: OFAG
■ Jachères florales

Par jachères florales, on entend les bordures pluriannuelles de 3 m de largeur au moins, ensemencées d'herbacées sauvages indigènes La fertilisation est interdite Des traitements chimiques plante par plante sont autorisés contre les mauvaises herbes posant des problèmes, pour autant qu'il soit impossible de les combattre par des moyens mécaniques sans une charge disproportionnée Dès l'année suivant celle de la mise en place, la jachère florale peut être fauchée pour moitié entre le 1er octobre et le 15 mars Cette jachère sert à protéger les herbacées sauvages menacées Elle offre également habitat et nourriture aux insectes et autres petits animaux En outre, elle sert de refuge aux lièvres et aux oiseaux
En 2000, un montant de 3’000 francs a été versé par ha Les contributions ne sont allouées que pour les surfaces situées dans les régions de plaine et des collines. Dans cette dernière, les surfaces de la zone de montagne I ne donnent pas droit aux contributions
Exploitations et surfaces ayant donné droit aux contributions; montant des contributions en 2000
Dans le contexte de la libéralisation du marché des céréales, les jachères florales sont devenues une solution de substitution intéressante aux cultures des champs, d’où une participation accrue
Caractéristique Unité Région de Région des Région de Total plaine collines montagne Exploitations nombre 1 493 299 4 1 1 796 Surface ha 1 126 188 1 1 315 Surface par exploitation ha 0,75 0,63 0,32 0,73 Contribution par exploitation fr 2 264 1 882 945 2 197 Total des contributions 1 000 fr 3 380 563 4 3 946 Total des contributions 1999 1 000 fr 1 981 253 1 2 235
1 Il s ’agit d’entreprises exploitant des surfaces dans les régions des collines ou de plaine
Source: OFAG
2 . 2 P A I E M E N T S D I R E C T S 2 212
■ Jachères tournantes
Par jachères tournantes, on entend des surfaces ensemencées, pendant un ou deux ans, d'herbacées sauvages indigènes accompagnatrices de cultures; elles doivent présenter une largeur de 6 m au moins et couvrir au minimum 20 ares L’enherbement naturel est également possible à des endroits propices. La fertilisation est interdite. Des traitements chimiques plante par plante sont autorisés contre les mauvaises herbes posant des problèmes, pour autant qu'il soit impossible de les combattre par des moyens mécaniques sans une charge disproportionnée La surface mise en jachère tournante ne peut être fauchée qu ’entre le 1er octobre et le 15 mars Les jachères tournantes offrent un habitat aux oiseaux couvant au sol, aux lièvres et aux insectes
En 2000, un montant de 2'500 francs a été versé par ha Les contributions ne sont allouées que pour les surfaces situées dans les régions de plaine et des collines. Dans cette dernière, les surfaces de la zone de montagne I ne donnent pas droit aux contributions
Exploitations et surfaces ayant donné droit aux contributions; montant des contributions en 2000
■ Bandes culturales extensives
Comme pour les jachères florales, l’important accroissement du nombre de jachères tournantes est dû, d’une part, à leur attrait économique et d’autre part, à leur encouragement systématique depuis 1999.
Les bandes culturales extensives offrent un espace de survie aux herbacées accompagnant traditionnellement les cultures On entend par là des bandes de cultures des champs, d'une largeur de 3 à 12 m, exploitées d’une manière extensive L’utilisation d’engrais azotés et d’insecticides ainsi que le traitement de surface chimique ou mécanique contre les mauvaises herbes sont interdits Des traitements chimiques plante par plante sont autorisés contre les mauvaises herbes posant des problèmes, pour autant qu'il soit impossible de les combattre par des moyens mécaniques sans une charge disproportionnée Ces bandes sont ensemencées de céréales (sauf maïs), colza, tournesol, pois protéagineux, féverole ou soja.
En 2000, un montant de 1'000 francs a été versé par ha Les contributions ne sont allouées que pour les surfaces situées dans les régions de plaine et des collines Dans cette dernière, les surfaces de la zone de montagne I ne donnent pas droit aux contributions.
Caractéristique Unité Région de Région des Région de Total plaine collines montagne Exploitations nombre 712 118 0 830 Surface ha 887 132 0 1 019 Surface par exploitation ha 1,25 1,12 0 1,23 Contribution par exploitation fr 3 115 2 793 0 3 070 Total des contributions 1 000 fr 2 218 330 0 2 548 Total des contributions 1999 1 000 fr 735 86 0 821
Source: OFAG
2 . 2 P A I E M E N T S D I R E C T S 2 2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E 213
Exploitations et surfaces ayant donné droit aux contributions; montant des contributions en 2000
L’encouragement des bandes culturales extensives a commencé en 1999 Elles sont moins attrayantes que les jachères florales et tournantes sur le plan économique.
La Confédération verse les contributions pour les arbres haute-tige de fruits à noyau ou à pépins ne faisant pas partie d’une culture fruitière, ainsi que pour les châtaigneraies et les noiseraies entretenues. Le tronc doit présenter une hauteur minimale de 1,2 m pour les arbres de fruits à noyau et de 1,6 m pour les autres L’utilisation d’herbicides pour dégager le tronc est interdite, sauf pour les arbres âgés de moins de cinq ans Les exploitants ont droit aux contributions à partir d’un minimum de 20 arbres. Les contributions pour les arbres fruitiers haute-tige peuvent être cumulées avec celles qui sont versées pour les prairies extensives ou peu intensives
En 2000, un montant de 15 francs a été versé par arbre
Bénéficiaires, arbres ayant donné droit aux contributions, montant des contributions en 2000
Caractéristique Unité Région de Région des Région de Total plaine collines montagne Exploitations nombre 154 35 0 189 Surface ha 43 50 48 Surface par exploitation ha 0,28 0,15 0 0,26 Contribution par exploitation fr 280 151 0 256 Total des contributions 1 000 fr 43 50 48 Total des contributions 1999 1 000 fr 53 60 59 Source: OFAG
Caractéristique Unité Région de Région des Région de Total plaine collines montagne Exploitations nombre 17 979 13 378 5 459 36 816 Arbres nombre 1 266 129 944 832 259 539 2 470 500 Arbres par exploitation nombre 70,42 70,63 47,54 67,10 Contribution par exploitation fr 1 056 1 059 713 1 007 Total des contributions 1 000 fr 18 991 14 172 3 893 37 057 Total des contributions 1999 1 000 fr 19 088 14 098 3 759 36 945 Source: OFAG
2 . 2 P A I E M E N T S D I R E C T S 2 214
■ Arbres fruitiers haute-tige
Répartition des surfaces de compensation écologique1 en 2000
Total 92 858 ha
Jachères tournantes 1,1%
Jachères florales 1,4%
Prairies peu intensives 43,2%

Bosquets champêtres et berges boisées 2,4%
1 Arbres fruitiers haute-tige non compris
2 Prairies extensives aménagées sur des terres assolées gelées comprises
Bandes culturales extensives 0,1%
Prairies extensives2 47,8%
Surfaces à litière 4,0%
Source: OFAG
2 . 2 P A I E M E N T S D I R E C T S 2 2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E 215
Culture extensive de céréales et de colza
Cette mesure a pour objectif d’inciter les exploitants à renoncer aux régulateurs de croissance, aux fongicides, aux stimulateurs chimiques de synthèse des défenses naturelles et aux insecticides dans la culture de céréales et de colza L’ensemble de la surface affectée aux céréales panifiables et fourragères et au colza doit répondre aux exigences y relatives

La part des céréales panifiables cultivées selon les exigences de la production extensive constitue 42% de la production totale Elle s’élève à 63% pour les céréales fourragères (sauf le maïs-grain) et à 25% pour le colza
En 2000, un montant de 400 francs a été versé par ha
Exploitations et surfaces ayant donné droit aux contributions, montant des contributions en 2000
Répartition des cultures extensives, en 2000
Céréales fourragères 46%
Céréales panifiables 50%
2 . 2 P A I E M E N T S D I R E C T S 2 216
Caractéristique Unité Région de Région des Région de Total plaine collines montagne Exploitations nombre 11 916 7 294 1 272 20 482 Surface ha 55 327 25 336 2 914 83 577 Surface par exploitation ha 4,64 3,47 2,29 4,08 Contribution par exploitation fr. 1 855 1 389 918 1 631 Total des contributions 1 000 fr 22 103 10 128 1 168 33 398 Total des contributions 1999 1 000 fr 23 360 10 444 1 332 35 136 Source: OFAG
Colza 4%
Source: OFAG
Tableau 34 page A40
Total 83 577 ha
Culture biologique
En complément des recettes supplémentaires réalisables sur le marché, la Confédération encourage l’agriculture biologique en tant que mode de production particulièrement respectueux de l’environnement Afin d’obtenir des contributions, les exploitants doivent appliquer au moins les règles de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique, révisée en août 2000 Une reconversion partielle n ’est possible que dans des exploitations pratiquant la viticulture, les cultures fruitières ou maraîchères ou la culture de plantes ornementales Les agriculteurs sont encouragés notamment à renoncer aux matières auxiliaires chimiques de synthèse telles qu ’engrais de commerce ou pesticides La prise en considération des cycles et procédés naturels revêt donc une importance toute particulière pour l’agriculteur.
Le 8% de la SAU totale a été cultivée en 2000 selon les règles de l’agriculture biologique.
L’augmentation de quelque 3,5% depuis 1999 du nombre d’exploitations pratiquant l’agriculture biologique met en évidence la tendance ascendante de ce mode de production La surface exploitée conformément à l’ordonnance ou aux directives bio a augmenté de 5%.

2 . 2 P A I E M E N T S D I R E C T S 2 217
Taux de 2000 fr./ha – cultures spéciales 1 000 – terres ouvertes, cultures spéciales exceptées 600 – surfaces herbagères et surfaces à litière 100 2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E
Exploitations et surfaces ayant donné droit aux contributions, montant des contributions en 2000
Part de la surface faisant l'objet de l'exploitation biologique, selon la région, en 2000

Caractéristique Unité Région de Région des Région de Total plaine collines montagne Exploitations Nombre 982 1 117 2 805 4 904 Surface ha 16 186 17 673 48 962 82 822 Surface par exploitation ha 16,48 15,82 17,46 16,89 Contribution par exploitation fr 4 669 2 256 1 811 2 485 Total des contributions 1 000 fr 4 585 2 520 5 080 12 185 Total des contributions 1999 1 000 fr 4 382 2 384 4 871 11 637 Source: OFAG
Région de plaine 20% Région de montagne 59% Source: OFAG Total 82 822 ha Région des collines 21%
2 . 2 P A I E M E N T S D I R E C T S 2 218
Tableau 32a, page A34
■ Systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux
Garde d’animaux de rente particulièrement respectueuse de l’espèce
Ce titre résume les deux programmes SST et SRPA, qui sont décrits ci-dessous.
La Confédération encourage les agriculteurs à garder les animaux dans des systèmes de stabulation répondant à des exigences qui dépassent largement le niveau requis dans la législation relative à la protection des animaux Les principes suivants sont applicables:
les animaux sont gardés librement en groupes; – ils ont la possibilité de se reposer, de se mouvoir et de s ' occuper d’une manière adaptée à leur comportement naturel;
les étables bénéficient d’une lumière du jour suffisante.
et animaux (UGB) ayant donné droit aux contributions; montant des contributions en 2000
Depuis 1999, on relève une augmentation marquante de la part des exploitations participant au programme SST (+19%) et de la somme des contributions (+18%)
–
–
Taux de 2000 fr /UGB – bovins, chèvres, lapins 70 – porcs 135 – volaille 180 Exploitations
Caractéristique Unité Région de Région des Région de Total plaine collines montagne Exploitations nombre 6 724 4 004 2 215 12 943 UGB nombre 158 722 73 574 32 940 265 236 UGB par exploitation nombre 23,61 18,38 14,87 20,49 Contribution par exploitation fr 2 213 1 760 1 274 1 912 Total des contributions 1 000 fr 14 877 7 049 2 822 24 749 Total des contributions 1999 1 000 fr 12 729 5 996 2 277 21 002 Source:
OFAG
Tableau 35, page A41 2 . 2 P A I E M E N T S D I R E C T S 2 219 2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E
■ Sorties régulières en plein air
La Confédération encourage les sorties régulières des animaux de rente en plein air, c ’est-à-dire sur un pâturage, dans une aire d'exercice ou à climat extérieur, conformément aux besoins des animaux Les exigences suivantes sont fixées pour les différentes espèces:
Animaux consommant des fourrages grossiers
au moins 26 sorties réglementaires au pâturage par mois pendant la période de végétation
– au moins 13 sorties réglementaires au pâturage par mois pendant la période d'affouragement d'hiver
Porcs
– porcs à l'engrais, animaux de renouvellement et verrats d'élevage: sorties quotidiennes

truies taries: au moins 3 sorties réglementaires par semaine
Volaille
Exploitations et animaux (UGB) ayant donné droit aux contributions; montant des contributions en 2000
Depuis 1999, on relève une augmentation marquante de la part des exploitations participant au programme SRPA (+17%) et de la somme des contributions (+15%).
2 . 2 P A I E M E N T S D I R E C T S 2 220
–
–
– sorties quotidiennes Taux de 2000 fr /UGB – bovins et équidés, bisons, moutons, chèvres, daims et cerfs rouges, lapins 135 – porcs 135 – volaille 180
Caractéristique Unité Région de Région des Région de Total plaine collines montagne Exploitations nombre 11 244 8 807 10 070 30 121 UGB nombre 267 823 183 299 166 878 618 000 UGB par exploitation nombre 23,82 20,81 16,57 20,52 Contribution par exploitation fr 3 206 2 817 2 236 2 768 Total des contributions 1 000 fr 36 048 24 806 22 516 83 370 Total des contributions 1999 1 000 fr 30 823 21 482 20 384 72 689 Source: OFAG
■ SST et SRPA: répartition selon la catégorie d’animaux
SST: répartition selon la catégorie d'animaux, en 2000
265 236 UGB
10,2%
s 22,0%
s 0,5%
SRPA: répartition selon la catégorie d'animaux, en 2000

otal 618 000 UGB
OFAG
3,0%
s 8,9%
s 7,5%
2 . 2 P A I E M E N T S D I R E C T S 2 221
Volaille
Source:
Bovins 67
Porc
Autre
Total
,3%
Volaille
Source:
Bovins 80,6%
Autre
OFAG T
Porc
2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E
Contributions d’estivage
Les contributions d’estivage ont pour objectif d’assurer l’exploitation et l’entretien de nos vastes pâturages d'estivage dans les Alpes, dans les Préalpes et dans le Jura. La région d’estivage s’étend sur quelque 600'000 ha, utilisés et entretenus par plus de 300'000 UGB Ont droit aux contributions les exploitants qui estivent des animaux dans une exploitation d'estivage, de pâturage ou de pâturages communautaires

Les contributions d’estivage ont été accordées à condition que les exploitations aient été gérées convenablement et d’une manière respectueuse de l’environnement et conforme aux prescriptions cantonales, communales ou coopératives Le 29 mars 2000, le Conseil fédéral a révisé l’ordonnance sur les contributions d’estivage; il a adapté la conception des contributions aux exigences actuelles en vue d’une exploitation durable et étendu dans ce sens les exigences en matière d’exploitation En outre, il a tenu compte des problèmes particuliers liés à l’estivage de moutons.
L’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les contributions d’estivage le 1er mai 2000 a entraîné un changement de système: les contributions ne sont plus versées par animal, mais par pâquier normal (PN), ou par UGB Un PN correspond à l’estivage d’une UGB pendant 100 jours. Par souci du maintien des droits acquis, les exploitations d’estivage où la durée d’estivage est plus brève continuent à recevoir une contribution par UGB pour les animaux traits La nouvelle ordonnance a permis d’éliminer dans une large mesure les inconvénients de l’ancienne réglementation, tels que l’incitation à intensifier la production, les contributions plus élevées pour les animaux traits ou l’absence de prise en considération de la durée d’estivage En même temps, de nouvelles exigences ont été définies pour l’exploitation, notamment pour l’estivage de moutons, et les contributions ont été augmentées Le PN étant fixé sur la base de l’estivage de 1996 à 1998, un montant forfaitaire est désormais versé par exploitation d’estivage. Il ne change pas tant que le chargement se situe entre 75 et 110% de la charge usuelle en bétail
Taux de 2000
– vaches traites, chèvres et brebis laitières, par UGB (56 à 115 jours d’estivage) 300
moutons, brebis laitières exceptées, par PN 120
– autres animaux consommant des fourrages grossiers, par PN 260
2 . 2 P A I E M E N T S D I R E C T S 2 222
–
Tableau 36 page A42
■ Exploitation durable des régions d’estivage
■
Contributions d’estivage 2000
Contributions pour la protection des eaux

L’art 62a de la loi sur la protection des eaux permet à la Confédération de promouvoir des mesures prises par des agriculteurs afin d’éviter le lessivage et le ruissellement de substances dans les eaux superficielles et souterraines. L’accent est mis sur la réduction des charges en nitrate dans l’eau potable et des charges en phosphore dans les eaux superficielles, aux endroits où les PER, l’agriculture biologique, les interdictions et les prescriptions contraignantes ou les programmes volontaires encouragés par la Confédération (production extensive, compensation écologique) ne sont pas suffisants
La nouvelle ordonnance sur la protection des eaux oblige les cantons à délimiter une aire d’alimentation pour les captages d’eaux souterraines et de surface, et à déterminer les mesures nécessaires à un assainissement, si la qualité des eaux laisse à désirer Ces mesures peuvent, par rapport à l’état de la technique, considérablement restreindre l’utilisation du sol et causer des pertes financières qui ne sont pas supportables du point de vue économique. Les contributions fédérales aux coûts sont de 80% pour les adaptations structurelles et de 50% pour les mesures d’exploitation En 2000, un montant de 1'089’690 francs a été versé
L’OFEFP et l’OFAG ont élaboré des stratégies pour diminuer les charges en nitrate et en phosphore causées par l’agriculture
2 . 2 P A I E M E N T S D I R E C T S 2 223
Caractéristique Contributions Exploitations UGB ou PN mio. de fr. nombre nombre Vaches traites, chèvres laitières, brebis laitières 23 136 3 416 77 227 Moutons, brebis laitières exceptées 2 961 1 087 25 227 Autres animaux consommant des fourrages grossiers 55 140 7 197 209 973 Total 81 238 7 968 1 Total 1999 67 571 8 233
Source: OFAG
1 Ce chiffre correspond au total des exploitations d’estivage ayant droit aux contributions (sans cumul)
2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E
Eviter le lessivage et le ruissellement de substances
Aperçu des projets 2000
Région, commune Durée probable Région visée du projet par le projet
Les cantons préparent actuellement divers autres projets L’OFAG attend à moyen terme 10 projets portant sur les nitrates et 2 concernant le phosphore Ces mesures sont financées par les crédits autorisés dans le domaine des contributions écologiques.
La reconversion de terres assolées en herbages permanents est une mesure permettant de réduire efficacement la lixiviation des nitrates Environ 15% de prairies supplémentaires ont été aménagées à Avry-sur-Matran.
2 . 2 P A I E M E N T S D I R E C T S 2 224
Canton
Année ha LU Sempach 1999–2008 4 905 LU Baldeggersee 2000–2008 4325 VD Thierrens 2000–2008 17,35 VD Morand 2000–2008 14,05 ZH Baltenswil 2000–2008 70,0 BE Walliswil 2000–2008 77,7 FR Avry-sur-Matran 2000–2005 36,7 FR Middes 2000–2006 44,96 SO Gäu 2000–2005 657,9 LU/AG Hallwilersee 2001–2008 3 786 AG Wohlenschwil début en 2001 61,5 TG Klettgau début en 2001 174, phase I AG Büschikon début en 2001 36 Source: OFAG
Terres ouvertes Prairies artificielles Prairies/pâturages e n % d e l a S A U 1999 2001 Source: OFAG 0 60 50 40 30 10 20
Avry-sur-Matran FR
des surfaces
■ Projet Avry-sur-Matran: évolution
■ Compensation écologique
Innovations 2001
Les décisions prises par le Conseil fédéral le 10 janvier 2001 ont notamment concerné les paiements directs écologiques. Les contributions ont été majorées pour les programmes cités ci-dessous
On a majoré de 500 francs les contributions pour bandes culturales extensives, qui passent ainsi à 1'500 fr /ha, afin d’augmenter l’attrait de cet élément de la compensation écologique
■ Culture biologique
Les contributions à la surface pour la culture biologique ont augmenté plus fortement que celles pour les exploitations PER La Confédération soutient ainsi davantage ce mode de production particulièrement respectueux de l’environnement. L’augmentation des contributions s’élève à 200 francs pour les cultures spéciales et pour les terres ouvertes, et à 100 francs pour le reste de la SAU
■ Systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux
La promotion de la garde d’animaux dans des étables particulièrement respectueuses des animaux profite au bien-être de ces derniers. Par ailleurs, une garde particulièrement respectueuse revêt une grande importance pour l’image de l’agriculture L’augmentation de 20 fr /UGB des contributions pour bovins, chèvres, lapins et porcs permet d’accroître l’attrait de ce programme.
2 . 2 P A I E M E N T S D I R E C T S 2 225
Taux de 2001 fr /ha – cultures spéciales 1 200 – terres ouvertes, cultures spéciales exceptées 800 – surfaces herbagères et surfaces à litière 200
Taux de 2001 fr / UGB – bovins, chèvres, lapins 90 – porcs 155
2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E
■ Sorties régulières en plein air d’animaux de rente
Les sorties régulières servent elles aussi le bien-être des animaux. Les contributions accordées au titre de ce programme augmentent de 20 fr /UGB pour les porcs et de 45 fr /UGB pour les bovins, équidés, bisons, moutons, chèvres, daims et cerfs rouges ainsi que lapins.
■ Ordonnance sur la qualité écologique
Le Conseil fédéral a édicté, le 4 avril 2001, l’ordonnance sur la qualité écologique La Confédération renforce ainsi son engagement pour une conservation efficace de la biodiversité Elle soutient désormais davantage les mesures régionales visant à améliorer la qualité et à aménager d’une manière ciblée les SCE La nouvelle ordonnance est la réponse à la critique, scientifiquement fondée, selon laquelle une partie des surfaces de compensation écologique présente une qualité insuffisante et ne contribue pas à une mise en réseau judicieuse.
Les cantons doivent fixer eux-mêmes leurs exigences en matière de qualité et de mise en réseau et financer 10 à 30% des contributions, en fonction de leur capacité financière
Les contributions versées aux exploitants sont imputables aux aides financières fédérales, à concurrence de:
2 . 2 P A I E M E N T S D I R E C T S 2 226
Taux de 2001 fr / UGB – bovins, équidés, bisons, moutons, chèvres, daims et cerfs rouges, lapins 180 – porcs 155
Taux de 2001 fr – pour la qualité biologique 500.– /ha – pour la mise en réseau 500 – /ha – pour les arbres fruitiers haute-tige 20 –/arbre
■■■■■■■■■■■■■■■■
2.3 Amélioration des bases de production
Les mesures énumérées ci-dessous encouragent une production de denrées alimentaires efficiente et respectueuse de l’environnement
Aides financières pour l'amélioration des bases de production
Ces mesures visent à atteindre les objectifs suivants:
– structures d’exploitation modernes et surfaces agricoles utiles bien équipées;

– production efficiente et respectueuse de l’environnement;
– variétés abondantes, aussi résistantes que possible, et produits de très bonne qualité; – protection de la santé humaine et animale ainsi que de l’environnement;
– diversité génétique
227 2 . 3 A M É L I O R A T I O N D E S B A S E S D E P R O D U C T I O N 2
Mesure Comptes Comptes Budget 1999 2000 2001 mio de fr Améliorations structurelles 76 88 91 Crédits d‘investissements 20 100 105 Aide aux exploitations 58 35 Vulgarisation et contributions à la recherche 23 22 24 Lutte contre les maladies phytosanitaires et contre les parasites 362 Production végétale et élevage 21 21 22 Total 148 245 279 Source: OFAG
2.3.1 Améliorations structurelles et aide aux exploitations
Améliorations structurelles
Les mesures prises dans le domaine des améliorations structurelles contribuent à améliorer les conditions de vie et les conditions économiques du monde rural Cela vaut en particulier pour la montagne et les zones périphériques

Nous disposons à cet effet de deux types d’aides à l’investissement:
les contributions (à fonds perdu) impliquant la participation des cantons; – les crédits d’investissements octroyés sous forme de prêts sans intérêts
Les aides à l’investissement permettent aux agriculteurs de développer et de maintenir des structures compétitives sans qu’il en résulte un endettement insupportable D’autres pays aussi, notamment dans l’UE, comptent ces aides parmi les principales mesures de promotion de l’espace rural
Les aides à l’investissement sont accordées aussi bien pour des mesures individuelles que collectives
En 2000, 87 millions de francs étaient à disposition pour les améliorations foncières et les constructions rurales, dont 7 millions sous la forme d’un crédit supplémentaire accordé pour couvrir les dégâts dus aux intempéries de 1999 L’OFAG a approuvé de nouveaux projets qui ont généré un volume global d’investissements de 340 millions de francs et bénéficié de contributions fédérales de 82 millions de francs au total. Cette somme ne correspond pas à celle budgétisée dans la rubrique «améliorations foncières et constructions rurales», car il est rare qu ’ une contribution allouée soit versée la même année; les crédits sont par ailleurs souvent accordés par tranche.
■■■■■■■■■■■■■■■■
–
228 2 . 3 A M É L I O R A T I O N D E S B A S E S D E P R O D U C T I O N 2
■ Moyens financiers destinés aux contributions
Contributions fédérales en 2000 Remaniements parcellaires avec mesures d'infrastructure
Construction de

Tableaux 39-40, pages A47-A48
Les moyens financiers engagés en 2000 par la Confédération sous forme de contributions ont dépassé de 14% ceux de l’année précédente Cette somme est toutefois inférieure de 27% à la moyenne des années 1990/92 L’augmentation des crédits fédéraux servant à couvrir les dégats dus aux intempéries est contenue dans les rubriques ordinaires 1994 et 2000
Contributions fédérales pour les améliorations foncières et les constructions rurales entre 1990/92–2000
Autres constructions rurales mio de fr 64% 13% 23% Région de plaine Région des collines Région de montagne 27,1 0 5 10 15 20 25 30 12,2 8,7 8,7 23,7 1,7 Source: OFAG
chemins Adductions d'eau Intempéries et autres mesures de génie rural Ruraux pour animaux consommant des fourrages grossiers
1990/921993 1994 1995 1996 1997 1998 19992000 m i o d e f r Rubrique ordinaire Rubrique spéciale pour la promotion de l'emploi dans la construction rurale Source: OFAG 1 Dans le cadre de la promotion de l’ emploi, des crédits spéciaux ont été alloués en 1993 et 1994 pour la construction de bâtiments agricoles 0 20 40 60 80 100 120 140 11991 51 91 151 85 85 82 75 75 87 229 2 . 3 A M É L I O R A T I O N D E S B A S E S D E P R O D U C T I O N 2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E 2
Les cantons ont accordé 2’542 crédits d’investissements en 2000, pour un montant total de 266,1 millions de francs, dont 87,2% étaient consacrés à des mesures individuelles et 12,8% à des mesures collectives En région de montagne, des crédits de transition d’une durée maximale de trois ans, appelés «crédits de construction», peuvent en outre être consentis
Crédits d’investissements en 2000
La plupart de ces crédits ont été utilisés pour des mesures individuelles, telles que l’aide initiale destinée aux jeunes agriculteurs, la construction, la transformation ou la rénovation de maisons d’habitation, de bâtiments d’exploitation ou de bâtiments alpestres. Ils sont remboursés dans un délai de 13,1 ans en moyenne. Les taux forfaitaires applicables à l'aide initiale ainsi qu'à l'aide accordée pour les maisons d'habitation ont été relevés de 25% en moyenne dès l’an 2000

Quant aux crédits alloués pour des mesures collectives, ils ont permis notamment de soutenir la réalisation d’améliorations foncières et des mesures de construction (bâtiments alpestres, étables communautaires, bâtiments et équipements destinés à la mise en valeur et au stockage de produits agricoles)
Crédits d'investissements accordés en 2000 par catégorie de mesures, sans les crédits de construction

230 2 . 3 A M É L I O R A T I O N D E S B A S E S D E P R O D U C T I O N 2
Affectation Cas Montant Part Nombre Mio de fr % Mesures individuelles 2 309 232,0 87,2 Mesures collectives, sans crédits de construction 132 10,0 3,8 Crédits de construction 101 24,1 9,0 Total 2 542 266,1 100,0 Source: OFAG
■ Moyens financiers destinés aux crédits d’investissements
Tableaux 41-42 pages A49-A50
Bâtiments d'exploitation Aide initiale Bâtiments d'habitation Achat en commun de cheptel vif et mort, transformation et stockage de produits agricoles Achat d'exploitations par les fermiers Améliorations foncières mio de fr 26,5% 46,0% 27,5% Région de plaine Région des collines Région de montagne 113,7 0 2040 60 80 100 120 71,4 47,1 4,2 2,7 2,9 Source: OFAG
■ Intempéries 1999/2000
Le fonds de roulement alimenté depuis 1963 s’élève actuellement à quelque 1,7 milliard de francs La Confédération met chaque année des fonds supplémentaires à la disposition des cantons En l’an 2000, le montant total octroyé atteignait 100 millions de francs. Ajouté aux remboursements courants, il sert à l’octroi de nouveaux crédits.
Les avalanches et intempéries extraordinaires qui ont fait des ravages en 1999 ont causé des dommages directs s’élevant à 800 millions de francs Douze cantons ont annoncé des dégâts à des terres cultivées et des ouvrages de génie rural pour un montant de 27 millions de francs En 2000, la Confédération a octroyé des contributions d’un total de 8,3 millions de francs pour les travaux de réfection L’article 95 de la loi sur l’agriculture concernant l’octroi de contributions supplémentaires pour remédier aux conséquences particulièrement graves d'événements naturels exceptionnels a été appliqué pour la première fois 7 millions de francs ont été obtenus comme crédits supplémentaires.
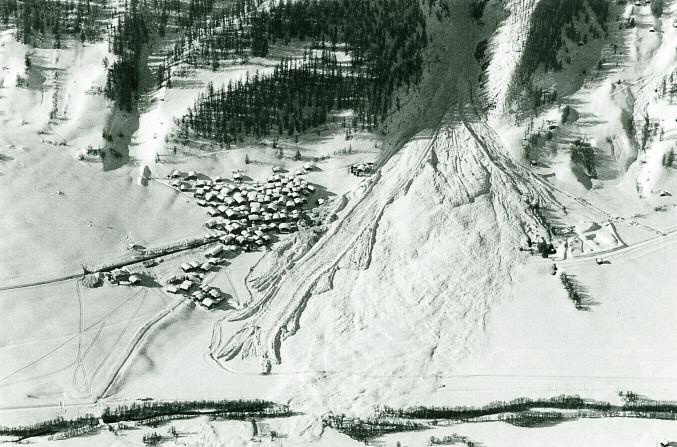
La Confédération n ’accorde pas d’aides pour l’achat d’aliments pour animaux ou pour le dédommagement des pertes de rendement Les coûts occasionnés ont largement été couverts par des aides spontanées et les dons d’organisations d’entraide Les pertes de rendement ont par ailleurs été dédommagées par le «Fonds suisse de secours pour dommages non assurables causés par des forces naturelles» qui a aussi participé aux frais de déblaiement à la charge de particuliers
Suite à une période de précipitations exceptionnelles en octobre 2000, des dégâts considérables ont à nouveau été occasionnés en Valais et sur le versant sud des Alpes Des dommages directs pour un total de 670 millions de francs ont été annoncés jusqu’à la fin de l’année Ils ont été évalués à 27 millions de francs dans l’agriculture Les besoins présumés en aide fédérale se montent à 15 millions de francs, dont une grande partie devrait être couverte par des crédits supplémentaires
231 2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E 2 . 3 A M É L I O R A T I O N D E S B A S E S D E P R O D U C T I O N 2
■ Exécution en trois phases
Evaluation des améliorations intégrales
Les améliorations intégrales existent depuis le début du siècle passé En raison de la répartition des héritages alors en vigueur (code Napoléon), les surfaces exploitées étaient fortement morcelées Par ailleurs, les droits de passage et de débardage ainsi que le manque de chemins carrossables ont peu à peu entravé l’exploitation Le remaniement parcellaire a permis de créer les structures nécessaires à une exploitation efficace Les améliorations intégrales, quant à elles, ont également été mises en œuvre pour accomplir les nombreuses tâches liées au développement des infrastructures d’importance nationale à partir des années cinquante (aéroport de Kloten, autoroutes, plus tard développement des chemins de fer) et à l’introduction des plans d'aménagement local, régional et national. Les intérêts de la protection de l’environnement, de la nature et du paysage y ont davantage été intégrés dès les années 80 Ainsi, les améliorations intégrales sont progressivement devenues une tâche interdisciplinaire ayant pour objectif de réaliser des solutions avantageuses pour l’agriculture et la collectivité.
Les intérêts publics en jeu se sont multipliés avec le temps La question de l’utilité des remaniements parcellaires pour l’exploitation agricole individuelle s ’est donc posée au cours des dernières années
L'Institut du génie rural de l'EPF de Zurich a quantifié les économies réalisées grâce à ces ouvrages dans le cadre de l’«Étude sur le bénéfice privé du regroupement des terres et de l’amélioration du réseau de chemins dans le cadre d’améliorations intégrales» Dans ce cadre, les conditions d’exploitation ont été comparées avant et après les améliorations intégrales Par regroupement parcellaire, on entend l’amélioration de la forme des parcelles, le regroupement des parcelles (unités d’exploitation) ainsi que la facilité d’accès des parcelles (desserte) Pour l’élément «réseaux de chemins», on considère la distance à parcourir entre le domaine et le centre de gravité des parcelles
Phase 1
Examen et évaluation des documents
Phase 2
Choix et vérification d’un système de calcul dans le cadre d’un projet-pilote
Phase 3
Évaluation statistique à l’aide d’autres exemples de la pratique
Dans une première phase, 14 études ayant trait aux questions économiques de l’exploitation des terres ont été évaluées scientifiquement afin de découvrir si un modèle pouvait être choisi pour remplir le mandat.
La deuxième phase s 'est caractérisée par le choix du modèle présenté dans la directive 1995 de l'Union suisse des paysans (USP) «Modification de la distance et de la forme des parcelles agricoles» Les économies réalisées pour chaque parcelle par l’amélioration de la forme des champs (regroupements parcellaires) et les distances plus courtes aux champs (réseaux de chemins) ont aussi pu être calculées Les économies de travail, de force de traction et de frais de machines suite aux remaniements parcellaires donnent le gain privé tiré d’améliorations intégrales en francs par ha et par an.
232 2 . 3 A M É L I O R A T I O N D E S B A S E S D E P R O D U C T I O N 2
À l’aide d’un générateur de nombres aléatoires, l’amélioration intégrale d’Ermensee (LU) a été choisie pour le projet-pilote Il a été démontré que, sur la base des directives de l’USP, les économies pour l’exploitant relatives à la distance au champ et à la forme des champs pouvaient être calculées et que les résultats étaient utilisables d’un point de vue statistique
D’autres améliorations intégrales ont été choisies à l’aide d’un générateur de nombres aléatoires dans la troisième phase, et les économies réalisées ont été calculées Les études se basent sur les années 1994/95 Dans un premier temps, seules les parcelles en propriété ont été intégrées à l’étude Les parcelles en affermage ont été traitées séparément
1 Aussi bien les terres en propriété que celles en affermage ont été incluses dans l’étude
2 Wallenschwil est un petit périmètre partiel de l’amélioration intégrale Beinwil-Wiggwil-Winterschwil

intégrales étudiées Amélioration intégrale Surface du périmètre ha Projet-pilote: Ermensee (LU) 1 427 Otelfingen-Boppelsen (ZH) 1 555 Beinwil (AG), périmètre partiel Wallenschwil 2 99 Ins-Gampelen-Gals (BE) 2 457 Sennwald (SG) 1 2 360 Damphreux (JU) 396 Châtillon-Font-Lully (FR) 490
Amélioration
Source: OFAG 233 2 . 3 A M É L I O R A T I O N D E S B A S E S D E P R O D U C T I O N 2
■
Amélioration intégrale Ins-Gampelen-Gals

Ancien état 234 2 . 3 A M É L I O R A T I O N D E S B A S E S D E P R O D U C T I O N 2
Source: OFAG

Nouvel état 235 2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E 2 . 3 A M É L I O R A T I O N D E S B A S E S D E P R O D U C T I O N 2
Source: OFAG
■ 800 francs d’économies sur les terres en propriété
Les économies réalisées en moyenne de toutes les améliorations incluses dans les études se montent à 800 francs par ha et par an Les écarts entre les diverses régions sont considérables La raison principale invoquée est la différence de degré de morcellement avant le remaniement parcellaire. Ceci est bien mis en évidence dans le projet Wallenschwil, où le morcellement n’était pas particulièrement marqué
3 Une des caractéristiques de l’amélioration intégrale de Wallenschwil est l’augmentation parfois substantielle des surfaces de certaines exploitations après remaniement En raison des frais d’exploitation accrus, leurs frais ne diminuent donc pas Calculés par unité de surface, le regroupement des terres et l’amélioration du réseau de chemins donnent toutefois des valeurs positives
4 Les 81 exploitations de l’étude des parcelles de terres en propriété ont été intégrées dans «Moyennes pondérées»
Source: OFAG
Les économies réalisées grâce à la forme des champs (groupement) sont en moyenne trois fois plus élevées que les économies dues à la distance aux champs (réseaux de chemins). Cela revient à dire que les frais liés aux virages en bout de champ ainsi que sur les chaintres, les coûts du travail à double occasionné par les chaintres ainsi que les rendements inférieurs en bordure de champ et sur les chaintres pèsent plus lourd dans la balance que les frais de déplacement entre le centre de l’exploitation et le centre de gravité des parcelles
Une amélioration intégrale engendre certains gains privés supplémentaires qui n ’ont pu être quantifiés dans ce travail sur la base des directives de l’USP Ainsi, les meilleurs revêtements du nouveau réseau de chemins diminuent l’usure des machines, améliorent la praticabilité lors de mauvaises conditions météorologiques et facilitent l’entretien des routes, ce qui contribue également à la réduction des frais L’amélioration de la régulation du régime hydrique des sols n ’ a pas non plus été prise en considération. Les drainages permettent une exploitation équilibrée des bonnes parcelles Les économies y relatives peuvent être significatives selon les régions
236 2 . 3 A M É L I O R A T I O N D E S B A S E S D E P R O D U C T I O N 2
Économies sur
terres en propriété Amélioration Économie par exploitation Économie par surface intégrale fr fr / ha Frais de Frais liés à Total Frais de Frais liés à Total trajets la forme des trajets la forme des parcelles parcelles Gals 2 380 6 593 8 972 265 799 1 064 ChâtillonFont-Lully 2 509 10 594 13 102 178 720 898 Otelfingen 1 277 5 543 6 819 157 715 872 Damphreux 6 123 11 173 17 296 293 518 811 Ermensee 1 684 3 713 5 396 215 396 611 Sennwald 2 032 2 950 4 981 211 265 476 Wallenschwil 3 3 -34 -31 11 133 144 Moyenne 4 2 171 5 913 8 085 203 574 778
les
■ Économies réduites de moitié sur les terres en affermage
L’étude des parcelles en affermage a mis à jour des économies réduites de moitié par rapport aux parcelles en propriété
Les gains plus faibles s ’expliquent de la façon suivante:
– les parcelles en affermage présentent souvent une forme moins appropriée et une aptitude du sol moins homogène;
elles sont souvent moins bien desservies et plus éloignées du centre d’exploitation; – les surfaces libérées lors d’une cessation d’exploitation sont réparties au hasard entre les autres agriculteurs
Aide aux exploitations
L’aide aux exploitations est une mesure d’accompagnement social servant à parer ou à remédier à des difficultés financières passagères non imputables aux requérants. L’aide a l’effet d’une conversion de dettes hypothécaires en prêts remboursables sans intérêt
■ Répartition des moyens financiers
Des prêts au titre de l’aide aux exploitations ont été accordés dans 316 cas en 2000, pour un montant total d’environ 31 millions de francs Le nombre de prêts a augmenté de plus de 50% par rapport à l’année précédente où il était de 204 La somme allouée a dépassé de 13 millions de francs celle de 1999. Quant au montant moyen des prêts, il a passé de 88'500 à 98'300 francs En moyenne, les remboursements s ’effectuent dans un délai de 12,7 an
Prêts à titre d’aides aux exploitations 2000
Source: OFAG
Alimenté depuis 1973 au moyen de fonds accordés par la Confédération et de remboursements, le fonds de roulement contient, y compris les parts des cantons, environ 121 millions de francs Les nouvelles ressources mises à la disposition des cantons en 2000 se montent à 7,75 millions de francs. L'octroi de prêts présuppose une prestation équitable des cantons qui, suivant leur capacité financière, variait entre 40 et 100% de l’aide fédérale jusqu’à la fin de l’an 2000 Dès 2001, la prestation des cantons a été abaissée et doit désormais atteindre entre 20 et 80% de l’aide fédérale. Ajoutés aux remboursements courants, les montants accordés par les pouvoirs publics sont utilisés pour l’octroi de nouveaux prêts
237 2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E 2 . 3 A M É L I O R A T I O N D E S B A S E S D E P R O D U C T I O N 2
–
Affectation Cas Montant Nombre Mio de fr Conversion de dettes existantes 280 28,9 Difficultés financières extraordinaires à surmonter 36 2,2 Total 316 31,1
Tableau 43 page A51
■ Formation de quatre centres de compétences
2.3.2 Recherche, vulgarisation, formation professionnelle, haras
Recherche agronomique
Depuis le début de l’année 2000, les stations fédérales de recherches agronomiques et le Haras national appliquent le concept de gestion par mandat de prestations et enveloppe budgétaire (GMEB) La GMEB dynamise le développement de la recherche et favorise une gestion moderne et économique Les expériences faites au cours de la première année permettent déjà de tirer des conclusions utiles pour la suite Globalement, le passage à la GMEB a été un succès. Les réactions montrent que la nouvelle forme de gestion nécessite encore un temps d’adaptation, jusqu’à ce que tous les collaborateurs se soient formés au nouveau système
La structure de la recherche agronomique peut être comparée à un holding dont la maison mère serait l’OFAG Celui-ci élabore la stratégie à long terme Les six stations de recherches administrées par GMEB sont des entreprises gérant l’opérationnel et jouissant d’une relative indépendance dans le cadre de leur mandat de prestations. Elles sont regroupées en quatre centres de compétences
Champs d’activité des centres de compétences
Centres de compétences
Grandes cultures, herbages et agroécologie

Arboriculture, viticulture et horticulture
Production animale et denrées alimentaires d’origine animale
Economie et technologie agricoles
F
AL R
Ressources environnementales et protection de la nature en agriculture Nature et paysage Systèmes agricoles écologiques
Contrôle écologique Grandes cultures; systèmes pastoraux Sélection de plantes de grandes cultures, plantes de grandes cultures transgéniques
Viticulture et œnologie Baies, plantes médicinales; cultures sous serres
Arboriculture, culture maraîchère Stockage et mise en valeur des fruits et des légumes
Examen des produits phytosanitaires et mesures phytosanitaires
Production de lait et de viande
Contrôle des aliments pour animaux
Lait et fromage
Produits laitiers
Prestations de services
238 2 . 3 A M É L I O R A T I O N D E S B A S E S D E P R O D U C T I O N 2
■■■■■■■■■■■■■■■■
Source: OFAG
AC
AW RAP
AM
Economie agricole Technique agricole AT
F
F
F
■ Objectifs atteints à 86%
La prestation de recherche est évaluée au moyen d’indicateurs concrets et de normes à atteindre Les objectifs préétablis ont été concrétisés dans environ 86% des cas Le manque de personnel compétent ou spécialisé dans certains domaines, ainsi que les mesures de restructuration encore en cours, ont engendré quelques retards dans divers projets
■ Budget réduit de 10%
Les économies à réaliser par la recherche agronomique de 1999 à fin 2001 s’élèvent à 8,3 millions de francs, ce qui correspond à environ 10% des moyens engagés
Dans l’ensemble, la GMEB offre une liberté accrue et une plus grande flexibilité opérationnelle aux stations de recherches. Cela implique toutefois plus de rigueur dans les rapports à fournir, qui offrent désormais une palette d’informations beaucoup plus large
Vulgarisation en agriculture et en économie familiale rurale
C’est aux cantons que revient la responsabilité de la vulgarisation. La Confédération leur apporte son soutien en offrant une aide financière à trois niveaux: aux services cantonaux de vulgarisation agricole et de vulgarisation en économie familiale rurale, aux services de vulgarisation spéciaux des organisations agricoles d’importance nationale et aux centrales de vulgarisation agricole de l’Association suisse pour le conseil en agriculture
■ Premières expériences de recensement des prestations de conseil
Depuis le début de l’année 2000, les cantons recensent et annoncent, conformément aux nouvelles directives de l’OFAG, les prestations de leur service de consultation donnant droit à une aide financière de la Confédération Les expériences sont concluantes.
Certes, il y a eu quelques difficultés initiales pendant la première année: la répartition des prestations de consultation par domaine d’activité n ’est pas toujours simple et le recensement demande un travail supplémentaire Ces difficultés devraient disparaître à mesure que des expériences seront acquises.
239 2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E 2 . 3 A M É L I O R A T I O N D E S B A S E S D E P R O D U C T I O N 2
Dépenses pour la vulgarisation en 2000 Destinataires Montant mio de fr Services cantonaux de vulgarisation agricole 8,6 Services cantonaux de vulgarisation en économie familiale rurale 0,8 Services de vulgarisation spéciaux des organisations agricoles 0,9 Association suisse pour le conseil en agriculture 8,4 Total 18,7
Source: Compte d Etat
La direction du service cantonal de vulgarisation dispose ainsi d’un instrument de gestion lui offrant une idée plus précise des procédures internes, moyennant, par exemple, la saisie des dépenses par catégorie de prestation ou par domaine d’activité Cet instrument facilitera aussi les étapes suivantes, telles que l’échelonnement des tarifs selon le type de prestation et la saisie statistique des manifestations de formation continue ou des cas de conseil
L’OFAG obtient ainsi pour la première fois des données quantifiées sur les prestations de vulgarisation, contrairement aux années précédentes, où seuls les taux d’emploi étaient connus Le délai transitoire est fixé de sorte à laisser suffisamment de temps aux cantons pour faire leurs expériences et mener à bien les adaptations nécessaires Dans l’intervalle, l’OFAG continue à verser son aide financière aux cantons selon le système encore en vigueur, axé sur les dépenses
La deuxième période contractuelle liant l’OFAG et l’Association suisse pour le conseil en agriculture arrive à terme à la fin 2001 Le contrat pour la période courant de 2002 à 2005 a fait l’objet de nouvelles négociations avec l’association et a été signé au printemps 2001 Il réglemente les tâches des deux centrales de vulgarisation, la LBL à Lindau et le SRVA à Lausanne.
Le nouveau contrat présente une certaine constance dans son contenu et des innovations quant à sa forme. La période contractuelle s’étend sur quatre ans comme jusqu’à présent; les prestations tant techniques que quantitatives exigées des centrales de vulgarisation restent quasiment inchangées; l’aide financière de la Confédération, fixée à 8,4 millions de francs par année, est maintenue
Une nouveauté importante est la conclusion d’une convention de prestations, qui implique:
– la formulation d’objectifs stratégiques et spécifiques;
la définition d’une stratégie de marché claire;
– la description des tâches actuelles comme produits et l’élaboration d’indicateurs et de normes correspondants
Les centrales de vulgarisation proposent des prestations principalement en rapport avec les cinq produits suivants:
développement de méthodes, récolte d’informations de base et de données, analyses et études ciblées;
initiation et formation continue des vulgarisateurs;
– élaboration ou développement et diffusion de documents, instruments de travail et logiciels;
soutien de projets spécifiques des services de vulgarisation, interprofessions et régions;
– mise sur pied et gestion de plates-formes de coordination ou collaboration à de tels projets
240 2 . 3 A M É L I O R A T I O N D E S B A S E S D E P R O D U C T I O N 2
–
–
–
–
■ Nouveau contrat pour les centrales de vulgarisation
■ La formation professionnelle agricole en pleine réforme
Formation professionnelle agricole
La formation professionnelle agricole a son fondement dans la loi sur l’agriculture et comprend la formation initiale et le perfectionnement de l’agriculteur, ainsi que les douze professions agricoles spécialisées Dans le cadre de la réforme de l’administration fédérale, la coordination de la formation professionnelle agricole a été transférée de l’OFAG à l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT)
La révision en cours de la loi sur la formation professionnelle devrait ainsi permettre d’intégrer les bases légales et la structure de la filière agricole dans le système général de formation professionnelle Le Conseil fédéral a adopté, l’année passée, le message relatif à une nouvelle loi sur la formation professionnelle conçue comme loi-cadre. Celle-ci prévoit deux nouveaux éléments essentiels: la flexibilité et la perméabilité de la formation professionnelle A cet effet, il convient de condenser l’offre de base et d’encourager le perfectionnement tout au long de la vie. Des offres et mesures spéciales doivent être mises en place pour tenir compte autant des élèves plus faibles que de ceux qui sont particulièrement doués Enfin, il importe de concéder une plus grande latitude décisionnelle aux associations professionnelles qui, en contrepartie, devront assumer davantage de responsabilité
La nécessité de réformer la formation professionnelle agricole ne découle pas seulement de la rationalisation de l’administration; elle est aussi renforcée par l’évolution des structures dans l’agriculture et l’espace rural: – la forte diminution du nombre d’apprentis remet en question la formation dans diverses professions agricoles spécialisées;
il existe des surcapacités dans la formation professionnelle agricole.
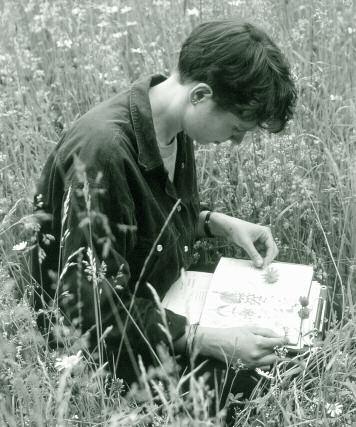
241 2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E 2 . 3 A M É L I O R A T I O N D E S B A S E S D E P R O D U C T I O N 2
–
Evolution formation professionnelle agricole et artisanale & industrielle N o m b r e Contrats 1ère année d'apprentissage professions artisanales et industrielles (indice) Contrats 1ère année d'apprentissage agriculture Source: OFFT 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000
En comparaison avec d’autres professions, le nombre de rapports d’apprentissage et d’apprentissages terminés a baissé plus que proportionnellement dans l’agriculture dès la fin des années septante, pour se stabiliser depuis quelques années à un niveau d’environ 900 certificats fédéraux de capacité par année. Cette évolution reflète la manière dont les successeurs potentiels et leurs parents jugent les perspectives d’avenir dans ce secteur Les contrats d’apprentissage par 100 entreprises exploitées à titre principal ont passé de plus de quatre par an dans les années septante à moins de deux dans les années nonante Or, en admettant un changement de génération tous les 25 à 30 ans et le nombre actuel d’entreprises exploitées à titre principal, il faudrait trois à quatre nouveaux rapports d’apprentissage par année pour qu ’elles continuent toutes à être gérées par des chefs d’exploitation ayant bénéficié d’une formation agricole.
Les associations professionnelles sont également affectées par les développements décrits. La Fédération suisse de l’agriculture, par exemple, jusqu’alors responsable de la formation professionnelle des agriculteurs, est arrivée à la conclusion qu ’elle n ’est plus à même d’accomplir sa tâche dans ces conditions Elle entend donc en céder la responsabilité à l’Union suisse des paysans (USP), qui met actuellement en place une plate-forme de formation destinée à toutes les organisations intéressées Dans le cadre d’un projet réalisé en rapport avec le deuxième arrêté sur les places d’apprentissage, l’USP a par ailleurs reçu le mandat de l’OFFT de créer un «champ des professions liées à la nature» La création de champs professionnels est conforme au message relatif à une nouvelle loi sur la formation professionnelle. Elle vise à augmenter la perméabilité, à améliorer la qualité de la formation et à garantir une utilisation plus efficace des ressources
Comme l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture sont des professions de la terre qui puisent leur source dans le milieu rural Il semble donc logique que ces trois secteurs aient des intérêts communs dans le domaine de la formation professionnelle Ils sont concurrents, certes, mais cela représente tout sauf un désavantage L’USP recherche dès lors les professions susceptibles de collaborer à la formation de la relève et leurs points communs en la matière Le regroupement de certains secteurs de formation devrait permettre d’éviter les chevauchements et de mettre à profit les synergies
242 2 . 3 A M É L I O R A T I O N D E S B A S E S D E P R O D U C T I O N 2
■ Le «champ des professions liées à la nature»
N o m b r e Sources: OFFT, OFS 0 1,5 1,0 0,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 1977 1980 1985 2000 1996 1990
Evolution nouveaux contrats d'apprentissage par 100 exploitations gérées à titre principal
Vu la baisse du nombre d’élèves et de participants aux cours, de nombreux centres de formation professionnelle agricole s ’efforcent de rendre leur offre aussi variée et étendue que possible Le faible nombre de participants se répartit donc sur une offre de formation plus large, ce qui accentue le fractionnement et détériore la qualité de la formation La création de champs professionnels donne aux institutions de formation la possibilité de concentrer leurs forces Chaque centre peut ainsi se focaliser sur une formation de base générale et une spécialisation appropriée, plutôt que d’offrir toute la palette des formations Prestataires universels actuellement, les écoles professionnelles deviendront ainsi peu à peu des centres de compétences
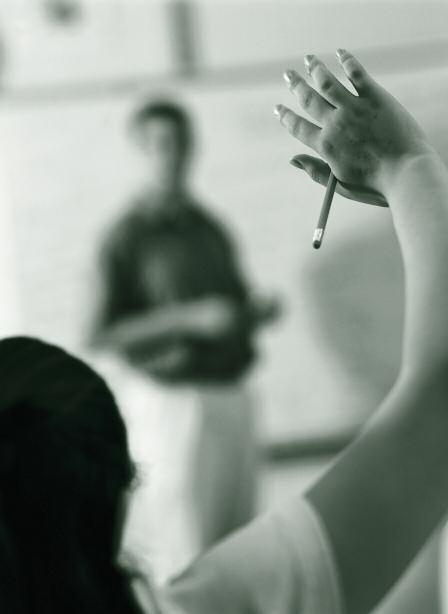
243 2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E 2 . 3 A M É L I O R A T I O N D E S B A S E S D E P R O D U C T I O N 2
Haras fédéral
Les objectifs stratégiques du Haras fédéral d’Avenches sont les suivants: – encouragement de la production chevaline agricole, respectueuse des animaux;
– promotion de la race des Franches-Montagnes;
– optimisation du transfert des connaissances: information et documentation
La gestion par GMEB a favorisé le développement du haras en un centre de compétences national pour les questions liées au cheval Elle confirme aussi son rôle essentiel pour le maintien de la race des Franches-Montagnes La palette de ses prestations témoigne de l’esprit novateur du haras: publications, colloques, formation et conseils sont appréciés de la clientèle Cette dernière, très variée, va des producteurs aux consommateurs, en passant par différentes organisations nationales et internationales
Les prestations du haras sont évaluées à l’aide de 43 indicateurs et normes Les objectifs fixés ont été atteints à 80% Le manque de personnel compétent ou spécialisé dans certains domaines est partiellement compensé par une collaboration accrue avec des tiers

244 2 . 3 A M É L I O R A T I O N D E S B A S E S D E P R O D U C T I O N 2
■ Gestion du Haras
■ Etude variétale
2.3.3 Matières auxiliaires de l’agriculture, protection des végétaux et des variétés
Semences
Dans le secteur des grandes cultures, les variétés de la plupart des espèces ne peuvent être importées ou mises en circulation que si elles ont été préalablement enregistrées dans le catalogue des variétés édité par l’OFAG Pour être enregistrée dans ce catalogue, une variété doit présenter une amélioration par rapport aux autres variétés dans le domaine de la culture ou de la transformation Afin de vérifier si cette exigence est remplie, les stations fédérales de recherches agronomiques sont mandatées par l’OFAG pour réaliser des examens officiels Ceux-ci sont effectués dans le cadre d’un réseau d’essais représentatif des diverses conditions de production du pays Les résultats sont rendus publics.
Le but de l’étude variétale consiste à mettre à la disposition des agriculteurs des variétés adaptées aux conditions de production suisses et répondant tant aux attentes des consommateurs qu ’ aux besoins de l’industrie de transformation.
Une importance particulière est accordée, en plus du rendement, à la résistance aux maladies et aux ravageurs. Les variétés sont testées quant à leur résistance potentielle, sans traitement avec des fongicides ou des insecticides On renonce, par exemple, à traiter les céréales à paille avec des raccourcisseurs chimiques pour tester leur résistance à la verse
Les potentiels d’utilisation et de transformation sont des données importantes servant à déterminer si une variété est adaptée aux besoins du marché Ainsi, on examinera dans quelle mesure une variété de pommes de terre se prête à la fabrication de frites ou de chips, qui requiert des caractéristiques très particulières. Une autre étude consiste à évaluer la valeur panifiable d’une variété de blé, les écarts de qualité entre les variétés pouvant être considérables Ces informations sont capitales pour la meunerie et la boulangerie lors du choix des variétés entrant dans la composition des différentes sortes de pain
Les exigences que doit remplir une variété pour être admise au catalogue sont fixées dans l’ordonnance du DFE du 7 décembre 1998 sur les semences et plants Une fois les essais réalisés, une commission technique consultative regroupant les sélectionneurs, les producteurs, les transformateurs et la distribution est appelée à se prononcer sur les résultats des examens; la variété est admise si elle remplit les conditions fixées dans l'ordonnance.
Le nombre de variétés de blé d'automne et de printemps cultivées en Suisse a sensiblement évolué depuis 1980 On compte aujourd'hui plus de 30 cultivars enregistrés dans le catalogue national Un autre exemple intéressant est celui de l'orge; l'évolution du choix variétal y est encore plus remarquable. Il faut toutefois noter que le nombre de variétés effectivement utilisées par les agriculteurs est plus restreint
■■■■■■■■■■■■■■■■
245 2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E 2 . 3 A M É L I O R A T I O N D E S B A S E S D E P R O D U C T I O N 2
Conformément à l’accord bilatéral sur l’agriculture, la Suisse doit ouvrir son marché intérieur aux variétés du catalogue européen Il importe donc, pour les agriculteurs comme pour les distributeurs ou l’industrie de transformation, de déceler, parmi les centaines de variétés figurant dans ce catalogue, celles qui sont le mieux adaptées à nos conditions de production et aux besoins du marché A ce titre, et en collaboration avec le réseau d'expérimentation des stations fédérales, des listes de variétés recommandées ont déjà été établies par les interprofessions telles que swiss granum, swisspatat ou l’Association pour le développement de la culture fourragère Le réseau d’essai sert en outre, comme auparavant, à tester des variétés suisses L’étude variétale gardera ainsi toute son importance dans un marché libéralisé

Produits phytosanitaires
La nouvelle ordonnance sur l'homologation de produits phytosanitaires est entrée en vigueur le 1er août 1999 Les autorisations 2000 ont été délivrées pour la première fois selon le nouveau droit Dans l’ordonnance précitée, les exigences en la matière sont plus fortement axées sur celles de l’UE Des modifications considérables ont dû être consenties, autant de la part des requérants que des autorités d’homologation Aussi, le contrôle des demandes à la date butoir, fixée au 15 janvier 2000, a-t-il montré que seules 5% étaient complètes et remplissaient les exigences selon le nouveau droit Il en est résulté un dialogue intense entre les requérants et leurs fédérations, d’une part, et les autorités d’homologation, de l’autre
toujours en vue de mettre en application les nouvelles exigences et procédures Suite à l’adoption, par les autorités, de la pratique d’homologation conforme aux nouvelles exigences internationales, il faut plus de temps pour compléter et traiter une demande.
246 2 . 3 A M É L I O R A T I O N D E S B A S E S D E P R O D U C T I O N 2
–
19801990 2001 N o m b r e blé orge Source: OFAG 0 40 30 20 10
Evolution du nombre de variétés d'orge et de blé commercialisables de 1980 à 2001
■ Avenir de l’étude variétale
■ Nouvelle pratique en matière d’homologation
■ Produits phytosanitaires dans la zone de protection des eaux souterraines S2
Les premières expériences faites en 2001 montrent que l’on est déjà assez bien parvenu à maîtriser les difficultés initiales dans l’application du nouveau règlement, auxquelles il fallait d’ailleurs s ’attendre La collaboration entre les requérants et les autorités d’homologation devrait se stabiliser au nouveau niveau dans les années à venir
Evolution des demandes et des nouvelles autorisations pour les produits phytosanitaires
Remarque: Ne sont pas comptées les demandes liées à un domaine d’application élargi de produits déjà autorisés, ni celles déposées en raison d’une modification d’activité professionnelle (fusions, vente de produits ou de branches d’activité) du détenteur de l’autorisation
En rapport avec le débat sur une éventuelle interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires dans la zone de protection des eaux souterraines S2, un groupe de travail composé de représentants de l’OFAG et de l’OFEFP a reçu le mandat de soumettre les produits homologués en Suisse à un examen relatif au danger potentiel pour la nappe phréatique Comme les données scientifiques relatives au comportement environnemental des produits phytosanitaires et les méthodes d’évaluation sont en constante évolution, des réévaluations ciblées sont indiquées L’évaluation de nouvelles données peut en effet établir qu ’ un produit phytosanitaire risque d’aboutir dans un captage d’eau potable, de par sa mobilité et sa dégradabilité L’autorité d’autorisation en interdit alors l’utilisation dans la zone de protection S2 Conformément à l’ordonnance du 23 juin 1999 sur l’homologation des produits phytosanitaires et à la modification de l’annexe 4 3 de l’ordonnance sur les substances qu ’elle mentionne, de telles conditions peuvent être imposées depuis janvier 2001 Les produits phytosanitaires dont l’autorisation n ’est pas assortie d’une condition peuvent être utilisés dans la zone S2 comme jusqu’à présent
Une procédure d’évaluation des dangers pour la nappe phréatique est, depuis quelque temps, appliquée avec succès dans les pays membres de l’UE En vue d’un ajustement international, l’OFAG estime qu’il faut également l’adopter. Le comportement environnemental de quelque 40 substances prioritaires a été évalué à l’aide de cette méthode d’appréciation internationale, compte tenu des dernières données scientifiques Ces évaluations scientifiques servent ainsi de base à la décision d’imposer ou non une condition liée à la protection des eaux pour un produit phytosanitaire déterminé La mise à jour des listes de substances actives par l’OFAG et l’OFEFP devrait être terminée prochainement
247 2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E 2 . 3 A M É L I O R A T I O N D E S B A S E S D E P R O D U C T I O N 2
Année Nouvelles demandes Produits nouvellement homologués Nombre Nombre 1998 126 110 1999 121 42 2000 100 91
■ Produits phytosanitaires et feu bactérien
En 2000, le feu bactérien, favorisé par les conditions météorologiques, a occasionné des dégâts très graves dans certaines régions de Suisse orientale et centrale Vu la propagation constante de la maladie, il y a peu d’espoir de pouvoir endiguer l’infection à l’aide des mesures de lutte actuelles. C’est la raison pour laquelle des produits phytosanitaires peuvent dorénavant être utilisés L’OFAG a autorisé à cette fin deux produits, l’un à base de poudre de roche acide («Myco-Sin») et l’autre à base de Bacillus subtilis («Biopro») Ces deux produits ne contiennent pas d’antibiotiques
En outre, l’OFAG examine une stratégie de lutte intégrant des antibiotiques La streptomycine, autorisée aux Etats-Unis, au Canada et dans divers pays de l’UE, comme l’Allemagne, est la seule substance qui se soit affirmée dans la pratique Une collaboration avec les autorités allemandes devrait permettre d’affiner la base décisionnelle quant à une éventuelle utilisation de la streptomycine, principalement quant à l’efficacité et à la sécurité (risque de transfert de résistance) La stratégie prévoit d’effectuer des essais contrôlés dans des zones à risque, qui seront suivis par la FAW au plan scientifique Par ailleurs, les experts continuent à rechercher d'autres produits phytosanitaires appropriés dans le cadre des efforts déployés à cet effet à l’échelle internationale, en étroite collaboration avec l’industrie et la pratique
Engrais
Suite à la crise de l’ESB, le DFE a édicté, à titre de prévention, de nouvelles dispositions pour les engrais contenant des produits animaux (risque de confusions) Depuis le 1er janvier 2001, ce type d’engrais est soumis à une autorisation de commercialisation (nouvelle ordonnance du DFE sur la mise en circulation des engrais; ordonnance sur le Livre des engrais) En font partie les engrais constitués à partir des matières suivantes ou en comprenant:
– farine de sang et autres produits sanguins;
gélatine issue de déchets de ruminants;
– farine de viande et farine de viande et d’os;
– farine de cretons et tourteaux de cretons;
farine d’os dégraissés;
– graisse extraite de parties de la carcasse impropres à la consommation;
– farine de cornes et farine d’onglons
Les demandes d’autorisation pour ces engrais doivent être déposées auprès de l’OFAG L’innocuité des composants d’origine animale doit être démontrée par le requérant. Si le résultat de l’examen du dossier par les instances compétentes, c ’est-à-dire l’OVF, l’OFAG et l’OFSP est favorable, le produit concerné peut être commercialisé en vertu d’une autorisation individuelle. Les critères d’évaluation fixés dans les directives de l’OFAG englobent l’identification de la catégorie de risque du pays d’origine, une déclaration d’origine complète ainsi que des critères de qualité concernant la production et le traitement du matériel Depuis le 1er janvier 2001, seuls des produits à base de farine de corne et d’onglons ont été autorisés
248 2 . 3 A M É L I O R A T I O N D E S B A S E S D E P R O D U C T I O N 2
–
–
■ Feu bactérien: développement de la situation en 2000
Protection des végétaux
Parmi les maladies bactériennes connues des arbres portant des fruits à pépins et de certaines plantes ornementales apparentées, le feu bactérien est la plus dangereuse. La maladie est due à l’action de la bactérie Erwinia amylovora, dont les premiers signalements remontent au 19e siècle aux Etats-Unis En Europe, elle a été constatée pour la première fois à la fin des années 50 en Angleterre, puis quelques années plus tard sur le continent, au Danemark, où a été découvert le premier foyer La maladie a ensuite rapidement gagné d’autres pays, comme les Pays-Bas, l’Allemagne, la Belgique et la France Au début des années 80, la maladie menace les cultures fruitières du BadeWurtemberg Le feu bactérien est détecté pour la première fois en Suisse en 1989 au nord du canton de Zurich, près de la frontière allemande.
Depuis son apparition en Suisse en 1989, le feu bactérien n ’avait jamais provoqué de foyers aussi importants qu ’ en 2000. La situation était particulièrement grave en Thurgovie, canton arboricole le plus important du pays où, dans une zone d’environ 100 km2, pas moins de 200 ha de vergers commerciaux et quelque 4'000 arbres haute-tige ont été touchés La virulence de la maladie dans cette zone au cours de l'année écoulée est due aux conditions météorologiques exceptionnellement favorables à la multiplication et à la dissémination de la bactérie E. amylovora au moment de la floraison des arbres fruitiers Il faut savoir que la floraison est le stade le plus propice aux infections des plantes hôtes

249 2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E 2 . 3 A M É L I O R A T I O N D E S B A S E S D E P R O D U C T I O N 2
L’évolution du feu bactérien en 2000 montre que l’agent pathogène peut dévaster de grandes surfaces en un rien de temps Des foyers sont apparus pour la première fois aussi dans plusieurs cantons de Suisse romande et au Tessin Dans ces régions, il ne s ’agit toutefois encore que de foyers isolés, touchant principalement la plante hôte ornementale Cotoneaster salicifolius
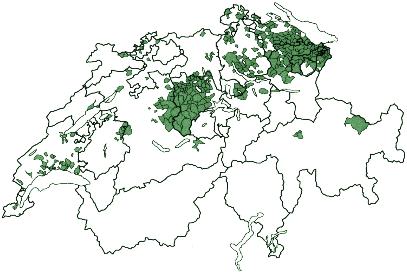

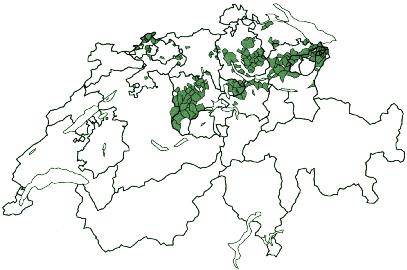
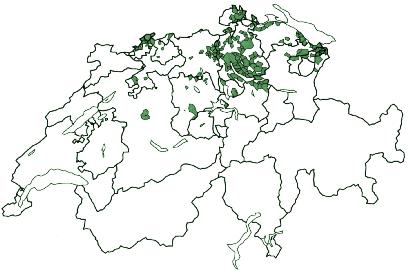
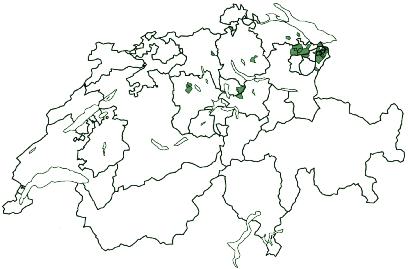
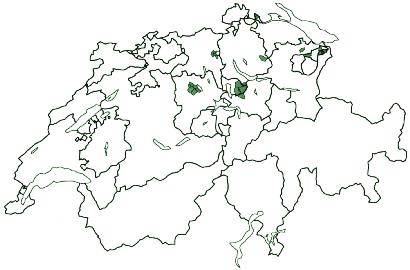
2 . 3 A M É L I O R A T I O N D E S B A S E S D E P R O D U C T I O N 2 250
Propagation du feu bactérien en Suisse de 1995 à 2000 1995 1996 1997 1998 1999 Communes avec foyers 2000 Source: FAW
La Confédération, reconnaissant très tôt la menace que représente cette maladie pour l’arboriculture et l’horticulture, a immédiatement mis en place un dispositif de lutte Ce dernier est basé sur un concept phytosanitaire global, qui s ’applique à tout organisme particulièrement nuisible aux végétaux ayant le statut d’organisme de quarantaine. Le concept prévoit notamment des mesures différenciées selon le degré de propagation de l’agent pathogène:

1 l’organisme nuisible est encore inconnu dans le pays, mais il risque d’être introduit par l’importation de plantes hôtes
➞ mesures à la frontière;
2. la présence de l'organisme nuisible est avérée, mais se limite à des foyers isolés;
➞ mesures de lutte visant à éradiquer l'organisme;
3. l’organisme nuisible est endémique dans certaines régions, mais les autres en sont encore pratiquement indemnes
➞ mesures visant à endiguer la propagation de l’organisme
La première phase du dispositif de lutte a commencé dès le début des années 70 avec l'interdiction d'importer les plantes hôtes du feu bactérien, afin d'empêcher l'introduction de la maladie par l'intermédiaire de végétaux contaminés
Avec la découverte du premier foyer d'infection en 1989, la mise en œuvre de mesures d’éradication a marqué le début de la deuxième phase Ces mesures consistent à détruire de manière systématique les plantes contaminées ainsi que les plantes présumées contaminées, même si celles-ci ne présentent pas de symptômes Dès 1997, l’éradication des foyers isolés est complétée par des mesures prophylactiques comme l’arrachage préventif de plantes connues pour être particulièrement sensibles.
Vu l’apparition croissante de foyers persistants dans certaines régions, la troisième phase du dispositif de lutte a été lancée en 1999. Dans les zones déclarées ‘contaminées’, les mesures de lutte ne visent dès lors plus qu’à contenir la progression de la maladie; elles servent à maintenir son potentiel infectieux au plus bas niveau possible, tout en limitant l’impact des mesures d’assainissement sur les plantes atteintes Il s ’agit notamment de privilégier l’amputation des branches atteintes plutôt que la destruction complète des arbres
2 . 3 A M É L I O R A T I O N D E S B A S E S D E P R O D U C T I O N 2 251
2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E
■ Stratégie de lutte
■ Soutien financier
Les frais de lutte comprennent les dépenses occasionnées pour l’assainissement ainsi que les éventuelles indemnités versées aux propriétaires de plantes dont la destruction a été ordonnée En moyenne, 2/3 des montants versés depuis 1989 ont été pris en charge par la Confédération et 1/3 par les cantons.
des mesures de lutte contre le feu bactérien
■ Perspectives
L'ampleur des dégâts causés par le feu bactérien au cours de l'année 2000 a amené le DFE à réviser les possibilités d'indemnisation Les nouvelles dispositions prévoient l'octroi d'indemnités par les cantons lorsque la destruction concerne des plantes produites ou cultivées à titre professionnel et que la perte consécutive à la destruction s'élève au moins à 1'500 francs La Confédération participe aux indemnités à raison de 50 à 75% selon les cas Le département souhaite ainsi atténuer les conséquences financières pour les agriculteurs dont les arbres ont été détruits au titre de la protection des végétaux.
Vu la manière dont la maladie s ’est propagée en Europe au cours de ces quarante dernières années, il n ’ y a guère d’espoir qu ’elle recule en Suisse dans les années à venir Les mesures conjointes de la Confédération et des cantons mises en œuvre au cours des deux premières phases du plan de lutte ont permis de retarder d’au moins dix ans son introduction, puis sa propagation La stratégie de lutte sera donc poursuivie, notamment pour protéger les zones qui sont encore indemnes ou dans lesquelles seuls des foyers isolés ont été décelés Afin de renforcer les mesures en vigueur, l’OFAG a décidé d’autoriser l’utilisation, dès le printemps 2001, de deux produits pour lutter contre le feu bactérien: le premier est un produit à base d’une bactérie antagoniste (Bacillus subtilis), le second contient de la poudre de roche Les deux produits sont compatibles avec les exigences qui ont cours en agriculture biologique.
2 . 3 A M É L I O R A T I O N D E S B A S E S D E P R O D U C T I O N 2 252
Coûts
m i o d e f r
* Estimation, les décomptes des cantons n’étant pas définitifs 0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 8990 91 92 93 94 95 96 97 9899 2000*
Source: OFAG
■ Plan d’action national en faveur des ressources phytogénétiques
Dans un nombre croissant de régions, l’éradication du feu bactérien n ’est plus envisageable Les mesures d’enrayement à développer représentent un nouveau défi pour l’arboriculture et la recherche En conséquence, le programme des stations fédérales de recherches s ’articulera autour des pôles suivants:
– intensification de l'étude épidémiologique du feu bactérien dans les conditions spécifiques à la Suisse;
développement des services de prévisions et d'avertissements;
– approfondissement de l'étude d'efficacité biologique des produits phytosanitaires
Ressources phytogénétiques

L’orientation du plan d’action suisse pour la conservation et l’utilisation durable des ressources phytogénétiques dans l’alimentation et l’agriculture se réfère au cadre fixé par le plan d'action global de 1996 de la FAO. Le plan d’action national suisse est une nouvelle mesure complétant celles déjà existantes de la politique agricole et les démarches dans le domaine de la diversité des espèces et des écosystèmes
La phase d’introduction dure de 1999 à 2002 Les tâches suivantes ont été considérées comme prioritaires:
Les inventaires des plantes cultivées indiquent quelles variétés sont présentes en quel nombre dans notre pays. Ils permettent aussi d’apprécier le risque de disparition et de déterminer si des programmes spéciaux de sauvegarde et d’utilisation sont nécessaires
Les programmes de sauvegarde des espèces fruitières à pollinisation croisée (allogames), ne pouvant pas être conservées à l’aide de semences, il est indispensable de planter et d’entretenir les arbres individuellement dans des «vergers conservatoires» Le concept de sauvegarde prévoit d’aménager des vergers nationaux et régionaux gérés par les organisations ou les cantons intéressés.
2 . 3 A M É L I O R A T I O N D E S B A S E S D E P R O D U C T I O N 2 253
–
2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E
Les programmes de conservation et d’utilisation sur les lieux (en champ) sont une pièce maîtresse du plan d’action national servant à garantir à long terme l’utilisation sur place de variétés locales sous-utilisées L’objectif de ces programmes est de maintenir et d’utiliser sur les lieux le savoir-faire de la population rurale en ce qui concerne la culture, l’usage et les caractéristiques des variétés locales Le projet «Ribelmais» dans la vallée du Rhin en est un exemple, un autre celui dans le canton des Grisons, à la faveur duquel d’anciennes variétés de céréales grisonnes sont à nouveau mises en culture
Les programmes de régénération portent sur des espèces végétales, dont la semence est stockée dans des banques de gènes pour une conservation à long terme Ces espèces forment la base à long terme de la sélection. La semence conservée doit être renouvelée à intervalles déterminés afin de garder sa vitalité

Les mesures du plan d’action national sont mises en œuvre sous la forme de projets Les organisations intéressées peuvent présenter des propositions allant dans ce sens L’art. 140 LAgr fournit la base légale régissant le soutien financier. La gestion globale et la haute surveillance relèvent de l’OFAG
Les aspects scientifiques du plan d’action national sont placés sous la responsabilité de la RAC, qui gère en particulier les travaux liés aux banques de gènes Elle assure en outre la coordination dans le domaine de la recherche, notamment avec l’EPF
La Commission suisse pour la conservation des plantes cultivées, largement représentative, accompagne les travaux en tant qu ’ organe consultatif. Elle coordonne les divers travaux (recherche agronomique, universités, producteurs de semences, agriculteurs biologiques, éleveurs, etc ) et élabore tous les deux ans à l’intention de l’OFAG un rapport sur la situation en matière de ressources phytogénétiques dans l’alimentation et l’agriculture
Au total, 47 projets ont été déposés en 1999 et 2000; 21 d’entre eux ont été acceptés, pour lesquels des contrats d’une durée n ’allant pas au-delà de la fin 2002 ont été conclus. En 1999, les dépenses se sont montées à 0,88 million de francs et à 1,357 million de francs en 2000 Grâce à l’engagement financier de la Confédération, des structures de collaboration adaptées ont pu être mises en place avec des organisations privées; par ailleurs, les rôles et les tâches des acteurs ont dû être clairement définis.
2 . 3 A M É L I O R A T I O N D E S B A S E S D E P R O D U C T I O N 2 254
■ Etat de la mise en œuvre
N o m b r e
Variétés, populations et lignées dans les banques de gènes RAC et FAL
0 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 B l é E p e a u t r e O r g e T r i t i c a l e S o j a L é g u m e s M a ï s P l a n t e s f o u r r a g è r e s S e i g l e P o m m e s d e t e r r e A u t r e s 4 3222 244 796784 608 398 381119 62 52 582
Source: Commission suisse pour la conservation des plantes cultivées
Comme dans d’autres domaines de l’agriculture, la libéralisation a eu des effets bénéfiques sur le développement de l’élevage Les éleveurs et leurs organisations ont mis à profit la marge de manœuvre et assument la responsabilité qui leur est désormais attribuée

L'éleveur ne subit presque plus de limitations étatiques dans ses actions Les activités d'élevage sont soutenues par la Confédération et les cantons par l’intermédiaire de contributions aux organisations d'élevage La Confédération et les cantons dépensent chaque année environ 40 millions de francs pour des prestations de service à l’élevage, telles que la gestion des herd-books, l'organisation des épreuves de performances, l’évaluation des données zootechniques y compris l’estimation de la valeur d’élevage, ainsi que pour les programmes de conservation des races suisses en danger. Chacune de ces mesures apporte une contribution importante au maintien d’un élevage indigène indépendant
À ce jour, la Confédération a reconnu 31 organisations d’élevage de bovins, équins, porcins, ovins et caprins. Les structures de la plupart des organisations d’élevage ont été revues et allégées afin qu ’elles puissent proposer les prestations revendiquées par les éleveurs à des prix aussi bas que possible et avec la plus grande flexibilité La Centrale suisse d’élevage du menu bétail, anciennement responsable de la gestion du herd-book du menu bétail, et la Fédération suisse des épreuves d’engraissement et d’abattage, jusqu’alors responsable de l’organisation des épreuves de productivité chez le porc, ont été dissoutes l’une au 31 décembre 1999 et l’autre au 31 décembre 2000 Les activités de ces organes ont été reprises par les organisations d’élevage correspondantes. Des adaptations structurelles au sein des organisations d’élevage bovines et chevalines étaient également incontournables pour maîtriser les défis zootechniques dans le nouvel environnement de la politique agricole
2 . 3 A M É L I O R A T I O N D E S B A S E S D E P R O D U C T I O N 2 255
■■■■■■■■■■■■■■■■ 2.3.4 Elevage
■ Les éleveurs et les organisations exploitent la marge de manœuvre
■ Importation d'animaux d'élevage et de semence de bovins
La tâche d’administrer les contingents tarifaires et l’importation d’animaux d’élevage ou de semence de taureaux revient à la Confédération La procédure du fur et à mesure est généralement la règle pour l’attribution des parts de contingent tarifaire La demande de races étrangères a toutefois dépassé les contingents tarifaires disponibles dans une telle mesure qu ’ une attribution selon cette procédure a engendré des problèmes administratifs insurmontables Il a par conséquent été décidé que, dès le 1er janvier 2001, les parts de contingent tarifaire seraient mises aux enchères, par analogie aux chevaux de sport Le contingent tarifaire annuel a été fixé à 1’200 animaux d’élevage 70% de ce contingent seront mis aux enchères avant le début de la période contingentaire et 30% dans le courant du premier semestre La vente aux enchères garantit une répartition des parts de contingent tarifaire répondant au principe de la concurrence. Vu l’insécurité liée à l’évolution de la fièvre aphteuse et de la crise de l’ESB, l’adjudication des contingents a été suspendue pour 2001
Importations à l’intérieur du contingent tarifaire 2000
■ Ressources zoogénétiques
Source:
Par leur soutien à des projets de conservation et de promotion de races d’animaux de rentes indigènes menacées, la Confédération et les cantons contribuent de façon importante à la préservation de la biodiversité agricole. Cette mesure remplit simultanément un mandat global de conservation des ressources zoogénétiques Quelque 30 races d’animaux de rente sont considérées comme indigènes ou exploitées par tradition. Chacune de ces races a, en plus de ses qualités génétiques individuelles, une importance particulière sur les plans écologique, économique, culturel et historique La responsabilité de la conservation et de la promotion des races revient en premier lieu aux organisations d’élevage reconnues Elles définissent et élaborent des programmes de conservation et d’encouragement des populations menacées et soumettent à l’OFAG pour approbation les projets correspondants, limités dans le temps Une autorisation est délivrée lorsque le projet déposé a été examiné et jugé positivement par un groupe d’experts externes Actuellement, toutes les races suisses des espèces bovine, porcine, équine, ovine et caprine considérées comme menacées sur la base des critères internationaux sont au bénéfice de programmes de conservation soutenus par des contributions publiques Les races concernées sont la vache d’Evolène, le mouton de l’Engadine, le mouton de l’Oberland grison, le mouton Miroir, le mouton Roux du Valais, la chèvre Bottée, la chèvre de l’Appenzell, la chèvre Grisonne à raies et la chèvre de Paon Par ailleurs, des mesures préventives ont été approuvées pour le cheval de la race des Franches-Montagnes, la vache brune originale et la chèvre Col noir du Valais Bien que n’étant pas menacées à l’heure actuelle, ces races enregistrent une baisse continuelle de leur effectif depuis quelques années. Des mesures prises à temps devraient permettre de leur éviter d’accéder au statut de race menacée
256 2 . 3 A M É L I O R A T I O N D E S B A S E S D E P R O D U C T I O N 2
Réglementation du marché Importation Contingent tarifaire Nombre Nombre Chevaux d’élevage Animaux 81 200 Bovins Animaux 2 604 2 500 Moutons / chèvres Animaux 254 600 Semence de bovins Doses 639 897 800 000
Rapport sur les mesures tarifaires du Conseil fédéral
■ Politique agricole 2007
2.4. Evolution future de la politique agricole
A l’avenir aussi, l’agriculture sera confrontée à des changements rapides, pour des raisons relevant de la politique intérieure et extérieure Les réformes ne sauraient donc s ’arrêter à la politique agricole 2002 (PA 2002) Afin de rester supportables pour les milieux concernés, les adaptations nécessaires devront se faire par étapes suivies, dont ils ont une vue d’ensemble C’est la raison pour laquelle les travaux préliminaires relatifs à l’évolution future de la politique agricole ont été entamés dès la phase de consolidation de PA 2002 Ils ont servi à poser les jalons permettant d’agir à temps et de façon offensive plutôt que de devoir réagir à retardement et sous la pression des échéances.
Nous avons baptisé «Politique agricole 2007» (PA 2007) l’évolution à venir de la politique agricole Ce chiffre 2007 coïncide avec la dernière année de la prochaine enveloppe financière de quatre ans (2004–2007) et marque le terme des travaux liés à la révision partielle de la LAgr Les propositions concernant cette dernière se fondent sur les travaux préparatoires de la Commission consultative agricole et de trois groupes de travail, ainsi que sur le résultat d’évaluations internes et externes. Quant au mandat de réexaminer le train de mesures de politique agricole, il découle, entre autres, de l’art 187 LAgr et de diverses interventions parlementaires

■■■■■■■■■■■■■■■■
2 . 4 E V O L U T I O N F U T U R E D E L A P O L I T I Q U E A G R I C O L E 2
257
■ Recommandations stratégiques
Document stratégique «Horizon 2010»
L’OFAG a donné le coup d’envoi des débats le 4 juillet 2000 en publiant le document stratégique «Horizon 2010» (en ligne: www.blw.admin.ch, rubrique «Politique agricole 2007») Il y présente ses considérations et propositions quant à l’orientation à donner à la politique agricole pendant la période couverte par les deux prochaines enveloppes financières (2004/7 et 2008/11)
Dans le document stratégique, l’OFAG arrive à la conclusion que l’amélioration de la compétitivité revêt une importance primordiale Pour concrétiser cette orientation, il propose d’optimiser toutes les catégories de mesures de politique agricole et plus particulièrement les organisations de marché Les gains d’efficience dans le soutien du marché pourront servir à financer des mesures d’accompagnement social de durée limitée, destinées à atténuer les effets d’une éventuelle accélération de l’évolution structurelle Cette stratégie permet de promouvoir la compétitivité à tous les échelons par le biais du marché Les structures évoluent ainsi plutôt en fonction de la réussite sur le marché que des interventions étatiques
La publication du document stratégique a suscité des réactions allant du rejet à l’approbation totale Même si des critiques parfois acerbes ont été exprimées, nous pouvons constater, aujourd’hui, qu ’elle a été un moyen approprié pour lancer le débat
Commission consultative agricole
En vertu de l’art 186 LAgr, le Conseil fédéral a institué la Commission consultative agricole et nommé ses 14 membres par arrêté du 31 mai 2000. La commission est présidée par le conseiller d’Etat Urs Schwaller, directeur des finances du canton de Fribourg Elle a pour tâche de conseiller le Conseil fédéral dans l’application et l’adaptation de la LAgr. La Commission consultative agricole s ’est penchée sur des questions stratégiques liées à l’évolution de la politique agricole et a adopté des recommandations à ce sujet Etablissant le bilan des étapes antérieures de la réforme, la commission a constaté que de gros progrès ont été réalisés grâce à la nouvelle politique agricole (PA 2002) dans les domaines de l’écologie et des marchés, et que l’agriculture est sur la voie de la durabilité
La commission fait aussi remarquer que l’agriculture doit encore relever de nombreux défis Elle devra notamment préserver ses parts de marché malgré l’ouverture des frontières et garantir la multifonctionnalité que l’on attend d’elle En conséquence, la commission estime qu’il faut développer systématiquement la politique agricole en suivant la voie empruntée A cet effet, elle a fixé plusieurs repères stratégiques:
la base constitutionnelle en vigueur (art 104 de la Constitution) ainsi que les grandes lignes et les objectifs de la PA 2002 restent valables Il convient de consolider la politique actuelle avant de procéder à des changements fondamentaux. La prochaine étape, de 2004 à 2007, consistera donc à peaufiner l’instrumentaire en vigueur;
2 . 4 E V O L U T I O N F U T U R E D E L A P O L I T I Q U E A G R I C O L E 2 258
–
■ Lancement du débat
■ Appréciation des propositions présentées par les groupes de travail
– il est capital d’améliorer encore la compétitivité de l’agriculture suisse ainsi que celle du secteur alimentaire C’est pourquoi il convient d’associer les partenaires contribuant à la valeur ajoutée, à tous les échelons du marché Dans ce contexte, toutes les mesures de politique agricole doivent être examinées en vue d’une optimisation;
– la réforme de la politique agricole doit ouvrir des perspectives d’avenir aux agriculteurs Il importe en particulier de renforcer les mesures d'amélioration structurelle pour les exploitations dynamiques Le rythme des ajustements structurels et des réformes doit autant que possible être supportable pour tous les acteurs concernés Il est donc nécessaire de prendre des mesures destinées à réduire les frais de production, ainsi que des mesures d’accompagnement temporaires
Ces éléments apportent certains repères à l’aide desquels il est possible de formuler une stratégie Quant au problème du financement des mesures de politique agricole, la commission ne l’a pas encore abordé de manière approfondie.
En accord avec la Commission consultative agricole, trois groupes de travail ont été institués en octobre 2000 et chargés de traiter les sujets suivants: «marchés» (président: Prof. P. Rieder, EPF Zurich), «paiements directs» (président: Prof. B. Lehmann, EPF Zurich) et «facteurs de production et social» (président: Prof Dr W Meier, FAT) Leur tâche consiste à élaborer des propositions permettant d’optimiser les mesures de politique agricole et de concrétiser les grandes lignes stratégiques au niveau des mesures La commission a adopté un mandat détaillé pour chacun de ces groupes
La Commission consultative a évalué les propositions concernant l’adaptation de la législation, soumises par les groupes de travail Elle soutient notamment les propositions suivantes:
– groupe de travail «marchés»: déréglementation du marché laitier (formulation potestative concernant la fixation du prix-cible et le contingentement laitier); soutien de programmes interentreprises pour l’adaptation aux marchés des fruits et des légumes;
– groupe de travail «paiements directs»: suppression quasi totale des limites découlant de considérations sociales et politiques; possibilité d’octroyer des contributions en faveur des régions;
groupe de travail «facteurs de production et social»: extension modérée du domaine bénéficiant des aides à l'investissement; mesures d’accompagnement structurelles (aides au recyclage professionnel et à la formation continue, réglementation concernant les gains de liquidation, indemnité pour cessation d'exploitation); dissolution du fonds phytosanitaire (financement par les ressources générales de la Confédération)
2 . 4 E V O L U T I O N F U T U R E D E L A P O L I T I Q U E A G R I C O L E 2 259 2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E
–
Groupes de travail
Les milieux concernés sont représentés dans les trois groupes de travail Une instance de coordination comprenant le président de la commission, les présidents des groupes de travail et la direction de l’OFAG assure la circulation des informations
Organisation du projet: groupes de travail – Commission consultative agricole
Groupe de travail «marchés»
Groupe de travail «paiements directs»
Groupe de travail «facteurs de production et social»
Instance de coordination

Commission consultative agricole
Les trois groupes ont livré leurs rapports à fin mars 2001 (en ligne: www.blw.admin.ch, rubrique «Politique agricole 2007») Conformément aux mandats, ils ont avant tout proposé des adaptations au plan législatif L'éventail de mesures proposées montre que les groupes n 'ont pas considéré l'aspect financier. Ils sont néanmoins tous arrivés à la conclusion qu ’ une réorientation fondamentale de la politique agricole ne s’impose pas
2 . 4 E V O L U T I O N F U T U R E D E L A P O L I T I Q U E A G R I C O L E 2 260
■ Propositions du groupe de travail «marchés»
De nombreux problèmes soulevés par le groupe de travail «marchés» peuvent être résolus par voie d’ordonnance Pour ce qui est de la LAgr, le groupe propose les adaptations suivantes:
Organisations de marché
– formulation plus souple concernant le prix-cible du lait et le contingentement laitier;
octroi de contributions pour les légumineuses à graines;
– introduction d’un soutien pour les légumes destinés à la transformation;
– programmes destinés à l'adaptation au marché ou contributions à la reconversion dans les domaines des fruits, des légumes et de la viticulture;
– remplacement de la promotion des matières premières renouvelables limitée aux installations pilotes et de démonstration par un soutien de durée indéterminée;
– délégation de la classification des vins au Conseil fédéral
Propositions d’ordre général
– possibilité d’introduire des formes d’assurances bénéficiant du soutien de l’Etat pour couvrir les risques liés à la production;
– cautionnement par l’Etat de crédits destinés à financer des réserves;
– coordination obligatoire de la répression des fraudes dans les domaines: désignation, importation, transit et exportation de marchandises, déclaration.
■ Propositions du groupe de travail «paiements directs»
La majorité des membres du groupe de travail estime qu ’ un changement fondamental du système des paiements directs serait prématuré Dans l’ensemble, ils sont assez satisfaits du système actuel En vue de la révision partielle de la LAgr, le groupe propose néanmoins plusieurs adaptations qu’il s ’agira de soumettre à un examen plus approfondi, soutenues par une majorité – parfois faible – de ses membres:
– introduction de contributions en faveur des régions permettant de prendre en compte leurs besoins particuliers;
– instauration d’une contribution liée à la main-d’œuvre;
– suppression de l’exigence concernant la taille minimale des exploitations ainsi que des valeurs limites (notamment limites de revenu et de fortune);
– distinction entre «contributions écologiques» et «contributions éthologiques»;
– compensation des conditions de production plus difficiles dans la région d’estivage et encouragement de l’exploitation de surfaces d’estivage particulièrement respectueuse de la nature
2 . 4 E V O L U T I O N F U T U R E D E L A P O L I T I Q U E A G R I C O L E 2 261 2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E
–
■ Propositions du groupe de travail «facteurs de production et social»
La législation agricole en vigueur connaît peu de réglementations spécifiques au domaine social L’instauration de mesures sociales nécessiterait donc de nombreuses adaptations législatives En revanche, les mesures relevant du domaine des améliorations structurelles et de celui des moyens de production sont déjà très bien réglementées dans la LAgr Le groupe de travail estime ainsi qu’il n ’ y a guère de modifications à prévoir pour ce qui est des moyens de production Il propose des adaptations dans les domaines suivants:
Social – renforcement de la conversion de dettes par le biais de l’aide aux exploitations;
– développement de la consultation sociale en tant que tâche de vulgarisation;
introduction d’aides au recyclage professionnel et à la formation continue;
– instauration d’une indemnité pour cessation d’exploitation ou de la pré-retraite;
– adaptation de l’imposition des gains de liquidation pour faciliter la cessation d’exploitation;
– promotion des services d’entraide et de dépannage;
– introduction d’une prime de vacances
Améliorations structurelles
– abandon du revenu comme critère d’entrée en matière et substitution par l’unité de main-d’œuvre standard pour les mesures individuelles;
– financement de l’entretien périodique d’améliorations foncières;
aides financières pour la création d’organisations d’entraide paysannes (p.ex. activités en rapport avec la gestion rationnelle des exploitations et la commercialisation en commun de produits régionaux);
mesures en faveur d’équipements servant à la production végétale et de plantations mieux adaptés aux nouvelles conditions du marché;
– appréciation différenciée de la neutralité en matière de concurrence selon les régions et extension en conséquence des possibilités de promotion (commercialisation, diversification des activités)
Moyens de production
– suppression de la participation financière des cantons dans le domaine de l’élevage;
introduction d’un mandat de prestations pour une taxation neutre de la laine de mouton;
– dissolution du fonds phytosanitaire (financement par les ressources générales de la Confédération);
– prescriptions concernant l’utilisation et la fabrication de matières auxiliaires de l’agriculture.
■ Perspectives
Sur la base des travaux préliminaires, l’Administration a élaboré un rapport de consultation proposant des adaptations législatives Ce rapport a été soumis aux milieux intéressés le 21 septembre 2001 Après évaluation de la consultation, le message aux Chambres fédérales devrait être adopté au printemps 2002 Il est prévu de soumettre au Parlement les propositions de révision de lois en même temps que le message relatif à l’enveloppe financière pour la période 2004–2007, afin qu’il puisse délibérer en parallèle des mesures et du financement (selon toute vraisemblance entre l’automne 2002 et le printemps 2003) Les nouvelles dispositions légales, les modifications d’ordonnances correspondantes et la nouvelle enveloppe financière devraient entrer en vigueur simultanément le 1er janvier 2004.
262 2 . 4 E V O L U T I O N F U T U R E D E L A P O L I T I Q U E A G R I C O L E 2
–
–
–
–

3 ■■■■■■■■■■■■■■■■ 3. Aspects internationaux 263
Les échanges de marchandises se font sur des marchés regroupant des régions toujours plus grandes, sur lesquels les marchandises peuvent circuler librement, sans barrière aux frontières nationales Nous en voulons pour preuve l’intégration progressive en Europe avec le marché commun. Des accords internationaux conclus dans le domaine de l’environnement visent à réduire les atteintes à la nature et à l’environnement
La Suisse, pays fortement exportateur, est donc intéressée à un accès aussi libre que possible aux marchés étrangers L'accord de l'OMC conclu en 1994 à Marrakech a fixé pour la première fois des règles pour le commerce de produits agricoles dans le cadre des règlements internationaux sur le commerce des biens et des services Notons qu ’ un des Accords bilatéraux conclus avec l’UE est l’Accord agricole, qui est partie intégrante desdits accords Sur le plan international, la Suisse œuvre pour une agriculture multifonctionnelle
Le rapport agricole tient compte de ces développements en traitant les thèmes internationaux au chapitre 3
– La première partie de la présente édition présente, à titre de point fort, des informations sur les organisations telles que l’OMC, l’OCDE et la FAO. Les activités de ces organisations portent en (grande) partie sur des questions relatives à l’agriculture
En outre, cette partie du rapport fait état du dossier européen et présente une étude de la Commission de l’UE sur les stratégies de gestion des risques.
– La seconde partie est consacrée à des comparaisons internationales Plus l’agriculture suisse doit se mesurer à la concurrence internationale et plus les informations sur les conditions régnant à l’étranger sont essentielles Le présent rapport continue les comparaisons internationales de prix commencées en l’an 2000, en ajoutant l’aspect de la parité des pouvoirs d’achat Dans un chapitre séparé, les résultats provenant d’exploitations comptables suisses sont finalement comparés avec ceux de l’UE.
3 . A S P E C T S I N T E R N A T I O N A U X 3 264
3.1 Développements internationaux
Dans le présent rapport agricole, le chapitre sur les évolutions au plan international est consacré en premier lieu à diverses organisations (OMC, OCDE, FAO), qui s ’occupent en partie ou exclusivement de thèmes ayant trait à l’agriculture
Nous abordons toutefois pour commencer les négociations bilatérales que la Suisse mène actuellement avec l’UE sur les produits agricoles transformés, une étude de l’UE sur les stratégies en matière de gestion des risques et les travaux concernant les accords de libre-échange La partie relative à l’OMC renseigne sur l’état des négociations dans le domaine agricole et sur l’examen de la politique commerciale suisse par cette organisation Quant aux travaux de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques), ils n’influent qu’indirectement sur l’évolution des organisations apparentées. Nous présentons quelques unes de ses études qui sont importantes pour l’agriculture suisse, portant notamment sur l’évaluation de notre politique agricole, la multifonctionnalité de l’agriculture ou encore le niveau du soutien accordé au secteur agricole (ESP) Enfin, nous présentons les activités de la FAO destinées à améliorer la situation alimentaire mondiale

■■■■■■■■■■■■■■■■
3 . 1 D É V E L O P P E M E N T S I N T E R N A T I O N A U X 3 265
Pas de pause dans le dossier européen

Après le refus massif, lors de la votation populaire du 4 mars 2001, de l’initiative «Oui à l’Europe» qui aurait obligé le Conseil fédéral à entamer sans délai des négociations d’adhésion avec l’Union européenne, la Suisse entend donner la priorité à la voie bilatérale ces prochaines années A court terme, il y a d’abord la mise en vigueur et l’exécution des sept accords bilatéraux conclus en 1999 avec la Communauté Européenne, dont l’accord agricole Ces accords entreront probablement en vigueur au début de 2002 Le processus de ratification dans les pays membres de l’UE est en cours Quant à la Suisse, elle a ratifié les accords le 16 octobre 2000
Dans l’Acte final de ces accords, les deux Parties contractantes ont convenu de reprendre les négociations pour parvenir à des conventions dans les domaines d’intérêt commun qui n ’ont pas encore été traités («leftovers») Le secteur agricole est plus particulièrement concerné par les négociations sur la mise à jour du Protocole 2 de l'Accord de libre-échange (ALE) de 1972 relatif aux produits agricoles transformés, comme par les négociations visant à améliorer la collaboration en matière de statistique et de lutte contre les fraudes Un nouveau tour de négociations a été lancé à mi2001
Le Protocole 2 de l'Accord de libre-échange de 1972 règle les modalités tarifaires relatives aux produits agricoles transformés (p.ex. chocolat, biscuits, soupes, sauces, pâtes, café instantané, confiture, yoghourts aux fruits) Il ne répond plus aux exigences actuelles et engendre toute une série de problèmes La Suisse souhaite avant tout que l’on étende et harmonise le champ d’application de ce protocole, et que l’on améliore le mécanisme de compensation des prix à la frontière Nous comparons ci-après l’ancien et le nouveau système, en prenant l’exemple de la farine exportée ou importée sous la forme de biscuits
L’exportateur touche une contribution à l’exportation, parce qu’il paie la farine fr 111,41/100 kg en Suisse, alors qu ’elle ne coûte que fr 29,11/100 kg à son concurrent européen La différence de 82 fr 30 représente ce que l’on appelle le handicap de l’industrie suisse lié aux prix des matières premières, qui est compensé par l’Etat Comme l’UE prélève également des droits de douane sur les produits de ce genre –fr 20,31/100 kg dans notre exemple – ce montant est lui aussi restitué à l’exportateur suisse A son tour, la Suisse perçoit un droit de douane sur la composante farine des biscuits (= élément mobile) pour maintenir les prix plus élevés de cette matière première dans le pays.
Les négociations bilatérales qui ont débuté au milieu de l’année visent à améliorer le mécanisme de compensation des prix en ce qui concerne les produits agricoles transformés L’institution d’un système de compensation des prix nets en référence au prix du marché de l’UE et non plus au prix du marché mondial diminuerait les dépenses de la Suisse et de l’UE pour les subventions à l’exportation Cela signifie, pour reprendre l’exemple de la farine, que l’UE ne prélèverait plus de droit de douane sur la farine contenue dans les biscuits (fr. 20,31), faisant diminuer d’autant la subvention à l’exportation à verser par la Suisse Le droit de douane perçu par celle-ci, c ’est-à-dire l’élément mobile, serait également réduit, ce qui permettrait à l’UE de renoncer à l’octroi de subventions pour les exportations destinées à la Suisse. Les deux parties
3 . 1 D É V E L O P P E M E N T S I N T E R N A T I O N A U X 3 266
■ «Actualisation du Protocole 2»
seraient donc en mesure d’utiliser de manière optimale les fonds disponibles pour les subventions à l’exportation, d’autant qu’ils sont plafonnés par l’OMC Ce serait une solution très avantageuse, car malgré le plafonnement, qui s ’applique aussi aux exportations de denrées alimentaires transformées (114, 9 mio. de fr. pour la Suisse), notre pays pourrait exporter, sous cette forme, un maximum de produits agricoles de base à la faveur de subventions
Les négociations ont aussi pour objectif d’introduire, dans le commerce avec l’UE, le libre-échange pour le sucre contenu dans des produits transformés Ni la Suisse ni l’UE ne percevraient alors de taxes pour la composante sucre dans les biscuits Le niveau des prix étant à peu près égal, cette réglementation n ’entraînerait pas de distorsions du marché.
Système actuel
Exportations
31
1 Prix du marché mondial = prix du marché UE moins prélèvement UE
131 71 Prix UE de la farine contenue dans produit transformé importé
2 em (élément mobile) = taxes douanières sur la matière première, sans l'élément de protection de l'industrie
Compensation des prix en référence au prix du marché UE
Exportations Importations fr / 100 kg fr / 100 kg fr / 100 kg Prix en Suisse
111 41 Prix UE de la farine contenue dans produit transformé importé
3 A S P E C T S I N T E R N A T I O N A U X 3 . 1 D É V E L O P P E M E N T S I N T E R N A T I O N A U X 3 267
Prix
Subventions
l'exportation 102.60
Importations fr / 100 kg fr / 100 kg fr / 100 kg Prix en Suisse 111 41 Prix du marché UE 29 11 29 11 Prix du marché UE Prélèvement UE –20
du marché mondial 1 –8 80
à
102.60 em 2 Suisse CH chiffre arrondi
l'exportation
111 41 Prix du marché UE 29 11 –29 11 29 11 Prix du marché UE Subventions à 82 30 82 30 em Suisse
CH
Stratégie de gestion des risques – une étude de l’UE

La Commission de l’UE a publié, au début de 2001, une étude sur la gestion des risques dans son agriculture (Risk Management Tools for EU Agriculture – with a special focus on insurance) Elle pense qu’il faut s ’attendre à des risques de plus en plus élevés concernant tant les prix que la production Les risques liés aux prix augmenteront en raison de la libéralisation progressive du commerce dans le secteur agricole, qui exposera davantage l’agriculture de l’Union aux marchés mondiaux De même, on escompte une tendance à la hausse pour ce qui est des risques liés à la production, tendance déterminée par plusieurs facteurs: règles plus strictes concernant l’utilisation de matières auxiliaires (p ex médicaments dans la production animale), augmentation de la mobilité et du commerce mondial d’animaux et de plantes, incidences négatives probables des changements climatiques et spécialisation accrue dans l’agriculture
On distingue trois stratégies de gestion des risques:
1 Stratégies applicables dans l’exploitation agricole: choisir des produits présentant moins de risques (p ex diminution des risques liés aux prix grâce à des mesures de soutien étatiques) et diversifier le programme de production, évitant la dépendance d’un seul produit
2 Stratégies destinées à répartir les risques: conclure des assurances et des contrats de prise en charge à long terme ou se prémunir contre un effondrement des prix sur des marchés à terme
3 Stratégies applicables à l’extérieur de l’exploitation agricole: rechercher des sources de revenus non agricoles
Les contrats à terme de marchandises et les assurances sont les principaux instruments du marché permettant de s ’ assurer contre les risques inhérents aux prix des produits agricoles et à la production Dans l’UE, cinq marchés négocient des contrats à terme pour des produits agricoles. En considération de la libéralisation du commerce et des fluctuations de prix plus fréquentes qui s ’ensuivent, les contrats à terme de marchandises gagneront vraisemblablement en importance Les instruments de soutien du marché prévus par la Politique agricole commune (PAC) continueront néanmoins de jouer un rôle important pour la limitation des risques liés aux principaux produits
Par contre, il n ’est guère probable que les marchés privés d’assurances contre les risques liés à la production agricole prennent de l’essor En effet, nombre de ces risques ne sont pas ou difficilement assurables. C’est notamment le cas des catastrophes naturelles et des épidémies Il s ’agit de gros risques qui se manifestent rarement mais qui occasionnent des dégâts considérables Or, les assureurs hésitent à les couvrir De même, une réassurance est souvent impossible ou très coûteuse. Par ailleurs, le calcul des primes pose de gros problèmes, car les assureurs ne disposent pas de données suffisantes pour estimer la probabilité d’un événement et le montant moyen des dégâts à craindre Ainsi, ils n ’acceptent pas non plus de couvrir de nouveaux risques (tels que l’ESB) De leur côté, les agriculteurs sous-estiment souvent les dangers et ne sont donc pas prêts à payer régulièrement des primes pour se prémunir. Enfin, d’autres instruments servant à limiter les risques de production, tels que les paiements de compensation par l’Etat, concurrencent les solutions d’assurance privées qui, elles, ne sont pas gratuites.
3 . 1 D É V E L O P P E M E N T S I N T E R N A T I O N A U X 3 268
■ L’UE n ’ a pas besoin de prendre des mesures à court terme
Dans les pays membres de l’UE comme en Suisse, la seule assurance privée connue partout est celle contre la grêle Un choix plus large d’assurances contre les risques liés à la production agricole n ’est offert que dans les pays où ces instruments bénéficient d’un soutien substantiel de l’Etat (Espagne, Portugal). Tous les Etats membres, de même que l’UE elle-même, prennent en revanche des mesures de prévention (mesures sanitaires et phytosanitaires)
En ce qui concerne les risques liés aux prix, la Commission de l’UE ne voit pas la nécessité de prendre des mesures spécifiques, les agriculteurs ayant de nombreuses possibilités de s ’ assurer à brève échéance On observe d’ailleurs, dans l’UE, une évolution dynamique des marchés à terme de produits agricoles. La seule solution que l’on pourrait envisager selon la Commission consisterait à soutenir des programmes de formation à l’échelle de l’Union, pour approfondir les connaissances des agriculteurs concernant le fonctionnement de ce type de marché.
S’agissant des risques liés à la production, la Commission constate que les Etats membres disposent d’une grande marge de manoeuvre et qu’ils la mettent à profit (mesures sanitaires et phytosanitaires, soutien de systèmes d’assurance, aide en cas de catastrophe). Par conséquent, aucune mesure ne s’impose à cet égard.
Dans son étude, la Commission examine aussi l’efficience des solutions d’assurance bénéficiant d’une aide de l’Etat. Dans un partenariat de ce genre entre ce dernier et les compagnies d’assurance, celles-ci disposent d’un plus grand savoir spécialisé, du moins au début Pour vérifier si elles utilisent les deniers publics à bon escient, l’Administration doit acquérir les connaissances nécessaires et mettre sur pied un appareil de contrôle Le secteur des assurances facture ses prestations, ce qui entraîne des coûts supplémentaires pour l’Etat. Ce dernier doit, de son côté, évaluer régulièrement si les gains réalisés par les assurances dans le cadre de ces systèmes semiétatiques sont proportionnés aux risques qu ’elles assument On relèvera enfin que dans les pays où de tels systèmes existent (p.ex. Etats-Unis et Espagne), ils sont devenus si complexes qu’ils en ont perdu leur transparence; il serait fort difficile de les réformer Les expériences des Etats-Unis et de l’Espagne nous enseignent en outre que malgré une grande palette de produits, on ne parvient jamais à couvrir tous les risques et que ces produits n’intéressent jamais tous les agriculteurs C’est la raison pour laquelle les paiements ad hoc de l’Etat restent importants
Selon la Commission de l’UE, des systèmes d’assurance ne sont utiles qu’à la condition d’être strictement ciblés sur les besoins des agriculteurs et surveillés de près. Des solutions régionales paraissent donc préférables à un système général pour toute l’Union Un engagement à long terme présupposerait que l’UE approfondisse la question de l’efficience et que l’instrument s’inscrive harmonieusement dans l’éventail de mesures d’une PAC plus évoluée Le cas échéant, il faudra vérifier que l’OMC considère le rôle des pouvoirs publics en rapport avec de tels instruments comme n’étant pas susceptible de provoquer des distorsions du commerce
3 A S P E C T S I N T E R N A T I O N A U X 3 . 1 D É V E L O P P E M E N T S I N T E R N A T I O N A U X 3 269
Accords de libre-échange
Dans le cadre de ses rapports avec des pays tiers, l’Association européenne de libreéchange (AELE) a conclu, au cours de l’année sous revue, un accord de libre-échange avec la Macédoine Celui-ci est entré en vigueur le 1er janvier 2001, en même temps que la convention sur le commerce de produits agricoles passée individuellement avec chaque pays membre, qui ne touche cependant que peu de produits en ce qui concerne la Suisse Le 27 novembre 2000, l’AELE a par ailleurs signé pour la première fois un accord de libre-échange avec un pays d’outre-mer, soit le Mexique Son champ d’application est nettement plus large que celui des autres accords de l’association En considération de la diversité de leurs politiques agricoles, les pays membres ont conclu, comme d’ordinaire, des accords bilatéraux pour ce qui est des échanges de produits agricoles et de produits agricoles transformés L’accord agricole contraint ainsi la Suisse à réduire ou à supprimer les droits de douane sur certains produits qui intéressent particulièrement le Mexique (p.ex. café, miel destiné à la transformation industrielle, bananes, certaines sortes de légumes) En contrepartie, le Mexique accorde à la Suisse des concessions tarifaires pour certains fruits et légumes (salades, oignons et abricots)
Ces concessions sont toutefois limitées en ce sens que les produits laitiers, la viande et les céréales sont exclus de l’accord et que le Mexique a refusé de faire des concessions pour les produits agricoles bénéficiant de subventions à l’exportation. L’accord et la convention concernant le domaine agricole passée avec la Suisse sont tous deux entrés en vigueur le 1er juillet 2001 Il en résultera probablement, pour les exportations suisses, une baisse des prélèvements à la frontière de quelque 100 millions de francs.

Les négociations de l’AELE avec la Croatie et la Jordanie ont également abouti S’agissant du secteur agricole, les conventions sont cependant très limitées En décembre 2000, des négociations ont été entamées avec le Chili et en juillet 2001 avec Singapour. L’Afrique du Sud est le prochain pays sur la liste. L’AELE poursuit également ses négociations avec quelques pays méditerranéens (Egypte, Chypre et Tunisie)
Les négociations relatives à la mise à jour de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE) se sont terminées dans le courant de 2001 Elles n ’ont toutefois pas apporté la libéralisation du secteur agricole souhaitée par la Suisse et convenue par notre pays avec l’UE, à cause de la forte résistance de la Norvège Celle-ci a néanmoins relevé nettement, de 14 à 60 t par an, le contingent à droit zéro qu ’elle concède à la Suisse pour les fromages De son côté, notre pays lui a accordé un contingent en franchise de 60 t, de même qu’à l’Islande
En plus de ces concessions tarifaires, les membres de l’AELE se sont mis d’accord, dans le domaine des obstacles techniques au commerce, sur l’équivalence des dispositions relatives aux plants et semences et à l’agriculture biologique Cette équivalence se fonde, d’une part, sur le contenu de l’accord bilatéral conclu entre la Suisse et l’UE et, d’autre part, sur l’Acquis de l’Espace Economique Européen (EEE) Le nouvel accord AELE devrait entrer en vigueur en même temps que les accords sectoriels entre la Suisse et l’UE
3 . 1 D É V E L O P P E M E N T S I N T E R N A T I O N A U X 3 270
Négociations de l’OMC à Genève
En concluant l’Accord sur l’agriculture (accord agricole), les membres de l’OMC se sont engagés à réduire les droits de douane, le soutien interne et les subventions à l’exportation sur une période de six ans allant jusqu’à fin 2000 La Suisse a rempli ses engagements Conformément à l’art 20 de l’accord, de nouvelles négociations ont été entamées en 2000 à Genève, en vue d’une réduction progressive et substantielle des mesures de soutien et de protection Dans cette première phase, les délégations ont délimité les champs de négociation La Suisse, quant à elle, a présenté une proposition détaillée en décembre 2000
La Suisse souhaite conserver une production agricole durable des points de vue économique, écologique et social A cette fin, elle propose que l’agriculture soit rétribuée par des paiements directs pour la production de biens publics, tels que l’entretien du paysage rural, l’occupation décentralisée du territoire et la préservation des ressources naturelles Dans sa proposition, la Suisse demande que chaque pays soit libre de déterminer le montant de ces paiements, conformément aux objectifs des politiques agricole, environnementale et régionale respectives En revanche, elle est prête à s ’ engager pour une définition plus précise des critères applicables, afin que l’on ne puisse pas lui reprocher de soutenir indirectement la production de denrées alimentaires, malgré l’existence d’un marché adéquat Le but de cette démarche est de renforcer la sécurité du droit pour nos paiements directs non liés à la production.
Mais il convient aussi de reconsidérer les règles, disciplines et critères concernant les trois piliers des négociations antérieures – accès au marché, soutien interne et subventions à l’exportation –, avant de négocier des mesures de réduction supplémentaires
1 L’accès au marché devrait être déterminé par le biais de concessions mutuelles, des conditions spéciales étant accordées aux pays en développement les plus pauvres Quant aux contingents tarifaires, il faut maintenir le libre choix du mode d’attribution, à condition que l’accès soit effectivement garanti De même, il est nécessaire de maintenir la clause de sauvegarde relative aux quantités et aux prix prévue pour le secteur agricole Plusieurs propositions concrètes allant dans ce sens sont en cours d’élaboration
2 Les trois boîtes concernant le soutien interne – orange, bleue et verte – doivent être définies de manière plus précise La boîte orange comprend les mesures liées à la production qu’il convient de réduire, la boîte bleue les primes non soumises à réduction et la boîte verte les mesures de soutien non liées à la production et non soumises à réduction Dans le cadre de la boîte verte, chaque pays doit pouvoir définir les prestations exigées de l’agriculture en fonction de ses propres besoins. Il ne faut pas fixer de plafond Ainsi, les pays membres pourront affecter le montant qu’ils souhaitent aux prestations d’une agriculture multifonctionnelle Outre l’entretien du paysage rural, l’occupation décentralisée du territoire et la préservation des ressources naturelles, ces prestations comprennent aussi la sécurité des denrées alimentaires, les réserves nécessaires à la sécurité de l’approvisionnement et la garde d’animaux respectueuse de l’espèce
3 A S P E C T S I N T E R N A T I O N A U X 3 . 1 D É V E L O P P E M E N T S I N T E R N A T I O N A U X 3 271
■ Proposition de négociation de la Suisse
3. Pour ce qui a trait aux subventions à l’exportation, il ne faudra pas seulement parler des restitutions directes, mais aussi des subventions indirectes, telles que les crédits à l’exportation et certaines formes de commerce d’Etat permettant de pratiquer des prix mixtes.
La Suisse souhaite en outre que l’on traite trois domaines réglés dans d’autres accords qui ont un lien avec l’agriculture:
– Une meilleure protection des indications de provenance géographiques devrait être assurée par une protection non seulement des indications de vins et de spiritueux, mais aussi de celles d’autres produits, tels que le fromage
– Les consommateurs devraient obtenir davantage d’informations sur les produits Cette exigence vise notamment les indications sur le mode de production – p ex informations sur la pollution de l’environnement ou le bien-être des animaux
, et la déclaration de produits OGM De telles informations assurent davantage de transparence et améliorent le fonctionnement des marchés, sans pour autant créer de nouvelles entraves techniques au commerce
– Les trois dimensions de la durabilité (économie, écologie et social) devraient être traitées dans divers accords Il importe d’éviter les mesures commerciales ayant des incidences négatives sur un ou plusieurs de ces piliers et d’internaliser les coûts externes de la production agricole.
Les propositions présentées par la Suisse pour les négociations ont été critiquées par les pays exportateurs de produits agricoles, qui jugent la libéralisation du marché insuffisante, mais les autres pays les qualifient de constructives
3 . 1 D É V E L O P P E M E N T S I N T E R N A T I O N A U X 3 272
–
■ Calendrier des négociations 2001/2002
La première phase des négociations formelles s’étant achevée à fin mars 2001, on est passé à la deuxième, qui devrait durer jusqu’au printemps 2002 Ces négociations sont de nature plus technique et porteront sur tous les sujets mentionnés dans les propositions des membres de l’OMC: aspects commerciaux, tels que contingents tarifaires et droits de douane et questions non commerciales, telles que sécurité alimentaire, sécurité des denrées alimentaires et développement rural La quatrième Conférence des ministres qui aura lieu du 9 au 13 novembre 2001 à Qatar jouera un rôle crucial pour la suite des négociations C’est là que se décidera le lancement éventuel d’un nouveau cycle élargi de l’OMC ou une modification du mandat de négociation dans le domaine de l’agriculture
Outre le cadre formel de négociation, il existe des groupes informels qui défendent leurs intérêts spécifiques Avec l’UE, le Japon, la Corée, la Norvège et l’île Maurice, la Suisse appartient au groupe des multifonctionnalistes, qui souhaitent assurer le rôle de l’agriculture non pas uniquement sous l’angle de la production de denrées alimentaires, mais aussi de prestations non liées aux produits Après la conférence de l’été 2000 à Ullensvang en Norvège, une conférence ayant réuni une cinquantaine de pays a été organisée à l’île Maurice à fin mai 2001, pour discuter de ces considérations autres que d'ordre commercial Ces deux réunions ont donné l’occasion d’analyser les difficultés spécifiques de ces négociations agricoles particulièrement complexes, surtout pour les nombreux pays en développement et en transition

3 . 1 D É V E L O P P E M E N T S I N T E R N A T I O N A U X 3 273
L’OMC et la politique commerciale suisse
L’OMC examine, à certains intervalles, la politique commerciale des pays membres en suivant une procédure déterminée. Le dernier examen de la Suisse a eu lieu durant l’année sous revue Tous les secteurs de l’économie nationale sont analysés, une grande importance étant évidemment accordée à l’agriculture
L’extrait suivant est tiré du rapport du secrétariat de l’OMC «Examen des politiques commerciales Suisse et Liechtenstein», du 6 novembre 2000:
Les réformes engagées en 1993 et poursuivies dans le cadre de l'initiative «Politique agricole 2002» ont permis de réduire l'intervention de l'Etat dans le secteur; les contributions accordées par l'Etat pour maintenir le revenu agricole par le biais de paiements directs sont principalement fondées sur des considérations environnementales et le champ d'application des systèmes de marge et de prix garantis a été considérablement réduit Toutefois, le soutien de l'Etat à l'agriculture représente encore près des trois quarts des recettes agricoles brutes; les exportations de produits laitiers, de bétail, de chevaux, de fruits, de pommes de terre et de certains produits agricoles transformés sont subventionnées L'incidence des réformes sur les prix a été limitée par l'absence de concurrence dans certaines branches d'activité, par les programmes de soutien des prix, et par le remplacement des offices de commercialisation par des institutions mandatées par l'Etat Le système de prise en charge (applicable aux importations de certains produits agricoles) en vertu duquel l'accès aux contingents est subordonné à l'achat de produits nationaux, joue également un rôle En conséquence, les prix intérieurs des produits agricoles sont restés élevés, par rapport à leur niveau dans d'autres pays. L'effet négatif des prix élevés des produits agricoles utilisés comme intrants par l'agro-industrie a été atténué par des incitations très diverses L'agriculture demeure le secteur le plus protégé. L'équivalent ad valorem des droits NPF appliqués aux importations de produits agricoles est d'environ 34 pour cent, en moyenne arithmétique, soit quatre fois la moyenne générale, avec un maximum de 678 pour cent Par ailleurs, les importations de produits agricoles sont soumises à un régime de licences, pour des raisons sanitaires, phytosanitaires ou relatives à la constitution de stocks de réserve obligatoires et à la gestion des contingents tarifaires, ainsi qu'à des prescriptions en matière d'étiquetage Dans l'ensemble, la politique agricole demeure complexe
3 . 1 D É V E L O P P E M E N T S I N T E R N A T I O N A U X 3 274
■ L’agriculture suisse jugée par l’OMC
■ Commentaire de la Suisse

Les objectifs fixés par le gouvernement se fondent sur l’article constitutionnel et sur la LAgr du 29 avril 1998
1. Une agriculture durable et compétitive doit pouvoir s ’ assurer une place dans notre société moderne où prédominent l'industrie et les services
2 L’agriculture doit être en mesure d’offrir, à des prix concurrentiels, des produits et des services adaptés aux marchés intérieur et extérieurs
3 L’agriculture doit utiliser les ressources de manière durable et contribuer ainsi à la préservation de la diversité des espèces, à l’entretien du paysage et au développement de l’espace rural.
La solution choisie pour atteindre ces objectifs consiste à séparer la politique des prix de celle des revenus et à rétribuer par des contributions étatiques les prestations fournies dans l’intérêt général (p ex prestations écologiques)
C’est en principe le marché qui règle la production de denrées alimentaires et la culture de matières premières renouvelables Les quelques aides encore allouées dans ces domaines sont conçues de sorte que leurs incidences sur le mécanisme du marché soit réduites au maximum Les interventions de l’Etat devront encore nettement diminuer
– L’Etat rétribue sous la forme de paiements directs les prestations pour lesquelles il n ’existe pas de marché, telles que l’entretien du paysage rural ou la préservation des ressources naturelles La rétribution porte aussi sur des prestations que l’agriculture fournit à la demande de la collectivité, par exemple en matière de protection de l’environnement ou des animaux. Ces paiements ne doivent pas être liés à la production
3 A S P E C T S I N T E R N A T I O N A U X 3 . 1 D É V E L O P P E M E N T S I N T E R N A T I O N A U X 3 275
–
■ Qu’est-ce que cette organisation?
L’OCDE – le géant discret
L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) est souvent considérée comme laboratoire d’idées, station d’observation, club des pays riches ou université inofficielle Chacune de ces étiquettes contient un brin de vérité, mais aucune d’entre elles ne capte vraiment la fonction de l’OCDE
Organisation réunissant 30 pays membres, l’OCDE offre en premier lieu aux gouvernements un cadre leur permettant d’examiner, d’élaborer et de développer leurs politiques économiques et sociales Les gouvernements y échangent leurs expériences, cherchent des solutions à des problèmes communs et s ’efforcent de faire concorder les politiques nationales et internationales, dont l’harmonisation s’impose en raison de la globalisation Les discussions au sein de ce forum peuvent conduire à des décisions, comme celles d’introduire des règles juridiquement contraignantes pour assurer la libre circulation des capitaux et des services, de prendre des mesures pour la lutte contre les fraudes ou encore de supprimer les subventions pour la construction navale Cependant, les entretiens servent surtout à mieux informer les gouvernements, afin qu’ils puissent ensuite tenir compte de tous les aspects des politiques publiques dans leur contexte national et mieux évaluer les conséquences de la politique nationale sur la communauté internationale. L’OCDE offre par ailleurs la possibilité d’un échange d’idées et d’opinion avec des pays présentant des conditions similaires
L’OCDE résulte d’un regroupement de pays animés par les mêmes idées. Elle peut être désignée comme club des riches, dans la mesure où ses membres produisent ensemble deux tiers des biens et des prestations de service du monde entier Mais l’OCDE n ’est pas un club privé Pour y adhérer, un pays doit fonctionner selon les règles de l’économie de marché et de la démocratie pluraliste Les pays-fondateurs d’Europe et de l’Amérique du Nord ont peu à peu été rejoints par le Japon, l’Australie, la NouvelleZélande, la Finlande, le Mexique, la République tchèque, la Hongrie, la Hollande, la Pologne et la Corée du Sud Dans le cadre de programmes organisés avec des pays de l’ancienne Union soviétique, d’Asie et d’Amérique latine, l’OCDE entretient par ailleurs de nombreux contacts avec le reste du monde qui peuvent dans certains cas aboutir à une adhésion
■ Travaux effectués au sein du Comité agricole et de ses groupes de travail
L’OFAG représente les intérêts de la Suisse au sein du Comité agricole de l’OCDE et de divers groupes de travail Les trois années passées, une part croissante des activités a été consacrée à l’élaboration de bases analytiques pour les négociations agricoles de l’OMC à venir. A relever les travaux concernant les effets du cycle d’Uruguay du GATT ainsi que la définition et l’appréciation de la multifonctionnalité de l’agriculture
3 . 1 D É V E L O P P E M E N T S I N T E R N A T I O N A U X 3 276
■ Policy Evaluation Matrix (PEM): première étude pilote achevée
Dans le domaine agricole (commerce et environnement inclus), l’OCDE a beaucoup contribué à rendre les discussions entre l’Ancien et le Nouveau monde plus objectives Depuis 1987, le Suisse Gérard Viatte est à la tête du Directoire de l’agriculture du Secrétariat de l’OCDE et le restera jusqu’à fin 2001. Sous sa direction, la qualité et l’impact politique immédiat du travail de l’OCDE dans le domaine agricole ont atteint une dimension jamais connue auparavant
Les principales activités prévues en 2001 et 2002 pour le Comité agricole et ses groupes de travail sont les suivantes:
– appréciation et surveillance des politiques agricoles;
prévisions sur l’évolution future des marchés et du commerce agricoles;
– évaluation et promotion de la libéralisation du commerce;
– amélioration de la durabilité écologique de l’agriculture;
analyse des points de recoupement entre influences et politiques internes et étrangères
Par PEM, on entend un modèle d’équilibre partiel applicable à toute organisation de marché impliquant une fonction de production. A l’aide de ce modèle, on analyse l’impact de changements marginaux du soutien (soutien des prix du marché, paiements directs) sur le revenu agricole, le commerce mondial et les dépenses des contribuables et des consommateurs. On tente aussi de modéliser et d’analyser les effets sur le marché du travail et sur l’environnement Les résultats de l’étude pilote relative aux grandes cultures ont été publiés au printemps 2001 Actuellement, le groupe d’experts développe un modèle semblable pour le marché laitier Il est prévu d’appliquer la PEM pour le monitoring des pays et pour divers autres travaux de l’OCDE. Depuis novembre 1998, l’OFAG participe au projet pilote PEM. En outre, l’EPF contribue dans ce contexte, depuis début 1999, à la modélisation des marchés suisses, selon un mandat de recherche que lui a confié l’OFAG
■ Cadre général de la multifonctionnalité de l’agriculture
L’OCDE traite depuis quelques années le sujet de la multifonctionnalité de l’agriculture
Elle a publié un concept analytique exhaustif à ce propos au printemps 2001 La Suisse a initié les travaux portant sur ce thème – qu ’elle juge capital – au sein de comités et de groupes de travail; elle les suit de près et y participe activement Malgré les divergences d’opinion et de position des pays membres de l’OCDE en ce qui concerne la multifonctionnalité de l’agriculture, ce concept analytique a été adopté par le Comité agricole.

3 A S P E C T S I N T E R N A T I O N A U X 3 . 1 D É V E L O P P E M E N T S I N T E R N A T I O N A U X 3 277
–
–
■ Autres travaux importants de l’OCDE dans l’année passée
Ledit document analyse les rapports entre multifonctionnalité et durabilité, la production couplée de biens économiques et non économiques dans l’agriculture, diverses dimensions de prestations non marchandes, leur mise à disposition en dehors de l’agriculture, leurs externalités et leur caractère de biens publics. A cet égard, l’OCDE arrive à la conclusion qu ’ une intervention limitée de l’Etat peut être requise lorsque, primo, il existe une grande corrélation entre marchandises agricoles et prestations non marchandes, secundo, il y a défaillance du marché pour ces dernières et, tertio, aucune option privée (p ex création de nouveaux marchés ou mise à disposition volontaire des prestations) ne constitue la meilleure stratégie pour fournir ces prestations non marchandes
L’OCDE a publié plusieurs documents portant sur les appellations d’origine géographiques, la mise en œuvre du cycle d’Uruguay de l’OMC, le découplage des instruments de soutien agricole, la biotechnologie et les marchés agricoles, les entreprises commerciales publiques, les crédits à l’exportation, la suppression des subventions à l’exportation et les indicateurs agro-environnementaux L’OCDE fournit ainsi un travail préparatoire important pour les négociations agricoles menées actuellement au sein de l’OMC à Genève
■ La politique agricole suisse vue par l’OCDE
Dans le rapport annuel «Politique agricole dans les pays de l’OCDE: Monitoring et évaluation 2001», la Suisse est encore critiquée pour le degré de protection de son agriculture, qui est toujours un des plus élevés du monde
Toutefois, l’OCDE reconnaît que notre pays s ’est engagé sur la bonne voie en abandonnant, dans le cadre de PA 2002, le soutien des prix au bénéfice de paiements écologiques non liés à la production.
3 . 1 D É V E L O P P E M E N T S I N T E R N A T I O N A U X 3 278
L’encadré ci-après contient un résumé de l’appréciation de la politique agricole par l’OCDE dans l’année sous revue:
L'agriculture suisse se caractérise par un soutien atteignant un niveau élevé et par le peu de place laissé aux mécanismes du marché La structure du soutien a changé depuis le milieu des années 80, la part du soutien des prix du marché diminuant et celle des paiements budgétaires augmentant Les prix garantis ont été supprimés en 2000 et l'écart entre les prix intérieurs et mondiaux s 'est réduit Bien que le CNS des producteurs (Coefficient Nominal de Soutien à la production: C’est le rapport entre l’ESP et la valeur du total des recettes brutes de l’exploitation évaluées aux prix du marché mondial, à l’exclusion de tout soutien budgétaire) ait diminué de 25% environ par rapport à la période 1986–1988, s'établissant à 2 93 en 2000, les prix intérieurs à la production demeurent en moyenne près de trois fois plus élevés que les prix du marché mondial. Les paiements ont augmenté pour dédommager les agriculteurs de la diminution de leurs revenus commerciaux et pour rémunérer la production de produits non alimentaires La part des paiements budgétaires dans le soutien total aux producteurs est passée de 18% pendant la période 1986–1988 à 39% en 1999, puis à 41% en 2000 En 2000, les augmentations les plus fortes ont concerné les paiements calculés en fonction de la production et de l'utilisation d'intrants, ou assortis de contraintes sur les intrants Sur le long terme, la structure des paiements budgétaires a considérablement changé, la part des paiements subordonnés à la consommation d'intrants passant de 44% en 1986–1988 à 14% en 2000 et celle des paiements calculés sur les versements antérieurs, institués en 1993, se hissant à 39% Dans l'ensemble, l'ESP en pourcentage a légèrement diminué (71% en 2000 contre 73% en 1986–1988), mais le niveau du soutien aux agriculteurs reste l'un des plus élevés de l'OCDE Les recettes agricoles brutes de 2000 (soutien compris) ont été près de trois fois et demie supérieures au niveau qu 'elles auraient atteint en l'absence de soutien
Dans le cadre de la PA 2002, le versement de la plupart des paiements budgétaires aux agriculteurs est subordonné à certaines prestations environnementales et les «paiements écologiques» assortis de restrictions concernant les pratiques agricoles ont augmenté dans des proportions particulièrement considérables ces dernières années L'abandon progressif du soutien des prix du marché au profit de paiements agro-environnementaux et d'autres paiements directs est susceptible d'aboutir à la mise en place d'un secteur agricole plus sensible au marché et plus durable Néanmoins, la réaffectation de certains crédits au soutien des prix sur le marché intérieur des produits laitiers et l'instauration d'une nouvelle contribution à la surface pour les terres ouvertes et les cultures pérennes, décidées par le parlement et le gouvernement fin 2000-début 2001, font craindre que la réduction du soutien subordonné à la production, prévue par la PA 2002, ne soit remise en cause. En outre, le soutien aux exploitants, en Suisse, reste sensiblement supérieur à la moyenne de l'OCDE, à telle enseigne que de nouveaux efforts de réforme semblent nécessaires pour soumettre davantage l'agriculture du pays à l'influence des prix du marché mondial
3 A S P E C T S I N T E R N A T I O N A U X 3 . 1 D É V E L O P P E M E N T S I N T E R N A T I O N A U X 3 279
■ Appréciation de la politique agricole par l’OCDE
■ Commentaire de la Suisse
Le jugement de l’OCDE est positif pour la Suisse, comparé par exemple aux trois autres pays où le niveau de protection de l’agriculture est très élevé (Norvège, Japon, Corée du Sud) Notre pays a notamment reçu de bonnes notes pour les réformes lancées dans le cadre de «PA 2002», visant à axer davantage l’agriculture sur le marché, à réduire le soutien des prix du marché et à rétribuer directement les prestations non liées à la production, telles que l’entretien du paysage et la préservation de la biodiversité Cependant, l’OCDE en vient à la conclusion que des efforts doivent encore être consentis pour améliorer la compétitivité de l’agriculture suisse au plan international
■ Qu’est-ce que l’ESP?
La méthode dite de l’ESP (Estimation du soutien aux producteurs; anglais: Producer Support Estimate, PSE) est utilisée pour déterminer le soutien accordé à l’agriculture. L’ESP est un indicateur de la valeur monétaire, au niveau de l’exploitation individuelle, des transferts bruts des consommateurs et contribuables au bénéfice des producteurs agricoles. La nature de ces transferts, les objectifs visés et les incidences sur la production et le revenu agricole ne sont pas pris en compte dans ce chiffre relatif au soutien global
L’OFAG est sceptique en ce qui concerne la méthode de l’ESP En considérant le soutien global et la proportion des recettes qu’il représente, l’OCDE ne distingue pas entre soutien des prix du marché (calculé selon l’écart entre le prix du marché mondial et le prix à la production en Suisse) et paiements directs découplés de la production de denrées alimentaires et destinés à promouvoir les prestations non liées à la production. La définition des prix sur le marché mondial pose également un problème S’il est relativement facile de déterminer celui des céréales, cette tâche est bien plus difficile pour le lait, étant donné qu’il est commercialisé presque exclusivement sous la forme de produits transformés En l’occurrence, le prix à la production fixé par le New Zealand Dairy Board a été choisi comme référence. Qui plus est, les prix du marché mondial oscillent fortement, ce qui entraîne une fluctuation des valeurs ESP, même s’il n ’ y a aucun changement de la politique nationale et que les prix du pays restent stables Les fluctuations des taux de change ont le même effet. C’est aussi la principale différence par rapport au calcul du soutien interne effectué pour la boîte orange de l’OMC Dans ce calcul, le prix de référence est fixe; pour ce qui est de la Suisse, il s ’agit souvent du prix de l’UE Par ailleurs, l’OMC ne regroupe pas les mesures des boîtes verte, bleue et orange, mais les indique séparément
Suite à l’augmentation de la somme des paiements directs, dont l’octroi requiert de plus en plus souvent des prestations non liées à la production, et à la diminution simultanée du soutien des prix du marché, la valeur de la production agricole a baissé, ce qui fait automatiquement croître l’ESP L’OCDE affirme qu ’elle ne peut rien y changer tant qu’il manque des critères clairs, objectifs et simples permettant de distinguer les contributions octroyées respectivement pour des prestations spécifiques et non spécifiques à un produit Cette distinction pose en effet des problèmes Une subvention allouée pour des engrais, par exemple, n ’est pas considérée comme spécifique à un produit, bien qu ’elle influe fortement sur la production La distinction précitée est difficile à faire pour des raisons techniques, mais il manque aussi la volonté politique de trouver une solution. Or, on ne pourra indiquer séparément les prestations non spécifiques à un produit dans le calcul ESP que lorsque des critères de classement seront disponibles L’OCDE ne peut en effet se fonder sur les critères définis pour la boîte verte
3 . 1 D É V E L O P P E M E N T S I N T E R N A T I O N A U X 3 280
de l’OMC, qui ne sont pas assez précis à son avis. Elle a toutefois lancé plusieurs études sur le sujet du «découplage», c ’est-à-dire en l’occurrence sur la recherche de critères de distinction

La subdivision de l’ESP appliquée par l’OCDE révèle, pour la Suisse, de grands changements ces dernières années: le soutien du prix du marché a reculé pendant les années nonante contrairement aux dépenses compensatoires (liées partiellement ou entièrement au produit) et aux dépenses non liées au produit servant à rétribuer des prestations spécifiques, qui se sont accrues
L’OFAG continuera à s ’ engager, au sein du Comité agricole de l’OCDE et de ses groupes de travail, pour que la méthode de l’ESP tienne mieux compte des réformes réalisées en Suisse et qu’à l’avenir les publications de l’organisation mettent davantage de poids sur la subdivision de l’ESP que sur le soutien global et la part du soutien aux recettes.
Soutien
3 A S P E C T S I N T E R N A T I O N A U X 3 . 1 D É V E L O P P E M E N T S I N T E R N A T I O N A U X 3 281
Composition de l’Estimation Suisse UE USA du soutien aux producteurs (ESP) (estimation) mio de fr mio de fr mio de fr ESP en valeurs absolues 7 501 152 520 82 667 Soutien des prix du marché 4 432 89 608 26 460 Paiements calculés en fonction 297 7 967 15 584 de la production Paiements liés aux surfaces de cultures/ 846 38 774 5 939 nombre d’animaux Paiements destinés à compenser la réduction 1 190 972 17 783 du soutien des prix du marché Paiements calculés en fonction 423 10 126 11 248 de l’utilisation d’intrants Paiements assortis de contraintes 124 4 976 3 338 sur les intrants Paiements liés au revenu 00 2 315 total de l’exploitation Paiements divers 190 97 0 ESP en pour-cent des recettes brutes 71 38 22 au niveau de l’exploitation agricole Taux de change BNS 2000: fr /EURO 1 5578 / fr /US-$ 1 6886
accordé à l’agriculture en 2000
OCDE
Source:
■ Commentaire de la Suisse
Le secrétariat de l’OCDE examine actuellement de quelle manière on pourrait améliorer le calcul de l’ESP, notamment en établissant une hiérarchie selon l’impact des mesures concernées sur la production et le soutien des prix du marché La hiérarchie discutée se présente comme suit: soutien des prix du marché, paiements calculés en fonction de la production, paiements calculés en fonction de l’utilisation d’intrants, paiements liés aux surfaces de cultures/nombre d'animaux, paiements destinés à compenser la réduction du soutien des prix du marché, paiements assortis de contraintes sur les intrants et paiements liés au revenu total de l'exploitation
Les rapports intégraux de l’OCDE et d’autres informations peuvent être obtenus sur son site Internet: www oecd org/agr ou, en partie, sur le site de l’OFAG: www blw admin ch
3 . 1 D É V E L O P P E M E N T S I N T E R N A T I O N A U X 3 282
Alimentation mondiale et FAO
Dans le Rapport agricole 2000, cette section a commencé par une rétrospective optimiste de la situation alimentaire mondiale, pour mentionner ensuite des impasses menaçant le potentiel agricole global Un an après, on constate que pour l’heure, les facteurs restrictifs se sont imposés Le rythme accéléré que visait la FAO dans la lutte contre la faim risque de céder la place au ralentissement

Depuis le Sommet de l’alimentation mondiale en 1996, la situation ne s ’est guère améliorée La mise en œuvre des sept engagements, 27 objectifs et 182 actions se fondant sur la Déclaration de Rome de la même année a été très lacunaire.
Cinq ans après le Sommet précité, l’évolution de l’alimentation mondiale est bien éloignée de la voie qui pourrait permettre, d’ici à 2015, de réduire de moitié le nombre de personnes souffrant de la faim La Conférence générale de la FAO en novembre 2001 procédera à un examen exhaustif des raisons ayant conduit à cette situation
Nous pouvons néanmoins faire dès à présent les constatations suivantes:
– plus de 800 millions de personnes souffrent encore de sous-alimentation ou de faim, dont 792 millions dans les pays en développement;
– les investissements dans des projets destinés à soutenir le développement de l’agriculture ont diminué au plan mondial, mais aussi de la part de la Suisse;
– la globalisation et la libéralisation ont eu des effets très inégaux sur la prospérité et n ’ont pas produit les résultats qu ’espéraient les plus pauvres dans les pays en développement;
– les catastrophes causées par les hommes ont augmenté 60 millions de personnes, soit plus que jamais, dépendent aujourd’hui de l’aide d’urgence dans 35 pays en développement;
– les changements climatiques ont des incidences imprévisibles sur la répartition des précipitations et sur les rendements agricoles;
– la propagation du SIDA s ’est accélérée 95% des cas sont enregistrés dans les pays en développement Dans de nombreux pays du Sud, cette pandémie est hors contrôle Elle touche avant tout les groupes les plus pauvres de la population et affecte aussi la production agricole;
– la faim étant largement répandue, la lutte contre la pauvreté ne fait guère de progrès Ces deux fléaux se déterminent mutuellement, la faim étant à la fois une cause et un effet de la pauvreté
3 A S P E C T S I N T E R N A T I O N A U X 3 . 1 D É V E L O P P E M E N T S I N T E R N A T I O N A U X 3 283
■ A l’ombre du plan d’action et de la Déclaration de Rome
■ Pronostics concernant l’évolution future
Selon l’analyse des tendances de la FAO pour les années 2015 et 2030, le nombre de personnes souffrant de malnutrition dans les pays en développement devrait baisser à 580 millions d’ici à 2015 On escompte donc un recul, mais il ne répondrait pas encore à l’objectif fixé lors du Sommet de l’alimentation mondiale. Ce ne sera probablement qu ’ en 2030 que ledit nombre aura baissé à environ 400 millions
Les pronostics diffèrent selon les régions On s ’attend ainsi à ce que l’objectif sera atteint d’ici à 2015 en Asie du Sud et de l’Est, tandis que la situation dans les pays de l’Afrique subsaharienne et du Proche-Orient est jugée plus défavorable L’Amérique latine, quant à elle, tient une position intermédiaire
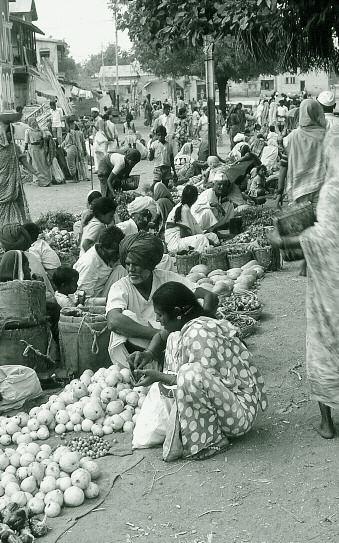
Pronostics
Les extrapolations de la FAO pour les 15 années à venir se fondent sur une croissance annuelle de la production alimentaire de 2% dans les pays en développement Il faudra cependant investir considérablement dans l’agriculture où prédomine la petite propriété et dans le développement rural pour que cette tendance persiste. La croissance économique ne résout pas automatiquement le problème de la malnutrition Il importe que les pauvres bénéficient davantage des investissements En ce sens, le succès dans la lutte contre la faim et la pauvreté exige impérativement que l’on accorde un soutien financier à la recherche agronomique, afin qu ’elle puisse mettre à disposition des moyens d’augmenter la production agricole et des technologies adaptées offrant des chances de croissance aux pauvres qui exploitent les terres agricoles
3 . 1 D É V E L O P P E M E N T S I N T E R N A T I O N A U X 3 284
l’évolution
1996-98 2015 2030 1996-98 2015 2030 Part de la population Nombre en % en millions Afrique subsaharienne 34 22 15 186 184 165 Proche Orient et Afrique du Nord 10 86 36 38 35 Amérique latine et Caraïbes 11 75 55 45 32 Chine et Inde 16 73 348 195 98 Reste de l’Asie 19 10 5 166 114 70 Pays en développement 18 10 6 791 576 400
concernant
de la sous-alimentation
Source: FAO
La lutte contre la faim s’impose non seulement pour des raisons humanitaires, mais aussi pour des raisons économiques non négligeables En effet, la faim et la sousalimentation occasionnent des coûts économiques considérables La malnutrition réduit sensiblement les performances physiques et le développement intellectuel, ce qui se répercute sur la productivité Elle détruit ainsi à la fois la vie des individus et des familles et diminue le rendement des investissements sociaux et économiques
Ampleur de la faim
La gravité de la faim, ou déficit alimentaire, est égale à la différence entre la quantité moyenne d’énergie alimentaire que les personnes sous-alimentées obtiennent de leurs repas et la quantité minimale d’énergie dont elles ont besoin pour préserver leur masse corporelle et avoir une activité légère
Le déficit alimentaire de la plupart des 800 millions de personnes qui souffrent de faim chronique est de 100 à 400 kilocalories par jour La plupart de ces personnes ne meurent pas de faim Souvent, elles sont minces mais pas émaciées La faim chronique n 'est pas toujours apparente car l’organisme compense le déficit énergétique par un ralentissement de l’activité physique et, dans le cas des enfants, de la croissance Les personnes qui ne mangent jamais à leur faim sont plus exposées aux maladies, les enfants sont souvent léthargiques et incapables de se concentrer à l’école, les mères donnent naissance à des bébés chétifs et les adultes n ’ont pas toujours l’énergie nécessaire pour réaliser leur potentiel
En chiffres bruts, il y a plus de personnes chroniquement sous-alimentées en Asie et dans le Pacifique, mais en termes de gravité de la faim, c ’est manifestement en Afrique subsaharienne que le problème est le plus grave. Dans 46 pour cent des pays, le déficit alimentaire moyen des personnes sous-alimentées est de plus de 300 kilocalories par jour On ne trouve un déficit alimentaire aussi grave que dans 16 pour cent des pays d’Asie et du Pacifique.

Lorsque le déficit énergétique alimentaire est très élevé, il concerne généralement tous les types d’aliments, y compris les aliments de base riches en glucides (maïs, pommes de terre, riz, blé et manioc) qui fournissent essentiellement de l’énergie Par contre, lorsque le déficit est plus modéré, les personnes sous-alimentées ont généralement assez d’aliments de base, mais ce qui leur manque ce sont les autres aliments nécessaires pour une bonne nutrition: légumineuses, viande, poisson, matières grasses, produits laitiers, fruits et légumes, qui fournissent protides, lipides et micronutriments La diversification de l’alimentation est essentielle pour la sécurité alimentaire
Source: FAO
3 A S P E C T S I N T E R N A T I O N A U X 3 . 1 D É V E L O P P E M E N T S I N T E R N A T I O N A U X 3 285
■ La voie de l’avenir
Pour que la situation s ’améliore, il faut absolument associer les couches pauvres de la population à la planification du développement La politique traditionnelle de développement rural se concentrait jusqu’à présent sur l’amélioration de l’infrastructure et des prestations de services. Elle ne prenait pas assez en considération les besoins des pauvres, car on pensait que les effets de la croissance finiraient par avoir des retombées sur eux La FAO a fait l’expérience que de petits groupes novateurs, réunissant des personnes avec des objectifs semblables, trouvent généralement des moyens de parer la faim et la pauvreté
Il est particulièrement urgent d’agir dans les 82 pays à faible revenu et à déficit vivrier. Bon nombre d’entre eux n ’ont ni les moyens de produire toute la nourriture dont ils ont besoin, ni les devises nécessaires pour l’importer Beaucoup d’entre eux sont aussi très endettés envers l’étranger, ce qui absorbe les maigres ressources disponibles pour investir dans le développement. En raison du fardeau du service de la dette, ils ne peuvent pas faire grand-chose, tant pour répondre aux besoins les plus urgents de la population démunie que pour investir dans les améliorations durables nécessaires pour faire disparaître le fléau de la faim
Source:
FAO
Les différents groupes sociaux qui sont menacés par la faim et la sous-alimentation doivent trouver chacun pour soi une approche adéquate Mais ils ne pourront la réaliser que si l’on crée, aux plans national et international, des conditions-cadre économiques, politiques et institutionnelles donnant aux personnes concernées la possibilité de prendre l’initiative Ce sont les pays en développement, conjointement avec la communauté internationale, qui doivent poser les fondements de ce progrès, par la mise en œuvre résolue des engagements contenus dans le plan d’action du Sommet de l’alimentation mondiale de 1996.
3 . 1 D É V E L O P P E M E N T S I N T E R N A T I O N A U X 3 286
3.2 Comparaisons internationales
Les développements de l’économie et de la société dans le monde exercent une influence accrue sur l’agriculture suisse L’accord agricole conclu dans le cadre de l'OMC et l’accord bilatéral avec l’UE sur l’agriculture, par exemple, ont des répercussions directes sur les conditions-cadre de l’agriculture suisse Des comparaisons internationales peuvent donc apporter certaines informations sur la situation de notre agriculture en regard de la concurrence étrangère
Ce chapitre poursuit les comparaisons de prix amorcées dans le rapport agricole 2000 Il compare un certain nombre de prix à la production et à la consommation pratiqués en Suisse et à l’étranger et retrace les évolutions des dernières années Ensuite, ces comparaisons sont présentées de façon détaillée sous l’angle de la parité du pouvoir d’achat. Dans un chapitre séparé, les résultats provenant d’exploitations comptables suisses sont finalement comparés avec ceux de l’UE

■■■■■■■■■■■■■■■■
3 . 2 C O M P A R A I S O N S I N T E R N A T I O N A L E S 3 287
■ Que touchent les producteurs?
Comparaisons de prix internationales
Les comparaisons de prix entreprises l’année dernière sont prolongées sur la même base. A partir du marché suisse, nous établissons des comparaisons avec des marchés étrangers identiques, similaires ou importants
De telles comparaisons de prix sont liées à certaines difficultés, dont le choix des produits, la disponibilité des données, la pertinence des valeurs, les modes de production et de commercialisation différents ou les influences liées aux facteurs monétaires Ce ne sont donc pas les valeurs absolues qui comptent, mais les variations enregistrées au fil du temps
Les recettes réalisées par les producteurs servent de base à la comparaison Elles sont pondérées en fonction de la composition de la production finale en Suisse. Le modèle de production suisse est ainsi transposé aux pays faisant l’objet de la comparaison On peut donc montrer quelle est par exemple la différence par rapport aux Etats-Unis lorsqu’on considère notre agriculture en référence aux recettes réalisées par les producteurs américains
Evolution des prix à la production: Suisse par rapport
Tableaux 47-48b, pages
Les chiffres de l’UE portent sur les quatre pays voisins (UE-4/6) Les pays cinq et six sont les Pays-Bas et la Belgique Ils sont également pris en compte pour les pommes de terre et les légumes, car les volumes de production dans ces secteurs sont élevés dans ces deux pays Le calcul de la moyenne pour l’UE repose sur les parts des pays respectifs à la production totale du groupe Les quatre, voire six pays, produisent entre 47 et 83% de la quantité totale produite par l’UE.
3 . 2 C O M P A R A I S O N S I N T E R N A T I O N A L E S 3 288
des pays sélectionnés CH EU-4/6 D F I A USA I n d i c e ( 1 9 9 0 / 9 2 = 1 0 0 ) 1990/92 1998/2000 zu CH 1990/92 Sources: USP, OFAG, Eurostat, ZMP (D) US Department of Agriculture 0 100 90 70 80 60 40 50 30 20 10
A55-A57
à
■ Que paient les consommateurs?
La tendance à la baisse des prix à la production se poursuit. Ceux enregistrés en Suisse ont chuté de 21% entre les deux périodes sous observation Entre 1999 et 2000, les prix se sont cependant relevés de 0,4% Dans les pays environnants de l’UE, la réduction a atteint 21% entre les deux périodes sous observation. L’écart relatif entre la Suisse et l’UE ne s ’est ainsi pas réduit pour les produits considérés En valeur absolue, il s ’est toutefois considérablement rétréci Si nos paysans produisaient le même panier type que les agriculteurs des pays environnants et le vendaient là-bas, les prix obtenus équivaudraient à 53% des prix suisses En comparaison à la Suisse, les différences individuelles pour la période 1998/2000 sont cependant considérables Alors qu ’ en Italie, les pommes de terre se vendaient à 110% des prix suisses, le prix au producteur des carottes en Belgique n ’atteignait que 16% de celui obtenu en Suisse Pour le colza et le blé, les valeurs de 26 et 25% respectivement sont également très basses.
Aux Etats-Unis, l’évolution a été différente Les prix au producteur ont continué sur leur courbe ascendante. Cela est toutefois dû en premier lieu à la hausse du cours du dollar. La différence avec les Etats-Unis s ’est réduite aussi bien relativement qu ’ en valeur absolue Pour le même panier type, les prix atteignent 47% des prix suisses
Aux fins de cette comparaison, les écarts de prix entre la Suisse et les pays considérés ont été déterminés selon l’ancien schéma de pondération de l’indice suisse des prix à la consommation Le schéma de la consommation suisse a été transposé aux autres pays. Les différences liées aux parités de pouvoir d’achat et la situation des coûts n ’ont pas été prises en compte
3 A S P E C T S I N T E R N A T I O N A U X 3 . 2 C O M P A R A I S O N S I N T E R N A T I O N A L E S 3 289
Evolution des prix à la consommation en Suisse par rapport à des pays sélectionnés CH
USA I n d i c e ( 1 9 9 0 / 9 2 = 1 0 0 ) 1990/92 1998/2000 zu CH 1990/92 Sources: USP, OFAG, Eurostat, ZMP (D), services statistiques de Turin (I), F, B, A, USA 0 100 90 70 80 60 40 50 30 20 10
UE-4/5 ø UE-basseø UE-élévée
Tableaux 49-50, pages A58-A59
Le groupe «UE-4» comprend à nouveau les pays environnants, c 'est-à-dire l'Allemagne, l'Autriche, la France et l'Italie Pour cette dernière, les chiffres de la ville de Turin ont servi de base de référence La Belgique a été prise en considération dans le domaine des légumes ou lorsque les chiffres des pays voisins n’étaient pas disponibles. Par ailleurs, les prix minimaux ou maximaux constatés dans les quatre ou cinq pays de référence ont été regroupés dans les segments correspondants
L’écart de prix entre la Suisse et l’UE n ’est pas aussi grand que pour les prix à la production, en raison de l’influence des marchandises importées
En Suisse, les prix à la consommation des produits retenus pour cette comparaison ont baissé de 4% entre les deux périodes sous observation 1990/92 et 1998/2000. Cette valeur correspond à celle mentionnée dans le dernier rapport pour la période de comparaison 1990/92 et 1997/99 Dans l’UE par contre, la chute atteint 8%, contre 7% dans l’exercice précédent. L'écart entre la Suisse et les pays de l’UE environnants se montait à 29% en 1990/92 et a augmenté à 32% pour la période 1998/2000 Le fossé entre la Suisse et l’UE se creuse donc en ce qui concerne les prix à la consommation Il reste toutefois d’énormes différences entre les divers pays Tandis que les prix d’une partie des produits laitiers sont plus élevés en Italie qu ’ en Suisse et que le sucre est généralement plus cher dans l’UE, les côtelettes de porc y sont vendues la moitié du prix suisse

Nos résultats correspondent aussi à ceux du relevé mandaté par la Commission de l’UE dans le cadre de ses études de marché intérieur Ont été comparés les prix à l’intérieur de l’UE pour les mêmes marchandises sur une période d’une année (août 1999 à août 2000) Un panier type composé de onze produits coûte – TVA comprise – 28 francs en Espagne, 48 francs au Danemark et 39 francs en moyenne UE Si l’on introduit les prix suisses pour le calcul de ce panier de marchandises, on obtient un montant de 65 francs Le niveau des prix dans l’UE se situe ainsi à 59% du niveau suisse, alors que ce chiffre est de 67% pour l’an 2000 selon nos calculs La différence s ’explique par le fait que dans notre comparaison des prix, les pays ont été pondérés selon leurs parts aux dépenses de consommation et non pas selon la moyenne arithmétique de l’UE Par ailleurs, les données de l’Autriche, prises en compte dans nos calculs, manquent dans l’étude des marchés intérieurs
Les prix à la consommation ayant, au contraire, augmenté aux Etats-Unis, l’écart par rapport à la Suisse s ’est réduit Il n ’affiche plus que 32% La raison principale est toutefois à rechercher dans le cours élevé du dollar
3 . 2 C O M P A R A I S O N S I N T E R N A T I O N A L E S 3 290
■ Parité du pouvoir d’achat – exemple et définition
Comparaisons internationales de prix à l’aide de la parité du pouvoir d’achat
Les explications données dans le chapitre précédent sont complétées par d’autres comparaisons de prix Cela permet de montrer que les résultats présentent bien des différences selon le volume des données considérées, mais que la tendance ne change guère
Il y a parité du pouvoir d’achat lorsque le change est défini de telle sorte que dans deux pays, le pouvoir d’achat de la monnaie indigène et étrangère sont égaux pour un niveau de prix donné. Plus simplement, cela signifie que les prix des mêmes produits sont identiques Ceci n’étant généralement pas le cas dans la pratique, il y a lieu de calculer les écarts Une méthode aisée de calculer approximativement des parités de pouvoir d’achat consiste à choisir un produit disponible partout dans le monde. Nous choisissons l’exemple si bien connu de par le monde, tiré du journal anglais «Economist»: le hamburger Le Big Mac est disponible dans 120 pays et a toujours la même composition Il devrait donc être vendu au même prix
Prix des hamburger en avril 2001 dans quelques pays choisis
Pays Prix dans la monnaie Prix en Prix en Niveau en du pays dollars francs comparaison
Economist
Les différences sont importantes Le prix du hamburger est le plus élevé en Suisse; il est de 38% inférieur dans l’UE et de 30% aux Etats-Unis Si le hamburger était représentatif pour le niveau des prix en Suisse, on en tirerait la conclusion que ce dernier est nettement plus haut que dans l’UE et les Etats-Unis
3 A S P E C T S I N T E R N A T I O N A U X 3 . 2 C O M P A R A I S O N S I N T E R N A T I O N A L E S 3 291
suisses à la Suisse $ fr % CH fr 6 30 3 65 6 30 100 UE Euro 2 57 2 27 3 92 62 - D DM 5 10 2 30 3 97 63 - F FF 18 50 2 49 4 30 68 - I Lit 4 300 1 95 3 37 53 - A öSch Aucune indication USA US $ 2 54 2 54 4 38 70 Source:
La parité du pouvoir d’achat – selon l’OFS – peut être décrite comme suit:
«Les parités de pouvoir d’achat mesurent le pouvoir d’achat réel des diverses monnaies en comparaison les unes aux autres Elles expriment le rapport de prix mesuré dans les diverses monnaies entre les mêmes paniers de marchandises (par ex hamburger ou un grand nombre de produits) de deux ou divers pays La parité du pouvoir d’achat donne le nombre d’unités de monnaie étrangère permettant d’acheter, à l’étranger, la quantité de marchandises obtenue pour une unité de monnaie indigène »
Pour revenir à la comparaison du hamburger, la définition peut être précisée comme suit: en Suisse, un hamburger coûte 6 fr 30 et aux Etats-Unis 2 54 dollars La parité du pouvoir d’achat est donc de 0,4032 ($ 2.54 / fr. 6,30); cela signifie que le pouvoir d’achat d’un franc suisse équivaut à celui de 0 4032 dollar aux Etats-Unis En d’autres termes, la parité du pouvoir d’achat est un facteur de conversion entre deux monnaies, qui met leur pouvoir d’achat réel en relation sans le détour par le cours du change Dans le cas présenté, le cours du dollar correspond à une valeur de 2 fr 48 et non pas au cours du change de 1 fr. 73, tel qu’il se négociait sur le marché des devises à miavril
Le calcul de la parité du pouvoir d’achat à l’aide de la comparaison de prix du hamburger prête à croire que le franc suisse est surévalué sur le marché des devises Il est tout de même intéressant de constater que des différences importantes apparaissent à l’intérieur de l’UE (zone Euro), malgré le cours de change fixe et la politique économique accordée entre les pays Ceci correspond aux résultats de l’étude du marché intérieur de l’UE présentée dans le chapitre précédent
La surévaluation du franc suisse, qui ressort de la comparaison du hamburger, se monte à 38% face à l’Euro, 30% face au dollar et 22% face à la livre anglaise. La comparaison comprend toutefois aussi certaines insuffisances liées à des distorsions de prix (droits de douane ou autres mesures de protection douanière), des impôts à la consommation ou aux prix immobiliers. Du point de vue de la politique agricole, il convient de mentionner que le prix du hamburger suisse reflète en premier lieu les coûts dépendant des secteurs situés en amont et en aval
Nous présentons ci-après des comparaisons de niveau des prix effectuées à l’aide de la parité du pouvoir d’achat.
3 . 2 C O M P A R A I S O N S I N T E R N A T I O N A L E S 3 292
d’achat et cours du change Etat au 17 avril 2001 1 fr pour US$ 1 US$ pour fr Pouvoir d’achat selon la comparaison du hamburger 0 4032 2 4803 Cours du change selon la cotation sur le marché des devises 0 5822 1 7314
Pouvoir
Les comparaisons internationales auxquelles la Suisse participe également portent sur un grand nombre de produits et de prestations de services, qui forment la base du produit intérieur brut et sont utilisés pour calculer la parité du pouvoir d’achat La liste comprend 3'000 à 3'500 produits. L’UE saisit les données à tour de rôle sur une période de trois ans, alors que l’OCDE effectue un calcul totalement nouveau tous les trois ans Elle l’a fait en 1996 et 1999, mais les évaluations pour 1999 ne sont pas encore disponibles Tant l’UE que l’OCDE calculent à l’aide des indices des prix correspondants, comme grandeurs auxiliaires, en premier lieu à l’aide de celui des prix à la consommation Dans l’interprétation des séries ci-après, il convient de tenir compte de ces restrictions
Il est possible de calculer des indices de prix aux différents échelons d’agrégation à partir des parités de pouvoir d’achat Nous présentons ci-après ceux concernant l’échelon des denrées alimentaires Les derniers chiffres disponibles proviennent d’Eurostat et se rapportent à l’année 1998. L’indice suisse de la viande présente la valeur la plus élevée en comparaison avec l’UE, celle des fruits/légumes/pommes de terre est la plus proche de la moyenne On n ’utilise pas seulement les chiffres de base de l’UE (UE = 100), mais convertit aussi les valeurs à un indice 100 pour la Suisse, afin qu’il soit possible de les comparer avec les résultats du chapitre précédent
Indices du niveau des prix 1998 pour les denrées alimentaires
En comparant les résultats de toutes les denrées alimentaires avec ceux du chapitre sur les comparaisons de prix internationales, on constate que les résultats sont pratiquement identiques, la différence n’étant que d’un point d’indice (70 contre 69) Cela s ’explique par la méthode Le panier type est limité à un petit nombre de produits, les données sont recalculées chaque année et la liste des pays UE ne se rapporte qu ’ aux pays environnants

3 A S P E C T S I N T E R N A T I O N A U X 3 . 2 C O M P A R A I S O N S I N T E R N A T I O N A L E S 3 293
Pays Total denrées Viande Fruits, légumes, alimentaires pommes de terre UE = 100 CH = 100 UE = 100 CH = 100 UE = 100 CH = 100 CH 142 100 172 100 132 100 UE 100 70 100 58 100 76 - D 106 75 117 68 107 81 - F 107 75 110 64 108 82 - I 98 69 94 55 97 73 - A 108 76 108 63 104 79 USA Pas d’indication Sources: OFS, Eurostat
■ Parité du pouvoir d’achat et comparaison du niveau des prix
Comparaison du niveau des prix 2000 et mai 2001 pour la totalité du panier de marchandises de l’économie publique
Ces chiffres montrent l’évolution des prix de l’ensemble de l’économie d’un pays, en référence au produit intérieur brut A cet échelon d’agrégation, la part des denrées alimentaires n ’atteint plus que 7% Hormis les chiffres de l’exercice sous revue, nous présentons les données actuelles de mai 2001; il manque toutefois la synthèse de l’ensemble de l’UE.
Les chiffres indiquent clairement que plus la palette de produits est large, plus l’écart des prix entre la Suisse et les pays de comparaison est faible. La comparaison avec l’UE l’illustre: si la différence relative à l’indice du hamburger se monte encore à 38 points, elle descend à 30 pour les denrées alimentaires et à 21 pour le produit intérieur brut En ce qui concerne les Etats-Unis, on ne dispose pas d’autant de données et les variations du cours du change influent davantage sur le résultat Si le cours du dollar grimpe de 1 fr. 30 à 1 fr. 80, les prix se rapprochent fortement du niveau suisse. Vu la politique monétaire de la Banque nationale suisse, cet effet est moins marqué dans l’espace Euro
3 . 2 C O M P A R A I S O N S I N T E R N A T I O N A L E S 3 294
Pays Indice du niveau des prix Indice du niveau des prix en 2000 mai 2001 CH = 100 CH = 100 CH 100 100 UE 79 - D 82 78 - F 83 76 - I 68 66 - A 80 78 USA 90 84 Source: OCDE
Définitions et méthodes, page A91
Les entreprises agricoles suisses en comparaison avec l’UE
Les comparaisons internationales sont un outil précieux permettant d’analyser la compétitivité de l’agriculture suisse Elles ne sont toutefois judicieuses et possibles que si l’on dispose d’une base de données solide La Commission de l’UE exploite avec tous les pays membres de l’Union le Réseau européen d'Information Comptable Agricole (RICA) fondé sur une méthode unifiée La FAT a converti les données comptables des dépouillements centralisés des années 1996 à 1998 selon ladite méthode D’où la possibilité de disposer de données comparables
Il existe des différences méthodologiques entre le RICA et le dépouillement centralisé de la FAT Parmi les principales dont il faut tenir compte lors de la conversion, il y a la définition et la typologie des entreprises agricoles, l’évaluation des actifs ainsi que les populations de référence et la pondération des résultats
Les principales variables standard du RICA
Total production brute
+ Balance subventions d’exploitation + taxes (surtout paiements directs)
– Total consommation intermédiaire
= Revenu brut d’exploitation
Amortissements
= Valeur ajoutée nette d’exploitation
– Facteurs extérieurs (salaires payés, fermage payé, intérêts payés)
+ Balance subventions et taxes sur investissement
= Revenu d’exploitation familial
Source: Commission de l’UE RICA
Le revenu d’exploitation familial comprend la rétribution de la main-d’œuvre familiale non salariée ainsi que celle du capital propre utilisé dans l’exploitation; il correspond donc à la notion de revenu agricole dans le dépouillement centralisé
La variable standard «Balance subventions d’exploitation + taxes» correspond pour l’essentiel aux paiements directs versés par les pouvoirs publics Dans les tableaux cidessous, elle est regroupée sous «Subventions et taxes» avec les «Subventions et taxes sur investissement»
3 A S P E C T S I N T E R N A T I O N A U X 3 . 2 C O M P A R A I S O N S I N T E R N A T I O N A L E S 3 295
–
■ Réseau RICA de l’UE
■ Revenu des exploitations suisses supérieur à la moyenne de l’UE
Au vu des indications disponibles, les analyses qui suivent se limitent aux années 1996 à 1998 Les données de l’UE sont régulièrement mises à jour sur Internet (http://europa eu int/comm/agriculture/rica/index en cfm)
Structures d’exploitation moyennes dans quelques pays européens 1996/98
La surface moyenne se situe en Suisse bien en dessous du niveau des pays voisins et des 15 pays de l’UE (moyenne). Quant aux cheptels, ils sont comparables à ceux de l’Autriche et de la moyenne européenne La quantité de travail fourni s’écarte peu de celle des pays voisins tout en étant supérieure à la moyenne de l’UE
Même si les exploitations suisses sont plus petites, la production brute et la somme de celle-ci et des «Subventions et taxes» (surtout paiements directs) sont comparables à celles des exploitations allemandes et françaises. La production animale brute et les paiements directs jouent le premier rôle en Suisse La part des «Subventions et taxes» est de 22% environ en Autriche, de 20% en Suisse et oscille entre 13 et 14% pour l’Allemagne et la France ainsi qu ’ en moyenne européenne
3 . 2 C O M P A R A I S O N S I N T E R N A T I O N A L E S 3 296
CH DFA UE (15) Main-d’œuvre totale, exprimée en unités de travail annuel (UTA) 1,86 1,99 1,79 1,91 1,50 Main-d’œuvre non salariée (UTA) 1,38 1,47 1,44 1,81 1,23 Surfaces agricoles (ha) 19,7 53,1 63,9 24,8 31,3 Cheptel total, exprimé en unités de bétail (UB) 28,9 57,6 52,2 25,3 27,3 Sources: Commission de l UE, RICA, FAT
E C U / e x p l
Autr
Sources: Commission UE, FAT 1 ECU = 1 fr 61 Production brute animale Production brute végétale 0 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000
Production brute et subventions 1996/98
CH D F A UE (15)
Subventions et taxes
e production brute
Pour ce qui est des dépenses, les exploitations suisses figurent en assez bonne place, le revenu de l'exploitation familiale dépassant largement celui des pays de l’UE sélectionnés et de la moyenne européenne Lors de l’interprétation, il s ’agira de tenir compte du fait qu ’ en termes de volume de production, les exploitations suisses sont bien plus petites que les entreprises françaises et allemandes. Il s ’ensuit qu ’ en comparaison européenne, nos exploitations réalisent des revenus supérieurs à la moyenne en dépit de structures plus modestes Il convient cependant de relativiser ce constat par la valeur d’achat d’un ECU qui est de 20 à 30% plus basse en Suisse.

3 A S P E C T S I N T E R N A T I O N A U X 3 . 2 C O M P A R A I S O N S I N T E R N A T I O N A L E S 3 297
Dépenses et revenu d'exploitation familial 1996/98 CH D F A UE (15) E C U / e x p l Facteurs extérieurs Amortissements Sources: Commission UE, FAT 1 ECU = 1 fr 61 Consommation intermédiaire Revenu d'exploitation familial 0 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000
■ Comparaison d’exploitations laitières de
Cette comparaison permet de situer les exploitations suisses à structures similaires en comparaison internationale Des exploitations d’une surface de 30 à 50 ha ont, en l’occurrence, été choisies
Pour dégager l’effet des conditions de production difficiles en région de montagne, les exploitations de plaine et de la région des collines ont été présentées séparément A titre de comparaison, on se réfère à des régions RICA où la production laitière joue un rôle de premier plan Ainsi, outre la Bavière et le Schleswig-Holstein, la région française Rhône-Alpes est prise en compte, région comprenant non seulement les Alpes mais aussi des parties de la Vallée du Rhône Pour l’Autriche, on ne dispose que de données à l’échelle nationale
Dans ce choix très restreint d’exploitations, il convient de tenir compte du fait qu ’ en Suisse et en Autriche, la taille des entreprises qui ont été retenues dépasse largement la moyenne des exploitations de production laitière, alors qu ’ en Allemagne, elles se situent dans la moyenne nationale Quant aux exploitations de la région Rhône-Alpes, elles sont sensiblement plus petites que la moyenne des entreprises laitières françaises
On ne retrouve les deux unités de main-d’œuvre (voire plus) utilisées en Suisse que dans les exploitations autrichiennes Si les employés agricoles sont extrêmement rares dans les exploitations des régions de référence de l’UE, ils représentent en Suisse entre 0,7 et 0,9 unité de main-d’œuvre. Quant à la performance laitière par vache en Suisse, elle est plutôt supérieure à la moyenne
ha
entreprises de production laitière 1996/98
CH CH, Plaine Bavière Schleswig- Rhône- A Ensemble et région Holstein Alpes des régions des collines
3 . 2 C O M P A R A I S O N S I N T E R N A T I O N A L E S 3 298
Structures d’exploitation
(30–50
SAU) des
Exploitations retenues 2 747 1 437 12 072 1 656 3 125 3 282 Main-d’œuvre totale (UTA) 2,3 2,5 1,6 1,5 1,5 2,4 Main-d’œuvre non salariée (UTA) 1,6 1,6 1,6 1,3 1,5 2,3 Surfaces agricoles (ha) 36,5 36,1 37,1 41,0 39,3 35,8 Cheptel total (UB) 42,9 51,7 56,8 72,4 39,4 38,0 Vaches laitières (UB) 23,6 28,0 31,4 36,2 26,5 22,3 Performance laitière (kg/vache) 5 905 6 120 5 500 5 879 5 357 5 269 Production laitière (kg) 139 600 171 500 172 900 212 500 142 000 117 400 Sources: Commission de l’UE, RICA, FAT
similaire
laitières suisses gourmandes en main-d’œuvre
taille
■ Exploitations
■ Production brute et paiements directs dans les exploitations laitières suisses sensiblement plus élevés
A structures d’exploitation égales, les entreprises suisses enregistrent une production agricole brute de 1,5 à 2 fois supérieure à celle des exploitations de référence européennes S’y ajoutent les paiements directs qui, avec quelque 40'000 ECU, sont largement supérieurs même au 21'000 ECU de l’Autriche. Les exploitations allemandes et françaises qui ont été analysées touchent des paiements directs à concurrence de 6'000 à 13'000 ECU

■ Dépenses des exploitations laitières suisses environ deux fois plus élevées
Côté dépenses aussi, les exploitations suisses se distancient clairement de leurs voisines Pour toutes les rubriques de dépenses, les deux groupes d’exploitations suisses se situent nettement au-dessus des groupes de référence de l’UE Les frais salariaux sont ici les plus évidents, ce paramètre n ’existant guère dans les exploitations de l’UE de taille comparable De même, les coûts liés à l’affermage et au service de la dette dépassent la moyenne en Suisse si on les considère en termes absolus La part des surfaces affermées est de quelque 60% pour les exploitations de notre pays, un pourcentage qui n ’est dépassé que par les entreprises de la région Rhône-Alpes, les coûts d’affermage étant toutefois comparativement modestes en France Ces parts sont de 40 à 50% pour les exploitations allemandes et de près d’un tiers en Autriche Les exploitations agricoles suisses dépensent pour l’entretien et les réparations des bâtiments au moins deux fois plus que leurs voisines d’Allemagne et d’Autriche, voire quatre fois plus que la région de référence française Côté amortissements, les entreprises bavaroises égalisent presque la Suisse, alors que les autres régions se situent bien en retrait.
Dans les exploitations françaises et autrichiennes, les dépenses totales (consommation intermédiaire, amortissements, facteurs extérieurs) ne représentent que 40% de celles consenties par les entreprises suisses de plaine et de la région des collines Ce pourcentage est de 60% environ pour les exploitations allemandes.
3 A S P E C T S I N T E R N A T I O N A U X 3 . 2 C O M P A R A I S O N S I N T E R N A T I O N A L E S 3 299
Production brute et subventions des exploitations laitières 1996/98 CH toutes régions CH plaine/ région des collines Bavière Schleswig Holstein RhôneAlpes A E C U / e x p l Subventions et taxes Autre production brute Production brute végétale Sources: Commission UE, FAT 1 ECU = 1 fr 61 Production brute animale sans lait Production brute lait de vache et autre lait 0 200 000 160 000 180 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000
Ces écarts de coûts massifs ne sauraient s ’expliquer par la dimension des exploitations, puisque la comparaison porte sur des entreprises de taille analogue Les prix plus élevés des aliments pour animaux sont, par exemple, les premiers responsables du surcroît de coûts dans les exploitations suisses Pour ce qui est des autres dépenses, c ’est l’aspect quantitatif qui pourrait être déterminant, notamment en ce qui concerne la main-d’œuvre, le capital tiers engagé et l’entretien des bâtiments et des machines S’y ajoutent certainement les conditions topographiques et climatiques, ainsi que les charges liées à la protection de l’environnement et des animaux. Mais tout cela n ’explique pas intégralement les écarts importants, par rapport à l’Autriche par exemple
Le revenu de l’exploitation familiale équivaut à la différence entre la production brute, subventions comprises, et les dépenses totales S’il représente pour les exploitations suisses 44'000 et près de 50'000 ECU respectivement, il est de 40'000 ECU seulement en Autriche (grâce à des coûts réduits) et de 19'000 à 24'000 ECU pour les autres groupes Dans la comparaison, on tiendra compte du fait que les exploitations autrichiennes font état de quelque 2,3 unités de main-d’œuvre non salariées entrant dans le revenu d’exploitation familial, contre 1,3 et 1,6 pour les autres
3 . 2 C O M P A R A I S O N S I N T E R N A T I O N A L E S 3 300
et
Dépenses et revenu d'exploitation familial des exploitations laitières 1996/98 CH toutes régions CH plaine/ région des collines Bavière Schleswig Holstein RhôneAlpes A E C U / e x p l Fermages, intérêts Salaires payés Amortissements Autre consommation intermédiaire Sources: Commission UE FAT 1 ECU = 1 fr 61 Entretien bâtiments et machines Fourrages pour UGBFG Revenu d' exploitation familial 0 200 000 160 000 180 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 ■ Revenu de l'exploitation familiale suisse largement en tête
régions
la Suisse.
301
Collaboration au rapport agricole 2001
■ Direction du projet, Werner Harder
secrétariat Alessandro Rossi
Monique Bühlmann
■ Auteurs
■ Rôle et situation de l‘agriculture
L’agriculture, partie intégrante de l‘économie
Alessandro Rossi
Marchés
Ursula Gautschi (coordination), Andreas Berger, Anders Gautschi, Jean Girardin, Simon Hasler, Katja Hinterberger, Thomas Meier, Beat Ryser
Situation économique
Vinzenz Jung
Aspects sociaux
Esther Muntwyler
Ecologie
Brigitte Decrausaz (coordination), Rhea Beltrami, Anton Candinas, Olivier Félix, Michel Fischler, Heinz Hänni, Esther Muntwyler
Appréciation de la durabilité
Vinzenz Jung
■ Mesures de politique agricole
Production et ventes
Ursula Gautschi (coordination)
Instruments de caractère global
Friedrich Brand, Jean-Marc Chappuis, Emanuel Golder, Simon Hasler, Samuel Heger, Niklaus Olibet, Marco Vanazzi
Economie laitière
Katja Hinterberger
Economie animale
Simon Hasler
Production végétale
Thomas Meier, Frédéric Rothen, Beat Ryser
302
Paiements directs
Thomas Maier (coordination), Hanspeter Berger, Viktor Kessler, Daniel Meyer, Hugo Roggo, Olivier Roux, Beat Tschumi, Peter Zbinden
Amélioration des bases de production
Améliorations structurelles
René Weber (coordination), Jörg Amsler, Willi Riedo, Andreas Schild
Recherche, vulgarisation, formation professionnelle, haras
Fabio Cerutti, Hans Marthaler, Anton Stöckli
Matières auxiliaires de l’agriculture, protection des végétaux et des variétés
Martin Huber, Alfred Klay, Hansjörg Lehmann, Jean-Daniel Tièche
Elevage
Karin Wohlfender
Evolution future de la politique agricole
Markus Wildisen, Marc Zuber
■ Aspects internationaux
Niklaus Olibet (coordination)
Développements internationaux
Vinzenz Jung, Anton Kohler, Niklaus Olibet, Hubert Poffet, Daniel Zulauf
Comparaisons internationales
Vinzenz Jung, Niklaus Olibet
■ Services de traduction Français: Christiane Bokor, Pierre-Yves Barrelet, Yvan Bourquard, Giovanna Mele, Paule Valiquer, Magdalena Zajac
Allemand: Yvonne Arnold
Italien: Patrizia Vanini, Simona Stückrad
■ Internet Denise Vallotton
■ Soutien technique Hanspeter Leu, Peter Müller
303
304
A N N E X E A1 ■■■■■■■■■■■■■■■■ Annexe Tableaux Structures A2 Tableaux Marchés A4 Tableaux Résultats économiques A14 Tableaux Dépenses de la Confédération A27 Tableaux Aspects internationaux A55 Cartes paiements directs A60 Textes légaux relevant du domaine de l‘agriculture A72 Définitions et méthodes A75 Abréviations A93 Bibliographie A95
■■■■■■■■■■■■■■■■ Tableaux Structures
A2 A N N E X E
Tableau 1
Exploitations Surface agricole utile Unités de gros bétail Classes de grandeur, en ha de surface 1990 1996 2000 1990 1996 2000 1990 1996 2000 agricole utile nombre nombre nombre ha ha ha nombre nombre nombre 0-1 6 629 5 054 3 609 2 895 2 123 1 336 82 550 54 588 61 016 1-3 13 190 7 113 4 762 23 828 12 614 8 861 34 466 22 522 14 753 3-5 8 259 6 926 5 393 32 243 27 004 21 348 42 473 34 355 27 714 5-10 18 833 15 148 13 149 141 403 113 654 99 056 209 784 156 778 127 361 10-15 18 920 15 907 13 812 233 888 197 421 171 817 341 563 273 225 230 628 15-20 12 710 11 970 11 172 218 771 207 194 193 856 290 523 268 163 247 517 20-25 6 677 7 248 7 244 147 772 161 294 161 311 173 896 187 984 191 057 25-30 3 364 4 143 4 430 91 271 112 886 121 005 97 680 120 265 130 901 30-40 2 674 3 669 4 168 90 726 124 930 142 266 87 709 119 097 142 628 40-50 875 1 351 1 591 38 672 59 904 70 501 32 214 50 956 61 914 50-70 507 728 921 28 849 41 226 52 672 23 172 32 761 42 707 70-100 127 166 209 10 371 13 287 17 021 7 414 9 490 13 290 > 100 50 56 77 7 802 9 339 11 444 6 315 6 005 8 025 Total 92 815 79 479 70 537 1 068 490 1 082 876 1 072 492 1 429 759 1 336 189 1 299 511 Source: OFS
Exploitations, surface agricole utile et unités de gros bétail
Tableau 2
Evolution de l'emploi dans l'agriculture
A N N E X E A3
Catégorie Main-d'oeuvre à plein temps Main-d'oeuvre à temps partiel Total 1990 1996 2000 1990 1996 2000 1990 1996 2000 Chef d'exploitation hommes 62 720 59 560 49 339 26 169 20 831 25 385 88 889 80 391 74 724 femmes 1 456 1 505 524 2 470 1 375 1 822 3 926 2 880 2 346 Autres collaborateurs familiaux hommes 21 796 13 828 8 749 22 729 25 118 18 212 44 525 38 946 26 961 femmes 14 367 22 043 14 281 65 770 36 634 47 665 80 137 58 677 61 946 Collaborateurs familiaux total 100 339 96 936 72 893 117 138 83 958 93 084 217 477 180 894 165 977 Colalborateurs suisses non familiaux hommes 12 453 11 435 10 836 2 949 5 125 15 402 11 435 15 961 femmes 3 200 2 851 2 592 3 304 4 976 4 194 6 504 7 827 6 786 Etrangers hommes 10 910 8 726 8 061 1 758 4 949 3 454 12 668 13 675 11 515 femmes 663 1 528 1 613 847 3 602 1 941 1 510 5 130 3 554 Collaborateurs non familiaux total 27 226 24 540 23 102 8 858 13 527 14 714 36 084 38 067 37 816 Main-d'oeuvre total 127 565 121 476 95 995 125 996 97 485 107 798 253 561 218 961 203 793 Source: OFS
■■■■■■■■■■■■■■■■ Tableaux Marchés
Tableau 3
Surface agricole utile d'après l'affectation
A4 A N N E X E
Produit 1990/92 1998 1999 2000 1 1990/92–1998/2000 ha ha ha ha % Céréales 207 292 186 867 182 257 182 669 -11 3 Céréales panifiables 102 840 100 962 97 542 99 259 -3 5 Blé 96 173 95 917 92 861 94 109 -2 0 Epeautre 2 160 1 542 1 221 1 467 -34 7 Seigle 4 432 3 367 3 433 3 643 -21 5 Méteil de céréales panifiables 75 136 27 41 -9 3 Céréales fourragères 104 453 85 905 84 715 83 411 -18 9 Orge 59 695 49 020 48 942 45 741 -19 8 Avoine 10 434 7 198 5 866 5 067 -42 1 Méteil de céréales fourragères 238 540 211 291 45 9 Maïs-grain 25 739 21 046 21 647 22 006 -16 2 Triticale 8 347 8 101 8 049 10 306 5 7 Légumes à cosse 2 258 2 866 2 950 2 892 28 5 Pois fourragers (protéagineux) 2 112 2 468 2 680 2 581 22 0 Féveroles 146 398 270 275 114 8 Lupins 36Plantes sarclées 36 385 34 183 34 429 34 775 -5 3 Pommes de terre (plants compris) 18 333 13 883 13 740 14 153 -24 0 Betteraves sucrières 14 308 16 675 17 450 17 725 20 8 Betteraves fourragères (semi-sucrières) 3 744 3 625 3 239 2 897 -13 1 Oléagineux 18 203 19 449 18 914 17 618 2 5 Colza 16 730 15 169 14 865 13 112 -14 0 Tournesol - 1 396 1 776 3 554Soja 1 474 2 884 2 273 952 38 2 Matières premières renouvelables - 1 631 1 728 1 413Colza - 1 531 1 576 1 231Autres (kénaf, chanvre etc ) - 100 152 182Légumes de plein champ 8 250 8 076 8 189 8 459 -0 1 Maïs vert et d'ensilage 38 204 40 997 40 475 40 486 6 4 Jachères vertes et florales 319 4 375 3 424 2 510 978 3 Autres terres ouvertes 830 917 1 581 1 725 69 5 Terres ouvertes 311 741 299 361 293 947 292 548 -5 3 Prairies artificielles 94 436 113 116 115 933 115 490 21.6 Autres terres assolées 3 977 2 967 3 009 2 920 -25 4 Terres assolées, total 410 154 415 444 412 889 410 958 0 7 Cultures fruitières 7 162 7 210 7 172 6 984 -0 6 Vignes 14 987 14 991 15 042 15 058 0 3 Roseau de Chine 3 274 260 267 8800 0 Prairies naturelles, pâturages 638 900 632 428 626 799 629 416 -1 5 Autre affection et litière et tourbe 7 394 8 058 9 737 9 809 24 4 Surface agricole utile 1 078 600 1 078 405 1 071 899 1 072 492 -0 4 1 Provisoire Sources: USP, OFS
1 Moyenne des années 1990/93
2 Variation entre 1990/93 et 1997/2000
Sources:
Lait et produits laitiers: USP (1990-98) dès 1999 TSM
Viande: Proviande
Oeufs: GalloSuisse
plantes sarclées et oléagineux: USP toutes les quantités 2000 provisoires
Fruit-Union Suisse
Centrale suisse de la culture maraîchère
OFAG cantons
A N N E X E A5 Tableau
Production Produit Unité 1990/92 1998 1999 2000 1990/92–1998/2000 % Lait et produits laitiers Lait de consommation t 549 810 488 486 438 000 508 918 -13 0 Crème t 68 133 66 400 70 400 67 770 0 1 Beurre t 38 766 40 800 37 238 36 611 -1 4 Poudre de lait t 35 844 34 468 35 534 42 361 4 5 Fromage t 134 400 136 800 134 306 167 382 8 8 Viande et oeufs Viande de boeuf t PM 130 710 110 788 110 435 95 700 -19 2 Viande de veau t PM 36 656 36 715 36 419 32 619 -3 8 Viande de porc t PM 266 360 231 574 225 657 224 901 -14 6 Viande de mouton t PM 5 065 6 078 6 316 5 528 18 0 Viande de chèvre t PM 541 514 494 550 -3 9 Viande de cheval t PM 1 212 1 353 1 196 1 265 4 9 Volaille t pouds de vente 20 733 25 608 26 367 28 406 29 2 Oeufs en coquille mio de pces 638 691 680 652 5 6 Céréales Blé tendre t 546 733 594 098 489 813 561 200 0 3 Seigle t 22 978 22 306 18 538 22 400 -8 3 Orge t 341 774 329 732 254 093 274 100 -16 3 Avoine t 52 807 39 855 27 996 26 300 -40 6 Maïs-grain t 211 047 191 813 194 321 212 400 -5 5 Triticale t 43 940 51 048 43 779 64 100 20 6 Autres t 11 469 12 123 6 678 9 000 -19 2 Plantes sarclées Pommes de terre t 833 333 560 000 484 000 600 636 -34 2 Betteraves sucrières t 925 867 1 126 125 1 187 334 1 409 959 34 1 Oléagineux Colza t 46 114 47 167 38 376 39 060 -9 9 Autres t 3 658 11 604 12 552 15 267 259 2 Fruits (de table) Pommes t 91 503 1 100 936 90 161 103 693 5 5 2 Poires t- 15 437 14 808 16 081Abricots t 3 407 1 3 144 2 341 2 845 -28 6 2 Cerises t 1 818 1 2 142 942 2 205 -21 0 2 Pruneaux t 2 837 1 2 803 2 397 2 369 -13 9 2 Fraises t 4 263 5 162 5 065 5 111 19 9 Légumes (frais) Carottes t 49 162 55 145 57 746 51 389 11 4 Oignons t 23 505 24 468 27 529 27 368 12 6 Céleris-raves t 8 506 8 752 8 686 10 093 7 9 Tomates t 21 830 29 951 27 384 30 932 34 8 Laitues pommées t 18 821 20 110 15 877 17 086 -6 0 Coux-fleurs t 8 331 7 509 6 666 6 701 -16 5 Concombres t 8 608 9 076 8 881 8 371 2 0 Vin Vin rouge hl 550 276 547 620 591 410 605 975 5 7 Vin blanc hl 764 525 624 621 718 256 669 746 -12 2
4
Céréales,
Fruits:
Légumes:
Vin:
Tableau 5
A6 A N N E X E
Production
Produit 1990/92 1998 1999 2000 1990/92–1998/2000 tttt% Total fromage 134 400 136 800 134 306 167 382 8 8 Fromages frais 4 387 11 343 13 093 35 101 352 4 Mozzarella - 8 495 9 634 11 582Autres fromages frais - 2 848 3 459 23 519Fromages à pâte molle 4 812 5 230 5 851 6 618 22 6 Tommes 1 249 1 694 1 054 737 -7 0 Fromages à pâte persillée, mi-gras à gras 1 573 1 191 1 909 2 141 11 1 Autres fromages à pâte molle 1 990 2 345 2 888 3 740 50 3 Fromages à pâte mi-dure 40 556 41 492 44 293 45 928 8 3 Appenzell 8 725 8 664 8 878 8 813 0 7 Tilsit 7 736 6 385 6 103 6 260 -19 2 Fromage à raclette 9 898 11 033 11 123 12 993 18 4 Autres fromages à pâte mi-dure 14 197 15 410 18 189 17 862 20 8 Fromages à pâte dure 84 629 78 727 70 824 79 240 -9 9 Emmental 56 588 47 988 41 637 45 325 -20 5 Gruyère 22 464 25 776 24 566 26 209 13 6 Sbrinz 4 659 3 713 3 090 3 303 -27 7 Autres fromages à pâte dure 918 1 250 1 531 4 403 160 9 Spécialités 1 15 8 245 494 1560 0 Total produits laitiers frais 680 822 625 702 612 900 697 769 -5 2 Lait de consommation 549 810 488 486 438 000 508 918 -13 0 Autres 131 012 137 216 174 900 188 851 27 5 Total beurre 38 766 40 800 37 238 36 611 -1.4 Beurre de choix 27 200 34 400 33 222 7 142 -8 4 Autres 11 566 6 400 4 016 29 469 14 9 Total crème 68 133 66 400 70 400 67 770 0 1 Total poudre de lait 35 844 34 468 35 534 42 361 4 5 1 Fromages de brebis et de chèvre purs Sources: USP, TSM Tableau 6 Mise en valeur du lait commercialisé Produit 1990/92 1998 1999 2000 1990/92–1998/2000 1 000 t de lait 1 000 t de lait 1 000 t de lait 1 000 t de lait % Lait de consommation 549 488 438 462 -15 7 Lait transformé 2 490 2 594 2 633 2 714 6 3 en fromage 1 531 1 545 1 503 1 410 -2 9 en beurre 356 402 337 459 12 2 en crème 430 438 460 252 -10 9 en d'autres produits laitiers 173 209 333 593 118 7 Total 3 039 3 082 3 071 3 176 2.3 Sources: USP TSM
de produits laitiers
Tableau 7
Mise en valeur de la récolte de la production végétale
1 Mise en valeur de céréales panifiables par année civile
2 Moyenne des années 1990/93
3 Variation entre 1990/93 et 1997/2000
4 Les chiffres y relatifs ne seront donc disponibles qu ' en 2002
5 Variation entre 1990/93 et 1996/99
Sources:
Céréales panifiables: OFAG
Pommes de terre: Régie fédérale des alcools, swisspatat
Fruits à cidre: OFAG; Spiritueux: Régie fédérale des alcools
Légumes destinés à la transformation: Centrale suisse de la culture maraîchère
A N N E X E A7
Produit 1990/92 1998 1999 2000 1990/92–1998/2000 tttt% Céréales panifiables 1 Prise en charge Confédération 569 000 576 799 460 894 547 100 -7 2 Variation de stocks - 26 333 - 18 100 - 11 800 0 -62 2 Alimentation humaine 399 000 394 700 389 700 391 900 -1 7 Affouragement 196 333 199 400 171 400 155 200 -10 7 Pommes de terre Pommes de terre de table 285 300 173 400 170 700 167 600 -40 2 Pommes de terre destinées à la transformation 114 700 121 400 121 900 120 900 5 8 Plants 35 933 22 300 27 000 31 200 -25 3 Affouragement à l'état frais 225 967 208 100 8 181 600 -42 5 Transformation en aliments pour animaux 146 900 27 900 23 400 76 000 -71 1 Pommes et poires à cidre suisses (transformation dans des cidreries artisanales) 183 006 2 315 803 103 609 256 352 3 8 3 Quantité de fruits à cidre pour jus brut 182 424 2 315 575 103 172 256 142 4 0 3 fraîchement pressés 10 477 2 8 429 7 620 8 621 -23 9 3 cidre de fruits destiné à la fabrication d'eau-de-vie de fruits 3 297 2 3 539 548 806 -59 6 3 concentré de jus 165 263 2 295 775 92 398 246 482 6 9 3 autres jus (vinaigre compris) 3 387 2 7 832 2 606 234 9 7 3 Fruits foulés 582 2 228 437 209 -53 8 3 Fabrication de spiritueux à base de pommes et de poires suisses 40 255 2 39 876 23 458 4 -23 3 5 à base de cerises et de pruneaux suisses 23 474 2 23 678 11 938 4 -26 3 5 Légumes frais suisses destinés à la fabrication de denrées alimentaires Légumes congelés 26 061 22 004 26 855 26 209 -4 0 Légumes en conserve (haricots, petits pois, carottes parisiennes) 19 776 12 190 15 258 15 770 -27 2 Choucroute (choux à choucroute) 8 091 6 101 5 894 6 885 -22 2 Raves d'automne 1 535 1 221 1 182 1 117 -23 6
1 Moyenne des années 1990/93
2 Variation entre 1990/93 et 1997/2000
Sources: Lait et produits laitiers, oeufs, céréales, plantes sarclées, oléagineux, fruits, légumes et vin: DGD
Viande: Proviande
Sucre: Office fiduciaire des importateurs suisses de denrées alimentaires
A8 A N N E X E Tableau 8 Commerce extérieur Produit 1990/92 1998 1999 2000 1990/92–1998/2000 tttt% Exporta- Importa- Exporta- Importa- Exporta- Importa- Exporta- Importa- Exporta- Importations tions tions tions tions tions tions tions tions tions Lait et produits laitiers Lait 19 23 007 46 22 988 30 22 795 24 23 017 72 7 -0 3 Yoghourt 1 195 17 925 78 1 156 110 2 694 101 33 2 466 7 Crème 909 25 1 523 8 1 559 6 1 509 166 68 4 137 2 Beurre 0 4 154 0 4 136 17 4 987 31 7 370 - 32 3 Poudre de lait 8 158 3 266 2 884 4 289 17 768 2 584 13 992 1 606 41 6 -13 5 Fromage 62 483 27 328 56 474 30 548 63 359 31 208 53 880 30 829 -7 3 12 9 Viande et oeufs Viande de boeuf 1 994 9 668 3 527 8 973 3 954 9 601 2 645 12 824 69 3 8 3 Viande de veau 0 916 0 586 0 1 345 0 2 007 - 43 4 Viande de porc 1 055 4 185 806 14 543 1 064 15 167 780 15 653 -16 3 261 3 Viande de mouton 5 6 093 0 6 157 0 5 611 0 7 616 -100 0 6 0 Viande de chèvre 0 403 0 503 0 413 0 453 - 13 1 Viande de cheval 0 4 609 0 4 041 0 3 884 0 3 922 - -14 3 Volaille 8 35 238 302 39 962 448 37 562 324 38 348 4569 6 9 6 Oeufs 0 31 401 0 22 589 0 23 281 0 23 579 - -26 3 Céréales Blé 6 232 134 49 184 617 86 249 619 25 298 922 738 7 5 3 Seigle 0 3 057 75 2 261 0 10 233 3 10 435 - 150 1 Orge 436 44 504 141 22 893 1 11 491 0 74 732 -89 1 -18 3 Avoine 131 60 885 1 555 38 624 0 23 411 0 45 863 295 9 -40 9 Maîs-grain 194 60 512 70 47 523 78 29 428 68 24 981 -62 9 -43 9 Plantes sarclées Pommes de terre 9 695 8 722 1 647 16 336 1 702 42 361 818 39 142 -85 7 273 9 Sucre 41 300 124 065 91 068 109 063 119 084 137 404 140 971 178 106 183 4 14 1 Oléagineux Oléagineux 453 135 456 834 151 083 830 135 408 923 136 229 90 1 4 0 Huiles et graisses végétales 18 680 57 765 13 227 83 636 15 426 84 021 18 127 86 735 -16 5 46 8 Fruits (frais) Pommes 683 1 12 169 1 185 9 385 3 125 6 295 367 9 164 86 8 2 -30 9 2 Poires 491 1 11 803 1 178 10 671 369 8 529 141 7 857 -53 9 2 -22 2 2 Abricots 226 1 10 578 1 56 8 866 3 12 199 62 9 322 -81 4 2 1 2 2 Cerises 256 1 1 062 1 269 924 7 1 567 22 1 134 -68 4 2 19 5 2 Prunes et pruneaux 12 1 3 290 1 53 3 241 0 4 678 0 4 370 25 0 2 25 0 2 Fraises 150 11 023 12 11 880 11 11 823 23 11 576 -89 8 6 7 Raisins 23 33 691 3 35 034 0 36 969 10 39 888 -81 4 10 7 Agrumes 161 135 780 21 129 626 49 122 668 11 124 099 -83 2 -7 6 Bananes 85 77 896 1 72 684 0 74 554 0 72 334 -99 6 -6 0 Légumes (frais) Carottes 71 1 710 0 7 140 185 5 867 21 6 089 -3 3 272 2 Oignons 862 3 444 1 8 257 3 5 644 0 4 756 -99 8 80 6 Céleris-raves 0 206 0 56 0 831 0 119 0 0 62 5 Tomates 402 35 700 1 39 772 56 42 138 41 42 392 -91 9 16 1 Laitues pommées 37 3 954 0 2 575 1 3 244 0 2 453 -99 1 -30 3 Choux-fleurs 11 9 985 14 9 331 0 9 503 3 9 261 -50 0 -6 2 Concombres 65 17 479 19 17 050 0 17 996 2 17 225 -89 2 -0 3 Vin de bouche Vin rouge (hl) 3 499 1 494 294 7 992 1 480 708 8 814 1 474 733 7 470 1 424 552 131 3 -2 3 Vin blanc (hl) 7 590 76 835 5 260 168 542 4 681 175 844 5 174 177 643 -33 6 126 5
A N N E X E A9 Tableau 9 Commerce extérieur fromage Produit 1990/92 1998 1999 2000 1990/92–1998/2000 tttt% Importations Fromages frais 1 4 175 8 280 8 485 8 491 101 7 Fromages râpés 2 233 271 333 312 31 2 Fromages fondus 3 2 221 2 499 2 550 2 527 13 7 Fromages à pâte persillée 4 2 276 2 306 2 414 2 346 3 5 Fromages à pâte molle 5 6 628 5 502 5 618 5 664 -15 6 Fromages à pâte mi-dure 6 11 795 5 722 5 234 4 617 Fromages à pâte dure 7 5 970 6 574 6 872 -1 2 Total fromages et séré 27 328 30 548 31 208 30 829 12 9 Exportations Fromages frais 1 21 10 29 558 3 Fromages râpés 2 104 103 156 130 24 3 Fromages fondus 3 8 245 6 532 6 733 6 020 -22 0 Fromages à pâte persillée 4 029 16Fromages à pâte molle 5 30 52 50 64 83 3 Fromages à pâte mi-dure 6 54 102 7 072 6 944 7 033 Fromages à pâte dure 7 42 712 49 457 40 588 -5 2 Total fromages et séré 62 483 56 474 63 359 53 880 -7 3 1 0406 1010 0406 1020 406 1090 2 0406 2010, 0406 2090 3 0406 3010 0406 3090 4 0406 4010, 0406 4021, 0406 4029, 0406 4081, 0406 4089 5 0406 9011 0406 9019 6 0406 9021, 0406 9031, 0406 9051, 0406 9091 7 0406 9039 0406 9059 0406 9060 0406 9099 Source: DGD
Tableau 10
Consommation par habitant
1 Moyenne des années 1990/93
2 Variation entre 1990/93 et 1997/2000
Sources:
Lait et produits laitiers oeufs plantes sarclées et oléagineux: USP 2000 chiffres partiellement provisoires
Proviande
OFAE
A10 A N N E X E
Produit 1990/92 1998 1999 2000 1990/92–1998/2000 kg kg kg kg % Lait et produits laitiers Lait de consommation 104 37 91 00 86 60 88 80 -14 9 Crème 6 43 6 40 6 70 6 20 0 0 Beurre 6 20 6 20 5 90 5 90 -3 2 Fromage 14 73 15 50 15 60 16 60 7 9 Fromages frais 1 50 2 70 2 90 3 30 97 8 Fromages à pâte molle 1 83 1 80 1 80 1 90 0 0 Fromages à pâte mi-dure 6 17 5 80 5 60 5 50 -8 6 Fromages à pâte dure 5 20 5 20 5 30 5 90 5 1 Viande et oeufs Viande de boeuf 13 71 11 25 11 53 10 30 -19 6 Viande de veau 4 25 4 04 4 08 3 73 -7 0 Viande de porc 29 73 26 28 25 63 25 43 -13 3 Viande de mouton 1 42 1 49 1 43 1 61 6 3 Viande de chèvre 0 12 0 13 0 11 0 12 -2 7 Viande de cheval 0 75 0 66 0 62 0 62 -15 9 Volaille 8 05 9 03 8 71 9 04 10 8 Oeufs en coquille (pces) 199 190 195 181 -5 2 Céréales Pain, articles de boulangerie 50 70 52 1 52 7 51 7 2 9 Plantes sarclées Pommes d t et produits à base de pommes d t 44 17 43 1 53 80 44 00 6 3 Sucre (y compris sucre contenu dans des produits transformés) 42 37 40 1 41 70 43 50 -1 4 Oléagineux Huiles et graisses végétales 12 80 14 5 14 3 14 50 12 8 Fruits (de table) Pommes 15 26 1 15 51 12 96 15 62 -5 4 2 Poires - 3 65 3 16 3 31Abricots 2 04 1 1 68 2 02 1 68 -10 7 2 Cerises 0 39 1 0 39 0 35 0 46 -8 3 2 Prunes et pruneaux 0 91 1 0 84 0 98 0 94 0 9 2 Fraises 2 24 2 40 2 34 2 31 4 9 Agrumes 20 09 18 25 17 03 17 23 -12 9 Bananes 11 53 10 24 10 35 10 05 -11 4 Légumes (frais) Carottes 7 53 8 77 8 81 7 98 13 2 Oignons 3 86 4 61 4 61 4 46 18 0 Céleris-raves 1 29 1 24 1 32 1 42 2 8 Tomates 8 46 9 82 9 65 10 18 16 8 Laitues pommées 3 37 3 20 2 66 2 71 -15 2 Choux-fleurs 2 71 2 37 2 25 2 22 -15 9 Concombres à salade 3 85 3 68 3 73 3 55 -5 2 Vin Vin rouge (l) 31 97 28 50 28 70 28 80 -10 3 Vin blanc (l) 14 47 12 50 12 80 12 70 -12 4 Vin total (l) 46 43 41 00 41 50 41 50 -11 0
Viande:
Céréales:
Fruits, légumes et
OFAG
vin:
Tableau 11
Prix à la production
1 Moyenne des années 1990/93
2 Variation entre 1990/93 et 1997/2000
3 Solde de paiements non compris: prix effectif supérieur de 10 à 15%
Sources:
Lait: OFAG
Bétail de boucherie, volaille, oeufs: USP
Céréales, cultures sarclées et oléagineux: FAT
Fruits: Fruit-Union Suisse
Légumes: Centrale suisse de la culture maraîchère
A N N E X E A11
Produit Unité 1990/92 1998 1999 2000 1990/92–1998/2000 % Lait CH total ct /kg 104 97 82 10 80 93 79 41 -23 0 Lait transformé en fromage (dès 1999) ct /kg 79 96 79 14Lait biologique (dès 1999) ct /kg 91 55 94 05Bétail de boucherie Vaches T3 fr /kg PM 7 82 4 75 4 90 6 54 -31 0 Vaches X3 fr /kg PM 7 53 3 66 3 77 5 02 -44 9 Jeunes vaches T3 fr /kg PM 8 13 5 18 6 40 7 73 -20 8 Taureaux T3 fr /kg PM 9 28 7 38 7 77 8 90 -13 7 Boeufs T3 fr /kg PM 9 83 7 38 7 90 8 79 -18 3 Génisses T3 fr /kg PM 8 66 6 85 7 37 8 67 -11 9 Veaux T3 fr /kg PM 14 39 11 36 11 03 13 13 -17 7 Porcs à viande fr /kg PM 5 83 4 80 4 38 4 69 -20 7 Agneaux jusqu'au 40 kg, T3 fr /kg PM 15 40 13 47 11 46 12 60 -18 8 Volaille et oeufs Poulets cl l, à la ferme fr /kg PV 3 72 2 97 2 84 2 81 -22 8 Oeufs issus d'un élevage au sol, au magasin fr /100 pces 41 02 43 61 42 86 41 47 4 0 Oeufs issus d'un élevage avec parcours, au magasin fr /100 pces 46 21 50 42 49 01 54 29 10 9 Oeufs vendus au centre collecteur >53 g fr /100 pces 33 29 24 33 22 21 20 98 -32 4 Céréales Blé fr /100 kg 99 34 75 65 75 41 66 35 -27 0 Seigle fr /100 kg 102 36 62 69 62 77 51 82 -42 3 Orge fr /100 kg 70 24 50 13 48 83 48 52 -30 0 Avoine fr /100 kg 71 40 47 68 48 83 48 23 -32 4 Triticale fr /100 kg 70 69 49 45 49 44 48 61 -30 5 Maîs-grain fr /100 kg 73 54 53 21 51 91 47 65 -30 8 Plantes sarclées Pommes de terre fr /100 kg 38 55 35 27 37 76 36 12 -5 6 Betteraves sucrières fr /100 kg 14 84 13 99 11 85 11 58 -15 9 Oléagineux Colza fr /100 kg 203 67 147 89 146 11 61 26 3 -41 9 Soja fr /100 kg 204 67 162 14 164 58 50 71 3 -38 5 Fruits Pommes: Golden Delicious I fr / kg 1 12 1 0 60 1 06 0 86 -24 8 2 Pommes: Idared I fr / kg 0 98 1 0 45 0 82 0 55 -31 1 2 Poires: Conférence fr / kg 1 33 1 0 78 1 09 0 88 -19 7 2 Abricots fr / kg 2 09 1 2 28 2 66 2 17 16 9 2 Cerises fr / kg 3 20 1 3 30 3 05 3 30 5 1 2 Pruneaux: Fellenberg fr / kg 1 40 1 1 40 1 40 1 50 4 5 2 Fraises fr / kg 4 77 4 40 4 80 4 80 -2 1 Légumes Carottes (de garde) fr /kg 1 09 1 18 1 05 1 15 3 4 Oignons (de garde) fr /kg 0 89 1 03 0 96 1 02 12 7 Céleris-raves (de garde) fr /kg 1 62 1 41 1 84 1 63 0 2 Tomates rondes fr /kg 2 42 1 89 1 92 2 15 -17 9 Laitues pommées fr /kg 2 37 2 20 2 89 2 72 9 8 Choux-fleurs fr /kg 1 85 1 78 1 88 1 88Concombres à salade fr /kg 1 66 1 66 1 73 1 97 7 8
Tableau 12
Prix à la consommation
A12 A N N E X E
Produit Unité 1990/92 1998 1999 2000 1990/92–1998/2000 % Lait et produits laitiers Lait entier pasteurisé, emballé fr /l 1 85 1 66 1 58 1 55 -13 7 Lait «drink» pasteurisé, emballé fr /l 1 85 1 66 1 58 1 54 -13 9 Lait écréme UHT fr /l - 1 55 1 48 1 42Emmental fr /kg 20 15 20 65 20 66 20 18 1 7 Gruyère fr /kg 20 40 20 93 20 67 20 17 0 9 Tilsit fr /kg - 17 76 17 49 17 47Camembert 45% (MG/ES) 125 g - 2 58 2 54 2 54Fromages à pâte molle, persillée 150 g - 2 34 3 34 3 36Mozzarella 45% (MG/ES) 150 g - 2 35 2 32 2 30Beurre de choix 200 g 3 46 3 01 2 89 2 97 -14 5 Le Beurre (beurre de cuisine) 250 g 3 44 3 00 2 92 2 94 -14 1 Crème entière, emballée 1/2 l - 5 44 5 19 4 83Crème à café, emballée 1/2 l - 2 75 2 62 2 49Yoghourt, aromatisé ou contenant des fruits 180 g 0 89 0 73 0 71 0 69 -20 2 Viande de boeuf Entrecôtes, en tranches fr /kg 48 36 44 36 45 68 50 14 -3 4 Steak fr /kg 37 59 33 69 34 76 39 24 -4 5 Rôti d'épaule fr /kg 26 34 23 52 24 09 27 73 -4 7 Viande hachée fr /kg 15 00 13 61 13 42 15 29 -6 0 Viande de por Ia Côtelettes, coupées fr /kg 35 32 37 07 35 84 40 77 7 3 Rôti d'épaule fr /kg 32 56 31 01 30 80 34 96 -0 9 Ragoût fr /kg 21 67 25 46 24 67 28 68 21 2 Viande de porc Ia Côtelettes, coupées fr /kg 19 88 17 91 18 26 19 80 -6 2 Steak fr /kg 24 48 24 44 22 38 24 58 -2 8 Rôti d'épaule fr /kg 18 43 17 60 16 75 18 60 -4 2 Ragôut, poitrine fr /kg 16 69 17 29 15 75 17 39 0 7 Viande d'agneau suisse, fraîche Gigot, sans l'os du bassin fr /kg 26 34 26 68 27 10 27 15 2 4 Côtelettes, coupées fr /kg 30 32 31 69 31 57 32 66 5 4 Produits carnés Jambon de derrière modél, coupé fr /kg 25 56 27 23 26 18 27 13 5 0 Salami suisse I, coupé fr /100 g 3 09 3 35 3 42 3 75 13 4 Poulets suisses, frais fr /kg 8 41 8 42 8 43 8 49 0 4 Production végétale et produits végétaux Farine blanche fr /kg 2 05 1 80 1 80 1 75 -13 0 Pain bis fr /500 g 2 08 2 00 1 98 1 82 -7 1 Pain mi-blanc fr /500 g 2 09 2 05 2 02 1 83 -5 9 Petits pains fr /pces 0 62 0 75 0 75 0 70 18 3 Croissants fr /pces 0 71 0 87 0 89 0 84 22 1 Spaghettis fr /500 g 1 66 1 39 1 43 1 54 -12 4 Pommes de terre fr /kg 1 43 1 66 1 77 1 87 23 5 Sucre cristallisé fr /kg 1 65 1 52 1 50 1 41 -10 5 Huile de tournesol fr /l 5 05 4 44 4 46 3 96 -15 1 Fruits (suisses et étrangers) Pommes: Golden Delicious fr /kg 3 15 1 3 10 2 98 3 40 0 4 2 Poires fr /kg 3 25 1 3 32 3 26 3 36 2 2 2 Abricots fr /kg 3 93 1 4 73 4 24 4 69 15 0 2 Cerises fr /kg 7 35 1 8 24 8 13 8 89 14 5 2 Pruneaux fr /kg 3 42 1 3 46 3 22 3 46 0 4 2 Fraises fr /kg 8 69 9 51 9 44 9 59 9 5 Légumes (consommation à l'état frais; suisses et étrangers) Carottes (de garde) fr /kg 1 91 1 87 1 78 1 78 -5 2 Oignons (de garde) fr /kg 1 86 2 14 2 03 1 94 9 5 Céleris-raves (de garde) fr /kg 3 14 3 32 3 67 3 36 9 9 Tomates rondes fr /kg 3 73 3 31 3 18 3 50 -10 7 Laitues pommées fr /kg 4 46 4 39 5 15 5 25 10 5 Choux-fleurs fr /kg 3 58 3 49 3 59 3 58 -0 8 Concombres à salade fr /kg 2 80 2 88 2 86 3 14 5 7
Moyenne des années 1990/93
Variation entre 1990/93 et 1997/2000 Sources: Lait, viande: OFAG Production végétale et produits végétaux: OFAG, OFS
1
2
Tableau 13
Taux d’auto-approvisionnement
1 Produits de meunerie et blé germé sur pied compris, mais sans les tourteaux; les modifications des réserves ne sont pas prises en considération
2 Blé dur, avoine, orge et maïs compris
3 Pommes, poires, cerises, prunes et pruneaux, abricots et pêches
4 Part de la production suisse dans le poids de la viande prête à la vente et des produits carnés
5 Viande chevaline et caprine, lapins, gibier, poissons, crustacés et mollusques compris
6 Energie digestible en joules, boissons alcoolisées comprises
7 Sans les produits animaux à base d’aliments pour animaux importés
8 Valeur calculée aux prix aux producteurs pour la production suisse et les importations aux prix selon la statistique commerciale (franco frontière non dédouanés)
Source: USP
A N N E X E A13
Produit 1990/92 1997 1998 1999 1990/92–1997/99 % Part en termes de volume: %%%% Blé panifiable 118 108 120 99 -9 0 Céréales fourragères 1 61 72 73 70 10 7 Total céréales 2 64 67 69 62 2 0 Pommes de terre de table 101 94 100 82 -9 0 Sucre 46 62 60 58 14 0 Graisses et huiles végétales 22 23 21 18 -1 3 Fruits 3 72 71 82 68 1 7 Légumes 55 56 54 52 -1 0 Lait de consommation 97 97 97 97 0 0 Beurre 89 89 92 88 0 7 Fromage 137 129 126 123 -11 0 Milch und Milchprodukte total 110 110 110 111 0 3 Kalbfleisch 4 97 99 98 95 0 3 Rindfleisch 4 93 98 92 88 -0 3 Schweinefleisch 4 99 90 93 92 -7 3 Schaffleisch 4 39 42 43 46 4 7 Geflügel 4 37 41 39 42 3 7 Viande de toutes sortes 45 76 72 71 70 -5 3 Oeufs et conserves d’œufs 44 49 49 47 4 3 Part en termes d'énergie alimentaire 6 : Denrées alimentaires végétales 43 44 47 40 0 7 Denrées alimentaires en tout, brutes 97 95 95 95 -2 0 Denrées alimentaires en tout, brutes 60 62 64 58 1 3 Denrées alimentaires en tout, nettes 7 58 54 56 54 -3 3 Part en termes de valeur denrées alimentaires en tout 8 72 66 65 63 -7 3
■■■■■■■■■■■■■■■■
Tableaux Résultats économiques
Tableau 14
Production finale de l'agriculture aux prix courants, en 1000 fr
A14 A N N E X E
Produit 1990/92 1998 1999 1 2000 2 1990/92 – 2001 3 1998/2000–1998/2000 2001 %% Céréales 807 539 658 938 515 434 527 000 -29 8 421 000 -25 8 Légumineuses 1 318 1 134 976 1 075 -19 4 800 -24 6 Pommes de terre 231 342 162 636 165 299 169 000 -28 4 164 000 -1 0 Betteraves sucrières 141 784 154 526 139 138 155 000 5 5 138 800 -7 2 Oléagineux (colza, soja, tournesol) 102 033 89 879 78 587 40 000 -31 9 39 000 -43 9 Tabac 16 945 21 328 16 554 19 800 13 5 20 000 4 0 Légumes 379 455 422 262 404 782 435 000 10 9 435 000 3 4 Fruits et baies 371 296 381 521 293 435 349 500 -8 0 298 000 -12 7 Plantes fourr (foin, maïs d'ensilage, fourr verts, ) 14 077 8 359 - 8 445 15 000 -64 7 0 -100 0 Sous-produits de la production végétale 14 044 14 004 12 395 16 500 1 8 14 000 -2 1 Moût de vin 586 831 509 883 563 561 540 000 -8 4 530 000 -1 5 Autres produits végétaux 14 144 9 731 10 574 10 000 -28 6 10 000 -1 0 Plantes et produits végétaux 2 680 807 2 434 201 2 192 290 2 277 875 -14 2 2 070 600 -10 0 Bovins 1 580 377 952 107 958 042 1 139 000 -35 7 930 000 -8 5 Porcins 1 556 531 1 079 380 974 148 1 041 000 -33 7 1 029 000 -0 2 Equidés (chevaux, ânes, mulets) 20 475 22 165 5 759 5 900 -44 9 5 900 -47 7 Ovins 71 810 69 133 58 475 60 100 -12 9 68 000 8 7 Caprins 4 906 4 627 4 029 4 300 -12 0 3 700 -14 3 Volaille (poulets, dindes, canards, oies) 186 808 176 698 176 454 188 000 -3 4 188 000 4 2 Autres animaux (lapins, abeilles) 26 010 19 795 17 703 17 500 -29 5 17 000 -7 3 Lait 3 461 227 2 807 490 2 565 444 2 560 000 -23 6 2 598 000 -1 8 Oeufs 207 617 178 358 154 644 155 000 -21 7 153 500 -5 6 Laine 507 93 00 -93 9 0 -100 0 Miel 47 917 57 529 37 667 40 000 -6 0 42 000 -6 8 Autres produits animaux 5 042 4 349 3 971 4 400 -15 9 4 400 3 8 Animaux et produits animaux 7 169 228 5 371 724 4 956 336 5 215 200 -27 7 5 039 500 -2 7 Travaux agricoles à façon 52 400 87 888 90 420 90 000 70 7 90 000 0 6 Production finale totale 9 902 435 7 893 813 7 239 046 7 583 075 -23.5 7 200 100 -4.9 1 Chiffres provisoires état hiver 2000/2001 2 Estimation, état hiver 2000/2001 3 Estimation état été 2001 Source: USP
1 Si la TVA perçue sur les ventes de produits agricoles n 'est pas égale aux taxes versées sur les achats de consommation intermédiaire et les biens d'investissements, la différence est compensée dans les comptes économiques de l'agriculture Lorsque le montant perçu est supérieur à celui qui a été payé, on obtient une surcompensation, qui est considérée comme une recette supplémentaire Jusqu'à présent, on a cependant toujours enregistré une sous-compensation en Suisse
2 Installations fixes incluses
3 Chiffres provisoires, état hiver 2000/2001
4 Estimation, état hiver 2000/2001
5 Estimation, état été 2001
Source: USP
A N N E X E A15 Tableau 15 Comptes économiques de l'agriculture aux prix courants, en 1000 fr Caractéristique 1990/92 1998 1999 3 2000 4 1990/92– 2001 5 1998/2000–1998/2000 2001 %% Production finale 9 902 435 7 893 813 7 239 046 7 583 075 -23 5 7 200 100 -4 9 Consommation intermédiaire totale 4 172 848 3 855 446 3 796 404 3 922 500 -7 5 3 954 000 2 5 Semences et plants 235 204 215 502 222 353 213 000 -7 8 204 000 -6 0 Bétail 7 535 10 858 10 862 16 000 66 9 11 000 -12 5 Energie 397 171 421 653 437 145 481 000 12 4 480 000 7 5 Engrais 243 903 149 114 147 004 144 000 -39 9 153 000 4 3 Produits phytosanitaires 138 587 120 376 123 364 125 000 -11 3 126 000 2 5 Aliments pour animaux 1 721 238 1 474 221 1 447 754 1 516 000 -14 1 1 550 000 4 8 Matériel et entretien de machines 682 312 730 918 732 244 727 500 7 0 740 000 1 3 Entretien des bâtiments d'exploitation 182 658 136 711 132 770 136 000 -26 0 140 000 3 6 Services 564 240 596 093 542 908 564 000 0 6 550 000 -3 1 Valeur ajoutée brute aux prix du marché 5 729 587 4 038 367 3 442 642 3 660 575 -35 2 3 246 100 -12 6 Contributions des pouvoirs publics (subventions) 1 317 038 2 439 386 2 424 077 2 417 000 84 3 2 679 000 10 4 Surcompensation TVA 1 Impôts liés à la production 123 433 194 331 120 824 76 000 5 6 62 000 -52 4 Sous-compensation TVA 1 - 79 074 97 552 98 000 - 105 000 14 7 Valeur ajoutée brute au coût des facteurs 6 923 192 6 204 348 5 648 343 5 903 575 -14 5 5 758 100 -2 7 Amortissements totaux 2 030 896 1 852 603 1 836 788 1 859 000 -8 9 1 899 000 2 7 Amortissement des constructions 2 1 057 197 791 850 768 363 788 000 -26 0 809 000 3 4 Amortissement des machines 973 699 1 060 753 1 068 425 1 071 000 9 6 1 090 000 2 2 Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 4 892 296 4 351 745 3 811 555 4 044 575 -16 8 3 859 100 -5 2 Fermages et intérêts 844 689 700 485 690 883 729 000 -16 3 759 000 7 4 Fermages 227 754 225 485 225 427 224 000 -1 2 225 000 0 0 Intérêts 616 936 475 000 465 456 505 000 -21 9 534 000 10 8 Revenu net de l'activité agricole pour la 4 047 607 3 651 260 3 120 672 3 315 575 -16 9 3 100 100 -7 8 main-d'oeuvre totale Rémunération de la main-d'oeuvre non familiale 827 058 763 996 738 113 715 000 -10 6 715 000 -3 3 Revenu net de l'activité agricole pour la 3 220 549 2 887 264 2 382 559 2 600 575 -18 5 2 385 100 -9 1 main-d'oeuvre familiale
Tableau 16
Résultats d'exploitation: toutes les régions
(médiane)
1 Taux d'intérêt moyen des obligations de la Confédération (1990: 6 40%; 1991: 6 23%; 1992: 6 42%; 1997: 3 40%; 1998: 2 81%; 1999: 3 02%; 2000: 3 95%)
2 Investissements bruts (sans prestations propres), déduction faite des subventions et des désinvestissements
3 Formation de capital propre (sans prestations propres), plus amortissements, plus/moins changements stocks et actif bétail
4 Rapport entre cash flow et total des investissements
5 Part d’exploitations avec cash flow > total des investissements
6 Part de capitaux étrangers <50% et formation de capital propre positive
7 Part de capitaux étrangers >50% et formation de capital propre positive
8 Part de capitaux étrangers <50% et formation de capital propre négative
9 Part de capitaux étrangers >50% et formation de capital propre négative
10 Rapport entre revenu de l'exploitation et main-d'oeuvre de l'exploitation
11 Rapport entre revenu de l'exploitation et surface agricole utile
12 Rapport entre revenu de l'exploitation et actifs totaux
13 Rapport entre (service de la dette plus bénéfice/pertes calculés plus intérêts sur le capital propre) et actifs de l'exploitation
14 Rapport entre (bénéfice/pertes calculés plus intérêts sur le capital propre) et capital propre de l’exploitation
15 Rapport entre (revenu agricole moins intérêts sur le capital propre) et unités de travail annuel de la famille (UTAF)
Source: dépouillement centralisé, FAT
A16 A N N E X E
Caractéristique Unité 1990/92 1997 1998 1999 2000 1997/1999–2000 % Exploitations de référence Nombre 4 302 3 901 3 861 3 494 3 419 -8 9 Exploitations représentées Nombre 62 921 57 194 56 579 54 906 53 896 -4 1 Structure d'exploitation Surface agricole utile ha 16 06 17 92 18 08 18 41 18 78 3 5 Terres ouvertes ha 4 90 5 14 5 11 5 08 5 17 1 2 Main-d'oeuvre de l'exploitation UTA 1 88 1 76 1 73 1 70 1 70 -1 7 dont main-d'oeuvre familiale UTAF 1 39 1 32 1 31 1 29 1 30 -0 5 Vaches, total Nombre 12 9 13 3 13 3 13 4 13 5 1 3 Animaux, total UGB 23 2 23 6 23 6 23 5 23 8 1 0 Structure du capital Actifs totaux fr 606 321 667 440 680 090 689 619 716 645 5 5 dont: actifs circulants fr 116 932 133 175 130 317 135 278 144 196 8 5 dont: actif bétail fr 60 662 42 860 40 396 41 172 44 706 7 8 dont: immobilisations fr 428 727 491 405 509 377 513 169 527 743 4 6 dont: actifs de l'exploitation fr 558 933 614 913 627 590 636 990 662 417 5 7 Part de capitaux étrangers % 43 42 41 41 41 -0 8 Intérêt calculé du capital propre de l'exploitation 1 fr 19 808 11 928 10 146 11 089 15 193 37 4 Compte d'exploitation Rendement brut total fr 184 762 187 643 183 882 181 702 199 145 8 0 dont: paiements directs fr 13 594 39 319 37 667 38 872 39 307 1 8 Charges matérielles fr 91 735 101 981 104 464 102 844 108 460 5 2 Revenu de l'exploitation fr 93 027 85 662 79 418 78 858 90 685 11 5 Frais de main-d'oeuvre fr 13 775 13 476 12 983 12 128 12 369 -3 8 Service de la dette fr 11 361 8 757 7 931 7 405 8 001 -0 4 Fermages fr 5 069 5 455 5 425 5 536 5 640 3 1 Charges réelles fr 121 941 129 669 130 802 127 912 134 470 3 9 Revenu agricole fr 62 822 57 974 53 079 53 789 64 675 17 7 Revenu accessoire fr 16 264 18 627 18 254 18 638 19 208 3 8 Revenu total fr 79 086 76 601 71 333 72 427 83 883 14 2 Consommation de la famille fr 59 573 60 768 62 003 59 220 62 650 3 3 Formation de capital propre fr 19 513 15 833 9 330 13 207 21 233 66 0 Investissements et financement Total des investissements 2 fr 46 914 40 922 49 585 41 856 44 964 1 9 Cash flow 3 fr 44 456 43 108 40 398 42 238 46 043 9 8 Rapport entre cash flow et investissements 4 % 95 105 81 101 102 6 6 Exploitations avec excédent de financement 5 % 66 68 60 66 67 3 6 Stabilité financière Exploitation en situation financière saine 6 % 52 49 44 47 52 11 4 Exploitations avec faible autonomie financière 7 % 26 24 21 21 25 13 6 Exploitations avec faible revenu 8 % 10 14 20 17 12 -29 4 Exploitations en situation financière précaire 9 % 12 13 15 15 11 -23 3 Productivité Productivité du travail 10 fr /UTA 49 473 48 616 45 846 46 376 53 426 13 8 Productivité des surfaces 11 fr /ha 5 796 4 780 4 393 4 282 4 829 7 7 Productivité du capital 12 % 16 7 13 9 12 7 12 4 13 7 5 4 Rentabilité Rentabilité du capital total 13 % 0 8 -1 6 -2 4 -2 3 -0 6 -71 4 Rentabilité du capital propre 14 % -2 2 -5 2 -6 3 -5 9 -3 2 -44 8 Revenu du travail de la main-d'oeuvre familiale 15 fr /UTAF 31 025 34 755 32 854 33 050 38 099 13 5 (moyenne) Revenu du travail de la main-d'oeuvre familiale 15 fr /UTAF 29 465 31 778 30 125 29 770 34 410 12 6
Tableau 17
Résultats d'exploitation: région de plaine*
1 Taux d'intérêt moyen des obligations de la Confédération (1990: 6 40%; 1991: 6 23%; 1992: 6 42%; 1997: 3 40%; 1998: 2 81%; 1999: 3 02%; 2000: 3 95%)
2 Investissements bruts (sans prestations propres), déduction faite des subventions et des désinvestissements
3 Formation de capital propre (sans prestations propres), plus amortissements, plus/moins changements stocks et actif bétail
4 Rapport entre cash flow et total des investissements
5 Part d’exploitations avec cash flow > total des investissements
6 Part de capitaux étrangers <50% et formation de capital propre positive
7 Part de capitaux étrangers >50% et formation de capital propre positive
8 Part de capitaux étrangers <50% et formation de capital propre négative
9 Part de capitaux étrangers >50% et formation de capital propre négative
10 Rapport entre revenu de l'exploitation et main-d'oeuvre de l'exploitation
11 Rapport entre revenu de l'exploitation et surface agricole utile
12 Rapport entre revenu de l'exploitation et actifs totaux
13 Rapport entre (service de la dette plus bénéfice/pertes calculés plus intérêts sur le capital propre) et actifs de l'exploitation
14 Rapport entre (bénéfice/pertes calculés plus intérêts sur le capital propre) et capital propre de l’exploitation
15 Rapport entre (revenu agricole moins intérêts sur le capital propre) et unités de travail annuel de la famille (UTAF)
* Région de plaine: zone de grandes cultures et zones intermédiaires
Source: dépouillement centralisé, FAT
A N N E X E A17
Caractéristique Unité 1990/92 1997 1998 1999 2000 1997/1999–2000 % Exploitations de référence Nombre 2 356 1 800 1 789 1 565 1 517 -11 7 Exploitations représentées Nombre 29 677 26 064 26 275 25 499 25 094 -3 3 Structure d'exploitation Surface agricole utile ha 16 66 18 91 18 90 19 33 19 41 1 9 Terres ouvertes ha 8 34 9 20 9 07 9 05 9 13 0 3 Main-d'oeuvre de l'exploitation UTA 2 05 1 91 1 86 1 83 1 80 -3 6 dont main-d'oeuvre familiale UTAF 1 36 1 30 1 27 1 26 1 26 -1 3 Vaches, total Nombre 12 8 13 3 13 3 13 4 13 3 -0 3 Animaux, total UGB 22 9 23 6 23 4 23 4 23 5 0 1 Structure du capital Actifs totaux fr 706 406 775 592 774 628 778 173 814 917 5 0 dont: actifs circulants fr 149 871 166 383 159 909 165 188 179 657 9 7 dont: actif bétail fr 61 461 44 204 40 588 41 791 44 637 5 8 dont: immobilisations fr 495 074 565 005 574 131 571 194 590 623 3 6 dont: actifs de l'exploitation fr 642 757 707 725 710 317 712 424 746 171 5 1 Part de capitaux étrangers % 41 40 40 40 39 -2 5 Intérêt calculé du capital propre de l'exploitation 1 fr 23 633 14 094 11 839 12 686 17 549 36 3 Compte d'exploitation Rendement brut total fr 225 249 229 974 224 055 218 369 242 054 8 0 dont: paiements directs fr 7 248 35 048 33 541 32 359 32 944 -2 1 Charges matérielles fr 110 193 122 378 123 500 122 085 129 262 5 4 Revenu de l'exploitation fr 115 056 107 596 100 555 96 284 112 792 11 1 Frais de main-d'oeuvre fr 20 784 20 477 19 172 18 194 18 330 -4 9 Service de la dette fr 13 463 10 363 9 073 8 424 9 051 -2 5 Fermages fr 7 015 7 486 7 425 7 698 7 673 1 8 Charges réelles fr 151 456 160 704 159 170 156 400 164 316 3 5 Revenu agricole fr 73 794 69 270 64 885 61 968 77 738 18 9 Revenu accessoire fr 16 429 18 703 17 507 17 580 17 805 -0 7 Revenu total fr 90 223 87 973 82 392 79 548 95 543 14 7 Consommation de la famille fr 67 985 69 861 70 676 66 577 69 756 1 0 Formation de capital propre fr 22 238 18 112 11 716 12 971 25 787 80 8 Investissements et financement Total des investissements 2 fr 56 951 45 697 55 734 46 615 52 271 5 9 Cash flow 3 fr 52 079 50 541 47 108 45 807 53 548 12 0 Rapport entre cash flow et investissements 4 % 92 111 85 98 102 4 1 Exploitations avec excédent de financement 5 % 64 67 61 64 69 7 8 Stabilité financière Exploitation en situation financière saine 6 % 52 49 45 47 54 14 9 Exploitations avec faible autonomie financière 7 % 24 21 20 17 23 19 0 Exploitations avec faible revenu 8 % 12 17 22 20 13 -33 9 Exploitations en situation financière précaire 9 % 12 13 13 16 10 -28 6 Productivité Productivité du travail 10 fr /UTA 56 050 56 330 54 204 52 755 62 635 15 1 Productivité des surfaces 11 fr /ha 6 908 5 691 5 321 4 981 5 810 9 0 Productivité du capital 12 % 17 9 15 2 14 2 13 5 15 1 5 6 Rentabilité Rentabilité du capital total 13 % 2 1 -0 1 -0 7 -1 2 0 9 -235 0 Rentabilité du capital propre 14 % 0 0 -2 6 -3 3 -4 1 -0 5 -85 0 Revenu du travail de la main-d'oeuvre familiale 15 fr /UTAF 36 924 42 423 41 723 39 210 47 891 16 5 (moyenne) Revenu du travail de la main-d'oeuvre familiale 15 fr /UTAF 36 186 39 552 39 191 36 114 44 561 16 4 (médiane)
Tableau 18
Résultats d'exploitation: région des collines*
(médiane)
1 Taux d'intérêt moyen des obligations de la Confédération (1990: 6 40%; 1991: 6 23%; 1992: 6 42%; 1997: 3 40%; 1998: 2 81%; 1999: 3 02%; 2000: 3 95%)
2 Investissements bruts (sans prestations propres), déduction faite des subventions et des désinvestissements
3 Formation de capital propre (sans prestations propres), plus amortissements, plus/moins changements stocks et actif bétail
4 Rapport entre cash flow et total des investissements
5 Part d’exploitations avec cash flow > total des investissements
6 Part de capitaux étrangers <50% et formation de capital propre positive
7 Part de capitaux étrangers >50% et formation de capital propre positive
8 Part de capitaux étrangers <50% et formation de capital propre négative
9 Part de capitaux étrangers >50% et formation de capital propre négative
10 Rapport entre revenu de l'exploitation et main-d'oeuvre de l'exploitation
11 Rapport entre revenu de l'exploitation et surface agricole utile
12 Rapport entre revenu de l'exploitation et actifs totaux
13 Rapport entre (service de la dette plus bénéfice/pertes calculés plus intérêts sur le capital propre) et actifs de l'exploitation
14 Rapport entre (bénéfice/pertes calculés plus intérêts sur le capital propre) et capital propre de l’exploitation
15 Rapport entre (revenu agricole moins intérêts sur le capital propre) et unités de travail annuel de la famille (UTAF)
* Région des collines: zone des collines et zone de montagne I
Source: dépouillement centralisé, FAT
A18 A N N E X E
Caractéristique Unité 1990/92 1997 1998 1999 2000 1997/1999–2000 % Exploitations de référence Nombre 1 125 1 103 1 119 1 029 1 017 -6 2 Exploitations représentées Nombre 17 397 15 796 15 420 14 967 14 588 -5 2 Structure d'exploitation Surface agricole utile ha 15 30 16 92 17 07 17 19 17 83 4 5 Terres ouvertes ha 3 08 3 08 2 98 2 99 3 15 4 4 Main-d'oeuvre de l'exploitation UTA 1 81 1 66 1 65 1 62 1 62 -1 4 dont main-d'oeuvre familiale UTAF 1 40 1 30 1 29 1 28 1 29 0 0 Vaches, total Nombre 14 4 14 7 14 8 14 7 15 3 3 8 Animaux, total UGB 26 0 26 3 26 6 26 0 27 0 2 7 Structure du capital Actifs totaux fr 553 876 622 467 648 445 655 042 677 784 5 6 dont: actifs circulants fr 95 672 116 547 114 116 116 937 122 136 5 4 dont: actif bétail fr 66 366 46 483 44 218 44 452 49 901 10 8 dont: immobilisations fr 391 838 459 437 490 111 493 653 505 747 5 1 dont: actifs de l'exploitation fr 516 933 572 477 595 810 602 991 626 182 6 1 Part de capitaux étrangers % 46 45 45 45 45 0 0 Intérêt calculé du capital propre de l'exploitation 1 fr 17 271 10 424 8 959 9 825 13 318 36 8 Compte d'exploitation Rendement brut total fr 170 201 172 687 169 697 167 340 183 249 7 9 dont: paiements directs fr 15 415 38 489 37 258 37 996 39 135 3 2 Charges matérielles fr 85 602 95 988 99 789 96 378 102 222 5 0 Revenu de l'exploitation fr 84 599 76 699 69 908 70 962 81 027 11 7 Frais de main-d'oeuvre fr 9 943 9 792 9 839 9 037 9 183 -3 9 Service de la dette fr 10 915 8 507 8 136 7 618 8 330 3 0 Fermages fr 3 903 4 660 4 513 4 422 4 789 5 7 Charges réelles fr 110 363 118 948 122 277 117 455 124 525 4 2 Revenu agricole fr 59 838 53 740 47 420 49 885 58 725 16 6 Revenu accessoire fr 14 544 18 973 19 283 19 849 21 814 12 6 Revenu total fr 74 382 72 713 66 703 69 734 80 539 15 5 Consommation de la famille fr 55 272 56 859 57 769 55 890 59 963 5 5 Formation de capital propre fr 19 110 15 854 8 934 13 844 20 576 59 8 Investissements et financement Total des investissements 2 fr 41 428 40 324 47 691 39 227 39 674 -6 5 Cash flow 3 fr 41 445 40 313 39 269 40 759 43 650 8 8 Rapport entre cash flow et investissements 4 % 100 100 82 104 110 15 4 Exploitations avec excédent de financement 5 % 68 70 61 67 68 3 0 Finanzielle Stabilität Exploitation en situation financière saine 6 % 50 47 43 46 50 10 3 Exploitations avec faible autonomie financière 7 % 30 29 25 26 31 16 3 Exploitations avec faible revenu 8 % 8 10 15 13 8 -36 8 Exploitations en situation financière précaire 9 % 12 14 17 15 11 -28 3 Productivité Productivité du travail 10 fr /UTA 46 654 46 179 42 381 43 842 50 119 13 6 Productivité des surfaces 11 fr /ha 5 533 4 534 4 096 4 128 4 545 6 9 Productivité du capital 12 % 16 4 13 4 11 7 11 8 12 9 4 9 Rentabilité Rentabilité du capital total 13 % 0 4 -2 0 -3 1 -2 5 -1 1 -56 6 Rentabilité du capital propre 14 % -3 3 -6 5 -8 3 -7 0 -4 5 -38 1 Revenu du travail de la main-d'oeuvre familiale 15 fr /UTAF 30 335 33 228 29 714 31 292 35 336 12 5 (moyenne) Revenu du travail de la main-d'oeuvre familiale 15 fr /UTAF 29 520 31 182 28 701 29 459 33 156 11 3
Tableau 19
Résultats d'exploitation: région de montagne*
1 Taux d'intérêt moyen des obligations de la Confédération (1990: 6 40%; 1991: 6 23%; 1992: 6 42%; 1997: 3 40%; 1998: 2 81%; 1999: 3 02%; 2000: 3 95%)
2 Investissements bruts (sans prestations propres), déduction faite des subventions et des désinvestissements
3 Formation de capital propre (sans prestations propres), plus amortissements, plus/moins changements stocks et actif bétail
4 Rapport entre cash flow et total des investissements
5 Part d’exploitations avec cash flow > total des investissements
6 Part de capitaux étrangers <50% et formation de capital propre positive
7 Part de capitaux étrangers >50% et formation de capital propre positive
8 Part de capitaux étrangers <50% et formation de capital propre négative
9 Part de capitaux étrangers >50% et formation de capital propre négative
10 Rapport entre revenu de l'exploitation et main-d'oeuvre de l'exploitation
11 Rapport entre revenu de l'exploitation et surface agricole utile
12 Rapport entre revenu de l'exploitation et actifs totaux
13 Rapport entre (service de la dette plus bénéfice/pertes calculés plus intérêts sur le capital propre) et actifs de l'exploitation
14 Rapport entre (bénéfice/pertes calculés plus intérêts sur le capital propre) et capital propre de l’exploitation
15 Rapport entre (revenu agricole moins intérêts sur le capital propre) et unités de travail annuel de la famille (UTAF)
* Région de montagne: zones de montagne II à IV
Source: dépouillement centralisé, FAT
A N N E X E A19
Caractéristique Unité 1990/92 1997 1998 1999 2000 1997/1999–2000 % Exploitations de référence Nombre 821 998 953 900 885 -6 9 Exploitations représentées Nombre 15 847 15 334 14 884 14 440 14 214 -4 5 Structure d'exploitation Surface agricole utile ha 15 76 17 28 17 67 18 06 18 63 5 4 Terres ouvertes ha 0 44 0 36 0 32 0 25 0 28 -9 7 Main-d'oeuvre de l'exploitation UTA 1 63 1 61 1 60 1 57 1 60 0 4 dont main-d'oeuvre familiale UTAF 1 42 1 39 1 38 1 37 1 39 0 7 Vaches, total Nombre 11 4 11 7 11 8 11 9 11 8 0 0 Animaux, total UGB 20 5 20 6 20 7 21 1 21 0 1 0 Structure du capital Actifs totaux fr 476 486 529 934 545 982 569 082 583 036 6 3 dont: actifs circulants fr 78 573 93 858 94 862 101 469 104 230 7 8 dont: actif bétail fr 52 902 36 846 36 097 36 681 39 497 8 1 dont: immobilisations fr 345 011 399 230 415 023 430 932 439 309 5 8 dont: actifs de l'exploitation fr 448 089 500 870 514 474 539 022 551 742 6 5 Part de capitaux étrangers % 45 42 41 40 40 -2 4 Intérêt calculé du capital propre de l'exploitation 1 fr 15 432 9 795 8 388 9 580 12 957 40 0 Compte d'exploitation Rendement brut total fr 124 931 131 097 127 656 131 838 139 707 7 3 dont: paiements directs fr 23 476 47 435 45 373 51 279 50 719 5 6 Charges matérielles fr 63 905 73 483 75 698 75 569 78 140 4 3 Revenu de l'exploitation fr 61 026 57 614 51 958 56 269 61 567 11 4 Frais de main-d'oeuvre fr 4 860 5 370 5 316 4 619 5 116 0 3 Service de la dette fr 7 918 6 286 5 704 5 386 5 808 0 3 Fermages fr 2 707 2 821 2 837 2 872 2 922 2 8 Charges réelles fr 79 390 87 960 89 556 88 445 91 986 3 8 Revenu agricole fr 45 541 43 137 38 101 43 392 47 721 14 9 Revenu accessoire fr 17 853 18 139 18 505 19 250 19 011 2 0 Revenu total fr 63 394 61 276 56 606 62 642 66 732 10 9 Consommation de la famille fr 48 548 49 338 51 077 49 678 52 865 5 7 Formation de capital propre fr 14 846 11 938 5 529 12 964 13 867 36 7 Investissements et financement Total des investissements 2 fr 34 138 33 423 40 694 36 177 37 494 2 0 Cash flow 3 fr 33 482 33 355 29 723 37 469 35 247 5 2 Rapport entre cash flow et investissements 4 % 98 100 73 104 94 1 8 Exploitations avec excédent de financement 5 % 70 68 59 70 65 -1 0 Stabilité financière Exploitation en situation financière saine 6 % 54 50 44 50 51 6 3 Exploitations avec faible autonomie financière 7 % 26 24 19 23 23 4 5 Exploitations avec faible revenu 8 % 8 14 20 15 14 -14 3 Exploitations en situation financière précaire 9 % 12 12 17 12 12 -12 2 Productivité Productivité du travail 10 fr /UTA 37 418 35 692 32 445 35 950 38 532 11 1 Productivité des surfaces 11 fr /ha 3 874 3 333 2 940 3 115 3 304 5 6 Productivité du capital 12 % 13 6 11 5 10 1 10 4 11 2 5 0 Rentabilité Rentabilité du capital total 13 % -2 3 -4 6 -5 6 -4 4 -3 8 -21 9 Rentabilité du capital propre 14 % -7 4 -10 2 -11 6 -9 2 -8 2 -20 6 Revenu du travail de la main-d'oeuvre familiale 15 fr /UTAF 21 201 24 022 21 498 24 747 25 064 7 0 (moyenne) Revenu du travail de la main-d'oeuvre familiale
fr /UTAF 20 707 22 920 20 629 22 991 22 851 3 0 (médiane)
15
Tableau 20a
Résultats d'exploitation selon les types d'exploitations*
– 1998/2000
1 Taux d'intérêt moyen des obligations de la Confédération (1998: 2 81%; 1999: 3 02%; 2000: 3 95%)
2 Investissements bruts (sans prestations propres), déduction faite des subventions et des désinvestissements
3 Formation de capital propre (sans prestations propres), plus amortissements, plus/moins changements stocks et actif bétail
4 Rapport entre cash flow et total des investissements
5 Part d’exploitations avec cash flow > total des investissements
6 Part de capitaux étrangers <50% et formation de capital propre positive
7 Part de capitaux étrangers >50% et formation de capital propre positive
8 Part de capitaux étrangers <50% et formation de capital propre négative
9 Part de capitaux étrangers >50% et formation de capital propre négative
10 Rapport entre revenu de l'exploitation et main-d'oeuvre de l'exploitation
11 Rapport entre revenu de l'exploitation et surface agricole utile
12 Rapport entre revenu de l'exploitation et actifs totaux
13 Rapport entre (service de la dette plus bénéfice/pertes calculés plus intérêts sur le capital propre) et actifs de l'exploitation
14 Rapport entre (bénéfice/pertes calculés plus intérêts sur le capital propre) et capital propre de l’exploitation
15 Rapport entre (revenu agricole moins intérêts sur le capital propre) et unités de travail annuel de la famille (UTAF)
* Nouvelle typologie des exploitations FAT99 (cf annexe: «Définitions et méthodes»)
Source: dépouillement centralisé, FAT
A20 A N N E X E
Production végétale Elevage Moyenne Lait Caractéristique Unité de toutes Grandes Cultures commer- Vaches Autres les expl cultures spéciales cialisé mères bovins Exploitations de référence Nombre 3 591 138 81 1 421 62 160 Exploitations représentées Nombre 55 127 3 378 3 479 20 548 1 255 3 568 Structure d'exploitation Surface agricole utile ha 18 42 22 34 12 80 17 86 17 07 14 89 Terres ouvertes ha 5 12 18 40 6 21 0 97 0 75 0 15 Main-d'oeuvre de l'exploitation UTA 1 71 1 34 2 42 1 64 1 33 1 42 dont main-d'oeuvre familiale UTAF 1 30 1 04 1 33 1 35 1 11 1 29 Vaches, total Nombre 13 4 3 6 2 0 15 7 15 8 9 2 Animaux, total UGB 23 6 7 9 3 1 24 2 21 3 16 4 Structure du capital Actifs totaux fr 695 451 735 002 782 113 621 780 650 807 496 577 dont: actifs circulants fr 136 597 166 032 219 487 112 657 113 533 92 607 dont: actif bétail fr 42 091 15 080 8 023 42 769 41 692 32 642 dont: immobilisations fr 516 763 553 890 554 603 466 354 495 582 371 328 dont: actifs de l'exploitation fr 642 332 685 381 724 621 578 157 615 565 466 941 Part de capitaux étrangers % 41 35 34 43 39 41 Intérêt calculé du capital propre de l'exploitation 1 fr 12 143 14 245 15 384 10 640 12 041 8 904 Compte d'exploitation Rendement brut total fr 188 243 203 028 244 981 152 909 129 432 108 448 dont: paiements directs fr 38 615 35 912 22 041 39 004 58 622 51 826 Charges matérielles fr 105 256 110 779 115 032 83 794 69 921 64 677 Revenu de l'exploitation fr 82 987 92 249 129 949 69 115 59 511 43 771 Frais de main-d'oeuvre fr 12 494 10 446 42 464 7 333 6 295 2 849 Service de la dette fr 7 779 7 659 8 299 6 942 6 574 4 898 Fermages fr 5 533 8 291 6 781 4 545 2 236 1 725 Charges réelles fr 131 062 137 175 172 575 102 614 85 025 74 149 Revenu agricole fr 57 181 65 853 72 405 50 295 44 406 34 299 Revenu accessoire fr 18 700 23 652 19 334 17 946 32 486 20 915 Revenu total fr 75 881 89 505 91 739 68 241 76 892 55 214 Consommation de la famille fr 61 291 77 943 77 251 55 087 56 464 46 508 Formation de capital propre fr 14 590 11 562 14 488 13 154 20 428 8 706 Investissements et financement Total des investissements 2 fr 45 468 46 913 35 272 41 172 44 289 34 796 Cash flow 3 fr 42 893 44 560 42 880 37 738 45 033 29 130 Rapport entre cash flow et investissements 4 % 95 95 127 92 102 84 Exploitations avec excédent de financement 5 % 64 59 65 66 70 65 Stabilité financière Exploitation en situation financière saine 6 % 48 45 43 48 69 42 Exploitations avec faible autonomie financière 7 % 22 17 18 24 16 25 Exploitations avec faible revenu 8 % 16 26 25 15 7 20 Exploitations en situation financière précaire 9 % 14 12 14 13 8 13 Productivité Productivité du travail 10 fr /UTA 48 549 68 723 53 611 42 209 45 097 30 801 Productivité des surfaces 11 fr /ha 4 502 4 127 10 146 3 866 3 483 2 933 Productivité du capital 12 % 12 9 13 5 17 9 11 9 9 7 9 3 Rentabilité Rentabilité du capital total 13 % -1 8 1 2 -0 3 -3 3 -1 7 -6 6 Rentabilité du capital propre 14 % -5 1 0 1 -2 4 -8 1 -4 6 -13 2 Revenu du travail de la main-d'oeuvre familiale 15 fr /UTAF 34 667 49 712 42 625 29 308 29 319 19 628
Revenu du travail de la main-d'oeuvre familiale 15 fr /UTAF 31 435 50 854 35 133 27 297 32 394 18 920
(moyenne)
(médiane)
Tableau 20b
Résultats d'exploitation selon les types d'exploitations* – 1998/2000
1 Taux d'intérêt moyen des obligations de la Confédération (1998: 2 81%; 1999: 3 02%; 2000: 3 95%)
2 Investissements bruts (sans prestations propres), déduction faite des subventions et des désinvestissements
3 Formation de capital propre (sans prestations propres), plus amortissements, plus/moins changements stocks et actif bétail
4 Rapport entre cash flow et total des investissements
5 Part d’exploitations avec cash flow > total des investissements
6 Part de capitaux étrangers <50% et formation de capital propre positive
7 Part de capitaux étrangers >50% et formation de capital propre positive
8 Part de capitaux étrangers <50% et formation de capital propre négative
9 Part de capitaux étrangers >50% et formation de capital propre négative
10 Rapport entre revenu de l'exploitation et main-d'oeuvre de l'exploitation
11 Rapport entre revenu de l'exploitation et surface agricole utile
12 Rapport entre revenu de l'exploitation et actifs totaux
13 Rapport entre (service de la dette plus bénéfice/pertes calculés plus intérêts sur le capital propre) et actifs de l'exploitation
14 Rapport entre (bénéfice/pertes calculés plus intérêts sur le capital propre) et capital propre de l’exploitation
15 Rapport entre (revenu agricole moins intérêts sur le capital propre) et unités de travail annuel de la famille (UTAF)
* Nouvelle typologie des exploitations FAT99 (cf annexe: «Définitions et méthodes»)
Source: dépouillement centralisé, FAT
A N N E X E A21
Elevage Exploitations combinées Moyennes Chevaux, Grandes Caractéristique Unité de toutes ovins, Trans- cultures + Vaches Transles expl caprins formation lait mères formation Autres Exploitations de référence Nombre 3 591 28 52 495 26 672 456 Exploitations représentées Nombre 55 127 1 152 1 205 6 393 371 6 136 7 642 Structure d'exploitation Surface agricole utile ha 18 42 13 33 11 05 23 98 23 87 18 53 19 58 Terres ouvertes ha 5 12 0 33 1 00 12 97 10 49 6 46 6 42 Main-d'oeuvre de l'exploitation UTA 1 71 1 24 1 51 1 96 1 70 1 83 1 74 dont main-d'oeuvre familiale UTAF 1 30 1 14 1 12 1 35 1 22 1 31 1 29 Vaches, total Nombre 13 4 1 8 11 3 18 1 21 7 15 2 14 5 Animaux, total UGB 23 6 12 1 43 0 27 9 30 3 37 3 25 9 Structure du capital Actifs totaux fr 695 451 429 673 768 141 796 715 751 879 846 797 755 276 dont: actifs circulants fr 136 597 69 903 103 390 167 027 171 056 154 937 147 753 dont: actif bétail fr 42 091 20 799 60 762 50 395 60 902 59 499 50 713 dont: immobilisations fr 516 763 338 971 603 989 579 293 519 921 632 361 556 810 dont: actifs de l'exploitation fr 642 332 401 474 735 263 738 399 676 900 780 164 672 270 Part de capitaux étrangers % 41 44 47 41 45 41 44 Intérêt calculé du capital propre de l'exploitation 1 fr 12 143 7 279 12 782 13 996 12 001 14 756 12 267 Compte d'exploitation Rendement brut total fr 188 243 86 844 260 768 238 756 221 521 264 222 196 748 dont: paiements directs fr 38 615 40 508 25 803 39 654 68 635 35 860 38 532 Charges matérielles fr 105 256 55 159 177 400 130 831 121 287 160 486 110 410 Revenu de l'exploitation fr 82 987 31 685 83 368 107 925 100 234 103 736 86 338 Frais de main-d'oeuvre fr 12 494 2 024 11 908 18 468 16 844 15 928 12 884 Service de la dette fr 7 779 5 375 10 656 8 902 8 275 9 747 8 738 Fermages fr 5 533 1 502 3 232 9 225 12 311 5 704 6 153 Charges réelles fr 131 062 64 061 203 196 167 426 158 717 191 865 138 186 Revenu agricole fr 57 181 22 784 57 572 71 330 62 804 72 357 58 563 Revenu accessoire fr 18 700 30 162 16 151 13 507 23 281 16 154 19 814 Revenu total fr 75 881 52 946 73 723 84 837 86 085 88 511 78 377 Consommation de la famille fr 61 291 49 689 59 678 66 603 70 878 67 540 63 088 Formation de capital propre fr 14 590 3 257 14 045 18 234 15 207 20 971 15 289 Investissements et financement Total des investissements 2 fr 45 468 39 106 31 360 55 160 52 063 59 650 49 604 Cash flow 3 fr 42 893 24 410 50 596 51 428 47 273 56 922 44 924 Rapport entre cash flow et investissements 4 % 95 71 205 93 97 97 91 Exploitations avec excédent de financement 5 % 64 51 74 63 61 67 65 Stabilité financière Exploitation en situation financière saine 6 % 48 45 37 48 45 52 47 Exploitations avec faible autonomie financière 7 % 22 21 27 22 21 21 23 Exploitations avec faible revenu 8 % 16 14 16 16 12 14 15 Exploitations en situation financière précaire 9 % 14 20 20 14 22 13 15 Productivité Productivité du travail 10 fr /UTA 48 549 25 630 55 357 54 988 58 987 56 652 49 755 Productivité des surfaces 11 fr /ha 4 502 2 379 7 552 4 498 4 221 5 588 4 409 Productivité du capital 12 % 12 9 7 9 11 4 14 6 14 8 13 3 12 8 Rentabilité Rentabilité du capital total 13 % -1 8 -8 8 0 3 -0 5 -0 6 0 4 -1 6 Rentabilité du capital propre 14 % -5 1 -18 3 -2 2 -2 9 -3 4 -1 4 -5 1 Revenu du travail de la main-d'oeuvre familiale15 fr /UTAF 34 667 13 646 39 805 42 509 41 639 44 097 35 757 (moyenne) Revenu du travail de la main-d'oeuvre familiale15 fr /UTAF 31 435 10 701 29 666 41 129 39 327 40 210 33 094 (médiane)
Tableau 21
Résultats d'exploitation par quartile: toutes les régions – 1998/2000
1 Taux d'intérêt moyen des obligations de la Confédération (1998: 2 81%; 1999: 3 02%; 2000: 3 95%)
2 Investissements bruts (sans prestations propres), déduction faite des subventions et des désinvestissements
3 Formation de capital propre (sans prestations propres), plus amortissements, plus/moins changements stocks et actif bétail
4 Rapport entre cash flow et total des investissements
5 Part d’exploitations avec cash flow > total des investissements
6 Part de capitaux étrangers <50% et formation de capital propre positive
7 Part de capitaux étrangers >50% et formation de capital propre positive
8 Part de capitaux étrangers <50% et formation de capital propre négative
9 Part de capitaux étrangers >50% et formation de capital propre négative
10 Rapport entre revenu de l'exploitation et main-d'oeuvre de l'exploitation
11 Rapport entre revenu de l'exploitation et surface agricole utile
12 Rapport entre revenu de l'exploitation et actifs totaux
13 Rapport entre (service de la dette plus bénéfice/pertes calculés plus intérêts sur le capital propre) et actifs de l'exploitation
14 Rapport entre (bénéfice/pertes calculés plus intérêts sur le capital propre) et capital propre de l’exploitation
15 Rapport entre (revenu agricole moins intérêts sur le capital propre) et unités de travail annuel de la famille (UTAF)
Source: dépouillement centralisé, FAT
A22 A N N E X E
ventilées selon le revenu du travail Caractéristique Unité Moyenne 1er quartile 2e quartile 3e quartile 4e quartile (0 –25%) (25 –50%) (50 –75%) (75 –100%) Exploitations de référence Nombre 3 591 741 886 975 990 Exploitations représentées Nombre 55 127 13 797 13 776 13 777 13 777 Structure d'exploitation Surface agricole utile ha 18 42 14 05 16 64 19 36 23 66 Terres ouvertes ha 5 12 2 60 3 21 5 19 9 50 Main-d'oeuvre de l'exploitation UTA 1 71 1 62 1 68 1 71 1 82 dont main-d'oeuvre familiale UTAF 1 30 1 29 1 38 1 34 1 19 Vaches, total Nombre 13 4 10 5 12 8 14 8 15 4 Animaux, total UGB 23 6 18 5 22 1 25 2 28 6 Structure du capital Actifs totaux fr 695 451 619 880 618 087 713 549 830 393 dont: actifs circulants fr 136 597 98 803 114 349 146 408 186 873 dont: actif bétail fr 42 091 33 116 39 504 44 779 50 980 dont: immobilisations fr 516 763 487 961 464 234 522 362 592 540 dont: actifs de l'exploitation fr 642 332 581 090 575 729 653 437 759 160 Part de capitaux étrangers % 41 42 42 40 41 Intérêt calculé du capital propre de l'exploitation 1 fr 12 143 10 890 10 682 12 597 14 403 Compte d'exploitation Rendement brut total fr 188 243 129 653 157 470 196 046 269 884 dont: paiements directs fr 38 615 33 891 37 279 39 439 43 859 Charges matérielles fr 105 256 88 101 92 408 106 261 134 278 Revenu de l'exploitation fr 82 987 41 552 65 062 89 785 135 606 Frais de main-d'oeuvre fr 12 494 10 166 8 779 11 276 19 754 Service de la dette fr 7 779 7 383 7 016 7 659 9 059 Fermages fr 5 533 3 008 4 186 5 911 9 032 Charges réelles fr 131 062 108 657 112 389 131 107 172 123 Revenu agricole fr 57 181 20 995 45 081 64 939 97 761 Revenu accessoire fr 18 700 27 100 18 391 15 414 13 883 Revenu total fr 75 881 48 095 63 472 80 353 111 644 Consommation de la famille fr 61 291 51 346 56 159 63 520 74 154 Formation de capital propre fr 14 590 -3 251 7 313 16 833 37 490 Investissements et financement Total des investissements 2 fr 45 468 37 559 40 270 46 443 57 614 Cash flow 3 fr 42 893 25 058 33 674 45 042 67 822 Rapport entre cash flow et investissements 4 % 95 68 84 98 118 Exploitations avec excédent de financement 5 % 64 54 64 69 72 Stabilité financière Exploitation en situation financière saine 6 % 48 31 46 56 59 Exploitations avec faible autonomie financière 7 % 22 14 23 23 29 Exploitations avec faible revenu 8 % 16 31 16 11 7 Exploitations en situation financière précaire 9 % 14 24 15 10 5 Productivité Productivité du travail 10 fr /UTA 48 549 25 644 38 727 52 344 74 401 Productivité des surfaces 11 fr /ha 4 502 2 959 3 909 4 637 5 727 Productivité du capital 12 % 12 9 7 1 11 3 13 7 17 8 Rentabilité Rentabilité du capital total 13 % -1 8 -7 8 -4 8 -1 0 4 5 Rentabilité du capital propre 14 % -5 1 -15 8 -10 5 -3 7 5 7 Revenu du travail de la main-d'oeuvre familiale 15 fr /UTAF 34 667 7 839 24 981 39 156 69 767 (moyenne) Revenu du travail de la main-d'oeuvre familiale 15 fr /UTAF 31 435 (médiane)
Tableau 22
Résultats d'exploitation par quartile: région de plaine* – 1998/2000
1 Taux d'intérêt moyen des obligations de la Confédération (1998: 2 81%; 1999: 3 02%; 2000: 3 95%)
2 Investissements bruts (sans prestations propres), déduction faite des subventions et des désinvestissements
3 Formation de capital propre (sans prestations propres), plus amortissements, plus/moins changements stocks et actif bétail
4 Rapport entre cash flow et total des investissements
5 Part d’exploitations avec cash flow > total des investissements
6 Part de capitaux étrangers <50% et formation de capital propre positive
7 Part de capitaux étrangers >50% et formation de capital propre positive
8 Part de capitaux étrangers <50% et formation de capital propre négative
9 Part de capitaux étrangers >50% et formation de capital propre négative
10 Rapport entre revenu de l'exploitation et main-d'oeuvre de l'exploitation
11 Rapport entre revenu de l'exploitation et surface agricole utile
12 Rapport entre revenu de l'exploitation et actifs totaux
13 Rapport entre (service de la dette plus bénéfice/pertes calculés plus intérêts sur le capital propre) et actifs de l'exploitation
14 Rapport entre (bénéfice/pertes calculés plus intérêts sur le capital propre) et capital propre de l’exploitation
15 Rapport entre (revenu agricole moins intérêts sur le capital propre) et unités de travail annuel de la famille (UTAF)
* Région de plaine: zone de grandes cultures et zones intermédiaires
Source: dépouillement centralisé, FAT
A N N E X E A23
ventilées selon le revenu du travail Caractéristique Unité Moyenne 1er quartile 2e quartile 3e quartile 4e quartile (0 –25%) (25 –50%) (50 –75%) (75 –100%) Exploitations de référence Nombre 1 624 350 418 427 429 Exploitations représentées Nombre 25 623 6 439 6 379 6 412 6 392 Structure d'exploitation Surface agricole utile ha 19 21 15 34 17 36 19 94 24 23 Terres ouvertes ha 9 08 6 63 7 36 9 16 13 19 Main-d'oeuvre de l'exploitation UTA 1 83 1 75 1 80 1 83 1 92 dont main-d'oeuvre familiale UTAF 1 26 1 25 1 36 1 29 1 15 Vaches, total Nombre 13 3 10 7 13 8 14 6 14 1 Animaux, total UGB 23 4 18 6 23 3 24 0 27 7 Structure du capital Actifs totaux fr 789 239 731 282 739 408 791 608 895 032 dont: actifs circulants fr 168 251 127 612 159 675 171 623 214 392 dont: actif bétail fr 42 339 34 387 41 488 43 913 49 605 dont: immobilisations fr 578 649 569 283 538 245 576 072 631 035 dont: actifs de l'exploitation fr 722 971 681 318 669 179 725 434 816 124 Part de capitaux étrangers % 40 41 39 39 40 Intérêt calculé du capital propre de l'exploitation 1 fr 14 024 13 097 13 008 14 190 15 808 Compte d'exploitation Rendement brut total fr 228 159 168 894 200 513 233 622 309 940 dont: paiements directs fr 32 948 26 438 30 073 34 418 40 895 Charges matérielles fr 124 949 110 051 114 643 123 334 151 849 Revenu de l'exploitation fr 103 210 58 843 85 870 110 288 158 091 Frais de main-d'oeuvre fr 18 565 17 403 14 163 17 157 25 532 Service de la dette fr 8 849 8 960 8 251 8 429 9 755 Fermages fr 7 599 4 898 6 218 8 283 11 008 Charges réelles fr 159 962 141 312 143 275 157 203 198 143 Revenu agricole fr 68 197 27 582 57 238 76 419 111 796 Revenu accessoire fr 17 631 26 154 16 869 14 120 13 324 Revenu total fr 85 828 53 736 74 107 90 539 125 120 Consommation de la famille fr 69 004 59 694 64 985 70 200 81 200 Formation de capital propre fr 16 824 -5 958 9 122 20 339 43 920 Investissements et financement Total des investissements 2 fr 51 540 42 671 49 365 55 318 58 834 Cash flow 3 fr 48 821 27 129 40 292 51 101 76 893 Rapport entre cash flow et investissements 4 % 95 64 83 92 130 Exploitations avec excédent de financement 5 % 65 51 64 67 74 Stabilité financière Exploitation en situation financière saine 6 % 49 28 48 58 60 Exploitations avec faible autonomie financière 7 % 20 12 18 22 28 Exploitations avec faible revenu 8 % 18 36 18 12 7 Exploitations en situation financière précaire 9 % 13 24 16 8 5 Productivité Productivité du travail 10 fr /UTA 56 532 33 708 47 653 60 349 82 082 Productivité des surfaces 11 fr /ha 5 371 3 840 4 955 5 529 6 518 Productivité du capital 12 % 14 3 8 6 12 8 15 2 19 3 Rentabilité Rentabilité du capital total 13 % -0 3 -6 2 -3 0 0 5 6 0 Rentabilité du capital propre 14 % -2 6 -12 8 -7 1 -1 0 8 1 Revenu du travail de la main-d'oeuvre familiale 15 fr /UTAF 42 941 11 620 32 505 48 391 83 341 (moyenne) Revenu du travail de la main-d'oeuvre familiale 15 fr /UTAF 39 955 (médiane)
Tableau 23
Résultats d'exploitation par quartile: région des collines* – 1998/2000
1 Taux d'intérêt moyen des obligations de la Confédération (1998: 2 81%; 1999: 3 02%; 2000: 3 95%)
2 Investissements bruts (sans prestations propres), déduction faite des subventions et des désinvestissements
3 Formation de capital propre (sans prestations propres), plus amortissements, plus/moins changements stocks et actif bétail
4 Rapport entre cash flow et total des investissements
5 Part d’exploitations avec cash flow > total des investissements
6 Part de capitaux étrangers <50% et formation de capital propre positive
7 Part de capitaux étrangers >50% et formation de capital propre positive
8 Part de capitaux étrangers <50% et formation de capital propre négative
9 Part de capitaux étrangers >50% et formation de capital propre négative
10 Rapport entre revenu de l'exploitation et main-d'oeuvre de l'exploitation
11 Rapport entre revenu de l'exploitation et surface agricole utile
12 Rapport entre revenu de l'exploitation et actifs totaux
13 Rapport entre (service de la dette plus bénéfice/pertes calculés plus intérêts sur le capital propre) et actifs de l'exploitation
14 Rapport entre (bénéfice/pertes calculés plus intérêts sur le capital propre) et capital propre de l’exploitation
15 Rapport entre (revenu agricole moins intérêts sur le capital propre) et unités de travail annuel de la famille (UTAF)
* Région des collines: zone des collines et zone de montagne I
Source: dépouillement centralisé, FAT
A24 A N N E X E
ventilées selon le revenu du travail Caractéristique Unité Moyenne 1er quartile 2e quartile 3e quartile 4e quartile (0 –25%) (25 –50%) (50 –75%) (75 –100%) Exploitations de référence Nombre 1 055 204 250 282 319 Exploitations représentées Nombre 14 992 3 761 3 745 3 727 3 758 Structure d'exploitation Surface agricole utile ha 17 36 12 37 15 39 18 30 23 39 Terres ouvertes ha 3 04 1 67 2 33 3 31 4 85 Main-d'oeuvre de l'exploitation UTA 1 63 1 56 1 63 1 62 1 71 dont main-d'oeuvre familiale UTAF 1 29 1 24 1 36 1 32 1 23 Vaches, total Nombre 14 9 11 8 14 0 15 9 18 1 Animaux, total UGB 26 5 20 5 23 8 27 7 34 1 Structure du capital Actifs totaux fr 660 424 603 108 614 506 662 665 761 310 dont: actifs circulants fr 117 730 90 883 107 390 117 423 155 184 dont: actif bétail fr 46 190 35 406 41 827 48 334 59 197 dont: immobilisations fr 496 504 476 819 465 289 496 908 546 929 dont: actifs de l'exploitation fr 608 328 557 246 565 548 611 177 699 317 Part de capitaux étrangers % 45 48 46 44 44 Intérêt calculé du capital propre de l'exploitation 1 fr 10 700 9 375 9 926 10 944 12 558 Compte d'exploitation Rendement brut total fr 173 429 125 158 151 127 180 133 237 312 dont: paiements directs fr 38 130 29 879 33 874 39 856 48 908 Charges matérielles fr 99 463 87 111 89 683 99 613 121 426 Revenu de l'exploitation fr 73 966 38 047 61 444 80 520 115 886 Frais de main-d'oeuvre fr 9 353 8 601 7 163 8 260 13 372 Service de la dette fr 8 028 8 039 7 442 7 698 8 929 Fermages fr 4 575 2 575 3 614 5 154 6 956 Charges réelles fr 121 419 106 326 107 902 120 725 150 683 Revenu agricole fr 52 010 18 832 43 225 59 408 86 629 Revenu accessoire fr 20 315 30 525 20 407 15 709 14 574 Revenu total fr 72 325 49 357 63 632 75 117 101 203 Consommation de la famille fr 57 873 49 708 55 151 60 287 66 374 Formation de capital propre fr 14 452 - 351 8 481 14 830 34 829 Investissements et financement Total des investissements 2 fr 42 197 39 155 38 316 42 304 49 028 Cash flow 3 fr 41 226 27 714 33 925 40 837 62 408 Rapport entre cash flow et investissements 4 % 99 72 89 97 129 Exploitations avec excédent de financement 5 % 65 57 65 66 73 Stabilité financière Exploitation en situation financière saine 6 % 47 32 45 51 56 Exploitations avec faible autonomie financière 7 % 27 17 27 28 36 Exploitations avec faible revenu 8 % 12 24 14 9 3 Exploitations en situation financière précaire 9 % 14 27 14 12 5 Productivité Productivité du travail 10 fr /UTA 45 447 24 499 37 770 49 718 67 631 Productivité des surfaces 11 fr /ha 4 256 3 078 3 989 4 396 4 945 Productivité du capital 12 % 12 1 6 8 10 9 13 2 16 5 Rentabilité Rentabilité du capital total 13 % -2 2 -7 9 -4 8 -1 3 3 6 Rentabilité du capital propre 14 % -6 6 -18 1 -11 5 -4 7 4 2 Revenu du travail de la main-d'oeuvre familiale 15 fr /UTAF 32 114 7 607 24 504 36 833 60 296 (moyenne) Revenu du travail de la main-d'oeuvre familiale 15 fr /UTAF 30 439 (médiane)
Tableau 24
Résultats d'exploitation par quartile: région de montagne* – 1998/2000
1 Taux d'intérêt moyen des obligations de la Confédération (1998: 2 81%; 1999: 3 02%; 2000: 3 95%)
2 Investissements bruts (sans prestations propres), déduction faite des subventions et des désinvestissements
3 Formation de capital propre (sans prestations propres), plus amortissements, plus/moins changements stocks et actif bétail
4 Rapport entre cash flow et total des investissements
5 Part d’exploitations avec cash flow > total des investissements
6 Part de capitaux étrangers <50% et formation de capital propre positive
7 Part de capitaux étrangers >50% et formation de capital propre positive
8 Part de capitaux étrangers <50% et formation de capital propre négative
9 Part de capitaux étrangers >50% et formation de capital propre négative
10 Rapport entre revenu de l'exploitation et main-d'oeuvre de l'exploitation
11 Rapport entre revenu de l'exploitation et surface agricole utile
12 Rapport entre revenu de l'exploitation et actifs totaux
13 Rapport entre (service de la dette plus bénéfice/pertes calculés plus intérêts sur le capital propre) et actifs de l'exploitation
14 Rapport entre (bénéfice/pertes calculés plus intérêts sur le capital propre) et capital propre de l’exploitation
15 Rapport entre (revenu agricole moins intérêts sur le capital propre) et unités de travail annuel de la famille (UTAF)
* Région de montagne: zones de montagne II à IV
Source: dépouillement centralisé, FAT
A N N E X E A25
ventilées selon le revenu du travail Caractéristique Unité Moyenne 1er quartile 2e quartile 3e quartile 4e quartile (0 –25%) (25 –50%) (50 –75%) (75 –100%) Exploitations de référence Nombre 913 191 214 238 269 Exploitations représentées Nombre 14 512 3 639 3 622 3 628 3 624 Structure d'exploitation Surface agricole utile ha 18 12 13 78 15 69 18 56 24 48 Terres ouvertes ha 0 28 0 13 0 16 0 30 0 54 Main-d'oeuvre de l'exploitation UTA 1 59 1 57 1 63 1 59 1 56 dont main-d'oeuvre familiale UTAF 1 38 1 35 1 46 1 41 1 30 Vaches, total Nombre 11 8 9 4 11 0 11 9 15 0 Animaux, total UGB 20 9 16 9 18 7 21 6 26 4 Structure du capital Actifs totaux fr 566 033 526 395 511 774 568 715 657 445 dont: actifs circulants fr 100 187 76 240 92 488 103 038 129 108 dont: actif bétail fr 37 425 29 717 34 069 38 949 46 993 dont: immobilisations fr 428 421 420 438 385 217 426 728 481 344 dont: actifs de l'exploitation fr 535 079 502 767 488 196 539 179 610 338 Part de capitaux étrangers % 40 41 41 39 41 Intérêt calculé du capital propre de l'exploitation 1 fr 10 308 9 772 9 410 10 442 11 613 Compte d'exploitation Rendement brut total fr 133 067 100 337 117 769 137 689 176 594 dont: paiements directs fr 49 124 40 810 45 568 49 798 60 352 Charges matérielles fr 76 469 70 716 70 713 76 389 88 072 Revenu de l'exploitation fr 56 598 29 621 47 056 61 300 88 522 Frais de main-d'oeuvre fr 5 017 5 242 3 988 4 483 6 354 Service de la dette fr 5 633 5 539 5 161 5 382 6 448 Fermages fr 2 877 2 145 2 309 3 061 3 997 Charges réelles fr 89 996 83 643 82 170 89 315 104 871 Revenu agricole fr 43 071 16 695 35 598 48 374 71 723 Revenu accessoire fr 18 923 25 707 18 358 15 902 15 696 Revenu total fr 61 994 42 402 53 956 64 276 87 419 Consommation de la famille fr 51 207 44 036 48 819 53 172 58 830 Formation de capital propre fr 10 787 -1 634 5 137 11 104 28 589 Investissements et financement Total des investissements 2 fr 38 122 33 880 30 433 39 248 48 952 Cash flow 3 fr 34 146 22 907 27 316 33 281 53 123 Rapport entre cash flow et investissements 4 % 90 69 89 85 111 Exploitations avec excédent de financement 5 % 65 55 64 68 71 Stabilité financière Exploitation en situation financière saine 6 % 48 31 48 53 62 Exploitations avec faible autonomie financière 7 % 22 14 17 27 27 Exploitations avec faible revenu 8 % 16 32 19 10 5 Exploitations en situation financière précaire 9 % 14 23 16 10 6 Productivité Productivité du travail 10 fr /UTA 35 642 18 844 28 934 38 493 56 713 Productivité des surfaces 11 fr /ha 3 120 2 153 3 000 3 302 3 608 Productivité du capital 12 % 10 6 5 9 9 6 11 4 14 5 Rentabilité Rentabilité du capital total 13 % -4 6 -9 9 -7 5 -3 9 1 4 Rentabilité du capital propre 14 % -9 7 -18 6 -14 7 -8 2 0 6 Revenu du travail de la main-d'oeuvre familiale 15 fr /UTAF 23 770 5 156 17 987 26 956 46 094 (moyenne) Revenu du travail de la main-d'oeuvre familiale 15 fr /UTAF 22 157 (médiane)
Tableau 25
Résultats des exploitations selon la région, le type d'exploitation et le quartile:
1990/92–1998/2000
A26 A N N E X E
Unité Toutes les Région de plaine Région des collines Région de montagne
Revenu selon la région 1990/92 1998/2000 1990/92 1998/2000 1990/92 1998/2000 1990/92 1998/2000 Surface agricole utile ha 16 06 18 42 16 66 19 21 15 30 17 36 15 76 18 12 Main-d'oeuvre familiale UTAF 1 39 1 30 1 36 1 26 1 40 1 29 1 42 1 38 Revenu agricole fr 62 822 57 181 73 794 68 197 59 838 52 010 45 541 43 071 Revenu accessoire fr 16 264 18 700 16 429 17 631 14 544 20 315 17 853 18 923 Revenu total fr 79 086 75 881 90 223 85 828 74 382 72 325 63 394 61 994 Revenu du travail par unité de main-d'oeuvre de la famille fr /UTA 31 025 34 667 36 924 42 941 30 335 32 114 21 201 23 770 Unité Grandes cultures Cultures spéciales Lait commercialisé Vaches-mères Revenu selon le type d'exploitation 1990/92 1998/2000 1990/92 1998/2000 1990/92 1998/2000 1990/92 1998/2000 Surface agricole utile ha 21 23 22 34 8 92 12 80 15 30 17 86 15 32 17 07 Main-d'oeuvre familiale UTAF 1 08 1 04 1 29 1 33 1 42 1 35 1 20 1 11 Revenu agricole fr 60 284 65 853 67 184 72 405 53 923 50 295 36 627 44 406 Revenu accessoire fr 26 928 23 652 21 555 19 334 16 044 17 946 33 558 32 486 Revenu total fr 87 212 89 505 88 739 91 739 69 967 68 241 70 185 76 892 Revenu du travail par unité de main-d'oeuvre de la famille fr /UTA 34 375 49 712 30 334 42 625 26 471 29 308 17 348 29 319 Unité Autre Chevaux/moutons/ Transformation bétail bovin chèvres Revenu selon le type d'exploitation 1990/92 1998/2000 1990/92 1998/2000 1990/92 1998/2000 Surface agricole utile ha 14 20 14 89 Seules sept 13 33 9 34 11 05 Main-d'oeuvre familiale UTAF 1 37 1 29 exploitations 1 14 1 35 1 12 Revenu agricole fr 38 407 34 299 disponibles 22 784 86 288 57 572 Revenu accessoire fr 20 570 20 915 30 162 14 614 16 151 Revenu total fr 58 977 55 214 52 946 100 902 73 723 Revenu du travail par unité de main-d'oeuvre de la famille fr /UTA 16 793 19 628 13 646 48 182 39 805 Unité Exploitations Exploitations Exploitations Autres combinées: combinées: combinées: exploitations grandes cultures + lait vaches-mères transformation combinées Revenu selon le type d'exploitation 1990/92 1998/2000 1990/92 1998/2000 1990/92 1998/2000 1990/92 1998/2000 Surface agricole utile ha 20 37 23 98 17 93 23 87 15 59 18 53 17 24 19 58 Main-d'oeuvre familiale UTAF 1 45 1 35 1 24 1 22 1 40 1 31 1 43 1 29 Revenu agricole fr 75 368 71 330 51 161 62 804 84 363 72 357 66 705 58 563 Revenu accessoire fr 11 802 13 507 20 475 23 281 12 032 16 154 15 000 19 814 Revenu total fr 87 170 84 837 71 636 86 085 96 395 88 511 81 705 78 377 Revenu du travail par unité de main-d'oeuvre de la famille fr /UTA 36 420 42 509 27 456 41 639 42 927 44 097 32 732 35 757 Unité 1er quartile 2ème quartile 3ème quartile 4ème quartile (0–25%) (25–50%) (50–75%) (75–100%) Revenu selon le quartile (revenu du travail) 1990/92 1998/2000 1990/92 1998/2000 1990/92 1998/2000 1990/92 1998/2000 Surface agricole utile ha 14 68 14 05 15 30 16 64 15 78 19 36 18 47 23 66 Main-d'oeuvre familiale UTAF 1 36 1 29 1 49 1 38 1 42 1 34 1 27 1 19 Revenu agricole fr 26 883 20 995 52 294 45 081 69 198 64 939 102 975 97 761 Revenu accessoire fr 27 789 27 100 14 629 18 391 12 064 15 414 10 557 13 883 Revenu total fr 54 672 48 095 66 923 63 472 81 262 80 353 113 532 111 644 Revenu du travail par unité de main-d'oeuvre de la famille fr /UTA 4 367 7 839 23 592 24 981 36 016 39 156 62 665 69 767 Source: dépouillement centralisé, FAT
exploitations
■■■■■■■■■■■■■■■■ Tableaux Dépenses de la Confédération
A N N E X E A27
Dépenses Production et ventes Tableau 26 Promotion des ventes: répartition des fonds Secteur Secteur produit-marché Compte 2000 Fonds attribués 2001 fr fr Production laitière 35 788 653 37 462 604 Fromage, étranger 26 975 377 27 730 019 Fromage, Suisse 2 462 776 3 849 000 Lait 6 350 500 5 883 585 Production animale 2 575 391 3 059 894 Viande 1 523 571 1 861 144 Oeufs 720 000 650 000 Poissons 8 250 0 Animaux vivants 313 550 548 750 Miel 10 020 0 Production végétale 5 704 595 6 264 552 Légumes 1 465 631 1 765 168 Fruits 1 613 305 1 904 684 Céréales 1 048 627 770 000 Pommes de terre 1 125 000 750 000 Oléagineux 452 032 374 700 Plantes ornementales 700 000 Mesures prises en commun 4 170 782 5 151 450 Mesures suprasectorielles (bio, PI) 1 539 906 1 911 500 Réservés pour les décomptes finales et les engagements à long terme 7 868 615 3 500 000 National 57 647 942 57 350 000 Régional 1 1 873 084 2 500 000 Total 59 521 026 59 850 000 1 Planification continue Source: OFAG
Tableau 27
Dépenses en économie laitière
A28 A N N E X E
Désignation Compte 1999 Compte 2000 Budget 2001 fr fr fr Mesures transitoires et liquidations Mesures transitoires temporaires 567 683 912 Liquidation de la Butyra 5 000 000 Liquidation de l'Union suisse du commerce de fromage 100 000 000 672 683 912 Soutien du marché (suppléments et aides) Supplément pour le lait transformé en fromage 108 968 404 280 058 833 320 900 000 Supplément de non-ensilage 30 031 589 50 693 222 49 000 000 Aides pour le beurre accordées dans le pays 89 627 206 108 493 186 114 200 000 Aides pour le lait écrémé et la poudre de lait accordées dans le pays 31 963 298 57 780 162 57 700 000 Aides pour le fromage accordées dans le pays 19 342 307 27 139 882 10 950 000 Aides à l'exportation de fromages 75 388 626 159 647 903 85 500 000 Aides à l'exportation d'autres produits laitières 19 364 575 24 886 812 21 200 000 374 686 005 708 700 000 659 450 000 Soutien du marché (administration) Commissions de recours "Contingentement laitier" 58 788 83 770 100 000 Administration de la mise en valeur du lait et du contingentement laitier 4 799 622 7 372 665 6 600 000 4 858 410 7 456 435 6 700 000 Total 1 052 228 327 716 156 435 666 150 000 Sources: Compte d’Etat, OFAG
Tableau 28
Dépenses en économie animale
A N N E X E A29
Désignation Compte 1999 Compte 2000 Budget 2001 fr fr fr Fonds «viande» Indemnités versées à des organisations privées du bétail de boucherie et de la viande 4 800 000 7 373 585 Achat de viande de boeuf destinée à l'aide humanitaire 6 000 000 0 Contributions au stockage de viande de veau 3 814 856 1 466 554 Contributions au stockage de viande de boeuf provenant d'animaux d'étal (taureaux, génisses, boeufs) 1 508 931 2 035 345 Contributions au stockage de viande de boeuf provenant d'animaux destinés à la transformation (vaches) 499 716 1 988 930 Contributions destinées à réduire le prix des cuisses de boeuf 1 241 387 199 041 Vente promotionnelle de veaux à saucisse 16 311 0 17 881 201 13 065 455 16 000 000 Caisse de compensation des prix des oeufs et des produits à base d’oeufs Contributions pour la conversion à l'élevage particulièrement respectueux des pondeuses 5 840 190 3 388 478 Contributions aux frais de ramassage et de calibrage 4 376 741 3 898 951 Actions de cassage d'oeufs du pays 1 030 045 1 202 531 Campagnes de ventes à prix réduits 552 750 729 217 Essais pratiques sur la volaille 199 867 121 629 TVA: réduction de la taxe perçue en amont 108 959 0 12 108 552 9 340 806 13 625 000 Bétail d’élevage et de rente Contributions à l'exporation de bétail d'élevage et de rente provenant de la région de montagne 919 700 2 768 200 Expositions 512 860 20 803 Achats destinés à alléger le marché et autres mesures 162 721 0 1 595 281 2 789 003 17 000 000 Contributions à la mise en valeur de laine de mouton 1 000 000 1 000 000 800 000 Total 32 585 034 26 193 264 47 425 000 Sources: Compte d’Etat, OFAG
Tableau 29
Dépenses pour la production végétale
A30 A N N E X E
Désignation Compte 1999 Compte 2000 Budget 2001 fr fr fr Contributions à la culture des champs 53 043 064 56 391 275 37 580 000 Contributions à la surface pour oléagineux 3 191 737 27 175 149 32 250 000 Contributions à la surface pour légumineuses à graines 3 409 376 3 671 201 3 654 000 Contributions à la surface pour plantes à fibres 940 425 525 190 800 000 Primes de culture pour céréales fourragères 45 501 526 25 019 735 876 000 Contributions de transformation et de mise an valeur 122 960 705 90 687 642 98 220 000 Transformation de sucre 32 589 784 46 829 775 48 000 000 Transformation d'oléagineux 36 809 863 1 481 824 4 000 000 Transformation de pommes de terre 12 367 967 18 909 564 19 500 000 Production de semences 2 066 126 3 465 960 3 600 000 Mise en valeur de fruits 39 126 965 19 283 193 21 495 000 Transformation de MPR 0 717 326 1 625 000 Promotion de la culture viti-vinicole 7 175 779 5 746 598 7 120 700 Frais de biens et de services 88 199 81 263 83 500 Promotion de la viticulture 1 349 030 1 061 542 1 100 000 Mesures de valorisation 1 5 738 550 4 603 793 5 937 200 Total 183 179 548 152 825 515 142 920 700 1 Promotion de la vente de vins à l’étranger Sources: Compte d’Etat, OFAG
Dépenses Paiements directs
A N N E X E A31 Tableau 30 Evolution des paiements directs 1999 2000 Type de contribution 1 000 fr 1 000 fr Total paiements directs 2 105 327 2 164 967 Paiements directs généraux 1 778 807 1 803 658 Contributions à la surface 1 163 094 1 186 770 Contributions pour la garde d'animaux consommant des fourrages grossiers 254 624 258 505 Contributions pour la garde d'animaux dans des conditions difficiles 255 882 251 593 Contributions générales pour des terrains en pente 95 882 96 714 Contributions pour les surfaces viticoles en pente 9 325 10 076 Paiements directs écologiques 326 520 361 309 Contributions écologiques 258 788 278 981 Contributions à la compensation écologique 100 674 108 130 Contributions pour la culture extensive de céréales et de colza (culture extensive) 35 135 33 398 Contributions pour les prairies extensives sur terres assolées gelées (disposition transitoire, jusqu'à fin 2000) 17 652 17 150 Contributions pour la culture biologique 11 637 12 185 Contributions pour la garde d'animaux de rente particulièrement respectueuse de l'espèce 93 690 108 118 Contribution d'estivage 67 571 81 238 Contributions pour la protection des eaux 161 1 090 Source: OFAG
Tableau 31a
Paiements directs généraux – 2000
A32 A N N E X E
Contributions à la surface Contributions pour animaux cons des fourrages grossiers Exploitations Surface Total contributions Exploitations UGBFG Total contributions nombre ha fr nombre nombre fr Canton ZH 3 933 71 299 81 656 183 2 000 14 065 12 067 800 BE 13 235 188 613 222 489 468 8 643 53 558 48 322 602 LU 5 275 76 810 91 197 863 3 098 18 458 17 146 207 UR 696 6 685 7 665 906 638 5 288 4 574 181 SZ 1 765 24 015 27 133 288 1 539 13 249 11 536 226 OW 733 8 103 9 357 179 635 3 691 3 276 496 NW 516 6 098 7 026 440 422 2 325 2 028 969 GL 440 7 224 8 595 561 422 3 506 3 098 798 ZG 614 10 700 12 327 698 407 2 688 2 403 884 FR 3 451 75 686 88 455 839 2 218 14 855 13 275 834 SO 1 482 31 422 36 241 329 987 8 212 7 184 661 BL 983 21 308 24 442 179 679 5 703 4 976 753 SH 600 13 981 15 624 759 249 2 267 2 025 752 AR 800 12 047 14 154 172 659 4 451 4 117 365 AI 607 7 277 8 688 924 391 2 099 2 115 915 SG 4 662 72 580 83 815 725 3 554 26 442 22 813 141 GR 2 915 51 470 59 016 740 2 776 34 618 28 435 534 AG 3 257 57 907 66 561 901 1 643 12 106 10 600 927 TG 2 864 49 736 58 111 340 942 5 590 4 678 817 TI 955 12 865 14 664 487 749 6 898 5 331 266 VD 4 171 104 982 118 940 350 1 920 17 534 15 447 584 VS 4 041 36 899 40 620 001 2 516 18 136 13 101 899 NE 1 007 33 104 36 868 217 718 6 848 6 232 564 GE 334 10 874 10 653 599 96 1 246 1 029 296 JU 1 137 38 215 42 460 670 945 14 278 12 682 197 Suisse 60 473 1029 899 1186 769 818 38 846 298 112 258 504 668 Zone 1 Plaine 25 615 481 194 552 878 415 10 899 77 507 67 444 422 Collines 8 506 143 727 166 838 240 5 363 35 677 31 005 465 ZM I 7 852 119 363 138 656 422 6 029 37 937 33 259 616 ZM II 9 517 155 501 178 544 715 7 823 63 340 56 926 768 ZM III 5 921 85 141 98 129 424 5 746 55 652 47 262 079 ZM IV 3 062 44 972 51 722 602 2 986 27 998 22 606 318 1 Attribution de la surface selon la zone dans laquelle se situe la majeure partie de la SAU de l’exploitation Source: OFAG
Tableau 31b
Paiements directs généraux – 2000
A N N E X E A33
Garde d'animaux dans des conditions Contributions générales Contributions pour les vignobles de production difficiles pour les terrains en pente en forte pente et en terrasses Total Total Total Exploitations UGBFG contributions Exploitations Surface contributions Exploitations Surface contributions nombre nombre fr nombre ha fr nombre ha fr Canton ZH 852 11 337 3 565 855 828 5 331 2 187 963 212 196 374 655 BE 9 384 115 898 64 060 450 8 756 48 366 20 285 876 67 107 349 929 LU 3 177 40 951 18 529 450 3 375 21 735 9 072 311 10 16 27 120 UR 689 7 619 6 637 343 645 4 729 2 243 069 000 SZ 1 566 19 973 11 666 514 1 524 10 186 4 358 654 10 7 13 980 OW 699 9 176 5 385 601 673 4 858 2 231 970 10 750 NW 481 6 368 3 360 054 462 3 847 1 719 639 000 GL 397 5 166 3 839 832 387 3 362 1 527 361 12 7 950 ZG 394 5 415 2 519 490 376 3 051 1 249 210 10 930 FR 1 919 28 124 10 576 815 1 645 7 465 2 950 461 20 14 21 430 SO 618 8 101 3 135 659 595 5 013 1 922 938 000 BL 707 9 224 2 598 739 695 6 127 2 354 211 39 36 61 905 SH 124 1 528 260 675 147 874 328 314 123 96 158 100 AR 794 10 610 6 100 054 792 6 635 2 794 851 28 24 425 AI 598 7 841 5 204 374 581 3 368 1 405 031 000 SG 3 022 40 116 19 461 926 3 078 25 338 10 565 184 75 105 280 625 GR 2 798 34 494 33 252 111 2 709 31 416 13 724 728 31 23 51 045 AG 1 112 14 270 2 985 162 1 235 7 892 3 030 895 124 170 289 140 TG 168 2 396 824 582 149 1 188 527 429 81 102 157 470 TI 707 7 233 5 901 017 596 3 134 1 383 395 179 163 315 020 VD 1 353 18 561 8 153 310 1 028 5 874 2 328 740 350 520 1 871 910 VS 2 512 21 695 19 860 297 2 404 12 959 5 808 527 1 402 1 641 5 818 205 NE 830 12 397 7 500 298 596 3 537 1 330 260 55 81 153 555 GE 000000 48 58 89 265 JU 806 11 820 6 213 510 604 3 581 1 382 521 26 9 090 Suisse 35 707 450 313 251 593 118 33 880 229 867 96 713 538 2 833 3 352 10 076 499 Zone 1 Plaine 2 303 32 727 2 988 916 2 113 569 645 2 286 660 1 787 2 251 6 712 235 Collines 7 945 104 933 27 108 851 7 372 3 893 567 15 224 926 194 285 731 373 ZM I 7 556 97 987 43 314 273 7 143 4 802 299 19 617 806 201 235 677 436 ZM II 9 003 114 608 78 407 082 8 445 6 209 709 26 237 620 500 526 1 758 605 ZM III 5 857 66 923 61 889 128 5 783 4 837 045 21 270 534 106 43 156 530 ZM IV 3 043 33 135 37 884 868 3 024 2 674 427 12 075 992 45 12 40 320 1 Attribution de la surface selon la zone dans laquelle se situe la majeure partie de la SAU de l’exploitation Source: OFAG
Tableau 32a
Contributions écologiques – 2000
1 Arbres fruitiers haute-tige convertis en ares 2 Attribution de la surface selon la zone dans laquelle se situe la majeure partie de la SAU de l’exploitation 3 SG, OW, AR, SZ: Sans les surfaces sous contrat LPN et montants «socle» correspondant
A34 A N N E X E
Compensation écologique 1 Agriculture biologique Exploitations Surface Total contributions Exploitations Surface Total contributions nombre ha fr nombre ha fr Canton ZH 3 845 8 153 11 108 458 311 5 674 1 165 475 BE 12 823 17 947 16 381 414 1 179 16 341 2 296 676 LU 5 255 8 637 9 387 067 229 3 466 513 824 UR 693 1 228 624 653 36 392 39 569 SZ 3 1 644 2 440 2 150 366 108 1 616 164 499 OW 3 732 1 072 899 320 97 1 193 120 440 NW 519 937 750 825 49 645 67 176 GL 437 1 131 687 515 67 1 114 111 121 ZG 615 1 525 1 627 373 68 1 185 137 794 FR 3 356 5 952 5 955 925 71 1 215 349 457 SO 1 468 3 870 4 494 006 105 2 601 399 348 BL 975 3 198 4 086 339 120 2 608 440 206 SH 571 1 408 1 968 541 15 307 95 929 AR 3 652 639 547 794 130 2 053 205 872 AI 442 483 349 484 22 331 33 021 SG 3 4 283 6 038 6 858 755 420 6 820 780 155 GR 2 844 14 872 5 887 107 1 075 21 490 2 324 369 AG 3 205 6 690 8 706 732 183 3 134 758 141 TG 2 798 4 978 6 806 186 177 2 789 731 652 TI 852 1 531 1 032 444 86 1 254 185 486 VD 3 851 7 806 9 148 575 79 1 471 419 732 VS 2 367 5 766 3 258 408 186 2 639 470 094 NE 775 1 941 1 469 101 37 1 013 151 339 GE 291 643 1 050 702 5 82 53 816 JU 1 102 2 966 2 892 466 49 1 388 169 714 Suisse 56 395 111 851 108 129 556 4 904 82 822 12 184 905 Zone 2 Plaine 24 111 43 245 58 884 749 982 16 186 4 585 204 Collines 8 370 16 626 19 297 401 484 8 095 1 360 989 ZM I 7 505 11 460 10 080 179 633 9 579 1 158 615 ZM II 8 143 13 551 9 303 813 1 031 16 742 1 736 100 ZM III 5 391 14 486 6 043 829 1 045 18 402 1 945 169 ZM IV 2 875 12 483 4 519 585 729 13 818 1 398 828
Source:
OFAG
Tableau 32b
Contributions écologiques – 2000
A N N E X E A35
Production extensive de Garde particulièrement respectueuse céréales et de colza des animaux de rente agricoles Exploitations Surface Total contributions Exploitations UGB Total contributions nombre ha fr nombre nombre fr Canton ZH 1 745 6 664 2 661 570 1 757 53 821 6 324 034 BE 6 288 19 530 7 810 786 7 665 170 708 21 755 863 LU 1 626 4 082 1 632 624 3 272 112 422 13 639 756 UR 000 306 4 519 570 587 SZ 27 36 14 300 757 16 971 2 118 961 OW 12 800 364 8 055 1 016 436 NW 000 225 5 846 718 856 GL 68 3 112 253 5 783 743 941 ZG 89 192 76 748 349 11 533 1 383 334 FR 1 422 6 450 2 579 977 2 083 72 464 9 167 461 SO 907 4 468 1 782 184 881 23 951 2 879 433 BL 728 3 722 1 471 015 456 16 168 1 901 681 SH 360 2 740 1 079 859 211 8 506 962 617 AR 000 525 12 459 1 621 592 AI 000 367 8 775 1 188 861 SG 488 1 018 398 487 2 372 70 886 8 902 879 GR 391 983 392 957 2 048 45 770 5 633 103 AG 1 935 8 134 3 251 959 1 492 46 081 5 495 340 TG 1 039 3 212 1 283 749 1 563 55 325 6 506 820 TI 85 118 122 371 674 13 052 1 557 380 VD 1 916 12 381 4 947 407 1 551 54 505 6 372 754 VS 148 423 166 570 848 9 975 1 260 133 NE 499 3 147 1 257 623 561 19 030 2 260 558 GE 181 2 466 946 909 46 1 675 183 980 JU 601 3 802 1 517 457 807 34 985 3 952 014 Suisse 20 482 83 577 33 398 464 31 433 883 266 108 118 374 Zone 1 Plaine 11 916 55 327 22 102 587 12 131 426 566 50 925 071 Collines 4 749 17 332 6 924 472 4 782 144 165 17 737 584 ZM I 2 545 8 004 3 203 789 4 369 112 715 14 116 941 ZM II 1 002 2 607 1 044 916 5 195 116 542 14 802 024 ZM III 222 268 107 316 3 301 56 731 7 181 239 ZM IV 48 38 15 384 1 655 26 546 3 355 515 1 Attribution de la surface selon la zone dans laquelle se situe la majeure partie de la SAU de l’exploitation Source: OFAG
Tableau 33a
Contributions pour la compensation écologique – 2000
partie de la SAU de l’exploitation
A36 A N N E X E
Prairies extensives Prairies peu intensives Exploitations Surface Total contributions Exploitations Surface Total contributions nombre ha fr nombre ha fr Canton ZH 3 043 3 588 5 049 166 1 275 1 181 751 118 BE 6 819 5 532 5 201 819 8 171 6 940 3 375 693 LU 3 858 3 464 3 519 881 2 657 1 974 1 027 244 UR 378 443 226 068 507 635 200 496 SZ 2 790 651 463 764 672 593 250 129 OW 2 581 617 396 359 227 144 60 701 NW 371 446 279 504 233 190 81 235 GL 384 777 461 391 189 242 91 197 ZG 311 241 276 760 294 215 118 423 FR 1 833 1 788 2 265 570 2 250 2 905 1 680 896 SO 1 123 1 666 2 035 763 722 966 561 251 BL 706 925 1 087 115 499 626 379 517 SH 509 758 1 056 045 211 232 151 127 AR 2 275 125 90 957 432 285 129 246 AI 255 177 124 699 128 96 43 156 SG 2 2 058 1 390 1 562 670 2 347 1 782 971 212 GR 2 084 5 067 2 441 197 2 507 9 418 2 905 082 AG 2 410 2 823 3 789 452 1 489 1 268 817 103 TG 1 625 1 232 1 798 917 1 365 895 578 623 TI 496 571 437 228 454 770 273 642 VD 2 674 3 169 4 189 483 1 532 2 575 1 346 396 VS 885 1 246 720 409 1 729 3 737 1 263 901 NE 417 575 571 955 500 1 154 535 478 GE 253 416 623 700 20 38 24 627 JU 716 983 1 139 475 693 1 243 651 782 Suisse 34 854 38 672 39 809 343 31 103 40 106 18 269 274 Zone 1 Plaine 16 974 16 804 24 567 442 10 499 9 164 5 884 086 Collines 4 974 4 872 5 677 591 5 009 4 761 2 986 524 ZM I 3 676 3 180 2 308 012 4 495 3 952 1 810 074 ZM II 4 110 4 246 2 862 706 4 931 6 238 2 739 436 ZM III 3 235 5 677 2 620 190 3 737 7 738 2 358 193 ZM IV 1 885 3 893 1 773 402 2 432 8 252 2 490 961 1 Attribution de la surface selon la zone dans laquelle se
la majeure
2 SG, OW, AR, SZ: Sans les surfaces sous contrat LPN
Source: OFAG
situe
et montants «socle» correspondant
Tableau 33b
Contributions pour la compensation écologique – 2000
1 Attribution de la surface selon la zone dans laquelle se situe la majeure partie de la SAU de l’exploitation
2 SG, OW, AR, SZ: Sans les surfaces sous contrat LPN et montants «socle» correspondant
A N N E X E A37
Surfaces à litière Haies, bosquets champêtres et berges boisées Exploitations Surface Total contributions Exploitations Surface Total contributions nombre ha fr nombre ha fr Canton ZH 1 147 1 249 1 698 256 924 184 265 411 BE 748 535 335 117 1 995 427 443 648 LU 209 96 125 515 286 59 79 206 UR 39 37 27 531 10 84 SZ 2 554 435 295 659 20 159 OW 2 77 34 27 034 10 1 884 NW 116 95 81 483 15 2 1 279 GL 54 44 30 786 10 2 1 146 ZG 293 506 390 248 175 42 45 822 FR 83 39 40 232 771 235 311 554 SO 000 310 90 111 673 BL 000 241 70 85 285 SH 86 9 210 215 61 84 774 AR 2 57 11 7 581 42 9 6 345 AI 183 156 108 983 61 11 7 546 SG 2 415 164 146 306 185 35 41 631 GR 73 36 17 428 110 29 23 387 AG 96 50 72 794 971 288 377 039 TG 166 89 128 534 470 93 137 686 TI 28 31 44 570 12 3 4 142 VD 89 66 50 287 1 082 346 468 092 VS 53 18 12 336 292 78 55 179 NE 33 2 058 124 47 44 686 GE 35 8 235 112 34 50 940 JU 22 9 7 771 327 129 129 239 Suisse 4 516 3 712 3 667 952 8 743 2 275 2 776 834 Zone 1 Plaine 1 392 1 299 1 930 117 5 129 1 260 1 865 482 Collines 555 405 478 982 1 598 425 509 562 ZM I 658 458 347 450 895 259 188 269 ZM II 1 030 870 601 436 771 248 174 720 ZM III 622 451 206 702 279 69 32 597 ZM IV 259 227 103 265 71 14 6 205
Source: OFAG
Tableau 33c
Contributions pour la compensation écologique – 2000
A38 A N N E X E
Jachère florale Jachère tournante Exploitations Surface Total contributions Exploitations Surface Total contributions nombre ha fr nombre ha fr Canton ZH 307 182 545 340 132 147 367 900 BE 198 103 309 835 95 104 258 924 LU 62 36 107 910 16 17 42 075 UR 000000 SZ 000000 OW 000000 NW 000000 GL 13 7 800 000 ZG 88 24 000 23 7 900 FR 88 71 214 060 56 69 173 137 SO 30 18 54 900 30 38 95 050 BL 109 74 220 890 42 60 150 225 SH 111 57 170 490 35 57 141 950 AR 000000 AI 000000 SG 93 84 250 830 13 10 25 300 GR 12 7 22 020 88 19 550 AG 292 105 315 960 109 104 259 975 TG 94 58 175 170 55 72 179 800 TI 5 11 32 520 2 22 55 750 VD 207 292 877 170 154 186 464 900 VS 68 97 290 220 18 32 79 975 NE 27 30 90 990 12 27 67 325 GE 54 58 172 620 32 33 81 500 JU 30 21 63 420 19 31 76 600 Suisse 1 796 1 315 3 946 145 830 1 019 2 547 836 Zone 1 Plaine 1 493 1 126 3 379 516 712 887 2 218 214 Collines 290 182 546 420 117 130 324 122 ZM I 95 16 429 12 5 500 ZM II 31 3 390 000 ZM III 10 390 000 ZM IV 000000 1 Attribution de la surface selon la zone dans laquelle se situe la majeure partie de la SAU de l’exploitation Source: OFAG
Tableau 33d
Contributions pour la compensation écologique – 2000
1 Attribution de la surface selon la zone dans laquelle se situe la majeure partie de la SAU de l’exploitation
A N N E X E A39
Bandes culturales extensives Arbres frutiers haute-tige Exploitations Surface Total contributions Exploitations Arbres Total contributions nombre ha fr nombre nombre fr Canton ZH 21 6 5 690 2 682 161 698 2 425 434 BE 36 14 13 580 8 750 429 259 6 438 887 LU 91 1 010 4 460 298 945 4 484 176 UR 000 250 11 360 170 400 SZ 000 1 084 76 039 1 140 585 OW 000 499 27 621 414 315 NW 000 379 20 487 307 305 GL 000 146 6 344 95 160 ZG 000 544 50 948 764 222 FR 000 2 003 84 511 1 267 404 SO 41 1 460 1 207 108 927 1 633 905 BL 10 1 1 300 937 144 134 2 162 013 SH 71 1 440 388 23 567 353 505 AR 000 362 20 911 313 665 AI 000 76 4 340 65 100 SG 81 1 390 3 256 257 313 3 859 405 GR 31 550 570 30 555 458 325 AG 24 5 5 480 2 703 204 592 3 068 774 TG 14 4 3 840 2 372 253 592 3 803 617 TI 000 218 12 303 184 559 VD 34 9 8 980 2 220 116 231 1 743 465 VS 000 724 55 745 836 175 NE 30 400 185 10 414 156 210 GE 10 2 2 230 121 5 790 86 850 JU 61 1 080 680 54 874 823 110 Suisse 189 48 48 430 36 816 2 470 500 37 056 566 Zone 1 Plaine 154 43 43 138 17 979 1 266 129 18 991 332 Collines 32 5 5 162 7 336 584 563 8 768 441 ZM I 30 130 6 042 360 269 5 403 699 ZM II 000 4 086 194 787 2 921 799 ZM III 000 1 172 55 040 825 601 ZM IV 000 201 9 712 145 694
Source: OFAG
Tableau 34
Contributions pour la production extensive de céréales et de colza – 2000
A40 A N N E X E
Céréales panifiables Céréales fourragères Colza Total Contributions Surface Exploitations Surface Exploitations Surface Contributions nombre ha nombre ha nombre ha fr Canton ZH 1 275 4 092 1 309 2 282 200 290 2 661 570 BE 3 783 8 734 5 661 10 330 346 467 7 810 786 LU 936 1 625 1 379 2 353 73 104 1 632 624 UR 0000000 SZ 55 24 30 11 14 300 OW 120000 800 NW 0000000 GL 006800 3 112 ZG 24 40 77 141 8 12 76 748 FR 861 3 130 1 265 3 121 97 198 2 579 977 SO 634 2 284 810 2 065 69 118 1 782 184 BL 547 1 872 674 1 753 46 97 1 471 015 SH 344 2 144 196 496 62 100 1 079 859 AR 0000000 AI 0000000 SG 174 286 414 689 24 43 398 487 GR 164 427 354 544 8 11 392 957 AG 1 584 4 654 1 673 3 286 142 194 3 251 959 TG 824 2 088 679 992 84 132 1 283 749 TI 11 45 10 73 00 122 371 VD 998 5 929 1 617 5 274 518 1 179 4 947 407 VS 97 292 98 126 15 166 570 NE 197 909 484 2 105 50 132 1 257 623 GE 135 1 481 166 880 22 105 946 909 JU 303 1 470 542 2 180 50 153 1 517 457 Suisse 12 897 41 508 17 438 38 727 1 801 3 342 33 398 464 Zone 1 Plaine 8 576 31 557 9 495 21 059 1 430 2 711 22 102 587 Collines 3 085 7 586 4 311 9 219 317 527 6 924 472 ZM I 1 032 2 091 2 424 5 813 50 101 3 203 789 ZM II 147 225 955 2 379 43 1 044 916 ZM III 47 43 208 225 00 107 316 ZM IV 10 6 45 33 00 15 384 1 Attribution de la surface selon la zone dans laquelle se situe la majeure partie de la SAU de l’exploitation Source: OFAG
Tableau 35
Contributions pour la garde particulièrement respectueuse des animaux – 2000
A N N E X E A41
Systèmes de stabulation particulièrement Sorties régulières en plein air respectueux des animaux Exploitations UGB Total contributions Exploitations UGB Total contributions nombre nombre fr nombre nombre fr Canton ZH 891 18 688 1 577 920 1 656 35 114 4 746 114 BE 2 579 41 825 4 297 963 7 475 128 884 17 457 900 LU 1 900 41 748 4 212 484 3 095 70 674 9 427 272 UR 57 703 55 907 304 3 816 514 680 SZ 205 3 733 328 762 740 13 238 1 790 199 OW 124 1 982 193 867 348 6 074 822 569 NW 109 2 004 201 306 216 3 843 517 550 GL 42 748 63 197 253 5 034 680 744 ZG 170 3 494 306 186 335 8 039 1 077 148 FR 1 105 21 468 2 176 343 1 949 50 996 6 991 118 SO 441 7 399 650 203 819 16 552 2 229 230 BL 242 5 662 489 375 441 10 507 1 412 306 SH 157 4 521 427 729 173 3 985 534 888 AR 120 1 746 175 006 523 10 713 1 446 586 AI 99 1 936 255 364 360 6 839 933 497 SG 828 17 678 1 709 550 2 306 53 208 7 193 329 GR 478 8 856 658 308 2 046 36 914 4 974 795 AG 770 16 654 1 528 273 1 368 29 416 3 967 067 TG 788 20 325 1 815 553 1 450 35 001 4 691 267 TI 200 3 184 233 497 670 9 868 1 323 883 VD 882 20 785 1 806 792 1 396 33 719 4 565 962 VS 93 1 318 99 551 835 8 657 1 160 582 NE 205 5 258 417 783 547 13 773 1 842 775 GE 21 575 44 732 42 1 100 139 248 JU 437 12 948 1 022 959 774 22 037 2 929 055 Suisse 12 943 265 236 24 748 610 30 121 618 000 83 369 764 Zone 1 Plaine 6 724 158 722 14 877 304 11 244 267 823 36 047 767 Collines 2 371 46 408 4 494 730 4 528 97 751 13 242 854 ZM I 1 633 27 166 2 554 268 4 279 85 548 11 562 673 ZM II 1 352 21 181 1 944 602 5 134 95 360 12 857 422 ZM III 604 8 102 614 776 3 286 48 629 6 566 463 ZM IV 259 3 658 262 930 1 650 22 888 3 092 585 1 Attribution de la surface selon la zone dans laquelle se situe la majeure partie de la SAU de l’exploitation Source: OFAG
Tableau 36
Contributions d'estivage – 2000
A42 A N N E X E
Exploitations Vaches Chèvres Brebis Autres Autres Contributions traites laitières laitières moutons UGBFG Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre fr Canton ZH 10 0 11 00 741 126 360 BE 1 994 27 995 3 635 70 25 292 68 878 17 084 148 LU 266 1 287 168 0 2 640 9 343 1 813 432 UR 384 4 079 510 1 16 268 7 000 2 130 277 SZ 444 3 229 789 0 9 323 18 760 3 364 829 OW 284 4 494 206 0 2 737 7 654 2 466 493 NW 134 1 530 168 0 2 022 4 186 1 117 643 GL 119 3 582 132 0 4 173 5 813 1 883 889 ZG 5 32 200 175 30 152 FR 651 7 578 694 0 5 098 32 402 6 311 478 SO 67 170 20 77 4 383 676 792 BL 14 0000 854 121 464 SH 10000 141 25 904 AR 123 1 329 199 00 2 892 746 610 AI 144 1 710 380 0 912 3 111 941 883 SG 454 9 257 694 4 14 745 27 973 5 816 162 GR 1 055 20 214 3 568 454 64 789 85 764 13 863 885 AG 6000 192 310 40 000 TG 20000 155 20 713 TI 233 4 888 5 468 6 13 768 5 932 2 472 821 VD 681 12 012 294 327 7 876 31 696 8 722 375 VS 530 12 921 257 0 54 191 16 218 6 744 035 NE 165 812 30 852 6 391 1 171 637 GE 1000 723 0 10 169 JU 201 3 256 33 0 1 245 11 640 3 535 075 Total 7 968 120 375 17 213 862 226 923 352 412 81 238 226 Source: OFAG
Tableau 37a
Paiements directs au niveau des exploitations1: selon la zone et la classe de grandeur – 2000
1 Les résultats se basent sur les données du dépouillement centralisé de la FAT
2 Contributions d'estivage, contributions à la culture, anciennes contributions aux détenteurs de vaches, ancienne contribution à l'exploitation selon art 31a LAgr, anciennes contributions pour PI, contributions écologiques cantonales et privées
A N N E X E A43
Zone de plaine ZPC Caractéristique Unité 10 – 20 20 – 30 30 – 50 10 – 20 20 – 30 30 – 50 ha SAU ha SAU ha SAU ha SAU ha SAU ha SAU Exploitations de référence nombre 756 432 157 282 147 38 Exploitations représentées nombre 10273 5655 2706 3621 1514 676 Surface agricole utile ha 15 28 24 15 36 10 14 89 23 96 37 71 Paiements directs selon l'ordonnance sur les paiements directs (OPD) Paiements directs généraux totaux fr 19 649 30 806 44 195 25 517 39 315 59 459 Contributions à la surface fr 18 049 28 389 40 315 17 433 28 444 43 232 Contributions pour herbivores fr 1 454 2 205 3 639 2 597 4 080 9 323 Contributions pour la garde d'animaux dans des conditions de production difficiles fr 70 106 87 3 528 3 639 3 827 Contributions pour des terrains en pente fr 76 106 154 1 959 3 152 3 077 Contributions écologiques totales fr 5 494 7 762 11 334 5 579 8 253 11 248 Compensation écologique fr 2 312 3 091 5 047 2 121 3 750 4 493 Production extensive fr 786 1 136 1 724 733 1 221 2 375 Agriculture biologique fr 303 278 477 237 89 203 Garde particulièrement respectueuse des animaux fr 2 093 3 257 4 086 2 488 3 193 4 177 Total paiements directs selon OPD fr 25 143 38 568 55 529 31 096 47 568 70 707 Rendement brut fr 191 458 274 693 358 754 171 839 245 915 311 146 Part des PD selon OPD dans le rendement brut % 13 1 14 0 15 5 18 1 19 3 22 7 Autres paiements directs 2 fr 1 243 2 184 4 317 1 117 3 058 4 848 Total paiements directs fr 26 386 40 752 59 846 32 213 50 626 75 555 Part des PD totaux dans le rendement brut % 13 8 14 8 16 7 18 7 20 6 24 3
Source: FAT
Tableau 37b
Paiements directs au niveau des exploitations1: selon la zone et la classe de grandeur – 2000
1 Les résultats se basent sur les données du dépouillement centralisé de la FAT
2 Contributions d'estivage, contributions à la culture, anciennes contributions aux détenteurs de vaches, ancienne contribution à l'exploitation selon art 31a LAgr, anciennes contributions pour PI, contributions écologiques cantonales et privées
A44 A N N E X E
ZM I ZM II Caractéristique Unité 10 – 20 20 – 30 30 – 50 10 – 20 20 – 30 30 – 50 ha SAU ha SAU ha SAU ha SAU ha SAU ha SAU Exploitations de référence nombre 243 111 41 227 131 69 Exploitations représentées nombre 3 057 1 264 636 3 209 1 486 894 Surface agricole utile ha 14 90 24 40 35 13 15 23 24 37 37 56 Paiements directs selon l'ordonnance sur les paiements directs (OPD) Paiements directs généraux totaux fr 30 966 44 361 56 440 37 664 48 857 64 879 Contributions à la surface fr 17 686 28 766 40 723 17 658 27 148 40 786 Contributions pour herbivores fr 3 345 4 889 4 733 5 701 6 913 9 135 Contributions pour la garde d'animaux dans des contributions de production difficiles fr 6 579 6 845 6 916 10 118 10 202 10 734 Contributions pour des terrains en pente fr 3 356 3 861 4 068 4 187 4 594 4 224 Contributions écologiques totales fr 4 385 6 286 9 145 3 278 5 130 7 171 Compensation écologique fr 1 379 1 893 2 487 1 168 1 591 2 318 Production extensive fr 254 596 1 886 30 95 467 Agriculture biologique fr 302 341 363 240 596 532 Garde particulièrement respectueuse des animaux fr 2 450 3 456 4 409 1 840 2 848 3 854 Total paiements directs selon OPD fr 35 351 50 647 65 585 40 942 53 987 72 050 Rendement brut fr 159 713 217 729 260 544 137 169 178 377 228 087 Part des PD selon OPD dans le rendement brut % 22 1 23 3 25 2 29 8 30 3 31 6 Autres paiements directs 2 fr 889 1 557 3 435 1 615 2 748 3 055 Total paiements directs fr 36 240 52 204 69 020 42 557 56 735 75 105 Part des PD totaux dans le rendement brut % 22 7 24 0 26 5 31 0 31 8 32 9
Source: FAT
Tableau 37c
Paiements directs au niveau des exploitations1: selon la zone et la classe de grandeur – 2000
1 Les résultats se basent sur les données du dépouillement centralisé de la FAT
2 Contributions d'estivage, contributions à la culture, anciennes contributions aux détenteurs de vaches, ancienne contribution à l'exploitation selon art 31a LAgr, anciennes contributions pour PI, contributions écologiques cantonales et privées
A N N E X E A45
ZM III ZM IV Caractéristique Unité 10 – 20 20 – 30 30 – 50 10 – 20 20 – 30 30 – 50 ha SAU ha SAU ha SAU ha SAU ha SAU ha SAU Exploitations de référence nombre 122 64 21 77 40 18 Exploitations représentées nombre 1 923 875 280 1 378 526 295 Surface agricole utile ha 15 22 24 52 35 40 14 57 24 45 34 10 Paiements directs selon l'ordonnance sur les paiements directs (OPD) Paiements directs généraux totaux fr 44 689 60 860 75 737 46 258 62 635 77 008 Contributions à la surface fr 17 054 27 766 39 915 16 859 27 276 40 954 Contributions pour herbivores fr 9 713 12 279 13 425 9 118 11 476 11 177 Contributions pour la garde d'animaux dans des conditions de production difficiles fr 12 926 14 072 14 944 15 287 17 621 17 268 Contributions pour des terrains en pente fr 4 996 6 743 7 453 4 994 6 262 7 609 Contributions écologiques totales fr 2 846 4 315 6 737 2 507 4 566 6 476 Compensation écologique fr 1 013 1 557 2 445 1 278 2 059 3 626 Production extensive fr 0 13 175 00 14 Agriculture biologique fr 337 665 1 226 283 752 1 326 Garde particulièrement respectueuse des animaux fr 1 496 2 080 2 891 946 1 755 1 510 Total paiements directs selon OPD fr 47 535 65 175 82 474 48 765 67 201 83 484 Rendement brut fr 114 277 156 270 195 708 98 288 149 279 164 977 Part des PD selon OPD dans le rendement brut % 41 6 41 7 42 1 49 6 45 0 50 6 Autres paiements directs 2 fr 2 244 2 493 4 801 1 693 3 691 4 741 Total paiements directs fr 49 779 67 668 87 275 50 458 70 892 88 225 Part des PD totaux dans le rendement brut % 43 6 43 3 44 6 51 3 47 5 53 5
Source: FAT
Tableau 38
Paiements directs au niveau des exploitations1: selon la région – 2000
1 Les résultats se basent sur les données du dépouillement centralisé de la FAT
2 Contributions d'estivage, contributions à la culture, anciennes contributions aux détenteurs de vaches, ancienne contribution à l'exploitation selon art 31a LAgr, anciennes contributions pour PI, contributions écologiques cantonales et privées
A46 A N N E X E
Caractéristique Unité Toutes les Région Région Région exploitations de plaine des collines de montagne Exploitations de référence nombre 3 419 1 517 1 017 885 Exploitations représentées nombe 53 896 25 094 14 588 14 214 Surface agricole utile ha 18 78 19 41 17 83 18 63 Paiements directs selon l'ordonnance sur les paiements directs (OPD) Paiements directs généraux totaux fr 31 858 24 416 31 976 44 876 Contributions à la surface fr 21 513 22 321 20 734 20 885 Contributions pour herbivores fr 3 953 1 912 3 680 7 835 Contributions pour la garde d'animaux dans des conditions de production difficiles fr 4 428 69 4 871 11 671 Contributions pour des terraines en pente fr 1 964 114 2 691 4 485 Contributions écologiques totales fr 5 542 6 560 5 607 3 677 Compensation écologique fr 2 239 2 870 2 045 1 324 Production extensive 652 957 699 64 Agriculture biologique fr 316 301 218 443 Garde particulièrement respectueuse des animaux fr 2 335 2 432 2 645 1 846 Total paiements directs selon OPD fr 37 400 30 976 37 583 48 553 Rendement brut fr 199 145 242 054 183 249 139 707 Part des PD selon OPD dans le rendement brut % 19 13 21 35 Paiements directs par ha fr /ha 1 991 1 596 2 108 2 606 Autres paiements directs 2 fr 1 907 1 968 1 552 2 166 Total paiements directs fr 39 307 32 944 39 135 50 719 Part des PD totaux dans le rendement brut % 19 7 13 6 21 4 36 3
Source:
FAT
Dépenses
Tableau 39
Amélioration des bases de production
Montants versés aux cantons – 2000
A N N E X E A47
Canton Améliorations foncières Constructions rurales Total contributions fr fr fr ZH 1 850 118 410 600 2 260 718 BE 11 570 555 2 929 900 14 500 455 LU 2 938 222 1 171 200 4 109 422 UR 819 618 1 022 400 1 842 018 SZ 1 807 327 1 075 000 2 882 327 OW 489 560 608 000 1 097 560 NW 274 780 225 565 500 345 GL 347 620 557 800 905 420 ZG 11 000 199 200 210 200 FR 3 805 399 2 555 400 6 360 799 SO 1 709 940 196 600 1 906 540 BL 270 143 498 948 769 091 SH 75 000 201 500 276 500 AR 155 372 853 100 1 008 472 AI 492 966 298 000 790 966 SG 4 445 092 2 660 500 7 105 592 GR 9 958 507 2 149 400 12 107 907 AG 1 011 661 560 000 1 571 661 TG 1 191 201 25 800 1 217 001 TI 1 416 475 1 370 380 2 786 855 VD 6 391 430 808 300 7 199 730 VS 5 771 685 3 587 017 9 358 702 NE 858 942 1 132 500 1 991 442 GE 300 000 300 000 JU 2 856 093 1 049 065 3 905 158 Divers 35 216 35 216 Total 60 853 922 26 146 175 87 000 097 Source: OFAG
Tableau 40
Contributions pour des projets approuvés, par mesure et par région – 2000
A48 A N N E X E
Mesure Contributions Coût total Région Région Région Total Total de plaine des collines de montagne 1 000 fr Améliorations foncières Remaniements parcellaires (infrastructure incl ) 9 749 5 832 11 543 27 124 81 635 Construction de chemins 208 1 350 10 599 12 157 40 828 Autres installations de transport 00 245 245 757 Mesures relatives au régime hydrique du sol 446 - 1 392 1 838 6 259 Adductions d'eau - 3 225 5 460 8 685 30 817 Racc au réseau électrique - 142 338 480 1 922 Remise en état et préservation 30 595 5 462 6 087 15 823 Documentation 4 27 31 108 Total 10 437 11 144 35 066 56 647 178 149 Constructions rurales Bâtiments d'exploitation pour UGBFG - 7 496 16 171 23 667 148 515 Fosses à purin et fumières - 215 279 494 4 239 Bâtiments alpestres 1 124 1 124 8 216 Bâtiments communs pour transf et stockage - 70 42 112 990 Total - 7 781 17 616 25 397 161 960 Total 10 437 18 925 52 682 82 044 340 109 Source: OFAG
Tableau 41
Crédits d'investissements approuvés par les cantons – 2000
A N N E X E A49
Canton Mesures Mesures Total collectives individuelles Crédits de construction Crédits d'investissements Crédits d'investissements nombre 1 000 fr nombre 1 000 fr nombre 1 000 fr nombre 1 000 fr ZH 3 195 123 14 354 126 14 549 BE 30 6 335 12 1 039 413 39 844 455 47 218 LU 1 320 16 1 029 222 23 389 239 24 738 UR 1 200 1 30 23 2 126 25 2 356 SZ 26 4 709 54 5 804 80 10 513 OW 4 209 40 3 522 44 3 731 NW 14 1 507 14 1 507 GL 2 205 10 1 273 12 1 478 ZG 33 4 192 33 4 192 FR 9 686 191 19 920 200 20 606 SO 3 1 186 6 683 60 5 933 69 7 802 BL 35 4 173 35 4 173 SH 1 20 23 2 036 24 2 056 AR 1 30 46 3 533 47 3 563 AI 3 110 40 2 921 43 3 031 SG 1 200 4 234 216 21 682 221 22 116 GR 14 5 615 7 339 118 11 161 139 17 115 AG 1 24 134 13 070 135 13 094 TG 1 40 96 11 488 97 11 528 TI 2 800 7 326 21 2 030 30 3 156 VD 1 200 31 2 498 171 16 214 203 18 912 VS 22 4 536 13 1 365 80 7 493 115 13 394 NE 5 350 48 4 361 53 4 711 GE 2 380 5 463 7 843 JU 3 200 93 9 469 96 9 669 Total 101 24 101 132 9 992 2 309 231 958 2 542 266 051 Source: OFAG
Tableau 42
Crédits d'investissements ventilés selon les catégories de mesures – 2000 (sans les crédits de construction)
A50 A N N E X E
Canton Aide Achat Maison Bâtiment Amélio- Transformation Achat Total initiale d'exploitation d'habitation d'exploitation rations et stockage commun par fermier foncières de produits de cheptel agricoles vif / mort 1 000 fr ZH 4 255 441 2 686 7 132 35 14 549 BE 10 920 615 8 909 19 694 745 40 883 LU 7 205 7 605 8 580 796 232 24 418 UR 270 1 210 676 2 156 SZ 1 890 2 047 1 867 5 804 OW 580 984 1 985 162 20 3 731 NW 90 980 436 1 506 GL 130 274 1 029 45 1 478 ZG 1 840 280 252 1 820 4 192 FR 4 310 272 3 060 12 278 340 70 276 20 606 SO 2 910 156 1 000 1 867 643 40 6 616 BL 1 685 445 164 1 879 4 173 SH 710 50 1 276 20 2 056 AR 1 240 845 1 448 30 3 563 AI 620 979 1 323 110 3 032 SG 7 030 120 3 764 10 971 30 21 915 GR 2 760 3 749 4 772 38 131 50 11 500 AG 6 587 1 472 5 011 24 13 094 TG 3 765 1 523 6 240 11 528 TI 650 90 1 581 15 20 2 356 VD 7 215 118 1 641 8 312 675 751 18 712 VS 620 1 922 5 508 580 25 202 8 857 NE 1 532 190 544 2 095 235 115 4 711 GE 390 73 380 843 JU 2 180 1 332 5 857 200 100 9 669 Total 71 384 2 637 47 082 113 710 2 854 2 432 1 849 241 948 Source: OFAG
Tableau 43
Prêts au titre de l'aide aux exploitations approuvés par les cantons – 2000 (parts de la Confédération et des cantons)
A N N E X E A51
Canton Nombre Somme Par cas Durée d'amortisation 1 000 fr fr Années ZH 10 709 70 900 15 2 BE 85 7 971 93 776 13 6 LU 33 3 716 112 606 17 3 UR 1 100 100 000 20 0 SZ 7 679 97 000 13 2 OW 4 270 67 500 14 0 NW 2 140 70 000 14 0 GL ZG FR 6 505 84 167 10 8 SO 6 523 87 167 12 8 BL 8 535 66 875 5 1 SH 1 75 75 000 10 0 AR 9 461 51 222 8 3 AI 2 142 71 000 7 5 SG 21 1 940 92 381 14 0 GR 2 190 95 000 17 5 AG 9 1 010 112 222 14 2 TG 5 430 86 000 11 6 TI 4 370 92 500 17 0 VD 29 3 968 136 828 11 2 VS 66 6 943 105 197 10 5 NE 3 175 58 333 9 6 GE JU 03 210 70 000 8 6 Total 316 31 062 98 297 12 7 Source: OFAG
Tableau 44
Récapitulation des contributions, crédits d'investissements et prêts d'aide aux exploitations
A52 A N N E X E
Mesure Projets approuvés 1999 Projets approuvés 2000 1 000 fr Contributions 75 654 82 044 Remaniements parcellaires et mesures d'infrastructure 30 814 27 124 Construction de chemins 10 600 12 157 Adductions d'eau 5 807 8 685 Autres mesures de génie rural 3 310 8 681 Bâtiments d'exploitation pour UGBFG 22 055 23 667 Autres constructions rurales 3 068 1 730 Crédits d'investissements 1 204 719 241 951 Bâtiments d'exploitation 102 547 113 710 Aide initiale 57 525 71 385 Maisons d'habitation 33 679 47 082 Achat commun de cheptel vif/mort, transformation et stockage de produits agricoles 5 264 4 182 Achat d'exploitation par fermier 2 949 2 737 Améliorations foncières 2 755 2 855 Prêts au titre de l'aide aux exploitations 2 18 057 31 062 Total 298 430 355 057 1 Crédits approuvés par le canton 2 Prêts approuvés par le canton Source: OFAG
Tableau 45
Dépenses pour l’élevage – 2000
A N N E X E A53
Espèce et mesures Montant Eleveurs Animaux admis Organisations au herd-book d'élevage fr nombre Bovins 14 722 000 32 500 543 665 8 Gestion du herd-book 2 713 000 Contrôle laitier et de la performance carnée 11 230 000 Appréciation de la conformation 779 000 Chevaux 1 091 000 8 500 10 500 18 Porcs 1 792 000 280 16 882 2 Elevage d'animaux admis au herd-book 668 000 Centre des épreuves d'engraissement et 1 124 000 d'abattage du porc de Sempach Moutons 1 169 000 5 680 85 278 2 Chèvres et brebis laitières 808 000 4 622 23 596 4 Elevage d'animaux admis au herd-book 599 000 Contrôle laitier 209 000 Races menacées de disparition 102 000 2 Total 19 684 000 679 921 31 Sources: Compte d'Etat / Organisations d'élevage
le Compte d Etat 1999 sert de base à la répartition des moyens financiers pour les différents domaines
C'est ainsi que les dépenses pour la mise en valeur des pommes de terre et des fruits ou celles de l'Administration des blés de 1990/92 ont été englobées dans les dépenses de l OFAG, alors qu à l époque, les comptes étaient encore séparés
Les chiffres de 1990/92 ainsi que 1998 ne coïncident donc pas avec les données du Compte d'Etat
L augmentation des dépenses administratives s explique notamment par le fait que certaines prestations, par exemple celles à la caisse de pensions ne sont plus centralisées mais attribuées aux offices concernés
Sources: Compte d Etat, OFAG
A54 A N N E X E
de la Confédération pour l'agriculture et l'alimentation, en 1
de fr Domaine 1990/92 1998 1999 2000 1990/92–1998/2000 % Dépenses OFAG 2 699 442 3 518 568 3 794 868 3 359 161 31 8 Production et écoulement 1 684 994 1 203 247 1 317 539 954 696 -31 2 Promotion des ventes 49 546 59 521 Economie laitière 1 127 273 966 885 1 052 228 716 156 -19 1 Economie animale 133 902 34 743 32 585 26 193 -76 7 Production végétale et élevage 423 819 201 619 183 180 152 826 -57 7 Paiements directs 772 258 2 125 689 2 285 600 2 114 470 181 7 Paiements directs généraux 758 332 1 329 503 1 846 188 1 758 985 116 9 Paiements directs écologiques 13 926 796 186 439 412 355 485 3708 4 Amélioration des bases de production 208 761 147 153 148 467 245 503 -13 6 Améliorations structurelles 133 879 76 400 76 400 88 000 -40 0 Crédits d'investissement 27 136 20 000 20 000 100 000 72 0 Aide aux exploitations 952 2 000 4 987 7 753 416 1 Vulgarisation et contributions à la recherche 21 476 22 164 23 226 22 015 4 6 Lutte contre les maladies phytosanitaires et contre les parasites 1 449 5 639 3 354 6 735 261 8 Production végétale et élevage 23 869 20 950 20 500 21 000 -12 8 Administration 33 429 42 479 43 262 44 492 29 9 Autres dépenses 348 163 407 432 402 132 368 329 12 8 Contributions à l'exportation de produits agricoles de transformation 93 867 136 747 129 466 111 842 34 3 Allocations familiales dans l'agriculture 77 996 92 600 90 420 91 230 17 2 Stations de recherches agronomiques 96 431 97 060 99 472 117 619 8 6 Haras 6 843 8 825 5 525 6 514 1 6 Autres dépenses 73 026 72 199 77 249 54 687 -6 8 Total agriculture et alimentation 3 047 605 3 926 000 4 197 000 3 727 490 29 6 Remarque:
Tableau 46 Dépenses
000
Tableaux Aspects internationaux
1 UE-4 comprend les pays voisins Allemagne (D) France (F) Italie (I) et Autriche (A)
2 Pour l Italie en 2000, calculé selon l indice CE des prix à la production, valeur absolue
A N N E X E A55
Tableau 47
Produit Pays Unité 1990/92 1998 1999 2000 1990/92–1998/2000 % Lait cru CH ct /kg 104 97 82 10 80 93 79 41 -23 UE-4 1 ct /kg 56 33 50 79 48 70 49 08 -12 - D ct /kg 55 40 50 62 48 08 49 16 -11 - F ct /kg 48 97 48 92 47 03 47 20 -3 - I 2 ct /kg 69 20 56 48 54 58 54 08 -20 - A ct /kg 66 27 46 64 46 37 45 14 -31 USA ct /kg 40 57 49 25 47 60 45 81 17 Taureaux CH fr /kg PM 9 28 7 38 7 77 8 90 -14 UE-4 1 fr /kg PM 5 64 4 97 4 80 4 71 -14 - D fr /kg PM 5 38 4 46 4 27 4 18 -20 - F fr /kg PM 5 58 4 58 4 47 4 39 -20 - I fr /kg PM 5 86 5 13 5 06 4 88 -14 - A fr /kg PM 6 53 4 62 4 42 4 39 -31 USA fr /kg PM 3 40 2 86 3 14 3 82 -4 Porcs CH fr /kg PM 5 83 4 80 4 38 4 69 -21 UE-4 1 fr /kg PM 2 98 2 01 1 85 2 23 -32 - D fr /kg PM 2 77 1 93 1 80 2 20 -29 - F fr /kg PM 2 86 1 97 1 82 2 17 -30 - I 2 fr /kg PM 3 50 2 42 2 15 2 52 -32 - A fr /kg PM 3 38 1 66 1 53 1 87 -50 USA fr /kg PM 1 81 1 27 1 30 1 94 -17 Poulets CH fr /kg PV 3 72 2 97 2 84 2 81 -23 UE-4 1 fr /kg PV 1 64 1 22 1 12 1 15 -29 - D fr /kg PV 1 41 1 19 1 08 1 07 -21 - F fr /kg PV 1 31 1 13 1 01 1 02 -20 - I 2 fr /kg PV 1 91 1 44 1 36 1 45 -26 - A fr /kg PV 2 28 1 33 1 26 1 22 -44 USA fr /kg PV 0 98 1 27 1 21 1 34 29 Oeufs CH fr /100 pces 33 29 24 33 22 21 20 98 -32 UE-4 1 fr /100 pces 11 62 8 90 8 17 10 01 -22 - D fr /100 pces 13 58 9 89 8 83 10 65 -28 - F fr /100 pces 8 66 6 45 5 87 7 02 -26 - I 2 fr /100 pces 12 94 11 75 11 08 13 11 -7 - A fr /100 pces 12 81 7 50 6 62 13 47 -28 USA fr /100 pces 7 55 7 93 7 53 9 10 8
Prix à la production des produits animaux Suisse – divers pays
Sources: OFAG USP Eurostat U S Department of Agriculture
■■■■■■■■■■■■■■■■
Prix à la production des produits végétaux Suisse – divers pays
1 UE-4 comprend les pays voisins Allemagne (D), France (F), Italie (I) et Autriche (A)
2 Pour l'Italie en 2000, calculé selon l'indice CE des prix à la production, valeur absolue
3 UE-4 plus Pays-Bas (NL) et Belgique (B)
4 Moyenne des années 1990/93 et variation 1990/93–1997/2000
Sources:
A56 A N N E X E
Tableau 48a
Produit Pays Unité 1990/92 1998 1999 2000 1990/92–1998/2000 % Blé CH fr /100 kg 99 34 75 65 75 41 66 35 -27 UE-4 1 fr /100 kg 30 00 18 65 18 20 18 00 -39 - D fr /100 kg 27 94 17 97 17 72 17 81 -36 - F fr /100 kg 28 54 18 62 18 09 17 65 -37 - I 2 fr /100 kg 36 15 23 61 22 87 23 75 -35 - A fr /100 kg 43 38 17 05 16 95 16 73 -61 USA fr /100 kg 15 32 15 45 14 25 15 88 -1 Orge CH fr /100 kg 70 24 50 13 48 83 48 52 -30 UE-4 1 fr /100 kg 26 81 17 11 17 17 16 94 -36 - D fr /100 kg 25 39 16 22 16 34 15 85 -36 - F fr /100 kg 25 83 17 53 17 72 17 61 -32 - I 2 fr /100 kg 34 75 22 76 22 74 23 76 -34 - A fr /100 kg 36 27 16 10 15 73 14 90 -57 USA fr /100 kg 12 30 11 49 10 85 13 15 -4 Maïs-grain CH fr /100 kg 73 54 53 21 51 91 47 65 -31 UE-4 1 fr /100 kg 33 91 20 60 21 17 20 33 -39 - D fr /100 kg 31 13 20 13 18 45 17 29 -40 - F fr /100 kg 29 84 19 35 19 65 19 27 -35 - I 2 fr /100 kg 41 09 23 38 24 95 23 59 -42 - A fr /100 kg 36 60 17 05 16 98 16 91 -54 USA fr /100 kg 12 76 12 56 11 16 22 36 20 Pommes de terre CH fr /100 kg 38 55 35 27 37 76 36 12 -6 UE-6 3 fr /100 kg 23 68 20 76 23 83 10 32 -23 - D fr /100 kg 22 70 16 58 20 60 9 56 -31 - F fr /100 kg 15 65 20 98 23 99 10 51 18 - I 2 fr /100 kg 44 08 38 69 43 96 37 12 -9 - A fr /100 kg 30 46 17 00 16 85 17 33 -44 - NL fr /100 kg 16 47 23 77 26 27 5 40 12 - B fr /100 kg 12 63 18 09 17 06 6 41 10 USA fr /100 kg 18 08 18 06 19 47 21 31 8 Betteraves sucrières CH fr /100 kg 14 84 13 99 11 85 11 58 -16 UE-4 1 fr /100 kg 7 49 6 66 6 39 6 20 -14 - D fr /100 kg 8 06 7 02 6 88 6 43 -16 - F fr /100 kg 5 88 5 57 5 27 5 41 -8 - I 2 fr /100 kg 9 65 8 28 7 91 7 46 -18 - A (depuis 92) fr /100 kg 8 87 7 59 7 47 7 27 -16 USA fr /100 kg - - - -Colza CH fr /100 kg 203 67 147 89 146 11 61 26 -42 UE-4 1 fr /100 kg 49 10 35 96 26 45 28 42 -38 - D fr /100 kg 53 62 35 33 26 21 27 72 -45 - F fr /100 kg 42 19 36 67 26 94 29 33 -27 - I fr /100 kg 53 08 - - -- A (depuis 92) fr /100 kg 53 03 32 05 20 52 22 68 -53 USA fr /100 kg - - - -Pommes: Golden Delicious CH 4 fr /kg 1 12 0 60 1 06 0 86 -25 UE-4 1 fr /kg 0 85 0 51 0 53 0 47 -41 - D fr /kg 0 95 0 56 0 56 0 49 -43 - F fr /kg 0 76 0 50 0 57 0 46 -33 - I 2 fr /kg 0 88 0 51 0 47 0 46 -45 - A (div ) fr /kg 1 07 0 40 0 45 0 40 -61 USA (div ) fr /kg 0 66 0 59 0 59 0 73 -3
OFAG, USP, Eurostat, U S Department of Agriculture
Tableau 48b
Prix à la production des produits végétaux Suisse – divers pays
1 Moyenne des années 1990/93 et variation 1990/93–1997/2000
2 UE-4 comprend les pays voisins Allegagne (D), France (F), Italie (I) et Autriche (A)
3 Pour l'Italie en 2000 calculé selon l'indice CE des prix à la production valeur absolue
4 UE-4 plus Pays-Bas (NL) et Belgique
A N N E X E A57
Produit Pays Unité 1990/92 1998 1999 2000 1990/92–1998/2000 % Poires I CH 1 fr /kg 1 33 0 78 1 09 0 88 -20 UE-4 2 fr /kg 1 05 0 75 0 74 0 70 -30 - D fr /kg 1 09 0 73 0 76 0 56 -37 - F fr /kg 1 17 1 11 0 95 0 95 -14 - I 3 fr /kg 0 98 0 65 0 67 0 64 -34 - A (depuis 92) fr /kg 1 21 0 72 0 81 0 60 -41 USA fr /kg 0 57 0 54 0 64 0 58 2 Carottes CH fr /kg 1 09 1 18 1 05 1 15 3 UE-6 4 fr /kg 0 62 0 48 0 53 0 48 -20 - D fr /kg 0 48 0 46 0 49 0 31 -13 - F fr /kg 0 44 0 44 0 58 0 47 12 - I 3 fr /kg 0 84 0 67 0 71 0 70 -17 - A fr /kg 0 41 0 25 0 33 0 28 -30 - NL fr /kg 0 39 0 41 0 47 0 51 19 - B fr /kg 0 36 0 27 0 14 0 15 -48 USA fr /kg 0 41 0 38 0 55 0 51 17 Oignons CH fr /kg 0 89 1 03 0 96 1 02 13 UE-5 (UE-6 sans NL) fr /kg 0 63 0 55 0 46 0 44 -24 - D fr /kg 0 33 0 29 0 20 0 16 -35 - F fr /kg 0 60 0 77 0 70 0 66 18 - I 3 fr /kg 0 71 0 60 0 52 0 54 -22 - A (depuis 92) fr /kg 0 28 0 36 0 16 0 16 -17 - NL fr /kg - - - -- B fr /kg 0 21 0 49 0 25 0 19 45 USA fr /kg 0 40 0 50 0 45 0 45 18 Tomates CH fr /kg 2 42 1 89 1 92 2 15 -18 UE-6 4 fr /kg 1 10 0 89 0 82 0 93 -20 - D fr /kg 0 95 0 96 1 04 1 09 9 - F fr /kg 1 32 1 15 1 13 1 38 -7 - I 3 fr /kg 0 91 0 79 0 74 0 84 -13 - A (depuis 92) fr /kg 1 08 0 77 0 80 0 92 -23 - NL fr /kg 1 26 1 34 1 15 1 17 -3 - B fr /kg 1 23 1 17 1 08 1 39 -1 USA fr /kg 1 00 1 16 0 93 1 17 8
Sources: OFAG USP Eurostat U S Department of Agriculture
Tableau 49
Prix à la consommation des produits animaux Suisse – divers pays
1 UE-4 comprend les pays voisins Allemagne (D), France (F), Italie (I) et Autriche (A)
Rubrique «Pays»: (min ) et (max ) –> prix minimal et prix maximal observés durant une année dans un pays donné Si l’année n ’est pas mentionnée, le chiffre vaut pour tous les ans, sauf si un autre pays est indiqué avec l’année
Sources: OFAG, OFS, ZMP (D), services statistiques nationaux de F, B, A, USA, service statistique de la ville de Turin (I)
A58 A N N E X E
Produit Pays Unité 1990/92 1998 1999 2000 1990/92–1998/2000 % Lait frais CH fr /l 1 85 1 66 1 58 1 55 -14 EU-4 1 fr /l 1 30 1 14 1 13 1 09 -13 - D (min) fr /l 1 07 0 96 0 93 0 86 -14 - I (max) fr /l 1 82 1 77 1 75 1 77 -3 USA fr /l 1 04 1 03 1 13 1 24 9 Fromage CH-Emmentaler fr /kg 20 15 20 65 20 66 20 18 2 EU-4 1 (avec B, sans F) fr /kg 15 98 13 15 13 55 12 65 -18 - D (min) fr /kg 13 52 10 88 11 30 10 09 -20 - B (max) fr /kg 17 63 17 69 17 51 17 13 -1 USA (Cheddar) fr /kg 11 14 11 33 12 49 14 26 14 Beurre CH fr /kg 13 76 12 00 11 68 11 76 -14 EU-4 1 fr /kg 9 04 8 37 8 17 8 01 -10 - D (min) fr /kg 6 81 6 26 5 92 5 70 -12 - I (max) fr /kg 12 90 12 50 12 25 12 01 -5 USA fr /kg 5 96 9 14 8 79 9 38 53 Crème CH fr /1/4 l 3 58 3 07 2 95 2 79 -18 EU-3 (EU-4 avec B, sans F+I) fr / 1⁄4 l 1 25 1 01 1 01 0 96 -21 - D (min) fr / 1⁄4 l 1 13 0 93 0 93 0 87 -20 - B / A-90/92 (max) fr / 1⁄4 l 2 53 1 66 1 67 1 64 -34 USA fr / 1⁄4 l - - - -Rôti de boeuf CH fr /kg 26 34 23 52 24 09 27 73 -5 EU-4 1 fr /kg 16 00 15 10 15 14 14 92 -6 - F (min) fr /kg 11 85 11 80 11 92 11 76 -0 - A (max) fr /kg 24 32 24 46 24 21 23 93 -0 USA fr /kg 9 26 8 71 9 15 10 95 4 Rôti de porc CH fr /kg 18 43 17 60 16 75 18 60 -4 EU-4 1 fr /kg 11 80 11 76 10 95 10 99 -5 - D / A-90/92 (min) fr /kg 10 00 10 56 9 79 9 66 0 - I (max) fr /kg 13 67 13 56 12 57 12 43 -6 USA fr /kg - - - -Côtelettes de porc CH fr /kg 19 88 17 91 18 26 19 80 -6 EU-4 1 fr /kg 10 62 9 89 9 07 9 24 -11 - D (min) fr /kg 9 71 9 17 8 30 8 39 -11 - I / A-99 + 00 (max) fr /kg 12 43 11 45 10 42 10 36 -14 USA fr /kg 10 02 10 30 10 51 12 54 11 Jambon CH fr /kg 25 56 27 23 26 18 27 13 5 EU-4 1 fr /kg 22 13 20 82 19 94 19 70 -9 - F / D-90/92 + 00 (min) fr /kg 20 38 19 10 18 07 18 63 -9 - I (max) fr /kg 27 15 25 27 24 59 23 17 -10 USA fr /kg 8 85 8 99 9 49 12 54 17 Poulet frais CH fr /kg 8 41 8 42 8 43 8 49 0 EU-4 1 fr /kg 5 72 5 19 4 93 4 90 -13 - F (min) fr /kg 4 84 3 91 3 82 3 86 -20 - I (max) fr /kg 6 17 6 13 5 71 5 89 -4 USA fr /kg 2 74 3 33 3 50 3 99 32 Oeufs CH fr /pces 0 57 0 57 0 57 0 58 2 EU-4 1 (avec B, sans F) fr /Sk 0 25 0 26 0 25 0 25 2 - B (min) fr /Sk 0 22 0 21 0 20 0 21 -8 - A (max) fr /Sk 0 33 0 36 0 35 0 34 4 USA fr /Sk 0 10 0 13 0 13 0 15 32
Tableau 50
Prix à la consommation des produits végétaux
Suisse – divers pays
1 UE-4 comprend les pays voisins Allemagne (D), France (F), Italie (I) et Autriche (A)
2 Moyenne des années 1990/93 et variation 1990/93–1997/2000
Rubrique «Pays»: (min ) et (max ) –> prix minimal et prix maximal observés durant une année dans un pays donné Si l année n est pas mentionnée, le chiffre vaut pour tous les ans, sauf si un autre pays est indiqué avec l année
Sources: OFAG, OFS, ZMP (D), services statistiques nationaux de F, B, A, USA, service statistique de la ville de Turin (I)
A N N E X E A59
Produit Pays Unité 1990/92 1998 1999 2000 1990/92–1998/2000 % Farine fleur CH fr /kg 2 05 1 80 1 80 1 75 -13 UE-4 1 (avec B, sans F) fr /kg 1 10 0 99 0 94 0 91 -13 - B /D-90/92 (min) fr /kg 0 79 0 83 0 82 0 79 3 - A (max) fr /kg 1 67 1 01 1 02 1 00 -39 USA fr /kg 0 75 0 96 0 97 1 08 34 Pain blanc CH fr /1/2 kg 2 09 2 05 2 02 1 83 -6 UE-4 1 fr /1⁄2 kg 1 49 1 53 1 53 1 50 2 - D pain de seigle (min) fr /1⁄2 kg 1 16 1 03 1 06 0 99 -11 - A (max) fr /1⁄2 kg 2 98 2 86 2 85 2 98 -3 USA fr /1⁄2 kg 1 12 1 37 1 47 1 73 37 Pommes de terre CH fr /kg 1 43 1 66 1 77 1 87 24 UE-5 (UE-4 plus B) fr /kg 0 92 1 02 1 09 1 00 12 - B / D-00 (min) fr /kg 0 56 0 72 0 84 0 74 38 - F / A-90/92 (max) fr /kg 1 27 1 52 1 57 1 50 20 USA fr /kg 1 04 1 20 1 31 1 41 26 Sucre CH fr /kg 1 65 1 52 1 50 1 41 -11 UE-3 (UE-4 avec B, sans F+I) fr /kg 1 75 1 61 1 57 1 54 -10 - B (min) fr /kg 1 67 1 51 1 50 1 46 -11 - A (max) fr /kg 1 89 1 73 1 71 1 66 -10 USA fr /kg 1 22 1 32 1 38 1 52 15 Huile végétale CH-tournesol fr /l 5 05 4 44 4 46 3 96 -15 UE-4 1 (avec B / sans D) fr /l 2 11 2 40 2 48 2 34 14 - I-soja/tournesol (min) fr /l 1 94 2 18 2 26 2 12 13 - F-tournesol / A-90/92 huile comestible fr /l 2 70 2 57 2 64 2 50 -5 USA - huile à salade (kg) fr /l 2 71 3 25 3 46 3 90 30 Pommes: Golden Delicious CH 2 fr /kg 3 15 3 10 2 98 3 40 1 UE-4 1 (F/A: div variétés) fr /kg 3 10 2 48 2 49 2 37 -21 - I / A-90/92 (min) fr /kg 2 94 2 19 2 27 1 97 -27 - F depuis 98 / D (max) fr /kg 3 25 2 73 2 70 2 72 -16 USA fr /kg 2 58 3 01 2 97 3 42 21 Poires CH 2 fr /kg 3 25 3 32 3 26 3 36 2 UE-4 1 fr /kg 3 43 2 89 2 66 2 75 -19 - I / D-90/92 (min) fr /kg 3 32 2 57 2 39 2 40 -26 - A / F-90/92 + 00 (max) fr /kg 3 62 3 29 2 95 3 17 -13 USA fr /kg 2 52 2 98 3 15 3 59 29 Bananes CH fr /kg 2 52 2 83 2 82 2 83 12 UE-4 1 fr /kg 2 61 2 45 2 30 2 17 -12 - D (min) fr /kg 1 89 2 32 2 14 1 99 14 - A / I-90/92 (max) fr /kg 3 56 2 92 2 69 2 46 -24 USA fr /kg 1 45 1 58 1 63 1 87 16 Carottes CH fr /kg 1 91 1 87 1 78 1 78 -5 UE-5 (UE-4 plus B) fr /kg 1 71 1 43 1 53 1 32 -17 - B (min) fr /kg 1 06 1 12 1 23 0 94 4 - I / A-99 (max) fr /kg 2 32 1 61 1 97 1 55 -26 USA fr /kg 1 35 1 79 1 86 2 09 42 Oignon CH fr /kg 1 86 2 14 2 03 1 94 10 UE-5 (UE-4 plus B) fr /kg 1 54 1 79 1 55 1 48 4 - B (min) fr /kg 0 92 1 27 1 05 0 92 17 - F / I-90/92 (max) fr /kg 1 75 2 42 2 07 1 92 22 USA fr /kg 1 29 - - -Tomates CH fr /kg 3 73 3 31 3 18 3 50 -11 UE-5 (UE-4 plus B) fr /kg 3 60 3 07 2 96 3 37 -13 - D/A-98 / B-90/92 (min) fr /kg 3 35 2 95 2 58 2 97 -15 - I B-97 / F-98 (max) fr /kg 4 41 3 37 3 37 3 81 -20 USA (en plein champ) fr /kg 3 29 4 71 4 54 5 15 46
■■■■■■■■■■■■■■■■ Cartes paiements directs
Carte 1
Surface agricole utile des exploitations ayant droit aux paiements directs – 2000
ha par exploitation 1
■ 0
■ <10
■ 10 –19,9
■ 20 –29,9
■ ≥30
■ Région d’estivage
1 par commune, somme SAU divisée par nombre total d’exploitations avec paiements directs
Source: OFAG
Données cartographiques GG25 © Office fédéral de topographie (BA013557)
A60 A N N E X E
Carte 2
Animaux de rente des exploitations ayant droit aux paiements directs – 2000
UGB par exploitation 1
■ 0
■ <10
■ 10 –19,9
■ 20 –29,9
■ ≥30
■ Région d’estivage
1
A N N E X E A61
par commune, somme UGB déterminant divisée par nombre total d exploitations avec paiements directs > 0 Fr
Source: OFAG Données cartographiques GG25 © Office fédéral de topographie (BA013557)
Carte 3
Contributions à la surface – 2000
fr par exploitation 1
■ 0
■ <12 000
■ 12 000– 23 999
■ 24 000– 35 999
■ ≥36 000
■ Région d’estivage
1 Par commune, somme des contributions de la mesure divisée par nombre total d exploitations avec paiements directs
A62 A N N E X E
Source: OFAG Données cartographiques GG25 © Office fédéral de topographie (BA013557)
Carte 4
Contributions pour la garde d’animaux consommant des fourrages grossiers – 2000
fr par exploitation 1
■ 0
■ <4 000
■ 4 000– 7 999
■ 8 000– 11 999
■ ≥12 000
■ Région d’estivage
A N N E X E A63
1 Par commune, somme des contributions de la mesure divisée par nombre total d exploitations avec paiements directs
Source: OFAG Données cartographiques GG25 © Office fédéral de topographie (BA013557)
Carte 5
Contributions pour la garde d’animaux dans des conditions difficiles – 2000
fr par exploitation 1
■ 0
■ <4 000
■ 4 000– 7 999
■ 8 000– 11 999
■ ≥12 000
■ Région d’estivage
A64 A N N E X E
1 Par commune, somme des contributions de la mesure divisée par nombre total d exploitations avec paiements directs
Source: OFAG Données cartographiques GG25 © Office fédéral de topographie (BA013557)
Carte 6
Contributions générales pour des terrains en pente – 2000
fr par exploitation 1
■ 0
■ <2 000
■ 2 000– 3 999
■ 4 000– 5 999
■ ≥6 000
■ Région d’estivage
A N N E X E A65
1 Par commune, somme des contributions de la mesure divisée par nombre total d exploitations avec paiements directs
Source: OFAG Données cartographiques GG25 © Office fédéral de topographie (BA013557)
Carte 7
Contributions pour vignes en pente et en terrasse – 2000
fr par exploitation 1
■ 0
■ <1 000
■ 1 000– 1 999
■ 2 000– 2 999
■ ≥3 000
■ Région d’estivage
1 Par commune, somme des contributions de la mesure divisée par nombre total d exploitations avec paiements directs
A66 A N N E X E
Source: OFAG Données cartographiques GG25 © Office fédéral de topographie (BA013557)
Carte 8
Contributions à la compensation écologique – 2000
fr par exploitation 1
■ 0
■ <2 000
■ 2 000– 3 999
■ 4 000– 5 999
■ ≥6 000
■ Région d’estivage
A N N E X E A67
1 Par commune, somme des contributions de la mesure divisée par nombre total d exploitations avec paiements directs
Source: OFAG Données cartographiques GG25 © Office fédéral de topographie (BA013557)
Carte 9
Contributions à la culture extensive de céréales et de colza – 2000
fr par exploitation 1
■ 0
■ <1 000
■ 1 000– 1 999
■ 2 000– 2 999
■ ≥3 000
■ Région d’estivage
1 Par commune, somme des contributions de la mesure divisée par nombre total d exploitations avec paiements directs
A68 A N N E X E
Source: OFAG Données cartographiques GG25 © Office fédéral de topographie (BA013557)
Carte 10
Contributions pour la culture biologique – 2000
fr par exploitation 1
■ 0
■ <2 000
■ 2 000– 3 999
■ 4 000– 5 999
■ ≥6 000
■ Région d’estivage
A N N E X E A69
1 Par commune, somme des contributions de la mesure divisée par nombre total d exploitations avec paiements directs
Source: OFAG Données cartographiques GG25 © Office fédéral de topographie (BA013557)
Carte 11
Contributions pour les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux (SST) – 2000
fr par exploitation 1
■ 0
■ <1 000
■ 1 000– 1 999
■ 2 000– 2 999
■ ≥3 000
■ Région d’estivage
1 Par commune, somme des contributions de la mesure divisée par nombre total d exploitations avec paiements directs
A70 A N N E X E
Source: OFAG Données cartographiques GG25 © Office fédéral de topographie (BA013557)
Carte 12
Contributions pour les sorties régulières en plein air (SRPA) – 2000
fr par exploitation 1
■ 0
■ <2 000
■ 2 000– 3 999
■ 4 000– 5 999
■ ≥6 000
■ Région d’estivage
A N N E X E A71
1 Par commune, somme des contributions de la mesure divisée par nombre total d exploitations avec paiements directs
Source: OFAG Données cartographiques GG25 © Office fédéral de topographie (BA013557)
Textes légaux relevant du domaine de l‘agriculture
– Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr, RS 910 1)
– Loi fédérale du 20 mars 1959 sur l'approvisionnement du pays en blé (Loi sur le blé, RS 916 111 0)
Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR, RS 211 412 11)
– Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA, RS 221 213 2)
–
Loi fédérale du 8 octobre 1982 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP, RS 531)
Loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés (RS 632 111 72)
– Loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD, RS 632 10)
Loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales (RS 232 16)
– Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA, RS 836 1)
– Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (loi sur l'aménagement du territoire, LAT, RS 700)
Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (loi sur les denrées alimentaires, LDAI, RS 817 0)
– Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux, RS 814 20)
– Loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des animaux (LPA, RS 455)
Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN, RS 451)
– Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE, RS 814 01)
Ordonnances
Généralités
– Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation
(Ordonnance sur la terminologie agricole, Oterm, RS 910 91)
– Ordonnance du 7 décembre 1998 sur le relevé et le traitement de données agricoles (Ordonnance sur les données agricoles, RS 919 117 71)
Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'évaluation de la durabilité de l'agriculture (RS 919 118)
Production et ventes
– Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les interprofessions et les organisations de producteurs (RS 919 117 72)
– Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'aide à la promotion des ventes de produits agricoles
(Ordonnance sur la promotion des ventes de produits agricoles, RS 916 010)
– Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles et des produits agricoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP, RS 910 12)
Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits végétaux et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique, RS 910 18)
Ordonnance du 3 novembre 1999 relative à la déclaration de produits agricoles issus de modes de production interdits en Suisse (Ordonnance agricole sur la déclaration; OagrD, RS 916 51)
Ordonnance générale du 7 décembre 1998 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIA, RS 916 01)
Ordonnance du 7 décembre 1998 concernant le contingentement de la production laitière (Ordonnance sur le contingentement laitier, OCL, RS 916 350 1)
Ordonnance du 7 décembre 1998 concernant le prix-cible, les suppléments et les aides dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL, RS 916 350 2)
Ordonnance du DFE du 7 décembre 1998 concernant le montant des aides pour les produits laitieres et les dispositions relatives au secteur beurrier et à la poudre de lait entier (RS 916 350 21)
A72 A N N E X E ■■■■■■■■■■■■■■■■
Lois
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Ordonnance du 7 décembre 1999 concernant la réorganisation du marché laitier
(Ordonnance de transition dans le domaine du lait, RS 916 350 3)
Ordonnance du 7 décembre 1998 concernant l'assurance et le contrôle de la qualité dans l'économie laitière (Ordonnance sur la qualité du lait, OQL, RS 916.351.0)
Ordonnance du 13 avril 1999 reltive à l'assurance de la qualité dans l'exploitation de production laitière (RS 916 351 021 1)
Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'importation de lait et de produits laitiers, d'huiles et de graisses comestibles, ainsi que de caséines et de caséinates (Ordonnance sur l'importation de lait et d'huiles comestibles, OILHGC, RS 916 355 1)
Ordonnance de l'OFAG du 30 mars 1999 concernant l'importation de beurre (RS 916 357 1)
Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'importation d'animaux de l'espèce chevaline
(Ordonnance sur l'importation de chevaux, OIC, RS 916 322 1)
Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB, RS 916 341)
Ordonnance du DFE du 7 décembre 1998 sur la volaille (RS 916 341 61)
Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les effectifs maximums dans la production de viande et d'oeufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM, RS 916.344)
Ordonnance du 7 juillet 1971 concernant la mise en valeur de la laine de mouton du pays (RS 916 361)
Ordonnance du 7 décembre 1998 sur le marché des oeufs (Ordonnance sur les oeufs, OO, RS 916 371)
Ordonnance du DFE du 18 juin 1996 sur les oeufs (RS 916 371 1)
Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les contributions à la surface et à la transformation dans la culture des champs (Ordonnance sur les contributions à la culture des champs OCCC, RS 910 17)
Ordonnance générale du 16 juin 1986 concernant la loi sur le blé (RS 916 111 01) –
Ordonnance du DFEP du 16 juin 1986 sur l'approvisionnement du pays en blé (RS 916 111 011) –
Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la fixation de droits de douane et sur l'importation de semences de céréales, de matières fourragères, de paille et de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux (Ordonnance sur l'importation de semences de céréales et de matières fourragères, RS 916 112 211)
– Ordonnance du 7 décembre 1998 concernant la mise en valeur ainsi que l'importation et l'exportation de pommes de terre (Ordonnance sur les pommes de terre, RS 916 113 11)
– Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la culture et la transformation des betteraves sucrières (Ordonnance sur le sucre, RS 916 114 11)
Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'importation et l'exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP, RS 916.121.10)
Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les mesures d'allégement du marché des fruits à noyau et sur la mise en valeur des fruits à pépins (Ordonnance sur les fruits, RS 916 131 11)
– Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnace sur le vin, RS 916 140)
Ordonnance de l'OFAG du 7 décembre 1998 sur l'assortiment des cépages et l'examen des variétés (RS 916 143 5)
Paiements directs
Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD, RS 910 13)
Ordonnance du DFE du 7 décembre 1998 sur les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux (Ordonnance SST, RS 910 132 4)
– Ordonnance du DFE du 7 décembre 1998 sur les sorties régulières en plein air d'animaux de rente (Ordonnance SRPA, RS 910 132 5)
– Ordonnance du 29 mars 2000 sur les contributions d'estivage (Ocest, RS 910 133)
– Ordonnance du 4 avril 2001 sur la promotion régionale de la qualité et de la mise en réseau des surfaces de compensation écologique dans l’agriculture (Ordonnance sur la qualité écologique, OQE, RS 910 14)
A N N E X E A73 –
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Amélioration des bases de production
– Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture
(Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS, RS 913 1)
– Ordonnance de l'OFAG du 7 décembre 1998 sur l'échelonnement des taux forfaitaires de l'aide à l'investissement (OFOR, RS 913 211)
–
Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'aide aux exploitations accordée au titre de mesure d'accompagnement social (Ordonnance sur l'aide aux exploitations OAEx, RS 914 11)
Ordonnance du 8 novembre 1995 sur la recherche agronomique (ORA, RS 426 10)
– Ordonnance du 13 décembre 1993 sur la formation professionnelle agricole (OFPA, RS 915 1)
–
Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'élevage (RS 916 310)
Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la production et la mise en circulation du matériel végétal de multiplication (Ordonnance sur les semences, RS 916 151)
Ordonnance du DFE du 7 décembre 1998 sur les semences et les plants des espèces de grandes cultures et de plantes fourragères (Ordonnance du DFE sur les semences et plants, RS 916 151 1)
Ordonnance du DFE du 11 juin 1999 sur la production et la mise en circulation du matériel de multiplication et des plants d'espèces fruitières et de vigne certifiés (RS 916 151 2)
Ordonnance de l'OFAG du 7 décembre 1998 sur le catalogue des variétés de céréales, de pommes de terre, de plantes fourragères et de chanvre (Ordonnance sur le catalogue des variétés, RS 916 151 6)
Ordonnance du 23 juin 1999 sur l'homologation de produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, RS 916 161)
Ordonnance du 26 janvier 1994 sur la mise dans le commerce des engrais et des produits assimilés aux engrais (O sur les engrais, RS 916 171)
Ordonnance du 28 février 2001 sur la protection des végétaux (OPV, RS 916.20)
Ordonnance du DFE du 25 janvier 1982 sur la déclaration obliga toire des ravageurs et des maladies présentant un danger général (RS 916 201)
– Ordonnance du 28 avril 1982 sur la lutte contre le pou de San José, le feu bactérien et les viroses des arbres fruitiers présentant un danger général (RS 916 22)
– Ordonnance du 26 mai 1999 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, RS 916 307)
Ordonnance du DFE du 10 juin 1999 sur la production et la mise dans le commerce des aliments pour animaux, des additifs destinés à l'alimentation animale, des agents d'ensilage et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLAA, RS 916 307 1)
– Ordonnance de l'Office fédéral de l'agriculture du 16 juin 1999 sur la liste des aliments OGM pour animaux (RS 916 307 11)
Les textes légaux peuvent être consultés ou obtenus de la manière suivante:
– Accès par Internet www admin ch/ch/d/sr/sr html
Commande à l‘OCFIM
– par Internet www admin ch/edmz
par fax 031 325 50 58
A74 A N N E X E
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
■■■■■■■■■■■■■■■■ Définitions et méthodes
Définitions
Biens publics: biens caractérisés par la non-rivalité et la non-exclusion Non-rivalité signifie en l’occurrence que la consommation d’un bien n ’entrave nullement la possibilité des autres de le consommer à leur tour Non-exclusion signifie que personne ne peut être empêché d’avoir part aux biens publics Par biens publics, on entend, par exemple, la défense nationale, la forêt comme cadre de loisirs ou l’attrait d’un paysage Comme il n ’existe pas de marché, ces biens n ’ont pas de valeur marchande Il incombe donc à l’Etat ou à ses mandataires de veiller à ce qu’ils soient à la disposition de la collectivité
Dispersion, variance (valeur statistique): dispersion des observations ou des valeurs autour de la moyenne
Effets externes: effets secondaires ou externalités positifs ou négatifs sur des tiers ou sur la collectivité, résultant des processus de consommation et de production de certains acteurs. N’étant pas saisis par le marché et n ’ayant donc pas de prix, ils provoquent des distorsions du marché et une allocation inappropriée de biens et de facteurs de production Une politique économique rationnelle doit viser à internaliser les effets externes
Exemples d’effets externes:
Effets externes négatifs (coûts sociaux)
Production
Consommation
Pollution de l’eau potable et des Coûts élevés de santé publique eaux souterraines et superficielles occasionnés par la consommation par un fumure inadéquate excessive d’alcool et de tabac
Effets externes positifs (utilité sociale) Conservation et entretien du paysage Baisse des coûts de santé publique grâce rural par la production agricole aux sports de masse pratiqués à titre de loisirs
Equivalent de lait: un équivalent de lait correspond à la teneur moyenne d’un kg de lait cru en matière grasse et en protéines (73 g) et sert d’étalon pour le calcul de la quantité de lait contenue dans un produit laitier
Evaluation (synonyme de contrôle des résultats): L’évaluation est une méthode servant à calculer et à évaluer l’effectivité (réalisation des objectifs), l’efficacité (rapports de cause à effet) et l’efficience (rentabilité) de mesures ou d’instruments, en référence à des objectifs définis préalablement On s ’ en sert surtout pour faire des comparaisons: comparaison avec des groupes de contrôle, comparaison «avantaprès», comparaisons intrasectorielles
Indicateur agro-environnemental: saisie représentative de données concernant une cause, un état, un changement ou un risque environnemental liés à l’activité agricole, importantes pour les décideurs (p ex degré d’érosion du sol; définition de l’OCDE)
Marge du marché: différence entre le prix à la consommation et le prix à la production (valeur absolue), ou part des dépenses du consommateur revenant aux échelons transformation et commerce (valeur relative) Le terme de marge est synonyme
Médiane: valeur centrale (donnée statistique); valeur située au milieu d’une série (p ex de mesures), de sorte à séparer un même nombre de valeurs supérieures et inférieures.
Monitoring: observation continue d’un objet durant une certaine période, à l’aide d’indicateurs et sans analyse des relations de cause à effet Le monitoring permet de mettre en évidence des évolutions Exemples: évolution de la surface agricole utile ou de populations d’oiseaux
A N N E X E A75
Moyenne: moyenne arithmétique (valeur statistique): somme des valeurs d’une série divisée par le nombre de ces valeurs
Multifonctionnalité de l’agriculture: multiples fonctions remplies par l’agriculture, notamment prestations fournies au-delà de la production agricole proprement dite. Ces dernières comprennent la sécurité alimentaire, l’entretien du paysage rural, la préservation des bases de production et de la diversité biologique ainsi que la contribution de l’agriculture à la viabilité économique et sociale de l’espace rural Une agriculture multifonctionnelle contribue substantiellement à un développement durable Ses multiples tâches sont mentionnées dans la Constitution fédérale (art 104)
Prix-cible: valeur de référence fixée par le Conseil fédéral pour un kg de lait commercialisé contenant en tout 73 g de matière grasse et de protéines Ce prix devrait pouvoir être atteint pour le lait transformé en produits à forte valeur ajoutée et commercialisé dans de bonnes conditions Il dépend notamment de l’appréciation de la situation régnant sur le marché et des moyens disponibles pour le soutien du marché Le supplément de non-ensilage n ’est pas pris en compte
Propriétés abiotiques: propriétés chimiques et physiques d’un espace, telles que facteurs climatiques (lumière, température, etc ), propriétés du sol, conditions hydrologiques et relief.
Propriétés biotiques: propriétés d’un espace déterminées par les plantes et les animaux qu’il abrite
Quartile, quart (valeur statistique): subdivision en quatre parties d’une suite de valeurs classées par ordre décroissant
«Schoggigesetz»: loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés (RS 632 111 72) Application du Protocole 2 de l’accord de libre-échange Suisse – CE de 1972 Compensation de la différence entre les prix des matières premières en Suisse et le prix du marché mondial pour les produits agricoles de base (exportation: subventions à l’exportation / importation: éléments mobiles)
Trafic de perfectionnement: les marchandises importées temporairement en Suisse à des fins de transformation ou de réparation donnent droit, à certaines conditions, à une réduction ou à une exemption des droits de douane Les produits et les matières de base agricoles bénéficient du trafic de perfectionnement, si des marchandises suisses équivalentes ne sont pas disponibles en quantité suffisante ou que le handicap de l’industrie alimentaire ne peut être compensé par d’autres mesures appropriées
D’autres termes se trouvent dans:
– «Définitions et terminologie d’économie rurale»
(commandes: Landwirtschaftliche Lehrmittelzentrale, Länggasse 79, 3052 Zollikofen)
Ordonnance sur la terminologie agricole (RS 910 91)
A76 A N N E X E
–
Méthodes
Relevé du prix du lait
L’OFAG relève mensuellement les prix à la production et publie les résultats dans le «bulletin du lait» Pour ce faire, il se fonde sur quatre références: quantité de lait totale, lait industriel, lait transformé en fromage et lait biologique Ces données sont saisies pour toute la Suisse, mais aussi ventilées selon cinq régions: Région I: Genève, Vaud, Neuchâtel, Jura et les parties francophones du canton de Berne (districts de La Neuveville, Courtelary et Moutier) Région II: Berne (sauf les district de la région I), Lucerne, Unterwald (Obwald Nidwald), Uri, Zoug et une partie du canton de Schwytz (district de Schwytz et de Küssnacht) Région III: Bâle-Campagne et Bâle-Ville, Argovie et Soleure Région IV: Zurich, Schaffhouse, Thurgovie Appenzell (Rhodes intérieures et Rhodes extérieures), Saint-Gall, une partie du canton de Schwytz (districts d’Einsiedeln, March et Höfe), Glaris, Grisons Région V: Valais et le Tessin
Les cinq régions du relevé des prix
Source: OFAG
Conformément à l’ordonnance sur la réorganisation du marché laitier, les prix payés aux producteurs doivent être relevés auprès des utilisateurs de lait. Tous les transformateurs industriels de poids ainsi qu ’ un choix représentatif de fromageries participent au relevé. Celui-ci porte ainsi sur plus de 60% de la quantité produite D’après l’ordonnance précitée, on entend, par prix du lait, le prix payé sur les lieux du relevé (au centre collecteur ou à la ferme), compte tenu des suppléments et déductions usuels dans la localité Par contre, le supplément de non-ensilage, de même que les cotisations volontaires aux fédérations et les déductions pour le petit-lait ne sont pas compris
A N N E X E A77
I II III IV V
Calcul des marges du marché
Lait et produits laitiers
Pour déterminer la marge du marché sur le lait et les produits laitiers, il faut, dans un premier temps, procéder au calcul théorique de la valeur ajoutée dans les segments lait de consommation, fromage, beurre, crème de consommation et yoghourts La valeur ajoutée, calculée pour chacun de ces produits finis, est exprimée en francs par kilo de lait transformé La marge du lait et des produits laitiers est une mesure de la différence entre d’une part, le prix payé au producteur de lait et d’autre part, le prix à la consommation du produit fini
Dans un deuxième temps, cette valeur doit être corrigée en fonction des propriétés spécifiques des produits Pour calculer les marges individuelles, on tient en effet compte des aides allouées par la Confédération, des déductions ou suppléments ainsi que de la valeur des sous-produits issus de la transformation Ainsi, la marge du marché globale sur le lait et les produits laitiers est la résultante de la valeur ajoutée et des propriétés spécifiques de chaque produit Elle réunit les marges des groupes de produits lait de consommation, fromage, beurre, crème de consommation et yoghourts qui, à leur tour, découlent des calculs effectués pour les produits servant d’indicateurs
La quantité de lait cru transformée annuellement en Suisse sert de référence pour le calcul de la marge globale et des marges individuelles précitées, chaque mode d’utilisation et chaque produit étant pondéré conformément à sa part
Pour calculer la marge, on ne tient compte que de la valeur ajoutée des produits laitiers fabriqués et consommés en Suisse On déduit donc les exportations de la quantité totale
Pour le relevé des prix à la consommation, on distingue trois canaux de distribution: grands distributeurs, discounts et magasins spécialisés Ils sont pondérés d’après les parts de marché, conformément aux indications fournies par l’Institut d'analyse marketing, Hergiswil (IHA · GfM).
A78 A N N E X E
Marge du marché emmental (octobre 2000) VP1/kg Emmental PV/kg Lait cru Prix du lait Marge du marché Emmental Rendement: 8% Aides, taxes Valeur des sous-produits, etc f r / k g Source: OFAG 1 PV = prix de vente 0 20.44 1 64 0 81
Viande
La marge brute de transformation-distribution sur la viande crue à la consommation est une valeur nominale (aux prix courants) hors TVA (hTVA) Exprimée en kg de «poids mort» (PM) (carcasse chaude), elle correspond à la différence, d’une part, entre le rendement brut et les coûts variables et, d’autre part, entre les recettes nettes et le prix de revient.
Le rendement brut équivaut au chiffre d’affaires du secteur de transformation-distribution ou, en d’autres termes, aux dépenses du consommateur (ménages privés et grossistes) Il comprend la vente de la viande crue à la consommation, ainsi que la mise en valeur de la viande à saucisse, de la peau et des abats par les grossistes Les coûts variables englobent plusieurs éléments: premièrement le prix de revient du bétail payé au producteur, qui est un prix moyen pondéré (conventionnel, labels et autres canaux de distribution) franco abattoir et qui inclut donc une éventuelle marge de négociant ou des frais de transport; deuxièmement, les frais d’élimination des abats, de la tête et des pieds, les pertes de découpe, de stockage et de refroidissement, la taxe de transport (RPLP) et la cotisation au marketing de base de Proviande
Viandes crues d’étal (prix au détail)
14 74 fr./kg PM
Recette nette
15.74 fr./kg PM
Marge brute de transformation et de distribution 7 60 fr./kg PM
Prix de revient = prix au paysan (franco abattoir)
8.13 fr./kg PM
Viandes à saucisse (prix de gros)
0.52 fr./kg PM
Abats vendables (prix de gros)
0.64 fr./kg PM
Abats et os à brûler, taxe RPLP, Marketing,
0.64 fr./kg PM
Remarque: les proportions de la figure ne correspondent pas à la réalité Les prix indiqués à titre d’ exemple ont servi à calculer la marge brute sur a viande crue de bœuf en janvier 2001 Ce sont des francs par kilo de carcasse chaude (poids mort, PM), à prix constants (ou réels 01.1999) et hors TVA D’éventuelles différences s ’ expliquent par des chiffres arrondis. Source: OFAG
La marge brute est définie en détail dans le numéro spécial du «Bulletin du marché de la viande» de janvier 2001, numéro 140, publié par la section Observation du marché de l’OFAG Ce numéro est disponible sur demande
L’estimation rétroactive de la marge brute de transformation-distribution pour les années 1990 à 1998 se fonde sur plusieurs hypothèses simplificatrices Il a notamment fallu estimer la moyenne (label – sans label) du prix de revient du bétail de boucherie pour la période de 1994 à 1998
On a utilisé à cet effet les chiffres disponibles concernant le prix de revient du bétail sans label, l’écart de prix entre label et conventionnel ainsi que la part du bétail label au total du bétail d’étal Par ailleurs, on a admis que le passage de l’impôt sur le chiffre d’affaires (ICHA) à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), en janvier 1995, n ’ a pas engendré de coûts ni de revenus supplémentaires à l’échelon de la transformation-distribution Finalement, on a choisi, pour les années dès 1999, la consommation annuelle des ménages privés comme clé de pondération entre les trois sortes de viandes (porc, bœuf, veau), alors que pour les années précédentes (1990 à 1998), c ’est la consommation par habitant relevée par Proviande qui a servi de référence
A N N E X E A79
R e n d e m e n t b r u t ( = f r a n c d u c o n s o m m a t e u r ) : 1 5 . 9 0 f r . / k g P M C o û t s v a r i a b l e s t o t a u x : 8 2 9 f r / k g P M
Fruits et légumes
La marge de marché sur les fruits et les légumes équivaut à la différence entre le prix de revient d’un produit au premier échelon du commerce, déduction faite des frais d’emballage, et le prix de vente final (frais d’emballage inclus) Aussi bien les données relatives au marché suisse que celles concernant les importations sont prises en compte, de même que, pour ces dernières, les prélèvements à la frontière Le calcul porte sur sept fruits et sept légumes importants, permettant de réaliser un chiffre d’affaires élevé Fruits: pommes (Golden Delicious et principales variétés de garde, telles que Granny Smith, importations, pondération quantitative); poires (suisses et importées, sans les variétés Abate et Nashi, pondération quantitative); fraises, nectarines, cerises, abricots et oranges Légumes: tomates (charnues et rondes, pondération quantitative), chou-fleur, oignons jaunes, carottes, chicorée Witloof, concombres et pommes de terre Les chiffres utilisés pour les pondérations quantitatives sont fournis par l’IHA*GfM, la Centrale suisse de la culture maraîchère (CCM), FruitUnion suisse (FUS), l’Office fédéral de la statistique (OFS) et la Direction générale des douanes (DGD)
Marge du marché fruits et légumes
Marge du marché
Marge du marché sur les légumes
Le prix de revient des divers produits correspond au prix franco chargeur (les frais d’entreposage des produits de garde sont pris en compte) pour ce qui est de la marchandise suisse et, pour les importations, à la valeur d’importation franco frontière, une pondération quantitative étant effectuée dans les deux cas. Les prix à la consommation sont déterminés à l’aide des données des principaux gros distributeurs et des marchés hebdomadaires Les canaux de distribution sont pondérés selon leur part de marché, conformément aux indications de l’IHA*GfM Finalement, on additionne les marges individuelles pour obtenir la marge du marché globale sur les légumes
Marge du marché sur les fruits
Le calcul de cette marge est un peu spécial en raison de l’apparition de courte durée de certains fruits saisonniers sur le marché Elle donne néanmoins de précieux renseignements, surtout dans une comparaison pluriannuelle
Le prix de revient des produits suisses correspond au prix à la production franco centre collecteur, celui des importations à la valeur d'importation franco frontière, dédouané, une pondération quantitative étant effectuée dans les deux cas Les frais de stockage et les intérêts sont pris en compte Les prix à la consommation sont déterminés à l’aide des données des principaux gros distributeurs et des marchés hebdomadaires. Les canaux de distribution sont pondérés selon leur part de marché, conformément aux indications de l’IHA GfM La marge du marché globale sur les fruits résulte de l’addition des marges individuelles
A80 A N N E X E
P importation P revient P dans le pays P vente finale
Source: OFAG
Comptes économiques de l'agriculture
Les comptes économiques de l’agriculture sont établis par le Secrétariat de l’USP, sur mandat et sous la surveillance de l’OFAG et de l’OFS, conformément au système européen des comptes généraux de l'économie publique (Eurostat). Reconnue au plan international, cette méthode permet de comparer nos données avec celles d’autres pays Les données de la Suisse sont transmises à différentes organisations internationales (OCDE, ONU)
Comptes économiques de l’agriculture
Production finale
Variation des stocks1 Construction pour compte propre Ventes dans le pays et exportations Autoconsommation Transformation par les producteurs
Valeur de la production finale
Composition de la production finale
Contributions des pouvoirs publics
Production finale
Recettes de l'activité agricole
Revenu net de l'activité agricole pour la main-d' oeuvre familiale
Rémunération des salariés
Fermages et intérêts
Amortissements
Souscompensation de la TVA2
1 Dans ce schéma le stock final est supposé être supérieur au stock initial; il en résulte donc une variation positive
Valeur ajoutée
Impôts liés à la production
Consommation intermédiaire
Utilisation des recettes
2 Si la TVA perçue sur les ventes de produits agricoles n ’ est pas égale aux taxes versées sur les achats de consommation intermédiaire et les biens d’investissements, la différence est compensée dans les comptes économiques de l’ agriculture Lorsque le montant perçu est supérieur à celui qui a été payé on obtient une surcompensation qui est considérée comme une recette supplémentaire Jusqu ’à présent, on a cependant toujours enregistré une sous-compensation en Suisse
Valeur ajoutée brute aux prix du marché Valeur ajoutée brute au coût des facteurs Valeur ajoutée nette au coût des facteurs Source: USP
La valeur de la production agricole (production finale) correspond à la valeur monétaire de tous les produits agricoles du pays; en y ajoutant les contributions des pouvoirs publics (subventions), on obtient les recettes tirées de l’activité agricole La consommation intermédiaire (coût de l’énergie, entretien, autres biens et services) est le poste principal en ce qui concerne les dépenses La différence entre les recettes et les dépenses représente le revenu net de l’activité agricole pour la main-d’œuvre familiale Ce revenu sectoriel indemnise le travail de la main-d’œuvre familiale et le capital propre investi A l’échelon des exploitations (données comptables), il équivaut plus ou moins au revenu agricole
A N N E X E A81
Dépouillement centralisé de la FAT
Nouvelle méthode
La méthode du dépouillement centralisé a changé fondamentalement dès les bilans de clôture de 1999. Par le passé, on déterminait le revenu d’exploitations-témoins répondant à des critères stricts (p ex limitation du revenu accessoire, exigence d’une formation spécialisée) Comme il s ’agissait d’une sélection sciemment positive, les résultats ne pouvaient être extrapolés En revanche, le nouveau système des «exploitations de référence», représentatives, permet de faire des constatations concernant l’agriculture tout entière
Aperçu des changements méthodologiques concernant le dépouillement centralisé
Sont considérées comme population toutes les exploitations suisses pouvant, en principe, servir de référence pour le dépouillement centralisé Elles doivent à cet effet atteindre certains seuils Ainsi, une exploitation comptant une surface d’au moins 10 ha ou gardant au moins 6 vaches appartient automatiquement à la population Celle-ci comprend quelque 57'000 exploitations, ce qui correspond à quelque 90% de la surface exploitée et à quelque 90% de la production
Dans cette population on choisit quelque 3'500 exploitations de référence
– Comme les structures de ces exploitations de référence diffèrent de celles de l’agriculture prise dans son ensemble, on procède à une pondération des résultats comptables On se sert, à cet effet, des données concernant la répartition des exploitations selon la grandeur et le type et d’après les zones Les résultats comptables des petites exploitations, sous-représentées dans le groupe de référence, acquièrent ainsi le poids qui leur revient
– On a aussi introduit une nouvelle typologie des exploitations, qui distingue mieux les types importants du point de vue de la politique agricole Environ deux tiers des exploitations peuvent être attribuées à sept types spécialisés se concentrant sur certaines branches de la production végétale ou de l’élevage Le dernier tiers comprend quatre types d’exploitations combinées (cf ci-après)
Grâce à la représentativité accrue et à la pondération, les résultats du dépouillement centralisé concernant l’ensemble de l’agriculture sont plus informatifs Il est aussi plus facile de comparer les données comptables au plan international Par contre, les changements méthodologiques ont rendu impossible la comparaison des données récentes avec d’anciens rapports sur le dépouillement centralisé Afin de pouvoir, malgré tout, établir des comparaisons pluriannuelles, nous avons appliqué rétroactivement la nouvelle méthode aux données comptables des années précédentes
La nouvelle typologie des exploitations FAT99
Dans le cadre des modifications méthodologiques proposées par la FAT (Station fédérale de recherches en économie et technologie agricoles), l’ancienne typologie des exploitations, fondée sur les travaux de la «Commission verte» (1966), a été remplacée par une nouvelle typologie (FAT99) Outre son utilisation dans la présentation des résultats, FAT99 sert à la sélection des exploitations et à la pondération de leurs données
La répartition des exploitations selon la nouvelle typologie se fait exclusivement sur la base des critères «surfaces» et «UGB» concernant les différentes catégories animales Dix chiffres-clés ou huit quotients par exploitation permettent une répartition différenciée et claire
A82 A N N E X E
–
–
Définition de la nouvelle typologie des exploitations FAT99
21 Garde Lait commercialisé au max au max plus de plus de au max
Les exploitations doivent satisfaire à tous les critères prévus dans une ligne
Abréviations:
UGB unités de gros bétail
SAU surface agricole utile en ha
UGB/SAU charge en bétail par ha de SAU
TO/SAU pourcentage de terres ouvertes par rapport à la SAU
CS/SAU pourcentage de cultures spéciales par rapport à la SAU
UGBB/UGB pourcentage d UGB bovines par rapport au cheptel total
VL/UGBB pourcentage de vaches laitières par rapport à l’effectif de bovins
VA/UGBB pourcentage de vaches allaitantes par rapport à l effectif de bovins
ChMC/UGB pourcentage de chevaux de moutons et de chèvres par rapport au cheptel total
PVol/UGB pourcentage de porcs et de volaille par rapport au cheptel total
Source: FAT
On distingue sept types d’exploitations spécialisées et quatre types combinés Les exploitations spécialisées en production végétale (11 et 12) ont un chargement en bétail inférieur à une UGB par ha de SAU. Le pourcentage de terres ouvertes dépasse 70% de la SAU dans les exploitations vouées aux grandes cultures et 10% dans celles qui pratiquent des cultures spéciales Quant aux exploitations spécialisées en production animale (21–41), leur surface de terres ouvertes et de cultures spéciales ne doit pas dépasser 25% et 10% respectivement Des exploitations sont considérées comme étant spécialisées dans la production de lait commercialisé ou, au contraire, dans la garde de vaches mères, lorsque les vaches laitières ou les vaches mères représentent plus de 25% du cheptel bovin Le groupe restant («autres bovins») réunit surtout des exploitations gardant des vaches laitières sans contingent (exploitations de montagne, spécialisées dans l’engraissement de veaux et dans l’élevage) Quant aux exploitations vouées au perfectionnement, les porcs et la volaille représentent plus de la moitié de leurs effectifs Enfin, les exploitations ne pouvant être attribuées à aucun des sept types précités, sont qualifiées de combinées (51–54)
A N N E X E A83
Domaines Type d'exploitation UGB/ TO/ CS/ UGBB/ VL/ VA/ ChMC/ PVol/ Autres SAU SAU SAU UGB UGBB UGBB UGB UGB conditions
11 Production Grandes cultures au max plus de max végétale 1 70% 10% 12 Cultures spéciales au max plus de 1 10%
31
chèvres 25% 10% 50% 41 Perfectionnement
25% 10% 50%
combinés grandes
40% 75% 25% 25% 11– 41 52 Vaches
75% 25% 25% 11– 41 53 Perfectionnement plus
25% 11– 41 54 Autres
11– 53
d’animaux 25% 10% 75% 25% 25% 22 Vaches allaitantes au max au max plus de au max plus de 25% 10% 75% 25% 25% 23 Autres bovins au max au max plus de ni 21 25% 10% 75% ni 22
Chevaux/moutons/ au max au max plus de
au max au max plus de
51 Domaines Lait commercialisé/ plus de plus de plus de au max pas
cultures
allaitantes plus de au max plus de pas
de pas
pas
Présentation des résultats
Conformément à l’art 7 de l’ordonnance sur l’évaluation de la durabilité, la situation économique doit aussi être appréciée selon les régions A cet effet, trois régions ont été définies en référence à l’ordonnance sur les zones agricoles:
région de plaine: zone de grandes cultures et zones intermédiaires – région des collines: zone des collines et zone de montagne I – région de montagne: zones de montagne II à IV
Délimitation des régions de plaine, des collines et de montagne (Communes en fonction de leur attribution à une zone prépondérante)
Région de plaine
Région de collines
Région de montagne
Afin de pouvoir apprécier la dispersion de certains chiffres-clés de manière différenciée, nous avons réparti les exploitations considérées en quartiles, en nous fondant sur le revenu du travail par unité de main-d’œuvre familiale UTAF Chaque quartile (0–25% / 25–50% / 50 –75% / 75–100%) comprend un quart des exploitations de la population
La représentation en quartiles permet une appréciation différenciée du point de vue économique Par contre, on a renoncé à une différenciation écologique, car la part d’exploitations de référence ne fournissant pas les prestations écologiques requises est inférieure à 3%, et la différence des revenus du travail est minime
L’article 5 LAgr exige l’appréciation de la situation économique «en moyenne pluriannuelle» C’est la raison pour laquelle les évolutions sont représentées sur plusieurs années Quant aux considérations plutôt statiques, elles se basent sur la moyenne la plus récente de trois ans (en l’occurrence 1998/2000)
A84 A N N E X E
–
Source: données SIPA 1998 Office fédéral de l' agriculture Limites communales © BFS GEOSTAT
Comparaison des revenus
En vue de la comparaison des revenus, on détermine le revenu du travail des agriculteurs, d’une part, et le salaire annuel brut des autres groupes de la population, d’autre part La situation salariale de ces derniers est saisie tous les deux ans par l’OFS à l’aide de son enquête sur la structure des salaires. Dans les années intermédiaires, les données sont actualisées au moyen de l’indice de l’évolution des salaires. L’enquête sur leur structure donne un aperçu représentatif de la situation salariale des employés de l’industrie (secteur secondaire) et des services (secteur tertiaire)
Composantes salariales saisies (enquête de l’OFS sur la structure des salaires)
Salaire brut du mois d’octobre (y compris cotisations de l’employé aux assurances sociales, prestations en nature, parts de primes, de chiffre d’affaires ou de provision régulièrement versées), indemnisations pour travail par équipes, travail de nuit et du dimanche, 1⁄12 du 13e salaire et 1⁄12 des paiements spéciaux annuels
Standardisation: conversion des cotisations (y compris charges sociales) en un temps de travail uniforme de 4 1⁄3 semaines à 40 heures
Les chiffres de l’enquête sur la structure des salaires sont convertis en salaires annuels bruts Ensuite, on détermine, pour chaque région, la médiane de tous les employés des secteurs secondaire et tertiaire
On calcule, pour l’agriculture, le revenu du travail agricole par UTAF, qui est le pendant des salaires annuels bruts Une UTAF se base sur 280 journées de travail, une personne correspondant au maximum à 1,0 UTAF
Calcul du revenu du travail agricole
Revenu agricole
– intérêts servis sur le capital propre engagé dans l’exploitation (taux d’intérêt moyen des obligations de la Confédération)
= revenu du travail réalisé par la famille du chef d’exploitation
: nombre d’unités de main-d’œuvre familiale (UTAF) (base: 280 journées de travail)
= revenu du travail par UTAF
A N N E X E A85
Exigences requises pour l’octroi de paiements directs (état août 2001)
Exigences générales
A droit aux paiements directs l’exploitant qui gère une exploitation agricole pour son compte et à ses risques et périls et qui a son domicile civil en Suisse N’y ont pas droit les exploitations de la Confédération, des cantons et des communes, ni les exploitants dont les cheptels dépassent les plafonds fixés dans l’ordonnance sur les effectifs maximums Sont également exclues les personnes morales, sauf s’il s ’agit d’exploitations familiales (art 2, OPD)
Autres exigences
Le droit aux contributions est encore lié à d’autres critères structurels et sociaux Le schéma ci-après récapitule en quelques mots clés les conditions liées à l’octroi des paiements directs
Conditions requises pour l’octroi des paiements directs
Taille minimale de l’exploitation
1 ha
Cultures spéciales: 50 ares
Surfaces viticoles en forte pente et en terrasses: 30 ares
Besoin minimal en travail 0,3 unité de main-d’oeuvre standard (UMOS)
Main-d’œuvre propre à l’exploitation
Âge de l’exploitant
Plafonnement des contributions
– Echelonnement
Au moins 50% des travaux nécessaires à l’exploitation effectués à l'aide de la main-d'œuvre propre à l'exploitation (famille et employés)
Jusqu’à 65 ans
Surface en ha Nombre
Montant maximum par UMOS 45 000 fr
– Revenu imposable (réduit de 30 000 fr pour les couples
Somme des paiements directs réduite dès 80 000 fr d’agriculteurs mariés) de revenu imposable
Fortune déterminante (revenu imposable réduit de 200 000 fr Somme des paiements directs réduite dès 800 000 fr de fortune par UMOS et de 200 000 fr pour les couples d’agriculteurs mariés) déterminante; suppression des paiements directs si la fortune déterminante dépasse fr 1 million
Source: ordonnance sur les paiements directs
A86 A N N E X E
d’animaux, Taux en % en UGB jusqu’à 30 45 100 30–60 45–90 75 60–90 90–135 50 plus de 90 135 0 –
–
Suppléments
Terrains en pente dans la région de montagne et des collines
0,02 UMOS par ha Culture biologique Comme pour la SAU, plus 20% Arbres fruitiers haute-tige 0,01 UMOS/10 arbres
Source: ordonnance sur la terminologie agricole
Le calcul des UMOS se fait à l’aide de facteurs de conversion pour la SAU et les animaux de rente Des suppléments sont versés pour certains modes d’exploitation tels que la culture biologique, qui demande plus de travail. Ces facteurs sont dérivés du relevé standard des processus de l’économie du travail Ils ont été simplifiés pour l’exécution des paiements directs et pour les mesures relevant des améliorations structurelles Ils ne se prêtent pas au calcul du besoin en travail effectif puisque celui-ci dépend des particularités de l’exploitation telles que la configuration du terrain, le regroupement des terres, les bâtiments et le degré de mécanisation
Echelonnement des contributions selon art 20 OPD
L’échelonnement en pour-cent vaut pour tous les types de contributions, à l’exception de celles qui sont allouées pour l’estivage et pour la protection des eaux
A N N E X E A87 Surface agricole utile UMOS/ha SAU sans les cultures spéciales 0,035 Cultures spéciales 0,400 Surfaces viticoles en forte pente et en terrasses 1,000 Animaux de rente UMOS/UGB Vaches laitières, brebis laitières et chèvres laitières 0,05 Porcs à l’engrais 0,01 Porcs d’élevage 0,02 Autres animaux de rente 0,04
Contributions
1–30 ha >30–60 ha >60–90 ha >90 ha f r . / h a Contributions pour les animaux consommant des fourrages grossiers 1–45 UGBFG >45–90 UGBFG >90–135 UGBFG >135 UGBFG f r . / U G B F G 0 1 200 900 600 300 0 900 675 450 225
à la surface
Prestations écologiques requises
Les PER visent une approche globale des systèmes agro-écologiques et des exploitations agricoles C’est à cette fin que les critères développés pour la production intégrée (PI) ont été repris, et que les PER ont vu le jour (état 1996). Par ailleurs, les exploitans doivent prouver qu’ils respectent les prescriptions de la législation sur la protection des animaux La PI, complétée par lesdites prescriptions, est ainsi devenue la norme de l’agriculture suisse Les paiements directs sont versés seulement aux exploitants qui fournissent les PER Si tel n ’est pas le cas, des paiements leur seront versés jusqu’au 31 décembre 2001 Toutefois, les contributions à la surface seront dès lors réduites de 800 francs par hectare de surface donnant droit aux contributions L’instauration des PER a permis d’intégrer les charges liées à la production intégrée (PI, état 1996) L’instauration de paiements directs a exercé une influence considérable sur les systèmes d’exploitation et, partant, sur l’écologie, ce qui se traduit entre autres par l’important accroissement des surfaces exploitées selon les directives PER et bio Si au début de la première étape de la réforme agricole en 1993, leur part représentait 20% à peine, elle concerne aujourd’hui quelque 96% de la SAU C’est grâce à des incitations financières ciblées qu’il a été possible de réaliser une participation aussi importante des exploitations On signalera par ailleurs que certaines exploitations telles que les domaines de l’Etat ou les personnes morales ne bénéficient pas du système de paiements directs, même si elles répondent aux exigences des PER ou de l’agriculture biologique
Les PER comprennent les points suivants:
– Devoir d’enregistrement et de preuve: pour avoir droit aux paiements directs, l’exploitant doit prouver qu’il fournit les PER dans l’ensemble de son exploitation, au moyen d’une attestation délivrée par l’organisation de contrôle cantonale Pour recevoir celle-ci, il tiendra à jour des enregistrements concernant la gestion de l’exploitation
– Garde des animaux de rente respectueuse de l’espèce: les dispositions de l’ordonnance sur la protection des animaux doivent être observées, le renversement du fardeau de la preuve étant valable en l’occurrence, c ’est-à-dire que l’exploitant doit prouver qu’il respecte la loi sur la protection des animaux
– Bilan de fumure équilibré: pour réduire les pertes d’éléments nutritifs dans l’environnement et garder le cycle de ces éléments aussi fermé que possible, les apports d’azote et de phosphore doivent être calculés en fonction du besoin des plantes et du potentiel de production de l’exploitation Dans le bilan de fumure, on utilise essentiellement les engrais de ferme; le recours aux engrais minéraux et aux engrais à base de déchets n 'est justifié qu ’ en cas de besoin, et une tolérance de 10% est assurée
– Des analyses du sol doivent être effectuées par parcelle au moins tous les dix ans, pour que l’on puisse connaître les réserves du sol en nutriments et adapter en conséquence les engrais nécessaires au maintien de la fertilité du sol
– Part équitable de surfaces de compensation écologique (SCE): au moins 3,5% de la SAU dans le cas des cultures spéciales, et 7% pour le reste de la SAU Des bandes herbeuses d'une largeur minimale de 0,5 m doivent être maintenues le long des chemins, et d’une largeur de 3 m le long des cours d’eau, des plans d’eau, des haies, des bosquets champêtres, des berges boisées et des lisières de forêt
Assolement régulier: pour maintenir la fertilité du sol et assurer un bon état sanitaire des plantes, le plan d’assolement annuel doit comprendre un minimum de quatre cultures différentes dans les exploitations comptant plus de 3 ha de terres ouvertes Des parts maximales des cultures principales aux terres ouvertes ou des pauses entre les cultures sont également prescrites
A88 A N N E X E
–
Exemples de parts maximales de cultures en % des terres assolées
– Protection appropriée du sol: un indice de protection du sol est défini pour chaque culture Afin de réduire l’érosion du sol et les pertes d’éléments nutritifs ou de produits de traitement des plantes, les exploitations de plus de 3 ha de terres ouvertes sont tenues d’atteindre un certain nombre de points pour l’indice moyen de protection Pour les cultures des champs, cet indice est de 50 points, contre 30 points pour les cultures maraîchères Les dates des relevés sont le 15 novembre et le 15 février
de l’indice de protection du sol en culture des champs
Sélection et utilisation ciblée des produits de traitement des plantes: ces produits peuvent atteindre l’air, le sol et l’eau et entraîner des effets négatifs non souhaitables sur certains organismes On leur préférera des mécanismes de régulation naturels et des procédés biologiques. Certains traitements sont interdits en culture des champs et en culture fourragère (p. ex. herbicides en prélevée pour le froment) Pour les cultures spéciales, les produits autorisés avec certaines restrictions d’utilisation sont régulièrement actualisés sur des listes
A N N E X E A89
– Céréales (sans le maïs et l’avoine) 66 – Blé et épeautre 50 – Maïs 40 – Avoine 25 – Betteraves 25 – Pommes de terre 25
Exemples
Points Colza 80 Orge d’automne, triticale, seigle, avoine d’automne 50 Blé d’automne, épeautre 40 Prairie artificielle jusqu’au 15 novembre 80 Prairie artificielle jusqu’au 15 février 100 –
Observation des lois
Si l’exploitant viole les prescriptions pertinentes de la loi sur la protection des eaux, de la loi sur la protection de l’environnement et de la loi sur la protection de la nature et du paysage, il risque non seulement une amende mais encore une réduction ou une suppression des paiements directs
Voici quelques exemples de prescriptions dont la violation peut entraîner des sanctions:
– Devoir de diligence destiné à empêcher toute atteinte nuisible aux eaux (art 3 LEaux);
Interdiction d’introduire ou d’infiltrer dans une eau des substances de nature à la polluer et de déposer et d’épandre de telles substances s’il existe un risque concret de pollution de l’eau (art 6 LEaux);
–
Non-respect des valeurs limites relatives aux UGBF fixées à l’art 14 LEaux (en fonction de la surface agricole utile fertilisable);
Capacité de stockage insuffisante pour les engrais de ferme selon l’art 14 LEaux;
– Destruction ou endommagement d’un biotope protégé par la Confédération ou le canton, notamment de roselières et de marais, de haies, de bosquets champêtres et de prairies sèches, d’une curiosité naturelle ou d’un monument protégés, d’un site protégé évocateur du passé, d’un site naturel protégé (sites marécageux compris), lorsque l’exploitation agricole en est la cause (art 24, al 1, let a, LPN en combinaison avec l’art 18, al 1bis, LPN)
Infractions à l'interdiction d'incinérer des déchets (art. 26a OPair)
Les infractions à ces prescriptions sont traitées individuellement en fonction des faits antérieurs et compte tenu des conséquences qu ’elles entraînent Elles sont attribuées à l’une des trois catégories suivantes:
Infraction unique sans effets durables Exemple: épandage unique de purin, contraire à la législation sur la protection des eaux (réduction de 5 à 25%, et de 2’500 fr au max )
Infractions uniques aux effets persistants, agissements ou omissions s’étendant sur plusieurs jours, semaines ou mois Exemple: tas de fumier non consolidé; épandages successifs de purin à des jours différents, contraires à la législation sur la protection des eaux, à des jours différents (réduction de 10 à 50%, et de 10’000 fr au max ) – Infractions répétées dans les trois ans contre les mêmes dispositions ayant trait à l’agriculture Sont déterminants les incidents à partir de l’année 1999 (réduction de 20 à 100%)
A90 A N N E X E
–
–
–
–
–
Comparaison des comptabilités au sein de l’UE
Qu’est-ce que le RICA?
Le réseau d'information comptable agricole de l’Union européenne (RICA) a été créé en 1965. Il a pour but de recueillir les données comptables nécessaires à la constatation annuelle des revenus dans les exploitations agricoles et à l'analyse du fonctionnement économique d'exploitations agricoles
L’échantillon annuel comprend en ce moment quelque 60'000 exploitations permettant de représenter plus de 90% de l’ensemble de la SAU et de la production agricole de l’UE
La plupart des pays membres disposent aussi de réseaux comptables nationaux, dont les données RICA peuvent être prélevées pour la Commission de l’EU Le RICA est la seule source fournissant des résultats économiques comparables sur le plan de l’Union pour les exploitations agricoles
Application de la méthode RICA
Dans plusieurs domaines, la saisie et l’évaluation des données dans le RICA diffèrent de la méthode appliquée dans le dépouillement centralisé des données comptables de la FAT Afin de rendre les résultats comptables suisses comparables aux données RICA, la FAT convertit les données suisses à plusieurs niveaux Les résultats des exploitations suisses présentés ci-après ne sont donc pas assimilables aux résultats des exploitations-témoins comptables
L’exclusion de la maison d’habitation entraîne des adaptations en ce qui concerne les frais de bâtiment, amortissements compris, le produit de la location de bâtiments, de même qu ’ une réduction proportionnelle des intérêts débiteurs, des fermages pour les exploitations entièrement affermées, ainsi que des actifs et des passifs.
Les valeurs comptables et les amortissements sont corrigés selon le coût d’acquisition actuel: machines +5%, bâtiment +20% Quant aux sols et aux autres actifs, on a repris les données du dépouillement centralisé (en Allemagne et en Irlande, il est aussi fait exception à l’appréciation aux prix du marché) Quant au compte des résultats (appréciation des animaux corrigée), au bilan et aux indicateurs relatifs au financement, on calcule des variables RICA standard Une limite inférieure est fixée pour 16 unités de dimension économique européennes en vue du relevé des données suisses Près de 50'000 exploitations couvrant plus de 90% de la surface et de la production peuvent représentées lorsqu’on emploie la typologie des exploitations de l’UE et une pondération analogue La FAT a appliqué pour la première fois la méthode RICA aux exploitations suisses en 1996.
A N N E X E A91
Différences méthodologiques entre le RICA et le dépouillement centralisé
Réseau d'information comptable agricole de l'UE
Définition de l’exploitation
Exploitation agricole sans le bâtiment d’habitation
Appréciation et amortissement
Sols, animaux, réserves et livraisons en nature aux prix du marché, installations au coût d’acquisition actuel
Amortissements appréciés en fonction du coût d’acquisition actuel; ruptures de bilan régulières
Compte des résultats
Production totale et consommation intermédiaire, mouvements internes; pour les animaux d’élevage, les variations de la valeur ne se répercutent sur les résultats qu ’ en cas de modification quantitative
Typologie des exploitations
Typologie de l’UE: le chiffre relatif à chaque branche (ha ou nombre d’animaux) est multiplié par une marge brute standard (MBS)
L’orientation technico-économique (OTE) résulte de la composition de la MBS relative à l’ensemble de l’exploitation La somme de MBS donne la dimension économique de l’exploitation en unités de dimension européenne(UDE; 1 UDE = 1200 ECU MBS)
Population et échantillon
Le RICA représente les unités exploitées à titre principal
Celles-ci doivent se situer en dessus d’un seuil économique (en UDE)
Ces seuils varient selon le pays Les pays voisins de la Suisse appliquent le plus souvent le seuil de 8 UDE, l’Italie, 2 UDE
Pondération des résultats
Fondement: stratification des exploitations selon le type d’exploitation (OTE), dimension économique en UDE) et région RICA (p ex länder allemands)
Dépouillement centralisé, exploitations-témoins
Le bâtiment d’habitation fait partie de l’exploitation; location théorique à la famille du chef d’exploitation
Appréciation selon le principe du prix de revient, soit: sol apprécié le plus souvent à la valeur de rendement; chiffres indicatifs pour les animaux, les réserves et les livraisons en nature
Amortissement des coûts d’acquisition nets historiques; constance du bilan
Compte des rendements bruts et des charges réelles sans mouvements internes
Toute variation de l’appréciation des animaux a une incidence sur le résultat
Typologie des exploitations FAT99: le type d’exploitation est défini en fonction des critères matériels (utilisation du sol et composition de l’effectif de bétail)
La classification établie selon la typologie FAT99 est plus constante dans le temps que celle de l’UE
C’est le plus souvent la surface agricole utile qui sert à mesurer la dimension de l’exploitaiton
La population des exploitations-témoins est délimitée à l’aide des seuils d’ordre matériel; elle englobe plus de 55'000 exploitations, comprenant de nombreuses unités exploitées à titre accessoire
Fondement: stratification des exploitations selon le type d’exploitation (FAT99), classe de grandeur (SAU) et région (de plaine, des collines, de montagne, en fonction des zones de production)
Sources: Commission de l’UE, FAT
A92 A N N E X E
■■■■■■■■■■■■■■■■ Abréviations
Organisation/institution
DFE Département fédéral de l’économie, Berne
DGD Direction générale des douanes, Berne
EPFZ Ecole polytechnique fédérale, Zurich
FAL Station fédérale de recherches en écologie et agriculture, Zurich-Reckenholz
FAM Station fédérale de recherches laitières, Liebefeld-Berne
FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome
FAT Station fédérale de recherches en économie et technologie agricoles, Tänikon
FAW Station fédérale de recherches en arboriculture, viticulture et horticulture, Wädenswil
IER Institut d’économie rurale, Zurich
IRAB Institut de recherche en agriculture biologique, Frick
LBL Landwirtschaftliche Beratungszentrale, Lindau (Centrale de vulgarisation agricole de Lindau)
OCDE Organisation for Economic Cooperation and Development, Paris
OFAE Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays, Berne
OFAG Office fédéral de l’agriculture, Berne
OFAS Office fédéral des assurances sociales, Berne
OFEFP Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage, Berne
OFFT Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie, Berne
OFS Office fédéral de la statistique, Neuchâtel
OFSP Office fédéral de la santé publique, Berne
OMC Organisation mondiale du commerce, Genève
OVF Office vétérinaire fédéral, Berne
PSL Producteurs Suisses de Lait, Berne
RAC Station fédérale de recherches en production végétale, Changins
RAP Station fédérale de recherches en production animale, Posieux
seco Secrétariat d'Etat à l'économie, Berne
SRVA Service romand de vulgarisation agricole, Lausanne
TSM Fiduciaire de l'économie laitière S àr l, Berne
UE Union européenne
USP Union suisse des paysans, Brougg
ZMP Zentrale Markt- und Preisberichtstelle für Erzeugnisse der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft S àr l, Bonn
Unités de mesure
ct centime
dt décitonne = 100 kg
fr. franc
ha hectare = 10'000 m2
hl hectolitre
kcal kilocalorie
kg kilogramme
km kilomètre
l litre
m mètre
m2 mètre carré
A N N E X E A93
mio million
mrd milliard
pce pièce
t tonne
% pour cent
Ø moyenne
Notion/désignation
AGP appellation géographique protégée
AOC appellation d’origine contrôlée
AVS assurance-vieillesse et survivants
CO2 dioxyde de carbone
ESB encéphalopathie spongiforme bovine («maladie de la vache folle»)
IV assurance-invalidité
LAgr loi sur l’agriculture
MPR matières premières renouvelables
N azote
OGM organismes génétiquement modifiés
P phosphore
PV poids vif
PAC politique agricole commune de l’UE
PER prestations écologiques requises
PI production intégrée
PM poids à l’abattage
PTP produit de traitement des plantes
SAU surface agricole utile
SCE surface de compensation écologique
SIPA Système d’Information de Politique Agricole
SRPA sorties régulières en plein air
SST système de stabulation particulièrement respectueux des animaux
TC taux du contingent
THC taux hors contingent
TVA taxe sur la valeur ajoutée
UGB unité de gros bétail
UGBFG unités de gros bétail fourrages grossiers
UMOS unité de main-d’oeuvre standard
UTA unité de travail annuel
UTAF unité de travail annuel de la famille
ZM I, II, zone de montagne I, II,
Référence à d’autres informations en annexe (p ex tableaux)
A94 A N N E X E
Bättig M., Kahlmeier S., Braun-Fahrländer C., 1999.
Aktionsplan Umwelt und Gesundheit: Wissen und Handeln zum Thema Ernährung und Umwelt
Travail de diplôme, division des sciences de l’environnement, EPF Zurich Institut de médecine sociale et préventive de l’Université de Bâle, Bâle
Bösch L , Kuster J , (Brugger, Hanser und Partner), 2001
Absatzförderung Landwirtschaft: Überprüfung der Plausibilität des Konzepts zur Mittelverteilung
Mandat de recherche de l’OFAG
Braun M , Aschwanden N , Wüthrich-Steiner C , 2001
Evaluation Ökomassnahmen: Phosphorverluste durch Abschwemmung.
Agrarforschung 8, 36-41.
Commission européenne, Direction générale de l'agriculture, 2001
Risk Management Tools for EU Agriculture
With a special focus on insurance, Bruxelles
Commission européenne, Direction générale de l'agriculture, 2001
Cadre pour des indicateurs relatifs aux dimensions économique et sociale d'une agriculture et d'un développement rural durables, Bruxelles.
Conseil fédéral suisse, 1992
Septième rapport sur l'agriculture, Berne
Conseil fédéral suisse, 1996
Message concernant la réforme de la politique agricole Deuxième étape (Politique agricole 2002), Berne
Conseil fédéral suisse, 1998
Message du Conseil fédéral concernant un arrêté fédéral sur les moyens financiers destinés à l’agriculture pour les années 2000 à 2003, Berne
De Rosa R , 1999
La réorientation de la politique agricole suisse: analyse financière et endettement Projet de recherche sur mandat de l’OFAG, Fribourg
Gaillard G , Rossier D , FAL, FAT, SRVA, LBL, FiBL, 2001
Bilan écologique de l’exploitation agricole. Méthode et application à 50 entreprises.
Herter U et al , 2001
Risikoanalyse zur Abfalldüngerverwertung in der Landwirtschaft
Rapport sur mandat de l’Office fédéral de l’agriculture, Berne
Institut de génie rural, EPF Zurich, 2001
Privater Nutzen von Arrondierung und Wegnetz bei Gesamtmelorationen.
Mandat de recherche de l’OFAG, Zurich.
A N N E X E A95 ■■■■■■■■■■■■■■■■
Bibliographie
Institut de médecine sociale et préventive de l’Université de Bâle, 2000
Ausgangslage im Teilbereich «Natur und Wohlbefinden», Ernährung, Landwirtschaft und Umwelt, Bâle
Institut de recherche SRS et Institut d'économie rurale (IER), 2000. Univox Teil III A Landwirtschaft 2000
Institut de recherche SRS, Recherche économique et marketing social, 2001
Befindlichkeit der landwirtschaftlichen Bevölkerung im Vergleich zur übrigen Bevölkerung
Rapport présentant les résultats d’un sondage représentatif réalisé sur mandat de l’OFAG, Zurich
Jenny, M , Weibel, U , Lugrin, B , Josephy B , Regamey J -L , Zbinden N (en impression/2001)
Förderung von typischen Brutvogelarten der offenen Feldflur durch ökologische Ausgleichsflächen in intensiv genutzten Ackerbaugebieten des Klettgaus SH und der Champagne genevoise GE OFEFP, Cahiers de l’environnement, Berne
Jörin R (Institut d'économie rurale de l’EPF Zurich), 2000
Die Regelung des Marktzutrittes, Theorie.
Mandat de recherche de l’OFAG, Zurich
Jörin R (Institut d'économie rurale de l’EPF Zurich), 2000
Die Regelung des Marktzutrittes beim Wein
Mandat de recherche de l’OFAG, Zurich
Koch B , Rieder P (Institut d'économie rurale de l’EPF Zurich), 2001
Fleischmarktanalyse.
Mandat de recherche de l’OFAG, Zurich
Koch B , Rieder P (Institut d'économie rurale de l’EPF Zurich), 2001
Eiermarktanalyse
Mandat de recherche de l’OFAG, Zurich
Koch B , Rieder P (Institut d'économie rurale de l’EPF Zurich), 2001
Marktanalysen, Theorie und Methoden
Mandat de recherche de l’OFAG, Zurich
Koch B , Rieder P (Institut d'économie rurale de l’EPF Zurich), 2001
Getreidemarktanalyse
Mandat de recherche de l’OFAG, Zurich
König M , Senti R , 2001
Überprüfung der Methodik bei der Mittelverteilung in der landwirtschaftlichen Absatzförderung.
Mandat de recherche de l’OFAG, Zurich.
Lehmann B et al (Institut d'économie rurale de l’EPF Zurich), 1999
Auswirkungen der Agrarreform auf das N-Verlustpotenzial in der Landwirtschaft
Rapport final de l’EPF, Zurich
A96 A N N E X E
Lehmann B et al (Institut d'économie rurale de l’EPF Zurich), 2000
Lebensqualität in der Schweizer Landwirtschaft
Grundlagen für eine zukünftige Sozialberichterstattung, Zurich
Lehmann B et al (Institut d'économie rurale de l’EPF Zurich), 2001
Evaluation des Milchmengenmanagements, Hauptstudie.
Mandat de recherche de l’OFAG, Zurich
Mauch Consulting, INFRAS, Ernst Basler und Partner AG, 2001
Politik der nachhaltigen Entwicklung in der Schweiz
Standortbestimmung und Perspektiven, Zurich
Office fédéral de l’agriculture (OFAG), 2000
Rapport agricole 2000, Berne
Office fédéral de l’agriculture (OFAG), 2001
Publication de l'attribution des contingents tarifaires.
Selon point 2 du rapport du Conseil fédéral du 21 février 2001 sur les mesures tarifaires douanières 2000, tiré à part
Office fédéral de l’agriculture (OFAG), 2001
Evaluation des mesures écologiques et des programmes de garde d’animaux
Quatrième rapport intermédiaire, Berne
Office fédéral de la statistique (OFS), diverses années
Reflets de l'agriculture suisse, Neuchâtel
Office fédéral de la statistique (OFS), 2001
Statistique de la superficie.
L'utilisation du sol: hier et aujourd'hui, Neuchâtel
Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP), 1996.
Stratégie de réduction des émissions d'azote
Cahier de l‘environnement no 273, Berne
Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP), 1998
Methanemissionen der schweizerischen Landwirtschaft.
Cahier de l‘environnement no 298, climat, Berne
Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP), 2000
Graue Treibhausgas-Emissionen des Energie- und des Ernährungssektors der Schweiz 1990 und 1998
Document environnement no 128, climat, Berne
Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), 2001
Indicateurs environnementaux pour l’agriculture.
Volume 3, Méthodes et résultats, Paris
Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), 2001
Politique agricole dans les pays de l’OCDE
Monitoring et évaluation 2001, Paris
A N N E X E A97
Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), 2001 Multifonctionnalité
Elaboration d’un cadre analytique, Paris.
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), 2000
L’état de l’insécurité alimentaire dans le monde
La faim au quotidien et la crainte permanente de la famine, Rome
Organisation mondiale du commerce (OMC), 2001
Examen des politiques commerciales: Suisse et Liechtenstein Rapport du Secrétariat, Genève
Rossier D , FAT, FAL, FiBL, SRVA, LBL, 2000
Evaluation simplifiée de l’impact environnemental potentiel de l’agriculture suisse.
Société suisse de l'industrie chimique, diverses années
Statistische Erhebungen über Pflanzenschutzmittel, Zurich
Station fédérale de recherches en écologie et agriculture (FAL), 1999
Bilan des éléments nutritifs dans l’agriculture suisse pour les années 1975 à 1995
Cahiers de la FAL 28, Spiess E , Zurich
Station fédérale de recherches en écologie et agriculture (FAL), 2000
Emissions de protoxyde d'azote de l'agriculture suisse.
Cahiers de la FAL 33, Zurich
Station fédérale de recherches en écologie et agriculture (FAL), 2001
Evaluation des mesures écologiques: La charge des eaux de surface en phosphore liée à l'érosion des sols
Cahiers de la FAL 37, Prasuhn V , Kaufmann U , Zurich
Station ornithologique de Sempach, 2001 Rebhuhnprojekt, Sempach
Union suisse des paysans (USP), diverses années Comptes économiques de l'agriculture suisse, Brougg
Union suisse des paysans (USP), diverses années Statistiques et évaluations concernant l’agriculture et l’alimentation, Brougg
A98 A N N E X E
A N N E X E A99
A100 A N N E X E