
R A P P O R T A G R I C O L E Bundesamt für Landwirtschaft Office fédéral de l’agriculture Ufficio federale dell’agricoltura Uffizi federal d’agricultura
Editeur
Office fédéral de l’agriculture (OFAG)
3003 Berne
Tél : 031 322 25 11
Fax: 031 322 26 34
Internet: www blw admin ch
Copyright: OFAG, Berne 2000
Layout et graphisme
Artwork, Grafik und Design, Saint-Gall
Impression Bruhin AG, Freienbach
Photos
AMS Agro-Marketing Suisse
Division cantonale
Améliorations structurelles
– FAL Station fédérale de recherches en agroécologie et agriculture
– Fédération suisse d'élevage de la race brune
Haras fédéral d’Avenches
Incolor AG
Keystone Archive
LBL Centrale de vulgarisation agricole de Lindau
– M Waldburger (FAL)
– Office fédéral de l’agriculture
– Organisation fromagère suisse
PhotoDisc Inc
Photothèque Agrofot
Prisma Dia-Agentur
PSL Fédération des Producteurs
Suisses de Lait
– RAC Station fédérale de recherches en production végétale de Changins
– Suisse Tourisme
Switzerland Cheese Marketing AG
Diffusion
OFCL/OCFIM, 3003 Berne
No de commande:
français: 730 680 00 f
10 2000 2000 41727
allemand: 730 680 00 d
10 2000 4000 41727
italien: 730 680 00 i
10 2000 500 41727
Fax: 031 325 50 58
Internet: www admin ch/edmz
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
A C H E V É D ’ I M P R I M E R 2
■■■■■■■■■■■■■■■■ Table des matières Préface 4 ■ 1. Rôle et situation 1.1 Economie 9 de l‘agriculture 1 1 1 L’agriculture, partie intégrante de l‘économie 10 1 1 2 Marchés 22 1 1 3 Situation économique du secteur agricole 47 1 1 4 Situation économique des exploitations 52 1.2 Aspects sociaux 63 1 2 1 Recours à des prestations sociales 64 1 2 2 Indicateurs sociaux 77 1 3 Ecologie 81 1 3 1 Indicateurs agro-environnementaux 82 1 3 2 Evaluation de l’impact environnemental de l’agriculture suisse 104 1 3 3 Biodiversité – produit de l’agriculture 107 1.3.4 Effets externes de l’agriculture suisse 113 1.4 Appréciation de la durabilité 117 ■ 2 Mesures de politique 2 1 Production et ventes 121 agricole 2 1 1 Instruments pluriels 123 2 1 2 Economie laitière 135 2 1 3 Production animale 142 2.1.4 Production végétale 147 2.2 Paiements directs 155 2.2.1 Concept, rôle, exigences, exécution et contrôle 156 2 2 2 Paiements directs généraux 167 2 2 3 Paiements directs écologiques 175 2.3 Amélioration des bases de production 187 2 3 1 Améliorations structurelles et aide aux exploitations 188 2 3 2 Recherche, vulgarisation, haras 194 2 3 3 Matières auxiliaires de l’agriculture, protection des végétaux et des variétés 200 2 3 4 Elevage 210 ■ 3. Aspects internationaux 3.1 Développements internationaux 213 3 2 Comparaisons internationales 231 ■ Annexe Tableaux A2 Textes légaux relevant du domaine de l‘agriculture A58 Procédés et méthodes A61 Abréviations A64 Bibliographie A66 T A B L E D E S M A T I È R E S 3
Les années nonante ont été marquées par d’intenses débats sur l’orientation de la politique agricole et de l’agriculture En 1996, le peuple et les cantons ont approuvé à une nette majorité un nouvel article constitutionnel, qui prescrit la promotion d’une agriculture à la fois durable et adaptée aux exigences du marché C’est la première fois que la notion de durabilité a ainsi été introduite dans la Constitution Longtemps, l’écologie a été au premier plan du débat sur la durabilité Le deuxième sommet de 1992 à Rio a toutefois démontré qu’il ne saurait y avoir de protection de l’environnement sans progrès social et sans efficience économique L’économie, le social et l’écologie sont donc les trois dimensions de la durabilité.

La nouvelle loi sur l’agriculture, en vigueur depuis le 1er janvier 1999, forme le cadre du développement durable de l’agriculture. L’Etat se retire autant que possible des opérations du marché Il rétribue par des paiements directs les prestations d’intérêt général et les prestations écologiques particulières fournies par les agriculteurs La Confédération investit 4 milliards de francs dans l’agriculture, dont 60% pour les paiements directs Dans son ordonnance sur l'évaluation de la durabilité de l'agriculture, le Conseil fédéral a chargé l’Office fédéral de l’agriculture d’examiner les conséquences économiques, sociales et écologiques des mesures de politique agricole et de présenter chaque année un rapport sur les résultats obtenus Le premier de ces rapports informe sur l’année 1999 et renseigne sur la façon dont les fonds ont été utilisés et sur les conséquences de la politique suivie
Le bilan dressé après une année d’application de la nouvelle base légale est réjouissant La situation économique est stable, ce qui ne va pas de soi En effet, la réorientation a exigé de grandes adaptations dans plusieurs domaines. Les garanties des prix et d’écoulement ont été supprimées, et les milieux concernés doivent désormais confronter davantage les forces du marché Ce passage au nouveau système a réussi grâce à l’engagement de tous. Il n ’ y a pas eu d’effondrement des marchés. Ces dernières années, d’énormes changements ont eu lieu dans les exploitations agricoles en matière d’écologie Depuis l’introduction des contributions y relatives, les prestations écologiques ont fortement augmenté, alors que l’utilisation de moyens de production risquant de porter atteinte à l’environnement a considérablement baissé
P R É F A C E ■■■■■■■■■■■■■■■■
Préface
4
Les rapports agricoles renseigneront sur l’évolution de certains paramètres économiques, sociaux et écologiques Le premier d’entre eux pose les fondements, qu’il s ’agira de compléter et d’améliorer, surtout en ce qui concerne le domaine social et l’écologie. Les résultats de diverses analyses, auxquelles sont soumises les mesures de politique agricole, seront intégrés au fur et à mesure Les rapports serviront aussi de base pour les décisions à prendre sur le développement de la politique agricole
L’analyse des résultats exposés dans le présent rapport montre que l’amélioration de la compétitivité doit demeurer au centre des préoccupations si l’on veut que l’agriculture maintienne ses parts de marché Les contraintes d’ajustement resteront donc fortes ces prochaines années D’une part, les mesures de politique agricole devraient être conçues de façon à permettre aux agriculteurs capables et désireux de développer leur exploitation de s’imposer sur le marché D’autre part, il convient de prévoir des mesures d’accompagnement social pour que les processus d’adaptation soient socialement supportables et que les exploitations sans avenir dans l’agriculture puissent disposer de solutions de rechange Enfin, les exigences concernant les mesures écologiques doivent être consolidées
Voici donc le premier de ces rapports J’espère qu’il vous intéressera et je me réjouirais si vous me faisiez part de vos remarques et suggestions.
Manfred Bötsch
Directeur de l’Office fédéral de l’agriculture

P R É F A C E
5
6
■■■■■■■■■■■■■■■■ 1. Rôle et situation de l’agriculture

1 7
Selon l’art. 104 de la Constitution fédérale, «la Confédération veille à ce que l’agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
a. à la sécurité de l’approvisionnement de la population;
b à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural;
c à l'occupation décentralisée du territoire»
Les buts ancrés dans la Constitution indiquent clairement que l’agriculture remplit des tâches qui vont au-delà de la seule production de denrées alimentaires On parle à ce propos de multifonctionnalité de l’agriculture L’entretien du paysage, la sauvegarde des bases naturelles de l’existence et l’occupation décentralisée du territoire sont des tâches d’intérêt public qui ne sont que partiellement rétribuées par le marché.
C’est en 1996 que la notion de durabilité a été introduite dans la Constitution pour la première fois. Elle représente, depuis la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (CNUED) de 1992, à Rio de Janeiro, une ligne directrice majeure en matière de politique
Le Conseil fédéral entend suivre les effets de la nouvelle politique agricole Il a créé les conditions indispensables pour ce faire dans son ordonnance sur l'évaluation de la durabilité de l'agriculture Les dispositions de l’art 1, al 1, de ladite ordonnance prévoient que la politique agricole et les prestations de l’agriculture doivent être régulièrement évaluées sous l’angle de la durabilité, alors qu ’ en vertu de l’art. 2 ce sont les conséquences économiques, sociales et écologiques qui doivent être évaluées L’OFAG publiera chaque année un rapport sur les résultats des analyses
Les trois dimensions de la durabilité constituent la structure de base des informations contenues au chapitre 1 du rapport agricole, chapitre consacré au rôle et à la situation de l’agriculture Il comprend trois volets: l’économie, le social et l’écologie
8 1 . R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E 1
Dans le passé, les rapports sur l’agriculture traitaient pour l’essentiel les aspects économiques de l’agriculture Signalons par exemple que les données comptables fournies par des entreprises choisies renseignaient sur le revenu des exploitations individuelles et que les comptes économiques de l’agriculture reflétaient la situation de tout le secteur Les recensements des exploitations agricoles, effectués en règle générale tous les cinq ans, livraient des informations sur le développement des structures dans l’agriculture De plus, on collectait de nombreuses données sur la production et les prix Dans le domaine économique, on disposait de bases très complètes pour la rédaction du rapport.
Ce chapitre présente la place économique de l’agriculture en tant que pan de l’économie et fournit des informations sur la production, la consommation, le commerce extérieur, les prix à la production et à la consommation sur les différents marchés, de même que sur la situation économique du secteur dans son ensemble et sur les exploitations individuelles

9 1 . 1 E C O N O M I E ■■■■■■■■■■■■■■■■
1.1 Economie
1
1.1.1 L’agriculture, partie intégrante de l’économie
Au cours des dernières décennies, les progrès techniques ont permis d’améliorer sensiblement les prestations fournies par l’agriculture A l’heure actuelle, l’agriculteur à la tête d’une exploitation moderne est en mesure d’exploiter une surface deux à trois fois plus importante ou de garder un cheptel deux ou trois fois plus nombreux qu’il y a 30 ou 40 ans Cette évolution de la productivité se répercute sur les secteurs situés en aval, les prix à la production étant moins élevés Pour maintenir un revenu suffisant tiré exclusivement de l’activité agricole, les agriculteurs doivent donc agrandir leur exploitation S’ils n ’ont pas cette possibilité, ils ont recours à un revenu accessoire pour remplacer le manque à gagner, ou abandonnent l’exploitation à long terme, en règle générale au moment du changement de génération Le recul du nombre d’exploitations agricoles en témoigne
Dans les années cinquante et soixante, le nombre d’exploitations agricoles diminuait d’environ 2% en moyenne annuelle Cette période a été suivie, dans les années septante et quatre-vingt, d’une phase de stagnation caractérisée par un taux de baisse annuel moyen de quelque 1% L’Etat est alors intervenu directement sur les marchés et a ainsi freiné l’évolution structurelle La réorientation de la politique agricole et son alignement accru sur le marché ont entraîné une intensification du changement structurel dans les années nonante, le taux du recul atteignant celui des années soixante Dans l’année sous revue, on a dénombré en Suisse 73’591 exploitations agricoles, soit
ou
de moins qu ’
10 1 . 1 E C O N O M I E 1 ■■■■■■■■■■■■■■■■
■
agricoles en baisse
2'821
3,7%
en 1998.
Nombre d’exploitations
19551965196919751980198519901 19901 19961999 N o m b r e d ' e x p l o i t a t i o n s e n % Recul par an Nombre d'exploitations Source:
0 240 000 200 000 160 000 120 000 80 000 40 000 0 3 2,5 2 1,5 1 0,5 2,42,11,91,20,82,12,62,5
Evolution du nombre des exploitations agricoles
OFS 1 Nouvelle méthode de relevé appliquée dès 1990 (sans les plus petits producteurs)
Nombre d’entreprises exploitées à titre principal ou accessoire

Pour distinguer entre les entreprises exploitées à titre principal et celles exploitées à titre accessoire, on se fonde en premier lieu sur le degré d’occupation dans l’entreprise. On parle d’une entreprise exploitée à titre principal lorsque son chef y est occupé à 50% au moins La charge de travail doit atteindre au minimum 1'500 heures par an Les données relatives aux deux types d’exploitations sont relevées dans le cadre des recensements des entreprises et de l’agriculture qui, en principe, ont lieu deux fois par décennie. Au cours de la dernière décennie, les entreprises ont été recensées en 1990 et 1996
Pendant cette période, l’évolution a été quasiment la même pour les entreprises exploitées à titre principal et celles exploitées à titre accessoire En Suisse, le rapport entre ces deux types d’entreprises est de 2/3 pour 1/3, alors que les pays de l’UE affichent une proportion exactement inverse Dans les années septante et quatre-vingt, l’UE, bien plus que le gouvernement suisse, s ’est en effet référée à l’accroissement de la productivité pour fixer les prix minimums garantis. Ceux qui souhaitaient y exercer une activité agricole à titre principal étaient donc contraints d’agrandir leur exploitation Dans ces conditions, de nombreux agriculteurs ont opté pour une activité accessoire
Entreprises exploitées à titre principal en Suisse et en Allemagne
CH: chiffres 1996
D: chiffres 1997
Sources: OFAG, rapport agricole allemand
1 . 1 E C O N O M I E 11
Exploitations 1990 1996 Variation % A titre principal 64 242 55 951 -12,9 dont en plaine 30 144 25 475 -15,5 dont en montagne 1 34 098 30 476 -10,6 A titre accessoire 28 573 23 528 -17,7 dont en plaine 11 451 10 302 -10,0 dont en montagne 1 17 122 13 226 -22,7 Total 92 815 79 479 -14,4
1 Zone des collines et zones de montagne I à IV Source: OFS
Structure CH D Entreprises exploitées à titre principal nombre 55 951 227 000 Ø Surface ha 17,4 41,3 UMO/100 ha 10,4 3,6 UGB/UMO 13,5 42,9
1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E 1
Les entreprises allemandes exploitées à titre principal cultivent une surface deux fois plus étendue que les entreprises suisses L’écart apparaît aussi clairement dans la main-d’oeuvre nécessaire à exploiter 100 ha et dans le nombre d’unités de gros bétail gardé par une unité de main-d’œuvre. La comparaison ne fournit que des ordres de grandeur, car il existe des différences dans le calcul de la charge en bétail Par ailleurs, en Allemagne, la proportion entre terres assolées et surfaces herbagères est inverse à celle de la Suisse, ces surfaces représentant 70% et 30% respectivement Or, l’exploitation des surfaces herbagères en Suisse, notamment dans la région de montagne, est plus pénible et coûteuse que celle des terres assolées en Allemagne Malgré ces différences, la comparaison permet de conclure que les entreprises allemandes exploitées à titre principal sont plus efficaces et plus productives que les entreprises suisses du même type.
Outre l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture et la pêche font partie du secteur primaire En 1998, 4,8% de la population active travaillaient dans ce secteur, dont 4% dans l’agriculture

12
1 . 1 E C O N O M I E 1 Evolution du nombre de personnes actives dans les trois secteurs économiques 196019801998 e n 1 0 0 0 Secteur primaire Secteur secondaire Secteur tertiaire Sources: OFS, USP 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 393 1 263 1 061 218 1 207 1 741 179 1 009 2 660
■ Un emploi sur huit est lié à l’agriculture
Les activités des branches situées en amont, notamment la production d’aliments pour animaux, et de celles situées en aval, telle la transformation de denrées alimentaires, sont étroitement liées à l’agriculture En l’absence d’une agriculture productive, ces activités disparaîtraient totalement ou partiellement.
Les chiffres concernant les personnes actives dans l’agriculture et la sylviculture, ainsi que dans les branches situées en amont et en aval, ont été relevés pour la dernière fois en 1995 Les branches situées en aval occupaient alors quelque 220'000 personnes, soit 5,8% de la population active La part des branches situées en amont se montait, quant à elle, à 1,5% Au total, l’agriculture et les secteurs qui lui sont étroitement liés occupent directement plus de 12% des personnes actives
La valeur ajoutée brute aux prix du marché sert à mesurer la prestation d’une économie. S’agissant de l’agriculture, elle correspond à la valeur des denrées produites (produits finis) déduction faite de la consommation intermédiaire La valeur ajoutée englobe toutes les ventes de produits agricoles à d’autres secteurs économiques, l’utilisation à des fins privées, les variations de stocks et les constructions pour compte propre
Valeur ajoutée brute aux prix du marché des trois secteurs économiques en 1998 (provisoire)
En 1998, la valeur ajoutée brute du secteur primaire aux prix du marché s’élevait à 5,9 milliards de francs, dont près des deux tiers à l’actif de l’agriculture Comparée à la valeur ajoutée de l’économie dans son ensemble, sa part de 1,1% est faible La rétribution des prestations d’intérêt général, notamment l’entretien du paysage rural, par le biais de paiements directs n ’est pas incluse dans ladite valeur Celle-ci n ’est donc pas un critère d’évaluation suffisant Mandatée par l’OFAG, l’entreprise ECOSYS SA, Genève, a dès lors évalué les fonctions écologiques de l’agriculture suisse, qui vont audelà de la pure production de denrées alimentaires. Cette étude estime l’utilité nette des fonctions écologiques à 2 milliards de francs par an (cf ch 1 3 4)
13 1 . 1 E C O N O M I E
Secteurs mio de fr % Secteur primaire 5 862 1,55 dont agriculture 3 999 1,06 Secteur secondaire 109 393 29,02 Secteur tertiaire 261 719 69,43 Total 376 974 100 Source: OFS
1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E 1
■ La valeur ajoutée ne révèle pas toutes les prestations de l’agriculture
■ UE: principal partenaire commercial pour les produits agricoles
En Suisse, le rapport entre importation et exportation de produits agricoles s’établit depuis des années à 2 : 1
Notre pays importe surtout des denrées peu ou pas transformées que la production suisse n ’arrive pas à fournir en quantité suffisante ou qui ne sont pas produites en Suisse, telles que le café, le thé et les épices
A l’inverse, les produits transformés constituent la majeure partie des exportations La Suisse réexporte aussi sous cette forme des matières premières importées Tel est le cas notamment du cacao et du tabac
Part
des produits agricoles au total des importations et exportations
ImportationsExportations
Les importations et les exportations de produits agricoles ont augmenté de valeur de 1990/92 à 1999 Par contre, leur part à l’ensemble du commerce a reculé de 7,2% à 6,8% pour les importations et de 3,0% à 2,7% pour les exportations.
Echanges de produits agricoles : pays d'origine et de destination en 1999
Importations: 8 159 mio. de fr.Exportations: 3 307 mio. de fr.
Autres pays 7%
Europe centrale 2%
Etats-Unis 5%
Pays en développement 14%
UE 72%
Autres pays 14%
Europe centrale 4%
Etats-Unis 6%
Pays en développement 8%
UE 68%
Source: DGD
Dans le domaine agricole, l’UE est le principal partenaire commercial de la Suisse Dans l’année sous revue, plus de 70% du total des importations agricoles provenaient de l’UE, alors qu ’environ deux tiers des exportations rejoignaient ce même espace Les premiers des viennent-ensuite étaient, pour les importations, les pays en développement avec 14% et, pour les exportations, un grand nombre de pays différents
14 1 . 1 E C O N O M I E 1
1990/9219991990/921999 e n m i l l i a r d s d e f r . Agriculture Ensemble de l'économie Source: DGD 0 20 40 60 80 100 120 140 6,9 94,7 8,2 120,0 2,7 89,5 3,3 120,7
Importation et exportation de produits agricoles et de produits transformés selon la catégorie de produits en 1999
Importations: 8 159 mio. de fr.Exportations: 3 307 mio. de fr.
Produits laitiers (4)

Tabac et divers (13, 14, 24)
Denrées alimentaires (20, 21)
Aliments pour animaux, déchets (23)
Céréales et préparations (10, 11, 19)
Denrées d'agrément (9, 17, 18)
Oléagineaux, graisses et huiles (12, 15)
Végétaux vivants, fleurs (6)
Légumes (7)
Fruits (8)
Produits animaux, Poissons (1, 2, 3, 5, 16)
Boissons (22)
2 0001 5001 00050005001 000( ): N° du tarif douanier Excédents d'importations ou d'exportations
Source: DGD
La Suisse importe tous les produits en quantité considérable. Classés en fonction de la valeur des marchandises, les produits animaux (poissons inclus) et les boissons figurent en première place avec près d’un tiers des importations Il est frappant de constater que, en matière d’exportation, seuls quelques rares produits agricoles non transformés sont vendus à l'étranger Les exportations concernent avant tout des produits transformés tels que le chocolat, les soupes et les röstis Ces produits contiennent parfois des matières premières importées, notamment le sucre qui, composant du chocolat, entre au pays pour le quitter après transformation L’excédent d’exportation le plus élevé est enregistré pour les produits laitiers. Dans l’année sous revue, il a atteint 154 millions de francs
15 1 . 1 E C O N O M I E 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E
408562 387504 784808 279155 536366 789606 34340 5193 5397 8397 1 28451 1 444199
1
Importation et exportation de produits agricoles et de produits transformés dans des pays sélectionnés en 1998 (par habitant)
1 5001 00050005001 0001 5002 000
Source: OCDE
La structure du commerce des produits agricoles varie d’un pays à l’autre. La Hollande est en tête du commerce par habitant aussi bien pour les importations que pour les exportations La Suisse, avec ses 400 $ par habitant, se trouve en première place des importateurs nets, devançant largement le Japon et la Grande-Bretagne. L’Irlande, quant à elle, mène le peloton des exportateurs nets avec 898 $ par habitant
■ Degré d’autosuffisance stable
L’agriculture suisse est chargée par la Constitution de fournir une contribution substantielle à la sécurité de l’approvisionnement de la population en denrées alimentaires. Par degré d’autosuffisance, on entend en général la part de la production indigène à la consommation totale du pays
Source: USP
16 1 . 1 E C O N O M I E 1
Irlande Pays-Bas Australie Canada France Espagne Etats-Unis Italie Autriche Allemagne Grande-Bretagne Japon Suisse 862 1 760 1 138 1 821 152440 376557 457635 398432 171201 395270 527362 511325 496292 35216 693293
($ par habitant)Exportations ($
habitant)
Importations
par
Excédents d'importations ou d'exportations
Evolution du degré d'autosuffisance (en énergie) 19601970198019901998 e n % Domaine animal Total Domaine végétal
30 40 50 60 70 80 90 100 110 Tableau 11, page A11
■ Les dépenses de l’agriculture stimulent l’économie de l’espace rural
Entre 1960 et 1998, l’agriculture suisse a produit environ deux tiers des denrées alimentaires consommées dans le pays Durant cette période, le degré d’autosuffisance est demeuré stable, en dépit de la croissance de la population (environ 2,5 mio de personnes en plus), grâce aux progrès réalisés en matière de productivité agricole. Le degré d’autosuffisance a pu être maintenu durant les années nonante malgré la concurrence internationale accrue à laquelle l’agriculture est confrontée notamment en raison de la réorientation de la politique agricole Par ailleurs, il convient de signaler que, depuis 1980, le degré d’autosuffisance progresse pour les produits végétaux et régresse pour les produits animaux
L’agriculture suisse est, à double titre, une cliente importante de l’économie. D’une part, elle achète en amont des prestations destinées à la production et, de l’autre, elle investit pour pouvoir fournir ses prestations
Dépenses liées à la production de l'agriculture en 1999 (estimation)

Total 3 813 mio. de fr.
Semences et plants, bétail 6%
Energie 11%
15% Engrais, produits phytosanitaires 7%
Aliments pour animaux 38%
Matériel ainsi qu'entretien de machines et de bâtiments d'exploitation 23%
Source: USP
En 1999, l’agriculture a fait l’acquisition, en amont, de marchandises d’une valeur de 3,8 milliards de francs, dont environ 1,5 milliard était destiné à l’achat d’aliments pour animaux En deuxième position, avec 865 millions de francs, on trouve le matériel ainsi que l’entretien des machines et des bâtiments d’exploitation Ensemble, ces deux positions ont représenté plus de 60% des dépenses liées à la production agricole La part de l’agriculture aux prestations préalables de l’économie dans son ensemble était de 1,1%, soit l’équivalent de sa part à la valeur ajoutée brute aux prix du marché
1 . 1 E C O N O M I E 17 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E
Services
1
■ Baisse continue des dépenses alimentaires dans les ménages

Comparaison des dépenses d’investissement entre l’agriculture et l’économie dans son ensemble en 1998 (provisoire)
Au total, l’économie a investi quelque 76 milliards de francs en 1998. Les dépenses d’investissement de l’agriculture se sont élevées à environ 1,5 milliard de francs L’agriculture et les dépenses liées à la production ont ainsi fourni une contribution à la valeur ajoutée dans d’autres branches et, par la suite, aux revenus, en particulier dans l’espace rural
19601970198019901998
Les relevés jusqu'a 1989 se fondent sur des ménages composés de salariés et de rentiers; à partir de 1990, l'enquête porte sur tous les ménages privés. Les dépenses du ménage englobent toutes les dépenses, impôts et assurances inclus. Les données relatives aux denrées alimentaires ne contiennent pas les dépenses pour les boissons et le tabac, ni celles des repas et boissons pris au restaurant.
Source: OFS
Dans le budget global des ménages privés, la part des dépenses pour les denrées alimentaires ne cesse de décroître En 1960, les denrées alimentaires représentaient 27% des dépenses des ménages privés pour tomber à 7% en 1998 Cette évolution est due à la croissance économique et à la cession des gains de producitivité de l’agriculture aux branches situées en aval
18 1 . 1 E C O N O M I E 1
Investissements Economie dans Agriculture son ensemble mio de fr mio de fr % Investissements dans les équipements 37 808 748 2,0 Investissements dans les bâtiments 38 209 743 1,9 Total 76 017 1 491 2,0 Sources: OFS USP
Evolution de la part des denrées alimentaires dans les dépenses des ménages
0 5 10 15 20 25 30 e n %
■ Stabilisation des dépenses de la Confédération pour l’agriculture et l’alimentation
La réorientation de la politique agricole des années nonante a consisté pour l’essentiel à séparer davantage la politique des prix de celle des revenus et à mieux prendre en considération des critères écologiques dans la production agricole Elle a été concrétisée, d’une part, par la réduction du soutien des prix des produits agricoles et, de l’autre, par l’introduction des paiements directs généraux et écologiques
Dépenses de la Confédération par groupes de tâches en 1999
Total 45 656 mio. de fr.
Autres tâches 10%
Relations avec l'étranger
5%
Formation et recherche
Prévoyance sociale 26%
Agriculture et alimentation 9%
7% Défense nationale 11%
Finances et impôts 18%
Trafic 14%
Source: Compte d'Etat
Dans l’année sous revue, la Confédération a consacré 4'197 millions de francs à l’agriculture et à l’alimentation Après les dépenses consacrées à la prévoyance sociale, aux finances et aux impôts, au trafic et à la défense nationale, celles pour l’agriculture et l’alimentation se placent en cinquième position
Remarque: le Compte d Etat de 1999 sert de base à la répartition des moyens financiers entre les différents domaines C’est ainsi que les dépenses pour la mise en valeur des pommes de terre et des fruits ou celles pour l’administration des blés 1990/92 ont été englobées dans les dépenses de l OFAG, même si à l époque, les comptes étaient encore séparés Les chiffres pour 1990/92 ainsi que ceux pour 1997 et 1998 ne coïncident donc pas avec les données du Compte d’Etat correspondant L augmentation des dépenses administratives, notamment après 1997, s explique par des dépenses pour des évaluations externes et des prestations à la caisse de pensions
1 budget 2000
Sources: Compte d’Etat OFAG
19 1 . 1 E C O N O M I E 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E
Evolution
dépenses
Domaine des dépenses 1990/92 1997 1998 1999 20001 mio. de fr. Dépenses OFAG 2 699 3 499 3 519 3 795 3 606 Production et écoulement 1 685 1 254 1 203 1 318 994 Paiements directs 772 2 070 2 126 2 286 2 316 Améliorations des bases de production 207 139 147 148 247 Administration 33 36 43 43 49 Autres dépenses 351 409 407 402 383 Total agriculture et alimentation 3 048 3 908 3 926 4 197 3 989
des
de la Confédération pour l’agriculture et l’alimentation
1
Les dépenses de la Confédération pour l’agriculture et l’alimentation ont augmenté de 860 millions de francs de 1990/92 à 1997 Cette progression s’inscrit dans la suite logique de la réorientation de la politique agricole et de l’extension des paiements directs qu ’elle implique. Au cours de la deuxième moitié des années nonante, les dépenses se sont stabilisées à près de 4 milliards L’augmentation de 271 millions de francs enregistrée au total en 1999 par rapport à 1998 s ’explique surtout par des dépenses extraordinaires en rapport avec la dissolution de l’USF et de la Butyra, ainsi que par la transition de l’ancienne à la nouvelle organisation du marché laitier
Depuis 1960, les dépenses de la Confédération pour l’agriculture et l’alimentation ont certes augmenté dans l’absolu, mais elles ont diminué en comparaison des dépenses totales. En dépit de la réorientation de la politique agricole qui pèse davantage sur les contribuables mais décharge les consommateurs, la proportion n ’ a pas évolué La légère augmentation de 1990 à 1999 est due aux dépenses extraordinaires de l’année 1999.

20
l'alimentation 19601970198019901999 m i o . d e f r . e n % en % des dépenses totales de la Confédération Source: Compte d'Etat 00 2 4 6 8 10 12 14 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 346826 163926764197 1 . 1 E C O N O M I E 1
Evolution des dépenses de la Confédération pour l'agriculture et
Tableau 41, page A50
■ Evolution différente des indices des prix
Evolution de l'indice des prix à la production et à la consommation des denrées alimentaires et de l'indice des prix des moyens de production agricole
Indice des prix des moyens de production agricole Indice national des prix à la consommation, sous-groupe denrées alimentaires et boissons Indice des prix à la production production agricole
L’indice des prix à la production des produits agricoles a reculé de 23% de 1990/92 (base = 100) à 1999 La baisse des prix à la production est l’une des conséquences de la réforme agricole et de la séparation de la politique des prix de celle des revenus. A noter que, dans le secteur de la viande, les prix ont diminué avant la réforme agricole En 1999, la vente des produits a rapporté à l’agriculture 2,6 milliards de moins qu ’ en 1990/92. Dans le même temps, une hausse des paiements directs de 1,5 milliard, montant destiné à rétribuer les prestations d’intérêt général et de nature écologique fournies par l’agriculture, a permis de compenser une partie du recul des recettes

L’indice des prix à la consommation des denrées alimentaires et des boissons a évolué différemment. Durant la période d’observation, il a progressé de 4%.
L’indice des prix des moyens de production agricole sert à mesurer l’évolution des prix de la consommation intermédiaire, des investissements dans les bâtiments et les équipements, des intérêts payés sur le capital étranger et des salaires de la maind’oeuvre non familiale En 1993, il a progressé de 4% par rapport à 1990/92 Ensuite, il a reculé constamment jusqu’en 1999, diminuant de 6% au total L’indice ne donne pas d’indications sur les économies liées à l’évolution structurelle, c ’est-à-dire à la diminution du nombre d’exploitations et de la main-d’œuvre
21 1 . 1 E C O N O M I E 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E
1990–921993199419951996199719981999
Sources:
USP 75 80 85 90 95 100 105 110 I n d i c e ( 1 9 9 0 / 9 2 = 1 0 0 ) 1
OFS,
1.1.2 Marchés
On se souviendra de 1999 comme d’une année aux conditions météorologiques extrêmes L’hiver des avalanches, qui ont causé de considérables dégâts aux bâtiments, forêts et terres cultivées, a été suivi d’un printemps humide et froid accompagné de crues et d’inondations, d’un été chaud et humide, d’un automne pluvieux et d’une fin d’année assombrie par l’ouragan «Lothar» et de graves dommages aux forêts et aux arbres fruitiers Ces conditions difficiles ont fait baisser les rendements en production végétale, surtout ceux de pommes de terre, de céréales et de denrées fourragères
Au plan international, les marchés agricoles ont repris après les effondrements occasionnés par la crise de 1998 en Asie La situation économique mondiale s ’est progressivement améliorée et on a enregistré un accroissement de la demande de denrées alimentaires.
L’année 1999 a également été marquée par la détection de résidus de dioxine et d’hormones dans des produits animaux, par une augmentation des cas d’ESB et par un âpre débat sur la présence d’OGM dans les aliments pour animaux et dans les semences et plants. La sécurité et la désignation des denrées alimentaires est un sujet-clé et le restera à l’avenir
Composition de la production finale en 1999
Total 7 270 mio. de fr.1
Autres produits végétaux 2%
Fruits, légumes 10%
Moûts de vin 7%
Pommes de terre, betteraves sucrières 4%
Céréales 7%
Lait 36%
Bovins 14%
Porcs 13%
Volaille, oeufs 5%
Autres produits animaux 2%
Source: USP 1 Estimation, état 23.12.1999
La production finale est un indicateur permettant d’évaluer l’importance et l’évolution des marchés des différents produits Elle a régressé par rapport à l’année précédente: en ce qui concerne les végétaux et les produits végétaux, elle a diminué de 11% (273 mio de fr ), et de 6% (322 mio de fr ) pour ce qui est des animaux et produits animaux La situation devrait toutefois s ’améliorer en 2000
1 . 1 E C O N O M I E 1 22 ■■■■■■■■■■■■■■■■
Tableau 12, page A12
■ Pas de turbulences sur le marché
Lait et produits laitiers
La nouvelle organisation du marché laitier est entrée en vigueur le 1er mai 1999. Jusqu’ici, la réforme s ’est bien déroulée et n ’ a pas provoqué de turbulences sur le marché Le prix-cible de 77 ct /kg de lait, fixé par le Conseil fédéral, a été dépassé en moyenne
La stabilité du rapport entre le franc suisse et la nouvelle monnaie européenne, de même qu ’ un dollar américain fort, ont facilité les exportations de fromage Le contexte a été favorable pour la vente de produits laitiers, surtout de fromage, notamment grâce à la relance conjoncturelle en Europe et à l’augmentation correspondante de la consommation
■ Production: stabilité des livraisons de lait
En 1999, le produit de la vente de lait a représenté une part de 36% de la production finale, proportion qui n ’ a guère changé ces dernières années

La production laitière totale a légèrement diminué, de 18'000 t, entre 1990/92 et 1999, passant à quelque 3,86 millions de t Cette quantité comprend le lait de vache (99,7%), de chèvre, de brebis et de jument (0,3%) Une performance laitière par vache en augmentation et une quantité de lait totale stable signifient réduction des effectifs De 1990/92 à 1999, la performance laitière s ’est accrue de 48 kg par an en moyenne, pour atteindre actuellement 5'390 kg par vache
En 1999, les producteurs ont livré 3,07 millions de t de lait destiné à la commercialisation Cette quantité a été produite par 715'000 vaches Les effectifs de vaches ont reculé de 1,7% (12'100 sujets) par rapport à l’année précédente et de 8% par rapport à la moyenne des années 1990/92 (62'000 sujets)
1 . 1 E C O N O M I E 23
Tableaux 1–11, pages A2–A11
des effectifs de vaches et de la performance laitière 1990/92199719981999 N o m b r e d e v a c h e s k g d e l a i t p a r v a c h e Effectif de vaches Performance laitière/vache Source: USP 680 000 5400 5300 5200 5100 5000 4900 4800 780 000 760 000 740 000 720 000 700 000 800 000 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E 1
Evolution
Livraison de lait selon les mois en 1998 et 1999

■ Mise en valeur: production de fromages frais en forte hausse
Jusqu’au mois d’avril de l’année considérée, les livraisons de lait étaient supérieures à celles de 1998 A partir de mai, elles ont été nettement inférieures, surtout en raison de la période de mauvais temps qui a détérioré la base fourragère
Sur les 3,86 millions de t produites globalement, environ 20% ont servi à l'auto-approvisionnement ou à l’affouragement dans l’exploitation. Quelque 3 millions de t ont par conséquent été commercialisées, dont 15% sous la forme de lait de consommation La majeure partie du solde a été destinée à la transformation
En 1999, la moitié du lait commercialisé (1,5 mio de t) a servi à la fabrication de fromage. La production de crème (797'000 t) et celle de beurre (771'000 t) en ont absorbé chacune un quart
1 . 1 E C O N O M I E 1 24
J a n v i e r F é v r i e r M a r s A v r i l M a i J u i n J u i l l e t A o û t S e p t e m b r e O c t o b r e N o v e m b r e D é c e m b r e e n t Livraisons de lait 1999 Livraisons de lait 1998 Source: USP 200 000 220 000 240 000 260 000 280 000 300 000 320 000
Pendant l’année sous revue, la fabrication de fromage a reculé de 1,8% par rapport à l’année précédente Le recul résulte des restrictions de la fabrication imposées par l’organisation de sorte «Emmentaler Switzerland», d’une réduction des stocks pendant la mise en oeuvre de la réforme et du nouveau mode de calcul des quantités produites à l’aide de facteurs de rendement Les fromages à pâte dure représentent encore la majeure partie de cette production La légère tendance à la baisse des années précédentes s ’est poursuivie en 1999, mais elle a été compensée par une augmentation continue du volume de production d’autres types de fromage depuis 1997 Ainsi, la production de fromages frais s ’est accrue de 15,4% par rapport à l’année précédente, passant à 13'093 t Le changement d’habitudes des consommateurs au cours des dernières années favorise les ventes de fromages frais tels que la mozzarella
Après une augmentation de 2,7% de 1997 à 1998, la production de beurre a fortement baissé en 1999; un recul de 8,7% l’a ramenée à 37'238 t Début 1999, l’approvisionnement abondant en denrées fourragères et la baisse escomptée du prix du lait, liée au changement de système, ont fait augmenter les livraisons de lait à tel point que la production de beurre a atteint des quantités records de janvier à avril Au mois de mai, la tendance s ’est inversée, notamment à cause des conditions météorologiques En automne, il a donc fallu importer cinq fois plus de beurre que prévu (près de 5'000 t) Cette baisse de la production résulte d’une diminution de la quantité de lait commercialisée et de la teneur en matière grasse, ainsi que de l’augmentation de la quantité de produits laitiers frais
Quant à la production de poudre de lait, elle a augmenté de 3,1% de 1998 à 1999 Cette augmentation s ’explique par les restrictions de droit privé à la fabrication de fromage; en outre, la tendance a été renforcée par l’industrie du chocolat, qui a utilisé davantage de lait entier en poudre du pays

1 . 1 E C O N O M I E 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E 25
1990/92199719981999 e n 1 0 0 0 t l a i t Autres produits laitiers Crème Beurre Sources: TSM, USP Fromage Lait de consommation 0 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 1
Evolution de la mise en valeur du lait commercialisé
Dans le secteur laitier, le bilan du commerce extérieur est positif. A l’exception du lait frais et du beurre, la Suisse a exporté plus de produits laitiers qu ’elle n ’ en a importés
En vertu de la réglementation spéciale dont bénéficie la zone franche de Genève, la Suisse a importé 22'795 t de lait frais en 1999, alors qu ’elle n ’ en exporte presque pas En revanche, les exportations de yoghourts accusent depuis des années une tendance à la hausse; elles ont augmenté de 25% de 1998 à 1999 passant à 1'156 t En comparaison, les importations de 110 t effectuées en 1999 sont relativement modestes Alors que les importations de beurre ont augmenté de 20,5% pour passer à 4'987 t en 1999, celles de poudre de lait ont diminué de près de 40% en faveur de la production suisse Les exportations de poudre de lait (17'768 t) ont également été considérables
En 1999, les exportations suisses de fromage ont représenté le double des importations Ce rapport n ’ a guère changé en comparaison de 1990/92 Les exportations se sont élevées à 63'359 t au total. Dans l’année considérée, les importations se sont réparties entre 38% de fromages à pâte mi-dure et à pâte dure (11'808 t) et 45% de fromages frais et à pâte molle (14'102 t)
1 . 1 E C O N O M I E 1 26
Evolution des exportations et importations de fromage 1990/92199719981999 e n t Exportations Importations Bilan commercial Sources: DGD, OFAG 0 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 Exportations et importations de fromage en 1999 Importations Exportations e n % Source: DGD 0 120 100 80 60 40 20 UE UE Italie Italie Allemagne France
■ Commerce extérieur: le fromage, produit d’exportation important
En ce qui concerne le commerce extérieur de produits laitiers, les pays membres de l’UE sont les principaux partenaires de la Suisse A cet égard, rien n ’ a changé ces dernières années Les importations effectuées par la Suisse proviennent pratiquement toutes de l’UE, alors que les exportations sont destinées à raison de 80% au marché communautaire Pendant l’année sous revue, 29,5% des exportations étaient destinées à l’Italie et 8,3% à l’Allemagne Les principaux pays de provenance des fromages importés ont été l’Italie (49,2%) et la France (36,6%)
Depuis des années, la consommation globale de lait et de produits laitiers est en légère baisse Cette évolution diffère toutefois selon les produits si l’on se fonde sur la consommation par habitant.
Alors que la population suisse avait encore consommé 104,4 kg de lait de consommation en 1990/92, ce chiffre a passé à 86,6 kg dans l’année sous revue Pendant cette même période, on a enregistré un accroissement de la consommation de fromage (+6,6%) et de crème de consommation (+4,2%). En 1998, le degré d’auto-approvisionnement (production du pays en pour-cent de la consommation) de lait et de produits laitiers s ’est monté à 110% Il se situe à ce niveau depuis des années

1 . 1 E C O N O M I E 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E 27
baisse Consommation par habitant de lait et de produits laitiers en kg de lait en 1999 Lait de consommation 86,6 Fromages à pâte dure 41,7 Crème de consommation 33,9 Fromages à pâte mi-dure 42,6 Fromages à pâte molle 10,5 Beurre 68,2 Fromages frais 11,9
■ Consommation globale en
1
Source: USP
■ Prix à la production: prix-cible dépassé
Le prix du lait était fixé et garanti par le Conseil fédéral jusqu’au 30 avril 1999; il s’élevait alors à 87 ct /kg Depuis le 1er mai 1999, le prix à la production dépend des forces du marché, de la protection à la frontière et des fonds destinés au soutien du marché Le prix garanti a été remplacé par le prix-cible, fixé par le Conseil fédéral à 77 ct./kg de lait contenant au total 73 g de matière grasse et de protéine Dans le contexte actuel, ce prix a été dépassé pour le lait qui est transformé en produits à forte valeur ajoutée et commercialisé dans de bonnes conditions Le prix-cible ne comprend pas le supplément de non-ensilage

L’OFAG relève mensuellement les prix à la production et publie les résultats dans le «bulletin du lait» Pour ce faire, il se fonde sur quatre références: quantité de lait totale, lait industriel, lait transformé en fromage et lait biologique. Ces données sont saisies pour toute la Suisse, mais aussi ventilées selon cinq régions: Suisse romande (région I), Berne/Suisse centrale (région II), Suisse du Nord-Ouest (région III), Zurich/Suisse orientale (région IV), Sud de la Suisse (région V).
Conformément à l’ordonnance sur la réorganisation du marché laitier, les prix payés aux producteurs doivent être relevés auprès des utilisateurs de lait Tous les transformateurs industriels de lait ainsi qu ’ un choix représentatif de fromageries participent au relevé Celui-ci porte ainsi sur plus de 60% de la quantité produite D’après l’ordonnance précitée, on entend, par prix du lait payé, le prix payé au lieu du relevé (au centre collecteur ou à la ferme), compte tenu des suppléments et déductions usuels dans la localité Par contre, ni le supplément de non-ensilage, ni les cotisations volontaires aux fédérations et les déductions pour le petit-lait ne sont compris
Prix du lait en 1999 (mai à décembre), pour toute la Suisse et selon les régions
1 . 1 E C O N O M I E 1 28
CH Région I Région II Région III Région IV Région V ct./kg Quantité totale 79,89 79,73 80,59 79,98 79,27 79,52 Lait industriel 78,94 79,11 78,99 79,10 78,60 79,75 Lait transformé en fromage 79,96 80,45 80,50 80,14 78,66 78,34 Lait biologique 91,55 90,13 94,05 91,33 90,11 pas relevé Source: OFAG
Les
Source: OFAG I II III IV V
cinq régions du relevé des prix
■ Prix à la consommation: lait de consommation et crème meilleur marché
Dans l’année sous revue, le prix-cible a été d’epassé en moyenne. S’agissant de l’ensemble de la Suisse, les différences de prix sont relativement faibles En revanche, le prix d’un kilo de lait biologique a été jusqu’à 12 ct supérieur à celui du lait industriel ou du lait transformé en fromage. Les écarts de prix entre les régions sont également plus marqués pour le lait biologique
A partir du 1er mai 1999, le consommateur a payé, en moyenne, 1 55 franc pour le litre de lait de consommation (lait entier pasteurisé) et environ 6 ct de plus pour le lait UHT Contrairement au prix du lait de consommation qui, depuis le 1er mai 1999, est resté inchangé dans toutes les régions, les prix à la consommation des différents fromages ont varié d’une région à l’autre.
Evolution des indices des prix à la consommation du lait et des produits laitiers
■ Marge du marché: tendance à la baisse
Les indices des prix à la consommation du lait et des produits laitiers ont évolué différemment depuis 1997. Alors que celui du lait de consommation a diminué de 3,5 points et celui de la crème de 4,2 points, ceux du beurre et du fromage n ’ont guère bougé
Le concept de marge du marché consiste en principe à observer l’évolution de deux niveaux de prix: le prix à la production et le prix à la consommation, ainsi que la différence entre les deux Il implique un calcul théorique de la valeur ajoutée dans les segments lait de consommation, fromage, beurre, crème de consommation et yoghourt On calcule la différence entre le prix à la production réalisé par kg de lait et le prix de vente du produit final transformé
1 . 1 E C O N O M I E 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E 29
1990/92199719981999 I n d i c e ( m a i 1 9 9 3 = 1 0 0 ) Lait Fromage Beurre Source: OFS Crème Autres produits laitiers 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 105,0 1
Marge générale sur le lait et les produits laitiers en 1999
De janvier à avril 1999, la marge générale sur le lait et les produits laitiers s ’est établie à 86 ct par kg de lait Après une légère augmentation pendant les mois d’été, elle a reculé et atteint en décembre son point le plus bas, soit 84,8 ct
■ Estimations 2000 Cette année aussi, la situation du marché laitier est bonne La relance économique contribue à la progression des ventes de produits laitiers en Suisse et à l’étranger, notamment de fromage, un secteur très important. L’influence des forces du marché améliore peu à peu la performance des entreprises et accroît leur compétitivité
La majeure partie du lait commercialisé trouvera ainsi en 2000 des débouchés intéressants côté recettes La production de fromage continuera probablement d’augmenter Compte tenu des chiffres du premier semestre 2000, la production de fromage frais et à pâte molle devrait dépasser largement les résultats de 1999 Les pronostics relatifs à la crème de consommation et aux autres produits frais sont réjouissants Quant au beurre, on peut parler d’une situation stable.
La situation sur le marché devrait garantir des prix stables aux producteurs On s ’attend à ce que pour 2000, le prix-cible de 77 ct par kg de lait soit dépassé (moyenne annuelle) Selon l’estimation 2000 des comptes économiques de l’agriculture (cf ch 1 1 3), la production finale devrait néanmoins être inférieure de 60 millions de francs à celle de 1999 Raison: le prix à la production réduit qui a cours depuis l’introduction, le 1er mai 1999, de la nouvelle réglementation du marché laitier concerne toute l’année 2000.
1 . 1 E C O N O M I E 1 30
J a n v i e r F é v r i e r M a r s A v r i l M a i J u i n J u i l l e t A o û t S e p t e m b r e O c t o b r e N o v e m b r e D é c e m b r e f r . p a r k g d e l a i t Source: OFAG 0,83 0,84 0,85 0,86 0,87 0,88 0,89
Tableau 12, page A12
Animaux et produits animaux
Durant l’année sous revue, la production de viande et d’œufs a subi le contrecoup des informations diffusées sur la découverte de résidus de dioxine et d’hormones dans des produits animaux En mai et en juin, on a découvert des résidus de dioxine dans la viande de volaille, les œufs et les produits à base d’œufs belges Les services fédéraux compétents ont immédiatement édicté une interdiction d’importer Ce n ’est qu’à partir de septembre que l’importation de produits de volaille belges a de nouveau été autorisée, lorsque les nombreux échantillons analysés étaient exempts de résidus Ainsi, la consommation de volaille a diminué de 3% par habitant en 1999, suite à l’insécurisation des consommateurs.
Lors de contrôles effectués à la frontière sur de la viande de bœuf en provenance des Etats-Unis, 7 des 26 échantillons analysés (première série de tests) contenaient des résidus d’hormones En Suisse, il existe une tolérance zéro pour la teneur en hormones artificielles et en stéroïdes dans la viande suisse destinée à être vendue Cependant, la santé des consommateurs n ’ a pas été mise en danger Par ailleurs, ces substances se trouvaient en si faible concentration qu ’elles ne pouvaient développer des effets hormonaux. Par la suite, l’Office vétérinaire fédéral (OVF) a radié l‘entreprise américaine concernée de la liste des fournisseurs agréés et a demandé aux autorités américaines de prendre des mesures de contrôle efficaces En raison des problèmes précités, l’importation de bœuf américain frais et congelé a baissé, passant de 1’129 t en 1998 à 750 t en 1999
Par la mise en vigueur, le 1er janvier 2000, de l’ordonnance agricole sur la déclaration, le Conseil fédéral a rendu plus stricte la déclaration obligatoire de viande et d’œufs de consommation issus de modes de production interdits en Suisse. La viande d’animaux nourris à l’aide d'hormones, d’antibiotiques ou d’autres substances antimicrobiennes visant à stimuler les performances doit être déclarée de manière adéquate Il en va de même pour les œufs de consommation provenant d’élevages en batterie.
En 1999, 25 nouveaux cas d’ESB sont apparus et 25 autres ont été enregistrés dans le cadre du programme de surveillance annuel Conformément à celui-ci, quelque 17’900 vaches abattues ont été soumises à un test ESB depuis le 1er mars 1999
Le 1er mai 1999, le DFE a fait usage, pour la première fois, de la clause de sauvegarde spéciale de l’OMC concernant les prix de la viande de porc Jusqu’à la fin de l’année, ce sont 1'002 t d’une valeur marchande de 4 millions de francs environ qui ont été grevées d’un droit de douane supplémentaire qui s ’est élevé à 0,38 million de francs en total

1 . 1 E C O N O M I E 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E 31
1
Tableaux 1–11, pages A2–A11
■ Production: effectifs en baisse
Le cheptel bovin a diminué de 2% par rapport à 1998. La tendance à long terme s ’est ainsi poursuivie, en raison principalement des progrès zootechniques dans la production laitière Comparé à 1990, le nombre de porcs, de poules pondeuses et de poules d’élevage a aussi nettement baissé. En revanche, celui de la volaille à l’engrais et des moutons n ’ a cessé de croître depuis 1990
Par rapport à l’année précédente, la production de viande de bœuf a diminué de 0,3%, celle de veau de 0,8% et celle de porc de 2,6%. Les agriculteurs ont en revanche augmenté de 3,9% la production de viande de mouton et de 3% celle de volaille L’augmentation de cette dernière a couvert la demande accrue de produits du pays résultant du scandale de la dioxine en Belgique

Evolution de la production des différentes catégories d'animaux 1
La production d’œufs a diminué de 1,6% par rapport à 1998, passant à 680 millions de pièces
32 1 . 1 E C O N O M I E 1
Evolution des effectifs Catégorie d'animaux 1990 1997 1998 1999 1990–1997/99 en 1 000 en 1 000 en 1 000 en 1 000 % Bovins 1 858 1 673 1 641 1 609 -11,68 Porcs 1 776 1 395 1 487 1 453 -18,64 Moutons 355 420 422 424 18,87 Chèvres 61 58 60 62 -1,64 Chevaux 38 46 46 49 23,68 Volaille à l'engrais 2 878 3 342 3 502 3 747 22,67 Poules pondeuses et d'élevage 2 795 2 278 2 270 2 223 -19,25 Source: OFS
Viande de boeuf Viande de veau Viande de porc Viande de mouton Volaille e n t
1 Poids mort; volaille en poids de vente 1990/92 1997 1998 1999 0 300 000 200 000 100 000 1 1 4 8 0 1 1 1 0 7 8 8 1 1 0 4 3 5 1 3 0 7 1 0 2 6 2 4 0 2 5 6 0 8 2 6 3 6 7 2 0 7 3 3 6 2 1 5 6 0 7 8 6 3 1 6 5 0 6 5 2 1 4 2 5 7 2 3 1 5 7 4 2 2 5 6 5 7 2 6 6 3 6 0 3 7 4 0 9 3 6 7 1 5 3 6 4 1 9 3 6 6 5 6
Source: Proviande
■ Commerce extérieur: bétail d’élevage et de rente exporté au Kosovo
Durant l’année sous revue, 1'345 t de viande de veau ont été importées, ce qui fait plus du double, comparé à 1998 Par contre, les importations de volaille ont reculé de 5% Concernant les quelque 10'000 t de viande de bœuf importées, il s ’agissait avant tout de morceaux spéciaux (aloyaux, «High-Quality-Beef» et morceaux parés de la cuisse de bœuf destinés à la fabrication de viande séchée) Ont aussi été importés 324 ânes, mulets et bardots et plus de 2'800 chevaux et petits poneys; résultat: les chiffres de 1998 ont été dépassés
Pour toutes les catégories de viande ainsi que pour les œufs, les exportations ne représentent qu ’ un faible pourcentage de la production du pays Le plus gros volume d’exportation concerne la viande séchée fabriquée à partir d’animaux de l’espèce bovine (viande des Grisons), destinée essentiellement à nos voisins, l’Allemagne et la France
Dans le cadre de l’aide humanitaire, quelque 500 génisses et vaches portantes ont été livrées au Kosovo En vertu des accords OMC, il aurait été possible de subventionner, par le biais d’une aide fédérale maximale de 17,7 millions de francs, l’exportation de 11'800 sujets Mais au vu des restrictions que de nombreux pays imposent toujours à nos exportations, suite à l’apparition de l’ESB dans le cheptel bovin suisse, nous n ’ avons pu réaliser que 4% des exportations que nous aurions pu effectuer.
■ Consommation globale en légère baisse
La part de la production suisse de viande de boeuf, de veau et de porc dans la consommation totale a représenté en 1999 plus de 90%. Pour ce qui est de la viande de cheval suisse, cette part, qui s ’est élevée à 14%, est la plus modeste Stimulée par une forte demande, celle de volaille du pays a atteint 42%, soit son niveau le plus élevé depuis 1988
Consommation par habitant de viande et de poissons en kg en 1999
Total 60,63 kg
Gibier 0,55
Lapins et lièvres 0,49
Volaille 8,71
Viande de cheval 0,62
Viande de chèvre 0,11
Viande de veau 4,08
Poissons et crustacés 7,48
Viande de boeuf 11,53
Viande de porc 25,63
Viande de mouton 1,43
Source: Proviande
La consommation de viande et de poisson a baissé de 1,1% par rapport à l’année précédente pour s’établir à 60,63 kg par habitant Le porc, qui représente 42% de l’ensemble, est la catégorie la plus importante en termes de volume Après avoir atteint en 1996 son niveau le plus bas depuis 1988, la consommation de bœuf a de nouveau augmenté: de 1,3% en 1997, de 2,4% en 1998 et de 2,5% en 1999 Toutefois, la consommation par habitant n ’ a pas atteint le niveau d’avant la crise de l’ESB. Pour ce qui est de la viande de veau, la consommation a augmenté de 1% depuis 1998, alors que celle de volaille a diminué de 3% en raison du scandale de la dioxine
1 . 1 E C O N O M I E 33 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E
1
■ Prix à la production de la viande de bœuf
La situation tendue qui a régné sur le marché du bœuf – prix bas et stocks importants
a pris fin en 1999 En raison de la consommation croissante et d’une offre moins importante, les prix des vaches, génisses, bœufs et taureaux ont augmenté à partir de l’été pour atteindre le niveau de 1995; ils s ’ y sont maintenus malgré une offre croissante (saisonnière) à la fin de l’automne Les producteurs ont obtenu en décembre environ 5 50 francs par kg/PM pour des vaches de bonne qualité (classe commerciale T2/3) La forte demande de viande de fabrication a permis à la fin de l’année d’écouler les stocks de bœuf Les prix du veau d’étal, quant à eux, se sont trouvés à un niveau très bas de février à juillet, puisqu’ils ne dépassaient guère 9 francs par kg/PM Entre janvier et avril, les producteurs de porcs ont obtenus moins de 4 francs par kg/PM Grâce à la baisse de la production et à une demande réjouissante en été, les prix se sont vite rétablis pour se stabiliser à environ 4.50 francs par kg/PM durant les derniers mois de l’année
Bétail de boucherie et porcs à viande: prix mensuels à la ferme en 1999

■ Prix à la consommation de viande de bœuf en
Vaches classe commerciale T2/3 Taureaux classe commerciale T3
Veaux classe commerciale T3 Porcs à viande, légers
Source: USP
Après la suppression, par le Conseil fédéral, des prix indicatifs des moutons et des agneaux, le 1er janvier 1999, les prix à la production ont subi de fortes pressions Les producteurs se sont vu offrir, en moyenne, 11 46 francs par kg/PM pour des agneaux pesant jusqu’à 40 kg de poids vif (47% de rendement en boucherie), soit 15% de moins que l’année précédente
Les prix des œufs vendus dans les centres collecteurs ont diminué de 9% par rapport à 1998 pour s’établir en moyenne à 22 21 ct l’œuf Grâce aux mesures ciblées d’allégement du marché prises après les fêtes de Pâques, la baisse des prix, résultant des fluctuations saisonnières, a pu être atténuée durant les mois d’été En raison de la pression exercée sur les prix, la production s ’est davantage concentrée sur des exploitations ayant des effectifs de pondeuses importants.
Le relèvement des prix à la production du gros bétail de boucherie a entraîné une augmentation des prix à la consommation du bœuf Quant aux prix du porc, ils ont également augmenté au deuxième semestre. Pour certains morceaux, ils sont toutefois restés légèrement inférieurs à ce qu’ils étaient une année auparavant
1 . 1 E C O N O M I E 1 34
–
en hausse
hausse
f r . / k g P M
0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 J a n v i e r F é v r i e r M a r s A v r i l M a i J u i n J u i l l e t A o û t S e p t e m b r e O c t o b r e N o v e m b r e D é c e m b r e
■ Estimations 2000
Depuis janvier 1999, la marge sur la viande fraîche (porc, bœuf, veau et agneau) ainsi que celle sur les produits carnés et les produits de charcuterie sont calculées selon une nouvelle méthode. Ce faisant, nous nous fondons, d’une part, sur le prix de revient de la catégorie animale en question (fr par kg/PM), de l’autre sur la moyenne nationale des prix en magasin, compte tenu de la proportion que représentent les prix des produits label. Ainsi, on est parti en janvier d’une marge de 100. Selon le produit, la marge a évolué différemment De toutes les marges sur la viande fraîche, celle sur le veau a été la plus faible Elle a souvent été 10% au-dessous de la marge de janvier Celle réalisée sur le porc a augmenté jusqu’à 9% par rapport à janvier Vers la fin de l’année, la marge sur la viande fraîche a dépassé la valeur de janvier de quelque 4 points d’indice.

Viande de bœuf et de veau: l’offre indigène diminuera probablement de 10% par rapport à l’année dernière Les prix des taureaux et des génisses (de qualité moyenne) payés aux producteurs devraient augmenter de quelque 20%, pour s’établir à 9 francs par kg/PM En ce qui concerne les veaux, le prix devrait atteindre 13 francs par kg/PM (moyenne annuelle), soit 20% de plus que l’année précédente Durant le premier semestre, la réduction de l’offre de bœuf et de veau a en grande partie été compensée par des importations Le nombre d’abattages de vaches et de génisses, en net recul comparé à 1999, laisse supposer que les effectifs de vaches sont en train d’augmenter
Viande de porc: l’offre indigène est stable Les producteurs devraient obtenir un prix moyen d’environ 4 60 francs par kg/PM
Oeufs: la production augmentera probablement de quelques pour-cent Au mieux, les prix à la production atteindront ceux de l’année passée
L’estimation 2000 des comptes économiques de l’agriculture (cf ch 1 1 3) prévoit, pour la production finale dans les secteurs viande et œufs, un plus de quelque 240 millions de francs, ou 10% par rapport aux douze mois précédents, l’essentiel –presque 200 millions – étant dû, malgré un volume de production bien inférieur, aux prix relativement élevés du bœuf et du veau.
1 . 1 E C O N O M I E 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E 35
■ Marge du marché variable sur la viande fraîche Evolution des marges en 1999 I n d i c e ( j a n v i e r 9 9 = 1 0 0 ) Porc Boeuf Veau Viande fraîche (boeuf, veau, porc et mouton) Source: OFAG 84,0 88,0 92,0 96,0 100,0 104,0 108,0 112,0 J a n v i e r F é v r i e r M a r s A v r i l M a i J u i n J u i l l e t A o û t S e p t e m b r e O c t o b r e N o v e m b r e D é c e m b r e 1
12,
A12
Tableau
page
■ Conditions météorologiques difficiles
Production végétale et produits végétaux
Le temps trop humide a entravé les semis d’automne et de printemps. Les précipitations fréquentes, associées à un temps chaud durant la période de végétation, ont accru le risque de maladie A l’exception de la viticulture, on a constaté un peu partout une baisse des rendements et des pertes de qualité

Par ailleurs, les importantes chutes de pluie printanières et les orages violents accompagnés de grêle en Suisse romande et en Suisse du Nord-Ouest ont causé d’énormes dégâts aux cultures agricoles Au total, l’assurance pour les dégâts dus à la grêle a versé 82 millions de francs d’indemnisations pour les dommages causés par la grêle et 15 millions pour ceux induits par les éléments naturels En outre, les gels en Valais sont à l’origine d’un recul de près de 50% de la récolte d’abricots par rapport à la moyenne des dix dernières années.
■ Production: mauvais rendements des cultures des champs, bonne récolte de raisins
Les terres ouvertes représentent 27% de la SAU, soit 293'949 ha, en baisse de 5'412 ha par rapport à 1998 Ce recul touche en particulier la culture céréalière (-4'611 ha) et la culture de pommes de terre (-143 ha). La surface affectée à ces deux cultures a régressé de 13% par rapport à 1990/92 Les cultures pérennes constituent 2,3% de la SAU, à savoir 24'260 ha dont 7'172 ha de cultures fruitières, 240 ha de baies et 15'042 ha de vignes.
1 . 1 E C O N O M I E 1 36
Tableaux 1–11 pages A2–A11
Composition des terres ouvertes en 1999
Total 293 949 ha
Maïs vert et d'ensilage 14%, 40 475 ha
Légumes de plein champ 3%, 8 189 ha
Colza 5%, 14 865 ha
Betteraves sucrières 6%, 17 450 ha

Autres cultures 5%, 16 974 ha
Céréales 62%, 182 256 ha
Pommes de terre 5%, 13 740 ha
Source: USP
Avec une récolte d’environ 519'300 t de céréales panifiables et 538'500 t de céréales fourragères, la production 1999 a été, en raison des conditions météorologiques, 15% inférieure à celle de l’année précédente; c ’est aussi la moins bonne des douze dernières années De même, la qualité, notamment la teneur en protéine, a été nettement inférieure à celle de 1998.
Evolution des récoltes de différents produits des champs
1990/92199719981999
Produits: rendements 1999 Blé d'automne (54,2 dt/ha) Orge (53 dt/ha)
Pommes de terre (353 dt/ha)
Betteraves sucrières (680 dt/ha) Colza (25,8 dt/ha)
Source: USP
En dépit d’une surface plus restreinte, la récolte d’oléagineux, totalisant 50'928 t, a reculé de 13% par rapport à 1998. A l’instar des années précédentes, la production de pommes de terre a poursuivi sa baisse, atteignant même son niveau le plus bas avec 484'000 t (-16 %) A l’inverse, les 1'187'334 t de betteraves sucrières battent tous les records grâce à une surface de culture étendue. Par contre, le rendement (680 dt/ha) et la teneur en sucre (16,8%) n ’ont pas pleinement égalé les valeurs de 1998
1 . 1 E C O N O M I E 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E 37
I n d i c e ( 1 9 9 0 / 9 2 = 1 0 0 )
70 80 90 100 110 120 130 140 1
Production suisse de fruits et de légumes en 1999
Sources: OFAG, Fruit-Union Suisse, Centrale suisse de la culture maraîchère
En moyenne des trois dernières années, le volume total consommé dans le pays des variétés de légumes et de fruits cultivables en Suisse s’élève respectivement à 492'240 et 168'344 t Les légumes suisses ont représenté 59% de ce volume, les fruits 72% Au cours des dix dernières années, la production de légumes a pu préserver ses parts de marché, la progression des fruits étant même d’environ 3%
Les fréquentes précipitations estivales ont permis d’accroître les rendements viticoles Totalisant 131 millions de litres de moûts de raisin (59 mio de rouge, 72 mio de blanc), la production a dépassé de 14 millions de litres celle de 1998.
En 1999 et 2000, les céréales panifiables bénéficient encore de la garantie limitée de prix et de prise en charge de la Confédération En 1999, l’Etat a pris en charge un total de 549'300 t Il en a vendu 388'700 aux moulins à des fins d’alimentation humaine, 166'300 t ayant été déclassées et mises en valeur dans le secteur des aliments pour animaux, avec 5'100 t de céréales germées Quant aux 121'400 t de blé dur importé, elles ont servi à la fabrication de pâtes. La transformation des céréales destinées à l’alimentation de l’homme, a donné 187'200 t de produits secondaires de la meunerie, qui ont été écoulés dans le secteur de l’alimentation des animaux
1 . 1 E C O N O M I E 1 38
Produit Production 1998–1999 1990/92–1999 t%% Pommes de table 90 161 -10,7 -3,6 Abricots, cerises, pruneaux (de table) 6 239 -30,3 -43,7 Légumes (frais, sans légumes de transformation) 269 372 -6,8 +9,7
■ Mise en valeur: conditions équilibrées Evolution de la mise en valeur de la récolte de pommes de terre 1990/92199719981999 e n 1 0 0 0 t Transformation en aliments pour animaux Affouragement à l'état frais Semences et plants Perfectionnement Consommation à l'état frais Sources: OFAG, swisspatat, Association suisse des négociants de pommes de terre 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
Sur les 292'600 t de pommes de terre qui ont servi à l’alimentation humaine en 1999, 121'900 t ont été transformées en pommes frites, pommes chips et autres produits à base de pommes de terre Pour des raisons de qualité, et malgré une récolte mineure, il a fallu écouler 154'100 t de pommes de terre dans le secteur des aliments pour animaux Depuis 1990/92, ce type de mise en valeur a reculé de 34%

Pour la dernière fois en 1999, la Confédération a fixé le prix et la surface des oléagineux destinés à l’alimentation humaine La récolte a permis aux huileries de produire 15'600 t d’huile comestible, 1'400 t d’huile de colza ayant servi de matière première renouvelable sous forme de combustibles et de lubrifiants
Les pommes de table suisses proviennent presque exclusivement des cultures fruitières. Depuis des années, la quantité vouée à une consommation fraîche varie entre 90'000 et 100'000 t, le reste allant aux cidreries La mise en valeur technique joue donc un rôle essentiel de tampon pour le marché des pommes de table Les pommes récoltées dans les vergers traditionnels qui, de par nature, sont soumises à de fortes variations de rendement (alternance), sont exclusivement transformées en moût (jus brut)
1 . 1 E C O N O M I E 39
Evolution de la mise en valeur de la récolte de pommes 1990/92199719981999 e n 1 0 0 0 t Vergers traditionnels (pommes) Cultures fruitières (pommes) Source: OFAG Pommes à cidre Pommes de table 0 50 100 150 200 250 300 350 1
Evolution de la transformation de légumes suisses en conserves et produits surgelés

Légumes en conserve (haricots, petits pois, carottes parisiennes)
Les légumes ont continué à perdre du terrain au cours des années nonante Par rapport à 1990/92, la quantité de légumes destinée à la production de surgelés est, quant à elle, restée stable Une forte croissance a été enregistrée dans le secteur des légumes frais transformés en légumes prêts à la cuisson, sans agent conservateur, et en aliments prêts à l’emploi (plats semi-préparés et préparés).
Les importations de produits végétaux ont une fois de plus atteint un volume considérable durant l’année sous revue Suite à la baisse de rendement, des quantités supplémentaires de pommes de terre, légumes et fruits à noyau ont été importées afin d’assurer l’approvisionnement du marché En comparaison, les exportations régulières de produits végétaux sont insignifiantes
Au total, les importations de céréales couvrent quelque 23% des besoins La demande de blé dur, notamment, est entièrement satisfaite par des importations A signaler également que, en 1999, 107'000 t de céréales panifiables et 76'200 t de céréales fourragères ont été importées à titre de complément de l’offre suisse 27'542 t de farine de céréales panifiables et de produits de mouture ont été exportées sous forme de matière première transformée en denrées alimentaires
1 . 1 E C O N O M I E 1 40
1990/92199719981999 e n t
Légumes congelés
0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000
Source: Centrale suisse de la culture maraîchère
■ Commerce extérieur: importations supplémentaires de pommes de terre
Production suisse et importation de différents produits en 1999
Céréales panifiables Céréales fourragères SucreOléagineuxPommes de terre LégumesFruits (sans fruits trop.)
Importations
Sources: USP, Fruit-Union Suisse, Centrale suisse de la culture maraîchère, DGD, Sucreries d'Aarberg et de Frauenfeld SA
En raison de la diminution du rendement et d’une détérioration de la qualité, il n ’ a pas été possible, en 1999, de satisfaire aux besoins de plants de pommes de terre, de pommes de terre comestibles et de pommes de terre destinées à la transformation Le DFE a donc augmenté deux fois le contingent tarifaire de 20'470 t Au total, 42'361 t de pommes de terre et 4'910 t d’équivalents ont été importées sous forme de produits à base de pommes de terre 1'663 t de plants de pommes de terre et 5'228 t de produits de pommes de terre ont été exportées Pour ce qui est des oléagineux, la part du lion est revenue aux importations de fèves de soja à des fins fourragères (100'150 t) et de tournesols (23'000 t) Les importations ont été 10% inférieures à celles de 1998, plus de 90% des huiles de soja pressées en Suisse (14'000 t) ayant été réexportées dans le trafic de perfectionnement Par ailleurs, 400 t d’huile de colza suisse ont servi à l’aide humanitaire

Totalisant 210'889 t, les importations de légumes cultivables en Suisse ont progressé de 4,6 % par rapport à 1998, alors que, avec 20'015 t, celles d'abricots, de cerises et de pruneaux ont même fait un bond de 49%. A l’inverse, les importations de produits stockables tels que les oignons, les carottes, les pommes et les poires, ont diminué Les exportations de légumes et de fruits demeurent insignifiantes En effet, les prix de revient sont élevés et les marchés d’exportation traditionnels font défaut S’y ajoutent les droits de douane considérables perçus par l’UE Dans le secteur des légumes, seules les carottes ont été exportées en quantités notables Au cours des dernières années, la branche des fruits a commencé à exporter régulièrement des pommes et des poires, notamment dans le but de développer des relations à long terme avec les importateurs étrangers. Dans l’année sous revue, les entreprises de transformation de fruits ont également commercialisé à l’étranger, sous forme de concentrés et parfois avec l’aide de la Confédération, une part de la récolte abondante de fruits à cidre de 1998 (28'492 t)
En 1999, les importations de vin ont atteint 147,4 millions de litres pour le rouge et 17,7 millions de litres pour le blanc, auxquels se sont ajoutés 13 millions de litres de mousseux, 9,4 millions de litres de vins de transformation et 1,5 million de litres de vins liquoreux Quant aux exportations de vins suisses, elles se sont limitées à quelque 700'000 litres. Les importations de vin rouge et de vin blanc ont régressé de 1% (1,7 mio de l) par rapport à 1998 Comparées aux importations, les exportations de vin, plutôt modestes, ont tout juste égalé, durant l’année sous revue, le niveau de l’année précédente.
1 . 1 E C O N O M I E 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E 41
e n t
Production suisse
0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000 1
■ Consommation: légumes frais à la mode
En 1998, chaque habitant a consommé 52,1 kg de pain et de produits de boulangerie. Par rapport à l’année précédente, la consommation s ’est accrue de 1,7 kg La moyenne des années 1996/98 est toutefois de 1,6% au-dessous de la moyenne 1990/92 Totalisant 1'450'400 t en 1999, la consommation d’aliments pour animaux a baissé par rapport à 1998 La part des céréales fourragères (692'054 t) a été légèrement inférieure à celle de l’année précédente
En 1999, la consommation suisse de sucre blanc a représenté 209'000 t, soit 32 kg par habitant, dont 85% en provenance du pays Les consommateurs se composent pour la moitié de ménages privés et pour l’autre de l’industrie
La consommation de fruits et de légumes frais cultivables en Suisse a évolué diversement En 1999, les Suisses ont consommé nettement plus de légumes frais qu’il y a dix ans Par contre, la consommation de fruits frais est en recul Durant l’année sous revue, chaque habitant a consommé 68 kg de légumes, soit 7 kg de plus qu ’ en moyenne des années 1990/92 Les fruits n ’ont pas connu la même évolution puisque les 23 kg consommés par habitant en 1999 équivalent à un recul de 4 kg par rapport à 1990/92
La consommation de légumes suisses s’inscrit dans le contexte d’un changement des habitudes alimentaires. A titre d’exemple, la consommation de salades iceberg suisses a presque doublé, passant de 7'500 t en moyenne au cours des années 1990/92 à 12'407 t en 1999, notamment au préjudice des salades pommées On observe également une très forte croissance de la consommation de brocolis suisses (1999: 2'504 t) qui a pratiquement doublé depuis 1995, parfois au détriment du chou-fleur Les courges indigènes ont aussi gagné du terrain puisque leur consommation est passée de moins de 1'000 t dans les années nonante à plus de 2'000 tonnes aujourd’hui Les tomates en branche sont de plus en plus appréciées (grappes à tomates rondes ou à tomates cerises). En 1999, la consommation de tomates suisses en branche a presque atteint 2'700 t, soit une hausse de 58% par rapport à il y a deux ans
Consommation de vin rouge et de vin blanc dans l'année vinicole 1998/99

Vin blanc étranger 9%Vin blanc: 31%
Vin rouge: 69% 294,6 mio. de litres: 100%
Vin blanc suisse 22%
Vin rouge suisse 19%
Vin rouge étranger 50%
Sources: DGD, OFAG, cantons
1 . 1 E C O N O M I E 1 42
En Suisse, la consommation de vin a atteint 294,6 millions de litres durant l’année vinicole 1998/99, soit une progression de 3,2 millions de litres par rapport à l’année précédente Le vin suisse en a représenté 41,1% Sa consommation a connu une hausse de 5 millions de litres pour s’établir à 121 millions de litres. Dans la consommation globale (vin de transformation inclus), le vin rouge a progressé de 1,1 million de litres pour aboutir à 203,6 millions de litres, alors que le vin blanc culmine désormais avec 90,9 millions de litres, soit une croissance de 2,1 millions de litres
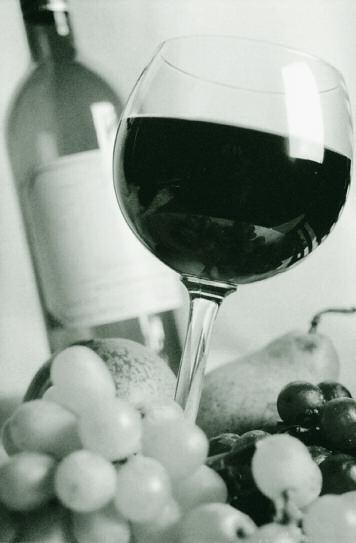
Dans les produits végétaux, la tendance à la baisse des prix à la production persiste depuis des années Cependant, les nombreuses pertes de rendement ont souvent entraîné une raréfaction de l’offre durant l’année sous revue. Aussi, les prix à la production de quelques produits ont-ils pu être maintenus, voire légèrement améliorés, par rapport à l’année précédente
Les prix de prise en charge des céréales panifiables et, pour la dernière fois, des oléagineux, ont été fixés par le Conseil fédéral Quant aux autres produits, les interprofessions ont établi des valeurs indicatives Outre les prix de base négociés, il existe dans ce domaine divers suppléments ou réductions en fonction de la qualité, de la ponctualité dans les livraisons, des cotisations aux interprofessions, etc , de sorte que les prix effectifs à la production s’écartent parfois considérablement des prix de base définis L’offre indigène étant limitée, les prix des céréales fourragères ont été supérieurs aux prix indicatifs recommandés par la branche.
L’augmentation des réserves de sucre sur le marché mondial est à l’origine des prix les plus bas depuis dix ans. Suite à cette baisse des prix du marché mondial, le produit moyen de la vente de sucre suisse a régressé au-dessous de 33 50 fr /dt La baisse des recettes dans le secteur du sucre n ’ a cependant exercé aucune influence sur le prix des betteraves sucrières en 1999 Par contre, la diminution de leur teneur en sucre explique un recul du prix de quelque 2 fr /dt
1 . 1 E C O N O M I E 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E 43
Evolution
des champs 1990/92199719981999 e n % Blé, 75.41 fr./dt Orge, 48.83 fr./dt Source: FAT Betteraves sucrières, 11.85 fr./dt Pommes de terre, 37.76 fr./dt Colza, 146.11 fr./dt Prix à la production 1999 -40 -30 -20 -10 0 1
■ Prix à la production: la tendance à la baisse persiste
des recettes des producteurs pour des produits
Prix des tomates rondes en fonction de l'offre en 1999

Production suisse Prix à la consommation (Suisse et étranger) Prix à la production (Suisse)
Sources: Centrale suisse de la culture maraîchère, DGD, OFAG
Au cours des dix dernières années, on a constaté une forte baisse des prix à la production des pommes et des poires, ainsi que de ceux des tomates et des légumes en conserves En 1999, les producteurs ont obtenu de meilleurs prix que l’année précédente pour de nombreux fruits et légumes. Toutefois, globalement, les prix plus élevés n ’ont pas suffi à compenser le manque à gagner résultant de la baisse du rendement Les chiffres des estimations préalables des récoltes étant relativement élevés, les prix à la production des cerises de table, situés à 3.05 fr./kg, ont été inférieurs de 8% à ceux de 1998 Les mauvaises conditions météorologiques pendant la récolte ont occasionné de lourdes pertes Néanmoins, les prix n ’ont guère progressé
Côté cerises à distiller, la branche s ’est entendue sur un prix indicatif de 66 ct /kg, soit 9 ct. de moins que celui de 1998. Le prix à la production des pruneaux à distiller n ’ a même pas été fixé en raison de l’alignement fiscal de la Suisse sur l’étranger pour les spiritueux Le Conseil fédéral a en effet augmenté au 1er juillet 1999 à 29 fr /l d’alcool pur le taux d’imposition des spiritueux indigènes, l’adaptant ainsi à celui appliqué aux importations Conséquence: une augmentation de la demande de spiritueux étrangers et une pression sur les prix à la production des fruits à distiller suisses
En 1998, le secteur des fruits a décidé une diminution générale de 10 fr /t des prix à la production des fruits à cidre, compte tenu des récoltes exceptionnelles En dépit de pronostics de récolte revus largement à la baisse pour 1999, les prix à la production sont restés au niveau de l’année précédente Les producteurs de fruits à cidre ont vu leurs contributions au fonds de fruits à cidre baisser par rapport à 1998, la retenue s’élevant à 15 fr /t L’année précédente, le montant de cette contribution était de 70 fr /t pour les pommes et de 40 fr /t pour les poires
1 . 1 E C O N O M I E 1 44
e n t e n f r . / k g
Quantité
J a n v i e r F é v r i e r M a r s A v r i l M a i J u i n J u i l l e t A o û t S e p t e m b r e O c t o b r e N o v e m b r e D é c e m b r e 0 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5
importée
Valeur estimée d’une récolte moyenne de raisins 1993/1997

Malgré la limitation de la production dans la culture vinicole et deux années de récolte faible à moyenne, les prix à la production ont à peine repris L’interprofession vin suisse estime, pour les années 1993 à 1997, à environ 527 millions de francs par an la valeur d’une récolte moyenne de raisins De grandes différences de prix apparaissent entre les régions, et parfois même à l’intérieur de celles-ci.
Le prix de la farine a reculé de 11.50 fr./dt, parallèlement à la réduction des prix de prise en charge et de vente de la Confédération pour les céréales panifiables Le prix du pain a également été ajusté à la baisse En 1999, la livre de pain bis coûtait 1 98 franc, soit 10 ct de moins qu ’ en moyenne des années 1990/92, alors que la réduction du prix du pain mi-blanc atteignait 7 ct la livre
L’écart de prix entre l’huile de colza et l’huile de tournesol a été majoré afin d’améliorer la compétitivité de la première Par conséquent, son prix a été inférieur de 50 ct /kg à celui de l’huile de tournesol. A noter également que la Confédération a soutenu une opération promotionnelle d’huile de colza de juillet à septembre 1999
Les prix à la consommation de légumes et de fruits ont suivi en 1999, tout comme en 1998, une évolution souvent parallèle aux prix à la production Par rapport à l’année précédente, les prix à la consommation ont fréquemment été inférieurs en raison des importations supplémentaires à bas prix
1 . 1 E C O N O M I E 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E 45
Région Récolte moyenne Valeur moyenne Prix moyen hl fr. fr./l Région du lac de Bienne 12 860 6 724 047 5,23 Fribourg 8 311 4 088 315 4,92 Vaud 362 393 199 915 317 5,52 Valais 462 459 180 555 795 3,90 Neuchâtel 35 102 18 096 906 5,16 Genève 120 233 30 794 336 2,56 Suisse alémanique 133 481 66 277 827 4,97 Tessin 39 938 21 033 002 5,27 Total Suisse 1 174 777 527 485 545 4,49 Source: Interprofession vin suisse
■ Prix à la consommation: prix du pain en baisse 1
■ Estimations 2000 En raison des conditions atmosphériques favorables, on peut s ’attendre à des rendements supérieurs à 1999
Grandes cultures: le rendement de l’orge et du colza a correspondu à la moyenne des années nonante La récolte de céréales panifiables, quant à elle, a été compromise par un temps pluvieux Les quantités ont été celles que l’on attendait, mais non la qualité, qui a souffert de la germination: Ont été particulièrement germés le seigle (entièrement) et le blé (un quart) Le reste du blé utilisable en tant que céréale panifiable suffit à couvrir les besoins du pays En ce qui concerne les pommes de terre et les betteraves sucrières, on s ’attend à de bonnes récoltes

Légumes: la quantité récoltée durant les six premiers mois de l’année, a été bien supérieure à celle de 1999 (année défavorable en raison des conditions atmosphériques), se situant au niveau de 1998 Cerises de table et cerises de conserve: très bonne récolte. Abricots: très bonne récolte également. Le mauvais temps de juillet a toutefois compromis la récolte de la variété Luizet (variété principale) Pommes et poires (cultures): on estime la récolte à 161’000 et 27’000 t respectivement La grêle qui a frappé la Suisse centrale et orientale aura pour effet que la quantité commercialisable sera réduite, se montant à 67% et 53% de la récolte totale respectivement On prévoit une grande quantité de fruits à cidre en provenance des vergers traditionnels
Vigne: on s ’attend à une récolte de bonne qualité, s’élevant à quelque 130 millions de litres de moût
En dépit de prix parfois à la baisse, les recettes totales devraient être, grâce à de meilleurs rendements, supérieures à celles de l’année passée (+86 millions de francs ou 4%; estimation 2000 des comptes économiques de l’agriculture, cf. ch. 1.1.3).
46
1 . 1 E C O N O M I E 1
12,
Tableau
page A12
■ Nouvelles bases juridiques pour la politique en matière de revenus
1.1.3 Situation économique du secteur agricole
La réforme de la politique agricole a reformulé, sur le plan légal, les objectifs de la Confédération en matière de politique des revenus Conformément à l’art 5 LAgr, les mesures de politique agricole doivent permettre aux exploitations remplissant les critères de durabilité et de performance économique de réaliser, en moyenne pluriannuelle, un revenu comparable à celui de la population active dans les autres secteurs économiques d’une même région De nouveaux principes se sont substitués à celui du salaire paritaire, consacré dans l’ancienne législation
Nous disposons de deux systèmes d’indicateurs pour présenter la situation économique de l’agriculture L’évaluation sectorielle se fonde sur les comptes économiques de l’agriculture, établis par le Secrétariat de l’USP sur mandat et sous la surveillance de l’OFAG et de l’OFS (cf. ch. 1.1.3). Quant à l'appréciation au niveau des exploitations, elle se réfère aux résultats comptables du dépouillement centralisé effectué par la FAT (cf ch 1 1 4)
Les dispositions légales sont concrétisées dans l’ordonnance sur l’évaluation de la durabilité de l’agriculture (art. 3 à 7). Elles précisent notamment que les comptes économiques de l’agriculture doivent servir d’indicateur principal pour l’évaluation de la situation économique et que dans l’analyse des résultats obtenus par les exploitations, il faut aussi tenir compte d’indicateurs tels que la productivité et la rentabilité.
Remarques méthodologiques
Les comptes économiques de l’agriculture sont établis conformément au système européen des comptes généraux de l'économie publique (Eurostat) Reconnue au plan international, cette méthode permet de comparer nos données à celles d’autres pays Ces données sont transmises à différentes organisations internationales (OCDE, ONU).
Ventes dans le pays et exportations
Autoconsommation
Transformation par les producteurs
Valeur de la production finale
Composition
Contributions des pouvoirs publics Revenu net de l'activité agricole pour la main-d'oeuvre familiale
Production finale
Valeur ajoutée brute aux prix du marché
Valeur ajoutée brute au coût des facteurs
Valeur ajoutée nette au coût des facteurs
Rémunération des salariés
Souscompensation de la TVA2
Impôts liés à la production
1 Dans ce schéma, le stock final est supposé être supérieur au stock initial; il en résulte donc une variation positive.
Recettes de l'activité agricole
Valeur ajoutée
Utilisation des recettes
2 Si la TVA perçue sur les ventes de produits agricoles n’est pas égale aux taxes versées sur les achats de consommation intermédiaire et les biens d’investissements, la différence est compensée dans les comptes économiques de l’agriculture. Lorsque le montant perçu est supérieur à celui qui a été payé, on obtient une surcompensation, qui est considérée comme une recette supplémentaire. Jusqu’à présent, on a cependant toujours enregistré une sous-compensation en Suisse.
Source: USP
47 ■■■■■■■■■■■■■■■■
1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E 1 . 1 E C O N O M I E
économiques de l’agriculture
Comptes
de la production finale Production finale
Consommation
Construction
propre
intermédiaire Fermages et intérêts Amortissements Variation des stocks1
pour compte
1
La valeur de la production agricole (production finale) correspond à la valeur monétaire de tous les produits agricoles du pays; en y ajoutant les contributions des pouvoirs publics (subventions), on obtient les recettes tirées de l’activité agricole La consommation intermédiaire (coût de l’énergie, entretien, autres biens et services) est le poste principal en ce qui concerne les dépenses La différence entre les recettes et les dépenses représente le revenu net de l’activité agricole pour la main-d’œuvre familiale Ce revenu sectoriel indemnise le travail de la main-d’œuvre familiale et le capital propre investi A l’échelon des exploitations (données comptables), il équivaut plus ou moins au revenu agricole
Résultats des comptes économiques de l’agriculture
Afin de compenser les fluctuations annuelles (p.ex. conditions météorologiques) et de respecter les contraintes légales, on apprécie le revenu sectoriel sur une base pluriannuelle La moyenne des trois années de 1990 à 1992 sert de référence; elle reflète la situation avant le lancement de la réforme agricole
48 1 . 1 E C O N O M I E 1
Résultats des comptes économiques de l'agriculture suisse Indications en prix courants en mio de fr 1990/92 1997 19981 19992 20003 Production finale 9 902 7 931 7 862 7 270 7 523 + contributions des pouvoirs publics (subventions) 1 317 2 547 2 439 2 630 2 646 - consommation intermédiaire 4 173 3 865 3 863 3 813 3 857 - impôts liés à la production, compensation TVA 123 300 274 229 168 Valeur ajoutée brute au coût des facteurs 6 923 6 313 6 165 5 859 6 144 - amortissements 2 031 1 857 1 853 1 836 1 859 - fermages et intérêts 845 729 700 690 729 - rémunération des salariés 827 798 764 740 725 Revenu net de l'activité agricole 3 221 2 930 2 847 2 593 2 831 pour la main-d'oeuvre familiale 1 Chiffres provisoires état 23 12 1999 2 Estimation, état 23 12 1999 3 Estimation état 23 8 2000 Source: USP
Pendant la période sous revue, c ’est-à-dire de 1990/92 à 1997/99, la valeur de la production finale a diminué de 22% en raison de la baisse des prix à la production La part de la production de bétail bovin a régressé de 16 à 13% pendant cette même période, tandis que celle des cultures spéciales (légumes, fruits, vin, tabac) a augmenté de 3%, passant de 14 à 17% Les transferts de l’Etat à l’agriculture (subventions) ont pratiquement doublé grâce au développement du système des paiements directs Les dépenses des agriculteurs (consommation intermédiaire, amortissements, fermages et intérêts), quant à elles, ont reculé de 9% Cela n ’ a toutefois pas permis de compenser entièrement la diminution de la production finale résultant de la baisse des prix Le revenu net sectoriel de la main-d’œuvre familiale a diminué de 13%, passant de quelque 3,2 milliards de francs (ø 1990/92) à environ 2,8 milliards (ø 1997/99) De même, le nombre d’unités de cette main-d’œuvre a baissé suite à l’évolution structurelle Par conséquent, le revenu net rapporté à l’unité de main-d’oeuvre a proportionnellement moins diminué qu ’ en ce qui concerne l’agriculture dans son ensemble
Le recul du revenu sectoriel en 1999 par rapport aux années précédentes s ’explique non seulement par la baisse des prix, mais aussi par des conditions météorologiques défavorables Les fortes pluies de l’été ont entraîné une diminution des rendements dans la plupart des branches de la production végétale et de l’économie animale

49 1 . 1 E C O N O M I E 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E
Evolution des comptes économiques de l’agriculture 1990199119921993199419951996199719981 1999 2 2000 3 Contributions des pouvoirs publics (subventions) Production finale Dépenses (cons. intermédiaire, impôts liés à la prod., amortissements, fermages, intérêts et salaires) Revenu net de l'activité agricole pour la main-d'oeuvre familiale Source: USP 1 Chiffres provisoires, état 23.12.1999 2 Estimation, état 23.12.1999 3 Estimation, état 23.8.2000 Indications en prix courants, en mio. de fr. 0 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 Tableaux 12–13,
1
pages A12–A13
■ Le revenu sectoriel 2000 comparable à celui des années précédentes
L’estimation 2000 (état août), se fonde sur l’année de calcul encore provisoire de 1998 et non pas sur l’estimation 1999 Ainsi, d’éventuelles imprécisions de cette dernière ne sont pas reportées sur l’année en cours Les valeurs de 2000 sont comparées ci-après surtout avec les années 1997/99 (moyenne de trois ans).
La production finale 2000 est de 2,1% inférieure à la moyenne de trois ans, représentant 7,52 milliards de francs selon l’estimation En comparaison avec l’estimation 1999, on escompte en revanche une progression de 3,5% Il y a donc redressement de la valeur de la production finale grâce aux meilleurs rendements de la production végétale et aux bons résultats atteints dans les secteurs bovin et porcin Le chiffre 1 1 2 contient, sous le titre «Estimations 2000», une estimation de la situation actuelle des divers secteurs de production.
Quant à la production finale végétale, on l’estime de 3,4% inférieure à celle des années précédentes. En comparaison avec l’année 1999, on s ’attend pour toutes les cultures à de meilleurs rendements, voire à des récoltes particulièrement abondantes pour les betteraves sucrières et les fruits Ces récoltes exceptionnelles conduiront à une chute des prix surtout pour les fruits D’une manière générale, la production finale végétale de l’anneé en cours pourrait dépasser de 4% l’estimation de 1999
La production finale animale régressera probablement de 1,7% en comparaison avec la moyenne triennale, une augmentation de quelque 24% étant attendue pour la production bovine grâce à des prix favorables et à un léger accroissement des cheptels escompté pour l’an 2000 On estime que la production finale animale dépassera de 3,3% celle de 1999 en raison surtout d’une situation favorable sur les marchés du bétail de boucherie
Quant à la consommation intermédiaire, elle est budgétisée à 3,86 milliards de francs Contrairement aux années précédentes, on attend un accroissement minime des dépenses de 0,3% La progression de 8% du poste «énergie» est due à la forte augmentation des prix des carburants depuis le début de l’année. Le poste «bétail» accuse, lui aussi, une augmentation (surtout en raison des importations accrues de bovins d’élevage de race pure) On observe un recul pour tous les autres postes («plants et semences» en particulier)
Par rapport à la moyenne triennale 1997/99, le budget fédéral 2000 fait état d’un plus grand nombre de transferts publics pour le secteur de l’agriculture (+4,2%) Les impôts liés à la production pourraient enregistrer une baisse de 61,8% Cette baisse importante résulte, d’une part, de la suppression de la contribution à la mise en valeur du lait et, d’autre part, d’une participation moins importante aux frais de mise en valeur des céréales
En ce qui concerne les amortissements, qui sont évalués à des prix de remplacement dans les comptes économiques de l'agriculture, leur ordre de grandeur se rapproche de celui des années précédentes Tandis que les amortissements de bâtiments sont légèrement inférieurs, ceux des machines ont tendance à augmenter en raison d’une hausse des prix.
50 1 . 1 E C O N O M I E 1
Tableau 12, page A12 Tableau 13 page A13
Les dépenses liées aux fermages et aux intérêts ont augmenté pour la première fois depuis 1992, en raison de l’évolution des taux d’intérêt Ces dépenses pourraient bien augmenter de 4,9% par rapport aux années 1997/99
Cette année encore, le nombre d’unités de main-d’oeuvre non familiale, des saisonniers entre autres, a reculé en raison de la stagnation des salaires Cela entraînera probablement une diminution de 5,5% des coûts d’employés (rémunération de la main-d’oeuvre non familiale) par rapport aux années précédentes
Le revenu net issu de l’activité agricole de la main-d’oeuvre familiale est estimé à 2,83 milliards de francs pour l’année en cours, soit une amélioration de 1,5% par rapport à 1997/99. Comparé à l’année dernière, le revenu sectoriel pourrait même augmenter de 9,2%

51 1 . 1 E C O N O M I E
1
■
1.1.4 Situation économique des exploitations
Remarques méthodologiques
L’évaluation de la situation économique des exploitations est fondée sur les résultats comptables du dépouillement centralisé effectué par la FAT En collaborant étroitement avec l’OFAG et à sa demande, cette station de recherches a défini des chiffres-clés et des solutions adéquates pour les représenter
Nouvelle méthode d’évaluation
La méthode du dépouillement centralisé a changé fondamentalement depuis les bilans de clôture de 1999 La page Internet de la FAT (www admin ch/sar/fat «Information», communiqué de presse no 13 du 23 août 2000) donne une description détaillée de ces changements.
Par le passé, on déterminait le revenu d’exploitations-témoins répondant à des critères stricts (p ex limitation du revenu accessoire, exigence d’une formation professionnelle) Comme il s ’agissait d’une sélection sciemment positive, les résultats ne pouvaient être extrapolés. En revanche, le nouveau système des «exploitations de référence» permet de faire des constatations représentatives concernant l’agriculture tout entière
Aperçu des changements méthodologiques concernant le dépouillement centralisé
Sont considérées comme univers toutes les exploitations suisses pouvant, en principe, servir de référence pour le dépouillement centralisé Elles doivent à cet effet atteindre certains seuils Ainsi, une exploitation comptant une surface d’au moins 10 ha ou gardant au moins 6 vaches appartient automatiquement à l’univers Celui-ci comprend quelque 58'000 exploitations, ce qui correspond à 78% du nombre total d’exploitations, à 95% de la SAU et à 98% du nombre de vaches enregistré lors du recensement des exploitations de 1996
– Dans cet univers d’environ 58'000 exploitations, on choisit quelque 3'500 exploitations de référence
– Comme les structures de ces exploitations de référence diffèrent de celles de l’agriculture prise dans son ensemble, on procède à une pondération des résultats comptables On se sert, à cet effet, des données du recensement des structures des exploitations concernant la répartition des exploitations selon la grandeur et le type et d’après les zones Les résultats comptables des petites exploitations, sous-représentées dans le groupe de référence, acquièrent ainsi le poids qui leur revient
Procédés et méthodes, page A61
– On a aussi introduit une nouvelle typologie des exploitations, qui distingue mieux les types importants du point de vue de la politique agricole Environ deux tiers des exploitations peuvent être attribuées à sept types spécialisés se concentrant sur certaines branches de la production végétale ou de l’élevage Le dernier tiers comprend quatre types d’exploitations combinées
52 1 . 1 E C O N O M I E 1 ■■■■■■■■■■■■■■■■
–
■ Mode de représentation
Grâce à l’extension de l’univers et à la pondération, les résultats du dépouillement centralisé sont plus représentatifs de l’ensemble de l’agriculture Il est aussi plus facile de comparer les données comptables au plan international Par contre, les changements méthodologiques ont rendu impossible la comparaison des données récentes avec d’anciens rapports sur le dépouillement centralisé Afin de pouvoir, malgré tout, établir des comparaisons pluriannuelles, nous avons appliqué rétroactivement la nouvelle méthode aux données comptables des dernières années
Conformément à l’art 7 de l’ordonnance sur l’évaluation de la durabilité de l’agriculture, la situation économique doit aussi être appréciée selon les régions A cet effet, trois régions ont été définies en référence à l’ordonnance sur les zones agricoles:
– région de plaine: zone de grandes cultures et zones intermédiaires;
– région des collines: zone des collines et zone de montagne I;

région de montagne: zones de montagne II à IV.
Délimitation
Région de plaine
Région de collines
Région de montagne
Office fédéral de l'agriculture
Limites communales Copyright BFS GEOSTAT
Source: données SIPA 1998
Afin de pouvoir apprécier la dispersion de certains chiffres-clés de manière différenciée, nous avons réparti les exploitations considérées en quartiles, en nous fondant sur le revenu du travail par unité de travail annuel de la famille (UTAF) Chaque quartile (0 –25% / 25 –50% / 50 –75% / 75 –100%) comprend un quart des exploitations de l’univers.
La représentation en quartiles permet une appréciation différenciée du point de vue économique. Par contre, on a renoncé à une différenciation basée sur des critères écologiques, car la part d’exploitations de référence ne fournissant pas les prestations écologiques requises est inférieure à 3%
L’article 5 LAgr exige l’appréciation de la situation économique «en moyenne pluriannuelle». C’est la raison pour laquelle les évolutions sont représentées sur plusieurs années Quant aux considérations plutôt statiques, elles se basent sur la moyenne de trois ans la plus récente (en l’occurrence 1997/99)
53 1 . 1 E C O N O M I E 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E
–
1
des régions de plaine, des collines et de montagne (Communes en fonction de leur attribution à une zone prépondérante)
■ Détermination du revenu du travail
En vue de la comparaison des revenus, on détermine le revenu du travail des agriculteurs, d’une part, et le salaire annuel brut des autres groupes de la population, d’autre part La situation salariale de ces derniers est saisie tous les deux ans par l’OFS à l’aide de son enquête sur la structure des salaires. Dans les années intermédiaires, les données sont actualisées au moyen de l’indice de l’évolution des salaires En 1998, l’enquête sur la structure des salaires a porté sur environ 24'500 entreprises; elle donne un aperçu représentatif de la situation salariale des employés de l’industrie (secteur secondaire) et des services (secteur tertiaire)
Composantes salariales saisies (enquête de l’OFS sur la structure des salaires)
Salaire brut du mois d’octobre (y compris cotisations de l’employé aux assurances sociales, prestations en nature, parts de primes, de chiffre d’affaires ou de provision régulièrement versées), indemnisations pour travail par équipes, travail de nuit et du dimanche, 1/12 du 13e salaire et 1/12 des paiements spéciaux annuels.
Standardisation: conversion des cotisations (y compris charges sociales) à un temps de travail uniforme de 4 1/3 semaines à 40 heures
Les chiffres de l’enquête sur la structure des salaires sont convertis en salaires annuels bruts. Ensuite, on détermine, pour chaque région, la médiane de tous les employés des secteurs secondaire et tertiaire
On calcule, pour l’agriculture, le revenu du travail agricole par UTAF, qui est le pendant des salaires annuels bruts Une UTAF se base sur 280 journées de travail, une personne correspondant au maximum à 1,0 UTAF
Calcul du revenu du travail agricole
Revenu agricole – intérêts servis sur le capital propre engagé dans l’exploitation (taux d’intérêt moyen des obligations de la Confédération)
= revenu du travail réalisé par la famille du chef d’exploitation : nombre d’unités de travail annuel de la famille (UTAF) (base: 280 journées de travail)
= revenu du travail par UTAF

54 1 . 1 E C O N O M I E 1
Résultats du dépouillement centralisé
On ne saurait toutefois se limiter à une comparaison des revenus, car le revenu du travail ne reflète que partiellement la situation économique effective des ménages agricoles Le revenu total, qui englobe aussi le produit des activités accessoires exercées à titre d’indépendant ou de salarié, constitue ici un complément précieux Des indicateurs supplémentaires permettent en outre d’examiner l’évolution et la dispersion de la productivité et de la viabilité, et d’estimer le potentiel de développement des exploitations Ces indicateurs sont mentionnés à l’annexe Il est présenté, ci-après, un choix à grande valeur informative
Le revenu agricole indemnise le travail des membres de la famille qui ne touchent pas à proprement parler un salaire, ainsi que le capital propre engagé dans l’exploitation Quant au revenu total, il couvre la consommation privée de la famille et sert à la formation de capital. Le capital propre doit s ’accroître afin que les agriculteurs puissent financer les investissements de substitution ou de développement (le renchérissement et le coût du développement de l’exploitation ne sont pas compris dans les amortissements), ainsi que leur prévoyance vieillesse
Contrairement aux estimations pessimistes de l’automne 1999, l’année sous revue enregistre des résultats économiques moyens par rapport aux années précédentes Certes, le rendement brut a diminué en moyenne de 1,1% par rapport aux années 1996/98 en raison des pertes occasionnées en culture des champs par les conditions météorologiques et de la baisse des prix du lait En revanche, les charges réelles se sont réduites de 1,7% depuis les années 1996/98, notamment grâce aux frais moins élevés enregistrés pour la réparation de bâtiments et de machines, qui étaient montés en flèche l’année précédente. De même, le coût de la main-d’oeuvre et le service de la dette ont continué à régresser
55 1 . 1 E C O N O M I E 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E
■
Revenu 1999 meilleur que prévu
1996199719981999 f r p a r e x p l o i t a t i o n Revenu accessoire Revenu agricole Source: dépouillement centralisé, FAT 0 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 17 203 18 627 18 254 18 638 49 45757 97453 07953 789 1,33 UTAFUnités
1,321,311,29
Revenu des exploitations agricoles de 1996 à 1999: moyenne des régions
de travail annuel de la famille
Tableaux 14–22 pages A14–A23
1
Tableaux 14–17, pages A14–A17
Malgré les conditions météorologiques défavorables, la mise en œuvre de la nouvelle politique agricole n ’ a pas entraîné un effondrement du revenu agricole En 1999, celuici s ’est stabilisé au niveau de 1996/98 en moyenne des exploitations Celles-ci ont compensé partiellement le manque à gagner par l’utilisation plus rationnelle des moyens de production et une adaptation structurelle Les exploitants ont en outre réussi à augmenter leur revenu accessoire, de sorte qu ’ en 1999, le revenu total a dépassé d’environ 1,3% celui des années 1996/98 Les résultats comptables confirment que les paysannes et paysans suisses font tout leur possible pour s ’adapter aux conditions générales de la nouvelle politique agricole
L’évolution des revenus diffère selon la région En 1999, le revenu des exploitations de plaine a été plus faible que les années précédentes (-5,3%), surtout parce qu ’elles ont subi davantage de pertes dans la production végétale en raison des conditions météorologiques et parce qu ’elles touchent moins de paiements directs (introduction du nouveau système). Avec 4%, le revenu total des exploitations de plaine à un peu moins diminué que le revenu agricole, grâce à une légère augmentation du revenu accessoire
Revenu des exploitations agricoles: régions de plaine, des collines et de montagne
56 1 . 1 E C O N O M I E 1
Revenu selon les régions Unité 1996 1997 1998 1999 1996/98 –1999 % Région de plaine Surface agricole utile ha 18,45 18,91 18,90 19,33 3,1 Unités de travail annuel de la famille UTAF 1,30 1,30 1,27 1,26 -2,3 Revenu agricole fr 62 201 69 270 64 885 61 968 -5,3 Revenu accessoire fr 16 072 18 703 17 507 17 580 0,9 Revenu total fr 78 273 87 973 82 392 79 548 -4,0 Région des collines Surface agricole utile ha 16,67 16,92 17,07 17,19 1,8 Unités de travail annuel de la famille UTAF 1,30 1,30 1,29 1,28 -1,3 Revenu agricole fr 42 509 53 740 47 420 49 885 4,2 Revenu accessoire fr 17 947 18 973 19 283 19 849 5,9 Revenu total fr 60 456 72 713 66 703 69 734 4,7 Région de montagne Surface agricole utile ha 17,19 17,28 17,67 18,06 3,9 Unités de travail annuel de la famille FJAE 1,39 1,39 1,38 1,37 -1,2 Revenu agricole fr. 34 321 43 137 38 101 43 392 12,6 Revenu accessoire fr 18 412 18 139 18 505 19 250 4,9 Revenu total fr 52 733 61 276 56 606 62 642 10,1 Source: dépouillement centralisé FAT
Dans la région des collines et celle de montagne, tant le revenu agricole que le revenu accessoire ont nettement augmenté par rapport aux trois années précédentes Les exploitations situées à plus haute altitude ont moins souffert du mauvais temps et ont profité davantage de la progression des paiements directs (plaine: +1,1% par rapport à 1996/98; montagne: +11,1%) L’écart de revenu entre la plaine et la montagne s ’est donc réduit

La part des paiements directs au rendement brut a représenté, en 1999, 15% dans la région de plaine, 23% dans celle des collines et 39% dans celle de montagne, ce qui montre bien l’importance que revêt cette mesure de politique agricole Le rôle du revenu accessoire, qui dans les régions des collines et de montagne apporte depuis longtemps une contribution substantielle au revenu, est resté relativement constant en plaine au cours des dernières années
On constate de grandes différences en ce qui concerne la situation des revenus des 11 types d’exploitations (branches de production)
Revenu des exploitations agricoles selon les types d’exploitations en 1997/99
57 1 . 1 E C O N O M I E 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E
Types d'exploitations Surface Unités de Revenu Revenu Revenu total agricole travail annuel agricole accessoire utile (ha) de la famille ha UTAF fr fr fr Moyenne des exploitations 18,14 1,31 54 948 18 506 73 454 Grandes cultures 22,40 1,04 66 024 27 940 93 964 Cultures spéciales 12,54 1,31 62 233 20 052 82 285 Lait commercialisé 17,43 1,36 47 668 17 900 65 568 Garde de vaches mères 16,99 1,13 43 711 31 311 75 022 Garde d'autres bovins 14,46 1,30 31 931 19 619 51 550 Chevaux, ovins et caprins 12,53 1,16 24 740 29 819 54 559 Transformation 10,88 1,19 59 634 15 559 75 193 Expl comb : grandes cultures + lait 23,58 1,37 68 193 12 986 81 179 Expl comb : vaches mères 24,65 1,23 57 118 25 445 82 563 Transformation combinée 17,95 1,31 72 448 16 085 88 533 Autres exploitations combinées 19,40 1,30 56 633 18 637 75 270 Source: dépouillement centralisé, FAT
1
Tableaux 18a–18b, pages A18–A19 Procédés et méthodes, page A61
En moyenne des années 1997/99, les revenus agricoles les plus élevés ont été réalisés par les exploitations pratiquant la culture des champs et les cultures spéciales, ainsi que par les entreprises de transformation combinées Les branches à faible coefficient de travail (culture des champs, vaches mères, chevaux, moutons et chèvres) offrent aux exploitations les meilleures possibilités de réaliser un revenu accessoire D’une manière générale, les exploitations de production laitière, de garde de bovins, de chevaux, de moutons et de chèvres ont enregistré les revenus totaux les plus bas
Les paramètres utilisés ci-dessous sont appréciés sur la base d’une présentation en quartiles
Le revenu du travail réalisé par les exploitations agricoles varie fortement selon la région et à l’intérieur des quartiles En région de plaine, le revenu du travail moyen de 1997/99 a représenté 24% dans le 1er quartile, alors que le revenu du 4e quartile constitue 198 % de la moyenne de toutes les exploitations. Les structures d’exploitation ont par contre moins varié Ainsi, dans le 1er quartile, la SAU se situait autour de 79% de la moyenne, contre 125% dans le 4e quartile Pour ce qui est de l’utilisation de main-d’œuvre de l’exploitation (UTA), la dispersion a, elle aussi, été plus faible (98% dans le 1er quartile; 104% dans le 4e) La surface exploitée par unité de maind’oeuvre a représenté 120% de la valeur moyenne (10,2 ha) pour les exploitations de plaine dans le 4e quartile (12,3 ha) et 80% de cette valeur dans le 1er quartile (8,2 ha) Le même constat s ’applique à la région des collines et à celle de montagne
Revenu du travail des exploitations agricoles en 1997/99: selon les régions et les quartiles
Revenu du travail 1 en fr par UTAF 2

1 Intérêts sur le capital propre au taux moyen des obligations de la Confédération: 1997: 3,40%; 1998: 2,81%; 1999: 3,02%
2 Unités de travail annuel de la famille: base de 280 journées de travail
Source: dépouillement centralisé, FAT
Les structures de l’exploitation n ’ont donc qu ’ une faible incidence sur le montant du revenu du travail. C’est bien davantage le chef d’exploitation qui influe sur les résultats économiques de l’entreprise Ainsi, les exploitations du 4e quartile ont besoin de moins de main-d’œuvre pour exploiter un hectare de terre (0,08 UTA/ha) que celles du 1er (0,12 UTA/ha). On remarquera que les dépenses pour la consommation courante (privée) de la famille dans le 1er quartile ne sont que légèrement inférieures aux valeurs du 4e quartile
En ce qui concerne la région de plaine et celle des collines, les exploitations du quartile supérieur ont, en 1997/99, réalisé un montant au moins équivalant au salaire annuel brut correspondant du reste de la population Quant à la région de montagne, le revenu moyen du travail dans le 4e quartile se situe à quelque 8'000 francs en dessous de la valeur comparative.
58 1 . 1 E C O N O M I E 1
Médiane Moyennes Région 1er quartile 2e quartile 3e quartile 4e quartile (0–25%) (25–50%) (50–75%) (75–100%) Région de plaine 38 286 9 849 31 101 47 255 81 326 Région des collines 29 781 8 212 24 265 35 801 58 198 Région de montagne 22 180 5 469 17 848 27 007 44 733
Tableaux 19–22, pages A20–A23
■ Grosses divergences en matière de revenu du travail
■ Stabilité financière
Salaire comparable selon les régions en 1997/99
1 Médiane des salaires annuels bruts de tous les employés actifs dans les secteurs secondaire et tertiaire
Sources: OFS, FAT
Si l’on tient compte du revenu accessoire dans l’appréciation, la situation des ménages agricoles est sensiblement meilleure que si l’on confrante uniquement le revenu du travail avec le salaire comparable Le revenu accessoire moyen se situe autour de 19'000 francs dans toutes les régions
La part de capitaux étrangers à l’ensemble du capital (= total actifs) renseigne sur l’endettement d’une exploitation En considérant aussi bien le chiffre-clé de l’endettement que la formation de capital propre, on parvient à juger si les dettes d’une exploitation sont supportables. Une exploitation enregistrant une part élevée de capitaux étrangers et une formation négative de capital propre n ’est pas viable à la longue
Vu ce qui précède, les exploitations sont réparties en quatre groupes en fonction de la stabilité financière
Répartition des exploitations en quatre groupes
Exploitations avec ...
Taux d'endettement (part capitaux étrangers) bas (<50%) élevé (>50%) positive situation financière faible autonomie Formation de saine financière capital propre négative faible revenu situation financière précaire
Source: De Rosa
L’appréciation de la stabilité financière présente une situation similaire dans les trois régions La moitié à peine des exploitations connaît une situation financière saine, alors qu ’elle est plus problématique pour un tiers d’entre elles (formation négative de capital propre). Bon nombre ont une formation de capital propre égale à zéro.
59 1 . 1 E C O N O M I E 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E
an Région de plaine 62 182 Région des collines 56 788 Région de montagne 52 656
Région Salaire comparable1 fr. par
1
Appréciation de la stabilité financière en 1997/99: selon les régions
plaine Région des collines Région de montagne
Il ressort d’évaluations supplémentaires que les jeunes agriculteurs s ’endettent plus, mais forment aussi plus de capital propre, contrairement aux générations précédentes qui forment peu de capital, mais font aussi moins de dettes. Tout comme pour la situation en matière de revenu, la stabilité financière présente des écarts substantiels dans les différents quartiles
Appréciation de la stabilité financière en 1997/99: région de plaine, selon les quartiles1
Moyenne1er quartile (0–25%)
2e quartile (25–50%)
3e quartile (50–75%)
4e quartile (75–100%)
Source: dépouillement centralisé, FAT
En 1997/99, seuls quelque 13% des exploitations de plaine ont enregistré une formation négative de capital propre dans le 4e quartile, contre deux tiers environ dans le 1er Par contre, le taux moyen d’endettement (part de capitaux étrangers) du 1er quartile (41%) ne dépassait que légèrement celui du 4e (39%) Quant à la grande dispersion constatée pour la formation de capital propre (moyenne du 1er quartile: -10’127 fr ; 4e quartile: 39’031 fr ), elle est due surtout à des écarts au niveau du revenu total (50’820 fr. contre 120’387 fr.), la consommation des familles variant moins (60’947 contre 81’356 fr )
60 1 . 1 E C O N O M I E 1
P a r t d ' e x p l o i t a t i o n s e n %
Critère de tri: revenu du travail situation financière précaire faible revenu faible autonomie financière situation financière saine 10 0 100 90 80 70 60 50 40 30 20 14 20 19 47 24 41 10 25 17 18 19 46 9 13 20 58 5 8 28 59
1
Région de
P a r t d ' e x p l o i t a t i o n s e n % situation financière précaire faible revenu faible autonomie financière situation financière saine Source: dépouillement centralisé, FAT 10 0 100 90 80 70 60 50 40 30 20 14 20 19 47 15 13 27 45 14 16 22 48
■ Productivité La productivité est exprimée par le rapport entre rendement (output) et allocation des facteurs de production (input) Le revenu de l’exploitation permet de déterminer la productivité des facteurs de production La productivité globale de l’exploitation indique le revenu de l’exploitation généré par chacun des facteurs de production (travail, surface, capital)
Détermination des différentes productivités de l’exploitation par ha SAU
Les tableaux à l’annexe font état des trois indicateurs permettant d’apprécier la productivité Les éléments qui suivent se limitent à la productivité des surfaces Pour ce qui est des facteurs de production travail et capital, nous présenterons plus en détail d’autres indicateurs significatifs (revenu du travail et rentabilité du capital)
Productivité des surfaces en 1997/99, selon les régions et quartiles1

Source: dépouillement centralisé, FAT
On constate des écarts substantiels dans les trois régions et selon les quartiles Avec quelque 67% en plaine, 63% dans la région des collines et 70% en montagne, la productivité moyenne des surfaces a dépassé, dans le 4e quartile, les valeurs correspondantes du 1er quartile 1997/99 C’est le revenu du travail qui sert de critère de tri pour la répartition en quartiles Les exploitations qui réalisent un bon revenu du travail obtiennent donc aussi une bonne productivité des surfaces et inversement
61 1 . 1 E C O N O M I E 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E
Productivité du travailProductivité
du capital Productivité des surfaces par UTA (salariés + famille) par fr. de capital investi (actifs totaux) Revenue de l'exploitation
Moyenne1er
2e quartile
3e quartile
4e quartile
f r / h a S A U
quartile (0–25%)
(25–50%)
(50–75%)
(75–100%)
1 Critère de tri: revenu du travail Région de plaine Région des collines Région de montagne 0 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 5 3 3 1 3 1 2 9 2 1 3 0 2 9 4 4 3 4 2 9 3 6 2 2 4 2 5 3 3 0 9 6 3 8 9 9 3 9 4 0 4 8 2 2 4 4 1 3 5 4 5 8 5 0 3 5 6 5 1 7 1
■ Rentabilité Les chiffres-clés concernant la rentabilité indiquent la rémunération des facteurs de production investis Par ailleurs, il convient de distinguer la rentabilité du capital de sa productivité Tandis que la productivité se réfère au revenu que le capital investi a permis de réaliser, la rentabilité indique le taux d’intérêt duquel le capital investi est grevé.
Détermination de la rentabilité du capital
Rentabilité du capital propre rente du capital propre 1 capital propre
Rentabilité du capital total produit net 2 actifs exploitation
1 Bénéfice et pertes calculés plus intérêts sur le capital propre; ou: revenu agricole moins rémunération comptable du travail familial au taux du salaire de référence
2 Service de la dette plus rente du capital propre
Le revenu agricole de bon nombre d’exploitations ne permet pas de rétribuer le travail de la famille du chef d’exploitation au taux du salaire de référence Du point de vue comptable, il en résulte donc une formation négative du capital propre (rentabilité négative) En matière de productivité de capital, les dispersions sont considérables Quant aux taux d’intérêt réalisés, ils oscillent entre -10,3% et 5,9% pour l’ensemble du capital et entre -20,4% et 7,7% pour le capital propre Seules les exploitations du 4e quartile ont registré, en moyenne des années 1997/99, une rémuneration positive aussi bien du capital propre que du capital total.

Rentabilité de l’ensemble du capital en 1997/99: selon les régions et quartiles 1
Moyenne1er quartile (0–25%) 2e quartile (25–50%) 3e quartile (50–75%) 4e quartile (75–100%)
Source: dépouillement centralisé, FAT
Quant à savoir pourquoi un exploitant décide de poursuivre ses activités même en cas d’intérêts négatifs sur le capital, en d’autres termes, lorsque la famille du chef d’exploitation accepte une rémunération de son travail inférieure au taux du salaire de référence, les raisons résident non seulement dans des considérations d’ordre économique (p ex absence de solutions de rechange), mais encore dans des valeurs non monétaires, telles que autonomie, vie à la campagne, attachement aux patrimoines familial et régional.
62 1 . 1 E C O N O M I E 1
I n t é r ê t s s u r l e c a p i t a l t o t a l e n %
1 Critère de tri: revenu du travail Région de plaine Région des collines Région de montagne 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 -2,0 -4,0 -6,0 -8,0 -10,0 -12,04 , 92 , 50, 71 0 , 37 , 77 , 86 , 75 , 13 , 81, 6 1 , 1 3 , 3 5 , 9 0, 33 , 3
1.2 Aspects sociaux
La situation sociale de l’agriculture n ’ a pas été jusqu’à ce jour analysée de façon systématique C’est pourquoi il convient encore de développer les méthodes adéquates et de définir les critères permettant d’apprécier la situation sociale des familles paysannes On pourra ensuite en dériver des indicateurs destinés à suivre l’évolution dans le domaine social
La présente description de la situation sociale repose pour l’essentiel sur deux éléments: premièrement, présentation des prestations fournies par des œuvres sociales aux paysannes et aux paysans et de leur portée; deuxièmement, premiers résultats d’une étude de fond réalisée par l’EPF de Zurich donnant des indications sur la qualité de la vie du point de vue de l’agriculture

1 . 2 A S P E C T S S O C I A U X
■■■■■■■■■■■■■■■■
1 63
■ Assurance-vieillesse et survivants
1.2.1 Recours à des prestations sociales
Les œuvres sociales publiques ainsi que les assurances des personnes et des biens constituent le filet de sécurité formel tant pour les paysans que pour les autres groupes de la population L’usage que les paysans font de ce filet et d’autres institutions sociales peut être comparé à celui des autres groupes A la fin de cette section, nous abordons les obstacles entravant le recours aux prestations sociales
Institutions sociales publiques
La rente AVS instituée en 1948 dépend du revenu soumis à cotisation durant la vie active ainsi que, le cas échéant, des bonifications pour tâches éducatives et d'assistance.

La statistique des revenus AVS de 1995 fait ressortir que 4'125'675 cotisants comprennent 24'384 agriculteurs indépendants, dont 1'206 femmes, n ’exerçant aucune autre activité soumise à cotisation 30'486 agriculteurs indépendants – dont 935 femmes – exerçaient en outre une activité salariée.
Les agriculteurs et agricultrices exerçant une activité salariée perçoivent une rente de vieillesse à peine inférieure à la moyenne suisse, alors que celle des indépendants à part entière est clairement inférieure à cette moyenne
Le droit à la rente de la paysanne (pré-splitting) est le plus souvent très faible Si la paysanne ne dispose pas d’un revenu extérieur à l’exploitation, son revenu ne relève pas de l’AVS; l’ensemble du revenu comptant pour l’AVS revient au mari Certes, il est possible de verser un revenu à l’épouse qui collabore à l’exploitation ou, lorsque des conditions déterminées sont remplies, de la déclarer comme personne exerçant une activité indépendante, mais dans la pratique, cette possibilité n ’est utilisée que très rarement La dixième révision de l’AVS a nettement amélioré la situation grâce à l’introduction des bonifications pour tâches éducatives et d'assistance
1 . 2 A S P E C T S S O C I A U X 1
■■■■■■■■■■■■■■■■
Activité et revenu soumis à cotisation AVS 1995, en fr Agricultrices et agriculteurs indépendants 36 496 Autres indépendants 65 896 Agricultrices et agriculteurs exerçant une activité accessoire 53 785 Salariés 56 800
64
■ Assurance-invalidité
L’échelle dégressive des cotisations joue un rôle tout particulier en raison des faibles revenus AVS réalisés dans l’agriculture Le revenu AVS moyen des paysans indépendants s ’est élevé en 1995 à quelque 36'000 francs Selon un calcul simplifié, il en résulte un taux de contribution AVS/AI/APG de 6,942%; ce taux s’élèverait à 9,5% sans l’échelle dégressive Cela correspond, en moyenne, à une réduction annuelle de la prime de 920 francs par exploitation
L’AI a pour objectif principal la réinsertion, c ’est-à-dire le rétablissement de la capacité de gain
Selon une étude (Donini), près de 7% d’agriculteurs ont bénéficié d’une rente AI en 1985 En 1993, ils représentaient plus de 7,5% des bénéficiaires Ces chiffres équivalent à plus d’un double de la part des bénéficiaires dans l’ensemble de la population active habitant en Suisse. Cela s ’explique notamment par la dureté du travail et par l’âge moyen élevé dans ce secteur (une personne active dans l’agriculture sur sept est âgée de plus de 62 ou 65 ans)
La situation des agriculteurs qui exercent une autre activité est tout autre La probabilité de toucher une rente AI est beaucoup plus faible. Les parts de 2,8% en 1985 et de 3% correspondent presque à la moyenne de la population active dans notre pays
L’aide en capital revêt une importance toute particulière parmi les mesures de réinsertion Elle a pour objectif de maintenir ou d’améliorer la capacité de gain Pour l’octroi de cette aide, il importe que les transformations nécessaires dans l’exploitation agricole soient induites par l’invalidité et que l’existence économique soit assurée après la transformation L’aide en capital peut être consentie sans obligation de remboursement ou comme prêt sans intérêts. Elle peut aussi être accordée sous la forme d’installations ou de prestations de garantie La loi ne fixe pas de plafond Cependant, l’aide doit être allouée dans les limites de ce qui est nécessaire et équitable. La somme des prêts dus en 1999 s ’est élevée à environ 16 millions de francs. De 120 à 145 agriculteurs reçoivent chaque année une telle aide
■ Prestations complémentaires
Des prestations complémentaires sont versées aux bénéficiaires de rentes AVS ou AI lorsque ces rentes ne suffisent pas à couvrir les besoins vitaux Le niveau de la fortune nette et les modalités de la cession du patrimoine (droit d'habitation, renonciation, etc ) sont décisifs dans le calcul des prestations complémentaires destinées aux bénéficiaires de rentes qui sont encore ou ont été propriétaires d’une exploitation agricole.
Dans le cadre de la fondation «Agriculture et handicapés», des prestations complémentaires sont versées à des personnes handicapées prises en charge par une famille paysanne et aidant dans l’exploitation
1 . 2 A S P E C T S S O C I A U X 1 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E
65
■ Allocations familiales
Les chiffres particuliers concernant le versement de prestations complémentaires dans l’agriculture ne sont pas disponibles Cependant, selon diverses études, les paysannes et paysans sont sous-représentés dans les services sociaux (Joost 1999, Wicki et Pfister 2000). La plus faible part des bénéficiaires paysans par rapport à la moyenne suisse s ’explique en partie par le fait que les agriculteurs ont bien plus souvent un revenu professionnel au-delà de l’âge AVS Au contraire, l’assurance insuffisante dans le cadre de la prévoyance professionnelle fait plutôt augmenter cette part

L’allocation pour perte de gain a pour objectif de compenser l’absence de revenu pendant le service militaire ou civil des assurés: il s ’agit d’éviter que de petites exploitations paysannes subissent des difficultés financières en raison de l’obligation de servir incombant à leurs collaborateurs C’est pourquoi des allocations d'exploitation sont versées aux membres de la famille travaillant dans l’exploitation
Cette réglementation spéciale privilégie l’agriculture par rapport à d’autres branches où l’on trouve des entreprises familiales
La finalité de la loi fédérale sur les allocations familiales dans l’agriculture relève de la politique familiale: il convient de soutenir les familles paysannes au revenu modeste ayant des enfants Le versement d’allocations familiales aux employés agricoles ainsi qu ’ aux paysans de montagne et aux petits paysans est régi par le droit fédéral. La limite de revenu est fixée à 30'000 francs plus 5'000 francs par enfant ayant droit à l’allocation Par contre, ce sont les dispositions cantonales qui réglementent l’octroi d’allocations familiales aux salariés en dehors de l’agriculture Dans les cantons ZH, FR, SH, SG, VD, VS, NE, GE et JU, des contributions sont versées en complément des allocations familiales destinées aux employés agricoles. Certains cantons connaissent également des réglementations complémentaires ou supplémentaires pour les agriculteurs indépendants (ZH, SO, SH, SG, VD, VS, NE, GE, JU) Les allocations sont versées via la caisse cantonale de compensation en matière d'allocations familiales.
1 . 2 A S P E C T S S O C I A U X 1
■ Caisse de compensation
66
■ Assurance-chômage et indemnité en cas d'insolvabilité
Conformément à la loi fédérale, les allocations familiales sont octroyées sous la forme d’allocations pour enfants et d’allocations de ménage
Allocations de ménage et allocations pour enfants
Allocation pour enfant par enfant Région de 160 fr pour les deux premiers enfants et par mois plaine 165 fr à partir du troisième enfant Région de 180 fr pour les deux premiers enfants montagne 185 fr à partir du troisième enfant
Allocation de ménage par travailleur 100 fr agricole et par mois
Répartition des allocations familiales: exercice 1999
Source: OFAS
La loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité vise à garantir aux personnes assujetties à l’AVS une compensation convenable du manque à gagner causé par le chômage, la réduction de l'horaire de travail, les intempéries ou l'insolvabilité de l'employeur.
Comme les indépendants ne sont en général pas assurés, les agriculteurs indépendants n ’ont pas droit, eux non plus, à une assurance-chômage En sont également exclus les membres de la famille qui travaillent dans l’exploitation et qui sont mis sur le même plan que les agriculteurs indépendants Cette assurance n ’entre donc en ligne de compte que pour une activité accessoire
De même, les exploitations paysannes, à la différence des autres entreprises artisanales tributaires des conditions météorologiques, ne sont pas indemnisées en cas d'intempéries
1 . 2 A S P E C T S S O C I A U X 1 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E
de
Dépenses mio de
Cotisations employeurs 11,7 Prestations en espèces 145,7 Contributions des pouvoirs publics 137,2 Frais d'administration 3,2 dont les 2/3 de la Confédération 91,5 + contribution d’allégement
- coût total pour la Confédération
- dont 1/3 des cantons
Recettes totales 148,9 Dépenses totales 148,9
Recettes mio
fr
fr
1,5
93,0
42,2
67
■ Assurance-maladie
Assurances de personnes
L’assurance-maladie porte obligatoirement sur l’assistance médicale nécessaire en cas de maladie et d’accident; à titre facultatif, elle comprend l'assurance d'indemnités journalières La plupart des agriculteurs bénéficient de l’assurance de base et d’une assurance supplémentaire pour des soins ambulatoires, ainsi que pour les soins dans une division commune de l'hôpital
D’après les cas traités par la caisse maladie AGRISANO, dont les assurés proviennent pour la plupart du monde agricole, l’utilisation de l’assurance par la population paysanne est inférieure à la moyenne, ce qui se répercute sur les primes Les soins sont souvent apportés au sein de la famille. En outre, les agriculteurs ont tendance à être domiciliés dans des régions où les primes sont meilleur marché
Dans de nombreux cantons, la limite de fortune prévue dans le système de réduction des primes défavorise les indépendants Or, ce sont précisément les paysans au revenu modeste qui doivent investir leur fortune dans leur exploitation, où celle-là apparaît comme fortune imposable C’est pourquoi de nombreux agriculteurs au revenu modeste n ’ont pas droit à une réduction de prime En 1998, 32 sur 100 personnes domiciliées dans le canton de Vaud ont bénéficié d’une réduction de prime, ce qui correspond à la moyenne suisse; par contre, cette part ne s ’est élevée qu’à 23% dans la population paysanne
■ Assurance-accidents
L’assurance-accidents protège toute personne salariée en Suisse contre les conséquences économiques des accidents professionnels et non professionnels ainsi que des maladies professionnelles Les dispositions de la loi sur l'assurance-accidents ne s ’appliquent ni aux agriculteurs indépendants ni aux membres de leur famille travaillant dans l’exploitation Quant à la main-d’œuvre non familiale, elle est assurée auprès de compagnies privées
Le risque d’accident est nettement plus élevé dans l’agriculture que dans les autres secteurs de l’économie; logiquement, il en va de même pour les frais par assuré et les primes En revanche, les accidents non professionnels sont moins fréquents et les frais par assuré moins élevés
■ Assurance militaire
L’assurance militaire vise à protéger les personnes accomplissant un service militaire ou civil, ou un service de protection civile, contre les conséquences pécuniaires de toutes les affections physiques ou psychiques survenant durant le service
Elle comprend des indemnités spéciales pour les indépendants, y compris les agriculteurs Si, en raison de la structure de son entreprise, l'indépendant ne peut couvrir pendant la durée de son incapacité de travail les frais fixes de l'entreprise qui continuent de courir, il doit être équitablement indemnisé de ce dommage
1 . 2 A S P E C T S S O C I A U X 1
68
■ Prévoyance professionnelle obligatoire
Au titre de la prévoyance professionnelle, les personnes assurées âgées ont droit à une rente leur permettant de maintenir le niveau de vie antérieur
Les indépendants et les membres de la famille qui travaillent dans leur entreprise ne sont pas assujettis à la prévoyance professionnelle obligatoire Dans le secteur agricole, plus de la moitié des chefs d’exploitation exercent une activité salariée à côté de l’activité indépendante Pour les hommes exerçant plusieurs activités, 50,2% du revenu proviennent en moyenne de l’activité agricole Le revenu moyen soumis à AVS s’élevant à 53'785 francs (1995), une somme de 26'785 francs provient de l’activité salariée Il dépasse à peine la limite fixée à 24'120 francs dans la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle Cette moyenne purement arithmétique ne renseigne ni sur le nombre d’agriculteurs exerçant une activité salariée accessoire soumis à obligation légale ni sur le degré de couverture d'assurance S’agissant des femmes travaillant à la fois comme agricultrices indépendantes et comme salariées, le revenu total moyen s’élève à 32'165 francs. Seuls 26% du revenu proviennent de l’agriculture. En moyenne, les femmes n ’atteignent pas la limite fixée dans la loi La part des personnes travaillant dans l’agriculture qui, au titre de la prévoyance professionnelle, ne bénéficient que peu ou pas d’une assurance dans la vieillesse ou en cas d’invalidité ou de décès est donc vraisemblablement très élevée

Depuis l’introduction de l’obligation d’établir les relevés et les états (à partir de la période d’imposition 1993/94), la prévoyance dans le cadre des piliers 2b et 3b, bénéficiant d'allégements fiscaux, a nettement gagné en importance pour de nombreux agriculteurs Le pilier 2b joue un rôle capital suite à l’institution des limites de revenu et de fortune pour l’octroi des paiements directs selon PA 2002 et pour la réduction des primes d’assurance maladie Les cotisations versées au titre du 2e pilier permettent de réduire le revenu et la fortune déterminants
Assurances mobilières
■ Assurance-responsabilité civile
L’assurance-responsabilité civile couvre les dommages matériels et corporels causés à des tiers En règle générale, les agriculteurs optent pour une assurance responsabilité civile combinée d'exploitation et privée
Une assurance responsabilité civile est obligatoire pour tous les véhicules à moteur circulant sur la voie publique Sont concernés des véhicules à moteur agricoles tels que les tracteurs, les moissonneuses-batteuses, etc Quant aux charrettes à bras à moteur et aux véhicules à moteur à un essieu, le contrat d’assurance est conclu par l'achat de la vignette d'assurance au poste de police
Les véhicules agricoles sont normalement munis d’un numéro vert. Leur utilisation est donc limitée aux activités agricoles et d’intérêt public Le risque étant réduit en comparaison avec les autres véhicules, la prime est inférieure à celle versée pour les autres numéros
1 . 2 A S P E C T S S O C I A U X 1 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E
69
■ Assurance immobilière et mobilière
Les bâtiments et le cheptel vif et mort sont exposés à de multiples dangers, avant tout aux dommages causés par les incendies ou les éléments naturels L'assurance incendie couvre notamment les dommages causés par l'incendie, la fumée et les explosions Les dommages consécutifs (eau, suie, etc.) sont également couverts. Dans la majorité des cantons, l'assurance immobilière est obligatoire Par contre, l'obligation d’assurance est rare pour le mobilier
Dans l’agriculture, les risques sont en particulier accrus en ce qui concerne les bâtiments, ce qui trouve son expression dans des primes légèrement plus élevées que pour les autres bâtiments
■ Assurance-grêle
La Société suisse d’assurance contre la grêle, à Zurich, est la seule compagnie qui assure les cultures contre cet élément naturel
Dans les principales zones de culture de Suisse, 90% des agriculteurs sont assurés contre la grêle Les primes de l’assurance sont fonction de la vulnérabilité à la grêle des cultures assurées, du danger local de grêle et des prétentions particulières de l’assuré (système du bonus/malus)
Assurance-grêle 1999
■ Assurance du bétail
L’assurance du bétail est pour l’essentiel organisée sur les plans privé et communal De nombreux agriculteurs ont conclu une assurance contre les maladies et les accidents pour leurs vaches et même une assurance-vie pour leurs chevaux.
Les agriculteurs sont indemnisés des pertes d’animaux en cas d’épizootie en vertu des dispositions de la législation fédérale. En règle générale, les indemnités sont calculées sur la base d’une estimation officielle des animaux ou des cheptels, effectuée selon les instructions de l’OVF La valeur d’abattage, de rente et d'élevage des animaux sert de référence, les valeurs estimées ne pouvant pas dépasser les maxima fixés à cet effet
1 . 2 A S P E C T S S O C I A U X 1
Culture Surface assurée Somme assurée Frais d'assurance 2 % 1 fr /ha fr /ha pour un risque léger un risque moyen Céréales 85 5 000 45 110 Pommes de terre 60 15 000 135 330 Maïs 55 5 200 93 166 Betteraves sucrières 50 9 000 90 189 Vin (ct VS non compris) 80 30 000 1 140 1 890 Fruits 50 25 000 1 750 2 800 Herbages (prairies et pâturages) 5 Assurance forfaitaire 28 60 1 Estimations par rapport à l’ensemble de la surface productive 2 Valeurs moyennes Source: Société suisse d assurance contre la grêle
70
■ Tissu familial
Autres filets de sécurité
La très fréquente coïncidence entre lieu du travail et domicile facilite la garde des enfants et les soins aux personnes âgées. Dans le monde agricole, les aînés peuvent souvent rester dans l’exploitation, à la différence des autres groupes sociaux, qui les placent dans des foyers pour personnes âgées En revanche, les aînés s ’occupent des enfants dans de nombreuses exploitations et exécutent bien des travaux fort utiles Dans certains cas, cette situation particulière dans l’agriculture peut conduire à des tensions entre ou dans les générations
■ Vulgarisation
Les personnes travaillant dans la vulgarisation agricole et dans la vulgarisation en économie familiale rurale sont souvent les premiers interlocuteurs d’une famille paysanne en cas de difficultés
Les généralistes disposant d’une longue expérience du conseil d'exploitation possèdent le plus souvent, en plus de leurs connaissances techniques, de grandes compétences sociales et humaines Les vulgarisations agricole et sociale doivent travailler de concert afin de trouver les solutions aux problèmes se posant pour des raisons sociales et pour des motifs d’exploitation.
■ Services d’employés auxiliaires et soins à domicile
Les services d’employés auxiliaires sont des organisations d’entraide paysanne qui ont pour tâche de fournir aux agriculteurs dans l’embarras pour cause de maladie, d’accident, de service militaire, de surcharge de travail, etc , une main-d’œuvre qualifiée à des conditions avantageuses Sont concernés avant tout le travail aux champs et à l’étable Parfois, l’aide en question intervient pour permettre à la famille paysanne de prendre des vacances. La durée de l’engagement est limitée.
Presque tous les cantons connaissent ces services qui, la plupart du temps, ont été créés par les associations paysannes cantonales. Dans certains cas, il s ’agit d’associations qui travaillent de manière totalement indépendante Mais ces services peuvent aussi être offerts par des coopératives agricoles En cas de besoin, on s ’adresse directement au service concerné, afin qu’il organise l’aide nécessaire C’est à lui qu’il appartient de facturer les engagements et d’indemniser les auxiliaires
Les agricultrices ne sont pas oubliées: elles ont plusieurs services à leur disposition, destinés à les soutenir dans les travaux ménagers de tous les jours et la gestion du budget domestique. En cas de maladie, d’accident, d’accouchement, de surcharge de travail, etc , elles peuvent s ’adresser aux services des soins à domicile (aides familiales) qui leur fourniront une aide temporaire Ces services (et il y en a d’autres) sont regroupés dans la Spitex, organisation locale des communes ou des associations de communes En outre, il existe dans certaines régions des associations privées (associations d’agricultrices, etc ), qui disposent d’un service d’aide réservé aux familles paysannes
1 . 2 A S P E C T S S O C I A U X 1 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E
71
■ Institutions privées
Les différentes prestations peuvent être fournies en espèces, en travail et en nature. Les œuvres d'entraide se spécialisent généralement dans un type de prestation Seuls quelques acteurs principaux sont mentionnés dans les considérations qui suivent Il existe de nombreux autres fonds et fondations exerçant des activités dans ce domaine.
Aide financière à l’investissement dans l’agriculture
■ Service volontaire à la ferme
L’objectif principal du service à la ferme n ’est pas directement l’aide sociale, mais la promotion de la compréhension entre la ville et la campagne. Les jeunes apprennent à connaître la vie et le travail des paysans et reçoivent, outre table et logis, de l’argent de poche pour leur collaboration Ils déchargent les familles paysannes, qui de leur côté se font une idée de leur conception de la vie.
Chiffres concernant le service volontaire à la ferme
■ Numéro de téléphone «Main tendue»: «Plus la peine est grande, moins on en parle»
Il s ’agit là d’une association fondée en 1996 par la Communauté protestante suisse de travail Eglise et agriculture, l’Union suisse des paysannes catholiques, la Fédération catholique suisse des paysans ainsi que la Centrale de vulgarisation agricole de Lindau La «Main tendue» est financée par les cotisations des membres et des dons
Son cœur est une équipe de volontaires. Ce sont pour la plupart des paysannes et des paysans, secondés par des personnes étroitement liées à l’agriculture de par leur expérience personnelle et professionnelle Il leur incombe une stricte obligation de garder le secret. Depuis 1997, près de 400 personnes ont fait appel à cette main
1 . 2 A S P E C T S S O C I A U X 1
Institution 1996 1997 1998 1999 1 000 fr Parrainage suisse pour communes de montagne, projets communs dans l’agriculture 2 200 3 775 2 488 Aide suisse aux montagnards, projets individuels et quelques projets collectifs 13 502 15 048 22 116 20 453 Parrainage COOP 1 787 1 085 1 370 >2 000 Fondation «Action de Noël» (magazine Beobachter) assainissement de logements 75 133 190 assainissement d’exploitations 264 185 230 121 Fondation pour l’entraide et pour l’aide sociale dans l’agriculture, en particulier dans la région de montagne 90 207 133 122 Aide pour les communes de montagne (projets collectifs dans l’agriculture) 300 400 400 410 Fédération suisse pour les améliorations d’exploitations dans l’agriculture de montagne 313 336 402 688 «Bergheimat» (soutien de petites exploitations biologiques en montagne) 15 10 12 12 Total 16 346 19 604 28 628 26 300
Année 1996 1997 1998 1999 Journées de travail 77 773 73 253 72 852 67 510 Participants 3 884 3 765 3 608 3 249 Durée, en jours (ø) 20 19,5 20,2 20,8
72
tendue aux paysannes, aux paysans et à leurs proches. La classe d’âge de 56 et 65 ans est la plus représentée Cette génération est confrontée au problème de la cession de l’exploitation Les femmes téléphonent plus souvent que les hommes (1999: femmes 61%, hommes 39%), certaines d’entre elles intervenant comme représentantes. A peu près deux tiers des appels viennent de la région de montagne Les téléphones viennent du pays entier; la plupart d’entre eux sont concentrés dans la Suisse centrale et orientale Cela s ’explique probablement par la publication régulière du numéro de téléphone de la «Main tendue» dans les journaux agricoles de ces régions (rapport annuel de l’association «Main tendue»)
Pondération des problèmes 1997 à 1999
FemmesHommes
personnels 30%
recherche 4%
financiers 5%
sociaux 14%
lieés à l'exploitation 14%
familiaux 33%
personnels 21%
recherche 2%
financiers 21%
familiaux 8%
sociaux 21%
lieés à l'exploitation 27%
La rubrique «Recherche» comprend la recherche de conjoint, d’aide-ménagère, d’exploitation, d’adresses, etc Les problèmes privés et professionnels sont souvent imbriqués dans une exploitation paysanne S’y ajoute fréquemment une accumulation de différents problèmes. Selon une pondération affinée, les dix problèmes les plus souvent évoqués par les femmes et par les hommes (1999) sont les suivants:
Femmes Hommes
Problèmes avec le partenaire Vider son sac
Problèmes psychiques
Conflits de générations

Charge continuelle
Vider son sac
Succession dans l’exploitation
Problèmes de santé
Crise
Problèmes avec les enfants
Problèmes financiers
Affermage
Transformation, construction
Recherche de sources de revenu
Problèmes avec les autorités et la vulgarisation
Problèmes juridiques
Cessation d'exploitation
Problèmes de santé
Problèmes juridiques Soucis concernant la politique agricole
Cette juxtaposition indique que les femmes et les hommes ne perçoivent pas les problèmes de la même manière
1 . 2 A S P E C T S S O C I A U X 1 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E
73
■ Information, transparence et état des connaissances
Obstacles entravant le recours aux prestations sociales
L’agriculture dispose d’un réseau de conseillers agricoles en assurances qui sont neutres. Les services de conseil en assurances travaillent en étroite collaboration avec les services de vulgarisation et les fiduciaires agricoles La Fondation de prévoyance de l'agriculture suisse et la caisse-maladie AGRISANO publient régulièrement dans la presse agricole des informations sur les assurances Les agriculteurs se voient offrir une large gamme de cours, de conférences, d’aide-mémoire et de brochures
Selon une étude (Wicki et Pfister), le niveau de connaissances est cependant à peine suffisant en ce qui concerne les possibilités offertes formellement en matière d’assurance: même si la plupart des personnes interrogées savent que les prestations complémentaires existent (83%), seule une minorité est en mesure d’indiquer correctement qui les verse (37%) et qui y a droit (43%) Un peu plus nombreux sont ceux qui savent à qui il faut s ’adresser pour faire valoir le droit à une prestation (57%). Une minorité également connaît l’allocation pour impotent (43%) Cette allocation, ou ce qu ’ on appelle la contribution aux frais de soins spéciaux, est une prestation de l’AI à laquelle on peut prétendre sous certaines conditions spécifiques Presque personne ne savait où l’on peut se renseigner sur le droit à cette allocation De même, les connaissances sont lacunaires sur l’aide sociale: on sous-estime ses tâches et ses compétences L’organisation de l’aide sociale n ’est pas claire non plus
■ Obstacles particuliers
Pour avoir droit aux prestations sociales, les intéressés doivent justifier du besoin et, partant, mettre au jour la situation financière du ménage et de l’exploitation Ils doivent communiquer des faits jusqu’ici privés à une autorité ou à un service social Celui-ci est en général proche du client dans le milieu rural Le recours à l’aide sociale est ainsi nettement plus rare à la campagne qu ’ en ville.
Les valeurs des agriculteurs, telles que l’autonomie, l’indépendance et la liberté sont en contradiction avec l’aide publique. Nombre de paysans et de paysannes ressentiraient comme une atteinte à leur fierté le recours à l’aide sociale La grande majorité (env 80%) n ’ en ferait usage qu’à grand-peine Même si la plupart des agriculteurs (74%) croient que les bénéficiaires de l’aide sociale ont des difficultés économiques, nombreux sont ceux qui voient là un échec personnel (près de 50%) Les bénéficiaires font parfois l’objet de graves préjugés («insolence», «paresse», etc Ceux qui ont de tels préjugés auront de la peine à recourir à l’aide sociale (Wicki et Pfister)
1 . 2 A S P E C T S S O C I A U X 1
74
Dans son enquête exhaustive menée auprès des services sociaux du canton de BâleCampagne, Joost n ’ a trouvé qu ’ un seul cas de soutien apporté dans l’agriculture Que les paysans et les paysannes aient tendance à s ’adresser au service social le plus tard possible ou à y renoncer, s ’explique probablement par leur crainte d’être stigmatisés comme bénéficiaires de l’aide sociale En raison du professionnalisme insuffisant du travail social dans le milieu rural (cf Fluder & Stremlow), le recours à l’aide sociale dans les petits villages est une affaire publique Etre dépendant de l’assistance publique au vu et au su de tous est vécu comme un fardeau Résultat: les paysans n ’osent pas demander une aide publique dans des situations de crise financière Ils rongent plutôt leur capital, c ’est-à-dire n’investissent pas ou pas assez En dépit des problèmes précités liés à la stigmatisation sociale, on considère une aide temporaire comme forme d’assistance la plus acceptable (63% des personnes interrogées; Wicki et Pfister)
Il existe peu d’indications permettant de conclure que des tracasseries administratives seraient à l’origine du recours insuffisant aux prestations sociales Celui-ci s ’explique plutôt par des connaissances lacunaires sur les procédures et compétences administratives que par des problèmes de l’administration Du point de vue juridique, les agriculteurs ne devraient pas bénéficier d’une aide sociale à long terme: le Tribunal fédéral a débouté en 1999 une famille paysanne qui avait demandé une prorogation du soutien social Comme pour les autres indépendants, il est parti du principe que les deniers de l’aide sociale ne devraient pas servir à maintenir en vie des exploitations non rentables.
Mis à part les obstacles précités, toute une série de particularités agricoles déterminent le recours aux prestations sociales
L’exploitation agricole et le ménage privé sont étroitement liés Il existe des imbrications de natures sociale et comptable: de sérieux problèmes financiers peuvent devenir un piège, car la famille paysanne engage sa fortune comme garantie.

Cependant, les faillites sont rares dans l’agriculture, et cela pour plusieurs raisons:
– Une grande marge de manœuvre existe entre le ménage et l’exploitation; en cas de difficultés financières, on peut réduire la consommation
– Les mesures de politique agricole se traduisent par un soutien du revenu et, partant, par un rythme de l’évolution structurelle socialement supportable
– Les exploitations en proie aux difficultés financières vivent souvent de leurs réserves cachées; elles peuvent renoncer aux investissements et utiliser pour la consommation l’argent des amortissements En cas d'urgence, elles peuvent vendre à la valeur vénale les terres et les bâtiments acquis à la valeur de rendement
1 . 2 A S P E C T S S O C I A U X 1 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E
75
■ Particularités agricoles
L’aide aux exploitations (cf. ch. 2.3, Amélioration des bases de production) permet de transformer les dettes en prêts sans intérêts Cependant, elle peut aussi servir à surmonter des difficultés financières exceptionnelles Elle a l’effet d’une mesure de désendettement individuelle. En 1999, des prêts à titre d’aide aux exploitations ont été accordés dans 204 cas pour un montant total de quelque 18,1 millions de francs Certains cantons ont chargé dernièrement des états-majors de crise de résoudre des problèmes très graves; ces cellules réunissent les représentants des autorités, de la vulgarisation, des organisations professionnelles et des banques
La jouissance du droit d'habitation est un élément essentiel de la prévoyance vieillesse dans les familles paysannes On réduit substantiellement le coût de la vie en économisant les frais de location ou le coût d’achat d’un appartement. Le droit à des biens en nature tels que le lait, la viande, les fruits et les légumes doit être évalué et établi selon l’exploitation
En résumé, on peut constater que le recours aux prestations sociales est généralement peu répandu: les paysans et les paysannes ne bénéficient le plus souvent que de rentes peu élevées Ils sont sous-représentés auprès des services sociaux en raison de leurs propres scrupules et des particularités caractérisant l’agriculture

1 . 2 A S P E C T S S O C I A U X 1
76
■ Objectifs
1.2.2 Indicateurs sociaux
Étude de fond
L'Institut d'économie rurale de l'EPF Zurich étudie actuellement la situation sociale de l’agriculture suisse Cette étude a pour objectifs de: – définir la qualité de la vie; – apprécier la qualité de la vie actuelle du point de vue des familles paysannes; – élaborer des indicateurs sociaux permettant un suivi de la qualité de la vie
Les indicateurs sociaux serviront d’instrument à l’appréciation de la situation sociale des paysannes et des paysans
■ Qualité de la vie
La notion de qualité de la vie constitue un élément permettant de déterminer les critères essentiels de la durabilité sociale du point de vue des acteurs concernés Cette notion se réfère à la fois au niveau de vie objectif et au sentiment subjectif de bienêtre
Les auteurs de l’étude de fond utilisent le critère de la satisfaction pour déterminer le bien-être subjectif et comparer les appréciations personnelles des différentes sphères de la vie. Ainsi, on compare la situation réelle avec les buts de la vie, les désirs et les projets La satisfaction est élevée ou faible selon le résultat de cette comparaison Les différentes sphères de la vie analysées sont le travail, la formation, le revenu, le niveau de vie, la famille et le contexte social, les conditions générales politiques et économiques, les loisirs, la santé, les valeurs, les attitudes ainsi que la religion
On peut parler d’une haute qualité de la vie lorsque les acteurs donnent une appréciation favorable des conditions de vie mesurables «objectivement» en référence à leur système d’objectifs et le degré de réalisation de ces derniers.
■ Méthodologie à deux temps
La méthode utilisée dans l’étude de fond comporte deux volets On a formulé des hypothèses relatives aux principaux indicateurs sociaux et sphères de la vie sur la base d’outils théoriques fournis par la littérature Dans un premier temps, on les a adaptées à l’agriculture suisse et complétées suite à des interviews axées sur les problèmes spécifiques Dans un second temps, on a testé ces hypothèses: une large enquête a été menée au printemps 2000 auprès de 1500 agricultrices et agriculteurs (échantillon aléatoire simple) dans le canton de Berne Dans l’ensemble, 560 personnes ont renvoyé le questionnaire principal pour chefs d’exploitation et 461 la feuille complémentaire pour époux, épouse ou partenaire. Le taux de réponses évaluables s ’est élevé à 527 questionnaires (36%) et 461 feuilles complémentaires (31%)
1 . 2 A S P E C T S S O C I A U X 1 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E ■■■■■■■■■■■■■■■■
77
■ Principales sphères de la vie

Premiers résultats
L’appréciation du poids des différentes sphères et du degré de satisfaction se traduit par un indice de qualité de la vie.
Les premiers résultats confirment l’importance des sphères de la vie choisies pour la détermination de la qualité de la vie dans l’agriculture suisse Ces sphères peuvent donc être considérées comme éléments pertinents pour la notion de qualité de la vie Il convient alors d’élaborer les indicateurs sociaux adéquats pour chacune d’elles
Sphères de la vie: importance relative (en % de toutes les réponses, n = 511)
très important peu important plutôt important sans importance indéterminé pas de réponse
D’après l’évaluation des 511 réponses, la santé et la famille sont très importantes pour 80% des répondants Plus de 50% considèrent comme très importants et 30% comme plutôt importants le travail, la formation ainsi que les valeurs et les attitudes Une place à part revient au revenu: certes, moins de la moitié des personnes interrogées le considèrent comme très important, mais plus de 50% comme plutôt important
1 . 2 A S P E C T S S O C I A U X 1
S p h è r e s d e l a v i e Formation Perfectionnement Revenu Niveau de vie Famille Contexte social Conditions générales Loisirs Santé Valeurs, attitudes Religion en %
Travail
Source: IER-EPF 0102030405060708090100 78
■ Appréciation de la satisfaction
Les agricultrices et agriculteurs ont été priés d’indiquer leur satisfaction subjective pour chaque sphère de la vie proposée La figure ci-après représente les résultats de cette appréciation Il en ressort nettement que – dans la sphère de la famille, 60% des répondants sont très satisfaits, – dans les six sphères suivantes – travail, formation, niveau de vie, contexte social, santé, valeurs et attitude – la majorité des répondants sont très ou plutôt satisfaits, – le degré de satisfaction est le plus faible en ce qui concerne le revenu et les conditions générales
Plusieurs questions complémentaires portant sur chaque sphère ont été posées aux personnes interrogées Cette manière de procéder permet d’apprécier la qualité de la vie, ainsi que d’analyser les raisons d’une appréciation donnée de la satisfaction dans chaque sphère
Appréciation de la satisfaction dans les sphères de la vie (en % de toutes les réponses, n = 511)
■
très satisfait insatisfait satisfait très insatisfait indéterminé pas de réponse
Source: IER-EPF
La combinaison des déclarations sur l’importance des différentes sphères de la vie avec l’appréciation subjective de la qualité de la vie dans les différentes sphères permet d’établir un indice de qualité de la vie. La pondération des sphères se réfère à une échelle de 0,2 à 1 (sans aucune importance jusqu’à très important) Les réponses à la question sur la satisfaction dans chaque sphère ont été classées selon une échelle allant de -3 (très insatisfait) à +3 (très satisfait) L’indice de qualité de la vie est finalement constitué par le produit de la somme des valeurs obtenues pour l’importance et pour la satisfaction dans chacune des douze sphères. D’après l’échelle choisie dans l’étude, l’indice peut prendre des valeurs dans une fourchette allant de -36 à +36
1 . 2 A S P E C T S S O C I A U X 1 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E
en %
Travail S p h è r e s d e l a v i e Formation Perfectionnement Revenu Niveau de vie Famille Contexte social Conditions générales Loisirs Santé Valeurs, attitudes Religion 0102030405060708090100
Indice de qualité de la vie 79
Lors de son interprétation, il ne faut pas oublier qu’il s ’agit là d’une appréciation globale de la qualité de la vie Une satisfaction négative dans une sphère peut être compensée par une satisfaction positive dans une autre
D’une manière générale, on observe de grandes différences dans l’appréciation individuelle du sentiment subjectif de la qualité de vie Pour 70% des répondants, l’indice se situe de 14 à 26 points Selon les critères choisis, ils sont plutôt satisfaits de leur situation sociale Un résultat négatif a été obtenu dans 15 cas Ces agricultrices et agriculteurs expriment une nette insatisfaction dans les douze sphères considérées Dans le domaine allant de 0 à 24 points d’indice, un haut degré de satisfaction dans certaines sphères peut compenser une forte insatisfaction dans d’autres Quant aux répondants dont l’indice est supérieur à 24, leur degré de satisfaction est généralement élevé dans toutes les sphères de la vie
Nombre de personnes intérrogées
01020304050607080
Source: IER-EPF
■ Perspectives Si 80% ou davantage des personnes interrogées estiment qu ’ un facteur est «très important» ou «plutôt important» pour la satisfaction dans une sphère de la vie, ce facteur est considéré comme favorisant la qualité de la vie Par contre, un facteur est considéré comme défavorisant la qualité de la vie lorsque 80% ou davantage estiment qu’il provoque l’insatisfaction L’EPF déduira les indicateurs sociaux sur la base de ces facteurs favorisant et défavorisant la qualité de la vie
1 . 2 A S P E C T S S O C I A U X 1
Qualité de la vie perçue: distribution ≤ 0 > 0 bis ≤ 2 > 2 bis ≤ 4 > 4 bis ≤ 6 > 6 bis ≤ 8 > 8 bis ≤ 10 > 10 bis ≤ 12 > 12 bis ≤ 14 > 14 bis ≤ 16 > 16 bis ≤ 18 > 18 bis ≤ 20 > 20 bis ≤ 22 > 22 bis ≤ 24 > 24 bis ≤ 26 > 26 bis ≤ 28 > 28 bis ≤ 30 > 30 bis ≤ 32
D o m a i n e d e l ' i n d i c e
80
■ Qualité de la vie dans l’agriculture suisse
1.3 Ecologie
En produisant des denrées alimentaires, l’agriculture répond à un besoin vital de l’être humain Cette production va de pair avec des interventions dans le milieu naturel La contribution de l’agriculture à l’aménagement du paysage, à la conservation et à l’enrichissement de l’espace vital ainsi qu’à la sauvegarde du paysage rural est perçue comme étant positive, contrairement aux effets tels que la pollution de l’environnement par des émissions nocives, la raréfaction des espèces ou l’appauvrissement des milieux naturels
Pour mesurer l’évolution de ces impacts environnementaux sous l’angle du développement durable, divers outils sont disponibles Parmi ceux-ci, deux ont été retenus, à savoir une palette d’indicateurs agro-environnementaux et une méthode simplifiée pour évaluer l’impact environnemental de l’agriculture suisse. Ces deux instruments sont en voie d’élaboration et font l’objet d’améliorationset de perfectionnements constants La présente partie du rapport donne des informations à leur sujet, présente en détail le domaine de la diversité biologique et renseigne sur une étude consacrée à l’evaluation des effets externes de l’agriculture suisse

■■■■■■■■■■■■■■■■
1 . 3 E C O L O G I E 1 81
1.3.1 Indicateurs agro-environnementaux

Les impacts de l’activité agricole sur l’environnement, le bien-être des animaux et la gestion durable des ressources naturelles peuvent être mesurés à l’aide d’indicateurs, qui fournissent des informations aux décideurs et aux milieux intéressés et les aident à mieux comprendre les interactions de l’agriculture et de l’environnement Ces indicateurs permettent en outre d’apprécier l’efficience des mesures servant à encourager une agriculture respectueuse de l’environnement Ils doivent être faciles à comprendre et à communiquer, pertinents, analytiquement corrects, mesurables et comparables au niveau international Afin de répondre au principe du développement durable, ils doivent en priorité permettre de mieux saisir les problèmes de portée globale ou régionale qui exercent une influence à long terme S’y ajoutent cependant quelques facteurs applicables à des problèmes locaux ou dont les effets sont de courte durée
Les indicateurs environnementaux sont nombreux. Sur le plan international, c ’est notamment l’OCDE qui s ’ occupe de cette question Parmi le grand nombre d’indicateurs disponibles, une sélection a été effectuée en fonction des critères précités Ont notamment été retenus certains indicateurs agro-environnementaux de l’OCDE qui sont particulièrement pertinents pour la Suisse ainsi que d’autres permettant de répondre plus spécifiquement à la problématique nationale Divers experts scientifiques, les milieux concernés et les offices fédéraux membres du Comité interdépartemental de Rio ont été consultés sur la sélection des indicateurs
1 . 3 E C O L O G I E 1 ■■■■■■■■■■■■■■■■
Dimension spatiotemporelle des problèmes environnementaux local Toxicité pour l'homme Formation de photooxydants Ecotoxicité Acidification Biodiversité Gaz à effet de serre Destruction de la couche d'ozone régionalglobal Espace T e m p s ( a n s ) Erosion 1 1 000 100 10 82
Les indicateurs agro-environnementaux découlent de critères qui décrivent les rapports multiples entre l’homme et l’environnement et ne sauraient être analysés séparément en raison de la complexité de ces corrélations Pour plus de clarté, ils ont été résumés et répartis en six groupes:
processus agricoles: l’azote (N), l’énergie et le phosphore (P) sont le «moteur» de la production agricole
caractéristiques des pratiques agricoles: les agriculteurs utilisent des matières auxiliaires pour produire
ressources abiotiques: la production agricole exerce un impact sur l’eau, le sol, l’air et le climat
ressources biotiques: l’agriculture influe sur la diversité biologique
comportement environnemental: le comportement social et les habitudes de consommation exercent une influence sur l’agriculture
comportement envers les animaux: l’attitude des consommateurs et des agriculteurs envers les animaux de rente est analysée, le bien-être des animaux étant
1 . 3 E C O L O G I E 1 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E
pris en compte Critères applicables au système «homme-environnement» Climat, air Sols Relief Eaux Flore, Faune Environnement/ nature Alimentation, santé Economie, travail Délassement, loisirs Transports, mobilité Urbanisation, habitation Homme Engrais Produits phytosanitaires Aliments pour animaux Machines 2 Climat, Air, Eaux, Fertilité du sol 3 Biodiversité agricole Habitat pour espèces sauvages Paysage 4 Comportement envers l'environnement 5 Comportement envers les animaux 6 Azote Energie Phosphore 1 Agriculture Mode d'utilisation du sol Domaines 1 2 3 4 5 6 83
On distingue deux types d’indicateurs:

– les indicateurs principaux permettent une évaluation globale dégageant des tendances. Ces indicateurs s ’adressent plus spécifiquement aux décideurs politiques et aux milieux concernés
– les indicateurs complémentaires permettent une analyse plus fine destinée à glaner des informations complémentaires et à confirmer ou à relativiser la tendance des indicateurs principaux Ils s ’adressent plus particulièrement aux spécialistes
Les indicateurs doivent être considérés comme un ensemble préliminaire intégré, et il convient d’user de prudence dans l’interprétation des tendances Les indicateurs retenus ne doivent pas être considérés comme des valeurs statiques. Ils évoluent en fonction des nouveaux acquis et technologies, des attentes de la société et des jalons posés par les milieux politiques Une certaine constance doit cependant être maintenue pour la comparabilité entre les années et l’observation des tendances.
1 . 3 E C O L O G I E 1
84
Récapitulation des indicateurs agro-environnementaux sélectionnés
et bien-être des animaux
dans des systèmes de garde animaux
1 Indicateurs retenus pour le Rapport agricole 2000
Légende:
En caractères gras: indicateurs principaux En écriture normale: indicateurs complémentaires
✐ indicateurs à développer ou à préciser
■ méthodes ou données disponibles
1 . 3 E C O L O G I E 1
Groupes Domaines Indicateurs Méthode Données RA2000 1 chiffrées Azote Bilan d’azote agricole ■■■ Processus Part agricole dans impact national ■✐ agricoles Efficience azote agricole ✐■ Comparaison internationale ■■■ Risque environn global et par exploitation ■■■ Energie Consommation et production énergétique ■■■ Part agricole dans impact national ✐✐ Efficience énergétique ✐✐ Comparaison internationale ✐✐ Phosphore Bilan de phosphore ■■■ Engrais Azote et phosphore dans les engrais ■■■ Caractéristiques Unités de gros bétail Suisse ■■■ des pratiques Unités de gros bétail par régions ■■■ agricoles Produits phytosanitaires Risque lié aux pesticides ✐✐ (consommation) Ventes de produits phytosanitaires ■■■ Comparaison internationale ■■■ Aliments pour animaux Importation et production d’aliments pour animaux ■■ Energie Energie fossile ■■ Climat Emissions de gaz à effet de serre Ressources d’origine agricole ■■■ abiotiques Part agricole dans impact national ■■■ Comparaison internationale ■■■ Emissions de méthane par kg de lait ■■■ Air ✐✐✐ Eaux Teneurs et impacts nitrates, phosphore et pesticides d’origine agricole ✐✐ Part agricole dans impact national ■✐ Sols Teneurs et impacts des pesticides ✐✐ Erosion, tassement ✐✐ Part agricole dans impact national ✐✐ Biodiversité agricole Races et variétés utilisées ■■■ Ressources Espèces sauvages dépendant de l’agriculture ■✐ biotiques Habitats Compensation écologique, au total ■■ Compensation écologique par zone ■■■ Compensation écol par type d’exploitation ■✐ Paysage ✐✐✐ Société ✐✐✐ Comportement Consommateurs ✐✐✐ envers Marché biologique ✐✐ l’environnement Pesticides et nitrates dans
■✐ Agriculteurs ✐✐✐ Surface bio ou
■■■ Bio / PI international ■■■ Formation,
✐✐
Marché
✐✐ Comportement Agriculteurs ✐✐✐ envers
Animaux
respectueux
■■■
✐✐✐
les aliments
prestations écolog requises
vulgarisation
Société
les
de l’espèce
Bien-être des animaux
1 2 4 5 6 3 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E 85
■ Bilan d’azote: toujours moins d’azote d’origine agricole dans l’environnement
Le premier rapport agricole se limite aux résultats d’indicateurs, pour lesquels on dispose de données à l’échelle nationale Ces données n’étant cependant pas toutes disponibles dans la même mesure, il est impossible de donner des résultats se référant tous à une même période. On note les lacunes les plus importantes dans les domaines de l’air, de l’eau, du sol et des paysages Les domaines les mieux pourvus en informations sont les processus agricoles et les caractéristiques des pratiques agricoles Des recherches supplémentaires s’imposent pour les indicateurs à cheval entre l’environnement et les aspects sociaux (comportement envers l’environnement) et entre l’environnement et l’économie L’intégration des domaines manquants, une description plus précise des méthodes et une meilleure qualité et disponibilité des données devraient contribuer à améliorer sans cesse la valeur informative des indicateurs retenus
Processus agricoles

L’agriculture suisse produit environ 60% de l’énergie alimentaire consommée dans le pays et quelque 75% de la consommation de protéines L’azote est un constituant important de ces dernières et représente, avec l’énergie et le phosphore, un élémentclé de l’environnement et, partant, du cycle agriculture-alimentation
Le bilan azoté est calculé selon la méthode «bilan azoté à la surface du sol» utilisée par l'OCDE. Il mesure la différence entre les quantités totales d’éléments azotés apportés au sol (engrais chimiques, engrais à base de déchets et engrais de ferme, fixation biologique, dépositions atmosphériques) et les quantités d’éléments azotés quittant le sol (produits de la culture des champs et de la culture fourragère tels que l’herbe, le foin et les céréales)
1 . 3 E C O L O G I E 1
Evolution du bilan azoté 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 1 N e n t Source: OFS 1 chiffres provisoires Input total Output total Bilan 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 86
■ En Suisse, l’excédent d’azote par ha correspond à la moyenne européenne
L’excédent d’azote a diminué de 25% depuis 1985. Les apports n ’ont cessé de reculer, alors que les sorties sont restées à peu près au même niveau Aujourd’hui, les agriculteurs utilisent l’azote de manière bien plus efficiente qu’il y a une dizaine d’années
La moitié de la quantité totale d’azote est appliquée sous forme d’engrais de ferme, un quart sous forme d’engrais minéraux Le solde se compose des dépositions atmosphériques et de la fixation de l’azote par les légumineuses 80% des exportations d’azote sont liées à la production d’herbe et de foin et 20% à d’autres cultures
L’apport d’azote sous forme d’engrais de ferme a diminué régulièrement depuis 1985, soit de 20'000 t au total Dès 1992, les agriculteurs ont aussi utilisé nettement moins d’engrais minéraux. Leur quantité a diminué de 12'000 t entre 1992 et 1998. Dès 1992 toujours, les exportations d’azote par la production d’herbe et de foin ont fortement reculé Cette évolution a eu lieu parallèlement à l’extension de la SAU exploitée sous la forme de prairies extensives ou peu intensives.
La méthode décrite ci-dessus pour calculer le bilan azoté à la surface du sol a été utilisée par tous les pays de l’OCDE dans les années 1985 à 1997
Pour la plupart des pays, la tendance de l’excédent d’azote est à la baisse, bien que les chiffres nationaux masquent des disparités régionales Contrairement à la Suisse, la plupart des pays de l’OCDE, dont ceux de l’UE, indiquent les engrais minéraux comme étant la principale source d’azote Les exportations d’azote ont évolué de la même manière dans l’UE et en Suisse Alors qu ’elles diminuent pour ce qui est des fourrages, elles augmentent légèrement en ce qui concerne la culture des champs
S’agissant de la réduction des excédents d’azote, la Suisse se place dans un des rangs supérieurs En ce qui concerne les excédents mêmes, ceux-ci correspondent à la moyenne de l’UE
1 . 3 E C O L O G I E 1
Source: OCDE Canada USA Nouv.- Zélande Japon France UE Pays-Bas Autriche Suisse Italie Allemagne 6 25 5 145 59 69 314 35 80 45 88 13 31 6 135 53 58 262 27 60 31 61 117 24 20 -7 -10 -16 -17 -23 -25 -31 -31
Evolution du bilan azoté de plusieurs pays de l'OCDE
-50050100150 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E 87
Variation en pour-cent de 1985–87 à 1995–97kg N/ha de SAU 1985–871995–97
■ Pertes d’azote se répercutant sur l’environnement de 17% depuis 1990
Les pertes d’azote d’origine agricole se répercutant sur l’environnement comprennent les émissions d’ammoniac dans les étables, pendant l’entreposage des engrais de ferme et sur les champs (au total près de la moitié des pertes globales), la lixiviation de nitrates (plus d’un tiers) ainsi que les émissions de gaz hilarants en provenance des sols Il existe des modélisations pour chacun de ces processus Les résultats concernant quelque 260 exploitations comptables représentatives ont été extrapolés au secteur de l’agriculture La méthode utilisée pour calculer les pertes azotées se répercutant sur l’environnement est différente de celle appliquée pour le bilan d’azote; les résultats ne sont donc pas comparables
Evolution des pertes potentielles d’azote
Les pertes d’azote d’origine agricole se répercutant sur l’environnement ont diminué au total de 17% entre 1990 et 1998 Selon la zone, elles ont connu une évolution très différente entre 1994 et 1998 Dans la région de plaine, ces pertes ont reculé de 13%, alors qu ’elles augmentaient en même temps de 6% dans la région de montagne Ces écarts s ’expliquent par l’accroissement du cheptel en montagne et sa baisse en plaine. L’utilisation d’engrais minéraux a également diminué, surtout en plaine En raison du volume de production plus important, les pertes d’azote totales se répercutant sur l’environnement y ont néanmoins été plus élevées, en 1998, que dans la région de montagne (60'000 contre 29'000 t)
1 . 3 E C O L O G I E 1
Evolution des pertes de N influant sur l'environnement 199019941998 N e n 1 0 0 0 t Sources: OFAG pour 1990; IER-EPF pour 1994 et 1998 0 120 100 80 60 40 20 107 95,9 88,9 Evolution des pertes potentielles de N par type d'exloitation dans la zone de plaine Grandes culturesCultures fourragères CombinéesExploitations spécialisées production animale N e n k g / h a Pertes potentielles 1994 Pertes potentielles1998 Source: IER-EPF 0 250 200 150 100 50 88
■
Le potentiel de pertes d’azote désigne la quantité d’azote qui, théoriquement, pourrait s’échapper dans la nature Il englobe la somme des pertes azotées à l’étable ou lors du stockage des engrais et de leur épandage, ainsi que l’azote ayant pénétré dans le sol mais n ’ayant pas été absorbé par les plantes. Entre 1994 et 1998, le potentiel de pertes azotées a suivi une évolution différente selon le type d’exploitation
Par rapport à 1994, le potentiel de pertes azotées des exploitations spécialisées dans la production animale et des exploitations de grandes cultures a fortement diminué en 1998, surtout parce qu ’elles ont utilisé toujours moins d’engrais Les exploitations spécialisées dans la production animale présentent néanmoins le potentiel de pertes azotées le plus élevé aussi bien en 1994 qu ’ en 1998 Dans les autres exploitations consacrées à la garde d’animaux, ce potentiel a également été plus élevé que dans les exploitations de grandes cultures La part des engrais de ferme – qui produisent plus de pertes que les engrais minéraux – à l’utilisation totale d’engrais azotés y est en effet plus élevée. Quant aux exploitations pratiquant la culture herbagère et aux exploitations combinées, on ne constate aucune amélioration, de 1994 à 1998, en ce qui concerne le potentiel de pertes azotées
■ Consommation d’énergie stable depuis 1990 Evolution de
On considère aussi bien l’évolution de la consommation d’énergie par l’agriculture que celle de l’énergie contenue dans les produits agricoles
De 1970 à 1990, la consommation d’énergie a augmenté pour se stabiliser au cours des années nonante. En même temps, on a constaté une augmentation de plus de 20% de l’énergie alimentaire contenue dans les produits agricoles Pendant la période précitée, la progression de la consommation d’énergie de l’agriculture a néanmoins été plus rapide, une partie de la main-d’oeuvre et des animaux de trait ayant été remplacée par des machines, véhicules et autres auxiliaires techniques Une comparaison entre l’énergie utilisée dans la production et celle contenue dans les produits agricoles met en évidence que la situation s ’est équilibrée depuis 1990

1 . 3 E C O L O G I E 1
l'énergie
produits
T e r a j o u l e Energie à des fins de production Energie dans produits agricoles
l'énergie utilisé et de
dans les
agricoles 197019801985199019951998
0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E 89
Source: D.Rossier
■ Bilan de phosphore: forte baisse des excédents
Pour établir le bilan de phosphore, on considère l’agriculture suisse comme une seule exploitation L’apport comprend les aliments pour animaux importés, les engrais minéraux et les engrais à base de déchets, les semences importées et les dépositions atmosphériques. Les sorties englobent les denrées alimentaires végétales et animales ainsi que d’autres produits fournis par l’agriculture
■ Utilisation d’engrais minéraux en forte
De 1990/92 à 1998, les excédents de phosphore ont reculé de quelque 20'000 tonnes à 9'000 tonnes Cette tendance résulte à la fois de la diminution des apports, notamment sous la forme d’engrais minéraux et d’importations d’aliments pour animaux, et de l’augmentation des exportations de phosphore
Pratiques agricoles
Ce domaine comprend des indicateurs permettant de saisir l’utilisation de matières auxiliaires de l’agriculture (engrais, pesticides, aliments pour animaux et énergie) On ne peut toutefois en tirer que des conclusions indirectes concernant l’impact environnemental Il faut donc en plus procéder à des analyses de risques et à des observations sur le terrain
Dans l’agriculture suisse, les éléments fertilisants sont en premier lieu fournis aux cultures sous la forme d’engrais de ferme. Des engrais minéraux et des engrais à base de déchets sont utilisés en complément Les engrais minéraux font l’objet d’une statistique établie depuis de nombreuses années
Il en ressort que depuis le début des années nonante, l’utilisation totale d’engrais minéraux azotés et phosphatés a sensiblement diminué Alors que celle d’engrais phosphatés a été réduite de moitié depuis 1950, le recul est moins prononcé pour ce qui est des engrais azotés, dont l’utilisation correspond environ à celle des années septante.
1 . 3 E C O L O G I E 1
1990–92199319941995199619971998 P e n t
Evolution du bilan de phosphore
Total apports Bilan Total exportations 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000
Source: FAL
90
baisse
Une valeur standard permettant d’évaluer la quantité d’engrais de ferme a été établie en fonction de l’espèce animale et du poids des animaux, à savoir l’unité de gros bétail-fumure (UGBF) Celle-ci équivaut à 35 kg de phosphore et à 105 kg d’azote que produit en moyenne une vache par an
Depuis 1990, le nombre total d’animaux de rente, exprimé en UGBF, a nettement reculé en Suisse, soit de 140'000 unités ou de presque 10%

1 . 3 E C O L O G I E 1 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E
Evolution de la consommation d'engrais minéraux 1946195019561960196619701976198019861999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1990 N Source: USP P 0 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 e n t 10 000 ■ Diminution des engrais de ferme grâce à la réduction du cheptel Evolution du cheptel U G B F 1 e n 1 0 0 0 Source: OFS 1 unité de gros bétail-fumure 1990199419961998 0 1 600 1 200 800 400 1443 1376 1336 1303 91
■ Baisse dans les régions à forte charge en bétail
Les données cantonales concernant la charge en bétail sont agrégées en fonction de la charge par ha, les cantons présentant des charges semblables étant regroupés
Evolution du cheptel groupé en fonction de la charge en bétail
■ Produits phytosanitaires: baisse des ventes de 30% depuis 1990
En Suisse, le nombre d’animaux varie énormément selon les régions La Suisse centrale et orientale présente une densité supérieure à la moyenne, tandis que la Suisse romande, en raison de la prédominance de la culture des champs, et les régions de montagne, compte tenu de la production réduite de fourrages grossiers, gardent moins d’animaux par ha. Les autres cantons du Plateau se situent dans la moyenne. La charge en bétail a surtout diminué dans les régions à forte densité en bétail
Les données concernant les produits phytosanitaires sont tirées de la statistique y relative et ventilées selon les groupes de biocides.
Evolution des ventes de produits phytosanitaires
Source: Société suisse de l'industrie chimique
De 1990 à 1998, la quantité de produits phytosanitaires vendue a reculé d’environ 31%, passant de 2'300 t à 1'600 t de substances actives. En ce qui concerne les deux groupes de substances appliquées le plus fréquemment, les fongicides et les herbicides, on a enregistré une baisse de 25% pendant cette période Quant aux régulateurs de croissance, leur utilisation a même diminué de 77%.
1 . 3 E C O L O G I E 1
GE, NE, VDBL, BS, SH, JU FR, BE, SO, AG, ZH LU, SZ, UR, NW, OW, GL, ZG
U G B F 1 / h a
TG, SG, AI, AR GR, TI, VS
1 unité de gros bétail-fumure 1990 1994 19961998 0,0 2,0 1,2 1,4 1,6 1,8 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2
Source: OFS
e n %
Fongicides, bactéricides et produits de traitement des semences Herbicides Insecticides Régulateurs de croissance Total 19901992199419961998 0 120 100 80 60 40 20 92
■ Pesticides dans l’OCDE

Les pays membres de l’OCDE saisissent des données sur l’utilisation et les ventes de pesticides, en termes de quantité de substances actives Cela permet de faire des comparaisons internationales, mais il convient d’être prudent, car les conditions pédoclimatiques ou culturales sont souvent très différentes entre les pays. Les méthodes de saisie des données ne sont par ailleurs pas entièrement harmonisées
Evolution
de l'utilisation de pesticides dans plusieurs pays membres de l'OCDE
Source: OCDE
Dans la plupart des pays de l’OCDE, la tendance pendant la dernière décennie est à la stagnation ou au déclin de l’utilisation de pesticides La Suisse ne fait pas partie des pays ayant enregistré le plus fort recul, mais elle se situe dans la moyenne de l’UE
1 . 3 E C O L O G I E 1 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E
Nouvelle-Zélande France Etats-Unis Japon Canada UE Suisse Autriche Pays-Bas Suède 3 690 96 897 377 577 97 672 35 370 333 804 2 456 5 670 20 241 3 885 3 752 97 229 373 115 84 850 29 206 253 684 1 832 3 552 10 553 1 454 1 0 -1 -13 -17 -24 -25 -37 -48 -62
Remarques: données UE sans Allemagne et Portugal. Données suisses indiquées sous 85–87 concernent 1988. Données 95–97 sont 91–93 pour USA et 94 pour Canada.
Variation en pour-cent de 1985–87 à 1995–97Substances actives en t 1985–871995–97
93
-60-50-40-30-20-1001020
■ Emissions de gaz à effet de serre: l’agriculture contribue davantage à la réduction que les autres pollueurs
Ressources abiotiques (climat, air, eau, sol)

L’activité agricole peut entraîner une charge chimique ou physique des ressources abiotiques : nitrates et pesticides dans l’eau, eutrophisation de l’eau et des sols ou émissions de gaz à effet de serre En revanche, les surfaces agricoles utiles peuvent aussi avoir un effet tampon et améliorer la qualité de l’environnement D’autre part, la détérioration des ressources abiotiques par des émissions extra-agricoles peut avoir des répercussions négatives sur l’agriculture
Il est actuellement difficile d’agréger, au niveau national, les données concernant les émissions agricoles dans l’eau, dans l’air et dans les sols ainsi que celles sur l’érosion, en raison de problèmes méthodologiques ou de l’absence de données. C’est pourquoi nous y avons renoncé dans le premier rapport agricole Par contre, des données de qualité existent sur les émissions de gaz à effet de serre
En ce qui concerne le climat, les gaz à effet de serre sont classés en fonction des quatre sources principales: transports, industrie et artisanat, agriculture et sylviculture ainsi que ménages De 1980 à 1995, on a saisi à l’échelon national les émissions de polluants de l’air effectivement occasionnées par l’homme, pour passer ensuite aux pronostics dès 1995 Les calculs se réfèrent aux émissions des trois gaz à effet de serre les plus fréquents dans l’agriculture, à savoir le CO2, le méthane et le gaz hilarant, les deux derniers étant convertis en équivalents CO2.
1 . 3 E C O L O G I E 1
94
Evolution des émissions de gaz à effet de serre: total Suisse et agriculture et économie forestière
■ Gaz à effet de serre d’origine agricole: recul en Suisse plus prononcé qu ’ en moyenne de l’UE
Depuis le début des années quatre-vingt, les émissions contribuant à l’effet de serre sont en baisse, tant celles occasionnées par la société dans son ensemble que celles provenant de l’agriculture La part de l’agriculture au total de ces émissions a diminué de 3%, passant de 21% (1980) à 18% (pronostic 2000) Le méthane et le gaz hilarant constituent la majeure partie des émissions d’origine agricole. Ces gaz proviennent avant tout de la production animale Les progrès enregistrés dans l’agriculture s ’expliquent par la réduction du cheptel, par le choix délibéré de techniques de stockage et d’épandage des engrais de ferme permettant de limiter au minimum les émissions, ainsi que par la sensibilisation des agriculteurs à l’importance d’épandre le lisier et le fumier au moment optimal
Des données concernant les émissions de gaz à effet de serre sont disponibles dans tous les pays de l’OCDE Une certaine prudence s’impose toutefois lors de comparaisons, car leurs définitions ne sont pas toujours identiques
Evolution des émissions de gaz à effet de serre d'origne agricole dans différents pays de l'OCDE de 1990/92 à 1995/97 en %
OCDE
1 . 3 E C O L O G I E 1 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E
1980198519902000 1995 e n t Total Suisse Agriculture et économie forestière
0 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000
Source: OFEFP
Source:
Canada Etats-Unis Pays-Bas Italie Autriche Nouvelle-Zélande UE France Suisse Japon Allemagne 7 4 1 12 1 -1 -2 -3 -6 -6 -8 -10-5051015 95
Emissions de méthane: 26% de moins par kg de lait qu ’ en 1980
La part des émissions de gaz à effet de serre d’origine agricole est modeste dans la plupart des pays de l’OCDE Ces émissions ont par ailleurs tendance à baisser depuis le début des années nonante, surtout grâce à la diminution du cheptel
L’énergie contenue dans les produits agricoles a légèrement augmenté au fil des années, alors que l’on observe, depuis 1980, une baisse des émissions de gaz d’origine agricole se répercutant sur le climat (en équivalents CO2) A titre d’exemple de cette efficience accrue, nous présentons les émissions de méthane par kg de lait produit, étroitement liées à la garde d’animaux,
L’effectif de vaches n ’ a cessé de diminuer depuis 1980, tandis qu ’ en même temps, la performance par vache s ’est constamment accrue Pendant cette période, les émissions de méthane ont diminué de 50'000 t pour s’établir à 225'000 t par an en raison de la baisse des effectifs d’animaux Le rapport entre émissions de méthane et production laitière s ’est donc amélioré, si bien que, aujourd’hui, ces émissions par kg de lait sont de 26% inférieures à celles de 1980.

1 . 3 E C O L O G I E 1
Evolution des émissions de méthane dans la production laitière I n d i c e ( 1 9 9 0 = 1 0 0 ) Sources: OFAG, OFEFP 1980198519902000 1995 0 140 120 100 80 60 40 20 96
■
Ressources biotiques
Les indicateurs pour les ressources biotiques (faune, flore) sont divisés en trois catégories: biodiversité agricole (races d’animaux de rente et variétés de plantes utiles enregistrées; espèces sauvages dépendant de l’agriculture); habitats semi-naturels dans l’agriculture (équivalant à la compensation écologique) et paysage Aucun indicateur du paysage n ’est actuellement disponible au niveau national
En Suisse, le cheptel se compose de diverses races d’animaux de rente enregistrées; on y cultive aussi diverses variétés de plantes
1 . 3 E C O L O G I E 1 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E
variétés de
Evolution des inscriptions de races d'animaux de rente au herd-book PorcsBovins N o m b r e d e r a c e s Source: OFAG 1985 1990 1995 1998 0 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 Evolution des inscriptions de variétés de plantes cultivées Pommes de terreCéréales N o m b r e d e v a r i é t é s Source: OFAG 1985 1990 1995 1998 0 35 30 25 20 15 10 5 97
■ Races d’animaux de rente et
plantes
■ Quelques races seulement sont utilisées
Depuis 1985, le nombre de races d’animaux de rente et de variétés de plantes homologuées ou utilisées augmente, surtout depuis 1995
Evolution de la part des principales races d'animaux de rente et de variétés de plantes utiles à la production totale
■ Augmentation marquante des surfaces de compensation écologique
Cependant, l’utilisation de ces ressources génétiques varie fortement d’un secteur à l’autre Deux races porcines et trois races bovines composent près de 100% du cheptel suisse Cette concentration, bien que plus faible, est également importante dans la production végétale, en particulier céréalière.
Par surfaces de compensation écologique (SCE), on entend les prairies extensives et peu intensives, les prairies extensives aménagées sur des terres assolées gelées, les surfaces à litière, les haies, les bosquets champêtres, les berges boisées, les jachères florales et tournantes, les bandes culturales extensives et les arbres fruitiers haute-tige
1 . 3 E C O L O G I E 1
Porcs (2)Bovins (3)Pommes de terre (5)Céréales (5) e n % Source: OFAG 1985 1990 1995 1998 0 100 80 60 40 20
Evolution des surfaces de compensation écologique1 e n 1 0 0 0 d ' h a Source: OFAG 1 sans les arbres fruitiers haute-tige 19921993199419951996199719981999 0 20 40 60 80 100 98
Evolution de la part de surfaces de compensation écologique
Entre 1993 et 1999, les SCE ont passé d’environ 50’000 ha à près de 90’000 ha Au total, elles représentaient, en 1999, 8,3% de la SAU Leur part à la SAU est nettement plus élevée dans les zones de montagne III et IV que dans les régions plus basses

1 . 3 E C O L O G I E 1 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E
e n % d e l a S A U
Source: OFAG 1 Zones de grandes cultures à zone des collines
ABZ – HZ1 BZ I – BZ IIBZ III – BZ IV 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
0
25 20 15 10 5 99
■ En six ans, les surfaces exploitées de manière respectueuse de l’environnement ont quintuplé
Comportement envers l’environnement (sensibilité écologique)
On développe, à l’heure actuelle, des indicateurs permettant de définir la sensibilité écologique des agriculteurs, des milieux agricoles et des consommateurs, le but étant de déterminer si les produits issus de modes de production particulièrement respectueux de l’environnement répondent à une demande réelle Comme ces indicateurs ne sont pas encore disponibles, nous nous sommes fondés sur la participation des agriculteurs aux programmes agro-environnementaux, qui sert également d’indicateur du risque environnemental global
Sur le plan national, on considère comme respectueux de l’environnement les modes d’exploitation répondant aux prestations écologiques requises (PER) Depuis 1999, tous les agriculteurs souhaitant toucher des paiements directs doivent fournir ces prestations, et cela dans toute l’exploitation Sur le plan international, on parle plutôt de plans de gestion environnementaux globaux
Les paiements directs destinés à rétribuer les prestations écologiques, instaurés en 1993, ont beaucoup contribué à la promotion des modes d’exploitation respectueux de l’environnement Alors que leur part à la surface totale n’était encore que de 18,4% à ce moment-là, elle a atteint 95,3% dans l’année sous revue En 1993, la culture biologique était pratiquée sur 1,8% de la surface totale; dans l’année sous revue, cette part a passé à 7,3%.

1 . 3 E C O L O G I E 1
Evolution de
l'environnement e n % d e l a S A U exploitation respectueuse de l'environnement dont bio Source: OFAG 1993199419951999 19971998 1996 0 100 60 80 40 20 1 1993 à 1998: PI+bio, dès 1999: PER 100
la part de surfaces affectées à une exploitation respectueuse de
■ Production biologique: la Suisse dans le peloton de tête
L’agriculture biologique est relativement bien définie au niveau international, ce qui permet quelques comparaisons entre pays
■ Production respectueuse de l’environnement dans l’ensemble de l’exploitation: la Suisse en tête
La surface cultivée selon les méthodes biologiques a augmenté considérablement dans les pays de l'OCDE au cours des dix dernières années. Dans l’UE, elle représente aujourd’hui presque 2% de la SAU Au plan international, la Suisse fait partie du peloton de tête en ce qui concerne la part de surfaces agricoles exploitées biologiquement.
L’harmonisation des principes régissant les plans de gestion environnementaux globaux qui ne se fondent pas sur les règles de la culture biologique est en cours au niveau international. Les pays membres de l’OCDE s ’entendent sur une définition correspondant dans les grandes lignes aux PER suisses
Parmi les pays ayant fourni des données, la Suisse compte la plus grande proportion d’exploitations suivant un plan de gestion environnemental global.
1 . 3 E C O L O G I E 1 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E
l'OCDE G r a n d eB r e t a g n e F r a n c e B e l g i q u e E s p a g n e R é p t c h é q u e P a y sB a s A l l e m a g n e I t a l i e S u i s s e S u è d e A u t r i c h e Début années nonante Moitié/fin années nonante Source: OCDE 0 12 10 8 6 4 2 e n % d e l a S A U
e n % d e l a S A U 19931997 Source:
1 pas d'indications pour l'Autriche en 1993 0 90 80 70 60 50 40 30 20 10 101
Evolution de la part de la culture biologique dans différents pays de
Evolution
de la part de surfaces affectées à une exploitation respectueuse de l'environnement (sans culture biologique) dans
différents
pays ItalieJaponSuèdeAutriche1 Suisse
OCDE
■ Programmes SRPA et
forte croissance du taux de participation
Comportement envers les animaux
La garde d’animaux de rente particulièrement respectueuse de l’espèce fait l’objet des deux programmes «sorties régulières en plein air» (SRPA) et «systèmes de stabulation particulièrement respectueux de l’espèce» (SST) Dans le premier rapport agricole, la participation aux programmes est utilisée pour évaluer le comportement des agriculteurs envers les animaux
Le programme SRPA définit les exigences à remplir en matière de sorties, de pâturages, de parcours et de stabulation des animaux (p ex aménagement de l’aire de repos)
Le programme SST porte sur des exigences complémentaires concernant l’étable et la garde des animaux: p ex systèmes de stabulation offrant diverses zones adaptées aux différentes activités des animaux
Le nombre d’UGB incluses dans ces programmes est en constante augmentation
La participation au programme SRPA est toutefois plus élevée. En effet, l’observation du programme SST est plus difficile, car des mesures de construction importantes sont parfois nécessaires pour s ’ y conformer
1 . 3 E C O L O G I E 1
SST:
P a r t s d ' U G B e n % SRPASST Sources: OFAG, OFS 1993199419951999 19971998 1996 0 40 50 35 30 25 20 15 10 5 102
Evolution de la participation aux programmes SRPA et SST
■ Taux de participation ventilé selon les zones
Les parts d’UGB se réfèrent au nombre total d’UGB détenues dans la zone en question.
Parts d'UGB aux programmes SRPA et SST, par zone en 1998
Comme il est plus difficile de réaliser les mesures de construction dans la région de montagne en raison de la topographie et des modes de production en résultant, le nombre d’UGB inclus dans le programme SST y est plus faible En revanche, la part d’UGB inscrites dans le programme SRPA y est plus élevée

1 . 3 E C O L O G I E 1
P a r t s d ' U G B e n % SRPASST Source: OFAG 0 45 40 35 30 25 20 15 10 5 Z o n e d e g r a n d e s c u l t u r e s Z o n e i n t e rm é d a i r e é l a r g i e Z o n e i n t e rm é d i a i r e Z o n e d e s c o l i n e s Z o n e d e m o n t a g n e I Z o n e d e m o n t a g n e I I Z o n e d e m o n t a g n e I I I Z o n e d e m o n t a g n e I V 103
1.3.2 Evaluation de l’impact environnemental de l’agriculture suisse
Dans le cadre d’une étude, à laquelle ont participé la Station fédérale de recherches en économie et technologie agricoles, Tänikon (FAT), la Station fédérale de recherches en écologie et agriculture, Zurich-Reckenholz (FAL), le Service romand de vulgarisation agricole, Lausanne (SRVA), la Centrale de vulgarisation agricole de Lindau (LBL) et l’Institut de recherche en agriculture biologique, Frick (IRAB), on a procédé à une évaluation simplifiée de l’impact environnemental potentiel de l’agriculture suisse (Rossier) Le but est d’évaluer de manière simplifiée l’impact potentiel de l’agriculture suisse sur l’environnement non vivant (ressources, climat, air, sol et eau), à partir des données statistiques nationales disponibles et au moyen d’une méthode basée, dans la mesure du possible, sur celle du bilan écologique selon la norme ISO 14040
Nous présentons, ci-après, la méthode utilisée et les premiers résultats de l’étude Ceux-ci doivent être interprétés avec précaution Une prudence toute particulière est requise pour les résultats antérieurs à 1990, car ils ont souvent été obtenus par extrapolation, notamment en ce qui concerne les émissions En revanche, la méthode appliquée a permis de faire des constats utiles, et il s ’est avéré qu ’elle se prête à un monitoring environnemental annuel du secteur agricole
La méthode d’évaluation choisie suit le cycle de vie des substances utilisées dans toutes les phases d’un système de production et analyse l’impact des émissions engendrées Les flux de substances sont enregistrés à partir de l’extraction des matières premières jusqu’à l’élimination des déchets Toutes les émissions ayant des effets sur l’environnement sont prises en considération. L’étude se concentre toutefois sur les impacts actuellement considérés comme particulièrement nuisibles à l’environnement au plan international L’aspect global de la méthode permet une analyse complète d’un système de production et évite les transferts de pollution d’un secteur de production à un autre Cependant, les aspects fertilité du sol, diversité biologique, habitats seminaturels et paysage ne peuvent pas encore être pris en compte
On considère le système agricole suisse comme une unité utilisant des intrants, produisant des denrées alimentaires et occasionnant des émissions Les premiers travaux consistent à saisir les données de production et à établir l’inventaire des émissions et des flux énergétiques Les données statistiques étant incomplètes pour les années 1970 à 1990, il a fallu procéder à des extrapolations à partir de données plus récentes. Il en est de même des facteurs d’émission
Pour huit catégories environnementales, on a calculé l’impact des émissions, établi l’inventaire des flux d’énergie et de substances et analysé leurs effets sur l’environnement

1 . 3 E C O L O G I E 1 ■■■■■■■■■■■■■■■■
104
■ L’approche de l’évaluation globale
■ Les effets négatifs sur l’environnement diminuent
L’impact environnemental de l’agriculture suisse peut être globalement analysé en fonction de la surface agricole exploitée Il est aussi possible d’analyser les résultats en fonction de l’énergie alimentaire produite pour tenir compte de l’efficience de la production agricole. Les mêmes tendances se dessinent.
Impacts environnementaux par unité d'énergie alimentaire produite
Ressources énergétiques non renouvelables
L’utilisation de ressources énergétiques non renouvelables a augmenté jusqu’en 1990 pour tendre ensuite vers une stabilisation Cela prouve que la gestion de ces ressources s ’améliore
Effet de serre
D’une manière générale, la contribution de l’agriculture à l’effet de serre a augmenté jusqu’en 1980 et diminué depuis lors Son évolution est notamment liée à la diminution du bétail bovin et porcin, ainsi qu’à la réduction des engrais minéraux azotés à partir de 1990
Formation d‘ozone
La contribution de l’agriculture suisse à la formation d’ozone s ’est stabilisée depuis 1980 Les émissions d’oxyde d’azote et de composés organiques volatils, dont la principale source est la combustion d’énergies fossiles, contribuent à plus de 90% à la formation d’ozone d’origine agricole
Acidification des sols
L’impact de l’agriculture sur l’acidification des sols a régulièrement diminué depuis 1980, surtout grâce à une baisse de près de 20% des émissions d’ammoniac dans l’air.
1 . 3 E C O L O G I E 1 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E
R e s s o u r c e s é n e r g é t q u e s n o n r e n o u v e l a b l e s E f f e t d e s e r r e F o r m a t i o n d ' o z o n e A c i d f i c a t i o n ( s o s ) E u t r o p h i s a t o n g l o b a l e T o x i c t é p o u r l ' h o m m e T o x i c t é t e r r e s t r e T o x c t é a q u a t i q u e
1970 1980 19901998 0 120 80 100 60 40 20 I n d i c e ( 1 9 8 0 = 1 0 0 ) 105
Source: Rossier
■ Perspectives
Eutrophisation totale
Depuis 1980, les effets de l’agriculture sur l’eutrophisation totale (émissions d’azote et de phosphore additionnées) sont en baisse Les principales émissions sont celles de nitrates dans l’eau et d’ammoniac dans l’air, qui représentent une part de 45% chacune
Toxicité pour l’homme
La méthode utilisée a permis de constater que depuis 1980, la charge relative aux métaux lourds et aux nitrates a diminué
Ecotoxicité terrestre
Les résultats actuels indiquent une diminution nette et régulière de la charge de sols depuis 1980 Cette amélioration s ’explique, entre autres, par la diminution considérable des teneurs en métaux lourds des boues d’épuration utilisées par l’agriculture, mais aussi par la forte diminution des apports d’engrais phosphatés. Les métaux lourds apportés au sol déterminent l’impact de l’agriculture suisse sur l’écotoxicité terrestre Celui du zinc est largement prédominant La méthode de caractérisation utilisée, qui donne plus de poids aux métaux lourds qu ’ aux composés organiques, doit encore être affinée
Ecotoxicité aquatique

L’impact de l’agriculture suisse sur l’écotoxicité aquatique n ’ a cessé de diminuer depuis 1980 en grande partie pour les raisons invoquées en rapport avec l’écotoxicité terrestre Les mêmes réserves d’ordre méthodologique doivent être faites
Dans le cadre de l’étude, on a tenté d’évaluer les effets de l’agriculture sur l’environnement par une méthode simple, laquelle permet aussi de faire le point de la situation chaque année Les résultats donnent une image simple et relativement facile à communiquer Il conviendra toutefois de développer et de perfectionner la méthode A l’avenir, l’évaluation devra aussi pouvoir se faire par type d’exploitation, par produit agricole ou par région On entend par ailleurs intégrer à l’analyse d’autres aspects tels que fertilité du sol, biodiversité et paysage
1 . 3 E C O L O G I E 1
106
■ Projet de recherche sur la diversité du paysage et des espèces
1.3.3 Biodiversité – produit de l’agriculture
En vertu de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique que la Suisse a ratifiée en 1994, notre politique agricole a été conçue, de façon à donner des incitations à la préservation, à la promotion et à l’utilisation durable de la biodiversité L’exploitation des surfaces agricoles utiles a ainsi évolué dans le sens de la convention précitée Celle-ci porte sur la préservation, la promotion et l’utilisation durable dans les trois domaines suivants: – diversité des systèmes écologiques; – diversité des espèces; – diversité génétique.
Les trois domaines sont traités ci-dessous pour montrer comment l’agriculture contribue à la préservation, à la promotion et à l’utilisation durable de la biodiversité.
La Station fédérale de recherches en agroécologie et agriculture (FAL) étudie, dans trois régions qui se distinguent des points de vue du paysage et de l’agriculture, les effets des surfaces de compensation écologique (SCE) sur la biodiversité. Sont également associés au projet de recherche la Station fédérale de recherches agronomiques de Changins (RAC), l’Institut de recherche en agriculture biologique (IRAB), le Service romand de vulgarisation agricole (SRVA) et la Station ornithologique suisse. Les trois régions faisant l’objet de l’étude sont les suivantes: Rafzerfeld dans le canton de Zurich – région de grandes cultures; Combremont/Nuvilly (VD / FR) – région de grandes cultures et de culture fourragère; Ruswil/Buttisholz (LU) – région de culture fourragère L’étude porte sur le paysage, les SCE, la végétation, ainsi que sur les papillons diurnes, carabidés, araignées et oiseaux.
■ Effet positif de la compensation écologique sur la diversité du paysage
Les trois régions sélectionnées se distinguent en ce qui concerne l’altitude, le relief et le climat, facteurs qui déterminent l’exploitation agricole La région de Rafzerfeld est la plus chaude et la plus plate; celle de Combremont/Nuvilly est située à plus haute altitude, avec des étés un peu plus frais et un relief plus accidenté Ruswil/Buttisholz est la région la plus haute et la plus humide; elle présente un relief de collines
Le paysage de Rafzerfeld est marqué non seulement par l’exploitation agricole, mais aussi par les villages, routes et gravières Ces éléments manquent dans les autres régions ou n ’ y prennent que peu de place.
1 . 3 E C O L O G I E 1 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E ■■■■■■■■■■■■■■■■
107
Région de l'étude de cas Rafzerfeld
Région de l'étude de cas Combremont / Nuvilly
Région de l'étude de cas Ruswil / Buttisholz
Mètre
Grandes cultures Prairie artificielle Prarie naturelle/pâturage
Culture spéciale Verger d'arbres fruitiers haute-tige Surfaces de compensation écologique
Forêt 108
Source: FAL
1 . 3 E C O L O G I E 1
0500 5001000
Bosquet, lisière, talus Gravière, artisanat Routes, localité, loisirs
Grâce aux incitations données par la politique agricole depuis 1993, les SCE ont augmenté dans toute la Suisse Les résultats sont présentés pour les régions de Rafzerfeld et de Ruswil/Buttisholz
Ruswil / Buttisholz: part des SCE à la SAU
Rafzerfeld: part des SCE à la SAU

Il ressort des études que la compensation écologique permet de préserver et de créer des éléments semi-naturels
Si l’on exclut les arbres fruitiers haute-tige, les prairies représentent la plus grande part dans les trois régions, à Combremont/Nuvilly surtout les prairies extensives aménagées sur des terres assolées gelées Dans la région de Rafzerfeld, la plupart des haies sont de nouvelles plantations effectuées en vue de la compensation écologique Seules les régions de Combremont/Nuvilly et Ruswil/Buttisholz comptent des arbres fruitiers haute-tige. En revanche, on ne trouve des jachères florales que dans celle de Rafzerfeld, où elles bénéficient d’une promotion spéciale
1 . 3 E C O L O G I E 1 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E
e n % AHT 1 Haies PPI 2 PESTAG 3 PE 4
FAL 1 arbres fruitiers haute-tige (1 arbre = 1 are) 2 prairies peu intensives 3 prairies extensives aménagées sur des terres assolées gelées 4 prairies extensives 19971999 1 0 6 5 4 3 2
Source:
e n % JF 1 Haies PPI 2 PESTAG 3 PE 4
FAL 1 jachères florales 2 prairies peu intensives 3 prairies extensives aménagées sur des terres assolées gelées 4 prairies extensives 19971999 0,5 0 3,5 3,0 2,5 1,5 2,0 1,0 109
Source:
Quel effet les SCE ont-elles sur la diversité des espèces? Nous disposons de résultats concernant deux des régions examinées A Ruswil/Buttisholz, on a observé 16 espèces de papillons diurnes en 1998, dont aucune n ’est menacée d’extinction en Suisse 84% des individus observés appartiennent aux espèces de piéridés les plus fréquentes et les plus répandues dans notre pays La prédominance des piéridés et le faible nombre d’espèces sont typiques des régions à exploitation agricole intensive
L’observation de quatre espèces vivant normalement sur des prairies, pâturages et bords de champs extensifs – le macaon, l’azuré de la bugrane, l’aurore et le petit nacré –permet de conclure que les SCE ont déjà un certain effet

Dans la région de grandes cultures de Rafzerfeld, 22 espèces de papillons diurnes ont été recensées Les trois mêmes piéridés qu’à Ruswil/Buttisholz y prédominent également avec une part de près de 70% Le plus grand nombre d’espèces a été observé le long des haies. La petite tortue et le macaon ont été trouvés à 75% dans les jachères florales
A Ruswil/Buttisholz, on a capturé 135 espèces d’araignées et 127 au Rafzerfeld
Les mêmes types de prairies contenaient toujours environ le même nombre d’espèces Par contre, la composition des diverses espèces varie selon les types de prairies. Ainsi, les prairies intensives hébergent surtout des espèces d’araignées vivant exclusivement dans des habitats non boisés alors que sur les prairies extensives, on trouve aussi des espèces pouvant vivre dans des habitats boisés. S’agissant des araignées vivant au sol, on n ’ a pas constaté de différence entre la faune des jachères florales et celle des cultures principales qui les entourent La composition des espèces d’araignées des prairies diffère de celle des champs de blé d’automne
1 . 3 E C O L O G I E 1
110
■ Préservation et promotion de la diversité des espèces spécifique aux régions
■ Diversité génétique
Les divers types de SCE influent donc différemment sur les groupes d’animaux:
les jachères florales sont une source de nourriture importante pour les papillons diurnes;
les papillons diurnes se dirigent plus souvent vers les prairies extensives que vers les prairies intensives; – sur les prairies extensives, on trouve aussi des espèces d’araignées pouvant vivre dans les bois ou dans les lisières de forêt Ces espèces ne sont pas observées sur les prairies intensives
Ces quelques exemples illustrent les multiples effets exercés par les SCE sur la biodiversité
La qualité botanique des SCE joue un rôle important, de même que les liens entre ces dernières Une prairie à haute qualité botanique offre un habitat à de nombreuses espèces végétales qui, à leur tour, représentent une base d’existence pour de nombreuses espèces animales (insectes, oiseaux) Or, la diversité botanique des SCE est menacée si ces dernières sont isolées et que l’échange génétique indispensable est entravé C’est pourquoi il est souhaitable de créer des réseaux de SCE Un réseau approprié permet aussi aux lièvres ou aux perdrix de survivre, car ils trouvent les corridors dont ils ont besoin.
Chaque région présente un potentiel d’espèces spécifiques, en fonction des conditions topographiques et climatiques. Pour promouvoir la qualité botanique des SCE adaptée à la région et assurer la création de réseaux, des programmes régionaux sont nécessaires La Confédération, quant à elle, a pour tâche de créer les conditions pour que les surfaces nécessaires à l’aménagement de SCE soient mises à disposition A cet effet, il est prévu de mettre en vigueur, en 2001, une conception de régionalisation donnant à la Confédération la possibilité de soutenir financièrement des projets régionaux destinés à une promotion ciblée de la diversité du paysage et des espèces
Un plan d’action global a été élaboré sur la base de la Convention sur la diversité biologique En se réferant à ce plan global, l’OFAG a établi un plan d’action national pour la conservation et l'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture Dans notre pays comme ailleurs, les anciennes espèces de plantes cultivées et d’animaux de rente sont de moins en moins utilisées et donc menacées d’extinction A défaut de mesures de préservation adéquates, on risque ainsi de perdre une grande partie des bases de la production agricole que représentent la diversité génétique et les connaissances spécifiques de la population paysanne. En collaboration avec les organisations et services concernés, on a donc déterminé les principales mesures pour la période de 1999 à 2002 en accordant la priorité aux tâches mentionnées ci-après.
Domaine végétal:
– établissement d’inventaires;
– programmes destinés à la conservation de variétés de fruits;
– réalisation de programmes de conservation et d’utilisation sur le terrain;
– programmes de régénération du matériel des banques de gènes
1 . 3 E C O L O G I E 1 1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E
–
–
111
Domaine animal:
programmes destinés à la conservation de races d’animaux de rente suisses menacées d’extinction;
création d’une banque de données concernant les races d’animaux de rente menacées d’extinction
Pour les seules ressources phytogénétiques, on compte en Suisse quelque 17'000 variétés, populations et lignes, qui sont activement conservées dans des banques de gènes ou sur le terrain Les banques de gènes sont gérées par les stations de recherches agronomiques, mais aussi par des institutions et sélectionneurs privés Les particuliers et les organisations peuvent présenter des projets dans le cadre du plan d’action international et demander l’aide de la Confédération. Celle-ci accorde actuellement des contributions à 13 projets portant sur les ressources phytogénétiques et à 3 projets concernant les races d’animaux Les efforts consentis en matière de diversité génétique complètent les travaux effectués dans les domaines de la diversité des espèces et du paysage

1 . 3 E C O L O G I E 1
–
–
112
■ Méthodologie
1.3.4 Effets externes de l’agriculture suisse
Dans une étude effectuée sur mandat de l’OFAG, on a procédé à une appréciation quantitative des externalités de l’agriculture suisse (Pillet, Maradan, Zingg; ECOSYS SA) Le mandat consistait à évaluer les fonctions écologiques et sociales de l’agriculture
Cette étude est une première tentative d’étendre les comptes économiques de l’agriculture aux biens non marchands et aux prestations de service Il s ’agit d’un domaine pour lequel, à ce jour, il n ’ a pas été fait d’évaluations scientifiques dans un sens aussi large Les résultats doivent être interprétés en conséquence
Les auteurs de l’étude se sont penchés sur trois types d’externalités:
Les effets externes au sens classique du terme, c ’est-à-dire les effets hors marché de l’agriculture sur l’environnement, tels que l’entretien du paysage, la pollution de l’air et l’érosion du sol
– Les externalités sociales, par exemple la contribution de l’agriculture à la sauvegarde des villages et des coutumes ainsi qu’à la sécurité alimentaire, ont été analysées
Les «emternalités» finalement, à savoir les intrants environnementaux non marchands utilisés par l’agriculture, tels que l’énergie solaire et la pluie
Analyse économique des effets externes
En d’autres termes, les externalités désignent, d’une part, des avantages dont les individus jouissent (air pur, eau potable, etc ), mais ne rémunèrent pas et, d’autre part, des inconvénients (bruit, fumée, salissures, trafic, etc.) pour lesquels ils ne sont pas dédommagés
Etant donné que les effets externes entraînent des modifications de bien-être chez certains individus sans pour autant donner lieu à une compensation (parce que des marchés manquent), leur évaluation procède de méthodes dont le but est de suppléer aux marchés manquants Elles reposent sur des comportements observés sur des marchés vrais ou hypothétiques et permettent de quantifier la dimension non marchande des activités de production par le biais du consentement à payer, du consentement à accepter, des prix hédoniques ou encore du coût de trajet
1 . 3 E C O L O G I E 1 113 ■■■■■■■■■■■■■■■■
–
–
1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E
Méthodes d’évaluation
Marché réel
Sondages directs Sondages indirects
■ Utilité pour les consommateurs
■ Méthode des prix du marché et consentement à payer
■ Méthode des frais de déplacement
Marché hypothétique
■ Coûts de réparation,
■ Méthode des dépenses préventives coûts de prévention
■ Relation entre charge et effet (dose respond method)
■ Taux d’évaluation (consentement
■ Attribution de dépenses à payer, demande d’indemnités) et de revenus probables
■ Classement de différentes alternatives (contingent ranking method)
Sources: Hoevenhagel (1991), Pillet (1993)
Les effets externes de l’agriculture ont été quantifiés à l’aide d’études suisses et étrangères
Les bénéfices externes (liés aux préférences individuelles) ont été estimés par le transfert des valeurs trouvées dans la littérature suisse et étrangère Cette démarche a demandé l’élaboration d’un protocole de transfert permettant de tenir compte des caractéristiques de l’agriculture suisse
– Les coûts externes ont été calculés par l’intermédiaire des coûts de pollution et de réparation.
Exemples de valeurs utilisées pour l’évaluation des bénéfices et des coûts externes de l’agriculture
Domaines Valeurs originales Sources
Bénéfices paysage 14 DM / ménage / mois Consentement à payer en Allemagne pour la «préservation du paysage»
récréation 7 ECU / ménage / an Méthode du coût de trajet estimant la valeur de la récréation en Italie avec la méthode du coût du trajet protection du sol 25 fr / ha / an Dépenses en CH pour maintenir la fertilité du sol
diversité des 35 fr / personne / mois Consentement à payer pour préservation de la biodiversité dans espèces les montagnes jurassiennes
Coûts pollution par les 12 fr / kg N
Coûts d’équipement des stations nitrates d’épuration des eaux pour la dénitrification
phosphates 4 fr / kg P
Coût de l’utilisation de produits chimiques pour précipiter le P dans les Stations d’épuration des eaux
Source: Pillet, Maradan, Zingg
1 . 3 E C O L O G I E 1 114
–
■ Les bénéfices nets se montent à 2 milliards de francs
Dans cette étude, on admet que jusqu’en 2008, l’agriculture n ’ aura plus guère d’effets négatifs sur les bases naturelles de l’existence et le climat Il ne s ’agit pas là d’une charge environnementale zéro, mais d’une judicieuse limitation écologique et économique de ladite charge. L’hypothèse qu ’ une telle situation prévaudra jusqu’en 2008 est fondée sur les développements qui se sont produits depuis l’adoption des programmes environnementaux (cf ch 1 3 1)
Effets externes de l’agriculture suisse 2008
Coûts et bénéfices externes
Bénéfices Coûts mio de fr mio de fr prestations d’intérêt public
1 120,5coûts (pollution, réparation)
naturel
-
bénéfices nets
Externalités sociétales
2 067,4 -
Source: Pillet, Maradan, Zingg
Les externalités sociétales reposent sur un fondement normatif; les normes et les valeurs sociales représentent les valeurs collectives de la communauté. Elles vont au-delà de la définition économique des effets externes et établissent la contribution positive ou négative de l’agriculture à la réalisation des normes et des valeurs sociales (par exemple, la contribution de l’agriculture à la conservation des traditions, à la sécurité de l’approvisionnement, etc )

Exemples d’externalités sociétales
Effets de l’agriculture sur… Désignation structures sociales conservation des villages coutumes, traditions locales structures spatiales occupation décentralisée du territoire équilibre entre zones rurales et urbaines valeurs sociales contribution à la sécurité de l’approvisionnement conservation des méthodes de travail traditionnelles
Source: Pillet Maradan Zingg
La dimension sociale des externalités de l’agriculture découle du fait que la société exprime ses valeurs collectives par le biais des normes sociales Il convient de se demander dès lors si l’agriculture remplit effectivement les fonctions et les rôles que la société lui a attribués par le biais de ces normes, c ’est-à-dire si elle contribue réellement à une occupation décentralisée du territoire Evaluer les externalités sociétales de l’agriculture revient par conséquent à mesurer les divergences et les convergences entre l’évolution de l’agriculture et le respect des valeurs de la collectivité
1 . 3 E C O L O G I E 1 115
patrimoine
climat,
910,3
santé, risques 36,6
1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E
L’agriculture contribue aux objectifs normatifs pour ce qui a trait aux structures sociales et spatiales; son apport a tendance à s ’affaiblir La contribution de l’agriculture aux valeurs et aux choix sociétaux est positive
Les emternalités peuvent être considérées comme la contre-partie des effets externes Elles désignent la contribution de l’environnement aux activités productives L’utilisation du préfixe «em-» souligne le caractère entrant des emternalités L’évaluation des emternalités constitue une étape importante de l’étude étant donné l’importance du travail de la nature dans le secteur agricole et la pression que les activités de ce secteur exercent sur l’environnement Les emternalités sont tout d’abord appréciées en termes physiques, c ’est-à-dire en unités énergétiques, et également comparées au plan international.
Intrants de l’agriculture
Intrants environnementaux Intrants marchands Renouvelables Non renouvelables soleil, pluie, pertes du sol électricité, lubrifiant, diesel, essence, cycle terrestre travail, fertilisants, pesticides, machines, semences, alim fourragers industriels et fourrages grossiers
Source: Pillet, Maradan, Zingg
Afin d’en évaluer les emternalités, les intrants de l’agriculture suisse ont été classifiés selon leur origine marchande ou environnementale (renouvelable ou non)
Il ressort de l’analyse que, dans l’agriculture suisse, les intrants non renouvelables ne jouent qu ’ un rôle mineur. Ces derniers doivent être considérés plutôt négativement car leur utilisation implique des conséquences environnementales non désirables Le rapport entre intrants environnementaux et intrants marchands est 1 : 4 Cela signifie que l’agriculture utilise 20% d’intrants environnementaux sous forme par exemple d’énergie solaire ou de pluie En comparaison internationale, l’agriculture suisse est bien placée, car elle utilise davantage d’emternalités renouvelables que non renouvelables
1 . 3 E C O L O G I E 1 116
■ Emternalités de l’agriculture suisse
■■■■■■■■■■■■■■■■ 1.4 Appréciation de la durabilité
Le premier rapport agricole met l’accent sur l’établissement d’indicateurs pour les trois dimensions que constituent l’économie, le social et l’écologie Il jette ainsi la base permettant d’observer les répercussions ultérieures de la politique agricole Ces indicateurs seront complétés et développés ces prochaines années dans les domaines du social et de l’écologie Des travaux parallèles devront permettre une évaluation des résultats sous l’angle de la durabilité, à l’aide d’un concept simple L’évaluation de la durabilité se fera par des énoncés de nature qualitative
■ Economie
D’une manière générale, on peut qualifier la situation économique de stable L’introduction de la Politique agricole 2002 n ’ a pas entraîné de turbulences sur les marchés La transition sur le marché du lait s ’est faite sans heurts, et le prix du lait a dépassé en 1999 le prix-cible de 77 ct par kilo de lait fixé par le Conseil fédéral La branche de la transformation a amorcé un processus de restructuration et d’adaptation
Les revenus par exploitation en 1999 équivalent pratiquement à la moyenne des années 1996/98. A l’échelon du secteur (production finale, revenu sectoriel), les valeurs médiocres résultent, d’une part, des faibles récoltes dans la production végétale en raison des conditions météorologiques défavorables; d’autre part, la production finale a tendance à régresser en raison de la baisse des prix depuis le début de la réforme agricole
Dans les conditions générales actuelles, les agriculteurs qui optent pour des modes de production durables et qui sont économiquement performants sont en mesure de réaliser un revenu comparable à celui du reste de la population.
■ Aspects sociaux
Les données de base permettant d’apprécier de la situation sociale de l’agriculture sont peu nombreuses Cette appréciation n ’ a pas encore pu être analysée d’une façon systématique Un groupe de travail institué par l’OFAG a recueilli des iniformations sur la sécurité sociale et le recours aux services sociaux dans l’agriculture Son rapport a été publié en juin 2000 L’EPF de Zurich est en train d’élaborer, sur mandat de l’OFAG, le concept d’un suivi de la situation sociale à l’aide d’indicateurs adéquats Un premier rapport intermédiaire est disponible
Il ressort du premier rapport agricole que les agriculteurs sollicitent moins les services sociaux que le reste de la population Mis à part les réticences spontanées et les particularités des exploitations paysannes, les conditions-cadre fixées par l’Etat pourraient bien, elles aussi, être en cause. L’évolution structurelle se fait encore et toujours lors d’un changement de générations essentiellement
La situation concernant les revenus et l’endettement est restée stable ces dernières années en moyenne de toutes les exploitations Mais le niveau du revenu moyen est passablement plus bas que le revenu moyen des autres groupes de la population Il existe par ailleurs des écarts substantiels entre les exploitations qui enregistrent les meilleurs et les moins bons résultats
1 . 4 A P P R É C I A T I O N D E L A D U R A B I L I T É 1 117
1 R Ô L E E T S I T U A T I O N D E L ’ A G R I C U L T U R E
■ Ecologie
La stratégie d’incitation par le biais des paiements directs et les efforts consentis sur les plans de la formation, de la recherche et de la vulgarisation font effet Les prestations écologiques de l’agriculture se sont multipliées et le recours à des substances nocives pour l’environnement a diminué. Les données de base fiables sont toutefois encore trop peu nombreuses pour que l’on puisse vérifier l’impact de ces développements favorables sur la qualité du sol ou de l’eau, sur le bien-être des animaux ou sur la diversité des espèces En effet, les corrélations sont complexes dans le domaine écologique, et les causes et les effets ne peuvent pas toujours être clairement identifiés; en outre, il faut souvent des années pour constater des effets positifs
Les problèmes environnementaux liés à la production agricole ont souvent un caractère régional ou local. On relèvera, par exemple, les atteintes à la nappe phréatique dues à l’agriculture dans les aires d'alimentation des captages d'eau Ce problème a donc été abordé sous l’angle régional Il en est de même des réseaux et de la qualité des surfaces de compensation écologique. Si l’on tentait de résoudre à l’échelon national les difficultés de nature régionale ou locale, la densité normative ne manquerait pas d’augmenter Or le seuil critique est d’ores et déjà atteint
L’introduction de la Politique agricole 2002 n ’ a pas engendré de problèmes notoires au cours de l’année sous revue Les estimations pour l’an 2000 annoncent une bonne année agricole Il n ’ en reste par moins que l’avenir sera toujours plus porteur d’un conflit d’intérêts entre le développement du revenu agricole et la nécessité d’améliorer la compétitivité afin que l’agriculture puisse conserver ses parts de marché, soit sa fonction productive L’accord agricole bilatéral avec l’UE ouvre des débouchés aux produits de l’agriculture suisse Pour que cette chance puisse être saisie, ces derniers doivent soutenir la concurrence avec les produits européens Le prix joue en l’occurrence un rôle important. Même les produits de haute qualité devront avoir un prix compétitif et s ’affirmer sur un marché plus ouvert
La possibilité de compenser une baisse des prix par des paiements directs se heurte à certaines limites, car les moyens financiers disponibles à cette fin ne sont pas illimités et il convient de rester raisonnable Le montant investi actuellement dans les paiements directs équivaut à peu près au bénéfice retiré de l’agriculture par la collectivité et pour lequel il n ’existe pas de rétribution sur le marché On s ’attend par ailleurs à voir grimper le salaire comparable plus fortement qu ’ au cours des dernières années Les exploitations agricoles doivent s ’adapter si elles entendent suivre l’évolution générale en matière de revenus Un nombre croissant d’entre elles pourraient se retrouver privées de toute possibilité de développement dans l’agriculture. Les contraintes d’ajustement resteront donc fortes ces prochaines années D’une part, les mesures de politique agricole devraient être conçues de façon à permettre aux exploitations qui sont aptes à se développer et souhaitent le faire de s’imposer sur le marché. D’autre part, il convient de prévoir des mesures d’accompagnement social pour que les processus d’adaptation soient socialement supportables et que les exploitations sans avenir dans l’agriculture puissent disposer de solutions de rechange Enfin, les mesures écologiques doivent être consolidées pour que les objectifs visés puissent être atteints
118 1 . 4 A P P R É C I A T I O N D E L A D U R A B I L I T É 1
■ Appréciation globale

■■■■■■■■■■■■■■■■ 2. Mesures de politique agricole 119 2
La loi sur l’agriculture du 29 avril 1998 contient des réglementations destinées à concrétiser l’art 104 constitutionnel de 1996 Suite à l’adoption de la nouvelle loi sur l’agriculture et de ses ordonnances, on a mis en oeuvre la réforme de la politique agricole, connue sous la désignation «Politique agricole 2002». La «Politique agricole 2002» a permis d’élaguer notablement la densité législative Le nombre des articles de loi a été réduit de plus de moitié Pour ce qui a trait aux marchés, bon nombre de prescriptions détaillées ont été abrogées, notamment les interventions étatiques directes sur le marché par les garanties de prix et de débouchés En outre, les organisations semi-étatiques «Union suisse du commerce de fromage» et «BUTYRA» ont été dissoutes
En décembre 1998, le Conseil fédéral a adopté 37 nouvelles ordonnances pour mettre en oeuvre la loi sur l’agriculture Simultanément, 99 textes légaux de l’ancienne législation étaient abrogés On constate donc que, au niveau des ordonnances aussi, on a fortement simplifié. De plus, la nouvelle législation a apporté des allégements considérables sur le plan des procédures et des autorisations Dans le domaine du marché notamment, nombreuses sont les tâches qui ont été déléguées aux intéressés directs
Les mesures de politique agricole peuvent être classées dans les trois domaines suivants:
– Production et vente: les mesures prises dans ce domaine visent à créer de bonnes conditions-cadre pour la production et le placement de denrées alimentaires. La loi prévoit que, cinq ans après son entrée en vigueur, les dépenses de la Confédération affectées à la production et au placement devront avoir été réduites d’un tiers par rapport à celles de 1998 En 2003, ce ne seront plus que quelque 800 millions qui pourront être consacrés à ces mesures
– Paiements directs: ces paiements sont considérés comme une rétribution de l’agriculture pour ses prestations en faveur de la collectivité, au rang desquelles figurent l’entretien du paysage, la sauvegarde des bases naturelles de l’existence, la contribution pour une occupation décentralisée du territoire ainsi que des prestations écologiques particulières Les prix payés pour les denrées alimentaires ne comprennent pas ces prestations car, pour elles, il n ’ y a pas de marché Par le biais des paiements directs, l’Etat s ’ assure le concours de l’agriculture pour fournir ces prestations d’intérêt général
– Amélioration des bases de production: ces mesures permettent à la Confédération de promouvoir et de soutenir une production de denrées alimentaires respectueuse de l’environnement, sûre et efficiente Ces mesures concernent l’amélioration des structures, le domaine de la recherche et de la vulgarisation, les matières auxiliaires et la protection des végétaux et des variétés
Le Parlement a approuvé en juin de l’année sous rapport un arrêté fédéral sur les moyens financiers destinés à l’agriculture pour les années 2000 à 2003 Il a accordé trois enveloppes financières pour les domaines de mesures susmentionnés, qui représentent environ 85% des dépenses affectées à l’agriculture et à l’alimentation Ces enveloppes financières totalisent quelque 3,5 milliards de francs par an Les dépenses de la Confédération pour l’agriculture se stabilisent donc au niveau de 1996/97.
120 2 . M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E 2
2.1 Production et ventes
Les mesures dans le domaine de la production et des ventes créent les conditionscadre permettant à l’agriculture suisse de maintenir ses parts de marché dans des conditions de concurrence plus âpres Les moyens financiers affectés à la promotion de la production et des ventes concourent à ce que l’agriculture retire les recettes les plus élevées possible de la vente des produits Ces mesures favorisent la fonction productive de l’agriculture, le principe de subsidiarité jouant en l’occurrence un rôle porteur Les mesures d’entraide interprofessionnelle revêtent une importance primordiale pour résoudre les problèmes La Confédération limite à un minimum ses interventions directes en matière de fonctionnement du marché, encourageant ainsi l’innovation et l’esprit d’entreprise, éléments décisifs pour maintenir les parts de marché

2 . 1 P R O D U C T I O N E T V E N T E S 121
■■■■■■■■■■■■■■■■
2
■
En 1999, quelque 1,3 milliard de francs ont été consacrés au soutien de la production et des ventes Ces dépenses, supérieures de 5,8% à celles de l’année précédente, sont dues pour la plus grande part aux frais extraordinaires uniques entraînés par la liquidation de l’Union suisse du commerce du fromage SA et de la Butyra, organisations semi-étatiques
Dépenses pour la production et les ventes en 1999

Source: Compte d’Etat
■ Perspectives Les dispositions transitoires de la LAgr exigent la réduction des dépenses dans le domaine de la production et des ventes. Dans les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi, la somme des contributions fédérales destinées aux domaines qu ’elle mentionne (art 187, al 12) devra être réduite d’un tiers par rapport aux dépenses de 1998. Durant la période 1999 –2003, le soutien du marché doit être ramené à quelque 800 millions de francs Quant aux moyens financiers destinés à la promotion des ventes, ils doivent être maintenus à un niveau constant, car cet instrument joue un rôle majeur dans un marché davantage libéralisé
Le temps dont nous disposons est trop court pour que nous puissions nous prononcer définitivement sur l’efficacité des mesures de politique agricole dans le domaine de la production et des ventes La LAgr prévoit (art 187, al 13) que, au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la nouvelle LAgr, il conviendra d’examiner les effets des mesures de politique agricole prises dans les différents domaines Les instruments de soutien du marché seront également intégrés dans cette évaluation L’OFAG a commencé les travaux à cet effet On informera régulièrement, par l’intermédiaire du rapport agricole, sur les résultats et leurs conséquences possibles
2 . 1 P R O D U C T I O N E T V E N T E S 2 122
Domaine des dépenses Montant Part mio de fr % Promotion des ventes 50 3,8 Economie laitière 1052 79,8 Production animale 33 2,5 Production végétale (viticulture comprise) 183 13,9 Total 1318
100,0
Moyens financiers en 1999
■ L’Etat n’intervient pas directement sur le fonctionnement du marché
2.1.1 Instruments pluriels
Par instruments pluriels, on entend les mesures de politique agricole au moyen desquelles la Confédération contribue, tous domaines de production confondus, à l’obtention du revenu le plus élevé possible de la vente du produit Les réglementations touchent l’entraide, la qualité, la promotion des ventes, la désignation, l’importation ou l’exportation des produits, l’observation et l’allégement du marché
La caractéristique de ces mesures est que l’Etat n’intervient pas directement dans le fonctionnement du marché, à l’exception de l’allégement, auquel il ne procède que lors de circonstances exceptionnelles Il s ’agit en l’occurrence de conditions-cadre légales au sein desquelles les acteurs peuvent se mouvoir de leur propre initiative Il appartient avant tout aux milieux directement concernés de prendre des mesures dans les domaines concernés Une place importante est accordée à l’entraide L’Etat n’intervient qu’à titre subsidiaire
Organisations de producteurs et interprofessions
Selon les art 8 et 9 de la LAgr, le Conseil fédéral a la possibilité de soutenir les organisations de producteurs ou les interprofessions pour ce qui a trait aux mesures d’entraide C’est pourquoi, il peut étendre à tous les intéressés les mesures d’entraide internes que prend une branche pour promouvoir la qualité et les ventes ainsi que pour adapter la production et l’offre aux exigences du marché L’intervention étatique est soumise à différentes conditions L’organisation doit être en particulier représentative, et l’intervention sur le fonctionnement du marché nécessaire et proportionnée.
Au cours de l’année sous rapport, on a constaté une forte dynamique dans la création d’interprofessions. Divers travaux sont en cours, qui visent à la fois à adapter de manière prospective les structures des associations et à les orienter en fonction des instruments de la politique agricole servant à soutenir les mesures d’entraide Dans l’année sous rapport, aucune demande visant à conférer un caractère contraignant aux mesures d’entraide n ’ a été présentée
■ Perspectives
On peut prévoir que dès 2001, à l’instar des modèles étrangers, des décisions largement soutenues par des organisations de producteurs et des interprofessions, ayant pour objectif le financement des mesures d’entraide, seront déclarées contraignantes pour une période déterminée Ainsi, les potentiels resquilleurs voulant bénéficier des mesures sans cotiser seront pris dans le filet de la collecte de fonds. La modification dans ce sens de la LAgr constituait une partie des mesures d’accompagnement des Accords bilatéraux avec l’UE
2 . 1 P R O D U C T I O N E T V E N T E S 2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E 123 ■■■■■■■■■■■■■■■■
2
■ Moyens financiers en 1999
Promotion des ventes
Du fait de la libéralisation graduelle des organisations du marché, combinée avec l’ouverture progressive des marchés, le rôle du marketing professionnel prend de l’importance La Confédération soutient les mesures prometteuses de promotion des ventes Elle prend à sa charge au maximum 50% des dépenses imputables
Les mesures soutenues par la Confédération concernent en particulier la communication dans le cadre de la stratégie des ventes (notamment relations publiques, promotion des ventes, étude de marché) en Suisse et à l’étranger En ce qui concerne les projets, une coopération étroite entre les acteurs est exigée afin qu’ils se présentent groupés face à la concurrence étrangère. Conformément à la politique régionale de la Confédération (en particulier l’arrêté fédéral REGIO PLUS), il est prévu de soutenir des projets régionaux de promotion des ventes pendant quatre ans au plus Pour ces projets, la collaboration entre divers partenaires dans les secteurs agricoles ou non agricoles est une condition requise pour le soutien, afin que le potentiel d’une région soit mieux mis à profit
En 1999, deux innovations ont été introduites:
– tout d’abord, on a attribué le Prix d’innovation agricole, qui récompense l’esprit novateur dans l’agriculture suisse Ce prix, doté d’une somme de 100’000 francs, est organisé par l’Agro-Marketing Suisse; il récompense des innovations dans le domaine de l’agriculture et de l’alimentation. Le concours est placé sous le patronage du chef du DFE;

– ensuite, pour la première fois aussi, la Suisse s ’est présentée à la «Grüne Woche», à Berlin, la plus importante foire européenne de consommateurs dans le secteur agro-alimentaire La responsabilité de cette présentation a été assumée par l’Agro-Marketing Suisse, qui a bénéficié du soutien financier de la Confédération tel qu’il est prévu dans l’ordonnance sur l’aide à la promotion des ventes de produits agricoles
Dans le domaine de la promotion des ventes, 1999 a été une année de transition L’ordonnance a prévu une réglementation transitoire d’une année pour tenir compte des bénéficiaires dont les projets ont encore cours, par exemple, les producteurs de lait, de viande et de fruits Cependant, il a aussi été possible de soutenir de nouveaux projets dans l’année sous rapport On a ainsi assuré à la fois une transition optimale vers le nouveau droit et la continuité des projets déjà lancés
Dans l’année sous rapport, 45 millions de francs ont été mis à la disposition de projets nationaux tant en Suisse qu’à l’étranger 60% ont été affectés, sur la base des dispositions transitoires, à des projets en cours, et 40% ont été payés à de nouveaux destinataires d’aide financière Suite à la réorganisation du marché laitier au 1er mai
1999, 14 millions supplémentaires ont été affectés au fromage De plus, les 16 projets régionaux bénéficiant d’un soutien ont absorbé quelque 50% des 5 millions de francs budgétisés pour 1999
2 . 1 P R O D U C T I O N E T V E N T E S 2 124
■ Financements assurés pour l’an 2000
C’est en 1999 déjà qu ’ on s ’est prononcé sur les projets soumis pour l’an 2000. Les montants ont été alloués par l’OFAG au 30 septembre 1999 En l’an 2000, ce sont au total 61 projets, émanant de 31 requérants, qui ont été soutenus aux niveaux suprarégional et national, ainsi qu’à l’étranger.
Répartition des fonds entre les secteurs produit-marché en 2000
Fromage, à l'étranger
Fromage, en Suisse
Lait
Fruits
Viande
Légumes
Pommes de terre
Céréales
Oeufs
Oléagineux
Animaux vivants
Miel
Poissons
Mesures prises en commun
Pour répartir cette manne, on a créé des secteurs produits-marché qu ’ on a évalué par la méthode du portefeuille. L’OFAG a commandé une analyse en ce sens destinée à évaluer, au plan du marché, les attraits de chaque produit agricole ainsi que sa capacité concurrentielle La plus grande partie des moyens engagés par la Confédération est affectée au secteur du lait et des produits laitiers
■ Perspectives Comme il a été dit, une aide dans le domaine de la promotion des ventes est subordonnée à une coordination des mesures entre les bénéficiaires Dans plusieurs domaines, la coopération se développe d’une manière positive, les producteurs agissant plus souvent en commun, dans le pays, avec la référence «Pays producteur Suisse»
A l’étranger, c ’est particulièrement la «Switzerland Cheese Marketing SA» qui occupe l’avant de la scène dans l’intérêt commun des producteurs suisses de fromage sous la formule «Fromages de Suisse» Pour s’imposer sur un marché libéralisé, il importe de collaborer dans la promotion des ventes, afin que les instruments du marketing puissent développer une efficacité optimale
2 . 1 P R O D U C T I O N E T V E N T E S 2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E 125
Tableau 23 page A24 2
mio. de fr. 051015202530 Source: OFAG
■ Protection des désignations pour les produits agricoles
Désignation
La protection de certaines désignations de produits agricoles a pour objectif, d’une part de protéger efficacement les consommateurs contre la tromperie, d’autre part – dans l’intérêt de l’agriculture – d’empêcher la concurrence déloyale liée à l’utilisation de ces désignations La protection concerne les produits biologiques et les produits avec appellations d’origine contrôlée et indications géographiques protégées Les réglementations pertinentes se trouvent dans l’ordonnance sur l’agriculture biologique et dans l’ordonnance concernant la protection des appellations d’origine et des indications géographiques des produits agricoles Ces dispositions permettent aussi la reconnaissance réciproque de produits de qualité entre la Suisse et l’UE, ce qui garantit la protection de ces produits sur le marché européen, de même que leur accès audit marché Dans un premier temps, seuls les produits biologiques sont concernés
■ Les règles bio créent la transparence
L’ordonnance sur l’agriculture biologique, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1998, s ’est révélée être un instrument efficace pour améliorer la transparence sur le marché bio C’est significatif car, grâce notamment aux programmes de paiements directs étatiques, la production biologique a cessé au cours de ces dernières années de n’être qu ’ un créneau. 7,3% de la surface agricole est exploitée maintenant selon les principes de la culture biologique Les produits bio se sont imposés sur le marché, même chez les grands distributeurs L’ordonnance bio prévoit pour les produits végétaux biologiques importés l’équivalence avec les dispositions légales suisses. C’est très important, car une part considérable des produits biologiques consommés proviennent encore de l’étranger
Dès que la plupart des délais transitoires ont été échus, et grâce aussi à une bonne initiation en matière d’application, l’ordonnance bio a développé ses effets au plan de l’économie suisse On a déjà pu remédier à divers abus concernant la désignation «biologique» et améliorer efficacement la transparence quant aux exigences minimales et aux contrôles par rapport aux réglementations précédentes, purement de droit privé
L’efficacité de ladite ordonnance a cependant ses limites Du fait de la place dominante occupée par le label «Bourgeon» sur le marché suisse, la concurrence est faible à l’heure actuelle Signalons qu ’ un seul organe peut établir des certificats pour le «Bourgeon» L’ordonnance bio prévoit un régime de libre concurrence entre les différents organismes de certification L’expérience démontre que certains segments du marché, dans lesquels la concurrence ne joue pas ou trop peu, auront à moyen terme des problèmes d’adaptation
2 . 1 P R O D U C T I O N E T V E N T E S 2 126
■ Etablissement du registre des appellations d’origine protégées (AOP) et des indications géographiques de provenance (IGP)
Vu la progression de la procédure d’enregistrement des appellations d’origine protégées (AOP) et des indications géographiques protégées (IGP), on pense que d’ici à l’an 2000, tous les dossiers en suspens seront publiés Cet instrument de politique agricole ne déploiera cependant tous ses effets qu ’ une fois que les diverses appellations seront enregistrées et dès que les délais transitoires les concernant seront échus, c ’est-à-dire seulement dans environ trois à cinq ans
Un compte rendu exhaustif concernant les AOC et IGP figure dans le rapport d’activité 1998 de la Commission pour les appellations d’origine et les indications géographiques
■ Déclaration des stimulateurs de performances dans la production de viande ainsi que des œufs issus de l’élevage en batterie
Conformément à l’art 18 LAgr, le Conseil fédéral édicte des prescriptions concernant la déclaration des produits issus de modes de production interdits en Suisse et relève les droits de douane sur ces produits. Il doit agir dans le respect des obligations internationales
Le Conseil fédéral a approuvé l’ordonnance agricole sur la déclaration le 3 novembre 1999 Les produits à déclarer sont ceux pour lesquels des hormones et/ou des substances antimocrobiennes destinées à stimuler les performances ont été utilisées, de même que les œufs de consommation provenant d’élevages en batterie Ces méthodes de production sont interdites en Suisse Seuls doivent être déclarés la viande fraîche et les œufs de consommation, de même que les préparations à base de ces produits Pour des raisons d’efficacité au plan de l’exécution, on a renoncé à soumettre immédiatement à déclaration d’autres produits Une augmentation des droits de douane ne pouvait être envisagée, car une différenciation en fonction du mode de production serait contraire aux engagements pris dans le cadre de l’OMC et aux accords de libre-échange conclus par la Suisse.

Le concept de la législation sur les denrées alimentaires a servi de base à l’ordonnance agricole sur la déclaration. Il prévoit l’obligation pour les vendeurs de déclarer le mode de production interdit au point de vente final Ce principe s ’applique aussi bien au commerce de détail qu ’ aux établissements de restauration L’exécution incombe aux cantons En règle générale, ce sont les inspecteurs des denrées alimentaires qui sont chargés de cette tâche
L’ordonnance agricole sur la déclaration est entrée en vigueur le 1er janvier 2000 Les aides-mémoire publiés sur Internet donnent aux milieux concernés des recommandations pour une application pratique conforme. Par ailleurs, l’OFAG publie une liste des pays qui ont ordonné des interdictions équivalentes à celles promulguées en Suisse
2 . 1 P R O D U C T I O N E T V E N T E S 2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E 127
2
■ Perspectives
L’UE a reconnu l’équivalence de l’ordonnance suisse sur l’agriculture biologique avec les dispositions légales européennes en la matière La Suisse figure sur la liste des pays tiers de l’UE, c ’est-à-dire que les produits certifiés qui en proviennent peuvent en principe être commercialisés sans entraves dans l’UE. Cependant, ces dispositions ne s ’appliquent pour l’instant qu ’ aux produits végétaux
L’intégration de la garde d’animaux de rente dans le domaine d’application de l’ordonnance sur l’agriculture biologique est à l’étude L’entrée en vigueur de l’ordonnance révisée est prévue en 2001 Les ministres de l’agriculture de l’UE ont adopté en juin 1999 la réglementation européenne – attendue depuis longtemps – sur les systèmes de garde d’animaux compatibles avec l’agriculture biologique, document qui doit servir de base à la réglementation suisse. Selon l’accord agricole bilatéral conclu avec l’UE, un accord d’équivalence doit aussi être trouvé pour les produits animaux issus de l’agriculture biologique, ce qui assurerait, par exemple au fromage bio suisse, l’accès au marché européen.
Des adaptations sont également prévues au plan de l’exécution Le contrôle de l’équivalence des produits importés effectué par l’OFAG est considéré par la branche comme une complication Or, le simple contrôle des documents par l’OFAG prendrait lui aussi du temps. Il faut donc, à moyen terme, revoir la procédure avec en point de mire une simplification tenant compte des obligations étatiques
Notre but est d’instaurer un système eurocompatible destiné à protéger les AOP et les IGP L’UE a enregistré 600 indications géographiques Compte tenu à la fois des différences et des dimensions de notre pays, on escompte l’enregistrement de 40 AOP et IGP Les accords bilatéraux comprennent une déclaration d’intention prévoyant la reconnaissance réciproque des registres
Instruments du commerce extérieur
■ Les réglementations d’importation soutiennent une agriculture productive
Dans le cadre du cycle Uruguay du GATT/OMC, toutes les entraves au commerce non tarifaires des Etats membres ont été transformées en droits de douane par le biais de la tarification Les réglementations d’importation sont des conditions-cadre importantes pour le respect de ces engagements de politique économique extérieure et pour la production de denrées alimentaires suisses
La régulation des importations ne peut se faire que par des mesures tarifaires, c ’est-àdire par des droits de douane prélevés sur les produits importés. Il est possible de diviser les quantités importées en une part soumise à des droits de douane élevés et une part bénéficiant de droits de douane plus faibles, au sein de ce que l’on appelle les contingents tarifaires. Ce mode de procéder permet des importations à des prix qui, pour une partie de celles-ci, ne s’écartent que très peu du niveau des prix étrangers Les parts de ces contingents tarifaires sont donc recherchées Des contingents tarifaires existent en particulier pour la viande, les produits laitiers, les pommes de terre, les fruits, les légumes, le blé panifiable et le vin
2 . 1 P R O D U C T I O N E T V E N T E S 2 128
L’attribution des contingents tarifaires s ’effectue par mise aux enchères, sur la base des achats de produits suisses, proportionnellement aux importations effectuées à une certaine date, ou selon l’ordre d’arrivée des demandes auprès de l’autorité concédante Les quantités libérées et les importations effectives au taux du contingent sont publiées dans le Rapport annuel du Conseil fédéral concernant les mesures tarifaires Jusque-là, l’utilisation des parts de contingent tarifaire variait selon les produits Pour d’autres produits, les importations sont régulées uniquement par les droits de douane Lors de la fixation de ces droits, on tient compte de la situation de l’approvisionnement en Suisse et des possibilités de placement de produits similaires, de même que de l’intérêt économique général Quant aux aliments pour animaux, les droits de douane sont adaptés périodiquement à l’évolution des prix franco frontière suisse selon le système des prix-seuils
La protection à la frontière comprend non seulement l’aspect quantitatif mais aussi un aspect qualitatif, en ce sens que les importations doivent être garanties exemptes de risques pour la santé (sécurité des aliments)

2 . 1 P R O D U C T I O N E T V E N T E S 2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E 129
Avr 98 Juil 98 Oct 98 Jan 99 Avr 99 Juil 99 Oct 99 Avr 00 f r / d t Source:
0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 Prélèvements
Limite Prix-seuil Prix à l'importation, dédouané Prix franco frontière suisse 2
Système des prix-seuils à l'exemple de l'orge
OFAG
à la frontière
■ Clause de sauvegarde de l’OMC: invoquée la première fois pour la viande de porc
Une réglementation d’importation reposant uniquement sur une différencation des droits de douane peut produire des effets disproportionnés sur le marché suisse C’est pourquoi l’accord agricole de l’OMC prévoit, dans de tels cas, une clause spéciale pour les produits agricoles. Selon celle-ci, les droits de douane perçus sur les produits en question peuvent être relevés dans une mesure limitée, définie avec précision, si les prix à l’importation baissent fortement (clause liée aux prix) ou si les quantités importées augmentent excessivement (clause quantitative) Les négociations du cycle d’Uruguay ont conféré à la clause de sauvegarde spéciale le rôle majeur de servir de barrière de sécurité contre des effets inattendus de la tarification
La conjonction de différents facteurs (par exemple crises en Asie et en Russie; augmentation considérable de la production de porcs dans l’UE et aux USA), a temporairement fait baisser les prix des quartiers de carcasse, en Allemagne par exemple, à environ 1 – franc par kg/PM, soit un niveau extrêmement bas Les différences de prix par rapport à l’étranger ont entraîné d’importants achats de viande de porc en dehors du contingent tarifaire D’où la demande des producteurs d’appliquer la clause spéciale de sauvegarde de l’OMC, par crainte d’effets néfastes sur la production suisse
Vu l’évolution des prix franco frontière suisse de la viande de porc, la clause spéciale de l’OMC liée aux prix a été appliquée pour la première fois, par procédure d’urgence, au mois de mai de l’année sous rapport, pour sept positions du tarif général des douanes concernant la viande de porc (ordonnance sur l’application de la clause de sauvegarde spéciale dans le domaine de la viande de porc). Cette ordonnance est restée en vigueur jusqu’à la fin de 1999
Durant cette période de huit mois, 3’682 t de viande de porc, représentant une valeur de quelque 25 millions de francs, ont été importées au taux hors contingent (THC) et dédouanées selon les positions du tarif concernées. Sur cette quantité, quelque 1’002 t, d’une valeur d’environ 4 millions de francs, ont été frappées d’un supplément de droits de douane de 0,38 million au total
Résultats de l’application de la clause de sauvegarde spéciale en matière de viande de porc
Type de dédouanement Impor- Valeur Droits de Supplé- Renchétations de la mar- douane ment rissement chandise
t mio de fr mio de fr mio de fr % Sans supplément selon clause de sauvegarde 2 680 21 12,25 Avec supplément selon clause de sauvegarde 1 002 4
Source: DGD

130 2 . 1 P R O D U C T I O N E T V E N T E S 2
Total
0,38
4,45 0,38 4,5
3 682 25 16,70
0,9
■ Importation et exportation de produits transformés (loi fédérale sur l’importation et l’exportation de produits agricoles transformés (Schoggigesetz)
On suppose que cette mesure a contribué à réduire les importations – grâce au renchérissement résultant des suppléments de droits de douane – quoique les effets n ’ en soient pas quantifiables Les expériences de ce premier recours à la clause de sauvegarde spéciale de l’OMC liée aux prix de la viande de porc montrent qu ’elle doit être appliquée à temps pour avoir un effet optimal C’est pourquoi on cherche une solution appropriée pour la prochaine application de cette clause, y compris la possibilité d’y recourir systématiquement pour les produits sensibles L’application de la clause nous a permis de tirer de précieux enseignements pour le prochain cycle de négocations de l’OMC
Les contributions à l’exportation pour les produits agricoles transformés, qui permettent de compenser la différence entre les prix des matières premières agricoles suisses et étrangères, ont pour but de favoriser l’exportation d’un maximum de matières premières agricoles suisses sous forme de produits transformés.
L’élément mobile et les droits de douane (protection de l’industrie) composent les prélèvements à la frontière L’élément mobile couvre l’écart de prix entre les matières premières suisses et étrangères Cela crée sur le marché suisse des conditions de concurrence comparables en ce qui concerne les prix des produits suisses et étrangers.
Produits transformés fabriqués à partir de matières premières agricoles Loi sur les produits agricoles transformés («Schoggigesetz»)
Mécanisme
Prix dans le pays
Contribution à l'exportation
Montant partiel flexible
Prix du marché mondiale
sur produits agricole transformé (farine sous forme de biscuits)
sur produits agricole transformé (farine sous forme de biscuits)
La «Schoggigesetz» compense la différence entre le coût des matières premières dans le pays et sur le marché mondial, mais pas celle entre les frais de production.
2 . 1 P R O D U C T I O N E T V E N T E S 2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E 131
Exportation Importation
2
La Suisse s ’est engagée, en signant l’accord de l’OMC de 1994, à abaisser ses contributions à l’exportation pour les produits agricoles de 36% en six ans dès 1995 (soit de les porter de 179,6 millions de francs – années de référence 1991/92 – à 114,9 millions de francs à partir de l’an 2000). Si les exportations augmentent et que les moyens financiers ne suffisent plus à couvrir la différence de coûts sur les matières premières agricoles transformées, une augmentation du trafic de perfectionnement ne peut être empêchée que par «d’autres mesures appropriées» (par exemple mesures d’entraide des producteurs) Le trafic de perfectionnement signifie que les matières premières peuvent être importées sans droits de douane, transformées en Suisse, et réexportées sous forme de produits prêts à la consommation (par exemple, du sucre étranger est importé sans droits de douane et réexporté sous forme de chocolat) Une augmentation des importations dans le cadre du trafic de perfectionnement débouche sur une perte des parts de marché de l’agriculture suisse
Notre industrie alimentaire a enregistré en 1999 un recul considérable de ses exportations vers l’Asie (surtout de chocolat), contrairement aux autres marchés, surtout ceux de l’UE, où elles sont en progression
■ Perspectives A court terme, les différents régimes d’importation ne subiront pas de modifications importantes Des changements peuvent se révéler nécessaires, par exemple suite aux résultats des prochains cycles de l’OMC D’autres adaptations pourraient encore porter sur des critères de répartition des contingents tarifaires ou procéder de raisons internes

2 . 1 P R O D U C T I O N E T V E N T E S 2 132
Quantités exportées et contributions à l'exportation Quantités exportées, en t Contributions à l'exportation, en mio. de fr. Source: OFAG 180 128 137 130 92 000 78 000 85 000 84 000 1991/921997199819991991/92199719981999
Observation du marché
Selon l’art 27 LAgr, le Conseil fédéral peut soumettre à observation les prix des marchandises faisant l’objet de mesures de politique agricole, et cela à tous les échelons du marché, de la production à la consommation
L’observation des prix a pour objectif d’améliorer la transparence du marché Il s ’agit en l’occurrence de déterminer si des baisses de prix aux producteurs sont effectivement répercutées sur les consommateurs De plus, l’observation des prix doit fournir des informations pour l’évaluation des mesures de politique agricole
La section «Observation du marché» de l’OFAG est chargée de ce travail. Ses tâches sont les suivantes:
– saisie du niveau des prix des produits agricoles et des produits de leur transformation;
– intensification de la transparence dans la formation des prix par des campagnes d’information du public
Les produits agricoles suivants peuvent être soumis à l’observation du marché:
– le lait et les produits laitiers;
– la viande, les produits carnés et la charcuterie;
– les œufs et la volaille;
– les produits de la culture des champs et les denrées qui en sont issues;
– les fruits et légumes et les produits de leur transformation
Pour assurer l’exécution de ces tâches, il est possible d’obliger les entreprises de transformation et les maisons de commerce, de même que les services administratifs, à relever et à livrer des données. La section «Observation du marché» publie des rapports mensuels sur les marchés du lait, de la viande, des fruits et légumes De plus, elle publie toutes les semaines en été et toutes les quinzaines en hiver, une récapitulation des prix du marché des produits les plus intéressants offerts sur les principaux marchés hebdomadaires L’établissement des marges pour la viande, le lait et les produits laitiers permet de plus de suivre régulièrement les effets de la politique agricole C’est dans ce but que, depuis le 1er mai 1999, les prix obtenus pour le lait par les producteurs sont aussi relevés
■ Perspectives On a commencé cette année à publier une marge des principaux fruits et légumes; le bulletin du lait comportant des données de la Fiduciaire de l’économie laitière (TSM) est transformé en bulletin mensuel sur la situation du marché De plus, on élabore les bases pour le calcul d’une marge sur les œufs, comprenant en particulier le relèvement des prix au producteur et à la consommation des principales catégories d’œufs. Quant à la viande, le calcul de la marge est en train d’être adapté méthodiquement pour le début de 2001
2 . 1 P R O D U C T I O N E T V E N T E S 2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E 133
2
■ Activité de contrôle pendant l’année considérée
Contrôles et enquêtes
Le contrôle des mesures prises dans les domaines de la production et des ventes incombe à une unité spéciale de l’OFAG, l’inspectorat. Celui-ci n ’accomplit pas de tâches d’exécution Il effectue des contrôles et des révisions, d’une part, et assure les enquêtes dans des affaires pénales, d’autre part Outre les mesures liées aux produits, son activité de contrôle porte aussi sur les aliments pour animaux et les produits phytosanitaires
Pendant l’année considérée, l’inspectorat a procédé à 1’113 contrôles et révisions Il a été contraint à demander le remboursement d’environ 1,5 million de francs d’aides accordées dans le domaine laitier En revanche, certains requérants n ’ont pas demandé toutes les aides auxquelles ils avaient droit Ils ont touché après coup un montant total de quelque 300'000 francs. Les réclamations et les versements après coup s ’expliquent surtout par une certaine insécurité liée à l’introduction de la nouvelle organisation du marché laitier
Pendant l’année sous revue, les principales activités de l’inspectorat ont été les suivantes:
– de mai à octobre, l’activité du service extérieur s ’est concentrée sur les contrôles dans les domaines beurre, légumes, fruits, fleurs coupées, œufs, viande et chevaux Les succédanés du lait, la poudre de lait entier et le concentré de lait ont également fait l’objet de contrôles réguliers au cours de l’année
– Les trois derniers mois de l’année, l’inspectorat s ’est avant tout consacré aux domaines des céréales, des pommes de terre et du fromage (production et transformation), ainsi qu’à la révision de la sucrerie Aarberg/Frauenfeld
– L’inspectorat a été associé à des examens en rapport avec des aliments pour animaux contenant de la dioxine Il a notamment assuré la surveillance sur le retrait de 108 t de ces aliments dans 60 exploitations Les aliments ont ensuite été éliminés selon les règles de l’art et de manière respectueuse de l’environnement.
– S’agissant des produits phytosanitaires, on a contrôlé les ventes et en particulier surveillé la destruction du maïs-OGM ordonnée par l’OFAG
■ Enquêtes dans des affaires pénales
L’inspectorat n ’ a pas seulement pour tâche d’effectuer des contrôles, mais aussi de mener des enquêtes dans des affaires pénales De telles procédures s’imposent, par exemple, lorsque des agriculteurs ne respectent pas les dispositions concernant le contingentement laitier. L’inspectorat est habilité à trancher sur place les affaires impliquant une amende maximale de 500 francs Il applique alors une procédure simplifiée; lorsque le mandat de répression a été rendu et que l’amende a été payée, la procédure est close. Il n ’existe pas de voies de droit dans ces cas. Les autres affaires sont transmises au service juridique de l’OFAG Pendant l’année considérée, l’inspectorat a infligé 84 amendes au total
2 . 1 P R O D U C T I O N E T V E N T E S 2 134
Mesures

2.1.2 Economie laitière
Le lait joue un rôle capital dans l’agriculture suisse: la production laitière représente en effet un tiers environ de la production finale Aucun autre produit agricole n ’est aussi tributaire des exportations: quelque 25% de la production sont exportés, avant tout sous forme de fromage
La nouvelle réglementation du marché laitier fixe les conditions de base permettant d’écouler une quantité maximale de lait et de ses dérivés sur les marchés suisse et étrangers C’est la raison pour laquelle on encourage, à tous les échelons de l’économie laitière, des structures compétitives et proches du marché. Les produits doivent satisfaire à des normes de qualité rigoureuses et être commercialisés d’une manière appropriée pour que le prix-cible puisse être atteint au niveau du producteur Les mesures d’orientation de la production et de soutien du marché sont conçues de manière à permettre aux forces du marché de s ’exprimer davantage aux plans de la production, de la transformation et du commerce
En plus des instruments que constituent les suppléments, les aides et la protection à la frontière, le contingentement laitier crée des conditions prévisibles quant à la situation du marché laitier On relèvera ici que les mesures de soutien financier sont fortement axées sur le fromage, dont le succès sur le marché est décisif pour une économie laitière prospère
2 . 1 P R O D U C T I O N E T V E N T E S 2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E 2 135 ■■■■■■■■■■■■■■■■
1999/2000 Produit Fromage Beurre Lait écrémé Poudre Lait de consommation de lait Crème Produits laitiers frais Mesure Protection à la frontière ■■■■■ Suppléments ■ Aides dans le pays ■ 1 ■ 2 ■ 2 ■ 3 Aides à l’exportation ■ 4 ■■ 5
1 pas pour tous les fromages
2 pour utilisations particulières seulement 3 pour la transformation en Suisse uniquement 4 différenciées selon les sortes de fromage et la destination (UE/autres pays) 5 ne s ’applique pas au lait de consommation Source: OFAG
Le Compte d’Etat 1999 comprend les dépenses selon les anciennes et nouvelles dispositions légales, ce qui rend assez hasardeuses les comparaisons avec les années précédentes En dépit des mesures d’économie instaurées en 1998, les dépenses consenties par la Confédération en faveur de l’économie laitière ont augmenté par rapport à l’année dernière L’explication réside dans le financement transitoire lié à la réorganisation du marché du lait
Aides
transitoires
de durée
En 1999, les dépenses de la Confédération dans le secteur laitier se sont chiffrées à 1’052 millions de francs en tout, montant qui se décompose comme suit: 568 millions pour les mesures transitoires de durée limitée (mise en valeur du lait de novembre 1998 à avril 1999), 105 millions de frais de liquidation de l’Union suisse du commerce de fromage (USF) et de la Butyra (deux organisations semi-étatiques) et 379 millions pour le soutien du marché selon le nouveau droit (de mai à novembre 1999) Il ressort de la répartition par produits que 711 millions de francs (68%) sont revenus au seul secteur du fromage Le beurre a, quant à lui, bénéficié de 258 millions de francs (25%), contre 83 millions (7%) pour la fabrication de lait en poudre

2 . 1 P R O D U C T I O N E T V E N T E S 2 136
Moyens financiers en 1999 Distribution des ressources en 1999
accordées l'étranger 9% Suppléments 13% Coût de la liquidation 10%
Tableau 24, page A25 ■
Aides
Sources: Compte d'Etat, OFAG accordées dans le pays 13%
Mesures
limitée 55%
Total 1 052 mio. de fr.
Contingentement laitier
La nouvelle réglementation du marché laitier reprend le principe du contingentement laitier instauré en 1977, la quantité de lait étant limitée à 3,2 millions de tonnes. Cette mesure constitue un soutien indirect du prix du lait, l’équilibre entre l’offre et la demande n’étant ainsi pas entièrement laissé au libre jeu des forces du marché Des motifs de politique régionale ont par ailleurs présidé au choix de maintenir les restrictions quantitatives même si elles débouchent sur un rétrécissement de la marge de manoeuvre des producteurs de lait et sur une diminution globale de la compétitivité

La nouvelle réglementation du marché autorise le commerce de contingents individuels entre exploitants, sans intervention de la part de l’Etat, le transfert de contingents de la région de montagne vers la plaine étant, en principe, interdit En louant ou en achetant des contingents, les producteurs disposent désormais de la latitude nécessaire pour adapter les quantités aux conditions de leur exploitation. Le commerce de contingents contribue à une production laitière efficace
Les contingents supplémentaires jouent un rôle important pour le placement du bétail de la région de montagne et favorisent la répartition du travail entre la montagne et la plaine. Une quantité de 1’500 kg de lait par animal acheté est attribuée pendant une période limitée au producteur qui se rend acquéreur de bétail en provenance de la région de montagne Quelque 17’000 animaux sont placés chaque année en plaine par ce biais. D’où une quantité de lait annuelle quasiment invariable d’environ 25’000 t, soit 0,8% du volume contingentaire global
Les contingents spéciaux selon l’art 33 LAgr sont réservés aux demandes de contingents supplémentaires Le Conseil fédéral peut accorder de tels contingents sous réserve des engagements pris dans le cadre de l’OMC, lorsque les fonds prévus pour les contributions à l’exportation de produits agricoles ne suffisent pas et qu’il existe une demande supplémentaire de lait pour l’exportation desdits produits Cette mesure permet d’éviter le trafic de perfectionnement de l’industrie alimentaire désireuse de se procurer des matières premières meilleur marché à l’étranger
2 . 1 P R O D U C T I O N E T V E N T E S 2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E 137 2
■ Commerce actif de contingents
Cet instrument aisé à manier a été largement et judicieusement utilisé. Les contingents n’étant plus liés à la surface mais attribués à l’exploitant, la marge de manoeuvre s ’est élargie Deux types de contrats peuvent être conclus pour la location: dans le premier des cas, le transfert est dit simple et non définitif, alors que dans le second, il s ’agit d’un transfert non définitif de la montagne vers la plaine, doublé d’un transfert inverse de l’élevage bovin (de la plaine vers la montagne)
Bilan de la première année de commerce de contingents (année laitière 1999/2000)
Pendant la première année laitière autorisant le commerce de contingents (mai 1999 à fin avril 2000), quelque 386 millions de kg de contingents ont été transférés, soit 12% du volume contingentaire global Cette quantité comprend environ 206 millions de kg de contingents «donnés en location» à la suite de la dissolution des communautés partielles d’exploitation, mais ayant en réalité déjà été cédés antérieurement aux partenaires desdites communautés Quelque 10 à 15% de producteurs ont conclu un contrat d’achat ou de location pour le transfert d’un contingent. Dans la mesure où il a été communiqué aux services administratifs chargés du contingentement laitier, le prix moyen des contingents négociés s ’est situé autour de 1 38 francs par kg de lait Quant au prix de location, il s ’est stabilisé à 10 ct , soit environ 13% du prix-cible
■ Perspectives
L’OFAG a chargé l’Institut d’économie rurale de l’EPF de Zurich (IER) d’examiner certaines questions liées au contingentement laitier, une tâche qui comprend d’abord une étude préliminaire (2000), suivie d’une étude principale (2001). L’objectif consiste en l’occurrence à examiner les diverses questions concernant l’effet et l’effectivité du contingentement, en analysant plus particulièrement son influence sur les quantités, les prix, les coûts et les revenus des producteurs, sur les structures et les régions ainsi que sur la durabilité
L’étude préliminaire illustre la structure de la production laitière en Suisse à partir de données individuelles fournies par dix types d’exploitations, données qui serviront de base aux calculs nécessaires à l’aide d’un modèle mathématique. A titre de complément, il a été procédé à un sondage représentatif parmi les producteurs
2 . 1 P R O D U C T I O N E T V E N T E S 2 138
Ventes Location I Location II Total Nombre de décisions 3 075 14 079 338 17 492 Total (en mio de kg) 67,4 308,6 10,3 386,3 Nombre de kg par transfert 21 915 21 922 30 464 22 084 Source:
OFAG
A la fin de 1999, environ 3’000 agriculteurs représentant tous les types d’exploitations et toutes les régions de Suisse ont reçu un formulaire relatif à la production de lait Le taux de réponses réjouissant de quelque 54% démontre que l’avenir de la production et du contingentement laitiers les préoccupe réellement.

Les premiers résultats du sondage ont été résumés dans un rapport succinct à l’intention des agriculteurs 72% des exploitants consultés voient une possibilité de réduire les coûts en modifiant le système de pacage, 69% en synchronisant les chaleurs des animaux et 61% en réduisant les coûts salariaux Par contre, 70% ne voient aucune solution dans l’accroissement de leur production laitière ni du reste dans l’augmentation de la performance laitière par vache (55%) Contre toute attente, les producteurs cherchent à réduire les coûts par une utilisation économe des moyens de production et non pas par une augmentation des quantités produites
Pour ce qui est des systèmes de stabulation, 86% des exploitants consultés déclarent garder leurs animaux dans des systèmes entravés, alors que 11% d’entre eux disposent d’un système à stabulation libre avec logettes En moyenne, les producteurs ont pu louer un volume de 35’000 kg de lait, sans devoir consentir d’investissements supplémentaires dans leurs étables, puisqu’ils disposent d’environ cinq places libres pour vaches laitières.
Le prix plancher moyen (prix inférieur auquel les exploitants sont encore prêts à produire du lait) est de 64 ct par kilo de lait 60% des personnes interrogées continueraient à produire du lait en dessous de 70 ct , mais seulement 40% en dessous de 65
2 . 1 P R O D U C T I O N E T V E N T E S 2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E 139
ct. Niveau plancher du prix de production du lait 70 ct.65 ct.60 ct.55 ct. Prix du lait au kilo 50 ct.45 ct.40 ct.35 ct. N o m b r e d ' e x p l o i t a t i o n s
0 100 200 300 400 500 416 234 282 64 53 422 2
Source: IER-EPF
Soutien du marché à l’aide de suppléments et d’aides

Un quart de la production de lait est écoulée à l’étranger Les recettes issues des exportations, de fromage en particulier, s ’alignent sur les prix européens, d’où un risque pour les prix suisses à la production de suivre le mouvement Les moyens financiers investis dans le soutien du marché permettent, aujourd’hui, d’atteindre un niveau dépassant de 30 ct celui de l’UE, mais leur réduction de 40%, d’ici à 2003, amenuisera cet écart Les mesures de soutien du marché ont pour but de garder une production laitière rentable par rapport aux autres secteurs de production
Le supplément pour le lait transformé en fromage constitue le pivot de la nouvelle organisation du marché laitier. Il est versé tout au long de l’année pour l’ensemble du lait transformé en fromage et permet de réduire le prix de la matière première Les transformateurs peuvent ainsi fabriquer du fromage à des prix compétitifs, ce qui réduit l’importance des subventions à l’exportation vers l’UE. Conformément à l’accord sur le fromage conclu dans le cadre des accords bilatéraux avec l’UE, la Suisse s ’est, de toute manière, engagée à supprimer progressivement toute aide à l’exportation Celle qui est versée pour le fromage se limite donc, à moyen terme, à l’ouverture de nouveaux débouchés en dehors de l’UE
Des aides sont allouées pour soutenir le placement de certains autres produits laitiers La contribution destinée à réduire le prix du beurre est nécessaire en raison de la faible protection douanière prévue pour les huiles et les graisses végétales comestibles. Il en est de même du lait écrémé destiné à une utilisation particulière, soit la fabrication de caséine acide, de caséine-présure et de caséinates, ainsi que de concentrés de protéine et de succédanés du lait Une contribution par équivalent de lait, calculée en fonction de la teneur en matière grasse et en protéine, est par ailleurs versée à titre d’encouragement de l’exportation de produits laitiers autres que le fromage, ce qui assure à chaque produit les mêmes chances initiales
2 . 1 P R O D U C T I O N E T V E N T E S 2 140
■ La nouvelle organisation du marché du lait fait ses preuves
Par la nouvelle réglementation, on entend renforcer la compétitivité à tous les échelons du marché En d’autres termes, le rapport prix-prestations doit être amélioré pour la sauvegarde des parts de marché Un premier bilan intermédiaire établi une année après l’entrée en vigueur des nouvelles conditions-cadre de l’économie laitière montre que le nouveau régime a bien passé l’examen pratique au vu des objectifs de la réforme de la politique laitière Le prix-cible de 77 ct par kg de lait a été atteint en moyenne, ce qui infirme toutes les prédictions d’un effondrement des prix et des débouchés Le secteur en aval est en voie de restructuration, et la structure de la mise en valeur évolue dans la direction souhaitée Il n ’ y a pas eu de perte de parts de marché La balance du commerce extérieur a, au contraire, connu une évolution favorable Les stocks disponibles de fromage, de beurre et de poudre de lait sont en outre équilibrés. On peut donc dire que la transition s ’est faite sans accrocs, et qu’il n ’est pas nécessaire de corriger le tir Il convient juste de maintenir le cap vers un renforcement de la compétitivité, les hypothèques du passé n’étant pas encore toutes levées.
■ Perspectives
Selon l’enveloppe financière 2000 à 2003, une réduction de 80 millions de francs est prévue en 2001; il s ’ensuivra une diminution des aides
Dans le cadre de l’évaluation de PA 2002, un mandat de recherche a été confié à l’IER de l’EPF de Zurich, recherche qui portera en particulier sur l’effet, l’effectivité et l’efficacité des instruments du marché laitier.

2 . 1 P R O D U C T I O N E T V E N T E S 2 L E S M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E 141
2
■ Moyens financiers en 1999
2.1.3 Production animale
La production de viande et d’œufs contribue à raison d’un tiers environ à la production finale Mais contrairement à l’économie laitière, le placement se limite presque exclusivement au marché suisse Les mesures à la frontière constituent le soutien principal de la production de viande, alors que pour la production d’œufs, des aides versées dans le pays viennent compléter ces mesures La Confédération n’investit proportionnellement que peu de moyens pour ces deux secteurs
Au cours de l’année sous revue, il n ’ y a eu ni dégagement dans les abattoirs, ni marchés publics pour les moutons, ni stockage ou ventes à prix réduits de viande de porc
En 1999, la Confédération a budgétisé 49,1 millions de francs pour des mesures relevant de l’économie animale Quelque 60% de ces fonds proviennent de droits de douane à affectation spéciale perçus sur les importations de viande, d’œufs et de produits à base d’œufs; ils alimentent le fonds de la viande ainsi que la caisse de compensation des prix des œufs et des produits à base d’œufs Les dépenses effectives de l’année 1999 se sont chiffrées à 32,6 millions de francs, les 16,5 millions résiduels du budget n ’ayant pas été utilisés en raison surtout des restrictions imposées à l’exportation de bétail d’élevage et de rente
2 . 1 P R O D U C T I O N E T V E N T E S 2 142
■■■■■■■■■■■■■■■■
Mesures prises en 1999 Animal/produit Bovins Veaux Porcs Chevaux Moutons Chèvres Volaille Œufs Mesure Protection douanière ■■■■■■■■ Dégagement des marchés publics ■■■ Dégagement des abattoirs ■■■■■ Campagnes de stockage ■■■ Campagnes de ventes à prix réduits ■■■ Essais pratiques ■ Contributions de reconversion ■ Contributions aux frais de ramassage et de calibrage ■ Campagnes d’œufs cassés et mesures de commercialisation ■ Contributions à la mise en valeur de laine de mouton ■ Contributions à l’exportation 1 ■■■■ Effectifs maximums ■■■■ 1 pour le bétail d’élevage et de rente uniquement Source: OFAG
■ Bétail de boucherie et viande: filet de sécurité minimum sur le marché suisse
Distribution des ressources en 1999
Total 32,6 mio. de fr.
Contributions pour la mise en valeur de la laine de mouton 3%
Bétail d'élevage et de rente 5%
Contributions destinées à soutenir la production suisse d'œfs 37%
Mandat de prestations de Proviande 15%
Contributions de stockage et réduction de prix de la viande de bœuf et de veau 40%
Sources: Compte d'Etat, OFAG
En 1999, les moyens de la Confédération ont servi essentiellement à soutenir les secteurs des œufs (37%), de la viande de bœuf (28%) et de la viande de veau (12%)

Les mesures prises dans le secteur du bétail de boucherie et de la viande sont financées par le fonds de la viande, lui-même alimenté, nous l’avons dit, par les parts de droits de douane à affectation spéciale Au cours de l’année sous revue, le fonds de la viande a servi à financer les opérations de stockage de viande de bœuf et de veau lors d’excédents saisonniers ou autres surplus temporaires, à baisser le prix des cuisses de bœuf pour la fabrication de viande séchée et à rétribuer les prestations de Proviande, organisation ayant succédé à la Coopérative suisse pour l’approvisionnement en bétail de boucherie et en viande
Les 6 millions alloués pour l’achat de viande de bœuf dans le cadre d’opérations humanitaires ont représenté la plus grande partie des dépenses 3,81 millions de francs ont été versés au titre de contributions de stockage pour la viande de veau et 1,51 million pour la viande de bœuf. En mai et juin 1999, 303 t de quartiers de devant de taureaux d’étal ont été stockées, alors que 1’120 t de viande de veau ont été entreposées de janvier à juillet Cela a permis d’éponger l’offre saisonnière excédentaire du printemps et de l’été et de stabiliser les prix Toutes les quantités stockées ont été acheminées sur le marché suisse en automne Entre février et juin, le montant total de 1,24 million de francs versé par la Confédération a permis de réduire le prix de 8’900 cuisses de bœuf d’un poids total de 300 t destinées à la fabrication de viande séchée
Proviande a touché 4,8 millions de francs pour les prestations qu ’elles a fournies en vertu de l’art 42 des dispositions transitoires de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le bétail de boucherie: enregistrement et contrôle des demandes de parts de contingent tarifaire, surveillance et dégagement des marchés publics de bétail de boucherie et de moutons, campagnes de stockage
2 . 1 P R O D U C T I O N E T V E N T E S 2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E 143
Tableau 25, page A26 2
■ Bétail d’élevage et de rente: des restrictions à l’importation freinent toujours les exportations
Dans le cadre du dégagement des marchés publics surveillés (attribution des animaux non vendus), Proviande a attribué aux détenteurs d’une part de contingent tarifaire 3’842 têtes de gros bétail et 1’565 veaux aux prix ayant cours sur le marché Ces attributions ont diminué par rapport à 1998 (6’105 têtes de gros bétail et 1’792 veaux) en raison d’une meilleure situation sur le marché Il n ’ y en a pas eu pour les moutons et les agneaux de pâturage

La région de montagne bénéficie d’avantages comparatifs en matière de coûts pour ce qui est de l’élevage de bovins destinés à la production de lait et de viande Les contributions à l’exportation de bétail d’élevage et de rente constituent en l’occurrence un soutien. Elles n ’ont pratiquement pas été sollicitées au cours de l’année sous revue puisque les pays de l’UE ont maintenu leur embargo en dépit des efforts déployés par le Conseil fédéral et par les offices fédéraux compétents pour faire lever les restrictions à l’importation décrétées à cause de l’ESB. Dans le cadre d’opérations humanitaires, 500 vaches et génisses portantes ont toutefois pu être exportées au Kosovo
■ Oeufs: mesures de soutien à la production suisse
Toutes les mesures prises dans le secteur des œufs sont financées par la Caisse de compensation des prix des œufs et des produits à base d’œuf, alimentée, nous l’avons dit, par les parts de droits de douane à affectation spéciale Cette caisse de compensation sert à soutenir la production d’œufs par les exploitations paysannes de notre pays et à financer les mesures de mise en valeur des œufs suisses.
La réorganisation de ce marché remonte à 1996, année où le Conseil fédéral a supprimé l’ancienne répartition du marché en une partie protégée (pour 1/3 de la production env ) et non protégée (pour le reste) Prix et placement étaient garantis sur le marché protégé. Pour atténuer l’impact de cette réorganisation, le Conseil fédéral a instauré deux mesures transitoires valables jusqu’en 2001:
1. L’OFAG verse des contributions aux frais de ramassage et de calibrage pour la prise en charge d’œufs de consommation produits par d’anciennes exploitations protégées Ces contributions d’un montant de 4,38 millions de francs ont aussi servi à soutenir les prix au cours de l’année sous revue
2 La garde de pondeuses respectueuse de l’espèce (SRPA ou SST) est par ailleurs encouragée En plus des contributions SST et SRPA, les producteurs d’œufs touchent des contributions de reconversion 576 exploitants gardant au total 784’330 pondeuses – soit plus de 28% de l’effectif total – ont reçu des contributions de reconversion d’un montant de 5,84 millions de francs en 1999; en 1997, ce pourcentage n’était que de 15% Cette augmentation de près de 100% en deux ans permet de conclure à l’efficacité des contributions de reconversion pour promouvoir les systèmes de garde respectueux de l’espèce
2 . 1 P R O D U C T I O N E T V E N T E S 2 144
■ Chevaux de rente et de sport: première mise aux enchères de parts de contingent tarifaire

En plus des mesures transitoires, il est possible de recourir aux fonds de la caisse de compensation pour des campagnes d’œufs cassés ainsi que pour des mesures de commercialisation lorsque l’offre saisonnière d’œufs de poules suisses est excédentaire. Le but consiste à stabiliser les prix. D’entente avec les milieux intéressés, l’OFAG a mis 2 millions de francs à disposition pour ces opérations qui ont commencé après Pâques et ont duré jusqu’à fin octobre La demande d’œufs de consommation baisse, en effet, très rapidement après les fêtes, alors qu’il est difficile de réduire l’offre à court terme dans les mêmes proportions Au total, 13,7 millions d’œufs suisses excédentaires ont été cassés pour être transformés, alors que 11,1 millions ont été vendus à prix réduit Ces mesures, qui ont coûté 1,58 million de francs en tout, ont contribué partiellement à stabiliser les prix
Les fonds de la caisse de compensation sont par ailleurs utilisés pour co-financer des essais pratiques dans le secteur de la volaille et pour en diffuser les résultats dans les milieux de la formation et de la vulgarisation. En 1999, l’OFAG et l’école d’aviculture de Zollikofen ont signé trois contrats portant sur la réalisation d’essais, dont une partie se prolonge jusqu’en 2000 Les résultats sont présentés régulièrement lors de journées d’information et sont publiés dans des revues spécialisées, encourageant par là une amélioration des systèmes de garde de la volaille
La nouvelle ordonnance sur l’importation de chevaux prévoit la mise aux enchères des contingents tarifaires. C’est en septembre 1999 que l’OFAG a mis en adjudication la première moitié du contingent tarifaire «animaux de l’espèce chevaline (sans les animaux d’élevage)» portant sur 1’561 chevaux 763 offres ont été soumises par 183 personnes physiques et morales ainsi que par des communautés de personnes ayant leur domicile ou leur siège sur le territoire douanier suisse; la quantité totale des offres pouvant être prise en considération a été de 5’203 chevaux, ce qui permet de conclure que l’attribution de la première tranche du contingent tarifaire s ’est faite dans des conditions de concurrence Au total, 146 personnes ont obtenu des parts de contingent pour la période contingentaire 2000. C’est au moins deux fois plus qu ’ en 1999.
2 . 1 P R O D U C T I O N E T V E N T E S 2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E 145
2
■ Perspectives En se référant à l’ordonnance sur le bétail de boucherie, le Conseil fédéral a réorganisé fondamentalement le marché du bétail de boucherie et de la viande Les appels d’offres pour des mandats de prestations, comprenant entre autres la taxation neutre de la qualité, et la nouvelle attribution des contingents tarifaires dans des conditions de concurrence en constituent les pierres angulaires En mars 1999, l’OFAG a fait un appel d’offres pour trois de ces mandats et les a adjugés, au terme d’une évaluation minutieuse, à Proviande, une organisation ayant déjà fourni des prestations à la Confédération Les trois contrats conclus entre l’OFAG et Proviande ont pris effet le 1er janvier 2000:
1 Taxation neutre de la qualité dans les abattoirs et sur les marchés publics surveillés: Depuis le 1er janvier 2000, Proviande procède à la taxation neutre de la qualité de tous les animaux sur pied des espèces bovine et ovine sur les marchés publics surveillés et des animaux abattus des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine dans les grands abattoirs. Par grand abattoir, on entend une entreprise qui accueille chaque année plus de 1’200 unités d’abattage (p ex 1’200 vaches ou 6’000 porcs; même définition que dans l’UE)
2 Surveillance des marchés publics et des abattoirs et mesures destinées à alléger le marché:

Dès le 1er janvier 2001, Proviande surveillera les marchés publics des espèces bovine et ovine Elle y procédera aux mesures de dégagement, aux appels d’offres ainsi qu ’ au contrôle des campagnes de stockage et des ventes à prix réduit.
3 Enregistrement et contrôle des demandes de parts de contingent tarifaire:
A partir du 1er janvier 2001, l’OFAG attribuera les parts de contingent pour le bétail de boucherie et la viande sur la base de nouveaux critères servant à calculer la prestation fournie en faveur de la production suisse. Proviande saisira et vérifiera ces prestations au moyen de demandes et les transmettra ensuite à l’OFAG
Dans le cadre de l’évaluation de PA 2002, un mandat de recherche a été confié à l’IER de l’EPF de Zurich, recherche qui portera sur l’effet, l’effectivité et l’efficacité des instruments et de la répartition des ressources sur les marchés de la viande et des œufs
La compétitivité des productions de porcs, de volaille et d’œufs n ’est pas encore optimale en raison principalement de coûts de fourrages élevés: ceux-ci constituent environ 50% (engraissement de porcs avec des aliments complets) et quelque 70% (production de viande de volaille et d’œufs) des coûts directs Une baisse des prix des aliments pour animaux contribuerait beaucoup à la compétitivité de ces branches de production Elle pourrait être obtenue par un abaissement des prix-seuils et une diminution des droits de douane sur les fourrages importés Mais il s ’ensuit une baisse des prix en Suisse et un manque à gagner, surtout pour les producteurs de céréales, d’oléagineux et de pommes de terre dans notre pays Pour compenser au moins une partie de ces pertes, de nouvelles mesures sont à l’étude
2 . 1 P R O D U C T I O N E T V E N T E S 2 146
Production végétale
Les mesures prises dans la production végétale ont pour objectif de maintenir la rentabilité des cultures des champs et des cultures spéciales par rapport aux productions de lait, de viande et d’œufs ainsi qu ’ aux importations Elles visent par ailleurs un équilibre entre les divers produits végétaux, permettant par là à l’agriculture de remplir son mandat constitutionnel, dont font partie la sécurité alimentaire et l’entretien d’un paysage rural diversifié
1 Contributions pour pommes de terre intégrées dans le mandat de mise en valeur; ne vaut pas pour toute la récolte (réserve de marché pour les jus de fruits à pépins; affouragement de pommes de terre à l état frais)
2 Contributions partiellement intégrées dans le mandat de mise en valeur (plants de pommes de terre)
3 Viticulture: seulement pour les vignobles en terrasses ou en pente
Source: OFAG
Les mesures de production végétale concernent principalement la protection à la frontière Pour ce qui est des céréales panifiables et des oléagineux, la garantie limitée en matière de prix et de placement avait encore cours en 1999 Les contributions à la surface, en particulier celles pour les céréales fourragères (primes de culture) ont assuré une compensation permettant de garantir la parité économique des cultures des champs Les sucreries ont, pour la première fois au cours de l’année sous revue, reçu un mandat de transformation portant sur la production de sucre suisse De nombreuses tâches administratives effectuées auparavant par l’OFAG au niveau de l’exécution ont été confiées aux interprofessions.
2 . 1 P R O D U C T I O N E T V E N T E S 2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E 147 ■■■■■■■■■■■■■■■■ 2.1.4
prises en 1999 Mesure Protection douanière ■■■■■■■ Garantie limitée en matière de prix et de placement ■■ Contributions à la transformation ■■ Mandats de mise en valeur 1 ■ Contributions de mise en valeur ■ Contributions à la surface ■ 3 Contributions à l’exportation ■ 2
Mesures
C u l t u r e C é r é a l e s p a n i f i a b l e s C é r é a l e s f o u r r a g è r e s, l é g u m i n e u s e s à g r a i n e s e t m a t i è r e s p r e m i è r e s r e n o u v e l a b l e s, v i t i c u l t u r e O l é a g i n e u x p o u r l a p r o d u c t i o n d ’ h u i l e c o m e s t i b l e P o m m e s d e t e r r e, a r b o r i c u l t u r e B e t t e r a v e s s u c r i è r e s S e m e n c e s L é g u m e s, f l e u r s c o u p é e s 2
■ Moyens financiers en 1999
Les dépenses consenties par la Confédération dans la production végétale en faveur de mesures de soutien du marché ont, pour les trois quarts, bénéficié à la culture des champs 70% de ces fonds ont été affectés au seul soutien des prix, le solde a été versé directement aux exploitations agricoles sous forme de contributions à la surface. En ce qui concerne les contributions à la culture des champs, la répartition est la suivante: 86% pour les céréales fourragères, 8% pour les matières premières renouvelables et 6% pour les légumineuses à graines (pois protéagineux, féverole) La culture fruitière et la viticulture ont bénéficié d’un quart des ressources investies dans le soutien du marché en production végétale
Distribution des ressources en 1999
Total 183 mio. de fr.
Mandats de prestations 1%
Contributions à la surface 29%
■ Céréales: garantie de prix et de placement pour l’avant-dernière fois

Contributions à la transformation 18%
Constributions à la mise en valeur 32% Garantie limitée du prix et de l'écoulement (contributions à la transformation) 20%
Sources: Compte d'Etat, OFAG
Cultures des champs
La parité économique et la part des différentes cultures des champs n ’ont que peu changé au cours de l’année sous revue
C’est pour l’avant-dernière fois que la Confédération a pris en charge, à des prix fixes, la quantité garantie de céréales panifiables (388’700 t) issues de la récolte de 1999 Elle a vendu cette quantité aux meuniers, au prix de revient Le reste des céréales panifiables a été déclassé pour être mis aux enchères dans le secteur fourrager Les producteurs ont couvert les coûts du déclassement par une contribution à la mise en valeur de 6 40 fr /dt
La parité économique entre les cultures de céréales panifiables et fourragères a été garantie au moyen de primes de culture Le niveau des prix suisses des céréales fourragères est géré au moyen des prix-seuils fixés par le Conseil fédéral, par groupe de produits, pour les denrées fourragères importées. Les prix réalisés par les producteurs de céréales fourragères sont de 15 à 20 fr /dt inférieurs aux prix des céréales panifiables
Le DFE détermine les valeurs indicatives d’importation des produits sur la base des prix-seuils, et l’OFAG fixe, à partir de ces valeurs et de ces prix, les droits de douane de sorte que les prix à l’importation des aliments pour animaux se situent dans une fourchette de ±3 franc par dt L’adaptation des droits de douane à l’évolution des prix du marché mondial se fait généralement au début d’un trimestre
2 . 1 P R O D U C T I O N E T V E N T E S 2 148
Tableau 26, page A27
■ Betteraves sucrières: la nouvelle réglementation a été introduite sans accrocs
Un mandat de transformation confié aux sucreries par la Confédération règle la culture suisse de la betterave sucrière Ce mandat porte sur une quantité minimale de 120’000 t et une quantité maximale de 185’000 t de sucre de betterave Les sucreries conviennent chaque année avec la Fédération suisse des betteraviers de la quantité de betteraves nécessaire, de la répartition entre planteurs ainsi que des prix et des conditions de prise en charge Elles s ’engagent à ne pas vendre le sucre et ses sous-produits en dessous des prix à l’importation et à assurer une transformation à des coûts avantageux
Les sucreries sont rétribuées à forfait par la Confédération dans le cadre du mandat de transformation La rétribution pour la transformation de la récolte de betteraves de 1998 s ’est chiffrée à 32,6 millions de francs; le décompte pour la transformation de la récolte de 1999 se fera en 2000 selon la nouvelle organisation du marché du sucre 45 millions de francs ont été budgétisés à cette fin Si le prix moyen du sucre se situe en dehors d’une fourchette de 35 à 45 francs/dt de sucre après déduction des prélèvements à la frontière, le solde lié au surplus ou à la perte de recettes sera pris en compte lors de la fixation du montant prévu pour la période de rémunération suivante Le prix du sucre étant tombé en dessous de 35 fr /dt sur le marché mondial, la Confédération a, en plus de la rémunération ordinaire, dû couvrir un manque à gagner de quelque 2,7 millions de francs.
■ Pommes de terre: nouvelle organisation du marché mais petite récolte
Le rendement de la culture de pommes de terre est tributaire des conditions météorologiques et donc soumis à de fortes fluctuations Les années de haut rendement, les prix sur le marché subissent de fortes pressions Les mesures prises en faveur de cette culture, en particulier la mise en valeur dans le secteur fourrager, contribuent à stabiliser les prix à la production L’OFAG a confié un mandat de mise en valeur à l’interprofession swisspatat, ce qui permet de soutenir, à l’aide de contributions, l’affouragement à l’état frais de pommes de terre déclassées, le stockage (limité à 3’000 t) de pommes de terre de table et, enfin, la transformation en denrées fourragères (par déshydratation) de pommes de terre non triées. Un forfait de 18 millions de francs a été alloué à swisspatat pour la mise en valeur de la récolte de 1999, la moitié du montant ayant été versée au cours de l’exercice 1999
Dépenses pour la mise en valeur des pommes de terre en 1999
Stockage de pommes de terre de table 5%
Déshydratation de pommes de terre 48%
Mise en valeur des plants de pommes de terre 13%
Exportation de produits à base de pommes de terre 8%
Affouragement de pommes de terre fraîches 26%
Source: swisspatat
2 . 1 P R O D U C T I O N E T V E N T E S 2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E 149
2
■ Oléagineux: cap vers la libéralisation
L’Association suisse des producteurs de semences a été chargée de la mise en valeur des plants de pommes de terre Elle peut utiliser les ressources disponibles pour l’affouragement à l’état frais, pour la transformation en denrées fourragères (déshydratation) ainsi que pour l’exportation. L’association a bénéficié d’une contribution de 2,6 millions de francs pour la mise en valeur de la récolte de 1999
L’OFAG accorde en outre des contributions à l’exportation de produits à base de pommes de terre, toutefois dans les limites fixées par l’OMC A partir de 2000, lesdites contributions ne pourront, en effet, dépasser 2,3 millions de francs et 8’437 t de pommes de terre (exportations de plants comprises) Par ailleurs, l’accord de l’OMC sur l’agriculture oblige la Suisse à garantir un accès minimal au marché pour 22’250 t de pommes de terre. En ce qui concerne les plants, les pommes de terre de table et les pommes de terre destinées à la transformation, l’attribution des contingents tarifaires partiels se fait en fonction d’une prestation en faveur de la production du pays Le contingent tarifaire partiel de produits à base de pommes de terre est attribué par adjudication
La surface de pommes de terre a régressé au cours des dernières années pour descendre juste en dessous des 14’000 ha en 1999, soit le niveau requis pour l’autoapprovisionnement. Les rendements de la culture ayant, par ailleurs, été faibles, les récoltes n ’ont pas suffi à couvrir les besoins du pays en pommes de terre de table de la qualité souhaitée On a donc dû augmenter le contingent tarifaire pour des importations supplémentaires, surtout de pommes de terres destinées à l’industrie de transformation
Une garantie des prix et du placement a été accordée pour la dernière fois en 1999 pour une surface d’oléagineux maximum de 21’000 ha. La surface affectée à la culture du colza ne pouvait, quant à elle, dépasser les 16’000 ha Quant aux huileries, elles ont touché pour la transformation d’oléagineux suisses une contribution s ’alignant sur les coûts attestés. C’est en vue de créer des conditions initiales favorables à la nouvelle organisation du marché que la Confédération a soutenu en 1999 des opérations promotionnelles d’huile de colza 400 t de cette huile ont en outre été mises à disposition dans le cadre de l’aide alimentaire
Un droit de douane est perçu sur les huiles et les graisses comestibles ainsi que sur le beurre importés afin de protéger la production suisse de beurre et d’oléagineux Ce sont les prix sur le marché mondial de l’huile et des tourteaux qui déterminent les droits de douane perçus sur ces produits et, partant, les prix d’importation des oléagineux
Les dépenses de la Confédération pour la prise en charge, la transformation et la vente d’oléagineux se sont chiffrées à 36,8 millions de francs en 1999 Le décompte final sera disponible dès la suppression définitive de l’actuelle organisation du marché
2 . 1 P R O D U C T I O N E T V E N T E S 2 150
■ Matières premières renouvelables: passage aux nouvelles mesures de soutien
L’encouragement des matières premières renouvelables (MPR) permet les essais techniques et l’introduction sur le marché de produits de substitution fabriqués à partir de MPR En 1999, c ’est l’ancienne organisation du marché qui avait encore cours Sur les 1’852 ha de surfaces de culture donnant droit à des contributions, 83% reviennent au colza et 14% au roseau de Chine Un soutien a par ailleurs été accordé à de petites surfaces consacrées à la culture de chanvre, de tournesol, de soja et de kénaf 3,7 millions de francs ont été alloués au titre de contributions à la surface pour MPR
En 1999, pour la première fois, des contributions destinées à réduire le prix de la matière première pour l’éthanol et d’autres formes d’énergie produites à partir de la biomasse auraient pu être accordées Aucune demande n ’ a toutefois été présentée au cours de l’année sous revue.
■ Perspectives

Dans la session de printemps de 2000, le Parlement a approuvé l’abrogation de la loi sur le blé, abrogation qui deviendra effective au 30 juin 2001. Dès la récolte 2001, la Confédération se retirera en très grande partie du marché des céréales panifiables L’obligation de livraison et celle de prise en charge seront supprimées, tout comme les prix de base garantis Céréales panifiables et fourragères ne formeront plus qu ’ un seul marché Les mesures à la frontière seront maintenues en tant qu’instrument régulateur important de l’Etat. Si la récolte ne dépasse pas les besoins de la Suisse, les prix du marché mondial et les prélèvements douaniers détermineront le niveau des prix La réglementation des importations de céréales sera adaptée à la nouvelle organisation du marché qui entre en vigueur le 1er juillet 2001. Quant aux contributions à la culture des céréales fourragères, elles ont été ramenées de 770 fr /ha à 400 fr /ha pour la récolte 2000 Les contributions à la culture des légumineuses à graines ont été étendues aux lupins dès la récolte 2000
La nouvelle réglementation du marché des oléagineux s ’applique à la récolte 2000. Protection à la frontière, contributions spécifiques à la surface et contributions à la transformation sont les principaux instruments de soutien de la culture indigène de colza, de soja et de tournesol. Ils servent à maintenir la transformation judicieuse des oléagineux en Suisse La contribution à la surface pour oléagineux est accordée indépendamment d’une utilisation de ces produits pour l’alimentation humaine ou à d’autres fins La nouvelle réglementation des ces produits équivaut dans ses grandes lignes à celle de l’UE
Trois huileries en Suisse transformaient jusqu’ici les oléagineux en huile comestible L’huilerie LIPTON-SAIS a toujours produit de l’huile en utilisant le procédé d’extraction, tandis que la Florin SA et la SABO Oleificio recourent au procédé de pressage et sont ce qu’il est convenu d’appeler des entreprises de pressage Par rapport aux matières premières utilisées, le rendement en huile qu ’elles obtiennent est de 4% à 6% inférieur Les contributions à la transformation sont destinées à compenser l’écart de rendement de ces deux procédés, mais étant donné que l’huilerie LIPTON-SAIS fermera ses portes à fin octobre 2000, ce rôle compensateur perdra de son importance
2 . 1 P R O D U C T I O N E T V E N T E S 2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E 151
2
■ Fruits et légumes: la protection à la frontière en tant que pivot des organisations de marché
La production de MPR sera encouragée dès la récolte 2000 par les mesures suivantes:
contributions à la surface pour toutes les plantes à fibres, à la condition qu ’elles soient récoltées à maturité;
contributions à la transformation des oléagineux et pour la biomasse produite sur la SAU: cultivés en tant que MPR, les oléagineux feront l’objet d’une réduction du prix de la matière première s’ils sont transformés dans des installations pilotes et de démonstration
Les contributions à la transformation d’oléagineux dans lesdites installations ont été augmentées à 30 fr /dt pour l’année 2000, ce qui devrait garantir une parité avec les autres cultures des champs pendant la période transitoire Le taux de 20 fr /dt sera appliqué aux oléagineux dès 2001.
L’Organisation de la branche suisse des céréales et oléagineux a été fondée le 10 mars 1999 et comprend la production, les centres collecteurs, le commerce et les entreprises de transformation Elle reprendra les tâches assumées auparavant par la Confédération dans le secteur des céréales et des oléagineux, en particulier pour ce qui est de l’organisation de la production et des mesures de promotion des ventes Depuis le 15 septembre 2000, l’interprofession s ’appelle «swiss granum»
Cultures spéciales
Dans le secteur des fruits, on recourt surtout aux deux mesures suivantes:
1 La protection à la frontière allège les fortes pressions concurrentielles qui pourraient résulter de l’importation de mêmes sortes de fruits Mis à part la période durant laquelle il est possible d’importer à un TC bas, les contingents tarifaires sont échelonnés dans le temps, en fonction de l’offre de fruits suisses. Les importations complètent ainsi la production suisse selon les besoins du marché Lorsque ceux-ci sont couverts par la production du pays, aucune importation au TC n ’est autorisée Dans ces phases d’auto-approvisionnement, c ’est le THC plus élevé qui s ’applique.
2 La Confédération participe financièrement à la mise en valeur des fruits à cidre et aux mesures de dégagement du marché des fruits à noyau Elle paie en particulier les coûts de stockage et d’intérêt du capital liés aux réserves de concentrés de jus de fruits à pépins si celles-ci dépassent les besoins normaux des cidreries; elle alloue par ailleurs des contributions à l’exportation de produits de fruits à pépins (concentré, jus et poudre) ainsi que de cerises fraîches ou transformées La prise en charge des coûts de commercialisation pour les livraisons de cerises et de prunes en région de montagne tombent également dans cette catégorie de mesures de soutien et profite à une partie de la population dont les revenus sont faibles
Il s ’agit surtout d’un filet de sécurité pour les producteurs de fruits qui, par la force des choses, sont confrontés à d’importantes fluctuations de prix, souvent imprévues, lorsque l’offre dépasse la demande Vu l’alternance naturelle des récoltes, la possibilité restreinte d’échelonner celles-ci dans le temps et la durée limitée de conservation des produits, les producteurs ne disposent que de très peu de moyens pour prendre euxmêmes des mesures. Quant aux cultures d’arbres fruitiers haute-tige, la production extensive, l’entretien du paysage et le maintien de la biodiversité sont rémunérés, dans le cadre du système des paiements directs, par une contribution à la compensation écologique.
2 . 1 P R O D U C T I O N E T V E N T E S 2 152
–
–
■ Economie viti-vinicole: offensive médiatique pour augmenter les parts de marché
Dans le secteur des légumes, la seule intervention directe de l’Etat est la protection à la frontière, laquelle est administrée comme pour les fruits Pour ce qui est des fleurs coupées, cette protection se limite à la période allant du 1er mai au 25 octobre Dans les deux cas, cet instrument permet de contrer la forte concurrence qu ’exercent sur la Suisse l’UE et les pays d’outre-mer
Dépenses pour la mise en valeur des fruits en 1999

Stock de concentré de fruits à pépins 9,6%
Exportation de concentré de jus de poires 28,2%
Exportation de cerises 1,6%
Exportation d'autres produits de fruits pépins 2%
Total: 39,1 mio. de fr.
Exportation de concentré de jus de pommes 58,1%
Autres 0,4% Allégement du marché (cerises et pruneaux) 0,1%
Source: OFAG
En 1999, la Confédération a versé au total 39,1 millions de francs pour la mise en valeur des fruits. Sont compris dans ce montant le co-financement des exportations de concentrés de jus de pomme et de poire issus de la récolte de 1998 Le secteur des fruits a en outre versé 19,2 millions de francs dans le cadre de l’entraide
Les mesures prises dans ce secteur servent à promouvoir les ventes – en particulier à l’étranger –, à maintenir les surfaces viticoles en forte pente et en terrasses, à améliorer la qualité par des limitations quantitatives et par des exigences minimales, à procéder aux mesures de contrôle nécessaires et à protéger les appellations d’origine. Toutes ces interventions de l’Etat sont financées par le fonds vinicole qui vise à:
a soutenir les mesures destinées au maintien des surfaces viticoles, en particulier les paiements directs en faveur des surfaces en forte pente et en terrasses;
b promouvoir les ventes des produits de la vigne, l’encouragement des ventes de vin se limitant, en l’occurrence, aux seules exportations;
c couvrir les coûts des attestations de la qualité qui ne sont pas pris en charge par l’OFAG
Le contingent d’importation de vin blanc a été entièrement épuisé, ce qui a influé sur les importations Cela n ’ a pas été le cas pour le vin rouge Le contingent n ’ayant été mis à profit qu’à raison de 96,1%, il n ’ y a pas eu d’effet restrictif sur les importations.
Les contributions en faveur de l’économie viti-vinicole suisse se sont chiffrées à 7,2 millions de francs, dont 1,4 million pour les contrôles de la vendange et 5,8 millions pour la promotion des ventes (5,5 millions de francs pour les seules contributions à l’exportation).
2 . 1 P R O D U C T I O N E T V E N T E S 153
2 2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E
■ Tabac: un partenariat inévitable
La Confédération a entièrement cessé de financer la production suisse du tabac en 1992 Elle ne fixe plus aujourd’hui que le prix maximum à la production en tant que valeur indicative La convention établie entre la Fédération suisse des associations de planteurs de tabac et la Société pour l’achat du tabac indigène règle la production et la prise en charge du tabac du pays Conformément au système de financement du tabac suisse, les fabricants et les importateurs de cigarettes doivent verser dans un fonds une taxe de 0,13 ct par cigarette, prélevée sur la marchandise destinée au marché du pays Cette taxe sert à couvrir la différence entre les recettes provenant de la vente de tabac aux fabricants et les coûts d’une récolte, notamment la rétribution des planteurs au prix fixé par l’interprofession Dans le cadre de l’organisation du marché du tabac, 394 exploitations familiales, soit 14 de moins qu ’ en 1998, ont réalisé une valeur de récolte de 16,9 millions de francs sur 647 ha.

■ Perspectives
La concentration croissante enregistrée dans les secteurs des fruits, des légumes et des plantes ornementales place les fournisseurs devant de nouveaux défis Leur aptitude à subsister sur un marché plus libéral en tant que partenaires durables des grands distributeurs dépendra non seulement des quantités qu’ils vendront mais aussi de la qualité de leurs services Les mesures prises par la Confédération pour soutenir les cultures spéciales devront s ’orienter davantage sur le maintien à long terme des parts de marché
L’économie viti-vinicole suisse devra, elle aussi, se mesurer davantage à la concurrence étrangère Dès le 1er janvier 2001, les contingents tarifaires de vin blanc et de vin rouge seront réunis en un seul contingent de 170 millions de litres On escompte qu’il en résultera une pression accrue sur la production indigène de vin blanc De par ce regroupement, le contingent de vin rouge, qui n’était pas entièrement mis à profit jusqu’à maintenant, pourra être utilisé pour l’importation de vins blancs à des conditions douanières favorables En prévision de ce développement, les interventions sur le marché sont désormais limitées au strict nécessaire et les contrôles sont harmonisés dans le secteur de l’économie viti-vinicole.
154 2 . 1 P R O D U C T I O N E T V E N T E S 2
■■■■■■■■■■■■■■■■
2.2 Paiements directs
Les paiements directs sont l’élément principal de la réorientation de la politique agricole Ils permettent, d’une part, de séparer la politique des prix et des revenus et, d’autre part, de rétribuer les prestations fournies à la demande de la collectivité On fait une distinction entre les paiements directs généraux et les paiements directs écologiques, les contributions écologiques faisant partie des seconds
Dépenses pour les paiements directs en 1999
Remarque: une comparaison directe avec les données du Compte d’Etat est impossible
Les valeurs indiquées sous 2 2 «Paiements directs» se rapportent à l’ensemble de l’année de contributions, alors que le Compte d’Etat indique les dépenses d’une année civile
Source: OFAG

2 . 2 P A I E M E N T S D I R E C T S 2
Mesure mio de fr Paiements directs généraux 1 769 Paiements directs écologiques 309 Total 2 078
155
■
2.2.1 Concept, rôle, exigences, exécution et contrôle
Rétribution de prestations fournies dans l’intérêt général
Ces prestations de l’agriculture sont rétribuées au moyen des paiements directs généraux En font partie les contributions à la surface et les contributions pour les animaux consommant des fourrages grossiers, contributions qui ont pour objectif d’assurer l’exploitation et l’entretien de toute la surface agricole Dans la région des collines et de montagne, les agriculteurs touchent en outre des contributions pour des terrains en pente et d’autres pour la garde d’animaux dans des conditions difficiles Il est ainsi tenu compte des difficultés d’exploitation dans ces régions Les prestations écologiques requises (PER) sont le préalable de l’octroi de tous les paiements directs

■ Rétribution de prestations écologiques particulières
Les paiements directs écologiques sont une incitation à fournir des prestations écologiques particulières qui dépassent le cadre des PER. En font partie les contributions écologiques, les contributions d’estivage et celles qui sont allouées pour la protection des eaux On entend par elles préserver et accroître la diversité des espèces dans les régions agricoles, diminuer la pollution des eaux par les nitrates et les phosphores tout en soutenant les systèmes de garde d’animaux de rente particulièrement respectueux de l’espèce.
2 . 2 P A I E M E N T S D I R E C T S 2 156
■■■■■■■■■■■■■■■■
■ Importance économique des paiements directs
En 1999, les paiements directs ont représenté quelque 55% des dépenses de l’OFAG. 63% de tous les paiements directs, contributions d’estivage incluses, sont allés à la région des collines et de montagne
une comparaison directe avec les données du Compte d’Etat est impossible Les valeurs indiquées sous 2 2 «Paiements directs» se rapportent à l’ensemble de l’année de contributions, alors que le Compte d’Etat indique les dépenses d’une année civile
2 . 2 P A I E M E N T S D I R E C T S 2 157 2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E
Paiements directs en
Type de contribution Total Région de Région des Région de plaine collines montagne 1 000 fr Total paiements directs 2 078 350 Paiements directs généraux 1 769 482 615 686 469 647 684 149 Contributions à la surface 1 163 094 545 168 300 104 317 822 Contributions pour la garde d’animaux consommant des fourrages grossiers 254 624 65 568 62 745 126 312 Contributions pour la garde d’animaux dans des conditions difficiles 255 882 2 723 72 037 181 121 Contributions pour les terrains en pente 95 882 2 227 34 761 58 894 Paiements directs écologiques 308 868 Contributions écologiques 241 136 124 638 68 179 48 319 Contributions à la compensation écologique 100 674 53 345 27 874 19 455 Contributions pour la culture extensive de céréales et de colza (culture extensive) 35 135 23 360 10 443 1 332 Contributions pour la culture biologique 11 637 4 382 2 384 4 871 Contributions pour la garde d’animaux de rente particulièrement respectueuse de l’espèce 93 690 43 551 27 478 22 661 Contributions d’estivage 67 571 Contributions pour la protection des eaux 161 Remarque:
Source: OFAG
1999
Paiements directs versés selon la région en 1999

La région des collines et de montagne est défavorisée sur le plan des conditions de production. En voici les principaux inconvénients:
– période de végétation plus courte, d’où des rendements réduits et des dépenses plus élevées pour la conservation des aliments destinés aux animaux; périodes de travail très intensif;
– l’exploitation des terrains en pente est plus difficile, la mécanisation coûte plus cher tout en étant moins performante;
– les voies de communication sont généralement moins favorables, ce qui prolonge les trajets et entraîne un surcroît de dépenses pour les transports, les achats, etc
L’exploitation plus difficile de ces régions est compensée à l’aide de contributions pour la garde d’animaux dans des conditions difficiles, de contributions pour des terrains en pente et de contributions d’estivage Il s ’ensuit que la somme des paiements directs par ha augmente proportionnellement aux difficultés d’exploitation A l’aune de la baisse des rendements en montagne, la part des paiements directs au rendement brut y occupe une place d’autant plus importante par rapport à la plaine
Part des paiements directs au rendement brut des exploitations, selon les régions, en 1999
2 . 2 P A I E M E N T S D I R E C T S 2 158
Caractéristique Unité Total Région de Région des Région de plaine collines montagne Exploitations Nombre 3 494 1 565 1 029 900 SAU en Ø ha 18,41 19,33 17,19 18,06 Paiements directs généraux fr 31 176 24 114 30 851 43 982 Contributions écologiques fr 5 272 6 338 5 244 3 420 Total paiements directs fr 36 338 30 452 36 095 47 402 Rendement brut fr 181 702 218 369 169 340 131 838 Part des paiements directs au rendement brut % 20,1 13,9 21,6 36,0 Source: FAT
Région de plaineRégion des collinesRégion de montagne f r . / h a Source: FAT 0 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 1575 2100 2625
Tableaux 33a–34, pages A40–A43
■ Exigences générales
Exigences requises pour l’octroi de paiements directs
A droit aux paiements directs l’exploitant qui gère une exploitation agricole pour son compte et à ses risques et périls et qui a son domicile civil en Suisse. N’y ont pas droit les exploitations de la Confédération, des cantons et des communes, ni les exploitants dont les cheptels dépassent les plafonds fixés dans l’ordonnance sur les effectifs maximums Sont également exclues les personnes morales, sauf s’il s ’agit d’exploitations familiales (art 2, OPD)
■ Autres conditions
Le droit aux contributions est encore lié à d’autres critères structurels et sociaux Le schéma ci-après récapitule en quelques mots-clés les conditions liées à l’octroi des paiements directs
Conditions requises pour l’octroi des paiements directs
Taille minimale de l’exploitation
Besoin minimal en travail
Main-d’oeuvre propre à l’exploitation
Age de l’exploitant
Plafonnement des contributions
– Echelonnement
1 ha
Cultures spéciales: 50 ares
Surfaces viticoles en forte pente et en terrasses: 30 ares
0,3 unité de main-d’oeuvre standard (UMOS)
Au moins 50% des travaux nécessaires à l’exploitation effectués à l'aide de la main-d'œuvre propre à l'exploitation (famille et employés).
jusqu’à 65 ans
Surface en ha Nombre d’animaux, Taux en % en UGB
Montant maximum par UMOS 45 000 francs
– Revenu imposable
Somme des paiements directs réduite dès 80 000 francs de revenu imposable
Somme des paiements directs réduite dès 800 000 francs (fortune imposable, moins 120 000 francs de fortune déterminante; suppression des paiements directs par UMOS) si la fortune déterminante dépasse 1 million de francs
Fortune déterminante
Source: Ordonnance sur les paiements directs (OPD)
2 . 2 P A I E M E N T S D I R E C T S 2 2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E 159
jusqu’à 30 45 100 30–60 45–90 75 60–90 90–135 50 plus de 90 135 0
–
–
Suppléments
Terrains en pente dans la région de montagne et des collines 0,02 UMOS par ha

arbres
Source: Ordonnance sur la terminologie agricole
Le calcul des UMOS se fait à l’aide de facteurs de conversion pour la SAU et les animaux de rente. Des suppléments sont versés pour certains modes d’exploitation tels que la culture biologique, qui demande plus de travail Ces facteurs sont dérivés du relevé standard des processus de l’économie du travail Ils ont été simplifiés pour l’exécution des paiements directs et pour les mesures relevant des améliorations structurelles Ils ne se prêtent pas au calcul du besoin en travail effectif puisque celui-ci dépend des particularités de l’exploitation telles que la configuration du terrain, le regroupement des terres, les bâtiments et le degré de mécanisation
Echelonnement des contributions selon art. 20 OPD
Contributions à la surface
Contributions pour les animaux consommant des fourrages grossiers
L’échelonnement en pour-cent vaut pour tous les types de contributions, à l’exception de celles qui sont allouées pour l’estivage et pour la protection des eaux.
2 . 2 P A I E M E N T S D I R E C T S 2 160 Surface agricole utile UMOS/ha SAU sans les cultures spéciales 0,035 Cultures spéciales 0,400 Surfaces viticoles en forte pente et en terrasses 1,000 Animaux de rente UMOS/UGB Vaches laitières, brebis laitières et chèvres laitières 0,05 Porcs à l’engrais 0,01 Porcs d’élevage 0,02 Autres animaux de rente 0,04
Culture biologique Comme pour la SAU, plus 20% Arbres fruitiers haute-tige 0,01 UMOS/10
f r . / h a
1–30 ha>30–60 ha>60–90 ha>90 ha
f r . / U G B F G 0 1 200 900 600 300 0 900 675 450 225
1–45 UGBFG>45–90 UGBFG>90–135 UGBFG>135 UGBFG
■ Prestations écologiques requises
Depuis 1999, seuls les exploitants qui fournissent les PER peuvent toucher des paiements directs Si tel n ’est pas le cas, des paiements leur seront versés jusqu’au 31 décembre 2001 Toutefois, les contributions à la surface seront dès lors réduites de 800 francs par ha de surface donnant droit aux contributions. L’instauration des PER a permis d’intégrer les charges liées à la production intégrée (PI, état 1996) Par ailleurs, l’exploitant doit prouver qu’il respecte les prescriptions de la législation sur la protection des animaux Complétée par les charges en la matière, la PI est ainsi devenue la norme de l’agriculture suisse et n ’existe plus en tant que telle
Les paiements directs ont exercé une influence considérable sur les systèmes d’exploitation et, partant, sur l’écologie. On en citera pour preuve l’important recul des surfaces exploitées de manière traditionnelle depuis la première étape de la réforme agricole amorcée en 1993 C’est par des incitations financières que la PI et l’agriculture biologique ont été encouragées systématiquement en tant que programmes écologiques indépendants, de façon à représenter 90% de l’ensemble de la SAU en 1998 Depuis l’introduction des PER en 1999, cette part est passée à 95%, ce qui assure pour ainsi dire une exploitation respectueuse de l’environnement et de la nature sur la quasi-totalité du territoire suisse L’écart qui subsiste s ’explique en partie par le délai transitoire précité.
2 . 2 P A I E M E N T S D I R E C T S 2 2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E 161
(PER) De la PI aux PER Programme facultatif, contributions particulières Dès 1993
Dès 1999 PIPER
Quantités exportées et contributions à l'exportation Quantités exportées, en t Contributions à l'exportation, en mio. de fr. Source: OFAG 180 128 137 130 92 000 78 000 85 000 84 000 1991/921997199819991991/92199719981999
Exigences minimales pour les paiements directs
et renversement du fardeau de la preuve dans le domaine de la protection des animaux
Les PER comprennent les points suivants (conformément à l’annexe OPD):
– Devoir d’enregistrement et de preuve: pour avoir droit aux paiements directs, l’exploitant doit prouver qu’il fournit les PER dans l’ensemble de son exploitation, au moyen d’une attestation délivrée par l’organisation de contrôle cantonale Pour recevoir celle-ci, il tiendra à jour des enregistrements concernant la gestion de l’exploitation
– Garde des animaux de rente respectueuse de l’espèce: les dispositions de l’ordonnance sur la protection des animaux doivent être observées, le renversement du fardeau de la preuve étant valable en l’occurrence, c ’est-à-dire que l’exploitant doit prouver qu’il respecte la loi sur la protection des animaux.
– Bilan de fumure équilibré: pour réduire les pertes d’éléments nutritifs dans l’environnement et garder le cycle de ces éléments aussi fermé que possible, les apports d’azote et de phosphore doivent être calculés en fonction du besoin des plantes et du potentiel de production de l’exploitation On évite ainsi les apports excessifs, tout en garantissant une tolérance de 10%
Des analyses du sol doivent être effectuées par parcelle au moins tous les dix ans, pour que l’on puisse connaître les réserves du sol en nutriments et les quantités d’engrais nécessaires au maintien de la fertilité du sol
– Part équitable de surfaces de compensation écologique (SCE): au moins 3,5% de la SAU dans le cas des cultures spéciales, et 7% pour le reste de la SAU Des bandes herbeuses d'une largeur minimale de 0,5 m doivent être maintenues le long des chemins, et d’une largeur de 3 m le long des cours d’eau, des plans d’eau, des haies, des bosquets champêtres, des berges boisées et des lisières de forêt.
– Assolement régulier: pour maintenir la fertilité du sol et assurer un bon état sanitaire des plantes, le plan d’assolement annuel doit comprendre un nombre minimal de quatre cultures différentes Dans les exploitations comptant plus de 3 ha de terres ouvertes, les cultures principales doivent occuper la plus grande partie des terres assolées; des pauses entre les cultures peuvent, par ailleurs, être prescrites
Exemples de parts maximales de cultures en % des terres assolées

2 . 2 P A I E M E N T S D I R E C T S 2 162
Céréales (sans le
et l’avoine) 66 Blé et épeautre 50 Maïs 40 Avoine 25 Betteraves 25 Pommes de terre 25
maïs
■ Observation des lois
– Protection appropriée du sol: des indices de protection du sol sont définis pour chaque culture Afin de réduire l’érosion du sol et les pertes d’éléments nutritifs ou de produits phytosanitaires, les exploitations de plus de 3 ha de terres ouvertes sont tenues d’atteindre un certain nombre de points pour l’indice moyen de protection. Pour les cultures des champs, cet indice est de 50 points, contre 30 points pour les cultures maraîchères Les dates des relevés sont le 15 novembre et le 15 février
Exemples de l’indice de protection du sol en culture des champs Points
– Sélection et utilisation ciblée des produits phytosanitaires: ces produits peuvent atteindre l’air, le sol et l’eau et entraîner des effets négatifs indésirables sur certains organismes On leur préférera des mécanismes de régulation naturels et des procédés biologiques. Les produits autorisés, soumis à certaines restrictions d’utilisation, sont répertoriés dans une liste tenue à jour
Si l’exploitant viole les prescriptions pertinentes pour l’agriculture de la loi sur la protection des eaux, de la loi sur la protection de l’environnement et de la loi sur la protection de la nature et du paysage, il risque non seulement une amende mais encore une réduction ou une suppression des paiements directs
Voici quelques exemples de prescriptions dont la violation peut entraîner des sanctions:
– Devoir de diligence destiné à empêcher toute atteinte nuisible aux eaux (article 3 LEaux);
– Interdiction d’introduire ou d’infiltrer dans une eau des substances de nature à la polluer et de déposer et d’épandre de telles substances s’il existe un risque concret de pollution de l’eau (article 6 LEaux);
– Non-respect des valeurs limites relatives aux UGBF fixées à l’article 14 LEaux (en fonction de la surface agricole utile fertilisable);
– Capacité de stockage insuffisante pour les engrais de ferme selon l’article 14 LEaux;
– Installations de stockage des engrais de ferme qui ne sont pas en état de fonctionner et pas étanches (article 28 OEaux);
– Stockage permanent de fumier dans les champs (>3 mois).
2 . 2 P A I E M E N T S D I R E C T S 2 2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E 163
Colza 80 Orge d’automne, triticale, seigle, avoine d’automne 50 Blé d’automne, épeautre 40 Prairie artificielle jusqu’au 15 novembre 80 Prairie artificielle jusqu’au 15 février 100
Les infractions à ces prescriptions sont traitées individuellement en fonction des faits antérieurs et compte tenu des conséquences qu ’elles entraînent Elles sont attribuées à l’une des trois catégories suivantes:
– Infraction unique sans effets durables Exemple: épandage unique de purin, contraire à la législation sur la protection des eaux (réduction de 5 à 25%, et de 2’500 fr au max )
– Infractions uniques aux effets persistants, agissements ou omissions s’étendant sur plusieurs jours, semaines ou mois Exemple: tas de fumier non consolidé; épandages successifs de purin à des jours différents, contraires à la législation sur la protection des eaux (réduction de 10 à 50%, et de 10’000 fr au max )
Infractions répétées dans les trois ans contre les mêmes dispositions ayant trait à l’agriculture Sont déterminants les incidents à partir de l’année 1999 (réduction de 20 à 100%)
Exécution et contrôle
L’article 66 OPD délègue aux cantons la tâche de contrôler les PER Sur le plan de l’exécution, ils peuvent y associer des organisations présentant toutes garanties de compétence et d'indépendance après les avoir préalablement contrôlées par sondage L’alinéa 4 précise selon quels critères les cantons ou les organisations associées sont tenues de contrôler les exploitations.
Sont assujetties à un contrôle:
toutes les exploitations qui demandent des contributions pour la première fois; – toutes les exploitations dans lesquelles des manquements ont été constatés lors de contrôles effectués l’année précédente; et
au moins 30% d’autres exploitations choisies au hasard
Depuis 1999, les exploitants qui fournissent des données fallacieuses concernant l’exploitation ou qui ne remplissent pas ou que partiellement les exigences liées à l’octroi des contributions sont sanctionnés selon des critères uniformes La Conférence des directeurs cantonaux de l’agriculture a édicté un dispositif de sanctions à cet effet
2 . 2 P A I E M E N T S D I R E C T S 2 164
–
–
–
■ Contrôles effectués en 1999
En 1999, les cantons ou les organismes mandatés ont procédé à environ 30’000 contrôles d’exploitations, dont 4'500 exploitations bio, pour vérifier si les PER étaient fournies Ont par ailleurs été contrôlées 58,2% des exploitations qui assurent à leurs animaux des sorties régulières en plein air (SRPA) et 58,5% des exploitations qui les gardent dans des systèmes particulièrement respectueux de l’espèce (SST)
Au total, 4'000 infractions ont été constatées, ce qui a entraîné des réductions de contributions de 8,2 millions de francs Ne sont pas compris dans ce montant les contributions non versées pour données fallacieuses dans la déclaration, ni les retenues auprès des exploitants n 'ayant pas droit aux contributions Les infractions ont concerné essentiellement les domaines suivants: exigences PER, programme SRPA, compensation écologique, exigences SST, conditions générales de la protection des eaux
de base
Schéma des infractions
compensation écologique insuffisante, bilan de fumure non équilibré, analyses du sol manquantes, assolement incorrect, autres motifs non spécifiés
2 . 2 P A I E M E N T S D I R E C T S 2 2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E 165
exigences
et des animaux,
Catégorie Infractions Sanctions Raisons principales Nombre fr Données de base 200 670 000 Fausses données concernant les surfaces, déclarations tardives; fausses données concernant le contingentement laitier, exploitants n ’ayant pas droit aux contributions Protection des eaux 170 378 000 Espace nécessaire au stockage des engrais de ferme insuffisant, endroits de stockage peu satisfaisants Protection de la nature 15 15 000 Inobservation des charges relatives à l'exploitation et du paysage Protection des animaux 100 65 000 Inobservation des prescriptions en matière d’étables et de systèmes de garde, intensité de la lumière, jours de sortie au pâturage Protection de l’environnement 15 1 Mise en danger des eaux PER 2 540 6 750 000 Enregistrements lacunaires,
SCE 540
Inobservation
Culture extensive 13 8 900 Enregistrements lacunaires Bio 2 17 6 500 Pas d’indication possible SST 110 31 000 Etables non conformes, aire de
insuffisante,
non spécifiés SRPA 254 65 000 Trop peu de journées de sorties ou de
enregistrements lacunaires Total 3 974 8 175 000 1 pas d’indication possible 2 Données de 7 cantons
186 000
des dates de fauche, données fausses concernant les surfaces, déclarations tardives ou incorrectes, fumure interdite
repos
autres motifs
pacage,
Autorisations spéciales
Les services cantonaux de protection des plantes peuvent délivrer des autorisations spéciales en vertu de l’OPD. En 1999, ils en ont accordé 2'270 pour 2'771 ha de SAU. La plupart de ces autorisations ont été délivrées pour traiter les mauvaises herbes dans des prairies naturelles ou pour réensemencer des prairies artificielles, surtout pour lutter contre le rumex
Autorisations spéciales accordées en 1999

Produits Autorisations Part Nombre % Herbicides en prélevée 84 3,7 Insecticides 302 13,3 Granulés dans le maïs 93 4,1 Granulés dans les betteraves 7 0,3 Herbicides pour prairies 1 435 63,2 Autres 349 15,4 Total 2 270 100 2 . 2 P A I E M E N T S D I R E C T S 2 166
■ Objectif: l’exploitation de toute la surface agricole
2.2.2 Paiements directs généraux
Contributions à la surface
Les contributions à la surface servent à rétribuer les prestations fournies dans l'intérêt général telles que la protection et l’entretien du paysage rural, la préservation des fonctions de l'espace rural et la sécurité alimentaire Elles ne sont pas différenciées selon l’utilisation des surfaces ou les régions Dans la région des collines et de montagne, où les conditions sont plus difficiles, les agriculteurs touchent en outre des contributions pour des terrains en pente et d’autres pour la garde d’animaux dans des conditions difficiles.
Pour les surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère, les taux de tous les paiements directs liés aux surfaces sont réduits de 25%. Il s ’agit en tout de 5'128 ha, exploités dans la zone limitrophe depuis 1984 Contributions à la surface en 1999
■■■■■■■■■■■■■■■■
Taux de 1999 fr./ha – jusqu’à 30 ha 1 200 – de 30 à 60 ha 900 – de 60 à 90 ha 600 – plus de 90 ha 0
Caractéristique Unité Région de Région des Région de Total plaine collines montagne Surface ha 480 769 261 164 280 012 1 021 945 Exploitations Nombre 25 766 16 430 18 500 60 696 Surface par exploitation ha 19 16 15 17 Contribution par exploitation fr 21 158 18 266 17 180 19 163 Total des contributions 1 000 fr 545 168 300 104 317 822 1 163 094
Source: OFAG
2 . 2 P A I E M E N T S D I R E C T S 2 2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E 167
Tableaux 27a–27b, pages A28–A29
7,3% de la SAU sont touchés par la réduction des contributions résultant de l’échelonnement En moyenne, la contribution à la surface qui est versée se chiffre à 1'138 francs Les entreprises comptant jusqu’à 10 ha exploitent ensemble 11,2% de la SAU
Contributions pour la garde d’animaux consommant des fourrages grossiers
Cette mesure a pour objectif de préserver la compétitivité des producteurs de viande disposant d’une base fourragère et d’assurer en même temps l’exploitation de l’ensemble des terres agricoles de la Suisse, pays à vocation herbagère
Les contributions pour la garde d’animaux consommant des fourrages grossiers sont versées pour des animaux gardés dans l’exploitation durant la période d’affouragement d’hiver (période de référence: entre le 1er janvier et le jour de référence de l’année de contributions) Par animaux consommant des fourrages grossiers, on entend les bovins et les équidés, ainsi que les moutons, les chèvres, les bisons, les cerfs, les lamas et les alpagas Les contributions sont versées pour les surfaces herbagères permanentes ou pour les prairies artificielles: les diverses catégories d’animaux sont converties en unités de gros bétail fourrage grossier (UGBFG)
2 . 2 P A I E M E N T S D I R E C T S 2 168 Exploitations et SAU: distribution selon la classe de grandeur plus de 90 Exploitations en %SAU en % 60–90 30–60 20–30 15–20 10–15 5–10 jusqu'à 5 Source:
C l a s s e s d e g r a n d e u r e n h a SAU avec contributions intégrales SAU touchée par la dégression 302010 0 102030 0,2 1,11,5 (1,1 17,4 26,7 19,0 17,1 9,2 9,7 0,6 0,1 18,5 18,3 23,1 20,1 9,52,0 5,0 0,4) (0,20,20,8 0,4) 0,2 0,1 0,61,11,5 0,8
OFAG
Limites d’encouragement UGBFG/ha – zone de grandes cultures, zone intermédiaire élargie et zone intermédiaire 2,0 – zone des collines 1,6 – zone de montagne I 1,4 – zone de montagne II 1,1 – zone de montagne III 0,9 – zone de montagne IV 0,8 – prairies de fauche situées en région d’estivage 0,7 ■
Utilisation des surfaces par des herbages
L'échelonnement selon les zones de la limite pour l'octroi des contributions correspond, d’une part, à celui de la charge en bétail maximale prévue dans les instructions pratiques pour la protection des eaux dans l'agriculture et tient compte, d’autre part, du potentiel de rendement décroissant. Ainsi, ces contributions exercent un effet neutre sur la production, tout en contribuant substantiellement à l’exploitation de toute la surface agricole
A droit aux contributions celui qui garde au moins une UGBFG dans son exploitation Les UGBFG sont réparties entre deux groupes de contributions Pour les bovins, équidés, bisons, chèvres et brebis laitières, le taux est de 900 francs par UGBFG, alors qu’il est fixé à 400 francs pour les autres chèvres et moutons ainsi que pour les cerfs, les lamas et les alpagas. Les contributions sont plus élevées pour les animaux exigeant davantage de travail et d'investissements dans les bâtiments
Contributions pour la garde d’animaux consommant des fourrages grossiers en 1999
Ces contributions ont remplacé celles qui ont été versées jusqu’en 1998 aux détenteurs de vaches ne mettant pas de lait dans le commerce. Elles sont désormais allouées non seulement pour les vaches dont le lait n ’est pas commercialisé, mais encore pour les autres animaux consommant des fourrages grossiers Les exploitations qui gardent des vaches en commercialisant leur lait profitent du soutien du marché dans le secteur laitier Il n 'est pas versé de contributions pour ces vaches, l'effectif de bétail étant réduit d'une UGBFG par 4000 kilos de lait livrés l’année précédente Pour ce qui est des producteurs de lait qui touchent les contributions, ils gardent une proportion relativement importante d’animaux d’élevage et d’engraissement par rapport à leur effectif de vaches et disposent d’une surface herbagère suffisante; il s ’agit donc d’exploitations plutôt extensives

2 . 2 P A I E M E N T S D I R E C T S 2 2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E 169
Caractéristique Unité Région de Région des Région de Total plaine collines montagne UGBFG donnant droit aux contributions Nombre 74 419 70 599 144 449 289 467 Exploitations Nombre 10 815 11 412 16 541 38 768 UGBFG donnant droit aux contributions par exploitation Nombre 6,9 6,2 8,7 7,5 Contribution par exploitation fr. 6 063 5 498 7 636 6 568 Total des contributions 1 000 fr 65 568 62 745 126 312 254 624 Source: OFAG
Contributions pour les exploitations avec et sans lait commercialisé
Contributions pour la garde d’animaux consommant des fourrages grossiers dans des conditions de production difficiles
■ Compensation des difficultés de production
Ces contributions servent à compenser les conditions de production difficiles des éleveurs dans la région de montagne et dans la zone des collines Contrairement aux contributions «générales» allouées pour la garde d’animaux de rente consommant des fourrages grossiers, destinées en premier lieu à promouvoir l’exploitation et l’entretien des herbages, cette mesure comporte aussi des aspects sociaux et structurels et vise des objectifs relevant de l’occupation du territoire. Les contributions sont versées aux exploitants qui exploitent au moins un ha de SAU dans la zone des collines ou dans la région de montagne et qui détiennent au moins une UGBFG Donnent droit aux contributions les mêmes catégories d’animaux que dans le cas des contributions versées pour la garde d’animaux consommant des fourrages grossiers Les contributions étant octroyées pour un maximum de 15 UGBFG par exploitation, cette mesure favorise les plus petites d’entre elles Les taux des contributions sont différenciés selon les zones
2 . 2 P A I E M E N T S D I R E C T S 2 170
Caractéristique Unité Exploitations avec Exploitations sans lait commercialisé lait commercialisé Exploitations Nombre 23 903 14 865 Animaux par exploitation UGBFG 22,1 12,1 Réduction des contributions en raison de la surface herbagère UGBFG 1,2 1,5 Déduction pour lait commercialisé UGBFG 15,3 0,1 Animaux donnant droit aux contributions UGBFG 5,6 10,5 Contribution par exploitation fr 4 930 9 201 Source: OFAG
Taux par UGBFG en 1999 fr /ha – zone des collines 260 – zone de montagne I 440 – zone de montagne II 690 – zone de montagne III 930 – zone de montagne IV 1 190
Contributions pour la garde d’animaux dans des conditions difficiles en 1999

des surfaces dans la région de montagne ou dans celle des collines
Animaux consommant des fourrages grossiers gardés dans des conditions de production difficiles: distribution selon la classe de grandeur
2 . 2 P A I E M E N T S D I R E C T S 2 2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E 171
Caractéristique Unité Région de Région des Région de Total plaine 1 collines montagne UGBFG donnant droit aux contributions Nombre 29 633 207 304 218 240 455 177 Exploitations Nombre 2 074 15 648 17 971 35 693 UGBFG par exploitation Nombre 14,3 13,2 12,1 12,7 Contribution par exploitation fr 1 313 4 603 10 079 7 161 Total des contributions 1 000 fr 2 723 72 037 181 121 255 882 1 Exploitations exploitant une
Source: OFAG 3 6 , 5 % d u c h e p t e l d e s e x p l o i t a t i o n s a ya n t d r o i t a u x c o n t r i b u t i o n s d é p a s s e n t l e s 15 UGBFG Un tiers des UGBFG sont donc exclus
partie
Source: OFAG C l a s s e s d e g r a n d e u r e n h a UGBFG avec contribution UGBFG sans contribution 15010050050150100200250 45 à 90 30 à 45 20 à 30 15 à 20 10 à 15 5 à 10 jusqu'à 5 27 7193 131 10118 732 41 1 7 88 46 16 69 60 58 20 83 65 Exploitations en 100Animaux en UGBFG en 1 000
■ Contributions générales pour les terrains en pente: compensation d’une exploitation difficile des surfaces
Contributions pour les terrains en pente

Les contributions générales pour des terrains en pente compensent l’exploitation des terres dans des conditions difficiles Elles sont uniquement versées pour les prairies, les surfaces à litière et les terres assolées Les prairies et les surfaces à litière doivent être fauchées au moins une fois par an Par contre, les contributions ne sont pas octroyées pour les haies et les bosquets champêtres, ni pour les pâturages et les vignobles
Ont droit aux contributions les exploitants dont l’exploitation comprend une surface en pente, dans la région des collines ou de montagne, dépassant 50 ares en tout et 5 ares par parcelle d’exploitation. On distingue deux degrés de déclivité:
Taux de 1999 fr./ha – Déclivité de 18 à 35% 370 – Déclivité de plus de 35% 510
2 . 2 P A I E M E N T S D I R E C T S 2 172
Contributions versées pour des terrains en pente en 1999
■ Contributions pour des terrains en pente: préservation des surfaces viticoles en forte pente et en terrasses
déclivité inférieure 18% 57,7%
déclivité de 18 à 35% 27,0%
déclivité de plus de 35% 15,3%
Source: OFAG
42,3% de la SAU des quelque 34'000 exploitations ayant droit aux contributions ont une déclivité supérieure à 18% Rapporté à toute la Suisse, les surfaces en pente et en forte pente représentent 22,4% des surfaces agricoles utiles pour lesquelles des contributions à la surface sont versées
Les contributions octroyées pour les surfaces viticoles en pente contribuent à la préservation des vignobles plantés en pente et en terrasses Il convient de faire la distinction entre, d’une part, les fortes et les très fortes pentes et, d’autre part, les terrasses aménagées sur des murs de soutènement Ces caractéristiques augmentent l’attrait du paysage, mais elles rendent aussi l’exploitation plus difficile. Pour les vignobles, les contributions sont allouées à partir d’une déclivité de 30%
Sont réputés vignobles en terrasse à partir d’une déclivité de 30% les surfaces viticoles composées de paliers réguliers, épaulés par des murs de soutènement, qui remplissent les conditions suivantes:
– densité minimale de terrasses, c ’est-à-dire distance maximale de 30 m entre les murs de soutènement;
– l’aménagement en terrasses doit couvrir un périmètre de 1 ha au moins;
– les murs de soutènement doivent mesurer au moins 1 m de hauteur, les murs en béton ordinaires n’étant pas pris en compte.
Caractéristique Unité Région de Région des Région de Total plaine 1 collines montagne Surfaces donnant droit aux contributions: – déclivité de 18 à 35% ha 4 349 68 242 73 416 146 007 – déclivité de plus de 35% ha 1 268 19 075 62 549 82 892 Total ha 5 618 87 316 135 964 228 898 Exploitations Nombre 2 032 14 568 17 303 33 903 Contribution par exploitation fr 1 096 2 386 3 404 2 828 Total des contributions 1 000 fr 2 227 34 761 58 894 95 882
1
Exploitations
englobant des surfaces situées dans la région de montagne et des collines Source: OFAG
Exploitations ayant touché des contributions pour terrains en pente en 1999
2 . 2 P A I E M E N T S D I R E C T S 2 2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E 173
Total 541 800 ha
Ont droit aux contributions les exploitants dont l’exploitation comprend une surface viticole en pente donnant droit aux contributions qui dépasse 10 ares en tout et 2 ares par parcelle d’exploitation Les taux des contributions sont fixés indépendamment des zones.
Contributions versées pour les vignes en forte pente et en terrasses en 1999
La part des surfaces viticoles en forte pente et en terrasses représente 31,8% de la surface viticole totale, et le nombre d’exploitations 57,2% du total des exploitations viticoles.

Taux de 1999 fr /ha – surface de 30 à 50% de déclivité 1 500 – surface de plus de 50% de déclivité 3 000 – surface en terrasse 5 000
Caractéristique Unité Surfaces donnant droit à la contribution; total 3 122 forte pente, déclivité de 30 à 50% ha 1 601 forte pente, déclivité de plus de 50% ha 340 terrasses ha 1 181 Exploitations Nombre 2 650 Surface par exploitation ha 1,18 Contribution par exploitation fr 3 519 Total des contributions 1 000 fr. 9 325 Source: OFAG
2 . 2 P A I E M E N T S D I R E C T S 2 174
2.2.3 Paiements directs écologiques
Contributions écologiques
Les paiements directs écologiques rétribuent des prestations écologiques particulières qui dépassent le cadre des PER Les exploitants peuvent choisir librement de participer à différents programmes qui leur sont offerts Ceux-ci sont indépendants les uns des autres, et les contributions peuvent être cumulées
SRPA 30%
SST 9%
biologique 5%
Compensation écologique
Compensation écologique 41%
Culture extensive de céréales et de colza 15%
Source: OFAG
En encourageant la compensation écologique, on entend préserver et, si possible, étendre l’espace vital de la faune et de la flore suisses dans les régions agricoles Par ailleurs, la compensation écologique contribue au maintien des structures et des éléments paysagers typiques Certains éléments de la compensation écologique sont rétribués à l’aide de contributions et peuvent en même temps être imputés à la compensation écologique obligatoire des PER D’autres éléments ne peuvent, par contre, être imputés qu’à la compensation écologique des PER
■■■■■■■■■■■■■■■■
Tableaux 28a–28b, pages A30–A31
Répartition des contributions écologiques entre les différents programmes en 1999
Agriculture
2 . 2 P A I E M E N T S D I R E C T S 2 2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E 175
Total 241,1 mio. de fr.
Tableaux 29a–29d, pages A32–A35
Eléments de la compensation écologique, donnant droit ou non à des contributions
Eléments imputables aux PER et donnant droit
Eléments imputables aux PER sans donner droit aux contributions aux contributions prairies extensives pâturages extensifs prairies peu intensives pâturages boisés surfaces à litière arbres isolés indigènes adaptés au site et allées d’arbres haies, bosquets champêtres et berges boisées fossés humides, mares, étangs
jachères florales surfaces rudérales, tas d’épierrage et affleurements rocheux jachères tournantes murs de pierres sèches bandes culturales extensives chemins naturels non stabilisés arbres fruitiers haute-tige surfaces viticoles à haute diversité biologique autres surfaces de compensation écologique définies par le service cantonal de protection de la nature
■ Prairies extensives
Ces surfaces doivent mesurer au moins 5 ares et ne peuvent être utilisées avant la mijuin pendant une période de six ans La fauche tardive doit garantir que les semences arrivent à maturité et que leur dispersion naturelle favorise la diversité des espèces. Elle laisse par ailleurs suffisamment de temps aux oiseaux nichant au sol et à d’autres petits mammifères pour leur reproduction La fumure est interdite, de même que l’utilisation de produits phytosanitaires, à l’exception du traitement plante par plante des mauvaises herbes qui posent des problèmes
Les contributions versées pour les prairies extensives, les surfaces à litière, les haies et les bosquets champêtres sont les mêmes et sont échelonnées selon les zones
Bénéficiaires, surfaces ayant donné droit aux contributions et montant des contributions en 1999
2 . 2 P A I E M E N T S D I R E C T S 2 176
Taux de 1999 fr /ha – zone de grandes cultures et zones intermédiaires 1 500 – zone des collines 1 200 – zones de montagne I et II 700 – zones de montagne III et IV 450
Caractéristique Unité Région de Région des Région de Total plaine collines montagne Exploitations Nombre 16 284 8 211 8 906 33 401 Surface ha 14 743 7 021 12 384 34 148 Surface par exploitation ha 0,91 0,86 1,39 1,02 Contribution par exploitation fr 1 320 850 726 1 046 Total des contributions 1 000 fr 21 494 6 978 6 462 34 934 Source: OFAG
■ Surfaces à litière
Par surfaces à litière, on entend les surfaces cultivées d'une manière extensive et se trouvant dans les lieux humides et marécageux et qui, en règle générale, sont fauchées en automne ou en hiver pour la production de litière Les prescriptions d’exploitation sont en principe les mêmes que pour les prairies extensives. La fauche n ’est toutefois autorisée qu’à partir du 1er septembre
Bénéficiaires, surfaces ayant donné droit aux contributions et montant des contributions en 1999
Caractéristique Unité Région de Région des Région de Total plaine collines montagne
■
Par haies, bosquets champêtres et berges boisées, on entend les haies basses, les haies arbustives et arborées, les brise-vents, les groupes d’arbres, les talus et les berges boisés Ces surfaces doivent mesurer au moins 5 ares et être utilisées de manière appropriée pendant une période de six ans sans interruption. Le rabattage jusqu'à la souche est autorisé sur un tiers au plus de la longueur totale des haies dans le contexte de leur entretien La fumure et l’utilisation de produits phytosanitaires sont interdites Une bande herbeuse, non fertilisée, d'une largeur de 3 m au moins doit être aménagée le long de ces surfaces de compensation écologique
Bénéficiaires, surfaces ayant donné droit aux contributions et montant des contributions en 1999

2 . 2 P A I E M E N T S D I R E C T S 2 2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E 177
Exploitations Nombre 1 478 1 421 2 443 5 342 Surface ha 1 431 1 014 2 268 4 713 Surface par exploitation ha 0,97 0,71 0,93 0,88 Contribution par exploitation fr. 1 432 673 572 836 Total des contributions 1 000 fr 2 116 956 1 396 4 468 Source:
OFAG
Caractéristique Unité Région de Région des Région de Total plaine collines montagne Exploitations Nombre 5 066 2 517 1 148 8 731 Surface ha 1 249 679 356 2 283 Surface par exploitation ha 0,25 0,27 0,31 0,26 Contribution par exploitation fr 365 274 200 317 Total des contributions 1 000 fr 1 847 690 230 2 767 Source: OFAG
Haies, bosquets champêtres et berges boisées
■ Prairies peu intensives
Les prairies peu intensives peuvent être légèrement fertilisées avec des engrais de ferme. En outre, elles sont assujetties aux mêmes règles d’utilisation que les prairies extensives
Bénéficiaires, surfaces ayant donné droit aux contributions et montant des contributions en 1999
■ Jachère florale

Par jachère florale, on entend les bordures pluriannuelles ensemencées d'herbacées sauvages indigènes Leur fertilisation est interdite Des traitements chimiques plante par plante sont autorisés contre les mauvaises herbes posant des problèmes, pour autant qu'il soit impossible de les combattre par des moyens mécaniques sans une charge disproportionnée Dès l'année suivant celle de la mise en place, la jachère florale peut être fauchée pour moitié entre le 1er octobre et le 15 mars. Cette jachère sert à protéger les herbacées sauvages menacées Elle offre également habitat et nourriture aux insectes et autres petits animaux En outre, elle sert de refuge aux lièvres et aux oiseaux En 1999, un montant de 3’000 francs a été versé par ha. Les contributions ne sont allouées que pour les surfaces situées dans les régions de plaine et des collines Dans la région des collines, les surfaces de la zone de montagne I ne donnent pas droit aux contributions
Bénéficiaires, surfaces ayant donné droit aux contributions et montant des contributions en 1999
Caractéristique Unité Région de Région des Région de Total
1 Il s ’agit d’entreprises exploitant des surfaces dans les régions des collines ou de plaine
■ Jachère tournante
Par jachère tournante, on entend des surfaces ensemencées, pendant un ou deux ans, d’herbacées sauvages indigènes accompagnatrices de cultures L’enherbement naturel est également possible à des endroits propices. La fertilisation est interdite. Des traite-
2 . 2 P A I E M E N T S D I R E C T S 2 178
de 1999 fr /ha – de la zone de grandes cultures à la zone des collines 650 – zones de montagne I et II 450 – zones de montagne III et IV 300
Taux
Total plaine collines montagne Exploitations Nombre 10 775 9 530 10 939 31 244 Surface ha 9 397 8 686 22 305 40 388 Surface par exploitation ha 0,87 0,91 2,04 1,29 Contribution par exploitation fr 560 504 695 590 Total des contributions 1 000 fr 6 032 4 806 7 607 18 445 Source: OFAG
Caractéristique Unité Région de Région des Région de
plaine collines montagne Exploitations Nombre 1 108 199 21 1 309 Surface ha 661 84 0 745 Surface par exploitation ha 0,60 0,42 0,14 0,57 Contribution par exploitation fr 1 788 1 270 405 1 707 Total des contributions 1 000 fr 1 981 253 1 2 235
Source: OFAG
■ Bandes culturales extensives
ments chimiques plante par plante sont autorisés contre les mauvaises herbes posant des problèmes, pour autant qu'il soit impossible de les combattre par des moyens mécaniques sans une charge disproportionnée En cas de graves problèmes avec des mauvaises herbes, les autorités cantonales peuvent accorder une autorisation spéciale pour le désherbage chimique La surface mise en jachère tournante ne peut être fauchée qu ’entre le 1er octobre et le 15 mars Les jachères tournantes offrent un habitat aux oiseaux couvant au sol, aux lièvres et aux insectes
En 1999, un montant de 2'500 francs a été versé par ha Les contributions ne sont allouées que pour les surfaces situées dans les régions de plaine et des collines Dans cette dernière, les surfaces de la zone de montagne I ne donnent pas droit aux contributions
Bénéficiaires, surfaces ayant donné droit aux contributions et montant des contributions en 1999
Les bandes culturales extensives offrent un espace de survie aux herbacées accompagnant traditionnellement les cultures On entend par là des bandes d'une largeur de 3 à 12 m, ensemencées de cultures des champs et utilisées d’une manière extensive L’utilisation d’engrais azotés et d’insecticides ainsi que le traitement de surface chimique ou mécanique contre les mauvaises herbes sont interdits Des traitements chimiques plante par plante sont autorisés contre les mauvaises herbes posant des problèmes, pour autant qu'il soit impossible de les combattre par des moyens mécaniques sans une charge disproportionnée Ces bandes sont ensemencées de céréales (sauf maïs), colza, tournesol, pois protéagineux, féverole ou soja
En 1999, un montant de 1'000 francs a été versé par ha Les contributions ne sont allouées que pour les surfaces situées dans les régions de plaine et des collines Dans cette dernière, les surfaces de la zone de montagne I ne donnent pas droit aux contributions
Bénéficiaires, surfaces ayant donné droit aux contributions et montant des contributions en 1999
2 . 2 P A I E M E N T S D I R E C T S 2 2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E 179
Caractéristique Unité Région de Région des Région de Total plaine collines montagne Exploitations Nombre 266 41 0 307 Surface ha 294 34 0 328 Surface par exploitation ha 1,11 0,84 0 1,07 Contribution par exploitation fr 2 764 2 090 0 2 674 Total des contributions 1 000 fr 735 86 0 821 Source: OFAG
Caractéristique Unité Région de Région des Région de Total plaine collines montagne Exploitations Nombre 210 35 0 245 Surface ha 53 60 59 Surface par exploitation ha 0,25 0,17 0 0,24 Contribution par exploitation fr 251 174 0 240 Total des contributions 1 000 fr 53 60 59 Source: OFAG
Les contributions sont versées pour les arbres haute-tige de fruits à noyau ou à pépins. Les châtaigneraies et noiseraies entretenues donnent également droit aux contributions Il faut 20 arbres au moins pour qu’il y ait un droit aux contributions Les contributions pour les arbres fruitiers haute-tige peuvent être cumulées avec celles qui sont versées pour les prairies extensives ou peu intensives
En 1999, un montant de 15 francs a été versé par arbre

Bénéficiaires, surfaces ayant donné droit aux contributions et montant des contributions en 1999
Source: OFAG 1 Sans arbres fruitiers haute-tige et sans prairies extensives aménagées sur des terres assolées gelées
Caractéristique Unité Région de Région des Région de Total plaine collines montagne Exploitations Nombre 18 233 13 398 5 417 37 048 Arbres Nombre 1 272 781 939 847 250 606 2 463 234 Arbres par exploitation Nombre 69,81 70,15 46,26 66,49 Contribution par exploitation fr 1 047 1 052 694 997 Total des contributions 1 000 fr 19 088 14 098 3 759 36 945 Source: OFAG
Arbres fruitiers haute-tige Distribution des surfaces de compensation écologique1 en 1999 Prairies extensives 41,3% Surfaces à litière 5,7% Jachères florales 0,9% Prairies peu intensives 48,9% Bosquets champêtres et berges boisées 2,8%
Total
665 ha Bandes culturales extensives 0,1% Jachères tournantes 0,4% 2 . 2 P A I E M E N T S D I R E C T S 2 180
■
82
Culture extensive de céréales et de colza
Cette mesure a pour objectif d’inciter les cultivateurs à renoncer aux régulateurs de croissance, aux fongicides, aux stimulateurs chimiques de synthèse des défenses naturelles et aux insecticides dans la culture de céréales et de colza L’ensemble de la surface affectée aux céréales panifiables et fourragères ainsi qu ’ au colza doit répondre aux exigences y relatives La récolte doit se faire lorsque la graine est à maturité, et les cultures ne doivent pas être envahies par les mauvaises herbes

En 1999, un montant de 400 francs a été versé par ha
Bénéficiaires, surfaces ayant donné droit aux contributions et montant des contributions en 1999
Caractéristique Unité Région de Région des Région de Total plaine collines montagne Exploitations Nombre 13 218 7 824 1 496 22 538 Surface ha 58 316 26 115 3 330 87 761 Surface par exploitation ha 4,41 3,34 2,23 3,89 Contribution par exploitation fr 1 767 1 335 890 1 559 Total des contributions 1 000 fr 23 360 10 444 1 332 35 136 Source: OFAG 2 . 2 P A I E M E N T S D I R E C T S 2 2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E 181 Distribution de
extensive en 1999 Céréales panifiables 48% Colza 4% Céréales fourragères 48%
OFAG Total 87 761 ha Tableau 30, page A36
la surface
Source:
Agriculture biologique
En complément des recettes supplémentaires réalisables sur le marché, la Confédération encourage l’agriculture biologique en tant que mode de production particulièrement respectueux de l’environnement Afin d’obtenir des contributions, les exploitants doivent appliquer les règles de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique Une reconversion par étapes n ’est possible que dans des exploitations pratiquant la viticulture, les cultures fruitières ou maraîchères ou la culture de plantes ornementales Il est notamment exigé de renoncer aux matières auxiliaires chimiques de synthèse La prise en considération des cycles et procédés naturels revêt donc une importance toute particulière pour l’agriculteur
En 1999, l’agriculture biologique couvrait 7,3% de l’ensemble de la SAU
Bénéficiaires, surfaces ayant donné droit aux contributions et montant des contributions en 1999
Part da la surface exploitée selon les règles de la production biologique, selon la région en 1999
20%
de montagne 59%
21%
2 . 2 P A I E M E N T S D I R E C T S 2 182
Taux de 1999 fr /ha – Cultures spéciales 1 000 – Terres ouvertes, sans les cultures spéciales 600 – Surfaces herbagères et surfaces à litière 100
Caractéristique Unité Région de Région des Région de Total plaine collines montagne Exploitations Nombre 955 1 066 2 723 4 744 Surface ha 15 296 16 683 46 476 78 454 Surface par exploitation ha 16,02 15,65 17,07 16,54 Contribution par exploitation fr 4 588 2 237 1 789 2 453 Total des contributions 1 000 fr. 4 382 2 384 4 871 11 637 Source: OFAG
Région de
Région
Source:
Total 78 454 ha Région
plaine
OFAG
des collines
Tableau 28a page A30
■ Systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux (SST)
Garde d’animaux de rente particulièrement respectueuse de l’espèce
Les mesures concernées permettent de promouvoir les exploitations dans lesquelles les animaux de rente sont gardés d’une manière particulièrement respectueuse de l’espèce ou sortent régulièrement en plein air
Il s ’agit là de promouvoir des systèmes de stabulation dépassant largement le niveau exigé par la législation relative à la protection des animaux Les principes suivants sont applicables:
les animaux sont gardés librement en groupes; – ils ont la possibilité de se reposer, de se mouvoir et de s ' occuper d’une manière adaptée à leur comportement naturel;

les étables bénéficient d’une lumière du jour suffisante.
Exploitations et animaux (UGB) ayant donné droit aux contributions et montant des contributions en 1999
■ Sorties régulières en plein air (SRPA)
La Confédération favorise les exploitations dans lesquelles les animaux sortent régulièrement en plein air Les exigences suivantes sont fixées pour les différentes espèces:
Animaux consommant des fourrages grossiers
– Au moins 26 sorties réglementaires au pâturage par mois pendant la période de végétation
– Au moins 13 sorties réglementaires au pâturage par mois pendant la période d'affouragement d'hiver
Porcs
– Au moins 3 sorties réglementaires par semaine
Volaille
Sorties quotidiennes
2 . 2 P A I E M E N T S D I R E C T S 2 2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E 183
–
–
Taux de 1999 fr / UGB – bovins, chèvres, lapins 70 – porcs 135 – volaille 180
Caractéristique Unité Région de Région des Région de Total plaine collines montagne Exploitations Nombre 5 783 3 431 1 691 10 905 UGB Nombre 136 336 62 623 26 474 225 434 UGB par exploitation Nombre 23,58 18,25 15,66 20,67 Contribution par exploitation fr 2 201 1 748 1 347 1 926 Total des contributions 1 000 fr 12 729 5 996 2 277 21 002 Source: OFAG
–
Tableau 31, page A37
■ Part de différentes catégories dans les programmes SST et SRPA
Pour toutes les catégories d’animaux, le pâturage, le parcours, l’aire à climat extérieur et l’étable doivent répondre aux besoins des animaux
Exploitations et animaux (UGB) ayant donné droit aux contributions et montant des contributions en 1999
Participation au programme SST en 1999
Total 225 434 UGB
11%
19%
Participation au programme SRPA en 1999
Total 538 667 UGB
70%
Source: OFAG
Autres (chevaux, bisons, moutons, chèvres) 7% Volaille 3%
Porcs 7%
83%
Source: OFAG
2 . 2 P A I E M E N T S D I R E C T S 2 184
Taux de 1999 fr / UGB – Animaux consommant des fourrages grossiers, lapins 135 – Porcs 135 – Volaille 180
Caractéristique
plaine collines montagne Exploitations Nombre 9 457 7 493 8 845 25 795 UGB Nombre 229 258 158 418 150 992 538 667 UGB par exploitation Nombre 24,24 21,14 17,07 20,88 Contribution par exploitation fr 3 259 2 867 2 305 2 818 Total des contributions 1 000 fr 30 823 21 482 20 384 72 689 Source: OFAG
Unité Région de Région des Région de Total
Autres
Volaille
(chèvres, lapins) 0%
Bovins
Porcs
Bovins
Contributions d’estivage
Les contributions d’estivage ont pour objectif d’assurer l’exploitation et l’entretien des pâturages d'estivage dans les Alpes, dans les Préalpes et dans le Jura. La région d’estivage s’étend sur quelque 600'000 ha, utilisés et entretenus par plus de 300'000 UGB Ont droit aux contributions les exploitants qui estivent des animaux dans une exploitation d'estivage, de pâturage ou de pâturages communautaires

Les contributions d’estivage ont été accordées à condition que les exploitations aient été gérées convenablement et d’une manière respectueuse de l’environnement, dans le respect des prescriptions cantonales, communales ou de coopératives En date du 29 mars 2000, le Conseil fédéral a révisé l’ordonnance sur les contributions d’estivage; il a adapté la conception des contributions aux exigences actuelles en vue d’une exploitation durable et complété dans ce sens les exigences en matière d’exploitation En outre, il a tenu compte des problèmes particuliers liés à l’estivage de moutons.
Une contribution par pâquier normal (PN) a été versée pour les exploitations de pâturages communautaires. Un PN correspond à l’estivage d’une UGBFG pendant
jours
2 . 2 P A I E M E N T S D I R E C T S 2 2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E 185
Taux de 1999 fr /animal – vaches traites 300 – taureaux d’élevage de plus d’un an, vaches mères, nourrices ou taries 200 – génisses et bœufs de un à trois ans 100 – veaux de six mois à un an 50 – chevaux, mulets ou bardots de plus de trois ans 140 – chevaux, mulets ou bardots de moins de trois ans, ânes 80 – chèvres laitières, brebis laitières (chèvres et brebis régulièrement traites pendant la période d’estivage) 60 – autres chèvres et moutons 10
Taux de 1999 fr /PN – vaches traites, chèvres laitières, brebis laitières 300 – autres bovins, chevaux, mulets, bardots, ânes 200 – autres chèvres et moutons 60 Contributions d'estivage en 1999 Caractéristique Contributions Exploitations UGB ou PN mio de fr Nombre Nombre Exploitations d’estivage et de pâturage 63 296 7 890 283 415 Exploitations de pâturages communautaires 4 275 343 19 720 Total 67 571 8 233 297 015 Source: OFAG ■ Exploitation durable
régions d’estivage
100
des
Tableaux 32a–32b, pages A38–A39
■ Eviter le lessivage et le ruissellement de substances
Contributions pour la protection des eaux
Le nouvel art 62a de la loi sur la protection des eaux permet à la Confédération de promouvoir des mesures prises par des agriculteurs afin d’éviter le lessivage et le ruissellement de substances dans les eaux superficielles et souterraines L’accent est mis sur la réduction des charges en nitrate dans l’eau potable et des charges en phosphore dans les eaux superficielles, là où les PER, l’agriculture biologique, les interdictions et les prescriptions contraignantes ou les programmes volontaires encouragés par la Confédération (production extensive, compensation écologique) ne sont pas suffisants
La nouvelle ordonnance sur la protection des eaux oblige les cantons à délimiter une aire d’alimentation pour les captages d’eaux souterraines et de surface, et à déterminer les mesures nécessaires à un assainissement si la qualité des eaux est insuffisante. Ces mesures peuvent, par rapport à l’état de la technique, considérablement restreindre l’utilisation du sol et causer des pertes financières qui ne sont pas supportables du point de vue économique Les contributions de la Confédération aux coûts sont de 80% pour les adaptations structurelles et de 50% pour les mesures d’exploitation En 1999, un montant de 161‘306 francs a été versé
L’OFEFP et l’OFAG ont élaboré des stratégies pour diminuer les charges en nitrate et en phosphore dues à l’agriculture
Les contributions en faveur de ces mesures sont incluses dans le budget pour les contributions écologiques
186 2 . 2 P A I E M E N T S D I R E C T S 2
en 1999 Canton Région, Contributions fédérales assurées Région visée commune par le projet Année fr ha LU Sempach 1999 –2004: 4 000 000 4 905 LU Baldeggersee 2000 –2005: 5 100 000 4 325 VD Thierrens 2000 –2005: 105 376 17,35 VD Morand 2000 –2001: 22 480 14,05 ZH Baltenswil 2000 –2005: 480 000 145 BE Walliswil 2000 –2005: 201 600 98 Source: OFAG
Projets déposés
2.3 Amélioration des bases de production
Les mesures énumérées ci-dessous encouragent une production de denrées alimentaires efficiente, sûre et respectueuse de l’environnement Dépenses pour l’amélioration des bases de production en 1999
Remarque: les dépenses indiquées dans le tableau pour l’amélioration des bases de production ne contiennent que celles du compte de l’OFAG Ne sont, par exemple, pas comprises dans le compte de l’OFAG les ressources financières en faveur des stations de recherches (99,5 mio de fr ) et du haras (5,5 mio de fr ) Les dépenses se montent au total à 322 millions de francs
Source: Compte d’Etat
Ces mesures visent à atteindre les objectifs suivants:
– structures d’exploitation modernes et surfaces agricoles utiles bien équipées;

– production efficiente et respectueuse de l’environnement;
– variétés abondantes, aussi résistantes que possible, et produits de très bonne qualité;
– protection de la santé humaine et animale ainsi que de l’environnement;
– diversité génétique
187 ■■■■■■■■■■■■■■■■
2 . 3 A M É L I O R A T I O N D E S B A S E S D E P R O D U C T I O N
Domaine de dépenses mio de fr Améliorations structurelles 76 Crédits d’investissements 20 Aide aux exploitations 5 Vulgarisation et contributions à la recherche 23 Lutte contre les maladies phytosanitaires et contre les parasites 3 Production végétale et élevage 21 Total 148
2
2.3.1 Améliorations structurelles et aide aux exploitations
Améliorations structurelles
Les mesures prises dans le domaine des améliorations structurelles contribuent à améliorer les conditions de vie et la situation économique en milieu rural Cela vaut en particulier pour la montagne et les zones périphériques
Nous disposons à cet effet de deux types d’aides à l’investissement:
– contributions (à fonds perdu) impliquant la participation des cantons;
– crédits d’investissements sous forme de prêts sans intérêts
Les aides à l’investissement permettent aux agriculteurs de développer et d’entretenir des structures compétitives sans qu’il en résulte un endettement intolérable D’autres pays aussi, notamment les membres de l’UE, comptent ces aides parmi les principales mesures de promotion de l’espace rural
Les aides à l’investissement sont accordées aussi bien pour des mesures individuelles que collectives
Ces mesures concernent essentiellement le domaine des constructions rurales Les aides à l’investissement aident les agriculteurs à financer, de manière supportable à long terme, les constructions qu ’exigent la gestion rationnelle de leur exploitation et l’observation des prescriptions prévues par les législations sur la protection des animaux et des eaux Elles permettent en même temps de prendre en considération les intérêts de l’aménagement du territoire ainsi que ceux de la protection du patrimoine, de la nature, du paysage et de l’environnement.
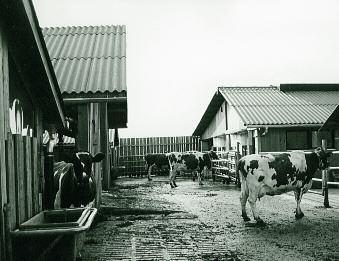
Parmi les principales mesures individuelles, on citera l'aide aux investissements destinée aux bâtiments d'habitation et d'exploitation, les investissements pour les étables et les bâtiments hébergeant le personnel d'alpage ou servant à la transformation du lait dans les exploitations d’estivage, ainsi que l'aide initiale accordée aux jeunes agriculteurs
Les mesures en question peuvent, en principe, être soutenues à l’aide de crédits d'investissements et de contributions à fonds perdu Les crédits d’investissements sont alloués en plaine et en montagne L’octroi de contributions à fonds perdu pour les constructions rurales se limite, par contre, aux bâtiments de la région de montagne et des collines qui sont destinés aux animaux consommant des fourrages grossiers, ainsi qu ’ aux bâtiments alpestres Contributions et crédits d’investissements sont fixés de manière forfaitaire, donc indépendamment des coûts effectifs Un supplément est cependant octroyé pour la construction d’étables particulièrement respectueuses des animaux.
188 2 . 3 A M É L I O R A T I O N D E S B A S E S D E P R O D U C T I O N 2 ■■■■■■■■■■■■■■■■
■ Mesures individuelles
■ Mesures collectives
L’aide initiale est octroyée sous forme de prêts. Elle sert à améliorer les conditions de départ des jeunes fermiers et propriétaires et doit être utilisée pour des mesures étroitement liées à l’entreprise paysanne Les bénéficiaires peuvent, en l’occurrence, décider librement de l’utilisation des prêts, par exemple pour diminuer leurs dettes bancaires, pour acheter du cheptel vif et mort ou des immeubles, ou pour rénover des bâtiments ruraux
Les mesures collectives contribuent à un espace rural viable et aident les agriculteurs à réduire leurs coûts de production
Par mesures collectives, on entend notamment les améliorations foncières, c ’est-à-dire les ouvrages de génie rural tels que la construction de chemins et d’installations de transport, les adductions d’eau, les raccordements au réseau électrique, les mesures de régulation du régime hydrique du sol, ainsi que la réorganisation de la propriété foncière et des rapports d’affermage Le but consiste à améliorer les structures à l’intérieur d’un périmètre bien défini comprenant une ou plusieurs communes Dans la plupart des cas, c ’est un syndicat ou une commune qui est le maître d’ouvrage Ces entreprises permettent non seulement d’atteindre des objectifs liés à l’agriculture, mais aussi d’accomplir des tâches d’aménagement du territoire et de protection. En font partie les mesures destinées à promouvoir l'aménagement de surfaces de compensation écologique, la création de réseaux écologiques ainsi que la protection du sol et des eaux.
Les mesures collectives sont soutenues financièrement surtout par le biais de contributions à fonds perdu Le droit aux contributions se limite presque exclusivement à la construction d’infrastructures L’entretien incombe aux bénéficiaires Des suppléments peuvent être alloués lorsque les améliorations foncières prévues en montagne ou dans la région d’estivage sont difficiles à financer De plus, on verse une contribution spéciale pour inciter les agriculteurs à réaliser volontairement des mesures écologiques qui ne sont pas imposées par la loi sur la protection de la nature et du paysage.
Les crédits d’investissements sont accordés pour le financement résiduel d’améliorations foncières ainsi que pour les bâtiments, équipements et machines que les producteurs construisent ou acquièrent en commun à titre d’entraide De même, des crédits d’investissements peuvent être consentis pour des équipements communautaires en viticulture et en culture fruitière, ainsi que pour l’achat en commun de machines et de véhicules Lorsqu'il s 'agit de projets importants destinés à la montagne, échelonnés sur plusieurs années, l’aide est aussi octroyée sous forme de crédits de construction.
■ Moyens financiers destinés aux contributions à fonds perdu
En 1999, un montant de 75 millions de francs était réservé aux améliorations structurelles, tout comme l’année précédente. L’OFAG a approuvé de nouveaux projets qui ont déclenché un volume global d’investissements de 311,5 millions de francs et qui correspondent à des contributions fédérales de 75,7 millions de francs au total Cette somme n ’est pas égale à celle budgétisée dans la rubrique «améliorations foncières et constructions rurales», car il est rare qu ’ une contribution allouée soit versée la même année; en outre, les crédits sont souvent accordés par tranche.

189 2 . 3 A M É L I O R A T I O N D E S B A S E S D E P R O D U C T I O N 2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E
2
Contributions fédérales en 1999
Construction de chemins

Adductions d'eau
Autres mesures de génie civil Bâtiments d'exploitation pour UGBFG
190
Remaniements parcellaires et améliorations structurelles
Autres constructions rurales mio. de fr. 62% 18% 20%
d'estivage 30,8 05101520253035 10,6 5,8 3,3 22,1 3,1
OFAG 2 . 3 A M É L I O R A T I O N D E S B A S E S D E P R O D U C T I O N 2
Région de plaine sans zone des collines Zone des collines et zone de montagne I Zones de montagne II–IV et région
Source:
■ Moyens financiers destinés aux crédits d’investissements
La somme accordée par la Confédération sous la forme de contributions à fonds perdu a diminué de 40% entre 1990 et 1999 Dans le cadre de la promotion de l'emploi, des crédits spéciaux ont été alloués en 1993 et 1994 pour la construction de bâtiments agricoles. La rubrique ordinaire 1994 comporte par ailleurs la réparation des dégâts causés par les intempéries en Valais et au Tessin
En 1999, les cantons ont accordé 2’395 crédits d’investissements, d’un montant total de 237,6 millions de francs, dont 81,4% ont été consacrés à des mesures individuelles et 18,6% à des mesures collectives En montagne, les pouvoirs publics peuvent en outre consentir des crédits de transition d’une durée maximale de trois ans, appelés «crédits de construction»
Crédits d’investissements accordés par les cantons en 1999
Les crédits pour mesures individuelles ont principalement été utilisés pour l'aide initiale, la construction, la transformation ou la rénovation de maisons d'habitation, de bâtiments d'exploitation ou de bâtiments alpestres Ils sont en moyenne remboursés en l’espace de 12,7 ans
Quant aux crédits alloués pour des mesures collectives, ils ont permis notamment de réaliser des améliorations foncières et d’investir dans des bâtiments et équipements destinés à la mise en valeur et au stockage de produits agricoles
191 2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E Contributions fédérales pour les améliorations foncières et les constructions rurales entre 1990 et 1999 1990199119921993199419951996199719981999 m i o d e f r Rubrique ordinaire Rubrique spéciale promotion de lémploi en constructions rurales Source: OFAG 0 20 40 60 80 100 120 140 1271301009191 5 15 8585827575 2 . 3 A M É L I O R A T I O N D E S B A S E S D E P R O D U C T I O N
Affectation Cas Montant Part Nombre mio. de fr. % Mesures individuelles 2 162 193,30 81,4 Mesures collectives, sans crédits de construction 129 11,42 4,8 Crédits de construction 104 32,83 13,8 Total 2 395 237,55 100 Source: OFAG
2
Tableaux 37–38, pages A46–A47
Tableaux 35–36, pages A44–A45
■ Perspectives
Crédits d’investissements accordés en 1999 par catégorie de mesures, sans les crédits de construction Bâtiment d'exploitation Aide initiale
d'habitation Achat de cheptel vif et mort, transformation et stockage des produits en commun
Région de plaine sans zone des collines Zone des collines et zone de montagne I
Le fonds de roulement, alimenté depuis 1963, comprend 1,6 milliard de francs environ En 1999, la Confédération a mis un montant de 20 millions de francs à la disposition des cantons Ajouté aux remboursements courants, il sert à l’octroi de nouveaux crédits.
Vu les dégâts extraordinaires dus aux intempéries (avalanches, glissements de terrain, coulées de boue, inondations) dans l’année sous revue, divers postulats et motions ont été déposés Un groupe de travail, composé de représentants de différents offices fédéraux, a conclu que les besoins financiers liés aux dégâts causés dans l’agriculture devaient être couverts selon la procédure ordinaire prévue pour l’obtention de crédits supplémentaires Les dégâts se chiffrant à 27 millions de francs (à l’exclusion des bâtiments et du cheptel vif et mort) ont nécessité une contribution de la Confédération de 7 millions de francs, à couvrir en 2000 par des crédits supplémentaires, sans compter les contributions des cantons et celles du fonds pour dommages causés par les éléments naturels C’est la montagne qui a été le plus fortement touchée

192
Achat d'exploitation par le fermier Améliorations foncières mio. de fr. 24% 49% 27%
d'estivage 102,5 020406080100120 57,5 33,7 5,3 2,9 2,8 Source: OFAG 2 . 3 A M É L I O R A T I O N D E S B A S E S D E P R O D U C T I O N 2
Bâtiment
Zones de montagne II–IV et région
■ Répartition des moyens financiers
Aide aux exploitations
L’aide aux exploitations est une mesure d’accompagnement social servant à parer ou à remédier à des difficultés financières passagères qui ne sont pas imputables aux requérants Elle permet aux bénéficiaires de convertir des dettes en prêts exempts d’intérêts Ceux-ci doivent être remboursés dans un délai maximum de 20 ans Peuvent prétendre à une aide les agriculteurs qui se trouvent dans une impasse financière en raison des conditions-cadre économiques ou de circonstances graves telles qu ’ un décès dans la famille, des problèmes en rapport avec le bétail ou des influences environnementales extraordinaires L’aide, qui a l’effet d’une mesure de désendettement individuelle, est accordée aux exploitations bien structurées qui ont de bonnes perspectives d’avenir.
En 1999, des prêts à titre d’aide aux exploitations ont été accordés dans 204 cas pour un montant total de quelque 18,1 millions de francs Si le nombre de prêts a été inférieur à celui de l’année précédente (243), la somme allouée a dépassé celle de 1998 de 2,3 millions de francs Quant au montant moyen, il a passé de 65'100 à 88’500 francs En moyenne, les remboursements se font dans un délai de 12,4 ans
Prêts accordés par les cantons à titre d’aide aux exploitations en 1999
Le fonds de roulement, alimenté depuis 1973 au moyen de fonds accordés par la Confédération et de remboursements, comprend quelque 109 millions de francs. Chaque année, la Confédération met un certain montant à la disposition des cantons (1999: 5 mio de fr ) L'octroi de prêts présuppose une prestation équitable des cantons qui, suivant leur capacité financière, varie entre 40 et 100% de l’aide fédérale Ajoutés aux remboursements courants, les montants accordés par les pouvoirs publics sont utilisés pour l’octroi de nouveaux crédits
■ Perspectives
Il faut considérer cette aide en premier lieu comme un instrument de secours. Selon l’évolution des taux d’intérêt et des marchés notamment, l’aide aux exploitations exigera des ressources supplémentaires, ce dont il a été tenu compte dans le plan financier.
193 2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E 2 . 3 A M É L I O R A T I O N D E S B A S E S D E P R O D U C T I O N
Affectation Cas Montant Nombre mio de fr Conversion de dettes 172 16,05 Difficultés financières extraordinaires à surmonter 32 2,01 Total 204 18,06
Source: OFAG
Tableau 39, page A48 2
2.3.2 Recherche, vulgarisation, haras Recherche agronomique
La recherche agronomique publique de la Suisse se subdivise pour l’essentiel en trois secteurs:
– le Département d’agronomie et de technologie alimentaire de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich: l’accent y est mis sur la recherche fondamentale et l’enseignement universitaire;
– les six stations fédérales de recherches agronomiques (SR), qui axent leurs activités sur les buts fixés par la politique agricole; elles représentent la recherche de l’OFAG, office auquel elles sont rattachées;
– Les hautes écoles spécialisées, nouvelles, qui sont actives dans la formation tertiaire ainsi que dans la recherche et le développement.
L’Institut de recherche en agriculture biologique – une fondation privée – se consacre dans ses travaux à la poursuite du développement de la culture biologique Ses activités sont soutenues par l’OFAG et d’autres offices fédéraux, ainsi que par des cantons, des entreprises et des particuliers.

■ La recherche de l’OFAG La recherche de l’OFAG est étroitement liée aux six SR. Celles-ci se consacrent, d’une part, à la recherche, de l’autre, à des tâches d’autorisation et de contrôle Par ses travaux de recherche, l’OFAG souhaite être reconnu, sur les plans national et international, en tant qu’institution encourageant une agriculture durable, ce qui renforcera la compétitivité des produits suisses Pour cela, la recherche est axée sur les besoins spécifiques de notre agriculture. Les tâches en matière d’autorisation et de contrôle représentent quelque 40% des travaux Même si ces activités ne font pas à proprement parler partie de la recherche, elles nécessitent un fondement et un appui scientifiques
Dépenses de la Confédération pour les six SR en 1999
194 2 . 3 A M É L I O R A T I O N D E S B A S E S D E P R O D U C T I O N 2
■■■■■■■■■■■■■■■■
Recettes 8 mio. de fr. 43% Autorisations, contrôle 39 mio. de fr. 100% Dépenses nettes 91 mio. de fr. 57% Recherche 52 mio. de fr. Dépenses brutes 99 mio. de fr.
Source: OFAG
■ Planification et organisation
L’OFAG dispose, pour la planification stratégique de sa recherche, d’un organe consultatif, le Conseil de la recherche agronomique Celui-ci se compose de personnalités confrontées dans leur vie professionnelle avec des questions politiques touchant à l’agronomie, la recherche, l’environnement et la société. Il garantit que, dans le cadre d’une planification à long terme de la recherche, tous les domaines du développement durable soient pris en considération
Organisation de la recherche de l’OFAG
Toutes les SR ont à leur côté un groupe d’experts pour la mise en oeuvre sur le plan opérationnel. Leurs experts les aident à déterminer les besoins de la pratique par rapport à la recherche
Dans chacun des groupes, les principaux clients et partenaires de la SR sont représentés En font partie les praticiens de l’agriculture, de même que les organisations et les fédérations appartenant aux secteurs situés en amont et en aval, les organisations de consommateurs, de l’environnement et des animaux, les services fédéraux et cantonaux concernés, les hautes écoles, les hautes écoles spécialisées et autres instituts correspondants, ainsi que les centrales de vulgarisation agricole. Les groupes d’experts sont nommés par l’OFAG
■ Buts stratégiques Pour les années 2000 à 2003, le Conseil fédéral a fixé six buts stratégiques à la recherche de l’OFAG:
– amélioration du potentiel de commercialisation par une production écologique, de haute qualité, respectueuse des animaux et répondant aux besoins du marché;
– renforcement de l’option écologique: écosystèmes/ressources naturelles;
– soutien de changements structurels supportables sur le plan social: développement socio-économique et structures rurales;
– mise sur pied d’un système efficace de détection précoce: aspects écologiques tels que préservation transfrontalière des ressources naturelles, effets des changements climatiques, disparition globale de la biodiversité; aspects économiques et politiques tels que mondialisation, sécurité alimentaire et sécurité des produits;
– optimisation du transfert des connaissances par l’information et la documentation;
– encouragement de la compétence professionnelle et mise en exergue de la recherche par la fixation de priorités, la qualité et la collaboration internationale
195 2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E 2 . 3 A M É L I O R A T I O N D E S B A S E S D E P R O D U C T I O N
OFAG Office
de l'agriculture Unité Recherche agronomique RAC Production végétale Changins FAL Ecologie et agriculture Zurich-Reckenholz FAW Arboriculture, viticulture et horticulture Wädenswil FAT Economie et technologie rurales Tänikon RAP Production animale Posieux FAM Production laitière Berne-Liebefeld 2
Source: OFAG
fédéral
Dans les années nonante, la recherche a été restructurée sur une grande échelle. Entre 1994 et 1998, 14 millions de francs ont été économisés (13,5% des moyens financiers) et 92 postes supprimés
Compte tenu d’une nouvelle adaptation des tâches et des structures, les SR doivent faire, d’ici à la fin de 2001, des économies supplémentaires d’un montant de 8,2 millions de francs Conséquence: quelque 80 postes vont encore être supprimés Ainsi, en huit ans (1994–2001), leurs moyens financiers auront diminué de près de 24%.
Dans le cadre de la réforme du gouvernement et de l’administration, le Conseil fédéral a décidé de soumettre les SR à la gestion par mandat de prestations et enveloppe budgétaire Les objectifs du nouveau modèle de gestion correspondent au concept de la nouvelle gestion publique Son introduction a eu lieu le 1er janvier 2000
La recherche de l’OFAG est désormais encore davantage axée sur les prestations et l’efficacité L’OFAG gère les SR en leur fixant des cadres scientifique, administratif et financier, tout en leur laissant une grande marge de manoeuvre sur le plan opérationnel. Les structures et les compétences sont conformes au principe de la subsidiarité, dans la mesure où elles favorisent les initiatives prises par les personnes concernées et une délégation échelonnée des compétences Ainsi, les SR voient leur autonomie renforcée
Un système de suivi de gestion et d'assurance qualité garantit la transparence des coûts et des prestations face à l’OFAG, au Conseil fédéral et au Parlement C’est pourquoi, des indicateurs et des normes ont été fixés pour les six buts stratégiques, de sorte que l’on puisse observer et évaluer si ceux-ci ont été atteints. En même temps, l’introduction de la comptabilité analytique renforce la prise de conscience des coûts et leur transparence à l’intérieur et à l’extérieur des SR
196 2 . 3 A M É L I O R A T I O N D E S B A S E S D E P R O D U C T I O N 2
■ Restructuration
■ Gestion par mandat de prestations et enveloppe budgétaire Réduction du personnel des SR 1990/92199319941995199619971998 P o s t e s 700 720 740 760 780 800 820
des SR
Source: OFAG
■ Proximité des clients Les nouvelles structures de la recherche soutiennent l’esprit d’entreprise. Les SR doivent être gérées comme des entreprises et s’imposer sur le marché Deux éléments essentiels pour réussir: la communication et la proximité des clients
Tous les projets prévus pour la période 2000 à 2003 sont réunis dans un catalogue de recherche où clients et personnes intéressées trouveront sans difficultés les informations souhaitées sur les travaux entrepris dans les SR ainsi que les personnes à contacter Il peut aussi être consulté dans Internet sous «http://www admin ch/sar»
Vulgarisation en agriculture et en économie familiale rurale
Au même titre que la recherche et la formation, la vulgarisation est partie intégrante du système de connaissances agricoles La vulgarisation en agriculture et en économie familiale rurale offre un soutien aux personnes qui y exercent une activité Il s ’agit en fait d’amener ces personnes à résoudre les problèmes spécifiques à leur profession et à réussir à s 'adapter aux changements La vulgarisation englobe non seulement le conseil individuel au sens restreint du terme, mais aussi le perfectionnement professionnel ciblé des familles paysannes, la promotion du transfert du savoir au sein de la population du secteur agricole et l’accompagnement de processus et de projets novateurs.

Cette vision exhaustive résulte du vaste débat relatif aux tâches de la vulgarisation déclenché par la réforme du gouvernement et de l’administration Autrefois intégrée à la formation professionnelle, la vulgarisation est désormais séparée L’OFAG en est responsable sur le plan administratif. Quant à la formation, la responsabilité incombe à l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie
Les prestations de vulgarisation offertes aux familles paysannes relèvent des cantons, qui s ’acquittent de leurs tâches à travers des services de vulgarisation ou en les déléguant à une organisation paysanne La Confédération soutient les services de vulgarisation par l’octroi d’aides financières aux salaires des vulgarisateurs La proportion de cette aide dépend de la capacité financière du canton
La Confédération appuie directement 14 organisations qui proposent une vulgarisation spécifique pour laquelle il s ’avère judicieux d’appliquer une solution à l’échelon national ou régional
Les cantons et plus de 50 organisations parrainent l’Association suisse pour le conseil en agriculture Cette association dirige les centrales de vulgarisation LBL à Lindau et SRVA à Lausanne, qui épaulent les services de vulgarisation cantonaux, régionaux et nationaux Elles proposent la formation continue professionnelle et méthodique des vulgarisateurs et analysent des résultats de la recherche, ou encore, mettent à disposition des supports et des documents. La Confédération soutient l’association par un forfait accordé sur la base d’un mandat de prestations; les négociations sur la troisième période contractuelle sont en cours
197 2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E 2 . 3 A M É L I O R A T I O N D E S B A S E S D E P R O D U C T I O N
2
■ Organisation et formes de la vulgarisation
Dépenses pour la vulgarisation en 1999

Le financement des services cantonaux de vulgarisation est axé sur les dépenses Il n ’ y a par ailleurs pas de distinction entre les prestations offertes avant tout dans l’intérêt privé des bénéficiaires (p. ex. alimentation du bétail laitier, planification de l’économie familiale rurale) et celles fournies surtout dans l’intérêt général (p ex utilisation écologique des surfaces à protéger, mesures de développement régional)
A l’avenir, l’aide financière devra être allouée en fonction des prestations fournies et échelonnée en fonction de l’intérêt public. Les diverses prestations seront subdivisées par domaines d’activités et catégories de prestations, la proportion de l’intérêt public étant fixée pour chaque catégorie et la valeur étant définie pour chaque unité de prestations (sur la base de points tarifaires). Depuis janvier 2000, les cantons doivent enregistrer les prestations en se référant à ce nouveau concept et ensuite les annoncer à l’OFAG Pour leur permettre de procéder aux ajustements nécessaires, l’aide financière ne sera toutefois calculée selon le nouveau système qu’à partir de 2002
198 2 . 3 A M É L I O R A T I O N D E S B A S E S D E P R O D U C T I O N 2
Destinataire Montant mio. de fr. Services cantonaux de vulgarisation agricole 9,9 Services cantonaux de vulgarisation en économie familiale rurale 0,8 Services de vulgarisation spéciaux des organisations agricoles 1,0 Association suisse pour le conseil en agriculture 8,4 Total 20,2
Source: Compte d’Etat
■ Nouveau système de financement des services cantonaux de vulgarisation
■ Mandat de prestations 2000 à 2003
Haras fédéral

Le Haras fédéral d’Avenches encourage une production chevaline agricole compétitive et respectueuse des animaux. Il accorde la priorité au maintien et à la promotion de la race des Franches-Montagnes
En tant que centre de compétence pour la production chevaline agricole, le Haras met à la disposition des producteurs et des organisations professionnelles d'élevage et de mise en valeur ses infrastructures, des animaux reproducteurs ainsi que son savoir-faire pour leur permettre de résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés
Le Haras est géré depuis le 1er janvier 2000 par mandat de prestations et enveloppe budgétaire Par le mandat de prestations 2000 à 2003, le Conseil fédéral a confié au Haras les objectifs stratégiques suivants:
– améliorer la qualité de la production chevaline agricole;
– améliorer la garde du cheval en milieu rural de façon à ce qu ’elle soit conforme à l'espèce et respectueuse de ses besoins naturels; encourager l'éthologie;
– contribuer au suivi de l'évolution socio-économique et structurelle de la production chevaline agricole;
– promouvoir les compétences spécifiques pour la résolution de problèmes futurs: aspects éthiques et de santé de la sélection, préservation de la race des FranchesMontagnes;
– optimiser le transfert de connaissances par l’information et la documentation
■ Restructuration Grâce à la restructuration et à la privatisation partielle du Haras fédéral amorcées en 1994, des économies annuelles de 2,21 millions de francs sont possibles depuis 1999. L'effectif du personnel a été réduit de 23 postes permanents (30%), passant de 75 à 52 postes Le nouveau modèle de gestion nécessitera une réduction d’effectif complémentaire de l’ordre de 10%. En 1999, le soutien de la Confédération au Haras a représenté 5,5 millions de francs
199 2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E 2 . 3 A M É L I O R A T I O N D E S B A S E S D E P R O D U C T I O N
2
2.3.3 Matières auxiliaires de l’agriculture, protection des végétaux et des variétés
Matières auxiliaires de l’agriculture
La législation distingue quatre groupes de matières auxiliaires de l’agriculture: les engrais, les produits phytosanitaires, les aliments pour animaux et le matériel végétal de multiplication (semences et plants) Il s ’agit de substances et d’organismes servant à la production agricole
La législation sur les matières auxiliaires de l’agriculture fixe les principes liés à la mise en circulation de ces matières Elles doivent se prêter à l’usage prévu et ne pas avoir d’effets secondaires intolérables lorsqu’elles sont utilisées de façon réglementaire

L’aptitude des matières à l’usage prévu est étroitement liée à la notion d’efficacité Celle-ci est traitée dans une partie de la législation Il s ’agit avant tout de garantir aux agriculteurs que la matière auxiliaire est suffisamment efficace pour l’usage qu’ils entendent en faire Lors du développement de la législation sur les matières auxiliaires, la question des effets secondaires gagne toutefois en importance par rapport à l’aspect de l’efficacité
Par effets secondaires, on entend les incidences indirectes d’une matière auxiliaire sur la santé de l’être humain et des animaux ou sur l’environnement Il peut, par exemple, s ’agir des effets d'un insecticide sur les insectes utiles ou de ceux d'un additif d’aliments pour animaux sur la fertilité des animaux de rente D’autres dispositions légales sont également applicables en ce qui concerne la santé humaine, telles que la loi sur les toxiques. Par ailleurs, il doit être tenu compte des principes définis dans la loi sur la protection de l’environnement
200 2 . 3 A M É L I O R A T I O N D E S B A S E S D E P R O D U C T I O N 2
■■■■■■■■■■■■■■■■
On peut distinguer huit instruments d’application utilisés dans le secteur des matières auxiliaires La LAgr sert de base légale, à l’exception des exigences posées à la production d’engrais et de produits phytosanitaires En raison des particularités liées à chacune des matières auxiliaires, l’usage de ces instruments n ’est pas le même dans tous les secteurs:
Instruments de mise en œuvre dans le domaine des matières auxiliaires de l’agriculture
Instruments Engrais Produits Aliments Semences phyto- pour sanitaires animaux
Homologation obligatoire
Exigences en matière de produits ■■■■
Exigences relatives à la production ■ 1 ■
Règles d’étiquetage
Prescriptions d’utilisation ■■■
Déclaration obligatoire ■■
Catalogue des variétés ■
Certification ■
1 La base des exigences posées à la production des engrais et des produits phytosanitaires n ’est pas la LAgr, mais la législation sur les toxiques et sur la protection de l'environnement
Source: OFAG
Homologation obligatoire: les matières auxiliaires ne peuvent être mises en circulation que si elles sont homologuées Il est ainsi possible d'examiner au préalable leurs éventuels effets secondaires et, le cas échéant, d'interdire leur utilisation
Exigences en matière de produits: les dispositions légales fixent les exigences minimales que doivent remplir les matières auxiliaires pour être mises en circulation
Exigences relatives à la production: des règles de qualité doivent être respectées lors de la production de certaines matières auxiliaires.
Règles d‘étiquetage: elles définissent les informations ou les mises en garde devant figurer sur les emballages
Prescriptions d’utilisation: elles fixent le cadre de l’utilisation autorisée permettant d’éviter des effets secondaires inadmissibles
Déclaration obligatoire: elle permet de faciliter le contrôle de la conformité de certaines matières auxiliaires
Catalogue des variétés: la plupart des plantes agricoles ne peuvent être mises en circulation que si la variété figure dans un catalogue officiel; seules les variétés remplissant les critères d’admission (résistance aux maladies, rendement, qualité) peuvent y être inscrites
Certification: dans le cas des semences, les exigences relatives aux produits font l’objet d’un contrôle officiel; chaque lot de semences est certifié
201 2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E 2 . 3 A M É L I O R A T I O N D E S B A S E S D E P R O D U C T I O N
■■■
1 ■■
■■■■
2
■ Instruments de mise en œuvre
■ Organismes génétiquement modifiés
Les matières auxiliaires qui sont constituées d’organismes génétiquement modifiés (OGM) ou en contiennent doivent, en plus de la procédure ordinaire, faire l’objet d’une déclaration et d’une autorisation avant la mise en circulation
S’agissant des aliments pour animaux, on a introduit une valeur de déclaration A l’instar des denrées alimentaires, cette valeur est nécessaire, car on ne peut exclure la contamination par des OGM lors de la fabrication et du transport Elle a été fixée à 3% pour les aliments pour animaux simples et à 2% pour les aliments composés
Les exigences relatives au dossier devant accompagner la demande, de même que les exigences relatives à l’octroi d’une autorisation, sont fixées dans l’ordonnance sur la dissémination d’organismes. Quant aux matières auxiliaires contenant des OGM, on applique aussi bien les dispositions de cette ordonnance que celles des ordonnances respectives sur les matières auxiliaires Ces dernières régissent aussi la procédure d’autorisation, ce qui permet d’éviter les doublons.
■ Engrais Depuis le 1er septembre 1999, le contrôle de la mise en circulation des engrais et des produits assimilés aux engrais est du ressort de l’OFAG L’ordonnance sur les engrais et l’ordonnance sur le Livre des engrais ont été révisées l’automne passé En parallèle à de nouvelles adaptations aux prescriptions de l’UE, on a libéralisé le domaine des engrais minéraux au même titre que celui des produits phytosanitaires
■ Produits phytosanitaires La nouvelle ordonnance du 23 juin 1999 sur les produits phytosanitaires est entrée en vigueur le 1er août 1999 Elle apporte trois nouveautés essentielles:
– les produits phytosanitaires pourront désormais être importés et mis en circulation en Suisse sans autorisation, pour autant qu’ils aient été admis dans une liste positive de l’OFAG;
– une protection du premier requérant compatible avec celle de l’UE est garantie pour les données de la première autorisation;
– les exigences technico-scientifiques posées à l’autorisation de produits phytosanitaires sont désormais davantage axées sur celles de l’UE.
Grâce à la liste positive, l’agriculture disposera progressivement d’un plus grand nombre de produits provenant de l’étranger Les producteurs agricoles pourront bénéficier de la baisse des coûts de la protection des végétaux qui en résultera
■ Aliments pour animaux Au cours de l’année sous revue, deux affaires liées à la contamination par des dioxines ont ébranlé la confiance des agriculteurs et des consommateurs dans la qualité des aliments pour animaux. Dans le premier cas, qui a concerné avant tout la Belgique, la présence de dioxines dans les aliments pour animaux est liée à la contamination d’huiles végétales de récupération, notamment d’huiles ménagères, par des huiles industrielles. Dans le second cas, l’argile kaolinitique utilisée comme liant pour la fabrication d’aliments pour animaux était à l’origine de la contamination
Même si, en ce qui concerne l’argile kaolinitique, le niveau de contamination des aliments pour animaux était nettement inférieur à la celui observé en Belgique, les produits concernés ont été retirés du commerce à titre préventif.
202 2 . 3 A M É L I O R A T I O N D E S B A S E S D E P R O D U C T I O N 2
■ Semences Au cours du printemps 1999, l’OFAG a ordonné le retrait du marché de semences de maïs importées contenant des impuretés d’OGM Les parcelles déjà semées (environ 230 ha) ont été détruites, et les agriculteurs touchés ont été dédommagés par l’importateur.
Les contrôles des semences ont été renforcés afin de prévenir toute situation de ce type Toutefois, en raison de l’internationalisation accrue du commerce des semences ainsi que du risque grandissant et inévitable de contamination accidentelle des lots de semences, il sera très difficile, pour les acteurs de la filière de commercialisation des semences et pour les autorités chargées de réaliser les contrôles, d’exclure toute contamination
Protection des végétaux
Les mesures de protection des végétaux visent à prévenir l’introduction et la propagation de nouveaux organismes nuisibles A titre d’exemple connu, citons les mesures de lutte contre la propagation du feu bactérien
L’importation de végétaux et produits végétaux, qui pourraient être porteurs d’organismes nuisibles particulièrement dangereux, est soumise à des prescriptions très strictes De tels végétaux et produits végétaux ainsi que le matériel végétal, qui sont importés en Suisse, doivent être accompagnés d’un certificat phytosanitaire qui remplit les exigences de la Convention internationale sur la protection des végétaux Ce certificat prouve que le matériel importé répond aux exigences phytosanitaires posées en Suisse Lors des formalités douanières, les contrôleurs du Service phytosanitaire fédéral vérifient le respect des prescriptions légales pour éviter l’introduction d’organismes nuisibles.

A l’intérieur du pays, la responsabilité des mesures incombe aux services phytosanitaires cantonaux, aidés dans leurs travaux par les stations fédérales de recherches agronomiques Les tâches essentielles de ces services consistent à surveiller la situation sur le territoire cantonal et à prendre les mesures nécessaires lors de la découverte d’un organisme nuisible particulièrement dangereux Si un tel organisme apparaît pour la première fois dans la région concernée, il conviendra de l’éradiquer par des moyens appropriés Au contraire, si l’organisme découvert est déjà établi et qu’il n ’est plus envisageable, pour des raisons techniques, de procéder à son éradication, l’objectif consistera alors à maintenir dans certaines limites les conséquences économiques et à empêcher la propagation de l’organisme dans des régions non contaminées. La surveillance s’étend tout particulièrement aux parcelles servant à la production de matériel de reproduction (semences, plants, etc )
Un projet de révision totale des dispositions légales est en cours d’élaboration L’objectif est de mettre sur pied un système de contrôle remplissant les exigences de l’UE Ce système permettrait une reconnaissance réciproque des réglementations et faciliterait considérablement le trafic international des végétaux
203 2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E 2 . 3 A M É L I O R A T I O N D E S B A S E S D E P R O D U C T I O N
2
Protection des obtentions végétales (protection des variétés)
Pour des raisons historiques, il n ’est pas délivré de brevet de produit pour les variétés végétales Au moment de l’introduction du droit des brevets, les résultats de la sélection végétale étaient considérés comme non brevetables, leur répétabilité étant insuffisante Un système de protection spécial a dès lors été conçu pour préserver malgré tout les obtentions Ainsi, la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales fixe des exigences minimales à l’échelon international La Suisse a ratifié la version 1978 de cette convention La loi fédérale sur la protection des obtentions végétales (loi sur la protection des variétés) contient les dispositions applicables à la Suisse. Elle fait partie du droit de la propriété intellectuelle. Le bureau de la Protection des variétés de l’OFAG se charge de son application
La protection des variétés est un droit d’exclusivité comparable au brevet qui protège la propriété intellectuelle des obtentions végétales Elle autorise exclusivement le propriétaire de l’obtention à mettre en circulation, fabriquer et offrir, à titre professionnel, du matériel de multiplication de la variété De cette manière, l’obtenteur peut amortir ses investissements. La protection des variétés contribue donc substantiellement à l’obtention de nouvelles variétés végétales répondant aux exigences économiques et écologiques Si le droit des obtenteurs n’était pas défini, la Suisse serait éventuellement défavorisée dans l’acquisition de nouveautés intéressantes provenant de l’étranger
La protection des variétés ne couvre pas la production de matériel de multiplication pour le propre besoin du producteur, par exemple le matériel de multiplication d’espèces agricoles produit par un agriculteur pour son propre usage. C’est ce que l’on entend par «privilège de l’agriculteur» Une variété protégée peut être utilisée pour la sélection de nouvelles obtentions sans que l’autorisation du détenteur du droit de protection ne soit requise. L’obtenteur est également autorisé à mettre en valeur la nouvelle variété sélectionnée sans l’accord de ce dernier On parle alors de la «réserve d’obtenteur»
Pour bénéficier d’une protection, la variété doit être nouvelle, distincte, homogène et stable Un examen cultural strict, effectué sur la base de caractéristiques fixées dans des directives internationales, garantit qu ’ une variété répond à ces critères Le critère de la nouveauté implique que la variété n ’ a pas encore été commercialisée en Suisse au moment de son inscription et que sa commercialisation à l’étranger date de quatre à six ans au plus L’examen cultural, mais pas le critère de la nouveauté, est également indispensable pour l’inscription dans le catalogue des variétés Il convient cependant de savoir que la protection des variétés et le catalogue des variétés sont indépendant l’un de l’autre
204 2 . 3 A M É L I O R A T I O N D E S B A S E S D E P R O D U C T I O N 2
■ Protection de la propriété intellectuelle des obtentions végétales
■ Différences entre le droit des variétés et le droit des brevets
■ Mise à jour du droit des variétés et du droit des brevets
Source: Feuille suisse des brevets, dessins et marques (les modifications de la protection des variétés sont publiées tous les 2 mois)
Aujourd’hui, le droit de protection des variétés se distingue du droit des brevets sur des points essentiels Ce dernier protège les inventions du domaine de la technique à condition qu ’elles soient inédites, qu ’elles se fondent sur une activité de recherche et soient commercialisables Le critère de nouveauté doit répondre à des exigences plus strictes que dans la protection des variétés De plus, le droit des brevets applique des délais de protection plus brefs et ne tolère aucune exception du type réserve d’obtenteur ou privilège de l’agriculteur Si les inventions brevetées peuvent être utilisées librement à des fins de recherche, il est indispensable de détenir une licence non exclusive pour mettre en valeur une nouvelle invention fondée sur celle brevetée Alors que dans la protection des variétés, l’effet protecteur se limite au matériel de multiplication, le droit des brevets garantit une protection exhaustive.
Aussi bien la loi sur la protection des variétés que celle sur les brevets sont en cours de révision et d’adaptation aux dispositions internationales La Convention internationale de 1991 pour la protection des obtentions végétales sert de référence à l’adaptation de la loi sur la protection des variétés, tandis que la loi sur les brevets est axée sur la directive UE relative à la protection juridique des inventions de la biotechnologie Les progrès réalisés dans ce dernier domaine permettent aujourd’hui de reproduire des procédés biotechnologiques et leurs résultats Aussi est-il désormais possible de soumettre les plantes au champ de protection d’un brevet de procédé en tant que produit issu en ligne directe d’un procédé En raison de cette évolution, les deux systèmes de protection se rapprochent l’un de l’autre

205 2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E 2 . 3 A M É L I O R A T I O N D E S B A S E S D E P R O D U C T I O N Variétés protégées, état au 31.12.99 Variétés Nombre Céréales, légumineuses et graminées 94 (froment, maïs, épeautre, avoine, orge, triticale, soja, pois, pommes de terre, légumineuses et graminées) Espèces fruitières 152 Légumes 11 Plantes ornementales et médicinales 451 Total 708
2
Approfondissement: Procédure d’homologation pour produits phytosanitaires
Les produits phytosanitaires (PPS) sont appliqués pour protéger les plantes utiles et pour assurer le rendement des cultures Ce sont des substances biologiquement actives qui, outre les effets de protection, peuvent avoir des effets secondaires non seulement sur les plantes, mais aussi sur des organismes qui ne sont pas visés et sur l’environnement C’est la raison pour laquelle on évalue, dans le cadre d’une procédure d’homologation détaillée, la sécurité des PPS par rapport à l’être humain, aux plantes cultivées et à l’environnement, en plus de l’efficacité Les PPS ne peuvent être mis dans le commerce que s'ils sont homologués en Suisse Divers offices fédéraux et les stations de recherches agronomiques de l’OFAG sont impliquées dans la procédure d’homologation suisse L’OFAG est l’autorité d’homologation
La réforme de la politique agricole a été mise à profit pour fixer les nouvelles conditionscadre de ladite procédure en Suisse Parmi les importantes innovations, on citera la protection du premier requérant, compatible avec l’UE, ainsi que l’alignement des exigences technico-scientifiques sur les prescriptions de l’UE et de l’OCDE en prévision d’une possible collaboration internationale La Suisse dispose désormais d’une base légale pour les importations libres de PPS homologués dans notre pays et à l’étranger. La nouvelle ordonnance sur l'homologation de produits phytosanitaires (ordonnance sur les produits phytosanitaires) constitue la base légale pour la concrétisation de toutes ces nouveautés. Elle est entrée en vigueur le 1er août 1999.
Les bases légales de la procédure d’homologation comprennent des exigences en matière de données ainsi que des principes d’évaluation concernant l’efficacité des produits et la protection de l’être humain et de l’environnement face aux effets nuisibles. La sécurité des PPS devrait ainsi être garantie pour les consommateurs, les utilisateurs, les plantes utiles et l’environnement La procédure d’homologation suisse sert également à soutenir les objectifs écologiques de la politique agricole C’est dans le contexte de l’amélioration de la qualité environnementale que la procédure d’homologation pour PPS offre aussi la possibilité de prendre des mesures telles que des restrictions d’utilisation, afin de réduire davantage encore les atteintes à l’environnement et les risques qu ’elles comportent De nombreux programmes destinés à établir et à réduire les risques pesant sur l’environnement sont en cours aussi bien en Suisse qu’à l’étranger Ils sont soutenus par l’OFAG, qui participe à d’autres programmes internationaux de réduction de risques dans le cadre de l’OCDE
L’obligation et la procédure d’homologation sont des mesures préventives efficaces, permettant de réduire les risques inhérents aux PPS et de concrétiser le principe de prévention en matière de protection de la santé et de l’environnement La personne désireuse de faire homologuer un PPS en Suisse doit déposer un dossier d’enregistrement à l’OFAG Plusieurs offices fédéraux et stations de recherches participent à la procédure d’homologation dans le cadre de leur mandat légal C’est l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) qui évalue les aspects ayant trait à la santé publique L’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) est, quant à lui, compétent pour les questions spécifiques relatives à l’environnement. En ce qui concerne la Station fédérale de recherches en arboriculture, viticulture et horticulture de Wädenswil (FAW) et la Station fédérale de recherches en écologie et agriculture de ZurichReckenholz (FAL), ces stations s ’occupent essentiellement de l’analyse des dossiers

206 2 . 3 A M É L I O R A T I O N D E S B A S E S D E P R O D U C T I O N 2
■ Bases d’homologation de produits phytosanitaires
pour évaluer les PPS sous l’angle de leur aptitude à servir dans l’agriculture et dans la production de denrées alimentaires ainsi que de leur compatibilité avec l’environnement Les données et les résultats d’évaluation recueillis par les différents services sont rassemblés par l’autorité d’homologation qui établit les documents de décision et formule les arguments en faveur ou à l’encontre d’une homologation Si l’évaluation du dossier est positive, l’homologation est accordée
On a besoin d’une base de données exhaustive permettant d’évaluer les effets possibles d’un PPS sur les consommateurs, les utilisateurs et l’environnement, pour pouvoir en estimer les risques et accorder une homologation en connaissance de cause
La base de données comprend les résultats de nombreuses études scientifiques sur le produit testé obtenus par simulation en laboratoire Ces résultats comportent des données qualitatives et quantitatives relatives aux effets nuisibles et au rapport entre les effets en question et les doses administrées. Les études sont principalement effectuées par les départements R + D de l’industrie Dans certains cas, ces données sont complétées par des résultats de recherches menées de manière autonome par les stations Selon les exigences actuelles, un dossier d’enregistrement doit fournir les indications suivantes:
– identification de la matière active et du produit phytosanitaire;
– propriétés physiques, chimiques et techniques du produit;
– action et application du produit;
– propriétés toxicologiques ( y compris sur le métabolisme des mammifères);
– résidus possibles dans les récoltes, les denrées alimentaires et les aliments pour animaux;
– rétention et comportement dans l’environnement;
– analyses écotoxicologiques: effets sur les poissons et les oiseaux.
Analyses toxicologiques des produits phytosanitaires
Toxicité aiguë
Analyse des résidus Toxicité aiguë pour certains organismes
Toxicologie Humaine
Effets sur l’être humain
• lors de l‘application
• résidus dans les denrées alimentaires
Toxicité chronique
Caractère cancérogène
Caractère mutagène
Métabolisme
Toxicologie Ecologique
Effets sur les organismes
• dans le sol et l‘eau
• sur les animaux sauvages
Corrélations dans l'écosystème Effets sur la reproduction
Atteintes à la fertilité
Etude à long terme sur fertilité, reproduction et comportement
Source: OFAG

207 2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E 2 . 3 A M É L I O R A T I O N D E S B A S E S D E P R O D U C T I O N
2
■ Evaluation de la toxicologie humaine

L’autorité d’évaluation des aspects de toxicologie humaine est l’OFSP. Les données relatives à des analyses toxicologiques effectuées sur des animaux en laboratoire (p ex toxicité aiguë, chronique, analyses toxicologiques spéciales), qui sont transmises aux autorités, servent à évaluer les conséquences nuisibles possibles sur les différents systèmes d’organes après un traitement à court ou à long terme avec le produit testé On peut entrer en contact avec des PPS lors de leur application ou lors de l’ingestion sous forme de résidus dans les denrées alimentaires L’objectif principal de ces études est d’établir une relation entre effets observés et dose administrée, c ’est-à-dire de savoir pour une quantité donnée, quels effets sont à prévoir Ces informations permettent, à partir d’une procédure internationale en usage, d’établir les seuils d’innocuité pour l’être humain
La classification et la dénomination des produits en fonction de leur toxicité, ainsi que des prescriptions relatives aux avertissements, servent à la protection des utilisateurs A cet effet, il est tenu compte du profil toxicologique de la matière active et du produit concerné ainsi que de l’ampleur d’une éventuelle atteinte lors de l’application
La protection des consommateurs, quant à elle, concerne la protection de la santé de l’être humain lors de l’ingestion de denrées alimentaires Une limite légale détermine la quantité tolérée de résidus de PPS. Cette limite est fixée de manière à exclure les risques pour la santé de l’être humain, mais aussi de sorte à garantir la protection des végétaux
■ Evaluation de la toxicologie et de la chimie environnementales
Les autorités d’évaluation sont principalement la FAW et la FAL Les études de toxicologie et de chimie environnementales analysent les effets sur les organismes aquatiques, tels que poissons, algues, animaux servant de nourriture aux poissons, sur les oiseaux et les insectes utiles comme par exemple les abeilles.
Les études sur la chimie environnementale et le métabolisme comprennent des analyses de laboratoire permettant d’évaluer la dégradabilité dans le sol et dans l’eau des résidus de matières actives et de produits de dégradation ainsi que leurs voies de dégradation L’infiltration dans le sol est également analysée Si les produits analysés ont des temps de dégradation dépassant certaines limites (dégradation lente) ou si les valeurs d’adsorption dans le sol sont inférieures à un seuil donné, on procède en outre à des modélisations et à des analyses sur le terrain, dites analyses lysimétriques, où l’on observe le comportement des matières actives et de leurs produits de dégradation sur différents sols Les critères d’analyse sont: la dégradation dans le sol, l’éventuelle concentration dans le sol, la dégradation sous l’effet de l’eau et de la lumière, l’infiltration dans le sol, c ’est-à-dire le lessivage dans les couches plus profondes du sol, voire dans les eaux souterraines
Une évaluation méthodique des données globales d’un dossier d’enregistrement et des risques que présente le produit en question, eu égard aux critères et aux principes d’évaluation, tels qu’ils sont appliqués à l’échelle européenne, garantit la sécurité de l’être humain, des animaux et de l’environnement lors de l’usage de PPS L’évaluation de la sécurité est une mesure préventive importante.
208 2 . 3 A M É L I O R A T I O N D E S B A S E S D E P R O D U C T I O N 2
■ Mesures circonstanciées visant à réduire les atteintes à l’environnement par les PPS ainsi que les risques qu’ils comportent
La procédure d’homologation permet de prendre des mesures afin de réduire les atteintes à l’environnement et les risques qui y sont liés, même lorsque l’homologation a déjà été délivrée Dans le cadre de différents projets, les analyses portent essentiellement sur les atteintes à l’environnement par les PPS utilisés dans le but de protéger les végétaux Ces analyses de monitoring comprennent par exemple l’enregistrement des quantités appliquées ou les données relatives aux résidus de PPS dans l’environnement (p ex dans les eaux) Les données ainsi obtenues servent à vérifier l’exactitude de l’évaluation des risques effectuée durant la procédure d’homologation Elles renseignent sur le comportement des substances dans l’écosystème dans des conditions d’application réelles Lorsque les résultats mettent en évidence un problème (p ex si un PPS est fréquemment décelé dans les eaux souterraines), l’application du produit concernée peut être diminuée voire interdite, afin de réduire les risques. Ainsi, l’application de l’herbicide antrazine a été diminuée dans la culture de maïs et interdite le long des voies ferrées, en bordure des routes et dans les régions karstiques
La méthode d’évaluation et de gestion des risques fait l’objet de développements continus à l’échelle internationale, et l’autorité d’homologation a le devoir d’adapter ses stratégies et ses critères aux nouvelles connaissances L’objectif de la durabilité dans l’agriculture a conduit dans le monde entier au lancement de différents projets visant à enregistrer les atteintes à l’environnement causées par les PPS ainsi que leurs risques L’autorité d’homologation en Suisse participe également à des programmes de réduction des risques à l’échelle nationale et internationale
■ Projets internationaux permettant de définir et de vérifier des indicateurs de risque
Il n ’est pas possible de quantifier en un seul chiffre le risque total que représentent toutes les utilisations de PPS dans l’agriculture C’est pourquoi, une proposition a été avancée dans le cadre de l’ONU et de l’OCDE, consistant à développer des valeurs de référence (indicateurs) pour le risque environnemental inhérent aux PPS. Il s ’agit de paramètres auxiliaires servant à déterminer un risque global, qui eux-mêmes sont calculés à l’aide de modélisations se fondant sur quelques paramètres environnementaux importants. L’utilité des paramètres auxiliaires consiste à quantifier les effets des mesures agroécologiques en vue d’une réduction des risques Dans le cadre d’un projet pilote de l’OCDE, les pays membres doivent vérifier, au moyen des données spécifiques à chaque pays, trois indicateurs concernant les eaux de surface quant à leur applicabilité et à leur valeur informative L’OFAG et la FAW participent à ce projet international
■ Liste des PPS autorisés
On compte actuellement, en Suisse, environ 400 matières actives homologuées au moyen de la procédure décrite ci-dessus Près de 1'400 produits commerciaux contenant ces matières actives sont vendus en tant que PPS Les produits autorisés sont publiés chaque année dans la «Liste des produits de traitement des plantes». Cette liste contient également des indications concernant l’application prévue, les restrictions d’application, les concentrations, les classes de toxicité et les précautions à prendre
209 2 M E S U R E S D E P O L I T I Q U E A G R I C O L E 2 . 3 A M É L I O R A T I O N D E S B A S E S D E P R O D U C T I O N
2
2.3.4 Elevage
Les mesures prises en la matière visent à maintenir un élevage suisse autonome. La valeur ajoutée doit se réaliser dans le pays Donnent droit à des contributions: les bovins, les chevaux, les porcs, les moutons et les chèvres Un autre objectif visé est la préservation des races de rente du pays menacées de disparition L’aide de la Confédération est égale à celle des cantons
L’ordonnance sur l’élevage définit les lignes directrices Quant aux modalités, éleveurs et organisations d’élevage les règlent sous leur propre responsabilité. La Confédération reconnaît une organisation si elle satisfait aux exigences prescrites Font partie des services de base offerts:
la gestion du herd-book;
– la mise sur pied d’épreuves de performances objectives;
– l’évaluation des données zootechniques, estimation de la valeur d’élevage comprise
La Confédération surveille les organisations reconnues par elle L’octroi d’aides financières dépend de la reconnaissance En outre, il appartient à la Confédération d’agréer les organisations s ’occupant de l’insémination artificielle des bovins; elle accorde par ailleurs les autorisations d’importer des animaux d’élevage et de la semence de taureaux et prend des mesures destinées à la préservation des races de rente du pays menacées de disparition
En 1999, la Confédération a soutenu financièrement le programme de herd-book établi par Pro Specie Rara, réservé aux races menacées de disparition; elle a fait de même en ce qui concerne les projets visant à la préservation de la chèvre bottée, du mouton de l’Oberland grison, du mouton de l’Engadine, du mouton roux du Valais et du mouton miroir

210 2 . 3 A M É L I O R A T I O N D E S B A S E S D E P R O D U C T I O N 2
■■■■■■■■■■■■■■■■
–
Dépenses pour l’élevage en 1999 Espèce Montant mio de fr Bovins 14,67 Chevaux 1,08 Porcs 1,66 Moutons 1,06 Chèvres et brebis laitières 0,75 Races menacées de disparition 0,07 Total 19,29 Source: Compte d’Etat
Tableau 40, page A49
■ Lignes directrices définies par la Confédération
■■■■■■■■■■■■■■■■ 3. Aspects internationaux

3
211
Dans les années nonante, le processus de globalisation a continué sa marche en avant. Les nouvelles technologies de communication permettent la transmission rapide des informations au-delà des frontières nationales Les échanges de marchandises se font sur des marchés regroupant des régions toujours plus grandes, sur lesquels les marchandises peuvent circuler librement, sans barrière aux frontières nationales Nous en voulons pour preuve l’intégration progressive en Europe avec le marché commun La Suisse, pays fortement exportateur, est donc intéressée à un accès aussi libre que possible aux marchés étrangers L'accord de l'OMC conclu en 1994 à Marrakech a fixé pour la première fois des règles pour le commerce de produits agricoles dans le cadre des règlements internationaux sur le commerce des biens et des services Il est à noter qu ’ un des accords bilatéraux conclus avec l’UE est l’Accord agricole. Pour l’agriculture suisse, les aspects internationaux ont pris davantage d’importance ces dernières années Et cela va s ’accentuer à l’avenir
Le rapport agricole tient compte de ces développements Ce premier rapport met l’accent sur deux points essentiels:
La première partie traite des développements sur le plan international pouvant avoir une influence sur la situation économique, écologique et sociale de l’agriculture. Les thèmes sont: l’accord bilatéral avec l’UE, la réforme de la politique agricole commune de l’UE, l’Accord agricole de l’OMC, l’intégration de l’agriculture dans divers accords de libre-échange, l’Accord international dans le domaine du développement durable et de l'environnement, ainsi que l’alimentation mondiale et la FAO
La seconde partie est consacrée à des comparaisons internationales Plus l’agriculture suisse doit se mesurer à la concurrence internationale, plus les informations sur les conditions régnant à l’étranger sont essentielles. Les deux thèmes sont: comparaisons internationales des prix et évolution de la marge du marché en Suisse, en Allemagne et aux Etats-Unis
3 . A S P E C T S I N T E R N A T I O N A U X 3 212
3.1 Développements internationaux
Sont abordés ci-après des événements internationaux tels que la conclusion de l’Accord agricole bilatéral, la réforme de la politique agricole commune de l’UE, ainsi que la conclusion de l’Accord agricole de l’OMC et de différents accords de libreéchange Ces événements ont en particulier des conséquences sur le développement économique de l’agriculture suisse Ensuite, ce chapitre traite de l’alimentation mondiale et présente brièvement la FAO, organisation spéciale de l’ONU pour l’alimentation et l’agriculture La fin de cette section est consacrée aux accords internationaux dans le domaine du développement durable et de l’environnement

■■■■■■■■■■■■■■■■
3 . 1 D É V E L O P P E M E N T S I N T E R N A T I O N A U X 3 213
Accord entre la Suisse et l’UE relatif aux échanges de produits agricoles
Au plan politique, les négociations bilatérales avec l’UE ont abouti en décembre 1998. Ratifiés à Berne le 26 février 1999, les textes des sept accords ont été signés à Luxembourg le 21 juin 1999

Les Chambres fédérales ont traité les accords et les mesures d’accompagnement au cours de la session spéciale du 30 août au 2 septembre ainsi que de la session d’hiver 1999 Le Conseil national et le Conseil des Etats ont approuvé les textes le 8 octobre 1999 à une grande majorité Un référendum a été lancé Le peuple et les cantons ont toutefois accepté les accords le 21 mai 2000. Il devrait entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 2002
L’Accord agricole prévoit des réductions tarifaires réciproques, des allégements dans le domaine des obstacles techniques au commerce ainsi que la reconnaissance mutuelle des désignations
– La libéralisation complète et réciproque des échanges de fromage, au terme d’une période transitoire de cinq ans, représente la pierre angulaire du volet tarifaire de l’Accord agricole Des concessions substantielles réciproques sont en outre prévues dans les secteurs des fruits et légumes, de l’horticulture, y compris les fleurs coupées et, dans une moindre mesure, pour certaines spécialités de viande séchée et des spécialités de vins
– L’accord allégera, voire supprimera les obstacles techniques dans les secteurs vétérinaire, phytosanitaire, des aliments pour animaux, des semences, des produits biologiques, et établira des règles de commercialisation pour les produits viti-vinicoles, ceci, en règle générale, sur la base d’arrangements fondés sur la reconnaissance de l’équivalence des législations. En outre, l’UE octroie la compétence à la Suisse de faire certifier sur son territoire ses exportations de fruits et légumes frais conformément aux normes de commercialisation communautaires
– Les désignations géographiques et traditionnelles des vins et la désignation des spiritueux font l’objet d’une reconnaissance et d’une protection réciproques
3 . 1 D É V E L O P P E M E N T S I N T E R N A T I O N A U X 3 214
■ Une chance pour notre agriculture
Concessions tarifaires réciproques dans les principaux domaines
50% de réduction
Sur le plan des mesures dites d’accompagnement, le Parlement a décidé de renforcer les possibilités d’entraide en modifiant les dispositions de la loi sur l’agriculture y relatives. Concrètement, le Conseil fédéral a ainsi la possibilité d’étendre à l’ensemble des producteurs et des transformateurs et, le cas échéant, au commerce, les contributions prélevées par une organisation auprès de ses membres, dans la mesure où lesdites contributions servent à financer uniquement des mesures d’entraide. Le Parlement a par ailleurs modifié la loi sur les denrées alimentaires, créant ainsi la possibilité d’harmoniser l’exécution dans le domaine de la production animale avec celle de l’UE
La mise en œuvre de l’Accord agricole au niveau interne nécessite en l’occurrence la révision intégrale de l’ordonnance sur le libre-échange, l’élaboration d’une nouvelle ordonnance dans le secteur des fromages ainsi que l’adaptation de diverses ordonnances relevant de la législation agricole, de celle sur les denrées alimentaires et de celle concernant le domaine vétérinaire.
Produit Concessions CH Concessions UE Lait Fromage Libre accès Libre accès après 5 ans après 5 ans Yoghourt / Crème Aucune 2 000 t Viande Jambon cru (porc) 1 000 t Aucune Viande séchée (boeuf) 200 t 1 200 t Légumes Tomates 10 000 t 1 000 t Carottes Aucune 5 000 t Produits à base de pommes de terre Aucune 3 000 t Fruits Pommes Aucune 3 000 t Poires Aucune 3 000 t Fraises Aucune 10 000 t Poudre de fruits et de légumes Aucune Libre accès Autres
d’olive
tarifaire
Fleurs coupées 1 000 t
accès Plantes ornementales Libre accès Libre accès
Huile
Aucune
Libre
3 A S P E C T S I N T E R N A T I O N A U X 3 . 1 D É V E L O P P E M E N T S I N T E R N A T I O N A U X 3 215
■ Objectif majeur: le renforcement de la compétitivité
Réforme de la politique agricole commune (PAC)
Avec l’adoption d’une vingtaine de mesures législatives, l’Union européenne a achevé, au Sommet de Berlin en mars 1999, son projet intitulé «Agenda 2000». Ce paquet législatif couvre quatre domaines principaux étroitement liés: réforme de la politique agricole commune, réforme de la politique structurelle, instruments de pré-adhésion pour les pays d’Europe centrale et orientale candidats à l’adhésion et nouveau cadre financier
La réforme dans le domaine agricole vise plusieurs objectifs, notamment: augmenter la compétitivité des produits agricoles communautaires sur le marché intérieur et le marché mondial, intégrer davantage des considérations environnementales et structurelles, simplifier la législation agricole et décentraliser son application, renforcer la position de négociation de l'Union à l'OMC et stabiliser les dépenses agricoles.
Deux types de mesures contribueront à la réalisation de ces objectifs Il s 'agit des nouvelles organisations du marché dans les secteurs des produits viti-vinicoles, des cultures arables, de la viande bovine et du lait, et d'autre part, de mesures de caractère plus horizontal.
■ Nouvelles organisations du marché
En ce qui concerne les céréales, le prix d’intervention est réduit de 15% à partir de la récolte 2000/2001 Dans le secteur du lait, les prix d’intervention pour le beurre et la poudre de lait écrémé seront également réduits de 15% en trois étapes L’opération ne sera cependant pas lancée avant l’année économique 2005/2006 Le contingentement laitier sera en tous cas maintenu jusqu’en 2007/08, et le quota global sera augmenté d’ici là de quelque 2,8 millions de tonnes. Cela correspond environ au volume contingentaire total de la Suisse Il en résultera un relèvement de 2,4% de la quantité de lait produite par l’UE Côté viande de boeuf, un filet de sécurité sera installé à un bas niveau dès juillet 2002. En même temps, le prix d’intervention sera remplacé par une réglementation de stockage privé Dès 2000, le prix de base de ce stockage sera de 20% inférieur à celui qui déclenchait une intervention en vertu de l’ancienne législation
Ces baisses de prix sont partiellement compensées aux agriculteurs par des paiements directs liés aux produits Une prime par kilo de lait sera versée dès 2005 Calculée aux taux de conversion actuels, elle pourrait se chiffrer à quelque 2,7 ct le kilo en 2007 Une prime d’abattage sera désormais allouée pour toutes les catégories de bovins. Celle qui est versée pour la garde extensive de bovins est fortement majorée
A titre d’innovation, les pays pourront disposer, en tant que forfait, d’une partie des fonds alloués pour l’octroi de primes dans les secteurs de la viande de boeuf et du lait Ils pourront décider eux-mêmes, dans les limites des plafonds fixés, quelles primes de base ils entendent majorer
3 . 1 D É V E L O P P E M E N T S I N T E R N A T I O N A U X 3 216
■ Développement de l’espace rural
Le paquet agricole est complété par le règlement sur le développement rural, deuxième pilier de la PAC, qui vise à garantir l'avenir des zones rurales européennes de la manière suivante:

– maintien des mesures d'accompagnement, instaurées en 1992 (préretraite, mesures agro-environnementales et boisement);
– diversification des exploitations agricoles (soutien à la transformation et à la commercialisation des produits agricoles, formation professionnelle, promotion et reconversion de l'agriculture, etc );
– adaptation structurelle des exploitations et aides initiales pour les jeunes agriculteurs
■ Mesures collectives
Un règlement horizontal, applicable aux différentes organisations communes des marchés, permet aux Etats membres de subordonner l’octroi des paiements directs à des prestations écologiques. De même, ils peuvent procéder à des réductions lorsque le nombre d’unités de main-d’oeuvre d’une exploitation tombe en dessous d’un certain seuil et que le revenu et la fortune dépassent un certain plafond Les pays membres sont libres de fixer les exigences écologiques et les limites à ne pas franchir
En vertu du nouveau règlement sur le financement de la politique agricole commune, les Etats membres pourront gérer leur partie des crédits du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) tout en respectant certains critères communautaires.
La mise en oeuvre de cette réforme de la PAC a commencé en l’an 2000 Les nouveaux règlements concernant le développement rural, les règles communes pour le régime de soutien direct et le financement de la PAC sont entrés en vigueur le 1er janvier Quant aux nouvelles dispositions relatives à différentes organisations de marché (grandes cultures, céréales, fécule de pomme de terre, viande bovine et vin), leur entrée en vigueur coïncide avec le début des campagnes 2000/2001
3 A S P E C T S I N T E R N A T I O N A U X 3 . 1 D É V E L O P P E M E N T S I N T E R N A T I O N A U X 3 217
Accord agricole OMC
C’est dans le cadre du Cycle d’Uruguay (1986-1994) que, pour la première fois, on a intégré l’agriculture dans le système commercial multilatéral tout en tenant compte de sa multifonctionnalité En signant l’Accord agricole, les membres de l’OMC se sont engagés à réduire graduellement les droits de douane, les mesures de soutien et les subventions à l’exportation au cours d’une période de six ans (1995-2000) Des dispositions particulières sont applicables pour les pays en voie de développement
Obligations suisses et propositions de négociation
Domaine Engagements 1995-2000
Accès au marché
Consolidation tarifaire
Contingent tarifaire (CT)
Soutien intérieur
Thèmes possibles dès 2001
– Moins 36% en moyenne pour toutes – Autres réductions tarifaires les lignes du tarif douanier différenciées
Au moins 15% pour chaque ligne
– Quantités importées en 1986/88 – Systèmes des taux uniques ou au moins 5% de la consommation – Mécanismes de répartition au TC intérieure
Systèmes des prix-seuils
Paiements directs non
Pas d’engagement à réduire ces
Description détaillée, liés à la production paiements pas d’incitation à produire ➞ Plafond libre
Soutien lié à la production
Subventions à l'exportation
Quantités
Préoccupations non liées au commerce
Moins 20% (CH: réduction
Réductions supplémentaires de 5,3 à 4,3 mrd de fr )
Moins 21%
Réduction supplémentaire
Valeurs – Moins 36% ou suppression
Multifonctionnalité – Désignation (origine et méthodes de production)
– Bien-être des animaux
La Suisse est membre de l’OMC depuis le 1er juillet 1995 En 2000, elle accomplit la dernière étape de l’exécution de ses engagements
Les obligations OMC concernant l’accès au marché et le soutien interne ont pu être respectées Les réductions des droits de douane et les contingents tarifaires convenus n ’ont pas perturbé le marché suisse A la suite de la réforme de la politique agricole et de la séparation de la politique des prix de celle des revenus qui en découle, le soutien suisse lié au produit a subi une réduction supplémentaire et se montait encore, selon la notification à l’OMC, à 2,8 milliards de francs Il est ainsi inférieur à la limite fixée par l’OMC (1995: 5,3 milliards de francs, dès 2000: 4,3 milliards de francs) Par contre, le plafond OMC concernant les subventions à l’exportation pour les produits transformés (loi sur le régime d'importation et d'exportation des produits agricoles transformés «Schoggigesetz») a été légèrement dépassé en 1999; il a néanmoins été possible d’avoir recours aux moyens non utilisés les années précédentes
–
–
–
–
–
–
–
–
–
3 . 1 D É V E L O P P E M E N T S I N T E R N A T I O N A U X 3 218
■ Et après?
Seattle
Les ministres de l’économie des pays membres de l’OMC se sont rencontrés à Seattle du 30 novembre au 3 décembre 1999 pour décider des objectifs, de l’agenda et de la structure d’un nouveau cycle OMC Les 135 membres de l’organisation n ’ont cependant pu se mettre d’accord sur un cycle de négociations complet La plupart d’entre eux, notamment les principaux pays industrialisés, continuent néanmoins à souhaiter un tel cycle La Suisse y voit elle aussi une chance de prendre en compte les exigences diverses des pays membres et d’atteindre un résultat global qui se révèle positif pour tous

Pour le moment, on ne peut pas encore dire si le prochain cycle de négociations aura lieu et, le cas échéant, à quel moment Même si Seattle a retardé le processus, il ne l’a toutefois pas stoppé
En vertu de la clause de poursuite du processus de réforme (art 20) figurant dans l’Accord agricole de l’OMC, les travaux préparatoires d’un nouveau cycle ont commencé à Genève Lors des premières séances spéciales du Comité agricole (mars, juin et septembre 2000), les délégations ont esquissé leurs points de vue concernant les quatre domaines de négociation: soutien dans le pays, accès au marché, subventions à l’exportation et ce qu’il est convenu d’appeler les «considérations autres que d'ordre commercial» Les membres de l’OMC disposent d’assez de temps, jusqu’à la fin de l’année, pour présenter leurs propositions de négociation. Le Conseil fédéral définira un mandat de négociation approprié Les milieux intéressés seront consultés en temps voulu
■ Examen d’autres réformes
A l’instar de tous les autres membres de l’OMC, la Suisse est disposée à examiner des réformes supplémentaires dans les disciplines traditionnelles (accès au marché, soutien du pays, subventions à l’exportation) en vertu de ses engagements et dans le cadre de l’article 20 de l’accord, lequel prescrit explicitement que l’on tienne aussi compte des «considérations autres que d’ordre commercial»
L’avantage de telles réformes convenues au plan mondial réside dans le fait que les marchés exportateurs deviennent accessibles à nos produits agricoles et que les perturbations des marchés internationaux causées par des subventions à l’exportation étatiques diminuent En outre, les indications de provenance géographiques – instrument important pour les spécialités suisses – peuvent être mieux protégées
3 A S P E C T S I N T E R N A T I O N A U X 3 . 1 D É V E L O P P E M E N T S I N T E R N A T I O N A U X 3 219
Pour ce qui a trait à l’accès au marché, un relèvement des contingents tarifaires rendrait plus difficile le maintien des volumes de production de l’agriculture suisse C’est pourquoi il importe de viser un niveau de protection raisonnable dans les cas où cela est possible, par exemple au moyen d'un régime de taxes douanières uniques. Il convient d’étudier, également dans le cadre du mandat de négociation, dans quelle mesure on pourrait ou devrait étendre aux autres produits agricoles le système des prix-seuils appliqué aux aliments pour animaux Si l’on envisage des réductions supplémentaires des droits de douane, une distinction doit être faite entre les produits sensibles et non sensibles La clause de protection spéciale pour l’agriculture doit être maintenue, ce qui n ’empêche pas de rechercher des adaptations judicieuses
«Clause de protection spéciale»

Elle peut être appliquée de manière autonome lorsque les quantités importées dépassent un certain seuil ou que le prix à l’importation est tombé au-dessous d’un certain niveau. Dans les deux cas, des droits de douane supplémentaires peuvent être perçus sans que les pays exportateurs puissent exiger des compensations pour des raisons tenant à la politique commerciale
C’est au cours du deuxième semestre 1999 que la Suisse a fait usage pour la première fois de la clause de protection liée aux prix (cf ch 2 1 1)
Compte tenu des réformes agricoles qu ’elle a amorcées, la Suisse dispose d’une certaine marge de manoeuvre pour procéder à d’autres adaptations de son soutien interne Il n ’est toutefois pas toujours facile de faire la distinction entre les paiements directs indépendants de la production – qui, en tant que mesures «Green-Box» ne doivent pas être réduits – et les autres mesures de soutien liées aux produits. Des travaux sont actuellement en cours dans le cadre de l’OCDE pour permettre une classification plus claire des mesures «Green-Box» Ces dernières doivent être ciblées, efficientes et transparentes, et ne sauraient provoquer de distorsions de la production ou du commerce Cependant, il importe que les pays puissent continuer à décider de manière autonome du montant absolu des moyens financiers engagés dans cette catégorie
En matière de subventions à l’exportation, une réduction supplémentaire est indiquée aussi sous l’angle d’une approche générale Pour la Suisse, ce serait toutefois un avantage si elle pouvait y renoncer pour les produits transformés L’Accord agricole bilatéral entre la Suisse et l’UE prévoit une suppression échelonnée des subventions à l’exportation dans le domaine du fromage Il importe de ne pas perdre de vue de tels développements et de défendre activement, à l’OMC aussi, les intérêts des exportations de la Suisse tant dans le domaine susmentionné que dans d’autres. En plus des subventions à l’exportation au sens classique du terme, les crédits à l’exportation et d’autres formes de subventionnement direct et indirect devraient être inclus dans les négociations Mentionnons dans cet ordre d’idées la décision de la Conférence des ministres de l’OCDE de janvier 2000, d’intégrer aussi les crédits à l’exportation de produits agricoles dans l’accord sur les crédits à l’exportation de l’OCDE et de conclure les négociations concrètes sur les modalités si possible pour la fin 2000 au plus tard Au sein de l’OMC, il convient d’obliger tous les pays à limiter ou à supprimer les aides à l’exportation de toute nature.
3 . 1 D É V E L O P P E M E N T S I N T E R N A T I O N A U X 3 220
■ Mieux ancrer la multifonctionnalité au plan international
En matière de «considérations autres que commerciales», la Suisse s ’ engage en faveur de l’amélioration du droit international pour la préservation d’une agriculture multifonctionnelle Dans la première phase des travaux, elle a participé activement au processus de préparation des négociations et à la concrétisation du concept de multifonctionnalité Une plate-forme commune à cet effet a été créée avec l’UE, le Japon, la Norvège, la Corée et l’Ile Maurice Elle bénéficie du soutien de quelque 40 pays Au plan de la concrétisation, les mesures «Green-Box» ont la priorité pour la Suisse Dans d’autres domaines touchant à l’agriculture, la Suisse recherche en outre, afin de bien informer les consommateurs, une amélioration de la protection des indications de provenance géographiques de même qu ’ une clarification de la base légale pour la déclaration de provenance et les méthodes de production Il y a lieu de signaler que, pour les membres de l’OMC, la protection des indications géographiques constitue déjà une obligation découlant de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord ADPIC) Au sein du Conseil ADPIC, deux questions sont actuellement traitées: celle de la concrétisation d’un registre multilatéral pour les vins et les spiritueux, pour lesquels une protection additionnelle doit être garantie et celle de l’extension de la protection additionnelle aux produits autres que les vins et les spiritueux Il va sans dire que la seconde question est du plus grand intérêt pour la Suisse, qui entend protéger ses fromages et ses produits traditionnels non seulement dans l’UE, mais aussi au niveau mondial.
Accords de libre-échange et agriculture
L’Association européenne de libre-échange (AELE), qui regroupe actuellement quatre pays membres (la Suisse, la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein), a conclu depuis le début des années 1990 une série d’accords de libre-échange (ALE) avec des pays tiers Ces accords de libre-échange se fixent pour objectif de procurer à l’économie suisse des conditions d’accès aux marchés comparables à celles qui sont réservées à ses principaux concurrents, surtout européens Ces accords préférentiels sont aujourd’hui au nombre de quinze, dont quatorze sont en vigueur. La plupart ont été conclus avec les Etats d’Europe centrale et orientale (11), les autres avec les pays méditerranéens (4) L’accord conclu avec l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) est entré en vigueur le 1er juillet 1999, celui avec le Maroc le 1er décembre de la même année En juin 2000, l’AELE a également signé un accord de libre-échange avec la Macédoine
L’AELE mène à l’heure actuelle des négociations avec plusieurs pays: Canada, Mexique, Chypre, Egypte, Jordanie et Tunisie Elle a d’ores et déjà décidé d’engager des négociations avec le Chili et l’Afrique du Sud; des pourparlers avec d’autres pays sont également prévus
3 A S P E C T S I N T E R N A T I O N A U X 3 . 1 D É V E L O P P E M E N T S I N T E R N A T I O N A U X 3 221
■ Intégration de l’agriculture
Ces accords couvrent les produits industriels, la plupart des produits agricoles transformés, les produits de la pêche et autres produits de la mer Les produits agricoles de base figurant aux chapitres 1 à 24 du tarif douanier ne sont pas couverts par les accords. Ils font l’objet d’arrangements bilatéraux distincts conclus à titre individuel entre des pays de l’AELE et le pays tiers concerné; ils entrent en vigueur parallèlement à l’ALE Ceci est dû au fait que chaque pays de l’AELE mène sa propre politique agricole et qu’il n ’existe pas de libre-échange pour les produits agricoles en son sein Même si d’un point de vue formel, l’agriculture ne tombe pas sous le coup de ces accords de libre-échange, on peut cependant dire qu ’elle en fait partie intégrante sur le plan pratique pour des raisons politiques
Dans le domaine agricole, les concessions octroyées par la Suisse se sont limitées jusqu’ici à des produits ne compromettant en rien les objectifs de notre politique agricole Au cours des dernières années, la ligne suivie par notre pays a consisté à accepter des demandes de concessions dans la mesure où il s ’agissait de concessions déjà accordées antérieurement à d’autres pays, la Suisse étant cependant prête à entrer en matière sur de nouvelles concessions si ces dernières devaient se révéler déterminantes pour le succès ou l’échec de la négociation, sans toutefois mettre en péril notre politique agricole Jusqu’ici, cette stratégie a dans l’ensemble bien fonctionné. Cependant, certains pays avec lesquels l’AELE envisage d’entamer des négociations sur des accords de libre-échange ont un intérêt particulier à pouvoir exporter leurs produits agricoles L’explication réside entre autres dans le fait que l’UE leur a accordé de sérieux avantages dans le domaine agricole. La Suisse doit donc s ’attendre à ce que, à l’avenir, on exige d’elle davantage de concessions pour les produits agricoles en contrepartie du libre accès au marché pour ses produits industriels Il s ’agira par conséquent pour elle d’obtenir un résultat optimal et équilibré dans ces négociations en évitant toute décision à même d’affecter de manière négative le processus de réforme agricole interne.
■ Résultats des arrangements avec l’OLP et le Maroc
L’arrangement bilatéral sur le commerce des produits agricoles entre la Suisse et l’OLP, entré en vigueur le 1er juillet 1999, prévoit l’octroi par la Suisse de concessions tarifaires en particulier pour les fleurs coupées, certains fruits et légumes Les concessions de l’Autorité palestinienne à la Suisse portent, quant à elles, sur des produits laitiers et certains produits agricoles transformés
Pour ce qui est de l’arrangement conclu avec le Maroc, entré en vigueur le 1er décembre 1999, les concessions octroyées par notre pays consistent en la diminution ou l’élimination de droits de douane sur des produits agricoles particulièrement importants pour le Maroc En contrepartie, la Suisse s ’est vu octroyer des concessions notamment dans les domaines des fromages, des graisses et huiles et des poudres de fruits
3 . 1 D É V E L O P P E M E N T S I N T E R N A T I O N A U X 3 222
■ La situation est meilleure qu’il y a trente ans
Alimentation mondiale et FAO

En trente ans, le nombre de personnes sous-alimentées ou souffrant de la famine dans les pays en développement a baissé de 920 millions à environ 800 millions. Pendant ce même laps de temps, la population mondiale s ’est accrue de 2,3 à 6 milliards d’êtres humains
L’amélioration de la situation alimentaire mondiale résulte des efforts déployés par les pays en développement eux-mêmes, conjugués avec les prestations internationales en matière de développement C’est en grande partie l’utilisation de meilleures techniques agricoles qui a permis un accroissement annuel de 3,3% des rendements agricoles dans les pays en développement entre 1970 et 1990 S’y ajoute une croissance démographique moindre dans ces pays également, soit 1,7% par an. L’augmentation de la production s ’est cependant heurtée à des limites au cours des années nonante, pour ne plus représenter que 2,6% Si l’on inclut les pays industrialisés, cette augmentation n ’est plus que de 1,8%.
En voici les motifs: – les ressources naturelles ont été utilisées sans le respect nécessaire de l’environnement, et le principe d’un développement agricole et rural durable a été négligé pendant de longues années, ce qui rend plus difficiles aujourd’hui les progrès en matière de productivité;
– les pauvres absolus, au nombre de 1,2 milliard de personnes en 1999, disposaient de moins d’un dollar par jour et ne disposaient ainsi pas du pouvoir d’achat nécessaire pour l’acquisition de denrées alimentaires;
– une multitude de catastrophes naturelles ou induites par l’homme, de guerres et de conflits ont restreint d’autant l’offre et la demande de denrées alimentaires dans les régions concernées;
– en Afrique subsaharienne, l’augmentation de la productivité agricole (3,0%) reste toujours inférieure à la croissance démographique (3,2%)
Année Population Victimes Par rapport de la famine à la population en mrd en mio 1970 3,7 920 1 personne sur 4 1980 4,5 900 1 personne sur 5 1990 5,3 840 1 personne sur 6 1995 5,8 820 1 personne sur 7 2000 6,0 800 1 personne sur 7,5 2010 1 7,2 720 1 personne sur 10 2015 2 7,5 400 1 personne sur 19
La faim dans le monde
1 Tendance extrapolée
2 But du sommet de la FAO de novembre 1996 sur l’alimentation mondiale
Sources: UNFPA, FAO
3 A S P E C T S I N T E R N A T I O N A U X 3 . 1 D É V E L O P P E M E N T S I N T E R N A T I O N A U X 3 223
Tableaux 47–48, pages A56–A57
■ Sommet alimentaire mondial de 1996 à Rome

Pour qu’il n ’ y ait plus de famine parmi une population mondiale estimée à 8,5 milliards en 2025, la production agricole devrait être accrue de 75% par rapport à celle des années nonante Ce but ne pourra être atteint sans une solidarité mondiale C'est pourquoi nous avons l'obligation de multiplier les efforts visant à renforcer le secteur agricole dans le tiers monde et à préserver une agriculture productive en Suisse
Les progrès réalisés sur le plan de l’alimentation mondiale, notamment en chiffres relatifs, ne sauraient faire perdre de vue qu ’ un habitant sur sept continue de souffrir de la faim ou d’être sous-alimenté Dans les années nonante, le nombre de victimes de la famine menaçait de stagner à un niveau élevé, d’où le sommet mondial convoqué par la FAO en 1996. Les présidents et représentants gouvernementaux de 186 pays ont approuvé un plan d’intervention et la déclaration de Rome Le but: réduire de moitié d’ici l’an 2015 le nombre de personnes souffrant de la faim ou sous-alimentées
La Suisse s ’est engagée en faveur de quatre éléments-clés lors de la formulation du plan, éléments qui revêtent aussi un importance particulière pour la mise en application:
– nécessité d’une bonne gestion gouvernementale;
– politique agricole multifonctionnelle servant des objectifs divers;
– mode de production durable;
– droit de co-décision démocratique, surtout pour les femmes
On constate, quatre ans après le sommet, que la communauté mondiale est toujours très éloignée de la voie conduisant à l’objectif fixé en 1996 Le nombre de victimes de la famine, qu’il est prévu de ramener à 400 millions d’ici 2015, n ’est pas sensiblement descendu en dessous de la barre des 800 millions en 1999
En voici les raisons principales:
– en dépit d’un accroissement global de la production alimentaire, la pauvreté absolue a continué de s’étendre parmi de larges couches de la population;
– les efforts entrepris par les pays concernés et les Etats donateurs sont insuffisants pour atteindre les objectifs fixés; les investisseurs sont réticents lorsqu’il s ’agit de favoriser le développement agricole dans les pays les plus pauvres;
– les catastrophes dues à des causes naturelles et aux interventions des hommes ont doublé au cours des vingt dernières années; plus de la moitié des populations sousalimentées sont durement touchées par des guerres, des conflits armés et des catastrophes écologiques;
au cours des dernières années, les crises économiques et financières survenues en Russie et divers pays asiatiques ont réduit à néant les progrès réalisés dans la lutte contre la pauvreté et la faim
–
3 . 1 D É V E L O P P E M E N T S I N T E R N A T I O N A U X 3 224
■ FAO: organisation spéciale de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture
La FAO a été fondée le 16 octobre 1945 avec les buts suivants:
contribuer à élever le niveau de vie dans le monde, à améliorer la situation alimentaire et à vaincre la famine et la sous-alimentation;
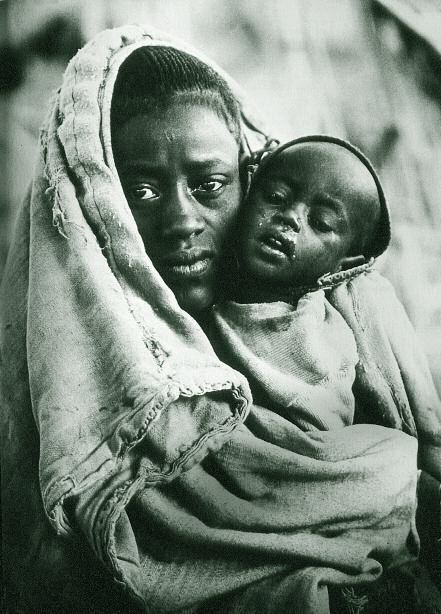
améliorer l’efficience de la production et la distribution des produits agricoles;
– créer des conditions de vie favorables pour la population rurale;
– promouvoir le développement économique mondial
Font partie des tâches normatives de la FAO:
– la collecte, l’évaluation et la diffusion d’informations statistiques, économiques et scientifiques pour développer l’agriculture et les économies forestière et alimentaire dans le monde (www fao org);
– la mise au point de bases de décision pour un développement agricole mondial, régional et national, conjointement avec les Etats membres et d’autres organisations internationales;
le développement de stratégies agricoles et alimentaires, surtout dans les pays en développement, compte tenu de la durabilité et de la protection des ressources naturelles
Tâches opérationnelles de la FAO:
– exécution de programmes et de projets de développement au moyen du budget ordinaire ou avec le financement de la Banque mondiale, des pays donateurs ou d’autres institutions;
– participation aux mesures d’aide alimentaire dans le cadre du Programme alimentaire mondial de la FAO/ONU;
l’instauration d’un programme spécial pour la sécurité alimentaire dans les pays en développement à faibles revenus, importateurs de produits alimentaires
–
–
–
–
3 A S P E C T S I N T E R N A T I O N A U X 3 . 1 D É V E L O P P E M E N T S I N T E R N A T I O N A U X 3 225
■ Accords d’une importance particulière pour l’agriculture
La Suisse est membre depuis 1947 de cette organisation spéciale de l’ONU. Le secrétariat suisse de la FAO à l’OFAG est le service de la Confédération responsable de la coordination envers la FAO à Rome Il assume aussi les travaux de secrétariat du comité FAO suisse qui, élu par le Conseil fédéral, est compétent en matière de suivi et de concrétisation du plan d’intervention du sommet alimentaire mondial

Le comité FAO est une commission consultative extra-parlementaire pour toutes les questions relatives à la FAO et à l’alimentation mondiale Il se compose de représentants de diverses organisations non gouvernementales actives dans les domaines du développement, de l’économie et de la science
La Suisse verse une participation annuelle aux dépenses de la FAO. La cotisation est calculée sur la base d’une clé décidée par l’assemblée générale de l’ONU pour une période de deux ans En ce qui concerne 2000/01, la Suisse participe au budget à raison de 1,2%, soit quelque 6 millions de francs. Elle contribue par ailleurs à des projets de développement et à des programmes destinés à améliorer la sécurité alimentaire dans le cadre de sa coopération au développement
Accords internationaux dans le domaine du développement durable et de l’environnement
Le développement galopant de la démographie et de l’économie mondiales a entraîné une «consommation» de l’environnement toujours plus forte depuis ces cinquante dernières années Dès les années septante, on s ’est rendu compte que les grands problèmes environnementaux appelaient une solution internationale La première conférence mondiale sur l’environnement a eu lieu à Stockholm en 1972, donnant lieu au premier débat d’envergure en la matière. Le deuxième sommet de 1992 à Rio a démontré qu’il ne saurait y avoir de protection de l’environnement sans progrès social et sans efficience économique Ecologie, économie et aspect social constituent les trois piliers d’un développement durable. Un programme d’action en matière de développement et d’environnement a été adopté à l’issue de la Conférence de Rio Il demande aux gouvernements d’élaborer des stratégies pour un développement durable Divers autres accords sur l’environnement ont été signés au cours des dernières années
Agenda 21;
– Engagement international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture (International Undertaking on Plant Genetic Resources);
– Convention des Nations Unies sur la diversité biologique;
– Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques;
Convention sur les pollutions de l’air transfrontalières;
– Protocole de la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone;
– Convention sur la protection des Alpes;
Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe;
– Convention relative à la protection de l’environnement maritime de l’Atlantique du nord-est
3 . 1 D É V E L O P P E M E N T S I N T E R N A T I O N A U X 3 226
–
–
–
■ La FAO et la Suisse
■ Engagement international et Convention sur la diversité biologique: aspects agricoles
Toutes ces conventions internationales n ’ont pas la même importance pour le secteur de l’agriculture Sont les plus importants les engagements qui découlent de l’Engagement international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (International Undertaking on Plant Genetic Resources), de la Convention sur la diversité biologique (Convention on Biological Diversity;CBD) et de la Convention sur les changements climatiques (Framework Convention on Climate Change; FCCC)
La diversité génétique joue un rôle important pour assurer à long terme l’approvisionnement alimentaire de la population A la fin des années septante, les efforts visant à conserver les ressources phytogénétiques ont été intensifiés aux niveaux national et international. Lors de sa 22e conférence en 1983, la FAO a adopté un programme global pour la conservation et l’utilisation durable desdites ressources dans les domaines de l’alimentation et de l’agriculture En fait partie un engagement international non contraignant (International Undertaking) qui a pour but d’assurer le libre accès aux échanges d’information en la matière
Les pays membres de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement ont adopté la Convention sur la diversité biologique en mai 1992 à Nairobi. Celle-ci couvre tous les aspects de la diversité biologique (diversité génétique, diversité des espèces, diversité des écosystèmes) et constitue une parade internationale à son appauvrissement Conformément à l’article 1 de la convention, les Etats contractants s ’engagent à mettre en oeuvre les objectifs suivants:
– maintien de la diversité biologique;
– utilisation durable de ses composantes;

partage juste et équitable des avantages découlant de l’exploitation des ressources génétiques
Les Etats contractants sont par ailleurs incités à:
– renforcer la collaboration internationale;
– mettre en oeuvre les objectifs de la Convention sur la biodiversité dans des stratégies, des politiques et des plans nationaux (politiques sectorielles comprises);
– prendre des mesures économiquement et socialement rationelles incitant à maintenir et à utiliser durablement la diversité biologique;
– encourager le savoir-faire scientifique et technique;
– contribuer à l’information et à la sensibilisation du public
3 A S P E C T S I N T E R N A T I O N A U X 3 . 1 D É V E L O P P E M E N T S I N T E R N A T I O N A U X 3 227
–
■ Droits des agriculteurs et Benefit Sharing
Dans le domaine des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture, la Convention sur la diversité biologique reconnaît un rôle de leader à la FAO L’engagement international en la matière tend à devenir l’élément central d’une agriculture durable. L’engagement en vigueur jusqu’ici est un accord passé entre les milieux intéressés de la production végétale et de la recherche, alors que le nouvel objet des négociations s ’alignera sur les préoccupations de la Convention sur la diversité biologique et sera un protocole de force obligatoire Le schéma représente les principaux objets des nouvelles négociations
Comparaison entre l'engagement actuel et le nouvel engagement
Nouvel engagement
Accès aux ressources phytogénétiques
Engagement actuel
– Banques génétiques
– Recherche agronomique
– Accès au matériel des banques génétiques
– Réseau d'information
– Financement
Partage des bénéfices
Droits des agriculteurs
Utilisation durable des ressources phytogénétiques dans l'exploitation
Coûts et financement des nouvelles tâches
En reconnaissant les droits des agriculteurs (Farmers Rights), on entend valoriser les prestations actuelles et futures de l’agriculture pour le maintien et le développement des ressources génétiques au profit de la collectivité Les systèmes de production agricole se concentrent, en effet, de plus en plus sur les prestations rétribuées par le marché Sans interventions directes ou subsidiaires de l’Etat, on risque un jour de voir disparaître peu à peu les prestations sans valeur marchande, telles que la culture de variétés rares ou l’élevage d’anciennes races d’animaux de rente
La notion de «partage des bénéfices» (Benefit Sharing) décrit la répartition des avantages liés à l’utilisation commerciale ou autre des ressources génétiques Une telle utilisation n ’est possible que parce que les agriculteurs sélectionnent des plantes depuis des générations et qu’ils ont, ce faisant, conservé et transmis les connaissances relatives aux propriétés et aux diverses utilisations des plantes et des animaux
3 . 1 D É V E L O P P E M E N T S I N T E R N A T I O N A U X 3 228
Lors de la cinquième conférence qui a réuni en juin 2000, à Nairobi, les Etats contractants de la Convention sur la diversité biologique, les délégués ont entre autres traité de l’accès aux ressources génétiques, de la répartition équitable des avantages liés à l’utilisation de ces ressources (benefit sharing) et de la protection des acquis traditionnels
Il ressort des négociations que le niveau des connaissances concernant l’état et l’évolution de la biodiversité dans l’alimentation et l’agriculture est encore très divers Le savoir interdisciplinaire est lacunaire, les causes de l’appauvrissement de la diversité biologique sont peu claires et les indicateurs d’appréciation généraux font défaut C’est pour supprimer ces incertitudes qu ’ un programme de travail a été élaboré; il contribuera à résoudre les questions suivantes:

– dégager les interventions nécessaires;
– identifier les politiques permettant de concrétiser la Convention sur la diversité biologique;
– intensifier l’acquisition de connaissances et leur transfert
Le Protocole sur la sécurité biologique (Biosafety) a été soumis à la conférence pour signature Il règle le commerce interétatique d’organismes génétiquement modifiés
L’étroite collaboration avec la FAO a été confirmée au niveau institutionnel Il a été demandé à l’organisation d’achever aussi vite que possible l’Engagement international sur les ressources phytogénétiques. La conférence a par ailleurs décidé de demander à l’OMC un statut d’observateur au sein du comité agricole, et cela notamment parce qu’il existe des rapports étroits entre l’OMC et la Convention sur la diversité biologique Ainsi, la première reconnaît la grande portée de diverses décisions de la convention, telles que celles qui concernent la biodiversité agricole, les plantes étrangères risquant de menacer les écosystèmes indigènes, les habitats naturels ou la flore, ou encore celle qui a trait au droit de la propriété intellectuelle, ces décisions pouvant toutes exercer des effets sur les règles commerciales
3 A S P E C T S I N T E R N A T I O N A U X 3 . 1 D É V E L O P P E M E N T S I N T E R N A T I O N A U X 3 229
■ Résultats de la cinquième conférence des Etats contractants dans le secteur agricole
■ Convention-cadre sur le climat: aspects agricoles
La Convention sur le climat entend freiner la hausse des températures moyennes à la surface de la terre En tant qu ’objectif final, elle vise la stabilisation des concentrations, dans l’atmosphère, de gaz à effet de serre à un niveau excluant une détérioration dangereuse du climat par l’homme. Ce niveau devrait être atteint dans un laps de temps qui permette aux écosystèmes de s ’adapter naturellement aux changements climatiques, de manière à ne pas mettre en danger la production alimentaire et à poursuivre durablement le développement économique Le Protocole de Kyoto a fixé des objectifs légalement contraignants et un calendrier pour la réduction des émissions La Suisse s ’est engagée à cette occasion à réduire ses émissions de 8% d’ici à 2012 par rapport à l’année 1990, un engagement auquel elle se doit de donner suite globalement L’agriculture devra, elle aussi, apporter sa contribution
En ce qui concerne le Protocole de Kyoto, il s ’agit essentiellement de réduire les émissions imputables aux processus de combustion Le texte permet de respecter ces engagements non seulement par une réduction des émissions, mais aussi par l’utilisation du phénomène puits On entend par là un processus par lequel un gaz à effet de serre est extrait de l’atmosphère et fixé pendant un certain laps de temps Or l’homme peut, par des activités ciblées, créer de telles possibilités: reforestations et modes d’exploitation agricole ménageant le sol Les Etats ont pu déposer leurs suggestions au secrétariat de la Convention sur le climat jusqu’au 1er août 2000, une chance que la Suisse a saisie. La suite des négociations montrera dans quelle mesure ces interventions de l’homme peuvent être prises en considération dans le calcul des futurs inventaires
3 . 1 D É V E L O P P E M E N T S I N T E R N A T I O N A U X 3 230
3.2 Comparaisons internationales
Après la seconde guerre mondiale, l’agriculture suisse a été largement mise à l'écart de la concurrence internationale Cette situation a changé dans les années nonante L’agriculture est de moins en moins à l’abri de la mondialisation de l’économie et de la société L’accord de l’OMC conclu en 1994 à Marrakech a fixé pour la première fois des règles pour le commerce de produits agricoles et a déclenché un processus conduisant à la réduction du protectionnisme dans ce domaine L’accord agricole signé suite aux négociations bilatérales avec l’UE apportera une nouvelle ouverture réciproque du marché pour divers produits
Dans cette situation, la question de la position internationale de notre agriculture se pose de plus en plus souvent Le présent chapitre y est tout particulièrement consacré Dans la première édition du rapport agricole, on compare, d’une part, les prix suisses à la production et à la consommation avec ceux pratiqués dans divers autres pays et, d’autre part, les marges suisses avec celles observées en Allemagne et aux Etats-Unis
Il est prévu de développer ce domaine dans les prochaines éditions Une étude comparative des coûts de production en Suisse et en Allemagne est en cours Ce projet vise à présenter les différences de coûts entre des groupes d’exploitations suisses représentatifs et le même type de groupes en Allemagne et à analyser les raisons de ces disparités Il s ’agit d’examiner notamment l’impact des prix et de la dimension ainsi que d’autres effets tels que la différence de prescriptions ou de grandeurs des parcelles.

■■■■■■■■■■■■■■■■
3 A S P E C T S I N T E R N A T I O N A U X 3 . 2 C O M P A R A I S O N S I N T E R N A T I O N A L E S 3 231
■ Prix à la production
Comparaisons internationales de prix
A partir du marché suisse, nous établissons des comparaisons avec des marchés étrangers identiques, similaires ou importants. La position de l’agriculture suisse et sa compétitivité en matière de prix sur le plan international occupent ici l’avant-plan Par souci d’objectivité, les comparaisons internationales sont établies sur la même base pour une période prolongée
Il n ’est pas facile de procéder à des comparaisons internationales Le choix des produits, la disponibilité des chiffres, la pertinence des valeurs, les modes de production et de commercialisation différents ou les facteurs monétaires posent des problèmes C’est pourquoi il ne s ’agit pas là de valeurs absolues, mais des taux de variation enregistrés au fil du temps
Les recettes réalisées par les producteurs servent de base à la comparaison Elles sont pondérées selon la composition de la production finale en Suisse Le modèle de production suisse est ainsi transposé aux pays faisant l’objet de la comparaison On peut donc, par exemple, montrer la différence relative par rapport aux Etats-Unis en se référant pour notre agriculture aux recettes réalisées par les producteurs américains.
Les chiffres de l’UE portent sur les quatre pays voisins (UE-4) Les Pays-Bas et la Belgique sont en plus pris en compte dans les domaines des pommes de terre et des légumes, les volumes de production étant élevés dans ces deux pays (UE-6) Le calcul de la moyenne pour l’UE repose sur les parts de production des pays retenus à la production totale du groupe donné Les quatre, voire six pays, produisent entre 45 et 80% de la quantité totale produite par l’UE
Sources: USP, OFAG, Eurostat, U.S. Departement of Agriculture
du prix à la production: Suisse en relation aux pays choisis
IA F I n d i c e ( 1 9 9 0 / 9 2 = 1 0 0 ) 90/92 97/99 à CH 90/92
Tableaux 42–43b, pages A51–A53
Evolution
CHUE-4/6DUSA
0 100 60 80 40 20 10 70 90 50 30 3 . 2 C O M P A R A I S O N S I N T E R N A T I O N A L E S 3 232
Entre les deux périodes sous observation, les prix à la production ont diminué en Suisse de 19%, soit une baisse semblable à celle enregistrée dans les pays de l’UE environnants Certes, cela peut paraître insuffisant dans la perspective d’un rapprochement du niveau des prix européen, mais dans l’absolu, le montant réalisé par unité en Suisse équivaut au double de celui réalisé dans l’Union Si nos paysans produisaient le même panier type que les agriculteurs des pays environnants, les prix obtenus par ceux-là équivaudraient à 53% des prix suisses dans les deux périodes La fourchette est cependant très large Ainsi, en 1999, les recettes provenant des pommes de terre ont été de 16% plus élevées en Italie qu ’ en Suisse
Les chiffres comparatifs relatifs à l’Autriche revêtent un intérêt tout particulier: ils permettent de confronter les situations d’avant et d’après l’adhésion à l’UE. Les recettes réalisées par les producteurs étaient en moyenne de 38% inférieures au niveau suisse en 1990/92; en 1997/99, cet écart s ’est élargi, passant à 52%
Une autre évolution peut être observée en référence aux Etats-Unis Les recettes des producteurs corrigées selon les taux de change ont augmenté globalement en raison du cours élevé du dollar (+4%); les recettes exprimées en monnaie nationale ont parfois également progressé, comme pour le lait cru (+10%) L’écart par rapport aux Etats-Unis s ’est ainsi réduit.
Aux fins de cette comparaison, les écarts de prix entre la Suisse et les pays considérés ont été déterminés selon le schéma de pondération de l’indice suisse des prix à la consommation Le schéma de la consommation suisse a été transposé aux autres pays Les différences concernant les parités de pouvoir d’achat et la situation des coûts n ’ont pas été prises en compte
Le groupe «UE-4» comprend les pays voisins, c ’est-à-dire l’Allemagne, la France, l’Italie et l’Autriche Faute d’alternative, les chiffres détaillés de la ville de Turin ont servi de référence pour l’Italie; c ’est malgré tout un bon indicateur de prix vu la proximité du marché suisse La Belgique a été prise en considération, en plus, dans le domaine des légumes (pommes de terre comprises) et lorsque les prix devant servir de référence n’étaient pas disponibles pour un ou plusieurs pays d’entre les quatre Etats précités Les prix à la consommation officiels n ’ont pas été disponibles pour les Pays-Bas Les prix minimaux (UE-min) et les prix maximaux (UE-max) constatés dans les quatre ou cinq pays de référence ont été regroupés dans les segments correspondants
 ■ Prix à la consommation
■ Prix à la consommation
3 A S P E C T S I N T E R N A T I O N A U X 3 . 2 C O M P A R A I S O N S I N T E R N A T I O N A L E S 3 233
Tableaux 44–45, pages A54–A55
Evolution du prix à la consommation: Suisse en relation aux pays choisis
L’écart des prix par rapport à l’étranger n ’est pas aussi grand que dans le cas des prix à la production, notamment parce que les marchandises importées sont comprises dans les prix à la consommation
En Suisse, les prix à la consommation des produits retenus pour cette comparaison ont baissé de 4% D’un point de vue relatif, le recul est moindre que celui des prix à la production Dans l’absolu, la somme équivaut environ à celle des prix à la production puisque la part de l’agriculture dans la valeur de vente finale des denrées alimentaires s’élève en moyenne à 24% seulement (cf évolution de la marge du marché en Suisse, en Allemagne et aux USA) Autrement dit, la baisse des prix à la production a été plus ou moins répercutée sur les prix à la consommation La baisse se chiffre à 7% dans les pays de l’UE servant de référence, aussi bien pour les prix élevés que pour les prix bas L’écart entre la Suisse et les pays environnants est donc passé de 29 à 31%. Les variations à l’intérieur des pays observés sont toutefois très importantes Si l’on ne prend en considération que les maxima, le niveau des prix est comparable au niveau suisse, avant tout en raison des prix enregistrés à Turin et en Autriche. Certains produits, tels que le pain blanc, le sucre ou les oignons, sont même moins chers en Suisse que dans les pays de référence
Comme pour les prix à la production, l’écart des prix à la consommation a également diminué entre les Etats-Unis et la Suisse Pour le panier considéré, les prix ont augmenté de 13% aux Etats-Unis La différence par rapport à la Suisse est passée de 49 à 37%
3 . 2 C O M P A R A I S O N S I N T E R N A T I O N A L E S 3 234
CHUE-4/5USA ø UE-max ø UE-min I n d i c e ( 1 9 9 0 / 9 2 = 1 0 0 ) 90/92 97/99 à CH 90/92 Sources: OFS, OFAG, ZMP (D), services statistiques de Turin (I), F, B, A, USA 0 100 60 80 40 20 10 70 90 50 30
■ Méthode pour le calcul de la marge du marché globale
Evolution de la marge du marché en Suisse, en Allemagne et aux USA
La plupart des produits agricoles ne passent pas du producteur (agriculteur) au consommateur dans leur forme d’origine Entre la production agricole et l’offre dans les magasins de vente de détail et les établissements de restauration, les produits voient leur valeur augmenter du fait du transport et du stockage, de même que de la préparation et de la transformation Les dépenses du consommateur en matière de denrées alimentaires contiennent ainsi deux composantes: la rémunération des produits agricoles «départ de la ferme» plus celle de la valeur ajoutée On a essayé, par le calcul ci-après, de déterminer l’étendue de ces deux composantes, d’un côté pour la Suisse, de l’autre pour l’Allemagne et les USA. Selon la composante prise en considération, on parle soit de part du producteur, soit de marge du marché La part du producteur (part de l’agriculture) consiste en les recettes de l’agriculture résultant de la vente des produits agricoles par rapport aux dépenses des consommateurs pour les denrées alimentaires qu’ils demandent Quant à la marge du marché, elle montre la part de la valeur ajoutée par rapport aux dépenses de consommation
Les considérations ci-après sont fondées sur une étude (Senti, König) effectuée sur mandat de l’OFAG.
Tout d’abord, on établit le prix à la production de chacun des produits agricoles entrant dans la consommation alimentaire suisse On déduit de la valeur totale de la production de l’agriculture suisse les revenus et les recettes de la vente des produits agricoles qui ne peuvent être imputés au domaine des denrées alimentaires (par exemple, revenu provenant de pensions pour la garde de chevaux ou recettes de la vente du tabac) ainsi que les exportations de denrées alimentaires.
Représentation des méthodes de calcul
Production finale de l'agriculture
moins valeur de la production des produits agricoles ne faisant pas partie des denrées alimentaires
moins valeur d'exportation des denrées alimentaires
Valeur de la production agricole
«Part du producteur»
Dépenses de consommation pour les denrées alimentaires
moins dépenses de cosommation pour les denrées alimentaires importées
Dépenses de consommation des résidants et des touristes pour les denrées alimentaires produites en Suisse
Source: Senti
3 A S P E C T S I N T E R N A T I O N A U X 3 . 2 C O M P A R A I S O N S I N T E R N A T I O N A L E S 3 235
Valeur ajoutée sous forme de transport et de stockage ainsi que de traitement et de transformation «Marge du marché»
■ Diminution de la part de l’agriculture aux dépenses de consommation entre 1988 et 1998
Dans une deuxième opération, on calcule la valeur de consommation des denrées alimentaires provenant de la production indigène Cette valeur se compose des dépenses pour les denrées alimentaires des ménages privés et des établissements de restauration (hôpitaux, maisons de retraite, etc.) ainsi que des dépenses pour les repas pris à l’extérieur Il convient d’ajouter aux dépenses de consommation des résidants celles des touristes séjournant dans notre pays Vu que le calcul repose uniquement sur les denrées alimentaires produites et consommées en Suisse, la valeur des denrées alimentaires importées doit être déduite des dépenses de consommation La comparaison entre la valeur de production et la valeur de consommation donne la part du fabricant et la marge du marché exprimées en % de la valeur de consommation
■ Evolution à long terme de la marge du marché
La valeur de production de l’agriculture représentait en 1988 un total de 8,5 milliards de francs avant de reculer jusqu’en 1998 pour s’établir à 6,5 milliards de francs. Les dépenses de consommation pour les produits agricoles suisses, ou pour les denrées alimentaires à la fabrication desquelles ils ont servi, ont augmenté au cours de la même période, passant de 22,8 à 27,2 milliards de francs. En 1988, la part de la valeur de production par rapport aux dépenses de consommation s’établissait à 37,6% Cette part s ’est régulièrement rétrécie dans les années suivantes et ne se montait plus qu’à 23,9% en 1998 Cette année-là, sur un franc de consommation, 24 ct sont revenus aux producteurs de produits agricoles de base
Les tendances à long terme de la marge du marché peuvent être articulées à l’aide de calculs antérieurs (Angehrn, Senti) qui englobent la période 1950 à 1989. Vu les différentes méthodes de calcul appliquées, il convient d’apporter certaines adaptations aux résultats du passé afin de garantir l’unité Abstraction faite de petites fluctuations, la part du producteur suit à long terme une courbe négative, une relation linéaire illustrant relativement bien cette évolution Sur la période observée, la part de l’agriculture aux dépenses de consommation annuelles a reculé en moyenne de 0 76 point pour-cent
3 . 2 C O M P A R A I S O N S I N T E R N A T I O N A L E S 3 236
Evolution de la marge du marché et de la part du producteur 19881989 Marge du marché Part du producteur 199019911992199319941995199619971998 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Source: Senti e n %
Tableau 46, page A56
Evolution à long terme de la marge du marché et de la part du producteur
■ Recul comparable de la part du producteur en Allemagne, aux USA et en Suisse
Les marges du secteur des denrées alimentaires sont mesurées depuis longtemps aussi bien en Allemagne (Wendt) qu ’ aux USA (United States Department of Agriculture) La comparaison avec l’étranger fournit les premiers points de référence à une interprétation du développement des marges suisses sur les denrées alimentaires Il s ’agit cependant de rester prudent dans la comparaison à cause des divergences des méthodes utilisées Les calculs en Allemagne et aux USA ne tiennent notamment pas compte de la consommation à l’extérieur du domicile La marge du marché étant particulièrement élevée lors des repas pris à l’extérieur, la part du producteur serait inférieure si les relevés allemands et américains englobaient ladite consommation
En 1988, les parts des recettes de la production agricole aux dépenses de consommation étaient très proches en Suisse et en Allemagne En règle générale, les recettes moindres de l’agriculture US s ’expliquent par les frais de transport élevés pour des raisons géographiques, les importantes prestations Convenience et les prix plus bas des produits à l’échelon agricole. Au cours de la décennie suivante, soit de 1988 à 1998, les parts des producteurs ont enregistré un recul quasiment parallèle dans les trois pays

3 A S P E C T S I N T E R N A T I O N A U X 3 . 2 C O M P A R A I S O N S I N T E R N A T I O N A L E S 3 237
Evolution de la part du producteur en comparaison internationale Année Suisse Allemagne USA %%% 1988 37,6 36,1 30,2 1993 30,7 27,9 25,9 1998 23,9 25,8 22,2 Source: Senti
1950 Marge du marché Part du producteur 19601970198019902000 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Source: Senti e n %
■ Interprétation des résultats
Jusqu’en 1994, la part de l’agriculture en Suisse a enregistré un recul inférieur à celui de l’Allemagne, mais un peu supérieur à celui des USA, la part US se situant initialement à un niveau inférieur (effet de base) Dans les années suivantes, la part du producteur suisse a diminué davantage qu ’ en Allemagne et qu ’ aux USA
En dépit de méthodes de calcul différentes, on constate, aussi bien sur le plan de la structure que sur celui de l’évolution des dépenses de consommation pour les denrées alimentaires et leur répartition entre l’agriculture et les secteurs économiques en aval, une similitude dans les trois pays industrialisés pris en compte, similitude qui se caractérise par un niveau de vie semblable et des habitudes de consommation comparables
De 1988 à 1998, la part de l’agriculture pour chaque franc dépensé a passé en Suisse de quelque 38 ct. à 24 ct. L’une des causes directes de cette évolution réside dans la réorientation de la politique agricole helvétique, notamment dans le passage du système du soutien du revenu agricole par les prix à celui du soutien par les paiements directs. Les prix à la production ont reculé. La perte de revenu a été partiellement compensée par les paiements directs à l’agriculture En revanche, les prix à la consommation sont demeurés pour l’essentiel stables
Par contre, l’hypothèse fréquemment avancée selon laquelle l’augmentation de la marge du marché serait due aux dépenses accrues pour les repas pris au restaurant ne se confirme pas La part des repas à l’extérieur dans les dépenses de consommation est restée pratiquement constante de 1988 à 1998
La diminution de la part du producteur peut entre autres s ’expliquer par le changement des habitudes alimentaires La demande de viande et de produits carnés, de lait et de produits laitiers, à savoir de produits à part de valeur agricole supérieure à la moyenne, n ’ a cessé de régresser depuis des années De plus, les produits dont la part du producteur est réduite, prennent de l’importance Ce déplacement de la demande a fait baisser la part moyenne de l’agriculture
3 . 2 C O M P A R A I S O N S I N T E R N A T I O N A L E S 3 238 Evolution de la part du producteur en comparaison internationale 19881989199019911992199319941995199619971998 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0
Suisse Allemagne
I n d i c e ( 1 9 8 8 = 1 )
Source: Senti
USA
Il s ’agit de prendre en compte le transport, le stockage, la conservation et la transformation comme éléments indispensables de la production de denrées alimentaires Etant donné la concentration accrue de la population dans les agglomérations, on ne saurait envisager de distribution des denrées alimentaires par les grossistes ou les détaillants sans transport et commerce professionnels Le changement des habitudes de consommation, le souhait de disposer toute l’année d’une offre de produits frais, la demande en hausse pour les denrées alimentaires transformées ou prêtes à servir ainsi que pour les prestations Convenience, entraînent une transformation accrue Le commerce intermédiaire décelant les créneaux du marché, il s ’ensuit généralement une augmentation de la demande de denrées alimentaires ou de produits agricoles Il importe en outre de tenir compte, dans l’interprétation des marges, de la corrélation entre les résultats des dernières années et l’évolution à long terme ainsi que de leur harmonisation avec les expériences acquises à l’étranger
Les calculs ne font apparaître que les évolutions, non pas les causes. Les résultats ne révèlent notamment rien de la justification économique et adéquate des parts incombant aux secteurs de la fabrication et de la transformation Pour en savoir davantage, d’autres analyses s ’avèrent indispensables
3 A S P E C T S I N T E R N A T I O N A U X 3 . 2 C O M P A R A I S O N S I N T E R N A T I O N A L E S 3 239
240
A N N E X E A1 ■■■■■■■■■■■■■■■■ Annexe Tableaux Marchés A2 Tableaux Résultats économiques A12 Tableaux Dépenses de la Confédération A24 Tableaux Aspects internationaux A51 Textes légaux relevant du domaine de l‘agriculture A58 Procédés et méthodes A61 Abréviations A64 Bibliographie A66
■■■■■■■■■■■■■■■■ Tableaux Marchés
Tableau 1
Surface agricole utile d'après l'affectation
A2 A N N E X E
Produit 1990/92 1997 1998 1999 1990/92 –1997/99 ha ha ha ha % Céréales 207 292 186 373 186 867 182 256 -10 7 Céréales panifiables 102 840 101 751 100 962 97 542 -2 7 Blé 96 173 95 432 95 917 92 861 -1 5 Epeautre 2 160 2 174 1 542 1 221 -23 8 Seigle 4 432 3 973 3 367 3 433 -19 0 Méteil de céréales panifiables 75 172 136 27 48 9 Céréales fourragères 104 453 84 622 85 905 84 714 -18 5 Orge 59 695 48 115 49 020 48 941 -18 4 Avoine 10 434 8 157 7 198 5 866 -32 2 Méteil de céréales fourragères 238 583 540 211 86 8 Maïs-grain 25 739 20 244 21 046 21 647 -18 5 Triticale 8 347 7 523 8 101 8 049 -5 5 Légumes à cosse 2 258 3 305 2 866 2 950 34 6 Pois fourragers (protéagineux) 2 112 2 955 2 468 2 680 27 9 Féveroles 146 350 398 270 131 9 Plantes sarclées 36 385 35 584 34 183 34 429 -4 5 Pommes de terre (plants compris) 18 333 14 962 13 883 13 740 -22 6 Betteraves sucrières 14 308 16 727 16 675 17 450 18 5 Betteraves fourragères (semi-sucrières) 3 744 3 895 3 625 3 239 -4 2 Oléagineux 18 203 18 103 19 449 18 914 3 4 Colza 16 730 14 745 15 169 14 865 -10 8 Tournesol - 1 017 1 396 1 776Soja 1 474 2 341 2 884 2 273 69 9 Matières premières renouvelables 0 1 535 1 631 1 591Colza - 1 513 1 531 1 533Autres (kénaf, chanvre etc ) - 22 100 58Légumes de plein champ 8 250 8 474 8 076 8 189 0 0 Maïs vert et d'ensilage 38 204 42 279 40 997 40 475 8 0 Jachères vertes et florales 319 4 009 4 375 3 406 1 1133 3 Autres terres ouvertes 830 1 076 917 1 739 49 8 Terres ouvertes 311 741 300 738 299 361 293 949 -4 4 Prairies artificielles 94 436 113 865 113 116 115 933 21 0 Autres terres assolées 3 977 2 998 2 967 3 575 -20 0 Terres assolées, total 410 154 417 601 415 444 413 457 1 1 3 Cultures fruitières 7 162 7 219 7 210 7 172 1 0 5 Vignes 14 987 14 934 14 991 15 042 1 0 0 Roseau de Chine 3 280 274 260 8944 4 Prairies naturelles, pâturages 638 900 627 457 632 428 626 799 -1 6 Autre affectation et litière et tourbe 7 394 8 237 8 059 9 169 14 8 Surface agricole utile 1 078 600 1 075 728 1 078 405 1 071 899 -0 3 1 Provisoire Sources: USP, OFS
Lait et produits laitiers: USP (1990– 98), dès 1999 TSM
Proviande
GalloSuisse
plantes sarclées et oléagineux: USP toutes les quantités 1999 provisoires
Fruit-Union Suisse
A N N E X E A3 Tableau 2 Production Produit Unité 1990/1992 1997 1998 1999 1990/92–1997/99 % Lait et produits laitiers Lait de consommation t 549 810 496 714 488 486 438 000 -13 7 Crème t 68 133 67 500 66 400 70 400 0 0 Beurre t 38 766 39 700 40 800 37 238 1 2 Poudre de lait t 35 844 33 590 34 468 35 534 -3 7 Fromage t 134 400 136 200 136 800 134 306 1 0 Viande et oeufs Viande de boeuf t PM 130 710 114 801 110 788 110 435 -14 3 Viande de veau t PM 36 656 37 409 36 715 36 419 0 5 Viande de porc t PM 266 360 214 257 231 574 225 657 -16 0 Viande de mouton t PM 5 065 6 215 6 078 6 316 22 5 Viande de chèvre t PM 541 542 514 494 -4 4 Viande de cheval t PM 1 212 1 511 1 353 1 196 11 7 Volaille t poids de vente 20 733 26 240 25 608 26 367 25 7 Oeufs en coquille mio de pces 638 663 691 680 6 2 Céréales Blé tendre t 546 733 572 520 594 098 500 400 6 7 Seigle t 22 978 23 971 22 306 18 900 0 7 Orge t 341 774 304 488 329 732 259 600 -7 2 Avoine t 52 807 45 337 39 855 28 600 -19 3 Maïs-grain t 211 047 187 727 191 813 198 700 -10 1 Triticale t 43 940 44 805 51 048 44 800 9 1 Autres t 11 469 15 235 12 123 6 800 19 3 Plantes sarclées Pommes de terre t 833 333 685 000 560 000 484 000 -25 3 Betteraves sucrières t 925 867 1 181 272 1 126 125 1 187 334 24 6 Oléagineux Colza t 46 114 50 020 47 167 38 376 5 4 Autres t 3 658 9 134 11 604 12 552 183 4 Fruits (de table) Pommes t 93 490 91 533 100 936 90 161 0 8 Poires t- 11 173 15 437 14 808Abricots t 6 667 1 830 4 000 2 900 -56 4 Cerises t 1 841 453 2 142 942 -36 0 Pruneaux t 2 575 2 203 2 803 2 397 -4 2 Fraises t 4 263 5 279 5 162 5 065 21 3 Légumes (frais) Carottes t 49 162 51 939 55 145 57 746 11 8 Oignons t 23 505 34 858 24 468 27 529 23 2 Céleris-raves t 8 506 13 724 8 752 8 686 22 1 Tomates t 21 830 27 296 29 951 27 384 29 2 Laitues pommées t 18 821 20 040 20 110 15 877 -0 8 Choux-fleurs t 8 331 7 941 7 509 6 666 -11 5 Concombres t 8 602 10 585 9 074 8 877 10 6 Vin Vin rouge hl 550 276 488 234 547 620 591 410 -1 4 Vin blanc hl 764 525 556 733 624 621 718 256 -17 2 Sources:
Viande:
Oeufs:
Céréales
Fruits:
Légumes:
culture
Vin: OFAG, cantons
Centrale suisse de la
maraîchère
A4 A N N E X E
Production de produits
Produit 1990/92 1997 1998 1999 1990/92–1997/99 tttt% Total fromage 134 400 136 200 136 800 134 306 1 0 Fromages frais 4 387 10 527 11 343 13 093 165 7 Mozzarella - 7 986 8 495 9 634Autres fromages frais - 2 541 2 848 3 459Fromages à pâte molle 4 812 5 358 5 230 5 851 13 9 Tommes 1 249 1 664 1 694 1 054 17 7 Fromages à pâte persillée, mi-gras à gras 1 573 1 344 1 191 1 909 -5 8 Autres fromages à pâte molle 1 990 2 350 2 345 2 888 27 0 Fromages à pâte mi-dure 40 556 41 532 41 492 44 293 4 6 Appenzell 8 725 8 313 8 664 8 878 -1 2 Tilsit 7 736 6 997 6 385 6 103 -16 0 Fromage à raclette 9 898 10 599 11 033 11 123 10 3 Autres fromages à pâte mi-dure 14 197 15 623 15 410 18 189 15 6 Fromages à pâte dure 84 629 78 774 78 727 70 824 -10 1 Emmental 56 588 48 629 47 988 41 637 -18 6 Gruyère 22 464 24 646 25 776 24 566 11 3 Sbrinz 4 659 4 286 3 713 3 090 -20 7 Autres fromages à pâte dure 918 1 213 1 250 1 531 45 0 Spécialités 1 15 98 245 482 2 Total produits laitiers frais 680 822 632 950 625 702 612 900 -8 4 Lait de consommation 549 810 496 714 488 486 438 000 -13 7 Autres 131 012 136 236 137 216 174 900 14 1 Total beurre 38 766 39 700 40 800 37 238 1.2 Beurre de choix 27 200 32 200 34 400 33 222 22 3 Autres 11 566 7 500 6 400 4 016 -48 4 Total crème 68 133 67 500 66 400 70 400 0 0 Total poudre de lait 35 844 33 590 34 468 35 534 -3 7 1 Fromages de brebis et de chèvre purs Sources: USP, TSM
Mise en valeur du lait commercialisé Produit 1990/92 1997 1998 1999 1990/92–1997/99 1 000 t de lait 1 000 t de lait 1 000 t de lait 1 000 t de lait % Lait de consommation 549 497 488 438 -13 6 Lait transformé 2 490 2 564 2 594 2 633 4 3 en fromage 1 531 1 539 1 545 1 503 -0 1 en beurre 356 375 402 337 4 3 en crème 430 440 438 460 3 7 en d'autres produits laitiers 173 210 209 333 44 9 Total 3 039 3 061 3 082 3 071 1.1 Sources: USP TSM
Tableau 3
laitiers
Tableau 4
Tableau 5
Mise en valeur de la récolte de la production végétale
1 Mise en valeur de céréales panifiables par année civile
2 Les chiffres y relatifs ne seront donc disponibles qu ' en 2001
3 Variation 90/92–97/98
panifiables: OFAG
Pommes de terre: Régie fédérale des alcools, swisspatat
Fruits à cidre: OFAG;
Spiritueux: Régie fédérale des alcools, Berne
Légumes destinés à la transformation: Centrale suisse de la culture maraîchère
A N N E X E A5
Produit 1990/92 1997 1998 1999 1990/92–1997/99 tttt% Céréales panifiables Prise en charge Confédération 569 000 605 000 576 000 549 300 1 4 Variation de stocks -26 333 -5 900 -18 100 -11 800 -54 7 Alimentation humaine 399 000 400 600 394 700 389 700 -1 0 Affouragement 196 333 210 300 199 400 171 400 -1 3 Pommes de terre Pommes de terre de table 285 300 187 000 173 400 170 700 -37 9 Pommes de terre destinées à la transformation 114 700 117 600 121 400 121 900 4 9 Plants 35 933 32 400 23 600 29 800 -20 4 Affouragement à l'état frais 225 967 244 500 206 800 129 800 -14 3 Transformation en aliments pour animaux 146 900 100 400 27 900 24 300 -65 4 Pommes et poires à cidre suisses (transformation dans des cidreries artisanales) 194 234 84 231 315 803 103 609 -13 6 Quantité de fruits à cidre pour jus brut 193 598 84 029 315 575 103 172 -13 4 fraîchement pressés 10 548 7 230 8 429 7 620 -26 4 cidre de fruits destiné à la fabrication d'eau-de-vie de fruits 3 916 436 3 539 548 -61 5 concentré de jus 175 928 72 171 295 775 92 398 -12 8 autres jus (vinaigre compris) 3 207 4 192 7 832 2 606 52 1 Fruits foulés 636 202 228 437 -54 6 Fabrication de spiritueux à base de pommes et de poires suisses 40 650 26 924 39 8762 -17 8 3 à base de cerises et de pruneaux suisses 24 637 12 676 23 6782 -26 2 3 Légumes frais suisses destinés à la fabrication de denrées alimentaires Légumes congelés 26 061 20 268 22 004 26 855 -11 6 Légumes en conserve (haricots, petits pois, carottes parisiennes) 19 776 17 058 12 190 15 258 -25 0 Choucroute (choux à choucroute) 8 091 6 090 6 101 5 894 -25 5 Raves d'automne 1 535 1 243 1 221 1 182 -20 8
Sources: Céréales
A6 A N N E X E Tableau 6 Commerce extérieur Produit 1990/1992 1997 1998 1999 1990/92–1997/99 tttt% Exporta- Importa- Exporta- Importa- Exporta- Importa- Exporta- Importa- Exporta- Importations tions tions tions tions tions tions tions tions tions Lait et produits laitiers Lait 19 23 007 53 22 805 46 22 988 30 22 795 122 8 -0 6 Yoghourt 1 195 17 873 50 925 78 1 156 110 -17 6 366 7 Crème 909 25 1 587 9 1 523 8 1 559 6 71 2 -69 7 Beurre 0 4 154 0 5 338 0 4 136 17 4 987 - 16 0 Poudre de lait 8 158 3 266 4 972 5 186 2 884 4 289 17 768 2 584 4 7 23 1 Fromage 62 483 27 328 60 703 30 856 56 474 30 548 63 359 31 208 -3 7 13 0 Viande et oeufs Viande de boeuf 1 994 9 668 6 615 7 805 3 527 8 973 3 644 10 024 130 5 -7 5 Viande de veau 0 916 1 389 0 586 0 1 345 - -15 5 Viande de porc 1 055 4 185 653 18 334 806 14 543 754 14 999 -30 1 281 3 Viande de mouton 5 6 093 0 6 588 0 6 157 0 5 611 - 0 4 Viande de chèvre 0 403 0 482 0 503 0 413 - 15 5 Viande de cheval 0 4 609 0 4 104 0 4 041 0 3 883 - -13 0 Volaille 8 35 238 384 38 990 302 39 962 448 37 562 4830 4 10 2 Oeufs 0 31 401 0 22 709 0 22 589 0 23 281 - -27 2 Céréales Blé 6 232 134 80 224 343 49 184 617 86 249 619 1025 7 -5 4 Seigle 0 3 057 0 2 235 75 2 261 0 10 233 - 60 6 Orge 436 44 504 1 15 221 141 22 893 1 11 491 -89 1 -62 8 Avoine 131 60 885 3 51 048 1 555 38 624 0 23 411 296 6 -38 1 Maïs-grain 194 60 512 83 60 033 70 47 523 78 29 428 -60 4 -24 5 Plantes sarclées Pommes de terre 9 695 33 420 2 043 11 341 1 647 16 336 1 702 42 361 -81 5 -30 1 Sucre 41 300 124 065 76 619 119 867 91 068 109 063 119 084 137 404 131 5 -1 6 Oléagineux Oléagineux 453 135 456 842 138 112 834 151 083 830 135 408 84 2 4 5 Huiles et graisses végétales 18 680 57 765 14 778 73 283 13 227 83 636 15 426 84 021 -22 5 39 0 Fruits Pommes 770 15 548 1 426 8 786 185 9 385 3 125 6 295 104 9 -47 5 Poires 404 12 556 217 9 673 178 10 671 579 8 529 -19 6 -23 3 Abricots 283 10 431 47 12 413 56 8 866 3 12 199 -87 5 7 0 Cerises 340 1 819 26 1 902 269 1 340 7 3 138 -70 4 16 9 Prunes et pruneaux 15 3 047 7 4 162 53 3 241 0 4 678 33 3 32 1 Fraises 150 12 299 11 13 025 12 13 373 11 13 417 -92 5 7 9 Raisins 23 33 691 2 34 824 3 35 034 0 36 969 -92 9 5 7 Agrumes 161 135 780 19 130 224 21 129 626 49 122 668 -81 6 -6 1 Bananes 85 77 896 0 74 245 1 72 684 0 74 554 -99 6 -5 2 Légumes (frais) Carottes 71 1 710 2 8396 0 7140 185 5867 -12 2 317 1 Oignons 862 3 444 1193 3055 1 8257 3 5644 -53 7 64 1 Céleris-raves 0 206 0 75 0 56 0 831 - 55 4 Tomates 402 35 700 0 42586 1 39772 56 42138 -0 7 16 2 Laitues pommées 37 3 954 0 3106 0 2575 1 3244 -99 1 -24 8 Choux-fleurs 11 9 985 1 9 239 14 9 331 0 9 503 -55 9 -6 3 Concombres 65 17 479 22 16 820 19 17 050 0 17 996 -78 9 -1 1 Vin Vin rouge (hl) 3 499 1 505 794 8 701 1 496 195 7 994 1 491 200 8 815 1 486 098 143 0 -1 0 Vin blanc (hl) 7 590 163 835 6 183 244 944 5 260 264 905 4 680 252 588 -29 2 55 1 Sources: Lait et produits laitiers, oeufs, céréales, plantes sarclées, oléagineux, fruits, légumes et vin: DGD Viande: Proviande Sucre: Office fiduciaire des importateurs suisses de denrées alimentaires
A N N E X E A7 Tableau 7 Commerce extérieur fromage Produit 1990/92 1997 1998 1999 1990/92–1997/99 tttt% Importations Fromages frais 1 4 175 8 136 8 280 8 485 98 8 Fromages râpés 2 233 232 271 333 19 8 Fromages fondus 3 2 221 2 541 2 499 2 550 13 9 Fromages à pâte persillée 4 2 276 2 392 2 306 2 414 4 1 Fromages à pâte molle 5 6 628 5 238 5 502 5 618 -17 7 Fromages à pâte mi-dure 6 6 225 5 722 5 234 Fromages à pâte dure 7 11 795 6 092 5 970 6 574 1 2 Total fromages et séré 27 328 30 856 30 548 31 208 13 0 Exportations Fromages frais 1 211 10 96 7 Fromages râpés 2 104 103 103 156 15 6 Fromages fondus 3 8 245 6 731 6 532 6 733 -19 2 Fromages à pâte persillée 4 0229Fromages à pâte molle 5 30 43 52 50 59 7 Fromages à pâte mi-dure 6 7 330 7 072 6 944 Fromages à pâte dure 7 54 102 46 493 42 712 49 457 -1 4 Total fromages et séré 62 483 60 703 56 474 63 359 -3 7 1 0406 1010 0406 1020 406 1090 2 0406 2010, 0406 2090 3 0406 3010 0406 3090 4 0406 4010, 0406 4021, 0406 4029, 0406 4081, 0406 4089 5 0406 9011 0406 9019 6 0406 9021, 0406 9031, 0406 9051, 0406 9091 7 0406 9039 0406 9059 0406 9060 0406 9099 Source: DGD
Tableau 8
Consommation par habitant
A8 A N N E X E
Produit 1990/92 1997 1998 1999 1990/92–1997/99 kg kg kg kg % Lait et produits laitiers Lait de consommation 104 37 92 90 91 00 86 60 -13 6 Crème 6 43 6 50 6 40 6 70 1 6 Beurre 6 20 6 30 6 20 5 90 -1 1 Fromage 14 73 15 60 15 50 15 70 5 9 Fromages frais 1 50 2 60 2 70 2 90 82 2 Fromages à pâte molle 1 83 1 80 1 80 1 80 -1 8 Fromages à pâte mi-dure 6 17 5 90 5 80 5 70 -5 9 Fromages à pâte dure 5 20 5 30 5 20 5 30 1 3 Viande et oeufs Viande de boeuf 13 71 10 99 11 25 11 53 -17 9 Viande de veau 4 25 4 12 4 04 4 08 -3 9 Viande de porc 29 73 25 29 26 28 25 63 -13 4 Viande de mouton 1 42 1 57 1 49 1 43 5 4 Viande de chèvre 0 12 0 13 0 13 0 11 0 0 Viande de cheval 0 75 0 68 0 66 0 62 -13 3 Volaille 8 05 9 03 9 03 8 71 10 8 Oeufs en coquille (pces) 199 184 190 195 -4 7 Céréales Pain, articles de boulangerie 50 7 50 4 52 1 - 1 1 Plantes sarclées Pommes d t et produits à base de pommes d t 44 2 46 2 43 1 - 1 1 Sucre (y compris sucre contenu dans des produits transformés exportés) 42 4 40 8 40 1 - -4 5 Oléagineux Huiles et graisses végétales 12 8 13 6 14 3 - 9 0 Fruits (de table) Pommes 16 04 13 93 15 51 13 15 -11 5 Poires - 2 91 3 65 3 21Abricots 2 49 2 00 1 80 2 13 -20 7 Cerises 0 49 0 33 0 45 0 57 -8 2 Prunes et pruneaux 0 83 0 90 0 84 1 00 9 8 Fraises 2 43 2 58 2 61 2 60 6 8 Agrumes 20 09 18 34 18 25 17 27 -10 6 Bananes 11 53 10 46 10 24 10 50 -9 8 Légumes (frais) Carottes 7 53 8 50 8 77 8 93 16 1 Oignons 3 86 5 17 4 61 4 67 24 7 Céleris-raves 1 29 1 94 1 24 1 34 16 8 Tomates 8 46 9 84 9 82 9 78 16 0 Laitues pommées 3 37 3 26 3 20 2 69 -9 5 Choux-fleurs 2 71 2 42 2 37 2 28 -13 1 Concombres à salade 3 85 3 86 3 68 3 78 -2 1 Vin Vin rouge (l) 31 97 28 60 28 50 28 70 -10 5 Vin blanc (l) 14 47 12 70 12 50 12 80 -12 4 Vin total (l) 46 43 41 30 41 00 41 50 -11 1 Sources: Lait et produits laitiers,oeufs, plantes sarclées et oléagineux:
Viande: Proviande Céréales: OFAE Fruits légumes et vin: OFAG
USP, 1999, chiffres provisoires
Tableau 9
Prix à la production
volaille, oeufs: USP (prix PV du bétail de boucherie convertis en prix PM à l'aide des facteurs de rendement)
A N N E X E A9
Produit Unité 1990/92 1997 1998 1999 1990/92–1997/99 % Lait CH total ct /kg 104 97 84 00 82 10 80 93 -21 6 Lait transformé en fromage (dès 1999) ct /kg 79 96Lait biologique (dès 1999) ct /kg 91 55Bétail de boucherie Vaches T3 fr / kg PM 7 82 4 67 4 75 4 90 -39 0 Vaches X3 fr / kg PM 7 53 3 45 3 66 3 77 -51 8 Jeunes vaches T3 fr / kg PM 8 13 5 94 5 18 6 40 -28 2 Taureaux T3 fr / kg PM 9 28 7 70 7 38 7 77 -17 9 Boeufs T3 fr / kg PM 9 83 7 60 7 38 7 90 -22 4 Génisses T3 fr / kg PM 8 66 6 87 6 85 7 37 -18 8 Veaux T3 fr / kg PM 14 39 10 84 11 36 11 03 -23 0 Porcs à viande fr / kg PM 5 83 5 59 4 80 4 38 -15 6 Agneaux jusqu'à 40 kg, T3 fr / kg PM 15 40 13 74 13 47 11 46 -16 3 Volaille et oeufs Poulets cl I, à la ferme fr / kg PV 3 72 3 01 2 97 2 84 -21 0 Oeufs issus d'un élevage au sol, au magasin fr /100 pces 41 02 42 64 43 61 42 86 4 9 Oeufs issus d'un élevage avec parcours, au magasin fr /100 pces 46 21 48 38 50 42 49 01 6 6 Oeufs vendus au centre collecteur >53 g fr /100 pces 33 29 26 47 24 33 22 21 -26 9 Céréales Blé fr /100 kg 99 34 75 58 75 65 75 41 -23 9 Seigle fr /100 kg 102 36 56 99 62 69 62 77 -40 6 Orge fr /100 kg 70 24 51 94 50 13 48 83 -28 4 Avoine fr /100 kg 71 40 51 61 47 68 48 83 -30 8 Triticale fr /100 kg 70 69 52 45 49 45 49 44 -28 6 Maïs-grain fr /100 kg 73 54 54 65 53 21 51 91 -27 6 Plantes sarclées Pommes de terre fr /100 kg 38 55 32 89 35 27 37 76 -8 4 Betteraves sucrières fr /100 kg 14 84 13 87 13 99 11 85 -10 8 Oléagineux Colza fr /100 kg 203 67 161 84 147 89 146 11 -25 4 Soja fr /100 kg 204 67 162 36 162 14 164 58 -20 3 Fruits Pommes: Golden Delicious I fr / kg 1 13 0 85 0 60 1 06 -26 0 Pommes: Idared I fr / kg 0 97 0 88 0 45 0 82 -26 4 Poires: Conférence fr / kg 1 38 1 52 0 78 1 09 -18 3 Abricots fr / kg 1 96 2 66 2 28 2 66 29 5 Cerises fr / kg 3 20 3 80 3 30 3 05 5 7 Pruneaux: Fellenberg fr / kg 1 27 1 55 1 40 1 40 14 5 Fraises fr / kg 4 77 4 80 4 40 4 80 -2 1 Légumes Carottes (de garde) fr / kg 1 09 1 20 1 18 1 05 4 9 Oignons (de garde) fr / kg 0 89 0 72 1 03 0 96 1 5 Céleris-raves (de garde) fr / kg 1 62 1 34 1 41 1 84 -5 7 Tomates rondes fr / kg 2 42 2 12 1 89 1 92 -18 3 Laitues pommées fr / kg 2 37 2 41 2 20 2 89 5 5 Choux-fleurs fr / kg 1 85 1 80 1 78 1 88 -1 4 Concombres à salade fr / kg 1 66 1 71 1 66 1 73 2 6 Sources: Lait: OFAG Bétail de boucherie,
Céréales, cultures sarclées et oléagineux: FAT Fruits: Fruit-Union Suisse Légumes: Centrale suisse de la culture maraîchère
Tableau 10
Prix à la consommation
A10 A N N E X E
Produit Unité 1990/92 1997 1998 1999 1990/92–1997/99 % Lait et produits laitiers Lait entier pasteurisé, emballé fr / l 1 85 1 66 1 66 1 58 -11 7 Lait «drink» pasteurisé, emballé fr / l 1 85 1 66 1 66 1 58 -11 7 Lait écrémé UHT fr / l - 1 55 1 55 1 48Emmental fr / kg 20 15 20 79 20 65 20 66 2 7 Gruyère fr / kg 20 40 19 80 20 93 20 67 0 3 Tilsit fr / kg - 17 63 17 76 17 49Camembert 45% (MG/ES) 125 g - 2 57 2 58 2 54Fromages à pâte molle, persillée 150 g - 3 32 2 34 3 34Mozzarella 45% (MG/ES) 150 g - 2 34 2 35 2 32Beurre de choix 200 g 3 46 3 01 3 01 2 89 -14 2 Le Beurre (beurre de cuisine) 250 g 3 44 3 04 3 00 2 92 -13 2 Crème entière, emballée 1/2 l - 5 50 5 44 5 19Crème à café, emballée 1/2 l - 2 73 2 75 2 62Yoghourt, aromatisé ou contenant des fruits 180 g 0 89 0 73 0 73 0 71 -18 7 Viande de boeuf Entrecôtes, en tranches fr / kg 48 36 43 89 44 36 45 68 -7 7 Steak fr / kg 37 59 33 18 33 69 34 76 -9 9 Rôti d'épaule fr / kg 26 34 23 42 23 52 24 09 -10 1 Viande hachée fr / kg 15 00 13 22 13 61 13 42 -10 6 Viande de veau Ia Côtelettes, coupées fr / kg 35 32 35 71 37 07 35 84 2 5 Rôti d'épaule fr / kg 32 56 29 13 31 01 30 80 -6 9 Ragoût fr / kg 21 67 23 00 25 46 24 67 12 5 Viande de porc Ia Côtelettes, coupées fr / kg 19 88 20 25 17 91 18 26 -5 4 Steak fr / kg 24 48 25 44 24 44 22 38 -1 6 Rôti d'épaule fr / kg 18 43 18 80 17 60 16 75 -3 9 Ragoût, poitrine fr / kg 16 69 17 94 17 29 15 75 1 8 Viande d'agneau suisse, fraîche Gigot, sans l'os du bassin fr / kg 26 34 25 62 26 68 27 10 0 5 Côtelettes, coupées fr / kg 30 32 30 78 31 69 31 57 3 4 Produits carnés Jambon de derrière modèl, coupé fr / kg 25 56 27 32 27 23 26 18 5 3 Salami suisse I, coupé fr /100 g 3 09 3 24 3 35 3 42 7 9 Poulets suisses, frais fr / kg 8 41 8 12 8 42 8 43 -1 1 Production végétale et produits végétaux arine blanche fr / kg 2 05 1 81 1 80 1 80 -12 0 Pain bis fr /500 g 2 08 1 99 2 00 1 98 -4 3 Pain mi-blanc fr /500 g 2 09 2 04 2 05 2 02 -2 6 Petits pains fr / pces 0 62 0 75 0 75 0 75 21 0 Croissants fr / pces 0 71 0 86 0 87 0 89 23 0 Spaghettis fr /500 g 1 66 1 35 1 39 1 43 -16 3 Pommes de terre fr / kg 1 43 1 65 1 66 1 77 18 4 Sucre cristallisé fr / kg 1 65 1 52 1 52 1 50 -8 3 Huile de tournesol fr / l 5 05 4 30 4 44 4 46 -12 9 Fruits (suisses et étrangers) Pommes: Golden Delicious fr / kg 3 19 3 17 3 10 2 98 -3 3 Poires fr / kg 3 26 3 30 3 37 3 24 1 3 Abricots fr / kg 3 81 4 59 5 10 4 74 26 2 Cerises fr / kg 7 39 8 66 8 72 8 72 17 7 Pruneaux fr / kg 3 44 3 87 3 51 3 13 1 8 Fraises fr / kg 8 69 9 23 9 69 9 34 8 4 Légumes (consommation à l'état frais; suisses et étrangers) Carottes (de garde) fr / kg 1 91 1 92 1 87 1 78 -2 8 Oignons (de garde) fr / kg 1 86 1 85 2 14 2 05 8 2 Céleris-raves (de garde) fr / kg 3 14 2 96 3 32 3 67 5 6 Tomates rondes fr / kg 3 73 3 24 3 24 3 18 -13 7 Laitues pommées fr / kg 4 46 4 89 4 39 5 15 7 8 Choux-fleurs fr / kg 3 58 3 53 3 45 3 59 -1 6 Concombres à salade fr / kg 2 80 2 70 2 88 2 86 0 5 Sources: Lait, viande: OFAG Production végétale et produits végétaux: OFAG, OFS
Tableau 11
Taux d’auto-approvisionnement
1 Produits de meunerie et blé germé sur pied compris, mais sans les tourteaux; les modifications des réserves ne sont pas prises en considération
2 Blé dur, avoine, orge, maïs et riz compris
3 Pommes, poires, cerises, prunes et pruneaux, abricots et pêches
4 Part de la production suisse dans le poids de la viande prête à la vente et des produits carnés
5 Viande chevaline et caprine, lapins, gibier, poissons, crustacés et mollusques compris
6 Energie digestible en joules, boissons alcoolisées comprises
7 Sans les produits animaux à base d’aliments pour animaux importés
8 Valeur calculée aux prix aux producteurs pour la production suisse et les importations aux prix selon la statistique commerciale (franco frontière non dédouanés)
Source: USP
A N N E X E A11
Produit 1990/92 1996 1997 1998 1990/92–1996/98 % Part en termes de volume: %%%% Blé panifiable 118 138 108 120 4 0 Céréales fourragères 1 61 74 72 73 12 0 Total céréales 2 64 71 67 69 5 0 Pommes de terre de table 101 99 94 100 -3 3 Sucre 46 64 62 60 16 0 Graisses et huiles végétales 22 19 23 21 -1 0 Fruits 3 72 79 71 86 6 7 Légumes 55 60 56 54 1 7 Lait de consommation 97 97 97 97 0 0 Beurre 89 89 89 92 1 0 Fromage 137 128 129 126 -9 3 Total lait et produits laitiers 110 109 110 110 -0 3 Viande de veau 4 97 99 99 98 1 7 Viande de bœuf 4 93 105 98 92 5 3 Viande de porc 4 99 89 90 93 -8 3 Viande de mouton 4 39 39 42 43 2 3 Volaille 4 37 37 41 39 2 0 Viande de toutes sortes 45 76 72 71 71 -4 7 0 0 Oeufs et conserves d’œufs 44 48 49 49 4 7 Part en termes d'énergie alimentaire 6 : Denrées alimentaires végétales 43 47 44 47 3 0 Denrées alimentaires en tout, brutes 97 95 95 95 -2 0 Denrées alimentaires en tout, brutes 60 64 62 64 3 3 Denrées alimentaires en tout, nettes 7 58 60 54 56 -1 3 Part en termes de valeur denrées alimentaires en tout 8 72 69 66 65 -5 3
■■■■■■■■■■■■■■■■ Tableaux Résultats économiques
Tableau 12
Production finale de l'agriculture aux prix courants, en 1000 fr
A12 A N N E X E
Produit 1990/92 1997 1998 1 1999 2 1990/92 – 2000 3 1997/99–1997/99 2000 %% Céréales 807 539 639 220 658 938 507 844 -25 5 527 000 -12 5 Légumineuses 1 318 1 436 1 134 920 -11 7 1 075 -7 6 Pommes de terre 231 342 183 383 162 636 155 093 -27 8 169 000 1 2 Betteraves sucrières 141 784 161 664 154 526 136 848 6 5 150 500 -0 3 Oléagineux (colza, soja, tournesol) 102 033 97 460 89 879 78 133 -13 3 40 000 -54 8 Tabac 16 945 15 725 21 328 20 443 13 1 19 800 3 3 Légumes 379 455 467 204 422 262 403 180 13 6 419 000 -2 8 Fruits et baies 371 296 303 212 373 008 307 095 -11 7 349 500 6 6 Plantes fourr (foin, maïs d'ensilage, fourr verts, ) 14 077 - 5 232 8 359 - 8 445 -112 6 15 000 -946 2 Sous-produits de la production végétale 14 044 13 574 14 004 12 145 -5 7 16 500 24 6 Moût de vin 586 831 489 368 509 883 529 368 -13 2 522 000 2 4 Autres produits végétaux 14 144 11 583 9 731 10 083 -26 0 10 000 -4 4 Plantes et produits végétaux 2 680 807 2 378 597 2 425 688 2 152 707 -13 5 2 239 375 -3 4 Bovins 1 580 377 955 413 947 819 997 698 -38 8 1 195 000 23 6 Porcins 1 556 531 1 202 066 1 074 946 960 990 -30 7 1 007 000 -6 7 Equidés (chevaux, ânes, mulets) 20 475 12 979 8 585 6 956 -53 6 5 900 -37 9 Ovins 71 810 69 869 70 062 66 554 -4 2 60 100 -12 7 Caprins 4 906 4 601 4 868 4 643 -4 1 4 300 -8 6 Volaille (poulets, dindes, canards, oies) 186 808 182 550 177 062 183 069 -3 2 188 000 3 9 Autres animaux (lapins, abeilles) 26 010 17 330 17 727 17 301 -32 9 17 500 0 3 Lait 3 461 227 2 806 361 2 807 490 2 580 970 -21 1 2 521 000 -7 7 Oeufs 207 617 180 707 178 358 160 165 -16 6 155 000 -10 4 Laine 507 226 93 50 -75 8 0Miel 47 917 31 529 57 362 44 141 -7 5 35 000 -21 1 Autres produits animaux 5 042 4 466 4 349 4 460 -12 2 4 400 -0 6 Animaux et produits animaux 7 169 228 5 468 097 5 348 721 5 026 997 -26 3 5 193 200 -1 7 Travaux agricoles à façon 52 400 84 226 87 888 90 452 67 0 90 000 2 8 Production finale totale 9 902 435 7 930 920 7 862 297 7 270 156 -22.4 7 522 575 -2.1 1 Chiffres provisoires état 23 12 1999 2 Estimation, état 23 12 1999 3 Estimation état 23 08 2000 Source: USP
1 Si la TVA perçue sur les ventes de produits agricoles n 'est pas égale aux taxes versées sur les achats de consommation intermédiaire et les biens d'investissements, la différence est compensée dans les comptes économiques de l'agriculture Lorsque le montant perçu est supérieur à celui qui a été payé, on obtient une surcompensation, qui est considérée comme une recette supplémentaire Jusqu'à présent, on a cependant toujours enregistré une sous-compensation en Suisse
2 Installations fixes incluses
3 Chiffres provisoires état 23 12 1999
4 Estimation, état 23 12 1999
5 Estimation, état 23 08 2000
A N N E X E A13 Tableau 13 Comptes économiques de l'agriculture aux prix courants, en 1000 fr Caractéristique 1990/92 1997 1998 3 1999 4 1990/92– 2000 5 1997/99 –1997/99 2000 %% Production finale 9 902 435 7 930 920 7 862 297 7 270 156 -22 4 7 522 575 -2 1 Consommation intermédiaire totale 4 172 848 3 864 706 3 863 209 3 812 674 -7 8 3 856 500 0 3 Semences et plants 235 204 224 313 216 181 215 519 -7 0 213 000 -2 6 Bétail 7 535 12 769 10 858 10 769 52 2 13 000 13 4 Energie 397 171 439 310 424 744 430 402 8 6 466 000 8 0 Engrais 243 903 151 252 149 114 145 031 -39 1 144 000 -3 0 Produits phytosanitaires 138 587 122 051 120 376 120 220 -12 8 122 000 0 9 Aliments pour animaux 1 721 238 1 477 442 1 481 207 1 461 023 -14 4 1 466 000 -0 5 Matériel et entretien de machines 682 312 724 056 730 918 732 743 6 9 727 500 -0 2 Entretien des bâtiments d'exploitation 182 658 139 693 136 711 132 397 -25 4 136 000 -0 2 Services 564 240 573 820 593 100 564 570 2 3 569 000 -1 4 Valeur ajoutée brute aux prix du marché 5 729 587 4 066 214 3 999 088 3 457 482 -33 0 3 666 075 -4 6 Contributions des pouvoirs publics (subventions) 1 317 038 2 547 089 2 439 386 2 630 000 92 8 2 646 000 4 2 Surcompensation TVA 1 Impôts liés à la production 123 433 221 757 194 331 133 054 48 3 70 000 -61 8 Sous-compensation TVA 1 - 78 231 79 579 95 751 - 98 000 15 9 Valeur ajoutée brute au coût des facteurs 6 923 192 6 313 315 6 164 564 5 858 677 -11 7 6 144 075 0 5 Amortissements totaux 2 030 896 1 856 684 1 852 603 1 835 517 -9 0 1 859 000 0 6 Amortissement des constructions 2 1 057 197 809 951 791 850 764 766 -25 4 788 000 -0 1 Amortissement des machines 973 699 1 046 733 1 060 753 1 070 751 8 8 1 071 000 1 1 Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 4 892 296 4 456 631 4 311 961 4 023 160 -12 8 4 285 075 0 5 Fermages et intérêts 844 689 729 088 700 485 689 937 -16 4 729 000 3 2 Fermages 227 754 225 609 225 485 224 481 -1 1 224 000 -0 5 Intérêts 616 936 503 479 475 000 465 456 -22 0 505 000 4 9 Revenu net de l'activité agricole pour la 4 047 607 3 727 543 3 611 476 3 333 223 -12 1 3 556 075 0 0 main-d'oeuvre totale Rémunération de la main-d'oeuvre non familiale 827 058 797 700 763 996 739 826 -7 2 725 000 -5 5 Revenu net de l'activité agricole pour la 3 220 549 2 929 843 2 847 480 2 593 397 -13 4 2 831 075 1 5 main-d'oeuvre familiale
Source: USP
Tableau 14
Résultats d’exploitation: toutes les régions
1 Taux d'intérêt moyen des obligations de la Confédération (1996: 4 00%; 1997: 3 40%; 1998: 2 81%; 1999: 3 02%)
2 Investissements bruts (sans prestations propres), déduction faite des subventions et des désinvestissements
3 Formation de capital propre (sans prestations propres), plus amortissements, plus/moins changements stocks et actif bétail
4 Rapport entre cash flow et total des investissements
5 Part d’exploitations avec cash flow > total des investissements
6 Part de capitaux étrangers <50% et formation de capital propre positive
7 Part de capitaux étrangers >50% et formation de capital propre positive
8 Part de capitaux étrangers <50% et formation de capital propre négative
9 Part de capitaux étrangers >50% et formation de capital propre négative
10 Rapport entre revenu de l'exploitation et main-d'oeuvre de l'exploitation
11 Rapport entre revenu de l'exploitation et surface agricole utile
12 Rapport entre revenu de l'exploitation et actifs totaux
13 Rapport entre (service de la dette plus bénéfice/pertes calculés plus intérêts sur le capital propre) et actifs de l'exploitation
14 Rapport entre (bénéfice/pertes calculés plus intérêts sur le capital propre) et capital propre de l’exploitation
15 Rapport entre (revenu agricole moins intérêts sur le capital propre) et unités de travail annuel de la famille (UTAF)
Source: dépouillement centralisé, FAT
A14 A N N E X E
Caractéristique Unité 1996 1997 1998 1999 1996/98–1999 % Exploitations de référence Nombre 3 937 3 901 3 861 3 494 -10 4 Exploitations représentées Nombre 58 207 57 194 56 579 54 906 -4 2 Structure d'exploitation Surface agricole utile ha 17 63 17 92 18 08 18 41 3 0 Terres ouvertes ha 5 20 5 14 5 11 5 08 -1 4 Main-d'oeuvre de l'exploitation UTA 1 77 1 76 1 73 1 70 -3 0 dont main-d'oeuvre familiale UTAF 1 33 1 32 1 31 1 29 -2 3 Vaches, total Nombre 13 4 13 3 13 3 13 4 0 5 Animaux, total UGB 23 7 23 6 23 6 23 5 -0 6 Structure du capital Actifs totaux fr 648 407 667 440 680 090 689 619 3 7 dont: actifs circulants fr 124 115 133 175 130 317 135 278 4 7 dont: actif bétail fr 42 404 42 860 40 396 41 172 -1 7 dont: immobilisations fr 481 888 491 405 509 377 513 169 3 8 dont: actifs de l'exploitation fr 602 218 614 913 627 590 636 990 3 6 Part de capitaux étrangers % 42 42 41 41 -1 6 Intérêt calculé du capital propre de l'exploitation 1 fr 13 651 11 928 10 146 11 089 -6 9 Compte d'exploitation Rendement brut total fr 179 438 187 643 183 882 181 702 -1 1 dont: paiements directs fr 37 226 39 319 37 667 38 872 2 1 Charges matérielles fr 101 598 101 981 104 464 102 844 0 2 Revenu de l'exploitation fr 77 840 85 662 79 418 78 858 -2 6 Frais de main-d'oeuvre fr 13 480 13 476 12 983 12 128 -8 9 Service de la dette fr 9 523 8 757 7 931 7 405 -15 2 Fermages fr 5 380 5 455 5 425 5 536 2 1 Charges réelles fr 129 981 129 669 130 802 127 912 -1 7 Revenu agricole fr 49 457 57 974 53 079 53 789 0 5 Revenu accessoire fr 17 203 18 627 18 254 18 638 3 4 Revenu total fr 66 660 76 601 71 333 72 427 1 3 Consommation de la famille fr 61 224 60 768 62 003 59 220 -3 4 Formation de capital propre fr 5 436 15 833 9 330 13 207 29 5 Investissements et financement Total des investissements 2 fr 40 501 40 922 49 585 41 856 -4 2 Cash flow 3 fr 41 545 43 108 40 398 42 238 1 3 Rapport entre cash flow et investissements 4 % 103 105 81 101 4 8 Exploitations avec excédent de financement 5 % 68 68 60 66 1 0 Stabilité financière Exploitation en situation financière saine 6 % 40 49 44 47 6 0 Exploitations avec faible autonomie financière 7 % 18 24 21 21 0 0 Exploitations avec faible revenu 8 % 23 14 20 17 -10 5 Exploitations en situation financière précaire 9 % 19 13 15 15 -4 3 Productivité Productivité du travail 10 fr /UTA 43 957 48 616 45 846 46 376 0 5 Productivité des surfaces 11 fr /ha 4 416 4 780 4 393 4 282 -5 5 Productivité du capital 12 % 12 9 13 9 12 7 12 4 -5 8 Rentabilité Rentabilité du capital total 13 % -2 8 -1 6 -2 4 -2 3 1 5 Rentabilité du capital propre 14 % -7 8 -5 2 -6 3 -5 9 -8 3 Revenu du travail de la main-d'oeuvre familiale 15 fr /UTAF 27 011 34 755 32 854 33 050 4 8 (moyenne) Revenu du travail de la main-d'oeuvre familiale 15 fr /UTAF 24 940 31 778 30 125 29 770 2 8 (médiane)
Tableau 15
Résultats d’exploitation: région de plaine*
1 Taux d'intérêt moyen des obligations de la Confédération (1996: 4 00%; 1997: 3 40%; 1998: 2 81%; 1999: 3 02%)
2 Investissements bruts (sans prestations propres), déduction faite des subventions et des désinvestissements
3 Formation de capital propre (sans prestations propres), plus amortissements, plus/moins changements stocks et actif bétail
4 Rapport entre cash flow et total des investissements
5 Part d’exploitations avec cash flow > total des investissements
6 Part de capitaux étrangers <50% et formation de capital propre positive
7 Part de capitaux étrangers >50% et formation de capital propre positive
8 Part de capitaux étrangers <50% et formation de capital propre négative
9 Part de capitaux étrangers >50% et formation de capital propre négative
10 Rapport entre revenu de l'exploitation et main-d'oeuvre de l'exploitation
11 Rapport entre revenu de l'exploitation et surface agricole utile
12 Rapport entre revenu de l'exploitation et actifs totaux
13 Rapport entre (service de la dette plus bénéfice/pertes calculés plus intérêts sur le capital propre) et actifs de l'exploitation
14 Rapport entre (bénéfice/pertes calculés plus intérêts sur le capital propre) et capital propre de l’exploitation
15 Rapport entre (revenu agricole moins intérêts sur le capital propre) et unités de travail annuel de la famille (UTAF)
* Région de plaine: zone de grandes cultures et zones intermédiaires
Source: dépouillement centralisé, FAT
A N N E X E A15
Caractéristique Unité 1996 1997 1998 1999 1996/98–1999 % Exploitations de référence Nombre 1 859 1 800 1 789 1 565 -13 8 Exploitations représentées Nombre 26 886 26 064 26 275 25 499 -3 4 Structure d'exploitation Surface agricole utile ha 18 45 18 91 18 90 19 33 3 1 Terres ouvertes ha 9 14 9 20 9 07 9 05 -0 9 Main-d'oeuvre de l'exploitation UTA 1 93 1 91 1 86 1 83 -3 7 dont main-d'oeuvre familiale UTAF 1 30 1 30 1 27 1 26 -2 3 Vaches, total Nombre 13 3 13 3 13 3 13 4 0 8 Animaux, total UGB 23 6 23 6 23 4 23 4 -0 6 Structure du capital Actifs totaux fr 753 467 775 592 774 628 778 173 1 3 dont: actifs circulants fr 154 900 166 383 159 909 165 188 3 0 dont: actif bétail fr 43 849 44 204 40 588 41 791 -2 5 dont: immobilisations fr 554 718 565 005 574 131 571 194 1 2 dont: actifs de l'exploitation fr 695 247 707 725 710 317 712 424 1 1 Part de capitaux étrangers % 41 40 40 40 -0 8 Intérêt calculé du capital propre de l'exploitation 1 fr 16 164 14 094 11 839 12 686 -9 6 Compte d'exploitation Rendement brut total fr 224 597 229 974 224 055 218 369 -3 5 dont: paiements directs fr 32 561 35 048 33 541 32 359 -4 0 Charges matérielles fr 123 080 122 378 123 500 122 085 -0 7 Revenu de l'exploitation fr 101 517 107 596 100 555 96 284 -6 7 Frais de main-d'oeuvre fr 20 620 20 477 19 172 18 194 -9 4 Service de la dette fr 11 334 10 363 9 073 8 424 -17 9 Fermages fr 7 362 7 486 7 425 7 698 3 7 Charges réelles fr 162 396 160 704 159 170 156 400 -2 7 Revenu agricole fr 62 201 69 270 64 885 61 968 -5 3 Revenu accessoire fr 16 072 18 703 17 507 17 580 0 9 Revenu total fr 78 273 87 973 82 392 79 548 -4 0 Consommation de la famille fr 70 077 69 861 70 676 66 577 -5 2 Formation de capital propre fr 8 196 18 112 11 716 12 971 2 3 Investissements et financement Total des investissements 2 fr 46 717 45 697 55 734 46 615 -5 6 Cash flow 3 fr 48 411 50 541 47 108 45 807 -5 9 Rapport entre cash flow et investissements 4 % 104 111 85 98 -2 0 Exploitations avec excédent de financement 5 % 67 67 61 64 -1 5 Stabilité financière Exploitation en situation financière saine 6 % 43 49 45 47 2 9 Exploitations avec faible autonomie financière 7 % 18 21 20 17 -13 6 Exploitations avec faible revenu 8 % 23 17 22 20 -3 2 Exploitations en situation financière précaire 9 % 16 13 13 16 14 3 Productivité Productivité du travail 10 fr /UTA 52 616 56 330 54 204 52 755 -3 0 Productivité des surfaces 11 fr /ha 5 502 5 691 5 321 4 981 -9 5 Productivité du capital 12 % 14 6 15 2 14 2 13 5 -8 0 Rentabilité Rentabilité du capital total 13 % -0 9 -0 1 -0 7 -1 2 111 8 Rentabilité du capital propre 14 % -4 4 -2 6 -3 3 -4 1 19 4 Revenu du travail de la main-d'oeuvre familiale 15 fr /UTAF 35 304 42 423 41 723 39 210 -1 5 (moyenne) Revenu du travail de la main-d'oeuvre familiale 15 fr /UTAF 33 497 39 552 39 191 36 114 -3 5 (médiane)
Tableau 16
Résultats d’exploitation: région des collines*
1 Taux d'intérêt moyen des obligations de la Confédération (1996: 4 00%; 1997: 3 40%; 1998: 2 81%; 1999: 3 02%)
2 Investissements bruts (sans prestations propres), déduction faite des subventions et des désinvestissements
3 Formation de capital propre (sans prestations propres), plus amortissements, plus/moins changements stocks et actif bétail
4 Rapport entre cash flow et total des investissements
5 Part d’exploitations avec cash flow > total des investissements
6 Part de capitaux étrangers <50% et formation de capital propre positive
7 Part de capitaux étrangers >50% et formation de capital propre positive
8 Part de capitaux étrangers <50% et formation de capital propre négative
9 Part de capitaux étrangers >50% et formation de capital propre négative
10 Rapport entre revenu de l'exploitation et main-d'oeuvre de l'exploitation
11 Rapport entre revenu de l'exploitation et surface agricole utile
12 Rapport entre revenu de l'exploitation et actifs totaux
13 Rapport entre (service de la dette plus bénéfice/pertes calculés plus intérêts sur le capital propre) et actifs de l'exploitation
14 Rapport entre (bénéfice/pertes calculés plus intérêts sur le capital propre) et capital propre de l’exploitation
15 Rapport entre (revenu agricole moins intérêts sur le capital propre) et unités de travail annuel de la famille (UTAF)
* Région des collines: zone des collines et zone de montagne I
Source: dépouillement centralisé, FAT
A16 A N N E X E
Caractéristique Unité 1996 1997 1998 1999 1996/98–1999 % Exploitations de référence Nombre 1 126 1 103 1 119 1 029 -7 8 Exploitations représentées Nombre 16 054 15 796 15 420 14 967 -5 0 Structure d'exploitation Surface agricole utile ha 16 67 16 92 17 07 17 19 1 8 Terres ouvertes ha 3 19 3 08 2 98 2 99 -3 0 Main-d'oeuvre de l'exploitation UTA 1 67 1 66 1 65 1 62 -2 4 dont main-d'oeuvre familiale UTAF 1 30 1 30 1 29 1 28 -1 3 Vaches, total Nombre 15 0 14 7 14 8 14 7 -0 9 Animaux, total UGB 26 5 26 3 26 6 26 0 -1 8 Structure du capital Actifs totaux fr 598 280 622 467 648 445 655 042 5 1 dont: actifs circulants fr 105 723 116 547 114 116 116 937 4 3 dont: actif bétail fr 45 694 46 483 44 218 44 452 -2 2 dont: immobilisations fr 446 863 459 437 490 111 493 653 6 1 dont: actifs de l'exploitation fr 558 145 572 477 595 810 602 991 4 8 Part de capitaux étrangers % 46 45 45 45 -0 7 Intérêt calculé du capital propre de l'exploitation 1 fr 11 784 10 424 8 959 9 825 -5 4 Compte d'exploitation Rendement brut total fr 160 008 172 687 169 697 167 340 -0 1 dont: paiements directs fr 36 980 38 489 37 258 37 996 1 1 Charges matérielles fr 93 956 95 988 99 789 96 378 -0 2 Revenu de l'exploitation fr 66 052 76 699 69 908 70 962 0 1 Frais de main-d'oeuvre fr 9 705 9 792 9 839 9 037 -7 6 Service de la dette fr 9 446 8 507 8 136 7 618 -12 4 Fermages fr 4 392 4 660 4 513 4 422 -2 2 Charges réelles fr 117 499 118 948 122 277 117 455 -1 8 Revenu agricole fr 42 509 53 740 47 420 49 885 4 2 Revenu accessoire fr 17 947 18 973 19 283 19 849 5 9 Revenu total fr 60 456 72 713 66 703 69 734 4 7 Consommation de la famille fr 57 323 56 859 57 769 55 890 -2 5 Formation de capital propre fr 3 133 15 854 8 934 13 844 48 7 Investissements et financement Total des investissements 2 fr 39 485 40 324 47 691 39 227 -7 7 Cash flow 3 fr 38 347 40 313 39 269 40 759 3 7 Rapport entre cash flow et investissements 4 % 97 100 82 104 11 8 Exploitations avec excédent de financement 5 % 70 70 61 67 0 0 Stabilité financière Exploitation en situation financière saine 6 % 35 47 43 46 10 4 Exploitations avec faible autonomie financière 7 % 19 29 25 26 6 8 Exploitations avec faible revenu 8 % 21 10 15 13 -15 2 Exploitations en situation financière précaire 9 % 25 14 17 15 -19 6 Productivité Productivité du travail 10 fr /UTA 39 644 46 179 42 381 43 842 2 6 Productivité des surfaces 11 fr /ha 3 963 4 534 4 096 4 128 -1 7 Productivité du capital 12 % 11 8 13 4 11 7 11 8 -4 1 Rentabilité Rentabilité du capital total 13 % -3 8 -2 0 -3 1 -2 5 -15 7 Rentabilité du capital propre 14 % -10 4 -6 5 -8 3 -7 0 -16 7 Revenu du travail de la main-d'oeuvre familiale 15 fr /UTAF 23 623 33 228 29 714 31 292 8 4 (moyenne) Revenu du travail de la main-d'oeuvre familiale 15 fr /UTAF 22 441 31 182 28 701 29 459 7 4 (médiane)
Tableau 17
Résultats d’exploitation: région de montagne*
1 Taux d'intérêt moyen des obligations de la Confédération (1996: 4 00%; 1997: 3 40%; 1998: 2 81%; 1999: 3 02%)
2 Investissements bruts (sans prestations propres), déduction faite des subventions et des désinvestissements
3 Formation de capital propre (sans prestations propres), plus amortissements, plus/moins changements stocks et actif bétail
4 Rapport entre cash flow et total des investissements
5 Part d’exploitations avec cash flow > total des investissements
6 Part de capitaux étrangers <50% et formation de capital propre positive
7 Part de capitaux étrangers >50% et formation de capital propre positive
8 Part de capitaux étrangers <50% et formation de capital propre négative
9 Part de capitaux étrangers >50% et formation de capital propre négative
10 Rapport entre revenu de l'exploitation et main-d'oeuvre de l'exploitation
11 Rapport entre revenu de l'exploitation et surface agricole utile
12 Rapport entre revenu de l'exploitation et actifs totaux
13 Rapport entre (service de la dette plus bénéfice/pertes calculés plus intérêts sur le capital propre) et actifs de l'exploitation
14 Rapport entre (bénéfice/pertes calculés plus intérêts sur le capital propre) et capital propre de l’exploitation
15 Rapport entre (revenu agricole moins intérêts sur le capital propre) et unités de travail annuel de la famille (UTAF)
* Région de montagne: zones de montagne II à IV
Source: dépouillement centralisé, FAT
A N N E X E A17
Caractéristique Unité 1996 1997 1998 1999 1996/98–1999 % Exploitations de référence Nombre 952 998 953 900 -7 0 Exploitations représentées Nombre 15 267 15 334 14 884 14 440 -4 8 Structure d'exploitation Surface agricole utile ha 17 19 17 28 17 67 18 06 3 9 Terres ouvertes ha 0 37 0 36 0 32 0 25 -28 6 Main-d'oeuvre de l'exploitation UTA 1 60 1 61 1 60 1 57 -2 1 dont main-d'oeuvre familiale UTAF 1 39 1 39 1 38 1 37 -1 2 Vaches, total Nombre 11 9 11 7 11 8 11 9 0 8 Animaux, total UGB 21 0 20 6 20 7 21 1 1 6 Structure du capital Actifs totaux fr 516 102 529 934 545 982 569 082 7 2 dont: actifs circulants fr 89 241 93 858 94 862 101 469 9 5 dont: actif bétail fr 36 399 36 846 36 097 36 681 0 6 dont: immobilisations fr 390 462 399 230 415 023 430 932 7 3 dont: actifs de l'exploitation fr 484 735 500 870 514 474 539 022 7 8 Part de capitaux étrangers % 42 42 41 40 -4 0 Intérêt calculé du capital propre de l'exploitation 1 fr 11 189 9 795 8 388 9 580 -2 2 Compte d'exploitation Rendement brut total fr 120 343 131 097 127 656 131 838 4 3 dont: paiements directs fr 45 701 47 435 45 373 51 279 11 1 Charges matérielles fr 71 805 73 483 75 698 75 569 2 6 Revenu de l'exploitation fr 48 538 57 614 51 958 56 269 6 8 Frais de main-d'oeuvre fr 4 873 5 370 5 316 4 619 -10 9 Service de la dette fr 6 416 6 286 5 704 5 386 -12 2 Fermages fr 2 928 2 821 2 837 2 872 0 3 Charges réelles fr 86 022 87 960 89 556 88 445 0 7 Revenu agricole fr 34 321 43 137 38 101 43 392 12 6 Revenu accessoire fr 18 412 18 139 18 505 19 250 4 9 Revenu total fr 52 733 61 276 56 606 62 642 10 1 Consommation de la famille fr 49 736 49 338 51 077 49 678 -0 7 Formation de capital propre fr 2 997 11 938 5 529 12 964 90 1 Investissements et financement Total des investissements 2 fr 30 625 33 423 40 694 36 177 3 6 Cash flow 3 fr 32 817 33 355 29 723 37 469 17 2 Rapport entre cash flow et investissements 4 % 107 100 73 104 11 4 Exploitations avec excédent de financement 5 % 69 68 59 70 7 1 Stabilité financière Exploitation en situation financière saine 6 % 37 50 44 50 14 5 Exploitations avec faible autonomie financière 7 % 17 24 19 23 15 0 Exploitations avec faible revenu 8 % 26 14 20 15 -25 0 Exploitations en situation financière précaire 9 % 20 12 17 12 -26 5 Productivité Productivité du travail 10 fr /UTA 30 308 35 692 32 445 35 950 9 6 Productivité des surfaces 11 fr /ha 2 823 3 333 2 940 3 115 2 7 Productivité du capital 12 % 10 0 11 5 10 1 10 4 -1 3 Rentabilité Rentabilité du capital total 13 % -6 5 -4 6 -5 6 -4 4 -21 0 Rentabilité du capital propre 14 % -13 6 -10 2 -11 6 -9 2 -22 0 Revenu du travail de la main-d'oeuvre familiale 15 fr /UTAF 16 643 24 022 21 498 24 747 19 4 (moyenne) Revenu du travail de la main-d'oeuvre familiale 15 fr /UTAF 15 559 22 920 20 629 22 991 16 7 (médiane)
Tableau 18a
Résultats d'exploitation selon les types d'exploitations*
– 1997/99
1 Taux d'intérêt moyen des obligations de la Confédération (1996: 4 00%; 1997: 3 40%; 1998: 2 81%; 1999: 3 02%)
2 Investissements bruts (sans prestations propres), déduction faite des subventions et des désinvestissements
3 Formation de capital propre (sans prestations propres), plus amortissements, plus/moins changements stocks et actif bétail
4 Rapport entre cash flow et total des investissements
5 Part d’exploitations avec cash flow > total des investissements
6 Part de capitaux étrangers <50% et formation de capital propre positive
7 Part de capitaux étrangers >50% et formation de capital propre positive
8 Part de capitaux étrangers <50% et formation de capital propre négative
9 Part de capitaux étrangers >50% et formation de capital propre négative
10 Rapport entre revenu de l'exploitation et main-d'oeuvre de l'exploitation
11 Rapport entre revenu de l'exploitation et surface agricole utile
12 Rapport entre revenu de l'exploitation et actifs totaux
13 Rapport entre (service de la dette plus bénéfice/pertes calculés plus intérêts sur le capital propre) et actifs de l'exploitation
14 Rapport entre (bénéfice/pertes calculés plus intérêts sur le capital propre) et capital propre de l’exploitation
15 Rapport entre (revenu agricole moins intérêts sur le capital propre) et unités de travail annuel de la famille (UTAF)
* Nouvelle typologie de la FAT «FAT99p» (cf annexe: «Procédés et méthodes»)
Source: dépouillement centralisé, FAT
A18 A N N E X E
Production végétale Elevage Moyenne Lait Caractéristique Unité de toutes Grandes Cultures commer- Vaches Autres les expl cultures spéciales cialisé mères bovins Exploitations de référence Nombre 3 752 145 84 1 470 56 166 Exploitations représentées Nombre 56 226 3 366 3 442 21 591 984 3 406 Structure d'exploitation Surface agricole utile ha 18 14 22 40 12 54 17 43 16 99 14 46 Terres ouvertes ha 5 11 18 45 6 34 0 95 0 61 0 09 Main-d'oeuvre de l'exploitation UTA 1 73 1 37 2 48 1 64 1 39 1 43 dont main-d'oeuvre familiale UTAF 1 31 1 04 1 31 1 36 1 13 1 30 Vaches, total Nombre 13 3 3 9 1 7 15 4 15 7 9 2 Animaux, total UGB 23 5 8 5 2 7 23 8 21 0 16 7 Structure du capital Actifs totaux fr 679 050 744 646 756 916 598 437 634 415 471 310 dont: actifs circulants fr 132 924 167 719 206 732 108 045 112 483 90 403 dont: actif bétail fr 41 476 16 217 6 976 41 340 38 901 32 872 dont: immobilisations fr 504 650 560 710 543 208 449 052 483 031 348 035 dont: actifs de l'exploitation fr 626 498 689 126 703 826 556 004 594 954 442 681 Part de capitaux étrangers % 42 35 35 43 38 42 Intérêt calculé du capital propre de l'exploitation 1 fr 11 054 13 490 13 747 9 473 11 206 7 780 Compte d'exploitation Rendement brut total fr 184 409 205 178 234 888 147 703 126 412 105 240 dont: paiements directs fr 38 619 36 974 22 910 38 341 61 095 52 385 Charges matérielles fr 103 096 111 228 112 130 81 208 67 677 63 825 Revenu de l'exploitation fr 81 313 93 950 122 758 66 495 58 735 41 415 Frais de main-d'oeuvre fr 12 862 11 258 45 629 7 268 7 129 2 997 Service de la dette fr 8 031 8 370 8 740 7 085 5 972 4 772 Fermages fr 5 472 8 298 6 156 4 474 1 923 1 715 Charges réelles fr 129 461 139 154 172 655 100 035 82 701 73 309 Revenu agricole fr 54 948 66 024 62 233 47 668 43 711 31 931 Revenu accessoire fr 18 506 27 940 20 052 17 900 31 311 19 619 Revenu total fr 73 454 93 964 82 285 65 568 75 022 51 550 Consommation de la famille fr 60 664 80 174 77 024 54 148 54 450 44 466 Formation de capital propre fr 12 790 13 790 5 261 11 420 20 572 7 084 Investissements et financement Total des investissements 2 fr 44 121 44 907 34 425 39 542 42 569 32 079 Cash flow 3 fr 41 915 47 583 35 943 36 397 45 852 26 644 Rapport entre cash flow et investissements 4 % 96 108 112 93 109 85 Exploitations avec excédent de financement 5 % 65 62 58 66 69 65 Stabilité financière Exploitation en situation financière saine 6 % 47 46 34 48 69 40 Exploitations avec faible autonomie financière 7 % 22 18 17 23 16 23 Exploitations avec faible revenu 8 % 17 25 32 15 7 21 Exploitations en situation financière précaire 9 % 14 11 17 14 8 16 Productivité Productivité du travail 10 fr /UTA 46 946 68 486 49 553 40 543 42 343 28 905 Productivité des surfaces 11 fr /ha 4 485 4 192 9 806 3 816 3 456 2 862 Productivité du capital 12 % 13 0 13 6 17 4 12 0 9 9 9 4 Rentabilité Rentabilité du capital total 13 % -2 1 1 4 -1 4 -3 8 -2 1 -7 3 Rentabilité du capital propre 14 % -5 8 0 3 -4 1 -9 2 -5 0 -14 8 Revenu du travail de la main-d'oeuvre familiale 15 fr /UTAF 33 553 50 493 36 992 28 176 28 804 18 634 (moyenne) Revenu du travail de la main-d'oeuvre familiale 15 fr /UTAF 30 558 51 755 29 649 26 669 29 679 18 524 (médiane)
Tableau 18b
Résultats d'exploitation selon les types d'exploitations* – 1997/99
1 Taux d'intérêt moyen des obligations de la Confédération (1996: 4 00%; 1997: 3 40%; 1998: 2 81%; 1999: 3 02%)
2 Investissements bruts (sans prestations propres), déduction faite des subventions et des désinvestissements
3 Formation de capital propre (sans prestations propres), plus amortissements, plus/moins changements stocks et actif bétail
4 Rapport entre cash flow et total des investissements
5 Part d’exploitations avec cash flow > total des investissements
6 Part de capitaux étrangers <50% et formation de capital propre positive
7 Part de capitaux étrangers >50% et formation de capital propre positive
8 Part de capitaux étrangers <50% et formation de capital propre négative
9 Part de capitaux étrangers >50% et formation de capital propre négative
10 Rapport entre revenu de l'exploitation et main-d'oeuvre de l'exploitation
11 Rapport entre revenu de l'exploitation et surface agricole utile
12 Rapport entre revenu de l'exploitation et actifs totaux
13 Rapport entre (service de la dette plus bénéfice/pertes calculés plus intérêts sur le capital propre) et actifs de l'exploitation
14 Rapport entre (bénéfice/pertes calculés plus intérêts sur le capital propre) et capital propre de l’exploitation
15 Rapport entre (revenu agricole moins intérêts sur le capital propre) et unités de travail annuel de la famille (UTAF)
* Nouvelle typologie de la FAT «FAT99» (cf annexe: «Procédés et méthodes»)
Source: dépouillement centralisé, FAT
A N N E X E A19
Elevage Exploitations combinées Moyennes Chevaux, Grandes Caractéristique Unité de toutes ovins, Trans- cultures + Vaches Transles expl caprins formation lait mères formation Autres Exploitations de référence Nombre 3 752 25 48 559 28 684 487 Exploitations représentées Nombre 56 226 1 121 1 173 6 973 330 6 067 7 774 Structure d'exploitation Surface agricole utile ha 18 14 12 53 10 88 23 58 24 65 17 95 19 40 Terres ouvertes ha 5 11 0 23 0 97 12 76 11 31 6 33 6 36 Main-d'oeuvre de l'exploitation UTA 1 73 1 25 1 54 1 99 1 73 1 86 1 76 dont main-d'oeuvre familiale UTAF 1 31 1 16 1 19 1 37 1 23 1 31 1 30 Vaches, total Nombre 13 3 2 0 11 2 17 9 23 6 14 8 14 4 Animaux, total UGB 23 5 12 2 45 7 27 9 34 4 36 4 25 7 Structure du capital Actifs totaux fr 679 050 403 347 837 512 782 475 751 853 825 470 742 788 dont: actifs circulants fr 132 924 77 858 108 237 161 369 167 121 153 559 144 541 dont: actif bétail fr 41 476 20 326 72 841 49 188 66 531 58 016 49 726 dont: immobilisations fr 504 650 305 163 656 434 571 918 518 201 613 895 548 521 dont: actifs de l'exploitation fr 626 498 369 030 772 826 726 249 679 812 760 288 664 155 Part de capitaux étrangers % 42 41 50 41 46 41 43 Intérêt calculé du capital propre de l'exploitation 1 fr 11 054 6 534 11 786 12 975 11 116 13 625 11 417 Compte d'exploitation Rendement brut total fr 184 409 89 941 267 178 233 911 223 656 260 390 192 851 dont: paiements directs fr 38 619 39 197 26 445 40 423 73 496 35 775 38 993 Charges matérielles fr 103 096 57 175 181 021 128 542 126 814 156 511 107 428 Revenu de l'exploitation fr 81 313 32 766 86 157 105 369 96 842 103 879 85 423 Frais de main-d'oeuvre fr 12 862 1 746 10 722 18 869 17 674 16 110 13 467 Service de la dette fr 8 031 4 538 12 966 9 235 8 943 9 760 9 171 Fermages fr 5 472 1 742 2 835 9 072 13 107 5 561 6 152 Charges réelles fr 129 461 65 201 207 544 165 718 166 538 187 942 136 218 Revenu agricole fr 54 948 24 740 59 634 68 193 57 118 72 448 56 633 Revenu accessoire fr 18 506 29 819 15 559 12 986 25 445 16 085 18 637 Revenu total fr 73 454 54 559 75 193 81 179 82 563 88 533 75 270 Consommation de la famille fr 60 664 48 592 61 722 66 144 70 359 67 266 61 994 Formation de capital propre fr 12 790 5 967 13 471 15 035 12 204 21 267 13 276 Investissements et financement Total des investissements 2 fr 44 121 32 076 60 053 52 467 56 079 57 876 46 893 Cash flow 3 fr 41 915 26 897 50 949 50 299 46 416 58 368 43 806 Rapport entre cash flow et investissements 4 % 96 97 104 97 84 104 94 Exploitations avec excédent de financement 5 % 65 60 65 63 62 68 65 Stabilité financière Exploitation en situation financière saine 6 % 47 46 36 48 40 54 47 Exploitations avec faible autonomie financière 7 % 22 21 31 21 24 21 23 Exploitations avec faible revenu 8 % 17 18 13 17 14 13 15 Exploitations en situation financière précaire 9 % 14 15 20 14 22 12 15 Productivité Productivité du travail 10 fr /UTA 46 946 26 259 55 935 52 994 56 030 55 947 48 487 Productivité des surfaces 11 fr /ha 4 485 2 627 7 953 4 472 3 934 5 797 4 408 Productivité du capital 12 % 13 0 9 0 11 2 14 5 14 2 13 7 12 9 Rentabilité Rentabilité du capital total 13 % -2 1 -9 5 0 4 -0 9 -1 3 0 6 -1 8 Rentabilité du capital propre 14 % -5 8 -18 7 -2 4 -3 8 -4 9 -1 3 -5 7 Revenu du travail de la main-d'oeuvre familiale15 fr /UTAF 33 553 15 596 40 134 40 316 37 522 44 851 34 642 (moyenne) Revenu du travail de la main-d'oeuvre familiale15 fr /UTAF 30 558 13 102 33 203 38 536 33 648 41 393 32 409
(médiane)
Tableau 19
Résultats d'exploitation par quartile: toutes les régions – 1997/99
1 Taux d'intérêt moyen des obligations de la Confédération (1996: 4 00%; 1997: 3 40%; 1998: 2 81%; 1999: 3 02%)
2 Investissements bruts (sans prestations propres), déduction faite des subventions et des désinvestissements
3 Formation de capital propre (sans prestations propres), plus amortissements, plus/moins changements stocks et actif bétail
4 Rapport entre cash flow et total des investissements
5 Part d’exploitations avec cash flow > total des investissements
6 Part de capitaux étrangers <50% et formation de capital propre positive
7 Part de capitaux étrangers >50% et formation de capital propre positive
8 Part de capitaux étrangers <50% et formation de capital propre négative
9 Part de capitaux étrangers >50% et formation de capital propre négative
10 Rapport entre revenu de l'exploitation et main-d'oeuvre de l'exploitation
11 Rapport entre revenu de l'exploitation et surface agricole utile
12 Rapport entre revenu de l'exploitation et actifs totaux
13 Rapport entre (service de la dette plus bénéfice/pertes calculés plus intérêts sur le capital propre) et actifs de l'exploitation
14 Rapport entre (bénéfice/pertes calculés plus intérêts sur le capital propre) et capital propre de l’exploitation
15 Rapport entre (revenu agricole moins intérêts sur le capital propre) et unités de travail annuel de la famille (UTAF)
Source: dépouillement centralisé, FAT
A20 A N N E X E
ventilées selon le revenu du travail Caractéristique Unité Moyenne 1er quartile 2e quartile 3e quartile 4e quartile (0 –25%) (25 –50%) (50 –75%) (75 –100%) Exploitations de référence Nombre 3 752 763 907 1 036 1 046 Exploitations représentées Nombre 56 226 14 069 14 058 14 049 14 051 Structure d'exploitation Surface agricole utile ha 18 14 14 11 16 36 19 21 22 88 Terres ouvertes ha 5 11 2 57 3 27 5 11 9 49 Main-d'oeuvre de l'exploitation UTA 1 73 1 68 1 71 1 71 1 83 dont main-d'oeuvre familiale UTAF 1 31 1 30 1 39 1 34 1 20 Vaches, total Nombre 13 3 10 6 12 6 15 0 15 0 Animaux, total UGB 23 5 18 9 21 8 25 6 28 0 Structure du capital Actifs totaux fr 679 050 618 162 604 995 685 900 807 264 dont: actifs circulants fr 132 924 101 070 112 725 135 327 182 623 dont: actif bétail fr 41 476 33 607 38 571 44 596 49 143 dont: immobilisations fr 504 650 483 485 453 699 505 977 575 498 dont: actifs de l'exploitation fr 626 498 574 199 565 119 632 320 734 457 Part de capitaux étrangers % 42 43 42 41 41 Intérêt calculé du capital propre de l'exploitation 1 fr 11 054 9 902 9 903 11 253 13 161 Compte d'exploitation Rendement brut total fr 184 409 130 784 153 532 189 913 263 492 dont: paiements directs fr 38 619 34 168 37 280 39 730 43 305 Charges matérielles fr 103 096 88 514 89 391 103 446 131 060 Revenu de l'exploitation fr 81 313 42 270 64 141 86 467 132 432 Frais de main-d'oeuvre fr 12 862 11 596 9 006 10 798 20 051 Service de la dette fr 8 031 7 911 7 122 7 828 9 265 Fermages fr 5 472 3 125 4 126 5 776 8 864 Charges réelles fr 129 461 111 147 109 645 127 848 169 240 Revenu agricole fr 54 948 19 638 43 887 62 065 94 252 Revenu accessoire fr 18 506 26 624 17 753 15 050 14 587 Revenu total fr 73 454 46 262 61 640 77 115 108 839 Consommation de la famille fr 60 664 51 397 55 481 61 600 74 192 Formation de capital propre fr 12 790 -5 135 6 159 15 515 34 647 Investissements et financement Total des investissements 2 fr 44 121 35 665 39 216 46 881 54 735 Cash flow 3 fr 41 915 24 245 32 697 44 614 66 131 Rapport entre cash flow et investissements 4 % 96 69 84 96 121 Exploitations avec excédent de financement 5 % 65 55 64 68 72 Stabilité financière Exploitation en situation financière saine 6 % 47 29 45 54 59 Exploitations avec faible autonomie financière 7 % 22 13 21 25 28 Exploitations avec faible revenu 8 % 17 33 18 11 7 Exploitations en situation financière précaire 9 % 14 25 16 10 6 Productivité Productivité du travail 10 fr /UTA 46 946 25 150 37 551 50 561 72 365 Productivité des surfaces 11 fr /ha 4 485 2 996 3 923 4 504 5 791 Productivité du capital 12 % 13 0 7 4 11 4 13 7 18 0 Rentabilité Rentabilité du capital total 13 % -2 1 -8 1 -5 0 -1 3 4 3 Rentabilité du capital propre 14 % -5 8 -16 8 -11 1 -4 4 5 2 Revenu du travail de la main-d'oeuvre familiale 15 fr /UTAF 33 553 7 464 24 444 37 956 67 539 (moyenne) Revenu du travail de la main-d'oeuvre familiale 15 fr /UTAF 30 558 (médiane)
Tableau 20
Résultats d'exploitation par quartile: région de plaine* – 1997/99
1 Taux d'intérêt moyen des obligations de la Confédération (1996: 4 00%; 1997: 3 40%; 1998: 2 81%; 1999: 3 02%)
2 Investissements bruts (sans prestations propres), déduction faite des subventions et des désinvestissements
3 Formation de capital propre (sans prestations propres), plus amortissements, plus/moins changements stocks et actif bétail
4 Rapport entre cash flow et total des investissements
5 Part d’exploitations avec cash flow > total des investissements
6 Part de capitaux étrangers <50% et formation de capital propre positive
7 Part de capitaux étrangers >50% et formation de capital propre positive
8 Part de capitaux étrangers <50% et formation de capital propre négative
9 Part de capitaux étrangers >50% et formation de capital propre négative
10 Rapport entre revenu de l'exploitation et main-d'oeuvre de l'exploitation
11 Rapport entre revenu de l'exploitation et surface agricole utile
12 Rapport entre revenu de l'exploitation et actifs totaux
13 Rapport entre (service de la dette plus bénéfice/pertes calculés plus intérêts sur le capital propre) et actifs de l'exploitation
14 Rapport entre (bénéfice/pertes calculés plus intérêts sur le capital propre) et capital propre de l’exploitation
15 Rapport entre (revenu agricole moins intérêts sur le capital propre) et unités de travail annuel de la famille (UTAF)
* Région de plaine: zone de grandes cultures et zones intermédiaires
Source: dépouillement centralisé, FAT
A N N E X E A21
ventilées selon le revenu du travail Caractéristique Unité Moyenne 1er quartile 2e quartile 3e quartile 4e quartile (0 –25%) (25 –50%) (50 –75%) (75 –100%) Exploitations de référence Nombre 1 718 350 441 474 453 Exploitations représentées Nombre 25 946 6 520 6 474 6 475 6 478 Structure d'exploitation Surface agricole utile ha 19 04 14 96 17 67 19 81 23 76 Terres ouvertes ha 9 10 6 35 7 60 9 16 13 33 Main-d'oeuvre de l'exploitation UTA 1 86 1 82 1 86 1 83 1 94 dont main-d'oeuvre familiale UTAF 1 28 1 27 1 38 1 32 1 14 Vaches, total Nombre 13 3 10 4 14 2 15 1 13 5 Animaux, total UGB 23 5 18 4 23 8 24 8 26 9 Structure du capital Actifs totaux fr 776 131 730 690 726 256 779 589 868 309 dont: actifs circulants fr 163 827 131 935 147 456 169 142 206 992 dont: actif bétail fr 42 194 34 508 42 370 44 234 47 707 dont: immobilisations fr 570 110 564 247 536 430 566 213 613 610 dont: actifs de l'exploitation fr 710 155 672 738 670 945 708 003 789 191 Part de capitaux étrangers % 40 41 40 39 39 Intérêt calculé du capital propre de l'exploitation 1 fr 12 873 11 923 12 061 13 016 14 498 ECompte d'exploitation Rendement brut total fr 224 133 166 487 198 552 228 399 303 435 dont: paiements directs fr 33 649 26 929 31 417 35 075 41 218 Charges matérielles fr 122 655 108 407 113 337 120 260 148 694 Revenu de l'exploitation fr 101 478 58 080 85 215 108 139 154 741 Frais de main-d'oeuvre fr 19 281 19 087 14 859 16 125 27 048 Service de la dette fr 9 287 9 637 8 872 8 781 9 855 Fermages fr 7 536 4 896 6 495 7 959 10 810 Charges réelles fr 158 758 142 027 143 563 153 125 196 408 Revenu agricole fr 65 374 24 460 54 989 75 274 107 028 Revenu accessoire fr 17 931 26 360 16 056 15 884 13 359 Revenu total fr 83 305 50 820 71 045 91 158 120 387 Consommation de la famille fr 69 039 60 947 63 564 70 340 81 356 Formation de capital propre fr 14 266 -10 127 7 481 20 818 39 031 Investissements et financement Total des investissements 2 fr 49 349 40 855 47 180 51 896 57 506 Cash flow 3 fr 47 819 24 700 40 047 53 049 73 616 Rapport entre cash flow et investissements 4 % 98 61 87 103 128 Exploitations avec excédent de financement 5 % 64 50 64 68 73 Stabilité financière Exploitation en situation financière saine 6 % 47 25 46 58 59 Exploitations avec faible autonomie financière 7 % 19 10 19 20 28 Exploitations avec faible revenu 8 % 20 41 18 13 8 Exploitations en situation financière précaire 9 % 14 24 17 9 5 Productivité Productivité du travail 10 fr /UTA 54 430 31 789 45 870 58 971 79 767 Productivité des surfaces 11 fr /ha 5 331 3 899 4 822 5 458 6 517 Productivité du capital 12 % 14 3 8 6 12 7 15 3 19 6 Rentabilité Rentabilité du capital total 13 % -0 7 -6 7 -3 3 0 3 5 9 Rentabilité du capital propre 14 % -3 3 -14 1 -7 9 -1 5 7 7 Revenu du travail de la main-d'oeuvre familiale 15 fr /UTAF 41 119 9 849 31 101 47 255 81 326 (moyenne) Revenu du travail de la main-d'oeuvre familiale 15 fr /UTAF 38 286 (médiane)
Tableau 21
Résultats d'exploitation par quartile: région des collines* – 1997/99
1 Taux d'intérêt moyen des obligations de la Confédération (1996: 4 00%; 1997: 3 40%; 1998: 2 81%; 1999: 3 02%)
2 Investissements bruts (sans prestations propres), déduction faite des subventions et des désinvestissements
3 Formation de capital propre (sans prestations propres), plus amortissements, plus/moins changements stocks et actif bétail
4 Rapport entre cash flow et total des investissements
5 Part d’exploitations avec cash flow > total des investissements
6 Part de capitaux étrangers <50% et formation de capital propre positive
7 Part de capitaux étrangers >50% et formation de capital propre positive
8 Part de capitaux étrangers <50% et formation de capital propre négative
9 Part de capitaux étrangers >50% et formation de capital propre négative
10 Rapport entre revenu de l'exploitation et main-d'oeuvre de l'exploitation
11 Rapport entre revenu de l'exploitation et surface agricole utile
12 Rapport entre revenu de l'exploitation et actifs totaux
13 Rapport entre (service de la dette plus bénéfice/pertes calculés plus intérêts sur le capital propre) et actifs de l'exploitation
14 Rapport entre (bénéfice/pertes calculés plus intérêts sur le capital propre) et capital propre de l’exploitation
15 Rapport entre (revenu agricole moins intérêts sur le capital propre) et unités de travail annuel de la famille (UTAF)
* Région des collines: zone des collines et zone de montagne I
Source: dépouillement centralisé, FAT
A22 A N N E X E
ventilées selon le revenu du travail Caractéristique Unité Moyenne 1er quartile 2e quartile 3e quartile 4e quartile (0 –25%) (25 –50%) (50 –75%) (75 –100%) Exploitations de référence Nombre 1 084 215 257 289 322 Exploitations représentées Nombre 15 394 3 864 3 843 3 830 3 857 Structure d'exploitation Surface agricole utile ha 17 06 12 98 15 42 17 78 22 06 Terres ouvertes ha 3 01 1 85 2 39 3 37 4 45 Main-d'oeuvre de l'exploitation UTA 1 64 1 60 1 65 1 63 1 69 dont main-d'oeuvre familiale UTAF 1 29 1 25 1 37 1 31 1 24 Vaches, total Nombre 14 7 12 3 13 8 15 5 17 3 Animaux, total UGB 26 3 21 3 24 0 27 1 32 9 Structure du capital Actifs totaux fr 641 985 610 540 596 061 641 485 719 711 dont: actifs circulants fr 115 867 92 527 107 475 117 758 145 666 dont: actif bétail fr 45 051 36 496 41 662 46 234 55 818 dont: immobilisations fr 481 067 481 517 446 924 477 493 518 227 dont: actifs de l'exploitation fr 590 426 561 230 547 204 591 534 661 698 Part de capitaux étrangers % 45 47 46 44 44 Intérêt calculé du capital propre de l'exploitation 1 fr 9 736 9 027 8 915 9 926 11 075 Compte d'exploitation Rendement brut total fr 169 908 127 784 148 817 175 742 227 322 dont: paiements directs fr 37 914 31 161 34 789 39 048 46 658 Charges matérielles fr 97 385 87 556 88 048 97 380 116 545 Revenu de l'exploitation fr 72 523 40 228 60 769 78 362 110 777 Frais de main-d'oeuvre fr 9 556 9 976 7 484 8 619 12 125 Service de la dette fr 8 087 8 260 7 515 7 845 8 724 Fermages fr 4 532 2 679 3 591 4 931 6 926 Charges réelles fr 119 560 108 471 106 638 118 775 144 321 Revenu agricole fr 50 348 19 313 42 179 56 967 83 002 Revenu accessoire fr 19 369 27 925 19 716 15 700 14 085 Revenu total fr 69 717 47 238 61 895 72 667 97 087 Consommation de la famille fr 56 840 48 577 54 112 58 700 65 998 Formation de capital propre fr 12 877 -1 339 7 783 13 967 31 089 Investissements et financement Total des investissements 2 fr 42 414 36 697 39 716 42 567 50 706 Cash flow 3 fr 40 114 27 360 33 110 40 770 59 201 Rapport entre cash flow et investissements 4 % 95 78 84 96 119 Exploitations avec excédent de financement 5 % 66 58 65 67 73 Stabilité financière Exploitation en situation financière saine 6 % 45 32 44 51 56 Exploitations avec faible autonomie financière 7 % 27 15 26 28 36 Exploitations avec faible revenu 8 % 13 25 14 9 3 Exploitations en situation financière précaire 9 % 15 28 16 12 5 Productivité Productivité du travail 10 fr /UTA 44 134 25 089 36 770 48 137 65 582 Productivité des surfaces 11 fr /ha 4 253 3 096 3 940 4 413 5 035 Productivité du capital 12 % 12 3 7 2 11 1 13 3 16 8 Rentabilité Rentabilité du capital total 13 % -2 5 -7 7 -5 1 -1 6 3 3 Rentabilité du capital propre 14 % -7 3 -17 6 -12 3 -5 4 3 6 Revenu du travail de la main-d'oeuvre familiale 15 fr /UTAF 31 411 8 212 24 265 35 801 58 198 (moyenne) Revenu du travail de la main-d'oeuvre familiale 15 fr /UTAF 29 781 (médiane)
Tableau 22
Résultats d'exploitation par quartile: région de montagne* – 1997/99
1 Taux d'intérêt moyen des obligations de la Confédération (1996: 4 00%; 1997: 3 40%; 1998: 2 81%; 1999: 3 02%)
2 Investissements bruts (sans prestations propres), déduction faite des subventions et des désinvestissements
3 Formation de capital propre (sans prestations propres), plus amortissements, plus/moins changements stocks et actif bétail
4 Rapport entre cash flow et total des investissements
5 Part d’exploitations avec cash flow > total des investissements
6 Part de capitaux étrangers <50% et formation de capital propre positive
7 Part de capitaux étrangers >50% et formation de capital propre positive
8 Part de capitaux étrangers <50% et formation de capital propre négative
9 Part de capitaux étrangers >50% et formation de capital propre négative
10 Rapport entre revenu de l'exploitation et main-d'oeuvre de l'exploitation
11 Rapport entre revenu de l'exploitation et surface agricole utile
12 Rapport entre revenu de l'exploitation et actifs totaux
13 Rapport entre (service de la dette plus bénéfice/pertes calculés plus intérêts sur le capital propre) et actifs de l'exploitation
14 Rapport entre (bénéfice/pertes calculés plus intérêts sur le capital propre) et capital propre de l’exploitation
15 Rapport entre (revenu agricole moins intérêts sur le capital propre) et unités de travail annuel de la famille (UTAF)
* Région de montagne: zones de montagne II à IV
Source: dépouillement centralisé, FAT
A N N E X E A23
ventilées selon le revenu du travail Caractéristique Unité Moyenne 1er quartile 2e quartile 3e quartile 4e quartile (0 –25%) (25 –50%) (50 –75%) (75 –100%) Exploitations de référence Nombre 950 198 224 242 286 Exploitations représentées Nombre 14 886 3 731 3 723 3 719 3 713 Structure d'exploitation Surface agricole utile ha 17 67 13 79 15 71 18 05 23 17 Terres ouvertes ha 0 31 0 13 0 20 0 33 0 58 Main-d'oeuvre de l'exploitation UTA 1 59 1 60 1 64 1 61 1 53 dont main-d'oeuvre familiale UTAF 1 38 1 36 1 45 1 41 1 29 Vaches, total Nombre 11 8 9 7 11 0 11 7 14 7 Animaux, total UGB 20 8 17 5 18 8 21 1 25 9 Structure du capital Actifs totaux fr 548 333 503 690 498 801 572 134 618 969 dont: actifs circulants fr 96 730 73 524 90 639 104 597 118 281 dont: actif bétail fr 36 541 30 386 33 359 37 295 45 162 dont: immobilisations fr 415 062 399 780 374 803 430 242 455 526 dont: actifs de l'exploitation fr 518 122 481 784 472 486 543 312 575 118 Part de capitaux étrangers % 41 43 41 39 42 Intérêt calculé du capital propre de l'exploitation 1 fr 9 254 8 393 8 468 10 077 10 084 Compte d'exploitation Rendement brut total fr 130 197 100 592 116 020 135 499 168 844 dont: paiements directs fr 48 029 41 093 45 510 48 260 57 295 Charges matérielles fr 74 917 71 252 69 774 73 773 84 898 Revenu de l'exploitation fr 55 280 29 340 46 246 61 726 83 946 Frais de main-d'oeuvre fr 5 101 5 476 4 170 5 054 5 708 Service de la dette fr 5 792 5 930 5 296 5 496 6 445 Fermages fr 2 844 2 143 2 364 2 971 3 903 Charges réelles fr 88 654 84 801 81 603 87 294 100 954 Revenu agricole fr 41 543 15 791 34 416 48 205 67 890 Revenu accessoire fr 18 632 25 606 17 947 15 821 15 126 Revenu total fr 60 175 41 397 52 363 64 026 83 016 Consommation de la famille fr 50 031 43 542 47 405 52 403 56 810 Formation de capital propre fr 10 144 -2 145 4 958 11 623 26 206 Investissements et financement Total des investissements 2 fr 36 764 33 752 29 284 36 257 47 818 Cash flow 3 fr 33 516 22 727 27 303 33 550 50 543 Rapport entre cash flow et investissements 4 % 92 69 93 96 108 Exploitations avec excédent de financement 5 % 66 57 67 69 70 Stabilité financière Exploitation en situation financière saine 6 % 48 29 49 54 61 Exploitations avec faible autonomie financière 7 % 22 15 17 26 29 Exploitations avec faible revenu 8 % 16 32 18 11 4 Exploitations en situation financière précaire 9 % 14 24 16 9 6 Productivité Productivité du travail 10 fr /UTA 34 696 18 403 28 190 38 343 54 944 Productivité des surfaces 11 fr /ha 3 129 2 130 2 944 3 429 3 622 Productivité du capital 12 % 10 7 6 1 9 8 11 4 14 6 Rentabilité Rentabilité du capital total 13 % -4 9 -10 3 -7 8 -3 8 1 1 Rentabilité du capital propre 14 % -10 3 -20 4 -15 4 -8 0 0 0 Revenu du travail de la main-d'oeuvre familiale 15 fr /UTAF 23 422 5 469 17 848 27 007 44 733 (moyenne) Revenu du travail de la main-d'oeuvre familiale 15 fr /UTAF 22 180 (médiane)
■■■■■■■■■■■■■■■■ Tableaux Dépenses de la Confédération
Dépenses Production et ventes
Tableau 23
Promotion des ventes: répartition des fonds pour 2000
A24 A N N E X E
Secteurs Secteur produit-marché Fonds attribués fr Production laitière 37 631 656 Fromage, étranger 29 017 880 Fromage, Suisse 2 262 776 Lait 6 351 000 Production animale 2 741 922 Viande 1 677 722 Oeufs 600 000 Poissons 8 250 Animaux vivants 439 250 Miel 16 700 Production végétale 6 251 305 Légumes 1 510 205 Fruits 2 008 100 Céréales 1 045 000 Pommes de terre 1 125 000 Oléagineux 563 000 Mesures prises en commun 5 797 162 Réservés pour les décomptes finals 1 000 000 National 53 422 045 Régional 1 6 000 000 Total 59 422 045 1 Planification continue Source: OFAG
Tableau 24
Dépenses en économie laitière – 1999
A N N E X E A25
Désignation Montant fr Mesures transitoires et liquidations Mesures transitoires temporaires 567 683 912 Liquidation de la Butyra 5 000 000 Liquidation de l’Union suisse du commerce de fromage 100 000 000 672 683 912 Soutien du marché (suppléments et aides) Supplément pour le lait transformé en fromage 108 968 404 Supplément de non-ensilage 30 031 589 Aides pour le beurre accordées dans le pays 89 627 206 Aides pour le lait écrémé et la poudre de lait accordées dans le pays 31 963 298 Aides pour le fromage accordées dans le pays 19 342 307 Aides à l’exportation de fromages 75 388 626 Aides à l’exportation d’autres produits laitiers 19 364 575 374 686 005 Soutien du marché (administration) Commissions de recours «Contingentement laitier» 58 788 Administration de la mise en valeur du lait et du contingentement laitier 4 799 622 4 858 410 Total 1 052 228 327 Sources: Compte d’Etat, OFAG
Tableau 25
Dépenses en économie animale – 1999
A26 A N N E X E
Désignation Montant fr Fonds «viande» Indemnités versées à des organisations privées du bétail de boucherie et de la viande 4 800 000 Achat de viande de boeuf destinée à l’aide humanitaire 6 000 000 Contributions au stockage de viande de veau 3 814 856 Contributions au stockage de viande de boeuf provenant d’animaux d’étal (taureaux, génisses, boeufs) 1 508 931 Contributions destinées à réduire le prix des cuisses de bœuf 1 241 387 Contributions au stockage de viande de boeuf provenant d’animaux destinés à la transformation (vaches) 499 716 Vente promotionnelle de veaux à saucisse 16 311 17 881 201 Caisse de compensation des prix des oeufs et des produits à base d’oeufs Contributions pour la conversion à l'élevage particulièrement respectueux des pondeuses 5 840 190 Contributions aux frais de ramassage et de calibrage 4 376 741 Actions de cassage d'oeufs du pays 1 030 045 Campagnes de ventes à prix réduits 552 750 Essais pratiques sur la volaille 199 867 TVA: réduction de la taxe perçue en amont 108 959 12 108 552 Bétail d’élevage et de rente Contributions à l’exportation de bétail d’élevage et de rente provenant de la région de montagne 919 700 Expositions 512 860 Achats destinés à alléger le marché et autres mesures 162 721 1 595 281 Contributions à la mise en valeur de laine de mouton 1 000 000 Total 32 585 034 Sources: Compte d Etat, OFAG
Tableau 26
Dépenses pour la production végétale – 1999
A N N E X E A27
Désignation Quote-part Montant fr / ha fr Contributions à la culture des champs 53 043 064 Contributions à la surface pour oléagineux comme MPR 2 000 3 191 737 Contributions à la surface pour légumineuses à graines 1 260 3 409 376 Contributions à la surface pour autres MPR 2 000 940 425 Primes de culture pour céréales fourragères 770 45 501 526 Contributions de transformation et de mise en valeur 122 960 705 Transformation de sucre 32 589 784 Transformation d'oléagineux 36 809 863 Transformation de pommes de terre 12 367 967 Production de semences 2 066 126 Mise en valeur de fruits 39 126 965 Transformation de MPR 0 Promotion de la culture viti-vinicole 7 175 779 Frais de biens et de services 88 199 Promotion de la viticulture 1 349 030 Mesures de valorisation 5 738 550 Total 183 179 548 Sources: Compte d’Etat, OFAG
Dépenses Paiements directs
Tableau 27a
Paiements directs généraux – 1999
A28 A N N E X E
Contributions à la surface Contributions pour herbivores Exploitations Surface Total contributions Exploitations UGBFG Total contributions nombre ha fr nombre nombre fr Canton ZH 3 983 70 988 80 283 827 1 936 13 395 11 633 518 BE 13 082 187 099 216 521 079 8 715 55 809 50 891 342 LU 5 290 76 343 89 815 300 2 999 16 940 16 108 874 UR 692 6 536 7 120 156 647 5 337 4 669 206 SZ 1 798 24 037 26 633 600 1 578 13 353 11 709 256 OW 756 8 070 8 924 657 656 3 576 3 190 244 NW 526 6 105 6 840 347 411 2 224 1 946 637 GL 441 7 170 8 499 649 427 3 608 3 183 963 ZG 625 10 676 12 251 045 401 2 298 2 092 086 FR 3 500 75 455 87 291 778 2 207 14 367 12 860 666 SO 1 466 30 642 34 761 520 982 7 670 6 858 773 BL 1 002 21 284 24 270 989 687 5 283 4 647 303 SH 605 13 893 15 363 214 218 1 989 1 800 927 AR 804 11 923 13 912 352 621 4 091 3 934 710 AI 610 7 192 8 622 210 363 1 875 1 975 082 SG 4 727 72 300 82 616 881 3 509 25 556 22 248 579 GR 2 949 50 482 57 464 635 2 812 34 356 28 532 123 AG 3 274 57 118 64 565 096 1 667 11 657 10 308 091 TG 2 907 49 984 57 865 240 860 4 721 3 984 714 TI 933 12 641 14 442 436 726 6 477 4 992 395 VD 4 226 104 438 117 719 730 1 997 15 846 14 811 045 VS 4 013 36 470 38 517 180 2 568 18 034 13 009 716 NE 1 010 32 286 36 154 459 731 6 506 6 016 913 GE 336 10 763 10 563 534 91 1 049 990 248 JU 1 141 38 048 42 073 349 959 13 449 12 227 995 Suisse 60 696 1 021 945 1163 094 263 38 768 289 467 254 624 406 Zone 1 Plaine 25 766 480 769 545 167 894 10 815 74 419 65 567 507 Collines 8 564 142 420 163 737 151 5 372 33 922 29 955 770 ZM I 7 866 118 744 136 367 203 6 040 36 677 32 788 999 ZM II 9 488 153 195 174 470 918 7 789 61 681 56 341 701 ZM III 5 999 84 266 95 681 482 5 814 55 939 48 145 187 ZM IV 3 013 42 551 47 669 615 2 938 26 830 21 825 242 1 Attribution de la surface selon la zone dans laquelle se situe la majeure partie de la SAU de l’exploitation Source: OFAG
Tableau 27b
Paiements directs généraux – 1999
A N N E X E A29
Garde d'animaux dans des conditions Contributions générales Contributions pour les vignobles de production difficiles pour les terrains en pente en forte pente et en terrasses Total Total Total Exploitations UGBFG contributions Exploitations Surface contributions Exploitations Surface contributions nombre nombre fr nombre ha fr nombre ha fr Canton ZH 873 11 753 3 707 742 830 5 318 2 182 842 211 191 364 320 BE 9 093 115 883 65 695 570 8 623 48 039 19 883 995 61 99 309 333 LU 3 183 41 193 18 755 088 3 376 21 684 9 051 163 8 12 18 945 UR 687 7 687 6 712 235 640 4 615 2 188 060 000 SZ 1 619 20 727 11 942 672 1 564 10 196 4 362 453 74 9 315 OW 723 9 367 5 468 774 689 4 856 2 230 533 10 750 NW 498 6 592 3 462 517 474 3 868 1 729 958 000 GL 399 5 277 3 914 779 389 3 342 1 520 654 12 7 950 ZG 391 5 404 2 522 782 373 3 037 1 243 324 000 FR 1 902 28 142 10 745 420 1 663 7 683 2 913 651 17 12 18 581 SO 599 8 088 3 162 914 595 5 041 1 919 701 000 BL 712 9 212 2 603 543 702 6 338 2 414 701 38 34 59 460 SH 84 1 108 232 446 144 869 325 922 121 93 152 355 AR 789 10 614 6 102 498 795 6 581 2 771 778 28 26 070 AI 601 7 958 5 275 709 585 3 335 1 391 204 000 SG 3 086 41 012 19 779 556 3 111 25 391 10 589 645 72 103 279 220 GR 2 832 35 154 33 713 023 2 748 30 967 13 529 276 29 22 48 030 AG 1 185 15 190 3 109 095 1 188 7 706 2 960 737 112 164 278 415 TG 158 2 239 817 478 151 1 213 538 820 81 102 157 215 TI 699 7 210 5 864 411 585 3 046 1 343 143 164 147 285 750 VD 1 374 19 083 8 373 251 1 040 5 950 2 362 310 324 451 1 655 915 VS 2 573 21 946 20 097 021 2 462 12 891 5 785 774 1 297 1 521 5 369 110 NE 827 12 463 7 528 796 579 3 427 1 290 100 51 76 141 430 GE 000000 52 81 140 705 JU 806 11 876 6 294 377 597 3 503 1 351 933 11 1 890 Suisse 35 693 455 177 255 881 697 33 903 228 898 95 881 677 2 650 3 122 9 324 759 Zone 1 Plaine 2 074 29 633 2 723 411 2 032 5 618 2 226 694 1 692 2 105 6 233 583 Collines 8 062 107 527 27 937 945 7 399 39 092 15 187 415 182 268 688 450 ZM I 7 586 99 777 44 099 071 7 169 48 224 19 573 923 198 224 641 501 ZM II 9 042 116 628 79 872 952 8 475 61 996 26 088 997 429 476 1 588 335 ZM III 5 933 68 939 63 795 583 5 857 48 648 21 363 129 107 40 139 335 ZM IV 2 996 32 672 37 452 735 2 971 25 320 11 441 519 42 10 33 555 1 Attribution de la surface selon la zone dans laquelle se situe la majeure partie de la SAU de l exploitation Source: OFAG
Tableau 28a
Contributions écologiques – 1999
A30 A N N E X E
Compensation écologique 1 Agriculture biologique Exploitations Surface Total contributions Exploitations Surface Total contributions nombre ha fr nombre ha fr Canton ZH 3 913 7 768 10 233 928 311 5 422 1 107 253 BE 12 474 16 899 15 038 423 1 134 15 263 2 173 767 LU 5 091 6 425 7 589 952 217 3 300 495 290 UR 683 1 163 584 868 35 384 38 778 SZ 1 676 2 417 2 117 813 102 1 523 156 201 OW 707 724 679 718 99 1 190 120 271 NW 526 945 752 003 50 647 66 738 GL 438 1 124 693 511 67 1 088 108 613 ZG 625 1 504 1 594 324 67 1 068 132 671 FR 3 390 5 794 5 600 484 73 1 111 349 079 SO 1 444 3 686 4 158 166 98 2 524 420 113 BL 986 3 071 3 789 272 119 2 556 429 038 SH 560 1 162 1 556 819 14 278 85 987 AR 656 635 541 219 128 1 996 200 984 AI 472 501 361 089 21 312 31 143 SG 4 649 7 728 8 220 024 408 6 588 748 480 GR 2 877 14 844 5 820 334 1 052 20 530 2 249 988 AG 3 219 6 382 8 034 382 169 2 845 667 575 TG 2 836 4 848 6 499 243 160 2 501 650 797 TI 812 1 511 998 537 80 1 154 180 720 VD 3 873 7 142 7 770 404 77 1 440 414 087 VS 2 431 5 910 3 248 970 184 2 517 456 910 NE 726 1 756 1 221 823 26 757 97 330 GE 274 495 779 098 7 111 84 251 JU 1 099 2 866 2 730 285 46 1 348 170 774 Suisse 56 437 107 298 100 614 689 4 744 78 454 11 636 838 Zone 2 Plaine 24 110 40 556 53 305 646 955 15 296 4 381 619 Collines 8 410 15 906 18 127 259 461 7 567 1 272 884 ZM I 7 467 11 018 9 727 540 605 9 116 1 111 283 ZM II 8 241 13 586 9 301 008 987 15 833 1 661 010 ZM III 5 418 14 342 5 905 086 1 044 17 765 1 902 364 ZM IV 2 791 11 891 4 248 150 692 12 877 1 307 678 1 Arbres fruitiers haute-tige convertis en ares 2 Attribution de la surface selon la zone dans laquelle se situe la majeure partie de la SAU de l’exploitation Source: OFAG
Tableau 28b
Contributions écologiques – 1999
A N N E X E A31
Production extensive de Garde particulièrement respectueuse céréales et de colza des animaux de rente agricoles Exploitations Surface Total contributions Exploitations Surface Total contributions nombre ha fr nombre nombre fr Canton ZH 1 998 7 202 2 876 823 1 553 47 930 5 661 671 BE 6 690 19 844 8 008 080 6 643 152 882 19 422 950 LU 1 853 4 539 1 815 672 2 892 94 303 11 408 250 UR 000 249 3 888 490 234 SZ 27 39 15 412 677 14 981 1 875 304 OW 42 792 327 6 913 887 257 NW 000 194 4 934 608 542 GL 7 10 4 112 230 5 336 689 507 ZG 129 252 100 960 322 9 907 1 200 337 FR 1 627 6 575 2 666 866 1 785 62 023 7 775 629 SO 1 001 4 636 1 874 960 628 17 936 2 156 448 BL 748 3 750 1 482 106 382 13 599 1 606 551 SH 390 2 853 1 123 616 171 7 089 801 958 AR 000 480 10 984 1 436 866 AI 000 319 7 345 989 448 SG 491 1 042 409 164 2 184 63 799 8 062 726 GR 427 995 397 705 1 942 42 882 5 321 196 AG 2 138 8 523 3 407 726 1 283 38 545 4 628 926 TG 1 217 3 704 1 479 450 1 295 45 984 5 430 690 TI 92 285 114 164 548 10 722 1 324 107 VD 2 061 12 829 5 125 176 1 319 47 064 5 482 435 VS 190 515 203 241 675 8 415 1 045 648 NE 534 3 167 1 266 445 488 17 320 2 049 576 GE 229 2 707 1 050 706 33 1 427 161 999 JU 685 4 292 1 712 478 639 27 992 3 172 596 Suisse 22 538 87 761 35 135 654 27 258 764 200 93 690 851 Zone 1 Plaine 13 218 58 316 23 360 313 10 433 365 640 43 551 903 Collines 5 114 17 863 7 141 037 4 128 123 846 15 287 258 ZM I 2 710 8 252 3 302 513 3 762 97 234 12 190 632 ZM II 1 184 2 996 1 198 086 4 583 102 680 13 107 868 ZM III 263 297 118 649 2 949 51 622 6 598 032 ZM IV 49 38 15 056 1 403 23 176 2 955 158 1 Attribution de la surface selon la zone dans laquelle se situe la majeure partie de la SAU de l’exploitation Source: OFAG
Tableau 29a
Contributions pour la compensation écologique – 1999
A32 A N N E X E
Prairies extensives Prairies peu intensives Exploitations Surface Total contributions Exploitations Surface Total contributions nombre ha fr nombre ha fr Canton ZH 3 027 3 295 4 633 725 1 325 1 276 812 922 BE 6 391 4 988 4 543 301 7 865 6 762 3 291 166 LU 3 080 1 648 2 039 256 2 629 1 716 940 323 UR 343 383 199 459 501 646 203 275 SZ 776 626 445 211 668 600 249 022 OW 447 283 194 003 234 149 63 056 NW 369 444 277 876 238 202 85 425 GL 379 762 461 838 193 248 93 751 ZG 305 236 268 850 297 211 116 708 FR 1 789 1 626 2 036 718 2 344 2 933 1 706 440 SO 1 085 1 529 1 839 357 747 987 571 506 BL 677 837 973 903 504 656 398 110 SH 481 643 895 861 194 194 125 961 AR 276 123 89 480 438 286 129 437 AI 266 182 128 152 149 102 45 945 SG 2 572 1 887 1 927 828 2 385 1 793 975 157 GR 2 094 4 827 2 319 193 2 556 9 640 2 976 735 AG 2 331 2 539 3 414 826 1 586 1 380 888 563 TG 1 573 1 140 1 663 605 1 409 918 593 758 TI 458 547 413 403 442 774 273 052 VD 2 551 2 675 3 495 877 1 595 2 641 1 389 509 VS 871 1 239 715 168 1 749 3 869 1 311 961 NE 358 467 447 505 479 1 128 530 775 GE 217 307 461 175 24 40 25 823 JU 685 913 1 048 208 693 1 238 647 695 Suisse 33 401 34 148 34 933 775 31 244 40 388 18 446 074 Zone 1 Plaine 16 284 14 743 21 494 102 10 775 9 397 6 032 117 Collines 4 756 4 277 4 982 852 5 052 4 789 3 014 316 ZM I 3 455 2 744 1 995 080 4 478 3 897 1 792 389 ZM II 3 969 3 650 2 467 383 4 845 6 237 2 743 904 ZM III 3 211 5 241 2 413 139 3 713 7 969 2 425 291 ZM IV 1 726 3 493 1 581 220 2 381 8 098 2 438 058 1 Attribution de la surface selon la zone dans laquelle se situe la majeure partie de la SAU de l’exploitation Source: OFAG
Tableau 29b
Contributions pour la compensation écologique – 1999
A N N E X E A33
Surfaces à litière Haies, bosquets champêtres et berges boisées Exploitations Surface Total contributions Exploitations Surface Total contributions nombre ha fr nombre ha fr Canton ZH 1 103 1 180 1 605 481 909 179 257 757 BE 721 502 322 825 1 949 409 424 795 LU 61 20 23 099 197 43 59 142 UR 26 27 22 354 10 84 SZ 561 445 304 991 10 84 OW 55 24 21 677 91 842 NW 116 94 81 362 14 1 1 174 GL 49 44 31 107 10 2 1 146 ZG 292 496 378 306 177 43 46 474 FR 81 39 42 257 782 243 323 963 SO 10 435 313 88 108 523 BL 000 231 65 78 524 SH 86 9 270 217 61 83 495 AR 64 12 8 715 43 9 6 177 AI 185 161 112 483 64 11 7 924 SG 1 478 1 335 1 141 952 303 52 60 773 GR 65 33 15 861 102 29 22 150 AG 99 51 74 864 986 288 376 787 TG 167 86 124 034 470 96 142 454 TI 25 42 60 931 10 3 4 022 VD 88 67 49 696 1 096 346 466 297 VS 69 31 18 744 320 114 80 218 NE 23 1 960 101 40 37 881 GE 35 8 235 110 33 50 055 JU 23 9 7 866 316 126 125 855 Suisse 5 342 4 713 4 468 501 8 731 2 283 2 766 594 Zone 1 Plaine 1 478 1 431 2 116 231 5 066 1 249 1 846 931 Collines 618 444 528 469 1 608 422 505 343 ZM I 803 570 427 337 909 257 184 435 ZM II 1 513 1 533 1 058 203 790 269 188 930 ZM III 692 539 248 120 284 70 33 583 ZM IV 238 196 90 142 74 16 7 373 1 Attribution de la surface selon la zone dans laquelle se situe la majeure partie de la SAU de l’exploitation Source: OFAG
Tableau 29c
Contributions pour la compensation écologique – 1999
A34 A N N E X E
Jachère florale Jachère tournante Exploitations Surface Total contributions Exploitations Surface Total contributions nombre ha fr nombre ha fr Canton ZH 217 105 314 340 37 38 95 175 BE 141 58 171 738 33 27 66 775 LU 47 18 53 430 96 15 025 UR 000000 SZ 000000 OW 000000 NW 000000 GL 13 7 800 000 ZG 76 17 250 000 FR 52 34 103 125 16 20 50 000 SO 18 5 15 000 69 22 550 BL 77 42 126 030 97 17 300 SH 88 28 85 159 12 13 33 225 AR 000000 AI 000000 SG 92 81 242 460 33 8 025 GR 10 2 7 320 13 11 28 650 AG 231 68 204 120 27 20 51 075 TG 73 35 104 370 17 12 30 050 TI 5 11 31 890 2 13 32 250 VD 120 117 349 710 72 80 200 375 VS 56 65 193 920 22 41 103 175 NE 12 12 36 420 79 23 525 GE 39 42 127 470 16 8 20 575 JU 23 14 42 990 69 23 225 Suisse 1 309 746 2 234 542 307 328 820 975 Zone 1 Plaine 1 108 661 1 980 982 266 294 735 300 Collines 192 80 240 930 40 33 82 850 ZM I 74 11 820 11 2 825 ZM II 20 810 000 ZM III 000000 ZM IV 000000 1 Attribution de la surface selon la zone dans laquelle se situe la majeure partie de la SAU de l’exploitation Source: OFAG
Tableau 29d
Contributions pour la compensation écologique – 1999
A N N E X E A35
Bandes culturales extensives Arbres frutiers haute-tige Exploitations Surface Total contributions Exploitations Arbres Total contributions nombre ha fr nombre nombre fr Canton ZH 27 6 5 960 2 814 168 890 2 533 322 BE 30 7 6 455 8 552 414 631 6 215 706 LU 11 2 2 350 4 442 297 154 4 457 310 UR 000 236 10 642 159 630 SZ 000 1 090 74 562 1 118 430 OW 000 508 26 675 400 125 NW 000 387 20 410 306 150 GL 000 148 6 522 97 830 ZG 10 460 555 51 085 766 277 FR 25 14 13 275 2 140 88 503 1 327 527 SO 61 1 120 1 200 106 716 1 600 740 BL 40 490 952 146 328 2 194 922 SH 19 3 3 240 386 21 375 320 608 AR 000 355 20 494 307 410 AI 000 77 4 439 66 585 SG 82 2 150 3 291 257 450 3 861 750 GR 31 540 565 30 020 450 300 AG 27 5 5 470 2 701 202 979 3 044 685 TG 16 3 3 170 2 422 255 871 3 837 802 TI 000 207 12 197 182 969 VD 44 10 9 930 2 259 120 600 1 809 000 VS 000 795 55 038 825 570 NE 30 420 175 9 556 143 340 GE 11 2 2 050 113 5 581 83 715 JU 10 2 1 710 678 55 516 832 740 Suisse 245 59 58 790 37 048 2 463 234 36 944 443 Zone 1 Plaine 210 53 52 710 18 233 1 272 781 19 087 631 Collines 32 6 5 940 7 384 585 455 8 781 826 ZM I 30 140 6 014 354 392 5 315 881 ZM II 000 4 075 189 510 2 842 651 ZM III 000 1 145 52 336 785 040 ZM IV 000 197 8 760 131 414
la zone
situe la majeure
de la SAU
l’exploitation
1 Attribution de la surface selon
dans laquelle se
partie
de
Source: OFAG
Tableau 30
Contributions pour la production extensive de céréales et de colza – 1999
A36 A N N E X E
Céréales panifiables Céréeales fourragères Colza Total Contributions Surface Exploitations Surface Exploitations Surface Contributions nombre ha nombre ha nombre ha fr Canton ZH 1 397 4 335 1 563 2 594 188 272 2 876 823 BE 3 900 8 538 5 993 10 838 322 468 8 008 080 LU 1 083 1 837 1 549 2 588 73 114 1 815 672 UR 0000000 SZ 32 26 36 00 15 412 OW 311100 792 NW 0000000 GL 007 10 00 4 112 ZG 36 64 111 179 79 100 960 FR 927 2 964 1 433 3 362 118 249 2 666 866 SO 674 2 217 898 2 219 119 200 1 874 960 BL 562 1 916 696 1 768 31 66 1 482 106 SH 361 2 142 245 604 62 108 1 123 616 AR 0000000 AI 0000000 SG 179 302 416 697 26 42 409 164 GR 180 438 370 546 6 10 397 705 AG 1 675 4 622 1 861 3 620 212 281 3 407 726 TG 937 2 391 826 1 118 112 195 1 479 450 TI 13 46 86 240 00 114 164 VD 1 041 5 884 1 789 5 709 555 1 236 5 125 176 VS 113 322 135 186 28 203 241 NE 194 874 523 2 217 32 77 1 266 445 GE 157 1 565 214 1 053 22 90 1 050 706 JU 317 1 614 626 2 535 54 143 1 712 478 Suisse 13 752 42 073 19 368 42 120 1 941 3 568 35 135 654 Zone 1 Plaine 9 121 32 020 10 728 23 371 1 578 2 924 23 233 210 Collines 3 293 7 673 4 657 9 645 311 546 7 130 989 ZM I 1 091 2 102 2 576 6 054 51 96 3 292 717 ZM II 175 228 1 123 2 766 12 1 197 102 ZM III 59 44 241 253 00 117 649 ZM IV 13 7 43 31 00 14 200 1 Attribution de la surface selon la zone dans laquelle se situe la majeure partie de la SAU de l’exploitation Source: OFAG
Tableau 31
Contributions pour la garde particulièrement respectueuse des animaux – 1999
A N N E X E A37
Systèmes de stabulation particulièrement Sorties régulières en plein air respectueux des animaux Exploitations UGB Total contributions Exploitations UGB Total contributions nombre nombre fr nombre nombre fr Canton ZH 765 16 305 1 387 493 1 458 31 609 4 274 178 BE 2 035 35 622 3 668 544 6 475 117 229 15 754 406 LU 1 670 34 837 3 445 123 2 664 59 466 7 963 127 UR 47 624 50 392 248 3 264 439 842 SZ 170 3 135 272 948 662 11 845 1 602 356 OW 101 1 503 153 912 311 5 410 733 345 NW 92 1 638 162 594 184 3 296 445 948 GL 38 656 56 723 230 4 680 632 784 ZG 141 2 745 239 766 307 7 161 960 571 FR 1 152 21 423 2 173 583 1 467 40 565 5 602 046 SO 308 5 519 481 603 581 12 411 1 674 845 BL 202 4 725 410 823 365 8 874 1 195 728 SH 135 3 710 346 814 144 3 379 455 144 AR 93 1 399 141 422 475 9 585 1 295 444 AI 83 1 505 191 950 312 5 840 797 498 SG 688 14 904 1 443 811 2 127 48 895 6 618 915 GR 408 7 586 562 488 1 938 35 296 4 758 708 AG 642 13 163 1 197 848 1 179 25 371 3 431 078 TG 631 17 038 1 531 397 1 188 28 946 3 899 293 TI 105 1 896 139 124 547 8 826 1 184 983 VD 790 18 374 1 590 777 1 165 28 690 3 891 658 VS 57 1 340 96 437 664 7 074 949 211 NE 174 4 649 362 859 475 12 671 1 686 717 GE 16 488 40 592 31 939 121 407 JU 362 10 650 852 864 598 17 342 2 319 732 Suisse 10 905 225 434 21 001 887 25 795 538 667 72 688 964 Zone 1 Plaine 5 783 136 336 12 728 695 9 457 229 258 30 823 208 Collines 2 065 39 485 3 834 869 3 854 84 336 11 452 389 ZM I 1 366 23 138 2 161 381 3 639 74 081 10 029 251 ZM II 1 040 17 183 1 575 065 4 514 85 491 11 532 803 ZM III 460 6 468 496 786 2 930 45 149 6 101 246 ZM IV 191 2 824 205 091 1 401 20 352 2 750 067 1 Attribution de la surface selon la zone dans laquelle se situe la majeure partie de la SAU de l’exploitation Source: OFAG
Tableau 32a
Contributions d'estivage – 1999
A38 A N N E X E
Canton Exploitations Vaches Vaches M/N1 1 Génisses, boeufs Veaux traites taureaux d'élevage de 1 à 3 ans de 1/2 à 1 an nombre nombre nombre nombre nombre ZH 10 0 62 593 50 BE 2 035 26 669 1 350 44 775 13 290 LU 286 1 324 438 8 438 740 UR 367 4 035 381 3 499 1 460 SZ 441 3 254 919 12 972 2 487 OW 269 4 448 282 5 432 1 583 NW 143 1 563 158 3 241 608 GL 127 3 634 281 3 732 1 408 ZG 5 20 12 164 6 FR 687 6 719 630 22 014 3 290 SO 69 538 3 523 260 BS 00000 BL 16 0 29 718 24 SH 100 152 0 AR 122 1 269 70 2 021 389 AI 148 1 705 73 2 365 531 SG 520 7 567 621 17 371 4 690 GR 1 046 16 191 7 241 30 278 13 828 AG 60 38 223 16 TG 100 116 0 TI 228 4 454 370 2 045 942 VD 705 11 983 1 585 23 128 5 231 VS 536 10 860 3 483 9 219 3 037 NE 265 1 218 588 6 466 717 GE 10000 JU 199 2 997 1 265 7 435 1 294 Total 8 233 110 448 19 876 209 920 55 881 1 Vaches mères et nourrices Source: OFAG
Tableau 32b
Contributions d'estivage – 1999
A N N E X E A39
Canton Chevaux de Chevaux Chèvres et Autres Autres Contributions plus de 3 ans jusqu'à 3 ans brebis laitières chèvres moutons nombre nombre nombre nombre nombre fr ZH 37 12 17 0 76 070 BE 685 696 3 584 1 960 26 396 14 646 526 LU 65 44 178 91 2 947 1 419 280 UR 14 3 608 681 15 387 1 926 839 SZ 106 68 743 401 8 455 2 731 934 OW 59 29 208 130 2 769 2 063 262 NW 140 8 98 1 989 879 770 GL 37 8 143 194 3 877 1 645 110 ZG 1060 25 240 FR 181 178 650 492 7 203 4 816 273 SO 42 27 91 124 498 204 BS 000000 BL 61 217 75 890 SH 00000 15 200 AR 8 15 202 63 623 741 AI 10 4 388 128 893 826 318 SG 76 40 555 929 16 151 4 673 896 GR 469 400 2 931 2 338 66 468 12 346 103 AG 0000 180 30 981 TG 00000 11 600 TI 109 135 5 091 2 053 13 350 2 144 398 VD 315 252 298 189 7 783 6 648 110 VS 162 78 282 2 753 55 547 5 528 731 NE 81 86 36 0 181 1 139 808 GE 0000 753 7 530 JU 839 465 56 59 1 010 2 770 094 Total 3 462 2 544 15 974 12 583 231 680 67 570 909 Source: OFAG
Tableau 33a
Paiements directs au niveau des exploitations 1: selon la zone et la classe de grandeur – 1999
1 Les résultats se basent sur les données du dépouillement centralisé de la FAT
2 Contributions d'estivage, contributions à la culture, anciennes contributions aux détenteurs de vaches, ancienne contribution à l'exploitation selon art 31a LAgr, anciennes contributions pour PI, contributions écologiques cantonales et privées
A40 A N N E X E
Zone de plaine ZPC Caractéristique Unité 10 – 20 20 – 30 30 – 50 10 – 20 20 – 30 30 – 50 ha SAU ha SAU ha SAU ha SAU ha SAU ha SAU Exploitations de référence nombre 810 438 141 295 144 43 Exploitations representées nombre 10 779 5 589 2 621 3 705 1 512 605 Surface agricole utile ha 15 38 24 05 35 54 15 00 23 86 35 61 Paiements directs selon l'ordonnance sur les paiements directs (OPD) Paiements directs généraux totaux fr 19 690 30 976 43 741 25 561 38 926 55 399 Contributions à la surface fr 18 137 28 329 39 706 17 761 28 324 40 767 Contributions pour herbivores fr 1 428 2 436 3 708 1 995 3 557 7 696 Contributions pour la garde d'animaux dans des conditions de production difficiles fr 45 87 167 3 790 3 903 4 016 Contributions pour des terrains en pente fr 80 124 160 2 015 3 142 2 920 Contributions écologiques totales fr 5 132 7 565 11 205 5 217 7 736 10 482 Compensation écologique fr 2 235 3 091 4 847 2 043 3 417 4 078 Production extensive fr 757 1 120 1 979 790 1 226 2 204 Agriculture biologique fr 282 348 410 242 126 0 Garde particulièrement respectueuse des animaux fr 1 858 3 006 3 969 2 142 2 967 4 200 Total paiements directs selon OPD fr 24 822 38 541 54 946 30 778 46 662 65 881 Rendement brut fr 177 174 255 698 325 840 159 238 232 983 266 072 Part des PD selon OPD dans le rendement brut % 14 0 15 1 16 9 19 3 20 0 24 8 Autres paiements directs 2 fr 1 309 2 167 4 365 1 616 2 838 5 153 Total paiements directs fr 26 131 40 708 59 311 32 394 49 500 71 034 Part des PD totaux dans le rendement brut % 14 7 15 9 18 2 20 3 21 2 26 7
Source:
FAT
Tableau 33b
Paiements directs au niveau des exploitations1 et la classe de grandeur – 1999
1 Les résultats se basent sur les données du dépouillement centralisé de la FAT
2 Contributions d'estivage, contributions à la culture, anciennes contributions aux détenteurs de vaches, ancienne contribution à l'exploitation selon art 31a LAgr, anciennes contributions pour PI, contributions écologiques cantonales et privées
A N N E X E A41
ZM I ZM II Caractéristique Unité 10 – 20 20 – 30 30 – 50 10 – 20 20 – 30 30 – 50 ha SAU ha SAU ha SAU ha SAU ha SAU ha SAU Exploitations de référence nombre 244 101 45 225 148 58 Exploitations representées nombre 3 342 1 085 657 3 283 1 487 791 Surface agricole utile ha 14 55 24 22 35 68 15 17 24 53 37 07 Paiements directs selon l'ordonnance sur les paiements directs (OPD) Paiements directs généraux totaux fr 30 494 43 370 57 733 37 464 50 183 62 307 Contributions à la surface fr 17 322 28 121 40 886 17 533 27 437 40 047 Contributions pour herbivores fr 3 420 4 564 6 439 5 751 7 796 8 365 Contributions pour la garde d'animaux dans des conditions de production difficiles fr 6 475 6 862 6 489 10 148 10 494 10 460 Contributions pour des terrains en pente fr 3 277 3 823 3 919 4 032 4 456 3 435 Contributions écologiques totales fr 4 054 6 386 9 347 3 232 4 838 6 260 Compensation écologique fr 1 529 2 104 2 208 1 101 1 564 1 616 Production extensive fr 244 533 1 903 36 87 515 Agriculture biologique fr 256 555 597 267 630 565 Garde particulièrement respectueuse des animaux fr 2 025 3 194 4 639 1 828 2 557 3 564 Total paiements directs selon OPD fr 34 548 49 756 67 080 40 696 55 021 68 567 Rendement brut fr 141 088 206 191 254 213 131 282 171 789 205 805 Part des PD selon OPD dans le rendement brut % 24 5 24 1 26 4 31 0 32 0 33 3 Autres paiements directs 2 fr 1 269 1 895 4 782 2 879 4 098 4 566 Total paiements directs fr 35 817 51 651 71 862 43 575 59 119 73 133 Part des PD totaux dans le rendement brut % 25 4 25 0 28 3 33 2 34 4 35 5
Source: FAT
Tableau 33c
Paiements directs au niveau des exploitations1: selon la zone et la classe de grandeur – 1999
1 Les résultats se basent sur les données du dépouillement centralisé de la FAT
2 Contributions d'estivage, contributions à la culture, anciennes contributions aux détenteurs de vaches, ancienne contribution à l'exploitation selon art 31a LAgr, anciennes contributions pour PI, contributions écologiques cantonales et privées
FAT
A42 A N N E X E
ZM III ZM IV Caractéristique Unité 10 – 20 20 – 30 30 – 50 10 – 20 20 – 30 30 – 50 ha SAU ha SAU ha SAU ha SAU ha SAU ha SAU Exploitations de référence nombre 130 73 20 72 33 18 Exploitations representées nombre 2 101 902 307 1 318 387 275 Surface agricole utile ha 14 94 24 18 36 48 14 43 24 61 33 95 Paiements directs selon l'ordonnance sur les paiements directs (OPD) Paiements directs généraux totaux fr 44 173 60 805 76 356 45 751 61 987 73 235 Contributions à la surface fr 16 868 27 651 40 185 16 489 27 429 38 956 Contributions pour herbivores fr 9 323 12 753 14 485 8 934 11 055 9 933 Contributions pour la garde d'animaux dans des conditions de production difficiles fr 13 185 14 138 14 364 15 637 17 359 16 889 Contributions pour des terrains en pente fr 4 797 6 263 7 322 4 691 6 144 7 457 Contributions écologiques totales fr 2 588 4 696 6 147 2 313 5 445 6 180 Compensation écologique fr 1 000 1 647 2 231 1 149 2 421 2 783 Production extensive fr 0 13 48 00 10 Agriculture biologique fr 289 756 1 110 245 1 052 1 354 Garde particulièrement respectueuse des animaux fr 1 299 2 280 2 758 919 1 972 2 033 Total paiements directs selon OPD fr 46 761 65 501 82 503 48 064 67 432 79 415 Rendement brut fr 107 904 154 976 187 496 98 997 142 687 170 203 Part des PD selon OPD dans le rendement brut % 43 3 42 3 44 0 48 6 47 3 46 7 Autres paiements directs 2 fr 4 386 5 693 6 563 4 363 6 529 6 715 Total paiements directs fr 51 147 71 194 89 066 52 427 73 961 86 130 Part des PD totaux dans le rendement brut % 47 4 45 9 47 5 53 0 51 8 50 6
Source:
Tableau 34
Paiements directs au niveau des exploitations1: selon la région – 1999
A N N E X E A43
Caractéristique Unité Toutes les Région Région Région exploitations de plaine des collines de montagne Exploitations de référence nombre 3 494 1 565 1 029 900 Exploitations representées nombre 54 906 25 499 14 967 14 440 Surface agricole utile ha 18 41 19 33 17 19 18 06 Paiements directs selon l'ordonnance sur les paiements directs (OPD) Paiements directs généraux totaux fr 31 176 24 114 30 851 43 982 Contributions à la surface fr 21 020 22 084 20 028 20 167 Contributions pour herbivores fr 3 759 1 823 3 211 7 744 Contributions pour la garde d'animaux dans des conditions de production difficiles fr 4 484 63 4 980 11 776 Contributions pour des terrains en pente fr 1 913 144 2 632 4 295 Contributions écologiques totales fr 5 272 6 338 5 244 3 420 Compensation écologique fr 2 145 2 781 1 961 1 211 Production extensive fr 657 984 677 60 Agriculture biologique fr 319 310 243 412 Garde particulièrement respectueuse des animaux fr 2 151 2 263 2 363 1 737 Total paiements directs selon OPD fr 36 448 30 452 36 095 47 402 Rendement brut fr 181 702 218 369 167 340 131 838 Part des PD selon OPD dans le rendement brut % 20 14 22 36 Paiements directs par ha fr /ha 1 980 1 575 2 100 2 625 Autres paiements directs2 fr 2 424 1 907 1 901 3 877 Total paiements directs fr 38 872 32 359 37 996 51 279 Part des PD totaux dans le rendement brut % 21 4 14 8 22 7 38 9 1 Les résultats se basent sur les
FAT 2 Contributions d'estivage, contributions
la culture, anciennes contributions aux détenteurs
selon art 31a LAgr, anciennes contributions pour PI, contributions écologiques cantonales
Source: FAT
données du dépouillement centralisé de la
à
de vaches, ancienne contribution à l'exploitation
et privées
Dépenses Amélioration des bases de production
Tableau 35
Montants versés aux cantons – 1999
A44 A N N E X E
Canton Améliorations foncières Constructions rurales Total contributions fr fr fr ZH 1 329 520 679 400 2 008 920 BE 8 945 659 2 574 000 11 519 659 LU 2 891 950 757 950 3 649 900 UR 575 130 1 125 640 1 700 770 SZ 1 583 499 1 219 000 2 802 499 OW 304 300 699 000 1 003 300 NW 158 500 446 995 605 495 GL 64 000 886 400 950 400 ZG 7 450 131 400 138 850 FR 3 302 260 2 321 600 5 623 860 SO 1 356 361 249 000 1 605 361 BL 325 672 423 989 749 661 SH 66 300 66 300 AR 439 418 968 850 1 408 268 AI 412 160 219 360 631 520 SG 2 950 429 2 569 000 5 519 429 GR 7 562 690 4 476 580 12 039 270 AG 638 050 567 700 1 205 750 TG 1 239 195 460 430 1 699 625 TI 1 601 607 930 502 2 532 109 VD 5 944 154 774 300 6 718 454 VS 3 032 989 2 484 000 5 516 989 NE 950 981 950 500 1 901 481 GE 251 820 251 820 JU 2 101 013 1 000 479 3 101 492 Divers 48 915 48 915 Total 48 017 722 26 982 375 75 000 097 Source: OFAG
Tableau 36
Contributions pour des projets approuvés, par mesure et par région – 1999
A N N E X E A45
Mesure Contributions Coût total Région Région Région Total Total de plaine des collines de montagne 1 000 fr Améliorations foncières Remaniements parc (infrastructure incl ) 13 080 4 625 13 109 30 814 90 895 Construction de chemins 71 1 879 8 650 10 600 34 420 Autres installations de transport 0 0 416 416 1 386 Mesures relatives au régime hydrique du sol 108 28 724 860 3 385 Adductions d'eau - 792 5 015 5 807 24 075 Racc au réseau électrique - 113 279 392 1 738 Remise en état et préservation 100 800 732 1 632 6 471 Documentation 4 0 6 10 46 Total 13 363 8 237 28 931 50 531 162 416 Constructions rurales Bâtiments d'exploitation pour UGBFG - 6 605 15 450 22 055 131 491 Fosse à purin et fumières - 336 665 1 001 3 698 Bâtiments alpestres 1 647 1 647 9 015 Bâtiments communs de transfert et stockage - 70 350 420 4 851 Total - 7 011 18 112 25 123 149 055 Total 13 363 15 248 47 043 75 654 311 471 Source: OFAG
Tableau 37
Crédits d'investissements approuvés par les cantons – 1999
A46 A N N E X E
Canton Mesures collectives Mesures individuelles Total Crédits de construction Crédits d'investissements Crédits d'investissements nombre 1 000 fr nombre 1 000 fr nombre 1 000 fr nombre 1 000 fr ZH 1 70 108 10 837 109 10 907 BE 34 6 345 12 1 450 438 38 683 484 46 478 LU 5 1 967 7 519 207 19 259 219 21 745 UR 2 147 19 1 465 21 1 612 SZ 12 1 160 1 66 57 5 648 70 6 874 OW 1 50 28 2 291 29 2 341 NW 20 1 336 20 1 336 GL 1 56 13 1 553 14 1 609 ZG 18 2 031 18 2 031 FR 8 714 170 15 743 178 16 457 SO 2 630 4 225 64 5 222 70 6 077 BL 2 84 51 4 466 53 4 550 SH 2 96 24 2 152 26 2 248 AR 2 100 40 2 438 42 2 538 AI 12 488 34 2 552 46 3 040 SG 2 430 4 115 182 14 106 188 14 651 GR 20 14 425 4 514 104 9 010 128 23 949 AG 5 688 140 13 048 145 13 736 TG 102 11 299 102 11 299 TI 4 780 5 824 20 2 518 29 4 122 VD 2 450 27 2 358 132 10 542 161 13 350 VS 22 5 797 17 2 156 83 6 363 122 14 316 NE 1 849 1 18 30 3 378 32 4 245 GE 1 50 4 316 5 366 JU 10 630 74 7 044 84 7 674 Total 104 32 833 129 11 418 2 162 193 300 2 395 237 551 Source: OFAG
Tableau 38
Crédits d'investissements ventilés selon les catégories de mesures – 1999 (sans les crédits de construction)
A N N E X E A47
Canton Aide Achat Maison Bâtiment Amélio- Transfert Achat Total initiale d'exploitation d'habi- d'exploitation rations et stockage commun par tation fonciens de produits cheptel fermier agricoles vif / mort 1 000 fr ZH 2 875 1 775 6 187 70 10 907 BE 12 848 926 4 923 20 334 145 957 40 133 LU 6 238 5 731 7 290 519 19 778 UR 225 260 980 147 1 612 SZ 1 225 160 2 019 2 310 5 714 OW 1 015 230 1 046 50 2 341 NW 675 290 371 1 336 GL 300 1 309 1 609 ZG 750 342 939 2 031 FR 5 080 245 1 905 8 553 168 466 40 16 457 SO 1 750 66 647 2 792 168 24 5 447 BL 1 500 297 448 2 222 60 24 4 551 SH 700 290 1 162 56 40 2 248 AR 880 498 1 060 100 2 538 AI 525 200 360 1 475 26 454 3 040 SG 3 365 274 2 785 7 701 36 30 30 14 221 GR 1 255 3 485 4 634 150 9 524 AG 5 155 1 962 5 931 616 72 13 736 TG 3 375 680 7 244 11 299 TI 100 693 1 925 240 350 34 3 342 VD 3 862 220 1 501 6 338 439 540 12 900 VS 825 1 904 4 520 986 184 99 8 518 NE 875 220 140 2 143 18 3 396 GE 250 66 50 366 JU 2 177 341 511 4 015 270 55 305 7 674 Total 57 525 2 949 33 679 102 547 2 755 4 029 1 234 204 718 Source: OFAG
Tableau 39
Prêts au titre de l'aide aux exploitations approuvés par les cantons – 1999 (parts de la Confédération et des cantons)
A48 A N N E X E
Canton Nombre Somme Par cas Durée d'amortisation 1 000 fr Fr Années ZH 14 1 140 81 429 16 1 BE 19 1 446 76 105 12 7 LU 26 2 428 93 385 17 5 UR 2 90 45 000 15 0 SZ OW 4 415 103 750 13 2 NW 2 140 70 000 14 0 GL ZG FR 10 865 86 500 10 5 SO 6 521 86 833 13 1 BL 5 242 48 400 1 0 SH 3 210 70 000 7 3 AR 6 225 37 500 7 8 AI SG 15 1 183 78 867 12 6 GR 2 110 55 000 17 5 AG 4 295 73 750 15 0 TG 4 269 67 250 10 5 TI 5 385 77 000 19 0 VD 16 2 202 137 625 13 0 VS 56 5 494 98 107 10 3 NE 1 137 137 000 12 0 GE JU 4 260 65 000 7 0 Total 204 18 057 Moyenne 88 515 12 4 Source: OFAG
Tableau 40
Dépenses pour l’élevage – 1999
1 Le total ne correspond pas aux chiffres individuels, car Pro Specie Rara gère plusieurs espèces animales
A N N E X E A49
Espèce Montant Eleveurs Animaux admis Organisations au herd-book d'élevage fr nombre Bovins 14 663 676 33 920 584 770 7 Gestion du herd-book 2 902 308 Contrôle laitier et de la performance carnée 11 017 279 Appréciation de la conformation 744 089 Chevaux 1 082 778 5 383 22 339 17 Porcs 1 664 081 1 000 18 200 2 Elevage d'animaux admis au herd-book 555 859 Centre des épreuves d'engraissement et d'abattage du porc de Sempach 1 108 222 Moutons 1 064 322 4 740 81 342 2 Chèvres et brebis laitières 749 008 2 000 24 021 4 Elevage d'animaux admis au herd-book 546 791 Contrôle laitier 202 217 Races menacées de disparition 69 000 433 1 Total 19 292 865 47 476 730 609 29 1
Source: Compte d'Etat
le Compte d Etat 1999 sert de base à la répartition des moyens financiers pour les différents domaines C'est ainsi que les dépenses pour la mise en valeur des pommes de terre et des fruits ou celles de l'Administration des blés de 1990/92 ont été englobées dans les dépenses de l OFAG, alors qu à l époque, les comptes étaient encore séparés Les chiffres de 1990/92 ainsi que de 1997 et 1998 ne coïncident donc pas avec les données du Compte d'Etat L augmentation des dépenses administratives, notamment après 1997, s explique par des dépenses pour des évaluations externes et des prestations à la caisse de pensions
Sources: Compte d Etat, OFAG
A50 A N N E X E
Domaine 1990/92 1997 1998 1999 1990/92–1997/99 % Dépenses OFAG 2 699 442 3 499 231 3 518 568 3 794 868 33 5 Production et écoulement 1 684 994 1 254 131 1 203 247 1 317 539 -25 3 Promotion des ventes 49 546 Economie laitière 1 127 273 982 680 966 885 1 052 228 -11 2 Economie animale 133 902 69 365 34 743 32 585 -66 0 Production végétale 423 819 202 086 201 619 183 180 -53 8 Paiements directs 772 258 2 070 005 2 125 689 2 285 600 179 8 Paiements directs généraux 758332 1 375 902 1 329 503 1 846 188 100 1 Paiements directs écologiques 13 926 694 103 796 186 439 412 4518 9 Amélioration des bases de production 208 761 138 824 147 153 148 467 -30 6 Améliorations structurelles 133 879 84 488 76 400 76 400 -40 9 Crédits d'investissement 27 136 4 900 20 000 20 000 -44 8 Aide aux exploitations 952 3073 2 000 4 987 252 2 Vulgarisation et contributions à la recherche 21 476 22 249 22 164 23 226 5 0 Lutte contre les maladies phytosanitaires et contre les parasites 1 449 1 718 5 639 3 354 146 4 Production végétale et élevage 23 869 22 396 20 950 20 500 -10 8 Administration 33 429 36 271 42 479 43 262 21 7 Autres dépenses 348 163 408 769 407 432 402 132 16 6 Contributions à l'exportation de produits agricoles de transformation 93 867 127 400 136 747 129 466 39 8 Allocations familiales dans l'agriculture 77 996 100 000 92 600 90 420 21 0 Stations de recherches agronomiques 96 431 100 896 97 060 99 472 2 8 Haras 6 843 6 774 8 825 5 525 2 9 Autres dépenses 73 026 73 699 72 199 77 249 1 9 Total agriculture et alimentation 3 047 605 3 908 000 3 926 000 4 197 000 31 6 Remarque:
Tableau 41 Dépenses de la Confédération pour l'agriculture et l'alimentation, en 1 000 de fr
■■■■■■■■■■■■■■■■ Tableaux Aspects internationaux
Sources: OFAG USP Eurostat U S Department of Agriculture
A N N E X E A51
Tableau 42
Produit Pays Unité 1990/92 1997 1998 1999 1990/92–1997/99 % Lait cru CH ct /kg 104 97 84 00 82 10 80 93 -22 UE-4 1 ct /kg 56 33 50 74 50 79 49 20 -11 - D ct /kg 55 40 48 92 50 62 48 08 -11 - F ct /kg 48 97 48 83 48 92 48 39 -1 - I ct /kg 69 20 61 12 56 48 54 58 -17 - A ct /kg 66 27 45 88 46 64 46 25 -30 USA ct /kg 40 57 42 81 49 25 47 60 15 Taureaux CH fr /kg PM 9 28 7 70 7 38 7 77 -18 UE-4 1 fr /kg PM 5 64 4 58 4 97 4 80 -15 - D fr /kg PM 5 38 4 39 4 46 4 27 -19 - F fr /kg PM 5 58 4 42 4 58 4 47 -20 - I fr /kg PM 5 86 4 92 5 13 5 06 -14 - A fr /kg PM 6 53 4 53 4 62 4 42 -31 USA fr /kg PM 3 40 3 04 2 86 3 14 -11 Porcs CH fr /kg PM 5 83 5 59 4 80 4 38 -15 UE-4 1 fr /kg PM 2 98 2 62 1 86 1 71 -31 - D fr /kg PM 2 77 2 64 1 72 1 61 -28 - F fr /kg PM 2 86 2 47 1 80 1 65 -31 - I fr /kg PM 3 50 2 88 2 42 2 15 -29 - A fr /kg PM 3 38 2 41 1 66 1 53 -45 USA fr /kg PM 1 81 2 03 1 27 1 30 -15 Poulets CH fr /kg PV 3 72 3 01 2 97 2 84 -21 UE-4 1 fr /kg PV 1 64 1 32 1 24 1 13 -25 - D fr /kg PV 1 41 1 29 1 19 1 08 -16 - F fr /kg PV 1 31 1 21 1 15 1 03 -14 - I fr /kg PV 1 91 1 56 1 44 1 36 -24 - A fr /kg PV 2 28 1 32 1 33 1 26 -43 USA fr /kg PV 0 98 1 19 1 27 1 21 25 Oeufs CH fr /100 pces 33 29 26 47 24 33 22 21 -27 UE-4 1 fr /100 pces 11 62 9 85 8 99 8 25 -22 - D fr /100 pces 13 58 11 04 9 89 8 83 -27 - F fr /100 pces 8 66 7 65 6 67 6 08 -21 - I fr /100 pces 12 94 12 08 11 75 11 08 -10 - A fr /100 pces 12 81 8 32 7 50 6 62 -42 USA fr /100 pces 7 55 8 43 7 93 7 53 5
Prix à la production des produits animaux Suisse - divers pays
1 UE-4 comprend les pays voisins Allemagne (D) France (F) Italie (I) et Autriche (A)
Prix à la production des produits végétaux Suisse - divers pays
A52 A N N E X E
Tableau 43a
Produit Pays Unité 1990/92 1997 1998 1999 1990/92–1997/99 % Blé CH fr /100 kg 99 34 75 58 75 65 75 41 -24 UE-4 1 fr /100 kg 30 00 20 35 18 26 17 34 -38 - D fr /100 kg 27 94 20 05 17 97 17 72 -34 - F fr /100 kg 28 54 20 15 17 97 16 65 -36 - I fr /100 kg 36 15 25 49 23 61 22 87 -34 - A fr /100 kg 43 38 18 13 17 05 16 95 -60 USA fr /100 kg 15 32 19 76 15 45 14 25 8 Orge CH fr /100 kg 70 24 51 94 50 13 48 83 -28 UE-4 1 fr /100 kg 26 81 18 69 16 91 16 48 -35 - D fr /100 kg 25 39 18 49 16 22 16 34 -33 - F fr /100 kg 25 83 18 37 17 06 15 89 -34 - I fr /100 kg 34 75 25 13 22 76 22 74 -32 - A fr /100 kg 36 27 17 37 16 10 15 73 -55 USA fr /100 kg 12 30 14 34 11 49 10 85 -1 Maïs-grain CH fr /100 kg 73 54 54 65 53 21 51 91 -28 UE-4 1 fr /100 kg 33 91 20 59 19 24 20 04 -41 - D fr /100 kg 31 13 20 36 20 13 18 45 -37 - F fr /100 kg 29 84 18 47 16 82 17 48 -41 - I fr /100 kg 41 09 24 88 23 38 24 95 -41 - A fr /100 kg 36 60 16 52 17 05 16 98 -54 USA fr /100 kg 12 76 14 84 12 56 11 16 1 Pommes de terre CH fr /100 kg 38 55 32 89 35 27 37 76 -8 UE-6 2 fr /100 kg 23 68 11 73 20 37 23 29 -22 - D fr /100 kg 22 70 10 29 16 59 20 80 -30 - F fr /100 kg 15 65 8 96 19 12 25 25 14 - I fr /100 kg 44 08 36 96 38 69 43 96 -10 - A fr /100 kg 30 46 12 83 17 00 16 85 -49 - NL fr /100 kg 16 47 11 14 23 77 26 27 24 - B fr /100 kg 12 63 7 20 18 09 17 06 12 USA fr /100 kg 18 08 16 60 18 06 19 47 0 Betteraves sucrières CH fr /100 kg 14 84 13 87 13 99 11 85 -11 UE-4 1 fr /100 kg 7 49 7 08 6 66 6 30 -11 - D fr /100 kg 8 06 7 58 7 02 6 81 -11 - F fr /100 kg 5 88 5 73 5 57 5 12 -7 - I fr /100 kg 9 65 9 31 8 28 7 91 -12 - A (depuis 92) fr /100 kg 8 87 7 91 7 59 7 47 -14 USA fr /100 kgColza CH fr /100 kg 203 67 161 84 147 89 146 11 -25 UE-4 1 fr /100 kg 49 10 33 43 34 26 24 78 -37 - D fr /100 kg 53 62 34 41 35 33 26 21 -40 - F fr /100 kg 42 19 32 69 33 36 23 62 -29 - I fr /100 kg 53 08 - - -- A (depuis 92) fr /100 kg 53 03 31 81 32 05 20 52 -47 USA fr /100 kgPommes: Golden Delicious CH fr /kg 1 13 0 85 0 60 1 06 -26 UE-4 1 fr /kg 0 85 0 56 0 51 0 53 -37 - D fr /kg 0 95 0 58 0 56 0 56 -40 - F fr /kg 0 76 0 57 0 50 0 57 -28 - I fr /kg 0 88 0 56 0 51 0 47 -42 - A (div ) fr /kg 1 07 0 49 0 40 0 45 -58 USA (div ) fr /kg 0 66 0 63 0 59 0 59 -9
1 UE-4 comprend les pays voisins Allemagne (D), France (F), Italie (I) et Autriche (A)
Sources: OFAG, USP, Eurostat, U S Department of Agriculture
2 UE-4 plus Pays-Bas (NL) et Belgique (B)
Tableau 43b
Prix à la production des produits végétaux Suisse - divers pays
A N N E X E A53
Produit Pays Unité 1990/92 1997 1998 1999 1990/92–1997/99 % Poires I CH fr /kg 1 3 1 52 0 78 1 09 -18 UE-4 1 fr /kg 1 05 0 84 0 75 0 74 -26 - D fr /kg 1 09 0 81 0 73 0 76 -30 - F fr /kg 1 17 0 99 1 11 0 95 -13 - I fr /kg 0 98 0 77 0 65 0 67 -29 - A (depuis 92) fr /kg 1 21 0 82 0 72 0 81 -35 USA fr /kg 0 57 0 68 0 54 0 64 7 Carottes CH fr /kg 1 09 1 20 1 18 1 05 5 UE-6 2 fr /kg 0 62 0 43 0 48 0 54 -23 - D fr /kg 0 48 0 40 0 46 0 49 -7 - F fr /kg 0 44 0 39 0 44 0 58 5 - I fr /kg 0 84 0 68 0 67 0 71 -18 - A fr /kg 0 41 0 32 0 25 0 33 -27 - NL fr /kg 0 39 0 30 0 41 0 47 1 - B fr /kg 0 36 0 24 0 27 0 14 -40 USA fr /kg 0 41 0 43 0 38 0 55 10 Oignons CH fr /kg 0 89 0 72 1 03 0 96 1 UE-5 (UE-6 sans NL) fr /kg 0 63 0 55 0 55 0 45 -18 - D fr /kg 0 33 0 25 0 29 0 20 -26 - F fr /kg 0 60 0 83 0 77 0 70 28 - I fr /kg 0 71 0 58 0 60 0 52 -20 - A (depuis 92) fr /kg 0 28 0 25 0 36 0 16 -7 - NL fr /kg - - - -- B fr /kg 0 21 0 27 0 49 0 25 57 USA fr /kg 0 40 0 38 0 50 0 45 12 Tomates CH fr /kg 2 42 2 12 1 89 1 92 -18 UE-6 2 fr /kg 1 10 0 89 0 89 0 82 -21 - D fr /kg 0 95 1 02 0 96 1 04 6 - F fr /kg 1 32 1 19 1 15 1 13 -12 - I fr /kg 0 91 0 76 0 79 0 74 -16 - A (depuis 92) fr /kg 1 08 0 76 0 77 0 80 -28 - NL fr /kg 1 26 1 67 1 34 1 15 10 - B fr /kg 1 23 1 20 1 17 1 08 -7 USA fr /kg 1 00 1 13 1 16 0 93 7 1 UE-4 comprend les
voisins Allemagne (D) France (F) Italie
2 UE-4 plus Pays-Bas (NL) et Belgique (B) Sources: OFAG USP Eurostat U S Department of Agriculture
pays
(I) et Autriche (A)
Tableau 44
Prix à la consommation des produits animaux Suisse - divers pays
1 UE-4 comprend les pays voisins Allemagne (D), France (F), Italie (I) et Autriche (A)
Rubrique «Pays» : (min ) et (max ) –> prix minimal et prix maximal observés durant une année dans un pays donné Si l’année n ’est pas mentionnée, le chiffre vaut pour tous les ans, sauf si un autre pays est indiqué avec l’année
Sources: OFAG, OFS, ZMP (D), services statistiques nationaux de F, B, A, USA, service statistique de la ville de Turin (I)
A54 A N N E X E
Produit Pays Unité 1990/92 1997 1998 1999 1990/92–1997/99 % Lait frais CH fr /l 1 85 1 66 1 66 1 58 -12 UE-4 1 fr /l 1 30 1 16 1 14 1 13 -12 - D / F-1997 (min) fr /l 1 07 0 95 0 96 0 93 -11 - I (max) fr /l 1 82 1 81 1 77 1 75 -2 USA fr /l 1 04 1 00 1 03 1 13 2 Fromage CH-Emmentaler fr /kg 20 15 20 79 20 65 20 66 3 UE-4 1 (avec B, sans F) fr /kg 15 98 13 71 13 15 13 55 -16 - D (min) fr /kg 13 52 11 56 10 88 11 30 -17 - B (max) fr /kg 17 63 17 81 17 69 17 51 0 USA (Cheddar) fr /kg 11 14 10 29 11 33 12 49 2 Beurre CH fr /kg 13 76 12 16 12 00 11 68 -13 UE-4 1 fr /kg 9 04 8 32 8 37 8 17 -8 - D (min) fr /kg 6 81 6 00 6 26 5 92 -11 - I (max) fr /kg 12 90 12 85 12 50 12 25 -3 USA fr /kg 5 96 6 93 9 14 8 79 39 Crème CH fr /1/4 l 3 58 3 07 3 07 2 95 -15 UE-3 (UE-4 avec B, sans F+I) fr /1/4 l 1 25 1 03 1 01 1 01 -19 - D (min) fr /1/4 l 1 13 0 94 0 93 0 93 -18 - B / A-90/92 (max) fr /1/4 l 2 53 1 76 1 66 1 67 -33 USA fr /1/4 l - - - -Rôti de boeuf CH fr /kg 26 34 23 42 23 52 24 09 -10 UE-4 1 fr /kg 16 00 15 24 15 10 15 14 -5 - F (min) fr /kg 11 85 11 97 11 80 11 92 0 - A (max) fr /kg 24 32 25 03 24 46 24 21 1 USA fr /kg 9 26 9 01 8 71 9 15 -3 Rôti de porc CH fr /kg 18 43 18 80 17 60 16 75 -4 UE-4 1 fr /kg 11 80 12 24 11 76 10 95 -1 - D / A-90/92 (min) fr /kg 10 00 11 11 10 56 9 79 5 - I (max) fr /kg 13 67 13 55 13 56 12 57 -3 USA fr /kg - - - -Côtelettes de porc CH fr /kg 19 88 20 25 17 91 18 26 -5 UE-4 1 fr /kg 10 62 10 51 9 89 9 07 -7 - D (min) fr /kg 9 71 9 91 9 17 8 30 -6 - I / A-99 (max) fr /kg 12 43 11 68 11 45 10 41 -10 USA fr /kg 10 02 11 13 10 30 10 51 6 Jambon CH fr /kg 25 56 27 32 27 23 26 18 5 UE-4 1 fr /kg - 21 18 20 82 19 94 -7 - F / D-90/92 (min) fr /kg 20 38 19 28 19 10 18 07 -8 - I (max) fr /kg 27 15 25 82 25 27 24 59 -7 USA fr /kg 8 85 8 91 8 99 9 49 3 Poulet frais CH fr /kg 8 41 8 12 8 42 8 43 -1 UE-4 1 fr /kg 5 72 5 35 5 19 4 93 -10 - F (min) fr /kg 4 84 4 29 3 91 3 82 -17 - I (max) fr /kg - 6 05 6 13 5 71 -3 USA fr /kg 2 74 3 20 3 33 3 50 22 Oeufs CH fr /pces 0 57 0 57 0 57 0 57 1 UE-4 1 (avec B, sans F) fr /pces 0 25 0 27 0 26 0 25 5 - B (min) fr /pces 0 22 0 22 0 21 0 20 -7 - A (max) fr /pces 0 33 0 36 0 36 0 35 7 USA fr /pces 0 10 0 12 0 13 0 13 22
Tableau 45
Prix à la consommation des produits végétaux
Suisse - divers pays
1 UE-4 comprend les pays voisins Allemagne (D), France (F), Italie (I) et Autriche (A) Rubrique «Pays» : (min ) et (max ) –> prix minimal et prix maximal observés durant une année dans un pays donné Si l’année n ’est pas mentionnée le chiffre vaut pour tous les ans sauf si un autre pays est indiqué avec l’année
Sources: OFAG OFS ZMP (D) services statistiques nationaux de F B A USA service statistique de la ville de Turin (I)
A N N E X E A55
Produit Pays Unité 1990/92 1997 1998 1999 1990/92–1997/99 % Farine fleur CH fr /kg 2 05 1 81 1 80 1 80 -12 UE-4 1 (avec B, sans F) fr /kg 1 10 0 96 0 99 0 94 -12 - B /D-90/92 (min) fr /kg 0 79 0 92 0 83 0 82 8 - A (max) fr /kg 1 67 1 03 1 01 1 02 -39 USA fr /kg 0 75 0 97 0 96 0 97 28 Pain blanc CH fr /1/2 kg 2 09 2 04 2 05 2 02 -2 UE-4 1 fr /1/2 kg 1 49 1 54 1 53 1 53 3 - D pain de seigle (min) fr /1/2 kg 1 16 1 05 1 03 1 06 -9 - A (max) fr /1/2 kg 2 98 2 97 2 86 2 85 -3 USA fr /1/2 kg 1 12 1 39 1 37 1 47 27 Pommes de terre CH fr /kg 1 43 1 65 1 66 1 77 18 UE-5 (UE-4 plus B) fr /kg 0 92 0 74 1 02 1 09 3 - B (min) fr /kg 0 56 0 61 0 72 0 84 30 - F / A-90/92+97 (max) fr /kg 1 27 1 12 1 52 1 57 10 USA fr /kg 1 04 1 14 1 20 1 31 17 Sucre CH fr /kg 1 65 1 52 1 52 1 50 -8 UE-3 (UE-4 avec B, sans F+I) fr /kg 1 75 1 73 1 61 1 57 -7 - B (min) fr /kg 1 67 1 57 1 51 1 50 -9 - A / I-97 (max) fr /kg 1 89 1 76 1 73 1 71 -8 USA fr /kg 1 22 1 34 1 32 1 38 10 Huile végétale CH - tournesol fr /l 5 05 4 30 4 44 4 46 -13 UE-4 1 (avec B / sans D) fr /l 2 11 2 28 2 40 2 48 13 - I-soja/tournesol (min) fr /l 1 94 2 05 2 18 2 26 12 - F-tournesol / A-90/92 huile comestible fr /l 2 70 2 41 2 57 2 64 -6 USA - huile à salade (kg) fr /l 2 71 2 78 3 25 3 46 17 Pommes: Golden Delicious CH fr /kg 3 19 3 17 3 10 2 98 -3 UE-4 1 (F/A: div variétés) fr /kg 3 10 2 36 2 48 2 49 -21 - I / A-90/92 (min) fr /kg 2 94 2 03 2 19 2 27 -26 - F ab 98 / D (max) fr /kg 3 25 2 51 2 73 2 70 -19 USA fr /kg 2 58 2 90 3 01 2 97 15 Poires CH fr /kg 3 41 3 27 3 42 3 27 -3 UE-4 1 fr /kg 3 43 2 58 2 89 2 66 -21 - I / D-90/92 (min) fr /kg 3 32 2 37 2 57 2 39 -26 - A / F-90/92 (max) fr /kg 3 62 2 91 3 29 2 95 -16 USA fr /kg 2 52 3 15 2 98 3 15 23 Bananes CH fr /kg 2 52 2 68 2 83 2 82 10 UE-4 1 fr /kg - 2 34 2 45 2 30 -9 - D (min) fr /kg 1 89 2 30 2 32 2 14 19 - A / I-90/92 (max) fr /kg 3 56 2 82 2 92 2 69 -21 USA fr /kg 1 45 1 56 1 58 1 63 9 Carottes CH fr /kg 1 91 1 92 1 87 1 78 -3 UE-5 (UE-4 plus B) fr /kg 1 71 1 38 1 43 1 53 -15 - B (min) fr /kg 1 06 1 04 1 12 1 23 7 - I / A-99 (max) fr /kg - 1 64 1 61 1 97 -25 USA fr /kg 1 35 1 64 1 79 1 86 31 Oignon de consommation CH fr /kg 1 86 1 85 2 14 2 05 8 UE-5 (UE-4 plus B) fr /kg 1 54 1 43 1 79 1 55 3 - B (min) fr /kg 0 92 1 02 1 27 1 05 20 - F / I-90/92 (max) fr /kg 1 75 - 2 42 2 07 28 USA fr /kg 1 29 1 54 - -Tomates CH fr /kg 3 73 3 24 3 24 3 18 -14 UE-5 (UE-4 plus B) fr /kg 3 60 2 68 3 07 2 96 -19 - D/A-98 / B-90/92 (min) fr /kg 3 35 2 63 2 95 2 58 -19 - I / B-97 / F-98 (max) fr /kg 4 41 2 81 3 37 3 37 -28 USA (en plein champ) fr /kg 3 29 4 13 4 71 4 54 36
Tableau 46
Valeur de la production, dépenses de consommation et part de l’agriculture, de 1988 à 1998
Tableau 47
Calories disponibles en 1995 et en 2020
A56 A N N E X E
Année Exportations Importations Valeur de la Dépenses de Part de Marge du marché production consommation l‘agriculture mio de fr mio de fr mio de fr mio de fr %% 1988 665 6 488 8 552 22 764 37 6 62 4 1989 739 6 844 8 632 23 204 37 2 62 8 1990 738 6 937 8 662 24 908 34 8 65 2 1991 716 7 310 8 634 26 152 33 0 67 0 1992 748 7 349 8 094 26 614 30 4 69 6 1993 726 7 326 8 141 26 493 30 7 69 3 1994 712 7 586 7 746 26 682 29 0 71 0 1995 726 7 282 7 387 27 815 26 6 73 4 1996 687 7 614 6 795 27 257 24 9 75 1 1997 723 8 018 6 597 27 021 24 4 75 6 1998 693 8 190 6 519 27 236 23 9 76 1 Source: Senti
Pays ou groupe de pays 1995 2020 Kcal/personne/jour Kcal/personne/jour Monde 2 717 2 918 Pays industrialisés 3 185 3 352 Pays en développement 2 579 2 821 Chine 2 752 3 139 Asie du Sud-Est 2 622 2 876 Asie du Sud 2 357 2 652 Asie occidentale et Afrique du Nord 3 081 3 177 Afrique subsaharienne 2 144 2 295 Amérique latine 2 789 3 026 Source: IFPRI IMPACT, simulations
Tableau 48
Taux de croissance mondiale de la population et de la production alimentaire (1970 à 1990 et pronostics pour 1990 à 2010)
A N N E X E A57
Pays ou groupe de pays Croissance de la Croissance de la Croissance de la production population production alimentaire 1 par personne 1 % par an % par an % par an Monde 1980 –1990 1 8 2 3 0 5 1990 –2010 1 6 1 8 0 2 Pays industrialisés 1970 –1990 0 8 1 4 0 6 1990 –2010 0 5 0 7 0 2 Pays en développement (Chine comprise) 1970 –1990 2 2 3 3 1 1 1990 –2010 1 8 2 6 0 8 Afrique subsaharienne 1970 –1990 3 0 1 9 - 1 1 1990 –2010 3 2 3 0 - 0 2 Proche Orient et Afrique du Nord 1970 –1990 2 8 3 1 0 3 1990 –2010 2 4 2 7 0 3 Amérique latine 1970 –1990 2 3 2 9 0 6 1990 –2010 1 7 2 3 0 6 Asie de l’Est 1970 –1990 1 7 4 1 2 4 1990 –2010 1 2 2 7 1 5 Asie du Sud 1970 –1990 2 4 3 1 0 7 1990 –2010 2 0 2 6 0 6 1 La perspective pour 2010 se réfère à la période 1988/90 Source: FAO
Textes légaux relevant du domaine de l‘agriculture
– Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr, RS 910 1)
– Loi fédérale du 20 mars 1959 sur l'approvisionnement du pays en blé (Loi sur le blé, RS 916 111 0)
Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR, RS 211 412 11)
– Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA, RS 221 213 2)
–
Loi fédérale du 8 octobre 1982 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP, RS 531)
Loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés (RS 632 111 72)
– Loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD, RS 632 10)
Loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales (RS 232 16)
– Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA, RS 836 1)
– Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (loi sur l'aménagement du territoire, LAT, RS 700)
Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (loi sur les denrées alimentaires, LDAI, RS 817 0)
– Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux, RS 814 20)
– Loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des animaux (LPA, RS 455)
Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN, RS 451)
– Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE, RS 814 01)
Ordonnances
Généralités
– Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation
(Ordonnance sur la terminologie agricole, Oterm, RS 910 91)
– Ordonnance du 7 décembre 1998 sur le relevé et le traitement de données agricoles (Ordonnance sur les données agricoles, RS 919 117 71)
Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'évaluation de la durabilité de l'agriculture (RS 919 118)
Production et ventes
– Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les interprofessions et les organisations de producteurs (RS 919 117 72)
– Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'aide à la promotion des ventes de produits agricoles
(Ordonnance sur la promotion des ventes de produits agricoles, RS 916 010)
– Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles et des produits agricoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP, RS 910 12)
Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits végétaux et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique, RS 910 18)
Ordonnance du 3 novembre 1999 relative à la déclaration de produits agricoles issus de modes de production interdits en Suisse (Ordonnance agricole sur la déclaration; OagrD, RS 916 51)
Ordonnance générale du 7 décembre 1998 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIA, RS 916 01)
Ordonnance du 7 décembre 1998 concernant le contingentement de la production laitière (Ordonnance sur le contingentement laitier, OCL, RS 916 350 1)
Ordonnance du 7 décembre 1998 concernant le prix-cible, les suppléments et les aides dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL, RS 916 350 2)
Ordonnance du DFE du 7 décembre 1998 concernant le montant des aides pour les produits laitieres et les dispositions relatives au secteur beurrier et à la poudre de lait entier (RS 916 350 21)
A58 A N N E X E ■■■■■■■■■■■■■■■■
Lois
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Ordonnance du 7 décembre 1999 concernant la réorganisation du marché laitier
(Ordonnance de transition dans le domaine du lait, RS 916 350 3)
Ordonnance du 7 décembre 1998 concernant l'assurance et le contrôle de la qualité dans l'économie laitière (Ordonnance sur la qualité du lait, OQL, RS 916.351.0)
Ordonnance du 13 avril 1999 reltive à l'assurance de la qualité dans l'exploitation de production laitière (RS 916 351 021 1)
Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'importation de lait et de produits laitiers, d'huiles et de graisses comestibles, ainsi que de caséines et de caséinates (Ordonnance sur l'importation de lait et d'huiles comestibles, OILHGC, RS 916 355 1)
Ordonnance de l'OFAG du 30 mars 1999 concernant l'importation de beurre (RS 916 357 1)
Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'importation d'animaux de l'espèce chevaline
(Ordonnance sur l'importation de chevaux, OIC, RS 916 322 1)
Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB, RS 916 341)
Ordonnance du DFE du 7 décembre 1998 sur la volaille (RS 916 341 61)
Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les effectifs maximums dans la production de viande et d'oeufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM, RS 916.344)
Ordonnance du 7 juillet 1971 concernant la mise en valeur de la laine de mouton du pays (RS 916 361)
Ordonnance du 7 décembre 1998 sur le marché des oeufs (Ordonnance sur les oeufs, OO, RS 916 371)
Ordonnance du DFE du 18 juin 1996 sur les oeufs (RS 916 371 1)
Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les contributions à la surface et à la transformation dans la culture des champs (Ordonnance sur les contributions à la culture des champs OCCC, RS 910 17)
Ordonnance générale du 16 juin 1986 concernant la loi sur le blé (RS 916 111 01) –
Ordonnance du DFEP du 16 juin 1986 sur l'approvisionnement du pays en blé (RS 916 111 011) –
Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la fixation de droits de douane et sur l'importation de semences de céréales, de matières fourragères, de paille et de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux (Ordonnance sur l'importation de semences de céréales et de matières fourragères, RS 916 112 211)
– Ordonnance du 7 décembre 1998 concernant la mise en valeur ainsi que l'importation et l'exportation de pommes de terre (Ordonnance sur les pommes de terre, RS 916 113 11)
– Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la culture et la transformation des betteraves sucrières (Ordonnance sur le sucre, RS 916 114 11)
Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'importation et l'exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP, RS 916.121.10)
Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les mesures d'allégement du marché des fruits à noyau et sur la mise en valeur des fruits à pépins (Ordonnance sur les fruits, RS 916 131 11)
– Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnace sur le vin, RS 916 140)
Ordonnance de l'OFAG du 7 décembre 1998 sur l'assortiment des cépages et l'examen des variétés (RS 916 143 5)
Paiements directs
Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD, RS 910 13)
Ordonnance du DFE du 7 décembre 1998 sur les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux (Ordonnance SST, RS 910 132 4)
– Ordonnance du DFE du 7 décembre 1998 sur les sorties régulières en plein air d'animaux de rente (Ordonnance SRPA, RS 910 132 5)
– Ordonnance du 29 mars 2000 sur les contributions d'estivage (Ocest, RS 910 133)
A N N E X E A59 –
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Amélioration des bases de production
– Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture
(Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS, RS 913 1)
– Ordonnance de l'OFAG du 7 décembre 1998 sur l'échelonnement des taux forfaitaires de l'aide à l'investissement (OFOR, RS 913 211)
–
Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'aide aux exploitations accordée au titre de mesure d'accompagnement social (Ordonnance sur l'aide aux exploitations OAEx, RS 914 11)
Ordonnance du 8 novembre 1995 sur la recherche agronomique (ORA, RS 426 10)
– Ordonnance du 13 décembre 1993 sur la formation professionnelle agricole (OFPA, RS 915 1)
–
Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'élevage (RS 916 310)
Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la production et la mise en circulation du matériel végétal de multiplication (Ordonnance sur les semences, RS 916 151)
Ordonnance du DFE du 7 décembre 1998 sur les semences et les plants des espèces de grandes cultures et de plantes fourragères (Ordonnance du DFE sur les semences et plants, RS 916 151 1)
Ordonnance du DFE du 11 juin 1999 sur la production et la mise en circulation du matériel de multiplication et des plants d'espèces fruitières et de vigne certifiés (RS 916 151 2)
Ordonnance de l'OFAG du 7 décembre 1998 sur le catalogue des variétés de céréales, de pommes de terre, de plantes fourragères et de chanvre (Ordonnance sur le catalogue des variétés, RS 916 151 6)
Ordonnance du 23 juin 1999 sur l'homologation de produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, RS 916 161)
Ordonnance du 26 janvier 1994 sur la mise dans le commerce des engrais et des produits assimilés aux engrais (O sur les engrais, RS 916 171)
– Ordonnance du 5 mars 1962 sur la protection des végétaux (RS 916.20)
Ordonnance du DFE du 25 janvier 1982 sur la déclaration obliga toire des ravageurs et des maladies présentant un danger général (RS 916 201)
Ordonnance du 28 avril 1982 sur la lutte contre le pou de San José, le feu bactérien et les viroses des arbres fruitiers présentant un danger général (RS 916 22)
Ordonnance du 26 mai 1999 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, RS 916 307)
Ordonnance du DFE du 10 juin 1999 sur la production et la mise dans le commerce des aliments pour animaux, des additifs destinés à l'alimentation animale, des agents d'ensilage et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLAA, RS 916 307 1) – Ordonnance de l'Office fédéral de l'agriculture du 16 juin 1999 sur la liste des aliments OGM pour animaux (RS 916 307 11)
Les textes légaux peuvent être consultés ou obtenus de la manière suivante:
Accès par Internet www admin ch/ch/d/sr/sr html
Commande à l‘OCFIM
par Internet www admin ch/edmz
– par fax 031 325 50 58
A60 A N N E X E
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
■■■■■■■■■■■■■■■■ Procédés et méthodes
Définitions
Biens publics: les biens publics se distinguent par deux caractéristiques: non rivalité et non exclusion Non rivalité dans la consommation signifie qu ’ on ne porte pas préjudice aux autres dans la consommation Non exclusion signifie que personne ne peut être empêché d’avoir part aux biens publics Sont des biens publics notamment la défense nationale, la forêt, un paysage naturel N’ayant pas de marché, les biens publics n ’ont pas non plus de valeur marchande C’est pourquoi, il appartient à l’Etat ou à ses mandataires de faire en sorte que les biens publics soient à la disposition de la collectivité
Dispersion: variabilité (valeur statistique): dispersion des observations ou des valeurs au-tour de la moyenne
Effets externes: effets secondaires positif ou négatifs sur des tiers ou la société dans son ensemble, qui sont le résultat de procédés utilisés par certains acteurs dans la production ou la consommation. Ils ne sont pas enregistrés directement par le marché ou les prix qui y sont pratiqués; c ’est pourquoi, ils mènent à des distorsions du marché et à un mauvais placement des biens et des facteurs de production Une politique économique rationnelle vise à interna-liser les effets externes
Exemples d’effets externes:
Production
Consommation
Effets externes négatifs (coûts sociaux) atteinte portée à l’eau potable, à la nappe consommation excessive d’al-cool et de tabac: phréatique et à l’eau de surface par augmentation des coûts de la santé une fumure inappropriée
Effets externes positifs (utilité sociale) préservation et entretien du paysage sport de masse pratiqué sous forme de loisirs: rural par les agriculteurs réduction des coûts de la santé
Equivalent de lait: correspond à la teneur moyenne d’un kg de lait cru en matière grasse et protéines (73 g); il sert de critère au calcul de la quantité de lait nécessaire à la fabrication d’un produit laitier
Evaluation: synonyme de contrôle des résultats L’évaluation est une méthode destinée à calculer et à évaluer l’effectivité (réalisation des objectifs), l’efficacité (rapports de causes à effets) et l’efficience (rentabilité) des mesures et des instruments. Les objectifs définis à l’avance sont essentiels pour une évaluation Les évaluations servent en premier lieu à des comparaisons: comparaison des groupes de contrôle, comparaison de la situation d’avant/d’après, comparaison intrasectorielle
Marge du marché: différence entre le prix à la consommation et le prix à la production (valeur absolue), ou pourcentage des dépenses du consommateur qui revient aux échelons «transformation» et «commerce» (valeur relative) Médiane: (valeur statistique): valeur telle (dans un ensemble de valeurs) que le nombre des observations qui lui sont inférieures est égale au nombre des observations qui lui sont supérieures (p ex série de mesures)
Moyenne: moyenne arithmétique (valeur statistique): somme des valeurs d’une série divisée par le nombre de ces valeurs
Multifonctionnalité: ce concept définit les multiples fonctions remplies par l’agriculture. Il comprend des prestations qui vont au-delà de la production agricole proprement dite En font partie l’approvisionnement du pays en denrées alimentaires, l’entretien du paysage rural, la préservation des bases de production et de la diversité biologique; s ’ y ajoute une contribution à la viabilité économique et sociale de l’espace rural Une agriculture multifonctionnelle contribue de manière essentielle au développement durable Toutes ces tâches figurent dans la Constitution fédérale (art 104)
A N N E X E A61
Prix-cible: valeur de référence fixée par le Conseil fédéral pour un kg de lait commercialisé contenant en tout 73 g de matière grasse et de protéines Ce prix doit pouvoir être atteint lorsque le lait est transformé en produits à forte valeur ajoutée et commercialisé dans de bonnes conditions Il dépend en grande partie de l’appréciation de la situation régnant sur le marché et des moyens à même de soutenir celui-ci. Le supplément de non-ensilage n ’est pas pris en considération.
Quartile: quart (valeur statistique): répartition d’une série d’observations ordonnées par valeurs croissantes en quatre groupes successifs comprenant chacun un même nombre d’observations
Ressources abiotiques: propriétés chimiques et physiques d’un espace, telles que facteurs climatiques (lumière, température, etc ), propriétés du sol, conditions hydrologiques, relief
Ressources biotiques: propriétés d’un espace lié aux plantes et animaux qui y vivent Suivi: observation continue à l’aide d’indicateurs durant une certaine période, sans analyse des relations de cause à effet axées sur des problèmes spécifiques Résultat recherché: in-dication d’une évolution possible Exemples: évolution de la surface agricole utile, populations d’oiseaux, etc.
Trafic de perfectionnement: sont concernées les marchandises qui, importées temporai-rement en Suisse à des fins de transformation ou de remise en état, donnent droit, à certaines conditions, à une réduction des droits de douane ou à leur exemption En ce qui concerne les produits agricoles (de base ou non), ils bénéficieront du trafic de perfectionnement si des marchandises suisses équivalentes ne sont pas disponibles en quantité suffisante ou si les prix des matières premières, trop élevés pour notre industrie alimentaire, ne peuvent être compensés par d’autres mesures appropriées
D’autres termes se trouvent dans:
– «Betriebswirtschaftliche Begriffe im Agrarbereich»
(pour les commandes: Landwirtschaftliche Lehrmittelzentrale, Länggasse 79, 3052 Zollikofen)
Ordonnance sur la terminologie agricole (RS 910 91)
Méthodes
Nouvelle typologie des exploitations FAT 99
Dans le cadre des modifications méthodiques proposées par la FAT, l’ancienne typologie des exploitations, fondée sur les travaux de la «Commission verte» (1966), a été remplacée par une nouvelle typologie (FAT 99) Celle-ci sert à la présentation des résultats, à la sélection des exploitations ainsi qu’à la pondération de leurs données
La répartition des exploitations selon la nouvelle typologie se fait exclusivement sur la base des critères «surfaces» et UGB» concernant les différentes catégories animales Dix chiffres-clés et huit quotients par exploitation garantissent une répartition différenciée et claire
A62 A N N E X E
–
Définition de la nouvelle typologie des exploitations FAT99
Les exploitations doivent satisfaire à tous les critères prévus dans une ligne Abréviations:
UGB unités de gros bétail
SAU surface agricole utile en ha
UGB/SAU charge en bétail par ha de SAU
TO/SAU pourcentage de terres ouvertes par rapport à la SAU
CS/SAU pourcentage de cultures spéciales par rapport à la SAU
UGBB/UGB pourcentage d UGB bovines par rapport au cheptel total
VL/UGBB pourcentage de vaches laitières par rapport à l’effectif de bovins
VA/UGBB pourcentage de vaches allaitantes par rapport à l effectif de bovins
ChMC/UGB pourcentage de chevaux de moutons et de chèvres par rapport au cheptel total
PVol/UGB pourcentage de porcs et de volaille par rapport au cheptel total
On distingue sept types d’exploitation spécialisés et quatre types d’exploitation combinés Les exploitations spécialisées dans la production végétale (11 et 12) ont une charge en bétail qui est inférieure à une UGB par ha de SAU Dans les exploitations vouées à la culture des champs, le pourcentage de terres ouvertes dépasse 70% de la SAU; dans celles consacrées aux cultures spéciales, le pourcentage de ces cultures dépasse 10% Les exploitations spécialisées dans la production animale (21–41) voient leur surface en terres ouvertes et en cultures spéciales limitée à respectivement 25% et 10% Pour ce qui est des exploitations spécialisées dans la production de lait commercialisé, plus de 25% de leur effectif de bovins sont des vaches laitières; les exploitations spécialisées dans la garde de vaches allaitantes répondent au critère analogue Dans le groupe «autres», on trouve avant tout des exploitations élevant des vaches laitières sans disposer de contingent (exploitations de montagne spécialisées dans l’engraissement de veaux et l’élevage) Quant aux exploitations vouées au perfectionnement, plus de 50% de leur effectif sont des porcs et de la volaille (exprimés en UGB) Enfin, celles qu ’ on ne peut attribuer à aucun des sept types spécialisés sont considérées comme des exploitations combinées (51–54)
A N N E X E A63
Domaines Type d'exploitation UGB/ TO/ CS/ UGBB/ VL/ VA/ ChMC/ PVol/ Autres SAU SAU SAU UGB UGBB UGBB UGB UGB conditions 11 Production grandes cultures max plus de max végétale 1 70% 10% 12 cultures spéciales max plus de 1 10% 21 Production lait commercialisé max max plus de plus de max animale 25% 10% 75% 25% 25% 22 vaches allaitantes max max plus de max plus de 25% 10% 75% 25% 25% 23 autres bovins max max plus de pas 21 25% 10% 75% oder 22 31 chevaux/moutons/ max max plus de chèvres 25% 10% 50% 41 perfectionnement max max plus de 25% 10% 50% 51 Domaines lait commercialisé/ plus de plus de plus de max pas combinés grandes cultures 40% 75% 25% 25% 11– 41 52 vaches allaitantes plus de max plus de pas 75% 25% 25% 11– 41 53 perfectionnement plus de pas 25% 11– 41 54 autres pas 11– 53
Abréviations
Organisation/institution
DFE Département fédéral de l’économie, Berne
DGD Direction générale des douanes, Berne
EPFZ Ecole polytechnique fédérale, Zurich
FAL Station fédérale de recherches en écologie et agriculture, Zurich-Reckenholz
FAM Station fédérale de recherches laitières, Liebefeld-Berne
FAO Food and Agriculture Organisation of the United Nations, Rome
FAT Station fédérale de recherches en économie et technologie agricoles, Tänikon
FAW Station fédérale de recherches en arboriculture, viticulture et horticulture, Wädenswil
IER Institut d’économie rurale, Zurich
IRAB Institut de recherche en agriculture biologique, Frick
LBL Landwirtschaftliche Beratungszentrale, Lindau (Centrale de vulgarisation agricole de Lindau)
OCDE Organisation for Economic Cooperation and Development, Paris
OFAE Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays, Berne
OFAG Office fédéral de l’agriculture, Berne
OFAS Office fédéral des assurances sociales, Berne
OFEFP Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage, Berne
OFS Office fédéral de la statistique, Neuchâtel
OFSP Office fédéral de la santé publique, Berne
OMC Organisation mondiale du commerce, Genève
OVF Office vétérinaire fédéral, Berne
PSL Union centrale des producteurs suisses de lait, Berne
RAC Station fédérale de recherches en production végétale, Changins
RAP Station fédérale de recherches en production animale, Posieux
seco Secrétariat d'Etat à l'économie, Berne
SRVA Service romand de vulgarisation agricole, Lausanne
TSM Fiduciaire de l'économie laitière, Berne
UE Union européenne
USP Union suisse des paysans, Brougg
ZMP Zentrale Markt- und Preisberichtstelle für Erzeugnisse der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft, Bonn
Unités de mesure
ct centime
dt décitonne = 100 kg
fr franc
ha hectare = 10'000 m2
hl hectolitre
kcal kilocalorie
kg kilogramme
km kilomètre
l litre
m mètre
m2 mètre carré
mio. million
A64 A N N E X E
■■■■■■■■■■■■■■■■
mrd milliard
pce pièce t tonne
% pour cent
Ø moyenne
Notion/désignation
AGP appellation géographique protégée
AOC appellation d’origine contrôlée
AVS assurance-vieillesse et survivants
CO2 dioxyde de carbone
ESB encéphalopathie spongiforme bovine («maladie de la vache folle»)
IV assurance-invalidité
LAgr loi sur l’agriculture
MPR matières premières renouvelables
N azote
OGM organismes génétiquement modifiés
P phosphore
PV poids vif
PAC politique agricole commune de l’UE
PER prestations écologiques requises
PI production intégrée
PM poids à l’abattage
PTP produit de traitement des plantes
SAU surface agricole utile
SCE surface de compensation écologique
SIPA Système d’Information de Politique Agricole
SRPA sorties régulières en plein air
SST système de stabulation particulièrement respectueux des animaux
TC taux du contingent
THC taux hors contingent
TVA taxe sur la valeur ajoutée
UGB unité de gros bétail
UGBFG unités de gros bétail fourrages grossiers
UMOS unité de main-d’oeuvre standard
UTA unité de travail annuel
UTAF unité de travail annuel de la famille
ZM I, II, zone de montagne I, II,
Référence à d’autres informations en annexe (p ex tableaux)
A N N E X E A65
Basler E. und Partner, 1999.
Jahresbericht BLW: Indikatoren Ökologie
Rapport final Projet sur mandat de l’OFAG, Zollikon
Bigler F , Jeanneret Ph , Lips A , Schüpbach B , Waldburger M , Fried P M , 1998
Wirkungskontrolle der Ökomassnahmen: Biologische Vielfalt.
Agrarforschung, 5 (8) 379-382
Broggi, M , Schlegel, H , 1989
Mindestbedarf an naturnahen Flächen in der Kulturlandschaft
Programme de recherche du Fonds national « Utilisation du sol en Suisse », Berne
Conseil fédéral suisse, 1992
Septième rapport sur l’agriculture, Berne
Conseil fédéral suisse, 1996
Message concernant la réforme de la politique agricole. Deuxième étape (Politique agricole 2002), Berne
Conseil fédéral suisse, 1998.
Message concernant un arrêté fédéral sur les moyens financiers destinés à l'agriculture pour les années 2000 à 2003, Berne
De Rosa R , 1999
La réorientation de la politique agricole suisse: analyse financière et endettement. Projet de recherche sur mandat de l’OFAG, Fribourg
Fluder R., Stremlow J. , 1999.
Armut und Bedürftigkeit in der Schweiz Herausforderung für das kommunale Sozialwesen Hauptverlag Bern
Galand, P , Gonseth, Y , 1991
Typologie des milieux de Suisse.
Ligue Suisse pour la protection de la nature, Centre suisse de cartographie de faune
Institut für Agrarwirtschaft (IAW), 1999
Auswirkungen der Agrarreform auf das N-Verlustpotenzial in der Landwirtschaft
Schlussbericht des IAW-ETH Zürich
Institut für Agrarwirtschaft (IAW), 2000
Evaluation der Milchkontingentierung.
Rapport final d’une étude préliminaire, projet de recherche sur mandat de l’OFAG, Zurich
Joost M , 1999
Landwirtschaft und Existenzgefährdung
Mit einer Befragung von Sozialhilfebehörden des Kantons Baselland Diplomarbeit an der Höheren Fachschule für Soziale Arbeit Basel, Basel.
A66 A N N E X E ■■■■■■■■■■■■■■■■
Bibliographie
OCDE, 2000
Indicateurs environnementaux pour l’agriculture
Méthodes et résultats
le rapport d’évaluation, Paris
Office fédéral de l’agriculture (OFAG), 2000
Evaluation des mesures écologiques. 3e rapport intermédiaire, Berne
Office fédéral de l’agriculture (OFAG), 2000
Sécurité sociale et services sociaux dans l’agriculture
Rapport du groupe de travail « Social » de l’OFAG, Berne
Office fédéral de la statistique, diverses années
Reflets de l'agriculture suisse, Neuchâtel
Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP), 1995
Emissions polluantes dues à l’activité humaine en Suisse de 1900 à 2010.
Cahier de l'environnement no 256
Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP), 1996
Stratégie de réduction des émissions d'azote
Cahier de l'environnement no 273
Pfister, H P , Naef-Daenzer, B , Blum, B , 1986
Qualitative und quantitative Beziehungen zwischen Heckenvorkommen im Kanton Thurgau und ausgewählten Heckenbrütern
Neuntöter, Goldammer, Dorngrasmücke, Mönschsgrasmücke und Gartengrasmücke; in Orn Beob 83, Heft 1, 7-34, Winterthur
Pillet G , Maradan D , Zingg N , 2000
Appréciation quantitative des externalites de l’agriculture suisse
Projet de recherche sur mandat de l’OFAG, Genève.
Rossier D , 2000
Evaluation simplifiée de l’impact environnemental potentiel de l’agriculture suisse
Rapport sur mandat de l’OFAG, FAL, SRVA, FAT, LBL, FiBL
Senti R , König M , 2000
Der Anteil des landwirtschaftlichen Produktionswerts an den Verbrauchsausgaben für Nahrungsmittel in derSchweiz
Projet de recherche sur mandat de l’OFAG, Zurich
Sorgentelefon für Bäuerinnen, Bauern und deren Angehörigen, 2000 Jahresbericht 1999, Morschach.
Station fédérale de recherches en écologie et agriculture, 1999
Bilan des éléments nutritifs dans l’agriculture suisse pour les années 1975 à 1995
Cahiers de la FAL 28, Spiess E , Zurich
Union suisse des paysans (USP), diverses années
Comptes économiques de l'agriculture suisse, Brougg
A N N E X E A67
–
Union suisse des paysans (USP), diverses années Statistiques et évaluation sur l'agriculture et l'alimentation, Brougg
Wendt H., 1998.
Anteile der landwirtschaftlichen Erzeugererlöse an den Verbrauchsausgaben für Nahrungsmittel in Deutschland
Aktualisiertes Konzept und Ergebnisse in: Agrarwirtschaft, 47 Jahrgang, Heft 8/9, S 361 – 367
Wicki W , Pfister-Sieber M , 2000
Wissen, Einstellung und Handlungsstrategien von Schweizer Bauern und Bäuerinnen in Zusammenhang mit Einkommenseinbussen und finanzieller Knappheit
Forschungsbericht Nr F-00-3 Hochschule für Sozialarbeit, Bern
A68 A N N E X E



























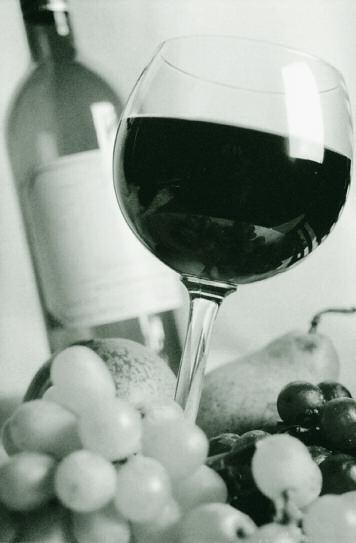













































































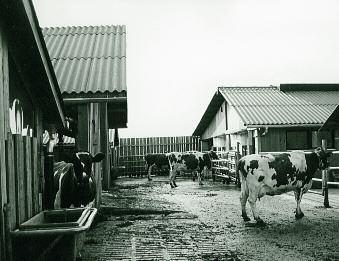






















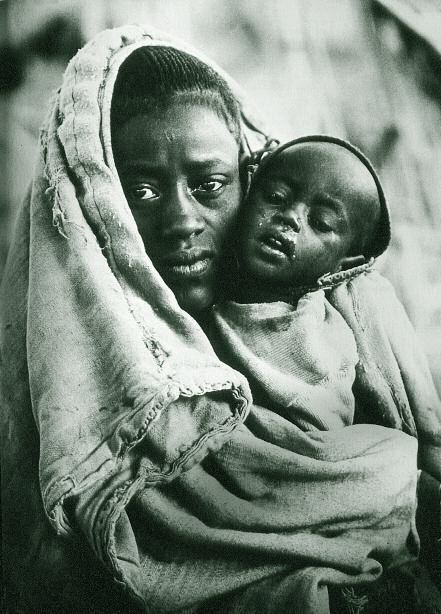




 ■ Prix à la consommation
■ Prix à la consommation
