

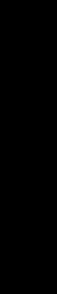
PROJETS ALTERNATIFS De la Mutation du Rapport de Gouvernance Architecte-Usagers à une Architecture Ethique et Soutenable Sous la direction de Pascale Marion et de Florence Lafourcade Décembre 2022
Mémoire de Master Marion Wurtz
LES
Source : Yona Friedman
LES PROJETS ALTERNATIFS : MUTATION DU RAPPORT DE GOUVERNANCE ARCHITECTE-USAGERS VERS UNE ARCHITECTURE ETHIQUE ET SOUTENABLE
Sous la direction de Pascale Marion et de Florence Lafourcade
École Nationale Supérieure d’Architecture de Strasbourg Master - Formation professionnelle continue n°10 Marion Wurtz
Mots clés : Projets alternatifs, Ecolieu, Tiers-lieu, Habitat Participatif, Gouvernance, Rapport Architecte-Usagers, Ethique, Soutenable, Participation, Autoplanification
2022

Source : Yona Friedman
Tout d’abord, je souhaite adresser mes remerciements à tous mes interlocuteurs des projets alternatifs m’ayant accordé leur temps et leur confiance. L’essence des valeurs qu’ils transmettent au travers de leurs projets et l’énergie dépensée pour les retranscrire dans un mode de vie alternatif m’inspire un profond respect. Je leur témoigne de la reconnaissance pour le temps qu’ils m’ont accordé durant des échanges de qualité, qui ont permis d’ouvrir certaines réflexions et pistes de recherche. Je tiens également à remercier Tristan Chaudon, et Joachim Boyries pour leurs disponibilités et la pertinence des propos dans leur démarche alternative d’accompagnement. Je remercie Pascale Marion en tant qu’architecte indépendante qui, s’engageant elle-même sur le questionnement de la pratique des architectes, a su guider et éclairer mon propos avec pertinence.
Je remercie mes directrices d’études Florence Lafourcade et, encore une fois, Pascale Marion de leurs nombreux conseils permettant de structurer ma réflexion de façon judicieuse, et d’avoir su objectiver mes recherches d’une manière qui fasse sens aussi bien pour moi que plus largement en s’inscrivant dans un champ de valeurs proche de ceux des projets alternatifs. Cela a rendu cette rédaction à la fois stimulante et enrichissante aussi bien dans mon cursus d’étudiante en architecture que dans la profession de maitre d’œuvre que j’exerce actuellement.
Je tiens également à remercier mes proches, pour leur relecture et leur soutien tout au long de cette recherche. Un merci tout particulièrement à Hélène Messmer, Catherine Kauffmann, Juan Colard, Firat Kaya, Kaal Biayi et Dominique Dieffenbacher, qui par leur intérêt pour le sujet m’ont permis de débattre plus largement sur la démarche citoyenne et l’engagement des usagers.
4
REMERCIEMENTS
6 SOMMAIRE REMERCIEMENTS...............................................................................................................4 SOMMAIRE…………………………………………………………………………………………………………….……...…
....................................................................................................................... .
.......................................................................................
CONCLUSION.............................................................................................................................. BIBLIOGRAPHIE .......................................................................................................................... 75 TABLE DES MATIÈRES ................................................................................................................. 81 TABLE DES ILLUSTRATIONS ......................................................................................................... 85 ANNEXES.....................................................................................................................................87
6 INTRODUCTION
8 Partie I - Gouvernance et Rupture avec les Modèles du Modernisme au Postmodernisme 2 1. Gouvernance verticale descendante
... 21 1.1. Le cas de la reconstruction après-guerre en France 21 1.2. Un va et vient de réformes déconnectées de l’usager 26 2. Une rupture multiple .................................................................................................................. 33 2.1 Densité et étalement urbain 33 2.2 Regard critique et rupture avec le territoire 37 Partie 2 - Vers une Gouvernance Adaptée, une Transition par les Projets Alternatifs.................... 4 1. Gouvernance horizontale, vers une architecture éthique.......................................................... 43 1.1. La fin d’« un monde pauvre » d’après Yona Friedman 43 1.2. Typologie de projets alternatifs et rapport architecte-usager 47 2. Une transition par incrémentalisme et/ou utopiste ?................................................................ 69 2.1. De l’éthique et du bon sens................................................................................................. 69 2.2 De l’incrémentalisme au projet local, Lucien Kroll, Alberto Magnaghi 71
INTRODUCTION
INTRODUCTION
Les pénuries de denrées et de matériaux liées au contexte politique et écologique mondial nous incitent à nous mettre en action. Toutefois, cette prise de conscience peut parfois sembler tardive et lente à mettre en œuvre, alors que nous perdons irrémédiablement certaines richesses, notamment celles liées à notre patrimoine écologique Ce monde, en pleine mutation forcée, est sans doute l’un des moteurs principaux des phénomènes de transition, voire de transgression qui tendent à s’hybrider et s’ancrer en France.
En architecture, ce phénomène peut se transcrire sous la forme de projets alternatifs. En effet, certains usagers décident d’être acteurs du changement, entamant ainsi une forme de processus libérateur face aux contraintes qu’ils rencontrent. Celles-ci ne sont parfois qu’une somme de cloisonnements de la société, les obligeant à se conformer à des modèles qui ne leurs conviennent pas. Qu’ils se positionnent en rupture avec l’héritage de l’espace rural et urbain de la postmodernité, ou en avance par rapport au processus d’architecture soutenable, leurs projets se développent dans un contexte législatif qui n’a pas encore ou peu évolué. Ces projets sont variés et sont référencés sous des noms différents, tels que : écolieu, habitat participatif, tiers-lieu, cabane, oasis, refuge, squat… Cette liste est non-exhaustive, chaque projet étant unique et pouvant se redéfinir, comme pour une tiny house, par exemple, initialement nomade et devenant sédentaire pour finalement devenir mobile home ou cabane. Cela démontre notamment qu’il est difficile de définir de manière précise tous ces types de projets. C’est pourquoi le terme parapluie de « projet alternatif » représente ici des projets différents de ceux liés aux dénominations communes de l’habitation collective, de la maison individuelle ou encore des infrastructures accueillant habituellement du public
Dans la présente étude nous pourrons nous demander dans quelle mesure les projets alternatifs interrogent le rapport architecte-usager tout en générant une architecture éthique et soutenable ?
9
METHODE
L’utilisation des termes habitant, usager ou projetant est sensiblement équivalente dans cette étude, même si cela pourrait être sujet à discussion en d’autres contextes. En effet, l’idée est ici d’évoquer une ou des personnes souhaitant créer ou transformer un espace en lui attribuant des qualités alternatives, dans une démarche éthique et/ou soutenable.
Il existe, d’après Yona Friedman, des « utopies réalisables »1 qui peuvent amener à penser « comment habiter la terre »2. Selon lui, l’utopie sociale trouve son fondement dans l’insatisfaction de certains membres de la société qui chercheront alors à y répondre. En ce sens, dans ses ouvrages parus à la fin du siècle dernier, l’on peut saisir la difficulté de mener à bien un projet selon les atouts que les usagers souhaitent lui conférer.
Les principales catégories de projet alternatif qui nous intéressent dans cette étude peuvent en quelques sortes se refléter dans le panel de projets représentatifs dit « standard ». Le projet dit « standard » se révèle dans le processus suivant : un maitre d’ouvrage soumet à un architecte son projet, ayant pour objet la construction ou l’aménagement d’un espace, qui revêt un caractère ordinaire. A cet égard, les projets alternatifs, qui semblent faire défaut dans la société, s’inscrivent en rupture de ce modèle ordinaire et standard qui ne convient pas ou plus.
Ainsi, le premier critère retenu pour ce corpus est de se placer en rupture avec un modèle ou de proposer une alternative dans un secteur donné, dans un cadre éthique et durable. D’une part, les projets étant épars, la sélection de projets alternatifs a été circonscrite dans la région Alsace, facilitant les déplacements par rapport au nombre d’échanges à réaliser avec les projetants. D’autre part, le bouche à oreille a permis la découverte de projets pour lesquels il existe parfois peu de communication officielle.
S’agissant des critères de sélection, les différents projets alternatifs doivent représenter les catégories standards citées précédemment. Ainsi, par analogie, l’étiquette de l’habitation collective sera représentée par le projet alternatif de l’habitat participatif, celle de la maison individuelle par une habitation répondant à des caractères primaires, et pour finir, celle des infrastructures accueillant du public par des tiers lieux et des écolieux.
Après avoir sélectionné plus d’une trentaine de projets, dont une vingtaine en Alsace, il s’agissait de choisir les plus représentatifs pour cette étude. Les critères de sélection ont été multiples, mais le principal était la disponibilité et la proximité des projets. Le phasage du projet n’était pas un critère de sélection. Au contraire, la singularité et leur temporalité pouvaient être des atouts afin d’évoquer avec recul ou non, les difficultés rencontrées lors de leur démarche de conception. Le fait qu’un architecte ait pris part à ces projets n’a pas non plus constitué un critère pertinent, dans la mesure où seul l’usager était, dans un premier temps, au cœur du sujet. Toutefois, en ce qui concerne le point de vue des architectes, ce dernier est surtout représenté par les écrits et les supports qu’ils font paraitre au sujet d’une architecture éthique et soutenable. Peu d’entre eux seront représentés dans le cadre de cette étude, car le caractère alternatif des projets met en lumière le défaut de pertinence de leur intervention à certains égards, ou tout simplement leur absence globale durant le projet.
1 FRIEDMAN, Yona Utopies réalisable. Paris : Editions de l’éclat, (première édition 1975 dans la collection 10/18) , 2015. 240p.
2 FRIEDMAN, Yona Comment habiter la terre. Paris : Editions l’éclat, 2016 (première édition 1976). 128p.
10
La question centrale de cette étude sera donc développée autour des projets retenus pour le corpus, juxtaposée à un apport théorique afin de déterminer un état des lieux du changement profond qui tend à s’opérer en architecture vers une dimension éthique et soutenable. L’étude de ces cas concrets permettra ainsi de nous questionner sur les moyens à notre disposition pour agir dès à présent vers de nouvelles pratiques. En partant d’un contexte historique, la réflexion menée s’appuie sur des enquêtes ainsi que sur des entretiens semi-dirigés proposés aux projetants ainsi qu’aux architectes liés au processus de projets alternatifs.
Pour ce faire, un cadre de recherche particulier a été fixé et se définit comme suit. En ce qui concerne le cadre temporel, celui-ci se définit sur la période de l’anthropocène qui renvoie « à l’état de la planète tel qu’il résulte de l’impact désormais massif, sur un temps court, des activités humaines »3. Cette période trouve son essor autour des années 1950 et depuis les crises qui se sont succédées (économique, sociale, politique, etc ) qui montrent les limites d’un modèle de société et les conséquences directes qui y sont liées.
En un sens, l’une des limites de cette méthode pourrait être induite par le choix du corpus qui ne représente qu’un panel limité d’acteurs. Dans un autre sens, l’émulation qui existe autour de ces projets alternatifs ne permet pas toujours au projetant d’accorder le temps et l’énergie nécessaire pour participer à ce type d’études. Leur priorité étant de pérenniser leur activité, ainsi que le fonctionnement et le développement de leur projet. La limite de cette méthode réside sans doute dans la distance qui existe entre mon lieu de résidence et celui de chacune des personnes sollicitées
Les projets alternatifs représentent une population d’individus en recherche de reconnexion et d’échange social. Il semble que les groupes ayant été les plus proches géographiquement étaient plus facilement abordables, le contact réel en plusieurs phases permettant de profiter d’échanges plus fréquents. Le développement de la réflexion se construisant en plusieurs étapes, il peut nécessiter, de ce fait, de rencontrer les groupes à plusieurs reprises. Or, cela implique de solliciter ces derniers à de nombreuses reprises, sans qu’il puisse toujours bénéficier d’un retour bénéfice sur le temps partagé. Le seul groupe pour qui cela a été le cas était Graine de lieu, avec lequel il s’est instauré un échange de bons procédés Ainsi, à chaque sollicitation, il pouvait me briguer des informations en rapport avec mon activité de maitrise d’œuvre, ce qui a permis de prolonger les discussions tout au long de l’étude du corpus
Yona Friedman soulevait les difficultés présentées par les modèles mathématiques et l’attention portée uniquement sur les résultats par les physiciens. Selon lui, « en physique, le processus est au moins aussi important que le résultat »4 . En observant ainsi les processus qui génèrent ces projets alternatifs, nous pouvons tenter de faire émerger les outils menant vers une architecture éthique et soutenable. De ce fait, même si ces projets peuvent être imparfaits voire ne pas aboutir, ou à l’inverse briller et inspirer, ce qui nous intéresse avant tout est d’observer la régularité ou la singularité des propositions d’alternatives au sein des différents projets retenus. Ce faisant, cela nous permettra de comprendre de quelle manière les mentalités et les pratiques peuvent changer, tant chez les usagers que chez les architectes.
3 BOURG Dominique, Chapitre 4. Anthropocène, questions d’interprétation. Dans : Rémi Beau éd., Penser l’Anthropocène (pp. 63-76). Paris : Presses de Sciences Po. (BOURG Dominique, 2018)
4 FRIEDMAN, Yona. L’ordre compliqué et autres fragements. Paris : s.n., 2020 (première édition 1958). 144p.
11
ETAT DE L’ART
L’ANTHROPOCENE COMME DEFINITION D’UNE PERIODE
La conséquence directe de l’anthropocène dont notre société actuelle entend le plus parler est celle du dérèglement climatique, dont l’enjeu principal est de tendre vers un développement durable et écologique Or, les acteurs de la croissance économique et industrielle tentent de s’emparer de ces thèmes en les utilisant comme des atouts politiques et commerciaux.
Pour Timothée Parrique, auteur de la thèse « la politique de la décroissance », les termes « capitalocène », « PIBocène » ou « éconocène » lui sembleraient plus appropriés. En effet, selon lui, « ces termes nous permettent de mettre le doigt sur le problème. Quand on dit « anthropocène » le problème c’est l’humanité, et là on va se poser la question, est ce que c’est un problème de nature humaine, de population, et tout cela se sont des faux problèmes. Le problème c’est le capitalisme, l’économicisme, de manière encore plus globale, la supériorité du mode de pensée économique, et un troisième problème, c’est la croissance comme idéologie » 5 Sans mettre de côté l’idée de la responsabilité des phénomènes, nous parlerons ici de capitalocène ou d’anthropocène selon l’idée qui sera à mettre en exergue.
Les écrits, centrés sur la période de l’anthropocène et notamment à propos des thèmes sociétal, politique et environnemental, sont récurrents. Les premières recherches menées autour du cadre temporel, fixées par la méthode, ont permis de constater une certaine récurrence dans la manière de développer les thèmes liés à l’anthropocène et au développement durable. Le cheminement de la présente étude s’est similairement construit dans le même schéma de définition des termes. Cela permet de transcrire d’une certaine manière le bien-fondé des propos de manière à justifier la démarche et l’importance de celle-ci en ce moment précis.
LA NOTION DE DEVELOPPEMENT DURABLE
En France, ce sont des évènements historiques et politiques marquants qui ont constitué l’avènement de l’utilisation de la formule de « développement durable ». Ces évènements sont multiples tels « le « Rapport Brundland » de 1987 qui est, à cet égard, le plus remarquable des textes clés : par-delà ses usages variés, il fonctionne comme fondateur de la notion et comme source légitime de la définition. Fonctionnent également comme des textes clés l’« Appel de La Haye » de 1989, l’« Appel d’Eidelber » de 1992, le « Discours de Chirac à Johannesbourg » en 2002 régulièrement présenté comme celui par lequel s’est enfin libérée l’expression politique de la culpabilité morale et du devoir d’action, ou encore le « Pacte écologique de Nicolas Hulot » lancé en 2006.6
5 VIDARD Mathieu , dans une interview de PARRIQUE Timothée, Pour une économie de la décroissance, [En ligne] 15 septembre 2022, consulté le 17 septembre 2022, disponible sur https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/la-terre-au-carre/la-terre-au-carre-du-jeudi-15-septembre2022-8313277
6 KRIEG-PLANQUE Alice, « La formule “développement durable” : un opérateur de neutralisation de la conflictualité », Langage et société, 2010/4 (n° 134), p. 5-29. DOI : 10.3917/ls.134.0005. URL : https://www.cairn.info/revue-langage-et-societe-2010-4-page-5.htm
12
Francine Pellaud se questionne à propos de l’éducation au développement durable, « les termes semblent à la mode, mais ont-ils encore du sens ?... »7. Initialement, la notion de développement durable proposait un processus permettant de faire évoluer notre société, tout en préservant notre qualité de vie. En se l’appropriant, les acteurs économiques ont donné naissance au phénomène de « greenwashing » ou « éco blanchiment » qui semble s’expliquer notamment par le fait que le développement durable est perçu davantage comme « un phénomène de société que nous retrouvons dans la communication des organisations »8
En s’intéressant à la définition que propose Kristel de Myttenaere dans sa thèse « Vers une architecture soutenable »9 , l’on peut se demander si cette notion constitue une étape nécessaire dans toute réflexion basée sur les notions d’architecture et de respect de l’environnement écologique. Elle propose de décortiquer la notion de « développement durable » en commençant par exposer que le terme, d’abord repris de l’anglais via l’adjectif « Sustainable », est une notion provenant de l’adjectif latin « Sustinere », soutenir en français. « Il s’agit donc d’un développement qui peut être soutenu pour des raisons plausibles, introduisant l’idée que tout type de développement n’est pas nécessairement positif. Cette qualification va donc de pair avec un questionnement : quelles peuvent être les raisons plausibles, supportables ? »10 . Cette notion introduit ainsi une notion éthique au développement. Elle propose, ensuite, une piste de compréhension de l’expression « développement durable » en citant Serge Latouche, « Le développement peut-il être durable ? » dans la revue l’Ecologiste N°6 février 2001 Pour elle, cette notion suggère une dimension temporelle de durée dans le temps, qui par conséquent pose question quant à son intérêt. En effet on peut penser le développement durable semblable à un phénomène ayant un début et une fin, ou au contraire, comme un mode de vie idéal, auquel cas, la dimension de durée biaise le sens que l’on a voulu conférer aux termes. Elle fait également le parallèle avec l’utilisation de l’adjectif dans la notion de « croissance durable » qui créée, d’après elle, une ambiguïté et remet en question l’efficience de voir la croissance durer. Les ressources n’étant pas inépuisables, il est inenvisageable que la croissance n’ait pas de fin.
7 PELLAUD Francine, Pour une éducation au développement durable, Editions Quae, Versaille, 2011, 205p
8 CORDELIER, Benoit, et BREDUILLIEARD Pauline. « Publicité verte et greenwashing », Gestion 2000, vol. 30, no. 6, 2013, pp. 115-131
9 MYTTENAERE, Kristel. Vers une architecture soutenable, thèse sous la direction d’André André De Herde, Science Appliqué disponible sur http://hdl.handle.net/2078.1/5002, 389p (MYTTENAERE, 2006)
10 Ibid.
13
LA NOTION DU BESOIN ET LA PYRAMIDE DE MASLOW

Dans cette course à la croissance infinie, la question sous-jacente que l’on peut se poser est de comprendre pourquoi nous nous sommes tellement éloignés de nos besoins essentiels. Pour tenter d’y répondre, la pyramide de Maslow propose une illustration des besoins fondamentaux de l’Humain. Le principe de son fonctionnement repose sur la considération que, si chaque besoin est considéré comme accompli, les préoccupations mènent vers le besoin supérieur. Si les besoins vitaux tels que la faim, le repos et l’habitat sont assurés, l’Humain gravira la pyramide en cherchant à accomplir le besoin de sécurité, puis celui d’appartenance et d’estime jusqu’à la recherche de l’accomplissement global. Or, comme le constate Francine Pellaud11, malgré la logique de cette pyramide, elle ne correspond pas à la réalité : « pour répondre à des besoins d’appartenance, d’estime, des hommes et des femmes sont capables d’exploits, sans pour autant que les besoins dits « fondamentaux » soient forcément garantis »12
Figure 1 Pyramide de Maslow 1943 Pyramide de Maslow. [consulté le 14 décembre 2022]. Disponible sur : https://lisette-mag.fr/pyramide-demaslow/
Il ressort de ce qu’il précède que la notion de développement soutenable sera préférée à celle de « développement durable » pour les réflexions qui suivront De même, il faut préciser que cette notion s’inscrit dans le domaine de compétence de l’architecture, celle-ci ayant un rôle plus qu’important à jouer, dans le processus de développement soutenable comme dans le processus primaire de sécurité de l’être humain Par conséquent, nous parlerons donc essentiellement d’architecture soutenable, « une architecture qui vaut la peine d’être soutenue pour des raisons qui font sens, qui s’appuient sur des principes, capable de synthétiser une somme d’enjeux »13 . 11 (PELLAUD, 2011) 12 Ibid. 13 (MYTTENAERE, 2006)
14
IMPACT DU BATI SUR L’ENVIRONNEMENT ET CHANGEMENT DE COMPORTEMENTS
Quelques chiffres sur la part de la consommation en énergie et la pollution en architecture
Il est indéniable que « le bâtiment (la construction) représente environ 40 % des émissions de CO2 des pays développés, 37 % de la consommation d’énergie et 40 % des déchets produits »14. Et pourtant en France, le Conseil National de la Transition Ecologique (CNTE)15 n’a été créé qu’en 201216 , remplaçant le Comité national du développement durable et du Grenelle de l’environnement (CNDDGE) qui avait lui-même été créé en 2008. Ces différents comités ont pour but d’élaborer une politique permettant d’accompagner la transition, jugée nécessaire par le sommet de la Terre de Rio en 1992 et la création du GIEC en 198817 . En tout, 6 rapports ont été publiés et peu de choses ont évolué depuis, jusqu’à la crise de la Covid-19 et la guerre en Ukraine qui viennent enrayer le système économique, politique et de santé, comme des grains de sable dans un engrenage
Le rapport au contexte actuel
Pourtant, et pour rappel, la période de l’anthropocène a débuté autour des années 1950. Face à ce constat, l’on peut se demander quel impact positif significatif nous avons su mettre en place depuis. Ironiquement, l’on peut se demander si l’impact le plus pertinent depuis 1950 n’est pas issu de la survenance de la pandémie de la Covid-19 en 2020, engendrant un confinement strict et freinant toutes les activités humaines. En effet, la planète entière a pu constater une baisse des déplacements et le ralentissement du secteur de l’industrie, permettant ainsi de limiter les pollutions et émissions De même, nous avons pu constater l’incidence du confinement sur le comportement de la population, leur rapport à la nature, à leur habitat, ainsi que leur rapport à la consommation. Enfin, d’autres effets de la pandémie et du contexte géopolitique européen ont mené à des pénuries de denrées qui ont un impact sur nos consommations. Depuis, des études portent sur l’analyse de ces comportements et questionnent quant à la durabilité des démarches responsables.
Ainsi, la pandémie de la Covid-19 s’inscrit incontestablement dans la période de l’anthropocène et du capitalocène. En nous touchant directement, cette épidémie a réduit la distance psychologique entre l’individu et le dérèglement climatique, ainsi qu’avec la détérioration de notre environnement, dans la mesure où la pandémie est perçue comme en étant une des résultantes.
14 DESHAYES Philippe, « Le secteur du bâtiment face aux enjeux du développement durable : logiques d'innovation et/ou problématiques du changement », Innovations, 2012/1 (n°37), p. 219-236
15 Mission : « Le conseil national de la transition écologique (CNTE) est consulté sur les projets de loi concernant, à titre principal, l’environnement ou l’énergie et sur les stratégies nationales relatives au développement durable, à la biodiversité et au développement de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises et la stratégie bas-carbone. », disponible sur https://www.ecologie.gouv.fr/cnte, consulté le 27 mai 2022
CNTE : Sa mission est présenté comme suit, « Le conseil national de la transition écologique (CNTE) est consulté sur les projets de loi concernant, à titre principal, l’environnement ou l’énergie et sur les stratégies nationales relatives au développement durable, à la biodiversité et au développement de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises et la stratégie
16 MONNOYER-SMITH, Laurence. Conseil national de la transition écologique. Environnement, Risques & Santé, 2017, vol. 16, no 3, p. 313-314
17 Jean Jouzel, Michel Petit, Valérie Masson-Delmotte. Trente ans d’histoire du Giec. La Météorologie, Météo et Climat, 2018, pp.117-124. ff10.4267/2042/65154ff. ffhal-03335732f
15
« La pandémie de coronavirus constitue un événement historique suffisamment inédit pour fortement modifier les valeurs partagées au sein de la société (Sheth, 2020). Définies par Rokeach (1973) comme des croyances durables, les valeurs portent sur le fait qu’une manière de se comporter est personnellement ou socialement préférable à toute autre. Ces valeurs sont le résultat d’un héritage culturel autant que d’expériences personnelles (Schwartz, 1992). »18
Si à la période dans laquelle nous nous trouvons est propice aux changements de comportements, ils n’apparaissent pas innovants pour autant. Un article interroge les effets de la pandémie de la Covid19 sur la société et note que, comme la plupart des changements responsables, « l’achat de seconde main ou de proximité, la consommation collaborative, sont apparus sur les décombres de la crise des subprimes en 2008. La crise du Covid-19 les a surtout vus s’étendre et se consolider, sans toutefois qu’ils se généralisent »19
LA REACTANCE PSYCHOLOGIQUE : DE LA SOCIETE DU RISQUE A L’ARCHITECTURE ETHIQUE
Si de premiers effets du confinement sont apparus positifs pour l’environnement, nous avons pu constater également un revirement de situation lorsqu’un semblant de « retour à la normale » a été possible. « Selon la théorie du self-licensing, une bonne action peut donner « droit » à une action plus douteuse (Merritt et al., 2010). C’est cette théorie qui explique qu’une salade verte choisie en entrée justifie le choix d’une part de gâteau au chocolat en dessert »20 . Nous avons pu observer ce phénomène dans les centres commerciaux avec les longues files d’attentes chez Zara ou Mc Donald’s. Pour l’évoquer, l’on parle de « réactance psychologique »21. Cela peut s’expliquer par le fait que « la réactance psychologique est plus forte dans les sociétés individualistes. Son intensité dépend aussi de l’expertise perçue de la source qui impose la privation de liberté »22 .
En un sens, la pandémie a accru chez les citoyens peu engagés jusque-là, une conscience environnementale face aux risques futurs liés aux dérèglements, tout en révélant « les limites de notre supposée suprématie technique »23
18 TRESPEUCH, Léo, ROBINOT, Élisabeth, BOTTI,
19 Ibid.
20 Ibid.
21 La réactance psychologique se réfère à un état émotionnel activé vers le recouvrement de la liberté à chaque fois que celle-ci est menacée source : Réactance psychologique : G. Mugny et S. Papastamou, Réactance psychologique et ordre social, vol. Vol. 2, Quaderns de psicologia. International journal of psychology, 1979, pp. p. 103-14.
22 (TRESPEUCH, 2021) 23 (TRESPEUCH, 2021)
16
Laurent, et al. Allons-nous vers une société plus responsable grâce à la pandémie de Covid-19? 2021. (TRESPEUCH, 2021)
LA SOCIETE DU RISQUE
En revenant sur le fait que la situation a peu évolué par rapport aux premières prises de conscience des enjeux écologiques, cela nous amène à la réflexion suivante : ce que nous savons être inévitable nous fait entrer dans une « société du risque »24 . A cet égard, les propos d’Arlette Bouzon permettent d’introduire la remise en question des fondements de notre société. Elle cite, à ce titre, la troisième partie du livre d’Ulrich Beck et expose ses idées : la « modernité réflexive »25 qui situe « la modernité dans laquelle nous vivons »26 , correspond à l’émergence d’une société du risque différente de la société industrielle classique.
Ainsi, « Ulrich Beck considère ainsi que la science est devenue l’instrument incontournable de mesure et de gestion des risques contemporains, et se trouve confrontée à des exigences nouvelles. Mais, pour accepter un risque donné, encore faudrait-il que les connaissances minimales nécessaires à la compréhension des situations à risques et des alternatives envisageables soient acquises par les individus. Or, en entretenant l’illusion que les risques peuvent être entièrement éliminés, ou du moins maîtrisés, l’expertise scientifique est source de bien des malentendus. La société contemporaine, société – industrielle – du risque, devient alors un lieu de méfiance généralisé où profanes, et parfois même les experts, doutent et remettent en question les fondements sur lesquels elle s’est construite. Ulrich Beck préconise, en conséquence, une transformation complète des formes classiques de la vie publique »27
La société industrielle a tenté de parer aux catastrophes engendrées par les changements climatiques, mais ces compensations trouvent leurs limites. En effet, ce mode de fonctionnement engendre une « société du risque » et malgré les meilleures technologies, la solution n’est pas de développer des outils pour remédier aux catastrophes, mais plutôt d’éviter qu’elles ne se produisent
24 BOUZON Arlette, « Ulrich BECK, La société du risque. Sur la voie d’une autre modernité, trad. de l’allemand par L. Bernardi », Questions de communication [En ligne], 2 | 2002, mis en ligne le 30 juillet 2012, consulté le 18 décembre 2020. URL : http://journals.openedition.org/questionsdecommunication/ 7281 ; DOI : https://doi.org/10.4000/questionsdecommunication.7281 (BOUZON, mis en ligne le 30 juillet 2012) 25 Ibid. 26 Ibid. 27 Ibid.
17
L’ARCHITECTURE ETHIQUE – LUCIEN KROLL, PATRICK BOUCHAIN ET PHILIPPE MADEC
Il semble nécessaire de se questionner sur les fondements du fonctionnement de la société post moderniste telle quelle est connue aujourd’hui. L’architecture éthique est une grande cause, elle est presque inattaquable de front. « L’incrémentalisme » et la « vicinitude »28 peuvent éventuellement accompagner cette transition. Selon les partisans de l'incrémentalisme, tels que le sont Lucien Kroll et Partick Bouchain, il est préférable d'apporter des modifications à un système ou à une politique en les testant et en les évaluant au fur et à mesure, plutôt qu'en adoptant des changements radicaux qui peuvent entraîner des conséquences imprévisibles.
De cette manière, nous pouvons essayer d’analyser et de comprendre certains processus générant une architecture éthique et soutenable à l’échelle du corpus. Ce questionnement doit nous servir à appréhender une architecture éthique, une manière d’« accueillir un autre savoir-vivre ensemble »29 Aujourd’hui, bâtir éthique pourrait se définir comme suit, selon Philippe Madec : « sont convoqués à la fois la connaissance de l’état du monde dans sa nouveauté inédite, le courage de s’attaquer aux habitudes, aux désirs et à leurs multinationales, une force morale pour désigner ce qui reste possible et l’envie créatrice de proposer la vision anticipatrice d’un autre établissement humain »30. De cette manière, les projets alternatifs du corpus révèlent une représentation de cet « autre établissement humain »31 . Il infère que la transformation de la société et donc, la mouvance vers une architecture éthique et soutenable, ne peuvent être réalisé sans la participation des usagers, au moyen d’« une volonté de participation citoyenne »32 Il n'existe pas de méthode unique pour garantir une architecture éthique, mais il existe plusieurs façons d'encourager une pratique architecturale responsable et respectueuse. Nous verrons tout au long de cette réflexion de quelle manière les architectes ont un rôle à jouer dans ce processus, tout comme l’ensemble des usagers et des pouvoirs politiques également.
Le monde, la planète Terre, les Hommes et l’environnement font partie d’un ensemble, d’un tout. Ce tout présente un emboitement d’échelles semblable à un ensemble de systèmes complexes, ou plutôt compliqués L'emboitement d'échelle consiste à intégrer différentes tailles d'habitats et d'espaces publics dans un même quartier, de manière à offrir une diversité de logements et de services au service d’un « autre établissement humain ».
De fait, « nous sommes incapables de penser de manière holistique »33. Il semble nécessaire d’après Yona Friedman de « décrire un processus avec précision »34 , et pour ce faire d’« avoir recours à son « histoire » : c’est-à-dire à la liste chronologique de ses étapes »35 28 KROLL, Lucien, De l’architecture action comme processus vivant…. Publication Inter, Les Editions de l’intervention, 2011, consulté le 8 mars 2022, https://id.erudit.org/iderudit/63940ac, p 8–15 / 108 29 FAREL, Alain, FAURE, Daniel, JUSSELME, Thomas, FRADIN, Etienne, MADEC, Philippe, BENOIT, Jacques, DEOUX, Suzanne, DESMOULINS, Christine, GAUZIN-MULLER, Dominique, TESTART, Jacques. Bâtir éthique et responsable. Paris, 2007 : Editions Le Moniteur. p. 140. 30 Ibid. 31 Ibid. 32 Ibid. 33 (FRIEDMAN, L’ordre compliqué, 2020, (première édition 1958)) 34 Ibid. 35 Ibid.
18
En s’appliquant à analyser les projets alternatifs retenus dans le corpus et grâce à la participation des projetants, les propos suivants tenteront de mettre en lumière les outils essaimant une architecture éthique et soutenable, duquel pourra résulter ce que l’on appelle en analyse transactionnelle, la position du « gagnant-gagnant » 36. Cela signifie que tendre vers une architecture éthique et soutenable doit autant profiter à l’habitant qu’à l’architecte, mais également à toute la société.
Afin de comprendre dans quelle mesure les projets alternatifs interrogent le rapport architecte-usager, tout en générant une architecture éthique et soutenable, l’on développera la réflexion de la manière suivante : dans un premier temps, l’on évoquera les raisons ayant conduit aux projets alternatifs en faisant un bilan historique de l’héritage de notre architecture d’après-guerre et des modes de gouvernance qui s’y sont opérés. Ensuite, l’on explicitera les démarches de projets alternatifs et de quelle manière ils permettent d’interroger le rapport architecte-usager, tout en générant une architecture éthique et soutenable. Enfin, l’on exposera comment l’incrémentalisme au service de l’architecte permet de replacer l’usager au cœur du processus d’élaboration du projet, tout en développant le projet local. 36 L’analyse transactionnelle est créée en 1958 par Eric Berne, médecin psychiatre et psychanalyste canadien
19
Partie
Gouvernance et Rupture avec les Modèles, du Modernisme au Postmodernisme

I
1. Gouvernance verticale descendante
1.1. Le cas de la reconstruction après-guerre en France
1.1.1 Contexte Alsacien
Historiquement, l’on pourrait croire qu’à la suite de la guerre de Trente Ans, puis de la Première ainsi que de la Seconde Guerre mondiale, la France et plus particulièrement l’Alsace, qui furent des espaces d’affrontements centraux, auraient donné l’occasion de rebâtir les villes selon les modes de vie modernes
Dans les faits, la guerre de Trente Ans a débuté en Alsace à la fin de l’année 1621. Bien souvent, les villages ont vu plus de la moitié de leurs constructions détruites et ce n’est qu’au début du XVIIIème siècle que la reconstruction a repris ardemment. D’ailleurs, ce sont les dates que l’on relève de nos jours sur les maisons les plus anciennes, excepté dans les vignobles où des constructions du XVIIème siècle ont pu être préservées grâce à leurs remparts. Les villages rebâtis ont été repeuplés essentiellement d’anciens habitants, mais aussi de colons français, allemands ou suisses
Cette phase de reconstruction a inscrit durablement le modèle de construction à pan de bois dans le patrimoine, précisément grâce au « savoir-faire des charpentiers locaux mais également des artisans venant des régions avoisinantes »37 venant de la Souabe, la Bavière ou du Tyrol. À ce stade, il semble que le patrimoine soit encore préservé grâce à l’artisanat local, ainsi qu’aux savoir-faire locaux des régions voisines.
1.1.1.a. Volonté d’innovations et urgence de reconstruction
À la suite de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, l’idée selon laquelle la reconstruction pourrait se réaliser grâce aux innovations techniques apportées par la révolution industrielle, ainsi qu’au courant du modernisme prospérant et aspirant à une progression sociale et économique, ne changea pas fondamentalement les espaces urbains connus jusque-là. En effet les politiques ainsi que les indemnisations menées après-guerre, ont conduit dans la plupart des cas à une reconstruction à l’identique partielle38. Si des enquêtes et des concours ont permis la codification de styles régionaux, l’Alsace a bénéficié d’une influence de mouvement régionaliste et de l’exposition internationale de folklore de 1937. De manière générale, peu de choses ont évolué : les constructions ont été réédifiées sur le même parcellaire, privilégiant « les villages-rue, où les maisons s’alignent le long d’une ou deux voies de circulation, plutôt que les village-tas d’origine médiévale, enserré dans des voies circulaires et des fortifications »39
37 DENIS Marie-Noële, « De l'influence des politiques de reconstruction sur l'architecture rurale en Alsace », Ethnologie française, 2007/HS (Vol. 37), p. 29-34. DOI : 10.3917/ethn.070.0029.
URL : https://www.cairn.info/revue-ethnologie-francaise-2007-HS-page-29.htm 38 Ibid. 39 Ibid.
21
1.1.1.b. La reconstruction dirigée par les politiques nationales
Comme cela a été évoqué précédemment, un certain nombre de représentants renommés de l’urbanisme, tels que Lucien Kroll et Patrick Bouchain, ont à cette époque tenté de faire « aboutir les solutions modernistes proposées sans succès depuis la fin du XIXe siècle »40. Dans ce contexte de reconstruction, cet échec était dû, semble-t-il, aux instabilités politiques, aux difficultés économiques et à « un certain état d’esprit individualiste repoussant l’application de plans d’ensemble propre à l’espace urbain »41. Finalement, ce sont les militaires français, en proposant des stratégies intégrant l’objectif d’espace urbain, qui ont fini par influencer la démarche à suivre. Cependant, leur plan d’action a intégré une manière moins audacieuse et davantage technique. Elle s’est inspirée notamment des expositions de la National Housing Agency américaine, dont les techniques proposent la rationalisation de la production. La période de reconstruction des années 1945 aux années 1955 ne sera qu’une période d’essai pour les années 1960, permettant de dépasser les méthodes artisanales d’avant-guerre en s’inscrivant d’avantage dans l’ère industrielle, grâce à de nouvelles méthodes de construction. En effet, « La reconstruction a privilégié la « modernisation raisonnable », qui est le résultat d’un compromis entre ancien et nouveau, le nouveau n’entrant qu’à reculons, sous la forme la plus édulcorée possible »42 Les progrès en matière de construction, rendus possibles grâce à la révolution industrielle qui, rappelons-le, a largement développé l’emploi du béton armé, ont permis de s’affranchir de certaines contraintes techniques. Cela a notamment facilité et accéléré les méthodes de construction. La construction des logements a elle-même pris la forme d’une certaine production industrielle, avec une uniformisation qui, en se généralisant, a eu pour conséquence un appauvrissement tant des particularités régionales du paysage architectural, que de notre savoir-faire artisanal. Cette aliénation entraine l’absence de consultation de l’usager quant à sa participation dans cette reconstruction globale.
L’on peut donc voir que, selon les régions, le propos peut être nuancé quant à la standardisation des constructions. L’après-guerre est aussi caractérisé par cette rivalité entre culture délocalisée, « soucieuse de renouer les fils de la modernité sans frontières interrompue par la guerre » et ceux qui utilisent « le savoir-faire des praticiens locaux, et peut alors se rapprocher des formes disparues »43. Si la simplification des modèles a en partie eu lieu en Alsace, elle reste modérée et permet encore aujourd’hui de distinguer les cœurs de village Alsacien, des villages hors région. Cela a permis de conserver « les principaux traits qui fondent l’originalité de la campagne alsacienne »44 . Si cela est vrai pour les cœurs de village aux abords des monuments historiques, cela se vérifie peutêtre moins pour les espaces pavillonnaires.
40 VAYSSIERE, Bertrand. Relever la France dans les après-guerres : reconstruction ou réaménagement ? [En ligne] [Consulté le : 10 Aout 2022.] Disponible sur : https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales.
41 Ibid.
42 Ibid.
43 MONNIER, Gérard. De la reconstruction a la croissance (1945-1975). [éd.] L'architecture du XXe siècle Gérard Monnier éd. Paris : s.n., 2000. pp. p. 74-104. Vol. Presses Universitaires de France, « Que sais-je ? ».
44 DENIS,Marie-Noële. De l'influence des politiques de reconstruction sur l'architecture rurale en Alsace.[Enligne] [Citation : 10 Aout 2022.] https://www.cairn.info/revue-ethnologie-francaise-2007-HS-pag.
22
1.1.2 La critique du Ciam par Team Ten, une tentative d’alternative ?
1.1.2.a. L’approche théorique relayée au second plan
Les mutations de la société, du domaine de la construction et donc de l’architecture ont largement été influencées par plus d’un siècle d’industrialisation. Cette forme de société inscrit sa durabilité dans une forme de croissance perpétuelle, l’on peut donc parler de « capitalocène » selon Timothée Parrique. En France, la période la plus faste, identifiée sous le nom « les Trente Glorieuses », a débuté en 1945 après la Seconde guerre mondiale, et s’est poursuivie jusqu’au premier choc pétrolier en 1973.
Quasiment à la même période, la charte d’Athènes a été co-rédigée par Le Corbusier en 1933, puis a été reprise en 1957 dans une nouvelle version éprouvée par le CIAM-France45. Sur le papier, les idées mises en place par Le Corbusier séduisent et fonctionnent. Toutefois, il semble que cette architecture trouve ses limites. D’une part, car c’est « dans ce haut degré de perfectionnement même, qui la disqualifie lorsque l’industrialisation de la construction exige de nouveau critères de productivité, des plans plus simples et répétitifs »46. D’autre part, car elle se heurte à des réactions qu’elle n’avait pas anticipées d’un point de vue social et culturel. L’architecture semble ne pas pouvoir suivre le rythme effréné de la croissance que l’on pense alors infinie, résultant d’une insolubilité de l’architecture dans le gouffre du capitalocène. D’une part, ni les ressources, ni la main d’œuvre ne sont infinies et, d’autre part, cela semble être en rupture avec le besoin et la manière d’habiter d’une part grandissante de la population.
« Dans cette période de grande activité pratique, la production théorique passe au second plan ; la partie la plus active se déplace vers l’approche technologique des structures, et vers l’empirisme de réponses aux nouveaux problèmes fonctionnels (par exemple en Angleterre le rapport Buchanan, en 1963, sur la nécessité d’adapter la ville à l’automobile) »47 Durant la même période, « Team X » qui remet en cause la charte d’Athènes, s’inscrit en rupture avec le mouvement moderne. Les précisions autour de la fondation du groupe et de l’intégralité des protagonistes est difficile à circonscrire, toutefois, « Team X » ou « Team Ten » est reconnu encore aujourd’hui pour être l’un des premiers groupes à s’opposer aux idées de la charte d’Athènes. Les fondateurs sont Jaap Bakema, George Candilis, Rolf Gutmann et Peter Smithson, rejoints par la suite par d'autres architectes. En opposition au CIAM, le groupe crée son propre agenda. Le CIAM sera dissous en 1959, après un dernier congrès en 1956, sous la pression de Team X et leur exigence d’alternatives. L’après-guerre, qui est caractérisée en France par les Trente Glorieuses, a permis aux architectes de remplir exponentiellement leur carnet de commandes et a inscrit leur travail dans une démarche davantage pratique que théorique. Or, l’architecture nécessite aussi de la théorisation, surtout lorsque l’on sait qu’elle était en pleine transformation avant la guerre, avec un courant moderne pas certain de son évolution. Finalement, la politique de reconstruction mise en place par les politiques a été le
45
Congrès International d’Architecture Moderne 46 MONNIER Gérard, « De la reconstruction a la croissance (1945-1975) », dans : Gérard Monnier éd., L'architecture du XXe siècle. Paris cedex 14, Presses Universitaires de France, « Que sais-je ? », 2000, p. 74104.URL : https://www.cairn.info/ 9782130507598-page-74.htm 47 Ibid.
23
théâtre d’un essai national et formel. C’est en cela que résulte un manque de recul qui a potentiellement amené à certaines catastrophes, comme celle des grands ensembles. En un sens, cela apparait dommageable, dans la mesure où l’on a mis les habitants dans une situation de vulnérabilité. D’autre part, l’on a fait face à une rénovation, parfois à de multiples reprises, de certains de ces bâtiments. L’énergie grise utilisée a de ce fait été plus importante que cela n’aurait été le cas, si le bâtiment avait été, dès le départ, de meilleure facture. L'énergie grise d'un bâtiment désigne l'énergie consommée tout au long de son cycle de vie, depuis sa construction jusqu'à sa démolition. L'énergie grise d'un bâtiment peut être influencée par plusieurs facteurs, tels que les matériaux de construction utilisés, l'efficacité énergétique des équipements et des dispositifs, et les habitudes de consommation d'énergie des occupants. En choisissant des matériaux durables et écologiques, en construisant des bâtiments efficaces en termes d'énergie et en encourageant les occupants à adopter des comportements éco-responsables, il est possible de réduire l'énergie grise d'un bâtiment et son impact sur l'environnement.
Certaines barres ont, quant à elles, simplement été détruites, puisque la simple rénovation ne pouvait suffire à l’amélioration de critères purement sociaux. Aujourd’hui encore, une part des acteurs de la construction reste inscrit dans un système de croissance exponentielle, et pense que démolir est la meilleure solution, alors que les changements climatiques et écologiques nous rappellent à l’ordre
1.1.2.b. Exemple d’alternative : le cas d’Ivry sur Seine par l’Atelier de Montrouge.
Dans le cadre de ces premiers facteurs historiques, l’habitant lui-même semble exempt de tout pouvoir, tandis que des groupes contestataires du CIAM et de la charte d’Athènes semblent s’interroger davantage sur le sort des habitants. Pendant que Le Corbusier, assisté des politiques, pensait reconstruire massivement la France, d’autres œuvraient pour des constructions de collectifs plus raisonnables et davantage tournées vers la maitrise d’ouvrage. C’est le cas du centre-ville d’Ivry sur Seine, théâtre d’expérimentations édifiées des années 1970 au milieu des années 1980 et commandées par la municipalité. Ces constructions se présentent comme « des alternatives à la production courante du moment »48. Il était donc possible de faire autrement. En tout cas, c’est ce que Jean Renaudie, l’un des fondateurs de l’Atelier de Montrouge, a tenté de proposer en se détachant des préceptes influencés par Le Corbusier, avec lequel il avait pu collaborer. L’on peut alors s’interroger sur la raison qui pousse à suivre un modèle plus qu’un autre, en l’imposant comme dogme absolu. Les raisons étaient-elles de croire en l’utopie des préceptes proposés par Le Corbusier ? Ou bien étaitce parce que l’immixtion de l’architecture en politique a favorisé un modèle plutôt qu’un autre ? Ce questionnement a son importance pour se prémunir de dérives lors de la recherche d’un nouveau processus ou modèle à suivre. Il sera intéressant de garder ce questionnement en fond de réflexion afin que, le moment venu, nous puissions en faire rejaillir l’intérêt. Peut-être qu’en évitant de voir la solution comme une issue unique, l’on pourrait davantage considérer que la diversité permet de ne
48 CHALJUB Bénédicte , Lorsque l’engagement entre maîtrise d’ouvrage et maîtres d’œuvre encourage l’innovation architecturale : le cas du centre-ville d’Ivry-sur-Seine, 1962-1986, Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique, 109 | 2009, 77-94
24
pas commettre les mêmes erreurs que dans le passé ? En tout état de cause, c’est à l’échelle de notre territoire français- que les conséquences se découvrent.
Si les Trente Glorieuses ont été synonymes de plein emploi et de croissance du pouvoir d’achat, l’on constate également que c’est le politique qui tire les ficelles, dans une situation où l’urgent primait sur la réflexion et la consultation des tiers, l’architecte bénéficiant de cette situation dans une commune mesure, puisqu’il était assuré d’obtenir des commandes sans avoir à user de moyen de communication.
25
1.2. Un va et vient de réformes déconnectées de l’usager
1.2.1
Expérimentation à l’échelle réelle dont l’usager est exempt
L’on peut observer une certaine dualité entre l’évolution de la pratique architecturale qui, n’étant soumise qu’à peu de contraintes, prend son essor dans l’une des formes les plus monumentales qu’elle n’ait jamais connu, et ce besoin de se réapproprier le logement après l’échec de la reconstruction de masse éprouvée par Le Corbusier.
Des années 1960 jusqu’aux années 1970, la construction de grands ensembles a prospéré et transformé les paysages urbains. Ces derniers sont apparus comme une solution rapide et efficace face aux crises du logement et à l’insalubrité de l’époque. Ce phénomène a vu le jour à la suite de prises de décisions politiques. Alors que la reconstruction de la ville s’opérait lentement depuis dix ans, il était déjà coutume qu’une politique nouvelle s’instaure en condamnant la précédente. C’est ce qu’affirme Annie Fourcaut : « les concepteurs des grands ensembles n’ont pas procédé autrement avec les lotissements défectueux de l’entre-deux-guerres, anti-modèle d’urbanisme »49. La construction de grands ensembles a donc été avant tout une démarche politique. S’il n’existe pas de définition en tant que telle, cette forme urbaine est reconnue aujourd’hui comme l’une des plus marquantes de cette période de reconstruction. Elle s’identifie par la caractéristique d’un « aménagement urbain comportant plusieurs bâtiments isolés pouvant être sous la forme de barres et de tours, construit sur un plan-masse constituant une unité de conception. Il peut être à l’usage d’activité et d’habitation et, dans ce cas, comporter plusieurs centaines ou milliers de logements ».50 Le plus souvent situés en périphérie d’agglomération, les grands ensembles se veulent inspirés de « l’architecture moderne influencé par la Charte d’Athènes »51, dont la principale influence est le fonctionnalisme.
Si Le Corbusier, avec la cité Radieuse, reste incontestablement le plus connu et prend à l’heure actuelle un nouvel essor grâce à une forme de spéculation artistique, son modèle reste largement décrié. Même si ses intentions de grands ensembles, résolvant les défis de la ville nouvelle avec des espaces décollés du sol, semblaient louables, il n’y eut que des opérations de massification ponctuelle, qui ne lui permirent pas de mettre sa théorie totalement et définitivement en pratique. La classe populaire fut la première à être touchée par la crise du logement et c’est donc à cette classe sociale que fut destinée la forme urbaine des grands ensembles. L’usager fut, là aussi, exempté de participation dans ce processus d’élaboration d’une ville nouvelle. Ce dernier fut alors qualifié comme « élaboration expérimentale de nouveau procédés de construction »52. C’est alors que pour la première fois en France, les politiques publiques ont poussé à « mettre en œuvre une taylorisation des processus de production : division extrême des tâches (ingénieurs, architectes, terrassiers, maçons), chronométrage
49 FOURCAUT Annie, « Débats et réalisations de l’entre-deux-guerres ou le lotissement comme anti modèle », dans DanièleVoldman (sous la direction de), Les origines des villes nouvelles de la région parisienne (1919-1969), Les Cahiers de l’IHTP, no 17, décembre 1990, p. 11-21;
50 GAUTHIEZ Bernard (dir.), Espace urbain, vocabulaire et morphologie, Edition du Patrimoine, Collection Vocabulaire, 2003, p 86
51 PAQUOT Thierry, Désastre urbains Les villes meurent aussi, Edition La Découverte, Paris, 2015, 2019, p 295
52 LEGOULLON Gwenaëlle, « La construction des grands ensembles en France : émergence de nouvelles vulnérabilités environnementales », VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement [Online], Volume 16 numéro 3 | décembre 2016, consulté le 11 Aout 2022. URL : http://journals.openedition.org/vertigo/17984 ; DOI : https://doi.org/10.4000/vertigo.17984
26
des ouvriers, intensification des rythmes de travail, rationalisation et planification méticuleuses des chantiers »53. Finalement, nous verrons dans cette étude que ce système lui-même montre des faiblesses aujourd’hui. A posteriori et avec un recul de plus d’un demi-siècle, les conclusions pouvant être tirées de la fin de cette politique des grands ensembles montre cette solution de reconstruction comme éphémère face à la crise du logement. Dans les faits, derrière ce processus de production se cachaient des phénomènes complexes n’étant pas pris en compte. Les plus fréquents furent l’accumulation de problèmes liés à l’éloignement des centres urbains et à la ghettoïsation de la classe à la fois populaire et multiculturelle, le tout présentant une hétérogénéité irrésolvable.
Figure 2 « J’ai grandi dans un H.L.M » – Zoé 54 53 Ibid. 54 ZOÉ. Le mot du jour [en ligne]. 10 juin 2016 [consulté le 8 avril 2022]. Disponible sur : http://www.lemotdujour.org/blog/2016/6/8/1j4d5p5azsnat0l0hhopx1qu1lg2l1

27
Au début des années 1970, les politiques publiques lancent la circulaire « ni tour, ni barre », mettant ainsi fin aux grands ensembles. Si les politiques de reconstruction d’après-guerre ont nécessité de rebâtir autant les infrastructures publiques que les habitats, c’est le sort de l’habitant qui est resté au cœur des préoccupations dans les crises majeures que le pays a traversé pour se reconstruire. Si les infrastructures servent au bien commun, il faut d’abord qu’il y ait une communauté. Pour qu’il y ait une communauté, il faut que les besoins de première nécessité soient accomplis, la possibilité de s’abriter en étant un. L’habitant ne devrait-il pas d’ailleurs être toujours au cœur du sujet ? Tant dans le questionnement de son logement que dans les infrastructures qu’il pratique et de surcroit qu’il « habite » ?
« Une société unie n'est pas une société sans différences, mais une société sans frontières intérieures »55 D’une part, l’architecture est influencée par l’héritage de la ville post-industrielle, dont le fonctionnement est basé sur le capitalisme, la croissance, la consommation et l’uniformisation D’autre part, la désunion entre les personnes qui bâtissent la société et celles qui la fondent, fait état d’un certain dysfonctionnement de notre société.
Nous avons intégré aujourd’hui qu’on ne pouvait plus entasser les individus aléatoirement sous le même toit, dans des espaces standardisés qui, faute de correspondre à une majorité, finissent par ne plus correspondre à personne.
55 Citation d’Olivier Guichard, ministre de l’Équipement et du logement, le 21 mars 1973, par Thomas Snégaroff, 21 mars 1973 : fin de la construction de grands ensembles,Histoired’info,RadioFrance,Publiéle 15janvier 2015, URL : https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/histoires-d-info/21-mars-1973-fin-de-la-construction-degrands-ensembles_1769827.html
28
1.2.2 Basculement des grands ensembles aux zones pavillonnaires
1.2.2.a. Le rêve de la maison individuelle, un faux modèle de liberté
D’une certaine manière, le problème des villes ne provient pas nécessairement de l’étalement urbain engendré par leur métropolisation. C’est aussi la question de la gestion du patrimoine existant, car nous devons partir d’un constat, celui de notre patrimoine. « Au 1er janvier 2017, la France, hors Mayotte, compte 35,7 millions de logements. Les résidences principales représentent 82,1 % du parc, les résidences secondaires et logements occasionnels 9,5 % et les logements vacants 8,4 %. Le parc progresse tendanciellement, sur un rythme de 1,1 % par an. Il se répartit entre 56 % de logements individuels et 44 % de logements collectifs. »56. La maison individuelle est une part conséquente du parc des logements, qui en représente un peu plus de la moitié. D’ailleurs, « dans la plupart des cas, le noyau urbain originel des villes ainsi que les formes primitives de leurs extensions ont d’abord eu recours massivement à la maison urbaine, et que l’immeuble n’est finalement que la forme tardive d’architecture résidentielle »57
Ce modèle est ancré sur notre territoire et dans notre société La maison est synonyme d’idéal pour encore de nombreuses personnes. Même sans habiter une maison, l’expression « rentrer à la maison » est d’usage commun. Toutefois, alors que cette figure de la construction du logement individuel prédomine et que les tentatives d’hybridation dans des grands ensembles ont échoué, les politiques relancent à nouveau les cartes vers le développement de secteurs pavillonnaires.
Ainsi, au début des années 1970, les acteurs politiques abandonnent les projets de grands ensembles, prohibant désormais ce type de forme urbaine, en encensant à nouveau la maison individuelle à travers le projet de zone pavillonnaire. Si l’on pourrait croire à un retour en force de la maison et de l’espace rural tel qu’on l’avait connu avant le courant moderniste, il est singulièrement différent. Les maisons individuelles ne s’organisent plus le long de rues principales ou secondaires, elles sont parquées dans des zones pavillonnaires, aussi appelées lotissements. La maison individuelle a en son pouvoir une certaine « reconnaissance sociale »58 et par les aspirations auxquelles elle ramène, lui permettent de connaitre un large succès, quelles que soient sa proximité urbaine et son organisation spatiale. Les conséquences du fractionnement entre l’espace de vie, l’espace de loisir et l’espace de travail ne sont pas immédiates, et pourtant, la maison pourrait représenter l’empreinte de la société postmoderniste.
56 Logement − Tableaux de l’économie française, Edition INSEE Références en ligne, Consulté le 19 janvier 2022, Consultable sur https://www.insee.fr/fr/statistiques/3303460?sommaire=3353488 (Logement − Tableaux de l’économie française, s.d.)
57 (MAGNAGHI, 2000, Édition française 2003) p15
58 TAPIE Guy, Maison individuelle, architecture, urbanité, Edition de l'Aube, La Tour d’Aigues, 2005, 253 p
29
1.2.2.b. De la réussite sociale…
Le pavillon présente, par son nom lui-même, une caractéristique à part de l’habitat individuel. Il signifie qu’il fait partie d’un ensemble pavillonnaire. La définition peut en être donnée ainsi : « Maison individuelle d’habitation, généralement entourée d’un terrain, que l’on trouve en zone rurale ou dans certains quartiers (le plus souvent périphériques) des grandes villes »59
Le fait qu’il soit sectorisé dans un ensemble de pavillons le ramène, dans une certaine mesure, à la condition des grands ensembles qui forme une ségrégation économique et sociale avec le reste de l’espace urbain. En éloignant les gens des lieux où ils travaillent ou encore de ceux où ils consomment, on les prive d’une certaine forme de liberté. En effet, s’ils pensaient avoir une « tranquillité sociale »60 , dont ils étaient dépourvus dans les grands ensembles, ils sont désormais contraints à l’usage quasisystématique de la voiture. En même temps qu’elle s’est développée, la maison individuelle a d’abord « matérialisé une ascension sociale »61. Puis au fur et à mesure, des changements sont apparus et l’ont désacralisé. Elle est alors devenue « une sorte de normalité sociale »62. Même si la maison se banalise, elle jouit d’un atout non égalable pour l’habitant en ce qu’elle lui permet d’en faire son « œuvre », « d’affirmer son identité personnelle, bref d’inscrire sa singularité dans le monde social »63. Elle permet également à l’habitant d’en assurer la construction, et donc de procéder à une auto-construction.
Figure 3 GENDRIN. En finir avec le rêve d’une « maison avec jardin » ? –Prendre Parti. [consulté le 14 décembre 2022]. Disponible sur : https://www.prendreparti.com/2022/02/17/en-finir-avec-le-reve-dunemaison-avec-jardin/

59 CNRTL (Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales), Définition 4.d), consulté le 16 Aout 2022 sur https://www.cnrtl.fr/definition/pavillon
60 (TAPIE, 2005)
61 Ibid.
62 Ibid. 63 Ibid.
30
1.2.2.c. …à la standardisation à grande échelle, le modèle des Chalendonnettes
La maison individuelle peut se décrire « au sens propre du terme, [par] quatre murs et un toit, ou habitent 63% d’entre nous » 64 comme l’évoque Camille Crosnier dans sa chronique « Le pavillon : rêve ou cauchemar ? »65, dont le modèle semble dépassé pour des raisons écologiques, économiques et sociales.
En 2005, Jean-Louis Borloo lance les maisons à 100 000 euros66. Ce dispositif devait favoriser l’accession à la propriété. En effet, comme la crise du logement ne semblait toujours pas réglée, l’objectif était de construire 20 000 à 30 000 maisons par an. Cinq ans plus tard, l’opération a touché à sa fin et seulement 800 maisons ont été construites, sans avoir respecté la promesse de coût. D’autres projets virent le jour, tels que les Chalendonnettes, du nom du Ministre de l'Equipement et du Logement en exercice de 1968 à 1972. Ils se caractérisent par des maisons individuelles souvent accolées et produites de manière industrielle. Bien que leur homogénéité soit apparente, leurs propriétaires ont exprimé pour la plupart que « leur maison n’est en rien semblable à celle du voisin »67 . En effet, chaque habitant se la réapproprie, en y laissant son empreinte par une modification de cloisonnement ou d’ornement ponctuel extérieur. Si la maison tendait à gommer les strates sociales autrefois marquées par l’habitat individuel et le logement en collectif, « la maison préfabriquée est un signe de distinction symbolique entre classes aisées et populaires ». À fa fin des années 1990, entre banalisation de la maison individuelle et évolutions des structures familiales, l’individualisation tend à conquérir de nouveaux territoires. En effet, « d’autres modèles de consommation et d’aspirations sociales sont venus concurrencer la sphère domestique. La maison n’est plus un objet suprême de désir, ni la seule voie de bonheur »68
64 CROSNIER Camille, GRISOT Sylvain, CHAUVIER Eric et HERENG Damien, Le pavillon : rêve ou cauchemar ? chronique le Débat de midi du 18 juillet 2022, consulté le 10 aout 2022. Disponible à l’adresse : URL https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/le-debat-de-midi/le-debat-de-midi-du-lundi-18-juillet-20225051771
65 Ibid.
66DE LEGGE Eric, Les maisons à 100 000 euros laissent un goût amer, Journal du net, Patrimoine, Immobilier, Publié le 7 avril 2011, Consulté le 11 Aout 2022, URL :
https://www.journaldunet.com/economie/immobilier/1083760-bon-plan-immobilier/1083783-les-maisons-a100-000-euros
67 (TAPIE, 2005)
68 Ibid.
31
1.2.2.d. Une artificialisation des sols non soutenable
Au sujet du rêve de la maison avec jardin, Camille Crosnier s’entretient et débat tour à tour avec une maire, un urbaniste, un anthropologue et le Président de la Fédération Française des Constructeurs de Maisons Individuelles (FFC). Cela n’est pas anecdotique car les débats autour des enjeux écologiques et architecturaux, outre le fait qu’ils soient sociétaux, marquent l’irruption d’une multitude de professions qui collaborent désormais avec le métier d’architecte. Il faut également voir là les conséquences de la division des tâches, conduites par les politiques lors de la reconstruction d’après-guerre. La multiplicité de ces acteurs est-elle fédératrice d’une prise en compte de multiples besoins, ou cela signe-t-il une rupture dans la relation entre l’architecte et l’habitant ? Patrick Bouchain est un architecte français connu pour ses travaux innovants et expérimentaux dans le domaine de l'architecture sociale et écologique. Né en 1953 à Paris, il inscrit sa pratique dans cette période des grands ensembles. Il confronte les principes du mouvement moderne à une production de travail fordiste, « qui ne prend pas en compte l’usager et l’histoire du lieu Il décide donc de consacrer son travail à la recherche de manières de « faire autrement » »69
En France, en 2021, ce sont environ 130 000 constructions de maisons individuelles qui sont sorties de terre. Depuis deux ans, ce chiffre est en augmentation de 15 à 20 % selon les régions. D’après Damien Hereng, le Président de la FFC, cette hausse s’explique par plusieurs raisons. D’une part, la crise sanitaire a matérialisé l’envie des Français de repartir en habitat individuel pour retrouver des espaces naturels avec un jardin, ainsi que de l’espace entre les individus. D’autre part, et d’une manière plus technique, l’évolution des normes thermiques avec l’entrée en vigueur de la RE2020 (Règlementation Environnementale 2020) a également poussé à l’accélération de dépôts de permis en fin d’année 2021, afin d’anticiper les surcoûts nécessaires à l’amélioration des constructions. Cette augmentation soudaine avait également pu être observée lors de l’entrée en vigueur de la RT2012 (Règlementation Thermique 2012).
Dans ces entretiens, le Président de la FFC a indiqué que le logement représente deux tiers de la consommation d’espace naturel agricole et forestier ces dernières années. La maison individuelle n’est pas la seule responsable de l’artificialisation des sols puisque, dans le secteur logistique, les projets sont peut-être moins nombreux, mais nécessitent des emprises importantes, de même que toutes les infrastructures y étant liées, telles que les emprises routières, ferroviaires, etc.
En tout état de cause, la société a ratifié le fait que l’artificialisation des sols par l’étalement des espaces ruraux et péri-urbains n’est plus soutenable. En ce qui concerne la dimension éthique, il semble qu’elle ne soit pas encore, à ce stade, au centre des préoccupations de tous. Et c’est peut-être de cette manière que les projets alternatifs vont pouvoir apporter un regard nouveau en proposant, grâce à leur expérience non-ordinaire, des conditions de réalisation des projets pouvant mener vers une architecture plus éthique.
69 TOUBANOS, Dimitri. Concevoir et construire autrement, pour une société durable : l’expérience participative de Lucien Kroll et Patrick Bouchain, École Nationale des Travaux Publics de l’État [ENTPE] et École nationale supérieure de l’architecture de Lyon (ENSAL), Jan 2017, Vaulx-en-Velin, 9 p
32
2. Une rupture multiple
2.1 Densité et étalement urbain
2.1.1
Rapport à l’hectare
Alors que l’on entend largement parler du phénomène d’étalement urbain qui vise, encore une fois, à faire culpabiliser l’individu et son rêve de maison individuelle, il semble important de relativiser ce propos par l’étude de la densité urbaine. Pour cela, deux représentations graphiques qui semblent opposables, peuvent toutefois s’avérer complémentaires afin de clore le débat entre grands ensembles et habitats individuels. Les études menées portent sur la densité des logements sur un hectare en comparant les résultats en fonction des formes urbaines.
Dans cette première représentation, si elle est donnée hors contexte comparatif, on peut conclure que l’habitat individuel joue le rôle du mauvais élève.
Figure 4 Forme d’habitat et niveau de densité 70
70 CAUE93 – FORESTIERMarie,RENAULTStéphane.ÉtuderéaliséeparleCAUEpourledépartementsurladensité pavillonnaire en Seine-Saint-Denis. Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement - 93 [en ligne]. [Sans date] [consulté le 6 avril 2022]. Disponible sur : https://www.caue93.fr/media/download/7799
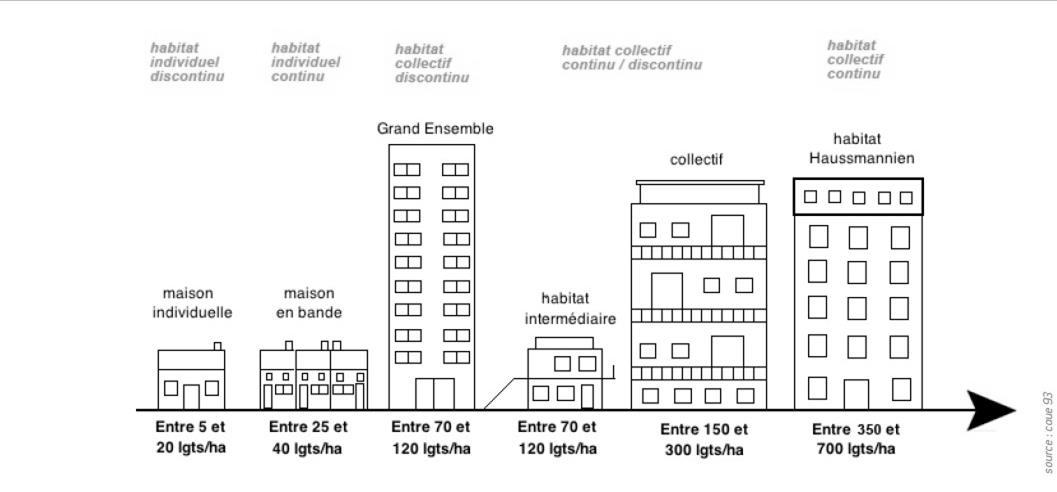
33
Dans cette seconde représentation de la densité urbaine à l’hectare, on peut observer qu’un grand ensemble nécessite des parkings et des abords mettant en perspective le recul nécessaire aux bâtiments de grande hauteur. Les grands ensembles peuvent donc, sur cet exemple, être consommateurs d’espace au même titre que les autres types d’habitats auxquels ils sont comparés. « La perception de la densité est l’élément clé. Elle est souvent perçue de manière péjorative, étant synonyme de concentration, de promiscuité, voire de pollution, de bruit, et de congestion, tous les maux urbains lui sont associés. Le dense est quasiment systématiquement associé au collectif de grande taille, à la hauteur, à la citoyenneté, au logement social et aux grandes barres de banlieue représentatives de l’échec des collectifs des années 70, synonymes de dysfonctionnements sociaux. Le collectif renvoie à la peur de l’entassement, et à la perte d’intimité »71

71 DREAL BRETAGNE. La densité et ses perceptions. Modalités de calcul de la densité. [en ligne]. [12 Juillet 2013] [consulté le 22 avril 2022]. Disponible sur : https://www.bretagne.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/14_09_05_Rapport_sur_les_perceptions_et_les_modalites_de_calcul_de_la_densite _cle2c9252-2.pdf
72 DUQUE GÓMEZ, Catalina. Densité urbaine, Cités Territoires Gouvernance (CITEGO). CITÉS TERRITOIRES GOUVERNANCE Le territoire au cœur de la transition [en ligne]. Décembre 2015 [consulté le 22 avril 2022]. Disponible sur : https://www.citego.org/bdf_fiche-notion-1_fr.html
34
Figure 5 La même densité peut prendre des formes bien différentes – Source : Vivre en Ville, adapté de Urban Task Force, Towards an urban renaissance, 199972
Les habitats purement individuels en forme discontinue sont absents de la comparaison, car celle-ci met l’accent sur la représentation de la densité sur une même valeur. Devrions-nous alors parler plutôt de densité perçue ou d’intensité ? La notion de densité supporte le poids de la mauvaise expérience. De fait, « on a souvent une vision un peu restrictive de la densité, elle est associée uniquement à un indicateur chiffré, alors qu’en réalité elle est bien plus riche que cela. Elle fait référence à un aménagement réfléchi et de qualité de l’espace, c’est pourquoi on pourrait plutôt parler d’intensité »73 . En voulant à tout prix supprimer la maison individuelle, c’est une fausse chasse aux sorcières qui s’opère. « Ce n’est pas la maison individuelle qui pose un problème, cela dépend où on la construit. Ce qui pose un problème, c’est ce qu’il y a de garé devant le garage. Ce n’est pas tant l’emprise au sol de la maison qui pose soucis en matière d’artificialisation, que finalement tout le système qu’il y a autour de ça. C’est le modèle pavillonnaire sous-entendu la mise à distance et l’impression de liberté qui se retourne contre les acquéreurs, qu’on perd au moment où on s’est mis à distance de la ville et de l’emploi »74
73
DREAL Bretagne, La densité et ses perceptions. Modalités de calcul de la densité, Linistère de la Transition écologique, 2013, 32 p 74 GRISOT Sylvain (CROSNIER Camille, 2022)
35
2.1.2 Le pavillon, un faux sentiment de liberté
Dans l’étude suisse ci-dessous, un graphique illustré nous permet d’observer, à l’aide d’une première courbe, la diminution du taux de motorisation lorsque la densité de population croit. La seconde courbe évoque la mixité fonctionnelle (rapport d'emplois par habitant) en fonction de la densité humaine. En s’intéressant à la lecture des données de la première courbe, on constate qu’à partir d’une densité de 200 habitants par hectare, le taux de motorisation chute difficilement sous les 300 véhicules pour 1000 habitants. Cela représente environ un véhicule pour 2/3 des ménages.

75
Si la maison individuelle peut donner un sentiment de liberté, quel est-il vraiment et quel pouvoir est vraiment aux mains des habitants ? Finalement, la polarisation programmatique des métropoles aussi bien que la création de cités dortoirs des zones pavillonnaires créent des contraintes endémiques. Pour Jankélévitch, philosophe de la période moderniste et postmoderniste, la première constatation est que « la liberté n'est pas quelque chose qui est, au sens où la liberté n'est pas un état, quelque chose qu'on peut posséder »76. En tant qu’immatérielle, ce n’est pas non plus quelque chose qu’on peut octroyer, « la liberté n'est rien, qu'elle n'est pas, mais qu’elle sera. Qu'elle n'existe pas, mais qu'elle devient. Autrement dit, la liberté est libératrice. Elle est une dynamique de libération »77
En d’autres termes, la liberté comprend du mouvement, un changement d’état, une certaine mobilité de l’être, de la situation. La dimension du contexte a son importance puisque « à l'inverse, je peux ne pas être techniquement libre, car ce sont essentiellement des critères qui relèvent d'un théâtre social, économique, historique, et l'être totalement à l'intérieur de moi, parce que je suis en chemin vers cette liberté »78 De cette manière, par analogie et par l’indexation d’un mouvement en marche, le projet alternatif et ses modes d’habiter peut-il nous amener vers une forme de liberté ?
75 TRIBU architecture, Quelle densité ?dans densification qualité ville. Densité [en ligne]. 4 mai 2015 [consulté le 15 avril 2022]. Disponible sur : http://www.densite.ch/fr/blog/quelle-densite
76 FLEURY Cynthia, Pour Jankélévitch, la liberté n’existe pas, mais elle devient, dans la chronique « un été avec Jankélévitch, France Inter, 12 Aout 2022, 4 min. Disponible sur https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/un-ete-avec-jankelevitch/un-ete-avec-jankelevitch-duvendredi-12-aout-2022-9382531, consulté le 12 aout 2022.
77 Ibid.
78 (FLEURY, 12 Aout 2022)
36
Figure 6 Courbes de tendance du taux de motorisation
2.2 Regard critique et rupture avec le territoire
2.2.1 Le diagramme de Jencks comme outil critique
En 1973, Charles Jencks, célèbre critique d’architecture, s’applique à suivre le parcours d’architectes, dénombrant leurs travaux tout en en analysant certains, et les classifie selon certains critères. Il créé alors le Diagramme de Jencks, connu sous le nom de « L’arbre évolutionniste de l’architecture »79 . Ce support visuel propose un schéma au lecteur qui lui permet d’appréhender l’évolution de l’architecture. Le diagramme a fait l’objet de rééditions et a été complété quelques années plus tard, pour finalement s’étendre sur toute la période du XXème siècle. D’après la monographie qui s’intéresse à l’histoire de Charles Jencks, « les schémas de l’évolution de l’architecture possèdent une dimension politique propre. L’œuvre architecturale est politique car elle « cristallise le domaine public » ; elle « influence d’une façon vague [mais] significative ses habitants » ; elle est reliée à un pouvoir - étatique, économique ou autres - par les étapes de sa création »80 .
Vers la fin des années 1970, le diagramme de Charles Jencks est marqué par l’importance du postmodernisme, qui est d’abord un courant artistique et rappelle la connivence avec l’architecture.
L’approche du mouvement architectural moderne et postmoderne peut sembler être une réponse holistique en matière d’habiter l’espace. Seulement, cela passe par une architecture qui se détache de son milieu et de son histoire, effaçant peu à peu toute diversité. Charles Jencks attachait de l’importance à la pluralité des récits et du monde. De ce fait, il appelait le lecteur à porter un regard critique sur l’architecture de son siècle. De plus, il a « produit des documents qui portent en eux la volonté de s’approcher du Réel, des multiples dimensions de notre monde tangible, et qui affirment la volonté de faire appel au pouvoir critique du public, des architectes particulièrement »81. Ce document graphique montre également à quel point l’enchevêtrement des filtres (« logical, idealist, selfconscious, intuitive, activist, unself conscious 80% of environment »82) permet de recroiser des informations pour décortiquer les mouvements dans leurs époques. L’intervention de Charles Jencks vient marquer l’intérêt de replacer le public dans les débats afin de le faire participer, avec l’architecte, au regard critique porté sur son temps. De même, elle l’invite, d’une certaine manière, à se questionner sur les choix possibles de son avenir, en toute connaissance de cause.
80 Ibid. 81 Ibid.
82 Extrait du diagramme de Charles Jencks, Iconographie « Figure 2 », 2007 (ROELS, 2009)
37
79 ROELS Christine, Charles Jencks, Oeuvre, histoire et fortune du critique d’architecture, Travail de Fin d’Etudes, Institut Supérieur d’Architecture de la Communauté Française – La Cambre, Bruxelles, 2009, p 152

38
Figure 7 ROELS Christine, Charles Jencks, Oeuvre, histoire et fortune du critique d’architecture, Travail de Fin d’Etudes, Institut Supérieur d’Architecture de la Communauté Française – La Cambre, Bruxelles, 2009, p 152
2.2.2 Une rupture de la société avec son territoire
2.2.2.a. Métropolisation & polarisation des villes
« Au début des années 1990, l’urbanisation, qui était née avec la révolution industrielle, se déploie, dans un contexte de globalisation, d’internationalisation et de mondialisation, sous la forme d’un processus de métropolisation »83. Les raisons principales de ce phénomène s’expliquent par le développement du secteur tertiaire et de sa faculté à créer de l’emploi, profitant aux territoires des métropoles. On observe également, par la division des tâches dans le travail, la multiplication croissante des métiers. Les familles profitent alors de l’urbanisation croissante des villes pour jouir de la diversification des métiers proposés sur le marché. Cette mondialisation se concentre dans les métropoles, afin de créer un maillage de connexions, une mobilité entre métropoles dans un cercle au départ fermé sur elles-mêmes. Les métropoles cristallisent ainsi l’opportunité de concentrer de multiples fonctions.
Avec la métropolisation et la polarisation de la ville, la distance entre les infrastructures s’est accrue, avec pour conséquence une certaine rupture au sein des agglomérations. Il en résulte que la population travaille en grande partie pour financer les déplacements justement destinés à se rendre au travail. Pour André Gorz, qui soutient les idées d’Ivan Illich, « les usagers briseront les chaînes du transport surpuissant lorsqu’ils se remettront à aimer comme un territoire leur îlot de circulation et à redouter de s’en éloigner trop souvent »84 Il ajoute : « Mais précisément, pour aimer « son territoire » il faudra d’abord qu’il soit rendu habitable et non pas circulable : que le quartier ou la commune redevienne un microcosme modelé par et pour toutes les activités humaines, où les gens travaillent, habitent, se détendent, s’instruisent, communiquent, s’ébrouent et gèrent en commun le milieu de leur vie commune »85 .
2.2.2.b. Perte d’identité et immédiateté
Nous avons vu que certains acteurs tentaient d’ouvrir la voie vers des alternatives aux manifestations hégémoniques. Le postmodernisme n’est-il alors qu’une évolution du modernisme ? « Les même formules typologiques, résultantes d’une uniformisation de la culture architecturale, se répandent. Habitat et équipement sont, avec les lieux de travail du secteur tertiaire, les grandes catégories qui dominent, non seulement la production mais aussi la conception »86. L’industrialisation a permis des innovations en matière de construction, permettant de s’affranchir des contraintes, avec des trames porteuses fines. Ce phénomène a permis de constituer la figure caractéristique du modernisme avec le dispositif du « mur-rideau », obtenant ainsi de grands plans libres. Finalement, de manière générale, l’architecture a fini par ne plus avoir de liens avec son territoire. Cette rupture avec le territoire n’est pas sans conséquence. « L’affranchissement progressif à l’égard de l’ensemble des contraintes territoriales (déterritorialisation) génère une ignorance croissante de la relation primordiale qui lie l’établissement humain à son environnement. Autrement dit, il entraîne une
83 DUMONT Gérard-François, « Une idéologie de la métropolisation ? », Population & Avenir, 2015/2 (n° 722), p.3-3. DOI : 10.3917/popav.722.0003. URL : https://www.cairn.info/revue-population-et-avenir-2015-2-page3.htm
84 GORZ André, Ecologica, Editions Galilée, Paris, 2008, 158p 85 Ibid.
86 (MONNIER, 2000)
39
amnésie territoriale et nous contraint à vivre dans des sites indifférents, dont le rôle se limite à servir de support aux fonctions d’une société instantanée, qui a subitement rompu toute relation avec l’histoire et la mémoire des lieux »87 . Ainsi, Alberto Magnaghi explique que, de cette manière, « la ville interrompt le processus qui engendre le paysage en garantissant sa reproductibilité et son identité »88 La perte d’identité est-elle alors liée à la perte de sens qu’évoque André Gorz dans son ouvrage Ecologica, à propos de la division du travail sous les influences d’une société « capitalocène » ?
« Le régime métropolitain prend appui sur un système de villes et le prolonge. Il semble néanmoins important de le distinguer du précédent, car il est l’expression territoriale d’un autre mode de développement économique, non plus industriel mais cognitif. On entre alors dans une civilisation communicationnelle, au sein de laquelle l’économie n’est plus centrée sur la fabrication, mais sur l’information et la communication. C’est l’avènement de l’immédiateté »89 . C’est notamment ce phénomène qui vient marquer la différence entre modernisme et postmodernisme. La déterritorialisation générée vient marquer une rupture, non pas seulement entre la ville et son territoire, mais également avec la société et les individus qui habitent le territoire. Cependant, le tournant que le postmodernisme a tenté de prendre ne semble pas clairement définir sa raison d’être, ni être marqué par un courant de pensée tranchant avec celui qui l’a précédé.
87
88 Ibid.
89 TALANDIERMagali,Résiliencedesmétropoleslerenouvellementdesmodèles,EditionLesConférencesPOPSU, conférence prononcée lors de l’atelier Résilience et alliance des territoires des Troisièmes journées nationales de France Urbain, le 28 mars 2019 à Toulouse, 2019
40
MAGNAGHI Alberto, Le projet local, Torino, 2000, Édition française 2003 Pierre Mardaga Spritmont (Belgique)
2.2.3 De l’ordre compliqué à l’éthique architecturale
On retrouve ici une forme d’ambivalence, semblable à « l’ordre compliqué »90 qu’évoquait Yona Friedman, avec des réalités enchevêtrées. Ce dernier évoquait, dans ce cadre, « une société composée d’individus uniques et irremplaçables, dont les actes ne sont pas nécessairement rationalisables. Cet ensemble d’individu (société) résulte de la communication reliant les individus, comme une sorte d’ondes d’impulsions. Chaque individu est le centre de la société »91. Yona Friedman décrit la société comme un « univers erratique ». Celui-ci peut se définir comme Erratique au sens « A.− [Dans l'espace] Qui erre, qui n'a pas de localisation fixe. B.− [Dans le temps] Qui n'est pas constant, qui est discontinu, intermittent »92. Cet ordre compliqué au sein de l’univers erratique nous rappelle une évidence de la diversité et de la pluralité dont sont faits le monde et les individus.
Pour proposer une architecture libératrice, dans une société compliquée, il semble qu’aucune solution ne puisse être écartée, car c’est en leur sein, par leur pluralité, que les solutions permettront aux individus de se trouver dans une dynamique de libération Ainsi, cela permettra de manifester, chez l’individu et la société, « une exigence d'accomplissement, un pouvoir faire, une volonté de faire. "Notre premier devoir est donc un devoir faire." »93 De cette manière, l’individu est inclus dans le processus et devient « co-responsable de tout l'avenir du monde »94. Ce processus de co-responsabilité permet d’initier, d’espérer la quête d’un monde meilleur, généré au moyen d’un processus de mobilité architecturale, permettant l’évolutivité des infrastructures en y conciliant les besoins de l’habitant.
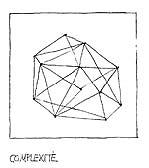
90
FRIEDMAN Yona, L’ordre compliqué et autres fragments, Edition l’Eclat, Paris, 2020 (première édition 1958), 144p 91 Ibid. 92 (Lexicales) Consulté le 21 août 2022 sur https://www.cnrtl.fr/definition/erratique 93 (FLEURY, 12 Aout 2022) 94 Ibid.

41
Figure 8 Illustration de Yona Friedman84
Partie
Vers une Gouvernance Adaptée, une Transition par les Projets Alternatifs

2
1. Gouvernance horizontale, vers une architecture éthique
1.1. La fin d’« un monde pauvre » d’après Yona Friedman
« La valorisation du capital repose de plus en plus sur des artifices, de moins en moins sur la production et la vente de marchandises »95. Cela s’illustre notamment par l’avènement des réseaux sociaux, des métiers de communications, de l’engouement pour la crypto-monnaie, etc. Toutes ces choses sont impalpables et donc instables sur le très long terme, dans la mesure où ces phénomènes sont de moins en moins mesurables en termes de valeur d’échange. Cela met en évidence la fragilité du système sur lequel repose notre société. Paradoxalement, notre société n’a jamais été autant tournée vers la notion et la recherche d’épanouissement et de bien-être. Il semble donc que « la décroissance de l’économie fondée sur la valeur d’échange a déjà eu lieu et s’accentuera. La question est seulement de savoir si elle va prendre la forme d’une crise catastrophique subie ou celle d’un choix de société autoorganisée »96 .
En 1976, Yona Friedman, architecte théoricien précurseur, a écrit de nombreux ouvrages théorisant les phénomènes et processus que nous vivons actuellement. Il expliquait déjà que nos organisations étaient devenues trop grandes en termes de gouvernance, tout comme dans leurs formes urbaines, et qu'il existait trop d'intermédiaires entre le pouvoir et la population pour que les mesures préconisées soient appliquées ou applicables. En rapprochant le fait que « nous ne produisons rien de ce que nous consommons et ne consommons rien de ce que nous produisons »97, nous sommes alors en train de nous diriger vers ce que l’on peut appeler un « monde pauvre »98. De plusenplusde pénuries apparaitront si nous ne faisons rien. Pour Yona Friedman, la solution réside dans l’organisation de petits groupes qui réussiront à survivre en assurant leurs propres besoins. 95 (GORZ, 2008) 96 Ibid. 97 Ibid. 98 FRIEDMAN Yona, Comment habiter la terre, Editions l’éclat, Paris, 2016, 128p (première édition 1976)
43
Figure 11 Groupe critique hiérarchisé102
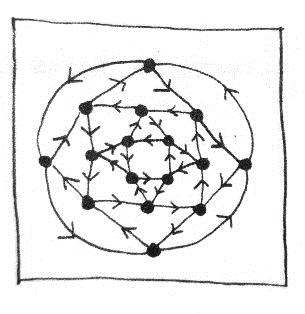

102

94
La domination de la société capitaliste et la politique de gouvernance actuelle font que « nos mécanismes habituels (gouvernance, organisations) sont trop grands, et il existe trop d‘intermédiaires chargés de transmettre l’information »99. Cela évoque la « taille des groupes critiques », théorisée dans l’ouvrage de « Comment vivre entre les autres sans être chef et sans être esclave ? »100 On y découvre que les groupes, pour fonctionner de façon optimale au sein de différents types de hiérarchie, ont quoi qu’il arrive une taille de groupe critique. A cet égard, il conclut qu’« aucun groupe égalitaire composé d’êtres humains (valence : 4, capacité de transmission : 6) ne peut avoir plus de 16 membres »101 Il ajoute que « le groupe critique hiérarchisé admet plus de 900 membres. (C’est un dessin partiel, car nous manquons de place pour compléter « la carte »). Un groupe qui dépassera la grandeur du « groupe critique » caractéristique pour la structure sociale qu’il désire 1) ou bien gardera sa structure et se divisera en deux groupes 2) ou bien changera sa structure »102 99 (FRIEDMAN, Utopies réalisable, 2015) 100 FRIEDMAN Yona, Comment vivre avec les autres sans être chef et sans être esclave, Editions Eclat Poche, 2016, Première édition Jean Jacques Pauvert,1974 101 Ibid. 102 Ibid.
44
Figure 9 Groupe critique égalitaire se divisant
Figure 10 Le groupe égalitaire de 16 membres
La domination d’une gouvernance unique et éloignée de la réalité des habitants et de leurs besoins semble donc être le frein et l’appauvrissement du monde dans lequel nous vivons. La sociétéprésente une capacité à s’auto-organiser,àautoproduire,àauto-planifier qui s’oppose à des désirs et des besoins formatés, « appauvris par l’omniprésence de propagandes commerciales et la surabondance de marchandises » 103
Retrouver des villes et des groupes de taille raisonnable permettant de traduire la taille des groupes critique, c’est une manière de prendre les qualités de l’espace rural, en l’adaptant à la ville afin d’en faire ré-émerger les qualités qui lui sont propres. Yona Friedman parle alors de « chercher d’autres alternatives quant à l’utilisation de nos villes »104.Cetteindépendanceetcettealternativeàlaville telle qu’on la connait est le « développement possible des villes en forme de villages urbains »105 . Il propose des processus « d’autoplanification et d’autoconstruction, d’agriculture urbaine »106, l’utilisation de l’énergie solaire, etc. Pour lui, cela doit passer par la réduction de l’insécurité qui s’opèrera grâce à la réduction de la taille des groupes faisant ainsi communauté. Le village urbain peut être autarcique, indépendant, préserver son identité ; il ne prône pas un retour en arrière, mais le retour à une indépendance, au travers l’utilisation de « technologie simple »107 .
Figure 12 Réorganiser la terre104

Afin que le village urbain fonctionne, il semble donc nécessaire de faire le parallèle avec la notion de « taille critique des groupes »108. Yona Friedman décrit de manière assez mathématique les relations dans un groupe et l’incidence de l’augmentation significative des groupes. Loin de décrire une situation idéale, il fait davantage l’observation et le constat des différentes organisations possibles, de sorte à réfléchir sur l’organisation des sociétés organisées en groupe telle qu’elles existent vraiment. Il attache l’importance de cette réflexion à l’hypothèse selon laquelle « la marche vers le « monde pauvre » a été déclenchée par l’illusion de la « richesse », puis accélérée par l’autre illusion, encore plus grande : celle de la possibilité d’une communication globale »109 . 103
(GORZ, 2008) 104
(FRIEDMAN, Comment habiter la terre, 2016 (première édition 1976)) 105 Ibid. 106 Ibid. 107 Ibid. 108
(FRIEDMAN, Comment vivre avec les autres sans être chef et sans être esclave, 2016, Première édition Jean Jacques Pauvert,1974) 109 Ibid.
45
Ilfinitparquestionnerlelecteuràproposdelapossibilité de faire émerger le « village urbain ». En arrivant « à faire comprendre aux habitants des grandes villes que les villages urbains peuvent être leurs « canots de sauvetage » », il suggère que « les alternatives que nous avons examinées ne sont pas des propositions que vous devez accepter et personne ne peut vous dire quelle est la bonne et quelle est la mauvaise, elles sont toutes possibles et elles peuvent même coexister »110. L’intérêt est donc de pousser l’individu à la réflexion, à la diversité, à l’auto-gouvernance, à l’indépendance de ses choix et de ses actions. Mais, Yona Friedman met en garde : « danscedocumentnous avonssurtoutparlé dela survie, oui parce que c’est une question urgente »111. En tout état de cause, « pour « prévoir l’inattendu », le plus important c’est de faire comprendre à tous, à vous et à moi, que le meilleur planificateur en cas de crise est celui qui fait ses propres plans »112 et que nous devons nous réhabituer à penser. Pour cela, il est nécessaire de s’informer, ce qu’il permet de faire grâce au type d’ouvrage qu’il propose et qu’il a en partie mis à disposition gratuitement. Afin de rendre ces outils accessibles au plus grand nombre, Yona Friedman a attaché de l’importance à rendre le discourssimpleet lesillustrationséloquentes.Decettemanière,iltendàredonneruneliberté aux acteurs de la société, aussi bien professionnels que non professionnels, qui en se réappropriant des outils, pourront entrer dans un processus de libération des contraintes urbaines et rurales qu’ils vivent. 110 (FRIEDMAN, Comment habiter la terre, 2016 (première édition 1976)) 111 Ibid. 112 Ibid.
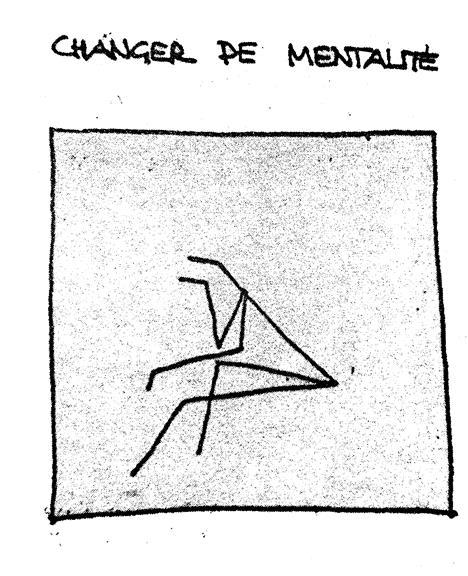
46
Figure 13 Changer de mentalité111
1.2. Typologie de projets alternatifs et rapport architecte-usager
1.2.1 L’habitat participatif
Les habitats participatifs sont peut-être les premiers projets alternatifs auxquels on pense. En effet, ils semblent se théoriser depuis plus longtemps que les autres, ou en tout cas l’appellation semble se rapprocher de formes de projets plus anciens qui s’inscrivaient également dans une forme de singularité pour leur propre époque.
1.2.1.a.
Les Familistères
Les familistères peuvent constituer un exemple d’habitat alternatif de l’époque, dont le modèle d’habitat communautaire est évocateur par rapport à l’habitat participatif. C’est au XIXème siècle qu’elle apparait, initiée par le patronat, qui souhaite loger des familles entières d’ouvriers afin de garantir une main d’œuvre à proximité. Ainsi, « dans le Familistère de Guise, imaginé par JeanBaptiste Godin en 1858, la vie quotidienne coopérative était organisée autour d'une cour couverte qui abritait divers équipements. Cette initiative patronale se transforme à travers le temps en une initiative habitante. Ainsi, le mouvement coopératif des Castors se constitue après la seconde guerre mondiale, étant fédéré autour d'une action militante qui prône l'autoconstruction »113 Le Familistère de Guise est certes un habitat participatif, mais outre le fait qu’il comprenait des logements, il comprenait également des salles de travail, des écoles, des jardins, des salles de spectacle et des équipements sportifs. En ce sens, il reprend un programme d’activité peut-être plus large que ce que l’on étudiera par la suite dans les typologies d’habitat participatif plus ordinaires.
1.2.1.b. Le Kibboutz
Le Kibboutz peut également constituer l’une des premières formes d’habitat participatif dont on a encore une trace aujourd’hui. Il s’agit d’une communauté agricole collective qui a vu le jour en Israël. Ce type de communauté a été créé dans les années 1910 par des immigrants juifs venus s'installer en Palestine, dans le but de construire une société socialiste et agricole. Les membres d'un kibboutz vivent et travaillent ensemble, partageant les tâches et les biens de manière égalitaire. Ce modèle est un exemple d'habitat participatif dans lequel les habitants sont impliqués dans la prise de décision concernant leur environnement de vie. Il existe donc une certaine gouvernance partagée
47
113 (TOUBANOS, 2017)
Yona Friedman a lui-même vécu cette expérience du Kibboutz. Durant la Seconde guerre mondiale, il s’est engagé dans la Résistance et fut arrêté en 1944, après avoir été dénoncé. L’année suivante, il s’installe avec ses parents en Roumanie, où pendant un an, ils vivent dans un camp de réfugiés. Dans son parcours de vie, il a ainsi pu faire face à des crises et des pénuries, ce qui explique en partie sans doute comment il a développé toute une réflexion dans ses écrits, avec des propositions résilientes et si innovantes pour l’époque. De confession juive, il est amené à fuir la guerre et réalise une partie de ses études d’architecture en Palestine, où il s’est exilé de façon clandestine. À ce moment de sa vie, il expérimente la vie en communauté et travaille en tant qu’ouvrier agricole au sein d’une organisation d’un Kibboutz. Quelques années plus tard, en 1949, il obtient son diplôme d’architecte. Sans affirmer avec certitude que cette expérience a imprégné Yona Friedman dans son métier d’architecte, il en résulte qu’il est un auteur qui se positionne clairement en faveur d’une conception participative, voire d’une « autoplanification »114 . C’est dans le développement de l’analyse du corpus qui suit que l’on tentera de dégager ce qui permet de réinterroger le rapport architecte-usager. Dans ce contexte, on observera dans quelle mesure l’usager prend part ou non au processus de conception et de quelle manière cela génère une architecture éthique et soutenable.
Figure 14 Qui doit planifier, source Yona Friedman

48
114
(FRIEDMAN, Comment habiter la terre, 2016 (première édition 1976))
1.2.1.c. L’habitat participatif « courant »
D’une certaine manière, on peut affirmer que l’habitat participatif est un concept ayant émergé à la fin du XXème siècle. Les premiers projets d'habitat participatif ont été créés dans des pays comme la Suisse et l'Allemagne, où des groupes de citoyens se sont regroupés pour construire des logements collectifs autonomes, en s'appuyant sur des principes de coopération et de participation active des habitants. « Les villes de Fribourg et Tübingen, en Allemagne du sud, ont été parmi les premières, dès les années 90, à reconnaître le potentiel des initiatives habitantes et à ouvrir leur stratégie de développement urbain aux baugruppen ou aux collectifs de particuliers »115

Erika, membre de l’habitat participatif d’Urban ‘hôtes a notamment pu vivre cette expérience de Kibboutz lors d’un cursus durant ses études universitaires en Allemagne, dont elle est originaire. Cette expérience fait partie d’un ensemble d’expériences d’habitat alternatif qu’elle a pu observer. Celles-ci semblent l’avoir marqué positivement, au point de vouloir elle-même s’inscrire dans cette démarche. A son arrivée en France, Erika a cherché à intégrer un tel projet. Toutefois, faute de possibilités pour l’époque, elle s’installe à Strasbourg, dans une maison mitoyenne qu’elle a fait construire avec son mari et dans laquelle elle va s’installer avec le reste de sa famille. Erika n’abandonne cependant pas le projet de vivre autrement, de vivre en commun, puisqu’elle se lance quelques dizaine d’années plus tard, avec son mari, dans le projet d’habitat participatif lancé par un appel à projet de la ville de Strasbourg.
Au démarrage du projet, ils sont plusieurs à travailler sur la constitution de groupes solides dont la finalité était d’accéder à l’achat de l’un des terrains proposés par la ville de Strasbourg. La formalisation et l’organisation de ces groupes restaient libres. Seuls les projets les plus aboutis ont pu accéder à ces derniers, étant précisé qu’ils devaient nécessairement constituer un habitat participatif. La ville a proposé des ateliers pour les accompagner en ces termes. Les structures juridiques encadrant le type de gouvernance, le type de financement et la constitution de programme ont fait l’objet d’une réflexion à part entière lors de ces ateliers. Ces derniers ont constitué une première phase à part entière dans la chronologie du projet.
Le témoignage de Stéphane, membre d’Urban’hôtes, est évocateur du processus dans lequel la plupart des groupes se sont inscrits. Avant d’être retenus, ils ont dû « respecter différentes phases pour pouvoir aller jusqu'à la présentation d'un dossier, d’un acte de candidature sur un terrain. Il a fallu en premier lieu apprendre à nous connaître et établir une charte de vie commune. En second lieu nous avons dû établir un mode de gouvernance »116. La gouvernance est ici partagée et la charte est un élément que
115
BRESSON, Sabrina et TUMMERS, Lidewij. L’habitat participatif en Europe. Vers des politiques alternatives de développement urbain ?. Métropoles, 2014, no 15, consulté le 11 décembre 2022, disponible en ligne [https://doi.org/10.4000/metropoles.4960]
116 (Habitat-Participatif-Strasbourg, s.d.) Urban ‘Hôtes, le témoignage de Stephan, Portail de l'habitat participatif [en ligne]. [Consulté le 29 janvier 2022]. Disponible
49
Figure 15 Autopromotion Urban Hôte, source personnelle
l’on retrouve systématiquement comme élément premier d’un projet d’habitat participatif, mais que l’on pourra rencontrer également dans d’autres typologies de projets alternatifs
Un habitat peut être classé dans la catégorie des habitats participatifs dès lors que l’on y observe des valeurs collaboratives et que l’on y rencontre plusieurs foyers s’installant sous le même toit. Il est rare et questionnable d’y voir uniquement deux foyers, dans la mesure où le nombre de foyers observables au départ avoisine les quatre à huit ménages, sans que cela ne constitue une limite effective117 La majeure partie de ces habitats est constituée principalement d’habitations collectives dont la particularité spatiale est de bénéficier d’espaces partagés tels que les espaces extérieurs, les espaces techniques (chaufferie, buanderie, etc.) et souvent une pièce commune ou une chambre d’accueil pour les visiteurs. La gouvernance est également une « gouvernance participative »118 , dans la plupart des cas

En ce sens, ces habitats impliquent indubitablement la collaboration des habitants. « L’habitat participatif repose sur une démarche citoyenne : il permet à des groupes de personnes de construire leur logement et de partager un mode de vie écologique et communautaire, à moindre coût. Il est encadré par la loi Alur »119. Si l’habitat participatif est bien encadré par une loi, il n’est pas exclu que les processus pour y parvenir, tels que les autofinancements et gestions des groupes, présentent une part d’ombre et ne soient pas encadrés législativement parlant. La « Loi Alur »120 est relativement récente puisqu’elle date du 24 mars 2014 et concerne un ensemble de domaines sous l’égide de l’accès au logement et à un urbanisme rénové. En termes d’engagement politique, il

sur : https://habitatparticipatif.strasbourg.eu/explorer/temoignages/urbanhotes-neudorf-temoignagehabitant/
117 Peu de sondages sont déjà disponibles afin de donner des chiffres exacts à ce propos.
118 EHG Éco Habitat Groupé [en ligne] [consulté le 14 décembre 2022]. Disponible sur : http://www.ecohabitatgroupe.fr/
119 FRANCE ministère de l’Écologie, Rubrique Politique publiques – Accès au logement – Accession à la propriété, vente et fiscalité de l’immobilier, Habitat participatif : un cadre juridique pour habiter autrement, 28 septembre 2020, consulté le 21 aout 2022 sur https://www.ecologie.gouv.fr/habitat-participatif-cadre-juridique-habiterautrement
120 Loi Alur, Légifrance, JORF n°0072 du 26 mars 2014 consulté le 21 août 2022, Disponible à l’adresse : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/JORFARTI000028772674/
50
Figure 16 Habitat participatif – Source Eco Habitat Groupé
Figure 17 Illustration pour les ateliers d’Habitat Participatif de Strasbourg115
semble que si certaines villes telles que celle de Strasbourg se soient engagées il y a déjà une dizaine d’années dans le soutien de ce type de projet, d’autres villes mettent plus de temps à s’y aventurer. Et c’est sans doute aussi selon la taille de chaque ville que cela influe. L’Eurométropole de Strasbourg a mis en place une plateforme regroupant des informations et des références sur les projets d'habitats participatifs. Eco-Quartier Strasbourg a été créé en 2001, puis en 2009 s’est développé Habitat participatif Strasbourg & sa région, sous l’égide de l’Eurométropole de Strasbourg. Celle-ci permet aux personnes intéressées par ce type de projets d'en proposer un ou de rejoindre un projet existant, grâce au réseau de soutien qu'elle met à disposition. La plateforme propose sa propre définition de l’habitat participatif, comme « une démarche permettant à un groupe de citoyens de s’associer pour concevoir ensemble un projet d’habitat, associés ou non à un opérateur immobilier. Les futurs habitants participent à la conception de leurs logements, mais aussi des espaces qui sont destinés à être partagés. Ils peuvent ainsi construire ou rénover un bâtiment et en assurent la gestion ultérieure »121 . Dans sa définition, Habitat Participatif de Strasbourg et ses environs évoque une participation à la conception. Est-ce une utopie fomentée, mais encore peu développée ?
Lors de la sélection des projets de recherche, la majorité des projets d'habitat participatif recensés étaient des projets d'habitats collectif neufs pour lesquels la participation à la conception était assez limitée. S’agissant de son rapport à l’architecte et dans le cadre de son expérience chez les Urban’hôtes, Erika en retient une expérience en deux tons. D’une part, elle fut d’abord enthousiaste d’avoir pu trouver un architecte qui souhaitait réellement s’intéresser à cette typologie d’habitat et qui a pris le temps de rencontrer chaque ménage afin de prendre en compte leurs besoins et leur cahier des charges lors de la conception des plans. Dans une certaine mesure, cela leur a permis de coconcevoir leur logement en faisant aboutir les plans de l’architecte d’une manière qui corresponde à leur besoin immédiat et projeté. Erika avait notamment insisté sur la volonté d’avoir une chambre dont la caractéristique permettrait de la rendre plus autonome et isolée par rapport au reste du logement. L’architecte s’est saisi de cette demande pour l’intégrer à leur appartement d’environ 134 m². Ainsi, on retrouve dans la continuité du sas d’entrée, un accès à une chambre ayant sa propre salle de bain. Erika semble aujourd’hui satisfaite d’avoir pu faire aboutir sa demande, car ses enfants ayant quitté le logement peu avant la réalisation du projet, il était important pour elle de pouvoir les accueillir en articulant une certaine intimité entre les espaces. D’autre part, une certaine forme de doléance a émergé concernant les aspects techniques et esthétiques. Rapidement après qu’ils aient pris procession des lieux, les habitants se sont rendus compte que certains aspects esthétiques avaient manifestement primés sur la conception, engendrant des difficultés d’entretien voire même certains sinistres. Les regrets exposés sont à la hauteur de l’ignorance qui a été entretenue par l’architecte entre l’absence de pédagogie et sa volonté de faire primer une certaine esthétique du bâtiment au détriment de sa pérennité. Cette expérience interroge incontestablement le rapport de l’architecte et de l’usager. Il aurait été pertinent d’offrir le point de vue de l’architecte Olivier Hangen de l’agence ATOLH Architecture qui a été contacté, mais n’a pas donné suite aux sollicitations, de manière inopportune
Les projets d’habitats participatifs neufs sont ceux qui nécessitent le plus la collaboration d’un architecte, notamment car ces derniers débutent à partir d’un terrain nu. La politique actuelle vise à protéger les sols contre l'artificialisation en préservant les espaces agricoles et naturels. En
121 Découvrir l'habitat participatif. Portail de l'habitat participatif [en ligne]. [Consulté le 13 décembre 2022]. Disponible sur : https://habitatparticipatif.strasbourg.eu/decouvrir-lhabitat-participatif/
51
conséquence, il y a peu de terrains disponibles et les projets de rénovation se développent de plus en plus. C’est le cas pour l’association Graine de Lieux de Sélestat, dont le projet de l’Œuvre propose l’extension et la réhabilitation de la maison de l’un des projetants.
Leur groupe n’est qu’au début du processus de création d’un habitat participatif. Les ménages ne sont pas encore tous constitués, mais accompagnés par Habitat Participatif de Strasbourg et ses environs, ainsi que l’Oasis Colibris, ils ont pu avancer sur le travail et la définition de leur raison d’être Ils ont également participé à une formation donnée par l’Oasis sur le consentement et ont approché différents architectes dont le choix s’est arrêté sur Tristan Chaudon. Dans le cadre de cette formation, un guide122 leur a été communiqué, proposant des fiches pratiques en tant qu’outils au service du projet participatif, avec notamment des informations sur la Communication Non Violente et autres notions connexes, démontrant ainsi toute l’importance de la communication dans le processus de conception.
Leur charte va pouvoir s’écrire d’une manière qui fasse sens en « œuvrant à bien vivre ensemble dans un esprit écologiste et humaniste » tel qu’ils l’ont précisé lors d’un entretien semi-dirigé.
Lors de l’entretien semi-dirigé, l’échange a permis d’approfondir les questions autour des attentes des projetants concernant leur relation avec l’architecte. Cela a mis en lumière une certaine ingénuité quant à l’approche de la conception participative. Graine de lieu aborde le processus de conception d’une manière qui semble influencée et cloisonnée par des années de gouvernance verticale. Dans un premier temps, ils ont exposé de quelle manière ils attendaient qu’un architecte dessine leur plan grâce au support qu’ils ont mis en place avec un cahier des charges par foyer. Par la suite, l’architecte Tristan Chaudon a fourni des explications quant à sa démarche. Cette dernière a permis de clarifier leur future collaboration dans le processus d’élaboration du projet afin qu’elle s’inscrive davantage dans un dispositif participatif lors d’ateliers
122 ANNEXE A - MOUVEMENT OASIS, GAYET Maïté, La Gouvernance dans les Oasis, L’université du nous, [en ligne], [consulté le 8 novembre 2022], disponible sur https://cooperativeoasis.org/wiki/?ConstruireCollectif/download&file=Livret_Gouvernance_dans_une_oasis.pdf, 16 p
52
Cette approche123 , annexée à la présente étude, consiste en deux étapes. La première est celle que l’on vient d’évoquer avec des ateliers constitutifs de ce qui s’apparente à de l’assistance à la maitrise d’ouvrage, voire de la maitrise d’usage. Tristan Chaudon propose de synthétiser sa démarche sous le schéma suivant. Il met en lumière la sensibilité avec laquelle il propose une approche de « l’esprit du lieu ». L'esprit du lieu est une notion importante en architecture qui fait référence à l'atmosphère, l'histoire et la culture d'un endroit donné. Lorsqu'un architecte conçoit un bâtiment, il essaie de tenir compte de l'esprit du lieu afin de créer un édifice qui s'intègre parfaitement à son environnement et qui reflète la culture et les valeurs de la région. Pour prendre en compte l'esprit du lieu, l'architecte doit étudier la géographie, l'histoire et la culture de la région, ainsi que les éléments de l'environnement naturel et bâti qui le caractérisent. Il doit également tenir compte des préférences et des besoins des personnes qui habiteront ou utiliseront le bâtiment. Cela peut contribuer à renforcer le sentiment d'appartenance et de communauté et à créer un lieu accueillant et agréable. Cette démarche fait sens pour les membres de Graine de lieu développant le projet de l’Œuvre, puisqu’ils s’inscrivent sciemment dans un projet de réhabilitation ayant de ce fait une histoire qui lui est propre.

53
123
ANNEXE B - CHAUDON Tristan, Accompagnement Architectural, Annexe 1, [Hors ligne] consulté le 18 octobre 2022, 3
p
Figure 18 Synthétisation de l'approche des ateliers, source Tristan Chaudon
La démarche d’atelier de Tristan Chaudon s’apparente à une mission d’AMO voir d’AMU. L’ordre des Architectes propose d’éclaircir la différence entre AMO et AMU de la manière qui suit. « Si l’AMU consiste en partie à accompagner la Maitrise d’Ouvrage « dit MOA » tout au long du projet, on peut retenir que l’AMU diffère de l’AMO en apportant une composante sociale forte et en réalisant un accompagnement tant auprès des usagers que des acteurs techniques, dont l’AMO : « le métier d’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) n’est pas éloigné de l’AMU en termes de fonction et de positionnement métier. Nous pouvons même dire que l’AMU est une composante de l’AMO. Il diffère néanmoins par sa posture, ses inspirations, et la méthodologie utilisée »124 Pascale Marion, directrice de cette étude, a notamment su enrichir le propos concernant la pratique d’AMU, en partageant le livret « Assistance à Maitrise d’Usage »125 reflétant un panorama de pratiques auquel elle a elle-même adhéré en tant qu’architecte. Il présente avec pertinence le processus et les étapes conduisant à cette première étape.
124 ORDRE DES ARCHITECTES. « Remettre l’usager au cœur du projet » : le Réseau national de l’Assistance à Maîtrise d’Usage publie son Livre Blanc pour guider la conception. Ordre des architectes [en ligne]. [Consulté le 17 décembre 2022]. Disponible sur : https://www.architectes.org/remettre-l-usager-au-coeur-du-projet-lereseau-national-de-l-assistance-maitrise-d-usage-publieson#:~:text=AMU%20et%20AMO&text=Nous%20pouvons%20m%C3%AAme%20dire%20que,%2C%20et%20la %20m%C3%A9thodologie%20utilis%C3%A9e.%20%C2%BB
125 Réseau Professionnel AMU Rhin Supérieur, Assistance à Maitrise d’Usage, Panorama d'exemples et de pratiques dans le Grand Est,publiéle1er septembre2021,[enligne],concultéle29octobre2022,disponiblesur : https://issuu.com/amu.rhinsup/docs/amu_-_panorama_d_exemples_et_de_pratiques_dans_le_

54
Figure 19 Temporalité et enjeux de l'AMU, source Réseau Professionnel AMU Rhin Supérieur
Le réseau AMU est composé d’architectes et de professionnels souhaitant proposer « une approche de conception qui place les usager·e·s, utilisateur trice s, habitant e s, citoyen ne s au centre du processus d’élaboration du projet »126
Cela permet d’ouvrir à des questions plus larges telle que la question de l’inter-génération au sein des projets d’habitat participatif. Si cette notion a été favorisée et traitée avec un choix de diversité générationnelle dans le projet Urban’hôtes, le projet de l’œuvre de l’association Graine de lieu s’est orienté sur des membres bi-générationnels, avec des actifs et des séniors semi-actifs Plus largement, on peut s’interroger sur la typologie des ménages qui peuplent les habitats participatifs. Certaines études tendent en effet à s’accorder sur le fait que les ménages représentés dans cette catégorie d’habitants sont des ménages relativement aisés. Cependant, le caractère représentatif de ces études est questionnable du fait d’un phénomène d’habitat participatif en pleine expansion. L’importance de replacer l’usager au cœur du processus d’élaboration du projet interroge le rapport architecte-usager. Nous pouvons nous interroger sur la concordance de l’AMU avec l’idéologie de Yona Friedman sur l’« autoplanification ». En souhaitant placer l’usager au cœur du processus d’élaboration du projet, cela ne précise pas si après l’étape d’AMU, il y aura ou non une co-conception, une autoplanification ou une conception sous une gouvernance ordinaire par un architecte. Yona Friedman propose d’utiliser les outils tels que « le langage des “ graphes”. Les Graphes ne sont rien d’autre que des figures construites avec des boutons et des “ficelles” »127. D’après lui, cette approche est le moyen de constituer un langage pour rendre « l’autoplanification »128 possible. 126 (Réseau-Professionnel-AMU-Rhin-Supérieur, publié le 1er septembre 2021) 127 (FRIEDMAN, Comment habiter la terre, 2016 (première édition 1976)) 128 Ibid.
55
1.2.2 L’écolieu
L’écolieu est, pour certains, synonyme d’écovillage. Le sens d’écolieu n’est pas encore répertorié dans les dictionnaires. Le préfixe provient de la contraction du mot écologie, combinée à la dimension spatiale d’un village, d’un lieu ou en tout cas d’un espace défini, circonscrit. L’écolieu est un espace dont le projet peut inclure de l’habitat participatif, mais dont la dimension est davantage portée sur l’écologie. On y rencontre souvent une mixité programmatique, avec une réelle intention de partager. En un sens, c’est une communauté dont le partage est davantage tourné vers l’extérieur, ce qui la différencie des habitats participatifs, qui ont une grande volonté de fonder leur « raison d’être » sur la notion du faire sens, sans pour autant miser leur dogme principal sur l’écologie. La « raison d’être » est un terme qui revient souvent dans les différents projets alternatifs, mais surtout ceux des habitats participatifs et des écolieux. Comme nous l’avons vu pour l’habitat participatif, elle est ici aussi la première chose sur laquelle ils travaillent avant la rédaction d’une charte. Ces notions seront davantage développées ultérieurement.
Un écolieu est donc un lieu de vie organisé de manière à minimiser son impact environnemental. Il s’agit généralement de communautés de personnes qui choisissent de vivre de manière durable en utilisant des énergies renouvelables. Certaines produisent leur propre nourriture et tendent à limiter leur consommation de ressources. Ces écolieux peuvent être des fermes, des villages ou des quartiers urbains organisés de manière à préserver l'environnement et à favoriser le bien-être des habitants. L'habitat participatif peut être une approche utilisée pour la création d'un écolieu, en impliquant les habitants dans la conception et la gestion de leur environnement de vie.
Le mouvement Colibris est un mouvement citoyen français qui vise à promouvoir des modes de vie durables et responsables. C’est l’un des mouvements fondés sous l’impulsion de Pierre Rabhi, un agriculteur et écrivain français qui milite en faveur d'une économie plus juste et plus respectueuse de l'environnement. Le mouvement organise des conférences, des ateliers et des événements pour sensibiliser la population à ces enjeux et pour les encourager à adopter des comportements plus durables dans leur vie quotidienne. Pierre Rabhi, né en 1940 en Algérie, fonde « l’Oasis en tous lieux » en 1997, puis co-fonde le mouvement Colibris en 2007. Celui-ci est porteur de notions et valeurs telles que l’éthique, une gouvernance collégiale, d’indépendance, de participation et de partage. Au niveau de l’éthique, il appelle à « changer de paradigme de société »129 Le mouvement Colibris a été nommé d'après un compte pour enfants dont l’histoire raconte les efforts de l’oiseau, au bec le plus petit, qui fait sa part pour éteindre un incendie Le mouvement soulève notamment l’importance de la prise de conscience des limites de notre planète et de la croissance jugée comme infinie. De cette manière, il exprime le fait que nous devrions viser notre épanouissement personnel plutôt que de nous laisser emporter par un matérialisme excessif. Nous devrions favoriser l'équilibre entre les valeurs féminines et masculines plutôt que la prédominance des valeurs masculines. Enfin, nous devrions « privilégier la coopération et l'entraide plutôt que la domination et l'obéissance »130 .
129
MOUVEMENT COLIBRIS, Notre vision : L’éthique du Colibri. Mouvement Colibris [en ligne]. [Consulté (COLIBRIS, )le 13 décembre 2022]. Disponible sur : https://www.colibris-lemouvement.org/lassociation/notrevision-lethique-colibri
130 Ibid.
56
Le mouvement prône également des valeurs rappelant l’importance de l’éducation, de l’interdépendance, du respect de la diversité comme forme de liberté, de la nature, de la sobriété, et enfin de la prise en compte de l’échelle locale comme levier d’action.
En 2012, le mouvement décide de mettre en place une gouvernance participative. Cela s’est traduit par l’implication de « toutes les parties prenantes du mouvement dans les décisions stratégiques, en utilisant un processus d'intelligence collective »132 Il existe bien d’autres mouvements tels que celui du Colibris, mais il est celui qui semble le plus largement développé et le plus connu au niveau national en tant que mouvement indépendant. Les politiques publiques offrent, quant à elles, un panel de mouvements régionaux regroupant les écolieux, sous l’appellation principale d’« habitat participatif », tels que Eco Habitat Groupé créé dans le Nord-Pas de Calais, Eco-Quartier Strasbourg, Habicoop créé à Lyon, HAB - Habité Autrement à Besançon, HESP’ère 21 créé en région Parisienne, etc. Si ces initiatives se développent, il ne faut pas y

57
Figure 20 Gouvernance du Mouvement Colibris
131
131 (MOUVEMENT COLIBRIS) 132 Ibid.
voir une concurrence en soit, mais plutôt une manière d’agir localement, en analogie à la taille des groupes critiques telle que nous l’avons vu précédemment.
Les écolieux ont été propulsés par les initiatives de projets alternatifs et des mouvements qui se sont développés exponentiellement ces dernières années.
La Coopérative Oasis est née de l’un des projets du mouvement Colibris, en 2014. Celui-ci avait pour but de développer et de faciliter la création d’écolieux appelés « Oasis » et définis comme « des lieux de vie et d’activité écologiques et collectifs. On y expérimente des modes de vie sobres et solidaires au service de la préservation du vivant »133. La coopérative référence également des projets tels que les « Écohameaux, habitats participatifs, fermes collectives, tiers-lieux tournés vers l’écologie… Tous ces lieux partagent des valeurs communes : la sobriété, le partage, la solidarité, la résilience et la convivialité »134. Le Mouvement Colibris et la Coopérative Oasis ont en commun de servir de tremplin grâce au référencement de réseaux. Ils mettent à dispositions des outils tels que des cartes et des « outils libres »135 Figure 21 Outils
133
COOPÉRATIVE OASIS. Qu’est-ce qu’une Oasis ? - Coopérative Oasis. Coopérative Oasis [en ligne]. [Consulté le 13 décembre 2022]. Disponible sur : https://cooperative-oasis.org/decouvrir/definition-oasis/ (OASIS) 134 Ibid. 135 (MOUVEMENT COLIBRIS) 136 (MOUVEMENT COLIBRIS)

58
libres - Mouvement Colibris136
La frontière est mince entre écolieu et tiers-lieu. D’après le Mouvement Colibris « certains écolieux sont des tiers-lieux mais pas tous ; certains tiers-lieux sont des écolieux mais pas tous... »137
L’Oasis Multikulti est un écolieu, mais également un tiers-lieu, dont la raison d’être est de constituer « un lieu de vie et de ressource où l'on pratique l'être ensemble en cultivant la terre et l'esprit »138 L’Oasis propose différents pôles d'activités dont le commerce en circuit court (micro-brasserie, fournil, marché, café associatif), la culture (atelier d'artistes, événements), le bien-être (ateliers aux thèmes variés, espace de massage), et un jardin associatif Sur la ferme occupée par l’Oasis, la maison d’habitation individuelle s’est transformée en habitation participative dont les cinq occupants participent activement aux activités de l’écolieu. La maison n’a pas été transformée particulièrement pour recevoir les habitants. Elle prend donc la forme d’une collocation, ce qui présente un intérêt quand on sait que l’habitat participatif standard prône davantage le chacun chez soi avec l’importance d’une mise en commun. Le projet s’est installé dans une ancienne ferme rurale, à l’initiative de Stéphanie, petite fille des précédents propriétaires. Durant la période estivale, ils accueillent tous les samedis des visites pour présenter leur projet. Dans le cadre de l’une de ces visites, ils nous ont présenté notamment les différentes activités développées au sein de la ferme. La micro-brasserie était alors en cours de travaux, expliquant sans doute le fait que les jardins étaient moins cultivés qu’à leur habitude.

Les mouvements de projets alternatifs sont stimulants, malgré cela ils peuvent également présenter un autre revers. Les personnes impliquées mettent beaucoup d'énergie dans leurs projets, ce qui les pousse parfois à remettre en question leurs propres besoins Pour la plupart des personnes interrogées dans cette étude, il existe un lien entre promouvoir un mode de vie plus respectueux des valeurs éthiques pour le bien commun, et leur propre épanouissement personnel Parfois épuisés, mais jamais découragés, des mouvements tels que l’Oasis Multikulti ont sans cesse cette nécessité d’attirer de nouvelles personnes pour les épauler dans ces audacieux projets.
137(MOUVEMENT COLIBRIS)
138 OASIS MULTIKULTI. Tiers-Lieu Oasis Multikulti | France. Oasis Multikulti [consulté le 14 décembre 2022]. Disponible sur : https://www.oasismultikulti.org/
59
Figure 22 Cour de l'Oasis Multikulti durant le 5ème Festikulti, source Oasis Multikulti
1.2.3
Le tiers-lieu
Les tiers lieux se caractérisent par la constitution d’espaces de travail partagés ou collaboratifs qui offrent des services et des installations aux entrepreneurs, aux travailleurs indépendants et aux petites entreprises. C’est d’ailleurs sous l’impulsion de ces derniers qu’ils ont vu le jour, se concrétisant tout d’abord en espace de travail appelé coworking, atelier, ou fablab, etc.
Ces espaces objectivent des attentes pour les personnes en recherche d’alternative dans leur façon de travailler. D’une certaine manière, cela permet de rompre avec l’isolement du travail d’indépendant, tout en mettant en commun des installations et des services. En ce sens, ils peuvent offrir une certaine flexibilité, tant pour la charge locative que dans bien d’autres aspects. Ces espaces se définissent ainsi par des valeurs collaboratives et solidaires.
Le Familistère de Guise, cité précédemment comme la préfiguration de l’habitat participatif d’aujourd’hui, comprenait non seulement des logements, mais également des salles de travail, des écoles, des jardins, des salles de spectacle et des équipements sportifs. Ces différents lieux cohabitant en un même sein interrogent sur la requalification d’une telle organisation en tant que tiers-lieu Au fil du temps, d’autres types d’activités ont vu le jour sous l’appellation de tiers-lieux. Elles ont été le moyen de concrétiser d’autres alternatives pour « des activités culturelles, de domiciliation d’entreprises, de café associatif, librairie, jardin partagé, boutique partagée, galerie, salle de réception, etc. »139 . Le Mouvement Colibris définit le tiers-lieu comme « un espace de travail partagé et collaboratif, d’un lieu intermédiaire de rencontres et d’échanges informels, d’un espace de sociabilité mis en œuvre par un collectif, au service d’un territoire »140.Ils permettent également, à des lieux possédant toutes les caractéristiques d’un écolieu, de marquer leur engagement même si leur préoccupation écologique est aléatoire.
L’apparition de l’appellation « tiers-lieu » en France est récente et semble se situer autour des années 2000 d’après la Coop Tiers-lieux. Cette dernière expose l’origine supposée de l’appellation comme s’agissant d’ « un « troisième lieu », d’un intermédiaire entre l’espace de l’intime du domicile et celui de l’entreprise, à l’image du café français. Une terminologie de « third place » traduite en « tiers-lieu » qui serait à l’origine d’une mauvaise appréhension du concept selon Burret (Burret, 2017) »141 .
Leurs points communs sont le partage de valeurs, ainsi que la volonté de faire en commun avec les autres usagés et de générer une solidarité et du partage. Ils se détachent en partie de l’écolieu par la notion d’accueil du public. L’accueil du public n’est pas une caractéristique fondatrice de tous les écolieux, bien qu’il reste un élément important dans la promotion des valeurs qu’ils prônent et la volonté de proposer et de répandre une alternative aux modes d’habiter et de vivre. Un écolieu peut ne pas accueillir de public. Le point commun entre un tiers-lieu et un écolieu est de ne pas être nécessairement doté d’espace d’hébergement, à la différence des habitats participatifs. Il existe tout de même de nombreux écolieux qui en sont dotés, et de manière plus anecdotique quelque tiers-lieux également.
139 (MOUVEMENT COLIBRIS) 140 (MOUVEMENT COLIBRIS) 141
COOP-TIERS-LIEUX. Les Cahiers du Labo - La Coopérative Tiers-Lieux. [En ligne] Consulté le 12 Décembre2022, Disponible sur : https://coop.tierslieux.net/document/les-cahiers-du-labo/.
60
Le schéma ci-dessous montre les différentes composantes d’un tiers-lieu et leur relation en rapport aux lieux. Il est important de noter que les dynamiques sociales qui en découlent peuvent changer selon différents facteurs. L’évolution séculière du tiers-lieu révèle « un processus qui peut évoluer dans une forme de complexité ou pas » 142 .
En regroupant de vastes possibilités, le tiers-lieu semble difficile à circonscrire. Pourtant, « dire que les tiers-lieux sont tous singuliers et qu’on ne peut pas les modéliser est devenu monnaie courante dans les débats sur les tiers-lieux. Certes, ils sont pluriels et il ne nous semble pas opportun de modéliser un tierslieu type. Mais pour autant, il nous semble primordial d’apporter des clés de lecture de ces tiers-lieux. Pour cela, nous proposons de les regarder à travers deux grandes lignes de force : le tiers, son rapport à l’autre avec son organisation humaine et le lieu, sa représentation physique »143
Figure 23 Schéma de l'organisation d'une tiers-lieu - source Coop Tiers-lieux26
142 COOP TIERS-LIEUX. Les Cahiers du Labo - La Coopérative Tiers-Lieux. La Coopérative Tiers-Lieux [en ligne]. [consulté le 14 décembre 2022]. Disponible sur : https://coop.tierslieux.net/document/les-cahiers-du-labo/ 143 Ibid.

61
Les tiers-lieux s’installent particulièrement dans d’anciennes friches industrielles en ce sens qu’elles offrent de grands espaces d’exploitation. De façon peut être plus inattendue, ils gagnent aussi les espaces ruraux pour « répondre au besoin de revitalisation »144. Cette typologie de projet alternatif s’ouvre sur une forme d’hybridation modulable et évolutive. C’est en cela qu’elle valorise et maintient une liberté attrayante pour les projetants. Elle consent également à la préservation de la diversité des projets. C’est en cette manière que les tiers-lieux tendent à atteindre et résoudre certains enjeux sociétaux. Ils permettent de toucher un public plus large et de créer d’autres liens que les projets alternatifs cités précédemment n’auraient pas pu atteindre.
Figure 24 Principe social du tiers-lieux, source Coop Tiers-lieux
Le schéma ci-dessus propose d’illustrer le rapport entre différentes composantes de ce qui fait un tierslieu. Les entités indispensables de ce dernier sont l’individu, le collectif et la société. Le tiers-lieu crée des rapports qui lient « les intérêts des individus (coworkers, consommateurs du café associatif, travailleurs nomades, salariés, prestataires de services, etc...) à ceux du collectif qui anime le tiers-lieu (sous forme spontanée, d’association, de SCIC, de SCOP…) et ceux du territoire (de la société dans son ensemble et des collectivités qui garantissent l’intérêt général) »145. C’est donc grâce à une dynamique créée par le rapport et les interactions de ce grand axe qu’existe le tiers-lieu. Ces derniers se fondent ainsi sur un « réseau hyper-local mais très connecté »146 Le lieu, et donc la création d’un espace 144 (COOP-TIERS-LIEUX) 145 Ibid. 146 Ibid.
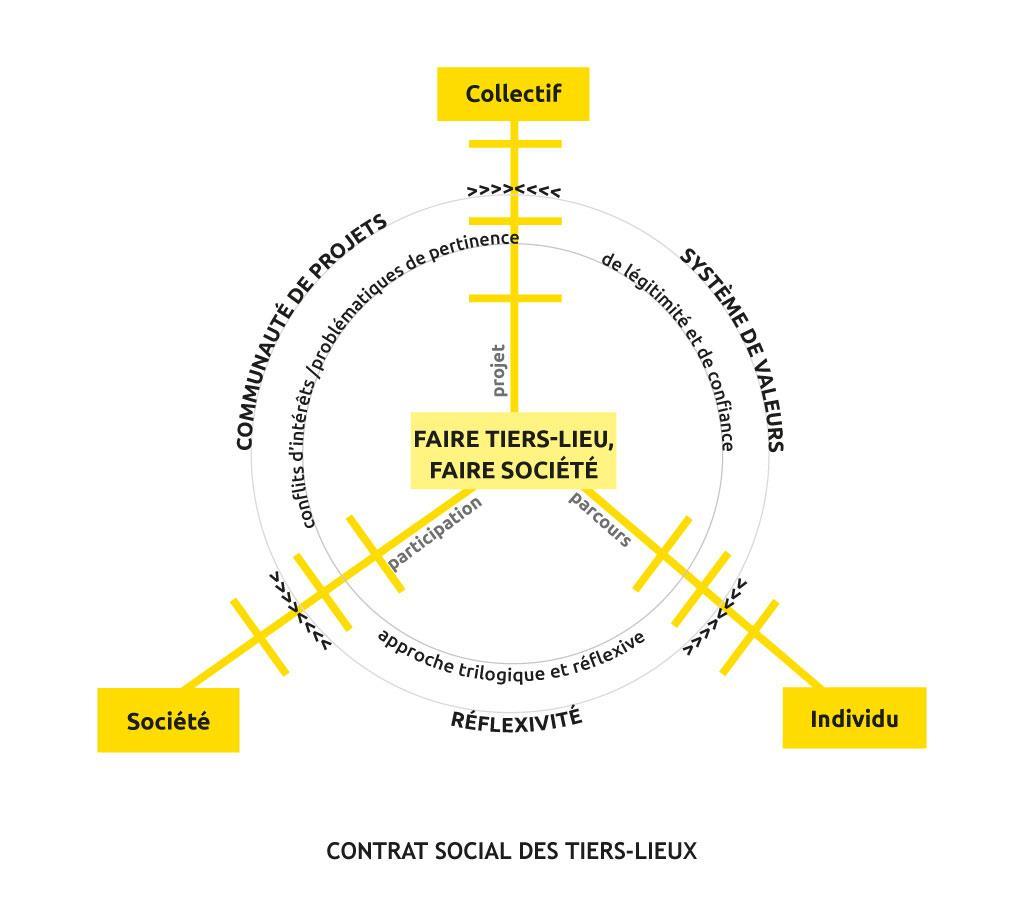
62
matériel, caractérisent, autant pour l’écolieu que pour le tiers-lieu, un fondement pour le fonctionnement de leurs infrastructures. Il est composé de plusieurs échelles qui pourraient se situer sur les grands axes des composantes du « contrat social des tiers-lieux » (voir Figure 17). L’échelle centrale est le lieu d’accueil comme élément formel et construit. La deuxième échelle est le lieu de partage et de participation comme lieu social, tandis que la dernière est celle de l’émancipation et de l’épanouissement personnel de l’individu, celui qui fait la société et qui soulève les questions de gouvernance. Le lien entre ces échelles est la valeur éthique. Pour que le lieu revête un caractère éthique, il doit permettre la diversité des individus, des programmes et des réponses. Le tiers-lieu, au même titre que les autres projets alternatifs, permet de catalyser la possibilité de faire autrement et de changer de mentalité en un lieu formel. Ainsi, c’est dans la proposition d’espaces concrets avec le concours d’activités qu’ils génèrent une architecture éthique et soutenable.
L’écolieu La Colo à Linthal, dont les cinq membres fondateurs (Nicolas, Louise, Fanny, Samuel et Marion) ont défini leur projet sous cette qualification, entre aussi en concours avec la notion de tierslieu. A l’investissement des lieux en 2019, leur première préoccupation était de travailler sur l’aménagement intérieur et extérieur de ces derniers. Ce travail devait permettre la mise aux normes du bâtiment en termes d’accessibilité et de sécurité, dans l’optique d’ouvrir le restaurant de La Colo. Pour cette mise aux normes, ils n’ont pas souhaité faire appel à un architecte. Ils ont sollicité les institutions publiques de la commission de sécurité et d'accessibilité qui ont pu les aiguiller de manière suffisante afin de remplir les demandes en vue d’obtenir les autorisations nécessaires à leur activité. A ce jour, ils viennent d’obtenir toutes les autorisations leur permettant l’ouverture du restaurant et la création de deux emplois, occupés par Louise et Samuel. Ils connaissent très bien leur environnement puisqu’ils en sont quasi tous originaires. Cela va pouvoir les aider et faciliter leur démarche de fonctionnement en circuit-court. Dans leur parcours, ils ont pu solliciter un architecte pour certains travaux de réaménagement. Louise raconte que les propositions que leur a fait l’architecte n’étaient pas adaptées à leur demande. Ils s’étaient vu proposer un projet comprenant une extension engendrant des coûts faramineux qu’ils ne pouvaient et ne voulaient pas assumer d’une part, mais qui ne semblaient pas non plus avoir été discutés dans les échanges avec l’architecte. Avant même d’avoir fait une sélection des corpus les plus pertinents pour cette étude, un bon nombre d’usagers ont relaté cette même expérience au sujet de la collaboration avec des architectes. Une expérience qui s’est avérée soit décevante, soit opiniâtre et donc inadaptée au budget et aux attentes des usagers. La question du budget est une question essentielle, et la rémunération de l’architecte l’est tout autant. On peut se demander si c’est la gouvernance verticale, en dépossédant les gens de la possibilité d’agir, qui a opéré cette déconnexion entre l’architecte et l’usager ou si d’autres facteurs concourent à cet état de fait. La déconnexion que l’on peut observer est bilatérale. Lorsque l’on évoque le terme de projet participatif avec les architectes, les réactions s’orientent spontanément sur la question de la rémunération qui peut sembler inadaptée et insatisfaisante dans ce type de projet. A l’inverse, les usagers qui n’ont pas connaissance de tout le travail à fournir étape par étape dans le processus d’élaboration d’un projet, se figurent comme étant contraints à des honoraires jugés exorbitants
63
A ce sujet, la communication pourrait être un élément clé comme alternative à cette question. C’est d’ailleurs ce que prône le réseau local AMU du Rhin Supérieur qui se compose d’une dizaine de structures différentes en « mobilisant des compétences variées (design, architecture, sociologie, urbanisme, facilitation). Convaincu·e·s de l’importance de l’inter-connaissance ainsi que du partage d’expériences et de savoir-faire »147

L’Atelier NA est une association d’architecte qui a d’abord collaboré bénévolement pour certains projets alternatifs tels que la Maison Mimir, à l’occasion d’un chantier participatif. L’Atelier NA a également été approché par le projet de La Colo, mais leur collaboration n’a pas abouti. L’Atelier NA se décrit comme « une association de droit local alsacien, regroupant architectes, artistes, constructeur.rice.s, designers, philosophes, citoyen.ne.s, cherchant à expérimenter et promouvoir l ’architecture en laquelle nous croyons : locale, solidaire, et responsable »148
Figure 25 Schéma synthétique sur la démarche et la philosophie architecturale, source Atelier NA
147 (Réseau-Professionnel-AMU-Rhin-Supérieur, publié le 1er septembre 2021) 148 ATELIER-NA. Atelier Na PHILOSOPHIE. Atelier NA [en ligne], [consulté le 18 décembre 2022]. Disponible sur : https://www.atelier-na.eu/atelierna
64
Joachim Boyries explique que le schéma ci-dessus illustre de manière synthétique leur démarche et précise ici les contours d’une éco-conception dans le processus conduisant vers la maitrise d’œuvre. Dans cette co-conception, il n’existe pas encore d’esquisses. Par analogie au travail de Tristan Chaudon se déterminant en deux phases, Atelier-Maitrise d’œuvre, l’Atelier NA illustre de façon plus détaillée le processus d’élaboration du projet. On y retrouve toutefois cette même scission entre la phase des ateliers et la phase de co-conception - maitrise d’œuvre. Ces phases étant sécables, Tristan Chaudon évoque qu’il serait tout à fait possible pour un collectif d’usagers de se constituer, de réaliser des ateliers avec un architecte ou autre professionnel compétent, puis de changer de collaborateur, en cours de projet, entre les ateliers et la maitrise d’œuvre. Il souligne qu’il ne recommande pas forcément le changement d’interlocuteur entre ces deux phases. En suivant toutes les étapes de la conception du projet, le professionnel sera en mesure d’ajuster sa démarche afin de la retranscrire dans le projet architectural de façon optimale. A ce jour, Joachim Boyries évoque souhaiter vivre de cette activité, et si certains chantiers ont été bénévoles, lui et ses comparses réfléchissent à proposer une rémunération qui fasse sens et soit adaptée aussi bien pour leurs associations d’architectes que pour les usagers.
La Maison Mimir est un tiers-lieu, mais son histoire atypique a rendu pertinente l’étude de son projet. En effet, la trajectoire de celui-ci n’apparaît pas comme une évidence. Son histoire commence en 2010, lors de l’occupation illégale de squatteurs d’un bâtiment abandonné, situation qui avait elle-même fait des émules auparavant. En se structurant au fil du temps, leur squat est devenu une association qui a proposé des évènements et régularisé sa situation après moults combats, tant au niveau administratif qu’organisationnel, le tout en passant par des difficultés d’insalubrité qui ont à plusieurs reprise mis en péril leur activité. Comme nous l’avons évoqué précédemment, il est difficile de poser des limites pour la définition d’un tiers-lieu. Si l’on pousse à l’extrême ces possibilités d’hybridation, d’autres formes de lieux alternatifs peuvent se révéler.
65
1.2.4 Les déclassés
Pour cette partie présentant des projets en déclassement des premières catégories de projets alternatifs énoncées, il est nécessaire de préciser que la méthode de présentation de la typologie présentera un propos davantage situé sur l’expérience des projets alternatifs et moins sur de la théorie, car il n’y a pas ou peu d’écrits sur cette typologie de projet, ou alors le sujet n’est pas traité en contingence avec le sujet tel qu’il est développé ici.
Le squat dont la Maison Mimir a su faire évoluer le statut illustre bien l’hybridation possible de projets alternatifs. Partant d'une situation de rupture, le squat est un lieu qui permet aux usagers de s'interroger sur les besoins et les valeurs qui manquent dans la société Le projet alternatif, abouti ou non, peut prendre la forme de squats, de tentes, de vans, ou encore de tiny house. Il permet une flexibilité quasi infinie. C’est dans sa transgression avec les modèles ordinaires qu’il propose d’interroger sur la qualification d’usage et d’habitation au sein de la société. Selon Jean-Paul Sartre, « la transgression, c'est l'acte par lequel un individu fait éclater les limites qui lui sont imposées par la société, afin de se libérer des normes et des conventions qui le conditionnent ». Il met en avant le fait que la transgression peut être un moyen pour l'individu de se libérer de certaines contraintes sociales et de découvrir sa propre identité. Pour lui, la transgression peut être un acte positif et libérateur.
Ces projets alternatifs que l’on choisit ici de catégoriser en déclassement par rapport aux autres, se révèlent à la fois dans une transgression des liens sociaux, mais aussi avec les lieux qu’ils occupent en faisant voler en éclat les conventions d’une société. La transgression du lieu est définie ici comme une utilisation d’une portion déterminée de l’espace, hors des modèles standards Elle constitue un acte qui va à l'encontre des règles et des normes établies dans une société ou dans un groupe social. Elle peut également prendre différentes formes, allant de la révolte à l'infraction à la loi. La transgression est souvent considérée comme un acte négatif, car elle peut mettre en danger l'ordre social ou remettre en cause les valeurs communes. Cependant, certaines personnes considèrent la transgression comme un acte positif, car elle peut permettre de faire évoluer les normes et les valeurs d'une société.
La Pigeonne est un squat se définissant comme « anarcha-féministe, queer et antiraciste »149, situé à Strasbourg. Il peut être surprenant de parler d’un squat comme d’un « projet alternatif ». En tous les cas, ce squat se caractérise en tant que projet dans le fait de planifier et de s’organiser autour d’idées communes et de valeurs de défense des minorités, le tout défini en un même lieu. La réponse à leur sollicitation ainsi qu’à leur participation en tant que sujet d’étude a été ferme et négative. Néanmoins, elle apparait curieusement satisfaisante. Au premier abord, ce refus pourrait mener à un sentiment de déception, mais c’est tout l’inverse qui s’est produit. La diversité des réponses face aux sollicitations fait partie intégrante de la méthode choisie dans cette étude. En témoignant du respect par rapport au fait que le groupe ne souhaitait pas y participer, on tentera tout de même de présenter en quoi leur démarche est importante et représentative de cette étude. 149 LA PIGEONNE, A propos, [Réseau social] [consulté le 16 décembre 2022]. Disponible sur : https://www.facebook.com/Lapigeonne
66
Celle-ci pourrait s’inscrire dans ce que La Pigeonne qualifie de « sollicitations d’étudiant-e-s en mal de sujets de recherches originaux pour avoir une bonne note »150. Cette réponse pousse à la remise en question en termes de techniques d’investigation, mais aussi en termes de sujet d’étude. Qu’est ce qui est le plus important, quels sont les besoins essentiels ? Les besoins physiologiques (s’alimenter, s’abriter) et de sécurité (faire confiance) sont la base du fonctionnement du squat. Cela démontre que la réponse aux besoins primaire est primordiale, avant même l’ouverture du groupe vers l’extérieur. Cette remise en question peut aussi susciter une volonté de se mettre en action. Le squat est donc l’une des formes les plus pures de transgression en matière de projet alternatif, tant par son mode d’action que par son mode de communication. Juger ces méthodes délétères et révoltantes est une approche improductive. Au contraire, leur approche transgressive permet de réagir avec tranchant ; ainsi soit on s’inscrit en opposition avec leurs valeurs, soit ces dernières nous poussent à agir. Cette expérience est donc vécue comme quelque chose de positif donnant l’occasion de davantage s’investir et militer pour le changement d’une société répondant aux besoins essentiels de l’individu, de manière éthique, mais aussi soutenable.
En effet, la vision soutenable et écologiste est également l’une des préoccupations du squat La Pigeonne. Il propose notamment des rencontres permettant de débattre sur des questions au sujet de « Comment articuler les luttes queers et écologistes ? Qu’est-ce que les pensées et les pratiques queers apportent à l’écologie ? »151. En proposant de s’intéresser à des sujets clés dont une grande partie fait déjà débat au sein de la société, La Pigeonne rappelle qu’il manque une diversité de réponses qui laisse pour compte la minorité qu’elle représente. Les projets alternatifs proposent une réponse à cela. Il est important de noter que cette interprétation de leur engagement dans l’écologie est sûrement peu représentative de l’étendue de ce que le mouvement de La Pigeonne pourrait apporter en termes de pertinence.

En tout état de cause, cette marginalisation suscite la volonté de trouver de nouvelle réponse et une nouvelle approche afin de proposer des lieux permettant aux individus de répondre à leurs besoins essentiels. Ce qui est le fondement même de l’architecture, tel que cela a été exposé en introduction des notions de l’étude.
Le Cabane de Lucie peut être décrite comme une transgression positive des modèles ordinaires d’habiter. Lucie dépeint les changements dans sa vie qui l’ont conduit à se requestionner sur ses besoins Pour elle, la réponse a été de se rapprocher de la nature qui l’entoure et cela s’est traduit par le fait de quitter son emploi de comptable et de démarrer une activité de masseuse. Cette dernière a constitué un moyen de se concentrer sur le bien-être des individus. Par ailleurs, elle a combiné à cette recherche, la nécessité de vivre avec plus de sobriété en habitant un espace qu’elle qualifie de « suffisant ». Tout au long du processus de conception, elle a évoqué avec une certaine ferveur toutes les choses dont elle n’avait pas besoin. Habituellement, dans le processus de conception d’un habitat 150 (La
67
Pigeonne)
151 Ibid.
Figure 26 Illustration d'une publication, source La Pigeonne
individuel, le concepteur professionnel (architecte, maitre d’œuvre, etc.) manie ses entretiens avec automatisme, pouvant se traduire par une proposition d’espace inadapté à la demande, ce d’autant lorsque ces dernières apparaissent comme singulières. En ce sens, le projet alternatif interroge le rapport architecte-usager et notamment le rôle de l’architecte dans sa pratique. Le projet de Lucie n’est pas une tiny house telle qu’on les voit se développer sur le marché. En effet, son habitat n’est pas nomade, mais construit sur de vraies fondations. Or, les tiny house sont contraintes de respecter un certain gabarit pour pouvoir circuler sur la route, contrainte à laquelle n’était pas soumise la Cabane de Lucie. Toutefois, cette dernière disposait d’un terrain très étroit avec des prospects l’obligeant à se trouver en recul de limite parcellaire. Ces contraintes n’ont toutefois eu que peu d’impact, dans la mesure où le projet n’a généré la création que d’une trentaine de mètres carré de surface plancher. Les automatismes des concepteurs, durant la phase de conception, ont généré des questionnements au sujet de l’emplacement de la machine à laver, qui finalement ne sera pas une machine standard, mais une sorte de caisson low-tech
Le Van de Paulo s’inscrit dans une autre forme d’hybridation du projet alternatif. La correspondance de ce projet avec les différents projets alternatifs réside dans le fait que c’est grâce à l’expérience et le vécu que la recherche en matière d’habiter se façonne. À la suite d’une première expérience de vie en van lors d’un voyage en Nouvelle-Zélande, Paulo avait comme projet initial de voyager à travers le monde. Lors d’entretiens semi-dirigés, il a expliqué comment les changements dans sa vie l’ont amené à requestionner son projet. Après avoir voyagé en stop durant plusieurs mois, il a formalisé son projet dans l’achat et les travaux d’aménagement d’un van. L’agencement de ce dernier l’a conduit à utiliser des outils de conception et de modélisation de plan en 3D avec l’aide d’un professionnel. La notion du « suffisant », telle que Lucie l’a évoquée dans son projet de cabane, prend ici encore plus son sens. L’espace très limité oblige à réfléchir sur ce qui est primordial au quotidien. Cela nous oblige à nous organiser à l’échelle de l’individu, mais plus largement on peut s’interroger sur l’organisation de nos sociétés.
68
2.1. De l’éthique et du bon sens
Tout au long de cette étude, tous les projets retenus et présentés sont ceux qui ont accepté de répondre aux sollicitations. Il est à noter également ceux qui ne répondent pas et qui par leur nonréponse marquent leur engagement dans une rupture globale tel que le squat La Pigeonne. Ainsi qu’il l’a été dit précédemment, cette transgression reste positive, dans la mesure où elle marque la volonté de réinterroger l’approche de l’étude, et plus généralement l’approche de la société et son fonctionnement. Yona Friedman propose de réfléchir au sujet de l’organisation de la société. « L’environnement c’est les autres, et notre impulsion irrésistible est de vouloir « organiser » ces autres, c’est-à-dire la société et l’environnement. Cet instinct d’organisation, fondamentalement humain, nous vient de notre désir d’améliorer » le monde, de l’améliorer en le rapprochant de l’image du monde que chaque individu façonne pour lui-même C’est peut-être la caractéristique principale qui différencie l’animal humain des autres animaux : les humains veulent organiser le monde, alors que la plupart des autres animaux savent s’organiser eux-mêmes. Se changer soi-même ou changer le monde. Changer le monde c’est le « conquérir ». Le but inconscient de l’humanité, c’est la conquête du monde, celle des autres, des sociétés, ou de l’environnement. Est-ce évitable ? »152 C’est en cela que l’axiomatique proposée par Yona Friedman ci-dessous, synthétise la réflexion menée dans son ouvrage « Utopies réalisables ».
Figure 27 Axiomatique des liaisons entre personnes et objet source Yona Friedman
Ce schéma est légendé par Yona Friedman comme suit « 1. Un objet n’appartient à un environnement que s’il fixe l’attention d’un individu ; 2. Un objet nécessaire à la survie d’un individu fixe son attention ; 3.Un objet qui fixe l’attention d’un individu fixe également son attention sur les liens existants entre ces objets et les autres (personnes ou objets) ; a. l’environnement peut être différent pour des individus différents en fonction de leur faculté d’attention ; b. l’opération génératrice des liens (qui ont servi à construire notre langage objectif) est donc l’attention ; c. la survie, sans cette attention, n’est pas possible ; d. la différence entre des individues et des objets (que nous avons définie par le concept de
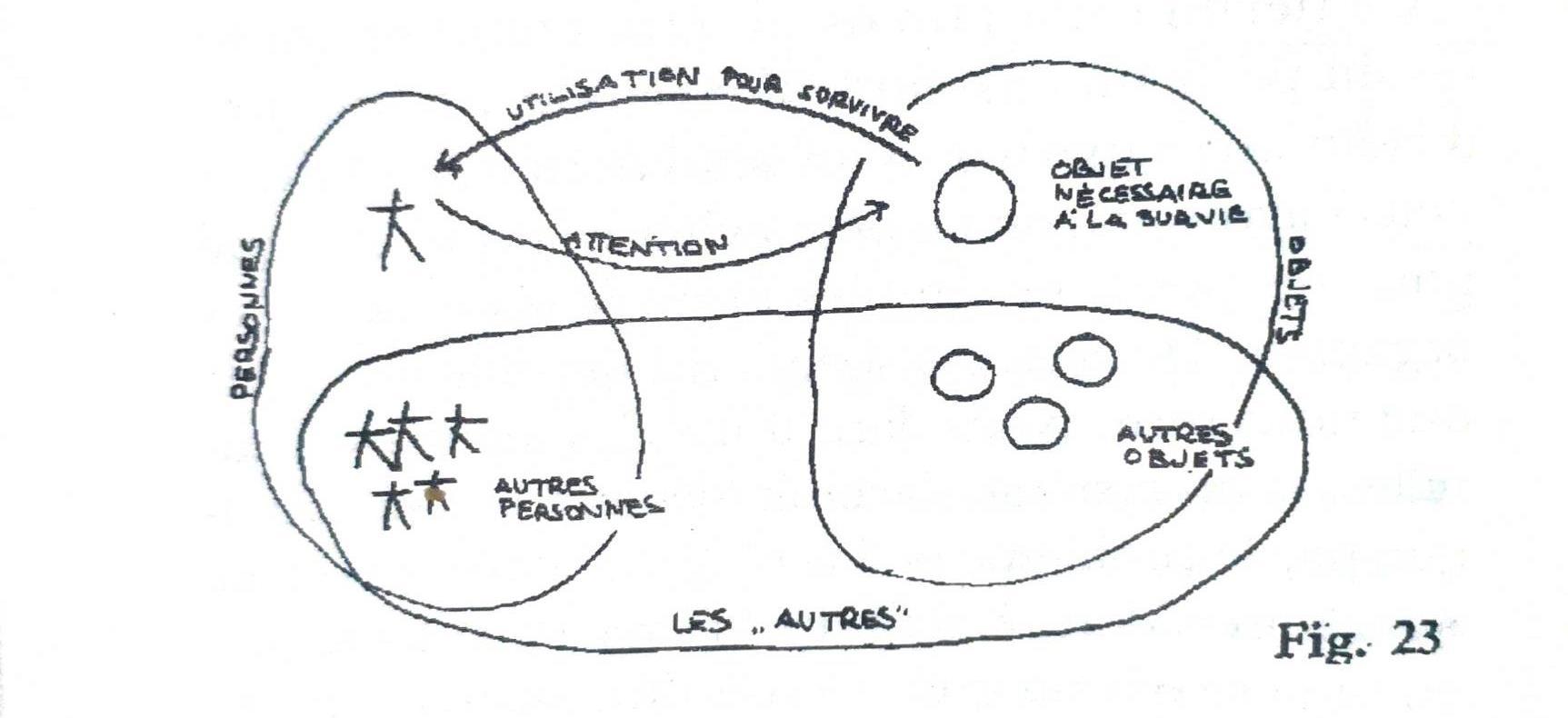
69
2. Une transition par incrémentalisme et/ou utopiste ?
152 FRIEDMAN Yona, Utopies réalisables, Edition l’Eclat, Paris, 2015 (première édition 1975), 231p
conscience des buts) est un différence d’attention, différence non traduisible du langage des uns dans celui des autres ; e. le problème de l’accès n’a pas d’autre origine que les limites de la possibilité d’attention d’un individu donné. Ce problème peut donc comporter des seuils différents selon les individus ou les objets »153
Pour lui, les sociétés d'aujourd'hui sont l’accomplissement de l'utopie, c'est-à-dire que les organisations actuelles sont les utopies d'hier qui sont devenues possibles à réaliser. Alors même que l’on pourrait penser que chacune des réformes politiques évoquées en première partie de cette étude n’ont démontré aucune solution satisfaisante, il semble simplement que nous n’ayons pas mis en avant le bon sens qui aurait pu tisser les liens vers une réponse adéquate pour la société de demain.
Yona Friedman démontre qu’il est impossible de maintenir de si grandes organisations dans nos sociétés. Leurs tailles ont largement dépassé la limite de « groupe critique » et c’est cela qui conduit notamment vers une insatisfaction citoyenne globale. S’attacher à des utopies universalistes n’est pas réalisable, car comme il l’a démontré dans sa réflexion, la communication généralisée est impossible.
(FRIEDMAN, Utopies réalisable, 2015)
70
153
2.2 De l’incrémentalisme au projet local, Lucien Kroll, Alberto Magnaghi
Cela nous amène à réfléchir sur l’élaboration de projets locaux en s’appuyant sur un processus par incrémentalisme tel que le proposent Lucien Kroll, architecte, et Alberto Magnaghi, cartographe.
2.2.1 « De l’architecture action comme processus vivant… »
« L'architecture action », vue par Lucien Kroll comme un « processus vivant », est une approche qui consiste à concevoir et à gérer les processus de manière flexible et adaptative, en prenant en compte les évolutions et les besoins changeant de l'organisation et de son environnement. Elle s'inspire de la biologie et de la dynamique des écosystèmes, en mettant l'accent sur l'adaptabilité, la résilience et l'agilité. Dans cette approche, les processus ne sont pas considérés comme des éléments statiques et figés, mais comme des éléments en constante évolution et en interaction avec leur environnement. L'architecture de processus vivant vise à créer un système de processus capable de s'adapter aux changements et de répondre de manière efficace aux besoins de l'organisation. Elle se concentre sur la création de processus souples et adaptatifs, plutôt que sur la standardisation et la simplification des processus. Il fonde la suite de sa réflexion sur la notion de l’incrémentalisme qu’il décrit comme un « autre mode de décision plus intuitif, holistique et « darwinien » (voir évolutionniste, à l’image des tâtonnements de la nature), se préoccupe de l’information vivante du contexte, mais ne veut décider de chaque étape qu’au moment où il l’aborde et seulement pendant son cours : à chaque étape, il regarde derrière lui et évolue d’après les décisions successives. »154 .
« Ainsi, la fin n’est jamais définie dès le début du processus. L’incrémentalisme est la façon écologique de décider par la participation continue de toutes les informations et de tous les informateurs qui surgissent inopinément, c’est-à-dire par rapport au contexte ; et le premier contexte d’une architecture, c’est bien l’habitant. Soucieux de ce contexte, le moyen le plus évident de le connaître est de lui proposer de participer au projet. ».
Pour mettre en place une architecture de processus vivant, il se dégage de la réflexion de Lucien Kroll qu’il faut suivre certaines étapes afin de proposer une architecture qui fasse sens : Identifier les processus clés de l'organisation et leur interdépendance ; Définir des indicateurs de performance pour chaque processus ; Établir une gouvernance adaptative pour la gestion des processus ; Mettre en place des mécanismes de feedback pour évaluer et améliorer en continu les processus ; Favoriser la collaboration et la co-création entre les différentes parties prenantes des processus
154 KROLL, Lucien. De l’architecture action comme processus vivant…. Inter, 2011, [en ligne] [consulté le 16 juillet 2022] Disponible sur Disponible sur : https://id.erudit.org/iderudit/63940ac , 8–15p
71
2.2.2 Le projet local
Ce qui émerge de cette étude, c’est l’importance de retrouver l’usager au cœur des processus d’élaboration de projet afin de proposer une architecture éthique et soutenable. Alberto Magnaghi, cartographe italien, s’intéresse au projet local et met en évidence la manière dont cela génère une architecture soutenable. En « redécouvrant le rôle de l’utopie »155, Alberto Magnaghi déconstruit le processus de déterritorialisation, organisant la standardisation des modes de vie qui crée une « nouvelle forme de pauvreté »156 . Ce phénomène résulte, selon lui, de « la dégradation générale de la qualité de vie sur un territoire »157 et se propage dans les métropoles des pays développés, voire à l’échelle mondiale. Pour lui, le développement local est une alternative au processus de déterritorialisation. A l’inverse, l’approche territorialiste qu’il propose doit permettre « un développement local et auto-soutenable »158. Dans cette démarche, il démontre le besoin primordial de replacer l’usager au cœur du processus en lui réattribuant le pouvoir de gouvernance. Dans cette perspective, « la valorisation du patrimoine et la sauvegarde de l’environnement (soutenabilité environnementale) »159 permettra de garantir le renouvellement « des caractéristiques territoriales (soutenabilité territoriale) »160 .
Son discours au sujet du projet local pourrait être considéré comme du localisme. Cette approche fait débat car en empruntant des valeurs telles que la démocratie participative, la cohésion sociale et la préservation de l’environnement, on pourrait penser sa cause noble, mais elle se heurte à des limites lorsque, par son fonctionnement, elle permet l’exclusion de certains groupes sociaux et limite la diversité de biens et/ou de services Au contraire, Alberto Magnaghi, en s’appuyant sur la notion de « projet local », propose une forme de « solidarités inter-locales ». De cette manière, il suscite une « multiplicité de styles de développements », permettant de s’écarter du paysage lisse et homogène qu’induit l’actuelle globalisation libérale. En proposant cette « globalisation par le bas », il dessine une utopie réalisable autour du « respect des besoins des acteurs les plus faibles » comme une soutenabilité sociale.
155 (MAGNAGHI, 2000, Édition française 2003) 156 Ibid. 157 Ibid. 158 Ibid. 159 Ibid. 160 Ibid.
72
CONCLUSION
CONCLUSION
L’architecture a longtemps été l’instrument des politiques pour mettre en avant des processus d’urbanisation de notre société capitaliste. C’est dans cette mesure que l’on peut penser que l’architecture a perdu tout sens. Ces pérégrinations l’ont éloigné de son essence première, qui est d’abriter et de protéger l’habitant, sous-entendant qu’elle devrait nécessairement être au service des habitants.
D’ailleurs, « la relation des architectes et de la société ne doit pas être un enracinement mais un accompagnement »161 comme le souligne Philippe Madec. La scission entre l’architecte et l’habitant est l’une des manifestations de la perte de sens. Pour lui, « l’évidence de la perte du sens architectural renvoie à une plus large abdication de l’époque, faite de renoncement, de cynisme et d’apathie »162. Il évoque ici la perte d’essence de l’architecture, la désunion qui existe dans sa relation avec d’autres domaines comme la politique, les arts, la philosophie ou la littérature. Pendant toute cette phase pratique de l’architecture et de la reconstruction d’après-guerre, les architectes n’ont plus eu de prise directe avec la théorie. En ce sens, Philippe Madec fait le même constat que Yona Friedman à propos du fait que « le recul de la théorie architecturale s’opère-t-il au moment précis où la société entre dans une phase d’inhibition face aux discours, elle a soupé des grands discours »163 .
Les projets alternatifs contribuent à interroger le rapport architecte-usager en mettant l’accent sur une autre forme de gouvernance, mais aussi sur la transgression par laquelle passent certains projets alternatifs. En replaçant l’usager au cœur du processus d’élaboration de projets, les architectes peuvent créer des bâtiments et des espaces qui répondent aux besoins réels des communautés et qui favorisent une utilisation durable et éthique des ressources. À une autre échelle, en s’associant avec des acteurs locaux et en travaillant en collaboration avec les communautés, les architectes peuvent créer des bâtiments qui ont un impact positif sur l’environnement et qui contribuent à un développement durable.
En conclusion, les projets alternatifs peuvent contribuer à renforcer le rapport architecte-usager en favorisant une collaboration active et une participation citoyenne, ainsi qu’en encourageant une architecture éthique et soutenable. Chacun des participants au questionnaire a répondu positivement à la question de savoir si leur sollicitation, dans le cadre de cette étude, a pu susciter une certaine remise en question ou la volonté d’approfondir une réflexion. En ce sens cette étude ouvre les bases d’une première action militante justifiant le choix du présent sujet notamment grâce à l’intérêt qu’ils y ont porté, ou non, comme on a pu le voir pour le squat La Pigeonne
161 MADEC Philippe, La secrète connivence de l’architecture et de l’éthique, Edition Pour les Polymathiques, Clermont-Ferrand, 2000, 13p
162 Ibid.
163 Ibid.
4
BIBLIOGRAPHIE
BIBLIOGRAPHIE
ARCHITECTES, O. D. (s.d.). « Remettre l’usager au cœur du projet » : le Réseau national de l’Assistance à Maîtrise d’Usage publie son Livre Blanc pour guider la conception. (Ordre des architectes) Consulté le [en ligne] [consulté le 17 décembre 2022], sur https://www.architectes.org/remettre-l-usager-au-coeur-du-projet-le-reseau-national-de-lassistance-maitrise-d-usage-publieson#:~:text=AMU%20et%20AMO&text=Nous%20pouvons%20m%C3%AAme%20dire%20que, %2C%20et%20la%20m%C3%A9thodologie%20utilis%C3%A9e.%20%C2%BB
ATELIER-NA. (s.d.). . Atelier Na PHILOSOPHIE. (Atelier NA [en ligne]) Consulté le [consulté le 18 décembre 2022], sur Disponible sur : https://www.atelier-na.eu/atelierna
BOURG Dominique, s. l. (2018). Chapitre 4. Anthropocène, questions d’interprétation. Dans : Rémi Beau éd., Penser l’Anthropocène (pp. 63-76). Paris: Presses de Sciences Po. Récupéré sur https://doi.org/10.3917/scpo.beaur.2018.01.0063
BOUZON, A. (mis en ligne le 30 juillet 2012). L'expertise en situation sur "Ulrich BECK, La société du risque. Sur la voie d’une autre modernité 2002". (t. d. Bernardi, Trad.) Questions de communication [En ligne]. doi:https://doi.org/10.4000/questionsdecommunication.7281
BRESSON, S. e. (2014). L’habitat participatif en Europe. Vers des politiques alternatives de développement urbain ? (N°15). Métropoles. doi:disponible en ligne [https://doi.org/10.4000/metropoles.4960]
Bretagne, D. (2013). La densité et ses perceptions. Modalités de calcul de la densité. Ministère de la Transition écologique.
CAUE93 – FORESTIER Marie, RENAULT Stéphane. Étude réalisée par le CAUE pour le département sur la densité pavillonnaire en Seine-Saint-Denis. Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement - 93 [en ligne]. [Sans date] [consulté le 6 avril 2022]. Disponible sur : https://www.caue93.fr/media/download/7799
CHALJUB, B. (2009). Lorsque l’engagement entre maîtrise d’ouvrage et maîtres d’œuvre encourage l’innovation architecturale: le cas du centre-ville d’Ivry-sur-Seine, 1962-1986. (1. |. Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique, Éd.)
COLIBRIS, M. ( ). Notre vision : L’éthique du Colibri. . Consulté le [en ligne]. [consulté le 13 décembre 2022]., sur Disponible sur : https://www.colibris-lemouvement.org/lassociation/notre-visionlethique-colibri
COLO, La. ([SANS DATE]). Dossier de présentation LA COLO. Linthal. Consulté le Consulté le 2 septembre 2021
COOP-TIERS-LIEUX. (s.d.). Les Cahiers du Labo - La Coopérative Tiers-Lieux. Consulté le [en ligne]. [consulté le 14 décembre 2022], sur Disponible sur : https://coop.tierslieux.net/document/lescahiers-du-labo/
CORDELIER Benoit, B. P. (2013/6). Publicité verte et greenwashing (Vol. (Volume 30)). (G. 2000, Éd.) doi:10.3917/g2000.306.0115.
6
CROS, & Françoise. (1992). Boutinet (Jean-Pierre). Anthropologie du projet. Revue française de pédagogie, volume 99. Récupéré sur https://www.persee.fr/doc/rfp_05567807_1992_num_99_1_2505_t1_0122_0000_3
CROSNIER Camille, G. S. (2022, juillet 18). Le pavillon : rêve ou cauchemar ? Consulté le aout 10, 2022, sur https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/le-debat-de-midi/le-debat-de-midi-dulundi-18-juillet-2022-5051771
DE LEGGE, E. (Publié le 7 avril 2011). Les maisons à 100 000 euros laissent un goût amer. (P. I. Journal du Net, Éd.) Consulté le Consulté le 11 Aout 2022, sur URL : https://www.journaldunet.com/economie/immobilier/1083760-bon-planimmobilier/1083783-les-maisons-a-100-000-euros
DENIS, M.-N. (s.d.). De l'influence des politiques de reconstruction sur l'architecture rurale en Alsace. doi:10.3917/ethn.070.0029
DESHAYES, P. (2012/1 (n°37)). Le secteur du bâtiment face aux enjeux du développement durable : logiques d'innovation et/ou problématiques du changement. (D. B. Supérieur, Éd.) Innovations, Revue d’économie et de management de l'innovation, pp. p 219-236. doi:10.3917/inno.037.0219
DREAL-BRETAGNE. ([en ligne]. [12 Juillet 2013] [consulté le 22 avril 2022]). La densité et ses perceptions. Modalités de calcul de la densité. Récupéré sur Disponible sur : https://www.bretagne.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/14_09_05_Rapport_sur_les_perceptions_et_les_modalites_de_cal cul_de_la_densite_cle2c9252-2.pdf
DUMONT, G.-F. (2015). « Une idéologie de la métropolisation ? ». Population & Avenir, n° 722, p. 3-3. doi:DOI : 10.3917/popav.722.0003
DUQUE GÓMEZ, Catalina. Densité urbaine, Cités Territoires Gouvernance (CITEGO). CITÉS TERRITOIRES GOUVERNANCE Le territoire au cœur de la transition [en ligne]. Décembre 2015 [consulté le 22 avril 2022]. Disponible sur : https://www.citego.org/bdf_fiche-notion-1_fr.html
ECO-Habitat-Groupé, E. É. (s.d.). Consulté le [en ligne] [consulté le 14 décembre 2022], sur Disponible sur : http://www.ecohabitatgroupe.fr/
FAREL, A. F.-M. (s.d.). Bâtir éthique et responsable. Paris, 2007: Editions Le Moniteur.
FLEURY, C. (12 Aout 2022). Pour Jankélévitch, la liberté n’existe pas, mais elle devient, dans la chronique « un été avec Jankélévitch. France Inter. Consulté le Aout 12 , 2022, sur https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/un-ete-avec-jankelevitch/un-ete-avecjankelevitch-du-vendredi-12-aout-2022-9382531
FRANCE. (JORF n°0072 du 26 mars 2014). Loi Alur, . Consulté le consulté le 21 Août 2022, sur , Disponible à l’adresse : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/JORFARTI000028772674/
FRANCE, M. d. (28 septembre 2020). Habitat participatif : un cadre juridique pour habiter autrement. Rubrique Politique publiques – Accès au logement – Accession à la propriété, vente et fiscalité
7
de l’immobilier. Consulté le consulté le 21 aout 2022, sur https://www.ecologie.gouv.fr/habitat-participatif-cadre-juridique-habiter-autrement
FRIEDMAN, Y. (2015). Utopies réalisable. Paris: Editions de l’éclat, (première édition 1975 dans la collection 10/18) .
FRIEDMAN, Y. (2016 (première édition 1976)). Comment habiter la terre. Paris: Editions l’éclat.
FRIEDMAN, Y. (2016, Première édition Jean Jacques Pauvert,1974). Comment vivre avec les autres sans être chef et sans être esclave. (E. E. Poche, Éd.)
FRIEDMAN, Y. (2020 (première édition 1958)). L’ordre compliqué et autres fragements. Paris.
FOURCAUT Annie, La banlieue en morceaux. La crise des lotissements défectueux en France dans l ’ entre-deux-guerres, Paris, Créaphis, 2000
FOURCAUT Annie, « Débats et réalisations de l’entre-deux-guerres ou le lotissement comme anti modèle », dans Danièle Voldman (sous la direction de), Les origines des villes nouvelles de la région parisienne (1919-1969), Les Cahiers de l’IHTP, no 17, décembre 1990, p. 11-21;
GAUTHIEZ(dir.), B. (2003). Espace urbain, vocabulaire et morphologie (Vol. Collection Vocabulaire). Edition du Patrimoine.
GORZ, A. (2008). Ecologica. Paris: Editions Galilée.
GRAINE-DE-LIEUX. (Avril 2022). Cahier de consultation, Elément pré-esquisse. Sélestat. Consulté le Consulté le 22 mai 2022, 10p
HABITAT-Participatif-Strasbourg. (s.d.). Urban ‘Hôtes, le témoignage de Stephan • Portail de l'habitat participatif. (Portail de l'habitat participatif [en ligne]) Consulté le [Consulté le 29 janvier 2022]. , sur Disponible sur : https://habitatparticipatif.strasbourg.eu/explorer/temoignages/urbanhotes-neudorf-tem
HABITAT-Participatif-Strasbourg. (s.d.) Découvrir l'habitat participatif. Portail de l'habitat participatif [en ligne]. (s.d.). Consulté le [consulté le 13 décembre 2022], sur Disponible sur : https://habitatparticipatif.strasbourg.eu/decouvrir-lhabitat-participatif/
INSEE Logement − Tableaux de l’économie française. (s.d.). (Edition INSEE Références en ligne) Consulté le Consulté le 19 janvier 2022, sur en ligne sur https://www.insee.fr/fr/statistiques/3303460?sommaire=3353488
JOUZEL Jean, P. M.-D. (2018, Février). Trente ans d’histoire du Giec. La Météorologie(100), pp. p117124.doi:10.4267/2042/65154
KRIEG-PLANQUE, A. (2010). La formule “développement durable” : un opérateur de neutralisation de la conflictualité. 2010/4 ((n° 134), p. 5-29.). doi:DOI : 10.3917/ls.134.0005
KROLL, L. (2011). De l’architecture action comme processus vivant…. Inter, , p 8–15 / 108. Consulté le consulté le 8 mars 2022, sur https://id.erudit.org/iderudit/63940ac
LEGOULLON, G. (décembre 2016). La construction des grands ensembles en France : émergence de nouvelles vulnérabilités environnementales (Vol. Volume 16). (V. l. [Online], Éd.) doi:DOI : https://doi.org/10.4000/vertigo.17984
8
Lexicales, C. N. (s.d.). CNRTL. Récupéré sur https://www.cnrtl.fr/
MADEC, P. (2000). La secrète connivence de l’architecture et de l’éthique. Clermont-Ferrand: Edition Pour les Polymatiques.
MAGNAGHI, A. (2000, Édition française 2003). Le projet local. Torino: Pierre Mardaga Spritmont (Belgique).
MONNIER, G. (2000). De la reconstruction a la croissance (1945-1975) (Vol. Presses Universitaires de France, « Que sais-je ? »). (L. d. Gérard Monnier éd., Éd.) Paris. Récupéré sur URL : https://www.cairn.info/ 9782130507598-page-74.htm
MONNOYER-SMITH, L. (2017, Mai-Juin). Conseil national de la transition écologique. Volume 16, numéro 3, p313-314. doi:doi:10.1684/ers.2017.0995
MUGNY, G., & PAPASTAMOU, S. (1979). Réactance psychologique et ordre social (Vol. Vol. 2). Quaderns de psicologia. International journal of psychology. Récupéré sur https://raco.cat/index.php/QuadernsPsicologia/article/view/200614
MYTTENAERE, K. (2006). Vers une architecture soutenable. 389p. Récupéré sur disponible sur http://hdl.handle.net/2078.1/5002
OASIS, C. (s.d.). Qu’est-ce qu’une Oasis ? - Coopérative Oasis. Consulté le [en ligne]. [Consulté le 13 décembre 2022], sur Disponible sur : https://cooperative-oasis.org/decouvrir/definitionoasis/
OASIS-MULTIKULTI. (s.d.). LE PROJET . Tiers-Lieu Oasis Multikulti | France. Oasis Multikulti [en ligne]. [sans date] . Consulté le [consulté le 19 décembre 2022], sur Disponible sur : https://www.oasismultikulti.org/
OASIS-MULTIKULTI. (s.d.) Tiers-Lieu Oasis Multikulti . Consulté le [consulté le 14 décembre 2022], sur Disponible sur : https://www.oasismultikulti.org/
PAQUOT, T. (2015, 2019). Désastre urbains Les villes meurent aussi. Paris: Edition La Découverte.
PELLAUD, F. (2011). Pour une éducation au développement durable. (E. Quae, Éd.) Versaille.
PIGEONNE, L. (s.d.). Lapigeonne. Consulté le [consulté le 16 décembre 2022], sur Disponible sur : https://www.facebook.com/Lapigeonne
PITSEYS, J. ( 2010). Le concept de gouvernance. Volume 65, pp. p. 207-228. doi: DOI : 10.3917/riej.065.0207
RESEAU-Professionnel-AMU-Rhin-Supérieur. (publié le 1er septembre 2021). Assistance à Maitrise d’Usage, Panorama d'exemples et de pratiques dans le Grand Est. Consulté le [en ligne], conculté le 29 octobre 2022, sur , disponible sur : https://issuu.com/amu.rhinsup/docs/amu__panorama_d_exemples_et_de_pratiques_dans_le_
ROELS, C. (2009). Charles Jencks, Oeuvre, histoire et fortune du critique d’architecture. Bruxelles: Travail de Fin d’Etudes, Institut Supérieur d’Architecture de la Communauté Française – La Cambre.
SNEGAROFF, T. (Publié le 15/01/2015). 21 mars 1973 : fin de la construction de grands ensembles. Consulté le Consulté le 11 Aout 2022, sur URL : https://www.francetvinfo.fr/replay-
9
radio/histoires-d-info/21-mars-1973-fin-de-la-construction-de-grandsensembles_1769827.html
TALANDIER, M. (2019). , Résilience des métropoles le renouvellement des modèles. Dans E. L. POPSU (Éd.), Conférence prononcé lors de l’atelier Résilience et alliance des territoires des Troisièmes journées nationales de France Urbain. Toulouse.
TAPIE, G. (2005). Maison individuelle, architecture, urbanité. La Tour d’Aigues: Edition de l'Aube. TOUBANOS, D. (2017). Concevoir et construire autrement, pour une société durable : l’expérience participative de Lucien Kroll et Patrick Bouchain. Vaulx-en-Velin: École Nationale des Travaux Publics de l’État [ENTPE] et École nationale supérieure de l’architecture de Lyon (ENSAL),. Consulté le Décembre 2022, sur https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01684155
TRESPEUCH, L. R. (2021, Octobre/Décembre). Allons-nous vers une société plus responsable grâce à la pandémie de Covid-19? Nature, Sciences, Sociétés, 29(4), pp. p 479 - 486. doi:10.1051/nss/2022005
TRIBU architecture, Quelle densité ? dans densification qualité ville. Densité [en ligne]. 4 mai 2015 [consulté le 15 avril 2022]. Disponible sur : http://www.densite.ch/fr/blog/quelle-densite
VAYSSIERE, B. (s.d.). Relever la France dans les après-guerres : reconstruction ou réaménagement ? doi:10.3917/gmcc.236.0045
VIDARD, M. T. ([En ligne] 15 septembre 2022). Pour une économie de la décroissance. France Inter. Consulté le consulté le 17 septembre 2022,, sur https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/la-terre-au-carre/la-terre-au-carre-dujeudi-15-septembre-2022-8313277
80
TABLE DES MATIÈRES
REMERCIEMENTS ......................................................................................................................... 4 SOMMAIRE .................................................................................................................................. 6 INTRODUCTION............................................................................................................................ 8
METHODE 10 ETAT DE L’ART 12 L’ANTHROPOCENE COMME DEFINITION D’UNE PERIODE 12
LA NOTION DE DEVELOPPEMENT DURABLE 12
LA NOTION DU BESOIN ET LA PYRAMIDE DE MASLOW ................................................................ 14
IMPACT DU BATI SUR L’ENVIRONNEMENT ET CHANGEMENT DE COMPORTEMENTS ................. 15
LA REACTANCE PSYCHOLOGIQUE : DE LA SOCIETE DU RISQUE A L’ARCHITECTURE ETHIQUE 16 LA SOCIETE DU RISQUE.......................................................................................................... 17 L’ARCHITECTURE ETHIQUE – LUCIEN KROLL, PATRICK BOUCHAIN ET PHILIPPE MADEC. ..... 18 Partie I Gouvernance et Rupture avec les Modèles, du Modernisme au Postmodernisme............. 20
1. Gouvernance verticale descendante 21 1.1. Le cas de la reconstruction après-guerre en France ........................................................... 21 1.1.1 Contexte Alsacien...................................................................................................... 21 1.1.1.a. Volonté d’innovations et urgence de reconstruction 21 1.1.1.b. La reconstruction dirigée par les politiques nationales 22 1.1.2 La critique du Ciam par Team Ten, une tentative d’alternative ?............................. 23 1.1.2.a. L’approche théorique relayée au second plan 23 1.1.2.b. Exemple d’alternative : le cas d’Ivry sur Seine par l’Atelier de Montrouge. 24 1.2. Un va et vient de réformes déconnectées de l’usager........................................................ 26 1.2.1 Expérimentation à l’échelle réelle dont l’usager est exempt.................................... 26 1.2.2 Basculement des grands ensembles aux zones pavillonnaires 29
1.2.2.a. Le rêve de la maison individuelle, un faux modèle de liberté 29 1.2.2.b. De la réussite sociale…...................................................................................... 30 1.2.2.c. …à la standardisation à grande échelle, le modèle des Chalendonnettes........ 31 1.2.2.d. Une artificialisation des sols non soutenable 32
2. Une rupture multiple .................................................................................................................. 33
2.1 Densité et étalement urbain ............................................................................................... 33
2.1.1 Rapport à l’hectare 33 2.1.2 Le pavillon, un faux sentiment de liberté 36
2.2 Regard critique et rupture avec le territoire....................................................................... 37
82
TABLE DES MATIERE
2.2.1 Le diagramme de Jencks comme outil critique......................................................... 37
2.2.2 Une rupture de la société avec son territoire 39
2.2.2.a. Métropolisation & polarisation des villes ......................................................... 39 2.2.2.b. Perte d’identité et immédiateté ....................................................................... 39 2.2.3 De l’ordre compliqué à l’éthique architecturale 41 Partie 2 Vers une Gouvernance Adaptée, une Transition par les Projets Alternatifs...................... 42
1. Gouvernance horizontale, vers une architecture éthique.......................................................... 43
1.1. La fin d’« un monde pauvre » d’après Yona Friedman 43 1.2. Typologie de projets alternatifs et rapport architecte-usager 47 1.2.1 L’habitat participatif.................................................................................................. 47 1.2.1.a. Les Familistères ................................................................................................. 47 1.2.1.b. Le Kibboutz 47 1.2.1.c. L’habitat participatif « courant » 49 1.2.2 L’écolieu..................................................................................................................... 56 1.2.3 Le tiers-lieu................................................................................................................ 60 1.2.4 Les déclassés 66
2. Une transition par incrémentalisme et/ou utopiste ?................................................................ 69 2.1. De l’éthique et du bon sens................................................................................................. 69 2.2 De l’incrémentalisme au projet local, Lucien Kroll, Alberto Magnaghi 71 2.2.1 « De l’architecture action comme processus vivant… » 71 2.2.2 Le projet local............................................................................................................ 72
87 Présentation desProjetsAlternatifs
88 URBAN’HOTES, habitat participatif à Strasbourg
GRAINE DE LIEUX – L’ŒUVRE, Habitat participatif à Sélestat
L’OASIS MULTIKULTI, écolieu à Mietesheim LA COLO, écolieu à Linthal
83
..........................................................................................................................
.................................................................................................
............................................................................................................................
.......
CONCLUSION.............................................................................................................................. 73 BIBLIOGRAPHIE
75 TABLE DES MATIÈRES 81 TABLE DES ILLUSTRATIONS
........ 85 ANNEXES
.
.........................................................................................
MAISON MIMIR, Tiers-lieu à Strasbourg
LA CABANE DE LUCIE à Anould
LE VAN DE PAULO, en itinérance
LA PIEGONNE, « squat anarchia-féministe de Strasbourg »
Enquêtes................................................................................................................................100
URBAN’HOTES, habitat participatif à Strasbourg
GRAINE DE LIEUX – L’ŒUVRE, Habitat participatif à Sélestat – Jacques GRAINE DE LIEUX –
L’ŒUVRE, Habitat participatif à Sélestat – Patrick OASIS MULTIKULTI, à Mietesheim - Stéphanie
LA CABANE DE LUCIE, à Anould - Lucie
LE VAN DE PAULO, en Itinérance dans le monde - Paulo
LA PIEGEONNE, Squat Queer Féministe Antiraciste à Strasbourg
Autres Supports.....................................................................................................................113
TABLEAU DE RECHERCHE ET DE SYNTHETISATION DES DONNEES
Annexe - A (extrait) La Gouvernance dans les Oasis - Le petit livret Colibris Annexe - B
Accompagnement Architectural
84
TABLE DES ILLUSTRATIONS
TABLE DES ILLUSTRATIONS
Figure 1 Pyramide de Maslow 1943 Pyramide de Maslow. [consulté le 14 décembre 2022]. Disponible sur : https://lisette-mag.fr/pyramide-de-maslow/ 14
Figure 2 « J’ai grandi dans un H.L.M » – Zoé 27
Figure 3 GENDRIN. En finir avec le rêve d’une « maison avec jardin » ? – Prendre Parti. [consulté le 14 décembre 2022]. Disponible sur : https://www.prendreparti.com/2022/02/17/en-finir-avec-le-reve-dune-maison-avecjardin/.................................................................................................................................................................... 30
Figure 4 Forme d’habitat et niveau de densité 33
Figure 5 La même densité peut prendre des formes bien différentes – Source : Vivre en Ville, adapté de Urban Task Force, Towards an urban renaissance, 1999 34
Figure 6 Courbes de tendance du taux de motorisation ....................................................................................... 36
Figure 7 ROELS Christine, Charles Jencks, Oeuvre, histoire et fortune du critique d’architecture, Travail de Fin d’Etudes, Institut Supérieur d’Architecture de la Communauté Française – La Cambre, Bruxelles, 2009, p 152 38
Figure 8 Illustration de Yona Friedman84 ............................................................................................................... 41
Figure 9 Groupe critique égalitaire se divisant102 44
Figure 10 Le groupe égalitaire de 16 membres 94 44
Figure 11 Groupe critique hiérarchisé102 ............................................................................................................... 44
Figure 12 Réorganiser la terre104 45
Figure 13 Changer de mentalité111 46
Figure 14 Qui doit planifier, source Yona Friedman .............................................................................................. 48
Figure 15 Autopromotion Urban Hôte, source personnelle 49
Figure 16 Habitat participatif – Source Eco Habitat Groupé 50
Figure 17 Illustration pour les ateliers d’Habitat Participatif de Strasbourg115 ..................................................... 50
Figure 18 Synthétisation de l'approche des ateliers, source Tristan Chaudon 53
Figure 19 Temporalité et enjeux de l'AMU, source Réseau Professionnel AMU Rhin Supérieur 54
Figure 20 Gouvernance du Mouvement Colibris ................................................................................................... 57
Figure 21 Outils libres - Mouvement Colibris 58
Figure 22 Cour de l'Oasis Multikulti durant le 5ème Festikulti, source Oasis Multikulti 59
Figure 23 Schéma de l'organisation d'une tiers-lieu - source Coop Tiers-lieux...................................................... 61
Figure 24 Principe social du tiers-lieux, source Coop Tiers-lieux 62
Figure 25 Schéma synthétique sur la démarche et la philosophie architecturale, source Atelier NA 64
Figure 26 Illustration d'une publication, source La Pigeonne................................................................................ 67
Figure 27 Axiomatique des liaisons entre personnes et objet source Yona Friedman 69
86
ANNEXES
Présentation des Projets Alternatifs
URBAN’HOTES, habitat participatif à Strasbourg164
Le groupe Urban'hôtes s'est constitué à l'occasion du 2ème appel à projet Autopromotion de la Ville deStrasbourg, dont il a été lauréat. Ses membres se sont réunis autour de l'objectif d'aller vers un lieu de vie durable, respectueux et ouvert sur l'environnement, dansunedémarchedepartagede connaissance et d'acquisition de compétences.
SituéenbordureduquartierduNeudorf,àdeuxpas de l'avenue du Rhin, le projet architectural s'inscrit dansuntissuurbaintrèshétérogène.Ilsenourritde la forme complexe du terrain, associée à de fortes contraintes réglementaires, du programme riche et denseetdeprincipesbioclimatiquessoucieuxd'une qualité environnementale. L'immeuble est constitué de 8 logements en R+2+combles, est implanté au nord du terrain où se situent ses accès principaux. Chaque logement est traversant et bénéficie de prolongements extérieurs (balcons ou terrasses) orientés sud ou sud-est. Le bardage bois àclairevoiehabillelescoursivesextérieuresaunord et les garde-corps des balcons, ainsi que la tuile en terre cuite foncée (toiture rampante et bardage en façade) participent à l'inscription de l'immeuble dans son environnement urbain et affirment la singularité du bâtiment.
PARTI-PRIS ECOLOGIQUE
Objectif énergétique : environ 40 KWhep/m²/an Énergies renouvelables : chauffage et eau chaude sanitaire produits par pompe à chaleur (aquathermie) Matériaux écologiques : murs extérieurs en ossaturebois isolés par de la ouate de cellulose et de la fibre de bois ; toitures en tuiles terre cuite ; revêtements des sols et habillages des murs, intérieurs écologiques Gestion de l'eau : réutilisation des eaux de pluie pour le potager ; toiture partiellement végétalisée
ESPACES MUTUALISES
Buanderie, salle commune, chambre d'amis, ateliers, potagers, très large local vélos
LES PARTENAIRES DU PROJET
Strasbourg Eurométropole, ATOLH Architecture (Olivier Hangen), Ecoquartier Strasbourg
Le projet d’autopromotion, le groupe Il s’agit de la réalisation d’un projet d’habitat directement par les
futurs propriétaires, qui assurent eux-mêmes la maîtrise d’ouvrage en concevant et finançant le projet. L’objectif du groupe est d’aller vers un lieu de vie durable, respectueux et ouvert sur l’environnement, dans une démarche de partage de connaissance et d’acquisition de compétences. Chaquemembreestattachéauxvaleursdelacharte parmi lesquelles se retrouvent la solidarité, le partage, la simplicité, le respect, la bienveillance et la diversité. Notre groupe d’autopromotion s’est constitué début 2012. Au 12 novembre 2014, notre groupe d’autopromotion est complet. Il se compose de 8 familles : 15 adultes (de 26 à 58 ans) et 6 enfants.
Notre projet se situera entre la rue St Urbain et la rue du Ballon, à Strasbourg sur un terrain d’environ 1400 m2. Nous avons pour objectif de concevoir collectivement un petit immeuble de 8 logements individuels (2 étages) et d’espaces mutualisés (salle polyvalente, chambre d’amis, buanderie, atelier de bricolage, garage à vélos, jardin). Nous avons déjà recruté un architecte et des bureaux d’étude qui travaillent sur ce projet. Nous avons déposé et obtenu le permis de construire. Nous allons démarrer la construction en 2015. Le projet Urban’hôtes s’inscrit dans le tissu urbain, très hétérogène par l’architecture et les formes d’habitat existantes, du secteur de la rue St-Urbain.
L’immeuble en R+2+combles est implanté au Nord du terrain et laisse libre au Sud un large espace aménagé en potager collectif. Les accès principaux, véhicules et piéton, sont organisés côté rue du Ballon. L’immeuble est desservi par un système de coursives extérieures, distribuant les 6 logements situés aux étages. Chacun des logements bénéficie d’un prolongement extérieur orienté Sud ou Sudest.
Le volume du bâtiment, contraint par les règles du POS en vigueur, dessine des formes riches et découpées, avec tantôt des toitures à pans, tantôt des toitures terrasses.
Les balcons, au Sud-Est et les toitures terrasses, en escalier au Sud, rythment la façade et affirment le caractère résidentiel du projet. Pour habiller les formes complexes et découpées du bâtiment, la façade, en enveloppe bois, est traitée par un enduit clair et la toiture en tuile en terre cuite foncées.
164 HABITAT-PARTICIPATIF-STRASBOURG. Urban'hotes • Portail de l'habitat participatif. Portail de l'habitat participatif [en ligne]. [sans date] [consulté le 19 décembre 2022]. Disponible sur : https://habitatparticipatif.strasbourg.eu/explorer/projets/urbanhotes/
ENGAGEMENTS ENVIRONNEMENTAUX
Objectif énergétique : Haute performance énergétique sans atteindre le passif : Environ 40 KWhep/m2/an Énergies renouvelables : Chauffage et eau chaude sanitaire produite par pompe à chaleur sur aqua thermie (nappe phréatique)
Matériaux écologiques : – Enveloppe bois et cellulose – Toiture en tuiles terre cuite – Fenêtres en bois
– Revêtements des sols et murs écologiques Gestion de l’eau : Récupération des eaux pluviales pour le potager Toiture partiellement végétalisée Espaces extérieurs perméables à l’eau
TEMOIGNAGE
DE STEPHAN
Stephan et sa famille souhaitaient rester dans leur quartier du Neudorf, mais rêvaient d'un espace extérieur et d'un logement respectueux de l'environnement. Ils ont trouvé le terrain idéal, non loin de la route du Rhin, avec leur groupe, les Urban'Hôtes. Entre les petits immeubles et les maisons anciennes, le bâtiment et son toit géométrique noir font office d'ovni
Un podcast réalisé par Emma Berthaud, pour l'association Eco-Quartier Strasbourg.
RETRANSCRIPTION DU TEMOIGNAGE
Je m'appelle Stephan, je vis dans l’immeuble Urban Hôtes avec ma compagne et mes deux enfants de 11 et 13 ans. Auparavant nous étions locataires dans un immeuble du Neudorf qui datait du début du 20ème siècle. On y était plutôt bien et j’aimais le cachet de l’ancien, mais nous ressentions le besoin d’une zone extérieure. Nous attachions également de l’importance à l’idée de nous installer dans un habitat peu consommateur d'énergie et respectueux de l’environnement.
La genèse du projet J’ai dans unpremier tempsentenduparlerduprojet d’éco-quartier Danube, qui a attiré ma curiosité. Puis nous avons été informés que la Ville de Strasbourg lançait un appel à projets pour un certain nombre de terrains sur Strasbourg, afin d’y implanter des immeubles en auto-promotion. En 2011, nous nous sommes donc orientés vers un atelier organisé par Eco-Quartier Strasbourg et l’Eurométropole, dont le but était de faire se rencontrer des groupes autour de potentiels terrain. L’un de ces terrains nous a vivement intéressé: il étaitsituéauNeudorf, et suffisamment grand pour y construire un immeuble avec pas mal de familles. Lors de cet atelier, nous avons
égalementimmédiatementrencontréquatreautres familles et avons commencé à travailler sur le projet.
Le groupe d'habitants
Nous avons souhaité être le plus multigénérationnel possible : trois familles ont entre 50 et60ans,avecsouventdesgrandsenfants.Ilyades familles avec des enfants plus jeunes, et des tout petits. Nous avons essayé d'avoir une vraie palette, c'était une volonté délibérée du groupe. Aujourd’hui, du groupe initial, il reste trois familles, et nous sommes 8 ménages au total. Il y a eu pas mal d’aller-retour, pour différentes raisons. Au départ deux personnes célibataires faisaient partie du groupe, mais ont préféré quitter le projet, notamment parce qu’il impliquait une grande disponibilité sur une longue période et que ce n’était pas possible pour elles à ce moment-là
La phase de conception
La mairie de Strasbourg avait conçu avec EcoQuartier Strasbourg tout un accompagnement dans le cadre de cet appel à projets. Nous avons dû respecter différentes phases pour pouvoir aller jusqu'à la présentation d'un dossier, d’un acte de candidature sur un terrain. Il a fallu en premier lieu apprendreà nous connaîtreet établir unecharte de vie commune. En second lieu nous avons dû établir un mode de gouvernance, décider comment seraient prises les décisions. Ce processus s’est mis en œuvre de manière très efficace et notre travail a abouti à un dossier solide, qui nous a valu d’être sélectionnés pour le projet.
Ilyadonceucettephasederencontreaudépart,et la phase de conception s’est rapidement mise en œuvre. Cela a duré de début 2012 jusqu'à mi 2016. On pourrait penser que c’est long, quatre ans et demi… mais en réalité cela correspond à peu près à la durée que met en œuvre un promoteur lors de la construction d’un immeuble.
Nous faisions une réunion du groupe complet par semaine, et des réunions supplémentaires par groupe de travail autour de différents sujets, soit sur le long terme, soit autour de problématiques ponctuelles. A chaque fois, les groupes de travail soumettaient ensuite leurs propositions au groupe complet. On avait un rythme, à certains moments, de deux réunions par semaine. Il s’agit d’un rythme très soutenu, c’est un processus extrêmement intéressant mais qui demande beaucoup de travail.
Là aussi nous avons été accompagnés par écoquartier et la mairie deStrasbourg.Eco-Quartier a organisé une sorte de speed-dating avec des architectes et leurs bureaux techniques. Nous
avions étudié différents dossiers, choisi trois équipes, et nous les avons rencontrés en personne.
Nous avons essayé de cratériser nos choix autant que possible, afin de rester objectifs. Mais avec du recul, nous réalisons qu’il est aussi important de choisir quelqu’un de très humain, avec d’excellentes capacité d’accompagnement.
L'aspect architectural J'ai découvert à travers ce projet tout le travail de l'architecte. Il nous a associé à toutes les phases. La première a été de définir un programme, selon ce que souhaitait chaque famille pour leur appartement. Le terrain choisi impliquait des contraintes extrêmement fortes. Aussi, l’architecte nous a avant tout proposé une esquisse de l’implantation de l’immeuble sur le terrain.
Notreimmeublecomposédehuitappartements,de 70à150m²,plusdespartiescommunes.Nousavons une salle commune de 30m², une chambre d’amis avec salle de bain et toilettes, et une buanderie. A l’extérieur nous disposons d’un local bricolage, d’un abri vélos et d’un espace de stockage en rez-dechaussée.
L'immeuble est orienté nord sud et les huit appartements sont traversants. Le système constructif choisi est une structure porteuse en béton, et uneisolation en ouate de bois et ouatede cellulose, qui nous procure une isolation très conséquente. Nous avons choisi un système de chauffage par pompe à chaleur. Il s’agit de géothermie, qui va chercher la chaleur de la nappe phréatique. Ce système nous permet de nous chauffer et de produire de l'eau chaude sanitaire.
La structure juridique Nous sommes partis sur un montage juridique déjà bien éprouvé au niveau de l'autopromotion : la SCIA, Société civile immobilière d'attribution. Pour résumer, il s’agit d’investir tous ensemble dans l’immeuble à travers des parts. C’est un statut utile pendant la période de montage du projet. A la fin, les différentes parts sont attribuées à chacun, et l’immeuble devient une copropriété.
Aumomentderentrerdans le projet,etc’estceque demandait la mairie, nous avons demandéà chacun rentrant dans le groupe de pouvoir démontrer sa solidité financière. C'est à dire de demander à la banque non pas un document qui donnait l’aval pour obtenir le prêt pour un appartement, mais un prêt qui puisse financer le projet. Ce point était crucial pour éviter que l’ensemble du projet ne soit remis en cause si l’un des membres se retrouvait en difficulté. Un autre élément contraignant était également d’avoir quelques liquidités financières pour pouvoir financer toutes les études.
L’établissement bancaire que nous avons choisi connaissait déjà ce type de projets en autopromotion, nous n’avons donc pas rencontré de difficultés particulières. Il nous a simplement fallumonterundossieraveclerestedugroupepour expliquer le projet, démontrer notre solidité financière, et les démarches se sont faites relativement aisément.
La vie collective Notre groupe fonctionne très bien, nous faisons régulièrement des repas en commun, des rencontres dans notre salle commune. Nous tenons régulièrement des réunions que nous appelons « comités de maison » où nous abordons l'aménagement, les travaux à faire…
Les liens avec le quartier Nous essayons de vivre dans ce quartier avec les habitants qui s’y trouvaient déjà. Nous ouvrons notre salle commune aux associations des alentours,ilyaparexempleunjardinpartagéquise trouve juste à côté qui a déjà pu faire plusieurs fois son assemblée générale chez nous. Nous participons aussi à la vie du quartier en nous impliquant dans la fête des voisins. Enfin, nous avons également mis en place un pédibus avec d’autres habitants de la rue, afin de pouvoir emmener nos enfants à l’école. Les enfants sont un excellent moyen pour rencontrer de nouvelles personnes…
GRAINE DE LIEUX – L’ŒUVRE, Habitat participatif à Sélestat165
PRESENTATION
Notre projet d’habitat participatif écologique est situé à Sélestat en zone résidentielle UC du PLU en cours de révision. Le terrain situé au 12, rue de l’œuvre à Sélestat comprend :
• Une surface de 1550 m² en forme de L
• Une maison de 1963 de 240 m² habitables sur les 2 niveaux
• Dessurfacesaménageablesencombles(environ 60 m²)
• Un sous-sol aménageable (environ 130 m²)
• Une possibilité de construction ou d’extension d’environ 500 m² de SDP
PROJET
Le groupe d’habitants désire se limiter à un habitat participatif composé de 8 foyers maximum.
La maison actuelle a été isolée thermiquement par l’extérieur il y a quelques années.
SOUHAITS D’AMENAGEMENT Allotissement
En imaginant des accès directs aux logements par l’extérieur, l’enveloppe actuelle de la maison pourrait accueillir des cellules habitables comprises entre 53 et 63 m², soit au total :
• Au rez-de-chaussée un appartement T2 et un T3
• A l’étage deux appartements T2
• En combles un appartement T2 ou T3 (option)
D’autres solutions sont envisageables en fonction des analyses et études opérées par les professionnels. (Un grand appartement sur un niveau etc…) L’objectif étant d’atteindre un groupe de 8 foyers au total, une extension ou un jumelage de construction est à prévoir. A ce jour 5 à 6 foyers sont déclarés et connus. Deux des foyers connus souhaitent un appartement de type T4, soit environ 80 à 100 m² chacun. Le restant des foyers non identifié à ce jour, (1 ou 2) pourra être par exemple 1 T4 et/ou 1 T3. Partant de ce postulat, la composition immobilière se traduirait par les logements suivants :
• 3 appartements type T2 (dont 1 en option)
• 2 ou 3 appartements type T3
• 2 ou 3 appartements type T4.
Les logements de plain-pied seront adaptés PMR
Distribution commune
Outre les logements privés, nous prévoyons une circulation et une distribution optimisées entre les logements et les surfaces partagées communes. Ainsi nous souhaitons à minima :
• Une chambre d’amis avec salle de bain,
• Unesallecommuneaveccuisine(nonERP)de45 à 55 m²,
• Un WC commun à la salle et à la Ch. A,
• Une entrée ou espace d’accueil commun de préférence à l’ensemble des foyers, pouvant être attenant à l’espace commun
• Unebuanderieavec 1 bac, 3 MàL et un séchoir à ventilation naturelle, en sous-sol existant,
• Un local atelier commun avec accès extérieur, en sous-sol existant,
• Unecaveavecboxesprivés,ensous-solexistant,
• Une cave de rangement commun, en sous-sol existant,
• Une chaufferie commune pour PAC, ECS thermodynamique et VMC située en partie centrale, ou en sous-sol existant,
• Un abri à vélos,
• 1 local poubelles et tri.
Et des options suivantes :
• L’aménagement d’un appartement T2 dans les combles actuels,
• Unlocalcommunpouvantfairefonctionbureau, salle de soins,
• Un four à pain,
• Un puits canadien,
• Une coproduction EC solaire combinée, • Une production d’énergie solaire P = 20 kW, • Suppression et évacuation de l’ancienne chaudière et cuve à fioul.
Construction
Nous souhaitons, tant que possible restructurer et construire avec des matériaux à faible empreinte carbone. Les ressources seront de préférence locales et géo-biosourcées. Les ouvrages et structures enterrés seront en béton armé étanche. Le principe de cuvelage sera retenu jusqu’au niveau TN + 0.80 m. (PPRI) En cas d’extension, la liaison entre l’existant et le nouveau bâtiment se fera en sous-sol à partir de la porte de garage existante et une partie encavement du nouveau bâtiment. L’extension n’aura pas de cave sous toute son emprise. Le réaménagement et la restructuration
165 GRAINE-DE-LIEUX,Cahierdeconsultation,Elémentpré-esquisse,Sélestat,Avril2022,Consultéle22mai2022, 10 p (GRAINE-DE-LIEUX, Avril 2022)
de la maison existante pourra se faire avec des matériaux classiques mais à fort pouvoir isolant phonique. Les options à énergie solaire du paragraphe 2.1.2 pourront trouver leur emplacement sur la toiture de l’extension conçue à cet effet. Les appartements privés seront de préférence traversants E-W ou N-S.
En fonction de la possibilité d’ajourer le sous-sol existant par des ouvertures comme des sauts de loup ou des puits, un maximum des surfaces communes pourra y être déployé. L’option aménagement d’un T2 ou T3 sous les combles, tiendra compte de l’enveloppe d’isolation extérieure sur chevrons et entre chevrons, du remplacement de la couverture en tuiles et d’un accès extérieur. Le chêne en bordure du domaine public sera à conserver dans la mesure du possible. L’ensemble des surfaces privées sont :
Surfaces privatives des logements (hors escaliers et accès)
1. : 61 m²
2. : 70 m²
3. : 63 m²
4. : 72 m²
5. : 38 m²
6. : 65 m²
7. : 90 m²
8. : 68 m²
Si possible, chaque appartement comprendra un balcon ou une terrasse d’environ 10 m² si possible.
Programme
Contact-Visite
Dansunpremiertempsnoussouhaitonsfairevisiter les lieux avec les bâtiments existants afin que le futur maître d’œuvre puisse en prendre
connaissance et rencontrer les membres disponibles.
Faisabilité
Après le premier contact, le futur maître d’œuvre remettra au maître d’ouvrage un rapport de visite et de faisabilité succincte pour le nombre de foyers pressentis. Ce rapport n’engagera aucune des deux parties et ne fera pas l’objet d’un élément de mission.
Mission pré-esquisse
Le futur maître d’œuvre pourra proposer une préesquisse en plan schématique des espaces « faisables » en tenant compte de l’enveloppe bâtie existante avec son extension projetée. Cette mission préalable à l’élément « Esquisse » proprement-dit,sera estimée, définieetproposéeà uncoûtquele futurmaîtred’œuvrepourradétailler et joindre à la démarche de faisabilité évoquée au 2.2.2ci-dessusetsuivantletableaujointenannexe.
Missions normalisées
Chaque élément de mission à compter de l’élément « esquisse » fera l’objet d’une rémunération forfaitaire unique et scindée. Les modifications de coût seront en fonction des stipulations du cahier des clauses administratives annexé au futur contrat de l’Architecte et de la maîtrise d’œuvre.
ANNEXES
Plan cadastral Photo Géoportail Coupe élévation de la maison existante Plans du rez-de-chaussée et de l’étage Photos des façades Estimation pour la pré-esquisse de l’architecte.
L’OASIS MULTIKULTI, écolieu à Mietesheim166
L'association Oasis Multikulti est de droit local d’Alsace Moselle. Elle est administrée en gouvernance partagée par sept co-président.e.s. Elle est composée d’une centaine de membres et d'une vingtaine de bénévoles actifs
ACTIVITÉS CULTURELLES
Entre ateliers et événements festifs, l'Oasis Multikulti est un point de rencontre et de lien pour la communauté locale
PRODUITS LOCAUX
Encourager les producteurs biologiques locaux, donner accès à des produits de qualité : le groupement d’achat est une alternative à la grande distribution et la promotion du circuit court.
JARDIN PÉDAGOGIQUE
À la fois support pédagogique et de production, le jardin est un lieu de formation, de production de légumes et de plantes aromatiques et médicinales dans le respect de la biodiversité.
LE LIEU
L’Oasis Multikulti, c'est un ancien corps de ferme traditionnel alsacien situé au centre du village de Mietesheim, en Alsace du Nord. La ferme dite "s'Gangloff" (le nom du lieu-dit) appartenait à la famille Urban depuis plusieurs générations.
Aujourd'hui c'est la SCI De la cour au jardin qui détient les locaux. Elle prend en charge les travaux et loue les différents espaces aux acteurs du tiers-lieu :
- l'association Oasis Multikulti - les habitants - les entreprises
L'ASSOCIATION
Elle fédère les habitant.e.s du village et environs autour des valeurs de la permaculture et de rencontres culturelles. Elle a une vocation pédagogique, culturelle, et encourage le circuit court en faisant le lien avec les producteurs locaux et les habitants. Son objectif ? Inviter à la résilience locale et donner accès à la culture, tout en expérimentant une nouvelle façon de vivre sur son territoire.
LES HABITANTS
Depuis novembre 2021, la maison principale du lieu s'est transformée en habitat participatif.
Stéphanie Urban : De formation artistique, elle a répondu à l'appel de ses racines en partant à la rencontre de personnes inspirantes en France et en Europe, avant de retourner s'installer dans la ferme de ses grand-parents pour ydévelopper leprojet de l'Oasis Multikulti. Ses domaines de prédilection : permaculture, pain au levain, facilitation graphique.
Dominique Pichard : Résident à mi-temps entre le collectif d'artistes M33 et l'Oasis Multikulti. Nourri par les cultures alternatives, la démarche de ce photographe-auteur s’oriente aujourd'hui vers les projets artistiques à portée sociale à travers la résidence de création, la rencontre multidisciplinaire et l’engagement collectif.
Autres habitants : Camille Jeambrun et Clément Descarpentries
LES ENTREPRISES
Atelier Natacha Perez Brasserie Les Semblables
166 OASIS-MULTIKULTI. Tiers-Lieu Oasis Multikulti | France. Oasis Multikulti [en ligne]. [sans date] [consulté le 19 décembre 2022]. Disponible sur : https://www.oasismultikulti.org/ (OASIS-MULTIKULTI)
LA COLO, écolieu à Linthal167
PREAMBULE
Le projet de LA COLO s’inscrit dans le Parc naturel régional des Ballons des Vosges, dans la commune de Linthal, sur le site de l’ancienne colonie des PTT (au lieu dit Remspach). Son premier objectif consiste à éviter la détérioration d’un bâtiment existant, mis en vente en 2007, relativement bien entretenu, offrant un grand potentiel d’accueil d’activités. Ce potentiel a conduit à la création de la Société civile immobilière (SCI) “La Colo du Neuweg” et de l’association “L’écolieu la Colo” afin de développer un lieu de vie et des activités valorisant le bâtiment et son environnement. La SCI a acquis le bâtiment le 8 décembre 2020.
SITUATION
Ville : Linthal (68610), lieu-dit du Remspach Département : 68-Haut-Rhin Région : Grand-Est
FONCIER
Parcelle cadastrale 0019, environ 1.4 ha (dont zonage agricole) - dont bâti : 800m² au sol sur trois niveaux
Type de chantier
Rénovation écologique d’un bâtiment existant et inexploité depuis 15 ans (ancienne colonie de vacances des PTT) dans le Parc naturel régional des Ballons des Vosges Nombre de ménages actuellement dans le groupe : 3
Année de création du groupe : 2019 Origine de l’initiative : Citoyenne (habitants)
LA GENÈSE : FAIRE AVEC L’EXISTANT
Origine du projet
Valoriser un bâtiment existant et inoccupé Le groupe s’est constitué au printemps 2019 autour du constat de la vacance prolongée de la colonie et du gâchis que cela représentait en termes de potentialités non exploitées. Les 5 membres du groupe, attachés à la nature et aux paysages qu’offrent les hauteurs de Linthal, ont mis en commun leurs préoccupations écologiques et sociales pour préciser les contours d’un projet de vie pour ce bâtiment et son environnement
PRÉSENTATION DES MEMBRES DU PROJET
Louise Baumann
Née en 1992, elle a grandi à la Ferme des Pensées Sauvages, à proximité de l’ancienne colonie des
PTT. Elle connaît parfaitement ses environs et le potentiel offert par la situation géographique du lieu, les avantages et contraintes liés à la vie en moyenne montagne. Fortement attachée à cet environnement, elle a à cœur de le respecter, de le valoriser et d’en partager les ressources au plus grand nombre. Elle a expérimenté la vie collective lors de séjours en Irlande où elle s’est formée au tissage. À son retour en 2016, elle a suivi une formationde cuisinière(AFPA Colmar).Surl’Écolieu, elleentend développer un projet decuisinesaineet savoureuse à partir de produits de l’agriculture locale et biologique. En couple avec Nicolas Francis, ils ont une petite fille, Ellaya (née en 2019).
Nicolas Francis
Né en 1986, il est aussi un familier des hauteurs de Linthal. Détenteur d’un Brevet Professionnel de Responsable d’Exploitation Agricole, il est sensible aux dynamiques du vivant qui s’expriment à travers le cycle végétal. C’est cette dynamique qu’il veut accompagner sur le terrain de l’Écolieu en entretenant un jardin de montagne hospitalier, afin d’y témoigner des potentialités de relations Fanny Songy, née en 1985, navigue entre art et artisanat depuis sa formation à la Fédération Régionale des Métiers d’Art d’Alsace. Elle travaille les enduits et les peintures naturelles à base de chaux. À l’Écolieu, elle entend développer son atelier et accueillir les curieux de traditions anciennes revisitées.
Samuel Colard
Né en 1979, il est enseignant artistique au conservatoire de Mulhouse. Il compose et joue des claviers dans différents groupes. Il habite Linthal depuis 2009 et en arpente régulièrement les différents chemins de randonnées. À l’Écolieu la Colo, il entend installer un atelier de création musicale, développer l’activité culturelle du lieu et proposer des stages de musique à destination des habitants de la vallée, et au-delà. Passionné de cuisine, il entend également s’associer aux savoirs-faire de Louise pour le projet de restauration. MariéàMarion,ilsontensembledeux enfants: Manolin (né en 2004) et Félix (né en 2006).
Marion Muller-Colard
Née en 1978, elle est installée dans la vallée de Linthal depuis 2009, avec son mari Samuel et leurs deuxfils.Ellemesureleprivilègeetlaresponsabilité d’habiter un environnement offrant tant de
167 LA COLO, Dossier de présentation LA COLO, Linthal, [SANS DATE], consulté le 2 septembre 2021, 26p. (COLO, [SANS DATE])
richesses. Membre du Comité Consultatif National d’Éthique, conférencière et écrivain, elle entend allier culture et nature en animant l’Écolieu par des stages d’écriture, et la venue d’artistes issus de différentes disciplines.
PROJET ET ACTIVITÉS
“Un écolieu est un site structuré autour d'un hameau, d'une ancienne ferme, ou d'un bâtiment isolé à la campagne, ayant choisi de suivre les principes de l'écologie et en mesure d'accueillir comme passagers ou comme résidents des personnes souhaitant y participer où y séjourner.” (Source : http://ecolieuxdefrance.free.fr)
Ainsi,leprojetàlaColos’articuleautourde3grands axes:
1. L’association “l’Ecolieu la colo”
Objet et but :
Animer le site de l’ancienne colonie des PTT du Remspach en synergie avec son environnement naturel, social et architectural. Moyens :
Développer un mode de vie et des activités qui témoignent de SENS, de SAVEUR et de SOLIDARITÉ dans le respect des valeurs établies par la Charte. Favoriser le lien social et des liens intergénérationnels par l'accueil et la création d’activités ouvertes au public :
•atelier ouvert de tissage et couture - Louise •friperie - Pascale
•fanfare de la montagne - Samuel •bibliothèque et ateliers lecture - Marion
Les valeurs de l’association sont développées dans une charte (cf annexe 1) et ses activités encadrées par un règlement intérieur. L’association ne poursuitaucunbutlucratifetn'estliéeàaucunparti politique ou religieux.
2.Les activités professionnelles Un restaurant
Après mise aux normes ERP 5, le restaurant de Louise et Samuel développera son accueil autour d’une alimentation basée sur des produits locaux et de saison en proposant une cuisine bio, authentique, eco-responsable et pleine de saveurs. En s'approvisionnant exclusivement auprès des producteursvoisins,ilproposeraunecarteélaborée à partir de produits sains et savoureux, dans une gamme de prix accessible à tous. Pouvant accueillir jusqu'à 30 couverts, la salle est située au cœur de l’ancienne colonie de vacances, apportant au lieu une ambiance chaleureuse, originale et pleine de souvenirs. La cuisine s’adjoindra les services d’un séchoir (aromates, tisanes chaudes et froides), d’un
fumoir (cuisson et conservation) et d’un atelier de transformation (Conserves, confitures).
Des ateliers professionnels
La Colo veut être un lieu d’hospitalité pour l’artisanat et les artisans transmettant des savoirfaire respectueux de l’environnement (peintures et enduits naturels par Fanny...), et d’artisanat de transformation de matière première locale (tissage en partenariat avec l’association Fleur de laine qui valoriserait la laine d’Alsace, par exemple).
3.L’habitat participatif au sein de la SCI
La SCI est appelée à accueillir en son sein de nouveaux membres, qui adhèrent au projet, vivent et/ou travaillent sur place. Chaque foyer possèdera ses espaces privés et aura accès à des espaces partagés (cuisine et lieu de vie, bibliothèque, jardin, atelier…). Afin que chacun s’engage de manière solidaire et équitable dans ce lieu, les statuts stipulent que : un associé = 1 part = 1 voix tout au long de la vie de la SCI. Par ailleurs, les habitants s’engagent à adhérer à une charte de valeurs (annexe 3) et à devenir membres de l'association.
La SCI envisage la création d’un ensemble de 6 foyers.
MODELE ECONOMIQUE
L’enjeu économique majeur du projet dans sa globalité est de faire face à la rénovation et aux chargesdu bâtiment. C’est la SCI La Colo duNeuweg qui s’en porte garante
RÉPARTITION DE LA SURFACE EXISTANTE : 2200m²
Espaces privés (1230m²) :
• Logements : 6 foyers…700m²
•Lieux partagés par les habitants : laverie, séjour, salle à manger, cuisine…190m²
•Atelier de bricolage (bois, mécanique…) …70m²
•Espaces techniques : chaufferie, armoires électriques, stockage…270m²
Espaces associatifs (450m²) :
•Salle d’activité (spectacle, conférence…) …150m²
•Atelier tissage…30m²
•Atelier musique…30m²
•Espace de travail partagé…30m²
•Friperie…10m²
•Circulations, sanitaire…160m²
•Bureau, réception…40m²
Espaces professionnels (420m²) :
•Cuisine du restaurant …140m²
•Espace public du restaurant …110m²
•7 locaux entre 12 et 40m²…170m²
Circulation (100m²):
•Couloirs, escaliers, hall, etc…100m²
MAISON MIMIR, Tiers-lieu à Strasbourg
La Maison Mimir est un ancien squat, devenu une référence en matièredelieualternatifdans l’espace Strasbourgeois. Cette association a connu de nombreux remous, et il faut compter son histoire afin de comprendre comment son histoire à fait sa particularité.
Un peu d’histoire
Le projet initial était composé d’une douzaine de petites maisons, dont le siècle ont fait fit de transformation, d’adjonction et de suppression de séquence du projet initial, jusqu’au bâtiment récemment rénové qui existe aujourd’hui.
La bâtisse témoigne d’une mémoire de presque 500 ans. A l’origine, ce projet était l’œuvre d’Elisabeth Schaffner baptisé «la maison des pauvres » dans les écrits qui retrace les origines historiques de la bâtisse. Dès l’origine, la bâtisse s’inscrit dans une démarche alternative, proposant un espace de vie et de partage, faisant fi des catégories sociales en passant de la maison des pauvres à un hôtel, une maison de passe, un centre de jeunes ou encore un foyer pour travailleurs. En 1999 la bâtisse est finalement laissée à l’abandon. C’est seulement en 2010 que la Maison Mimir est réinvestie par des personnes sans domicile. L’objectif a tout été de créer non pas seulement un lieu d’habitation mais également de création, d’échange, solidarité et d’initiative. Il est indéniable qu’avant même que se répande le phénomène de tiers-lieu, la Maison Mimir était en avance sur son temps. Toute son histoire témoigne des difficultés de s’inscrire à contre-courant, tant au niveau de la structure juridique, financière, et législative.
Régularisation du squat Afin de régulariser dans un premier temps l’occupation de la bâtisse, un consensus a été trouvé avec la ville de Strasbourg en signant un bail emphytéotique au bout de 3 années d’occupation. Ce bail court jusqu’en 2033 Cependant, la maison
abandonnée était dans un état de délabrement, et même si aux cours des 10 années d’occupation de l’association des petits travaux ont été entrepris, elle a nécessité de grand travaux ces dernières années afin de la remettre aux normes. Il a donné lieu à un chantier participatif, dont l’école de l’INA Strasbourg a notamment participé, ainsi que l’Atelier NA. D’architecture
Peut-être que le projet ne s’inscrit pas dans une démarche d’exemplarité en ce qui concerne le respect des lois, en prenant les devants tant sur l’investissement des lieux sans bail, que sur les travaux sans demande préalable. Seulement, si les demandesavaientétéfaitedanslesrègles,ceprojet existerait-il aujourd’hui ? Un bon nombre de projet alternatif se retrouve encore aujourd’hui dans un questionnement sur le choix du statut juridique le plus adapté. Et si actuellement, nous des solutions et des accompagnements sont possible par le soutien d’association spécialisé notamment, les premiers à avoir entrepris ces démarches ont a priori du parfois aller à contre-courant dela loi pour faire bouger les limites.
Programme
L’association fonctionne sur un principe s’association collégiale, composé d’un bar associatif nommé « le Barakawa », d’un service de Bagagerie, vide dressing et vide bibliothèque en prix libre afin de requestionner le rapport à l’argent. Il y a également plusieurs logements mais il n’a pas été possible d’avoir d’avantage d’information sur la manière d’organiser ces logements car il n’a été possible de rentrer en contact qu’avec une personne ayant travaillé dans ces lieux il y a plusieurs années de cela. Aux dernières nouvelles, la maison semble avoir rencontré des problèmes sanitaires et a dû être geler pour traiter un problème de nuisible.
LA CABANE DE LUCIE à Anould
PRESENTATION
Le projet de construction d’une maison individuelle représente 30 m² de surface habitable. Le nom de maison individuelle semble adapté si on considère les critères d’habitat, et d’individualité. Cependant, en termes de ce que nous connaissons de ce type d’habitat, nous sommes relativement éloignés des standards. En effet, la maison se veut le plus autonome possible. Chauffage au bois, électricité solaire, phyto-épurassions, récupération des eaux de pluies.
LE PROGRAMME
La maison doit comporter un espace de vie central en rez de chaussée, avec une salle de bain comprenant lavabo, douche et toilette sèche, un espace cuisine, un espace repas dont le mobilier sert à la fois de rangement et à la fois de dispositif de circulation vertical pour l’accès aux deux espaces nuit. Les espaces nuits sont situé de part et d’autre de l’espace vie, créer en mezzanine. Ils sont ouverts sur celui-ci et ne possède, ni porte, ni cloison.
L’espace de vie possède un oriel qui vient créer une alcôve permettant d’observer le paysage. De dispositif permet une porosité avec la nature environnante. Une terrasse bois vient se greffer à la maison. Accessible depuis la porte d’entrée, dans le prolongement d’une coursive, son orientation au Sud offreunevuesur lerestant dela parcelle. Cette espace extérieure permet à la fois une connexion avec le paysage extérieur, et là la fois avec l’annexe de la maison qui sera construit à l’opposé de la parcelle et sera introduit par un jardin japonais.
L’aspect atypique de la demande interroge sur les automatismes de conception observable au sein de lapratiquearchitecturaleenmaisonindividuelle. Ce projet fait l’objet d’un travail professionnel de la part de l’auteur et a suscité de l’intérêt notamment carilpermettaitdeproposerunpointdevueinclusif du point de vu de l’élaboration du projet global.
LE VAN DE PAULO, en itinérance
PRESENTATION
Le projet de Paulo s’est construit depuis bientôt ne dizaine d’année. Initialement il avait pour projet de faire le tour du monde. Avant cela, il souhaitait préparer un voyage hors de ce projet global. En démarrant par La Nouvelle Zélande, il avait déjà atteint une destination lui ayant apportée une diversité de paysage et de rencontre qui serait difficile à égalé. Après l’achat d’un van, qu’il a luimême aménagé avec l’aide de quelques amis, il démarre son itinérance en France, puis dans une grande partie de l’Europe.
SES PROJETS FUTURS
Le projet initial était detraverser la moitiédu globe, enallantjusqu'enMongolie,passantparlaRussieet le Kazakhstan entre autres. La situation géopolitique étant ce qu'elle est depuis bientôt un an, Paulo a repensé son voyage autrement et s'est tourné vers l'autre moitié du globe. Un départ courant de l'année prochaine est prévu : un an en Amérique du Nord, puis deux années en Amérique du Sud. Toujours avec son camion qu'il a repensé cetteannée, changeant complètement sonsystème électrique ainsi que la disposition de l'aménagement du van pour toujours plus d'autonomie.
SON ETAT D’ESPRIT
Après deux années marquées par la COVID et l'impossibilité de voyager au long-court, Paulo évoque le besoin de se remettre en mouvement. Les évènements d'Avril 2022 ont encore une fois chamboulés les projets de Paulo, c’est donc avec une certaine résilience que son projet de voyage se prépare pour cette nouvelle aventure Cela se traduit autant par des changements apportés à sa maison sur roues que dans les différentes démarches pour rendre l'exploration de ces deux nouveaux continents possibles.
LA PIEGONNE, « squat anarchia-féministe de Strasbourg »168
LE SQUAT
Pourquoi nous squattons ?
Le squat Pourquoi nous squattons ? Nous, femmes et personnes queers, féministes, précaires, exilées et marginalisées à plusieurs niveaux, occupons à Strasbourg un bâtiment délaissé depuis plusieurs années. Depuis le 27 février 2020, La Pigeonne est devenue un squat d’habitation et d’organisation en mixité choisie (sans hommes cisgenres*). En tant que femmes et personnes queers, nous sommes cibles de violences à la fois physiques, sexuelles, économiques, sociales et administratives. Nous subissons davantage la pauvreté et la précarité. Nous revendiquons notre droit inconditionnel à avoiruntoit.Nous trouvons aberrantd’êtreàlarue, demanquerdesoinsoudenourrituretandisqueles possédants gaspillent et continuent de s’enrichir. La précaritén’ajamaisétéunchoixpourpersonne.Elle est le résultat d’une volonté politique, organisée et réaffirmée des dominants pour entretenir une classe exploitable. Ni les institutions ni les patrons ne veulent notre autonomie. Au contraire ils participent quotidiennement à notre précarisation. Dès lors, nos priorités sont de nous mettre à l’abri, de construire des solidarités entre nous, de dénoncer ensemble une société patriarcale et un système économique qui sacrifie les plus vulnérables. Pour une transformation sociale et l’émancipation de toutes les femmes et personnes queers, nous privilégions des initiatives faites par nous et pour nous. Face à l’incompétence de l’État, la violence de ses institutions, et sa répression policière sexiste, queerphobe et raciste de plus en plus violente et systématique, nous nous organisons. Nous occupons l’espace qu’on nous refuse.
*une personne cisgenre c’est quelqu’un qui est en accord avec le genre/sexe qui lui a été assigné à la naissance
POLITIQUE D’ACCUEIL
La Pigeonne est un squat d’habitation et d’activités par et pour les femmes, les personnes trans et non binaires, qu’iels soient lesbiennes, bisexuel-les, pansexuel-les ou hétérosexuel-les. C’est un lieu féministe,queeretantiracisteenmixitéchoisiesans hommes cisgenres*.
La pigeonne, c’est pour qui ?
La Pigeonne est un lieu de vie et d’entraide pour les femmes et les personnes queers. Nous donnons la
(PIGEONNE)
priorité aux personnes racisé-es**, exilé-es, précaires qui subissent des violences et des oppressions spécifiques et qui désirent vivre dans un lieu collectif et autogéré.
La pigeonne, c’est quoi ?
La Pigeonne c’est un squat de vie et d’activité autogéré, c’est-à-dire que les habitant-es gèrent collectivement et horizontalement toutes les décisions et les tâches. Nous accueillons des personnes souhaitant habiter et s’investir dans le lieu pour du moyen ou du long terme. Nous ne sommes ni un centre d’hébergement, ni un accueil de jour. Nous ne faisons pas de travail social ou de bénévolat. Aussi, nous réorientons systématiquement toutes les personnes à la recherche d’un hébergement d’urgence vers les structures sociales compétentes. Les personnes souhaitant s’installer à la Pigeonne sont invitées à nous contacter par email, téléphone ou FB. Encore une fois, nous donnons la priorité aux personnes en grande précarité trans, lesbiennes ou bisexuelles migrant-es et exilé-es. N’hésitez pas à rediriger vers nous les personnes concerné-es.
*les gens cisgenres sont des personnes en adéquation avec le genre qui leur a été attribué à la naissance.
** les personnes racisées sont des personnes qui subissent du racisme
BIBLIOTHEQUE MARSHA P. JOHNSON
Parce que les ressources féministes, queers et antiracistes sont rares, tu trouveras à la bibliothèque Marsha P. Johnson des livres, des zines,desDVDàemprunter,ouencoredestrucsDIY à prix libre, un freeshop, une freepicerie. C’est un espace de rencontre, d’échange et de solidarité, un espace où trouver de la force, où nourrir tes rages, tes luttes et tes désirs. La bibiothèque est ouverte en général chaque 1er lundi du mois (club de lecture) et dernier mardi du mois (permanence). Ponctuellement, elle accueille des ateliers, rencontres,débats…C’estunespaceenautogestion où chacun.e peut proposer des thématiques, ateliers, activités et filer un coup de main dans l’organisation. Tu trouveras un inventaire en cliquant ici : toute proposition de dons ou commandes de livres est bienvenue !
168
Enquêtes
URBAN’HOTES, habitat participatif à Strasbourg
1/ Informations générales : Pourriez-vous me présenter en quelques lignes, qui vous êtes (prénom + âges+villederésidenceactuelle) Quelrôlevoustenez au sein du projet (par exemple membre actif, porteparole, décisionnaire, trésorier, etc.) et qui vous représente en général face aux institutions, si une personne a été désignée ?
Erika Cabassut, 64 ans, Strasbourg, membre actif
2/ Expectatives envers le projet et les différents acteurs impliqués : Pourriez-vous me présenter en quelques lignes. Pourquoi vous êtes-vous lancé dans ce projet ? Quel était/serait le projet idéal (s’il n’y avait aucune contrainte) ? De quoi avez-vous besoin pour concrétiser le projet ou le pérenniser dans l’avenir ? Quels sont les professionnels vers lesquels vous vous êtes tourné dans votre démarche de projet ? Avez-vous fait appel à un/des architectes ? Pourquoi (que ce soit oui ou non) ? Comment envisagez-vous le projet une fois que vous n’en ferez plus partie ? (Pourrait-il changer de fonction et être remodelé, modifié à l’avenir ? Comment peut-il être amené à évoluer dans plusieurs décennies ?)
Nous nous sommes lancés dans ce projet parce que noustrouvonsqueçaaplusdesensqued'habiterseul.
Dans ce projet on habite dans un groupe social solidaire qui réfléchit à une manière de vivre plus écologique et plus humaine. Le projet idéal : plus d'espace extérieur afin de pouvoir aménager un espace pour les enfants avec des jeux, un poulailler, des potagers plus grands afin de pouvoir cultiver plus de légumes et d'arbres fruitiers. Pouvoir mettre en place des installations pour produire de l'énergie. Avoir des espaces communs plus grands, une salle de jeux pour les enfants, une bibliothèque.
Nous avons travaillé avec un architecte qui a fait les plans, parce que sans architecte c'est un peu difficile. Nous pensons rester vivre ici le plus longtemps possible. Le fonctionnement du groupe dépend de ses membres. S'il doit y avoir des changements dans le groupe, et que certaines personnes ne sont pas intéressées par la vie de groupe, le projet changera en une copropriété classique.
3/ Votre retour d’expérience à ce jour : Quelles sont les étapes et modalités de collaboration avec les différents acteurs, professionnels ou non, de votre projet ? Et quelles sont vos attentes vis-à-vis de ces collaborations ? (Autoconstruction, chantier participatif, gestion de maitrise d’œuvre, intervention de tierces personnes) En quoi votre engagement dans ce projet a changé quelque chose dans votre vie
personnelle et/ou professionnelle ? Cela a-t-il aussi changé quelque chose dans votre relation aux autres, de manière générale ? Quelle est votre vision de la collaboration entre l’architecte et l’habitant, et selon vous, quelle serait ou aurait été la collaboration idéale pour votre projet ? Pensez-vous que ce questionnaire est susceptible d’influencer votre projet et votre perception à propos de futures collaborations entre architecte et habitant ?
NousavonsétéaccompagnésparlavilledeStrasbourg tout au longde laphasede mise en routedu projet. La villeaorganisédesateliers(lesarchitectes-lesaspects juridiques - la prise de décision etc.) pour nous aider à avancer et prendre des décisions. Nous avions rendezvous une fois par mois avec une personne de la ville responsable des projets d'autopromotion pour faire le point, discuter de nos problèmes etc. A un moment donné, nous avions un gros problème dans le groupe et nous avons fait appel à une médiatrice pour résoudre ce problème. Une personne est partie. Nous avonstravaillé trèsétroitement avec l'architecte, quia dû consacrer beaucoup de temps à notre groupe : rencontresindividuelles,participation auxréunionsde groupe.
Avec l'architecte, nous avons choisi les différentes entreprisesquiont dû comprendrequeltypedeprojet c'était, nous les avons tous rencontrés individuellement. Les professionnels doivent être plus souples et plus ouverts dans un tel projet. Dans un projet d'autopromotion, l'architecte doit investir beaucoup plus de temps, il doit être à l'écoute, il doit concevoir un bâtiment avec et pour les habitants. Il doit prendre le temps d'expliquer, de discuter, de s'adapter, et éventuellement de changer ses propositions. C'est n'est pas toujours le cas. Le problème est que les habitants ne sont pas des spécialistes et ne connaissent pas tous les aspects de l'architecture,alorsquel'architecteestlespécialisteet il a plus de connaissances techniques.
Concilier l'esthétique et l'usage pratique n'est pas toujours simple non plus. Trop souvent c'est l'esthétique qui prime et on perd du confort ou de la sécurité. Nous aurions dû avoir plus d'informations techniques et prendre encore plus de temps afin de faire les bons choix. Ce projet donne plus de sens à notre manière de vivre, au-delà d'un bon voisinage, nous pouvons mettre plus facilement en œuvre l'entraide, la solidarité, le vivre ensemble, d'abord dans le groupe, mais aussi au-delà du groupe (fête des voisins-miseenplaced'unpédibuspourlesenfants...)
GRAINE DE LIEUX – L’ŒUVRE, Habitat participatif à Sélestat – Jacques
1 / Informations générales : Pourriez-vous me présenter en quelques lignes, Qui vous êtes (prénom + âges + ville de résidence actuelle) ; Quel rôle vous tenez au sein du projet (par exemple membre actif, porte-parole, décisionnaire, trésorier, etc.) et qui vous représente en général faceauxinstitutions,siunepersonneaété désignée Mes réponses personnelles : Jacques, 71 ans, originaire du Ried et établi actuellement à Sélestat après avoir vécu quelques années dans lesud-ouest de la France. Notre association Graine de lieu s’est officiellement constituée en juillet 2021 après un temps d’échanges entre quelques intéressés suite à une annonce d’intention que j’ai postée sur le réseau du RCCA (réseau citoyen du centre Alsace) en février 2021.
Pour moi le choix du mode d’habitat est un acte politique, social, environnemental et durable pour que chacun puisse accéder à son logement décent sans (trop) subir la spéculation et le parcage organisé par des promoteurs et syndics.
Dans notre ville de Sélestat notre démarche auprès des élus est restée sans écho, la règle étant la délégation du foncier public à des promoteurs et aménageurs privés. Ce sont des membres de l’association, propriétaires d’un bien immobilier, qui nous permettent de maîtriser le foncier pour nos projets.
L’association fonctionne sur un mode « sociocratique » avec une rotation des délégations officielles. Nous changeons de président, secrétaire et trésorier tous les ans et tous les membres sont administrateurs. Le groupe m’a octroyé la présidencededépartparreconnaissanceetpourles besoins de représentation. L’assemblée générale fixéeen octobreprochain permettra de nommer de nouveaux délégués pouruneannée. Les sortants ne sont pas rééligibles. Ainsi chaque membre s’investira un temps donné comme délégué représentatif. Bien sûr chacun restera actif en fonction de ses capacités, de ses envies momentanées et de ses disponibilités.
2/ Expectatives envers le projet et les différents acteurs impliqués
Nous nous adossons aux retours d’expériences des habitatsparticipatifsexistantsettravaillonsavecles documents édités et rassemblés par différents organismes sympathisants.
Nos partenaires directs et nos attentes sont donc, comme pour tout projet de construction, les conseils juridiques (notaire, comptable) financiers (banques, aides publiques) et techniques (architectes, BE, services publics) avec en plus une
assistance en maîtrise d’usage que nous gérons et décidonsàlacarteenfonction desbesoinsressentis dans le groupe.
Pourriez-vous me présenter en quelques lignes, pourquoi vous êtes-vous lancé dans ce projet ? Comme dit, le mal logement, la baisse de la qualité des appartements et de leur environnement et le système d’exploitation des occupants ont également étaient des déclencheurs pour prendre en main son propre hébergement physique et de confort.
Enfin le facteur humain, avec un espoir de trouver une convivialité entre cohabitants. Et avec le recul, je dirais que chaque étape de la vie aurait besoin d’une adaptation d’hébergement et d’habitation à sa propre situation (familiale, environnementale, temporelle, professionnelle, sanitaire …).
Quel était/serait le projet idéal (s’il n’y avait aucune contrainte) ?
Que le foncier soit dissocié du bâti et qu’il reste « public » et uniquement en usufruit, Que le bâti soit une « copropriété » et l’appartement une « nue-propriété » et donc que l’habitant soit uniquement propriétaire de « parts sociales investies » avec un lot attribué et une redevance correspondant à la « location du terrain » indexée sur l’IRL par exemple.
Ce principe permettrait, outre l’évolution graduelle prévue dans chaque appartement, de changer le moment venu d’appartement qui correspond au besoin réel. Ce changement n’entrainerait que la modification et l’adaptation du nombre de parts sociales (en plus ou en moins en fonction dela taille des logements échangés) En cas de changement d’habitant ou de sortie, le sortant (ou l’héritier) récupère les parts investies actualisées suivant l’index IRL. Au sein du bâtiment, les repères pour les habitantsresteraientlesmêmes(voisinage,espaces communs, environnement…) Comme dit un proverbe arabe dans un ouvrage de Hassan Fathy, « choisi ton voisin avant de choisir ta maison »
De quoi avez-vous besoin pour concrétiser le projet ou le pérenniser dans l’avenir ?
La pérennisation repose sur le facteur humain principalement. Donc c’est la formation sociale permanente et l’assistance à maîtrise d’usage occasionnelle qui permettraient de concrétiser et de pérenniser un habitat partagé.
Quels sont les professionnels vers lesquels vous vous êtes tourné dans votre démarche de projet ?
Les premières ressources proviennent d’un investissement personnel et d’un échange avec les organismes (Habitat Participatif France, Ecoquartier Strasbourg, Université du Nous, Colibris, CAUE, et retours d’expériences.) Donc je dirais une formation autodidacte. En ce qui concerne ce qui est en cours et ce qui suivra, nous sommes en relation avec un notaire, des architectes en consultation, des formateurs et des facilitateurs.
Avez-vous fait appel à un/des architectes ? Pourquoi (que ce soit oui ou non) ?
Nous sommes au stade de la consultation des architectes sensibilisés par notre démarche pour permettre de confirmer la faisabilité technique et financière. Puis d’engager un contrat de maîtrise d’œuvre global.
Comment envisagez-vous le projet une fois que vous n’en ferez plus partie ? (Pourrait-il changer de fonction et être remodelé, modifié à l’avenir ? Comment peut-il être amené à évoluer dans plusieurs décennies ?)
Notre raison d’être, la charte des valeurs, les statuts de la future société, le règlement et l’autogestion devront permettre de gérer les entrées et sorties des habitants. Les documents précités évolueront bien sûr au fil du temps pour s’adapter progressivement à l’environnement et à l’état psycho-écologique qui impacteront les futurs habitants.
3/ Votre retour d’expérience à ce jour :Quellessont les étapes et modalités de collaboration avec les différents acteurs, professionnels ou non, de votre projet ? Et quelles sont vos attentes vis-à-vis de ces collaborations ? (Autoconstruction, chantier participatif, gestion de maitrise d’œuvre, intervention de tierces personnes)
Le peu de retours confirme la nécessité d’une prise en main et une formation personnelle avec des organismes le plus neutre possible si nous souhaitons la faisabilité financière juste. L’idéale
serait effectivement de se charger également d’une part d’autoconstruction, mais ce ne sera pas le cas pour le site de Sélestat, vu l’âge de certains et l’indisponibilité d’autres. Des ébauches d’esquisses seront travaillées en interne du groupe. La conception et la maîtrise d’œuvre seront dévolues aux professionnels
En quoi votre engagement dans ce projet a changé quelque chose dans votre vie personnelle et/ou professionnelle ? Cela a-t-il aussi changé quelque chose dans votre relation aux autres, de manière générale ?
Se lancer dans une construction est toujours une grosse motivation pour les décideurs. C’est un investissement chronophage mais riche intellectuellement et relationnellement dans un groupe. Personnellement il me permet de m’ouvrir vers d’autres personnes
Quelle est votre vision de la collaboration entre l’architecte et l’habitant, et selon vous, quelle serait ou aurait été la collaboration idéale pour votre projet ?
La technicité et la compétence en maîtrise d’œuvre sont des atouts de mon point de vue pour réussir le rendu d’un bâtiment conforme et durable.
L’accompagnement du groupe par l’architecte, son intégration dans ce groupe, permettrait également une meilleure vision globale de tout un chacun, architecte compris.
Pensez-vous que ce questionnaire est susceptible d’influencer votre projet et votre perception à propos defutures collaborations entre architecte et habitant ?
Il me permet d’apprécier l’intérêt relationnel et la prise en compte du maître d’ouvrage et de son usage. Trop d’architectes sont influencés par les entreprises
GRAINE DE LIEUX – L’ŒUVRE, Habitat participatif à Sélestat – Patrick
1 / Informations générales : Pourriez-vous me présenter en quelques lignes, Qui vous êtes (prénom + âges + ville de résidence actuelle) ; Quel rôle vous tenez au sein du projet (par exemple membre actif, porte-parole, décisionnaire, trésorier, etc.) et qui vous représente en général face aux institutions, si une personne a été désignée Patrick, 71 ans, retraité, habitant actuellement à Ebersheim.
Membre actif de l’association Graine de Lieu (GDL), et engagé avec mon épouse dans le projet d’habitat participatif de Sélestat Rue de l’Oeuvre (RDO).
Celui qui représente l’association GDL est son président, actuellement Mathieu, désigné lors de la dernière AG. Le membre qui à mon avis représente la RDO est Jacques, sans qu’il n’y ait eu de désignation « officielle » des autres membres engagés dans ce projet de Sélestat.
2/ Expectatives envers le projet et les différents acteurs impliqués : pourquoi nous nous sommes lancés dans ce projet
Nous habitons actuellement une maison trop grande (nos enfants sont partis et n’habitent plus la région) sur un terrain trop grand. Leur entretien et les charges liées demandent beaucoup de temps et de moyens, ce qui nous motive à rechercher un habitat plus petit avec moins de contraintes. Nous entretenons de bonnes relations de voisinage et n’avons pas (au moins pour le moment) de problème d’isolement social. Il existe a priori 2 solutions à notre situation :
• Aller vivre en appartement, avec des avantages (gestion de l’immeuble prise en charge par le syndic de copropriété, charges qui devraient être plus réduites, notamment le chauffage) mais aussi des inconvénients (surfaces plus réduites, pas de ‘surface-tampon’ type jardin ou cour, pas d’atelier, cave exiguë, parfois peu de contact avec les voisins qu’on ne choisit pas)
• Chercher une maison plus petite sur un terrain plus petit, avec là aussi des avantages (surfaces plus confortables, existence d’une cour ou jardin, possibilité d’avoir une cave avec un coin atelier…) mais aussi l’inconvénient de se transplanter dans un quartier où il faut recréer des liens sociaux avec des voisins qu’on ne connaît pas. Le problème de l’entretien, bien que diminué, reste cependant bien présent. Bien que nous n’ayons aucune autre expérience concrète d’habitat participatif (hormis notre vie commune depuis 38 ans...) nous nous sommes lancés dans ce projet d’habitat à l’initiative de mon épouse que cette forme d’habitat séduit. Mais à la réflexion ce type d’habitat me paraît, à moi aussi, avoir des atouts :
• Nous habiterons avec des gens que nous connaissons et avec lesquels nous avons créé des liens, permettant ainsi une vie sociale active tout en préservant un espace de vie privée.
• La cohabitation se fera selon des règles qui auront été discutées. Ceci ne veut pas dire qu’il n’y aura pas de conflit (il y en aura !), mais (il faut l’espérer) il y aura une volonté de les résoudre de la manière la plus satisfaisante pour tout le monde.
• Ce type d’habitat peut être un bon compromis entre la maison individuelle et la vie en appartement, grâce aux espaces partagés (salle commune, cour, jardin, atelier…).
Les charges d’entretien seront plus légères qu’en maison individuelle (a priori) et les charges de chauffage également plus réduites.
• Ce type d’habitat, dans la mesure où il permet la mise en commun de divers moyens, est certainement plus satisfaisant d’un point de vue écologique que l’habitat en maison individuelle.
Quel serait le projet idéal ? (S’il n’y avait aucune contrainte)
Ce serait une maison bleue sur la colline située…
• dans un bel endroit, avec une belle vue, une belle lumière et au calme, mais proche des infrastructures et commerces utiles
• où il ferait bon vivre, en bonne harmonie avec ses voisins tout en disposant d’un espace privé capable de préserver son intimité
• dans de bonnes conditions de confort (surfaces suffisantes tant pour l’habitation que pour la cour et le jardin, lumière, isolation phonique et thermique), mais sans luxe inutile ni excès, avec le plus faible impact écologique possible.
De quoi avez-vous besoin pour concrétiser le projet ?
• d’un collectif de personnes motivées partageant (à peu près) les mêmes motivations
• de moyens financiers
• d’un lieu pouvant accueillir le projet (a priori nous disposons d’un lieu)
• de professionnels compétents et comprenant le projet, qui nous aident à le réaliser
Quels sont les professionnels vers lesquels vous vous êtes tourné dans votre démarche de projet ? • un notaire qui nous a exposé les différentes formes juridiques (1 soirée) • des architectes
Avez-vous fait appel à un/des architectes ? Pourquoi ? Nous avons contacté des architectes parce que pour mener à bien un tel projet il semble indispensable de recourir à un professionnel de la construction.
3/ Retour d’expérience à ce jour : Étapes et modalités de collaborationaveclesdifférentsacteurs,attentesvis-à-vis de ces collaborations ?
Nous débuterons prochainement une AMU avec un architecte. J’attends de cette collaboration qu’à travers un dialogue (ou une procédure qu’il nous proposera) il nous aide à définir notre projet d’ensemble et également l’appartement de chacun, afin d’aboutir à l’établissement d’un cahier des charges qui sera la base de travail de l’architecte pour son esquisse. La notion de dialogue me paraît importante, il ne faudrait pas que des solutions soient proposées sans que cela ne réponde à une interrogation ou une demande de la part d’un participant ou du groupe. Il serait souhaitable que cela permette au groupe de se projeter et de s’approprier cet habitat. Je ne
connais pas suffisamment ce que signifient les termes « autoconstruction, chantier participatif, gestion de maitrise d’œuvre » pour me prononcer à ce sujet. Nous n’avons pas repris de contact avec le notaire, ni contacté de banquier pour le moment.
En quoi votre engagement dans ce projet a changé quelque chose dans votre vie personnelle et/ou professionnelle ? Cela a-t-il aussi changé quelque chose dans votre relation aux autres, de manière générale ? Ce projet a déjà été l’occasion de rencontrer au cours de nombreuses réunions de personnes d’horizons assez divers, ce qui est enrichissant. Il m’est difficile de préciser la nature de ce type de relation : c’est une relation de proximité et de bienveillance, pas forcément de l’amitié, commesionsepréparaitpour un longvoyageensemble...
Pour autant, je n’ai pas conscience que cela ait beaucoup changé ma relation aux autres, de manière générale.
Quelle est votre vision de la collaboration entre l’architecte et l’habitant, et selon vous, quelle serait la collaboration idéale pour votre projet ?
J’insiste sur l’importance du dialogue évoqué précédemment. Il me semble que l’architecte doit répondre à la demande et aux souhaits des participants et du groupe, les affiner, puis les traduire avec les exigences de son métier et son expérience, tout en respectant les limites du projet (notamment financières).
Pensez-vous que ce questionnaire est susceptible d’influencer votre projet et votre perception à propos de futures collaborations entre architecte et habitant ?
Je ne sais pas si ce questionnaire va influencer notre projet (je suis un participant parmi d’autres). Mais en tout cas il m’a amené à réfléchir sur la nature de la collaboration entre le futur habitant que je suis et l’architecte. Je me propose également de me renseigner plus loin sur les notions de autoconstruction, chantier participatif, gestion de maitrise d’œuvre… Et j’entrevois que le travail de l’architecte n’est pas un mince défi !
1
OASIS MULTIKULTI, à Mietesheim
1/ Informations générales : Pourriez-vous me présenterenquelqueslignes, Quivousêtes(prénom +âges + ville de résidence actuelle) ; Stéphanie Urban, 32 ans, habitante de l'Oasis Multikulti à Mietesheim
Quel rôle vous tenez au sein du projet (par exemple membre actif, porte-parole, décisionnaire, trésorier, etc.) et qui vous représente en général face aux institutions, si une personne a été désignée Je suis la fondatrice du projet, comme je suis propriétaire des lieux, je m'occupe essentiellement de la gestion immobilière et des travaux
2/ Expectatives envers le projet et les différents acteurs impliqués ; Pourriez-vous me présenter en quelqueslignes ;Pourquoivousêtes-vouslancédans ce projet ?
C'est un rêve au départ : transformer l'ancienne ferme de mes grands-parents en un lieu de rencontre, partage, apprentissage, avec un lien vers la nature et la culture. Rencontrer des lieux dans la même mouvance m'a donné l'élan de me lancer.
Quel était/serait le projet idéal (s’il n’y avait aucune contrainte) ? De quoi avez-vous besoin pour concrétiser le projet ou le pérenniser dans l’avenir ? De clarifier certaines choses au niveau de la gouvernance. Le projet est à un tournant, les personnes qui se sont investis au départ se sont retirées et une nouvelle équipe s'est installée. De plus, je me suis retirée de la coordination du lieu. Nous avons besoin de faire le point sur la vision à long terme. L'idée est aujourd'hui de mieux partager les tâches, mobiliser plus de monde et trouver d'autresmoyensfinancierspourpérenniserleprojet.
Pour l'instant c'est la SCI, avec 3 associés (moi, mon père,ma sœur)quifinançons les travaux,cequin'est pas assez pour un projet de cette ampleur.
Quelssontlesprofessionnels verslesquelsvousvous êtes tourné dans votre démarche de projet ?
Concernant la rénovation, nous avons fait appel à l'entreprise Batilibre qui propose de mener des chantiers participatifs sur le lieu. L'entreprise étant beaucoupsollicitée,nousavonsfaitégalementappel à des personnes indépendantes spécialisées dans la terre crue. Grâce à leur pédagogie, nous sommes plusieurs sur place à avoir appris des techniques de rénovation sur les prochains chantiers.
Avez-vousfaitappelàun/desarchitectes? Pourquoi (que ce soit oui ou non) ?
Nous avons déjà demandé conseil à des architectes, malheureusement ce que l'on a contacté n'étaient pas spécialisés dans le domaine de la rénovation en terre. Pour l'instant, c'est aussi une question financière.
Comment envisagez-vous le projet une fois que vous n’en ferez plus partie ? (Pourrait-il changer de fonction et être remodelé, modifié à l’avenir ? Comment peut-il être amené à évoluer dans plusieurs décennies ?)
J'imaginequeplusieurspersonnesserontàlagestion des différents pôles d'activités: alimentation (microbrasserie, fournil, marché, café associatif), culture (atelier d'artistes, événements), bien-être (ateliers aux thèmes variés, espace de massage), jardin associatif. Chaque pôle serait autonome financièrement et propriétaire de leur espace. Une partieseraitdédiéeàl'accueildepersonnespourdes stages par exemple.
3/ Votre retour d’expérience à ce jour Quelles sont les étapes et modalités de collaboration avec les différents acteurs, professionnels ou non, de votre projet ? et quelles sont vos attentes vis-à-vis de ces collaborations ? (Autoconstruction, chantier participatif, gestion de maîtrise d’œuvre, intervention de tierces personnes)
On est en train d'y travailler ! Jenesais pas répondre à cette question pour le moment.
En quoi votre engagement dans ce projet a changé quelque chose dans votre vie personnelle et/ou professionnelle ? Cela a-t-il aussi changé quelque chose dans votre relation aux autres, de manière générale ?
J'ai dédié les 4 dernières années à ce projet, autant personnellement et professionnellement. L'évolution, du projet et de moi-même, est remarquable mais je sens qu'aujourd'hui que j'ai besoin de retrouver une vie personnelle. Je réalise aussi la complexité du collectif, tout en étant en gratitude des moments passés à construire ensemble. L'équilibre entre le respect de ses besoins et l'énergie du collectif n'a pas été toujours facile.
Quelle est votre vision de la collaboration entre l’architecte et l’habitant, et selon vous, quelle serait ou aurait été la collaboration idéale pour votre projet ?
Je pense qu'un architecte qui prendrait en compte l'avis du collectif, mènerait sa propre enquête pour répondre au mieux aux besoins de chacun, tout en connaissant le bâtiment. Je pense même que cette personne devrait faire partie intégrante du projet pour comprendre les enjeux, en participant aux réflexions communes par exemple.
Pensez-vous que ce questionnaire est susceptible d’influencer votre projet et votre perception à propos de futures collaborations entre architecte et habitant ?
Oui, cela m'a permis d'appuyer mes réflexions actuelles et pourquoi pas proposer l'intégration d'un architecte au prochain projet de rénovation que nous avons : la réalisation d'une salle pour les ateliers !
LA CABANE DE LUCIE, à Anould
1/ Informations générales : Pourriez-vous me présenter en quelques lignes,Qui vousêtes (prénom +âges + ville de résidence actuelle) ; Quel rôle vous tenez au sein du projet (par exemple membre actif, porte-parole, décisionnaire, trésorier, etc.) et qui vous représente en général face aux institutions, si une personne a été désignée
Lucie 33 ans, habitant actuellement à Fraize (88), auparavant à Marckolsheim (67) avant le début du projet.
Je suis membre actif principal, pas de représentant.
2/ Expectatives envers le projet et les différents acteurs impliqués Pourriez-vous me présenter en quelques lignes, Pourquoi vous êtes-vous lancé dans ce projet ?
Après le confinement, une séparation, besoin de revenir à l’essentiel, besoin de retrouver la nature, créer un projet personnel qui me ressemble. Besoin de s’accorder avec la nature qui nous entoure.
Quel était/serait le projet idéal (s’il n’y avait aucune contrainte) ?
Avoir un plus grand terrain, pour pouvoir installer des habitats légers autonomes et les louer, faire découvrir à d’autres qu’on peut vivre avec notre temps tout en respectant la nature.
De quoi avez-vous besoin pour concrétiser le projet ou le pérenniser dans l’avenir ?
D’argent, cela peut faire sourire… et un soutien des acteurs locaux (pour ça on est loin du but)
Quelssontlesprofessionnels verslesquelsvousvous êtes tourné dans votre démarche de projet ?
Un courtier pour mener à bien le projet au niveau financier. Plusieurs professionnels dans le domaine de l’autonomie énergétique : panneaux solaires et batteries, récupération d’eau de pluie, filtrage, assainissement.
Avez-vousfaitappelàun/desarchitectes? Pourquoi (que ce soit oui ou non) ?
Oui parce que je ne comprenais rien au permis de construire, je voulais faire tout dans les règles et mettre toutesles chances de moncôtépourqu’ilsoit accepté,etcelapermettaitd’avoirégalementunavis professionnel sur la réalisation du projet en termes techniques.
Comment envisagez-vous le projet une fois que vous n’en ferez plus partie ? (Pourrait-il changer de fonction et être remodelé, modifié à l’avenir ?
Comment peut-il être amené à évoluer dans plusieurs décennies ?)
Le projet est que la maison soit 100% autonome énergétiquement, cependant il est prévu que le terrain soit viabilisé en cas d’une revente future. Mais si je devais ne plus y habiter, je pense plutôt en faire une location saisonnière afin de faire partager le principe d’une maison autonome.
3/ Votre retour d’expérience à ce jour Quelles sont les étapes et modalités de collaboration avec les différents acteurs, professionnels ou non, de votre projet ? et quelles sont vos attentes vis-à-vis de ces collaborations ? (Autoconstruction, chantier participatif, gestion de maitrise d’œuvre, intervention de tierces personnes)
La premièreétapea été decontacter un courtier, car le financement était bien sur le plus important, sans argent on ne fait rien. Il me semblait important d’avoir un courtier pour avoir plus de poids auprès desbanques,étantdonnéquejen’avaispasd’apport et qu’il s’agit pour partie d’une auto-construction. Cela a été compliqué dans un premier temps : la première courtière n’avait pas réussiàfaire passerle projet auprès de la banque, j’ai failli tout annuler Une autre courtière a pris le relais et le projet a été validé. Comme quoi un projet peut complétement dépendre d’un professionnel compétent ou non. Il y a eu également beaucoup de discussions avec l’architecte, ce qui m’a permis de mieux apprivoiser la suite du projet.
Les démarches pour le permis de construire ont été assez simples, car le projet ressemble au plus possible à un projet classique sur le papier. Nous n’avons pas détaillé plus que ça le fait que la maison soit autonome.
Les entreprises ont déjà été contactées pour les devis, à présent la phase de mise en œuvre démarre et il n’est pas toujours facile de tout organiser, niveau planning…
En quoi votre engagement dans ce projet a changé quelque chose dans votre vie personnelle et/ou professionnelle ? Cela a-t-il aussi changé quelque chose dans votre relation aux autres, de manière générale ?
C’est un projet personnel, donc oui il change ma vie personnelle mais aussi professionnelle. Personnellement car je change d’environnement, je suis partie d’Alsace pour les Vosges, les montagnes, le calme. Professionnellement, car le but étant de créer mon salon de massage sur le terrain et d’arrêter mon métier de comptable. Tout étant tourné vers le bien-être, mieux-être, profiter de la vie, de l’instant, prendre le temps. Ma relation aux autres a sans doute changé aussi. Dernièrement j’ai appris que des gens racontent que je serais entré dans une secte… Cela me fait sourire, je crois que c’est ça, la secte de la nature, ce que les gens ne comprennent pas ils le retranscrivent à leur manière. Il y des gens qui ne changeront jamais d’opinion mais pour les autres j’aimerais leur faire découvrir ma vision.
Quelle est votre vision de la collaboration entre l’architecte et l’habitant, et selon vous, quelle serait ou aurait été la collaboration idéale pour votre projet ?
Nous avons pu beaucoup discuter de ce projet ensemble, si j’avais pu financièrement j’aurais accordé ma confiance à mon architecte pour mener à bien le projet de A à Z, avoir ses conseils à chaque étape du projet. Malgré cela, elle a été très présente etd’ungrandsoutien,c’étaittrès appréciabled’avoir unprofessionneldubâtimentàquiseréférépourles questions techniques en particulier.
Pensez-vous que ce questionnaire est susceptible d’influencer votre projet et votre perception à propos de futures collaborations entre architecte et habitant ?
J’ai vraiment apprécié la collaboration que j’ai eu avec l’architecte, je n’avais encore jamais eu l’occasion de faire appel à un architecte et je ne pense pas pouvoir créer un futur projet sans architecte.
LE VAN DE PAULO, en Itinérance dans le monde
1/ Informations générales : Pourriez-vous me présenter en quelques lignes,Qui vousêtes (prénom +âges + ville de résidence actuelle) ; Paulo, 34 ans, actuellement en Bretagne du côté de Vannes, mais pas d'adresse fixe. Une adresse administrative chez mon frère pour recevoir les documents officiels nécessaires aux visas et autres papiers du style.
Quel rôle vous tenez au sein du projet (par exemple membre actif, porte-parole, décisionnaire, trésorier, etc.) et qui vous représente en général face aux institutions, si une personne a été désignée Au sein de mon projet ? Auto-investisseur de mon projet, concepteur, réalisateur, et acteur.
2/ Expectatives envers le projet et les différents acteurs impliqués
J'espère pouvoir continuer ma vie en van pendant encore quelques années. À l'heure actuelle, aucune envie de revenir à une vie sédentaire. Projet de voyage sur le long court en attente. Adaptation à la situation sanitaire et géopolitique du monde, changement des projets pour continuer de voyager d'une manière … ou d'une autre.
Pourriez-vous me présenter en quelques lignes, Pourquoi vous êtes-vous lancé dans ce projet ? C'est un projet qui remonte à maintenant 5 ans. Mêmeonpeutdire7ans,vuqu'ilestnéenNouvelleZélande, lors de mon premier grand voyage. Remarquant que cette soif de découvrir le monde était né, et que ce monde était trop grand pour rester au même endroit toute sa vie, qu’au final il fallait peu pour pouvoir voyager, vivredes aventures et s'ouvrir au monde. Alors, revenant en Europe, je savais que j'avais envie de voyager encore en van aménagé. La manière était à définir, et a bien évolué depuis 7 ans.
Quel était/serait le projet idéal (s’il n’y avait aucune contrainte) ?
S’il n’y avait aucune contrainte. Pouvoir aménager ma maison roulante avec les besoins que j’ai. Sans partir dans le “too much”, juste pouvoir avoir le nécessaire et pouvoir voyager dans les pays souhaités. En gros, un van mécaniquement fiable et agréable à conduire sur de longues distances ainsi que dans du long terme, une dizaine d’années ? Être autonome en énergie, pouvoir conduire un van électrique au maximum, pouvoir recharger avec des énergies renouvelables (même s’il est impossible d’avoir un van électrique sans passer par une station de charge). Pouvoir voyager et passer les frontières sans se soucier des situations géopolitiques de
chaque pays traversé. Pouvoir traverser les océans par bateaux sans frais et continuer ainsi d’explorer le monde. Je n’ai pas besoin de beaucoup plus grand quemon van actuel, un peu plus large et un peu plus haut serait suffisant, techniquement parlant (pour pouvoir tenir debout dedans,et pour pouvoir dormir en largeur).
De quoi avez-vous besoin pour concrétiser le projet ou le pérenniser dans l’avenir ? Toujours besoin d’un peu plus de budget financier, mais on fait toujours avec ce que l’on a. On fait des concessions sur certains points pour pouvoir en améliorer d’autres. À l’heure actuelle mon projet est plutôt pérenne dans la théorie. Il y a encore des points incertains, mais il s’agit encore une fois de s’adapter et de faire avec.
Quelssontlesprofessionnels verslesquelsvousvous êtes tourné dans votre démarche de projet ? Je me suis essentiellement tourné vers des amis ayant des compétences. Pour pouvoir travailler avec eux, proposer ma main d'œuvre et mes compétences. Pour les fournisseurs de pièces ou de besoins techniques, je me suis tourné vers des professionnels. Lors de difficultés rencontrées, essentiellement suite à des soucis de temps, je me suis tourné vers d’autres professionnels. Mais dans une moindre mesure.
Avez-vous fait appel à un/des architectes ? Pourquoi (que ce soit oui ou non) ?
J’ai travaillé avec unami maître d'œuvre en projet de construction bois, qui est aussi menuisier. On a travaillé ensemble sur la conception. Essentiellement par idées, plans et dessins pour ma part, et on a mis en 3D la conception du projet ensemble, puis la réalisation.
Comment envisagez-vous le projet une fois que vous n’en ferez plus partie ? (Pourrait-il changer de fonction et être remodelé, modifié à l’avenir ? Comment peut-il être amené à évoluer dans plusieurs décennies ?)
Le projet est essentiellement créé et construit pour mon utilisation. Je ne peux pas l’imaginer d’une autre manière, ni le céder ou le vendre à une autre personne. Toutefois, avec les difficultés rencontrées par rapport à des soucis de gabarit. La nécessité de devoir vendre à un moment du projet, peut-être dans les 5 prochaines années est apparue, et la réflexiondeconstruirequelquechosequisoitadapté non pas uniquement à moi mais à un potentiel acheteur est apparue dans la construction et l'élaboration de la construction.
3/ Votre retour d’expérience à ce jour Travailler avec des connaissances est extrêmement enrichissant, socialement, humainement et sur d’autres points. Mais comporte aussi des soucis sur le fait de respecter des délais et de tenir des deadlines. De plus, il faut accepter que le projet ne sera potentiellement pas parfait, et que chaque imperfection devra être retravaillée par soi-même. Mais c’est aussi ça le challenge de construire le projet, de pouvoir comprendre chaque étape de la construction, comprendre pourquoi il a été imaginé comme cela, et pouvoir comprendre comment le réparer ou le faire évoluer.
Quellessontlesétapesetmodalitésdecollaboration aveclesdifférentsacteurs,professionnelsounon,de votreprojet?etquellessontvosattentesvis-à-visde ces collaborations ? (Autoconstruction, chantier participatif, gestion de maitrise d’œuvre, intervention de tierces personnes)
Je n’ai en réalité voulu travailler avec qu’un seul professionnel à un moment donné du projet. Mais cela n’a pas abouti. Par ma demande beaucoup trop spécifique sur un point de construction, qui ne comprenait pas une réalisation complète de leur part, mais plutôt une aide sur un souci que je rencontrai. Le professionnel en question m’a fait comprendre qu’il n’avait pas de place dans l’emploi du temps pour répondre à ma demande. La réalité était sûrement plus que la demande que j’avais ne correspondait pas à leurs demandes à eux, et que cela représentait trop de contraintes par rapport à un gain potentiel pour eux.
En quoi votre engagement dans ce projet a changé quelque chose dans votre vie personnelle et/ou professionnelle ? Cela a-t-il aussi changé quelque chose dans votre relation aux autres, de manière générale ?
Ce projet est un changement de grande envergure en soi. Mais le sachant, j’avais déjà pris les dispositions pour me rendre disponible et participer à la conception de la construction. J’ai eu la chance de pouvoir m’adapter professionnellement et trouver des moyens de travailler tout en passant du temps sur la construction du van. Malheureusement
comme évoqué, les délais et les besoins ont pris plus de temps que prévu et encore aujourd’hui je suis sur la recherche de possibilité de répondre aux deadlines qui arrivent. Ma relation aux autres a effectivement changé, étant donné que mon temps a été essentiellement alloué à la possibilité de travailler sur le van, tout en travaillant pour injecter de l’argent dans le projet. J’ai fait le choix de mettre decôtémon relationnel avec les autrespourpouvoir me concentrer sur le projet. Cela a permis de tisser des liens forts avec les gens avec qui je travaillais, mais en perdre certains autres avec ceux qui ne comprenait pas mon investissement dedans.
Quelle est votre vision de la collaboration entre l’architecte et l’habitant, et selon vous, quelle serait ouauraitétélacollaborationidéalepourvotreprojet ?
Dans mon cas, la relation est moindre, et dans la conception si on peut considérer que j’ai travaillé avec un “architecte”, je dirais qu'un suivi régulier et une mise en plan concrète des idées est obligatoire pourpouvoirvisualiseretimaginerlaconstructionet touslespointsquivontapparaîtreaufuretàmesure que la chose se construit. Nous sommes souvent repassés par des logiciels 3D qui permettaient de faire évoluer le projet et de s’adapter à nos problématiques rencontrées.
Pensez-vous que ce questionnaire est susceptible d’influencer votre projet et votre perception à propos de futures collaborations entre architecte et habitant ?
Il est vrai que dans un projet futur, peut-être sur l’aspect conception, je mettrai encore plus de prioritésurlaconceptionenamontpourlesplans3D et pour l’aspect réflexion de construction. Ce questionnaire met en lumière, par les questions, et parlevécuduprojet,àquelpointilestnécessairede bien préparer et avec les bonnes personnes, la mise en place de la construction. Après, il est aussi vrai que l’aspect financier est toujours problématique dans ce genre de projet, et que les contraintes rencontrées sont parties de ce choix d’avoir voulu travailler avec des connaissances plutôt que de choisir une solution peut-être moins problématique.
LA PIEGEONNE, Squat Queer Féministe Antiraciste à Strasbourg
La Pigeonne n’a pas souhaité répondre aux sollicitations de cette étude. Il est cependant essentiel de les remercier d’avoir eu l’obligeance de répondre à mon message. Cette réponse négative, courte et cordiale renvoyait vers une publication. Cette publication à son importance et est retranscrite ci-dessous.
« IL
FAUT SAVOIR METTRE LES MAINS DANS LE COMPOST !
Depuis le début de notre squat, et de plus en plus souvent,nousrecevonsdesdemandesintrusivesde personnes qui soit ne savent pas ce que c’est qu’un squat, soit n’ont pas pris la peine de lire notre présentation sur notre site : demandes d’interviews de journalistes curieu-x-ses ; sollicitations d’étudiant-e-s en mal de sujets de recherches originaux pour avoir une bonne note ; des personnes qui veulent venir « observer » l’organisation anarchaféministe d’un squat pour la recopier ailleurs mais en la rendant « acceptable », « confortable » et bourgeoise ; des personnes qui veulent«visiter»laPigeonnecommesinousétions une auberge de jeunesse pour touristes militant-e-s.
Même si ces initiatives partent de « bons sentiments », nous gerbons ces sentiments. Nous ne sommes pas des sujets d’étude « anthropo-
sociologiques » ou des terrains d’enquête. Nous ne cherchons pas à « sauver des femmes et des personnes LGBTI+++ » et à recevoir des médailles. Nous n’éprouvons aucun plaisir sacrificiel à effectuer du travail gratuit pour des bourgeois-e-s en mal d’expérience « atypique ». Nous n’avons pas besoin de voyeurs et voyeuses, de personnes qui regardent nos initiatives depuis une position surplombante ou exotisante sans jamais participer à la vie de ce lieu essentiel.
Nous sommes épuisé-e-s et en colère face à un contexte politique d’exploitation et un pouvoir fasciste dont les dangers ne semblent pas être mesurés. Le futur est incertain, mais nous sommes convaincu-e-s que nous n’en aurons aucun si nous sommes isolé-e-s et demeurons la proie des patrons,despropriosetdespatriarches.Malgrédes constats alarmants, nous sommes fatigué-e-s de constater que certains mécanismes perdurent. Nous sommes certes un « lieu alternatif », mais surtout un lieu en opposition au fonctionnement d’une société qui cherche à faire du profit. Et notamment du profit sur les initiatives « radicales » pour s’enrichir ou nourrir la gloriole personnelle. Nous n’avons pas leur temps. Leur agenda ne nous intéresse pas. Nous avons faim d’organisation collective en dehors de l’idéologie libérale. »
Autres Supports
TABLEAU DE RECHERCHE ET DE SYNTHETISATION DES DONNEES
Catégories Habitat participatif Ecolieu Tiers-lieu Inclassable et/ou Hybridé Hébergement (privé, ou d’accueil) Oui, privé Aléatoire, de type privé ou d’accueil Aléatoire, de type privé ou d’accueil Aléatoire, de type privé ou d’accueil
Préoccupation écologique Pas nécessairement Essentielle Pas nécessaire Aléatoire Générer une économique Non Aléatoire Essentielle Aléatoire Lieu de travail collaboratif Non Aléatoire Oui Aléatoire Gouvernance au sein du groupe Partagée Partagée Partagée Aléatoire Autonomie énergétique Aléatoire Tend vers Aléatoire Aléatoire Accueil de public Ponctuel et aléatoire Aléatoire Essentiel -
Intergénérationnel Aléatoire Aléatoire Aléatoire Aléatoire Marginalisation Faible Moyenne à faible Moyenne à faible Forte Charte écrite Oui Oui, parfois sous la forme de statut AléatoireNécessité de planification (maitrise d’usage, maitrise d’œuvre)
Forte Moyenne à forte Faible Faible et aléatoire
Type de bâti Souvent neuf, parfois réhabilité
Neuf ou réhabilité Très souvent réhabilité, et souvent dans des friches industrielles
Souvent marginal Valeur participative Forte Forte Aléatoire Faible ou aléatoire
Projet corpus Graine de lieu, Urban’ hôtes Oasis Multikulti, La Colo Maison Mimir La Pigeonne, la Cabane de Lucie, Le Van de Paulo

Annexe - A (extrait)


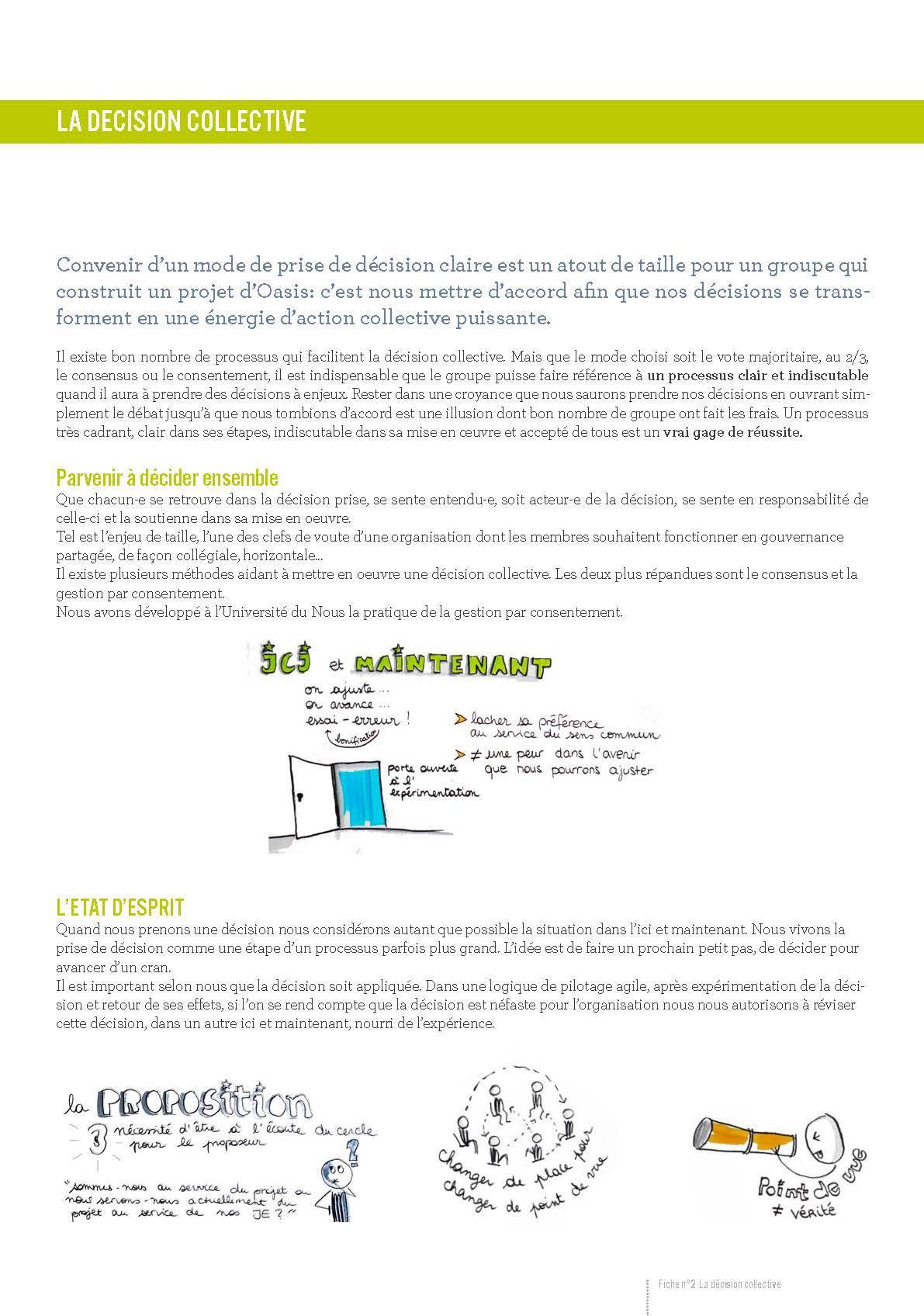


LACOMMUNICATIONBIENVEILLANTE
L'objectif dela CommunicationNon-Violente® est derendrenos communications plus efficaces. La CNV reposesur uneidéemaîtresse: nousavons tous des besoins universelsquenous cherchons à satisfairedans nos relations à autrui, et ceux-ci s'expriment autavers denosémotions.

La plupartdu temps, noscommunications sont biaisées par nos jugements, nosinterprétations,nos évaluations qui les rendent peuefficaces.Pour Marshall Rosenberg, inventeur de la CNY, tout part d'abordd'une bonneécoutede soi-même,c'est-à-dire réussir à identifier clairement nos sentiments face à une situation donnée, pour identifier, derrière cela, le ou les besoins ou enjeux que nouscherchons à satisfaire...et enfin, aboutir à une demande ou une décision personnelle.

Quandj'aivu/ entenduque
Jemesuis&enti1'...

joyeux, tritste, encolère, honteux, gêné, dégoûté, surpris, révolté, jaloux, impatient, déçu


Parcequej'aibesoinde d'estime de soi de protection et de sécurité, besoin physiologique, d'amour,d'appartenance, de réalisation de soi

®�Ir êJ l>o® �*ôuc:{f@ � [?@(R)@':@@� ffi)C)� § a@/�t10w� ��uù�tre�S> �C0�icSJerruœ� ............................................ 1nnex1entü���t.................·-······..····00••00 ftchen'5 lacommun,cJbonb1enve1llant.e
Je tepropose

Annexe
- B


Impression et reliure GROUPE CAR, Centre Alsace Repro, Imprimé en janvier 2023, Sélestat
Les projets alternatifs

De la Mutation du Rapport de Gouvernance ArchitecteUsagers à une Architecture Ethique et Soutenable
La présente étude propose d’interroger le rapport architecte-usager à travers plusieurs enquêtes menées sur un corpus de projets alternatifs tels que les habitats participatifs, écolieux, tiers-lieux, squats et bien d’autres encore. C’est à travers l’expérience des usagers que la démarche d’élaboration du projet est questionnée. Ces mêmes expériences permettent également de s’interroger au sujet de la gouvernance partagée et de la co-conception comme moyen de médiation entre l’architecte et l’usager. La réflexion menée dans le cadre de cette étude a également pour objectif de faire émerger la manière dont ces différents projets alternatifs peuvent générer une architecture éthique et soutenable.
 Illustration source : Yona Friedman
Illustration source : Yona Friedman


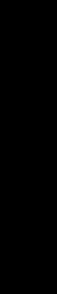






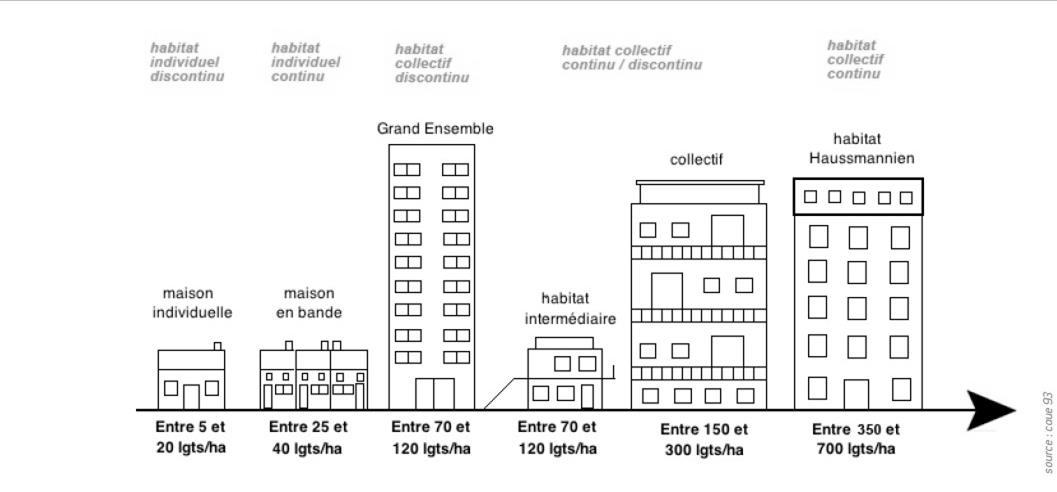



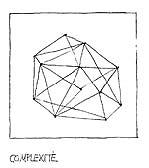


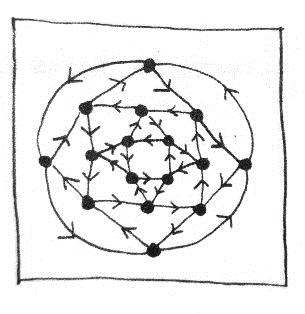



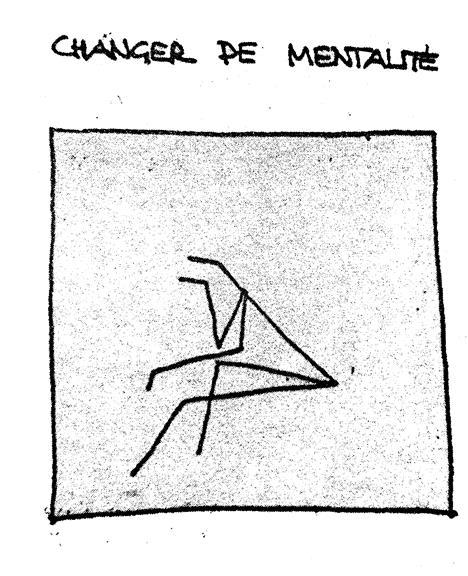










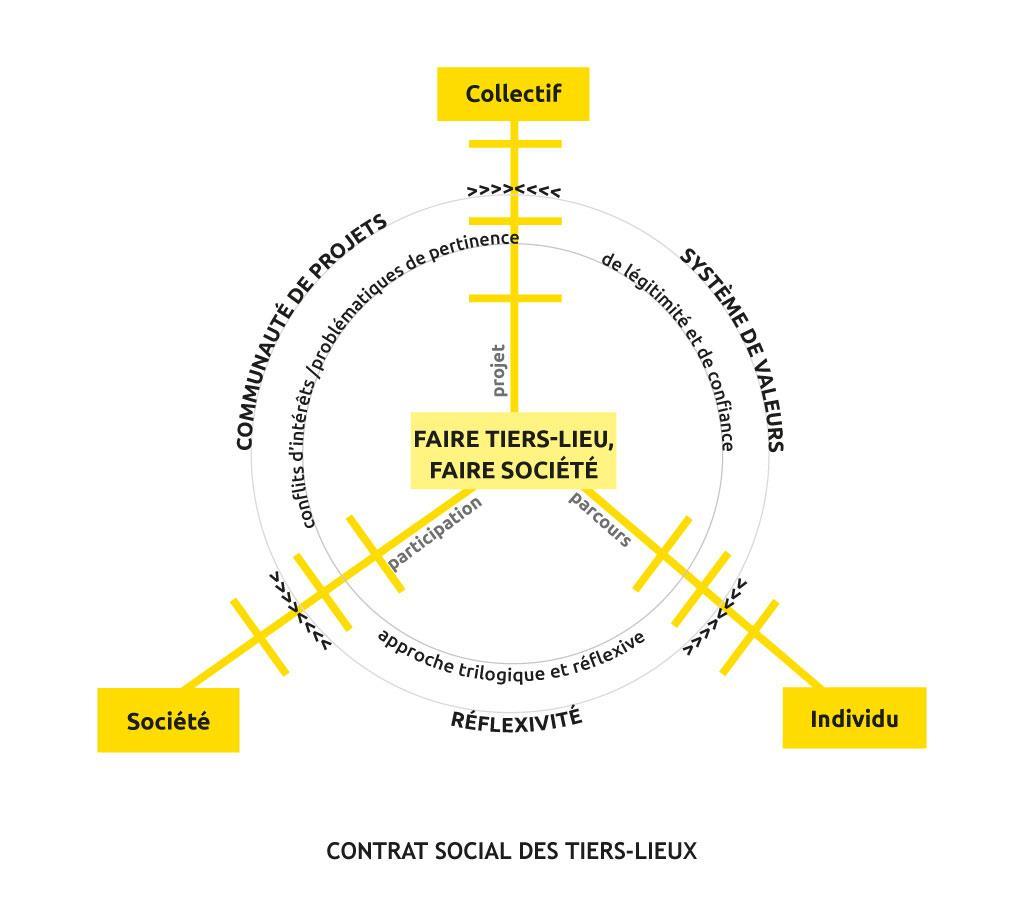


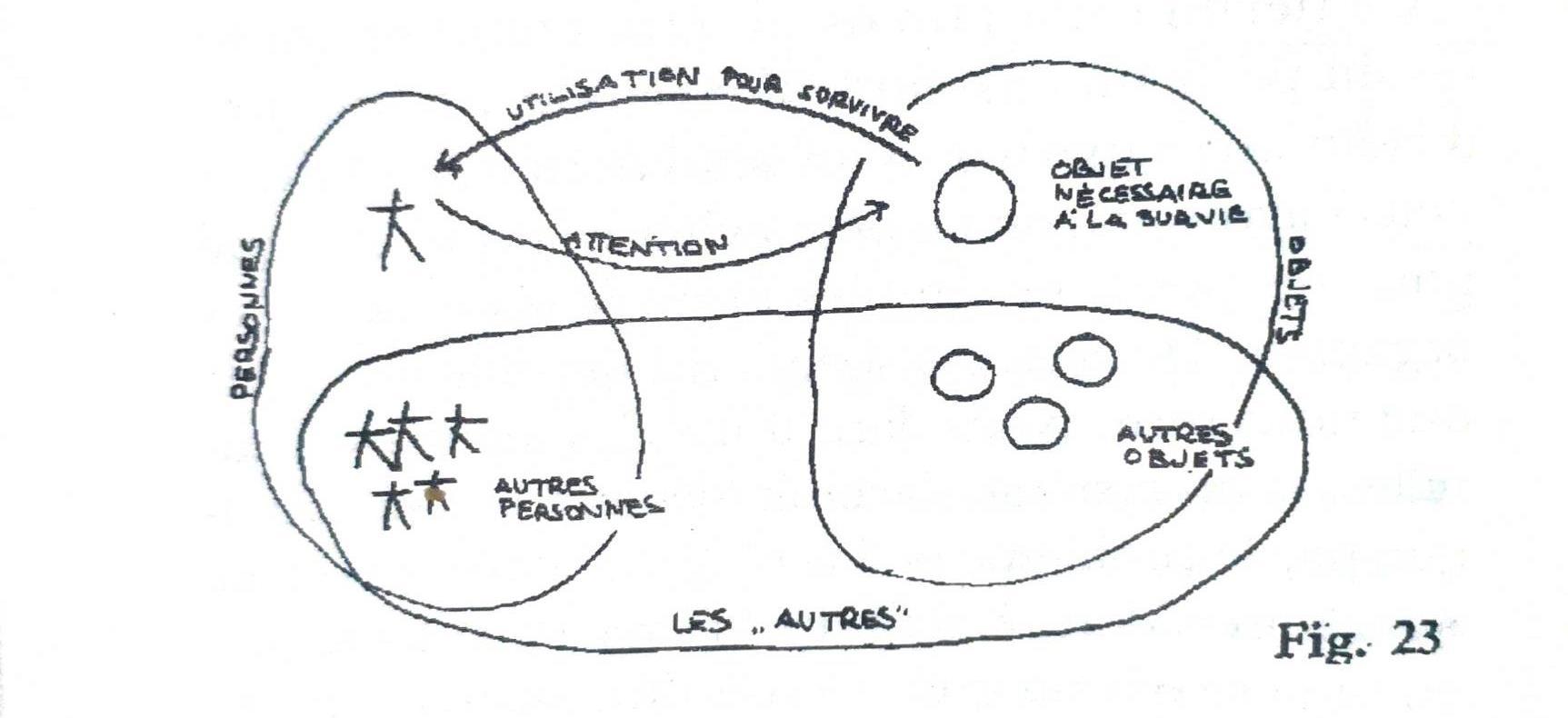



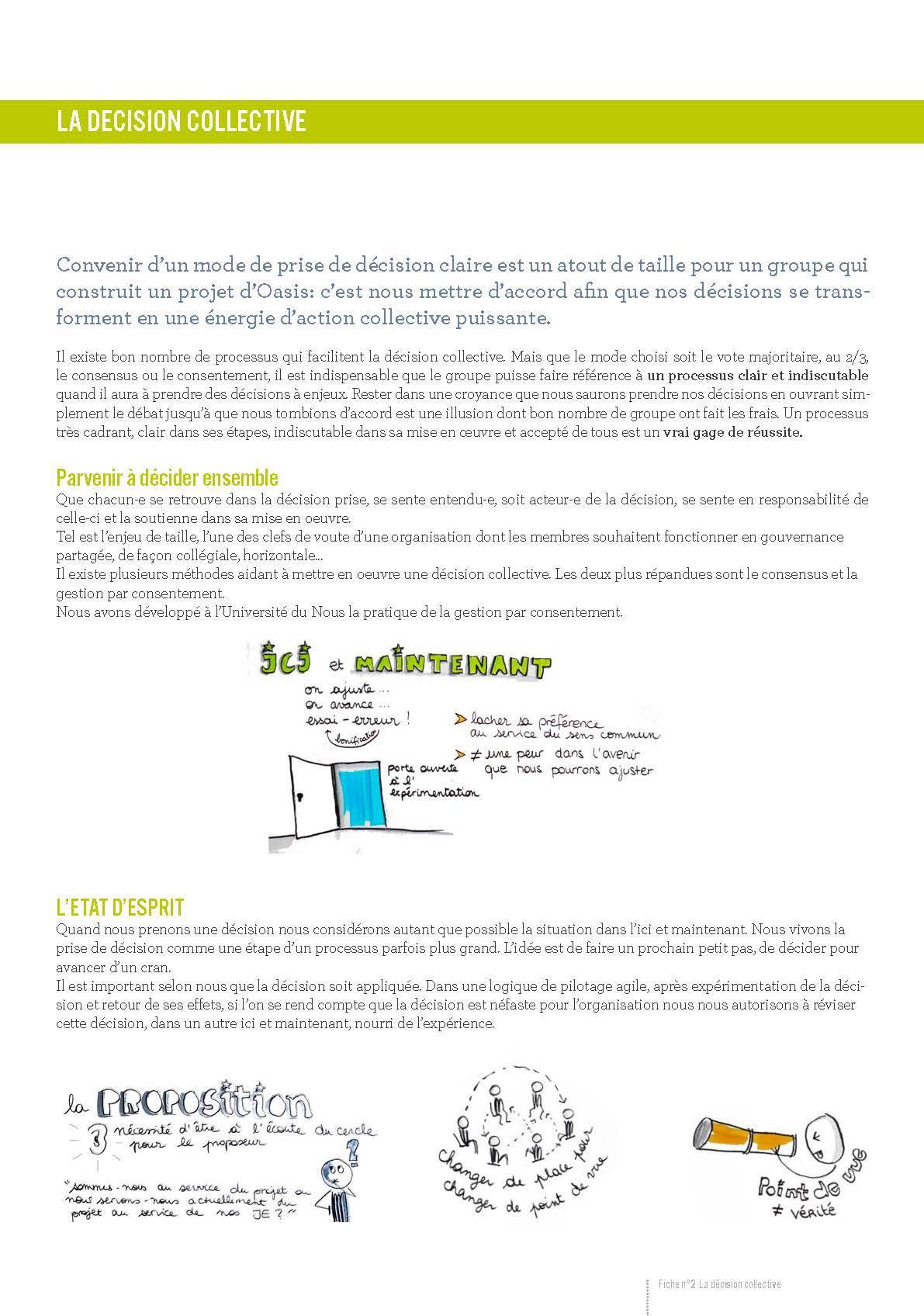












 Illustration source : Yona Friedman
Illustration source : Yona Friedman