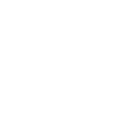”
A L’origine du monde de Courbet, correspond, symétriquement, une fin. Ou plutôt un envers du monde. Le Couple (1896) de Maillol n’unit pas seulement la nymphe et le satyre. Il rêve de L’Hermaphrodite, de l’envers du Genre -dans le creux du lit. Sur la table de chevet, il y a L’Amant de Lady Chatterley (1928) de D.H.Lawrence, un chef-d’oeuvre de la littérature érotique.
L’Amour lapidaire d’enfants de la Gallia Narbonensis
Comme un tableau d’Hubert Robert…
Sous un soleil d’hiver, par un jour de grand mistral, la Provence se fait farouche, presque rétive aux hommes, livrée aux caprices de ses éléments. Les ramures ploient, les branchages s’envolent en spirales effrénées ; nous cheminons, luttant contre les rafales, dans un lacis de bourrasques hurlantes. Sur la rose des vents méditerranéenne, le mistral occupe sa place souveraine : vent du nord-ouest, il tranche l’air comme une lame, emportant avec lui le silence et la poussière. Il a sa musique propre, sèche et sifflante ; il a aussi sa palette de couleurs. Le ciel, lavé de toute brume, s’embrase d’une clarté cristalline ; le soleil verse sur la terre une lumière d’albâtre, vive.
Au détour d’une ruelle, soudain, le cœur se serre : voici que se dresse, dans sa gloire silencieuse, l’épure souveraine de l’amphithéâtre d’Arles, temple voué au soleil et au vent, la majesté des Arènes de Nîmes, le gigantisme presque sacré du théâtre antique d’Orange, qui semble défier les siècles, surgi dans la lumière comme un songe de pierre. Ces instants de grâce sont comme des épiphanies du temps – le temps figé dans la pierre, la pierre victorieuse du vent et des âges. Devant ces colosses patinés de soleil, nous éprouvons l’humilité de notre passage, la petitesse de ce que nous sommes. Car la pierre, toujours, garde mémoire de la chaleur, du souffle, du pas des hommes. Quoi de plus enivrant, alors, que de poser la main sur ces antiques gorgés de lumière blanche – ces pierres chauffées au vif soleil, qui semblent palpiter encore du feu des anciens ? La Provence entière paraît alors bruire d’une langue de vent et de feu, d’un parler ancien où le mot soulèu s’unit au pèiro, et où le monde tout entier se résume à cette clarté sans ombre, à cette chaleur qui dure au-delà des siècles.
Cette présence tellurique de l’Antique trouve un écho inattendu au Couvent des Bernardins, où Simon Porte Jacquemus fait dialoguer, sous la voûte cistercienne, les Antiques romains des Chenel et les formes voluptueuses des sculptures de Maillol, réunis par les Lorquin. Ces passionnés de marbre partagent, sans l’expliciter, une même origine : cette Gallia Narbonensis dont la pierre, nourrie de lumière, fut leur premier langage. L’esthétique méridionale, dans Mythes, ne relève pas d’une imitation érudite des Anciens, mais d’une intériorisation sensuelle et instinctive de la romanité, transmise par la pierre même de la Provence. À travers une suite de « tableaux » de liturgie du quotidien, l’exposition met en lumière l’aisance et la sensualité des pierres, le caractère minéral de l’imaginaire et du goût des formes, un dialogue entre l’éternel et l’ordinaire. Or ce théâtre des jours des Provençaux, semblable aux ruines habitées d’Hubert Robert où l’homme et la pierre se répondent dans une même mélancolie lumineuse, invite à une réflexion plus vaste sur le caractère unique du lien des élus qui frôlent depuis leur plus jeune âge les Antiques de la Gallia Narbonensis.
La richesse de l’« héritage » latin de la Provence ne réside pas dans la capacité d’imiter des modèles imaginés par les Grecs ou les Romains, mais bien cette extraordinaire connivence organique que, depuis le XIXe siècle, les enfants de cette terre romanisée du Midi entretiennent avec la pierre antique. Maillol, s’il crut trouver en Grèce les clés de son art, ne fit que reconnaître au loin ce qu’il portait en lui : la mémoire charnelle d’un sol romanisé. Quant à l’esthétique des Chenel, union instinctive du marbre et de la céramique, elle prolonge, à sa manière, cette fidélité à la romanité – moins comme un modèle à imiter qu’une substance vive, transmise par la matière même.
La Salle à manger de Louis XVI et de Marie-Antoinette
Cette essence latine de la Provence ne se donne pourtant pas pour une évidence : il fallut qu’un autre révélât, qu’un regard étranger ouvrît les yeux des Provençaux… Heureusement, ce ne fut point l’un des nôtres : nous savons quel tribut Cézanne dut payer à cette clairvoyance solitaire. Aujourd’hui, nous nous rengorgeons de la Sainte-Victoire, emblème devenu totem, sans
toujours songer qu’avant ces célébrations tardives, avant cette ferveur rétrospective, les Aixois, sans le confesser, nourrissaient à son égard un sentiment obscur – un mélange d’incompréhension, de gêne et d’irritation muette. C’était comme si le peintre, en livrant sa montagne à la lumière, eût voulu partager son triomphe avec d’autres, alors qu’il ne désirait, au fond, que notre reconnaissance. Il attendait de nous ce simple acquiescement du regard, cette approbation silencieuse qu’accorde parfois une patrie à l’un des siens – mais la Provence, aveugle encore à sa propre splendeur, la lui refusa. La fierté des Antiques provençaux connut une destinée analogue.
En 1786, la Direction des Bâtiments du Roi commande à Hubert Robert quatre grands tableaux illustrant « Les Antiquités de la France » pour la salle à manger des petits appartements du Roi au château de Fontainebleau. Au Salon de 1787, le peintre expose donc : L’Arc de Triomphe et l’amphithéâtre de la ville d’Orange, Le Pont du Gard, La Maison carrée, les arènes et la tour Magne de Nîmes ainsi que L’Intérieur du Temple de Diane à Nîmes (Paris, musée du Louvre).
Les Antiquités de la France d’Hubert Robert constituent en réalité une recomposition libre et inspirée, un projet empreint d’espérance. Dès le Salon de 1785, il avait exposé une toile décrite, dans le livret du Salon, comme appartenant au futur Paul Ier de Russie et représentant «La Réunion des plus célèbres Monuments antiques de la France, tels que les Arènes & la Maison quarrée (sic) de Nîmes, le pont du Gar (sic), l’Arc de Triomphe & le Monument de Saint-Rémy, & un autre Arc de Triomphe d’Orange » (Pavlovsk, Palais de Pavlovsk). Et au Salon de 1787, nul ne perçut que L’Arc de Triomphe et l’amphithéâtre de la ville d’Orange et La Maison carrée relevaient du caprice architectural, réunissant en un même cadre des monuments éloignés les uns des autres. L’Ami des artistes affirmait que : « Tous les voyageurs ont rendu justice à l’exactitude & à la vérité de ces monuments ; l’Artiste ne paroît (sic) avoir rien négligé pour rendre leurs effets plus sensibles. Un des plus nobles emplois de la peinture, c’est de chercher à fausser des mains du tems (sic), ces ouvrages qui servent à nous faire connoître (sic) le génie des Anciens, & à nous apprendre à les imiter. »
Plus circonspect, le critique des Inscriptions pour mettre au bas de différens (sic) tableaux feignait de s’interroger :
« A-t-on représenté ce temple de Diane
Tel qu’il fut autrefois ou qu’il est aujourd’hui ?
Que le peintre le dise, on s’en rapporte à lui, Et là-dessus, plus de chicane »
Hubert Robert prit bien de singulières libertés avec l’état réel des ruines ; mais n’est-ce point la force d’une imagination vive et pétulante que d’opérer des miracles ?
Préserver sans effacer, sanctifier sans muséifier
Dès la visite de François Ier à Nîmes, en 1533, les vestiges firent l’objet d’une attention particulière et certains furent illustrés dans un ouvrage publié en 1559 par Jean Poldo d’Albenas. Pourtant, Eleuthérophile Millin – Aubin Louis Millin de Grandmaison –conte, au début du XIXe siècle, une histoire d’appropriation à la fois inquiétante et romanesque :
1 Inscriptions pour mettre au bas de différens tableaux exposés au Salon du Louvre en 1787, Paris, Bibliothèque Nationale de France, Collection Deloynes, XV, 387, p. 601 (p. 9)
« Vers le XIe ou le XIIe siècle, on fit de ce temple un hôtel de ville ; et pour cette destination, on y plaça une cheminée, on y ouvrit des croisées, on mura le vestibule, on abattit le perron. Un particulier l’obtint en échange, et y adossa une petite maison. Cet édifice passa ensuite à une famille qui en fit une écurie.
En 1670, il échut aux Augustins, qui obtinrent de Colbert des fonds pour en faire une église, à condition que le monument antique seroit rebâti soigneusement et rendu à sa première forme cependant ils bâtirent dans l'intérieur une église, qui, heureusement, étoit isolée. Colbert auroit exécuté le projet de faire transporter cet édifice à Paris, s les artistes qu'il envoya avoient jugé que cela pût s'exécuter sans compromettre l’existence du bâtiment. »2
Dans son Voyage dans les départemens (sic) du Midi de la France, Millin livre une méditation dont la justesse pourrait encore instruire les esprits du présent :
« On a tort de vouloir restaurer ainsi les édifices antiques ; la marque que leur imprime le temps par ses outrages plaît à l’imagination, et l’on ne doit pas l’effacer : mais il faut tout faire pour empêcher leur dégradation et leur ruine ; et il est impossible de s’imaginer comment on peut laisser de pareils chefs-d’œuvre exposés aux insultes de la barbarie et de l’ignorance. [...] Au lieu de cela, la partie opposée à la façade est si couverte d’ordures, qu’on croiroit que ce temple a été consacré à la déesse des cloaques ; une nuée d’enfans inonde le portique et les côtés ; la pointe acérée de la toupie perce de mille trous les belles dalles de pierre ; le sabot y trace une infinité de cercles : des polissons grimpent sur les colonnes pour avoir des nids ; d’autres assiègent leurs magnifiques chapiteaux à coups de pierre, pour en faire partir les oiseaux, ou pour atteindre quelque ornement qu’ils ont désigné comme le but où vise leur adresse. Avec quel plaisir je me serois armé d’un fouet pour chasser cette canaille dévastatrice! Mais d’autres bandes auroient succédé à celles-ci ; et cette attaque n’eût fait qu’exciter leur rage contre un chef-d’œuvre que le temps semble vouloir respecter, malgré tout ce que les hommes font chaque jour pour le détruire. »
L’érudit Millin s’indigne de la négligence des hommes et du sort réservé aux témoins de l’Antiquité, il dénonce la barbarie des temps modernes, qui profane. Son regard, pétri d’un zèle moral, confère aux ruines la gravité d’un memento, d’une responsabilité collective envers la beauté ancienne. À cette vigilance courroucée de l’érudit qui perçoit souillure et dégradation répond, chez l’artiste, la tendresse du visionnaire : le discernement d’un souffle, d’une continuité secrète entre la ruine et le quotidien.
Cette disposition s’enracina chez Hubert Robert, natif de Paris, un quart de siècle avant son séjour prolongé en Provence, lors du voyage avec Saint-Non et Fragonard dans le Sud de l’Italie, « anciennement appelée Grande Grèce ». Ils y admirèrent la sérénité de ces populations pour lesquelles la grandeur ancienne ne constituait ni un fardeau ni un culte, mais une présence vivante, un paysage habité. Dans ces contrées, le temps semblait pour ainsi dire s’être arrêté, et où les tentatives d’introduction de la modernité avaient échoué. Saint-Non y puisa l’essence de sa Description du royaume de Naples et de Sicile, où il assurait qu’« un très petit nombre [de personnes] qui aient été curieuses de porter leurs pas jusqu’à l’extrémité du Royaume de Naples, qui aient osé, pour ainsi dire, traverser la Calabre, cette belle partie de l’Italie, depuis longtemps inculte, inhabitée, et que l’on regardoit comme en proie aux bandits, et à l’effroi des voyageurs. »4 Or les ruines y étaient celles des périodes fastes de cette région, qui avait connu les foisonnements et les émulations culturelles les plus prolixes au cours de l’Antiquité et du Moyen Âge. Ces deux hommes brillants, en quête d’authenticité, étaient accompagnés de Jean-Honoré Fragonard – ce Provençal, qui, ironie du destin, ne réalisa pas vraiment qu’il existât dans les terroirs de son enfant des monuments et des vies semblables à ceux qu’il admirait dans la « Grande Grèce ».
Les Antiquités de la France d’Hubert Robert ne sont donc pas une représentation fidèle de cette coexistence harmonieuse entre les Provençaux et leurs vestiges. Il ne cherche pas à effacer le caractère délabré des monuments pour les restituer dans leur perfection originelle comme l’avait fait Poussin avant lui : le temps, pour lui, est le vecteur d’une méditation sur la fragilité des civilisations. Chez lui, la majesté des Anciens s’accompagne de la conscience de son effacement, et c’est dans ce sentiment mêlé de regret et de douceur que s’épanouit l’éloquence véritable de la ruine, à la fois emblème de la vanité des choses humaines et source d’un émerveillement paisible devant l’innocence des vies qui s’y abritent encore.
Démysthifier
Deux siècles et demi plus tard, dans la Provincia Romana, la proximité du sublime et du trivial ne trahit plus une profanation chez les « descendants » des personnages peints par Hubert Robert, mais une forme d’accoutumance – un oubli presque suave – par lequel l’existence moderne s’installe parmi les chefs-d’œuvre sans éprouver le moindre trouble de leur voisinage. Ce phénomène se laisse encore percevoir auprès de ceux qui habitent les vestiges antiques et semblent à peine en discerner la majesté. Par un jour d’été, lorsque la chaleur s’attarde sur les pierres et que le grésillement lointain des sonos souille l’air immobile, malgré la vulgarité criarde des enseignes de restaurants alentour, le Théâtre antique d’Orange demeure debout, intact ; il suffit de lever le regard pour que quelque chose, au plus profond de l’âme, s’accorde à sa permanence. À Arles, pour fuir le vacarme des ruelles encombrées, une émotion semblable saisit le visiteur traversant le cloître Saint-Trophime, lieu d’une plénitude saisissante, empreinte d’une gratitude muette et presque sacrée. Dans les Jardins de la Fontaine à Nîmes, où des fragments d’antiques remployés affleurent sous les strobiles, la paix du lieu semble prolonger l’antique sérénité. Sous les ombrages légers, au détour d’une allée déserte, la pierre recomposée conserve le souvenir des dieux, tandis que des familles promènent des poussettes de plastique, d’une laideur impardonnable. Près de la Tour Magne, il est singulier d’apercevoir des coureurs, casqués d’oreillettes, glisser devant le monument dans une indifférence presque déconcertante. Certaines de ces dissonances visuelles finissent pourtant par devenir matière à méditation. Ou à une inspiration poétique !
Mythes est avant tout une prolongation inspirée du jeu raffiné auquel se livrent les Chenel. En déposant des fleurs dans des urnes antiques, en érigeant des chapiteaux en tables basses, en offrant une existence nouvelle à une stèle romaine du IIe siècle – retaillée par les Byzantins pour soutenir quelque autel, puis désormais métamorphosée en guéridon –, ils poursuivent depuis plusieurs années une rêverie singulière sur la continuité des formes et la survivance des matières. Ils invitent à vivre naturellement avec ces œuvres, à se les approprier.
2 Aubin Louis Millin de Grandmaison, Voyage dans les départemens (sic) du Midi de la France, 1807-1809, IV, p. 215-216.
3 Aubin Louis Millin de Grandmaison, Voyage dans les départemens (sic) du Midi de la France, 1807-1809, IV, p. 219-220.
4 Cité dans Bruno Neveu, « Le voyage de l’abbé de Saint-Non dans l’Italie du Sud », Journal des Arts, Paris, octobre-décembre 1973, p. 295-300, p. 296.
L’esthétique de leurs marbres le permet d’ailleurs. Les « marmor lunense », privilégiés au Ier et au IIe siècles, par leur grain pur, leur blancheur légèrement bleutée et leur robustesse, offrent des patines merveilleuses, dont ils refusent de se priver. Loin des choix radicaux de certains musées ou institutions – nous pensons volontiers aux Marbres des collections Torlonia–, ils ne choisissent et conservent que des statues ou des éléments d’architecture qui présentent des altérations dues à la lente percolation des eaux calcaires, qui offrent à la patine d’origine un côté désaturé, laissent apparaitre des voiles opalins et des efflorescence crayeuses d’un blanc ivoirien. Les fines suintures verticales, souvent irisées d’un ton lactescent ou grège, qui adoucissent le poli initial sont des trésors. Rien n’est plus plaisir, au toucher, que les liserés d’incrustations calcaires qui forme comme une brume pierreuse, un miroitement atténué du grain lunense. Le chatoiement beige rosé des sculptures exhumées des sites humides, responsables d’accumulation de calcite, d’oxydations ferrugineuses, donnant aux reliefs une coloration beige rosé, aux creux des tons cendrés. Les vibrations chromatiques confèrent au marbre une vibration singulière, une palette du temps. De même, chaque reprise devient un vestige de la durée, un hommage discret à ceux qui, avant eux, touchèrent ces pierres. Car les restaurations successives sont autant de dons, et il serait sacrilège de les abolir.
Dans Mythes, un fragment saisissant retient le regard : les jambes d’une Artémis, demeurées seules, des pieds jusqu’aux genoux. Le marbre, à peine doré par les ans, conserve la souplesse d’un drapé que la lumière anime ; les plis, obliques et pleins d’élan, traduisent l’instant suspendu d’une marche divine. Comme les marbriers du XVIIe ou du XVIIIe siècle qui, dans leur ferveur antiquaire, l’avaient munie d’un socle moderne pour en parfaire la silhouette, Simon Porte Jacquemus la ressuscite dans une mise en scène harmonieuse, parmi les vanneries débordantes d’artichauts. Cette Artémis transfigurée en apparition champêtre, écho lointain d’un marbre antique devenu songe d’une déesse en mouvement, glissant parmi les étals d’un marché provençal, un panier de jonc au bras, dans une lumière d’aurore. Les attachements en fer demeurent visibles – stigmates des ajouts du XVIIe ou du XVIIIe siècle, traces de ces mains passées qui voulurent restituer un corps à la déesse mutilée. Les Chenel, fidèles à leur éthique de la transparence, ne les dissimulent point : ils les laissent parler, témoigner du long destin des formes, de cette chaîne ininterrompue où chaque époque, en touchant la matière, y dépose sa propre âme.
La Provence, Provincia Romana
Mythes propose un récit symbolique d’une Provence rêvée et d’une féminité réinventée, dont les contours se dessinent, depuis la fin du XIXe siècle, entre la présence des Antiques et la lumière du corps.
La plus belle conquête de la Provence au XIXe siècle n’aura pas été son repli jaloux sur elle-même, ni cette volonté de figer sa langue comme un rempart contre le monde. Mistral érige la femme en symbole de pureté, non point comme être de désir ou de liberté. Il la veut intacte, immobile, vouée à célébrer le passé plus qu’à engendrer l’avenir. Cette idéalisation prend la forme d’un culte quasi liturgique, où la féminité s’efface dans la blancheur d’un mythe pastoral : la femme mistralienne devient une vierge consacrée, une Rosière couronnée non pour son intelligence ni pour son courage, mais pour la docilité qu’impose la vertu. Le rituel, sous les apparences d’un hommage, consacre en vérité une dépossession : la femme n’est plus sujet mais emblème, fétiche d’une Provence rêvée, instrument d’un imaginaire masculin qui confond la pureté du sol avec celle du corps féminin. Ainsi se perpétue, sous le vernis poétique du Félibrige, une mystique de la conservation, où la femme incarne la terre elle-même – fertile, silencieuse, et toujours offerte à la gloire du poète, jamais à sa propre parole.
Grâce à des esprits venus d’ailleurs, qui surent nous réapprendre la fierté de notre lien singulier avec l’Antiquité, la Provence connut aussi le privilège d’un songe au contact de ses trésors : rêver des chitôns qui épousent le creux des hanches, la douceur des seins, le mouvement des jambes ; des himations qui effleurent la nudité sans la travestir. Le premier « tableau » de Mythes est ainsi un magnifique dialogue entre un buste antique et une femme de Maillol, aux courbes généreuses. Deux détails colorés suffisent à « placer » ce décor : le verre de jus d’orange matinal, et la draperies couleur safran, nonchalamment abandonnée sur le tub aux formes archaïsantes, héritées de la baignoire du Capitole. Tout y célèbre une nudité sereine, un plaisir du corps offert à la lumière, des étoffes qui ne dissimulent pas mais révèlent. Rien ne s’oppose, tout se souvient.
Au cœur du parcours de l’exposition, afin de rappeler combien les nus féminins de Maillol, issus de la sève antique, trouvent leurs descendantes dans les silhouettes drapées conçues par Jacquemus, Simon Porte Jacquemus a disposé Soleil, la robe sculpturale de la collection Le Paysan, sur un portant, derrière une statue antique et une figure de Maillol. La mise en scène crée un miracle : trois présences échangent silencieusement dans un espace baigné d’or pâle – le marbre, le bronze et l’étoffe. Entre elles circule une même respiration, une même ferveur pour la pureté des formes. La draperie « soleil » emble avoir recueilli la chaleur du jour que le marbre, depuis deux mille ans, réfléchit, et que le bronze, retient comme un feu intérieur.
La magie de Mythes est cette ode à la longue fidélité des formes méditerranéennes à elles-mêmes, à leur pouvoir de régénération
et de métamorphose sans s’abolir. La beauté antique n’est point une relique, mais un organisme vivant, qui respire encore dans la lumière du Sud. Par la main de l’artiste, le passé se perpétue, s’invite à nouveau dans le concert des formes et des plis.
La magie tient moins à l’effet de surprise dans ce Couvent des Bernardins, qu’à une opération plus secrète : les formes ne sont jamais répétées, elles se ré-éclairent. Un pli, de la toge à la cotonnade contemporaine ; un déhanché, du bronze à la chemise ample ; la mémoire change d’angle. Rien ne se fige : la forme antique demeure un principe de croissance, source de la mode, irrigant matières sans perdre sa tenue.
Ainsi comprise, Mythes dépasse la seule célébration d’un héritage méditerranéen : elle en propose une véritable reformulation. Par le jeu des correspondances, l’exposition invite à repenser la généalogie culturelle et spirituelle de la Provence à la manière dont Rémi Brague repensa l’Europe dans L’Europe, la voie romaine (1992). Le philosophe y dessine les contours d’une âme européenne née d’un dialogue constant avec l’altérité, et fondée sur une filiation multiple : Athènes, Jérusalem et Rome. Loin d’être une simple héritière de la Grèce, l’Europe qu’il décrit accepte ses héritages tout en les ordonnant à la raison juridique et politique. La « secondarité » de Rome, loin d’être une faiblesse, devient principe d’ouverture à l’altérité et capacité à se réinventer. Le dépassement des dispositions grecques offre la « voie » – non pas tel un chemin unique – mais comme une aventure philosophique, un humanisme sans cesse réactualisée.
Ce que Brague nomme la « voie romaine », Simon Porte Jacquemus et ses complices l’incarnent à travers un théâtre plastique de la romanité, héritière et réinventrice tout à la fois. Là où le philosophe exalte la traduction comme reformulation de la mémoire, éclairée par l’intelligence du meilleur de cette aventure pour aller vers un meilleur, Mythes est une traduction à son tour de la mémoire des formes antiques dans le langage du présent. Chaque restauration d’un antique, chaque création en bronze ou en étoffes est une réécriture d’une mémoire dans le vocabulaire du présent.
L’histoire même de la Provence – et plus particulièrement l’histoire de sa sculpture – participe de cette aventure : tradition d’accueil, de reprise et de réinvention, elle fait du passé non un monument, mais une source vivante. Après tout, c’est aux Alyscamps, dans la nef de l’église Saint Honorat, que fut créé en 1784 le premier musée public d’antiquités français. Hubert Robert en peignit des images saisissantes, comme plus tard Van Gogh. Et dans ce jardin de pierres, la sève circule encore.
Carole Blumenfeld
Maillol, un classique au-delà du classicisme
En 1995, dans leur guide du visiteur du musée Maillol qui venait d’ouvrir à Paris à l’initiative de Dina Vierny, Jean-Luc Daval et Bertrand Lorquin rappelaient que la Fondation et le musée se situent « derrière la majestueuse Fontaine des Quatre Saisons (1739-1746) du grand sculpteur Edme Bouchardon »1 . Bouchardon, un sculpteur néo-classique du XVIIIe siècle. Les deux auteurs s’amusaient à relever que « le faible débit de cette fontaine luxueuse lui a valu le surnom de la « trompeuse ». En elle en effet, la sculpture l’emportait sur l’ouvrage d’utilité publique. Et si cette « trompeuse » à l’entrée du musée Maillol agissait comme une mise en garde ? Maillol n’est-il pas toujours plus complexe qu’on ne le pense et qu’on ne le dit ? A ceux qui le voient « tout classique » et son art sorti tout droit de l’antique, comme Waldemar-George qui écrivait en 1971 : « Maillol est un Grec »2 « tendant la main à Bouchardon », on peut rétorquer que l’art de Maillol n’est finalement pas si « grec » que cela, ni si proche du néo-classicisme de Bouchardon. Les époques sont bien différentes et, d’ailleurs, il y a plusieurs antiquités. Au temps de Maillol, à la charnière des XIXe et XXe siècles, la notion d’antique est bien renouvelée, en dehors du champ des études classiques des élites -où l’artistique est souvent rabattu sur le littéraire-, par le développement de l’ethnographie, de l’anthropologie, des recherches sur les mythes et de l’archéologie. Dans le monde d’Homère, la ruse, la métis, s’incarnait dans le rusé Ulysse qui savait mieux que d’autres donner le change. Métis et métamorphose ont la même racine étymologique, justement la capacité de changer, de métamorphoser. L’Antiquité dont se saisit Maillol, il la métamorphose. Bien loin d’un quelconque « retour à l’ordre », l’œuvre rusée de Maillol nous attire sous les habits de l’antique vers sa propre vision de l’art.
L’Antiquité de Maillol n’est pas celle de Bouchardon
Le rapport de Bouchardon et de l’époque des Lumières (XVIIIe siècle) à l’antique, est la redécouverte d’un style qu’il s’agit d’imiter ou, mieux, de s’approprier ; c’est affaire de spécialistes, d’érudits, d’antiquaires, d’artistes académiques ; c’est culturel. Le rapport de Maillol à l’antique au début du XXe siècle est l’affaire de toute une société, confrontée à sa propre capacité à donner du sens à la vie ; l’artiste est à l’écoute d’une civilisation rurale, voire païenne, qui a perduré de façon souterraine sous le fracas de la modernisation, de l’urbanisation, du machinisme industriel ou de la production en série, et qui aspire -au moment sans doute où elle est menacée de disparaître-, à montrer qu’elle a conservé sa vitalité et sa possibilité d’éclairer le monde ; ce n’est plus culturel, c’est vital !
Autant l’art néo-classique avait une mission claire : installer l’art civique d’une société de citoyens où le modèle à suivre est celui d’une élite, celle des Lumières ; autant le rapport à l’antique de Maillol et de sa génération est trouble et complexe. Paul Gauguin, qui eut une grande rétrospective posthume au Salon d’automne de 1906, était allé poursuivre un rêve primitiviste d’abord en Bretagne puis jusqu’à Tahiti et aux Marquises dans son « atelier des Tropiques ». Les débuts de Maillol lui doivent tout : de ses terres cuites à ses formes monolithiques qui rappellent Oviri (1894). Dans le « musée imaginaire » de la génération à laquelle appartient Maillol, c’est-à-dire l’ensemble des images qu’elle a pu voir -dans les livres de photographies, dans les musées et les catalogues de vente-, la redécouverte de la Grèce archaïque, cycladique, mycénienne, dorienne, est concomitante de celle des grandes civilisations de l’Asie. L’exposition universelle de 1878 à Paris a montré les masques et les idoles de Nouvelle Calédonie. La même année, l’ouverture au palais du Trocadéro du Muséum ethnographique des missions scientifiques va permettre aux artistes de considérer de vastes ensembles d’objets tribaux. En 1889, c’est l’exposition coloniale de Paris qui révèle l’art khmer et l’art indien. On peut également mentionner la grande exposition universelle de 1900 où Maillol récupéra certains moulages qui resteront dans son atelier et influenceront sa vision de l’art archaïque.
Waldemar George a bien retracé la découverte de l’antiquité par Maillol :
« Maillol découvre la Grèce avant d’entreprendre son mémorable voyage à Olympie, à Delphes et à Athènes. Il l’entrevoit au Louvre, il en retrouve les traces en Catalogne, il la porte en lui. Son optique n’est ni celle de David ni celle de Canova ; pas plus qu’il n’est le descendant de l’art parthénonien, il ne met à profit les plus récentes conquêtes de l’archéologie comme Ingres le faisait, sinon dans le Bain turc du moins dans Romulus et dans la Stratonice
Chaque époque et chaque génération adopte devant l’Antiquité une nouvelle perspective. Pour un lycéen, le grec est une langue morte et la Grèce appartient au passé. Mais l’Hellade inspire encore Renoir quand il évoque le jugement de Pâris. Maillol est un Grec au même titre que le sont Mallarmé quand il écrit L’après-midi d’un faune ce poème que dansera, sur les rythmes brisés de Debussy, le Scythe Vaslas Nijinski, et Valéry, quand il compose Narcisse. Il est épris de texte mythologique, comme l’est Picasso qui ressuscite la blonde Nausicaa évoluant sur les plages égéennes ou bien quand il retrace les ébats des satyres et des nymphes.
Ceci dit, la question des sources-mères de Maillol reste secondaire. Elle concerne les scoliastes. Il importe beaucoup plus d’envisager l’art du maître de L’Été tel qu’en lui-même enfin … que de l’étudier dans ses rapports médiats ou immédiats avec l’Inde et l’Égypte, la Grèce, le XVIe et le XVIIe siècles. »3
C’est grâce à son ami et mécène le comte Harry Kessler que Maillol visite le British Museum en 1904, puis se rend en Grèce du 25 avril au 3 juin 1908, avec le poète Hugo von Hofmannsthal. Il remplit de notes et de dessins son carnet de voyage, et on comprend en le parcourant que pour lui, cette culture antique est vivante. Il dessine en même temps les sculptures, les architectures antiques et les scènes de la vie de tous les jours, les passants, les bergers, les femmes, les animaux. Les photographies prises pendant le voyage, les cartes postales envoyées en témoignent : les roches Phédriades à Delphes, massif splendide, et, à côté, la fontaine Castalie où Hofmannsthal boit. Tout cela forme un continuum avec son propre univers catalan. Maillol retrouve Banyuls dans l’Attique. Dans le vivant comme dans l’art, il admire ce que Johann Joachim Winckelmann aimait déjà au XVIIIe siècle dans la sculpture antique : « edle Einfalt und stille Größe » (« noble simplicité et calme grandeur »).
A dire vrai, Waldemar-George l’avait déjà remarqué : « Lorsqu’il débute, Maillol se tourne, non vers l’art grec classique, mais vers l’art égyptien. » Maillol le dit clairement : au Musée Archéologique de Delphes, «je regarde une belle statue imitée des Égyptiens et là je me sens remué profondément – là la grandeur est évidente, l’ampleur des formes est d’un dieu – l’art a touché son but - » Bien plus tard, en 1944, il se remémore en présence d’Henri Frère, poète et ami de l’artiste, d’un autre épisode du voyage:
« Me trouvant à Athènes, il y a déjà quelques années, je dessinais au musée une statue que l’on nomme l’Apollon à l’Omphalos; c’est une statue qui magnifie l’étude de la chair à un point surprenant, par conséquent loin déjà de la grandeur et de la majesté des œuvres de Phidias. Mon dessin terminé, je me retourne et me trouve en face d’une très grande statue primitive, une œuvre dans le style égyptien, sévère et grandiose. Enfin la statue d’un dieu ! J’ai compris combien cet art surpassait l’Apollon à Omphalos 4 par son élévation spirituelle cette comparaison me fit réfléchir profondément et me laissa perplexe (…) J’ai compris que la sculpture c’était ça. Ou plutôt que la sculpture était faite pour ça. Pour produire une grande impression. »5
La Grèce que découvrent les modernes comme Maillol est davantage la Grèce archaïque qui engendra le courant primitiviste, que la Grèce classique, qu’imitèrent les courants néo-classiques -de Jean Goujon, qu’aimait Maillol, à Coysevox et à Bouchardon. C’est cette Grèce archaïque que les fouilles des archéologues, en particulier des Anglais et des Allemands ont mise au goût
3 Ibidem, p.41.42.
1 Bertrand Lorquin et Jean Luc Daval, Fondation Dina Vierny, Musée Maillol : guide du visiteur Paris, Fondation Dina Vierny-Musée Maillol, 1995.
2 Waldemar-George, Maillol Paris, Arted éditions d’art, 1971, p.41.
4 Cette statue d’Apollon en marbre pentélique avait été trouvée à Athènes au théâtre de Dionysos. Œuvre du IIe siècle après J.-C., elle était la copie d’un original en bronze réalisé vers 460-450 av. J.-C. par un sculpteur du style sévère, peut-être Kalamis.
5 Henri Frère, Conversations de Maillol, Paris, Somogy Edition d’art, 2016.
du jour. Ce n’est plus l’art classique que défendit autrefois Adolf Von Hildebrandt, le rival de Rodin. Maillol témoigne d’un intérêt pour la sculpture grecque primitive, celle qui subit le plus fortement la leçon de l’Égypte. Celle des Kouroi et des Korês dérivés de la statuaire égyptienne et des idoles cycladiques. Presque immobiles, esquissant à peine le mouvement d’avancer une jambe, à peine dégagée du reste du corps, du bloc.
Le sculpteur confesse à Judith Cladel : « Pour mon goût il faut le moins de mouvement possible en sculpture. Il ne faut pas que ça chahute et que ça grimace et, dans le mouvement, on grimace facilement. Rodin lui-même reste tranquille : le mouvement il le met dans le rendu de la musculature, mais l’ensemble est sobre et calme. Les statues égyptiennes, plus elles sont immobiles, plus il semble qu’elles vont remuer … Les sphinx, on s’attend à les voir se lever. » On sait que cette quasi-immobilité d’une femme qui avance fascina les romanciers et les artistes, de Wilhelm Jensen (1837-1911) à La Femme qui marche (1932) de Giacometti. Freud lut en 1906 l’ouvrage Gradiva, fantaisie pompéienne de Wilhelm Jensen, écrivain de langue allemande, publié en 1903, et en rédigea un commentaire publié en 1907 : « Le délire et les rêves dans la « Gradiva » de W. Jensen (Der Wahn und die Traüme in W. Jensens « Gradiva »).
Le sculpteur aima à s’inspirer des statues agenouillées d’Égypte, des statues-couples caractéristiques de la statuaire funéraire. La Nuit (1908-1912) oppose au regard un bloc qui rappelle les sculptures-cubes de l’Antiquité égyptienne. Même quand Maillol représente une femme qui se penche, il dit : « Pour moi c’est une maison » 6. Le rapport de la sculpture à l’architecture est évident : clarté, parallélisme, géométrisme, formes simples telles que recommandées par Paul Valéry dans son Eupalinos ou l’Architecte (1921) 7. En revanche, quand il veut saisir toute l’impétuosité du désir, il bouscule la sculpture française classique si calme, si réglée sur Phidias pour lui donner le souffle épique du combat des Lapithes et des Centaures du fronton du temple d’Olympie qu’il admira en 1908. Tel est le haut-relief du Désir de 1907. La jambe de la femme repousse l’homme, oblitérant celle de l’assaillant. Les membres du couple affronté se saisissent, opposés au sein d’un même schéma ordonnateur.
L’amour au bord des tombes
Au lendemain de la grande boucherie que fut la première guerre mondiale, où les enfants des campagnes peuplées des pays d’Europe furent fauchés, moissonnés par le canon, l’arme technique, la brutalité de l’acier, Maillol fut le sculpteur qui, dans des paysages naturels splendides, leur rendit hommage dans une alliance inusitée, sinon référée à l’Antiquité et au monde païen, de la gravitas et de la voluptas. Les monuments aux morts de Maillol ne sont pas catholiques ; ils viennent d’ailleurs, des Gigantomachies, comme celle de Pergame ; ce héros-là, à Banyuls-sur-Mer, aux muscles bandés, n’est pas mort, et les mères et les fiancées des guerriers morts pour la patrie, à Banyuls (1933) dissimulent avec dignité leur douleur dans des gestes rituels. C’est l’éternel Galate blessé décliné par toute la statuaire antique qui resurgit sous le ciseau de Maillol. Si la confiance en la vie dans la mort reste peut-être encore chrétienne, son expression est égyptienne ou encore hellénique.
On pense à cette lettre de Maillol adressée à Maurice Denis en 1907 : « (…) J’ai vu hier à Paris, une nouvelle salle égyptienne : quelle merveille ! quel art si beau ; quelle belle assurance dans la vie et confiance dans la mort - c’est le soleil ! » 8 La salle des plâtres au musée Maillol à Paris qu’on voit à travers une vitre m’a souvent donné la même impression ambivalente : le soleil d’une brusque remontée du temps passé, pourtant devenu inaccessible. Maillol aimait le Doryphore (vers 440 av. J.-C.) de Polyclète, dont l’historien de la sculpture grecque Claude Rolley disait : « le Doryphore ne marche pas ; il exprime la disponibilité pour tout mouvement, sans être en mouvement » 9
6 Dina Vierny, une vie pour l’art documentaire réalisé par Alain Jaubert, Palette Production, France 3 Sud, avec la participation du CNC, ministère de la Culture et de la Communication (DAP), 2006. Dina Vierny et Alain Jaubert, Histoire de ma vie racontée à Alain Jaubert Paris : Témoins de l’art Gallimard, 2009, p.73.
7 Paul Valéry, Eupalinos ou l’Architecte Paris, Gallimard, 1921.
8 Voir Maurice Denis, « Aristide Maillol », Les Cahiers d’aujourd’hui, Paris : G. Crès, 1921.
9 Claude Rolley, La sculpture grecque : 2, La période classique, Paris, Picard, 1999.
Mais revenons aux monuments de Banyuls, d’Elne, de Port-Vendres, de Céret. Quelque chose de grec et de païen. Et l’alliance du bleu de la Méditerranée et du noir du bronze, de la matité de la pierre. C’est en sculpture l’équivalent de la poésie de Paul-Jean Toulet, se promenant en 1915 en Arles au milieu des Alyscamps, des arbres, des tombes et des senteurs vitales :
« Dans Arle, où sont les Aliscans, Quand l’ombre est rouge, sous les roses, Et clair le temps, Prends garde à la douceur des choses, Lorsque tu sens battre sans cause Ton cœur trop lourd
Et que se taisent les colombes : Parle tout bas si c’est d’amour, Au bord des tombes. » 10
En 1920, Paul Valéry semble s’en souvenir dans son poème : « Le cimetière marin » dont on cite ici la première strophe :
« Ce toit tranquille, où marchent des colombes, Entre les pins palpite, entre les tombes ; Midi le juste y compose de feux
La mer, la mer, toujours recommencée Ô récompense après une pensée
Qu’un long regard sur le calme des dieux ! »
Maillol, dont Gide loua la « beauté silencieuse » des œuvres, trop conscient de la fragilité de la vie -ce que Toulet appelait « la douceur des choses » -, refusa de rompre l’équilibre entre la gravité et la volupté. Comment séparer l’une de l’autre, sauf à forcer le trait, à devenir grossier, ou à l’inverse, amer ou mélancolique ? L’harmonie 11, que recherchait Valéry mais aussi l’Italien Giorgio de Chirico, dans un court texte écrit en français en 1913 titré « le sentiment de la préhistoire », la préhistoire étant en réalité pour lui la Grèce archaïque.
Chirico va tenter de mixer, d’hybrider ces signes du passé profond, largement mythifiés, avec les réalités de son temps, de l’âge moderne. Jusqu’au divorce inévitable et à l’incohérence. Selon le surréaliste André Breton, qui admirait beaucoup ses peintures de cette époque, certaines d’avant la Grande Guerre qui introduisaient des canons et des ombres inquiétantes de statues équestres de chefs de guerre et de militaires, étaient des prémonitions « rigides » et pleines de « terreur » de la guerre de 1914-1918. Il le dit ainsi dans une conférence sur l’ « esprit moderne » à l’Ateneo de Barcelone en 1922.
Les compositions appelées « places d’Italie » du même De Chirico confrontent l’héritage antique ou renaissant -sous la forme de monuments, d’arcades, de palais, de statues d’Ariane- et la modernité machinique : locomotives, cheminées d’usine, camions de déménagement, instruments divers, le tout mêlé dans une atmosphère onirique dont on sent bien qu’elle ne peut avoir cours dans la réalité concrète. C’est l’origine du surréalisme mais la source antique, magique, ne remonte pas par capillarité à l’âge moderne.
10 Paul-Jean Toulet, Romances sans musique, 1915.
11 Harmonie, ce maître-mot pour Maillol si justement mis en exergue dans Antoinette Lenormand-Romain, Ophélie Ferlier-Bouat, Aristide Maillol 18611944, la quête de l’harmonie, catalogue de l’exposition, Paris, Musée d’Orsay, 12 avril au 21 août 2022, Zürich, Kunthaus, 7 octobre au 22 janvier 2023, Roubaix, La Piscine-Musée d’art et d’industrie André Diligent, 18 février au 21 mai 2023, avec le partenariat exceptionnel de la Fondation Dina Vierny - Musée Maillol, Paris, Gallimard, 2022.
Oswald Spengler publie en allemand Le Déclin de l’Occident (Der Untergang des Abendlandes) en 1918 (pour la première partie) et 1922 (pour la seconde). Pour lui, ce qu’il appelle l’Occident, en réalité l’Europe, est passé par trois grandes périodes caractérisées par des attitudes contrastées : apollinienne, puis magique et enfin l’attitude faustienne qui mena l’Europe technicienne et mécanique à la Grande Guerre et à ce « déclin » qu’il dénonce.
A la recherche de l’Age d’or
Maillol est à la recherche d’un monde qu’on est en train de perdre parce qu’on finit par ne plus le voir. Qu’on le perd de vue. Comme d’autres penseurs, écrivains et artistes de sa génération, il a entendu ce cri : « Le Grand Pan est mort » repris par le félibrige Joseph d’Arbaud, disciple de Frédéric Mistral, ami de Joachim Gasquet qui fréquenta Cézanne 12. Dans son roman La Bête du Vaccarès publié en 1926, une étrange créature vit aux alentours de l’étang du Vaccarès en Camargue. Pourchassée, elle subit les brutalités des hommes et les violences de la civilisation moderne. Elle apparaît de moins en moins, avant de disparaître à la fin du roman dans une fondrière, laissant à sa place la simple souche couverte de boue et pourtant desséchée qu’elle était devenue. Cette créature, c’est Pan. Non plus le glorieux Pan de la mythologie, mais le dernier avatar, exsangue et dérisoire, du maître de la végétation et des amours. Pan qui meurt, c’est tout un rapport au corps, à la nature, à la fusion des corps et de la nature ; ce sont de grands rythmes millénaires, ce sont des prophéties, des intuitions, une spiritualité et une proximité entre hommes, nature et bêtes que l’animisme soutenait, qui disparaissent avec lui. Une œuvre de Bouchardon, le Faune endormi (1726 /1730), pourrait être mise en parallèle avec la mort de la créature mythologique. Elle n’est pas sans rapport avec l’érotisme de certaines sculptures de Maillol et avec ses sculptures renversées comme la Rivière : l’alliance d’Éros et de Thanatos.
Dans les premières décennies du XXe siècle, le courant félibrige en Provence, la passion de poètes, d’artistes, d’érudits locaux, d’académies et de sociétés savantes, en pays catalan et ailleurs, ont étudié folklore, langues et traditions. Mais l’ethnographie n’explore que « la beauté du mort » (Michel de Certeau, 1970). Le régionalisme aboutit à « l’invention de la tradition » (Hobsbawm) et parfois même à de franches impostures comme la mythologie forgée de toutes pièces autour des gardians de Camargue. N’est-ce pas le « marquis » Folco de Baroncelli, ami de Mistral, qui mit en scène dans son domaine un supposé mode de vie plein d’honneur et de comportements chevaleresques ? Le tout en harmonie avec la nature, près des Saintes-Maries de la Mer, où furent même tournés des films qui anticipent les westerns des cowboys du Far West.
Mais l’art, quand il n’imite pas, peut seul faire naître le sentiment actuel de la beauté, équivalent à celui qu’en leur temps, certaines périodes d’harmonie ont pu connaître. Autour de la Méditerranée, le noucentisme espagnol avec Josep Clarà, ami de Maillol, le Novecento italien avec Carlo Carrà, le cézannisme et le postimpressionnisme des Signac et autres Cross ont repensé l’Antique à partir du présent de la sensation, de la lumière et de la plénitude des formes se détachant sur l’azur. C’est bien en effet un même rêve de fusion de la modernité et de l’âge d’or de la communion supposée avec la nature qui anime Cézanne que Maillol admira comme un maître, Henri-Edmond Cross, Paul Signac -qu’on pense à son tableau Au temps d’harmonie réalisé en 1895 à Saint-Tropez, aujourd’hui à l’hôtel de ville de Montreuil-, ou encore Maurice Denis, l’ami de Maillol. Faire renaître sur les rives de la Méditerranée, les scènes de l’âge d’or. A l’époque, l’harmonie était recherchée dans l’avenir radieux que promettait l’anarchie, une idéologie à laquelle Maillol jeune, épris de liberté et méfiant avec le pouvoir d’état centralisateur, s’était laissé gagner. Après le pointillisme de Luxe, calme et volupté (1904), Henri Matisse, délégua dans son œuvre Le bonheur de vivre (1906) à quelques groupes de baigneurs qui semblaient sortis d’une peinture de Cézanne et à quelques troupeaux de chèvres dessinées à la hâte, ce soin de revivre l’antique harmonie du monde. Puis ce fut son ami André Derain avec ses Baigneuses Mais ce primitivisme-là peina à convaincre des publics citadins déjà passés à une autre perception de la modernité, faite d’insolites perspectives, de machines volantes, d’hélices d’avion, de transsibérien et de remorqueurs.
12 Joseph d’Arbaud, La Bèstio dóu Vacarés (La Bête du Vaccarès) Paris, Grasset & Fasquelle, 1926.
Le premier numéro de la revue puriste créée par Le Corbusier, Amédée Ozenfant - auteur d’un véritable best-seller en 1928, Artet Paul Dermée, L’esprit Nouveau, paru en octobre 1920 affirmait : « Il y a un esprit nouveau. C’est un esprit de construction et de synthèse guidé par une conception claire. Quoi qu’on en pense, il anime aujourd’hui la plus grande partie de l’activité humaine. » Le 1er janvier 1921, le numéro 10 de cette même revue publie un article signé par Le Corbusier-Saugnier et titré « Des yeux qui ne voient pas … III les autos ». On y lit : « Cette précision, cette netteté d’exécution ne flatte pas qu’un sentiment nouveau, né de la mécanique. Phidias sentait ainsi ; l’entablement du Parthénon en témoigne. De même les Égyptiens lorsqu’ils polissait les pyramides. C’était au temps où Euclide et Pythagore dictaient la conduite de leurs contemporains. » Les tenants de l’art moderne ont en effet espéré en une sorte de fusion de l’antique et de la modernité, espérant que la grâce et la spiritualité de l’Antiquité pourraient imprégner l’époque moderne et adoucir les rigueurs et les brutalités du machinisme et du monde moderne. Le titre de la revue était d’ailleurs emprunté à une conférence qu’avait donnée Apollinaire en 1913. Le purisme, contemporain du futurisme, de dada et du surréalisme, proclamait que la clarté de l’idée et de la forme rendait égaux l’artiste et l’ingénieur, les formes de l’art et celles de l’invention technique. On verra dans cette revue Le Corbusier comparer par exemple l’architecture du Parthénon et le design (la construction) d’une automobile moderne, alors que Marinetti avait en 1909 proclamé dans le Manifeste du Futurisme (1909), on le sait, la supériorité d’une automobile « jetée à pleine vitesse sur l’asphalte » sur la Vénus de Milo.
Pas de voiture, pas de machine dans l’art de Maillol, mais le calcul, l’harmonie, le sens de la proportion associés à la conviction humaniste que présentent les corps modelés, galbés, attirants : « Je cherche l’architecture et les volumes. La sculpture c’est de l’architecture, l’équilibre de masses, une composition avec du goût. Cet aspect architectural est difficile à atteindre. Je tâche de l’obtenir comme l’a fait Polyclète. Je pars toujours d’une figure géométrique, carré, losange, triangle, parce que ce sont ces figures qui tiennent le mieux dans l’espace. » 13
En 1975, Thomas Messer voyait Maillol « en contradiction avec les modes archaïques d’origine africaine et exotique qui dominent notre époque depuis que Picasso a créé les Demoiselles d’Avignon »14. C’est compter sans l’influence de l’art asiatique sur Maillol, marqué, comme Modigliani, par l’art d’Extrême-Orient. Parmi les moulages présentés à l’Exposition universelle de Paris en 1900 qu’il avait récupérés, comme nous l’avons déjà dit -et qu’on voit sur les murs de l’atelier dans de nombreuses photographies, un relief montre un couple divin bouddhique dans une scène d’amour où la femme-danseuse est totalement renversée en arrière, sa tête venant pratiquement toucher le sol. Elle inspire une eau-forte de décembre 1926 titrée « Bacchante » 15. Un autre relief représente Çiva. Le sculpteur avait dit à Judith Cladel : « Les sculpteurs hindous ont fait des statues avec dix bras, mais ces statues ne sont pas agitées » 16. Par ailleurs, le 8 novembre 1910, Maillol disait au comte Kessler à propos du dos de la pierre de Méditerranée : « Cette forme-là est neuve, les Grecs n’ont jamais fait ça, cette forme ronde qui se rapproche de l’art oriental, des Japonais. »17
Giovanni Lista a pu écrire récemment dans La sculpture moderne du primitivisme aux avant-gardes (2018) 18: « Le néoclassicisme est représenté par Aristide Maillol qui utilise le nu féminin comme un signe autosuffisant et autonome, dépourvu de toute narration ou contenu symbolique. Admirateur de Puvis de Chavannes, il en reprend l’approche visant un art d’harmonie, de sérénité et de silence. Ses statues, telles Léda (1902), Méditerranée (1905) ou Flora (1911), sont un ensemble de formes pleines lisses et épurées, qui s’enchaînent et se suivent en continu pour créer une figure désindividualisée et intemporelle.
13 Judith Cladel, Maillol, sa vie, son œuvre, ses idées, Paris, Bernard Grasset, 1937
14 Thomas Messer, « Preface », in cat .exp. Alfred H.Barr, Jr (ed), Masters of Modern Art, New York, MoMA, 1975, p. 5.
15 Marcel Guérin, Catalogue raisonné de l’œuvre gravé et lithographié de Aristide Maillol Tome 2, Les lithographies Les eaux-fortes, Genève, Éditions Pierre Cailler, 1967, n°325.
16 Judith Cladel, op.cit., p.218
17 Cité par Ophélie Ferlier-Bouat, « La Nuit », Aristide Maillol (1861-1944), La quête de l’harmonie Paris, Musée d’Orsay, Gallimard, p.158.
18 Giovanni Lista, La sculpture moderne du primitivisme aux avant-gardes, Paris, Editions Ligéia, 2018, p.57.
Le néoclassicisme historique du XVIIe siècle avait sublimé la chair en vidant de substance le modèle antique. Maillol réussit à réintroduire une plénitude charnelle tout en restant à l’intérieur des paramètres de l’art de la Grèce classique. »
Si l’on ne peut qu’être d’accord avec ce que l’historien d’art italien écrit de la « plénitude charnelle » réintroduite par Maillol, alors que le néo-classicisme était resté purement idéaliste, on doit en revanche réaffirmer que le sculpteur ne se réclame pas de la Grèce classique -n’est donc pas néoclassique-, mais bien davantage, comme nous l’avons dit, de la Grèce archaïque, très proche de ses sources primitives égyptiennes, de ses formes qui tiennent l’équilibre entre l’immobilité architecturale et la suggestion du mouvement, entre l’apparence humaine et la force divine, la gravitas et la voluptas. C’est en cela qu’en sculpture, il se distingue des « modernes néo-classiques » Charles Despiau, Robert Wlérick, Jane Poupelet, Louis-Eugène Dejean ou Henry Arnold.
Maillol a su réinventer la sculpture. Dès 1931, l’historien et philosophe Carl Einstein écrit : « Il possède la rare qualité de travailler sans relâche la forme de façon tactile dans un geste de fluidité dense, tenant partout compte de la forme cubique d’ensemble. » Par ce geste de fluidité dense, Maillol opère le passage de témoin entre la sculpture des Myron, Polyclète et autres Scopas et notre modernité. Rodin n’est que fluide, Medardo Rosso, Lehmbruck également ; Despiau, Bourdelle recherchent la densité. L’œuvre de Maillol seule a cette « fluidité dense », vitale, que l’historien de la sculpture britannique Herbert Read ressentait en ces termes en 1956 : « Un torse de Maillol est une réalité palpable : nous pouvons l’appréhender visuellement, mais l’œil n’est pas flatté, n’est pas flatteur. Les formes sont exprimées à partir d’une profondeur vitale, et nos sensations, si nous en prenons conscience, sont des sensations de poussée, de poids, d’existence solide. »19
Thierry Dufrêne
19 Herbert
of
Washington,
by Maillol is a palpable reality: we may apprehend it visually, but the eye is not pandered to, is not flattered. The forms are expressed from a vital depth, and our sensations, if we become aware of them, are sensations of thrust, of weight, of solid existence.” (notre traduction).
Read, The Art of Sculpture, The A.W.Mellon Lectures in the Fine Arts, 1954, National Gallery
Art,
Bollingen Series XXXV.3, Princeton University Press, 1956, p.87. “A torso
Index
TORSE D’APHRODITE
Romain, Ier-IIe siècle ap. J.-C. Marbre
H. : 51 cm. – L. : 36 cm. – P. : 19 cm.
Provenance :
Ancienne collection européenne depuis le XVIIIe siècle, d’après les techniques de restauration.
Ancienne collection privée new-yorkaise depuis les années 1970. Puis dans une collection belge depuis 2018.
TÊTE D’HOMME CASQUÉ
Romain, Ier-IIe siècle ap. J.-C. Marbre
H. : 48,5 cm. – L. : 20 cm. – P. : 20 cm.
Provenance :
Ancienne collection privée française, Lyon.
Ancienne collection du Dr. Rebatel (1845-1905), Lyon. Puis par descendance.
FRAGMENT DE VÉNUS
Romain, Ier-IIe siècle ap. J.-C. Marbre
H. : 38 cm. – L. : 20 cm. – P. : 15 cm.
Provenance :
Ancienne collection anglaise, acquis à la fin des années 1980.
TORSE DE VÉNUS
Romain, vers le IIe siècle ap. J.-C. Marbre
H. : 30,5 cm. – L. 16 cm. – P. : 9 cm.
Provenance :
Ancienne collection européenne depuis les années 1940 d’après les techniques de soclage. Ancienne collection privée, issu d’une succession et présenté dans une maison de style géorgien située à The Paragon, Bath.
FEMME DRAPÉE
Romain, IIe siècle ap. J.-C. Marbre
H. : 158 cm. – L. : 60,5 cm. – P. : 41 cm.
Provenance :
Ancienne collection européenne depuis le XVIIIe siècle d’après les techniques de restauration.
Ancienne collection du marchand d’art François Antonovitch. Dans sa collection dès les années 1980 d’après les témoignages.
TORSE DE VÉNUS
Grec, Hellénistique, IIe-Ier siècle av. J.-C. Marbre
H. : 25,5 cm. – L. : 9,5 cm. – P. : 8,5 cm.
Provenance :
Ancienne collection privée américaine, New-York, depuis les années 1940 d’après les techniques de soclage.
Ancienne collection privée américaine, New York, acheté dans les années 1990.
TÊTE D’ATHÉNA
Romain, Ier siècle av. J.-C Ier siècle ap. J.-C.
Marbre
H. : 31 cm. – L. : 20 cm. – P. : 18 cm.
Provenance :
Dans une collection européenne depuis le XVIIIe siècle d’après les techniques de restauration.
Puis dans une collection privée anglaise depuis les années 1970 ou 1980.
Transmis par descendance au sein de la même famille.
FRAGMENT DE JAMBES DRAPÉES
Romain, Ier-IIe siècle ap. J.-C.
Marbre
H. : 59 cm. – L. : 60 cm. – P. : 36 cm.
Provenance :
Ancienne collection privée française avant 2000.
FRAGMENT D’UNE MAIN AVEC UNE LANCE
Romain, IIe-IIIe siècle ap. J.-C.
Marbre
H. : 10 cm. – L. : 9 cm. – P. : 6 cm.
Provenance :
Ancienne collection privée anglaise, probablement acheté dans les années 1990.
MAIN GAUCHE
Romain, IIe-IIIe siècle ap. J.-C.
Marbre
H. : 29 cm. – L. : 12 cm. – P. : 8 cm.
Provenance :
Ancienne collection privée parisienne de la rue du Faubourg Saint Honoré, puis par succession dans les années 1990.
CLIPEUS AVEC LE PORTRAIT D’UN JEUNE HOMME
Romain, vers le IIe siècle ap. J.-C.
Marbre
H. : 56 cm. – L. : 55 cm. – P. : 10 cm.
Provenance :
Ancienne collection privée de David Sylvester (1924-2001), Londres.
Vendu chez Sotheby’s, Londres, « The Property of David Sylvester Esq., C.B.E ; Antiquities », 10 juillet 1990, lot 271.
Puis dans une collection privée anglaise, 1990-2014.
Avec Ariadne Galleries, New York et Londres, acquis au précédent.
Puis dans une collection privée américaine depuis 2016.
STATUE D’UN JEUNE SATYRE
Romain, Ier-IIe siècle ap. J.-C.
Marbre
H. : 111 cm. – L. : 45 cm. – P. : 28 cm.
Provenance :
Ancienne collection privée européenne du XVIIIe-XIXe siècle d’après les techniques de restauration.
Vendu chez Sotheby’s, New York, « Antiquities », 17 Décembre 1996, lot 91.
Sur le marché de l’art londonien.
Vendu chez Christie’s, New York, « Antiquities», 10 Décembre 2004, lot 588.
Ancienne collection privée new-yorkaise d’un antiquaire, acquis à la vente précédente.
CHAPITEAU CORINTHIEN
Romain, Ier-IIe siècle ap. J.-C. Marbre
H. : 49 cm. – L : 50 cm. – P. 50 cm.
Provenance :
Ancienne collection privée, Suffolk, jusqu’en 2023.
PANTHÈRE ASSISE
Romain, milieu du IIe siècle ap. J.-C., règne de l’empereur Hadrien (117-138)
Marbre Bigio Antico
H. : 42 cm. – L. : 23 cm. – P. : 35 cm.
Pattes avant, base et oreilles restaurées au XVIIIe siècle
Provenance :
Ancienne collection privée du conte Xavier Branicki (1816-1879), Château de Montrésor, France.
Dans la même famille depuis le début du XIXe siècle.
FRAGMENT DE JAMBE GAUCHE
Travail italien, XVIIe siècle
Marbre
H. : 75 cm. – L. : 51 cm. – P. : 31,5 cm.
Restauration d’une station ancienne
Provenance :
Ancienne collection française du Sud de la France depuis les années 1960. Vendu par la galerie Ginac, 28 rue Ségurane, Nice, en 1999.
Ancienne collection privée de Mme V. T., dans sa résidence parisienne du 8ème arrondissement, acquis au précédent.
SATUE ASSISE D’INEFER
Égyptien, Basse époque, XXVe-XXVIe dynastie Granite d’Assouan
H. : 32 cm. – L. : 25,5 cm. – P. : 11 cm.
Provenance :
Ancienne collection privée de Maurice Nahman (1868-1948), Le Caire. Vendu à l’Hôtel Drouot, Paris, Collection Maurice Nahman, 26-27 février 1953, lot 41. Acquis par Marguerite Bordet (1909-2014), artiste plasticienne, à la fin des années 1990. Puis dans une collection privée parisienne à partir de 1999.
TORSE DE JEUNE HOMME
Romain, vers le Ier siècle av. J.-C. Marbre
H. : 92,5 cm. – L : 40 cm. – P. 25 cm.
Provenance :
Ancienne collection privée de Don Rodolfo Boncompagni Ludovisi (1832-1911), Villa Ludovisi, Rome.
Acquis en 1897 par le Baron Léon de Somzée (1837-1901), Bruxelles.
Vendu par J.Fievez « Collections de Somzée », Bruxelles, 24 mai 1904, lot 24. Acquis par le marchand d’art belge René Withofs (1919-1997), puis par descendance. Ancienne collection privée de 1998 à 2025.
TORSE MASCULIN
Romain, Ier-IIe siècle ap. J.-C.
Marbre
H. : 87,6 cm. – L. 70 cm. – P. : 42 cm.
Provenance :
Ancienne collection européenne depuis le XVIIIe siècle d’après les techniques de restauration.
Acquis par la Merrin Gallery, New York, en 1989. Puis vendu chez Christie’s New York le 9 décembre 2008, lot 150 Puis dans une collection privée jusqu’en 2025.
TORSE DE DIONYSOS
Romain, Ier-IIe siècle ap. J.-C.
Marbre
H. : 55 cm. – L. : 42 cm. – P. 20 cm.
Provenance :
Ancienne collection privée parisienne de M. W., acquis dans les années 1990 et exposé dans sa maison au Touquet.
FRAGMENT D’UNE STATUE D’HERMAPHRODITE
Romain, Ier-IIe siècle ap. J.-C.
Marbre
H. : 33 cm. – L. : 35 cm. – P. : 33 cm.
Provenance :
Ancienne collection privée d’Alain Peyrefitte (1925-1999).
Puis ancienne collection de Françoise Sagan, (1935-2004), donné par elle-même à Mr. X, Paris.
Vendu à Drouot le 13 décembre 2019, lot 157. Puis collection privée anglaise jusqu’en 2025.
ARISTIDE MAILLOL
Torse de l’Île de France ou Jeune fille marchant dans l’eau, 1922
Bronze
H. : 120 cm. – L. : 56 cm. – P. 40 cm.
ARISTIDE MAILLOL
Tête de l’Harmonie (Dina), 1943
Bronze
H. : 25,5 cm. – L. : 20 cm. – P. 20 cm.
ARISTIDE MAILLOL
Nymphe sans bras, 1930
Bronze
H. : 156 cm. – L. : 62 cm. – P. : 46 cm.
ARISTIDE MAILLOL
Petite Nymphe drapée, 1936
Bronze
H. : 29 cm.
ARISTIDE MAILLOL
Baigneuse à la draperie ou Baigneuse drapée ou La Seine (1er état), 1921
Bronze
H. : 179 cm. – L. : 67 cm. – P. : 43 cm.
ARISTIDE MAILLOL
Étude pour le monument à Paul Cézanne (torse), 1912
Bronze
H. : 14 cm. – L. : 15,5 cm. – P. : 5 cm.
ARISTIDE MAILLOL
Jeune femme ou Torse de femme ou Petit nu, vers 1896
Bronze
H. : 28 cm. – L. : 7,5 cm. – P. : 5,8 cm.
ARISTIDE MAILLOL
Les mains, 1930
Bronze
H. : 15 cm. – L. : 9 cm. – P. : 4 cm.
ARISTIDE MAILLOL
La main, 1938
Bronze
:
ARISTIDE MAILLOL
Femme accroupie, 1911
Bronze
ARISTIDE MAILLOL
Flore drapée (avec guirlande de fleurs), 1909
Bronze
ARISTIDE MAILLOL
Jeune fille allongée, 1921
Plomb
ARISTIDE MAILLOL
Torse d’une nymphe, 1931
Bronze
H. : 131 cm.
ARISTIDE MAILLOL
Le jeune homme, 1930
Bronze
H. : 32 cm. – L. 10,5 cm. – P. : 7 cm.
ARISTIDE MAILLOL
Le Couple ou L’homme et la femme, 1896
Bronze
H. : 17 cm. – L. : 16 cm. – P. : 8,5 cm.
Commissaire d’exposition
Simon Porte Jacquemus
Direction artistique et production
Duan Zhang de Courrèges, Romain Cluzel, Sophie Pinet, Guillaume Semerciyan et Emma de Villemandy
Ollivier, Adrien et Gladys Chenel
Alexandre et Pierre Lorquin
Galeries participantes
Galerie Chenel et Galerie Dina Vierny
Graphisme
Adrien Chenel et Alexandra Baltas
Textes
Carole Blumenfeld et Thierry Dufrêne
Photographies
Adrien Chenel
Lieu d’exposition
Collège des Bernardins
Marie Aristide
Imprimé par Burlet Graphics
Aucune partie de cette publication ne peut être transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, y compris la photocopie, l’enregistrement ou tout système de stockage ou de recherche, sans l’autorisation préalable des détenteurs des droits d’auteur et des éditeurs.
Publié en novembre 2025
Edition de 1000 exemplaires.