
ARTICLE 1
Médication soutenue, MIGS, MIBS et implants • Partie IV
ARTICLE 2
L’uvéite non infectieuse • Partie II


ARTICLE 1
Médication soutenue, MIGS, MIBS et implants • Partie IV
ARTICLE 2
L’uvéite non infectieuse • Partie II
Une conception. Deux options.
Faites confiance aux lentilles cornéennes BiofinityMD toric et MyDayMD toric dont la conception torique avancée, l’excellente acuité visuelle6, la bonne stabilité⁷ et l’ajustement fiable7 en font le produit idéal
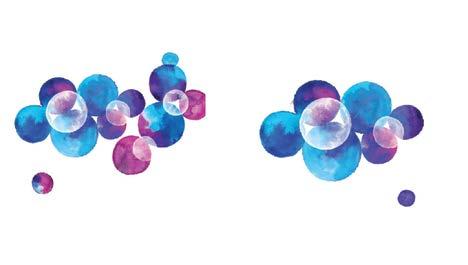
Pour un confort tout au long de la journée, jour après jour.

Lentilles toriques
BiofinityMD toric
Géométrieoptimisée de la lentille toriqueMC TechnologieAquaformMD Convient jusqu’à 99,9 % des patientsastigmates3
Chose certaine, à tous points de vue
CooperVision offre à vos patients astigmates des performances 3,4inégalées
DMmrofauqAeigolonhceT tneivnoC à’uqsuj 9,99
3setamgitsastneitap
eésimitpoeirtémoéG ed al ellitnel CMeuqirot
unique MyDayMD toric

Lentilles toriques à usage



Pour un confort tout au long de la journée, jour après jour.
Faites confiance aux lentilles cornéennes BiofinityMD toric et MyDayMD toric dont la conception torique avancée, l’excellente acuité ,6visuelle la bonne 7stabilité et l’ajustement 7fiable en font le produit idéal pour presque 5tous vos patients astigmates.
Une conception. Deux options.

de se retrouver dans un cours d’eau à l’échelle mondiale. CooperVision achète un nombre de crédits égal au poids du plastique dans les commandes de [claritiMD 1 day/MyDayMD à usage unique, BiofinityMD et MiSightMD 1 day] au cours d’une période précise. Le plastique présent dans les commandes de [claritiMD 1 day/MyDayMD à usage unique, BiofinityMD et MiSightMD 1 day] est déterminé par le poids du plastique dans l’emballage-coque, les lentilles et l’emballage secondaire, y compris les stratifiés, les adhésifs et les ajouts auxiliaires (par exemple, l’encre). 3. Données internes, CVI, 2020. Sondage en ligne mené par Kubik auprès de professionnels de la vue aux États-Unis, en Allemagne, en Espagne, au Japon et en Corée du Sud. Échantillon pondéré total n = 549. Significativement plus élevé que Johnson & Johnson Vision, Alcon et Bausch + Lomb; p<0,05. 4. Données internes, CVI, 2020. Revue sur le rendement tirée de 12 études sur les lentilles cornéennes souples toriques, comprenant les lentilles MyDayMD toric à usage unique BiofinityMD

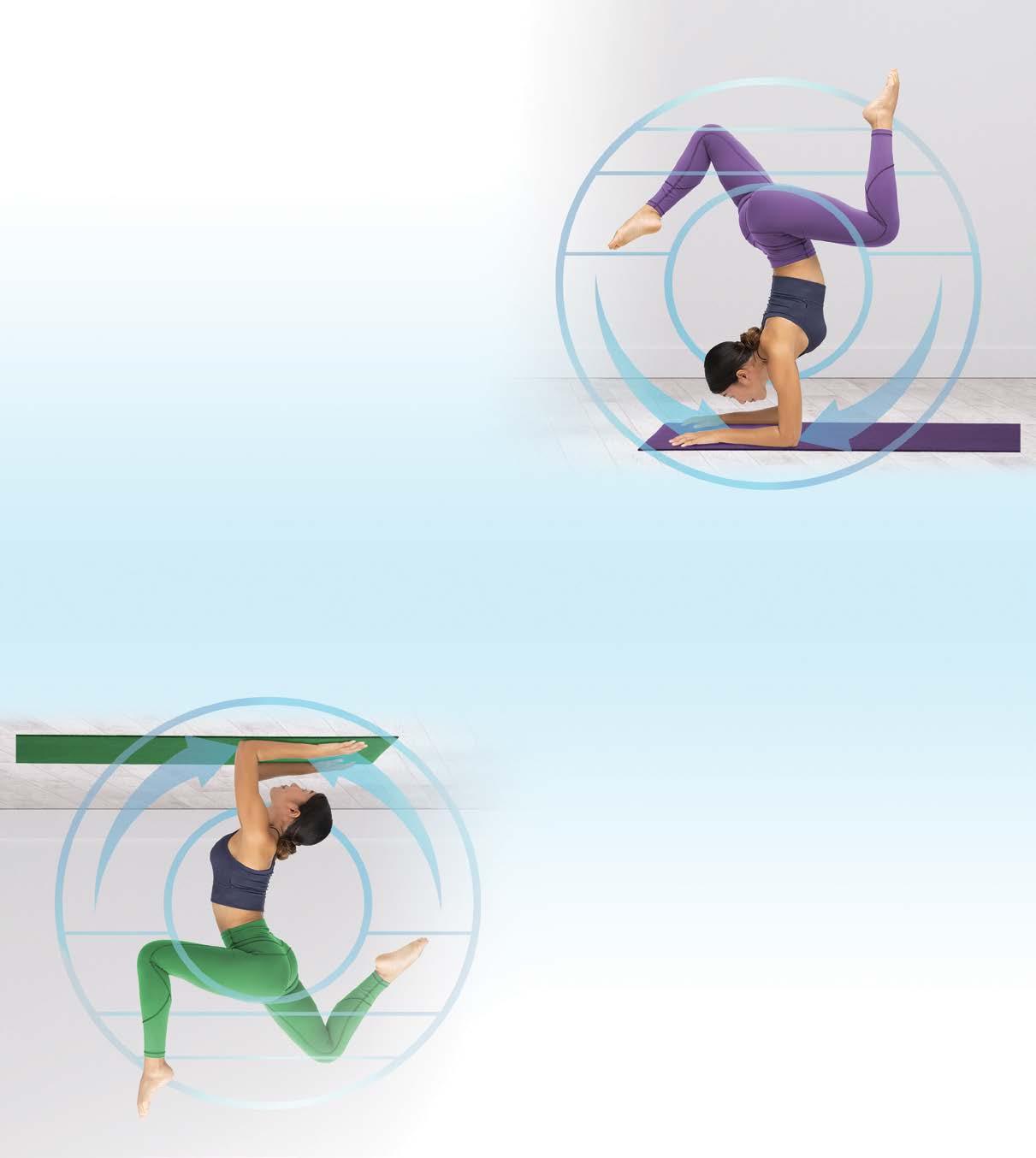

ÉDITEUR
Association des Optométristes du Québec
1255, boul. Robert-Bourassa, bureau 1400
Montréal, Québec H3B 3X1
COURRIEL | aoq@aoqnet.qc.ca
PRÉSIDENT
Docteur Guillaume Fortin, optométriste
ABONNEMENT ANNUEL
CANADA | 85,45 $
ÉTRANGER | 125,00 $ (taxes incluses)
COORDONNATEUR SCIENTIFIQUE
Docteur Jean-Pierre Lagacé, optométriste, M.Sc. COURRIEL | jpierre.lagace@aoqnet.qc.ca
COORDONNATRICE DE LA PRODUCTION
Josée Lusignan | 514 288-6272
COURRIEL | josee.lusignan@aoqnet.qc.ca
PUBLICITÉ
Cynthia Fournelle
CPS Média Inc.
TÉLÉPHONE | 450 227-8414, poste 318 COURRIEL | cfournelle@cpsmedia.ca
CONCEPTION GRAPHIQUE BooDesign.ca
ARTICLES DEMANDÉS
VEUILLEZ ENVOYER VOS ARTICLES À L’ÉDITEUR Revue l’Optométriste 1255, boul. Robert-Bourassa, bureau 1400 Montréal, Québec H3B 3X1
TÉLÉPHONE | 514 288-6272
TÉLÉCOPIEUR | 514 288-7071
COURRIEL | aoq@aoqnet.qc.ca
SITE INTERNET | www.aoqnet.qc.ca
Bibliothèque nationale du Québec 2e trimestre 1979 Reproduction interdite sans autorisation.
LE PRÉSENT NUMÉRO A ÉTÉ TIRÉ À 3 050 exemplaires
ISSN-0708-3173
Numéro de convention postale : 41129579
« L’optométriste (O.D.) est un professionnel de la santé de première ligne, détenteur d’un doctorat universitaire de 5 ans, qui agit comme porte d’entrée des services oculo-visuels. Il évalue la vision, la binocularité et la santé oculaire. Son rôle est de procéder à l’examen des yeux et de la vision. Il peut également prescrire et administrer des médicaments aux fins de l’examen de la vision et du traitement de certaines pathologies oculaires. Il prescrit les lentilles ophtalmiques nécessaires, qu’elles soient cornéennes ou pour lunettes, et des traitements de rééducation visuelle. L’optométriste prodigue des conseils afin de prévenir les troubles visuels et de promouvoir la saine santé oculo-visuelle de ses patients et, au besoin, il peut diriger le patient vers d’autres professionnels de la santé. »
L’Optométriste ouvre ses pages à toute collaboration pouvant intéresser la profession optométrique sur le plan professionnel, social, économique et syndical. Le Comité de rédaction invite tous les optométristes à soumettre le rapport d’un cas ou un article susceptible d’intéresser leurs confrères. Tous les écrits soumis deviennent la propriété de la revue l’Optométriste. Le Comité de rédaction se réserve le droit de publier un article dans le numéro qui lui convient. Aucune indemnité ne sera versée à l’auteur pour l’utilisation d’un article. Les textes ainsi que les publi-reportages publiés dans cette revue n’engagent que leur auteur.


36
CHRONIQUE LES CONSEILS D'AFFAIRES MNP
Les avantages de la tenue de livres et de la comptabilité virtuelle
La sémantique
Docteur Guillaume Fortin, optométriste, Président
08 ARTICLE 1
Médication soutenue, MIGS, MIBS et implants • Partie IV
Docteur Jean-Pierre Lagacé, optométriste, M.Sc.
22 ARTICLE 2
L’uvéite non infectieuse • Partie II
Docteur Jean-Pierre Lagacé, optométriste, M.Sc.
38 CHRONIQUE JURIDIQUE
Les modes de prévention et règlement des différends : régler autrement vos conflits pour économiser temps et argent!
40 CHRONIQUE ACTUALITÉS
52 CHRONIQUE FMOQ
Vente de sa résidence secondaire : comment réduire
sa facture fiscale ?
55 CHRONIQUE LUSSIER
55 Assurance habitation : Bien comprendre le coût de reconstruction
56 Quelles sont les obligations de l’employeur en matière de risques psychosociaux ?
58 LES PETITES ANNONCES CLASSÉES DE L'AOQ


Les nouveaux privilèges de diagnostic accordés aux pharmaciens et infirmières praticiennes spécialisées, voilà un beau sujet qui mérite un peu d’attention ! En effet, bien que nous encouragions tous les efforts en vue d’améliorer l’accessibilité aux soins pour les patients québécois, nous avons reçu dernièrement plusieurs commentaires de la part de nos membres sur ce projet de loi 67. Nous avons entendu l’indignation de certains d’entre vous entre autres sur la question du diagnostic de la conjonctivite par d’autres professionnels. Sachez que nous partageons vos questionnements, car il est évident pour nous qu’il est impossible de faire un diagnostic de conjonctivite sans d’abord une formation solide sur tout ce que peut être un « œil rouge » et sans examen à la lampe à fente. Pour ajouter à une situation particulière, le projet de loi 67 donnera le droit aux IPS et pharmaciens de diagnostiquer une conjonctivite alors qu’« officiellement », les optométristes vers qui les pharmaciens et les infirmières dirigent leurs cas depuis 20 ans n’ont toujours qu’« officieusement » ce droit de diagnostiquer. Nous avions même dû modifier une publicité télé il y a quelques années à la suite d’une plainte de l’Association des ophtalmologistes qui nous demandait de changer le mot diagnostiquer pour « détecter ». Comme quoi les temps changent ?

Mais quelle importance ? Comme optométristes, nous n’avons jamais eu besoin d’un projet de loi pour nous dire que nous avions le droit ou non de diagnostiquer une condition… ce que nous faisons dans nos bureaux n’a rien à voir avec la sémantique, ni avec la politique. C’est nous qui traitons la kératite herpétique diagnostiquée comme conjonctivite il y a 5 jours et qui ne s’améliore évidemment pas. C’est nous qui prenons en charge ces nombreuses conjonctivites virales sous traitement antibiotique inutile depuis 5 jours. C’est nous qui différencions ces conjonctivites virales, allergiques ou bactériennes des uvéites ou épisclérites entre autres. Nous n’avons pas besoin d’un projet de loi pour nous dire merci d’effectuer ce travail depuis 20 ans en officialisant notre droit au diagnostic.
Cela dit, nous sommes convaincus que les IPS et les pharmaciens peuvent et doivent aller aux limites de leur champ de pratique pour aider les patients, mais en ce qui nous concerne, les nouvelles prérogatives ne changeront rien à ce qui se faisait déjà pour tous les cas d’yeux rouges vus d’abord par le pharmacien ou l’IPS et dirigés vers nous par la suite. Ce qui se faisait déjà bien va continuer tout simplement.
Mais la situation n’en est pas moins difficile à avaler pour nos membres qui attendent depuis longtemps des changements simples et qui se font répondre chaque fois qu’il faut rouvrir et pratiquement réécrire l’ensemble de la Loi sur l’optométrie pour éliminer certains détails qui nuisent à la pratique. Le message que nous martelons depuis quelques années est que notre efficacité à désengorger le système est limitée par des listes restreintes de molécules que nous pouvons prescrire. Elle est aussi limitée par un manque d’autonomie professionnelle. Notre efficacité n’est pas limitée par un mot. Le « diagnostic » ne change rien en fin de compte.
Le gouvernement peut bien nous donner le droit de diagnostiquer une infection urinaire s’il le désire, mais n’étant absolument pas habilités pour ce faire, cela ne va jamais désengorger le système ! Ce qu’il nous faut, enfin, c’est la liberté de prescrire toute médication topique ou orale pour les conditions qui nous concernent et une autonomie complète, en particulier en ce qui concerne le glaucome. Parfois, nous entendons un argumentaire basé sur la couverture incomplète des soins optométriques qui serait un frein à ces avancées. En premier lieu, les plus grands bénéficiaires d’un champ de pratique accru et de l’abolition des barrières à la prescription ne seront pas les optométristes, mais bien les patients et, par le fait même, le système de santé. Alors, au gouvernement de faire ses choix. En clair : c’est à l’État de décider s’il veut de notre aide. Nous sommes déjà fort occupés et avons moins besoin de l’aide de l’État que l’inverse. Nous pouvons en faire plus, mais ce n’est pas avec les offres actuelles qui frisent le ridicule que nous accepterons de le faire sous la couverture de la RAMQ. Aussi, est-ce que tout est couvert à la pharmacie ? N’y a-t-il pas des IPS en clinique privée ? Est-ce que les médecins s’empêchent de diriger les patients pour des examens en audiologie ou en podiatrie sous prétexte que la RAMQ ne les couvre pas ? Il faut absolument se sortir de cette pensée qui tourne en rond depuis trop longtemps et arrêter d’associer accessibilité avec gratuité.
Nous recevons déjà plus de 160 000 urgences oculaires par année pour lesquelles le traitement et le suivi sont 100 % privés et cela fonctionne très bien depuis 20 ans ! Avec des rendez-vous partout au Québec en moins de 24 heures, l’urgence oculaire est infiniment plus accessible chez l’optométriste que chez le médecin. Comme quoi gratuité et accessibilité ne s’accordent pas nécessairement. D’ailleurs, nous ne demandons pas de couverture RAMQ pour la portion traitement des urgences oculaires, car nous souhaitons être efficaces et rentables afin de continuer d’offrir le service d’urgence à nos patients.
Les offres gouvernementales actuelles auraient pour effet immédiat le renvoi de ces 160 000 patients dans les salles d’urgence ou vers le fameux GAP… Et à ce sujet, selon la FMOQ, une visite aux urgences coûte 400 $ et nous savons maintenant que la prime aux médecins pour voir un nouveau patient par le GAP sera de 100 $ en plus des honoraires réguliers du médecin…
Enfin, est-ce une bonne chose que d’autres professionnels formés, équipés et compétents puissent aider aux soins oculaires des Québécois en complémentarité avec les optométristes ? Probablement. Mais il serait encore mieux de rendre les experts de la première ligne oculovisuelle plus efficaces ! Pour ce faire et pour le bien de leurs patients, les optométristes ont besoin de latitude et d’autonomie. Qu’on nous donne le « droit » de diagnostiquer n’importe quoi, cela ne changera rien si nous continuons d’être restreints par des règles qui ne tiennent pas compte de la réalité de la pratique optométrique actuelle et, qui plus est, sont en retard de plus d’une décennie sur le reste de l’Amérique du Nord. En attendant, personnellement, je laisserai tous ceux qui le veulent s’amuser avec le mot « diagnostic » pendant que je continuerai de traiter mes patients et de soulager l’hôpital d’autant de cas de corps étranger que je le peux, de trauma, d’uvéite, de décollement du vitré, de décollement de rétine, d’occlusion de la veine centrale de la rétine, d’amaurose fugace et, oui, même… de simple conjonctivite !
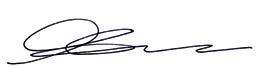
Docteur Guillaume Fortin, optométriste Président
POUR NOUS JOINDRE
514 288-6272
1 888-SOS-OPTO
DES QUESTIONS ?
écrivez-nous à aoq@aoqnet.qc.ca
FAIRE UN CHANGEMENT D'ADRESSE
Rendez-vous sur le portail de l'AOQ | aoqnet.qc.ca


taille de départ supplémentaire à un prix de départ attractif
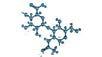


Lubrification forte qui ne compromet pas l'acuité visuelle


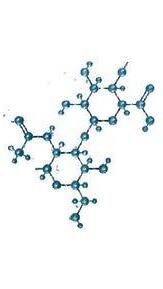
Hyaluronate de sodium de haut poids moléculaire pour une sensation HYLO® inégalée





Haute concentration pour un soulagement fort, immédiat et durable
Commencez vos patients fort!



Implant XEN ab externo
Même si l’utilisation de l’approche ab externo diminue de plus en plus depuis l’avènement de l’approche ab interno (± 4 %), certains chirurgiens l’utilisent encore149
Au fil du temps, les chirurgiens ont développé une approche ab externo de l’implantation du Xen qui élimine les incisions cornéennes pendant l’opération tout en permettant de choisir le meilleur emplacement et même de retirer l’endoprothèse et de la placer une seconde fois si nécessaire. Comme nous ouvrons la conjonctive, nous pouvons appliquer de la mitomycine C (MMC) directement sur la sclérotique, cautériser les vaisseaux, effectuer une ténonectomie si nécessaire et repositionner directement l’endoprothèse si besoin est. L’aiguillage postopératoire de l’hémorragie est moins fréquent150
Après réalisation de l’anesthésie topique, le chirurgien réalise une boutonnière conjonctivale en nasal supérieur. Il imbibe ensuite des petites éponges d’antimitotique (antimétabolite), et les positionne en sous-conjonctival, par la boutonnière, au niveau de la future bulle de filtration. Après 1 à 2 minutes, il lave abondamment la surface oculaire de façon à éliminer le maximum d’antimitotique. Il injecte ensuite le XEN® Gel Stent à 3 mm du limbe, vers la chambre antérieure. Un contrôle gonioscopique permet ensuite de vérifier le bon positionnement du XEN® Gel Stent. La conjonctive est ensuite suturée par deux points de Vicryl 8.0149
Technique ab externo
Voici les étapes de base de l’implantation ab externo
1. Réaliser une péritomie sous-conjonctivale, en interrompant l’insertion de l’endoprothèse de Tenon 1 à 2 mm derrière le limbe pour éviter qu’elle n’enserre l’endoprothèse et n’obstrue le flux postérieur.
2. Créer une poche conjonctivale. Envisager une cautérisation sclérale si cela s’avère utile. Envisager une ténonectomie si le fascia de Tenon semble exceptionnellement épais. Placez deux éponges imbibées de mitomycine dans la poche et retirez-les après 1 à 2 minutes. Les éponges placées directement sur la sclérotique sont bien adaptées pour arrêter la fibrose près de l’endoprothèse et du site d’incision.
3. Utiliser une solution saline équilibrée pour effectuer une hydrodissection de la poche conjonctivale tout en rinçant l'aMMC. Cela favorise la formation de grandes bulles.
4. En utilisant le système d’insertion Xen (le même que celui utilisé pour la mise en place ab interno), injecter l’endoprothèse environ 2 à 3 mm derrière le limbe, en pénétrant dans la chambre antérieure. Veiller à placer l’endoprothèse près de l’iris et suffisamment loin de la cornée pour éviter tout risque de décompensation cornéenne. Une fois l’endoprothèse placée, on peut facilement l’ajuster à l’aide d’une pince.
5. Fermer l’incision avec deux sutures interrompues en nylon 10-0, en veillant à obtenir une fermeture étanche. Le flux est dirigé vers l’arrière et une fuite de l’hématome est possible, mais peu probable.
6. Injecter un antibiotique et un stéroïde150
Potentiel d’une technique transconjonctivale
Une deuxième approche ab externo du Xen se dessine : l’injection transconjonctivale. Elle ne prend que quelques instants et l’injecteur est le seul outil. Avec cette technique, l'aMMC est injectée et l’endoprothèse est placée à travers la conjonctive (en entrant dans la conjonctive 8 mm en arrière du limbe) et entre ensuite dans la sclérotique 2 à 3 mm en arrière du limbe, comme avec la technique ab externo précédente. Si les chirurgiens obtiennent des données montrant que cette technique est viable, sa rapidité et sa simplicité pourraient en faire une bonne option pour les urgences ou pour les patients moins susceptibles de cicatriser, en particulier si elle peut être réalisée au cabinet.
Comparaison des résultats d’une endoprothèse en gélatine de 45 μm placéeab externo avec une conjonctive ouverte et ab externo avec une conjonctive fermée
Objectif : Comparer les résultats d’une endoprothèse en gélatine (XEN45 Gel Stent [XGS]) placée soit ab externo avec conjonctive ouverte (AEO), soit ab externo avec conjonctive fermée (AEF) avec ou sans chirurgie de la cataracte chez des patients atteints de glaucome151
Conception : Étude comparative rétrospective non randomisée.
Participants : Un total de 86 yeux de 86 patients atteints de glaucome qui ont reçu XGS placée soit AEO (N = 49) ou AEF(N = 37) avec ou sans chirurgie de la cataracte entre mai 2019 et avril 2022 au Massachusetts Eye and Ear.
Méthodes : Revue et analyse de 809 visites à partir des dossiers patients d’un centre de triage de niveau 3.
Principaux indicateurs de résultats : Pression intraoculaire (PIO), charge médicamenteuse, taux de réussite de Kaplan-Meier (KM), impact du 5-fluorouracile (5-FU) et complications.
Résultats : Les données démographiques de base étaient similaires dans les deux groupes, à l’exception de la PIO de base et du type de glaucome. Les procédures AEO et AEF ont toutes deux entraîné des schémas significatifs de réduction de la PIO et de la médication depuis le début jusqu’à un an. La procédure AEO a eu des taux de réussite qualifiée (QS) de KM significativement plus élevés que la procédure AEF, mais des taux de réussite complète (CS) similaires. Selon la méthode QS, la probabilité cumulative de survie était de 73 % dans le groupe AEO et de 51 % dans le groupe AEF au mois 6, et de 62 % dans le groupe AEO et de 20 % dans le groupe AEF à l’année 1. Sous CS, la probabilité cumulative de survie était de 41 % dans le groupe AEO et de 37 % dans le groupe AEF au 6e mois, de 29 % dans le groupe AEO et de 14 % dans le groupe AEF à l’année 1.
La procédure AEO a permis une réduction de la PIO significativement plus importante que la procédure AEF à tous les moments postopératoires au-delà de la semaine 2, mais une réduction similaire de la charge médicamenteuse. À la première année postopératoire (POY1), la PIO moyenne a été réduite à 10,72 ± 5,71 mm Hg avec 1,16 ± 1,68 médicament après l’OEA et à 17,03 ± 2,37 mm Hg avec 1,59 ± 1,21 médicament après l’AEF. La phacoémulsification (phaco) n’était pas un facteur significatif, tandis que l’utilisation du 5-FU tendait à devenir significative. La durée de l’intervention était plus longue pour l’OEA XGS autonome.
Conclusions : Nous avons démontré que les deux placements réduisent la médication et la PIO par rapport à la ligne de base, le placement AEO ayant des taux de réussite XGS et un contrôle de la PIO plus favorables aux dépens d’une durée de procédure plus longue et d’une utilisation plus importante de 5-FU.
Drain miniature pour glaucome Ex-PRESS
Le drain pour glaucome Ex-PRESS (fabriquée par Alcon) est un implant miniature biocompatible en acier inoxydable. Il est placé sous un rabat scléral dans la chambre antérieure pour faciliter le drainage et former une bulle, comme dans le cas d’une trabéculectomie traditionnelle. Une aiguille de calibre 25 est utilisée pour pénétrer dans la chambre antérieure au niveau de la ligne grise sous le rabat scléral, suivie de l’insertion de ce dispositif. Comme il n’y a pas de sclérectomie ou d’iridectomie, l’inflammation postopératoire est moindre. Cette trabéculectomie modifiée peut être combinée à une opération de la cataracte. Dans une série de cas comparatifs portant sur 345 yeux, la réussite chirurgicale a été de 94,8 % dans le groupe Ex-PRESS seul (suivi moyen : 25,7 mois, intervalle 1-46 mois) et de 95,6 % dans le groupe Ex-PRESS combiné à l’extraction de la cataracte (suivi moyen : 21,9 mois (intervalle 1,9 -46 mois). Une autre étude rétrospective a révélé des profils d’efficacité et de sécurité similaires entre la dérivation Ex-PRESS et la trabéculectomie standard, bien que le coût de la dérivation Ex-PRESS soit considérablement plus élevé152
Dispositif de filtration du glaucome EX-PRESS : efficacité, sécurité et prévisibilité
L’implantation de l’EX-PRESS est techniquement plus simple que la trabéculectomie, avec moins d’étapes chirurgicales. La récupération de la vision a été plus rapide après l’implantation de l’EX-PRESS qu’après la trabéculectomie152
La variation de la pression intraoculaire est plus faible pendant la période postopératoire précoce, ce qui indique une procédure plus prévisible. Bien que l’efficacité de l’implant EX-PRESS soit comparable à celle de la trabéculectomie, les complications postopératoires semblent moins fréquentes après l’implantation de l’EX-PRESS qu’après la trabéculectomie. Le dispositif de filtration du glaucome EX-PRESS semble être sûr et efficace dans le traitement chirurgical du glaucome à angle ouvert153
Le dispositif de filtration EX-PRESS pour le glaucome (Alcon Laboratories, Fort Worth, TX, É.-U.) a été approuvé en 2002 par la Food and Drug Administration des États-Unis. Il s’agit d’un dispositif de filtration en acier inoxydable, sans valve, conçu pour dériver l’humeur aqueuse de la chambre antérieure vers une bulle de filtration sous-conjonctivale. La biocompatibilité du dispositif a été démontrée pour la première fois sur des yeux de lapin, l’examen histopathologique n’ayant révélé que peu ou pas d’inflammation154. Le dispositif mesure 2,64 mm de long et est disponible avec une lumière interne de 50 ou 200 μm. Conçu à l’origine pour être placé directement sous la conjonctive, le dispositif a d’abord été associée à des complications telles que l’érosion conjonctivale, l’extrusion, l’hypotonie et d’autres effets indésirables155-157. On a modifié le procédé pour placer le dispositif sous un lambeau scléral d’épaisseur partielle, ce qui a largement éliminé le risque d’hypotonie, d’érosion et d’extrusion158. Le placement du dispositif EX-PRESS sous un lambeau scléral d’épaisseur partielle a été largement adopté et est désormais la technique recommandée pour la mise en place du dispositif.
Le dispositif de filtration du glaucome EX-PRESS a été approuvé pour abaisser la pression intraoculaire chez les patients souffrant d’un glaucome non contrôlé, y compris ceux chez qui les traitements médicaux et chirurgicaux conventionnels ont échoué. Le dispositif étant placé dans l’angle de la chambre antérieure, son utilisation est contre-indiquée chez les patients atteints de glaucome aigu à angle fermé. La prudence est de mise chez les patients présentant des angles étroits, à moins que la procédure ne soit combinée à une opération de la cataracte. Cependant, le risque d’occlusion du dispositif est faible en utilisant la version actuelle du dispositif, qui est plus courte que la version originale. Les patients dont l’uvéite est bien contrôlée peuvent être traités, bien que les patients atteints d’uvéite active puissent développer une occlusion du dispositif. Une utilisation prudente du dispositif est recommandée chez les jeunes patients, en raison du peu d’informations sur le suivi à long terme de l’implant159
L’étude initiale de l’implantation de l’EX-PRESS sous un lambeau scléral était une étude non comparative de 24 yeux de patients atteints de glaucome à angle ouvert dont le traitement médical et le traitement chirurgical antérieur avaient échoué158=6. Dans cette étude, la pression intraoculaire a été réduite d’une moyenne de 27,2 ± 7,1 mm Hg en préopératoire à 14,5 ± 5,0 mm Hg à 12 mois (n = 21), et 14,2 ± 4,2 mm Hg à 24 mois (n = 8) en postopératoire, avec P < 0,05 sur tous les points temporels.
Plus récemment, Lankaranian et coll.160 ont réalisé une étude non comparative sur les résultats de l’implant EX-PRESS chez 100 patients atteints de glaucome et ayant des antécédents de chirurgie de la cataracte ou d’échec de chirurgie du glaucome.
Le succès a été défini comme complet si la pression intraoculaire était comprise entre 5 et 21 mm Hg sans médication ni intervention chirurgicale, et qualifié si la pression intraoculaire se situait dans la même fourchette, mais avec un médicament contre le glaucome. Une réussite complète a été constatée chez 60 % des patients et 24 % étaient des réussites qualifiées, avec une baisse de la pression intraoculaire d’une pression intraoculaire préopératoire moyenne de 27,7 ± 9,2 mm Hg à 14,02 ± 5,1 mm Hg lors du dernier suivi.
Les résultats à long terme après l’implantation du dispositif EX-PRESS ont été rapportés dans une étude rétrospective des dossiers de 248 patients traités avec l’implant EX-PRESS161. Cent trente-six yeux (55 %) ont subi une implantation EX-PRESS seule, tandis que 112 yeux (45 %) ont subi une extraction de la cataracte combinée à une implantation EX-PRESS, les résultats des deux groupes étant regroupés. La pression intraoculaire préopératoire moyenne a diminué de 27,63 ± 8,26 mm Hg (n = 248) à 13,95 ± 2,70 mm Hg (n = 95) à 5 ans. Avec une définition du succès complet comme une pression intraoculaire postopératoire de 5-18 mm Hg sans médication contre le glaucome, et un succès qualifié comme la même plage de pression intraoculaire, mais avec ou sans médication, les taux de succès complet et qualifié étaient 83 % et 85 %, respectivement, à 1 an, et 57 % et 63 %, respectivement, à 5 ans de suivi.
Une étude prospective comparative menée par de Jong11 a examiné les résultats de l’EX-PRESS sur 40 yeux par rapport à la trabéculectomie sur 40 yeux. Les patients du groupe EX-PRESS présentaient une réduction de 42,0 % de la pression intraoculaire à 12 mois, tandis que les patients du groupe trabéculectomie présentaient une réduction de 29,3 % (P = 0,05). Le succès complet a été défini comme une pression intraoculaire de 4 à 18 mm Hg sans utilisation de médicaments antiglaucomateux, ce qui a été atteint chez 81,8 % des patients du groupe EX-PRESS et 47,5 % des patients du groupe trabéculectomie (P = 0,002). Les résultats de ces patients après une période de suivi plus longue ont été publiés dans un article ultérieur par de Jong et coll.162
Trente-neuf yeux de chaque groupe de l’étude originale ont été inclus. La tendance à une meilleure réduction de la pression intraoculaire dans le groupe EX-PRESS par rapport au groupe trabéculectomie s’est maintenue jusqu’à l’année 3. Après la troisième année et jusqu’à la cinquième année, la différence de pression intraoculaire entre les deux groupes n’était pas significative. De même, plus de patients ont obtenu un succès complet dans le groupe EX-PRESS que dans le groupe trabéculectomie à 3 ans (66,7 % contre 41,0 %, P = 0,02), mais cette différence n’était plus statistiquement significative à 5 ans (59,0 % contre 46,2 %, P = 0,25). Dans l’ensemble, ces études suggèrent que le contrôle de la pression intraoculaire avec l’implant EX-PRESS est comparable à celui de la trabéculectomie.
Une série rétrospective a comparé 35 procédures EX-PRESS consécutives à 35 procédures de trabéculectomie standard consécutives163. La pression intraoculaire dans le groupe EX-PRESS était plus élevée que dans le groupe trabéculectomie à un an et lors du dernier suivi (P = 0,004 et P = 0,008, respectivement). Cependant, les réductions globales de la pression intraoculaire au dernier suivi étaient similaires, avec une réduction de 45 % dans le groupe EX-PRESS et de 48,45 % dans le groupe trabéculectomie (P = 0,209).
En outre, les taux de réussite n’étaient pas significativement différents entre les groupes. Le succès non qualifié a été défini comme une pression intraoculaire de 5-18 mm Hg et une réduction d’au moins 30 % de la pression intraoculaire sans l’utilisation de médicaments contre le glaucome et un succès qualifié comme la même chose, mais avec médication. Un succès non qualifié a été obtenu dans 77,14 % des procédures EX-PRESS et 74,29 % des trabéculectomies lors du dernier suivi (P = 1,00), et des succès qualifiés ont été constatés dans 5,71 % des yeux EX-PRESS et 8,57 % des yeux trabéculectomisés (P = 0,99).
D’autres études ont révélé des taux de réussite comparables entre les yeux traités par EX-PRESS et ceux traités par trabéculectomie standard. Marzette et Herndon164 ont comparé rétrospectivement 77 yeux traités par trabéculectomie à 76 yeux traités par implants EX-PRESS, et ont inclus les patients qui avaient également subi une phacoémulsification au moment de l’opération. Le succès complet a été défini comme une pression intraoculaire de 5 à 21 mm Hg sans médication supplémentaire ou chirurgie du glaucome, et le succès qualifié comme la même chose, mais avec un médicament contre le glaucome. Le taux de succès global (total et qualifié) n’était pas statistiquement différent entre les deux groupes, avec des taux de succès de 82 % et 71 % dans les groupes EX-PRESS et trabéculectomie, respectivement. Il n’y avait pas de différence statistiquement significative dans le pourcentage de réduction de la pression intraoculaire, avec une réduction moyenne de 42 % dans les deux groupes.
Moisseiev et coll.165 ont également réalisé une étude rétrospective comparant l’EX-PRESS dans 39 yeux à la trabéculectomie dans 61 yeux. Dans cette étude, il n’y avait pas de différence significative dans la réduction de la pression intraoculaire ou dans les taux de réussite entre les deux groupes. Le succès a été défini comme une réduction de 20 % de la pression intraoculaire par rapport à la valeur préopératoire ou une pression intraoculaire inférieure à 20 mm Hg, avec 86,9 % du groupe trabéculectomie et 84,6 % du groupe EX-PRESS ayant obtenu un succès chirurgical.
Les preuves les plus solides de l’efficacité du dispositif EX-PRESS sont rapportées dans des essais cliniques prospectifs randomisés. Un vaste essai prospectif randomisé multicentrique mené par Netland et coll.166 a porté sur 59 yeux traités par l’implant EX-PRESS et 61 yeux traités par trabéculectomie. La pression intraoculaire moyenne était similaire dans les deux groupes au cours du suivi postopératoire, avec une pression intraoculaire moyenne de 14,7 ± 4,6 mm Hg dans le groupe EX-PRESS et de 14,6 ± 7,1 mm Hg dans le groupe trabéculectomie deux ans après l’opération (P = 0,927). Avec un succès défini comme une pression intraoculaire de 5-18 mm Hg avec ou sans médication, et sans autre chirurgie du glaucome, les taux de succès étaient de 90 % et 87 % à 1 an, et 83 % et 79 % à 2 ans dans les groupes EX-PRESS et trabéculectomie, respectivement (P = 0.563).
Une étude prospective randomisée menée par Wagschal et coll.167 a inclus 33 sujets recevant le dispositif EX-PRESS et 31 subissant une trabéculectomie. Après un an, la réduction de la pression intraoculaire était similaire dans les deux groupes, avec une réduction de 47 % dans le groupe trabéculectomie et de 50 % dans le groupe EX-PRESS. La pression intraoculaire moyenne n’était pas significativement différente entre les groupes à toutes les visites.
Un succès complet, défini par une pression intraoculaire comprise entre 5 et 18 mm Hg et une réduction de 20 % de la pression intraoculaire par rapport à la valeur de référence sans médication, a été constaté dans 57 % du groupe trabéculectomie et 70 % du groupe EX-PRESS (P = 0,28), tandis qu’un succès qualifié (même définition, mais avec des médicaments hypotenseurs) a été obtenu par 77 % des patients des deux groupes.
Dans une étude prospective randomisée portant sur 15 patients, Dahan et coll.168 ont comparé la trabéculectomie et l’implantation d’EX-PRESS dans les yeux d’un même patient. Dans cette étude, les yeux traités par implantation d’EX-PRESS présentaient une pression intraoculaire moyenne postopératoire et un nombre de médicaments significativement inférieurs à ceux du groupe trabéculectomie. Les taux de réussite complète (pression intraoculaire de 5 à 18 mm Hg sans médication) étaient plus élevés après l’implantation de l’EX-PRESS qu’après la trabéculectomie (P = 0,0024).
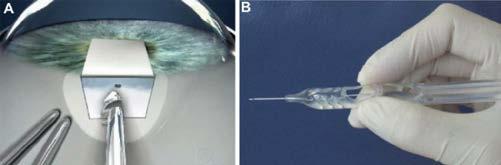
Le dispositif de filtration du glaucome EX-PRESS est placé sous un lambeau scléral d’épaisseur partielle par une aiguille de calibre 25 au niveau du limbe. Remarques : (A) Le dispositif modèle P-50 a un diamètre interne de 50 μm, un diamètre externe de 0,4 mm et une longueur de 2,64 mm. (B) Le dispositif EX-PRESS est préchargé pour l’implantation sur un système de livraison manuel. Images fournies avec l’aimable autorisation d’Alcon inc.
L’un de ces dispositifs, la mini dérivation Ex-Press pour le glaucome, est disponible au niveau international depuis près de 20 ans et a été implanté chez près de 100 000 patients dans le monde. Ce dispositif est conçu pour dériver l’eau de la chambre antérieure vers un réservoir sous-conjonctival. Une trabéculectomie crée un réservoir conjonctival ou une bulle filtrante169
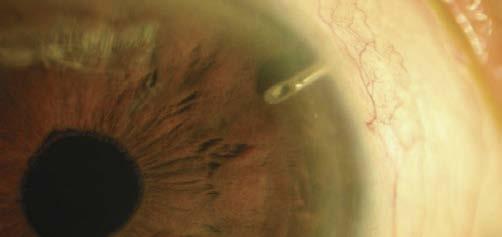
L’implant Ex-Press est un tube en acier inoxydable sans valve qui a été conçu pour améliorer la trabéculectomie standard. La technique chirurgicale ne nécessite pas de sclérostomie ni d’iridectomie. Le dispositif est inséré dans la chambre antérieure sous un volet scléral. Pour que le patient puisse bénéficier de l’implant Ex-Press, il faut qu’il y ait suffisamment d’espace dans l’angle de la chambre antérieure pour que le dispositif puisse être mis en place. Ex-Press est donc contre-indiqué en cas de fermeture aiguë ou chronique de l’angle, d’angle étroit, de microphtalmie et de nanopthalmie.
Drain Ex-Press modèle R-50
Pointe biseautée pour une insertion facile

Drain Ex-PRESS modèle P50/200
Canal vertical pour l'écoulement postérieur

Après l’implantation du dispositif Ex-Press, l’eau est dirigée vers un réservoir sous-conjonctival, de manière similaire aux résultats de la trabéculectomie, sans ablation de la sclérotique ou de l’iris, selon des études publiées récemment dans l’International Journal Ophthalmology170 et le Journal of Ophthalmology171
Une revue systématique et une méta-analyse publiées récemment dans l’International Journal of Ophthalmology170 ont montré que la trabéculectomie et le dispositif Ex-Press présentaient une efficacité équivalente dans la réduction de la PIO. Cependant, l’Ex-Press était associé à un risque plus faible d’hypotonie et d’hyphéma que la trabéculectomie.
Cette analyse a porté sur 11 études comparant l’efficacité de l’Ex-Press à celle de la trabéculectomie. L’efficacité de l’Ex-Press s’est avérée similaire à celle de la trabéculectomie en ce qui concerne la réduction de la PIO à un an et à deux ans de suivi. (P = 0,50 et différence moyenne pondérée [DMP] : 2,89; intervalle de confiance à 95 % [IC] : -8,05-13,83; P = 0,60, respectivement).
L’implantation du dispositif Ex-Press a été associée à un taux de succès complet et qualifié significativement plus élevé (odds ratio [OR] : 1,59; IC à 95 % : 1,07-2,35; P = 0,02 et OR : 1,74; IC à 95 % : 1,06-2,86; P = 0,03, respectivement).
La fréquence de l’hypotonie et de l’hyphéma était significativement plus faible après la procédure d’implantation d’Ex-Press qu’après la trabéculectomie (OR : 0,39; IC à 95 % : 0,21-0,72; P = 0,003 et OR : 0,27; IC à 95 % : 0,10-0,69; P = 0,003, respectivement).
Cibler le canal de Schlemm Viscocanalostomie
La viscocanalostomie est une procédure non pénétrante visant à augmenter la facilité d’écoulement en créant des changements morphologiques significatifs au niveau du réseau trabéculaire. Il s’agit d’une procédure efficace pour abaisser la pression intraoculaire (PIO) dans les yeux glaucomateux à angle ouvert. Par rapport à la trabéculectomie, les études de méta-analyse ont montré que les PIO finales sont significativement plus élevées. Néanmoins, la viscocanalostomie est une technique plus sûre qui présente beaucoup moins de complications que la trabéculectomie.
La viscocanalostomie est donc une meilleure option dans les yeux où les PIO cibles se situent dans la moyenne haute, ou dans les yeux présentant un risque élevé de complications avec la trabéculectomie172
Technique opératoire
La viscocanalostomie est une technique chirurgicale exigeante qui nécessite une longue courbe d’apprentissage173 Tout d’abord, un lambeau conjonctival basé sur le fornix est créé. Ensuite, un lambeau parabolique externe de 5 x 5 mm, d’une épaisseur d’environ 200 μm, est disséqué, suivi d’un lambeau scléral interne concentrique de 4 x 4 mm sculpté sous le précédent. Le lambeau interne doit être disséqué assez profondément pour avoir un réflexe sombre de la choroïde sous-jacente. Pendant que la coupe est avancée vers l’avant, le canal de Schlemm est désobstrué. Les deux ostia du canal de Schlemm sont ensuite canulés avec la canule spécifique de 190 μm et le canal de Schlemm est dilaté par des injections lentes et répétées de hyaluronate de sodium de haut poids moléculaire. Lors d’une canaloplastie, la dilatation du canal de Schlemm se fait par cathétérisme de toute la longueur du canal à l’aide d’un microcathéter et par libération contrôlée de hyaluronate de sodium de poids moléculaire élevé à l’intérieur de tout le canal. Une suture en polypropylène 10-0 est ensuite passée à l’intérieur du canal et, à travers une boucle de suture, serrée pour distendre le réseau trabéculaire vers l’intérieur en mettant le tissu en tension.
En tirant doucement le volet scléral interne vers le haut et en appuyant délicatement sur le fond du canal et la membrane de Descemet avec la pointe d’un coton-tige, la membrane elle-même est alors séparée de la cornée et le clivage est avancé dans la cornée claire sur environ 1 mm, créant ainsi ce que l’on appelle la « fenêtre trabéculo-descemétique ». Dès que la fenêtre est terminée, le volet scléral interne est excisé. L’étape suivante consiste à sceller le lac en suturant fermement le volet scléral externe à l’aide de sept points de nylon 10-0. Du hyaluronate de sodium de haut poids moléculaire est ensuite injecté sous le rabat pour remplir temporairement l’espace intrascléral et éviter qu’il ne s’effondre et ne se cicatrise au début de la période postopératoire. Enfin, la conjonctive est suturée en place.
La viscocanalostomie augmente l’écoulement aqueux par différentes voies. L’injection de viscoélastique dans le canal dilate non seulement le canal et les collecteurs associés, mais perturbe également les parois internes et externes du canal de Schlemm et les couches trabéculaires adjacentes, augmentant ainsi la facilité d’écoulement trabéculaire et faisant en sorte que la procédure agisse comme une « micro-trabéculotomie »174. La facilité d’écoulement de l’eau est également augmentée par la lésion de la paroi interne du canal de Schlemm et du trabéculum adjacent sur le site de l’opération, ce qui favorise l’écoulement de l’eau dans le lac scléral. À partir de là, l’eau peut quitter l’œil par trois voies différentes :
par les extrémités coupées et les secteurs précédemment non fonctionnels du canal de Schlemm vers les canaux collecteurs;
par filtration externe dans l’espace sous-conjonctival;
par absorption dans l’espace sous-choroïdien.
La filtration externe et les saignées filtrantes sont rares dans la viscocanalostomie et ne peuvent être détectées que par biomicroscopie ou par biomicroscopie ultrasonique dans un tiers des yeux175. Une zone hypoéchogène supraciliaire, suggérant un drainage aqueux dans l’espace sous-choroïdien, a été mise en évidence par biomicroscopie ultrasonore176. Dans les yeux présentant une PIO élevée après une intervention chirurgicale, une petite ouverture de la membrane trabéculo-descemétique peut être réalisée à l’aide d’un laser à grenat d’yttrium et d’aluminium dopé au néodyme (Nd:YAG). Cette procédure, appelée « goniopuncture au laser », améliore la filtration externe, modifiant ainsi le mécanisme d’action de base de la viscocanalostomie, et est indiquée dans les yeux où la dilatation du canal de Schlemm n’a pas suffi à augmenter de manière significative la facilité d’écoulement trabéculaire. Le taux de goniopuncture au laser varie selon les études sur la viscocanalostomie de 45 à 33 %177. Dans une étude plus large sur la canaloplastie (une procédure avec une dilatation bien contrôlée du canal de Schlemm), la nécessité d’une goniopuncture n’était que de 4,7 %178
Résultats : La viscocanalostomie est une procédure efficace pour abaisser la PIO avec un bon profil de sécurité. Elle présente peu de complications, une gestion postopératoire facile et induit beaucoup moins de gêne oculaire que la trabéculectomie, comme on peut s’y attendre compte tenu de l’absence de la bulle filtrante dans la majorité des cas.
Par rapport à la trabéculectomie, même si de nombreuses études ne parviennent pas à trouver des différences significatives entre les procédures, les PIO finales semblent être plus élevées après la viscocanalostomie. Contrairement à la trabéculectomie (qui entraîne généralement des PIO dans les dizaines inférieures), les PIO après la viscocanalostomie se situent dans la plage normale (c’est-à-dire dans les dizaines supérieures). Cela peut s’expliquer par le mécanisme d’action de la viscocanalostomie, qui repose sur l’augmentation de la facilité d’écoulement à travers le réseau trabéculaire.
Une comparaison directe entre les différentes études visant à comparer la viscocanalostomie à la trabéculectomie est difficile, car les critères de réussite, la durée du suivi et les techniques sont différents. De nombreux articles traitent également de la viscocanalostomie et de la chirurgie de la cataracte combinées. En 2001, Jonescu-Cuipers et coll. 179 , ont montré à six mois un taux de succès complet (PIO <20 mm Hg) de 0 % après viscocanalostomie et de 50 % après trabéculectomie sur 20 yeux. En 2002, le même groupe de recherche9 a réalisé une étude sur 60 patients et a constaté qu’un an après la viscocanalostomie ou la trabéculectomie, 30 % des patients ayant subi une viscocanalostomie présentaient une PIO <22 mm Hg sans médication, contre 56,7 % des patients ayant subi une trabéculectomie180
La viscocanalostomie a montré beaucoup moins de complications que la trabéculectomie. O’Brart et coll.181=10 ont montré un taux de réussite à un an (PIO ≤ 21 mm Hg sans médication) de 100 % après trabéculectomie avec antimétabolites et de 64 % après viscocanalostomie. Toutes les viscocanalostomies n’ont pas été réalisées selon le protocole standard, car le canal de Schlemm n’a été dilaté à l’aide d’un viscoélastique que dans la moitié des cas. Dans un essai contrôlé randomisé de 24 mois comparant la viscocanalostomie à la trabéculectomie, Carassa et coll.175 ont rapporté des niveaux de PIO finaux similaires de 16,3 ± 5,1 mm Hg après la viscocanalostomie et de 14,0 ± 4,6 mm Hg après la trabéculectomie.
De plus, aucune différence significative n’a été trouvée entre les deux procédures avec des objectifs de PIO de ≤ 21 mm Hg (76 contre 80 %) ou < 16 mm Hg (56 contre 72 %) sans médication. Le groupe trabéculectomie a eu plus de complications, a nécessité un nombre significativement plus élevé de visites postopératoires avec plus d’interventions supplémentaires (comme des aiguilles ou des injections de 5-fluorouracil). À 12 mois, les patients ayant subi une viscocanalostomie ont rapporté moins de gêne oculaire que les patients ayant subi une trabéculectomie.181
La canaloplastie est une procédure non pénétrante qui utilise la technologie des microcathéters. Pour réaliser une canaloplastie, une incision est pratiquée dans l’œil afin d’accéder au canal de Schlemm de la même manière qu’une viscocanalostomie. Un microcathéter contourne le canal autour de l’iris, élargissant le canal de drainage principal et ses petits canaux collecteurs grâce à l’injection d’un matériau stérile, semblable à un gel, appelé viscoélastique. Le cathéter est ensuite retiré et une suture est placée dans le canal et serrée. L’ouverture du canal permet de réduire la pression à l’intérieur de l’œil. La canaloplastie présente deux avantages principaux par rapport aux chirurgies traditionnelles du glaucome. Le premier de ces avantages est un profil de sécurité amélioré par rapport à la trabéculectomie. Comme la canaloplastie ne nécessite pas la création d’un saignement, les risques importants à long terme tels que l’infection et l’hypotonie (pression oculaire extrêmement basse) sont évités. Le deuxième avantage principal est que lorsque la canaloplastieest combinée à une opération de la cataracte, la PIO est encore plus réduite que lorsqu’elle est effectuée seule182. Des résultats à long terme (trois ans) ont été publiés aux États-Unis182 et en Europe183, démontrant une réduction significative et durable de la pression oculaire et du nombre de médicaments nécessaires au contrôle du glaucome. La canaloplastie est une modification de la viscocanalostomie, une forme de chirurgie non pénétrante du glaucome. Dans cette technique plus ancienne, introduite pour la première fois par Stegman et ses collègues184, l’OVD était injecté dans le CS de part et d’autre d’un site de dissection sclérale externe à l’aide d’une canule métallique. La canule, parce qu’elle n’était pas flexible, ne pouvait être étendue dans le CS que sur une distance limitée et ne pouvait donc dilater qu’une partie limitée du canal, de part et d’autre du site de dissection. L’injection d’OVD provoquait une augmentation des dimensions du CS, entraînant des microruptures dans la paroi interne du canal, ainsi que dans la MT adjacente. Cela créait une connexion directe entre la chambre antérieure et la lumière du canal. Les volets scléraux créés pour découvrir le CS étaient suturés de manière étanche afin d’éviter la formation d’une bulle filtrante. Comparée à la trabéculectomie, la viscocanalostomie s’est avérée être une procédure très sûre avec moins de complications, mais sa réduction de la PIO était inférieure185. Son efficacité à long terme a été décevante, probablement en raison d’une éventuelle fermeture du CS dans la période postopératoire186
La canaloplastie présente l’avantage de pouvoir dilater le CS sur toute sa longueur à l’aide d’un microcathéter flexible187. Elle présente également l’avantage d’utiliser une suture de tension permanente qui reste dans le CS pour maintenir sa dilatation au fil du temps. Koerber a rapporté une comparaison entre une canaloplastie réalisée dans un œil et une viscocanalostomie dans l’œil controlatéral.
Les yeux ayant subi une viscocanalostomie avaient une PIO postopératoire de 16,1 ± 3,9 sous 0,4 ± 0,5 médicament, avec 35,7 % de succès complet et 50 % de succès non qualifié. En revanche, les yeux ayant subi une canaloplastie avaient une PIO de 14,5 ± 2,6 sous 0,3 ± 0,5 médicament avec 60 % de succès complet et 86,7 % de succès qualifié188
La canaloplastie présente plusieurs avantages par rapport à la trabéculectomie. Dans la plupart des cas, tant que la goniopuncture n’est pas pratiquée, il n’y a pas de saignée et les complications liées à la saignée sont donc évitées. L’hypotonie et toutes les complications qui y sont liées peuvent également être évitées dans la plupart des cas puisque l’aqueux est autorisé à s’écouler via le système d’écoulement naturel, de sorte que la PIO ne devrait pas pouvoir tomber en dessous de la pression veineuse épisclérale. Les soins postopératoires et le suivi sont également plus simples et moins rigoureux, et la récupération visuelle est généralement plus rapide. Cependant, la canaloplastie est également une opération plus difficile sur le plan technique que la trabéculectomie et ne permet généralement pas d’obtenir une PIO aussi basse. Elle laisse également une cicatrice sur la conjonctive, ce qui peut augmenter le risque d’échec de la trabéculectomie dans le futur, si elle s’avérait nécessaire.
Résultats : Lewis et ses collègues ont rapporté les résultats à 3 ans d’un essai multicentrique portant sur 157 yeux ayant bénéficié d’une canaloplastie ab externo. La PIO préopératoire était de 23,8 ± 5 sous 1,8 ± 0,9 médicament. La PIO postopératoire globale à 3 ans était de 15,2 ± 3,5 sous 0,8 ± 0,9 médicament, ce qui représente une réduction de 36,1 % de la PIO. Un sous-ensemble de 36 yeux ayant subi une chirurgie de la cataracte en même temps qu’une canaloplastie a obtenu des résultats significativement meilleurs avec une PIO de 13,6 ± 3,6 (une réduction de 42 %) sous 0,3 ± 0,5 médicaments189
La canaloplastie est considérée comme plus sûre que la trabéculectomie, mais elle est aussi généralement considérée comme moins efficace en ce qui concerne la réduction de la PIO. Tam et ses collègues ont remis en question cette notion, en montrant que dans certaines circonstances, la canaloplastie peut donner des résultats tout à fait comparables à ceux de la trabéculectomie. Dans leur comparaison rétrospective de 101 yeux, 50 recevant une canaloplastie et 51 recevant une trabéculectomie, ils ont rapporté des résultats égaux en matière de PIO et d’utilisation de médicaments. La cohorte de canaloplastie est passée d’une PIO préopératoire de 26,4 ± 6,5 avec 3,6 ± 0,9 médicaments à une PIO postopératoire de 13,4 ± 2,7 avec 0,6 ± 1,1 médicament. La cohorte de trabéculectomie est passée d’une PIO préopératoire de 26,8 ± 8,1 sous 3,6 ± 1,1 médicaments à une PIO postopératoire de 12,3 ± 3,5 sous 0,7 ± 1,3 médicament190
Les résultats chirurgicaux de la technique abinterno ont été rapportés par Gallardo en 2021191. Dans cette série de cas rétrospective, comparative et consécutive de 53 patients ayant subi une canaloplastie iTrack en tant que procédure autonome ou en combinaison avec une chirurgie de la cataracte, la pression intraoculaire a été réduite de 20 +4,9 mm Hg au départ à 13,6 +1,9 mm Hg après 24 mois de suivi, respectivement (P < 0,001). Cela s’est traduit par une réduction significative de l’utilisation de médicaments topiques à la fois dans le groupe de traitement autonome et dans le groupe de traitement combiné. Cette technique ab interno n’a donné lieu à aucun événement indésirable grave ni à aucune complication.
La canaloplastie nécessite l’utilisation d’un microcathéter flexible de 200 μm de diamètre avec une pointe sans traumatisme émoussée de 250 μm (iTrack, Nova Eye Medical Limited, Adelaide, Australie). Ce microcathéter possède une lumière interne pour l’injection de l’OVD. L’OVD est injecté via une seringue à vis qui permet d’injecter des aliquotes précises. Le microcathéter est également doté d’une fibre optique pour transmettre la lumière et est généralement utilisé avec l’illuminateur à fibre optique iLumen (Nova Eye Medical Limited, Adelaide, Australie) qui fonctionne sur batterie et qui permet à l’extrémité du microcathéter de briller en rouge ou de clignoter pour indiquer sa position dans le CS au cours de la procédure.
1. La canaloplastie peut être réalisée sous anesthésie sous-conjonctivale, sous-ténonienne ou rétrobulbaire.
2. Une péritomie conjonctivale basée sur le fornix est réalisée.
3. Un lambeau scléral superficiel d’environ 5 mm sur 5 mm est créé.
4. Un lambeau scléral profond de 4 mm sur 4 mm est ensuite créé dans les limites du lambeau superficiel, en disséquant jusqu’à 50 microns de la choroïde. Cette dissection est poursuivie jusqu’à la cornée claire. La ligne de Schwalbe est soigneusement détachée. Le lambeau interne est ensuite amputé et une large fenêtre trabéculo-descemétique de 500 microns est créée.
5. Le CS est localisé et désoperculé. Une paracentèse est créée. Le microcathéter est avancé à 360° autour du CS. La fibre optique qui éclaire l’extrémité du microcathéter permet de guider la trajectoire du cathéter au fur et à mesure de son avancement.
6. Lorsque l’extrémité distale du cathéter réapparaît au niveau du site chirurgical, une suture en polypropylène 9-0 (Prolène) y est attachée et le microcathéter est retiré à travers le canal. Toutes les deux heures d’horloge, une quantité précise d’OVD est injectée dans le CS via l’injecteur à vis. Il faut veiller à ce que le cathéter soit en mouvement perpétuel dans le CS lorsque l’OVD est injecté afin d’éviter la création d’un décollement de Descemet. Le microcathéter tire la suture Prolene autour du canal après lui.
7. Lorsque le microcathéter a complètement dégagé le canal, la suture Prolene est détachée du cathéter. La suture est ensuite serrée pour appliquer une tension modérée à long terme sur les tissus de la paroi interne du canal de Schlemm. Certains chirurgiens peuvent choisir de fixer un greffon d’espacement dans l’espace du volet scléral, comme cela se fait dans la sclérectomie profonde, pour permettre la formation d’un lac aqueux intrascléral.
8. Le volet scléral est ensuite fermé hermétiquement avec une suture en nylon 10-0 si on ne souhaite pas la formation d’une bulle. Sinon, le volet peut être laissé libre pour permettre une filtration sous-conjonctivale douce, comme lors d’une sclérectomie profonde.
9. La conjonctive est ensuite fermée192
Cibler le corps ciliaire
CW-TSCPC (cyclophotocoagulation transsclérale à ondes continues)
MP-TSCPC (traitement au laser transscléral à micropulsations)
Le traitement du glaucome réfractaire comprend une variété de procédures cyclodestructrices. La première procédure cyclodestructrice au laser a été réalisée par Beckman et ses collègues en 1972, et depuis lors, plusieurs autres procédures cyclodestructrices ont été mises en œuvre (voir le tableau ci-dessous).
An Auteur Type de Laser
1989 Brancato et coll.193
1992 Gaasterland et coll.194
1992 Uram195
2010 Tan et coll.196
Neodymium:yttrium-aluminum-garnet (Nd:TAG) laser (1 064 nm)
Laser à diode semi-conductrice (810 nm)
Cytophotocoagulation endoscopique
Laser à diode à micropulsations
La cyclophotocoagulation transsclérale traditionnelle par diode (TSCPC), ou cyclophotocoagulation transsclérale par diode à onde continue (CW-TSCPC), a été largement utilisée depuis qu’elle a été mise au point dans les années 1990. Dans ces procédures, un laser à diode cible et détruit l’épithélium pigmenté du corps ciliaire, diminuant ainsi la production d’humeur aqueuse. Cependant, le laser délivré à une dose continue entraîne souvent des dommages collatéraux importants aux tissus, contribuant à de graves complications, telles que l’uvéite, la perte de vision, l’hypotonie chronique, le décollement de la choroïde et, plus rarement, la phtisie bulbeuse et l’ophtalmie sympathique.
La cyclophotocoagulation transsclérale à diode par micro-impulsions (MP-TSCPC) a donc été mise au point ces dernières années comme une approche de rechange, potentiellement plus sûre, de la cyclodestruction.
La principale différence entre la MP-TSCPC et la TSCPC traditionnelle est que la MP-TSCPC délivre une série d’impulsions courtes et répétitives d’énergie alternant avec des périodes de repos entre les impulsions. On pense que cela permet une « période de refroidissement » avec une dissipation thermique entre les impulsions, ce qui réduit potentiellement les dommages collatéraux aux tissus.
Indications
La MP-TSCPC a été principalement utilisée pour abaisser la pression intraoculaire dans les cas de glaucome réfractaire. Alors que la TSCPC traditionnelle n’est généralement utilisée que dans les cas réfractaires avec un faible potentiel visuel, la MP-TSCPC peut également être utilisée dans les yeux qui voient et qui ont un bon potentiel visuel.
La MP-TSCPC peut être pratiquée sur des yeux qui ont déjà subi une chirurgie incisionnelle du glaucome, telle qu’une trabéculectomie, une chirurgie de dérivation tubulaire, une dérivation de régulation de pression excessive, une dérivation de glaucome miniature (Alcon, Fort Worth, TX), ou une combinaison de ces interventions197. La procédure convient bien aux jeunes (plus de 45 ans) et aux personnes plus âgées (plus de 65 ans).
Aucune conclusion définitive n’a été tirée concernant l’adéquation ou l’efficacité par rapport à d’autres facteurs démographiques tels que l’appartenance ethnique du patient.
Diverses études ont démontré que la MP-TSCPC est à la fois sûre et efficace dans le traitement de divers sous-types de glaucome, y compris le glaucome primaire à angle ouvert (POAG), le glaucome par pseudo-exfoliation, le glaucome néovasculaire, le glaucome chronique par fermeture de l’angle, le glaucome à tension normale, le glaucome uvéitique et d’autres glaucomes secondaires198-200
En outre, la MP-TSCPC est de plus en plus considérée comme une thérapie précoce pour les yeux glaucomateux, ou même chez les personnes chez qui on soupçonne un glaucome200=8, comme un complément potentiel ou un traitement de rechange à la trabéculoplastie au laser, ou pour les patients qui ne sont pas de bons candidats pour une chirurgie incisionnelle du glaucome. La MP-TSCPC peut également être répétée dans les yeux qui n’ont pas obtenu de résultats satisfaisants après le traitement initial, bien qu’il y ait peu de preuves disponibles sur les résultats du retraitement201
Technique chirurgicale
La MP-TSCPC est généralement réalisée sous anesthésie surveillée et avec un bloc rétrobulbaire ou péribulbaire de 3 à 5 ml de lidocaïne à 2 %. L’instrument couramment utilisé est le système laser Cyclo G6® Glaucoma avec le dispositif MicroPulse P3® Glaucoma (Iridex Corporation, Mountain View, CA). Plus de vingt articles évalués par des pairs ont fait état de données concernant l’utilisation de ce dispositif. Après l’anesthésie, la sonde laser à diode de 810 nm est placée perpendiculairement au limbe, tout en maintenant un contact ferme à tout moment. La sonde est réglée sur le mode d’émission de micropulsations avec des temps d’activation et de désactivation spécifiés. Le rapport cyclique est de 31,3 %, soit un temps d’activation de 0,5 ms et un temps de désactivation de 1,1 ms par cycle. Bien que 2 000 mW soit la puissance la plus couramment utilisée, diverses études ont fait état de réglages allant de 1 600 mW à 2 500 mW. Jusqu’à présent, il n’existe pas de protocole normalisé pour les paramètres de cette technique chirurgicale, et les réglages et la technique varient généralement en fonction des préférences du chirurgien201, 202. Cinq paramètres modifiables, la durée totale du traitement et la puissance, la zone traitée, la position de la sonde et la vitesse du mouvement de balayage, peuvent influencer le résultat clinique de cette technique. En règle générale, le chirurgien déplace la sonde d’un mouvement continu de balayage,ou rapide, de glissement ou de « peinture » ou lent sur le limbe supérieur et/ou inférieur (180 ou 360) de l’œil, en évitant les positions 3 et 9 heures afin de protéger les structures neurovasculaires ciliaires d’une lésion. Les bulles kystiques et autres zones de conjonctive fine doivent être évitées. La durée totale du traitement a varié entre 100 et 360 secondes par séance dans les études rapportées et, dans de nombreux cas, elle est choisie en fonction des préférences du chirurgien. Il n’existe pas de consensus sur la durée idéale du traitement, bien qu’une durée plus longue puisse être associée à une plus grande probabilité d’événements indésirables197. Preda et ses collègues203 ont effectué la technique avec différentes durées de traitement au laser en fonction de la gravité des pressions intraoculaires des patients :
Groupe 1 : pression intraoculaire < 26 mm Hg pendant 80 secondes;
Groupe 2 : pression intraoculaire entre 26 et 30 mm Hg pendant 100 secondes;
Groupe 3 : pression intraoculaire entre 31 et 49 mm Hg pendant 120 secondes;
Groupe 4 : pression intraoculaire > 50 mm Hg pendant 130 secondes.
Bien que le taux de réussite varie d’un groupe à l’autre, au moins 60 % des patients ont obtenu une réduction de la pression intraoculaire postopératoire. À la fin de l’intervention, un stéroïde sous conjonctival peut être administré199. Si un bloc rétrobulbaire a été réalisé, une occlusion doit être appliquée sur l’œil en postopératoire.
Soins postopératoires
En postopératoire, les patients reçoivent généralement de l’acétate de prednisolone topique à 1 % avec ou sans agent anti-inflammatoire non stéroïdien tel que le kétorolac 0,4 % ou 0,5 % pendant au moins une semaine197. Un médicament cycloplégique topique peut également être ajouté[11]. Ces médicaments peuvent ensuite être diminués en fonction du niveau d’inflammation et du confort du patient204 Les antibiotiques topiques ne sont généralement pas nécessaires pour cette procédure non incisionnelle. Les médicaments contre le glaucome peuvent être diminués, généralement un à la fois, si la pression intraoculaire cible est atteinte après l’opération.

(avec l’aimable autorisation de l’auteur). Dr Albert S. Khouri
Une réduction postopératoire des médicaments a été observée à 18 mois, bien que les médicaments aient été réduits progressivement dès trois mois après l’intervention. Les yeux ayant des antécédents de chirurgie incisionnelle du glaucome semblent avoir une probabilité plus élevée de réussite après la MP-TSCPC par rapport à ceux qui n’ont pas de voie d’écoulement chirurgicale aqueuse préexistante197
La réduction postopératoire de la pression intraoculaire est également liée aux pressions intraoculaires de base, des pressions de base plus faibles entraînant une plus grande amélioration203. En outre, une étude dans laquelle la MP-TSCPC a été réalisée avec différents réglages de puissance tout en maintenant l’application du laser constante a révélé que des réglages de puissance plus élevés étaient corrélés à une réduction accrue de la pression intraoculaire, 2 000 mW entraînant une réduction de 30 % et 2 500 mW entraînant une réduction de 57 %204
Le taux de retraitement a également été utilisé comme mesure des résultats. Une étude a rapporté que 12 mois après la MP-TSCPC, 12 % des patients atteints de glaucome primaire à angle ouvert, 16 % des patients atteints de glaucome par pseudo-exfoliation et 41,2 % des patients atteints de glaucome secondaire ont dû subir un retraitement198=6 De même, une autre étude a rapporté un taux de réussite du traitement de 73,7 % si l’on considère uniquement le traitement initial, et de 89,5 % si l’on tient compte des patients qui ont subi un retraitement205
Certaines données indiquent que l’efficacité de la MP-TSCPC peut varier en fonction de l’âge du patient. Une étude comparant l’efficacité chez les adultes par rapport aux patients pédiatriques a rapporté un taux de réussite chez les adultes de 72,22 % contre 22,22 % chez les enfants206
Réduction de la production aqueuse par ablation du corps ciliaire
Endocyclophotocoagulation (ECP)
Résultats
La majorité des données indiquent que la MP-TSCPC a une efficacité similaire à celle de la TSCPC classique dans le traitement du glaucome réfractaire, mais avec des résultats plus cohérents et plus prévisibles. Deux principales mesures de résultats similaires à la TSCPC traditionnelle ont été rapportées. Il s’agit de 1) la réduction de la pression intraoculaire après l’intervention et 2) la réduction du nombre de médicaments préopératoires. Une revue systématique de la littérature a observé que, 18 mois après le traitement, 52 % des patients traités par MP-TSCPC et 30 % des patients traités par CW-TSCPC avaient réussi à maintenir une pression intraoculaire comprise entre 6 et 21 mm Hg, ce qui correspond à une réduction d’environ 30 % par rapport à leur pression intraoculaire préopératoire202
La cyclophotocoagulation endoscopique (ECP) est une procédure cyclodestructrice mise au point par Martin Uram en 1992. Elle vise à réduire au minimum les inconvénients des procédures cyclodestructrices plus traditionnelles tout en maximisant l’avantage de l’ablation de l’épithélium du corps ciliaire pour réduire la pression intraoculaire (PIO). Elle utilise un endoscope laser contenant trois groupes de fibres : un guide d’image, une source de lumière et un laser à diode semi-conductrice. Cette technologie permet de visualiser directement l’épithélium ciliaire. L’énergie laser peut ainsi être envoyée avec précision aux processus ciliaires, ce qui limite les dommages causés au corps ciliaire sous-jacent et aux tissus environnants207
La cyclodestruction comme méthode de traitement du glaucome a été observée pour la première fois par Heine lorsqu’il a découvert que les détachements du corps ciliaire entraînaient des diminutions de la pression intraoculaire208 Dans les années 1960, Purnell a préconisé un rayonnement ultrasonique transscléral pour produire la destruction souhaitée209. Depuis lors, la cyclophotocoagulation par voie transpupillaire ou par voie transsclérale avec ou sans contact a été popularisée en utilisant une multitude de lasers différents210
Les diverses tentatives de diminution de la pression intraoculaire par cyclodestruction présentent un ensemble commun d’inconvénients et de complications. Avant l’ECP, les procédures de cyclodestruction impliquaient que le chirurgien tente d’ablater le tissu ciliaire avec une capacité limitée d’évaluer la précision anatomique ou l’effet qualitatif. Les complications comprennent l’hypotonie prolongée, la douleur, l’uvéite, l’hémorragie, l’épanchement choroïdien, l’ischémie du segment antérieur, la scléromalacie, l’échec et la nécessité de retraiter, ainsi que la perte visuelle postopératoire associée à l’œdème maculaire cystoïde chronique. Traditionnellement, ces procédures étaient limitées aux patients atteints de glaucome réfractaire, généralement en dernier recours après l’échec d’autres procédures chirurgicales.
L’ECP permet d’appliquer la cyclodestruction de manière plus ciblée, directement sur le tissu cible, l’épithélium ciliaire, tout en réduisant au minimum les dommages collatéraux.
Les études histologiques confirment qu’il y a moins de perturbations tissulaires avec l’ECP qu’avec la cyclophotocoagulation transsclérale (TSCPC)211. Lin et ses collègues212 ont montré que la cyclophotocoagulation transsclérale causait une grave perturbation de l’apophyse ciliaire et de la racine de l’iris et provoquait une vasculopathie occlusive jusqu’à un mois. En revanche, l’ECP n’a provoqué qu’un rétrécissement localisé de l’apophyse ciliaire. L’ECP a également provoqué une vasculopathie occlusive, mais il y a eu une reperfusion partielle à un mois. Ils ont émis l’hypothèse que le retour partiel de la circulation sanguine pouvait expliquer en partie l’absence d’hypotonie et de phtisie avec l’ECPpar rapport à la TSCPC.
L’un des grands avantages de l’ECP par rapport aux techniques de cyclophotocoagulation transsclérale est la possibilité d’envoyer de l’énergie laser de manière hautement titrable sur le processus ciliaire. L’effet tissulaire optimal est de blanchir le processus ciliaire et de provoquer un rétrécissement visible du tissu. La photocoagulation est appliquée avec l’endoscope à 1,0-3,0 mm des procès ciliaires. Kahook, Noecker et leurs collègues recommandent d’utiliser le laser à une distance d’environ 2 mm de l’apophyse ciliaire. À cette distance, on peut généralement voir 6 procès ciliaires dans le champ de vision de l’endoscope. Cette distance est idéale pour réduire le plus possible la perte de transmission de l’énergie laser tout en réduisant le risque de surtraitement213
Les niveaux de puissance du laser à diode semi-conductrice de 810 nm sont augmentés à partir de niveaux de puissance inférieurs pour obtenir un blanchiment et un rétrécissement des processus ciliaires. En général, 100 à 300 mW suffisent pour obtenir l’effet désiré sur les tissus. Une application lente et continue du traitement laser permet aux chirurgiens de « peindre » méthodiquement l’ensemble de chaque processus ciliaire de manière lisse et bien contrôlée. Un traitement d’au moins 270° est souvent nécessaire pour obtenir une réduction optimale de la pression intraoculaire avec l’ECP214
Si l’ECP est administrée par une seule incision, la sonde endoscopique incurvée permet au chirurgien d’étendre la zone de traitement de l’apophyse ciliaire au-delà de ce qu’il peut faire avec un endoscope droit. Kahook et ses collègues ont montré qu’un traitement à 360 degrés par ECP à travers deux incisions est supérieur à un traitement partiel à travers une incision. Le traitement à 360 degrés a permis d’abaisser la PIO, de réduire davantage la charge médicamenteuse du glaucome et de réduire le nombre d’échecs thérapeutiques par rapport au traitement partiel214
Les indications pour la réalisation de l’ECP restent quelque peu controversées et continuent d’être débattues. À la lumière des complications potentielles associées à cette procédure, une sélection prudente des patients a été conseillée. L’ECP a été utilisée dans une grande variété de types de glaucomes, y compris le glaucome primaire à angle ouvert, le glaucome à angle fermé, le glaucome pigmentaire, le glaucome néovasculaire, le glaucome traumatique, le glaucome pédiatrique et d’autres glaucomes réfractaires215
Avec l’amélioration des technologies laser, l’utilisation de la transillumination sclérale, les techniques endoscopiques et la précision de la localisation du traitement ont remis en question les idées préconçues sur la place de la cyclophotocoagulation dans l’arsenal thérapeutique du glaucome. Des preuves de plus en plus nombreuses confirment que la cyclophotocoagulation est un traitement viable chez les patients atteints de glaucomes légers à modérés et contrôlés médicalement avec un bon potentiel de vision216 À l’heure actuelle, il n’existe cependant aucune étude prospective randomisée à long terme comparant l’ECP à la cyclophotocoagulation transsclérale et à la trabéculectomie.
Plus récemment, l’ECP a été utilisée de façon routinière en conjonction avec l’extraction de la cataracte comme chirurgie initiale du glaucome. Les premières études semblent confirmer que l’ECP est efficace pour abaisser la PIO et suggèrent un excellent profil de sécurité dans ce contexte217 Fort d’une grande expérience avec l’ECP, Berke suggère de la pratiquer en association avec une chirurgie de la cataracte par petite incision chez les patients atteints de cataracte et de glaucome modéré sous deux ou plusieurs médicaments218. Une cataracte visuellement significative est souvent le moteur de la décision de procéder à une phaco-ECP chez les patients souffrant à la fois de cataracte et de glaucome.
Malgré de nombreuses expériences anecdotiques positives, des études à long terme plus prospectives et bien contrôlées sont nécessaires pour déterminer avec plus de précision les avantages et les indications réels de l’ECP219. Les pics de pression intraoculaire, l’augmentation de l’inflammation postopératoire, la dislocation de la lentille intraoculaire et l’efficacité à long terme restent des préoccupations légitimes. L’efficacité à long terme et les implications potentielles sur les maladies oculaires concomitantes restent largement inconnues, bien qu’une étude de Siegel et coll. examine rétrospectivement la durée de suivi de 72 mois de la phaco-ECP combinée avec une réduction de la thérapie hypertensive oculaire combinée à la phaco seule220
Soins postopératoires
L’évolution postopératoire limitée après l’ECP est l’une des caractéristiques les plus souhaitables de cette procédure.
Chez la plupart des patients, la gestion postopératoire de l’ECP seule et de l’ECP combinée à une chirurgie de la cataracte est similaire à celle rencontrée lors d’une chirurgie de la cataracte seule. L’utilisation périopératoire d’un antibiotique topique à large spectre, d’acétate de prednisolone topique à 1 % ou de difluprednate topique, et d’un anti-inflammatoire non stéroïdien topique est généralement recommandée. Dans la période postopératoire immédiate, l’utilisation d’un médicament topique ou systémique contre le glaucome peut être utile pour prévenir les pics de pression intraoculaire postopératoires précoces. Avec une prise en charge précoce et agressive de l’inflammation, les complications telles que les synéchies postérieures et antérieures, l’opacification de la capsule postérieure et l’œdème maculaire cystoïde reflètent celles rencontrées chez les patients subissant une chirurgie de la cataracte seule221
Les médicaments contre le glaucome sont souvent diminués lentement au cours du premier ou du deuxième mois, en fonction du niveau de la PIO et de l’objectif du traitement.
Berke et ses collègues222 ont montré que dans un essai contrôlé randomisé portant sur 626 patients atteints de glaucome sous contrôle médical, la phacoémulsification combinée à l’ECPétait supérieure à la phacoémulsification seule en termes de réduction de la PIO et de diminution de la charge médicamenteuse liée au glaucome. Le groupe phaco-ECP est passé d’une PIO préopératoire de 19,08 mm Hg ± 4,14 avec 1,53 ± 0,89 médicament à une PIO postopératoire de 15,73 mm Hg ± 3,00 avec 0,65 ± 0,95 médicament. Le groupe phaco seul n’a pas montré de baisse soutenue de la PIO ni de diminution de la charge médicamenteuse, passant d’une PIO préopératoire de 18,16 mm Hg ± 3,38 avec 1,20 ± 0,83 médicament à une PIO postopératoire de 18,93 mm Hg ± 4,12 avec 1,20 ± 0,87 médicament. Ils n’ont signalé aucune complication grave dans les deux groupes et les taux d’œdème maculaire cystoïde étaient les mêmes dans les deux groupes.
Chen et ses collègues223 ont montré que l’ECP peut être efficace dans le cas d’un glaucome réfractaire ayant échoué à une chirurgie filtrante du glaucome et à une cyclophotocoagulation transsclérale. Ils ont rapporté une réduction de la PIO d’une valeur préopératoire de 27,7 mm Hg ± 10,3 à une PIO postopératoire de 17,0 ± 6,7 mm Hg lors de la dernière visite (diminution de 34 %). Ils ont rapporté un taux de réussite de 90 %, défini comme une PIO ≤ 21 mm Hg. Ils ont également rapporté une réduction des médicaments contre le glaucome de 3,0 ± 1,3 avant l’opération à 2,0 ± 1,3 après l’opération. Seulement 6 % des patients ont subi une perte d’acuité visuelle de 2 lignes ou plus. Un exsudat de fibrine a été observé dans 24 % des cas, un hyphéma dans 12 % des cas, un EMC dans 10 % des cas et un décollement de la choroïde dans 4 % des cas. Il n’y a pas eu de complications graves telles que l’hypotonie ou la phtisie.
L’ECP se compare également favorablement à d’autres chirurgies du glaucome. Lima et ses collègues ont rapporté que dans 68 yeux pseudophaques avec des antécédents de trabéculectomie ratée, de manière prospective, l’ECP avait un taux de réussite équivalent à celui des valves de glaucome d’Ahmed avec moins de complications224. Gayton et ses collègues, dans un essai prospectif randomisé portant sur 58 patients, ont comparé la phaco avec ECP à la phaco avec trabéculectomie, et ont rapporté que les deux groupes avaient des taux de réussite similaires. Le groupe phaco avec trabéculectomie avait cependant un taux de réussite plus élevé sans médicaments supplémentaires contre le glaucome225
Tan, Noecker, Francis et leurs collègues ont rapporté de bons résultats avec l’ECP plus phaco dans une analyse rétrospective de 53 patients qui avaient un glaucome non contrôlé malgré une chirurgie antérieure du glaucome et un traitement médical maximal. Ils ont rapporté une baisse de la PIO de 27,9 mm Hg ± 7,5 en préopératoire à 11,1 mm Hg ± 6,5 deux ans après l’opération, avec une réduction significative de la charge médicamenteuse de 3,4 ± 1,2 en préopératoire à 0,6 ± 1,3 en postopératoire. En raison de la nature agressive de l’ECP plus phaco, un taux relativement élevé d’hypotonie a été signalé, environ 7,5 %, ce qui est très rare avec l’ECP standard. Un patient a souffert d’un échec de greffe de cornée en postopératoire, mais il n’y a pas eu d’autres complications graves226
En ce qui concerne les résultats à long terme, Yap et ses collègues ont évalué les résultats à trois ans de la phaco-ECP dans des yeux présentant un POAG naïf sur le plan chirurgical. L’échec a été défini comme une PIO > 21 mm Hg, (2) une réduction < 20 % lors de deux visites consécutives ou (3) une nouvelle intervention chirurgicale visant à abaisser la PIO. Les taux de réussite aux années 1, 2 et 3 étaient respectivement de 70 %, 54 % et 45 %. La PIO moyenne avant l’opération était de 18,4 ± 5,2 mm Hg et a été réduite de manière statistiquement significative après l’opération à 14,3 ± 4,7 mm Hg à 1 an, 14,1 ± 4,0 mm Hg à 2 ans et 13,6 ± 3,7 mm Hg à 3 ans. Le nombre moyen de médicaments topiques a été réduit de manière statistiquement significative, passant de 2,7 ± 0,9 à 1,3 ± 1,2 à 1 an, 1,7 ± 1,2 à 2 ans et 1,8 ± 1,3 à 3 ans227. Dans une autre étude menée par Lindfield et ses collègues, la phaco-ECP a entraîné une diminution statistiquement significative de la PIO à tous les points temporels postopératoires lorsqu’elle a été étudiée jusqu’à 24 mois, avec une diminution moyenne de 7,1 mm Hg228
Dispositifs conventionnels de drainage du glaucome, dispositif EX-PRESS® modifiant la trabéculectomie et nouveaux dispositifs MIGS, résumé du statut réglementaire actuel, avantages et inconvénients de chaque groupe de dispositifs (shunts aqueux, avec ou sans valve; dispositifs MIGS, dispositifs du canal de Schlemm, suprachoroïdiens et sous-conjonctivaux) et efficacité de chaque dispositif dans la réduction de la PIO, telle que rapportée dans des études sélectionnées.
Implants conventionnels pour le glaucome et nouveaux dispositifs MIGS : un examen complet des options actuelles et des orientations futures229
Type de dispositif
Site de l’intervention anatomique
Trabéculectomie — dispositif de modification Espace sous-conjonctival
Dispositifs de chirurgie mini invasive du glaucome (MIGS)
Appareil (fabricant)
Dispositif de filtration EX-PRESS® pour le glaucome (Alcon Laboratories inc.)
Canal de Schlemm iStent® (Glaukos Corporation)
Statut réglementaire
Marquage CE, approuvé par la FDA depuis 2002
Espace suprachoroïdien
Marquage CE accordé en 2004, approbation de la FDA depuis 2012
iStentinject® (Glaukos Corporation) Marquage CE délivré en 2010
iStentinject® W (Glaukos Corporation) Approbation de la FDA depuis 2020
Hydrus® Microstent (Ivantis inc.)
CyPass® Micro-Stent (Alcon Laboratories inc.)
Marquage CE accordé en 2011, approbation de la FDA depuis 2018
Retiré du marché mondial en 2018
iStent SUPRA® (Glaukos Corporation) Marquage CE accordé en 2010, en cours d’examen par la FDA
SOLX® gold shunt (SOLX inc.)
STARfloMC Glaucoma Implant (iSTAR Medical)
MINIjecMC (iSTAR Medical)
Espace sous-conjonctival
XEN® Gel Stent (Allergan inc.)
PRESERFLOMC MicroShunt (Santen)
Marquage CE accordé, approuvé au Canada
Marquage CE délivré en 2012
Marquage CE délivré en 2021
Marquage CE accordé en 2013, approbation de la FDA depuis 2016
Marquage CE accordé en 2012, approbation de la FDA depuis 2020
Avantages Désavantages
Efficacité élevée dans la réduction de la PIO; plus prévisible que la trabéculectomie, avec moins de fluctuations de la PIO au cours de la période postopératoire précoce; les complications sont moins fréquentes par rapport à la trabéculectomie.
Risque réduit d’hypotonie et de complications liées à l’hypotonie; profil de sécurité favorable.
Risque d’échec en raison de la fibrose sous-conjonctivale et des complications liées à l’hématome;
L’hypotonie est fréquemment signalée, ainsi que l’érosion, le déplacement et le blocage de l’implant.
Risque élevé de fibrose pouvant conduire à l’obstruction du dispositif; réduction modeste de la PIO, ce qui fait que ces dispositifs ne conviennent qu’aux patients atteints de glaucome léger à modéré; ne convient pas aux patients ayant une pression veineuse épisclérale élevée.
Plus efficace pour réduire la PIO que les dispositifs MIGS pour le canal de Schlemm.
Risque élevé de fibrose pouvant conduire à l’obstruction du dispositif; pics de PIO imprévisibles; risque plus élevé d’hypotonie (transitoire).
Grande efficacité dans la réduction de la PIO, ce qui rend ces dispositifs adaptés aux patients atteints de glaucome plus sévère; la possibilité d’appliquer des agents antifibrotiques dans l’espace sous-conjonctival optimise la réponse fibrotique; la modulation de l’encapsulation des blebs est possible grâce à des techniques telles que le massage des blebs ou l’aiguilletage des blebs. Risque d’échec dû à la fibrose sous-conjonctivale et aux complications liées à l’hémorragie.
% de réduction de la PIO au cours du suivi (type d’étude)
41,4 % à 2 ans (essai clinique prospectif et randomisé) [29]
33,7 % à 1 an (essai clinique prospectif et randomisé) [30]
31,0 % à 2 ans (essai clinique prospectif et randomisé) [31]
Aucune étude publiée
37,1 % à 1 an (essai clinique prospectif et randomisé) [30]
34,3 % à 5 ans a (essai clinique prospectif et randomisé) [32]
Aucune étude publiée
35,8 % à 5 ans (essai clinique prospectif et randomisé) [33]
38,5 % à 2 ans (étude prospective) [34]
39,1 % à 6 mois (essai clinique prospectif à un seul groupe [35]
36,3 % à 1 an (essai clinique prospectif à un seul groupe) [36]
46,7 % à 5 ans (essai clinique prospectif, non randomisé, à un seul groupe) [101]
149. https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03369514/document
150. https://www.healio.com/news/ophthalmology/20210707/ ab-externo-technique-eases-implantation-of-xen-gel-stent
151. El Helwe H, Ingram Z, Falah H, Trzcinski J, Solá-Del Valle DA. Comparing Outcomes of 45 μm Gelatin Stent Placed ab externo with Open Conjunctiva to ab externo with Closed Conjunctiva. Ophthalmol Glaucoma. 2023 Aug 2:S2589-4196(23)00136-9. doi: 10.1016/j.ogla.2023.07.009. Epub ahead of print. PMID: 37536395.
152. https://eyewiki.aao.org/Techniques_for_Combined_ Cataract_and_Filtering_Glaucoma_Surgery
153. Chan JE, Netland PA. EX-PRESS Glaucoma Filtration Device: efficacy, safety, and predictability. Med Devices (Auckl). 2015 Sep 2;8:381-8. doi: 10.2147/MDER.S63350. PMID: 26366105; PMCID: PMC4562650.
154. Nyska A, Glovinsky Y, Belkin M, Epstein Y. Biocompatibility of the Ex-PRESS miniature glaucoma drainage implant. J Glaucoma. 2003;12:275–280.
155. Wamsley S, Moster MR, Rai S, Alvim HS, Fontanarosa J. Results of the use of the Ex-PRESS miniature glaucoma implant in technically challenging, advanced glaucoma cases: a clinical pilot study. Am J Ophthalmol. 2004;138:1049–1051. [PubMed] [Google Scholar]
156. Stewart RM, Diamond JG, Ashmore ED, Ayyala RS. Complications following Ex-Press glaucoma shunt implantation. Am J Ophthalmol. 2005;140:340–341. [PubMed] [Google Scholar]
157. Traverso CE, de Feo F, Messas-Kaplan A, et al. Long term effect on IOP of a stainless steel glaucoma drainage implant (Ex-PRESS) in combined surgery with phacoemulsification. Br J Ophthalmol. 2005;89:425–429. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
158. Dahan E, Carmichael TR. Implantation of a miniature glaucoma device under a scleral flap. J Glaucoma. 2005;14:98–102.
159. Salim S. The role of the Ex-PRESS glaucoma filtration device in glaucoma surgery. Semin Ophthalmol. 2013;28:180–184.
160. Lankaranian D, Razeghinejad MR, Prasad A, et al. Intermediate-term results of the Ex-PRESS miniature glaucoma implant under a scleral flap in previously operated eyes. Clin Experiment Ophthalmol. 2011;39:421–428.
161. Mariotti C, Dahan E, Nicolai M, Levitz L, Bouee S. Long-term outcomes and risk factors for failure with the EX-press glaucoma drainage device. Eye (Lond) 2014;28:1–8.
162. de Jong L, Lafuma A, Aguadg AS, Berdeaux G. Five-year extension of a clinical trial comparing the EX-PRESS glaucoma filtration device and trabeculectomy in primary open-angle glaucoma. Clin Ophthalmol. 2011;5:527–533.
163. Good TJ, Kahook MY. Assessment of bleb morphologic features and postoperative outcomes after Ex-PRESS drainage device implantation versus trabeculectomy. Am J Ophthalmol. 2011;151:507–513.
164. Marzette L, Herndon LW. A comparison of the Ex-PRESS™ mini glaucoma shunt with standard trabeculectomy in the surgical treatment of glaucoma. Ophthalmic Surg Lasers Imaging. 2011;42:453–459.
165. Moisseiev E, Zunz E, Tzur R, Kurtz S, Shemesh G. Standard trabeculectomy and Ex-PRESS miniature glaucoma shunt: a comparative study and literature review. J Glaucoma. 2014 Mar 13; Epub.
166. Netland PA, Sarkisian SR, Jr, Moster MR, et al. Randomized, prospective, comparative trial of EX-PRESS glaucoma filtration device versus trabeculectomy (XVT study) Am J Ophthalmol. 2014;157:433–440.
167. Wagschal LD, Trope GE, Jinapriya D, Jin YP, Buys YM. Prospective randomized study comparing Ex-PRESS to trabeculectomy: 1-year results. J Glaucoma. 2013 Nov 16; Epub.
168. Dahan E, Ben Simon GJ, Lafuma A. Comparison of trabeculectomy and EX-PRESS implantationin fellow eyes of the same patient: a prospective, randomized study. Eye (Lond) 2012;26:703–710.
169. https://www.mdalert.com/article/longterm-data-on-expressshunt-for-uncontrolled-glaucoma-are-very-promising
170. Wang L, Sha F, Guo DD, Bi HS, Si JK, Du YX, Tang K. Efficacy and economic analysis of Ex-PRESS implantation versus trabeculectomy in uncontrolled glaucoma: a systematic review and Meta-analysis. Int J Ophthalmol. 2016 Jan 18;9(1):124-31. doi: 10.18240/ijo.2016.01.21. PMID: 26949622; PMCID: PMC4768498.
171. Konopińska J, Deniziak M, Saeed E, Bartczak A, Zalewska R, Mariak Z, Rękas M. Prospective Randomized Study Comparing Combined Phaco-ExPress and Phacotrabeculectomy in Open Angle Glaucoma Treatment: 12-Month Follow-Up. J Ophthalmol. 2015;2015:720109. doi: 10.1155/2015/720109. Epub 2015 Jun 7. PMID: 26137318; PMCID: PMC4475547.
172. https://www.touchophthalmology.com/anterior-segment/ journal-articles/comparing-viscocanalostomy-withtrabeculectomy/
173. Stegmann R, Pienaar A, Miller D, Viscocanalostomy for open-angle glaucoma in black African patients, J Cataract Refract Surg, 1999;25:316–22.
174. Tamm ER, Carassa RG, Albert DM, et al., Viscocanalostomy in Rhesusmonkeys, Arch Ophthalmol, 2004;122:1826–38.
175. Carassa R, Bettin P, Fiori M, Brancato R, Viscocanalostomy: a pilot study, Eur J Ophthalmol, 1998;8:57–61.
176. Negri-Aranguren I, Croxatto O, Grigera DE, Midterm ultrasound biomicroscopy findings in eyes with successful viscocanalostomy, J Cataract Refract Surg, 2002;28:752–7.
177. Alp MN, Yarangumeli A, Koz OG, Kural G, Nd:YAG laser goniopuncture in viscocanalostomy: penetration in nonpenetrating glaucoma surgery, Int Ophthalmol, 2010;30:245–52.
178. Lewis RA, von Wolff K, Tetz M, et al., Canaloplasty: circumferential viscodilation and tensioning of Schlemm canal using flexible microcatheter for the treatment of open-angle glaucoma in adults. Two-year interim clinical study results, J Cataract Refract Surg, 2009;35:814–24.
179. Jonescu-Cuypers C, Jacobi P, Konen W, Krieglstein G, Primary viscocanalostomy versus trabeculectomy in white patients with open-angle glaucoma: arandomized clinical trial, Ophthalmology, 2001;108:254–8.
180. Luke C, Dietlein TS, Jacobi PC, et al., A prospective randomized trial of viscocanalostomy versus trabeculectomy in open-angle glaucoma: a 1-year follow-up study, J Glaucoma, 2002;11:294–9.
181. O’Brart DSP, Rowlands E, Islam N, Noury AMS, A randomised, prospective study comparing trabeculectomy augmented with antimetabolites with a viscocanalostomy technique for the management of open angle glaucoma uncontrolled by medical therapy, Br J Ophthalmol, 2002;86:748–54.
182. Lewis, Richard A.; Kurt von Wolff; Manfred Tetz; Norbert Koerber; John R. Kearney; Bradford J. Shingleton; Thomas W. Samuelson (April 2011). "Canaloplasty: Three-year results of circumferential viscodilation and tensioning of Schlemm canal using a microcatheter to treat open-angle glaucoma". Journal of Cataract and Refractive Surgery. 37 (4): 682–690.
183. Bull, Holger; Kurt von Wolf; Norbert Körber; Manfred Tetz (October 2011). "Three-year canaloplasty outcomes for the treatment of open-angle glaucoma: European study results". Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 249 (10): 1537–45.
184. Stegmann R, Pienaar A, Miller D. Viscocanalostomy for open-angle glaucoma in black African patients. J Cataract Refract Surg. 1999;25:316Y322.
185. Yalvac IC, Sahin M, Eksioglu U, et al. Primary viscocanalostomy versus trabeculectomy for primary openangle glaucoma: three-year prospective randomized clinical trial. J Cataract Refract Surg. 2004;30:2050-2057.
186. Sunaric-Megevand G, Leuenberger PM. Results of viscocanalostomy for primary open-angle glaucoma. Am J Ophthalmol 2001 Aug;132(2):221-8
187. Kearney JR, Ball SF, Field MW, et al. Circumferential viscodilation of Schlemm’s canal with a flexible microcannula during non-penetrating glaucoma surgery. DJO.
188. Koerber NJ. Canaloplasty in one eye compared with viscocanalostomy in the contralateral eye in patients with bilateral open angle glaucoma. J Glaucoma. 2012;21:129-134.
189. Lewis RA, von Wolff K, Tetz M, et al. Canaloplasty: Three year results of circumferential viscodilation and tensioning of Schlemm’s canal using a microcatheter to treat of openangle glaucoma J Cataract Refract Surg. 2011;37:682-690.
190. Tam DY, Calafati J, Ahmed I. Non-penetrating Schlemm’s Canaloplasty vs Trabeculectomy. Presented at the American Glaucoma Society meeting, Naples, FL, March, 2010.
191. Gallardo MJ. Clinical Ophthalmology 2021:15;1591-1599.
192. Koerber, NJ. Canaloplasty New Approach to Nonpenetrating Glaucoma Surgery. Techniques in Ophthalmology 5(3):102–106, 2007.
193. Brancato R, Giovanni L, Trabucchi G, Pietroni C. Contact Transscleral Cyclophotocoagulation With Nd:YAG Laser in Uncontrolled Glaucoma. Opthalmic Surg. 1989;20(8):547-51
194. Gaasterland DE, Pollack IP, Spaeth GL, Coleman DJ, Wilensky JT. Initial experience with a new method of laser transscleral cyclophotocoagulation for ciliary ablation in severe glaucoma. Transactions of the American Ophthalmological Society 1992;90:225-46
195. Uram M. Endoscopic cyclophotocoagulation in glaucoma management. Curr OpinOphthalmol. 1995;6:19–29
196. Tan AM, Chockalingam M, Aquino MC, Lim ZI, See JL, Chew PT. Micropulse transscleral diode laser cyclophotocoagulation in the treatment of refractory glaucoma. Clin Exp Ophthalmol. 2010;38(3):266-272
197. Garcia, Giancarlo A. et al. Micropulse Transscleral Diode Laser Cyclophotocoagulation in Refractory Glaucoma. Ophthalmology Glaucoma, Volume 2, Issue 6, 402 – 412
198. Tekeli O, Köse HC. Outcomes of micropulse transscleral cyclophotocoagulation in primary open-angle glaucoma, pseudoexfoliation glaucoma, and secondary glaucoma [published online ahead of print, 2020 Mar 31]. Eur J Ophthalmol. 2020;1120672120914231
199. Al Habash A, AlAhmadi AS. Outcome OfMicroPulse® Transscleral Photocoagulation In Different Types Of Glaucoma. Clin Ophthalmol. 2019;13:2353-2360
200. Kaba Q, Somani S, Tam E, Yuen D. The Effectiveness and Safety of Micropulse Cyclophotocoagulation in the Treatment of Ocular Hypertension and Glaucoma 2020;3(3):181-189. doi: 10.1016/j.ogla.2020.02.005
201. Sanchez FG, Peirano-Bonomi JC, Grippo TM. Micropulse Transscleral Cyclophotocoagulation: A Hypothesis for the Ideal Parameters. Med Hypothesis DiscovInnovOphthalmol. 2018;7(3):94-100
202. Ma A, Yu SWY, Wong JKW. Micropulse laser for the treatment of glaucoma: A literature review. SurvOphthalmol. 2019;64(4):486-497. doi:10.1016/j.survophthal.2019.01.001
203. Preda MA, Karancsi OL, Munteanu M, Stanca HT. Clinical outcomes of micropulse transscleral cyclophotocoagulation in refractory glaucoma—18 months follow-up. Lasers Med Sci. 2020. DOI: 10.1007/s10103-019-02934-x
204. Sarrafpour S, Saleh D, Ayoub S, Radcliffe nm (2019) Micropulse transscleral cyclophotocoagulation a look at long-term effectiveness and outcomes. Ophthalmol Glaucoma 2(3):167–171
205. Kuchar S, Moster MR, Reamer CB, Waisbourd M. Treatment outcomes of micropulse transscleral cyclophotocoagulation in advanced glaucoma. Lasers Med Sci. 2016;31:393–396
206. Lee JH, Shi Y, Amoozgar B, Aderman C, De Alba CA, Lin S, Han Y. Outcomes of MicroPulse laser TSCPC on pediatric vs adult glaucoma patients. J Glaucoma. 2017;26(10):936–939
207. Uram M. Endoscopic cyclophotocoagulation in glaucoma management. Curr Opin Ophthalmol. 1995;6(2):19–29.
208. Heine L. Die Cyklodialyse, eine neue glaucomoperation. Deutsche MedWochenschr. 1905;31:824–825.
209. Purnell EW, Sokollu A, Torchia R, et al. Focal chorioretinitis produced by ultrasound. Invest Ophthalmol. 1964;3:657–664.
210. Pastor SA, Singh K, Lee DA, et al. Cyclophotocoagulation: a report by the American Academy of Ophthalmology. Ophthalmology. 2001;108(11):2130–2138.
211. Pantcheva MB, Kahook MK, Schuman JS, Noecker RJ. Comparison of acute structural and histopathological changes in human autopsy eyes after endoscopic cyclophotocoagulation and trans-scleral cyclophotocoagulation. Br J Ophthalmol. 2007;91:248–52
212. Lin SC, Chen MJ, Lin MS, Howes E, Stamper RL. Vascular effects of ciliary tissue from endoscopic versus trans-scleral cyclophotocoagulation. Br J Opthalmol. 2006;90:496–500.
213. Yu JY, Kahook MY, Lathrop KL, Noecker RJ. The effect of probe placement and type of viscoelastic material on ECP laser energy transmission. Ophthalmic Surgery, Lasers & Imaging. March/April 2008. Vol. 39. No.2
214. Kahook MY, Lathrop KL, Noecker RJ. One-site versus two-site endoscopic cyclophotocoagulation. J Glaucoma. 2007;16: 527–530.
215. Lin S. Perspective: endoscopic cyclophotocoagulation. Br J Ophthalmol. 2002;86:1434–1438.
216. Wilensky JT, Kammer J. Long-term visual outcome of transscleral laser cyclotherapy in eyes with ambulatory vision. Ophthalmology. 2004;111:1389–1392.
217. Uram M. Combined phacoemulsification, endoscopic ciliary process photocoagulation, and intraocular lens implantation in glaucoma management. Ophthalmic Surg. 1995;26(4): 346–352.
218. Berke SJ, Cohen AJ, Sturm RT, et al. Endoscopic cyclophotocoagulation (ECP) and phacoemulsification in the treatment of medically controlled primary open-angle glaucoma. J Glaucoma. 2000;9(1):2000.
219. Netland PA, Mansberger SL, Lin S. Uncontrolled intraocular pressure after endoscopic cyclophotocoagulation. J Glaucoma. 2007;16:165–167.
220. Siegel MJ, Faridi O, et al. The Long-term Efficacy Of Combined Endoscopic Cyclophotocoagulation (ECP) And Phacoemulsification In The Treatment Of Mild-moderate Gl
221. Berke SJ, Cohen AJ, Sturm RT, et al. Endoscopic cyclophotocoagulation (ECP) and phacoemulsification in the treatment of medically controlled primary open-angle glaucoma. J Glaucoma. 2000;9(1):2000.
222. Berke SJ. Endoscopic cyclophotocoagulation and phacoemulsification in glaucoma management. Techniques in Ophthalmology 4(2):74-81, 2006
223. Chen J, Cohn RA, Lin SC, Cortes AE, Alvarado JA. Endoscopic photocoagulation of the ciliary body for treatment of refractory glaucomas. Am J Ophthalmol 1997;124:787-796.
224. Lima FE et al. A Prospective, Comparative Study between Endoscopic Cyclophotocoagulation and the Ahmed Drainage Implant in Refractory Glaucoma. J Glaucoma 2004;13:233-237.
225. Gayton JL, VanDer Karr M, Sanders V. Combined cataract and glaucoma surgery: trabeculectomy versus endoscopic laser cycloablation. J Cataract Refract Surg. 2000;26:330–336.
226. Tan, JC, Vakili, G, Noecker R, Francis, B. “ECP-Plus” to Treat Refractory Glaucoma. Poster 21st Annual AGS meeting.
227. Bechrakis NE, Muller-Stolzenurg NW, Helbig H, et al. Sympathetic ophthalmia following laser cyclophotocoagulation. Arch Ophthalmol. 1994;112:80–84.
228. Lindfield D, Ritchie RW, Griffiths MF. 'Phaco-ECP': combined endoscopic cyclophotocoagulation and cataract surgery to augment medical control of glaucoma. BMJ Open. 2012 May 30;2(3):e000578. doi: 10.1136/bmjopen-2011-000578. PMID: 22649172; PMCID: PMC3367146.
229. https://www.nature.com/articles/s41433-021-01595-x/tables/1


L’étude SITE (Systemic Immunosuppressive Therapy for Eye Disease) nous a fourni de très bonnes données qui nous montrent que lorsque l’immunosuppression permet un contrôle complet de la panuvéite postérieure ou de la panuvéite, elle peut réduire de manière significative les complications de l’uvéite, en particulier la formation de membranes néovasculaires choroïdiennes. Ces données nous montrent également que l’on n’obtient pas le même effet si les patients sont contrôlés de manière minimale, ce qui signifie que nous les laissons couverts et qu’ils ne sont pas complètement calmes. Cela forme mon paradigme de traitement et je m’appuie sur l’immunosuppression plus tôt, parce que je sais que nous obtenons de meilleurs résultats25
SITE était une étude de cohorte rétrospective montrant qu’un an après le début du TIM, un contrôle durable de l’inflammation était atteint chez 62,2 %, 66 %, 73,1 %, 51,9 % et 76,3 % des patients prenant respectivement de l’azathioprine, du méthotrexate, du mycophénolate mofétil, de la cyclosporine et du cyclophosphamide 25 Elle a également révélé que le taux de contrôle de l’inflammation chutait lorsque la prednisone orale était arrêtée, quel que soit l’agent de TIM utilisé.
ClinicalTrials.gov ID NCT00116090
Étude de cohorte sur le traitement immunosuppresseur systémique des maladies oculaires (étude SITE)
Résumé : Cette étude évaluera si un traitement qui supprime les réactions immunitaires administré pour traiter les maladies inflammatoires de l’œil est associée à un risque plus élevé de décès et de cancer. Les maladies inflammatoires de l’œil, notamment l’uvéite, la sclérite et la pemphigoïde des muqueuses, sont des maladies qui entraînent parfois une cécité majeure.
Pour certains patients, le traitement par corticostéroïdes ne suffit pas à contrôler les maladies. Les chercheurs espèrent obtenir des informations sur la pertinence du traitement immunosuppresseur pour les patients et sur les substances à éviter. L’étude évaluera également la fréquence des complications à court terme liées à la thérapie immunosuppressive ainsi que les avantages que cette thérapie peut apporter au traitement des maladies oculaires26
Les dossiers médicaux de patients âgés de moins de 65 ans (âge médian compris entre 21 et 65 ans) ayant souffert d’une maladie oculaire inflammatoire et non infectieuse peuvent être examinés dans le cadre de cette étude. Une base de données sera constituée à partir de l’examen des dossiers des patients examinés à la clinique d’uvéite du National Eye Institute depuis 1977 et dans trois autres sites. Les patients considérés comme exposés aux thérapies immunosuppressives seront comparés à deux groupes : la population générale des États-Unis et un groupe interne de patients atteints des mêmes maladies oculaires inflammatoires et n’ayant pas reçu d’immunosuppression. Des données concernant environ 10 000 à 15 000 patients seront collectées. Les patients ne seront pas identifiés lors de l’examen des dossiers. L’incidence du cancer sera examinée, ainsi que les résultats du traitement immunosuppresseur, mesurés par le contrôle de la maladie oculaire, l’acuité visuelle, les changements dans l’utilisation des corticostéroïdes et les taux de rémission, c’est-à-dire la diminution des symptômes de la maladie.
Les dossiers médicaux d’un groupe témoin de patients n’ayant pas reçu de traitement immunosuppresseur pour leur uvéite seront également examinés. Les données sur l’incidence du cancer sont plus difficiles à obtenir, car elles nécessitent un contact personnel avec les patients. Dans ce cas, les patients seront contactés par téléphone ou par courrier, et ceux qui auront donné leur consentement éclairé seront interrogés sur leurs antécédents médicaux, y compris les cas antérieurs de cancer et d’autres affections.
Pour les patients décédés, les chercheurs tenteront de communiquer avec le plus proche parent au sujet de ces informations médicales.
Contexte : Les maladies inflammatoires oculaires, notamment l’uvéite, la sclérite et la pemphigoïde des muqueuses, sont des maladies oculaires cécitantes majeures. Chez certains patients, la corticothérapie est insuffisante pour contrôler la maladie inflammatoire oculaire, de sorte qu’un traitement immunosuppresseur est nécessaire. Le traitement immunosuppresseur des maladies oculaires fait le plus souvent appel à des antimétabolites, des inhibiteurs de lymphocytes T et/ou des agents alkylants. Des études menées sur des patients atteints de maladies immunologiques systémiques graves ou d’autres maladies systémiques ont suggéré que ces traitements pouvaient entraîner un risque accru de cancer et d’autres morbidités à long terme. Dans ces études, il a été difficile de déterminer si ce risque accru était dû aux maladies systémiques sous-jacentes ou au traitement.
Objectifs : L’étude de cohorte SITE (Systemic Immunosuppressive Therapy for Eye Diseases) évaluera directement si le traitement immunosuppresseur des maladies inflammatoires oculaires est associé à un risque excessif de mortalité et de cancer.
L’étude devrait fournir des informations essentielles pour décider si un traitement immunosuppresseur est justifié pour ces patients et si certains agents immunosuppresseurs devraient être évités. En outre, l’étude évaluera la fréquence des complications à court terme liées à ce traitement et les avantages oculaires de la thérapie.
Début de l’étude : 2005-06-16
Fin de l’étude : 2008-04-21
Nombre de participants : 6 300
Méthodes d’identification des effets indésirables à long terme du traitement chez les patients atteints de maladies oculaires : l’étude de cohorte SITE (Systemic Immunosuppressive Therapy for Eye Diseases)
Objectif : Évaluer les méthodes épidémiologiques potentielles pour étudier les effets à long terme de l’immunosuppression sur le risque de mortalité et de tumeur maligne mortelle, et présenter les détails méthodologiques de l’étude de cohorte SITE (Systemic Immunosuppressive Therapy for Eye Diseases)27
Méthodes : Revue des avantages et des inconvénients des modèles d’étude potentiels pour l’évaluation des événements rares et tardifs, et présentation de l’approche de l’étude de cohorte SITE.
Résultats : L’essai contrôlé randomisé est la méthode la plus solide pour évaluer les effets d’un traitement, mais la longue durée de l’étude, les coûts élevés et les problèmes éthiques liés à l’étude de la toxicité limitent son utilisation dans ce contexte. Les études de cohortes rétrospectives sont potentiellement plus rentables et plus opportunes, s’il existe des dossiers fournissant les informations souhaitées sur une période de suivi suffisante dans le passé. Les méthodes cas-témoins nécessitent des échantillons de très grande taille pour évaluer le risque associé à des expositions rares, et le biais de rappel est problématique lorsqu’il s’agit d’étudier la mortalité. L’étude de cohorte SITE est une étude de cohorte rétrospective. L’utilisation passée d’antimétabolites, d’inhibiteurs de cellules T, d’agents alkylants et d’autres immunosuppresseurs est déterminée à partir des dossiers médicaux d’environ 9 250 patients souffrant d’inflammation oculaire dans cinq centres tertiaires sur une période allant jusqu’à 30 ans. La mortalité et les résultats de la mortalité par cause sur environ 100 000 années-personnes ont été déterminés à l’aide de l’Index national des décès. Les groupes de patients immunodéprimés et non immunodéprimés sont comparés entre eux et avec les taux de mortalité de la population générale tirés des statistiques vitales américaines. Les différences détectables calculées pour la mortalité/maladie mortelle par rapport à la population générale sont de 22 %/49 % pour les antimétabolites, 28 %/62 % pour les inhibiteurs de cellules T et 36 %/81 % pour les agents alkylants.
Conclusions : Les informations issues de l’étude de cohorte SITE devraient permettre de déterminer si l’utilisation de ces médicaments immunosuppresseurs pour traiter l’inflammation oculaire augmente le risque de mortalité et de cancer mortel. Cette approche épidémiologique peut être utile pour évaluer les risques à long terme des thérapies systémiques pour d’autres maladies oculaires.
« Avant l’arrivée des inhibiteurs du TNF tels que Humira (adalimumab) et Remicade (infliximab), nous utilisions souvent un antimétabolite plus un inhibiteur des lymphocytes T », explique le Dr Henry. « Aujourd’hui, nous commençons généralement par un antimétabolite tel que le méthotrexate ou le mycophénolate, et nous disposons de bonnes preuves de niveau I pour cette voie grâce à l’essai FAST28 ».
L’étude FAST (First-line Antimetabolites as Steroid-sparing Treatment) a porté sur 265 adultes atteints d’uvéite non infectieuse, répartis de manière aléatoire entre le méthotrexate par voie orale, à raison de 25 mg par semaine, et le mycophénolate mofétil par voie orale, à raison de 3 g par jour. Chez les patients souffrant d’uvéite postérieure ou de panuvéite, le traitement a réussi dans 74,4 % des cas dans le groupe méthotrexate contre 55,3 % dans le groupe mycophénolate, tandis que chez les patients souffrant d’uvéite intermédiaire, il a réussi dans 33,3 % des cas dans le groupe méthotrexate contre 63,6 % dans le groupe mycophénolate28
Les deux agents de première intention sont le plus souvent les antimétabolites (tels que le méthotrexate, le mycophénolate ou l’azathioprine) et les agents biologiques. Les anti-TNF sont probablement les agents biologiques les plus utilisés : Humira, Remicade (infliximab), Simponi Aria (golimumab) ou Cimzia (certolizumab pégol). Pour les maladies plus agressives, on utilise parfois le rituximab.
Environ 40 à 60 % des patients auront besoin d’une thérapie combinée. Nous ajoutons généralement l’agent anti-TNF à l’antimétabolite. Cette voie est devenue acceptable pour les enfants et les adultes : d’abord l’antimétabolite puis, si nécessaire, une thérapie combinée et l’ajout de l’agent anti-TNF.
Certains patients qui ont besoin d’une thérapie combinée peuvent ne pas tolérer l’antimétabolite ou l’anti-TNF, poursuit le Dr Dahr. « Chez ces patients, nous pourrions envisager un inhibiteur des lymphocytes T tel que le tacrolimus ou la cyclosporine en tant que composante de la thérapie combinée. Bien qu’il s’agisse d’un stéroïde injecté dans le vitré comme une forme de traitement local, l’implant Yutiq (fluocinolone 0,18 mg) a une longue durée d’action (deux à trois ans) et peut servir d’élément de base dans un régime de traitement à long terme, ajoute-t-il. Il existe donc de nombreuses combinaisons différentes. L’association d’un antimétabolite et d’un inhibiteur de cellules T, par exemple, est une combinaison classique qui peut donner de bons résultats et qui est peu coûteuse. Nous pouvons également utiliser un implant Yutiq en association avec un anti-TNF chez un patient qui ne tolère pas l’antimétabolite, mais qui a besoin de plus que l’anti-TNF seul. »
« Les inhibiteurs de cellules T et les agents alkylants (cyclophosphamide et chlorambucil) sont, à mon avis, les plus lourds, déclare le Dr Arepalli13. Je les réserve aux patients dont la maladie est la plus grave. Je m’en remets vraiment à la rhumatologie pour choisir cette voie, car ces médicaments peuvent entraîner de nombreux effets secondaires. J’ai une poignée de patients qui prennent des agents alkylants. L’un d’entre eux me vient à l’esprit : il s’agit d’un patient souffrant d’une terrible sclérite dans le cadre d’une granulomatose avec polyangéite.
Nous sommes passés par tous les autres moyens et nous avons fini par utiliser le cyclophosphamide parce qu’on n’arrivait pas à contrôler la condition d’une autre manière. Ainsi, bien qu’il s’agisse de médicaments plus anciens et qu’ils soient parmi les plus puissants que nous ayons, ils sont toujours très utiles pour les patients dont la condition ne peut être contrôlée avec certains de nos médicaments plus récents ».
Étude SYCAMORE : Le premier essai contrôlé randomisé portant sur des enfants traités par l’adalimumab en association avec le méthotrexate pour l’uvéite associée à l’AJI s’est achevé récemment au Royaume-Uni29. Les chercheurs ont constaté que l’association était beaucoup plus efficace pour contrôler l’inflammation et qu’elle entraînait moins d’échecs thérapeutiques que le méthotrexate seul. « L’essai a été interrompu prématurément devant l’importance des avantages constatés », a commenté le Dr Lee.
L’étude montre également la voie à suivre pour ce qui est de la méthodologie, souligne le Dr Lee : en se concentrant sur un seul type d’uvéite, comme l’ont fait les chercheurs dans ce cas, « on pourrait être en mesure de séparer le signal du bruit ».
Adalimumab et méthotrexate pour le traitement de l’uvéite dans l’arthrite juvénile idiopathique
Contexte : L’adalimumab, un anticorps monoclonal anti-facteur de nécrose tumorale entièrement humain, est efficace dans le traitement de l’arthrite juvénile idiopathique (AJI). Nous avons testé l’efficacité de l’adalimumab dans le traitement de l’uvéite associée à l’AJI29
Méthodes : Dans cet essai multicentrique, à double insu, randomisé et contrôlé par placebo, nous avons évalué l’efficacité et l’innocuité de l’adalimumab chez des enfants et des adolescents âgés de 2 ans ou plus qui présentaient une uvéite active associée à l’AJI. Les patients qui prenaient une dose stable de méthotrexate ont été répartis au hasard dans un rapport 2:1 pour recevoir soit de l’adalimumab (à une dose de 20 mg ou 40 mg, selon le poids corporel), soit un placebo, administré par voie sous-cutanée toutes les 2 semaines. Les patients ont poursuivi l’essai jusqu’à l’échec du traitement ou jusqu’à ce que 18 mois se soient écoulés. Ils ont été suivis jusqu’à 2 ans après la randomisation. Le principal critère d’évaluation était le temps écoulé avant l’échec du traitement, défini en fonction d’un score d’inflammation intraoculaire multicomposant basé sur les critères de la Standardization of Uveitis Nomenclature
Résultats de l’étude : Les critères d’arrêt préspécifiés ont été remplis après le recrutement de 90 des 114 patients. Nous avons observé 16 échecs thérapeutiques chez 60 patients (27 %) du groupe adalimumab contre 18 échecs thérapeutiques chez 30 patients (60 %) du groupe placebo (rapport de risque, 0,25; intervalle de confiance [IC] à 95 %, 0,12 à 0,49; P < 0,0001 [la limite d’arrêt préspécifiée]). Les effets indésirables ont été plus fréquents chez les patients recevant l’adalimumab que chez ceux recevant le placebo (10,07 événements par année-patient [IC à 95 %, 9,26 à 10,89] contre 6,51 événements par année-patient [IC à 95 %, 5,26 à 7,77]), de même que les effets indésirables graves (0,29 événement par année-patient [IC à 95 %, 0,15 à 0,43] contre 0,19 événement par année-patient [IC à 95 %, 0,00 à 0,40]).
Conclusions : Le traitement par l’adalimumab a permis de maîtriser l’inflammation et a été associé à un taux d’échec thérapeutique inférieur à celui du placebo chez les enfants et les adolescents atteints d’uvéite active associée à l’AJI qui prenaient une dose stable de méthotrexate. L’incidence des effets indésirables et des effets indésirables graves est beaucoup plus élevée chez les patients qui ont reçu l’adalimumab que chez ceux qui ont reçu le placebo.
Essais Visual 1 et 2 : Ces essais ont révélé que l’adalimumab réduisait le risque de poussée uvéitique ou de perte d’acuité visuelle à l’arrêt des corticostéroïdes chez les patients atteints d’une uvéite inactive contrôlée par des corticostéroïdes systémiques30, 31
L’adalimumab chez les patients atteints d’uvéite active non infectieuse
Contexte : Les patients atteints d’uvéite non infectieuse sont exposés aux complications à long terme d’une inflammation non contrôlée, ainsi qu’aux effets indésirables d’une thérapie glucocorticoïde à long terme. Nous avons mené un essai pour évaluer l’efficacité et l’innocuité de l’adalimumab en tant qu’agent d’épargne glucocorticoïde pour le traitement de l’uvéite non infectieuse30
Méthodes : Cet essai multinational de phase 3 a porté sur des adultes présentant une uvéite intermédiaire non infectieuse active, une uvéite postérieure ou une panuvéite malgré un traitement à la prednisone pendant au moins 2 semaines. Les investigateurs et les patients n’ont pas été informés de la répartition des groupes d’étude. Les patients ont été répartis au hasard dans un rapport 1:1 pour recevoir de l’adalimumab (une dose de charge de 80 mg suivie d’une dose de 40 mg toutes les 2 semaines) ou un placebo apparié. Tous les patients ont reçu une dose obligatoire de prednisone, suivie d’une réduction progressive de la prednisone pendant 15 semaines. Le principal critère d’évaluation de l’efficacité était le délai avant l’échec du traitement à partir de la semaine 6. L’échec du traitement était un résultat à composantes multiples basé sur l’évaluation de nouvelles lésions inflammatoires, de la meilleure acuité visuelle corrigée, du grade des cellules de la chambre antérieure et du degré d’opacification du vitré. Neuf critères secondaires d’efficacité ont été évalués et les effets indésirables ont été rapportés.
Résultats : Le délai médian avant l’échec du traitement est de 24 semaines dans le groupe adalimumab et de 13 semaines dans le groupe placebo. Parmi les 217 patients de la population en intention de traiter, ceux qui recevaient l’adalimumab étaient moins susceptibles que ceux du groupe placebo de subir un échec thérapeutique (rapport de risque, 0,50; intervalle de confiance à 95 %, 0,36 à 0,70; P < 0,001). Les résultats concernant les trois critères d’évaluation secondaires (changement dans le grade des cellules de la chambre antérieure, changement dans le grade du voile vitré et changement dans la meilleure acuité visuelle corrigée) étaient significativement meilleurs dans le groupe adalimumab que dans le groupe placebo. Des effets indésirables et des effets indésirables graves ont été signalés plus fréquemment chez les patients ayant reçu l’adalimumab (1 052,4 contre 971,7 effets indésirables et 28,8 contre 13,6 effets indésirables graves pour 100 années-personnes).
Dans l’étude Visual 1, l’échec du traitement était de 24 semaines dans le groupe adalimumab et de 13 semaines dans le groupe placebo. Dans l’étude Visual 2 menée auprès de patients souffrant d’uvéite contrôlée, l’échec du traitement est survenu chez 55 % des patients du groupe placebo et chez 39 % de ceux qui prenaient de l’adalimumab, a déclaré le Dr Sen : « Il s’agit d’un progrès important, mais il y a encore beaucoup de place pour l’amélioration ».
Adalimumab pour la prévention des poussées uvéitiques chez les patients atteints d’une uvéite non infectieuse inactive contrôlée par des corticostéroïdes (VISUAL II) : essai de phase 3 multicentrique, à double insu, randomisé et contrôlé par placebo
Contexte : L’uvéite non infectieuse est un trouble oculaire potentiellement dangereux pour la vue, causé par une inflammation chronique et ses complications. Le succès thérapeutique est limité par les effets indésirables systémiques associés à l’utilisation à long terme de corticostéroïdes et d’immunomodulateurs si les médicaments topiques ne suffisent pas à contrôler l’inflammation. Nous avons cherché à évaluer l’efficacité et l’innocuité de l’adalimumab chez des patients atteints d’une uvéite non infectieuse inactive contrôlée par des corticostéroïdes systémiques31
Méthodes : Nous avons réalisé cet essai de phase 3 multicentrique, doublement masqué, randomisé et contrôlé par placebo dans 62 sites d’étude répartis dans 21 pays aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Israël, en Australie et en Amérique latine. Les patients (âgés de ≥18 ans) atteints d’une uvéite intermédiaire, postérieure ou panuvéitique inactive et non infectieuse, contrôlée par 10 à 35 mg/jour de prednisone, ont été répartis au hasard (1:1), par l’intermédiaire d’un système interactif de réponse vocale et Web, avec une taille de bloc de quatre, pour recevoir soit de l’adalimumab sous-cutané (dose de charge de 80 mg; dose bihebdomadaire de 40 mg), soit un placebo, avec une réduction obligatoire de la prednisone à partir de la semaine 2. La randomisation a été stratifiée en fonction du traitement immunosuppresseur initial. Le personnel du promoteur chargé de superviser directement la conduite et la gestion de l’étude, les investigateurs, le personnel du site de l’étude et les patients n’ont pas été informés de la répartition des traitements. Le principal critère d’efficacité était le délai avant l’échec du traitement, un critère multicomposant englobant les nouvelles lésions inflammatoires choriorétiniennes ou vasculaires rétiniennes actives, le grade des cellules de la chambre antérieure, le grade du voile vitréen et l’acuité visuelle. L’analyse a été réalisée en intention de traiter. Cet essai est enregistré auprès de ClinicalTrials.gov sous le numéro NCT01124838.
Résultats : Entre le 10 août 2010 et le 14 mai 2015, nous avons réparti au hasard 229 patients entre le placebo (n = 114) et l’adalimumab (n = 115); 226 patients constituaient la population en intention de traiter. La durée médiane du suivi a été de 155 jours (IQR 77-357) dans le groupe placebo et de 245 jours (119-564) dans le groupe adalimumab. Le traitement a échoué chez 61 (55 %) des 111 patients du groupe placebo et chez 45 (39 %) des 115 patients du groupe adalimumab. Le délai avant l’échec du traitement est significativement plus court dans le groupe adalimumab que dans le groupe placebo (médiane non estimée [>18 mois] vs 8-3 mois; rapport de risque 0-57, IC à 95 % 0-39-0-84; p = 0-004). Le 40e percentile du temps écoulé avant l’échec du traitement était de 4 à 8 mois dans le groupe placebo et de 10 à 2 mois dans le groupe adalimumab.
Aucun patient des deux groupes n’a présenté d’infection opportuniste (à l’exception de la candidose buccale et de la tuberculose). Aucune tumeur maligne n’a été signalée dans le groupe placebo, tandis qu’un patient (1 %) du groupe adalimumab a présenté un carcinome épidermoïde sans gravité. Les effets indésirables les plus fréquents ont été l’arthralgie (12 [11 %] patients dans le groupe placebo et 27 [23 %] patients dans le groupe adalimumab), la rhinopharyngite (16 [17 %] et 8 [16 %] patients, respectivement) et les céphalées (17 [15 %] patients dans chaque groupe).
Interprétation : L’adalimumab a réduit de façon significative le risque de poussée uvéitique ou de perte d’acuité visuelle lors du retrait des corticostéroïdes chez les patients atteints d’une uvéite intermédiaire, postérieure ou panuvéitique inactive et non infectieuse, contrôlée par des corticostéroïdes systémiques. Aucun nouveau signal d’innocuité n’a été observé et le taux d’effets indésirables était similaire dans les deux groupes. Ces résultats suggèrent que l’adalimumab est bien toléré et pourrait être une option thérapeutique efficace dans cette population de patients. Une étude de prolongation ouverte (NCT01148225) est en cours afin d’obtenir des données sur l’innocuité à long terme de l’adalimumab chez les patients atteints d’uvéite non infectieuse.
Autres essais cliniques en développement
Essais de phase I
L’essai Minocycline for Chronic Autoimmune Uveitis est une étude interventionnelle de phase 1 avec un recrutement estimé à 10 participants à l’Université Sun Yat-Sen en Chine32, 33. Les patients prendront 100 mg de minocycline par jour par voie orale afin d’évaluer son impact sur divers paramètres, y compris les changements dans la sensibilité maculaire, la meilleure acuité visuelle corrigée (MAVC), les champs visuels et les fluctuations de l’électrorétinogramme (ERG) à 6 et 12 mois.
Minocycline pour l’uvéite auto-immune chronique34
En bref : L’uvéite auto-immune est une maladie oculaire non infectieuse, grave, récidivante et menaçant la vue. Environ 20 à 25 % des patients atteints d’uvéite auto-immune souffrent du dilemme de la cécité en raison de l’état inflammatoire chronique et persistant des yeux, qui entraîne une destruction continue de la structure des yeux et conduit progressivement à des dommages irréversibles sur la fonction visuelle. Cependant, l’efficacité des traitements actuels, notamment les glucocorticoïdes, les immunosuppresseurs et les produits biologiques pour l’uvéite auto-immune chronique, est limitée. La minocycline est considérée depuis des décennies comme ayant une fonction anti-apoptose et immunomodulatrice et elle s’est révélée bénéfique dans plusieurs maladies neurodégénératives et neuro-inflammatoires. Cet essai vise à étudier l’efficacité et la sécurité de la minocycline dans le traitement de l’uvéite auto-immune chronique accompagnée de modifications dégénératives de la rétine34
Début de l’étude (réel) : 2021-12-01
Fin de l’étude primaire (estimée) : 2025-12-31
Fin de l’étude (estimée) : 2026-12-31
Effectifs (estimés) : 10
L’étude Pivotal Study of Izokibep in Noninfectious, Intermediate -, Posterior-, or Panuveitis, commanditée par Acelyrin inc, est un essai de phase 2 b conçu comme une étude interventionnelle d’environ 100 patients35. Les patients seront randomisés en deux groupes : (1) traitement sous-cutané placebo administré chaque semaine ou (2) izokibep administré chaque semaine par voie sous-cutanée. L’étude évaluera l’izokibep, un bloqueur de l’interleukine-17A, un acteur à part entière de la cascade inflammatoire. Le résultat principal mesurera le temps écoulé jusqu’à l’échec du traitement, qui est défini dans le protocole de l’étude. Les résultats secondaires incluent, sans s’y limiter, la proportion de sujets ayant atteint la quiescence, le changement de la MAVC, le changement de l’épaisseur centrale de la rétine et l’incidence des événements indésirables apparus sous traitement (TEAE).
L’étude Effectivity of Antituberculosis Therapy in Idiopathic Uveitis With Positive Interferon Gamma Release Assay (IGRA), parrainée par l’université Fakultas Kedokteran en Indonésie, est une étude de phase 2 à triple masque évaluant 80 participants randomisés pour recevoir soit un traitement antituberculeux, soit un stéroïde oral pour les patients atteints d’uvéite avec un test IGRA positif3 Le principal critère de jugement sera le pourcentage d’échec du traitement, défini comme plus de 0,5+ cellule de chambre antérieure (CA) ou opacification du vitré, lésions rétiniennes ou choroïdiennes actives, ou incapacité à diminuer progressivement jusqu’à moins de 7,5 mg de prednisone orale ou 2 gouttes d’acétate de prednisolone à 1 % par jour36
L’étude Abatacept in Patients With Birdshot HLA A29 Uveitis, parrainée par l’université Ziekehuizen Leuven en Belgique, est une étude de phase 2 prospective, ouverte, interventionnelle et de preuve de concept évaluant l’abatacept administré une fois par semaine à des patients diagnostiqués avec une choriorétinopathie Birdshot4. Le nombre de participants visé sera de 15. Le résultat principal sera le temps écoulé avant la récurrence dans au moins un œil, établie par une aggravation de la MAVC d’au moins 15 lettres, une augmentation de 30 % de l’épaisseur centrale de la rétine (ECR), une augmentation en 2 étapes du voile vitré, de nouvelles lésions inflammatoires dans la choroïde ou des changements vasculaires rétiniens. Les critères d’évaluation secondaires comprennent une modification du voile vitré, de la MAVC, de l’ECR, de l’épaisseur choroïdienne, du fonctionnement visuel et des modifications de l’ERG37
L’étude Adalimumab Plus Methotrexate for the Treatment of Pediatric Uveitis, parrainée par l’Université Sun Yat-Sen, est une étude de phase 2, avec assignation d’un seul groupe, dont le nombre cible est de 30 participants38. L’objectif est d’évaluer les effets de l’adalimumab et du méthotrexate dans le traitement de la panuvéite non infectieuse chez les enfants. L’objectif est d’évaluer les effets de l’adalimumab et du méthotrexate dans le traitement de la panuvéite non infectieuse chez les enfants. Le résultat principal sera le temps nécessaire pour atteindre la rémission, et les résultats secondaires comprendront la première rechute une fois la rémission atteinte, la dose totale de stéroïdes utilisée, et la MAVC.
L’étude SAVE-2 (Intravitreal Sirolimus as Therapeutic Approach to Uveitis), parrainée par l’université de Stanford et Santen inc, est un essai de phase 2, randomisé et non masqué, qui compare deux dosages de sirolimus (440 µg une fois par mois contre 880 µg tous les deux mois) chez 30 participants39. Le critère de jugement principal est le nombre de crises uvéitiques, et les critères de jugement secondaires sont les événements indésirables, la TRC et l’effet d’épargne stéroïdienne.
L’essai A Study of Brepocitinib in Adults With Active Noninfectious Nonanterior Uveitis (NEPTUNE), parrainé par Priovant Therapeutics, est un essai de phase 2, randomisé, à trois masques, évaluant l’effet du brepocitinib oral dans l’uvéite intermédiaire active, l’uvéite postérieure et la panuvéite7. Le nombre de participants est estimé à 24. Le principal critère de jugement sera l’incidence des TEAE et des événements indésirables graves40
Un essai multicentrique de phase 2 à bras unique visant à évaluer l’efficacité et la sécurité de l’ustekinumab en association avec la prednisone pour le traitement de l’uvéite sévère non infectieuse (USNI) est organisé par les hôpitaux universitaires de Dijon en France41. Il s’agit d’une étude de phase 2, avec assignation d’un seul groupe, portant sur environ 29 participants et visant à évaluer les effets de la prednisone et de l’ustekinumab (90 mg, administrés par voie sous-cutanée), les principaux résultats étant le pourcentage de rémission et le pourcentage de patients exempts de rechute de la maladie.
L’étude Reduction or Discontinuation of TNF-α Inhibitor in Noninfectious Uveitis Patients est une étude de phase 2, non masquée, interventionnelle, sur un seul groupe de 28 patients de l’Université Sun Yat-Sen, qui évaluera les résultats de l’arrêt progressif de l’adalimumab chez les patients atteints d’une uvéite précédemment contrôlée par le médicament42. Le médicament sera administré tous les mois (comme il l’était initialement toutes les 2 semaines pour contrôler la maladie). Si la maladie reste quiescente, l’administration sera interrompue au bout de 6 mois. Le critère d’évaluation principal sera le taux de rechute de l’inflammation, et les critères d’évaluation secondaires comprendront l’évaluation de l’AVC et de l’épaisseur maculaire.
L’étude sur le golimumab pour le traitement de l’uvéite de Behçet réfractaire, organisée par le Peking Union Medical College Hospital en Chine, est une étude de phase 2, interventionnelle, à groupe unique, évaluant le rôle du golimumab, un anticorps monoclonal anti-TNF-α dans la maladie de Behçet réfractaire43. Les résultats primaires comprennent l’impact du médicament sur le score d’attaque oculaire de la maladie, la MAVC, les résultats de la tomographie par cohérence optique et le taux de récurrence de l’uvéite. Les résultats secondaires comprennent l’inflammation intraoculaire, les effets de réduction des corticostéroïdes et l’impact sur la qualité de vie.
Essais de phase III
L’étude ADVISE ( Adalimumab vs Conventional Immunosuppression for Uveitis Trial), parrainée par le Johns Hopkins Center for Clinical Trials and Evidence Synthesis de Baltimore (Maryland), est une étude de phase 3, randomisée et ouverte, portant sur environ 222 participants et comparant l’adalimumab à l’immunosuppression classique (azathioprine, méthotrexate, mycophénolate, cyclosporine et tacrolimus) 44
Le principal critère d’évaluation sera l’obtention d’une réduction des corticostéroïdes (7,5 mg de corticostéroïdes par jour ou moins) lors de deux visites consécutives au cours des six premiers mois. Les résultats secondaires comprennent l’arrêt de la prednisone avant un an, l’acuité visuelle et les complications de l’uvéite et de son traitement.
L’étude Co-THEIA ( Efficacy, Safety, and Costs of Methotrexate, Adalimumab, or Their Combination in Noninfectious Nonanterior Uveitis), organisée par l’hôpital San Carlos en Espagne, est une étude de phase 3, randomisée et à simple insu, qui évalue trois groupes : (1) adalimumab, (2) méthotrexate, et (3) adalimumab et méthotrexate dans le traitement de l’uvéite non infectieuse non antérieure45. L’étude vise à inclure 192 participants. Le principal critère d’évaluation sera la réponse clinique, définie comme la résolution complète de l’inflammation à la 16e semaine et maintenue jusqu’à la 52e semaine.
L’étude A Study of Baricitinib (LY3009104) in Participants From 2 Years to Less Than 18 Years With Active JIAassociated Uveitis or Chronic Anterior Antinuclear AntibodyPositive Uveitis, commanditée par Eli Lilly and Company, est une étude de phase 3, randomisée et non masquée, évaluant le baricitinib par rapport à l’adalimumab chez des enfants atteints d’uvéite active associée à l’arthrite juvénile idiopathique (AJI) ou d’uvéite chronique à anticorps antinucléaires antérieurs positifs46. Le résultat primaire mesurera le pourcentage de répondeurs, défini comme une diminution de l’inflammation en deux étapes.
Une étude de TRS01 chez des sujets atteints d’uvéite antérieure active non infectieuse, y compris des sujets atteints de glaucome uvéitique, organisée par Tarsier, est une évaluation de phase 3, randomisée, à quadruple masque, d’une goutte, TRS01, comparée à des gouttes de stéroïdes approuvées par la FDA dans le traitement de l’uvéite antérieure active non infectieuse47. L’étude compte 162 participants. Le résultat primaire mesuré sera la quantité de cellules dans la chambre antérieure, et le résultat secondaire sera les changements dans les cellules par rapport à la ligne de base, entre autres.
L’étude Safety and Efficacy of an Injectable Fluocinolone Acetonide Intravitreal Insert (FAI), parrainée par EyePoint Pharmaceuticals, est une étude de phase 3, randomisée, avec assignation parallèle de 12 participants évaluant l’insert FAI (Yutiq; maintenant commercialisé par Alimera Sciences) par rapport à une injection fictive chez des patients souffrant d’uvéite postérieure48. Les critères d’évaluation primaires analyseront la proportion de sujets présentant une récidive dans les 6 mois suivant le traitement.
L’étude The Use of 2 Yutiq vs Sham for Treatment of Chronic Noninfectious Intraocular Inflammation Affecting the Posterior Segment (TYNI), parrainée par Texas Retina Associates et Eye Point Pharmaceuticals, est une étude collaborative de phase 3, prospective, randomisée, en double aveugle de 30 participants évaluant les patients qui reçoivent 2 implants FAI le jour 1 par rapport à ceux qui reçoivent 2 injections placebo le jour 149. Le principal critère d’évaluation sera la récurrence de l’uvéite au mois 6.
L’étude Systemic and Topical Antivirals for Control of Cytomegalovirus Anterior Uveitis: Treatment Outcomes (STACCATO), parrainée par l’Université de Californie à San Francisco, est un essai randomisé à double masque comparant le valgancyclovir oral, le gancyclovir topique (2 %) et un placebo pour l’uvéite antérieure à cytomégalovirus (CMV)50. Le principal résultat mesuré est le changement de la charge virale du jour 0 au jour 28, et les résultats secondaires comprennent la quiescence de la maladie ainsi que l’effet du stéroïde topique sur les yeux avant l’inclusion dans l’étude.
L’étude Limit-JIA (Preventing Extension of Oligoarticular Juvenile Idiopathic Arthritis), parrainée par l’université Duke, est une étude ouverte, de phase 3, à assignation parallèle et non masquée, qui évalue l’efficacité de l’abatacept sous-cutané (Orencia; Bristol Myers-Squibb) dans la prévention de l’extension de l’arthrite juvénile idiopathique51 L’étude comporte deux parties, la première partie ayant été interrompue en février 2022. La partie 2 est une continuation non randomisée évaluant l’administration d’abatacept par rapport aux soins habituels de l’AJI, chez les patients atteints d’AJI limitée pour voir si le médicament peut prévenir l’extension de la maladie ou l’uvéite.
Depuis la publication du précédent aperçu des essais cliniques sur l’uvéite dans le numéro d’octobre 2022 du Retinal Physician, Santen a mis fin à son étude de phase 3 LUMINA évaluant l’efficacité et la sécurité du sirolimus intravitréen chez les patients atteints d’uvéite postérieure non infectieuse52
Essais de phase IV
L’étude Fluocinolone Acetonide Intravitreal Implant 0,18 mg in the Treatment of Chronic Noninfectious Posterior Segment Uveitis, parrainée par EyePoint Pharmaceuticals, est une étude prospective ouverte de phase 4 évaluant les résultats à deux ans de l’implant FAI53. Les résultats primaires incluront le changement de la MAVC ainsi que le changement de l’épaisseur du sous-champ central, et les résultats secondaires incluront la récurrence de l’inflammation, les fuites vasculaires et l’œdème maculaire.
L’étude ADJUST (Adalimumab in JIA-associated Uveitis Stopping Trial), parrainée par l’Université de Californie à San Francisco, est une étude de phase 3, randomisée, à quadruple masque, menée auprès d’environ 118 participants atteints d’uvéite associée à l’AJI ou d’uvéite antérieure chronique ANA-positive, comparant la poursuite du traitement par l’adalimumab à l’arrêt du médicament (avec administration d’un placebo)54. Le principal critère d’évaluation est le délai avant l’échec du traitement.
L’étude Biologic Therapy in Pediatric JIA Uveitis, parrainée par l’hôpital Kasr El Aini en Égypte, vise à évaluer, dans une étude ouverte, l’efficacité des inhibiteurs du TNF-α chez 250 enfants égyptiens atteints d’AJI55. Le résultat principal sera axé sur les effets d’épargne stéroïdienne du médicament à 24 mois.
L’étude A Clinical Trial of Infliximab for Childhood Uveitis, parrainée par l’Université médicale de Tianjin en Chine, est un essai ouvert de 10 participants recevant de l’infliximab par voie intraveineuse 56
Le résultat principal mesurera le changement de la MAVC entre le début et chaque visite sur 24 semaines, et les résultats secondaires incluront le changement du grade des cellules de la CA et du trouble vitréen entre le début et chaque visite.
L’étude A Study to Assess Change in Disease Activity and Adverse Events of Adalimumab in Chinese Participants Requiring High Dose Corticosteroids for Active Noninfectious Intermediate, Posterior, or Panuveitis est une étude de phase 4, non masquée, à assignation d’un seul groupe, parrainée par AbbVie et menée en Chine57. Les résultats secondaires mesureront les lésions actives, le grade des cellules de la CA et le grade du voile vitré, la MAVC et la nécessité d’administrer moins de 7,5 mg de corticostéroïdes systémiques.
L’étude Efficacy and Safety of Adalimumab in Noninfectious Anterior Pediatric Uveitis With Peripheral Vascular Leakage est parrainée par le Peking Union Medical College Hospital en Chine58. Il s’agit d’une étude de phase 4, randomisée et ouverte, qui compare l’adalimumab (40 mg, administrés par voie sous-cutanée toutes les deux semaines) au méthotrexate (administration orale de 10 mg toutes les semaines) chez 50 enfants atteints d’uvéite antérieure et présentant une fuite vasculaire périphérique à l’angiogramme à la fluorescéine. Le critère d’évaluation principal sera l’apparition d’une poussée d’uvéite. Les critères d’évaluation secondaires mesureront les fuites vasculaires, les précipités kératiques, le trouble du vitré, la MAVC et les effets indésirables.
L’étude Topical 2% Ganciclovir Eye Drop for CMV Anterior Uveitis/Endotheliitis est commanditée par le Singapore National Eye Centre59. Cette étude ouverte de phase 4 évaluera la réponse au traitement du ganciclovir topique à 2 % chez 25 patients ayant reçu un diagnostic d’infection du segment antérieur par le cytomégalovirus. Après 6 semaines, une paracentèse en chambre aqueuse sera effectuée pour tester la charge virale ainsi que les niveaux de ganciclovir. Le résultat principal sera la concentration médiane de ganciclovir dans la chambre aqueuse. Le résultat secondaire sera l’efficacité clinique dans l’élimination de la charge virale du CMV, mesurée par la résolution de l’uvéite antérieure/endothélite et un prélèvement aqueux négatif pour le CMV.
L’étude The Ozurdex Monotherapy Trial (OM), parrainée par l’Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa au Canada, est une étude randomisée, à assignation parallèle et à triple masque, visant à évaluer l’efficacité et la sécurité de l’implant intravitréen de dexaméthasone 0,7 mg (Ozurdex; Allergan/AbbVie) pour le traitement de la panuvéite intermédiaire, postérieure ou non infectieuse60. Les patients seront traités par Ozdurex ou par une réduction progressive de la prednisone par voie orale. Le critère d’évaluation principal mesurera le pourcentage de patients dont le score de trouble du vitré est de 0 au bout de 6 mois. Les mesures secondaires incluront la MAVC, l’ECR, le temps de résolution du voile vitré et le temps d’échec défini comme le nombre de mois avec l’implant Ozurdex jusqu’à ce qu’un traitement d’appoint soit indiqué.
25. Kim JS, Knickelbein JE, Nussenblatt RB, Sen HN. Clinical trials in noninfectious uveitis. Int Ophthalmol Clin 2015;55:3:79-110.
26. https://www.clinicaltrials.gov/study/NCT00116090
27. Kempen JH, Daniel E, Gangaputra S, Dreger K, Jabs DA, Kaçmaz RO, Pujari SS, Anzaar F, Foster CS, Helzlsouer KJ, Levy-Clarke GA, Nussenblatt RB, Liesegang T, Rosenbaum JT, Suhler EB. Methods for identifying long-term adverse effects of treatment in patients with eye diseases: the Systemic Immunosuppressive Therapy for Eye Diseases (SITE) Cohort Study. Ophthalmic Epidemiol. 2008 Jan-Feb;15(1):47-55. doi: 10.1080/09286580701585892. PMID: 18300089.
28. Rathinam SR, Gonzales JA, Thundikandy R, Kanakath A, Murugan SB, Vedhanayaki R, Lim LL, Suhler EB, Al-Dhibi HA, Doan T, Keenan JD, Rao MM, Ebert CD, Nguyen HH, Kim E, Porco TC, Acharya NR; FAST Research Group. Effect of corticosteroid-sparing treatment with mycophenolate mofetil vs methotrexate on inflammation in patients with uveitis: A randomized clinical trial. JAMA 2019;10:322:10:936-945.
29. Ramanan AV, Dick AD, Jones AP, McKay A, Williamson PR, Compeyrot-Lacassagne S, Hardwick B, Hickey H, Hughes D, Woo P, Benton D, Edelsten C, Beresford MW; SYCAMORE Study Group. Adalimumab plus Methotrexate for Uveitis in Juvenile Idiopathic Arthritis. N Engl J Med. 2017 Apr 27;376(17):1637-1646. doi: 10.1056/ NEJMoa1614160. PMID: 28445659.
30. Jaffe GJ, Dick AD, Brézin AP, Nguyen QD, Thorne JE, Kestelyn P, Barisani-Asenbauer T, Franco P, Heiligenhaus A, Scales D, Chu DS, Camez A, Kwatra NV, Song AP, Kron M, Tari S, Suhler EB. Adalimumab in Patients with Active Noninfectious Uveitis. N Engl J Med. 2016 Sep 8;375(10):932-43. doi: 10.1056/NEJMoa1509852. PMID: 27602665.
31. Nguyen QD, Merrill PT, Jaffe GJ, Dick AD, Kurup SK, Sheppard J, Schlaen A, Pavesio C, Cimino L, Van Calster J, Camez AA, Kwatra NV, Song AP, Kron M, Tari S, Brézin AP. Adalimumab for prevention of uveitic flare in patients with inactive non-infectious uveitis controlled by corticosteroids (VISUAL II): a multicentre, double-masked, randomised, placebo-controlled phase 3 trial. Lancet. 2016 Sep 17;388(10050):1183-92. doi: 10.1016/S01406736(16)31339-3. Epub 2016 Aug 16. Erratum in: Lancet. 2016 Sep 17;388(10050):1160. PMID: 27542302.
32 https://retinalphysician.com/issues/2023/june/uveitiscorner-current-clinical-trials-in-uveitis/
33. Minocycline for Chronic Autoimmune Uveitis. Clinicaltrials. gov identifier: NCT05474729. Updated April 18, 2023. Accessed May 15, 2023. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/ NCT05474729
34. https://classic.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05474729
35. Phase 2b Pivotal Study of Izokibep in Non-infectious, Intermediate-, Posterior- or Pan-uveitis. Clinicaltrials. gov identifier: NCT05384249. Updated May 11, 2023. Accessed May 15, 2023. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/ NCT05384249
36. The Effectivity of Antituberculosis Therapy in Idiopathic Uveitis With Positive IGRA. Clinicaltrials.gov identifier: NCT05005637. Updated September 14, 2021. Accessed May 15, 2023. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/ NCT05005637
37. Abatacept in Patients With Birdshot HLA A29 Uveitis (HLA-A29). Clinicaltrials.gov identifier: NCT03871361. Updated January 27, 2023. Accessed May 15, 2023. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03871361
38. Adalimumab Plus Methotrexate for the Treatment of Pediatric Uveitis. Clinicaltrials.gov identifier: NCT04588818.
39. Intravitreal Sirolimus as Therapeutic Approach to Uveitis (SAVE-2). Clinicaltrials.gov identifier: NCT01280669. Updated May 7, 2021.
40. A Study of Brepocitinib in Adults With Active Non-Infectious Non-Anterior Uveitis (NEPTUNE). Clinicaltrials.gov identifier: NCT05523765. Updated May 3, 2023. Accessed May 15, 2023. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05523765.
41. A Multicenter Phase 2 Single-arm Proof-of-concept Trial to Assess the Efficacy and Safety of Ustekinumab in Association With Prednisone for the Treatment of Non-infectious Severe Uveitis (NISU) (USTEKINISU). Clinicaltrials.gov identifier: NCT03847272. Updated April 13, 2021. Accessed May 15, 2023. https://clinicaltrials.gov/ ct2/show/NCT03847272.
42. Reduction or Discontinuation of TNF-α Inhibitor in Noninfectious Uveitis Patients. Clinicaltrials.gov identifier: NCT05155592. Updated December 13, 2021. Accessed May 15, 2023. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/ NCT05155592.
43. Golimumab for the Treatment of Refractory Behcet’s Uveitis. Clinicaltrials.gov identifier: NCT04218565. Updated April 7, 2023. Accessed May 15, 2023. https://clinicaltrials. gov/ct2/show/NCT04218565.
44. Adalimumab vs Conventional Immunosuppression for Uveitis Trial (ADVISE). Clinicaltrials.gov identifier: NCT03828019. Updated June 21, 2022. Accessed May 15, 2023. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03828019
45. Efficacy, Safety and Costs of Methotrexate, Adalimumab, or Their Combination in Non-infectious Non-anterior Uveitis (Co-THEIA). Clinicaltrials.gov identifier: NCT04798755. Updated March 6, 2022. Accessed May 15, 2023. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04798755
46. A Study of Baricitinib (LY3009104) in Participants From 2 Years to Less Than 18 Years Old With Active JIA-Associated Uveitis or Chronic Anterior Antinuclear Antibody-Positive Uveitis. Clinicaltrials.gov identifier: NCT04088409. Updated April 18, 2023. Accessed May 15.
47. A Study of TRS01 in Subjects With Active Noninfectious Anterior Uveitis Including Subjects With Uveitic Glaucoma. Clinicaltrials.gov identifier: NCT05042609. Updated April 18, 2023. Accessed May 15, 2023. https:// clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05042609
48. Safety and Efficacy of an Injectable Fluocinolone Acetonide Intravitreal Insert (FAI). Clinicaltrials.gov identifier: NCT05070728. Updated December 21, 2022. Accessed May 15, 2023. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/ NCT05070728
49. The Use of Two YUTIQ Versus Sham for Treatment of Chronic Noninfectious Intraocular Inflammation Affecting the Posterior Segment (TYNI). Clinicaltrials.gov identifier: NCT05486468. Updated October 31, 2022. Accessed May 15, 2023. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05486468
50. Systemic and Topical Antivirals for Control of Cytomegalovirus Anterior Uveitis: Treatment Outcomes (STACCATO). Clinicaltrials.gov identifier: NCT03586284. Updated July 6, 2022. Accessed May 15, 2023. https:// clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03586284
51. Preventing Extension of Oligoarticular Juvenile Idiopathic Arthritis (Limit-JIA). Clinicaltrials.gov identifier: NCT03841357. Updated August 18, 2022. Accessed May 15, 2023. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03841357
52. A Phase 3 Study Assessing the Efficacy and Safety of Intravitreal Injections of 440 µg DE-109 for the Treatment of Active, Noninfectious Uveitis of the Posterior Segment of the Eye (LUMINA). Clinicaltrials.gov identifier: NCT03711929. Updated November 10, 2022. Accessed May 15, 2023. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03711929
53. Fluocinolone Acetonide Intravitreal Implant 0.18 mg in the Treatment of Chronic Non-Infectious Posterior Segment Uveitis. Clinicaltrials.gov identifier: NCT05322070. Updated August 22, 2022. Accessed May 15, 2023. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05322070
54. Adalimumab in JIA-associated Uveitis Stopping Trial (ADJUST). Clinicaltrials.gov identifier: NCT03816397. Updated March 30, 2023. Accessed May 15, 2023. https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03816397
55. Biologic Therapy in Pediatric JIA Uveitis. Clinicaltrials. gov identifier: NCT05540743. Updated October 4, 2022. Accessed May 15, 2023. https://www.clinicaltrials.gov/ct2/ show/NCT05540743
56. A Clinical Trial of Infliximab for Childhood Uveitis. Clinicaltrials.gov identifier: NCT04150770. Updated November 2, 2021. Accessed May 15, 2023. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04150770
57. A Study to Assess Change in Disease Activity and Adverse Events of Adalimumab in Chinese Participants Requiring High Dose Corticosteroids for Active NonInfectious Intermediate, Posterior, or Pan-Uveitis. Clinicaltrials.gov identifier: NCT05414201. Updated February 10, 2023. Accessed May 15, 2023. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05414201
58. The Efficacy and Safety of Adalimumab in Non-infectious Anterior Pediatric Uveitis With Peripheral Vascular Leakage. Clinicaltrials.gov identifier: NCT05015335. Updated November 10, 2021. Accessed May 15, 2023. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05015335
59. Topical 2% Ganciclovir Eye Drop for CMV Anterior Uveitis / Endotheliitis. Clinicaltrials.gov identifier: NCT02943057. Updated November 17, 2022. Accessed May 15, 2023. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02943057
60. Ozurdex Monotherapy Trial (OM). Clinicaltrials.gov identifier: NCT05101928. Updated December 16, 2022. Accessed May 15, 2023. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05101928

La version “À la demande” est aussi disponible en tout temps.

Aidez vos employé.e.s à atteindre leur plein potentiel.
Favorisez une atmosphère d’apprentissage et de développement.
Faites progresser votre pratique en offrant des soins de meilleure qualité grâce à un personnel bien formé.
L’inscription débute le 22 juillet!

Le 1000 KM Pure Industriel du Grand défi Pierre Lavoie était de retour cette année sous une toute nouvelle mouture !



L ’ ÉQUIP E CLI N IQ U E V I S UE LL E
D E L ONGUE U I L

Mélanie Dubois, Dre Angèle Devaux, OD, Dr Jonathan Alary, OD, Marie-Claude Tanguay, Mathieu Tanguay
L ’ ÉQUIP E D E S
Î LE S- D E - L A - M A DE L E I N E

Émilie Audet, Julien-Claude Boudreau, Dre Sandrine Malaison-Tremblay, OD, Jason Boros, Véronique Dufour, Dre Amélie Poirier, OD
Pendant trois jours soit du 14 au 16 juin dernier, 215 équipes de 5 cyclistes ont parcouru 1000 km qui étaient segmentés en 12 étapes. À travers ces étapes, les cyclistes ont sillonné la région de la Capitale Nationale et des environs. Les 1200 cyclistes ont enfin franchi la ligne d’arrivée à l’Université Laval !
À leur arrivée, chaque cycliste s’est vu remettre une médaille créée et fabriquée au Québec avec de l’aluminium du Saguenay-Lac-Saint-Jean, gracieuseté de Rio Tinto
Toutes nos félicitations aux optométristes ayant participé à ce grand événement !

Dre Sandrine Malaison-Tremblay, OD
Dr Jonathan Alary, OD
Dre Amélie Poirier, OD
L’OPTOMÉTRISTE EST LE PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ OCULAIRE LE PLUS CONSULTÉ 1 000 répondants* 53 %
lunettes, ni lentilles
Optométriste
Ophtalmologiste
Opticien d’ordonnances
Médecin
Urgence, CLSC, infirmière
Aucun, autres, je ne sais pas
Examen de la vue
Changement de vision inexpliqué Yeux qui piquent ou un œil rouge
Corps étranger dans l’œil 34 %
des répondants ont consulté un professionnel pour une urgence oculaire
« GHOSTING » DE RENDEZ-VOUS
12 % oublient d’annuler ou de se présenter à un rendez-vous
Principalement les 18-34 ans (32 %) et plus souvent les hommes (16 % vs 8 % femmes)
66 %
Examen de la vue, santé des yeux
Optométriste
Ophtalmologiste
Urgence, CLSC, infirmière Médecin
Autres, ne se rappelle pas Opticien d’ordonnances
Baisse de la vue, mal aux yeux (yeux secs, vision embrouillée, douleur,…)
Pour acheter des lunettes ou des verres de contact, vérifier la force des lunettes
Rappel visite de contrôle
Emploi, permis de conduire, autres, je ne sais pas
RAISON PRINCIPALE DE LA CONSULTATION 19 % Web
des répondants sont fidèles à leur optométriste dont 42 % depuis 10 ans ou plus
81 % des répondants affirment être satisfaits du dernier examen chez l’optométriste
73 % des répondants affirment consulter leur optométriste au moins une fois aux deux ans
33 % Proximité (maison / travail)
17 % Localisé dans centre commercial souvent fréquenté
25 % Référence parents ou amis
% Site Web de la clinique ou chaîne
*Les répondant ont visité un optométriste au moins une fois dans les trois dernières années.
ENDROIT DE LA DERNIÈRE VISITE CHEZ L’OPTOMÉTRISTE
34 % Chaîne (Doyle, IRIS, NewLook, etc.)
33 % Clinique d’optométristes
21 % Bannière, regroupement d’optométristes
7 % Magasin grande surface
4 % Centre de réadaptation en déficience visuelle, institution d’enseignement, clinique d’ophtalmologie, autres
1 % Je ne sais pas
SUITE À UN EXAMEN DE LA VUE
59 % ont acheté des lunettes
11 % ont acheté des verres de contact
96 % des répondants ont acheté des lunettes ou des verres de contact chez l’optométriste qui a fait l’examen
FACTEURS QUI MOTIVENT LE CHOIX DE L'ENDROIT POUR L'ACHAT
78 % Les prix
75 % Le service après-vente
74 % Le service conseil
71 % L’examen de la vue au même endroit
69 % Le choix des montures
TEMPS D’ÉCRAN QUOTIDIEN
(12 DERNIERS MOIS)
65 % L’accueil et l’ambiance
59 % Une promotion ou un spécial
56 % Le délai pour l’obtention des lunettes / verres de contact
Moins de 150 $ 7 %
150 $ à 250 $ 14 %
251 $ à 450 $
Plus de 650 $ Je ne me souviens plus 26 % 5 %
ACHAT EN LIGNE
Achat en ligne
Intention d’achat (12 prochains mois)
Certainement
Probablement
451 $ à 650 $ 20 % 15 10 43 9 29 30 20 15 46
Lunettes d’ordonnance
Verres de contact Lunettes solaires
73 % ont consulté pour un examen de la vue avant l’achat en ligne
55 % ont regardé ou essayé des montures en magasin avant l’achat en ligne
33 % ont consulté après l’achat en ligne afin de faire ajuster leurs lunettes
des répondants mentionnent que la principale raison de l’achat de lunettes en ligne est le prix
Dans le cas d’une kératoconjonctivite sèche (sécheresse oculaire) modérée ou sévère
PrCEQUAMC (solution ophtalmique de cyclosporine à 0,09 % p/v) est indiqué pour augmenter la production de larmes chez les patients atteints de kératoconjonctivite sèche (sécheresse oculaire) modérée ou sévère.


CEQUA est une préparation fondée sur la technologie des nanomicelles*
* La signification clinique n’est pas connue.
Usage clinique :
Enfants (< 18 ans) : L’efficacité et l’innocuité de CEQUA n’ont pas été établies chez les enfants. Santé Canada n’a donc pas autorisé d’indication pour cette population.
Personnes âgées (> 65 ans) : Dans l’ensemble, aucune différence n’a été observée sur le plan de l’innocuité ou de l’efficacité entre les patients âgés et les patients adultes plus jeunes.
Contre-indications :
• Patients qui présentent une hypersensibilité à ce médicament ou à l’un des composants du produit (y compris les ingrédients non médicinaux) ou du contenant
• Patients atteints d’infections oculaires ou périoculaires évolutives ou soupçonnées
• Patients atteints d’affections oculaires ou périoculaires malignes ou précancéreuses
Mises en garde et précautions pertinentes :
• Destiné à un usage ophtalmique topique seulement
• Il convient de résoudre les infections oculaires ou périoculaires existantes ou soupçonnées avant l’instauration d’un traitement par CEQUA. Si une infection se produit pendant le traitement, l’administration de CEQUA doit être interrompue jusqu’à ce que l’infection ait été enrayée.
• Il faut déconseiller aux patients de conduire un véhicule et d’utiliser des machines jusqu’à ce que leur vision soit redevenue normale après l’administration de CEQUA.
• CEQUA n’a pas été étudié chez des patients ayant des antécédents de kératite herpétique, de maladie des glandes lacrymales en phase terminale, de kératoconjonctivite sèche (KCS) causée par la destruction des cellules caliciformes conjonctivales comme dans le cas d’une carence en vitamine A, ou de tissu cicatriciel comme dans le cas d’une pemphigoïde cicatricielle, de brûlures causées par des produits alcalins, du syndrome de Stevens-Johnson, d’un trachome ou d’une exposition au rayonnement.
• Il faut surveiller de près les patients atteints d’une kératite grave.
• Risque de blessure et de contamination oculaires
• CEQUA ne doit pas être administré pendant que le patient porte des lentilles cornéennes.
• Infections et tumeurs locales : Une surveillance régulière est recommandée lorsque CEQUA est utilisé à long terme.
• Réactions d’hypersensibilité
• Les effets de CEQUA n’ont pas été étudiés chez des patients atteints d’insuffisance rénale ou hépatique.
• CEQUA est déconseillé pendant une grossesse, sauf si les avantages l’emportent sur les risques.
• Il faut faire preuve de prudence lors de l’administration de CEQUA aux femmes qui allaitent. Pour de plus amples renseignements :
Veuillez consulter la monographie de CEQUA à l’adresse https://pdf.hres.ca/dpd_pm/00060038.PDF pour des renseignements importants non abordés ici concernant les effets indésirables, les interactions médicamenteuses et la posologie. Vous pouvez aussi obtenir la monographie du produit en communiquant avec notre Service médical au numéro sans frais 1 844 924-0656.
RÉFÉRENCE : Monographie de CEQUAMC actuelle, Sun Pharma Global FZE.
© 2022 Sun Pharma Canada Inc. Tous droits réservés.
CEQUA est une marque de commerce de Sun Pharma Global FZE. Utilisée sous licence.

Les petites annonces classées de l’AOQ


PM-CA-CQA-0031F


Grâce à la se de la revue l’Op deux coups : votre annonce, au coût de 25 $ par parution (taxes en sus), sera publiée dans la revue et sera distribuée aux optométristes, aux opticiens d’ordonnances, aux ophtalmologistes et aux compagnies d’optique Elle se retrouvera également sur notre site Internet jusqu’à la parution de la prochaine revue Vous bénéficierez donc d’une visibilité accrue
Votre annonce doit contenir environ 50 mots et doit
être au nom d’un optométriste membre de l’AOQ
Vous devez nous faire parvenir votre annonce par courriel à josee lusignan@aoqnet qc ca

MONSIEUR DANNY WALD, CPA
LEADER, QUÉBEC, SERVICES DE COMPTABILITÉ INFONUAGIQUE
514 861-9724 | DANNY.WALD@MNP.CA
Pour l’administration de votre clinique, l’adoption de nouvelles technologies est indispensable pour optimiser vos opérations quotidiennes. Avec les systèmes de gestion financière modernes, il est désormais possible d’automatiser un éventail de tâches. En matière de comptabilité, une solution infonuagique offre de nombreux avantages. Dans cet article, Danny Wald, CPA auditeur et leader des Services de comptabilité infonuagique de MNP au Québec, nous en apprend davantage sur cet outil numérique fiable et précis.
Peu importe la taille de votre clinique, le service FUTÉ offre la possibilité d’automatiser certaines tâches liées à la comptabilité et à la tenue de livres pour améliorer ou maintenir votre rentabilité (gestion des dépenses, facturation, services de paie, etc.). Il ne s’agit pas d’un système informatique, mais d’une intégration à vos applications et logiciels que vous utilisez déjà au sein de votre clinique, comme Quickbooks ou Xero, par exemple.
Qu’est-ce qu’un système comptable infonuagique ?
Il s’agit d’une solution innovante permettant de gérer les activités comptables d’une entreprise à l’aide d’une connexion à Internet. Contrairement aux logiciels installés sur des ordinateurs de bureau, les systèmes infonuagiques sont accessibles par un navigateur Web (à partir d’un appareil mobile ou d’un ordinateur portable, par exemple).
Que ce soit pour la gestion de factures, de dépenses ou d’un système de paie, les logiciels et les applications infonuagiques vous permettent d’optimiser la comptabilité de votre clinique et de vous concentrer sur vos patients. L’adoption d’une telle solution peut d’ailleurs améliorer votre efficacité opérationnelle, tout en réduisant les risques liés à la gestion des données.
La technologie évolue rapidement. Pour certains professionnels, passer du papier au numérique peut être un défi de taille, mais en utilisant des systèmes infonuagiques, les informations financières deviennent plus accessibles et sécurisées. Utilisez-vous les services bancaires en ligne de votre institution financière ? Si vous avez répondu oui à cette question, vous êtes prêt à faire le saut vers une solution infonuagique pour votre clinique.
Solution tout-en-un adaptée à chaque étape du cycle de vie d’une entreprise, le service FUTÉ de MNP donne un coup de main aux professionnels pour la gestion de leurs finances ou la formation de leur personnel à l’aide de technologies infonuagiques. Que votre clinique soit en phase de lancement, de développement ou de départ, ce service s’adapte à ses besoins pour vous permettre de vous consacrer à sa réussite.
sont les avantages du service FUTÉ de MNP ?
Le service FUTÉ vous donnera les moyens de propulser votre clinique vers de nouveaux sommets en ayant l’esprit tranquille. Voici quelques bénéfices :
Accessibilité : une plateforme infonuagique vous permet d’accéder à vos informations financières en ligne à tout moment, n’importe où et depuis n’importe quel appareil (ordinateur portatif, tablette électronique, téléphone intelligent, etc.). En un seul clic, vous pouvez obtenir le portrait de votre situation financière rapidement, où que vous soyez. L’information financière se retrouve au même endroit, ce qui facilite également la collaboration entre les membres de votre équipe et avec vos partenaires.
Un conseiller à vos côtés en tout temps : nos conseillers évalueront les besoins de votre clinique afin de créer une solution sur mesure, veiller à sa mise en œuvre et vous aider avec celle-ci. Avez-vous également besoin de services en fiscalité, en audit ou en planification ?
Avec MNP, il est possible d’avoir accès à l’expertise d’autres professionnels pour la gestion de vos finances. Vous n’aurez plus besoin d’embaucher du personnel seulement pour la comptabilité ou la tenue de livres. De plus, dans un domaine en constante évolution, les besoins de votre clinique peuvent changer en cours de route. Les solutions de comptabilité numériques peuvent facilement être adaptées à votre nouvelle situation et nos conseillers pourront gérer ces changements.
Plusieurs utilisateurs peuvent y avoir accès : le service FUTÉ permet à plusieurs membres de votre équipe d’accéder à vos données comptables. Pour des mesures de sécurité, certains contrôles peuvent être ajoutés ou retirés. Dans le cas de vos employés qui travaillent à temps plein sur votre comptabilité et qui ont besoin d’approuver des documents, il est possible de leur donner un accès administrateur.
Des données financières accessibles en temps réel : avec le service FUTÉ, vous êtes en mesure d’obtenir une vue d’ensemble de vos activités en tout temps (analyses de données, informations financières et rapports, entre autres). Vous n’avez plus besoin d’attendre à la fin de l’exercice financier pour recueillir ces résultats. Vous pouvez être proactif en prenant des décisions fondées sur des données précises qui peuvent avoir un impact sur votre succès rapidement. Une économie de coûts : avec FUTÉ, nul besoin d’acheter de nouveaux logiciels de comptabilité ou du matériel informatique supplémentaire. Les tarifs pour les solutions infonuagiques sont généralement basés sur un abonnement, ce qui vous permettra de mieux contrôler les dépenses.
Sur le plan environnemental, la numérisation de vos documents favorise une gestion plus efficace des ressources et contribue à créer un milieu de travail plus écologique.
Sécurité : comme il ne s’agit pas d’un système informatique, le service FUTÉ utilise des logiciels et des applications qui jouissent d’une excellente réputation en matière de sécurité pour protéger vos informations sensibles. De plus, grâce aux mises à jour automatiques, les logiciels sont toujours à la pointe des normes comptables et des règlementations en vigueur.
Intégration avec des logiciels existants : le service FUTÉ s’intègre avec les logiciels existants de votre clinique (services de paie, facturation, etc.), ce qui facilite une gestion plus efficace des opérations. Puisqu’il n’y a pas d’achat supplémentaire à faire, la plateforme peut s’adapter selon un écosystème de modules complémentaires. Elle est évolutive, rentable et simple à utiliser.
Chaque situation est unique. L’utilisation d’un système comptable infonuagique est une décision stratégique pour toute clinique souhaitant rester concurrentielle dans un marché en constante évolution. Notre équipe sera en mesure de vous aider à choisir la formule la mieux adaptée à vos besoins et à naviguer à travers cette technologie. Que diriez-vous de vous simplifier la tâche au quotidien ? Communiquez avec nous dès maintenant !

Nos conseillers peuvent vous aider avec votre comptabilité virtuelle.


Les modes de prévention et règlement des différends : régler autrement vos conflits pour économiser temps et argent !
Ces dernières années, autant dans les médias que du côté des institutions gouvernementales, les modes de prévention et règlement des différends (modes PRD) ont été mis de l’avant. Faisons un tour de piste afin de bien comprendre ce que sont les modes PRD, pourquoi et quand doit-on les utiliser, et à qui ils s’adressent.

La première question posée lorsqu’il est question des modes PRD est : qu’est-ce que c’est ? Autant du côté du public en général qu’au sein des professionnels, les façons de régler les différends, autres que le tribunal, sont encore méconnues bien qu’utilisées à l’insu des participants. En effet, dès que les gens vivent un conflit, le réflexe est soit de négocier (c’est un mode PRD), soit de se tourner vers les tribunaux. Les tribunaux ne sont pas des modes PRD puisqu’ils représentent un mode de dernier recours après avoir essayé d’autres approches. Le Code de procédure civile1 oblige d’ailleurs les parties à considérer ces autres modes avant de s’adresser aux tribunaux. Les modes PRD sont ainsi placés au centre des options dans le cas d’un conflit.
Le Code de procédure civile nomme expressément trois modes PRD : la négociation, la médiation et l’arbitrage. La négociation peut être faite entre les parties ou à l’aide d’un avocat. Une personne neutre peut également aider à négocier lorsqu’il est difficile de le faire par soi-même (difficulté de communiquer avec l’autre personne, manque de temps, etc.). L’important, c’est que la communication soit fluide entre les personnes qui doivent échanger à propos du problème. En effet, quand les émotions fortes s’en mêlent, il est plus difficile d’arriver à une entente.
Dans les cas où la négociation échoue, il est possible de faire appel à la médiation. Plusieurs types de médiation existent. En matière familiale, les médiateurs sont accrédités et doivent être membres des ordres professionnels désignés afin de pouvoir faire des médiations. Certaines heures peuvent être payées par le ministère de la Justice. En matières civile et commerciale, les médiateurs peuvent être avocats, notaires, ingénieurs, etc.
1 Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01, art.1
Il est important de retenir que le but de la médiation est de créer un environnement neutre où les parties pourront discuter librement des enjeux et trouver des solutions au problème. Le médiateur n’a pas pour rôle de trancher la question, ce n’est pas un juge. Il tente plutôt d’aider les parties à trouver des solutions raisonnables dans un environnement sain et respectueux de chacun. En principe, la médiation est au choix des parties. Si une des parties refuse, la médiation n’aura pas lieu. Si les parties acceptent la médiation, elles choisissent ensemble le médiateur et se partagent les frais. Il faut souligner qu’en matière de petites créances, certaines régions ont maintenant un service de médiation obligatoire pour les demandes de 5 000 $ et moins2 Le médiateur aux petites créances est habituellement un avocat ou un notaire et il est payé par le ministère de la Justice. Finalement, sachez que des services de médiation citoyenne sont offerts dans l’ensemble des régions du Québec. Ce service gratuit offert par des médiateurs bénévoles peut vous aider à démêler votre situation et, par un processus simple et adapté, vous permettre de trouver une solution à votre problème3. La médiation citoyenne est régulièrement utilisée pour les conflits entre voisins. Notez que même les tribunaux peuvent avoir des services de médiation ou de conciliation. Si vous êtes dans un processus judiciaire devant un tribunal, vérifiez avec celui-ci les options disponibles.
2 https://www.quebec.ca/justice-et-etat-civil/petites-creances/mediation-arbitrage-petites-creances/mediation-obligatoire
3 https://equijustice.ca/fr/services-de-justice-reparatrice/mediation-citoyenne
4 https://www.quebec.ca/justice-et-etat-civil/modes-prevention-reglement-differends/arbitrage
Dans un dernier temps, l’arbitrage4 est également un mode PRD prévu au Code de procédure civile. Il est principalement utilisé en droit du travail et dans les contrats. Le processus d’arbitrage ressemble beaucoup au processus judiciaire. Les avantages de l’arbitrage, contrairement au dépôt d’une demande au tribunal, sont la rapidité, la confidentialité (l’audition est publique alors que l’arbitrage est privé), et enfin, le fait de mettre fin au litige de manière définitive (pas de possibilité d’appel). Informez-vous des frais et des règles applicables devant l’arbitre.
Pourquoi utiliser un mode PRD ? La négociation et la médiation, notamment, vous permettent d’entrer en communication avec l’autre partie afin de mentionner ce que vous vivez et ce que vous voulez et d’entendre la version de l’autre. Le fait d’échanger directement ou plus précisément sur les enjeux vécus évite les suppositions et les hypothèses qui peuvent ne pas être admissibles en preuve ni même pertinentes devant le tribunal. Vous pouvez donc économiser du temps et de l’argent en ciblant les réels enjeux. De plus, les services de médiation peuvent être gratuits ou certaines heures payées par le ministère de la Justice. Encore une fois, cela vous permet d’économiser. De plus, en matière commerciale, il peut être intéressant de négocier ou d’arriver à une entente en dehors des tribunaux. Sachez qu’en principe, les audiences devant les tribunaux sont publiques et les décisions rendues également. Une entente entre les parties est de nature privée, donc en principe, confidentielle.
Quand utilise-t-on les modes PRD ?
Quand vous voulez! Même lorsque vous êtes en processus judiciaire, il peut être possible de négocier avec l’autre partie ou son avocat. Donc, avant même le processus judiciaire, sauf s’il y a des interdictions de contact, il est possible de négocier ou de demander à l’autre personne d’aller en médiation.
Qui peut utiliser les modes PRD ?
Tout le monde, que vous soyez un particulier, une entreprise, une société par actions, ou une association, vous avez accès aux modes PRD, soit par l’entremise de votre professionnel du droit, qui pourra négocier ou prévoir des clauses de médiation dans vos contrats, soit par vous-même en prenant le temps de discuter et de comprendre les besoins et les insatisfactions de l’autre partie, soit votre clientèle, vos fournisseurs ou toute autre partie prenante.
À retenir : prendre le temps de communiquer avec vos clients et fournisseurs peut vous faire épargner beaucoup de temps sur des conflits à venir et plusieurs dollars. Prenons le temps de se parler !
Si vous avez des questions sur ce sujet ou sur toute autre question juridique, vous pouvez communiquer avec les avocats de votre ligne d’assistance téléphonique juridique gratuite du lundi au vendredi de 8 h à 18 h en composant le 1 877 579-7052.



Viatris lance Ryzumvi pour l’inversion de la mydriase
Principaux renseignements :
Viatris lance Ryzumvi pour l’inversion de la dilatation.
Le médicament agit généralement en 30 minutes.
Viatris lance le premier collyre commercialisé et approuvé par la FDA pour l’inversion de la dilatation, selon un communiqué de presse.
La FDA a approuvé Ryzumvi (solution ophtalmique de phentolamine 0,75 %) en septembre 2023 suite aux résultats positifs de deux essais randomisés contrôlés par véhicule.
Viatris lance le premier collyre commercialisé et approuvé par la FDA pour l’inversion de la dilatation, selon un communiqué de presse.
Dans les essais MIRA-2 et MIRA-3, 553 patients âgés de 12 à 80 ans ont subi une mydriase induite par l’instillation de phényléphrine, de tropicamide ou de Paremyd (solution ophtalmique d’hydrobromide d’hydroxyamphétamine/ tropicamide) suivie de deux gouttes de Ryzumvi dans l’œil étudié ou d’une goutte dans l’autre œil de Ryzumvi ou d’un placebo une heure après l’instillation de l’agent mydriatique.
Quatre-vingt-dix minutes après l’administration, 49 % et 58 % des patients ayant reçu deux gouttes de Ryzumvi ont retrouvé un diamètre pupillaire de 0,2 mm ou moins par rapport à la valeur initiale, contre 7 % et 6 % des patients ayant reçu le placebo. Le début de l’action de Ryzumvi se produit généralement en 30 minutes, selon le communiqué.
Source : https://www.healio.com/news/ophthalmology/20240401/viatris-launchesryzumvi-for-mydriasis-reversal#:~:text=Viatris%20is%20launching%20 the%20first,randomized%2C%20vehicle%2Dcontrolled%20trials.

La FDA approuve l’essai LYNX-2 de la phentolamine en solution ophtalmique pour le traitement de la mauvaise vision de nuit Ocuphire Pharma a reçu l’accord de la FDA dans le cadre d’une évaluation spéciale du protocole pour son essai de phase 3 LYNX-2, une étude de la solution ophtalmique de phentolamine pour le traitement de l’acuité visuelle réduite dans des conditions de faible luminosité.
Selon un communiqué de presse de la société, la FDA a reconnu que le protocole de l’essai clinique et l’analyse statistique prévue pouvaient répondre de manière adéquate aux objectifs soutenant la soumission réglementaire et la future demande de mise sur le marché.
« L’accord SPA (évaluation de protocole spéciale) avec la FDA fournit une voie réglementaire claire pour la solution ophtalmique de phentolamine chez les patients ayant une mauvaise vision nocturne après une chirurgie kérato-réfractive », déclare George Magrath, MD, MBA, MS, PDG d’Ocuphire, dans le communiqué. « Les préparatifs de l’essai de phase 3 LYNX-2 ont commencé et nous prévoyons que le recrutement des patients débutera au premier trimestre 2024. »
L’essai multicentrique, randomisé, en double aveugle et contrôlé par placebo étudiera l’innocuité et l’efficacité de la solution ophtalmique de phentolamine chez un maximum de 200 patients aux États-Unis. Le principal résultat d’intérêt est un gain d’au moins trois lignes, ou 15 lettres, d’amélioration de la vision de loin sur une carte à faible contraste dans des conditions de faible luminosité après 15 jours de traitement.
« Actuellement, il n’existe aucun traitement pharmacologique approuvé par la FDA pour traiter cette condition qui est régulièrement présentée dans nos cliniques », explique Marguerite McDonald, MD, FACS, professeur clinique d’ophtalmologie au centre médical Langone de l’Université de New York et au centre des sciences de la santé de l’Université de Tulane, dans le communiqué. « La phentolamine en solution ophtalmique se distingue des autres antibiotiques de sa catégorie par le fait qu’elle ne réduit pas la pupille, ce qui peut diminuer le contraste et dégrader la vision.
Source : https://www.ocuphire.com/news-media/press-releases/detail/425/ ocuphire-pharma-receives-fda-agreement-under-special https://optimumdestination.com/2024/01/04/fda-agrees-to-lynx-2-trial-ofphentolamine-ophthalmic-solution-for-poor-night-vision/
La FDA approuve Ryzumvi (solution ophtalmique de phentolamine 0,75 %) pour le traitement de la mydriase induite par des médicaments
Ocuphire Pharma et Viatris ont développé ensemble ce médicament pour inverser la mydriase pharmacologiquement induite par des agents agonistes adrénergiques ou parasympatholytiques1
La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé le collyre à la phentolamine 0,75 % (Ryzumvi) pour l’inversion de la mydriase pharmacologiquement induite par des agents agonistes adrénergiques ou parasympatholytiques, ou par une combinaison de ceux-ci, qui a été formulé par Ocuphire Pharma et Viatris1. Anciennement connu sous le nom de Nyxol, le Ryzumvi, fraîchement rebaptisé, est un collyre stable, sans conservateur, qui bloque le récepteur α1 dans le muscle dilatateur de l’iris sans affecter le muscle ciliaire. Le résultat est destiné à inverser la mydriase, la presbytie et les troubles de la vision nocturne induits par la pharmacologie.
Aux États-Unis, on estime à 100 millions le nombre de dilatations oculaires effectuées chaque année pour des examens de routine, le suivi de maladies ou des interventions chirurgicales sur la rétine2. Les effets secondaires de la mydriase pharmacologique comprennent une sensibilité à la lumière (photophobie) et une vision floue pouvant durer jusqu’à 24 heures, ce qui peut rendre difficile la lecture, le travail et la conduite3
L’approbation de Ryzumvi fait suite au dépôt d’une demande d’autorisation de mise sur le marché (NDA) en décembre et à l’acceptation de la NDA par la FDA en février. La NDA a été déposée conformément aux résultats de l’essai clinique MIRA. Lors du dépôt de la NDA, Ocuphire a indiqué que la solution ophtalmique de phentolamine 0,75 % ramène rapidement les yeux dilatés à leur diamètre pupillaire de base dès 60 à 90 minutes après la dilatation. Rick Rodgers, MBA, PDG par intérim d’Ocuphire, a évoqué l’approbation et la collaboration entre Ocuphire et Viatris dans un communiqué de presse1
Ocuphire a fait état de données préliminaires positives issues des essais cliniques MIRA — MIRA-1, MIRA-2, MIRA-3 et MIRA-4 — dans l’inversion de la mydriase, de l’essai de phase 3 LYNX-1 dans les troubles de la vision nocturne et de l’essai de phase 2 b VEGA-1 pour la solution ophtalmique de phentolamine 0,75 % en tant qu’agent unique et en tant que traitement d’appoint avec une faible dose de pilocarpine à 0,4 % dans la presbytie. Ocuphire a noté que la solution ophtalmique de phentolamine 0,75 % a été étudiée dans un total de 12 essais cliniques (3 Phase 1, 5 Phase 2, 4 Phase 3) sur un total d’environ 1 100 patients (avec plus de 650 patients traités à la phentolamine) et a démontré des données cliniques prometteuses pour l’utilisation dans les multiples indications ophtalmiques mentionnées ci-dessus.
Les essais MIRA-2 et MIRA-3 ont atteint avec succès leur objectif principal et leurs principaux objectifs secondaires, démontrant une supériorité statistiquement significative de la solution ophtalmique de phentolamine 0,75 % par rapport au placebo pour ramener rapidement les yeux dilatés à leur diamètre pupillaire de base dès 60 et 90 minutes. Le collyre de phentolamine 0,75 % a montré un profil d’innocuité et de tolérance favorable dans tous les essais. De plus, les résultats positifs de l’essai pédiatrique MIRA-4 soutiennent un élargissement potentiel de l’étiquetage de la solution pour l’inversion de la mydriase pour inclure les sujets âgés de 3 ans et plus.
Les essais cliniques MIRA
Dans les essais MIRA-2 et MIRA-3, un total de 553 sujets âgés de 12 à 80 ans, ayant subi une mydriase induite par l’instillation de phényléphrine ou de tropicamide ou d’une combinaison de bromhydrate d’hydroxyamphétamine et de tropicamide (Paremyd), ont été randomisés. Deux gouttes (œil de l’étude) ou une goutte placebo (œil du patient) de Ryzumvior (véhicule) ont été administrées une heure après l’instillation de l’agent mydriatique.
Le pourcentage de sujets dont les yeux étudiés sont revenus à un diamètre pupillaire ≤ 0,2 mm par rapport au diamètre initial était statistiquement plus élevé (p < 0,01) à tous les points temporels mesurés de 60 minutes à 24 heures dans le groupe Ryzumvi par rapport au groupe placebo (véhicule) dans les deux essais MIRA-2 et MIRA-3. L’efficacité de Ryzumvi était similaire dans toutes les tranches d’âge, y compris chez les enfants âgés de 3 à 17 ans. Les sujets pédiatriques âgés de 12 à 17 ans (n = 27) ont été traités dans les essais MIRA-2 et MIRA-3 et les sujets pédiatriques âgés de 3 à 11 ans (n = 11) ont été traités dans l’essai MIRA-4.
« L’approbation de Ryzumvi par la FDA marque une étape importante pour notre division Eye Care et souligne l’engagement de Viatris à faire progresser les soins oculaires et à en améliorer l’accès pour les professionnels des soins oculaires et les patients », déclare le président de la division Eye Care de Viatris, Jeffrey Nau, Ph. D.
Informations sur l’innocuité de la solution ophtalmique de phentolamine 0,75 % (Ryzumvi) :
Uvéite : L’utilisation du collyre Phentolamine 0,75 % (Ryzumvi) n’est pas recommandée chez les patients souffrant d’une inflammation oculaire active (par exemple, iritis).
Risque de lésion oculaire ou de contamination : Évitez de toucher l’embout du flacon avec l’œil, ou toute autre surface, afin d’éviter tout risque de blessure ou de contamination de l’œil.
Utilisation avec des lentilles de contact : Conseiller aux porteurs de lentilles de contact de retirer leurs lentilles avant l’instillation de la solution ophtalmique de phentolamine 0,75 % et d’attendre 10 minutes après l’administration avant de remettre leurs lentilles de contact.
Effets indésirables
La gêne au point d’instillation (16 %), l’hyperémie conjonctivale (12 %) et la dysgueusie (6 %) ont été les effets indésirables les plus fréquemment rapportés.
1. Ocuphire Pharma and Viatris announce FDA approval of RYZUMVI™ (phentolamine ophthalmic solution) 0.75% eye drops for the treatment of pharmacologicallyinducedmydriasis produced by adrenergic agonists (e.g., phenylephrine) or parasympatholytic (e.g., tropicamide) agents. Ocuphire Pharma. Press release. Released September 27, 2023. Accessed September 27, 2023. https://www.ocuphire.com/news-media/press-releases/ detail/415/ocuphire-pharma-and-viatris-announce-fdaapproval-of
2. Wilson FA, Stimpson JP, Wang Y. Inconsistencies exist in national estimates of eye care services utilization in the United States. J Ophthalmol. 2015;2015:435606. doi: 10.1155/2015/435606. Epub 2015 Aug 9. PMID: 26346484; PMCID: PMC4546761
3. PAREMYD® (hydroxyamphetamine hydrobromide/ tropicamide ophthalmic solution) 1%/0.25% US prescribing information. Somerset, NJ.: Akorn, Inc.; 2001.
4. Ocuphire announces FDA acceptance of new drug application and PDUFA date of September 28, 2023 for Nyxol® eye drops for reversal of mydriasis. Press release. Released February 13, 2023. Accessed September 27, 2023. https://www.ocuphire.com/news-media/pressreleases/detail/396/ocuphire-announces-fda-acceptanceof-new-drug-application
La kératoplastie et la réticulation peuvent être efficaces dans le kératocône progressif
La kératoplastie lamellaire intrastromale combinée à la réticulation du collagène améliore la stabilité tectonique et la résistance biomécanique des cornées avec un kératocône tout en aplatissant la cornée et en améliorant l’acuité visuelle.
« Nous pouvons l’utiliser comme traitement de rechange pour stabiliser le kératocône progressif dans les cornées plus fines pour lesquelles nous ne pouvons pas effectuer uniquement une réticulation du collagène », a déclaré le docteur M.S. Swathi lors de la réunion d’hiver de l’ESCRS.
Le traitement comprend la création assistée par laser femtoseconde d’une poche stromale à 180 μm de profondeur et l’insertion dans la poche d’un lenticule donneur de 150 μm d’épaisseur et de 8 mm à 8,75 mm de diamètre. La CXL est ensuite réalisé après élimination de l’épithélium.
« Notre objectif était d’évaluer les changements biomécaniques de la cornée après la procédure. Nous avons mené une étude sur 10 patients atteints de kératocône progressif, en les suivant pendant une période de 6 mois. Nous avons principalement inclus des patients dont la pachymétrie la plus fine était comprise entre 350 μm et 400 μm, dont la meilleure acuité visuelle corrigée était inférieure à 6/18 et qui ne toléraient pas les lentilles de contact », explique Dr Swathi.
L’épaisseur de la cornée est passée de 428 μm à 557 μm, et les paramètres de Corvis ST (Oculus), notamment la rigidité et l’amplitude de la déformation, se sont considérablement améliorés. La topographie a également montré des changements significatifs, avec un aplatissement de 1,06 D en K1, de 2,42 D en K2 et de 3,84 D en kératométrie maximale. L’acuité visuelle non corrigée et la BCVA se sont améliorées d’environ une ligne.
Source : Swathi MS, et al. Corneal biomechanical changes following keratoplasty plus (intrastromal lamellar keratoplasty combined with collagen crosslinking) procedure in progressive keratoconus – pilot study. Presented at: ESCRS winter meeting; Febr. 15-18, 2024; Frankfurt, Germany.

Aucun impact sur l’état de réfraction n’a été constaté 10 à 20 ans après une utilisation à court terme de l’atropine
Ces résultats soulèvent des questions sur la durée du traitement nécessaire pour obtenir un résultat durable, sur le moment où la thérapie peut être interrompue et, dans l’ensemble, sur la valeur de cette intervention dans la gestion de la myopie.
Une longueur axiale (LA) plus longue au départ dans l’enfance et un allongement axial plus important pendant le traitement au cours de la période d’essai clinique ont été associés à une incidence plus élevée de dégénérescence maculaire myopique précoce chez les participants adultes.
Les résultats des essais cliniques des gouttes oculaires topiques d’atropine pour le contrôle de la myopie chez l’enfant n’étant pas uniformes d’un essai à l’autre à court terme, il est essentiel d’en établir l’innocuité et les effets à long terme. Des chercheurs de l’Institut de recherche de Singapour ont mené l’étude ATLAS (Atropine Treatment Long-term Assessment Study) afin d’évaluer les résultats du suivi à 20 ans et l’innocuité pour les patients ayant participé à l’étude ATOM1 et les résultats du suivi à 10 ans des patients ayant participé à l’étude ATOM2. Leurs résultats, publiés dans JAMA Ophthalmology, confirment l’importance des essais de traitement randomisés à court terme complétés par un suivi à long terme des participants lorsque la condition médicale étudiée peut continuer à évoluer après l’arrêt de l’intervention. Cependant, en ce qui concerne le traitement de contrôle de la myopie, on peut s’attendre à ce que la progression se poursuive jusqu’à deux décennies après la fin de la partie randomisée et de la partie initiale d’observation post-traitement de ces essais1
Cette étude prospective d’observation en double aveugle des essais cliniques randomisés ATOM1 et ATOM2 s’est déroulée dans deux centres uniques et a inclus des adultes examinés en 2021-2022 dans le cadre de l’étude ATOM1 (atropine 1 % vs placebo; de 1999 à 2003) et de l’étude ATOM2 (atropine 0,01 % vs 0,1 % vs 0,5 %; de 2006 à 2012).
Dans ces cohortes, l’utilisation de collyres topiques d’atropine à court terme allant de 0,01 % à 1,0 % pendant une durée de deux à quatre ans à partir de l’âge d’environ neuf ans avec une myopie modérée n’a pas été associée à des différences dans les états de réfraction finaux 10 à 20 ans après le traitement. Il n’y a pas eu d’augmentation de l’incidence des complications oculaires liées au traitement ou à la myopie dans le groupe traité par l’atropine à 1 % par rapport au groupe placebo.
« Cette étude pourrait confirmer la littérature existante selon laquelle l’atropine pourrait être inefficace pour réduire la progression de la myopie, cette étude examinant spécifiquement la progression à l’âge adulte par l’observation des résultats sur une période de 10 à 20 ans », écrivent les auteurs de l’étude dans leur article. « Ces observations soulèvent plusieurs questions de recherche qui méritent d’être approfondies, la durée du traitement à l’atropine nécessaire pour obtenir un résultat durable, le moment où le traitement peut être arrêté, et l’opportunité de diminuer la dose ou de poursuivre le traitement jusqu’au milieu de l’adolescence1 »
Un commentaire de Michael Repka, MD, également publié dans le JAMA Ophthalmology, a souligné que les résultats de l’étude ATLAS offraient une certaine garantie de sécurité puisqu’il n’y avait pas de différences dans le taux d’événements indésirables dans toutes les analyses, sauf une. Il a également souligné que les données sur les résultats à long terme des gouttes oculaires d’atropine pour le contrôle de la myopie doivent être interprétées avec prudence et qu’elles devraient largement servir de guide pour la planification des recherches futures.2
L’auteur a toutefois noté que l’efficacité à long terme de l’atropine pour le contrôle de la myopie était remise en question. « Honnêtement, les résultats sont décevants », écrit le Dr Repka.
« Après un suivi à très long terme des études ATOM1 (environ 20 ans) et ATOM2 (environ 10 ans), les gouttes oculaires d’atropine à 1,0 % pour le contrôle de la myopie n’étaient pas meilleures que le placebo ou les yeux non traités dans l’étude ATOM1 et entre les concentrations dans l’étude ATOM2 (0,01 %, 0,1 % et 0,5 %) en ce qui concerne les résultats d’erreur réfractive à long terme, a-t-il poursuivi. La progression de la myopie après l’essai clinique randomisé ATOM2 était plus importante après l’arrêt d’une concentration d’atropine de 0,5 % qu’avec des concentrations plus faibles (0,01 % et 0,1 %), éliminant ainsi le bénéfice initial observé avec le dosage le plus fort, comme on l’avait vu lors d’un suivi antérieur. Une progression plus importante après le traitement était associée à un âge plus jeune au moment du traitement, ce qui indique qu’il s’agit d’un groupe à cibler dans les études futures ».
« Les résultats de l’étude ATLAS nous rappellent qu’il existe une incertitude quant à la valeur et à l’innocuité à long terme des gouttes oculaires d’atropine pour le contrôle de la myopie », conclut le commentaire.
« Ces résultats soulignent la nécessité de mener des études cliniques randomisées pour définir des stratégies efficaces et sûres de contrôle de la myopie à un stade précoce du développement de la myopie, mais aussi d’inclure des méthodes permettant d’obtenir des études critiques à long terme sur les résultats de l’état de la réfraction2 ».
Source : https://www.reviewofoptometry.com/article/no-refractive-error-impactfound-10-to-20-years-after-shortterm-atropine-use
1. Li Y, Yip M, Ning Y, et al. Topical atropine for childhood myopia control: the atropine treatment long-term assessment study. JAMA Ophthalmol. November 30, 2023. [Epub ahead of print].
2. Repka MX. Atropine eye drops for myopia control in childhood—more long-term data, please. JAMA Ophthalmol. November 30, 2023. [Epub ahead of print].

La réticulation est efficace dans le syndrome d’érosion cornéenne récurrente
La réticulation de la cornée s’est avérée être un traitement de rechange efficace pour le syndrome d’érosion cornéenne récurrente et a permis de soulager les symptômes sans récidive après un an.
Le syndrome d’érosion cornéenne récurrente est une affection courante causée par l’affaiblissement de l’adhésion de la membrane basale de la cornée à l’épithélium, selon le résumé de l’étude.
« Alors, pourquoi ne pas utiliser la réticulation pour renforcer les connexions entre la membrane basale et l’épithélium ? » a déclaré le docteur Olga Diego Navarro lors de la réunion d’hiver de l’ESCRS.
Une étude rétrospective, réalisée au Complejo Hospitalario Universitario d’Albacete, en Espagne, a évalué cette nouvelle utilisation hors étiquette de la CXL et a inclus 10 yeux de patients âgés de plus de 18 ans n’ayant pas répondu au traitement conservateur, avec un suivi d’un an. Le protocole de Dresde a été utilisé dans trois yeux et un protocole accéléré a été utilisé dans sept yeux.
« Dans notre population, le syndrome était plus fréquent chez les femmes d’environ 46 ans et les principaux facteurs de risque étaient la dystrophie de la membrane basale épithéliale (70 %) et un traumatisme antérieur (30 %) », a déclaré Diego Navarro.
Une réduction significative de la pachymétrie a été observée après le traitement, de 542,8 μm en préopératoire à 502,8 μm en postopératoire (P < 0,05). L’endothélium n’a pas été affecté. La réfraction a montré un déplacement vers l’hypermétropie d’environ 1 D, consécutif à l’aplatissement de la cornée, mais la meilleure acuité visuelle corrigée est restée inchangée. Il n’y a pas eu de complications ni de récidives après un an de suivi.
Source : Diego Navarro O, et al. New cross-linking applications: Off-label alternative use for recurrent corneal erosion syndrome. Presented at: ESCRS winter meeting; Feb. 15-18, 2024; Frankfurt, Germany.

Évaluation de l’acuité visuelle chez les patients atteints de DMLA sèche après stimulation électrique à microcourant
Contexte : Évaluer le microcourant pour améliorer la vision dans le cas de la dégénérescence maculaire sèche liée à l’âge. La dégénérescence maculaire sèche liée à l’âge est une cause majeure de cécité, d’invalidité et d’érosion sévère de la qualité de vie dans le monde entier. En dehors de la supplémentation nutritionnelle, il n’existe pas de thérapie approuvée.
Méthodes : Il s’agit d’un essai clinique prospectif randomisé contrôlé par simulacre pour des participants atteints de DMLA sèche confirmée avec perte visuelle documentée. Les participants ont été randomisés à trois contre un pour recevoir une stimulation électrique externe transpalpébrale par microcourant avec l’appareil MacuMira (Calgary). Le groupe traité a reçu quatre traitements au cours des deux premières semaines, et deux traitements supplémentaires aux semaines 14 et 26. Les différences de BCVA et de sensibilité aux contrastes (SC) ont été estimées à l’aide d’une analyse de variance à effets mixtes et à mesures répétées.
Résultats : Changement de l’acuité visuelle avec l’évaluation ETDRS du nombre de lettres lues (NLR) et de la sensibilité au contraste aux semaines 4 et 30, par rapport à la première visite, entre 43 participants traités et 19 participants du groupe témoin. Le groupe de contrôle avait un NLR de 24,2 (SD 7,1) au départ, 24,2 (SD 7,2) à 4 semaines et 22,1 (SD 7,4) à 30 semaines. Le groupe Traitement avait un NLR de 19,6 (SD 8,9) au départ, 27,6 (SD 9,1) à 4 semaines et 27,8 (SD 8,4) à 30 semaines. Le changement de NLR par rapport à la valeur initiale dans le groupe traité par rapport au groupe témoin était de 7,7 (IC à 95 % 5,7, 9,7, p < 0,001) à 4 semaines et de 10,4 (IC à 95 % 7,8, 13,1, p < 0,001) à 30 semaines. Les bénéfices étaient similaires pour la SC. Conclusions : Cette étude pilote sur le microcourant transpalpébral a démontré une amélioration des mesures visuelles et est très encourageante en tant que traitement potentiel de la DMLA sèche.

Enregistrement de l’essai : NCT02540148, ClinicalTrials.gov. Stimulation électrique transpalpébrale par microcourant
Source : Parkinson KM, Sayre EC, Tobe SW. Evaluation of visual acuity in dry AMD patients after microcurrent electrical stimulation. Int J Retina Vitreous. 2023 Jun 18;9(1):36. doi: 10.1186/s40942-023-00471-y. PMID: 37331928; PMCID: PMC10278316.

Une étonnante lentille de contact en forme de spirale utilise un « vortex optique » pour corriger la vue

La nouvelle lentille pourrait être utilisée dans les lentilles de contact. (Laurent Galinier)
Des scientifiques ont conçu une nouvelle lentille de contact étonnante qui pourrait révolutionner la vision. Elle est basée sur un motif en spirale qui permet à l’œil de faire la mise au point à différentes distances et dans des conditions d’éclairage variées.
Au-delà des lentilles de contact, les inventeurs affirment que cette technologie pourrait être appliquée à toute une série de systèmes d’imagerie miniaturisés, y compris des gadgets grand public tels que les casques de réalité virtuelle, afin d’offrir plus de polyvalence et de flexibilité que les lentilles existantes.
La lentille, appelée dioptre en spirale, fait tourner la lumière entrante dans un vortex optique, ce qui permet de tenir compte des diverses déformations de la cornée de l’œil qui peuvent survenir avec l’âge.
« Contrairement aux lentilles multifocales existantes, notre lentille fonctionne bien dans une large gamme de conditions lumineuses et conserve sa multifocalité quelle que soit la taille de la pupille », explique Bertrand Simon, du Laboratoire de photonique, numérique et nanosciences (LP2N), en France.
« Pour les utilisateurs potentiels d’implants ou les personnes souffrant d’hypermétropie liée à l’âge, elle pourrait fournir une vision claire et constante, ce qui pourrait révolutionner la vision ».
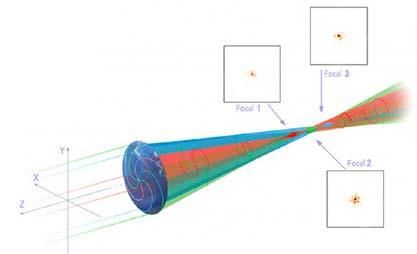
À l’heure actuelle, les personnes âgées souffrant d’hypermétropie et de cataracte peuvent utiliser des verres progressifs pour faire la mise au point à différentes distances, les différentes parties du verre ayant des puissances d’agrandissement différentes.
Ici, tout est réuni dans une seule lentille, beaucoup plus petite, sans les distorsions qui peuvent se produire autour de la vision périphérique du porteur, grâce à l’application d’une spirale basée sur la spirale de Fermat.
Bien que les chercheurs soient encore loin de pouvoir produire en masse des lentilles de contact à dioptrie spiralée, ils ont effectué des simulations et des tests au laser qui ont montré que la lentille fonctionnait comme prévu. Des expériences menées sur des volontaires ont également donné des résultats prometteurs.
« La création d’un vortex optique nécessite généralement plusieurs composants optiques », explique Laurent Galinier, de la société d’optique SPIRAL SAS en France. « Notre lentille, en revanche, intègre directement à sa surface les éléments nécessaires à la création d’un vortex optique ».
« La création de vortex optiques est un domaine de recherche en plein essor, mais notre méthode simplifie le processus, ce qui constitue une avancée significative dans le domaine de l’optique ».
Tout cela est très positif, mais il reste encore beaucoup de travail à faire : l’équipe affirme que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre la nature exacte des vortex optiques (ou de la lumière tordue) produits par le dioptre en spirale.

Ensuite, la technologie devra être testée dans des lunettes pour les personnes dont la vision n’est pas parfaite, dans des scénarios réels. Les chercheurs mentionnent également une série d’autres applications dans des caméras allant des drones aux voitures autopilotées.
« Outre les applications visuelles, la conception simple de cette lentille pourrait grandement profiter aux systèmes d’imagerie compacts », explique M. Simon.
« Elle rationaliserait la conception et la fonction de ces systèmes tout en offrant un moyen de réaliser des images à différentes profondeurs sans éléments optiques supplémentaires ».
Source : https://www.sciencealert.com/amazing-spiral-shaped-contact-lensuses-optical-vortex-to-correct-vision#:~:text=Contact-,Amazing%20 Spiral%2DShaped%20Contact%20Lens%20Uses,Optical%20Vortex’%20 to%20Correct%20Vision&text=Scientists%20have%20designed%20a%20 striking,and%20in%20varying%20lighting%20conditions.

Les enfants souffrant d’un excès de convergence sont les moins réceptifs au traitement par lentilles DIMS pour la myopie
C’est ce qui a été constaté par rapport à d’autres types de dysfonctionnement de la vergence dans une population d’enfants chinois.
Les verres de lunettes conçus pour réduire la progression de la myopie ne sont pas encore commercialisés aux ÉtatsUnis, mais il est utile de comprendre leurs forces et leurs faiblesses en prévision de leur éventuelle commercialisation dans ce pays. À cette fin, une nouvelle étude menée en Chine pourrait s’avérer intéressante.
Une équipe de Pékin a récemment étudié le rôle des verres de lunettes DIMS (de focus incorporated multiple segments) dans le ralentissement de la myopie. Les chercheurs ont recruté rétrospectivement 292 enfants myopes à qui l’on avait prescrit des lentilles DIMS, le dysfonctionnement de la vergence étant déterminé par la phorie de loin et de près. La longueur axiale (LA) et la réfraction subjective cycloplégique ont été effectuées avant l’adaptation des lentilles et lors des suivis à six mois et à un an. La LA et le changement d’équivalent sphérique (ES) par rapport à la ligne de base ont été calculés pour les deux suivis, puis comparés dans des sous-groupes stratifiés selon le type de dysfonctionnement de la vergence.

Il est possible que le retard d’accommodation affaiblisse l’effet des lentilles DIMS, ont supposé les chercheurs en examinant les résultats de leur étude.
Photo : Hoya Vision Care
Les chercheurs ont constaté un allongement axial significatif et une progression de l’ES aux deux périodes de suivi. L’augmentation de la LA à six mois et à un an était négativement corrélée à l’âge, tandis que la progression de l’ES à six mois était associée à l’âge. À six mois, l’allongement de la LA chez les enfants présentant un excès de convergence était plus important que chez les myopes normaux, ainsi que chez ceux présentant une insuffisance de convergence, un excès de divergence, une insuffisance de divergence et une ésophorie de base à six mois.
Les lunettes DIMS offrent la possibilité de ralentir de manière significative la progression de la myopie par rapport aux lunettes à vision unique grâce à la défocalisation myopique dans la rétine mipériphérique. Cependant, des recherches antérieures ont indiqué que différents types de dysfonctionnement de la vergence sont corrélés à l’erreur de réfraction, et l’impact du dysfonctionnement de la vergence est inconnu sur les personnes dont la myopie progresse et qui portent des lentilles DIMS.
Cette recherche actuelle jette un peu de lumière sur cette question, en démontrant que les porteurs de lentilles DIMS présentant un excès de convergence ont connu une élongation de la LA plus rapide que ceux ne présentant pas de dysfonctionnement de la vergence ou présentant d’autres types de dysfonctionnement de la vergence. Les patients souffrant d’un excès de divergence présentaient également une progression ralentie de l’ES par rapport aux autres types de dysfonctionnement de la vergence.
Les auteurs précisent que leurs résultats indiquent que les porteurs de DIMS avaient une élongation moyenne de la LA de 0,21 mm et une progression moyenne de l’ES de 0,48 D à un an, deux mesures qui sont cohérentes avec des études antérieures.
Le fait que les changements de la LA et de l’ES soient associés à l’âge est également conforme aux études antérieures. Plus un enfant est jeune, plus sa myopie progresse rapidement et plus il subit une élongation de la LA. Par conséquent, les enfants plus jeunes peuvent avoir besoin d’une défocalisation myopique plus importante pour contrôler la myopie.
D’autres études ont montré que la convergence accommodative était plus importante à l’apparition de la myopie et que la vergence fusionnelle positive de près était plus élevée chez les enfants myopes que chez les enfants emmétropes. De même, l’augmentation de la convergence accommodative et du rapport d’accommodation est associée à un décalage accommodatif.
Comme l'expliquent les auteurs, « en théorie, le retard d’accommodation peut provoquer une défocalisation hyperopique qui affaiblit l’effet des lentilles DIMS, qui induit une défocalisation myopique dans la rétine périphérique moyenne. Cela pourrait expliquer la raison pour laquelle les changements dans la LA sont plus importants chez les porteurs de verres de lunettes DIMS présentant un excès de convergence ».
Étant donné que ce facteur a manifestement eu un impact sur l’efficacité finale des lentilles DIMS, les auteurs proposent que « le dysfonctionnement de la vergence soit évalué avant d’adopter une stratégie de contrôle de la myopie ».
Source : Ma J, Yang X, Liu Z, et coll. The impact of vergence dysfunction on myopia control in children wearing defocus spectacle lenses. Clin Ophthalmol. 2024;18 (799-807).

L’atropine à faible dose démontre son innocuité et son efficacité à trois ans
Une formulation à 0,01 % a obtenu des taux de réponse élevés et a réduit la progression de la myopie sans effets indésirables graves lors d’un essai de phase III. Dans de nombreuses études menées en dehors des ÉtatsUnis, il a été démontré que les enfants bénéficiaient d’une progression réduite de la myopie grâce à une faible dose d’atropine. Aujourd’hui, ces effets bénéfiques ont également été observés dans un échantillon américain et européen, ce qui pourrait potentiellement conduire à la première goutte approuvée par la FDA pour le contrôle de la myopie, selon un article présenté lors de la réunion 2023 de l’ARVO à La Nouvelle-Orléans.
Dans l’essai clinique randomisé de phase III, le NVK002, une formulation d’atropine sans conservateur, a eu un impact significatif sur la progression de la myopie avec un bon profil d’innocuité. Le NVK002 est développé par Vyluma et les résultats présentés proviennent de l’essai de phase III de la société, appelé l’étude Childhood Atropine for Myopia Progression (CHAMP).
L’étude a inclus 576 participants âgés de 3 à 17 ans (réfraction sphérique équivalente de -0,5 D à -6 D; astigmatisme à -1,5 D maximum), qui ont été randomisés 2:2:3 pour recevoir une fois par jour un placebo, un collyre NVK002 0,01 % ou 0,02 % pendant trois ans. La réponse a été définie comme une progression de la myopie inférieure à 0,5 D au cours de la période de l’étude.
Les deux doses de NVK002 ont ralenti la progression de la myopie. Après 36 mois, la concentration de 0,01 % a augmenté de manière significative la proportion de personnes ayant répondu au traitement par rapport au placebo et a également ralenti de manière significative la progression de la réfraction moyenne de l’équivalent sphérique et l’allongement axial. La concentration de 0,02 % a ralenti de manière significative l’allongement axial moyen, mais n’a pas augmenté de manière significative la proportion de répondeurs ni ralenti la progression de la réfraction sphérique moyenne. Il n’y a pas eu d’effets indésirables oculaires graves nécessitant un traitement d’urgence, et les effets non oculaires apparus sous traitement n’ont pas été considérés comme liés au médicament.
Bien que la récente étude LAMP2, qui a comparé les concentrations d’atropine de 0,05 % et de 0,01 %, n’ait trouvé d’efficacité que pour la première, cette nouvelle étude documente également un effet de traitement avec la dose la plus faible.
« Pour la première fois dans un échantillon américain et européen, il a été démontré que l’atropine à faible dose peut avoir un impact significatif sur la progression de la myopie », ont écrit les chercheurs dans leur résumé. « Le NVK002 0,01 % a démontré une efficacité significative sur les trois principaux critères d’efficacité par rapport au placebo sur une période de trois ans, tandis que les deux concentrations de NVK002 présentaient un excellent profil d’innocuité.
Le NVK002 0,01 % pourrait offrir la première option de traitement pharmacologique approuvée pour la progression de la myopie ».
Source : Zadnik K, Schulman E, Flitcroft DI, et coll. Low-dose atropine for treatment of pediatric myopia progression: a double-masked placebo-controlled, randomized trial of 3-year efficacy and safety. ARVO 2023 annual meeting. https://www.reviewofoptometry.com/article/lowdose-atropinedemonstrates-safety-and-efficacy-at-three-years

Comparaison de l’efficacité du NVK002, nouvelle formulation d’atropine à faible dose, dans le traitement de la progression de la myopie chez les enfants dans l’essai clinique CHAMP, entre les populations en intention de traiter (ITT) et les populations ITT modifiées
Contexte : En utilisant une analyse modifiée de l’intention de traiter (mITT) chez des sujets âgés de 6 à 10 ans au départ, l’essai clinique de phase 3 CHAMP (NCT03350620) a démontré l’efficacité du NVK002 topique, une nouvelle formulation d’atropine à faible dose sans agent de conservation, dans le ralentissement de la progression de la myopie sur une période de 36 mois. Nous avons montré que dans ce sous-groupe d’enfants, le NVK002 0,01 % était statistiquement significatif par rapport au placebo pour augmenter la proportion de répondeurs (progression de la myopie < 0,50 D sur 3 ans) et pour ralentir la progression de la longueur axiale (LA) et de la myopie (réfraction sphérique équivalente, RSE). Nous comparons ici l’efficacité dans l’ensemble de l’intention de traiter (ITT) des sujets âgés de 3 à < 17 ans au début de l’étude avec la population mITT. Méthodes : Des sujets américains et européens âgés de 3 à < 17 ans et présentant une RES comprise entre -0,50 D et -6,00 D ont été traités par un placebo topique uniquotidien ou par le NVK002 0,01 % pendant 36 mois. Les critères d’efficacité analysés étaient la proportion de répondeurs et le changement moyen par rapport à la ligne de base de la RES et de la LA au mois 36 dans les groupes mITT et ITT.
Résultats : Dans l’ITT, 165 sujets ont été randomisés dans le groupe placebo et 164 dans le groupe NVK002 0,01 %. Dans le mITT, 144 sujets ont été randomisés dans le groupe placebo et 133 dans le groupe NVK002 0,01 %. Au mois 36, le NVK002 0,01 % a augmenté de manière significative la proportion de répondeurs par rapport au placebo dans les deux groupes (mITT : 17,5 % de répondeurs au placebo contre 28,5 % de répondeurs au 0,01 %; rapport de cotes 3,9; p = 0,031; ITT : 21,3 % de répondeurs au placebo contre 31,6 % de répondeurs au 0,01 %; rapport de cotes 3,9; p = 0,035). Le NVK002 0,01 % a également ralenti de manière significative la progression moyenne de la RES (mITT : 0,24 D différence moyenne au moindre carré [LSMD]; ITT : 0,25 D LSMD) et l’allongement axial (mITT : -0,13 mm LSMD; ITT : -0,13 mm LSMD), avec les deux critères d’évaluation à p < 0,001 pour le mITT et l’ITT.
Conclusion : Les analyses des ensembles mITT et ITT ont montré des pourcentages comparables de répondeurs au traitement par NVK002 0,01 % dans les deux groupes. Ces résultats suggèrent que l’inclusion de données provenant de sujets âgés de 3 à 17 ans (ITT) plutôt que de 6 à 10 ans (mITT) peut ne pas altérer l’efficacité du NVK0020.01 % dans l’essai CHAMP, et que le NVK002 0,01 % peut être approprié pour traiter les enfants myopes avec une large fourchette d’âge.
Source : https://www.aoa.org/AOA/Documents/Education/ePosters/2023%20 Top%20ePosters%20Submissions/Top%205%20Poster%204.pdf

Le traitement de la maladie d’Alzheimer par des inhibiteurs de l’acétylcholinestérase pourrait réduire le risque de DMLA Principaux renseignements :
Le modèle de Cox ajusté a montré que chaque année supplémentaire de traitement par inhibiteur de l’acétylcholinestérase était liée à un risque de DMLA inférieur de 6 %.
L’âge, la race blanche et la race autre/inconnue étaient associés à un HR plus élevé.
Les inhibiteurs de l’acétylcholinestérase utilisés pour traiter la maladie d’Alzheimer pourraient également réduire le risque de développer une dégénérescence maculaire liée à l’âge, selon une étude de cohorte de vétérans âgés publiée dans JAMA Ophthalmology
« Étant donné que les médicaments contre la MA pourraient limiter les processus inflammatoires pathologiques et protéger contre le stress oxydatif et les lésions microvasculaires dans l’œil, nous avons émis l’hypothèse que les patients atteints de la MA et traités avec des AChEI pourraient présenter un risque plus faible de DMLA », ont écrit S. Scott Sutton, PharmD, du Columbia VA Health Care System, et ses collègues.
Les chercheurs ont mené une étude de cohorte rétrospective sur 21 823 vétérans atteints de la maladie d’Alzheimer (MA), âgés de 55 à 80 ans, qui ont été traités dans des établissements de soins de santé du Département des anciens combattants entre janvier 2000 et septembre 2023. Les participants n’avaient pas de diagnostic préexistant de DMLA.
La cohorte comprenait 12 847 participants traités pour la MA avec les inhibiteurs de l’acétylcholinestérase (AChEI) donépézil, rivastigmine ou galantamine, et 4 898 traités avec la mémantine. Les autres participants n’ont pas été traités. Les groupes traités et non traités étaient majoritairement composés d’hommes blancs. Le groupe traité présentait une comorbidité moyenne de Charlson plus faible et une proportion plus faible de fumeurs et d’hypertendus, mais un taux plus élevé d’hypercholestérolémie pure.
Le groupe non traité avait un nombre médian plus élevé d’examens de la vue par an.
Selon un modèle de Cox dépendant du temps, chaque année supplémentaire de traitement par l’AChEI était associée à un HR de DMLA inférieur de 4 %. Après l’appariement des scores de propension, les chercheurs ont indiqué que chaque année supplémentaire de traitement était associée à un risque de DMLA inférieur de 6 %.
Les variables associées à un HR plus élevé de DMLA comprenaient l’âge, la race blanche et la race autre ou inconnue.
« Cette étude vient s’ajouter au nombre croissant de publications examinant les effets des AChEI en dehors de la maladie d’Alzheimer », ont écrit Sutton et ses collègues.
« Les AChEI ont été associés à plusieurs avantages non liés à la maladie d’Alzheimer, notamment une réduction de la mortalité, du risque d’infarctus du myocarde et d’accident vasculaire cérébral, ainsi qu’un ralentissement de la progression de la [maladie rénale chronique]. Bien que l’amélioration des résultats cognitifs soit l’objectif principal du traitement par AChEI, ces bénéfices secondaires peuvent jouer un rôle important dans la décision de traiter ou de poursuivre le traitement. »
Source : Sutton SS, et coll. JAMA Ophthalmol. 2024;doi:10.1001/ jamaophthalmol.2023.6014.

Efficacité de l’association fixe de Latanoprost/ Timolol du matin ou du soir dans le traitement du glaucome à angle ouvert et de l’hypertension oculaire : un essai clinique randomisé
Objectif : Comparer l’efficacité de l’association fixe latanoprost/timolol du matin et du soir chez des patients atteints de glaucome primaire à angle ouvert (GPAO) et d’hypertension oculaire.
Méthodes : Dans cet essai clinique randomisé en double aveugle, 63 patients chinois non traités atteints de GPAO et d’hypertension oculaire ont été recrutés. Tous les patients ont reçu le LTFC et ont été randomisés (1:1) dans le groupe 1, administration du matin (8 heures) ou dans le groupe 2, administration du soir (20 heures). Des gouttes de véhicule ont été utilisées le matin ou le soir, en conséquence, pour préserver le masquage. Les patients ont été traités pendant 4 semaines. Les résultats comprenaient la réduction moyenne de la pression intraoculaire (PIO) sur 24 heures et la fluctuation de la PIO par rapport à la ligne de base après un traitement de 4 semaines.
Résultats : Cinquante-six patients ont été inclus dans l’analyse finale. Dans les deux groupes, les valeurs de PIO après traitement étaient significativement inférieures à celles de la ligne de base à chaque point de mesure sur 24 heures.
Une différence significative entre les groupes dans la réduction de la PIO par rapport à la ligne de base a été observée à 9 h 30 (4,01 ± 2,62 vs 2,42 ± 3,23 mm Hg, groupe de dosage du soir vs groupe de dosage du matin; P = 0,048). Les deux groupes ont montré une diminution de la fluctuation de la PIO après le traitement. Cependant, le groupe ayant reçu la dose du matin a connu une diminution significativement plus importante de la fluctuation diurne de la PIO que le groupe ayant reçu la dose du soir (2,04 ± 2,32 mm Hg contre 0,50 ± 1,70 mm Hg, respectivement; P = 0,012).
Conclusions : L’administration du LTFC le matin et le soir peut réduire efficacement la PIO sur 24 heures et sa fluctuation. Le dosage du matin est plus susceptible de contrôler efficacement les fluctuations diurnes de la PIO.
Pertinence translationnelle : Cet essai clinique multicentrique, en double aveugle et randomisé génère des preuves solides sur le schéma posologique optimal de LTFC pour aider à la prise de décision clinique dans le traitement de la PIO élevée.

L’implant de Travoprost montre une réduction « robuste » de la PIO à 3 mois
Selon un communiqué de presse de Glaukos, la FDA a approuvé l’iDose TR pour la réduction de la PIO chez les patients souffrant d’hypertension oculaire ou de glaucome à angle ouvert en décembre 2023.
L’iDose TR (implant intracaméral de travoprost) 75 mcg est « conçu pour délivrer en continu des niveaux thérapeutiques 24/7 d’une formulation propriétaire de travoprost à l’intérieur de l’œil pendant des périodes prolongées » afin de résoudre les problèmes d’observance et d’effets secondaires causés par les traitements topiques du glaucome.
L’implant a déjà démontré des résultats positifs dans les études de phase 3 GC-010 et GC-012, qui ont randomisé 1 150 patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d’hypertension oculaire pour les traiter soit avec iDose TR, soit avec une solution ophtalmique topique de timolol à 0,5 % deux fois par jour.
À 12 mois, 81 % des patients traités avec iDose TR n’avaient plus besoin de médicaments topiques dans les deux essais, et 98 % des patients ont poursuivi l’essai, contre 95 % des patients traités avec le timolol. L’implant a été bien toléré et a montré des résultats d’innocuité favorables dans les deux essais de phase 3, ainsi que dans d’autres études contrôlées, où les effets indésirables oculaires les plus courants (2 % à 6 %) étaient des augmentations de la PIO, des iritis, une sécheresse oculaire et des défauts du champ visuel, « dont la plupart étaient légers et de nature transitoire », d’après le communiqué.
L’implant intraoculaire de travoprost a démontré une réduction de la PIO chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d’hypertension oculaire 3 mois après une seule administration, selon une étude publiée dans Ophthalmology
« L’iDose est sûr et efficace chez les patients phaques, sans incidence de cataracte ou de perte de cellules endothéliales au cours du suivi de l’étude », a déclaré à Healio Steven R. Sarkisian Jr, MD, auteur principal de l’étude.
Données dérivées de Sarkisian SR, et coll. Ophthalmology. 2024;doi:10.1016/j.ophtha.2024.02.022.
Dans l’essai de non-infériorité de phase 3, multicentrique, randomisé, en double aveugle, contrôlé par simulacre, les participants ont reçu un implant de travoprost à élution rapide (200 yeux) ou un implant de travoprost à élution lente (197 yeux) plus un collyre placebo administré deux fois par jour ou une procédure simulée (193 yeux) plus une solution ophtalmique de timolol à 0,5 % administrée deux fois par jour.
Le résultat principal était le changement moyen par rapport à la PIO de base dans l’œil étudié à 8 heures et à 10 heures au jour 10, à la semaine 6 et au mois 3, et les résultats d’innocuité comprenaient l’évaluation des événements indésirables, le nombre de cellules endothéliales cornéennes, l’acuité visuelle et l’hyperémie conjonctivale.
On a observé une réduction moyenne de la PIO allant de 6,6 mm Hg à 8,4 mm Hg par rapport à la ligne de base dans le groupe des implants à élution rapide, de 6,6 mm Hg à 8,5 mm Hg dans le groupe des implants à élution lente et de 6,5 mm Hg à 7,7 mm Hg dans le groupe timolol au cours des six points temporels. L’étude a atteint son objectif principal et les deux groupes d’implants ont démontré une non-infériorité statistique et clinique par rapport au timolol en ce qui concerne l’efficacité à réduire la PIO.
Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés étaient l’iritis, l’hyperémie oculaire, la réduction de l’acuité visuelle et l’augmentation de la PIO, la plupart d’entre eux étant de gravité légère ou modérée. Un cas d’endophtalmie a été observé dans un œil de l’étude.
« L’implant intraoculaire de travoprost démontre une réduction robuste de la PIO, non inférieure au timolol sur une période d’évaluation primaire de l’efficacité de 3 mois, et constitue un traitement de rechange sûr et efficace aux médicaments topiques abaissant la PIO », écrivent les auteurs.
Commentaire de l’investigateur Steven R. Sarkisian Jr, MD
Nous savons déjà que 90 % des patients qui prennent des médicaments contre le glaucome ne respectent pas leur traitement à des degrés divers. Je pense que de nombreux ophtalmologistes vivent comme si leurs patients étaient en quelque sorte spéciaux et que les données ne s’appliquaient pas à eux.
Les simples faits concernant la non-observance des médicaments topiques devraient nous inciter à nous arrêter et à reconsidérer l’algorithme de traitement conventionnel dans lequel les gouttes ophtalmiques constituent la première ligne pour la gestion d’une PIO élevée. Je suggérerais une trabéculoplastie laser sélective primaire suivie d’un iDose si le patient n’atteint pas la PIO cible après un SLT ou si le SLT échoue en moins de 6 à 12 mois. Les médicaments peuvent désormais être utilisés en troisième intention après la SLT et l’iDose, et nous devrions être en mesure d’obtenir une observance totale chez 80 % des patients, voire plus.
N’oublions pas que la plupart des patients atteints de glaucome peuvent être contrôlés après une trabéculectomie et un ou deux médicaments, sans qu’il soit nécessaire de faire appel à un « spécialiste du glaucome ».
Source : 1, Sarkisian S.R., et coll. Ophthalmology. 2024;doi:10.1016/j. ophtha.2024.02.022.
2) https://www.aaojournal.org/article/S0161-6420 (24) 00161-1/abstract

SightGlass reçoit de la FDA la désignation de dispositif révolutionnaire pour des verres de lunettes qui ralentissent la myopie
La FDA a accordé la désignation de dispositif révolutionnaire aux verres de lunettes à technologie d’optique de diffusion de SightGlass Vision, qui sont conçus pour ralentir la progression de la myopie chez les enfants.
« Des études récentes montrent qu’environ la moitié des enfants américains sont myopes, mais que la plupart d’entre eux ne bénéficient pas de traitements éprouvés pour ralentir la progression de la myopie », déclare Andrew Sedgwick, PDG de SightGlass Vision, dans un communiqué de presse de l’entreprise.
« Nous sommes enthousiastes à l’idée de collaborer plus étroitement avec la FDA pour obtenir l’autorisation de mise sur le marché américain. »
Selon le communiqué, la technologie d’optique de diffusion (DOT) de la société comprend des milliers d’éléments de diffusion de la lumière qui imitent le contraste naturel sur la rétine et réduisent la progression de la myopie, et dont l’efficacité et la sécurité ont été démontrées dans le cadre d’évaluations cliniques.
Le programme de la FDA sur les dispositifs innovants offre aux fabricants des occasions plus fréquentes de recevoir des commentaires sur des dispositifs innovants qui peuvent traiter ou diagnostiquer efficacement des maladies débilitantes telles que la myopie.
Seuls 18 dispositifs ophtalmiques ont reçu cette désignation depuis la création du programme en 2015, précise le communiqué.
« La désignation par la FDA d’un dispositif révolutionnaire pour les verres de lunettes DOT est une étape importante pour notre organisation et pour la lutte plus large contre l’épidémie de myopie pédiatrique », déclare M. Sedgwick dans le communiqué.
Source : Kim SH; Kim YK, Shin YI, et coll. Nighttime outdoor artificial light and risk of age-related macular degeneration. JAMA Netw Open. 2024;7(1):e2351650. doi:10.1001/jamanetworkopen.2023.51650










VENDREDI, 4 OCTOBRE DE 12 H À 18 H
SAMEDI, 5 OCTOBRE DE 10 H À 14 H 30
Palais des congrès de Montréal















Les Prix et Reconnaissance en Optométrie visent à reconnaître la participation exceptionnelle d’optométristes ou de collaboratrices et collaborateurs au développement de la profession. Ces reconnaissances s’inscrivent dans un exercice de valorisation de notre profession.



DRE MARIE-ÈVE CORBEIL OPTOMÉTRISTE

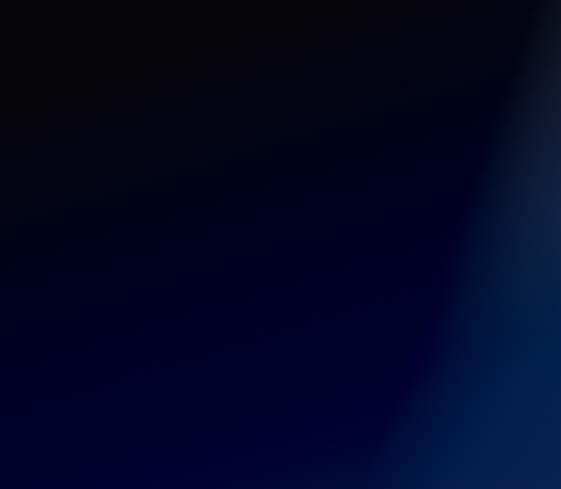
Dre Marie-Ève Corbeil est diplômée de l’École d’optométrie depuis 2001 et titulaire d’une maîtrise en Sciences de la vision depuis 2006. Dre Corbeil s’est pleinement investie dans sa profession d’optométriste. Rapidement, elle est devenue chargée de cours et de clinique à l’École d’optométrie, puis a accédé au poste de professeure adjointe pour obtenir ensuite son agrégation en 2015. Dès ses débuts, elle s’est intéressée aux soins pédiatriques, prenant en charge la clinique d’optométrie pédiatrique de l’École d’optométrie en 2007.
En 2015, Dre Corbeil a joué un rôle dans la création de la clinique l’Extension qui offre des soins visuels, dentaires et orthopédagogiques aux enfants défavorisés du quartier Parc-Extension à Montréal. Tout au long de sa carrière universitaire, Dre Corbeil a encadré de nombreuses équipes étudiantes de recherche en optométrie et s’est impliquée activement dans la vie académique, ce qui lui a valu le prix d’excellence en enseignement en 2017.
En 2018, elle a quitté son poste de professeure pour se consacrer à son propre cabinet, où elle se concentre principalement sur les soins pédiatriques et s’est engagée à fournir des services de qualité à tous, y compris aux patients à besoins spéciaux tels que ceux atteints de TSA, trisomie ou déficience intellectuelle. Dre Corbeil a également été honorée du prix du 108e bâtisseur de l’École d’optométrie pour son engagement académique. Elle a été membre du conseil d’administration de l’OOQ pendant huit ans et continue de siéger au comité de l’exercice clinique. En tant qu’optométriste pédiatrique, elle a été invitée à participer à différentes émissions de télévision. Elle contribue également au CPRO en tant que conférencière et coordonnatrice scientifique participant à la planification du contenu et du choix des conférenciers.
Dre Corbeil a une personnalité unique et remarquable. Elle est à l’écoute et trouve toujours les bons mots pour exprimer ses idées, donner du réconfort et des conseils à ses patients ou à ses pairs.



DR LAURENT LALONDE
OPHTALMOLOGISTE
Dr Lalonde a terminé sa résidence en ophtalmologie en 1993 et a eu à cœur d’encourager la collaboration ophtalmologie-optométrie. Il a participé à l’essor de la clinique d’ophtalmologie IRIS de 2001 à 2013, en étant le spécialiste de l’implant LIO phakes et en donnant des formations sur ce sujet aux optométristes qui désiraient référer leurs patients pour cette intervention. Dr Lalonde a aussi accueilli des étudiants finissants en optométrie à raison d’une journée par semaine à cette clinique pendant quelques années. Il s’est impliqué dans la formation des stagiaires finissants et des résidents en santé oculaire à l’Institut de l’œil des Laurentides (IOL) dès l’ouverture de la clinique en 2010.
De 2004 à 2013, Dr Lalonde a donné plusieurs conférences pour la formation continue des optométristes, notamment sur les LIO phakes et la chirurgie de cataracte avec LIO de spécialité. Il a également participé à quatre ateliers de cogestion en chirurgie réfractive et à trois ateliers de cogestion en chirurgie de cataracte en 2004 et 2005.

DRE ALEX-ANNE HARVEY
OPTOMÉTRISTE
Depuis sa graduation en 2015, la feuille de route du Dre Alex-Anne Harvey est impressionnante. Dès ses premières expériences, elle prend part à des missions humanitaires dans des milieux mal desservis tels que la Tanzanie, l’Équateur et la Roumanie. Elle s’est rendue à maintes reprises dans le Nord du Québec pour offrir des soins aux Premières Nations.
Dre Harvey a ouvert une clinique d’optométrie indépendante écologique en 2019 du nom d’Uvée-Optométriste de Quartier. Cette clinique qui se différencie à prime abord par ses valeurs environnementales et sociales, offre un service irréprochable aux patients en très grande partie grâce aux soins du Dre Harvey. En 2023, elle a poussé plus loin le développement de l’optométrie indépendante et écoresponsable en contribuant à l’ouverture de la 2e succursale d’Uvée tout en mettant sur pied le projet Vision Solidaire pour aider les travailleurs à faible revenu à s’offrir des examens et des lunettes abordables.
Tout en gérant ces projets, Dre Harvey contribue au développement de l’optométrie sociale, ce qui l’incite à faire une maîtrise en santé publique à l’Université de Montréal et ce, avec mention. Dans le cadre de sa maîtrise, elle a entrepris une revue de la littérature des meilleures pratiques de dépistage en milieu scolaire dans des pays à faible ou moyen revenu. Ce travail de haute qualité a été publié en février 2024 dans le journal Nature-Eye. C’est ainsi que l’Agence internationale pour la prévention de la cécité (IAPB) lui a confié la refonte du nouveau Guide de dépistage scolaire dans des pays à faible ou moyen revenu qui sera utilisé en pratique.
Depuis 2008, il a été plusieurs fois conférencier à Innovations (formation du CPRO) en plus d’avoir grandement aidé au recrutement des autres ophtalmologistes conférenciers. En 2017, il a participé à la formation des optométristes pour l’obtention des nouveaux privilèges thérapeutiques.
Il a aussi participé à plusieurs projets de recherche en collaboration avec des étudiants et des professeurs de l’École d’optométrie.
Ces collaborations ont donné lieu à de nombreuses communications scientifiques à l’ASCRS et à l’ESCRS. Dernièrement, sa conviction en la collaboration entre ophtalmologistes et optométristes a été essentielle pour la mise en place d’un programme de résidence en santé oculaire, effectué à la clinique externe de l’Hôpital de St-Jérôme ainsi qu’au point de service de Boisbriand. Il a convaincu des confrères ophtalmologistes de superviser une résidente en santé oculaire.
Dr Lalonde est un fervent défenseur de la saine collaboration entre l’optométrie et l’ophtalmologie. Il a su convaincre ses confrères ophtalmologistes de l’IOL et ceux de l’Hôpital de St-Jérôme que la présence de résidents en optométrie contribuerait à améliorer la qualité des soins oculaires offerts à la clientèle tout en améliorant l’accessibilité aux soins.

MADAME ANN FORTIN
Mme Ann Fortin a exercé le rôle de présidente de l’AÉOUM pour l’année 2023-2024. Elle a représenté l’AÉOUM lors de rencontres avec l’AOQ et l’OOQ. Elle a fait preuve de leadership en guidant et conseillant les membres du conseil de régie lors des assemblées générales de l’AÉOUM.
Au cours de ses années universitaires, Mme Fortin s’est impliquée de plusieurs façons. Elle a été la présidente de la promotion 2024, un poste qu’elle a occupé avec brio. Elle a su représenter les membres de sa cohorte lors de divers enjeux. En plus d’être une personne avec une éthique de travail irréprochable, Mme Fortin est une personne ouverte d’esprit et toujours à l’écoute. Elle a offert des séances d’écoute en tant que paire-aidante auprès des étudiants en optométrie. Organisée, motivée et toujours à la tâche, Mme Fortin a su défendre les droits des étudiants auprès de la direction et des professeurs de l’École d’optométrie. Ses efforts et son dévouement au profit de la vie étudiante en optométrie sont des aspects qui doivent inévitablement être soulignés.
En plus d’assurer sur le plan académique, elle détient des capacités de communication et des habiletés interrelationnelles impeccables. Elle démontre une sincérité et un dévouement exceptionnels envers le bien-être de la population étudiante en optométrie.
Originaire de Chibougamau, Mme Fortin retournera dans sa ville natale afin d’offrir des soins optométriques à sa communauté qui lui tient très à cœur.
514 686-2081
Marie-Claude*, optométriste de 62 ans, possède un appartement et un chalet qu’elle utilise quelques semaines par an. Elle souhaite vendre le chalet et désire connaître ses options pour optimiser sa vente d’un point de vue fiscal.
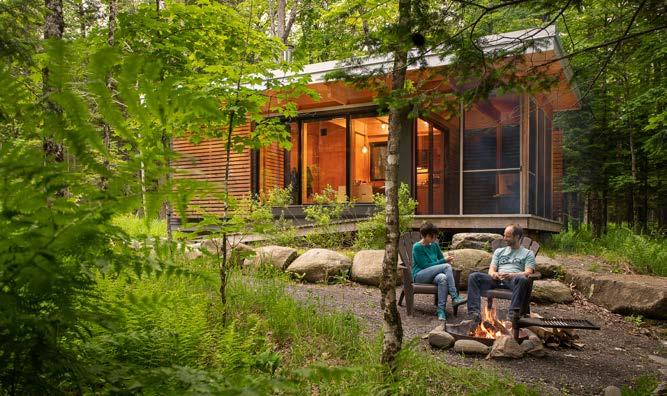
Marie-Claude a acheté son chalet il y a 25 ans au prix de 150 000 $. Elle a dépensé 100 000 $ en rénovations depuis, pour lesquelles elle a conservé ses factures. Si la vente est réalisée au prix de 600 000 $, son gain en capital constitue 350 000 $ (gain en capital = prix de vente 600 000 $ — [prix d’achat 150 000 $ + rénovations 100 000 $]).
Quelles solutions s’offrent à Marie-Claude pour réduire les incidences fiscales d’un gain en capital important ?
Selon les règles en vigueur au moment de rédiger cet article, du montant de gain en capital de 350 000 $, seuls 50 % sont déclarés comme gain en capital imposable. Toutefois, si les récentes modifications budgétaires proposées sont adoptées comme telles et que la transaction a lieu après le 25 juin 2024, la première tranche de 250 000 $ bénéficiera d’un taux d’inclusion du gain en capital de 50 % alors que l’excédent sera majoré à 66,67 %.
Dans sa déclaration de revenus, Marie-Claude devra donc ajouter à son revenu un gain en capital imposable de 175 000 $ (191 670 $ si la transaction a lieu après le 25 juin 2024), assujetti à l’impôt selon son taux d’imposition personnel marginal (53,3 %, ce qui représente environ 93 275 $ selon les règles avant le 25 juin 2024 et 102 160 $ après cette date, soit une différence de 8 885 $).
Marie-Claude devrait passer en revue tous les points ci-après avec son planificateur financier afin de trouver des pistes d’optimisation de sa fiscalité.
Utiliser l’exemption pour résidence principale
Cette option consiste à exonérer d’impôt le gain sur la résidence principale. Il n’est pas nécessaire que le bien soit utilisé en tant que résidence principale au sens strict du terme. Marie-Claude peut désigner son chalet comme résidence principale aux fins fiscales. Le calcul de cette exemption s’effectue comme suit :
Gain en capital x 1 +
nombre d’années de désignation de résidence principale
nombre d’années où elle a été propriétaire
Cette résidence doit appartenir personnellement au contribuable (ici MarieClaude) et être normalement habitée au cours de l’année par le contribuable, son conjoint, l’ancien conjoint (qui était marié ou de fait) ou l’enfant du contribuable. L’exonération n’est pas permise dans le cas d’une résidence louée qui n’a jamais été habitée par l’une de ces personnes.
Ce choix n’a pas à être fait avant la vente de l’une des résidences; il est important de consulter un spécialiste afin de déterminer le meilleur choix dans les circonstances, dès que l’une des résidences est en processus de vente, car l’équation pour le calcul d’exemption pour résidence principale peut être différente suivant les choix faits.
Vérifier son solde de cotisations inutilisées au REER
Si ce solde existe au moment de la vente de la résidence secondaire, Marie-Claude aura tout intérêt à cotiser à ses REER pour réduire les conséquences fiscales de son gain en capital.
Vérifier les pertes en capital nettes déductibles reportées des années antérieures
Si Marie-Claude possède ce type de perte à la suite de la disposition d’autres biens (comme des actions ou fonds communs de placement non enregistrés) dans des années antérieures, elle peut les utiliser à l’encontre du gain en capital imposable créé par la vente de son chalet. Ces pertes en capital nettes sont reportables dans les trois années antérieures et indéfiniment pour le futur.
Augmenter, si possible, le prix de base rajusté de ses résidences
Au coût du bien, on ajoute généralement les dépenses engagées pour en faire l’acquisition, tels que les frais de notaire et les droits de mutation. Le gain en capital sera diminué d’autant, car il correspond à la différence entre le produit de disposition et le prix de base rajusté de l’immeuble.
Marie-Claude pourra aussi inclure les travaux d’amélioration capitalisés apportés au chalet. Ces derniers doivent correspondre à des dépenses de nature capitale, donc réalisées pour augmenter la valeur de l’immeuble, contrairement à des dépenses de nature courante. À titre d’exemple, les rénovations pour un agrandissement de la salle de bain sont des dépenses capitalisables, alors que la réfection du toit ou le remplacement des fenêtres sont généralement des dépenses de nature courante qui ne sont pas déductibles (sauf si l’immeuble est loué).
Utiliser la provision pour gains en capital
La Loi de l’impôt sur le revenu permettrait à Marie-Claude de reporter son gain en capital sur un maximum de 5 ans. Toutefois, le produit de la vente doit également être reporté sur le même nombre d’années choisies, permettant de diminuer la facture fiscale globale, puisqu’en principe, le taux d’imposition ne serait augmenté que partiellement durant ces années.
Cette solution est souvent recommandée pour les membres d’une famille ou des proches dont on connaît l’historique financier, car elle paraît, certes, avantageuse d’un point de vue fiscal, mais le vendeur prend le risque financier de ne pas être payé en totalité, si la capacité financière de son acheteur diminue au fil des ans. Pour atténuer ces risques, Marie-Claude (qui agit à titre de vendeur) pourrait exiger une hypothèque immobilière sur la propriété vendue, afin de garantir le solde du prix de vente.
Isoler la valeur des biens meubles vendus avec la résidence secondaire
Pour les biens meubles garnissant la résidence et inclus dans la vente (par exemple les électroménagers), il est possible d’isoler leur valeur du produit de disposition de la résidence pour diminuer l’impôt sur le gain en capital. Cette option s’offre à Marie-Claude si elle décide de ne pas bénéficier de l’exemption de résidence principale pour son chalet.
Certains biens meubles, rattachés à son chalet sans en perdre leur individualité, sont considérés par la loi comme des immeubles tant qu’ils restent rattachés à l’immeuble (un spa, une piscine hors terre, un cabanon, etc.). Marie-Claude pourra capitaliser leur coût d’origine à celui de son chalet vendu, ce qui augmentera le prix de base rajusté du chalet et réduira le gain en capital imposable.
Choisir un autre moment pour vendre la résidence secondaire.
Si la vente de son chalet n’est pas nécessaire, Marie-Claude pourrait envisager de le conserver jusqu’à son décès, afin de reporter cet impôt sur le gain en capital. Au moment de son décès, il y aura une disposition présumée de la résidence secondaire déclenchant ainsi l’impôt sur le gain en capital.
Utiliser une police d’assurance vie
Marie-Claude détient une assurance vie d’un montant de 150 000 $. Le produit de cette protection pourrait être utilisé par sa succession, à son décès, pour acquitter les impôts sur le gain en capital déclenché par disposition présumée de son chalet à titre de résidence secondaire.
Cette option devrait être envisagée par Marie-Claude si, finalement, elle décide de ne pas vendre son chalet et souhaite s’assurer que son fils, son seul héritier, ne soit pas dans l’obligation de le vendre pour régler la facture fiscale. Cette protection devrait couvrir, en tout ou en majeure partie, l’impôt sur le gain en capital, permettant ainsi à son fils de conserver le chalet.
Mise en garde
Cet article ne traite pas de toutes les solutions possibles pour réduire l’incidence fiscale d’un gain en capital important; il ne reflète qu’une situation parmi d’autres. Pour faire le tour complet de toutes les possibilités personnalisées à votre situation, nous vous invitons à communiquer avec un planificateur financier, fiscaliste ou autre professionnel.
*nom fictif
Magda Tavares, B.A.A., Pl. Fin., CIMMD Représentante-conseil adjointe, Gestionnaire de portefeuille — Gestion privée Fonds FMOQ; Jacinthe Faucher, Pl. Fin., D. Fisc., notaire, fiscaliste et planificatrice financière — Fonds FMOQ

POUR LE SAVOIR, RIEN DE MIEUX QUE DE COMPARER LES RENDEMENTS, LE RISQUE ET LES FRAIS DE VOS PORTEFEUILLES AUX MARCHÉS
Demandez un deuxième avis pour vous rassurer dans vos choix ou revoir vos investissements.
Service offert aux optométristes et à leurs proches.
COMMUNIQUEZ AVEC NOUS ! NOUS SOMMES À VOTRE ENTIÈRE DISPOSITION
MONTRÉAL : 514 868-2081 ou 1 888 542-8597
QUÉBEC : 418 657-5777 ou 1 877 323-5777 info@fondsfmoq.com | FONDSFMOQ.COM

Vous avez travaillé dur et amassé de l’argent afin de réaliser votre rêve, posséder votre maison. Voici le moment de l’assurer adéquatement… mais comment savoir pour quel montant protéger votre habitation ?

D’après vous, sur quoi se base le courtier pour vous conseiller adéquatement :
Le prix payé ?
L’évaluation municipale ?
Le coût de reconstruction ?
C’est le coût de reconstruction qui détermine le montant de protection de votre bâtiment dans votre contrat d’assurance habitation. Voilà pourquoi tenter de diminuer ce montant afin de diminuer votre prime d’assurance serait un calcul bien risqué !
Les différences à retenir pour l’évaluation de votre résidence
La valeur marchande (de vente)
d’une maison est influencée par plusieurs facteurs : emplacement/quartier, valeur du terrain, style et décoration intérieure, vendeur pressé ou non, etc. Elle peut donc être plus élevée ou plus faible que le coût de reconstruction.
L’évaluation foncière
sert de base d’imposition équitable pour le financement municipal et des commissions scolaires. Effectuée selon différentes méthodes selon les municipalités, elle se base sur la valeur réelle de la maison et du terrain et constitue une « estimation globale » et non individuelle des biens.
La valeur à neuf, ou coût de reconstruction, est le coût qui devra être engagé pour reconstruire votre maison « à l’identique » si elle venait à être détruite, par un incendie par exemple. Ce montant n’est pas lié à la valeur du terrain. Il dépend plutôt de l’évolution du prix des matériaux depuis la date de construction, du coût de la main-d’œuvre qualifiée pour réaliser la reconstruction, des frais de déblai et démolition avant de reconstruire, etc. Souvent, reconstruire coûte plus cher que construire !
Courtier d’assurances ou évaluateur en bâtiment ?
Afin de déterminer le coût de reconstruction, votre courtier d’assurances vous posera des questions concernant votre résidence : l’année de construction, la dimension, le genre de construction, les matériaux utilisés, etc. Il dispose d’un outil de travail dans lequel il intègre vos réponses. À l’aide d’un barème, cet outil suggère de manière approximative le coût de reconstruction de votre maison, permettant à votre courtier de vous offrir des protections répondant à vos besoins à une juste prime.
Mais n’oubliez pas : en dépit de sa compétence et du soin qu’il apportera à cette tâche, votre courtier n’est pas un évaluateur agréé. Si vous désirez être certain du coût de reconstruction, le plus sûr est de retenir les services d’un évaluateur professionnel.

Les entreprises de toutes les tailles doivent prendre en charge les risques psychosociaux qui apparaissent sous différentes formes : le harcèlement au travail, la violence en milieu de travail, la violence conjugale, familiale ou à caractère sexuel et la possible exposition à un évènement potentiellement traumatique.
En quoi consistent les risques psychosociaux ?
En milieu professionnel, les risques psychosociaux se définissent comme des facteurs liés à la nature ou à l’organisation du travail pouvant affecter la santé physique et psychologique d’un travailleur. Ils trouvent leur source dans des facteurs comme la charge de travail, la justice organisationnelle, l’autonomie décisionnelle, la reconnaissance et le soutien au travail, l’apparition de conflits, de violence, etc. Ainsi, les risques psychosociaux associés au travail se retrouvent dans différents contextes et ils peuvent se produire dans n’importe quel milieu professionnel.
Qu’en est-il des obligations de l’employeur en matière des risques psychosociaux ?
Les obligations de l’employeur touchent la prévention, l’administration et la gestion.
Prévention : L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique et psychique du travailleur. Concrètement, il doit définir les risques présents, y compris les risques sociaux, corriger les situations à risque et les maîtriser. De plus, l’employeur doit protéger les travailleurs exposés ou ayant été exposés, dans le cadre de leur travail, à du harcèlement psychologique et/ou à caractère sexuel, ou à une situation de violence en milieu de travail sous toutes ses différentes formes.
Administration : L’employeur doit mettre en place une politique sur la prévention du harcèlement psychologique et/ou sexuel en milieu de travail, de même qu’un processus de traitement des plaintes. De plus, il doit implanter une politique de prévention de la violence en milieu de travail. Dans le but de faire vivre ces différentes politiques au sein de son organisation, il devra aussi mettre sur pied divers mécanismes comme de la formation, des pauses santé et sécurité au travail, des séances d’information, des initiatives de sensibilisation, un code de vie ou de civilité en milieu de travail, l’application de mesures disciplinaires, etc.
Gestion : Tout employeur, allant de la microentreprise jusqu’à la multinationale en passant par la PME, devra prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique et/ou sexuel et la violence en milieu de travail sous toutes ses formes. Si une telle conduite est portée à son attention, il devra déployer les moyens nécessaires pour la faire cesser. Par exemple, il doit prendre au sérieux les différents signalements ou plaintes de la part de ses travailleurs, mener une enquête lors d’un dépôt officiel de plainte, s’assurer du respect et de l’application des différentes politiques, gérer les conflits, appliquer des mesures correctives, etc.
Qu’est-ce que la Loi 42 souhaite changer ou améliorer à ce chapitre ?
Le projet de loi 42 vise à prévenir et à combattre le harcèlement psychologique et la violence à caractère sexuel en milieu de travail. Cette volonté se traduit de différentes façons. En voici quelques exemples :
L’extension du délai de dépôt d’une réclamation pour lésion professionnelle, à la suite de violence à caractère sexuel en milieu de travail. Ce délai passera de six mois à deux ans pour quiconque ayant subi une telle lésion;
Une équipe spécialisée en matière de violence à caractère sexuel sera mise en place au Tribunal administratif du travail;
Ce dernier pourra désormais imposer des dommages punitifs lorsque l’employeur est reconnu personnellement responsable du harcèlement.
En quoi l’expertise d’un partenaire comme Lussier peut-elle aider les employeurs dans ce dossier complexe qu’est la prévention et la gestion des risques psychosociaux ?
Les conseillers spécialisés de Lussier mettent à la disposition des employeurs une vaste gamme de services pratiques allant de la formation jusqu’aux enquêtes suite à un dépôt de plainte pour harcèlement psychologique ou sexuel au travail, en passant par le coaching, la rédaction de politique, l’élaboration d’un code de civilité, la gestion de conflits, etc.
L’accompagnement des conseillers spécialisés se module en fonction des besoins de l’employeur. Il peut prendre différentes formes, que ce soit de l’aide pour définir et analyser les risques psychosociaux, ou un soutien pour la prise en charge des facteurs de risques.

Assurance responsabilité professionnelle
Assurance clinique d’optométrie
Assurance des particuliers
Assurance collective
Appelez-nous pour une soumission dès aujourd’hui !
Cabinet de services financiers 1 877 543-2960
Lussier.co/AOQ

Rabais de groupe disponibles
Temps plein / partiel / permanent Clinique visuelle de Verchères optoplus.com



Docteure Johanne Roy, optométriste 450 583-6644 optojroy@yahoo.ca
Vous cherchez un environnement de travail agréable qui répond à vos besoins ? La clinique visuelle de Verchères, bien établie depuis 33 ans, est à la recherche d’un(e) optométriste motivé(e) pour se joindre à son équipe dynamique. En plus d’une clientèle fidèle et variée, la clinique est fermée la fin de semaine pour une conciliation travail-vie personnelle idéale. Vous aurez la chance de planifier votre horaire selon vos disponibilités et de développer la pratique que vous souhaitez. Venez pratiquer dans une clinique bien équipée (OCT, CV, laboratoire sur place) qui vous permettra de vous épanouir sur le plan professionnel !
Vous pouvez me rejoindre en toute confidentialité.
Temps partiel
Spectorvision Optométristes spectorvision.ca
Docteur Allan Spector, optométriste 514 502-1606
a.spector20@gmail.com
Nous recherchons un optométriste enthousiaste et passionné par les soins aux patients pour un poste à temps partiel avec des horaires flexibles. Notre pratique dispose d'une salle de prétests équipée d'un autoréfractomètre, d'un autotonomètre, d'un OCT, d'une caméra rétinienne et de tests automatisés de champ visuel, tous gérés par des assistants optométriques. Nous avons également un grand magasin avec des montures élégantes pour tous les budgets.
Temps plein / permanent / temporaire / partiel Greiche & Scaff greiche-scaff.com
Docteur André Aoun, optométriste 514 207-9211 andre.aoun@greiche-scaff.com
Nous vous offrons des conditions exceptionnelles, une très grande flexibilité de pratique et un encadrement dynamique. Nos priorités sont vos besoins pour œuvrer à la santé de vos patients. Parce qu’avant d’être nos clients, ils sont avant tout vos patients. Saisissez dès maintenant l’opportunité de faire partie de notre grande famille Greiche & Scaff. Notre promesse ? Votre tranquillité d’esprit. Discrétion assurée.
Temps plein / partiel
Clinique d’Optométrie de l’Érable
Docteure Marie-Pier Genest, optométriste
Madame Marie-Claude Beaulieu 819 362-8787 marieclaudebeaulieu@live.ca
Rejoignez notre équipe chaleureuse et dynamique ! Nous cherchons un(e) optométriste à temps plein / temps partiel selon vos disponibilités ! Nouveaux locaux depuis janvier 2023 ! Prétests fait par des assistantes qualifiées. Clientèle fidèle établie depuis plus de 35 ans !
Temps plein / partiel / permanent Lunetterie Optiprix optiprix.ca
Docteur Normand Houle, optométriste 819 820-8912 n.houle@optiprix.ca
Joignez-vous à notre équipe de 4 optométristes, 4 opticiennes d’ordonnances et 9 assistant(e)s certifie(e)s. Local très spacieux et lumineux avec 4 salles d’examens, OCT, Octopus, camera grand-champ (ZEISS). Ambiance familiale et équipe dynamique pour prendre soin de notre fidèle clientèle. Pour une pratique professionnelle variée (horaire rempli des mois à l’avance) et un milieu de vie des plus agréables. L’Estrie est un terrain de jeu pour les sportifs et les amants de la nature. Vous y trouverez de nombreux plans d’eau, des terrains de golf, un paradis pour les cyclistes ainsi qu’un relief montagneux pour le ski et des randonnées inoubliables. On vous attend !
Temps partiel / remplacements ponctuels
Raymond et Côté, opticiens et optométristes mobiles visionrc.ca
Docteure Shelton Regismarianayagam, optométriste 514 946-1010 poste #3 cv@visionrc.ca
L’équipe de Raymond et Côté est à la recherche d’optométristes un jour/semaine sur le territoire de Laval et de la Rive-Nord. Vous êtes optométriste à la recherche d’un peu d’aventure ? Nous sommes ouverts à rencontrer des professionnels de cœur qui veulent améliorer le monde. Si vous voulez explorer vos possibilités de pratique mobile en RPA et en CHSLD avec une équipe dédiée à la mission, contactez-nous pour en discuter et venir observer nos équipes sur le terrain. Nous serons enchantés de vous accueillir dans notre belle équipe déjà composée de 6 opticiens d’ordonnances et 7 optométristes. Au plaisir de vous rencontrer !
Temps plein / temps partiel / volant / permanent ou temporaire
IRIS, Le Groupe Visuel Pour plus de détails, visitez : career.iris.ca/fr/ optometristes
Docteure Jahel St-Jacques, optométriste 418 234-4510 jahel.st-jacques@iris.ca
La qualité des services aux patients vous tient à cœur ? Vous recherchez un environnement de pratique favorisant la collaboration interprofessionnelle, une clientèle familiale et fidèle ainsi que de l’équipement de pointe ? IRIS a des opportunités partout au Québec : Rive-Sud de Montréal, Outaouais, Lanaudière, Trois-Rivières, Sherbrooke, Québec/Lévis, BasSt-Laurent, Charlevoix, Sept-Îles, Saguenay-Lac-St-Jean, Abitibi-Témiscamingue ! Plusieurs postes d’optométristes volants et opportunités de partenariat sont disponibles ! En plus d’une remarquable qualité de pratique, plusieurs secteurs vous offriront une qualité de vie avantageuse et de nombreux attraits touristiques et activités de plein air.
Temps partiel / permanent Lunetterie Abella & De Montigny lunetterieabella.com
Docteure Sylvie Larouche, optométriste
Monsieur Yazid Abella 514 243-5114 contact@lunetterieabella.com
La Lunetterie Abella & De Montigny, clinique indépendante établie depuis 44 ans, est à la recherche d’un(e) optométriste pour se joindre à son équipe une journée par semaine et possibilité de deux journées. La clinique est bien équipée (OCT, champ visuel, autoréfractomètre 4 en 1) dans le but de bien servir sa clientèle chaleureuse et fidèle. Vous bénéficierez d’un horaire complet dans une ambiance de travail conviviale, professionnelle et sans pression avec une équipe motivée et à l’écoute. La clinique est située dans le quartier Ahuntsic, près du métro Crémazie (stationnement disponible).
Au plaisir de vous rencontrer !
Temps plein
LOPTICIEN.CA
Docteur Alain Côté, optométriste 514 244-0151 ou 514 592-3692
Madame Marie Vachon marie.vachon@lopticien.ca
LOPTICIEN.CA propriétaire indépendant avec deux boutiques dans la région de Laval offre à ses optométristes un environnement professionnel, l’utilisation d’équipements à la fine pointe de la technologie et garantit des journées complètes de rendez-vous.
Temps partiel / permanent Clinique d’optométrie Embrun embrunoptometry.com
Docteure Céline Pomainville, optométriste 613 443-5550 embrunod@live.ca
La clinique d’optométrie d’Embrun est à la recherche d’un(e) optométriste préférablement bilingue pour se joindre à notre équipe. Notre clinique est équipée avec : OCT Zeiss – Optomap Monaco – Myah de Topcon – Nidek (autoréfraction / kératométrie / NCT / pachymétrie) –champs visuels Humphrey – dispensaire et laboratoire sur place, belles heures d’ouverture.
Contractuel 1 semaine ou + / année
Docteure Annie Dionne, optométriste 514 694-0836
Demandez Steffan steffandonnelly_ood@hotmail.com optiquedonnelly.com
Optique Donnelly est à la recherche d'optométristes pour accompagner ses équipes d'opticiens d’ordonnances à travers le Nunavik. Saisissez l'opportunité de découvrir les communautés du Grand Nord québécois. 14 villages de la Baie d'Hudson et d'Ungava vous attendent. Les voyages sont de 6 jours. Déplacements et hébergements pris en charge. Rémunération jusqu'à 2 000 $ / jour de travail + perdiem. Expérience extraordinaire et dépaysement garanti.
Temps plein / permanent Clinique d’optométrie de Buckingham buckingham@opto-reseau.com
Docteure Christine Paquin, optométriste 819 213-5438
cpaquin@optobuck.ca
Clinique indépendante, membre de la bannière Opto-Réseau recherche un(e) optométriste pour joindre une équipe dynamique de 4 opticiens d’ordonnances et plusieurs assistantes. Les horaires sont flexibles et nous sommes fermés la fin de semaine. Nous avons 4 salles d’examens disponibles et avons OCT, Optomap, topographe, champ visuel Humphrey, biométrie et clinique de sécheresse (IPL, radiofréquence) ainsi qu’un laboratoire sur place. Nous avons une clientèle très diversifiée, familiale et fidèle. N’hésitez pas à me contacter en toute confidentialité.
Temps partiel / remplacements ponctuels
Raymond et Côté, opticiens et optométristes mobiles visionrc.ca
Docteure Shelton Regismarianayagam, optométriste 514 946-1010 poste #3 cv@visionrc.ca
L’équipe de Raymond et Côté est à la recherche d’optométristes désireux de varier leur pratique à travers nos cliniques visuelles mobiles au service des aînés. Forts de nos 31 ans d’expertise en cliniques mobiles dans la région de Montréal, nos services s’installent dans la région de Québec. Nous offrons un environnement de travail atypique et très enrichissant auprès d’une clientèle ayant de grands besoins. Que ce soit pour des besoins ponctuels ou de façon plus régulière à temps partiel, nous serons enchantés de vous accueillir dans notre belle équipe déjà composée de 6 opticiens d'ordonnances et 7 optométristes. Au plaisir de vous rencontrer !
Temps plein
Clinique d’optométrie Centre-Sud
Docteur Jean-Pierre Lagacé, optométriste 514 527-8039
Madame Louise Lagacé Cousineau louiselcousineau@yahoo.ca
Située au cœur du centre-ville de Montréal, la clinique d’optométrie Centre-Sud établie depuis 30 ans est à la recherche d’un(e) optométriste à temps plein pour joindre son équipe de 3 assistantes. La clinique est équipée de tout le matériel nécessaire pour offrir des soins optométriques généraux et spécialisés sous un même toit. Nous avons une clientèle familiale et fidèle avec un horaire rempli. La clinique est située dans le quartier Centre-Sud, près du métro Berri-UQAM. N’hésitez pas à communiquer avec nous en toute confidentialité. Au plaisir de vous rencontrer !
Temps plein
Centre Visuel des Eskers 819 732-6831
Docteure Andrée-Anne Roy, optométriste 819 354-6078
andree-anne.roy@hotmail.com
Docteure Caroline Coulombe, optométriste 819 856-3630
caroline.coulombe@lino.com
Le Centre Visuel des Eskers d’Amos recherche un(e) optométriste à temps plein avec possibilité de travailler 4 ou 5 jours par semaine. Notre clinique établie depuis plus de 75 ans, permet aux optométristes d’avoir une pratique de l’optométrie très variée, valorisante et enrichissante. Patients fidèles à leur optométriste, clientèle variée de tous âges, pathologies, lentilles cornéennes, lunetterie, équipements de pointe, collaboration avec les ophtalmologistes, assistantes certifiées et opticienne d’ordonnances. Nous avons des horaires flexibles et très remplis. Fermé les samedis et ouvert un seul soir par semaine. C’est l’opportunité de démarrer une merveilleuse carrière en région, loin des embouteillages, de profiter des grands espaces et de travailler près de la maison. De plus, notre clinique est entièrement rénovée !
Nous vous attendons !
Temps plein / partiel / permanent / temporaire et possibilité d’association
Optique Santé optiquesante.com
Docteure Ariane Roy, optométriste
Madame Christine Michaud 418 543-2020 ou 418 590-2021 info@optiquesante.com
Que cherchez-vous comme pratique d’optométrie ? La flexibilité, l’humanité, l’équilibre entre la vie professionnelle sociale et familiale, un environnement technologique, un personnel dévoué ? Optique Santé, clinique indépendante établie depuis 35 ans, vous offre 8 salles d’examen, la présence de 5 optométristes, 3 opticiens d’ordonnances, assistantes, OCT, caméras, Lipiview-Lipiflow et la possibilité de travailler selon vos disponibilités ou en téléoptométrie. Aucune fin de semaine. On vous attend pour vivre l’expérience de notre clinique située au cœur de la ville de Chicoutimi.
Temps plein / temporaire
IRIS, Le Groupe Visuel
Pour plus de détails, visitez : career.iris.ca/fr/ optometristes
Docteure Vicky Larochelle, optométriste 819 448-0474 vicky.larochelle@iris.ca
Une opportunité exceptionnelle s’offre à vous ! IRIS propose un programme incitatif à l’établissement pendant un an dans l’une ou l’autre des régions suivantes : IRIS Matane, IRIS Sept-Îles et IRIS Baie-Comeau. Possibilité de profiter de cette opportunité en duo ! Bonification exceptionnelle pour la première année, hébergement payé, 12 semaines de vacances, contrat de courte durée et autres avantages liés au déplacement. Des cliniques à la fine pointe de la technologie (OCT, dossier électronique, intelligence artificielle) vous attendent dans un cadre enchanteur avec des équipes formées et compétentes. IRIS est fière de desservir avec excellence les régions du Québec depuis 1990. Joignez-vous à nous !
Docteur Michel De Blois, optométriste 514 293-0806 mike.deblois@hotmail.ca
Pratique à vendre à Repentigny, Galeries Legardeur (Maxi, SAQ, Jean-Coutu et +). L’achat de la clinique est une excellente opportunité d’affaires, retraite imminente. Pratique bien établie depuis 35 ans. Clinique indépendante avec clientèle nombreuse, régulière, fidèle et agréable. Communauté en pleine croissance. Récemment rénovée. Prix abordable !
Docteure Barbara Kurtz, optométriste drbkurtzoptometrist@gmail.com
Madame Pascale Guillon 514 923-9181 pascale@roicorp.com
Pratique d’optométrie de 20 ans, à 30 minutes au nord d’Ottawa/Gatineau. Potentiel de revenus de 500 000 $ + demande accrue. Communauté huppée en grande croissance. Nouvel espace de 2 salles d’examens sur ~ 1 000 p.c. connexe à un centre médical.
Docteur Fadi Maroun, optométriste 514 341-2020
Demandez Madame Risa cliniquemaroun@hotmail.com
Champ visuel Octopus 900 NEUF avec table électronique ajustable, imprimante et système d’ordinateur (acheté en 2017);
Visiomètre (+ cylindre)
Kératomètre
Ophtalmoscope binoculaire indirect-Keeler (montage mural)
Exophtalmomètre
5 lentimètres (4 neufs)
Prix demandé : 25 000 $, les pièces individuelles peuvent être négociées.
Docteur David Yalovsky, optométriste
514 235-0787
1 table à réglage électrique
Longueur 144 cm – largeur 46.5 cm - hauteur 78 cm
Peut contenir 2 instruments. Il y a deux trous sur la surface pour les fils
1 table à réglage électrique
Longeur 61 cm - largeur 48 cm – hauteur 78 cm
Elle ne contient qu’un seul instrument
Lentille de Volk Superfield
Caisse de verres
Autoréfractomètre / Kerat Huvitz MRK-3100
Divers outils portatifs pour le dispensaire
Chaise d’examen et poteau 500 $
Montures collection Jean Reno 60% de réduction
Certains prix sont négociables !

pensez à mettre votre profil à jour.
Maintenir vos informations à jour nous permet de communiquer avec vous en cas de besoin.
Vous pouvez mettre à jour vos informations directement sur le portail de formation du CPRO, dans la section Mon dossier sous l’onglet Profil.
Rappel : Veuillez conserver votre numéro de pratique à l’Ordre comme identifiant afin de faciliter la maintenance du site


Les nouvelles lignes directrices de la formation continue obligatoire, entrées en vigueur le 1er avril dernier, ne contiennent plus les catégories Santé oculaire et Optométrie générale.
Le catalogue du CPRO sera mis à jour en août pour s’adapter à ce changement
Vous verrez apparaître une nouvelle catégorie, ED, pour identifier les formations en éthique et déontologie, pour lesquelles un minimum de 3 UFC doit être acquis au cours du cycle.




Lubrification intensive des yeux chroniquement secs


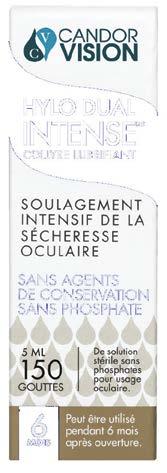


Soulage les symptômes inflammatoires : brûlures et démangeaisons
Longue durée pour moins d'applications quotidiennes

