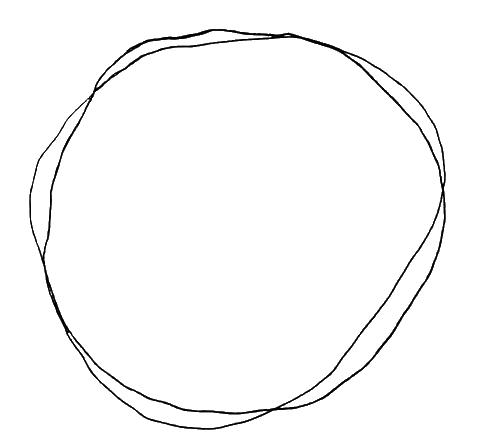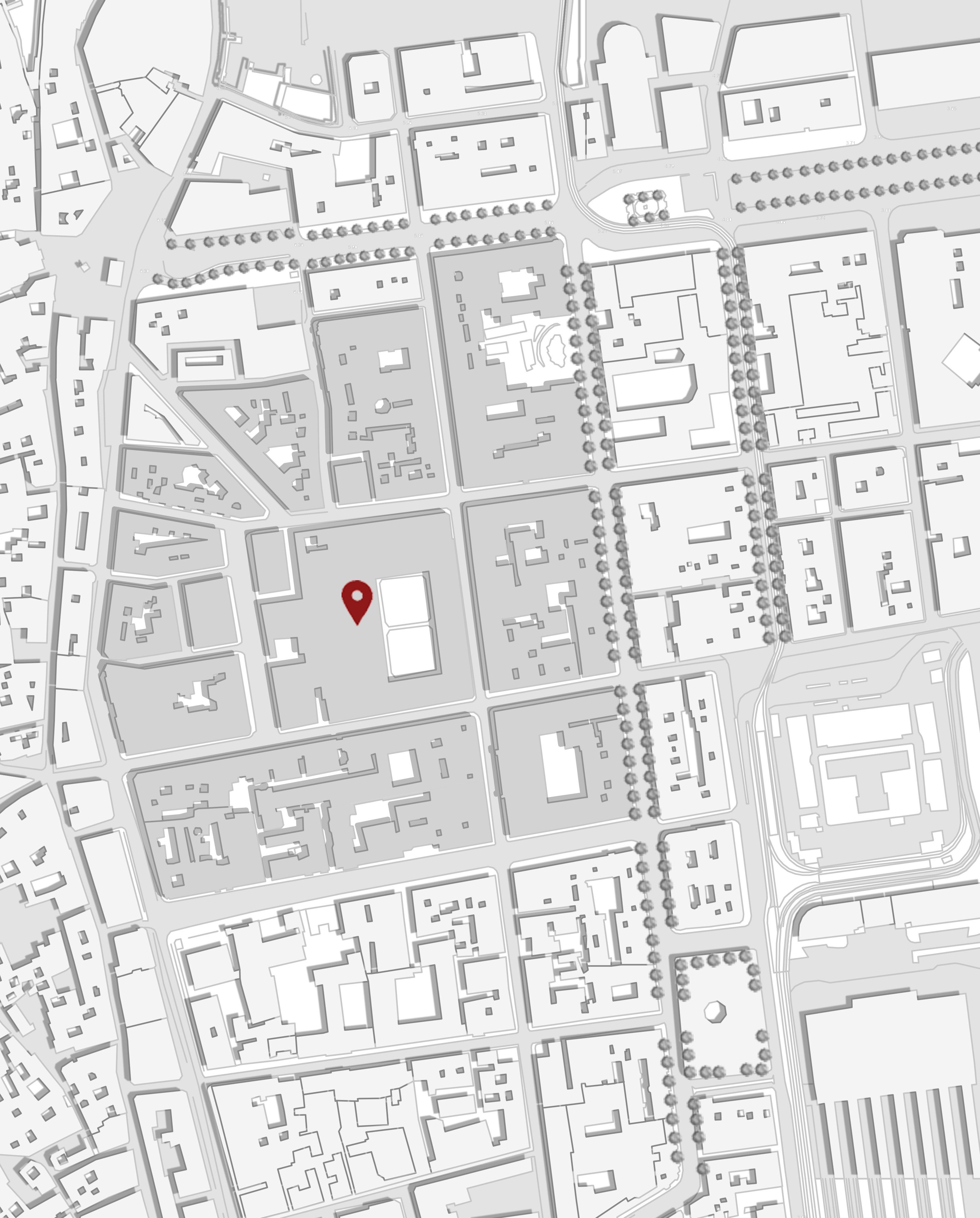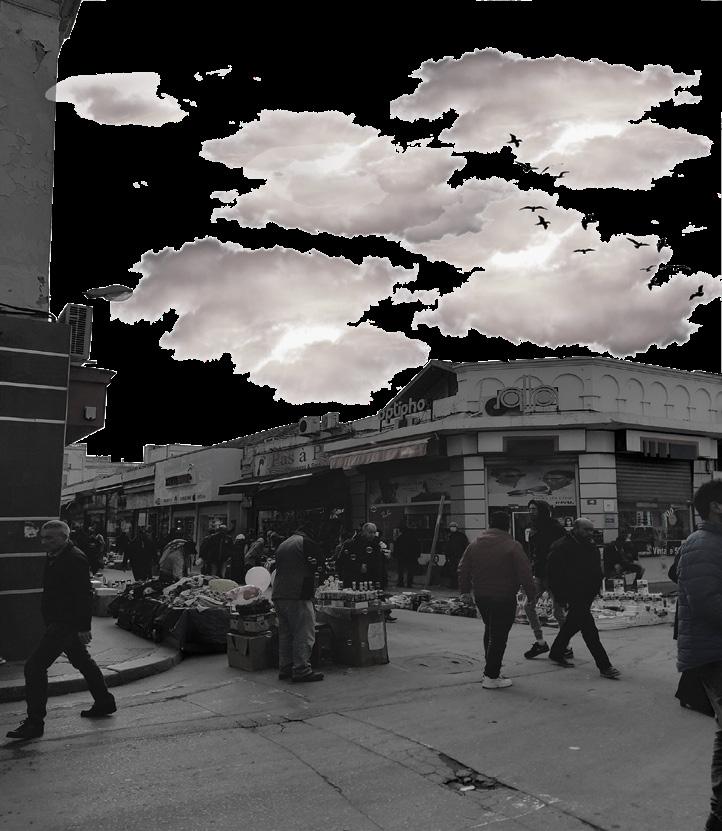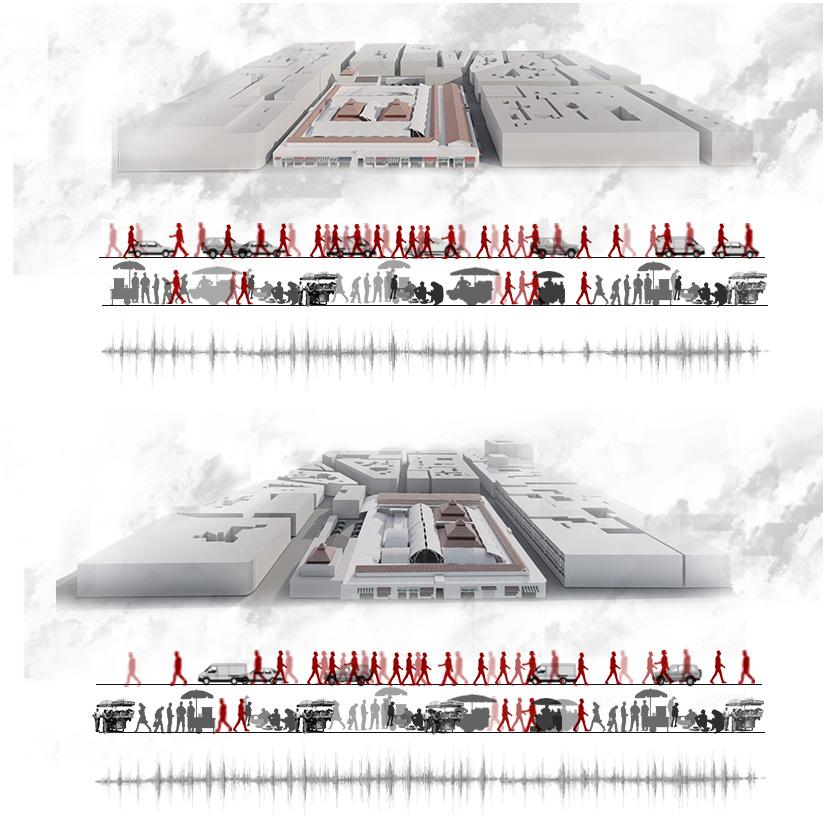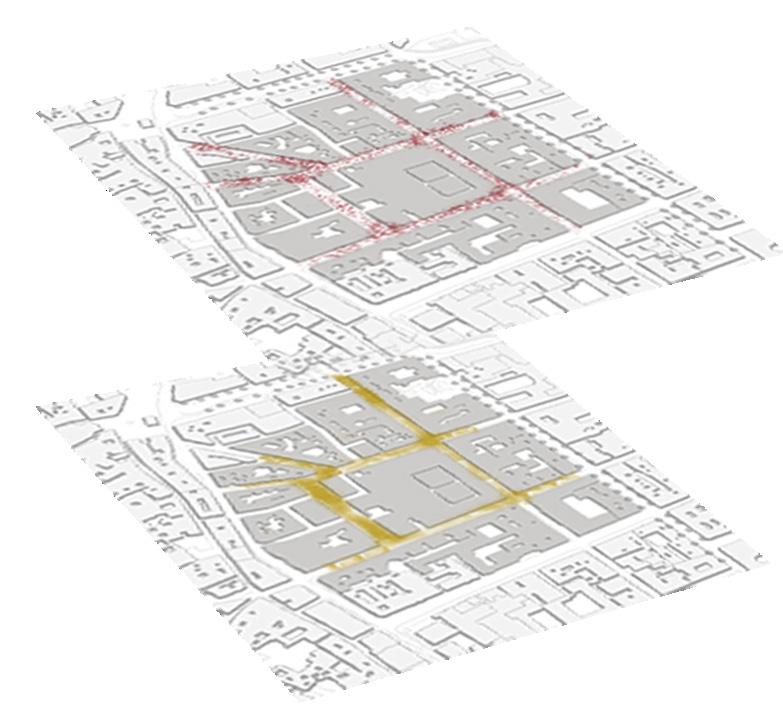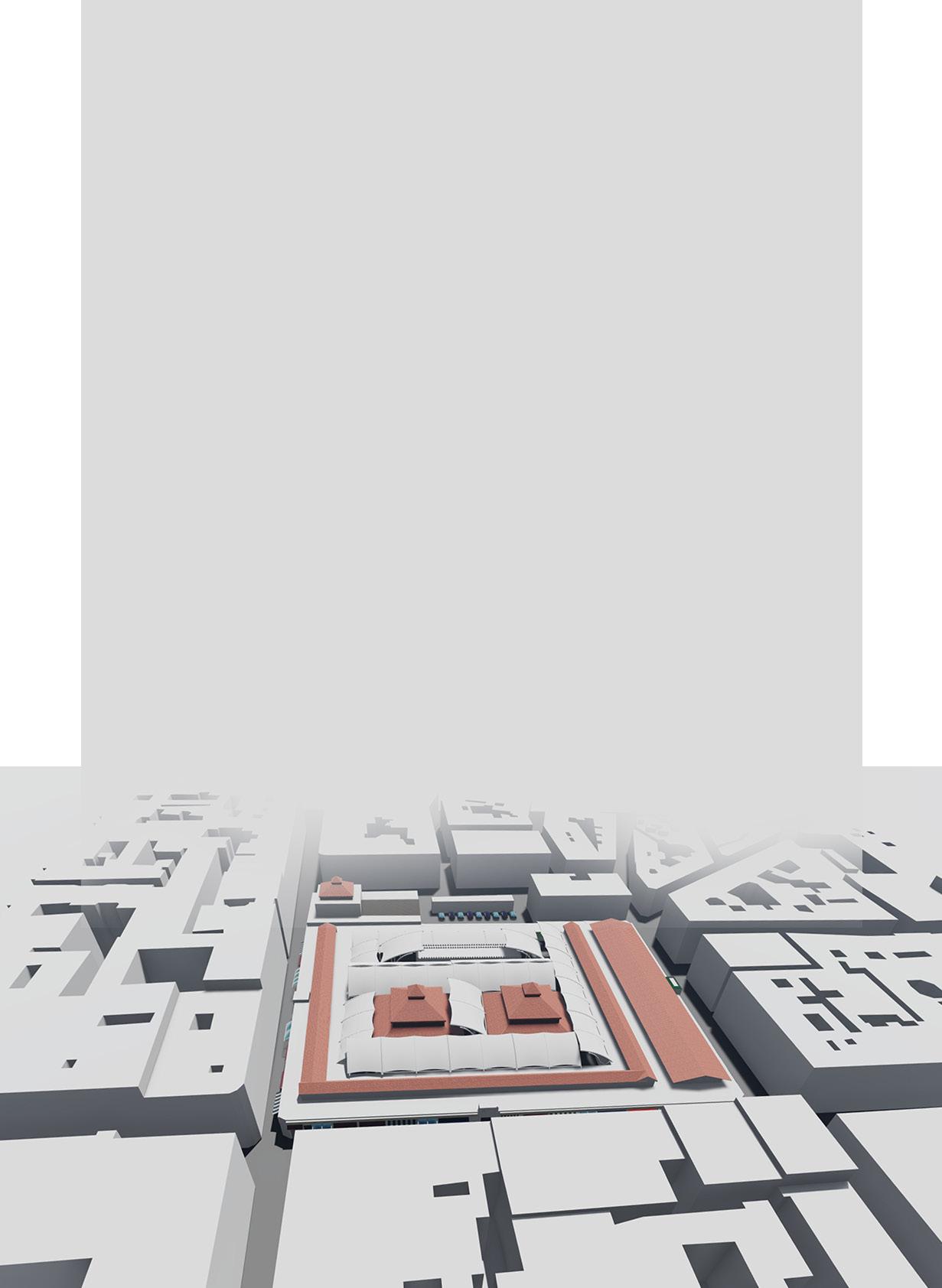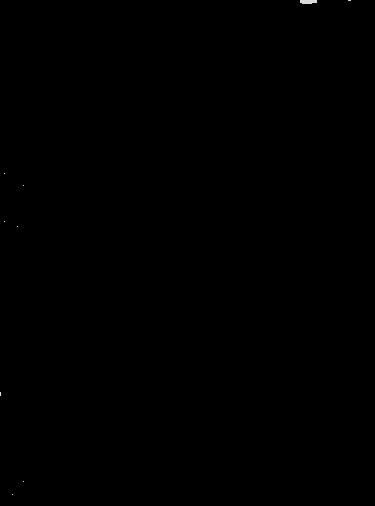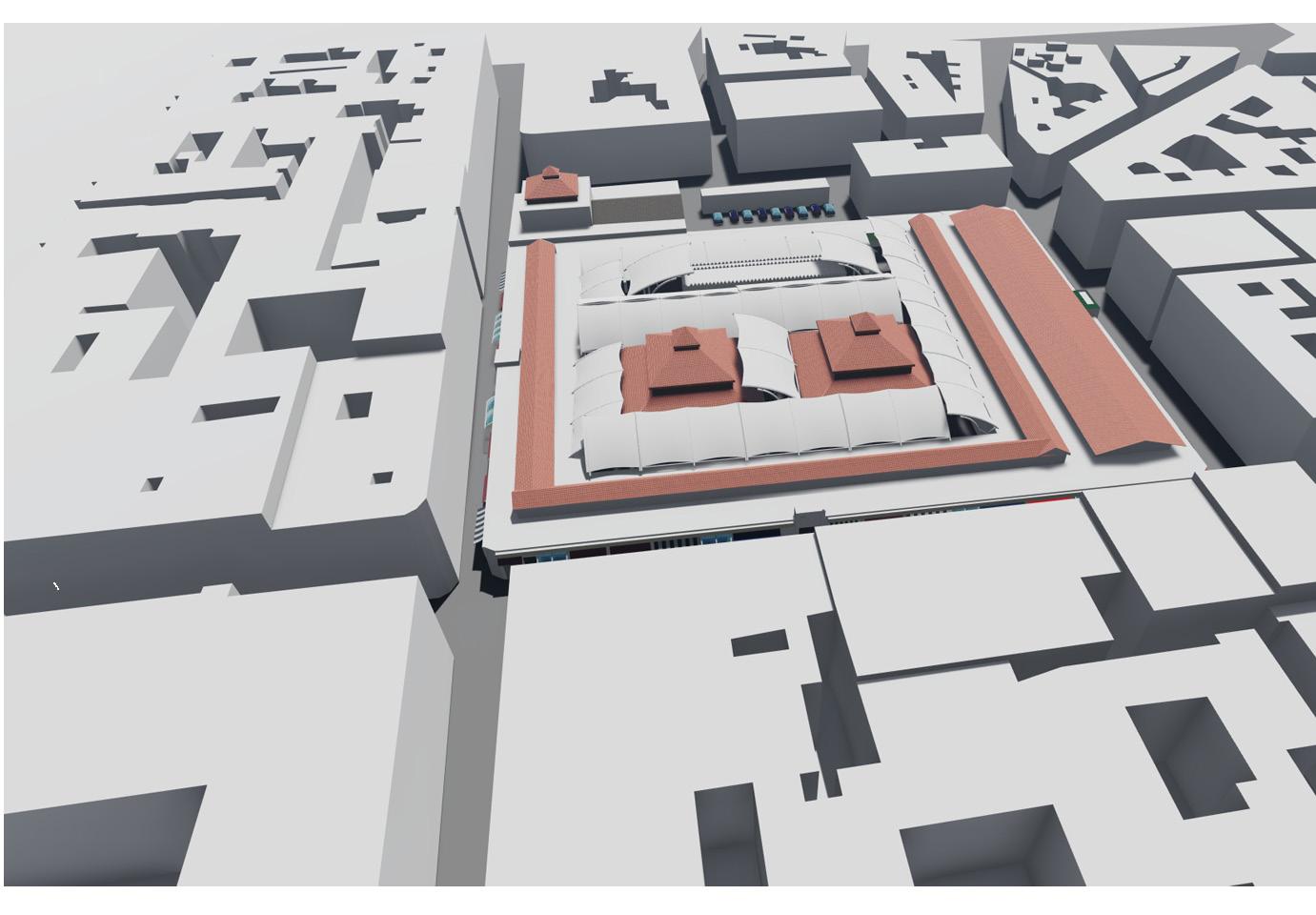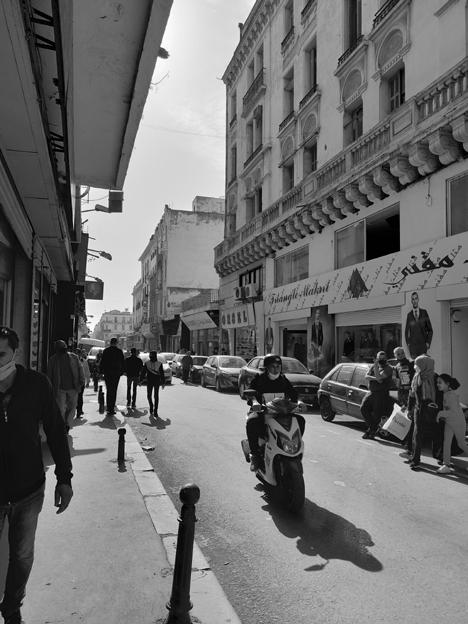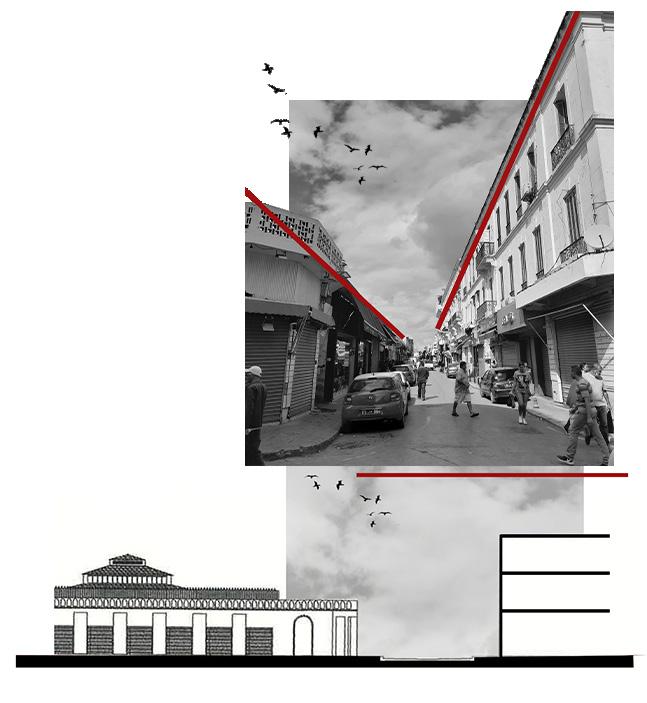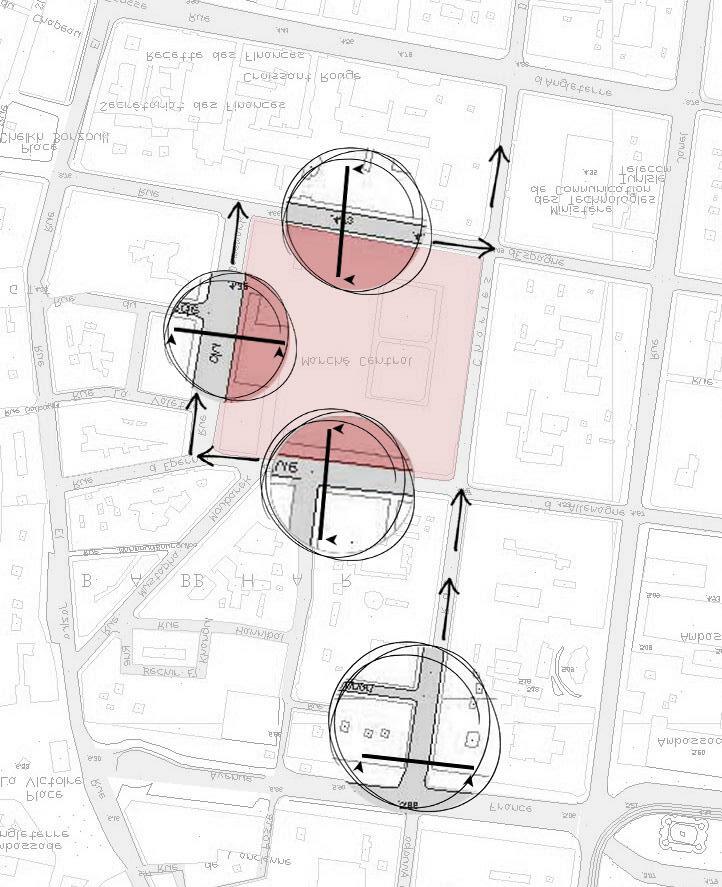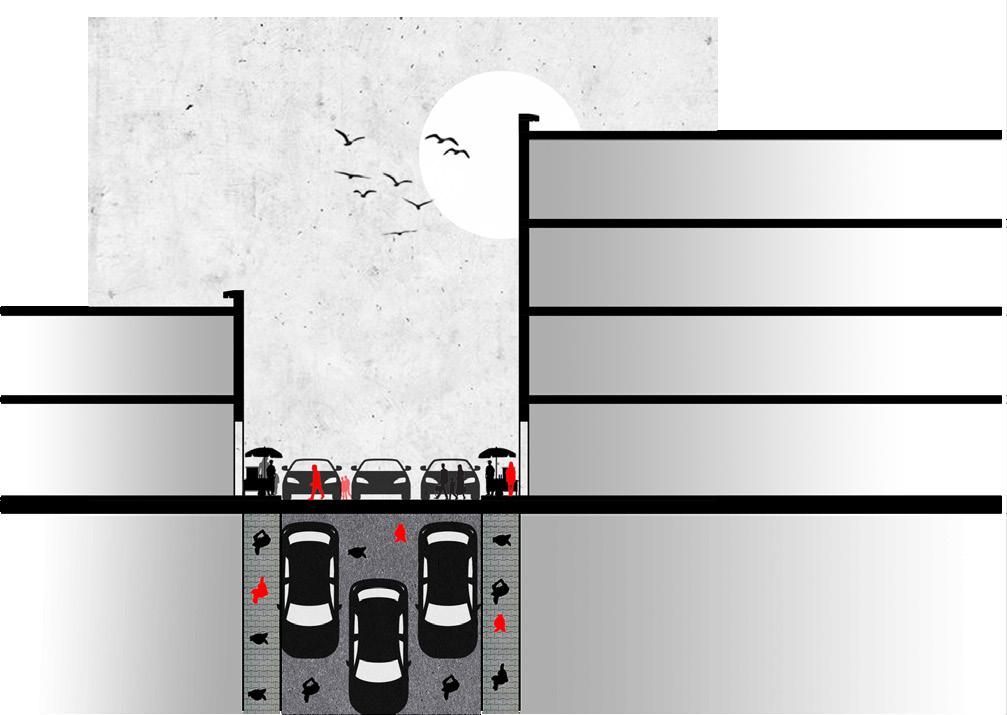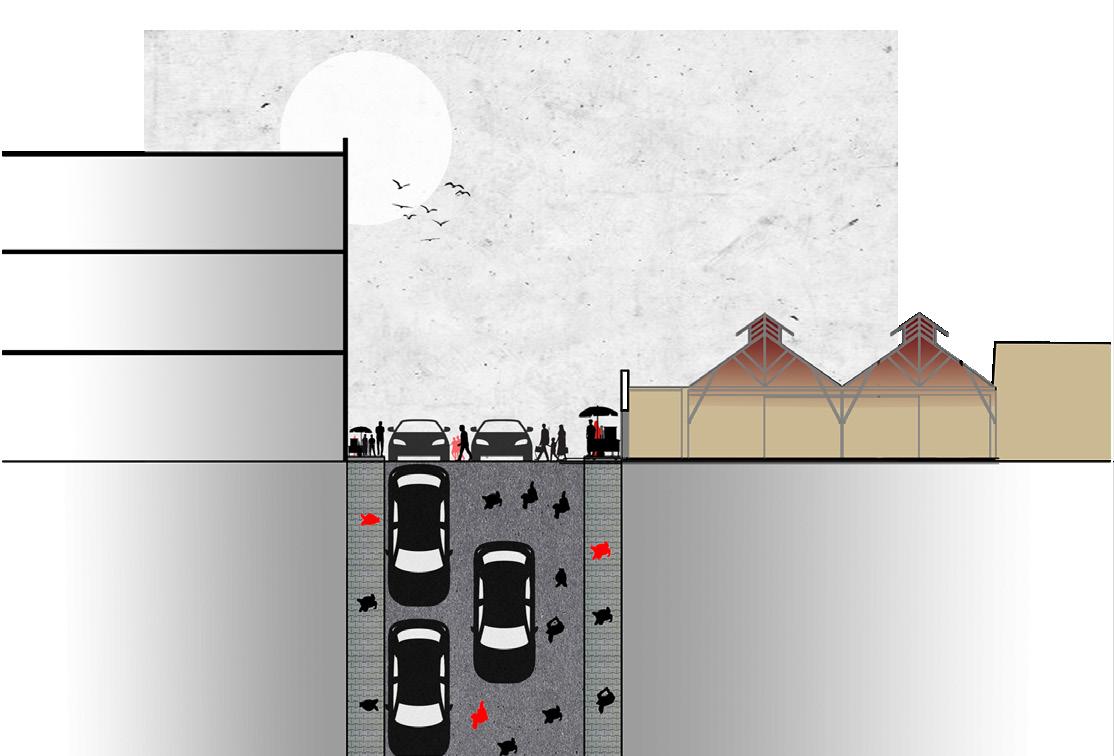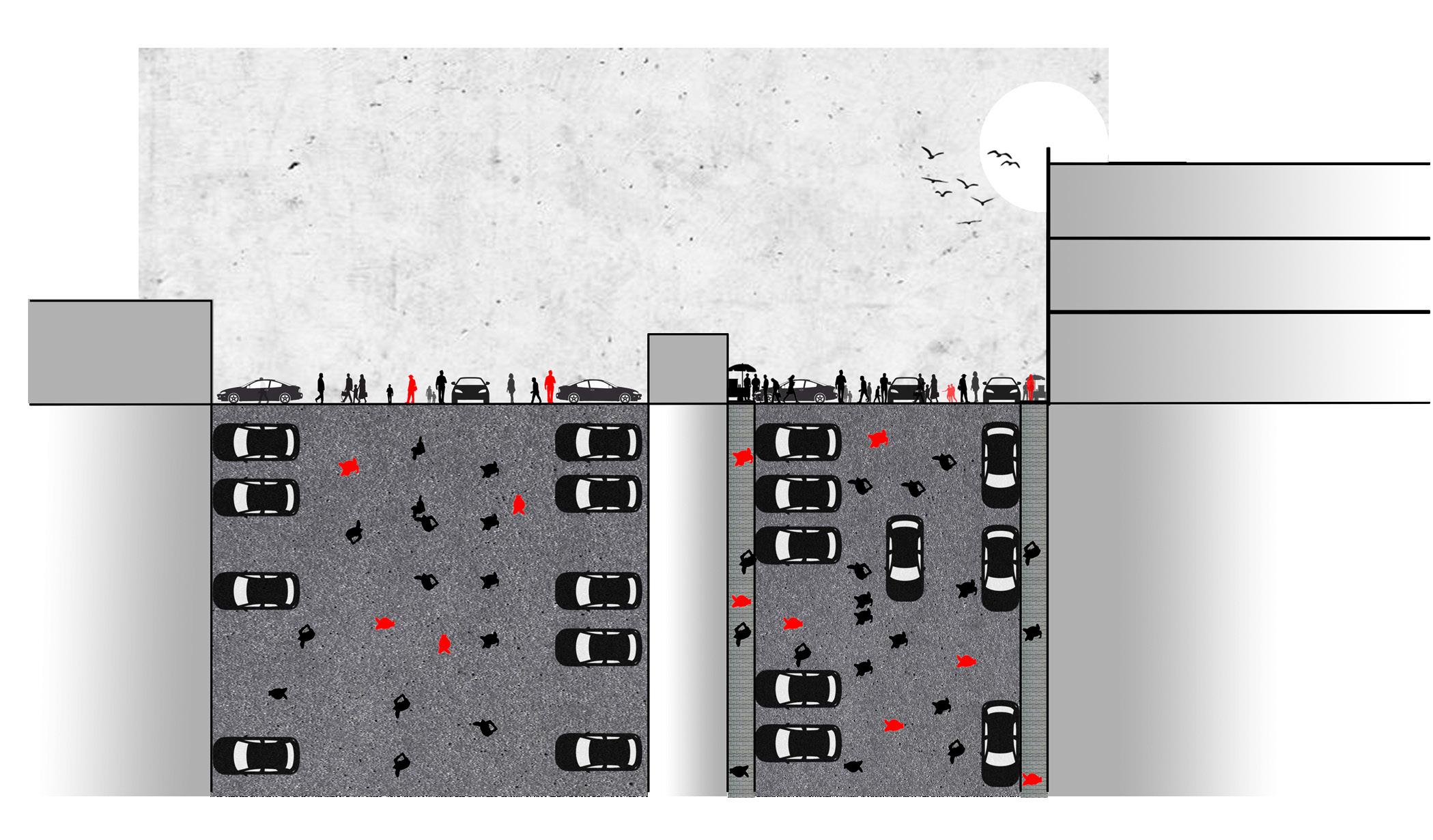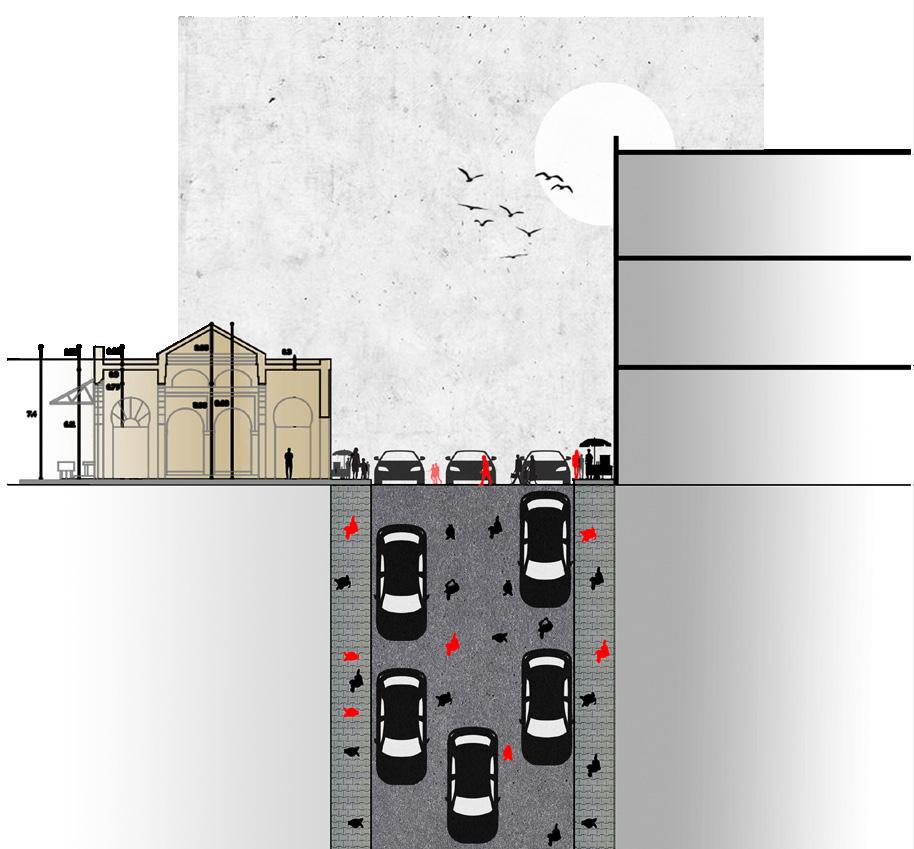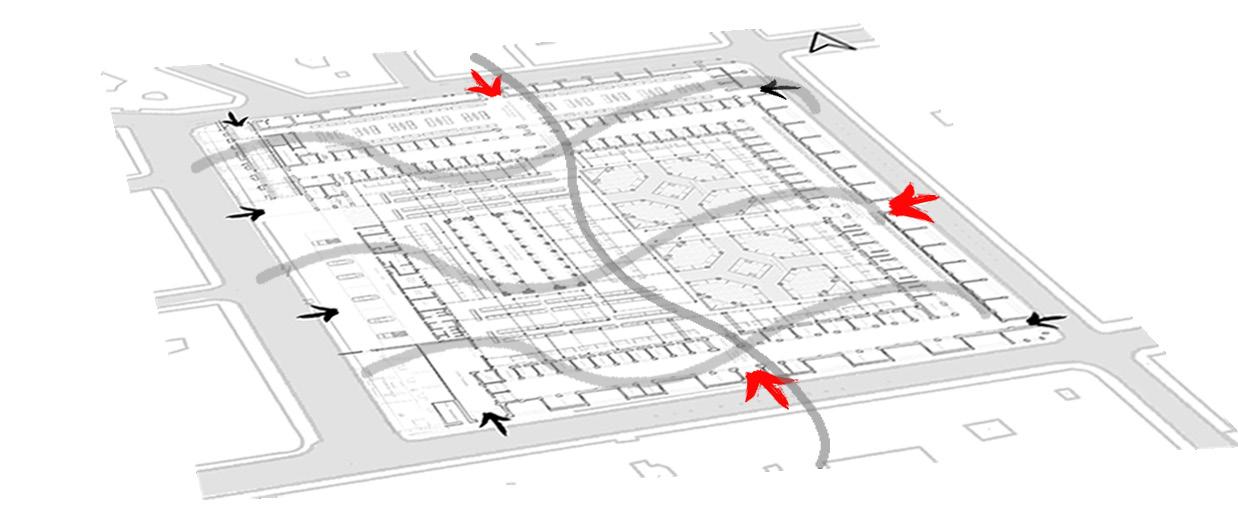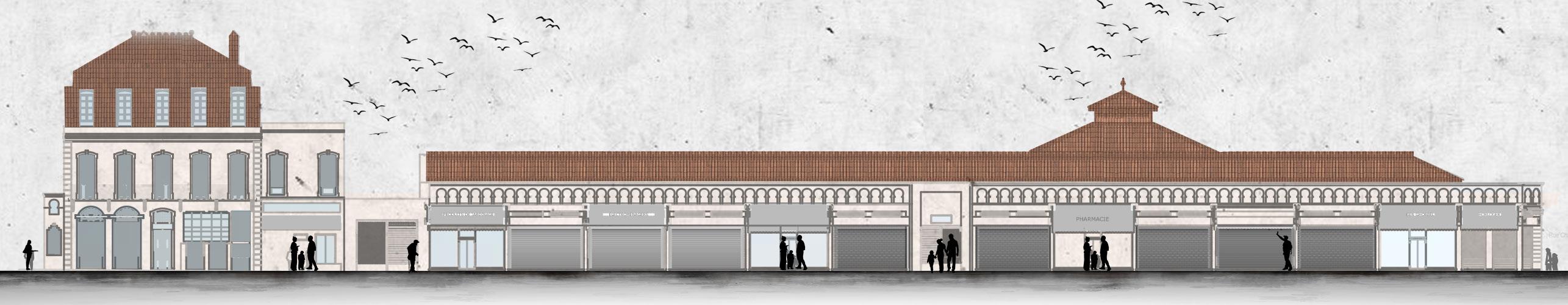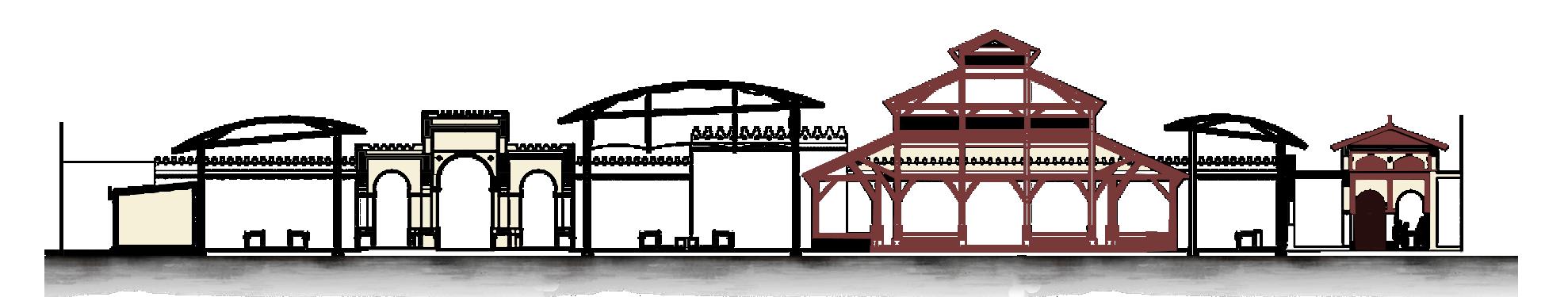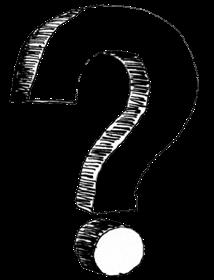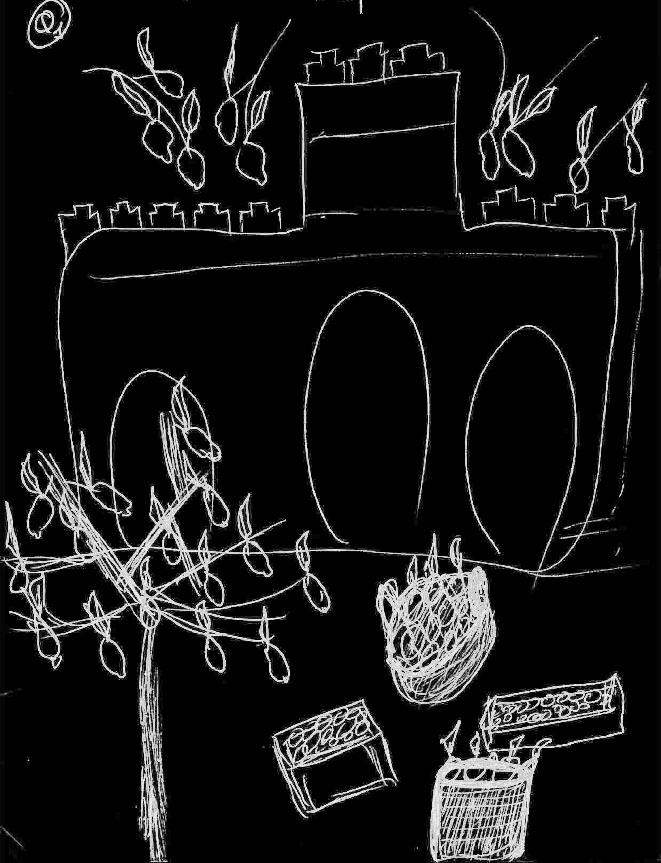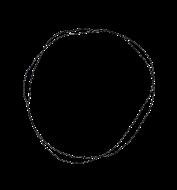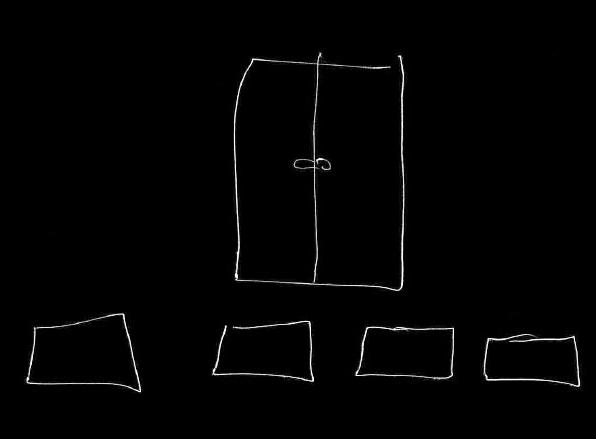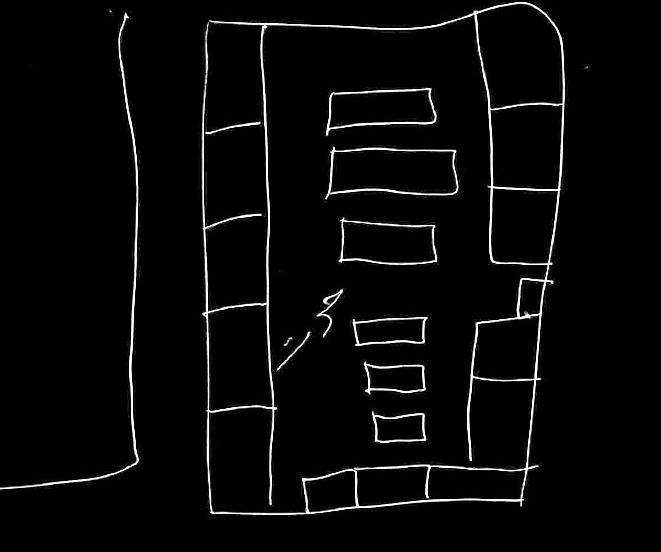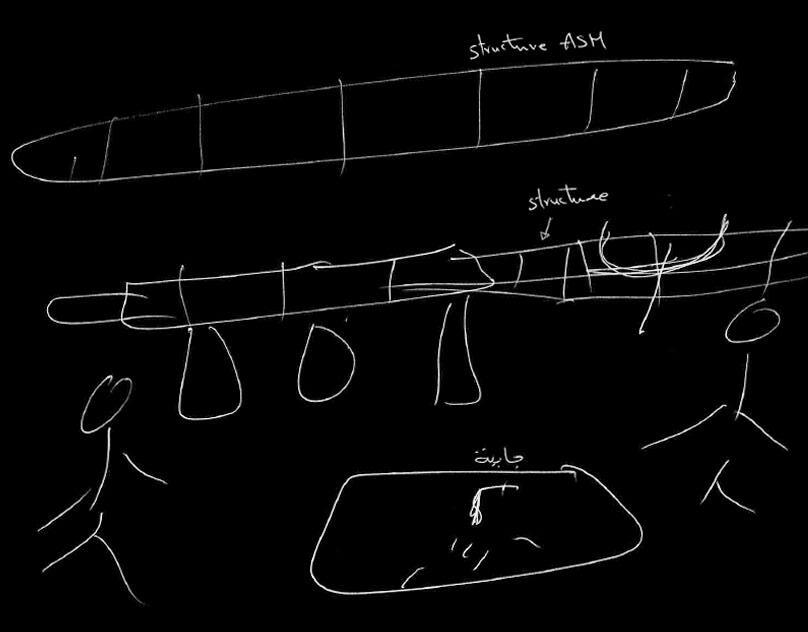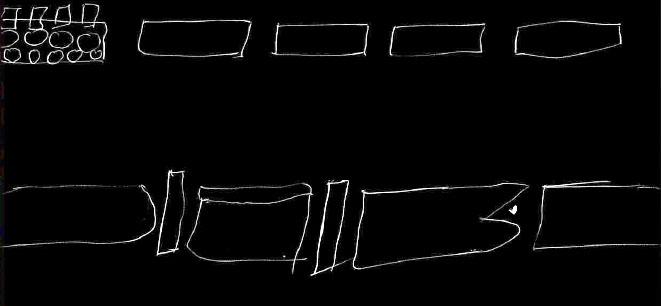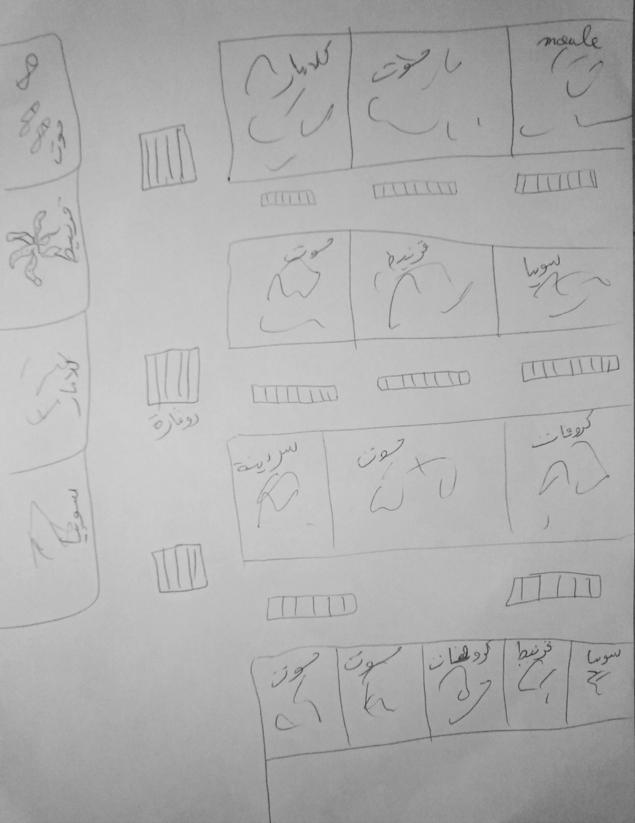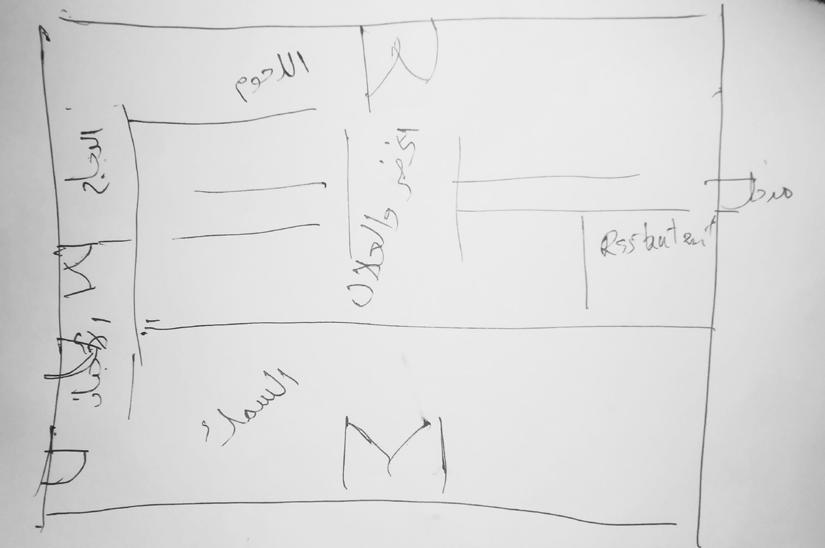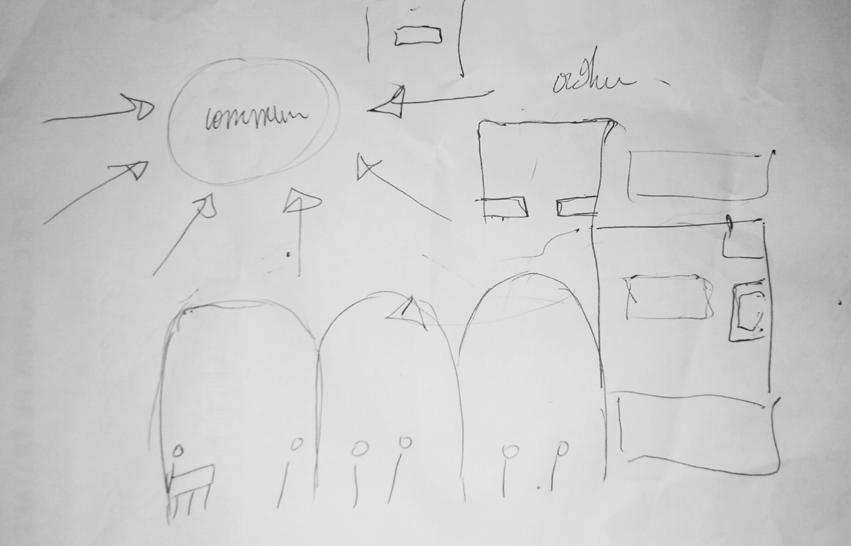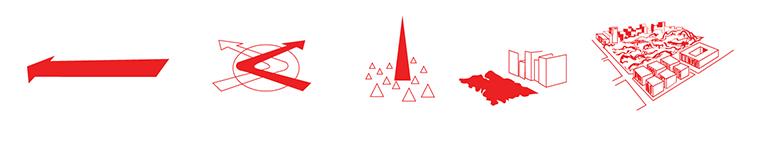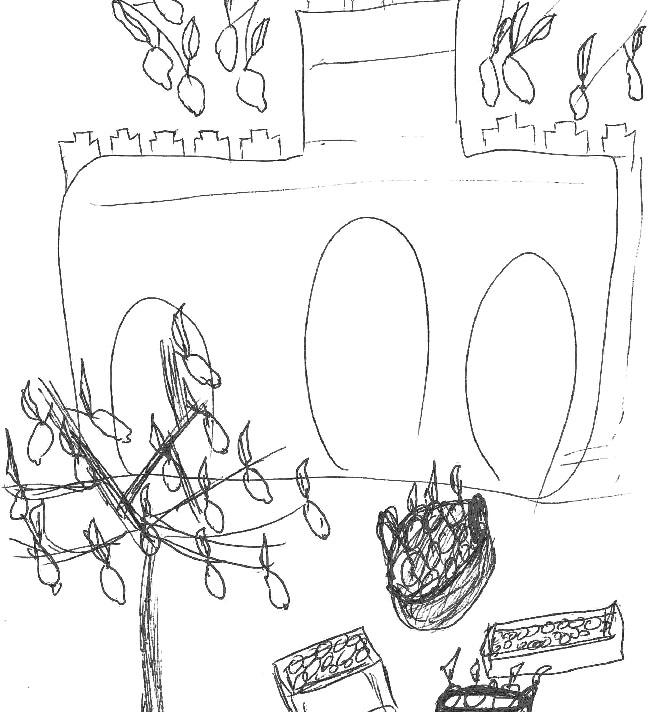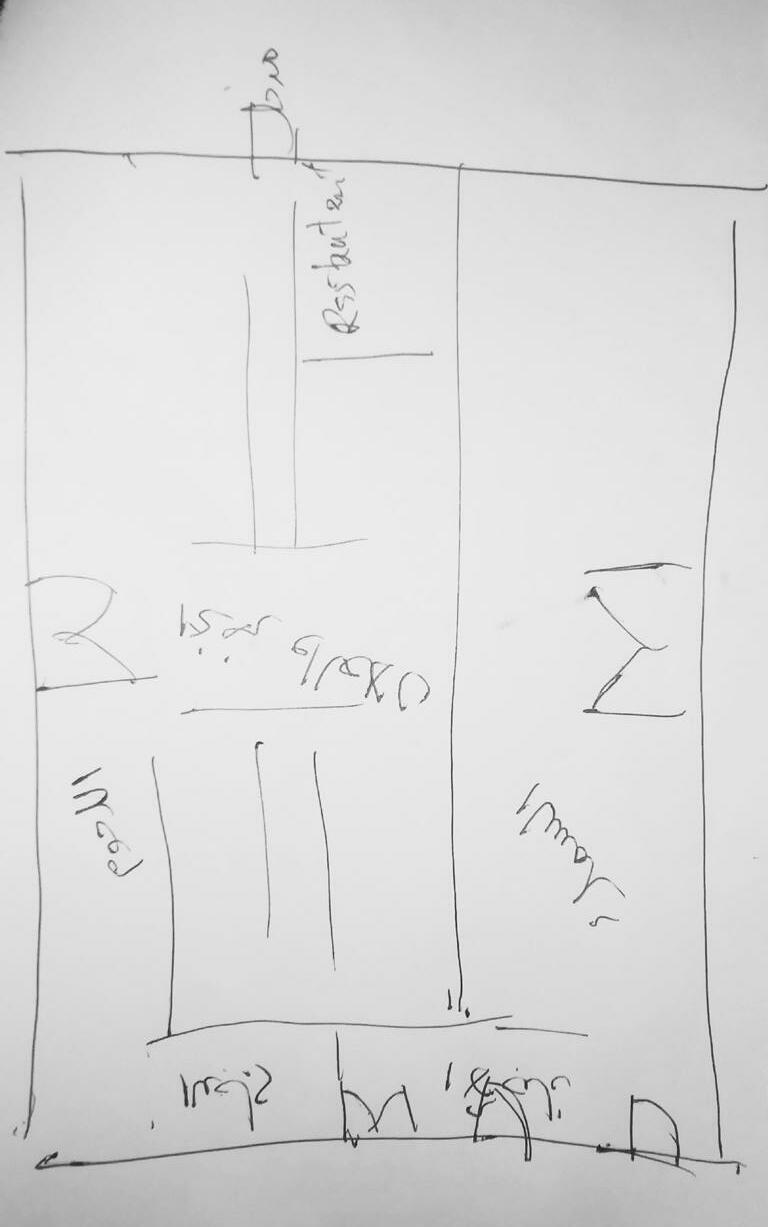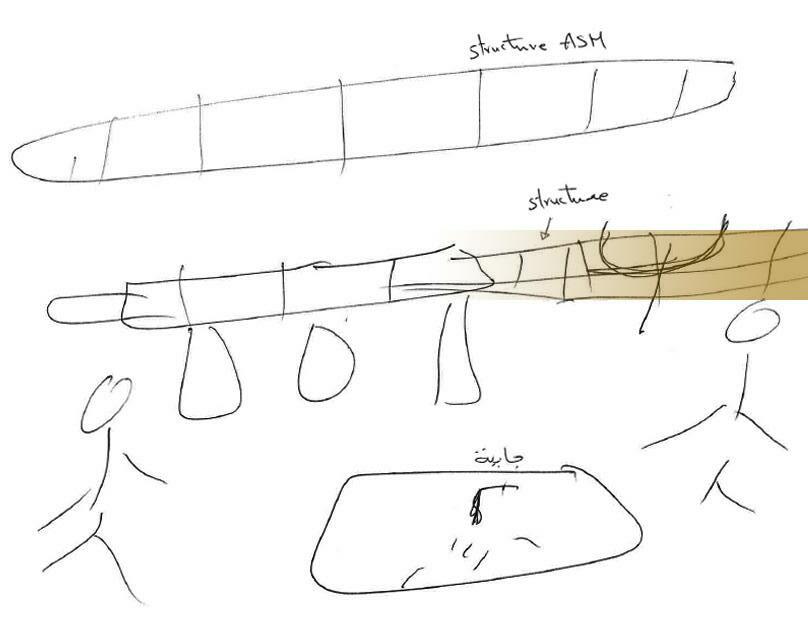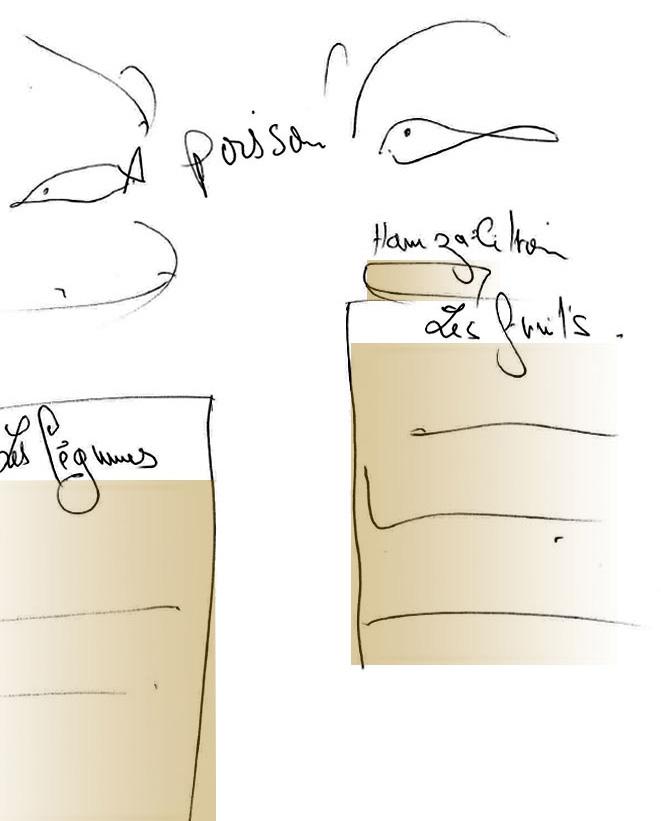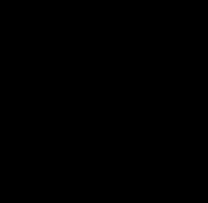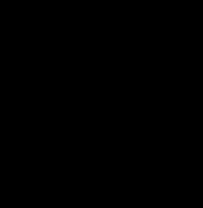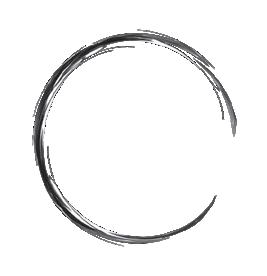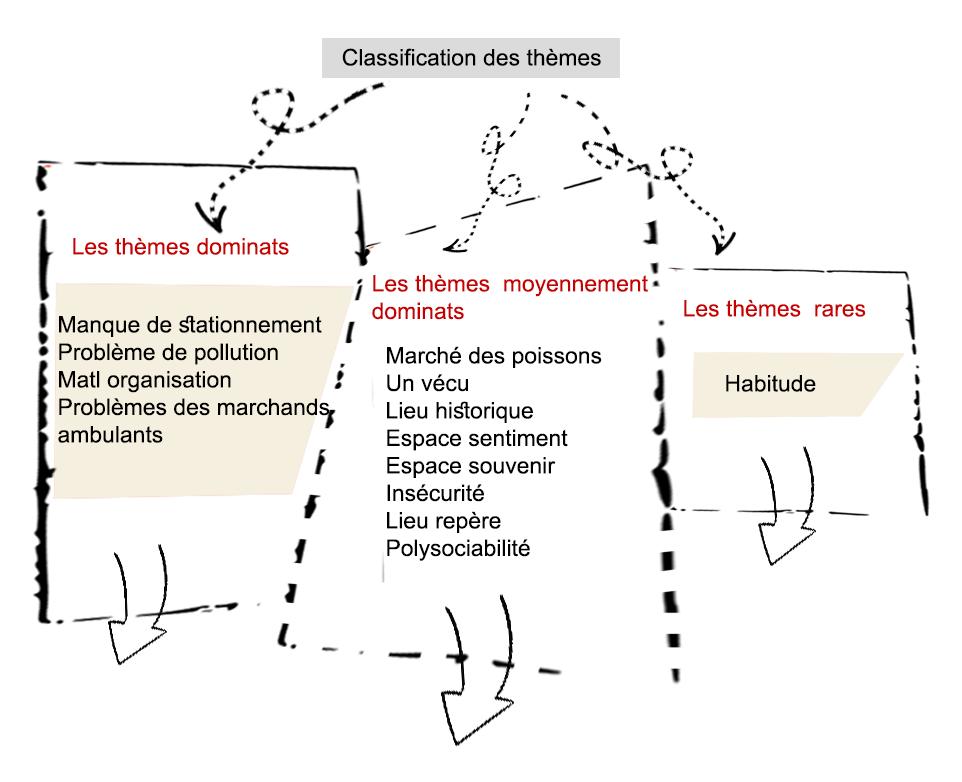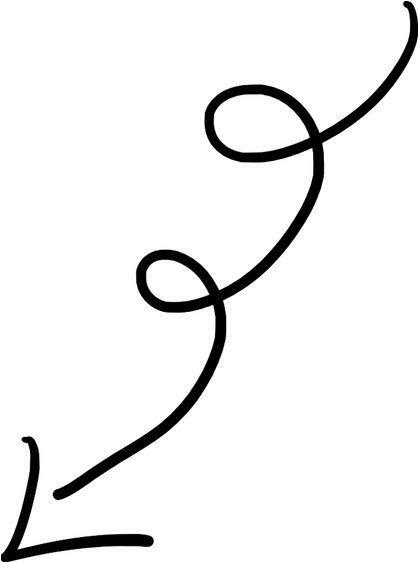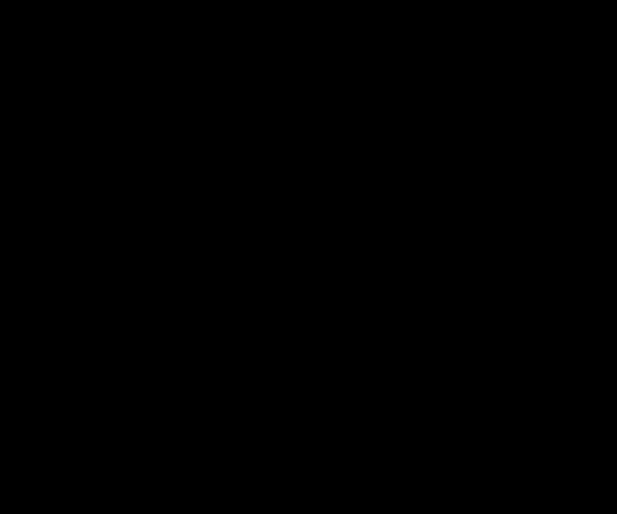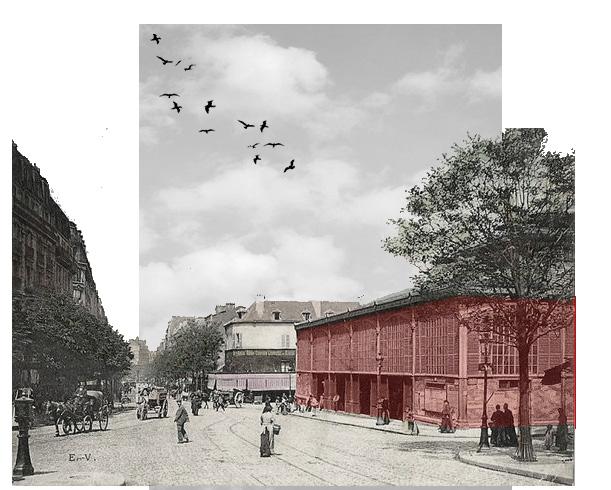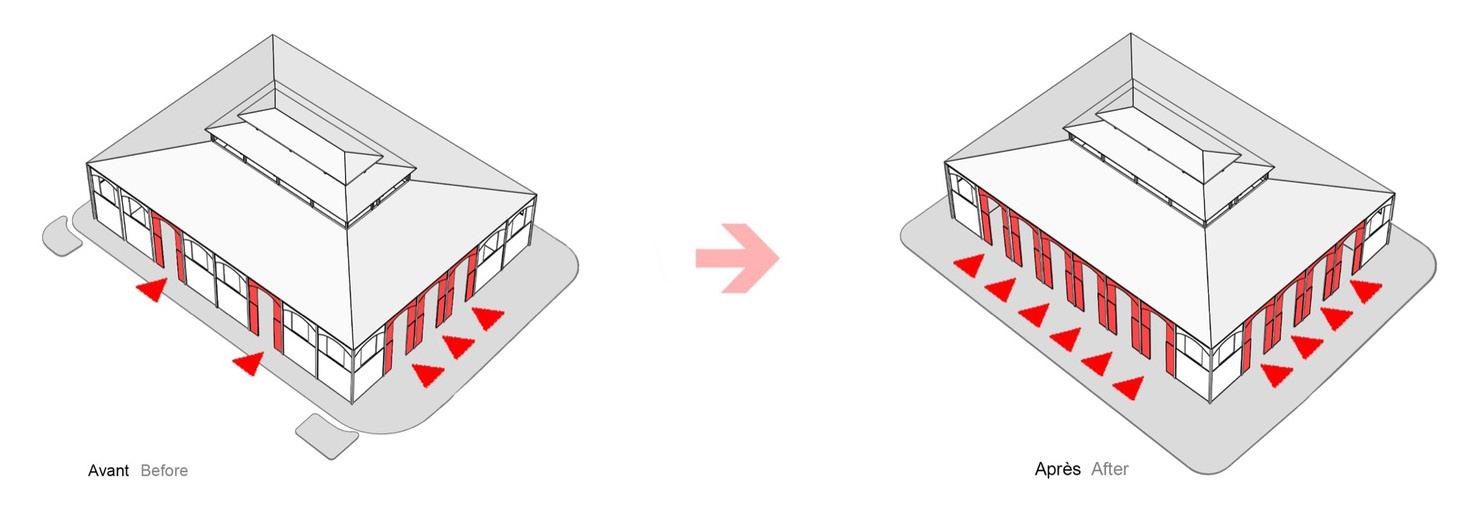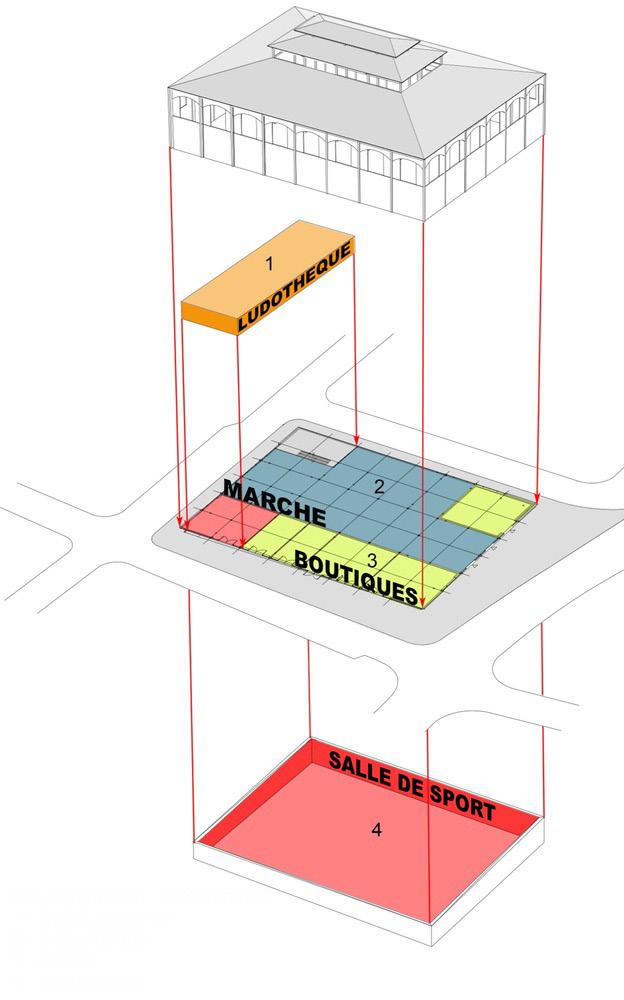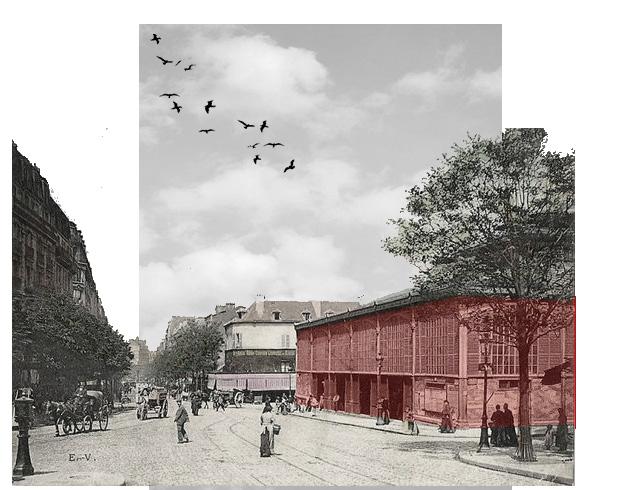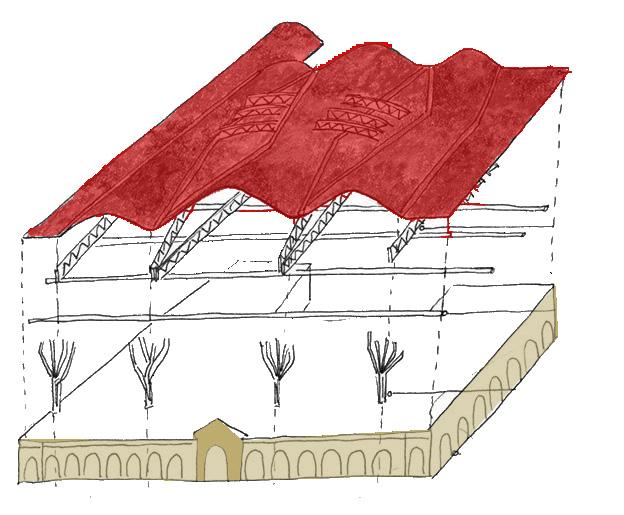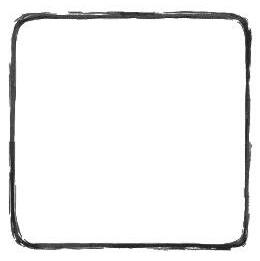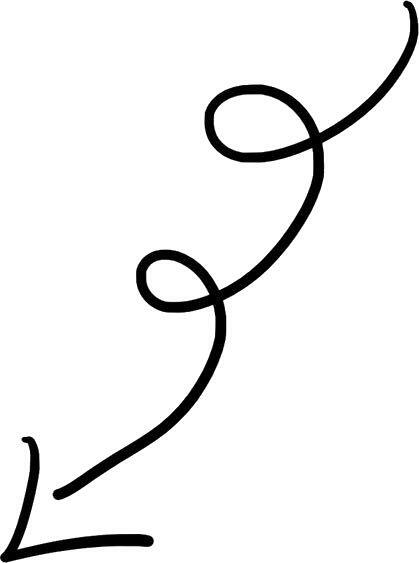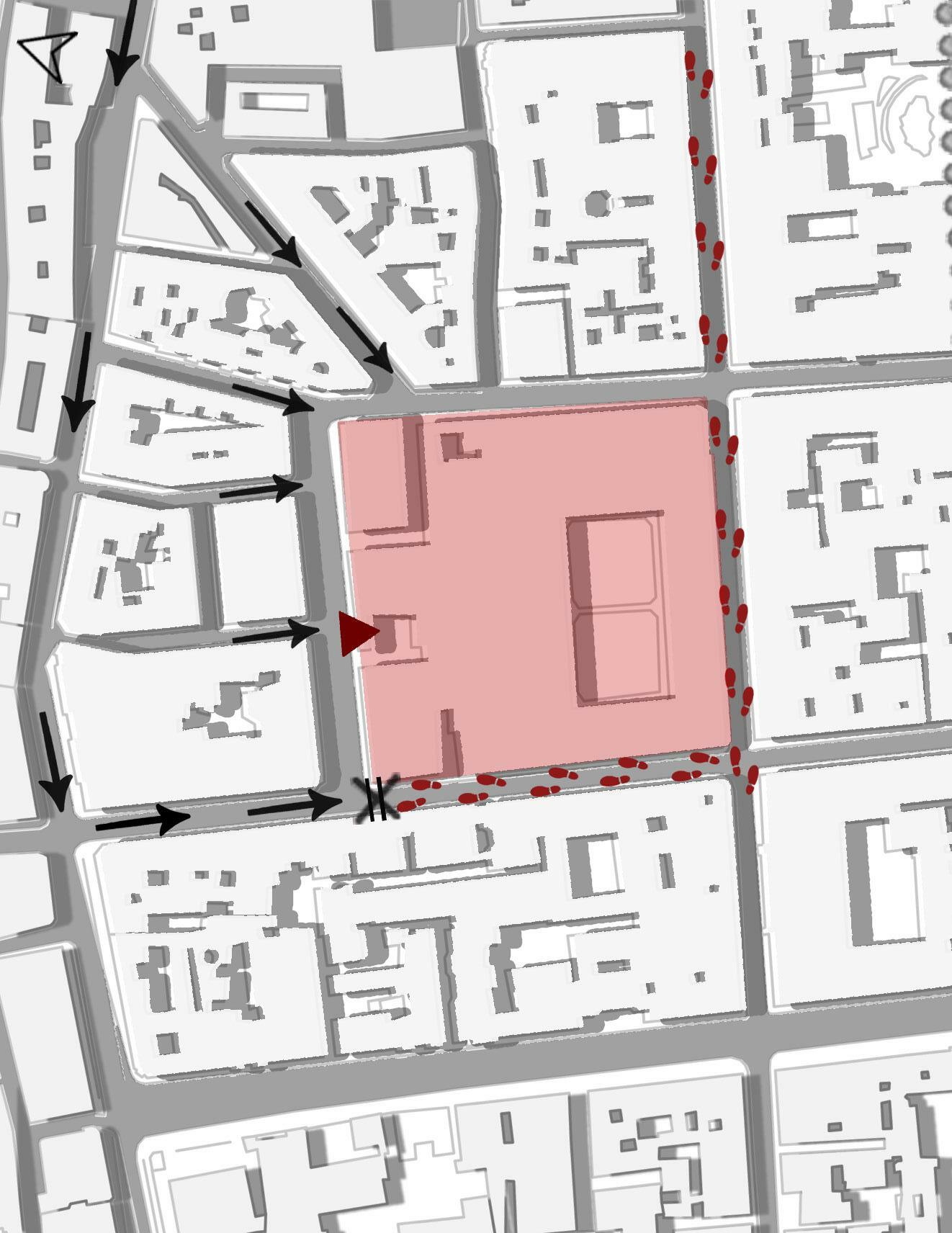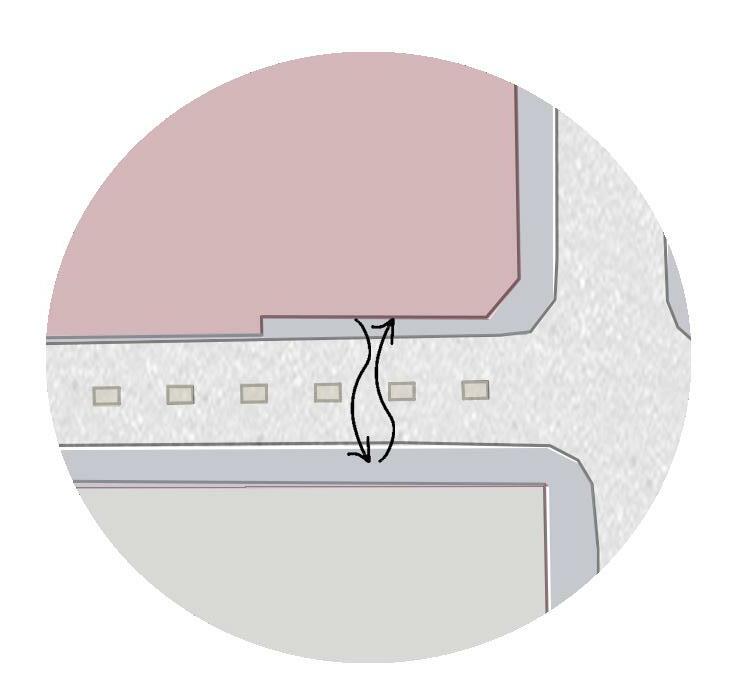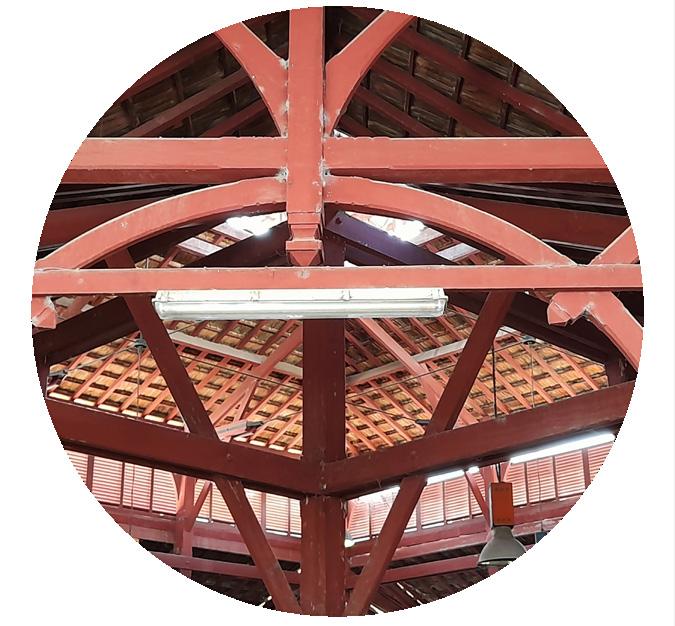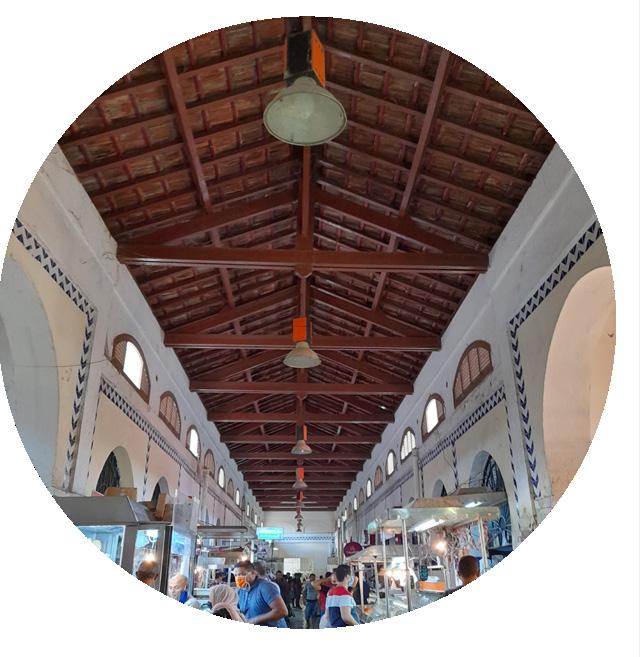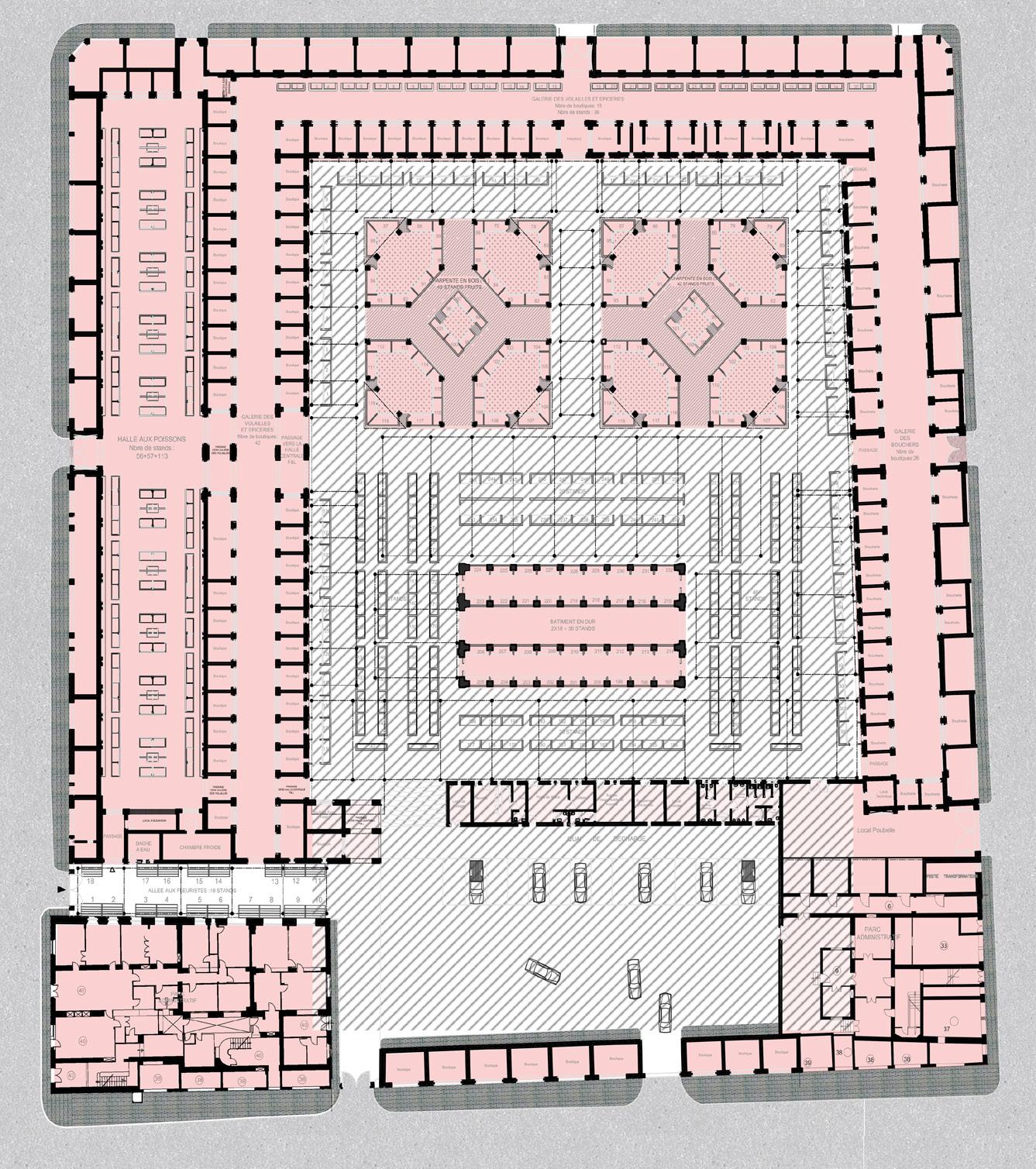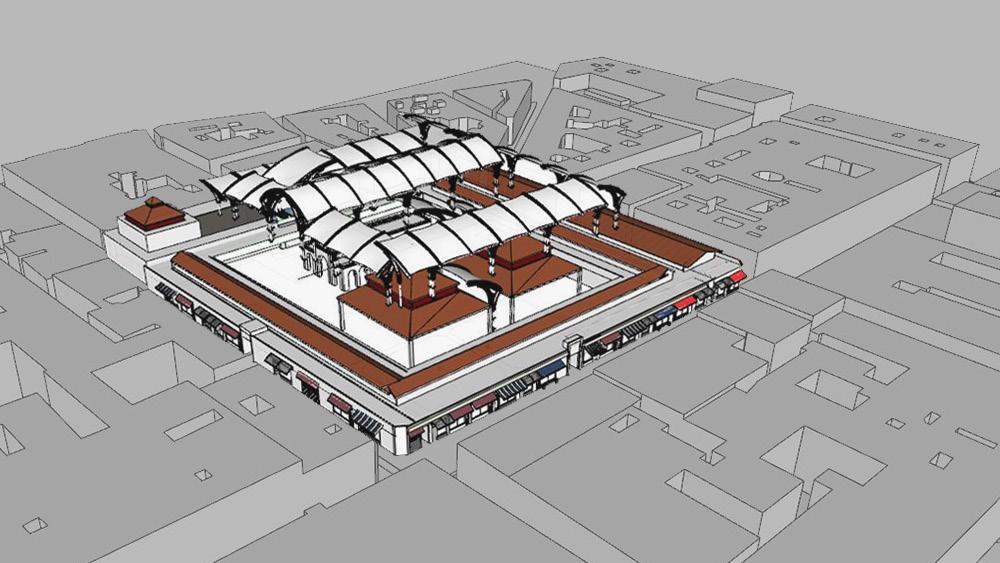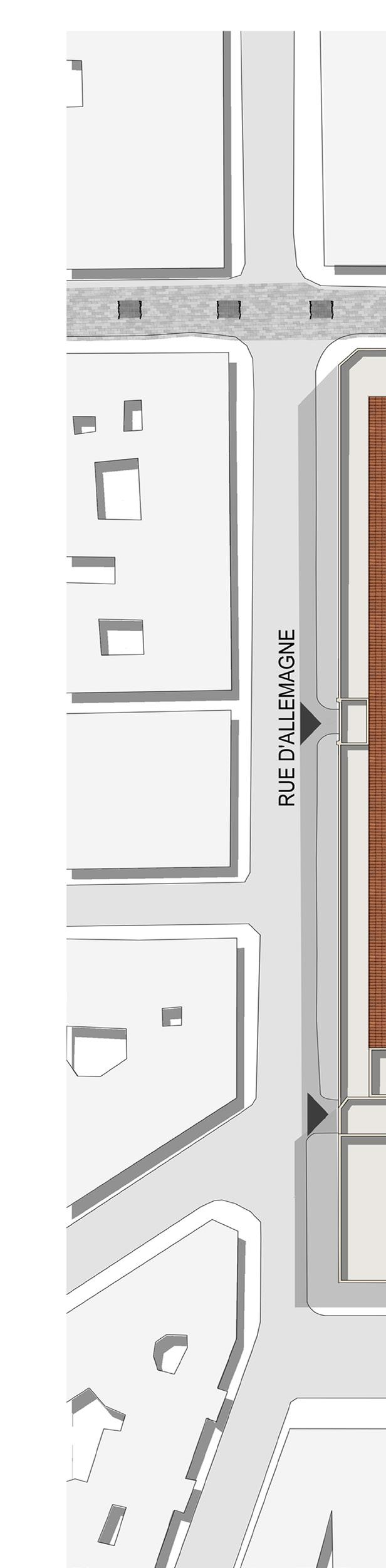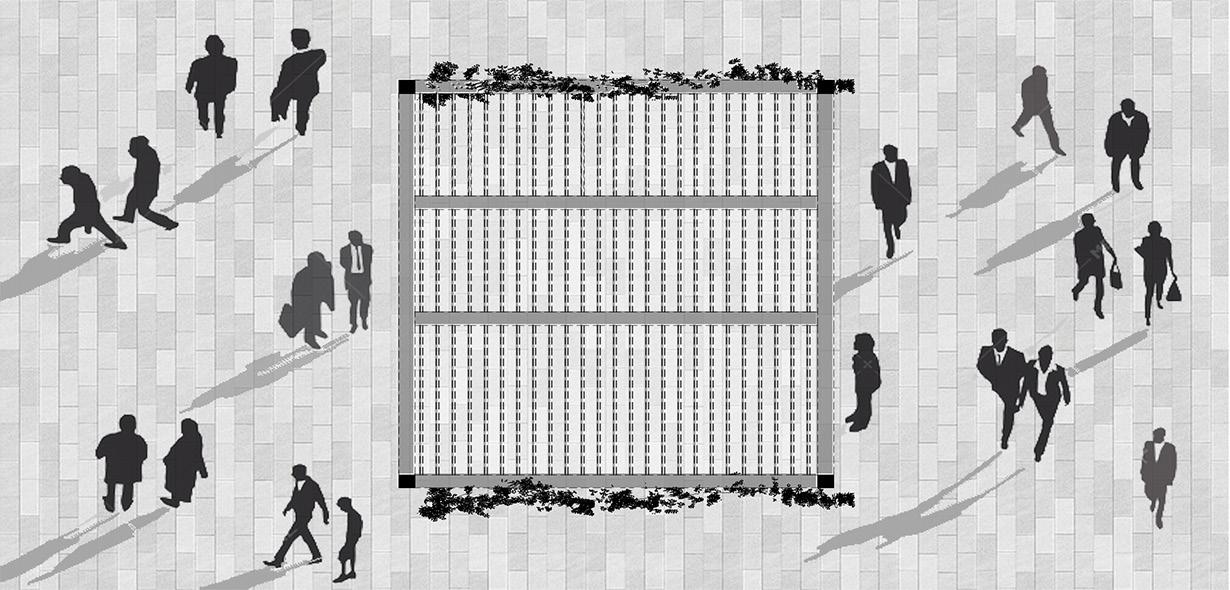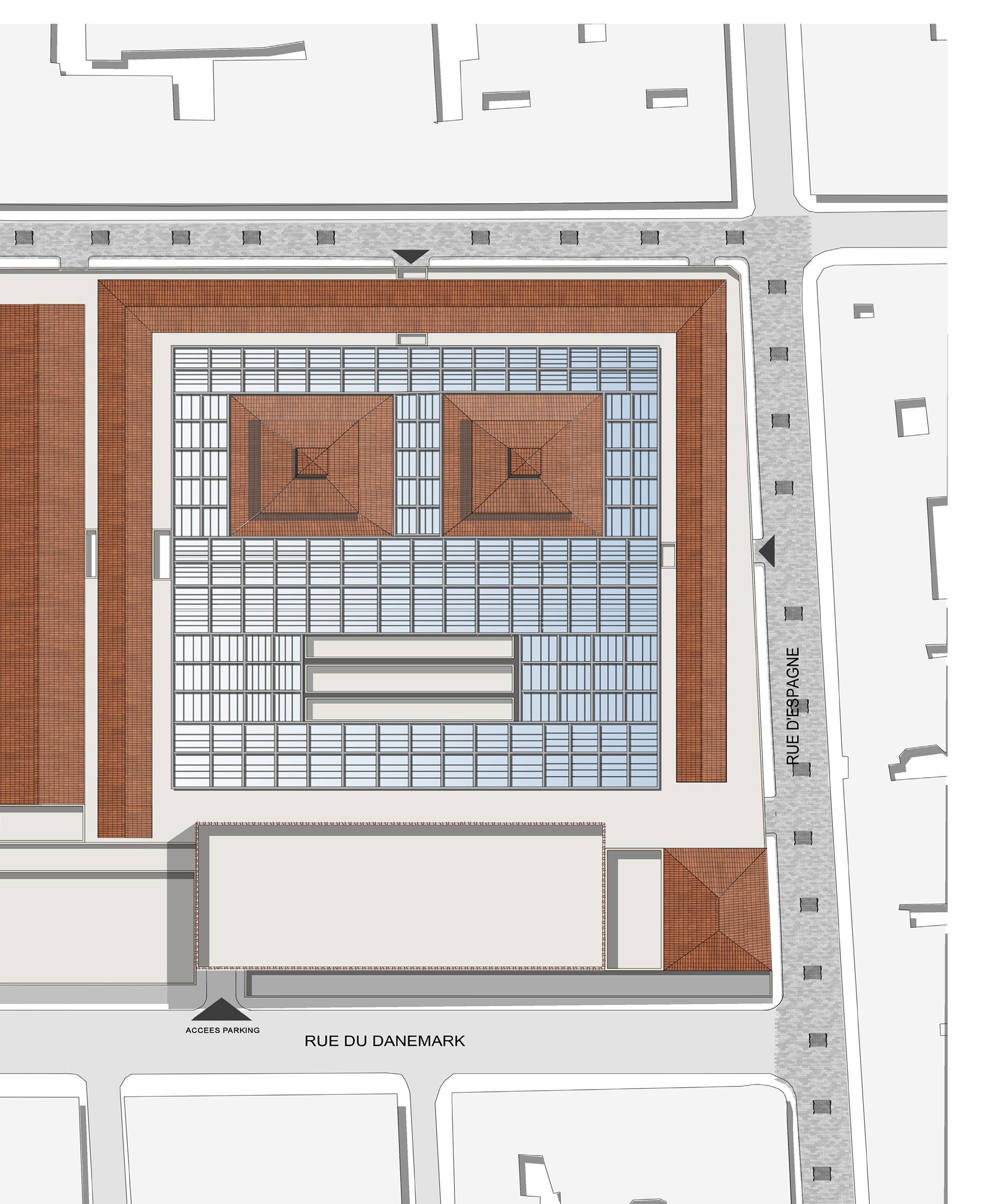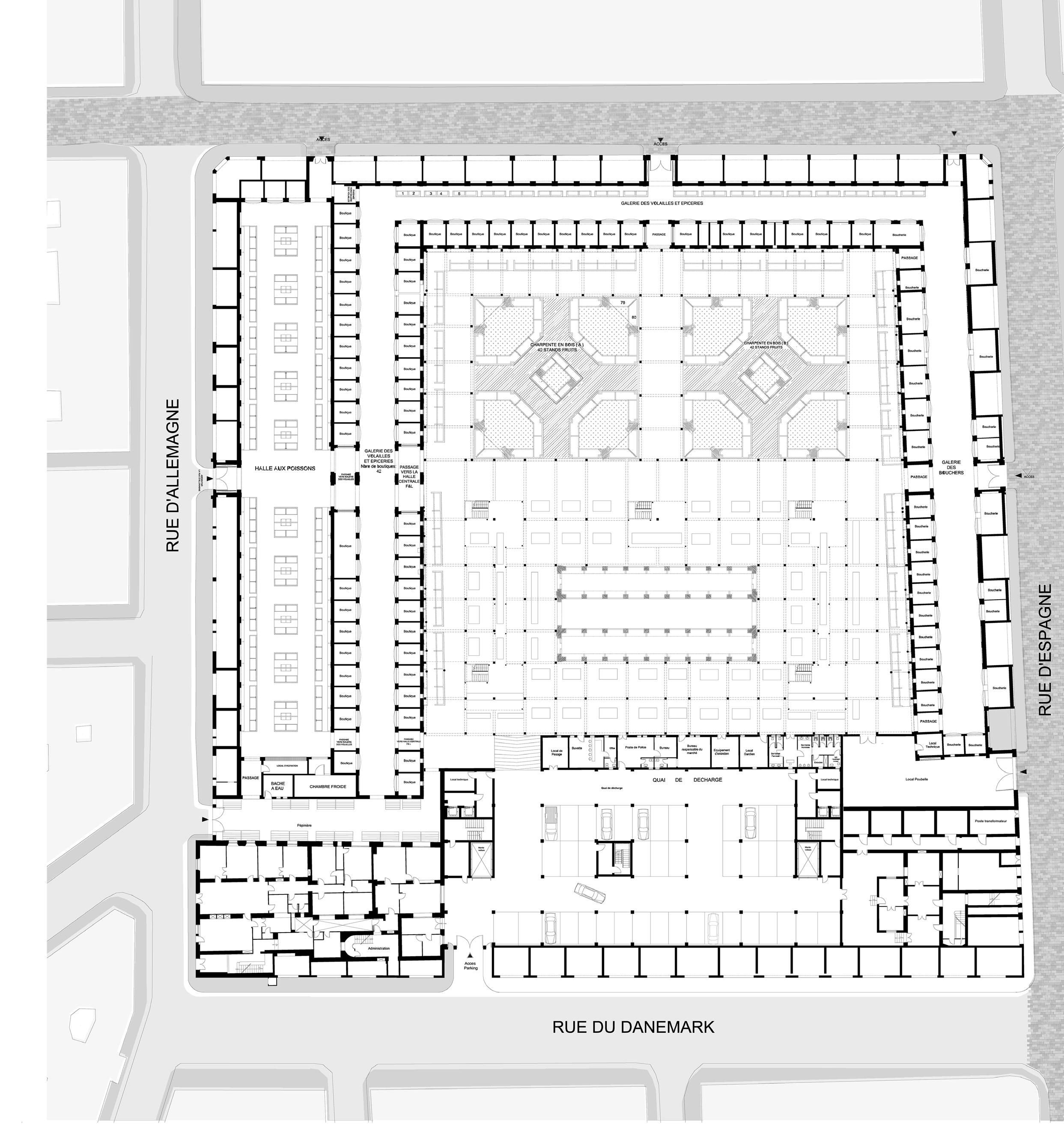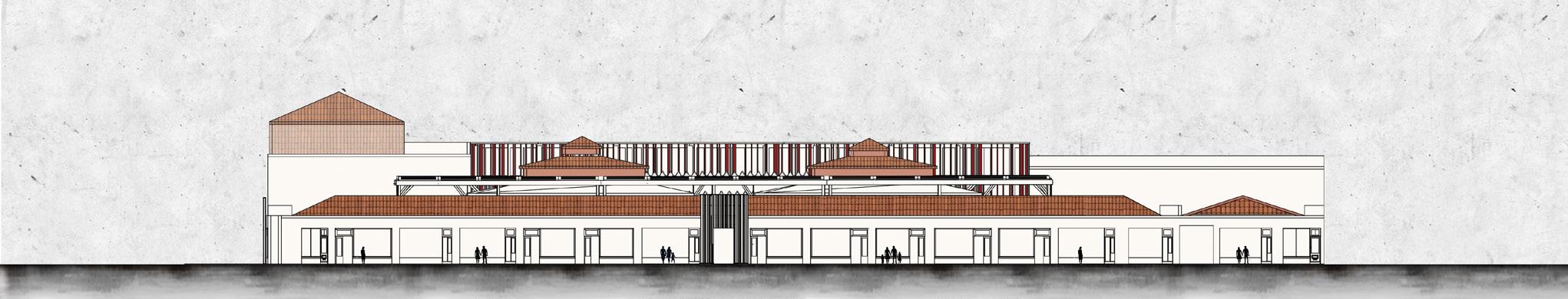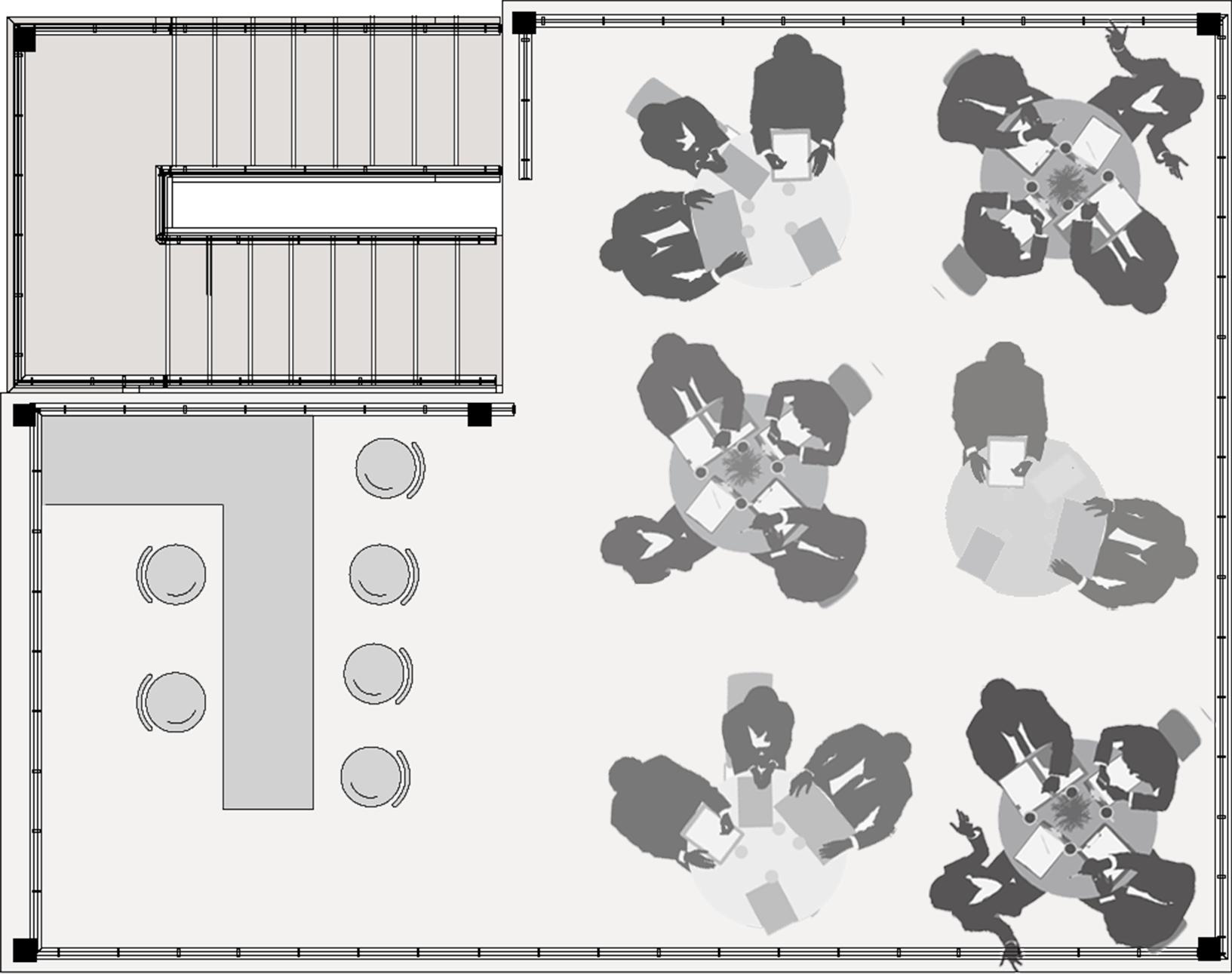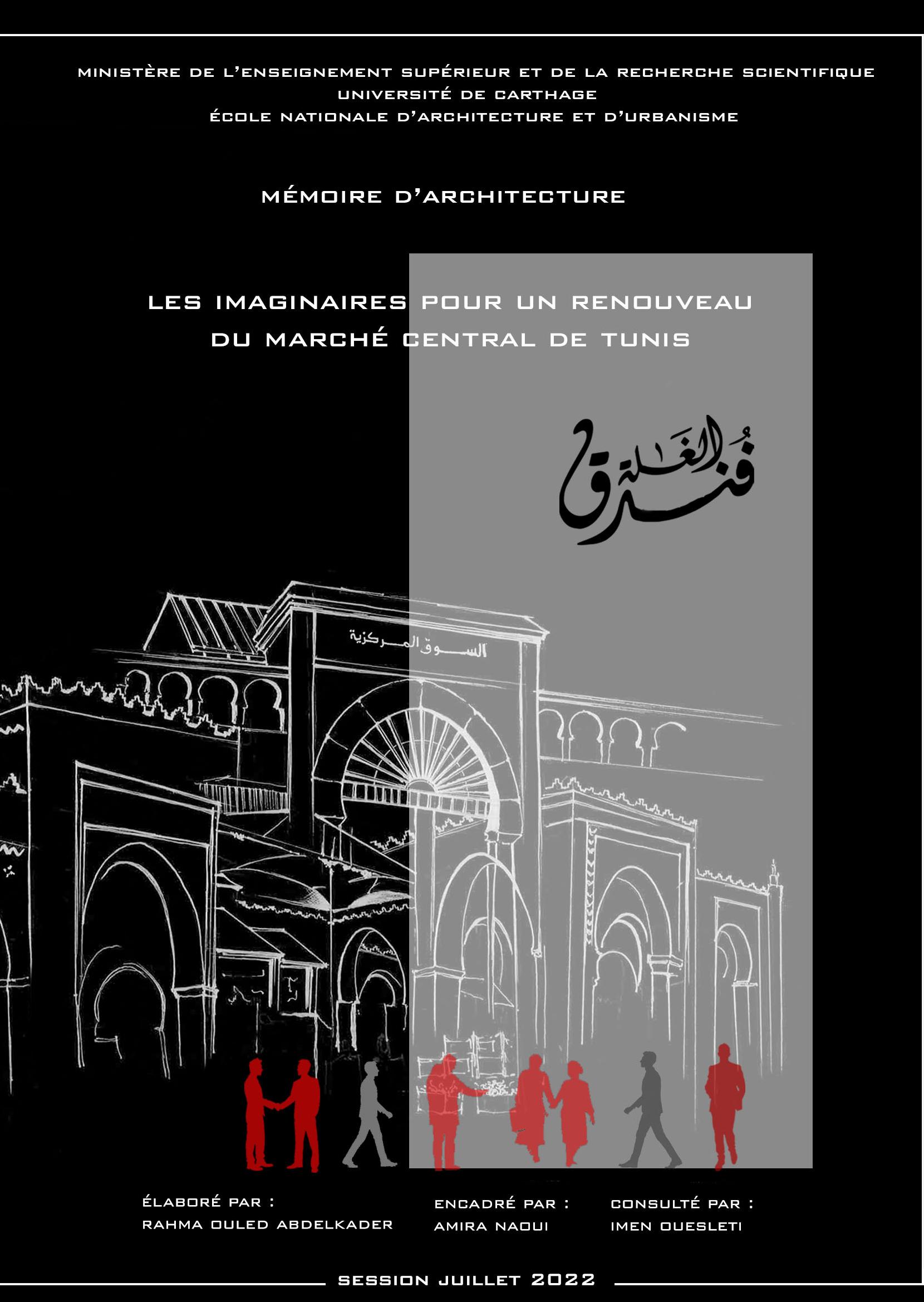
2
Les imaginaires pour une révision du Marché Central de Tunis
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE UNIVERSITE DE CARTHAGE
ECOLE NATIONALE D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME
MEMOIRE D'ARCHITECTURE
LES IMAGINAIRES POUR UN RENOUVEAU DU MARCHE CENTRAL DE TUNIS
Elaboré par : Rahma Ouled Abdelkader
Encadré par : Amira Naoui
Session Juillet 2022
Consulté par : Imen Ouesleti

III
IV
dédicaces
Je dédie ce mémoire à tous ceux qui me sont chers : Mes chers parents , Rafik et Rakia , que nulle dédicace ne puisse exprimer mon amour éternel, pour leur patience illimitée, leur encouragement et leurs grands sacrifices.
Mon cher frère , Rayen , pour son grand amour et son caractère en or , qu’il trouve ici l’expression de ma haute gratitude.
Ma chère tante Nejia pour son soutien tout au long de mon parcours universitaire . Mes chers cousins , Chahd et Amen Allah.
Ma chère amie et sœur ,Jihene, qui sans son encouragement , ce travail n’aura jamais vu le jour. Mes chères amies , à tous ceux que j’aime . Finalement , à l'âme de ceux qui nous ont quitté : Mon cher grand père Mohamed Ali Ma chère tante Jouda et mon cher oncle Maher .
V Les imaginaires pour une révision du Marché Central de Tunis
Rahma Ouled Abdelkader
remerciements
“ la réussite sourit à ceux qui font les choses avec passion , pas avec raison” Jack Welch.
Il m’est offert ici , par ces quelques lignes , la possibilité d'adresser mes remerciements les plus chaleureux à toutes les personnes qui, par leurs conseils et leurs suggestions ont permis d’aboutir à l’accomplissement de ce mémoire.
Je remercie particulièrement , Mme Amira Naoui , la directrice de ce mémoire pour avoir veillé à ce que ce travail se déroule dans les meilleurs conditions, pour sa persévérance et son encouragement qui m'ont incité à donner le mieux de moi même, qu’elle veuille bien trouver ici l’expression de ma profonde gratitude.
Mes remerciements s’adressent aussi à Mme Imen Ouesleti , ma consultante de mémoire pour ses précieux conseils ainsi que ses qualités humaines.
Un grand merci à Mr Riadh Siala et Mr Sofien Dhif pour leurs aides précieuses.
Je remercie également mes professeurs qui m’ont enseigné durant mon parcours universitaire, ainsi que les gens qui m’ont fourni des informations ou des documentations.
VI
Le présent mémoire porte sur la révision du marché central de Tunis, anciennement nommé « fondouk el-ghalla »,à travers une écriture spatiale qui tente de construire l’identité collective du lieu afin de conserver ses atouts tout en l’adaptant aux nouveaux besoins. Dans une perspective de favoriser le processus d’appropriation de cet espace , nous essayons d’interroger l'imaginaire collectif et d'introduire ce paramètre pour analyser les pratiques sociales existantes dans le but d’expliquer le décalage et la désynchronisation qui existent entre la forme de l’espace commercial et la pratique commerciale aujourd’hui .
Dans notre quête d’offrir une nouvelle vie au marché , nous cherchons à aboutir à une opération régulatrice et contextuelle qui réfléchit le marché par rapport à son environnement immédiat à travers une lecture socio-spatiale basée sur l'interaction entre les dimensions concrète, sociale et abstraite de l’espace.
Résumé mots clés
Marché central de Tunis - Imaginaire collectif- renouveaudimension sociale-dimension abstraite-dimension concrètereprésentations spatiales-enquête empirique.
VII Les imaginaires pour une révision du Marché Central de Tunis

SOMMAIRE Dédicaces.............................................................................v Remerciements......................................................................vi Résumé...............................................................................vii Sommaire..............................................................................8 Introduction générale..........................................................10 1- Contexte et motivation ....................................................11 2- Problématique.................................................................12 3- Méthodologie...................................................................14 02 01 Introduction..........................................................................35 II.1 La mutation au coeur de centre ville de Tunis.....................36 II.1.1 Naissance de la ville européenne.....................................36 II.1.2 L'environnement immédiat du marché central..................38 II.2 De la marge de la médina vers le centre ville .............................40 II.2.1 Pourquoi le nom du "Foundouk-al-ghalla".........................40 II.2.2 L'emplacement du "Foundouk-al-ghalla"...........................41 II.3 Foundouk al-ghalla : une nouvelle ère..................................44 II.3.1 Le nouveau siège du Foundouk..........................................44 II.3.2 Réhabilitation du marché central par l'ASM.......................45 Conslusion...................................................................................49 Chapitre II :la morpho-dynamique du marché central Chapitre I :l'imaginaire , un concept opératoire Introduction .........................................................................17 I.1 L'imaginaire,une constrcution transdisciplinaire..................18 I.1.1 L'imagination.....................................................................18 I.1.2 De l'imagination à l'imaginaire...........................................20 I.2 L'imaginaire,une source de création....................................24 I.2.1 L'imaginaire indivduel........................................................24 I.2.2 L'imaginaire collecitf..........................................................28 I.3 L'imaginaire et les représentations spatiales................................30 I.3.1 La représentation comme un processus...........................30 I.3.2 Les cartes mentales..........................................................32 Conslusion.................................................................................33
III.1. Construction d'un protocole d'analyse................................52
III.1.1 L'imaginaire collectif,quels perspectifs?.............................52
III.1.2 L'imaginaire,une boîte à outils conceptuels......................53
III.2. Le marché central,un vécu..................................................54
III.2.1 A l'échelle urbaine.............................................................54

Introduction...................................................................................51
03 04
III.2.2 A l'échelle du bâtiment.......................................................66 III.3. La quête des imaginaires..........................................................72 III.3.1 Interroger l'imaginaire collectif...........................................72 III.3.2 Les cartes mentales............................................................74 III.3.3 Les entretiens semi directifs..............................................85 Conslusion...................................................................................91 Introduction...................................................................................93 IV.1. L'espace commercial,autrement...........................................94 IV.1.1 le marché,l'îcone de la ville.................................................94 IV.1.2 Le marché,l'hybride fonctionnel..........................................100 IV.1.3 Le marché,l'urbanité via une mise en scène......................103 IV.1.4 Synthèse............................................................................108 IV.2. Projetation des concepts........................................................110 IV.2.1 La quête de l'imaginaire collectif..........................................110 IV.2.2 Le programme fonctionnel.................................................111 IV.3 Stratégie d'intervention..........................................................112 IV.3.1 Délimitation de la zone d'intervention...................................112 IV.3.2 Le plan d'action..................................................................113 Conslusion générale....................................................................119 Annexe......................................................................................120 Bibliographie...............................................................................121 Table des figures...........................................................................122 Table de matières........................................................................126 Chapitre III :le marché central, des imaginaires Chapitre IV: Vers un renouveau du marché via l'imaginaire
Introduction générale
“Un marché ? note Dominique
Fernandez, quel terme plat et mercantile pour désigner le territoire magique ou se déroule la plus fastueuse des cérémonies à la gloire des couleurs et des parfums !”
(Grasset,1993 ,l’or des tropiques,p30)

10
Figure 1 : le marché central... Ce fut un effet . Source : Collage personnel
1- Contexte et motivation
Chaque dimanche , comme la plupart des gens qui habitent à Tunis , mes parents ont l’habitude d’aller faire les courses au marché central… Comme il arrive parfois de le nommer "Fondouk el ghalla" , un jour je les ai accompagnés et ce fut la découverte !un bâtiment ancien et majestueux, son aura et sa présence ont suscité mon intérêt. Ainsi , ce mémoire représente pour moi l’opportunité de déchiffrer cette énigme en essayant de comprendre sa dynamique et ces dimensions cachées.
l'aventure a bien débuté dans le studio “ Milieux et lieux à l'œuvre" ou nous étions amenés à partir d’un contexte, d’un lieu,d’un constat pour en construire un processus amenant à projeter une vision stratégique portée sur ce lieu.

11
Les imaginaires pour un renouveau du Marché Central de Tunis
2 -problématique:
Il est indéniable que, partout dans le monde, la valeur d’un marché dans la ville est fondamentale. Les lieux de commerce sont plus que des espaces destinés à l’achat et à la vente, ils reflètent l’image d’un élément d’animation pour la ville avec un fort impact urbain , social et économique. Prenons le cas du marché central de Tunis appelée précédemment"Fondouk-el-ghalla" à l’époque précoloniale, il représente l’une des infrastructures dont dépend la vie de la capitale. En effet , il représente une composante essentielle du centre ville de Tunis. Il est également fort présent dans la mémoire collective.Ce bâtiment a connu des mutations multiples au cours de son histoire, et cette morpho-dynamique a marqué la métamorphose de ce lieu et sa richesse.
Aujourd’hui, alors que les besoins évoluent et continuent de se développer, l’usager essaie d'adapter et de s’adapter dans son espace commercial.Avec tous les changements dans la pratique commerciale, et avec la fonction évolutive du marché , certaines conformations ne sont toujours pas adaptées aux besoins actuels.
En plus des problèmes observés au niveau du bâtiment luimême, nous commençons à constater un dysfonctionnement dans le vécu urbain aux alentours du marché.
12
Malgré les différentes opérations assurées par l’ASM, un décalage entre l’espace conçu et l’espace vécu existe toujours.
Notre hypothèse est que la spécificité du marché ouvre les pistes de sa révision via l’imaginaire encore plus collectif pour prêter attention aux différentes pratiques plurielles mais surtout socio-spatiales.
Comment agir sur un existant pour le transformer ? Dans quel sens l’imaginaire, surtout le collectif, est il générateur d’une stratégie de révision du marché central?
L’enjeu de ce projet consiste à traduire les représentations de l’imaginaire collectif en configurations spatiales et construire l'identité collective du lieu .
L’acte architectural qui aura lieu sur le marché , offrira un nouveau regard sur l'appropriation d’espace qui pourrait lui donner une nouvelle vie et ajouter une strate dans la morpho- dynamique du lieu.
13
Les imaginaires pour un renouveau du Marché Central de Tunis
En partant de la problématique posée précédemment, une approche méthodologique sera nécessaire pour aborder notre sujet.
Tout un travail de collecte d’informations , d’analyse et de recherche des différentes perceptions à propos de ce sujet est réalisé dans le but de construire un protocole pour approcher l’objet d’étude dans une démarche qui se veut objectivante.
Repenser le marché via l’imaginaire revient à considérer le bâtiment comme un repère de ville , en plus de la fonction primaire. Le processus cognition-action permet de déduire à partir des champs sociologiques et scientifiques un protocole d’action menant à penser dans la complexité.
le manuscrit s'articule autour de quatre chapitres :
01 02
l'imaginaire , un concept opératoire
le premier chapitre s’appuie sur un développement théorique. En premier lieu , nous traitons l’imaginaire comme un concept philosophique transdisciplinaire qui inspire tout type de création . Ensuite , nous explicitons la genèse de l’imaginaire individuel pour en dériver l’imaginaire collectif et la relation entre la société à la mémoire collective. En deuxième lieu , nous abordons l’imaginaire spatial qui est stimulé à travers la perception dans l’espace en question et comment on arrive à représenter cet imaginaire à travers la carte mentale de lynch. Ensuite ,à travers ces différentes représentations , nous expliquerons comment tenter de développer un projet architectural via cet imaginaire collectif.
la morpho-dynamique du marché central
Le deuxième chapitre expose le contexte généralà savoir le centre ville de Tunis ou “la ville européenne” et son évolution et depuis la colonisation . Puis nous expliquons la morpho-dynamique de Fondouk el-ghalla et sa transformation en marché central de Tunis, aussi bien que son environnement immédiat .
14 3 -
méthodologie
le marché central, des imaginaires
Le troisième chapitre définit le marché central de Tunis est comme des scènes imaginales, un parcours commenté et des transects urbains seront parmi les outils analytiques.l’analyse ne concerne pas que ce lieu commercial mais tout l’environnement immédiat pour mieux préciser les potentialités et détecter les problèmes existants.
On ne peut en aucun cas ne pas évoquer la quête de l’imaginaire collectif et social à travers une enquête sur site afin de creuser la mémoire collective. Nous décortiquons d'abord les représentations spatiales proposées par les enquêtées , puis nous procédons à des entretiens semidirectifs. Les résultats de cette enquête seront interprétés comme des outils aide à la conception.
Vers un renouveau du marché via l'imaginaire
Après , nous présentons des exemples qui cristallisent les différentes interrogations posées précédemment.
A travers les chapitres précédents, de nouveaux concepts et réflexions ont été tirés permettant de développer une programmation précise. Finalement nous mettons forme une architecture qui découle des concepts étudiés.
15
Les imaginaires pour un renouveau du Marché Central de Tunis
03
04
chapitre I
L'imaginaire, un concept opératoire
Figure 2 : l'imaginaire , un outil opératoire . Source : Collage personnel

L’imaginaire , un concept pluridisciplinaire, est évoqué dans la plupart des domaines. Il est emprunté dans son sens figuré et renvoie à un ensemble de productions mentales à base d’images visuelles ou langagières . Par ailleurs , l’imaginaire individuel ou collectif se développe comme une formation de représentations en des réalités.
Dans le premier chapitre, la notion de l’imaginaire est abordée comme un concept opératoire qui inspire tout type de création. Nous allons , dans un premier temps , décortiquer cette notion ainsi que sa genèse pour en dériver l’imaginaire collectif.
Dans un deuxième temps , nous aborderons la méthode de représentation de cet imaginaire à travers la carte mentale de Kevin Lynch pour comprendre les pratiques sociales et les liens qu’entretiennent ces acteurs avec l’espace concerné.
Cette démarche a permis la construction d’un protocole d’analyse qui sera projeté , par la suite , sur notre territoire d’étude.

introduction
Les imaginaires pour une révision du Marché Central de Tunis
I.1. L’imaginaire , une construction transdisciplinaire
I.1.1. L'imagination
• L’imagination : une faculté de connaissance
L’imagination 1 est le pouvoir de représenter ce qui est absent . Il s'agit de la faculté de fabriquer des images. Elle est élaborée à partir d’un élément qui est existant, par rapport à quelque chose que nous regardons , qui nous touche. Selon Bachelard, l'imagination n'est pas comme l'étymologie suggère, le pouvoir de former des images de la réalité; cette première représente ainsi la capacité de former des images qui vont au-delà de la réalité. Elle est une faculté de surhumanité. Aristote, dans son livre distingue trois facultés de connaissance à savoir : 1-l'entendement, 2-l'imagination 3-la sensation .
Figure 3 : les facultés de connaissance de Aristote . Source : auteur
L'imagination
L’imagination est née à partir de notre esprit , c’est quelque chose que nous élaborons à partir d’un élément qui est existant, par rapport à quelque chose que nous regardons,qui nous touche. A titre d’exemple , nous pouvons imaginer un triangle sans le dessiner. Il s’agit bien là d’une faculté de connaissance puisque nous nous représentons certaines facultés qui sont celles des corps.
Figure 4 : l'imagination à partir de l'esprit. Source : auteur
1L’imagination est la faculté de se représenter ou de former des images à travers l’esprit à partir d’éléments dérivés de perceptions sensorielles ou d’abstractions: Défi ntion de l’imagination : Wikipédia



18
Elèment existant E S P R I T
I : l'imaginaire , un concept opératoire
les images que nous formons ainsi nous permettent de mieux saisir la nature de ces corps. l’imagination conserve chez Descartes le statut que que lui avait donné Aristote. Elle est plus que la sensibilité : l’imagination est l’aptitude à donner forme aux choses et à les faire apparaître.
Figure 5 : l’imagination entre connaissance et sensibilité . Source : collage personnel

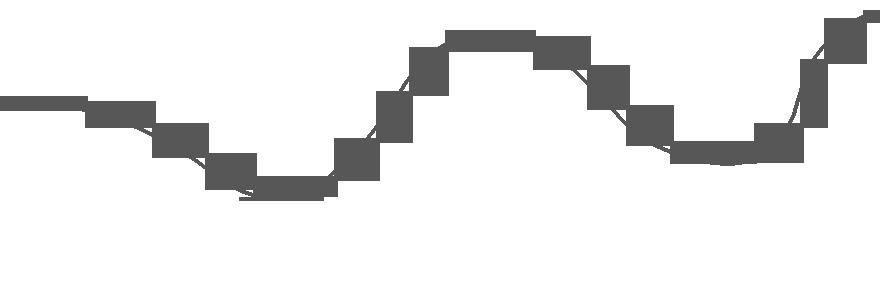
• Le schématisme : pratique d’imagination
Le « schématisme » de l’imagination est un concept de Kant. l'imagination n'est pas seulement le droit de créer ou de fournir des expressions autres que la sensation, c'est aussi la capacité de percevoir certaines caractéristiques peu pratiques dans les objets, qui ne sont ni des sens directs ni complètement géométriques.
L'imagination est coordonnée jusqu'à ce que nous puissions reconnaître un objet conceptuel, ce qui est une sorte d'opération de synthèse d'images ou "synthèse figurative “ Le concept d'imagination de Kant est assez contradictoire. D'une part, il le rattache aux activités de connaissance de manière étroite et essentielle . Mais d'autre part, dans le cadre de l'expérience esthétique liée à la nature, il exerce un pouvoir de nous révéler notre appartenance au « monde intelligible».
19
Chapitre
Aristote

A retenir
Résumant les développements passés, le concept d'imagination d'Aristote à Kant est relativement stable : Kant

La capacité des choses à apparaître devant nous et à nous façonner
La capacité à connecter nos pensées avec la réalité objective I.1.2. De l’imagination à l’imaginaire

Depuis Kant, l’imagination a changé de statut. Elle n’est plus liée au savoir et à la réalité, mais au rêve et à la création artistique. Ce changement se reflète dans l’utilisation du terme “imaginaire” comme nom au lieu d’un simple adjectif. L’imaginaire peut être sommairement défini comme le résultat de l’imagination individuelle, collective ou sociale pour produire un mythe selon lequel les images, les performances, les histoires sont plus ou moins séparées de la réalité .
L'imagination
L'imaginaire
Construire et imaginer à partir de ce qui est existant , qui permet des innovations
Créer et construire à partir de ce qui n'existe pas
L'imagination et L'imaginaire font strictement partie de l'esprit
Figure 6 : La différence entre l'imagination et l'imaginaire. Source : Schéma Personnel
20
Chapitre I : l'imaginaire , un concept opératoire
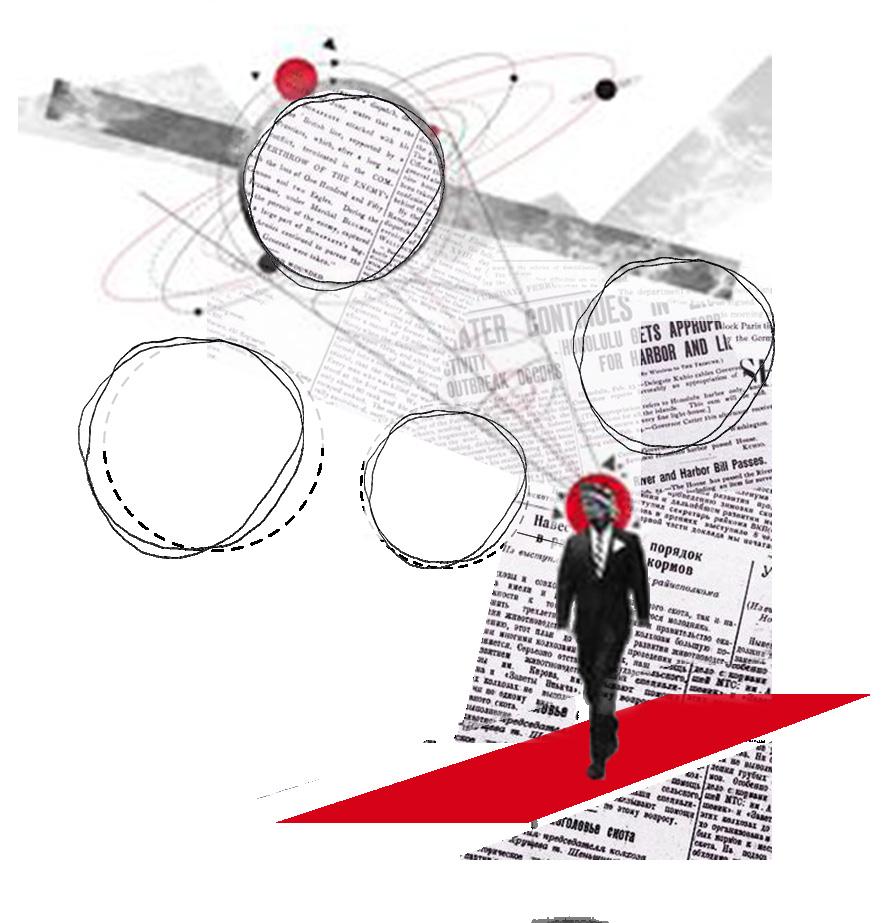
Fiction Mythologie
Les productions artistiques
Idéologie
L'imaginaire est une catégorie plastique ,c'est un ensemble d'entités aux termes assez divers : fantasme, mémoire, rêve, croyance, fi ction, récits , qui sont autant l'expression de l’imaginaire d’un individu ou d’une culture. On peut parler de l’imaginaire d’un individu mais aussi d’un peuple, travers toutes ses œuvres et croyances.
C'est un terme 2 encore difficile à définir car il interfère souvent avec d'autres termes, notamment: la mythologie, l’idéologie, la fi ction...
Lucian boia 3 montre bien que l’imaginaire est dé fi ni par ces structures internes plus que par des référents et matériaux dont il est vain de déterminer le caractère réel ou non: “l’imaginaire se mêle à la réalité extérieure et se confronte à elle ; il y trouve des points d’appui , ou, par contre , un milieu hostile ; il peut être confirmé ou répudié . Il agit sur le monde et le monde agit sur lui. Mais , dans son essence , il constitue une réalité indépendante , disposant de ses propres structures et de sa propre dynamique” .
2 Comme le rappelle Jean Jacques Wunenburger “ le terme est d’inscription récente dans la langue française et semble ignoré dans bien des langues ( il n’y a pas d’équivalent en anglais)”
3 Lucian Boia est un historienroumain francophone . Son œuvre originale, traite de l'imaginaire collectif ; il s'est par ailleurs attaché à démonter les ressorts scientifiques du communisme.
21
•
L’imaginaire : Un ensemble d’images
L’imaginaire d’un individu ou d’un groupe se développe dans la formation de représentations et de croyances dans la réalité. Ces dernieres dépassent le niveau de l’expérience sensorielle et forment leur propre monde qui peut nourrir des histoires (mythes sociaux). L’imagination est indissociable de l’invention de la création, du maintien et du renouvellement des images de l’imagination. “ On n’imagine pas les idées. Bien plus , quand on travaille dans un champ d’idées , il faut chasser les images . Inventer dans l’ordre des idées et imaginer des images sont des exploits psychologiques très différents”4
Figure 9 : L’imaginaire, un ensemble d’images hétéroclites. ,source : Collage personnel
L'imaginaire est un réseau d’images passives qui enveloppe tout être humain et toute civilisation. L’imaginaire d’un peuple , d’une époque ne peut pas seulement être compris comme un magma d’images hétéroclites. Il suit une structure historique constituée de constantes et de changements au fi l du temps. A suivre les travaux des centres de recherche sur l’imaginaire , liés à l’école française de Grenoble , une analyse sur ce qu’est l’imaginaire a été dégagée. L’imaginaire touche un aspect représentationnel linguistique et un aspect émotionnel du sujet. L’imaginaire est donc plus proche des perceptions que des conceptions abstraites.
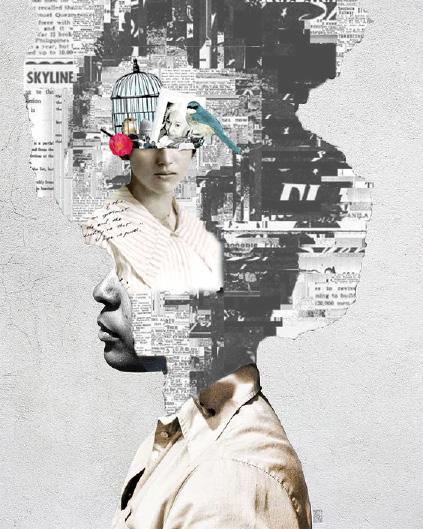
22
Idées Images
Figure 8 : la philosophie Bachelardienne ,source : Schéma personnel
4 Gaston Bachelard, Fragments d’une Poétique du Feu. (1988), p 32
Chapitre I : l'imaginaire , un concept opératoire
Il n’y a un imaginaire que si un ensemble d’images et de récits forment une totalité plus ou moins cohérente qui produit un sens. Ainsi, l’imaginaire est un ensemble de productions mentales basées sur des images visuelles (peintures, images...) et du langage (métaphores, symboles, récit ) ou incarnés dans des œuvres, formant un ensemble cohérent et dynamique modifie ou enrichit la réalité de la perception ou de l’imagination.
Figure 10 : L’imaginaire, un ensemblede productions mentales. Source : Schéma personnel
• Les fonctions et les valeurs de l’imaginaire L'imaginaire est un processus mental qui produit des images de base, construit des histoires qui maintiennent l'existence en ordre et interprète mieux notre propre monde. "l’homme produit bien un imaginaire fait d’images , d’analogies , de métaphores de symboles , de récits ,de mythes qui s’insinuent dans son vécu , même sans insu , qui pénètrent ses pensées , pour les orienter ou les inhiber " 5
L’imaginaire permet de:



5Jean-Jacques Wunenburger, L'imaginaire , p5

23
Séparer des choses réelles, présentes et perçues Créer des oeuvres d’art Aménager nos espaces Instituer des rites et cultes
1 2 3 4
I.2. l’imaginaire , une source de création
I.2.1. L'imaginaire individuel
•
L’homme , la fabrique des imaginaires
Sur le plan individuel , l’imaginaire prouve la subjectivité et la singularité de la personne. Avant même d’essayer de les écrire dans les normes symboliques du langage, les images existent déjà dans nos esprits.
Elles appartiennet à la singularité de l’histoire personnelle. L’imaginaire est un monde qui vit dans notre esprit, composé de toutes les images, sensations et représentations collectés dans nos vies, qu'elles soient issues de notre expérience réelle ou de la fi ction qui nous a marqués.
Figure 11 : l’Homme , la fabrique de l’imaginaire Source : Collage personnel
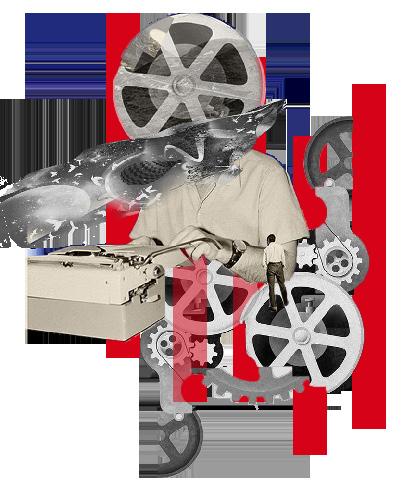
Le réel fait partie de l’imaginaire personnel :nous n’imaginons jamais à partir de rien . Le concret passe à travers le filtre de nos sens , de nos émotions, de notre compréhension et de notre cerveau. L’imaginaire devient alors un réservoir auto remplissant. Notre expérience , nos peurs , nos espoirs nourrissent l’imaginaire individuel. Notre imaginaire est notre stock interne d’images.
Figure 12 : Du concrêt à l’imaginaire Source : Schéma personnel
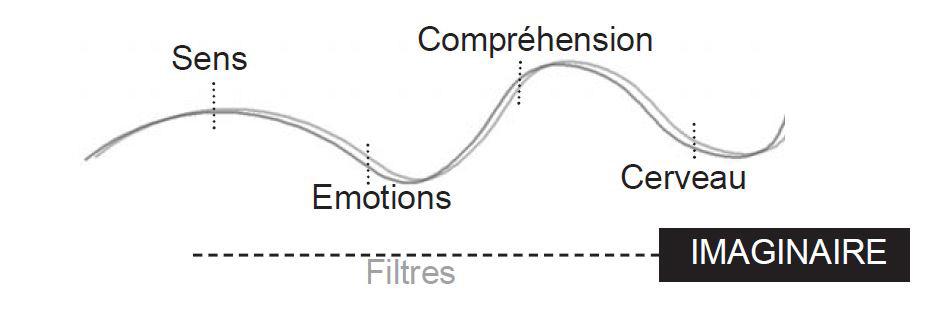
24
Figure 13 :L’imaginaire personnel, un réservoir d’images.
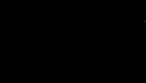
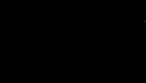
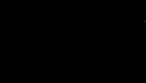
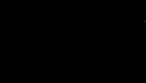
Source : Collage personnel
L'imaginaire Individuel
A retenir
Chapitre I : l'imaginaire , un concept opératoire
L'esprit semble aussi être traversé par des illusions hypersensibles, des métaphores créatives, des analogies infinies, des forêts symboliques et des mythes fleuris.
L’imaginaire est un réservoir d’images sensorielles, émotionnelles,a ff ectives,psychiques,qui nourrit la manière d’appréhender le monde. Comment chaque Homme produit de l’imaginaire? Cette question a été impliquée dans le débat classique sur la philosophie de la connaissance. Depuis Kant , certains philosophes ont formulé l’hypothèse que l’image a parfois besoin d’être activée par des expériences psychologiques spécifiques. L’imaginaire nous permet d’abord de nous détacher de l’immédiat, du réel présent et perçu, sans nous enfermer dans des pensées abstraites .
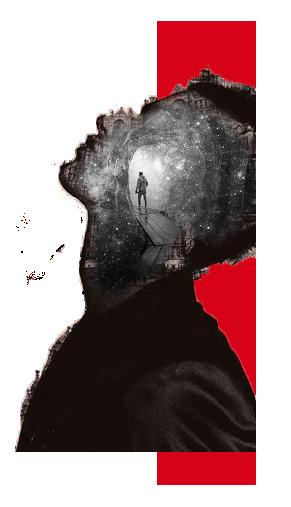
Cependant, du point de vue de la composition psychologique humaine, cette production d’un autre monde répond à un certain nombre de finalités, qu’on peut décrire tant du point de vue de formation de l’individu . L’homme invente, développe et légitime sa croyance en des imaginaires pour que ce rapport à l’imaginaire obéisse à des besoins, des satisfactions, des effets à court et à long terme indissociables de sa condition humaine.
Issue d'une expérience réelle
S'appuie sur la subjectivité de la personne
S'appuie sur la singularité de l'histoire personnelle
Un stock interne d'images
25
L'Homme


• L'imaginaire, source de création architecturale



Selon Bachelard , l’imaginaire n’est pas un supplément esthétique , n’est pas simplement des divertissements qui permettent d’embellir l’existence. Mais l’imaginaire nous permet d’habiter ce monde.
Cela montre à quel point notre présence au milieu de l’espace , des matières , des formes et des mouvements se fait via les imaginaires . Nous ne nous inscrivons pas dans un monde purement fonctionnel, Il faut enrichir le monde fonctionnel de toutes ces valeurs symboliques.
la présence dans : L ' I M A G I N A I R E
L'espace les matières les formes
Figure 14 : La présence de l'Homme via l'imaginaire. Source : Schéma personnel

La ville imaginaire
Avec son concept de «ville spatiale», Yona Friedman6 imagine un urbanisme tridimensionnel au-dessus de la ville existante, composé de structures que rempliront euxmêmes les habitants.C'est une utopie attachée à la dimension sociale.
Figure 15 : La ville spatiale . Source : www.centrepompidou.fr
6 Né en 1923, l’architecte d’origine hongroise Yona Friedman s’installe à Paris en 1957. En 1958, il publie L’Architecture mobile, ouvrage dans lequel il décrit une mégastructure aménagée par ses usagers.
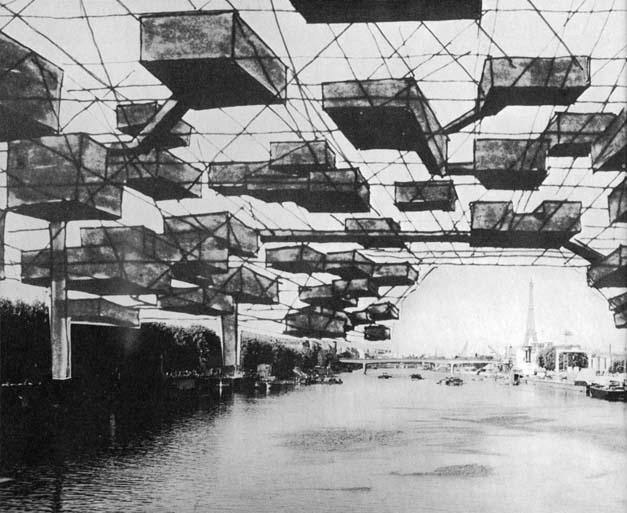
26
Chapitre I : l'imaginaire , un concept opératoire
« Cette technique permet un nouveau développement de l'urbanisme : celui de la ville tridimensionnelle ; il s'agit de multiplier la surface originale de la ville à l'aide de plans surélevés »7
Figure 16 : Image d'étude de la ville spatiale .
Source : www.centrepompidou.fr
Figure 17 : Dessin : Encre et collage sur papier . Source : www.centrepompidou.fr
La ville spatiale constitue ainsi « terrain artificiel » : une grille suspendue dans l'espace qui cartographie un nouveau territoire à l'aide d'un réseau homogène et continu.
Cette trame modulaire permet à la ville de grandir à l'infini au sein de cette mégastructure.
Figure 18 : Maquette de la ville spatiale .
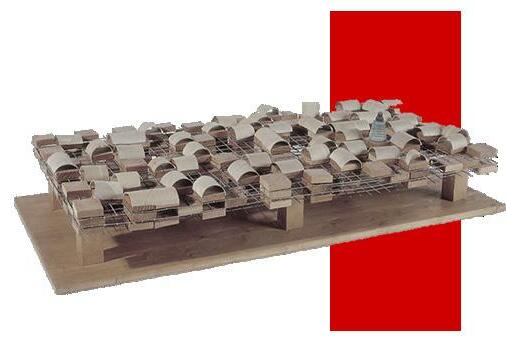
Source : www.centrepompidou.fr
Imaginaire :source de création architectural
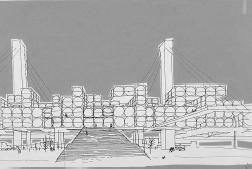
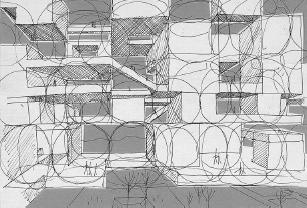
A retenir
Cette ville spatiale inspire encore aujourd'hui l'imaginaire de nombreux artistes et architectes contemporains, ainsi que les dernières recherches en matière de construction modulaire.
Le caractère unique et le degré de créativité du système architectural sont obtenus grâce à l'imaginaire.
Le phénomène de l'imaginaire est un processus intellectuel qui rend l'expérience conceptuelle sensible et hautement créative.
27
7 Yona Friedman , la ville spatiale , 1960
I.2.2. l’imaginaire collectif

• l’imaginaire collectif , une doxa


l'imaginaire collectif est le résultat d’une activité mentale qui fonde en partie les positions et les conduites, les représentations permettent d’interpréter le monde et renvoient simultanément à différentes sources de significations.

L'imaginaire collectif rassemble tous les éléments qui s’organisent, pour un groupe donné dans une unité significative.
Les grecs de l'Antiquité, les philosophes plus particulièrement, parlent de doxa8 pour désigner l'ensemble des croyances, des opinions, des images, des visions qui servent à un individu à se faire une représentation de la réalité.
Ainsi, l'imaginaire collectif est à la fois une représentation individuelle et collective de la réalité.
Lorsque des individus ou des groupes parlent de situations qu'ils ont vécues, ils présentent leurs propos lorsqu'ils s'expriment sur des événements qui les touchent ou qu'ils perçoivent comme extérieurs.
Figure 19 : L'imaginaire collectif . Source : schéma personnel
8 Ensemble des opinions communes aux membres d'une société et qui sont relatives à un comportement social.
28
Imaginaire collectif Représentation individuelle REPRESENTATION DE LA REALITE Représentation collective
Chapitre I : l'imaginaire , un concept opératoire
• De l’imaginaire collectif à l'imaginaire social
L'imaginaire collectif est un ensemble de symboles et concepts de la mémoire et d'imagination d'un groupe d'individus qui donne forme à la mémoire collective.
Par exemple, on peut parler de l'imaginaire collectif d'un parti politique, d'un groupe religieux, d'une catégorie sociale, au sein desquels un groupe partage une vision, une idéologie, une croyance, une opinion...
Le concept d'imaginaire social, sert également d'un répertoire de pratiques que ses membres peuvent adopter.


Il s’agit donc d’une arrière-plan de la société.
Cette notion d'imaginaire permet de penser les identités culturelles et politiques. Elle comprend aussi toutes les représentations imaginaires propres à un groupe social : mythes, croyances cosmiques et religieuses. Cet ensemble de significations participe à la vie commune et à la pratique sociale.Cette notion d'imaginaire social vise à penser la dimension performative de la représentation, l'impact de l'imaginaire sur les pratiques, les comportements, les modes d'appropriation du monde et les sensibilités collectives.

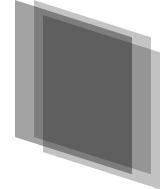
l'imaginaire social
Figure 20 : L'imaginaire, un arrière plan de la société . Source : schéma personnel

29
I.3. l’imaginaire et les réprésentations spatiales

I . 3 . 1 . la représentation comme un processus

Les travaux en écopsychologie ont montré que le comportement des individus est dépendant des cadres spatiaux et que les composants de ces cadres impliquent l'expression de schémas qui expriment le sens du lieu. Cela met en évidence la relation entre les aspects physiques de l'environnement, les composantes spatiales et la configuration humaine.
Ainsi , l’interaction individu-espace est confirmée à travers des mécanismes perceptifs et des phénomènes cognitifs qui indiquent la présence d'images ou de représentations mentales à déchiffrer.
Facteurs culturels Facteurs sociaux


Individu
Facteurs psychologiques


Facteurs économiques

Figure 21 : Interaction espace-individu . Source : schéma personnel l'image mentale influence les choix spatiaux individuels, et l'étude de cette image est cruciale pour appréhender l'espace subjectif d'un individu, car il s'agit d'un symbole imaginaire.. En fait, la représentation implique un sens de l'interprétation chargé de sens et de symbolisme. "l’espace présenté n’est qu’une construction individuelle et collective en liaison aussi bien avec le cadre de vie, support nécessaire pour les pratiques quotidiennes , qu'avec l’imaginaire".9

30
9 Amel Hammami Monstassar , l'enfant la maison et l'école ,p 49
I . 3 . 2 . Les cartes mentales
La représentation est la reconstruction subjective d'un objet en son absence, c'est l'évocation mentale évoquée par un mot, un objet ou un lieu. Une représentation repose sur une vision subjective. Souvent,la perception est selon des croyances personnelles .
C'est ainsi qu'en tant que concepteur , il est intéressant de voir comment nos propres perceptions conditionnent notre manière d'agir sur notre environnement.
La méthode des cartes mentales a été introduite par Kevin Lynch10 en 1960 où il identifie dans chaque dessin (dessin effectué sur terrain par un acteur social sur une thématique donnée) cinq typologies d’éléments structurants la perception de l’espace urbain.
Au même moment, la perception d’un espace est constituée de 5 éléments définis par Lynch , ces repères permettent de rendre la lecture des cartes mentales plus scientifique et objective qui
Les voies sont les chenaux le long desquels l’observateur se déplace. habituellement, occasionnellement, ou potentiellement..
Les limites sont les éléments linéaires que l’observateur n’emploie pas ou ne considère pas comme des voies. Ce sont les frontières entre deux phases.
Les quartiers sont des parties de la ville, d’une taille assez grande, qu’on se représente comme un espace à deux dimensions
Les nœuds sont des points, les lieux stratégiques d’une ville. ce sont des marqueurs territoriaux).
Les points de repère sont un autre type de référence ponctuelle. Ce sont des marqueurs territoriaux).
10 Kevin Lynch est un urbaniste, architecte et enseignant américain. Son livre le plus connu est L'Image de la cité.
31
Chapitre I : l'imaginaire , un concept opératoire
1 2 3 4 5
• Etude d'un exemple
Cartes mentales et représentations spatiales de résidants en MARPA : un outil d’aide à l’implantation de nouvelles structures d’hébergement ?11
La recherche d’un optimum territorial pour la création de nouvelles Maisons d’Accueil Rurales pour Personnes Âgées implique d’analyser les pratiques spatiales et les liens qu’entretiennent les résidants avec le territoire concerné.
Les cartes mentales sont un outil pour l’évaluation d’un optimum territorial pour la construction des maisons d’Accueil Rurales pour Personnes Âgées .
Le processus
1 2 3 4
Echantillon de 29 résidants
Entretiens demi- directifs
Carte mentale
Analyse de représentations spatiales
Figure 22 : Les étapes de la recherche effectuée. Source : schéma personnel
Exemples des cartes mentales réalisées
la carte mentale met en avant l’ancrage comportemental dans son aspect spatial.
Elle permet aussi par la connaissance de l’importance du stock de routines d’un individu d’entrevoir le niveau de contraintes qu’il subit (routes, pente…).

La compréhension des espaces d’activités/déplacements donne une architecture potentielle de modélisation des comportements.
11Pierre-Marie Chapon, Clémence Beuret , Clément Bolomier, Philippe Choisy et Sandro Zambernardi , « Cartes mentales et représentations spatiales de résidants en MARPA : un outil d’aide à l’implantation de nouvelles structures d’hébergement ? », Norois, 216 | 2010, 57-66.
32
Figure 23 : Quelques exemples des représentations spatiales . Source : https://journals.openedition.org/



La synthèse de ces cartes
Conclusion
L’imaginaire est une source de création dans plusieurs domaines. Il s’agit d’un ensemble d’artefacts mentaux basés sur un système d’image ou de texte. D'où la possibilité de faire une interprétation. Par analogie, l’imaginaire individuel ou collectif intervient dans la réflexion architecturale à travers les images qui traversent l’esprit.
Ainsi , la carte mentale est une représentation spatiale de cet imaginaire. C’est une transcription subjective de la perception et de l'expérience de l'espace. A travers ces images, nous pouvons interroger l’ imaginaire pour les traduire en configurations spatiales. Ce seront des outils opératoires aidant à la conception.
33
Chapitre I : l'imaginaire , un concept opératoire
chapitre II
la morpho-dynamique du marché central
 Figure 24 : les strates histpriques du marché , source : collage personnel
Figure 24 : les strates histpriques du marché , source : collage personnel
Le «fondouk al ghalla» de Tunis (actuellement le «marché central») a subi plusieurs mutations au cours de son histoire, et ces changements ont marqué la métamorphose de ce lieu commercial et sa richesse. Pendant la période coloniale, ce bâtiment était l'un des plus importantes institutions urbaines dans la capitale. Pas seulement parce qu'il fait partie de l'infrastructure qui vit une ville en plein essor, mais à cause de ses changements, Il jouit d'une grande réputation . Espace commerçant à la fois « ancien » et «moderne»,« tunisien» et « européen », le fondouk est en vérité le produit d’un long processus de cohabitation et d’acculturation.11

Ce chapitre procède à une analyse approfondie de toutes ces mutations afin de retracer le processus complexe du «fondouk el ghalla» pour ‘en savoir plus sur sa dynamique et comment l’actualiser.
"les lieux de mémoire annoncent un point de départ synchronique, la saisie d’un passé projeté à la surface du présent. Ils problématisent notre représentation du passé. Ils répondent à une exigence d’éclairer le passé par le présent, de comprendre le présent par le passé."
Pierre Nora, les lieux de mémoires ,1980,p103
11karim ben yedder , le foundouk al-ghalla de Tunis , 2016,p17
introduction
Les imaginaires pour une révision du Marché Central de Tunis
II.1. la mutation au coeur de centre ville de Tunis
II.1.1. Naissance de la ville européenne
• Tunis , la captiale coloniale
Avant la colonisation

0


100 m
Pendant la colonisation
0 100 m
Après la colonisation
A partir de 1860, la juxtaposition dans le site de Tunis , d’une ville ancienne ( la médina et des faubourgs) et d’une autre nouvellement , a fini par priver la Médina de son rôle de centre de la cité et par créer une nouvelle centralité.L’établissement ,en 1881, du protectorat français renforcera cet état de fait et tout en s’identifiant au centre colonial, le nouveau “coeur” de Tunis prendra une dimension caractéristique suite à la mise en place des instruments de la gestion urbaine , notamment des grandes infrastructures et des équipements nécessaires au fonctionnement de la cité nouvelle, et leur répartition en fonction de l’axe central que représentait la promenade de la marine. Contrairement à la structure concentrique de la Médina, la nouvelle ville dite , européenne ou coloniale s’impose sur une structure régulière.Ses deux axes principaux sont l’avenue de la marine et l’avenue de carthage.
L'avenue de la Marine a été baptisée du nom de Jules Ferry en 1900. Elle a été conçue principalement comme un espace public. Par conséquent, l'avenue de La Marine est devenue une promenade. Plus tard, toute la ville s'est développée autour de cet axe. Il commence par le Nord, en direction du chenal qui mène à la mer.
0 400 m
Figure 25 : l’évolution de la ville de Tunis , source : webo.tn interprété par auteur
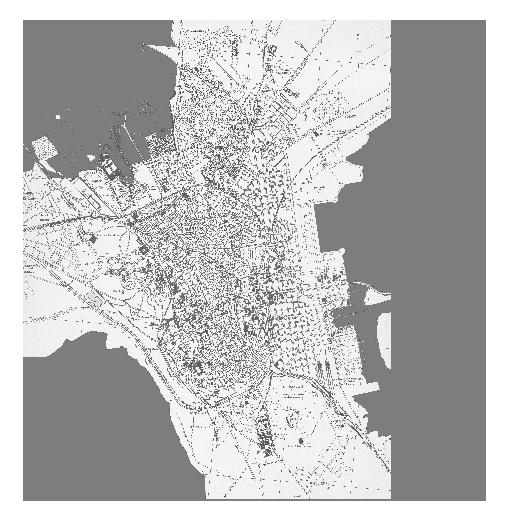


36
la médina la ville coloniale
Chapitre II : La morpho-dynamique du marché central
La cathédrale Saint Vincent de Paul qui fait face à la résidence Générale, un ensemble de commerces, de restaurants, d’hôtels et de cafés structurent l’extension de la ville européenne .une population de Maltais, de Tunisiens musulmans et juifs, d’Italiens.Entre maisons bourgeoises, logements modestes, oukala-s (logements autour d’une cour centrale où les locataires se partagent la cuisine et les toilettes) et fondouks de passage, ateliers d’artisans et ruelles commerçantes, la médina de Tunis, s’organise depuis toujours autour de la mosquée Zitouna et la citadelle de la Kasbah.
• le marché central de Tunis , une interface 0 100 m

Figure 26 : la situation du marché central.

Source: schéma personnel
Le marché central est situé entre deux structures urbaines différentes. Le premier est celui de la Médina, l'organisation organique de la toile d'araignée, et le second est la celui de la ville coloniale , tissu régulier et orthogonal. Pas loin de la place Bab Bhar , le marché central est orienté comme tous les métiers polluants de la médina selon la direction Nord ouest afin d’assurer la ventilation des espaces(figure 26).

Figure 27 : les rues pendant la colonisation . source : photos :Archive nationale de Tunis (ANT) avec un collage personnel

37
II.1.2. l’environnement immédiat du marché central: évolution et transformation
Le foundouk et son entourage ont connu plusieurs transformations depuis leur création jusqu'à la veille de la deuxième guerre mondiale.
Figure 28 : Quelques étapes de la transformation du marché central à travers le temps . Source : photos:Archive nationale de Tunis (ANT) avec un collage personnel l'époque coloniale: 1886

On a prolongé la rue d’Allemagne , qui se termine en impasse, jusqu’à la rue ‘Jazira’ (Figure 27) ce qui vapermettre un accès direct au nouveau fondouk à partir de cette rue. En plus , on a relié les rues d’Allemagne et d’Espagne en ouvrant une nouvelle rue baptisée rue de Danemark(Figure 28). Les terrains nécessaires à l’aménagement de ces deux rues étaient concédés par le prince Taïeb Bey et aux dépens de l’ancien Foundouk
1930
Le foundouk el ghalla est appelé de manière officielle «MARCHE CENTRAL»
38
le marché central Rue d'Allemagne Rue du Danemark Rue Al jazira
Figure 29 :Prolongement de la Rue d'Allemagne source : auteur
1938
Figure 31 :La création de la Rue du Danemark source : auteur
Les travaux d’agrandissement et d’aménagement du foundouk n’ont eu lieu qu’en 1933 et ont duré quatre ans. Par conséquent, son intérieur a subi un certain nombre de rénovations à travers l’investissement dans des locaux vacants. Parallèlement, la largeur de la rue du Danemark adjacente au marché est passée de 7 m à 17 m. Neuf nouvelles boutiques ont été ouvertes dans cette rue. Ils seront affectés à la vente de dattes et de figues sèches (Chariha).Ces travaux vont libérer plus d’espace au marché et surtout à ses abords, ce qui va permettre une meilleure circulation dans cette zone.

0 100 m 0 8m




Agrandissement de la rue de Dannemark
Figure 30 :La transformation des rues voisinantes du marché ; source : auteur



l’aménagement de douze boutiques ouvrant sur cette rue en transformant les locaux anciennement occupés


Elargissement de la rue d'Espagne
Nouvelles boutiques aménagées sur la rue d'Espagne
39
Chapitre II : La morpho-dynamique du marché central
II.2. De la marge de la médina vers le centre de la ville européenne
II.2.1. Pourquoi le nom du“Foundouk al-ghalla” ?

En Tunisie et à l'époque précoloniale, la plupart des Foundouks étaient encore situés en dehors de la ville, près des portes principales. Le confort de ces bâtiments n'est pas assez élevé pour répondre aux besoins essentiels des visiteurs. Ils ont généralement besoin d'être accompagnés de leurs bêtes (mules, ânes, chevaux et chameaux). Les fondouks se composent généralement d'un ou deux étages: le premier étage est réservé aux carrosses, et marchandises. Et il y a un étage pour accueillir les visiteurs. Les pièces sont généralement petites, sans éclairage ni ventilation autre que l'ouverture de la porte. Elles donnent toutes sur la cour ou sur la galerie.
A l’époque précoloniale , les foundouks de Tunis étaient classées selon la nationalité ( foundouk des français , des Maltais ..) ou l’appartenance régionale (Zghawnia , Binzartia , Tsetria, etc…) , soit par type de commerce ; biadh (charbon ) , Harir (soie) …
40
Figure 32 :Foundouk Al-ghalla , source : collage personnel
II.2.2. L’emplacement du “Foundouk al-ghalla”

• A l’époque précoloniale
Le marché est situé derrière les murs de la Médina, du côté de la Porte de France.Il y a plusieurs avantages à un tel emplacement: -Il permet d'approvisionner les villes tout en évitant l’encombrement dû à la concentration des activités de gros et de détail en un même lieu. -De part sa situation, les visiteurs et les marchandises amenées par les convois transitant par “Bab’khadra” en provenance de l’arrière-pays de la capitale et de la région de Bizerte, ainsi que les marchandises entrant et arrivant de “Bab Aliwa” et “Bab falla”, peuvent y pénétrer. -La proximité des remparts et de la porte française permet également un contrôle fiscal efficace, d’autant plus que le foundouk al-ghallah a reçu une grande quantité de marchandises.
41
II
La
Chapitre
:
morpho-dynamique du marché central
• A l’époque coloniale

Une fois installés dans le pays, les Français ont voulu déplacer Foundouk vers un nouveau site construit dans les rues de “Mharzia” et “ Manoubia” depuis 1884. Cependant, ils ont finalement choisi un autre emplacement, non loin de l'ancien Foundouk , mais se sont dirigés vers le sud en direction de Bab'Jazira. Ce transfert permettra d'économiser des terrains précieux pour l'expansion de la ville nouvelle du côté de la porte de France et la délocalisation d'activités encombrantes.
En raison de la superficie insuffisante du nouveau site, un nouveau marché a été créé à proximité en 1891. Depuis, les deux locaux ne sont séparés que par la rue du Danemark.
Le local donnant sur la rue “Jazira” s’appelle “Vieux foundouk”, et elle a été concédé au Prince “Taieb Bey”.
Les deux fondouks devaient travailler séparément
42
Figure 33 : le marché central à l’époque coloniale ,source : cartepostale.com
marché central
jusqu’à la fermeture de celui décerné au prince Taieb Bey au début du 20e siècle. De son côté, le deuxième local est plus intégré à la ville européenne et occupe un vaste îlot entre les rues d’Italie, d’Espagne, de Belgique et du Danemark. Outre l’importance de ces rues, en particulier la rue d’Italie , la rue la plus commerçante de Tunisie à l’époque (plus tard connue sous le nom de rue Charles de gaulle).Le nouvel emplacement parait stratégique juste à proximité de la gare et bureau de poste, très approprié pour une installation d’un marché central.


Mais avec le temps, ce même emplacement posaitplusieurs problèmes. Comme il constituait un facteur d’encombrement et de pollution pour le quartier environnant, le conseil municipal finira le 21 décembre 1939 par décider le transfert du marché de gros du Foundouk à la halle aux grains qui se trouvait à la Marine Le foundouk al-ghalla . Quant à lui , il ne gardera que la fonction de marché de détail..Fonction qu'il continuera à assumer jusqu’à nos jours.
Figure 35 :la cour du marché 1869 ,source : www.picclick.fr

43
Chapitre II : La morpho-dynamique du
Figure 34 :Marché aux poissons à l’époque coloniale ,source : www.picclick.fr
Figure 36 :Vue aérienne du marché central à l’époque coloniale .Source : www.picclick.fr
II.3. Foundouk al-ghalla : une nouvelle ère
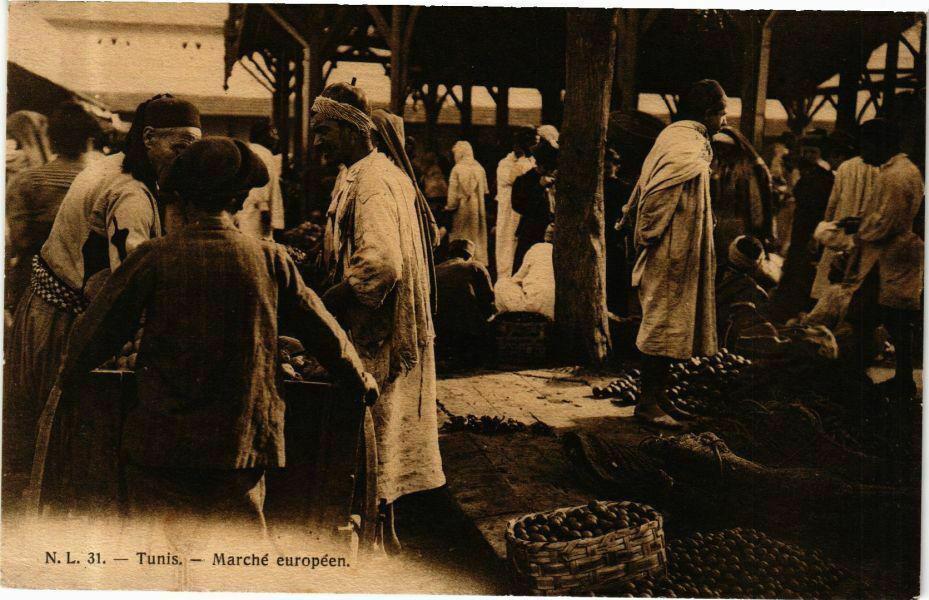
II.3.1. Le nouveau siège du Foundouk
Figure 37 :l'intérieur du marché ,source : www.picclick.fr
"Construit en 1891 dans un style mi-arabisant , combinant la brique rouge , la fonte et le bois. Le nouveau marché occupe un vaste quadrilatère de 11.000 m2 de superfice. Sur son pourtour et tout le long d’un couloir couvert et bien aéré , sont disposées des boutiques couvertes et classées par quartiers : ceux des bouchers , des épiciers , des marchands de volailles et de gibier , des marchands de légumes et de fruits."12

Figure 38 :Marché aux légumes ,source : www.picclick.fr
Figure 39 :Une ambiance dans le marché ,source : www.picclick.fr
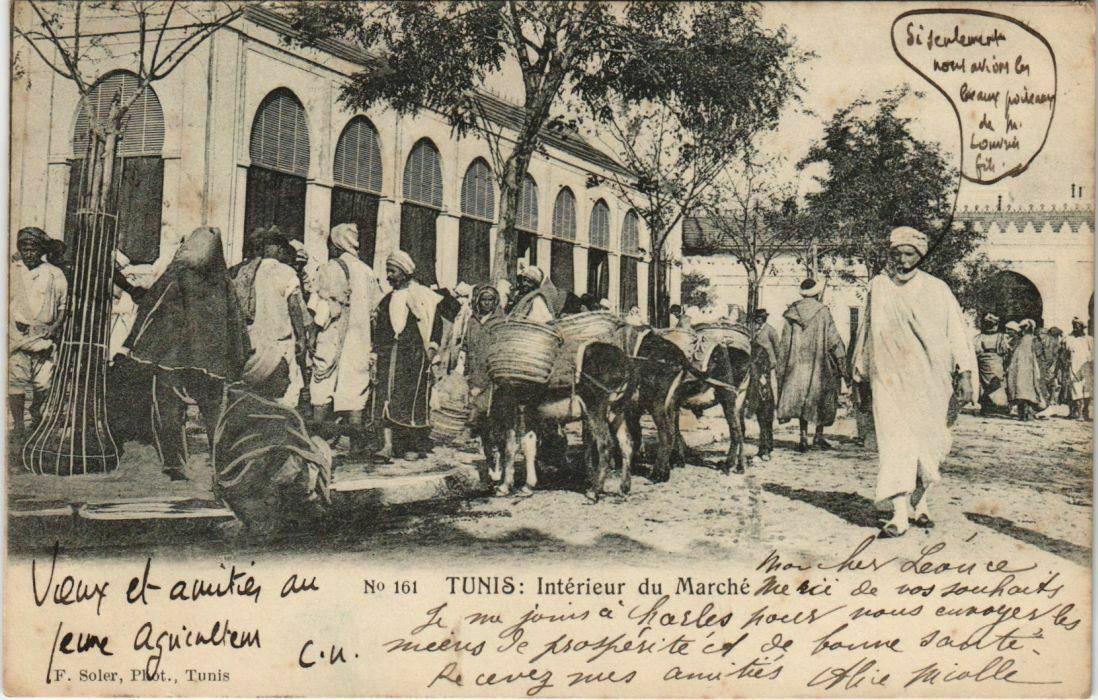
Au centre du bâtiment , se trouve une grande cour sous des préaux ou sont installées les étals de la poissonnerie, lesquels seront transférés ultérieurement au pavillon qui constituait le foundouk. les huiles formants lui-même une partie presque indépendante du nouveau bâtiment , mais réservé uniquement au commerce des huiles avec onze boutiques affectées à cet effet la partie représentant le foundouk al-ghalla proprement dit contenait boutiques , une buvette , un café maure , des tables et deux caves pour la vente des poissons , un chalet de nécessité , des emplacements réservés à la vente des fleurs et des biscuits , ouvrant sur les rues d’Italie et d’Espagne.
12Ensemble des opinions communes aux membres d'une société et qui sont relatives à un comportement social.
44
II.3.2. Réhabilitation et réaménagement du marché central par l’ASM
2007
“La mise en valeur du Marché Central participerait à penser une opération d’intégration urbaine valorisant l’interface entre la Médina et la ville basse, zone qui présente aujourd’hui des problèmes de dégradation ( Rue Al jazira, Rue Mongi slim) Mais qui représente une valeur patrimoniale liée à ses dimensions historiques , sociales et économiques.” 13
Le marché central implique l’adoption d’un parti d’aménagement et architectural à la fois audacieux et traditionnel: Un aménagement intérieur plus pratique et fonctionnel,optimisant l’utilisation de l’espace, organisant les flux , une reprise des façades , une mise aux normes de ces équipements.
Complètement réahbilité , le marché central, l'ancien «Fondouk El Ghalla», a été inauguré 2007, après quatre ans de travaux:
Restauration des halles, des façades de l'ensemble des commerces et des revêtements muraux. Rénovation des réseaux d'évacuation des eaux. Rénovation de la halle en bois située au centre du marché. Couverture des espaces extérieurs (en toile tendue)et des halles périphériques. Modernisation des équipements du marché.
C’est ainsi que les galeries commerçantes ont été réhabilitées, la halle aux poissons totalement réaménagée ainsi que celle des fruits et légumes.
Description fournie par l'ASM
45 Chapitre II : La
du
central
morpho-dynamique
marché
13
1 2 3 4 5
Le plan du marché avant l'intervention de l'ASM: Echelle 1/1000


le nouveau aménagement des stands la halle des poissons après aménagement


la Halle des fruits après

46
Chapitre II : La morpho-dynamique du marché central
après l'intervention de l'ASM
Coupe du marché avant l'intervention de l'ASM: Echelle : 1/1000
La galerie marchande



Coupe du marché après l'intervention de l'ASM : L'ajout d'une couverture en toile tendue Echelle 1/1000
Le marché des poissons L'étalage des fruits et des légumes
Figure 40 :la réhabilitation du Marché Central par l'ASM ,source : Schéma personnel



47
 Figure 41 :Axe de synthèse ,Source : schéma personnel
Figure 41 :Axe de synthèse ,Source : schéma personnel
morpho-dynamique du marché central
Conclusion

Un bâtiment est une entité dynamique d'une complexité plus large. C'est un espace physique purement géométrique, faisant partie d'un territoire qui évolue dans le temps. le marché central ,comme centre ville de Tunis sont la superposition de strates successives au fil du temps. Les empreintes du passé sont tissées à travers un nouveau filtre contemporain, nous donnant un aperçu des couches historiques du bâtiment d'une part, et découvrant son potentiel social actuel d'autre part. De la naissance de la ville européenne au réaménagement de l'ASM, cette dynamique morphologique du marché se modélise dans le temps et dans l'espace, d’ou sa présence dans l’imaginaire collectif .
La morpho-dynmique
Le marché central de Tunis
Découvrir son potentiel social Sa présence dans l'imaginaire collectif
Figure 42 :la présence du marché dans l'imaginaire collectif ,Source : schéma personnel


49
Chapitre II : La
chapitre III
le marché central , des imaginaires
 Figure 43 :une scéne dans le marché central ,source : collage personnel
Figure 43 :une scéne dans le marché central ,source : collage personnel
Après avoir étudié le marché central de Tunis en étant une dimension historique et son évolution à travers le temps , nous effectuons une lecture contextuelle à l’échelle urbaine et architecturale. Nous procédons, dans un second lieu, à analyser les séquences du vécu urbain et social spécifique du support d’intervention et son environnement immédiat avec un relevé de l’état des lieux ainsi que son analyse pour connaître ses différentes particularités architecturales et structurelles afin d’en tirer les potentiels à exploiter et les contraintes à améliorer.
Le chapitre présenterait,en second lieu,l’immersion dans la dimension d’imaginaire collectif à travers la construction d’un protocole d’analyse orienté qui sert à superposer les filtres socio spatiales pour en tirer des conclusions.

introduction
Les imaginaires pour une révision du Marché Central de Tunis
III.1. Construction d'un protocole d'analyse orienté "imaginaire"
III.1.1. l'imaginaire collectif , quels perspectifs ?
Généralement, quand nous évoquons les marchés , nous nous concentrons sur la fonction qu’ils assurent.
Certes , partout dans le monde, la valeur du marché dans la ville est primordiale ,et c’est le cas du marché central de Tunis. Il a été conçu dans les années 30, et depuis lors il s'est dégradé même après les restaurations effectuées par l’ASM. Outre la fonction initiale qui est le commerce, il doit être actualisé pour répondre aux besoins des citoyens de la ville de demain.
Indépendamment de la fonction évolutive du marché , nous explorons l’imaginaire collectif comme concept mais aussi outil aide à repenser l’espace du marché à l’échelle des différentes formes d’appropriation des espaces du marché par les différents usagers de l’espace. Cette voie d’interroger l’Homme commun mais aussi l’Homme fréquentant usuellement l’espace permettra de concevoir différentes solutions permettant l’actualisation du bâtiment . Interroger l’imaginaire des gens afin qu'ils puissent caractériser spatialement leur rapport à cet espace commercial.
Contexte Concept
Interroger l'imaginaire collectif
Figure 44 : Entre le concept et le contexte. Source : schéma personnel
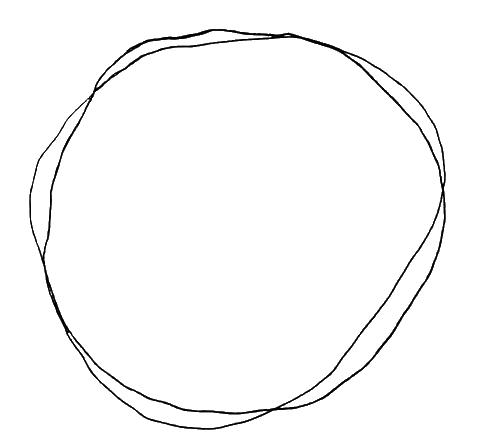
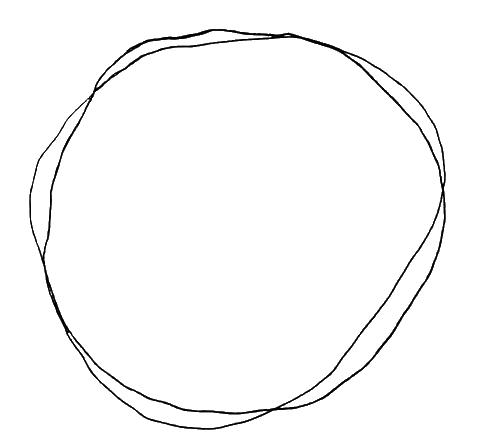
52
Le Marché Central de Tunis
Chapitre III: Le marché central , des imaginaires
III.1.2. L'imaginaire, une boîte à outils conceptuels
Avant d’entamer le travail de terrain, nous avons jugé nécessaire d'élaborer un protocole d'analyse qui met en valeur notre contexte par rapport au concept.
le marché en tant que vécu et repère de ville constituent les autres paramètres de l’analyse .
Pour cela, notre analyse contextuelle comprend deux dimensions :
Dimension 1 : Le marché central en tant que vécu et perçu dont le premier volet est l’observation sensible du terrain .
Cette analyse se base sur les configurations spatiotemporelles des éléments d’investigation contextuelles.
Dimension 2 : Interroger l’imaginaire des gens : donner le crayon pour dessiner afin de faire une interprétation de ces représentations.Des entretiens semi-directifs ont ensuite été menés auprès des différents usagers de cet espace.
Figure 45 : Protocole d'analyse contextuelle. Source : schéma personnel

53
III.2. Le marché central , un vécu
III.2.1. A l'échelle urbaine
•
Délimitation du périmètre d'étude
Le marché se situe entre deux tissus urbains différents : le premier est celui de la Médina: tissu organique à toile d’araignée, le second est celui de la ville coloniale ; tissu régulier et orthogonal.

Le marché central est orienté selon la direction Nord Ouest afin d’assurer la ventilation de ces espaces.
Situé sur la trame coloniale , Il occupe à lui seul , un îlot de dimensions importantes par rapport aux parcelles avoisinantes et de structure imposante.
Notre périmètre est composé du marché central avec les quatres rues autour de cet îlot :
Rue Charles de gaulles Rue d’Espagne Rue d’Allemagne Rue du Danemark
54
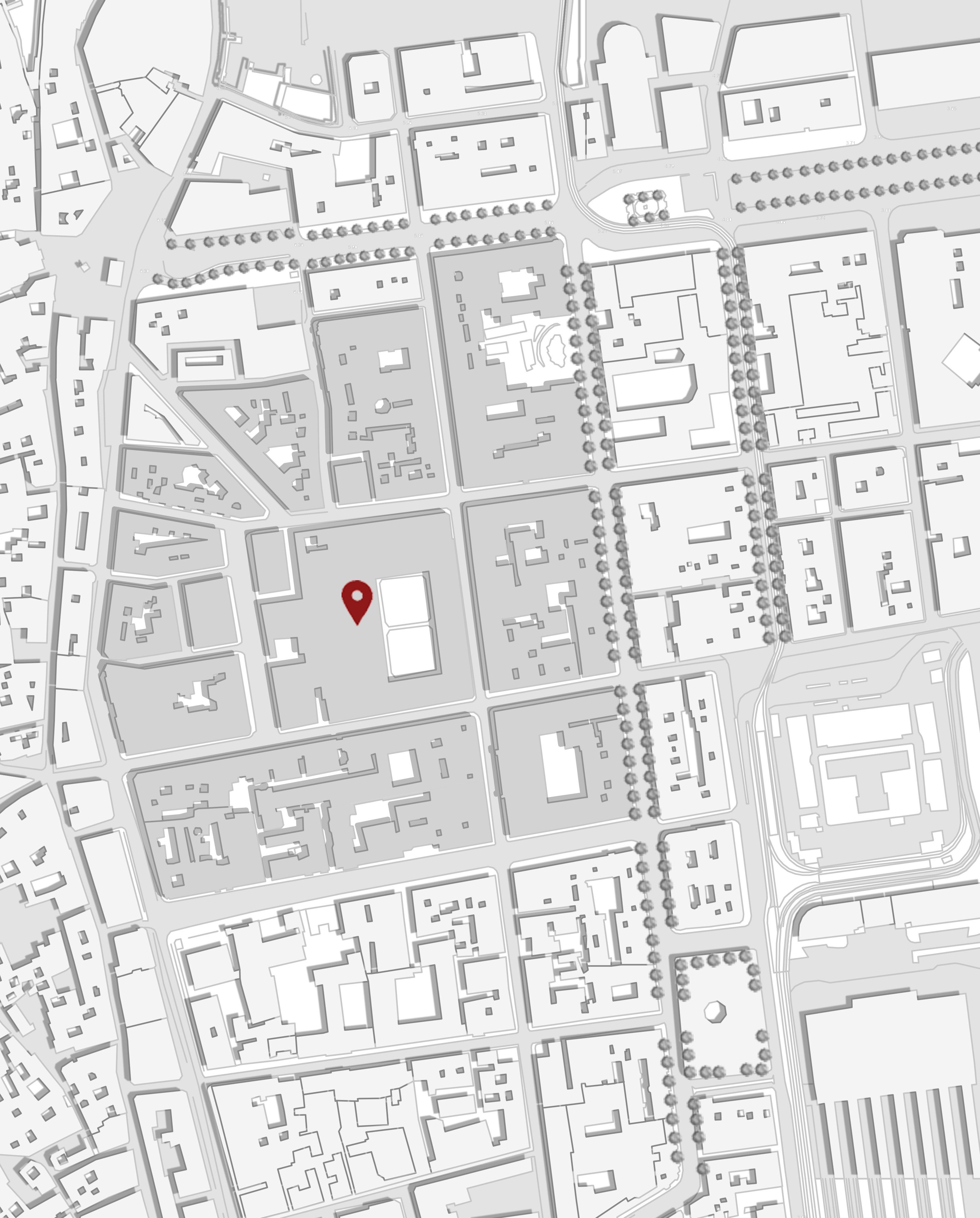


Le
des
Rue Jamel Abdennaser Rue Charles de gaulles Rue d'Allemagne Avenue Habib Bourguiba La Médina Bab Bhar Place Barcelone La ville Coloniale La gare Rue d'Espagne Rue du Danemark Rue Aljazira Périmètre d'étude Le Marché Central Figure 46 :Figure : Situation et délimitation du périmètre d'étude .Source : PAU 0 100m
Chapitre III:
marché central ,
imaginaires
• Voiries
Avec un emplacement stratégique dans la ville coloniale , le marché central occupe tout un îlot rectangulaire au centre ville de Tunis. Il est entouré de quatre voies véhiculaires dont les plus fréquentées sont rue Charles de gaulles et rue d’Espagne.
La Zone urbaine du marché se caractérise par une diversité de voiries : Les unes sont principales et d’autres sont secondaires. Cette richesse amplifie la fréquentation de la zone par plusieurs catégories d’usagers, ce qui la rend un point de convergence .
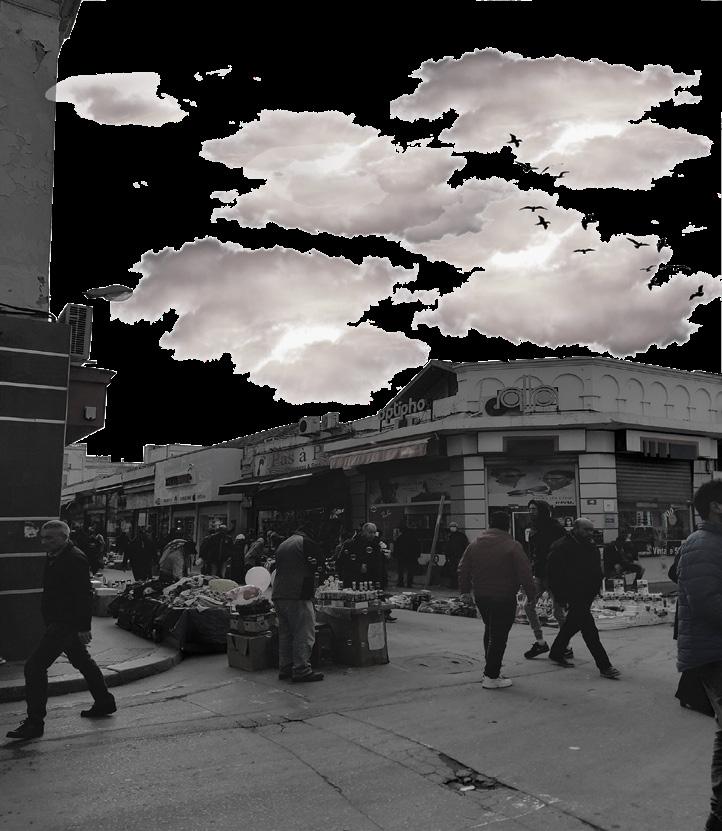


L'îlot dans lequel s’inscrit le marché central bénéficie d’un réseau de voirie très important : la largeur de ses voiries principales ce qui favorise l'accessibilité.

56
1 Croisement entre l'avenue Habib Bourguiba et Rue Charles de Gaulles
2 Croisement entre Rue d'Allemagne et Rue Amilcar
3 Croisement entre Rue d'Allemagne et Rue Charles de Gaulles





57 Chapitre III: Le marché central , des imaginaires 4 5 6 6 Croisement entre Rue d'Allemagne et Rue du Danemark Croisement entre Rue Charles de Gaulles et Rue d'Espagne Croisement entre Rue d'Espagne et Rue du Danemark Noeud urbain Noeud urbain Voie principale Voie secondaire Figure 47 : Les voiries et les noueds urbains . Source : schéma personnel 1 2 3 4 5 6 0 100m
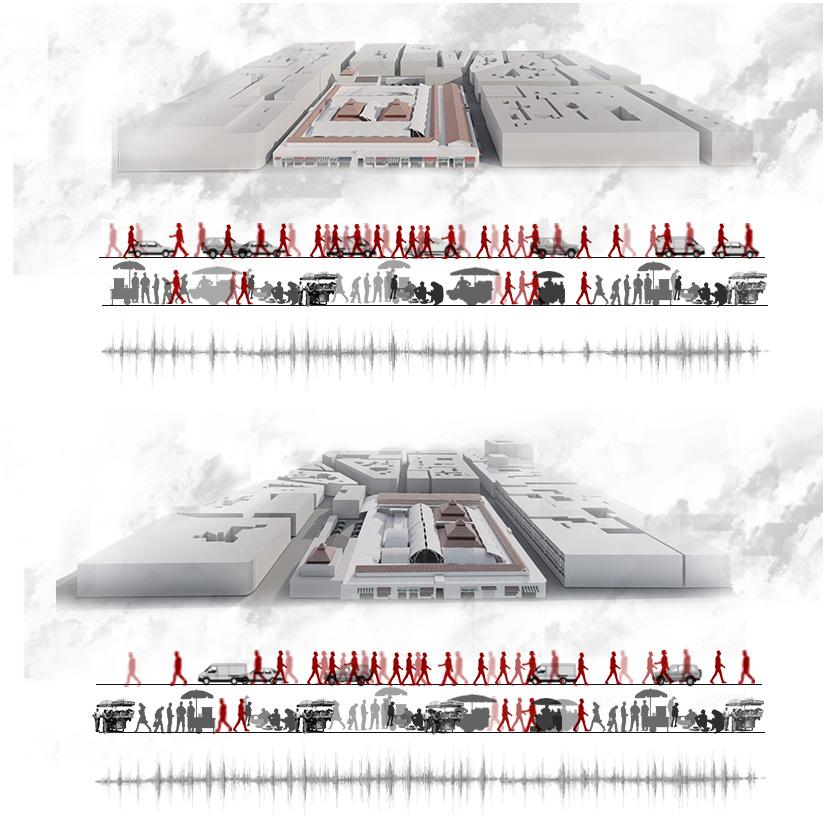
58 • La
1 1 2 2 3 3
dynmaique urbaine
Chapitre III: Le marché central , des imaginaires
Rue Charles de Gaulles
Rue d'Espagne
piéton Flux véhiculaire
1 2 3 Flux urbain

Commerçants informels Analyse du sonore
Figure 48 : Le Flux urbain . Source : schéma personnel
Le flux piéton varie selon le temps et les saisons et dépend des fonctions de chaque rue. En effet , il est concentré aux alentours du marché essentiellement à la rue de Charles de Gaulles et rue d’Espagne. Ces rues présentent un flux piéton important basé sur la présence des commerçants informels et des marchandises. La diversité des activités économiques entre les boutiques, les marchandises sur la rue et le marché central offre une circulation dynamique quotidienne.
Le site se présente animé par différents types d’usagers: Les simples passagers , les commerçants , les gens qui viennent spécifiquement pour le marché , les habitants du quartier. L’intensité du flux véhiculaire se différencie selon le temps , mais généralement il est moins important que le flux piéton.
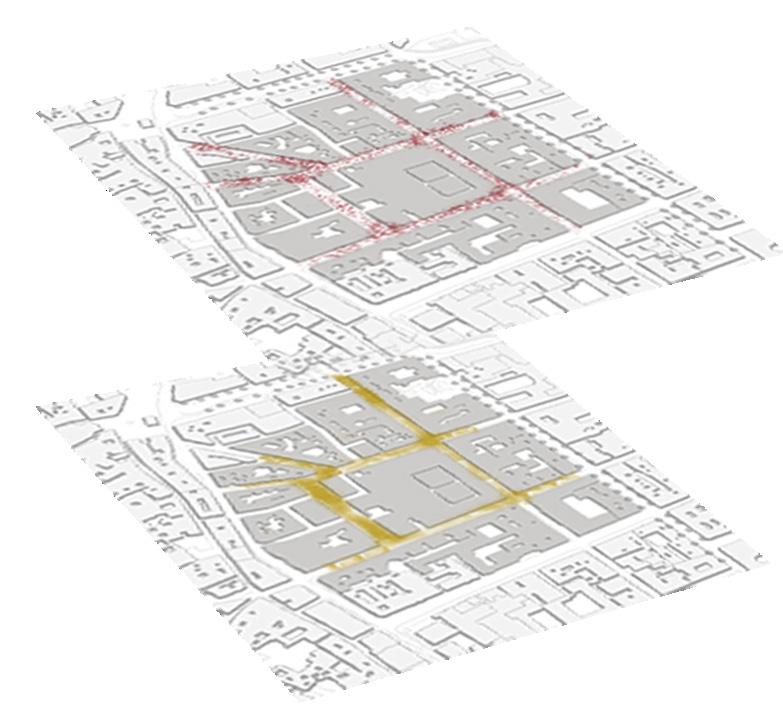
59
Flux
0 100m
• Stationnement

D'après l’analyse de la situation actuelle du stationnement dans la zone d’étude, nous constatons une surcharge dans les rues autour du marché, ce qui affirme le manque de places de stationnement.
La suroccupation des rues amplifie le problème de l’embouteillage et le désordre flagrant aux alentours du marché.

60
Saturation du flux
Marché central
Figure 49 : Le stationnement . Source : schéma personnel
Chapitre III: Le marché central , des imaginaires
• L'insertion urbaine
Le Marché Central fait partie d'un tissu dense, il y a trop de bâtiments et trop de circulation dans un espace trop petit. Ceci explique plusieurs problèmes qui se sont posés à l'échelle urbaine. L’étude parcellaire montre que le marché lui-même occupe un îlot important par rapport aux parcelles voisines.
Figure 51 : Le maillage urbain . Source : schéma personnel
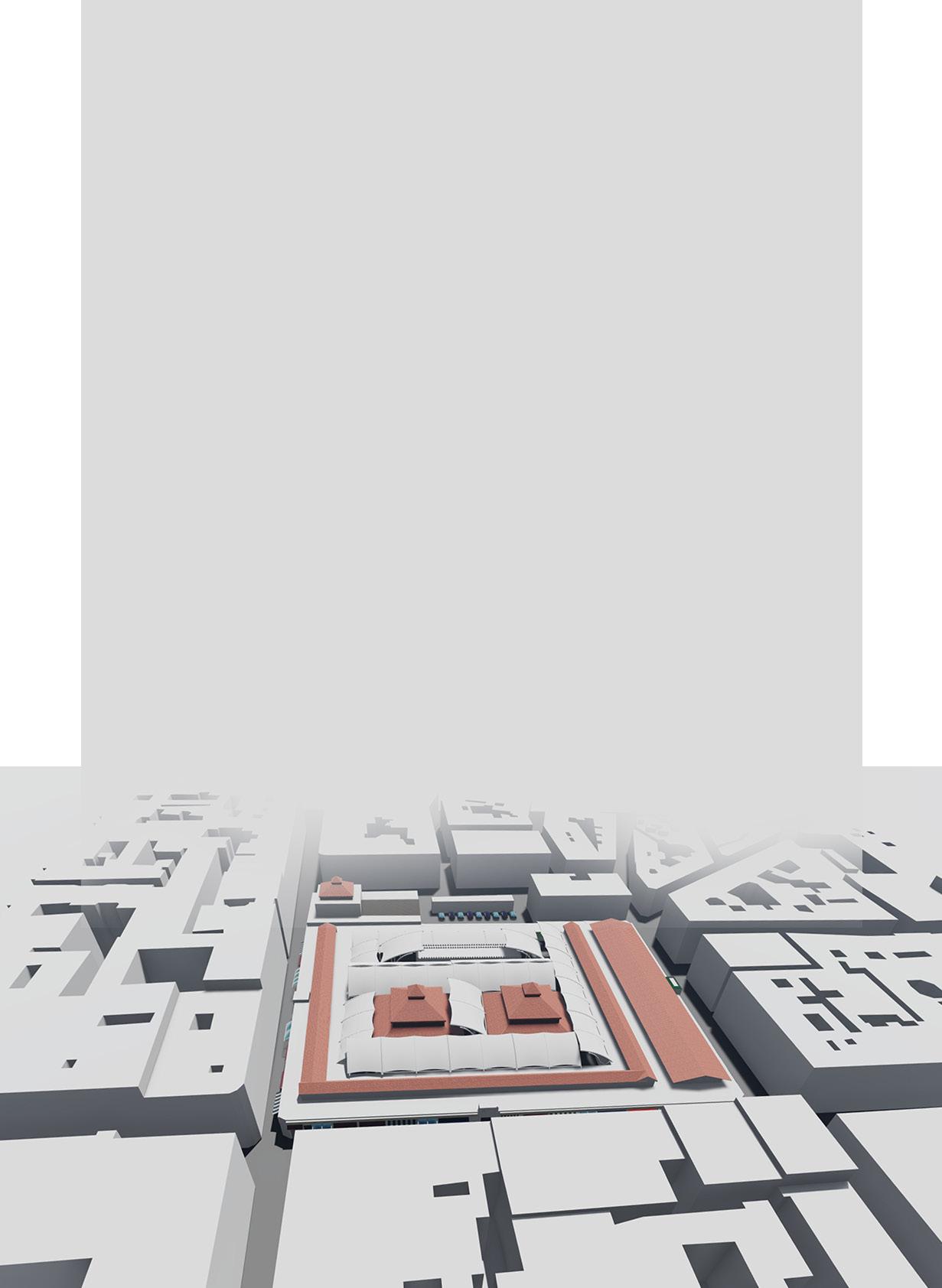
0 100m

Figure 50 : Rapport plein vide. Source : schéma personnel
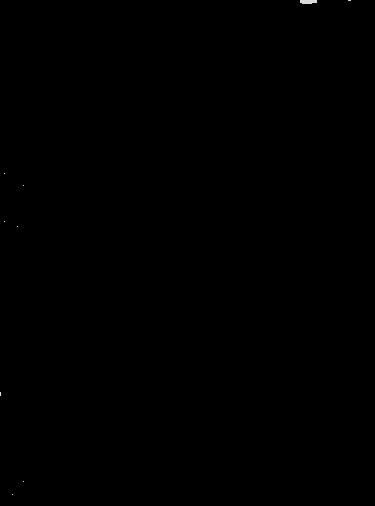
61

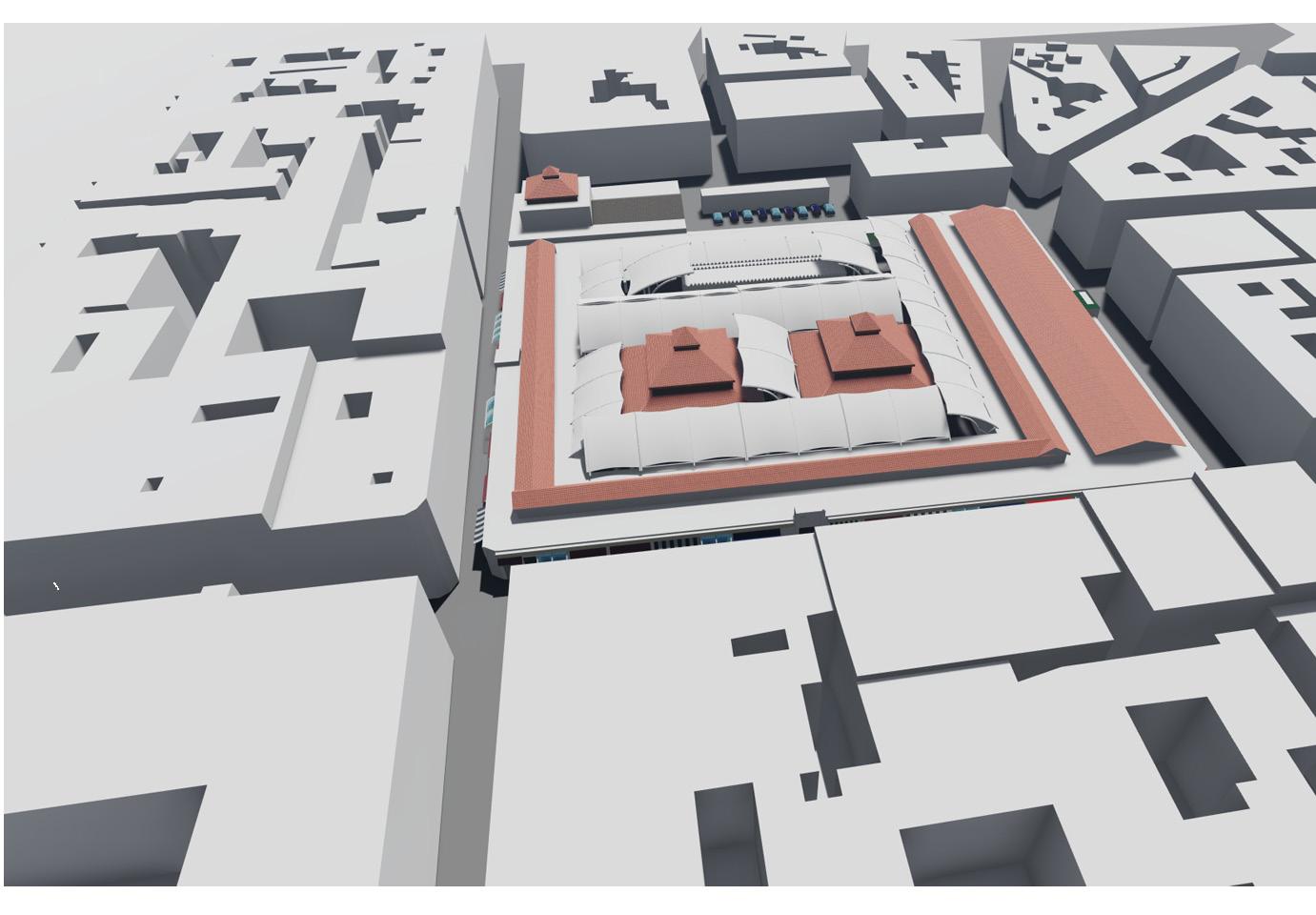

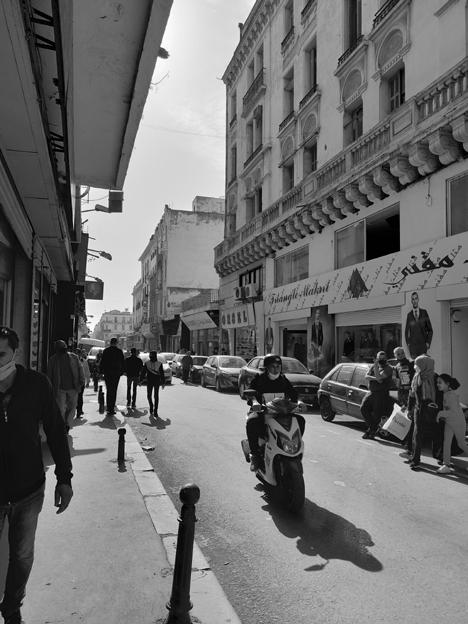


• Le
Rue d'Allemagne Rue du Danemark A B A Coupe A-A
perçu urbain
Les skylines des façades actuelles montrent une homogénéité des hauteurs dans ce tissu dont la plupart des bâtiments sont de R+2 ou R+3 à l'exception du marché central. la perspective de la rue est découpée : un seul niveau se dresse du côté du marché central , de l'autre côté se sont des immeuble R+2.


Chapitre III: Le marché central , des imaginaires
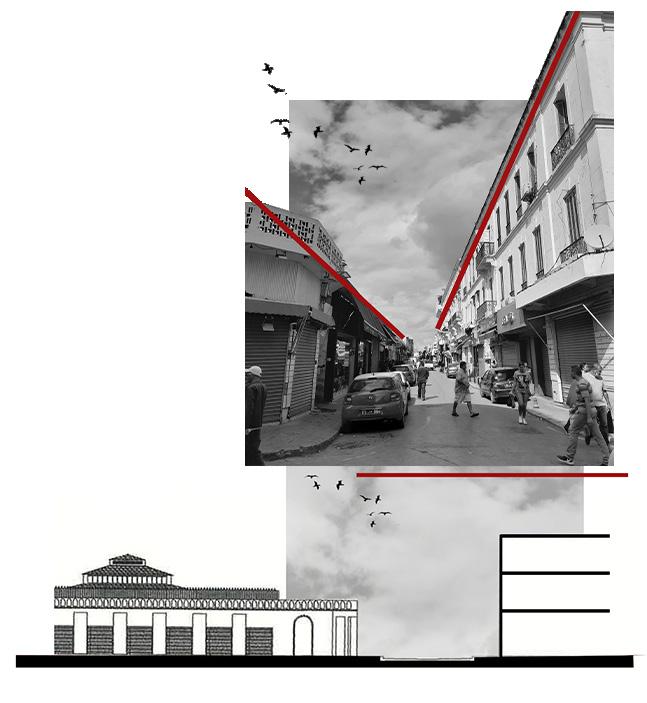
63
Rue Charles de gaulle
Rue d'Espagne
B
Coupe B-B
Figure 52 : Le perçu urbain . Source : schéma personnel
0 100m
• Le vécu urbain
Afin de mieux comprendre le contexte socio-urbain de la zone environnante du marché, nous étudions un parcours urbain à travers 4 séquences : la 1ère est au niveau du début de la Rue Charles de Gaulles, la 2ème est celle au niveau de la Rue d’Allemagne , la 3ème est celle au niveau de la Rue du Danemark et pour finir une séquence dans la Rue
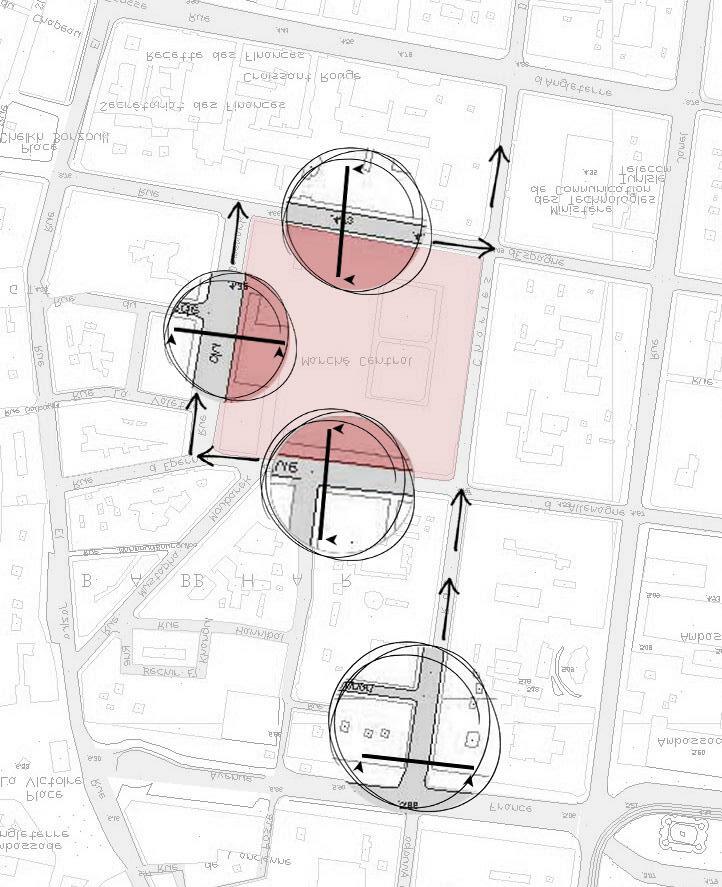
Figure 53 : Le parcours urbain étudié urbain . Source : schéma personnel
Figure 54 : Coupe sur la rue de Charles de Gaulles . Source : schéma personnel
Le point de départ de cet itinéraire est majoritairement très encombré : le flux véhiculaire est à sens uniqueous avons remarqué que des commerçants informels ont commencé à apparaître
Séquence 1: Coupe A-A Séquence 2: Coupe B-B
Figure 55 : Coupe sur la rue d'Allemagne . Source : schéma personnel
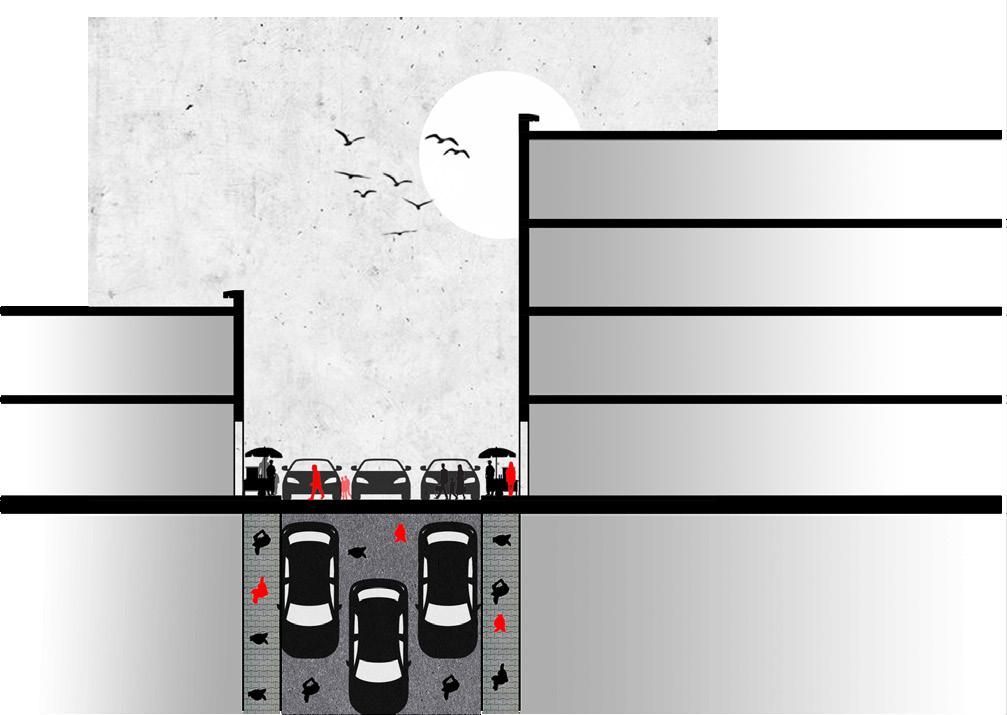
La mobilité douce et le flux véhiculaire sont très importants au niveau de cette Rue pendant toute la journée et surtout à l’heure de pointe, entre 9h et 12h
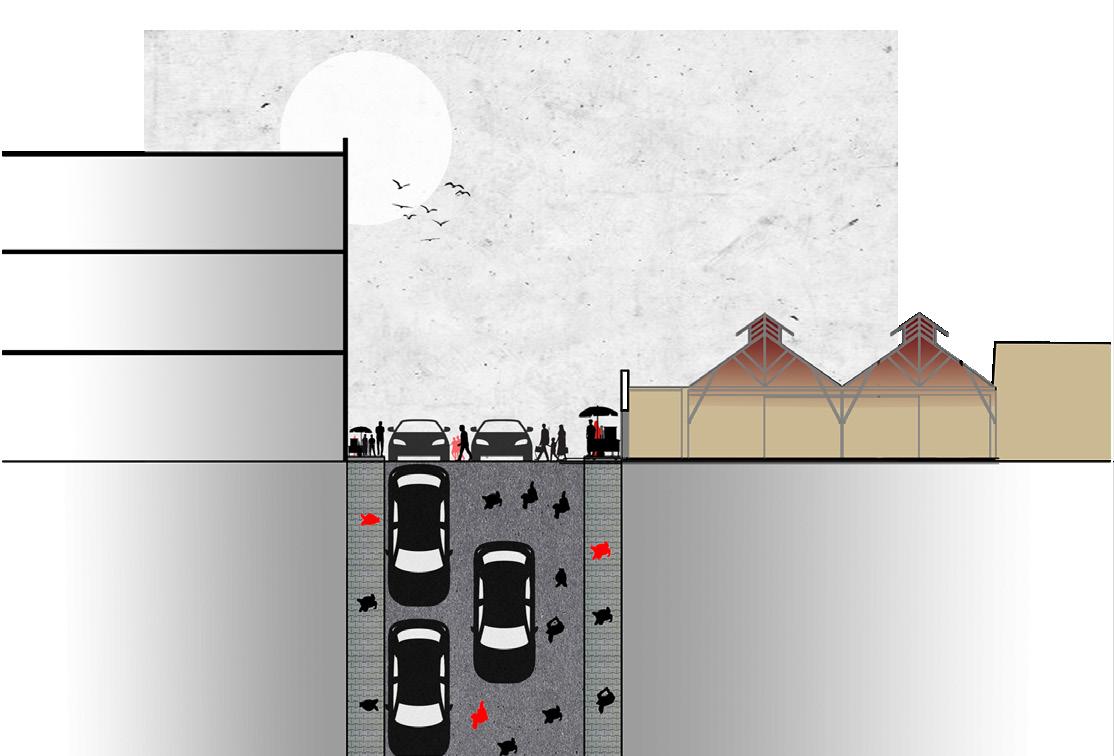
64
Chapitre III: Le marché central , des imaginaires
Séquence 3 : Coupe C-C
Ce tronçon urbain est plus large et nous avons remarqué plus de trafic. C'est parce qu'il y a un parking de service du marché central donnant sur la rue .Le flux piéton est également important car dans les deux rives de la Rue , il existe des magasins de ventes des dattes.
Séquence 4: Coupe D-D
La particularité de cette rue est la présence importante de commerçants informels. ils bloquent toujours la mobilité
Figure 57 : Coupe sur la rue dd'Espagne . Source : schéma personnel
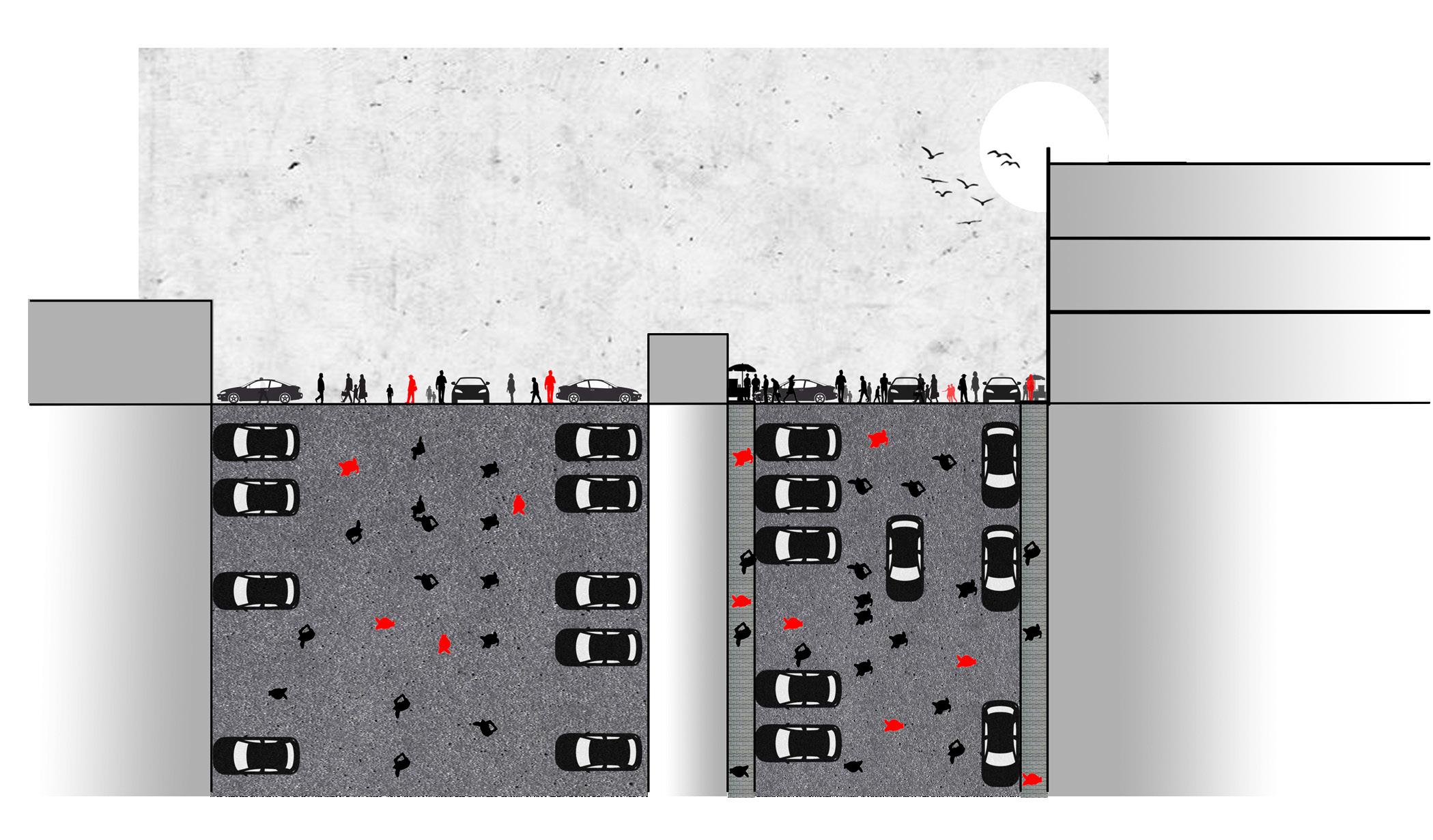
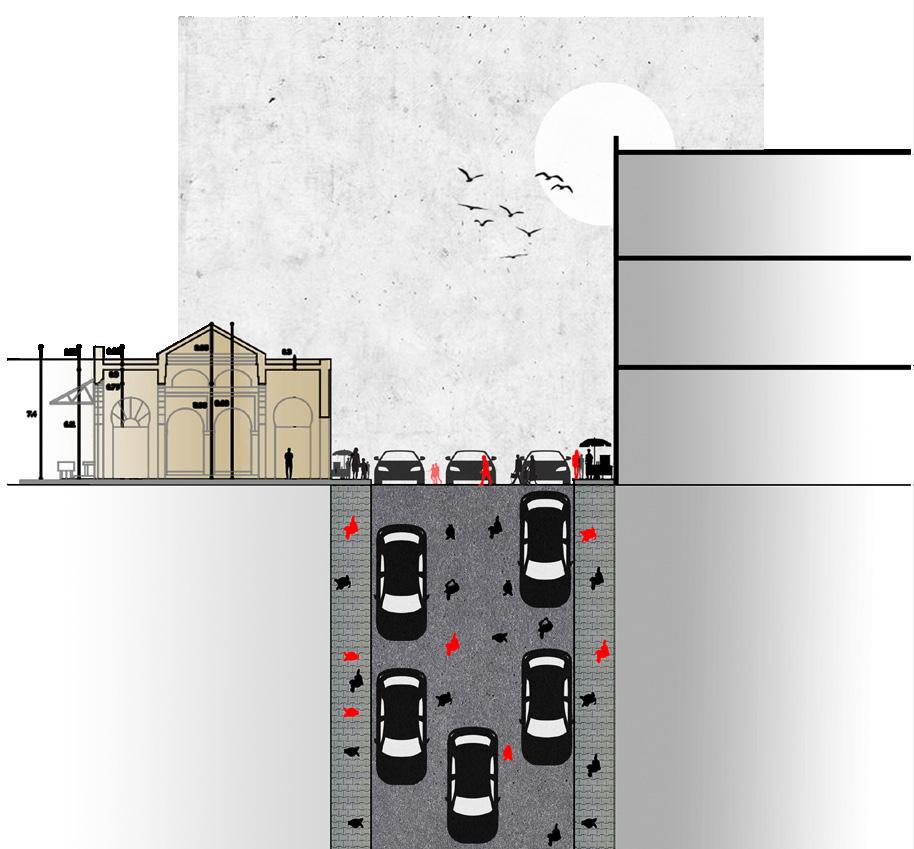
Stationnement anarchique des véhicules.
La zone environnante du marché souffre d’un grand problème de circulation
La présence des marchands informels dans la plupart de cette zone mais surtout dans la Rue de Charles de gaulles et dans la Rue d’espagne
65
A retenir 1 2 3
Figure 56 : Coupe sur la rue du Danemark . Source : schéma personnel
III.2.2.
A l'échelle du bâtiment
• le marché central , une entité poreuse
Le marché central de Tunis est un fragment urbain perméable qui tisse des liens de continuité avec l'environnement dans lequel se situe le marché, dans son tissu , comme une entité poreuse accessible par ses quatre façades . le marché donne sur 4 rues par sept portes réparties entre accès principales et de service, comme indiqué ci-dessous







Rue Du Danemark

Rue D'Allemagne
Rue D'Espagne

66
Rue Charles de Gaulles
Figure 58 : Accéssibilité du Marché Central . Source : schéma personnel
1 2 3
Chapitre III: Le marché central , des imaginaires
Cet aspect de porosité est accentué par une multitude d’accès. l’organisation de l’espace intérieur rend la circulation structurée ce qui facilite le passage et transforme l’intérieur du marché en un raccourci et une partie intégrante de l’extérieur.
Le marché central est donc un lieu poreux , fluide et connecté à son contexte d’implantation.
Accès principal Accès service
Figure 59 : la fluidité du Marché Central . Source : schéma personnel
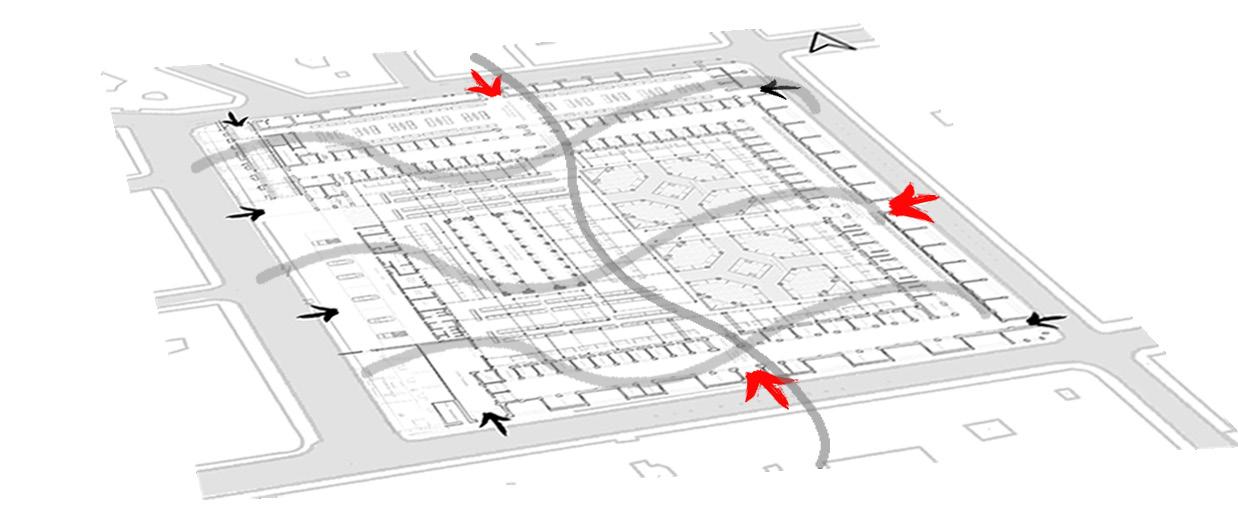
A retenir

Pas de distinction entre l'accès principal et l'accès de service .
l’entrée n’est pas marquée
la présence des marchands ambulants devant les portes .

67
les élèments graphiques


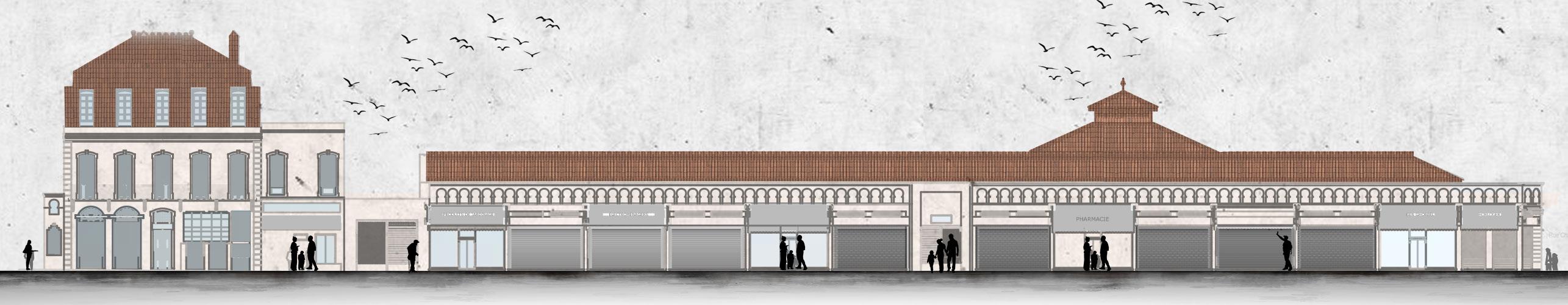

68 •
Figure 60 :Facade extérieure Rue Charles de Gaulles . Source : ASM avec modification personnelle
Figure 61 :Facade extérieure Rue d'Espagne . Source : ASM avec modification personnelle
Figure 62 :Facade extérieure Rue d'Allemagne . Source : ASM avec modification personnelle
Figure 63 :Facade extérieure Rue de Danemark . Source : ASM avec modification personnelle
Chapitre III: Le marché central , des imaginaires
• l'organisation fonctionelle
Les espaces de vente sont organisés par zoning, autour d’une place centrale originale dédiée aux fruits et légumes. Les dives boutiques qui englobent le marché reflètent une continuité urbaine. le programme de rénovation du Marché Central consiste à réintégrer 568 point de vente réparties en : 370 pour les fruits et légumes. 69 pour les poissons. 24 pour la viande. 28 points de vente de volaille . et 50 points de vente de divers produits alimentaires.
Etalage de fruits et des légumes Galeires des volailles et épiceries 22852 m2
Boutiques Parking
Figure 64 :Etalage fonctionnel . Source : schéma personnel
Halle des poissons 1050 m2
Pépinière Administration
69
•
La mixité structurelle A A
Le marché représente une multitude de type de structure. La restructuration achevée en 2007 a montré de différentes topologies de construction, en relation avec les fonctionnalités, les besoins climatiques, et les besoins architecturaux . Essentiellement, les clôtures et murs sont en maçonnerie, des cloisons en pierre et brique.
-La Halle centrale , l’ancien bâtiment , est une structure en maçonnerie et couverte en dalle pleine.


-Les espaces intérieurs des légumes et fruits sont couverts en toiles tendues légèrement inclinées.
-Les Halles anciennes des fruits sont retravaillées en structure métallique et charpente en bois revêtue en tuile rouge.
-Les galeries marchandes ont une couverture en charpente de bois en pente.
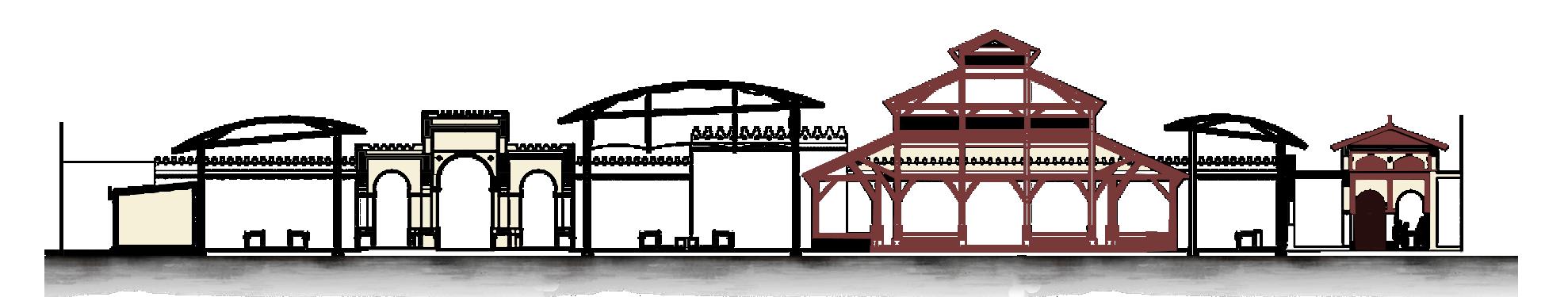
70
COUPE A-A
Figure 65 :Les différentes structures dans le marché central de Tunis. Source : schéma personnel
Chapitre III: Le marché central , des imaginaires • Limites et problèmes



La toiture en toiles tendues représente aujourd’hui plusieurs problèmes.C’est sans doute une forme de protection contre les conditions climatiques extérieures, mais, elle constitue aujourd'hui une source de malaise pour les marchands ainsi que pour les visiteurs.
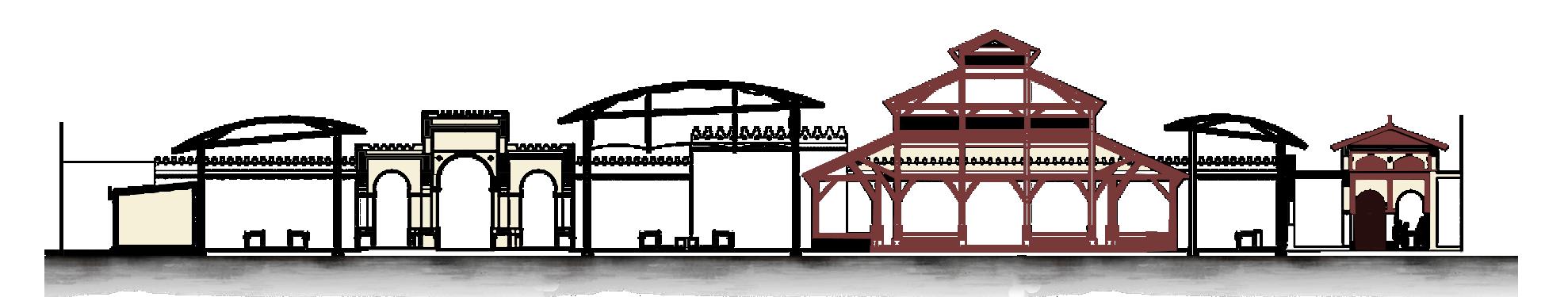
71
Figure 66 :Les incivénients de la couverture. Source : prise personnelle
III.3. La quête des imaginaires
III.3.1. Interroger l'imaginaire collectif •
L'enquête in situ
Afin d'interroger l'imaginaire collectif des principaux acteurs du marché central, nous avons opté pour la méthode d'enquête qualitative afin de comprendre les pratiques sociales et les liens qu'entretiennent ces acteurs avec l’espace concerné.
En fait , l'enquête repose sur deux techniques essentielles qui peuvent se compléter , à savoir la carte mentale et les entretiens semi-directifs.
Notre choix pour l’enquête qualitative est guidé par la spécificité de notre problématique qui cherche à saisir les représentations spatiales du marché central via la technique de la carte mentale et les entretiens semidirectifs afin d’extraire le maximum d’informations de vécus ,d’expériences de sensations autour de ce lieu .
Comment représenter cet imaginaire collectif Par quel processus
"Une enquête14 est une opération qui a pour but la découverte de faits, l'amélioration des connaissances ou la résolution de doutes et de problèmes. Concrètement, il s'agit d'une recherche poussée d'informations, avec le but de l'exhaustivité dans la découverte des informations inconnues au début de l'enquête et parfois la volonté de publication des informations collectées." 15 14 Enquête menée sous la direction de madame Imen Oueslati, enseignante à l’ENAU 15https://fr.wikipedia.org/wiki/Enquête
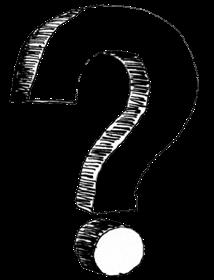
72
Chapitre III: Le marché central , des imaginaires
Interroger l'imaginaiare collectif
Choisir la population cible
Echantillonage de 10 personnes
Donner le crayon aux enquêtées pour dessiner leurs représentations spatiales du marché central
L'analyse et la transcription de ces cartes mentales selon la méthode de Kevin Lynch
Les entretiens semi-directifs
Analyse thématique des entretiens L'interprétation des résultats
Figure 67 : Le processus de l'enquête. Source : schéma personnel
• Population enquêtée

Nous avons interrogé 10 personnes de profils et d'âges différents, réparties en 7 commerçants travaillant dans le marché central et 3 visiteurs. La population enquêtée est la suivante :
Les cartes mentales des commerçants
Enquêté Sexe Age catégorie professionnelle E1
Homme 30 Vendeur du citron E2 Homme 42 Vendeur des légumes E3
Femme 57 Vendeuse des épices E4
Homme 42 Vendeur des poissons E5
Homme 45 Vendeur des fruits E6
Homme 42 Vendeur des épices E7 Homme 26 Vendeur des poissons
Figure 68 : Tableau des commerçants enquêtés . Source : tableau personnel

73
1 2
4
3
5 6 7
Les visiteurs



Figure 69 : Tableau des commerçants enquêtés . Source : schéma personnel
Cette technique permet de concrétiser l'imaginaire à travers le dessin, d'identifier et d’expliquer le degré de lisibilité et d’imagibilité de l’espace par l’usager .
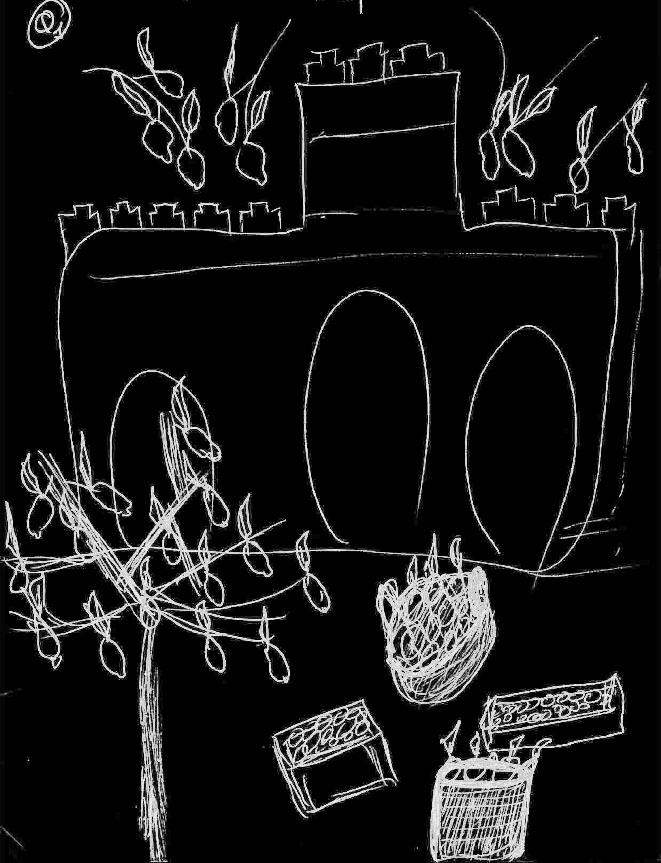

La carte mentale dessinée va mettre en valeur son imagibilité en tant qu’espace représenté mais aussi sa lisibilité en tant qu’espace perçu.

74
Figure 70 : Carte mentale du commerçant E1 . Source : schéma personnel
Nom
E9
E10
Les
Les
Carte
E1 Les
Enquêté
Sexe Age catégorie professionnelle E8 Wassim Homme 21 Etudiant
Salma Femme 45 Résidente dans le quartier
Mansour Homme 59 Fonctionnaire III.3.2. Les cartes mentales •
représentations spatiales
photos du marché
mentale
commerçants
E2
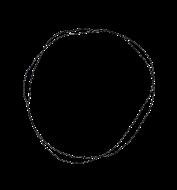
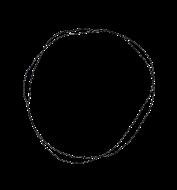








La carte mentale

Chapitre III: Le marché central , des imaginaires


Pour moi , mon stand de citron est la première chose qui m'est venue dans mon esprit , j’estime que mon stand a donné une valeur au marché et d’ailleurs beaucoup de visiteurs viennent juste pour découvrir la beauté de ce stand. Je vais aussi dessiner ce volume car il est proche du stand et je l'admire personnellement
Les photos du marché
Figure 71 : Carte mentale du commerçant E2 . Source :
Je vais dessiner mon stand de vente de légumes , et le stand de fruits de mon ami . Mais le marché central est réputé surtout pour les poissons. Je veux surtout mentionner Hamza , le vendeur de citron qui est un point de repère dans le marché avec son joli stand.

La carte mentale E3
Les cartes mentales
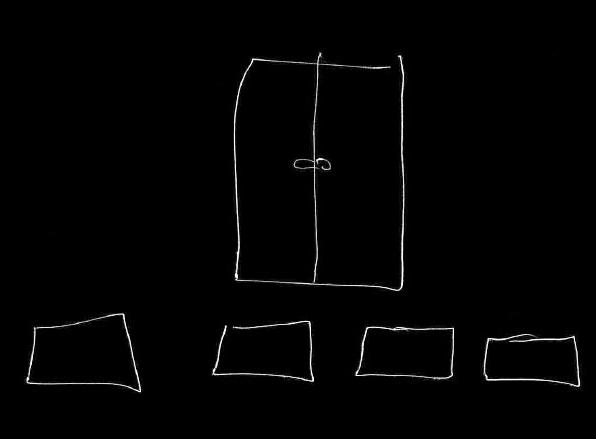
Les photos du marché
Figure 72 : Carte mentale du commerçant E3 . Source : schéma personnel
75
schéma personnel
E4
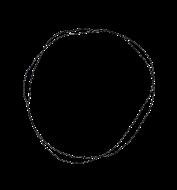
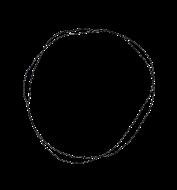
La carte mentale
Je vais dessiner la porte d'entrée principale du marché, il y a quelques vendeurs ambulants impolis devant la porte, bloquant l'entrée du marché
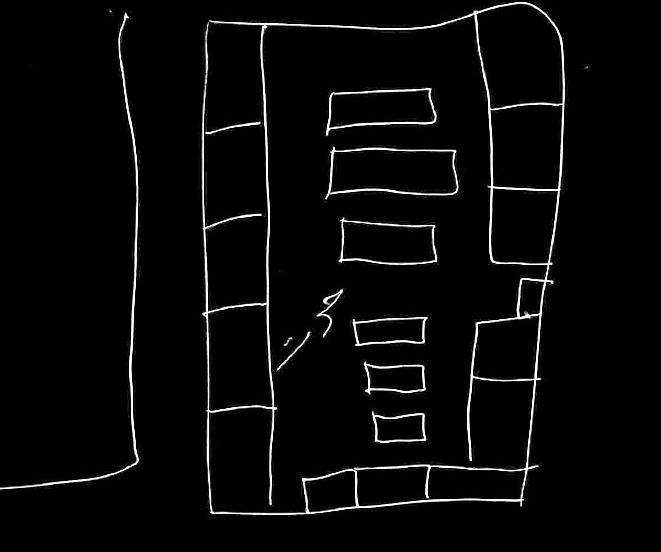
Les photos du marché
Figure 73 : Carte mentale du commerçant E4 . Source : schéma personnel
Pour moi, l e marché aux poissons est la partie la plus importante du marché, j'y travaille toute la journée et ne quitte presque jamais mon stand. Mon dessin traduit la partie totale du marché avec l’étalement des stands
La carte mentale
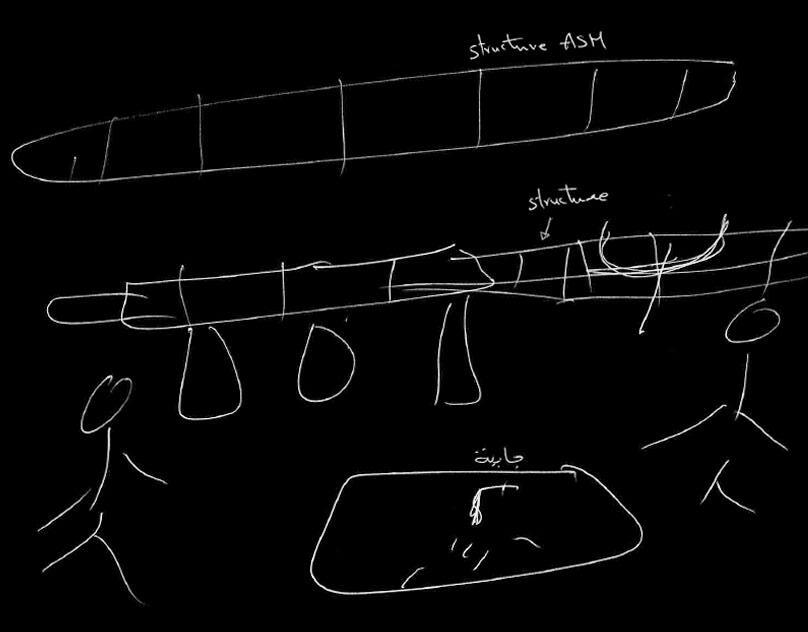
Les photos du marché


E5







Figure 74 : Carte mentale du commerçant E5 . Source : schéma personnel

76
Chapitre III: Le marché central , des imaginaires


Je vais dessiner mon stand de légumes et la structure qui se trouve juste au-dessus, j’étais là lorsqu’elle était construite. Je vais présenter aussi la “jebya” qui était dans le marché mais elle n'existe plus maintenant.

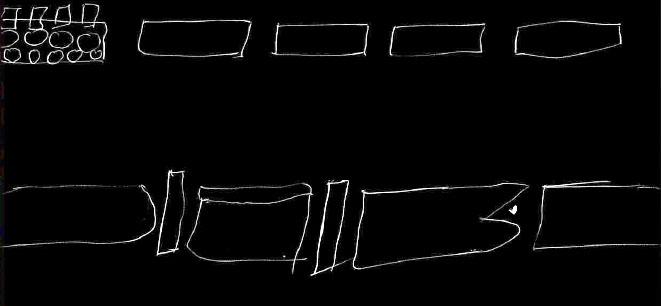
La carte mentale
Les photos du marché
E6






E7
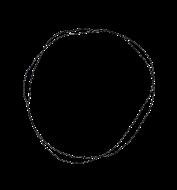
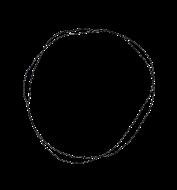
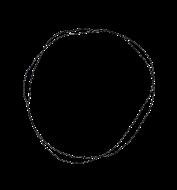






Figure 75 : Carte mentale du commerçant E6 . Source : schéma personnel
Ma carte mentale est mon stand de vente des épices, et cette partie est est ma préférée dans le marché
La carte mentale
Les photos du marché
Figure 76 : Carte mentale du commerçant E7 . Source : schéma personnel
Si j'entends le terme Marché Central, je penserai directement à la partie poisson, je pense que c'est la plus importante
77
Les cartes mentales des visiteurs














Figure 77 : Carte mentale du visiteur E8 . Source : schéma personnel
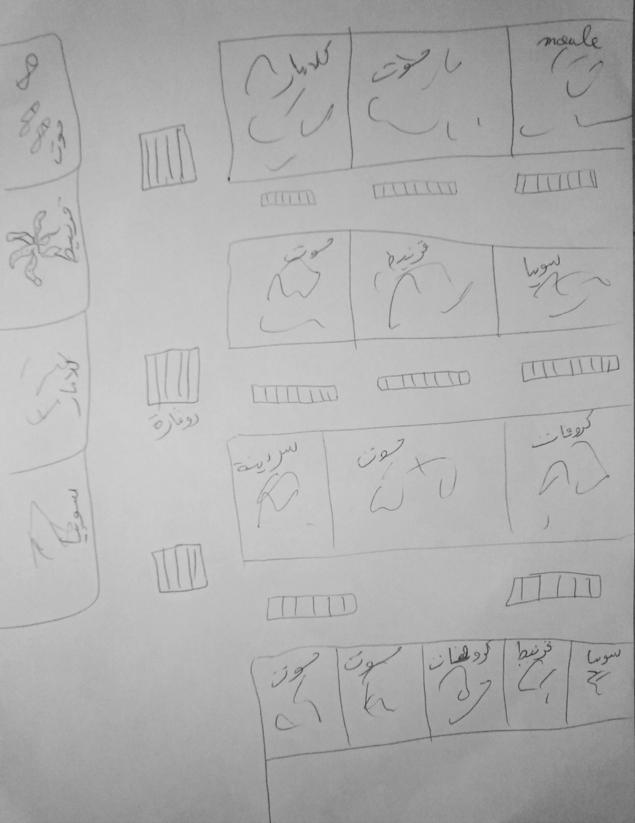
Je trouve que les arcs présents dans les portes d’entrées sont remarquables et spécifiques dans le marché central. Je vais représenter aussi les stands de légumes. Aussi , c’est un espace commun qui regroupe différents visiteurs.
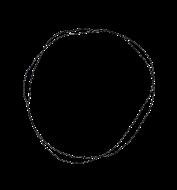
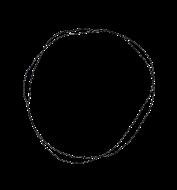
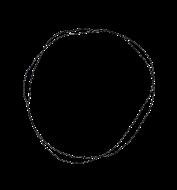
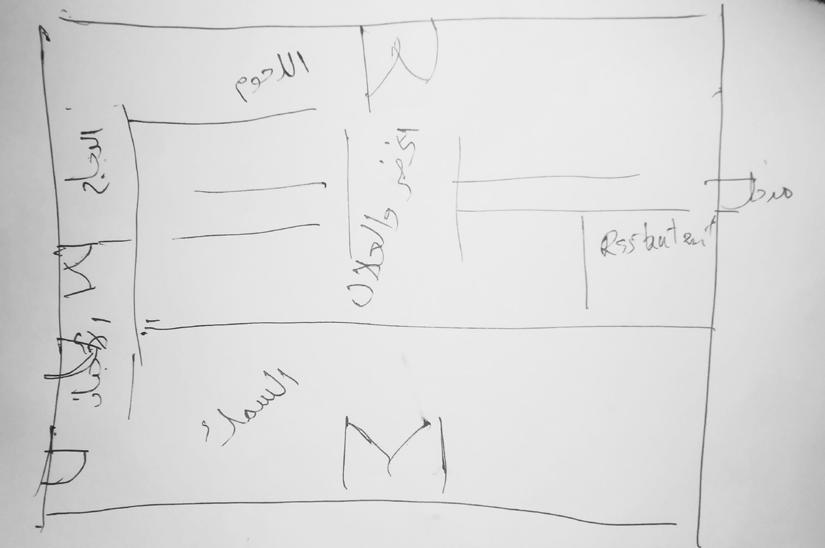
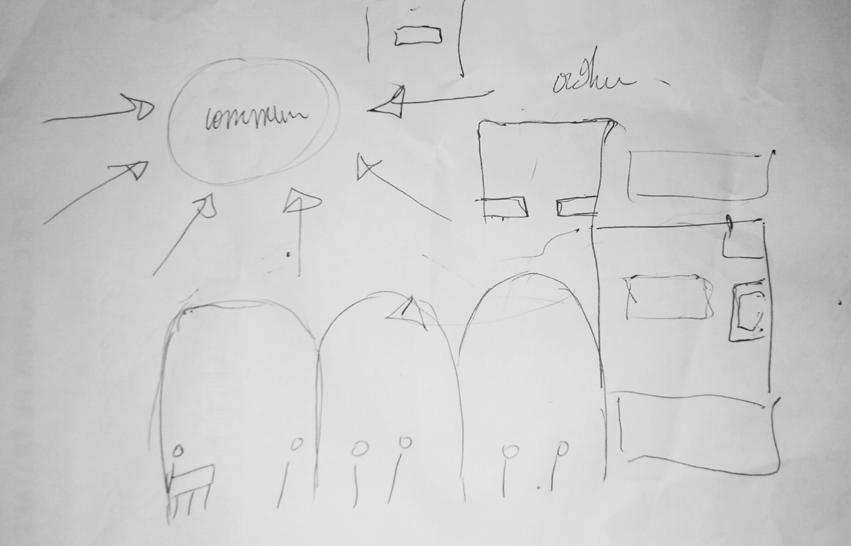
Figure 78 : Carte mentale du visiteur E9 . Source : schéma personnel
Pour moi le marché central est le marché des poissons, il existe plusieurs types de poissons et de fruits de mer que tu ne trouves que dans le marché central avec les meilleurs prix . Je vais dessiner mon parcours lorsque je visite le lieu pour faire mes courses avec la division des espaces car je fréquente souvent le marché
Figure 79 : Carte mentale du visiteur E10 . Source : schéma personnel
78
E8 E8 E8 E8 E9 E10
•
Chapitre III: Le marché central , des imaginaires
Interprétation et analyse
Cette méthode permet de mettre en évidence des éléments plus ou moins importants à travers les représentations dessinées . Chacun construit ses représentations à partir de ses pratiques et de ses perceptions personnelles, mais elles sont aussi collectives car dépendantes du contexte spatial, économique, culturel et social. Bien qu'elles soient hétérogènes, elles peuvent être comparées entre elles car elles apportent des éléments identiques.
"C’est cette forme, cette couleur ou cette disposition, qui facilitent la création d’images mentales de l’environnement vivement identifiées, puissamment structurées et d’une grande utilité." 16
Pour l’interprétation des cartes mentales , on va tirer les cinq éléments clés comme une légende dans n’importe quelle carte representée par les enquêtés.
les itinéraires les points de repères les carrefours Les limites Les zones
Figure 80 : Les cinq élèments types de la carte mentale : schéma personnel
Ainsi , l’étude menée à travers les cartes mentales permet d’établir des cartes de synthèse qui préfigure les caractéristiques de lecture de marché.

16Lynch
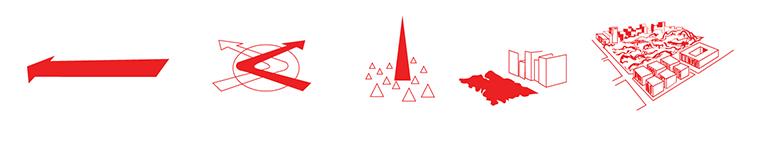
79
(l'image de la cité ,1960, p. 11) définition d’imagibilité
"Un point de repère n'est pas nécessairement un grand objet : cela peut être une poignée de porte tout aussi bien qu'un dôme. Si la porte brillante est justement la vôtre, elle devient un point de repère." 18 18
1 Les repères
Ce sont des lieux facilement identifiables, et chacun peut les identifier pour se positionner ou s’orienter . D'après les cartes mentales fournies par les enquêtés. Trois espaces sont répétés, ce sont :

i) le volume central
C'est le cœur du marché central qui stocke aujourd'hui les déchets de fruits et légumes. Auparavant, ce volume était un espace d'exposition pour les produits de saison et les eaux florales (eau de rose, géranium et fleur d'oranger).
ii) La porte d’entrée :
L'entrée principale du marché est un objet issu de la perception, c'est un repère visuel qui structure la perception de l’ensemble urbain . C’est un objet-repère .
80
E8 E1
Kevin Lynch, L’image de la Cité , p20
Repère 1
Figure 81 : Le volume central . Source : schéma personnel
Chapitre III: Le marché central , des imaginaires

E3
Figure 82 : La porte d'entrée , un repère. Source : schéma personnel

iii) Le marché des poissons
Le Marché Central est réputé pour le marché des poissons , cet espace a été répété six fois par les enquêtés, ce qui illustre son importance dans l'imaginaire collectif. Selon la carte mentale dessinée, le marché aux poissons est représenté comme un rectangle ou un stand de commerçants. Par conséquent, nous pouvons en déduire que cette partie du marché est un espace catalyseur. De plus, à partir de la représentation des expériences personnelles, la pratique de cet espace est ressortie.
Figure 83 : Le marché des poissons , un repère. Source : schéma personnel
81
Repère 2
E1
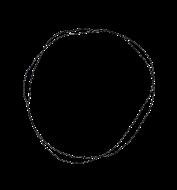
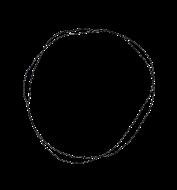
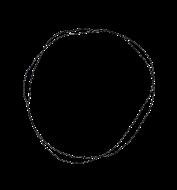
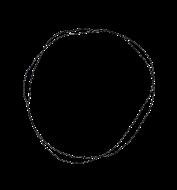
E5

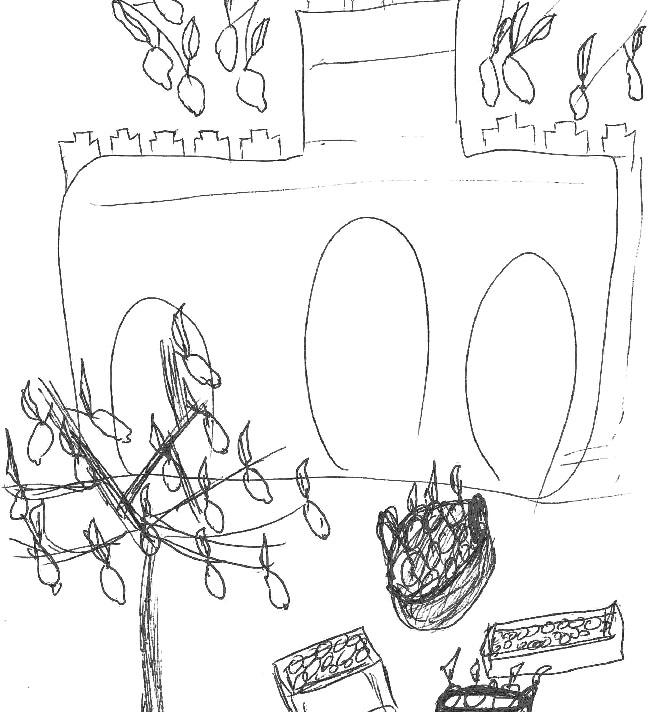
2 Les Limites
Les commerçants ont un attachement particulier à leur stands , chacun commence par dessiner son propre stand comme si le marché se limite à la frontière de leur stands . On représente l’espace sur la base de la personne même, c’est la personne qui est le centre de cet espace.



E7 E6
La limite des stands des commerçants enquêtés Figure 84 : Les stands , une limite . Source : schéma personnel



La limite du marché a rétréci Chaque stand= une limite

82
Chapitre III: Le marché central , des imaginaires
Aussi , dans leurs perceptions on voit beaucoup les stands qui sont dans leurs champs visuels.

E4
E2
E5
Figure 85 : La limite des stands dans les champs visuels des enquêtés . Source : schéma personnel
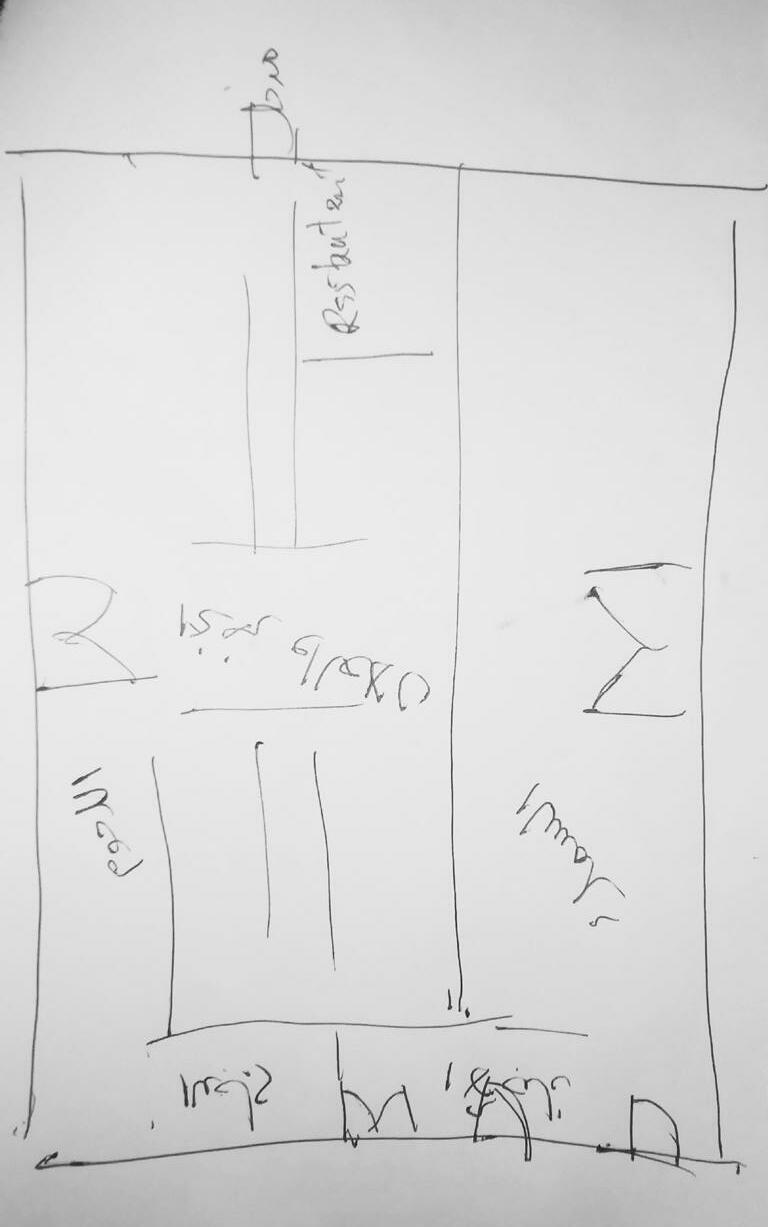
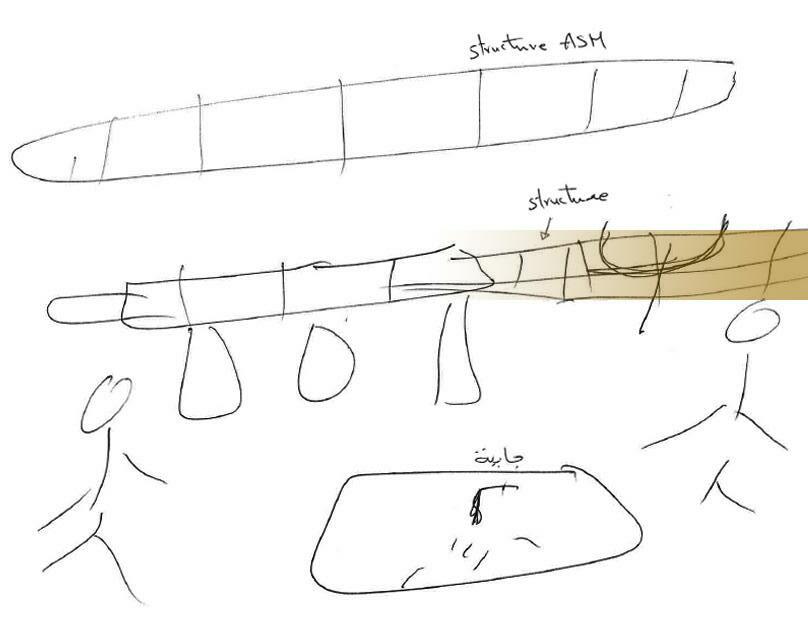

3 les itinéraires
E10
Cet enquêté a dessiné le marché central comme étant une promenade entre les différents étalages , selon lui cet itinéraire part du marché aux poissons et rejoint ensuite d'autres parties. Il établit le chemin suivi d’un point à l’autre.
Le parcours
Figure 86 : Le parcours dans le marché . Source : schéma personnel
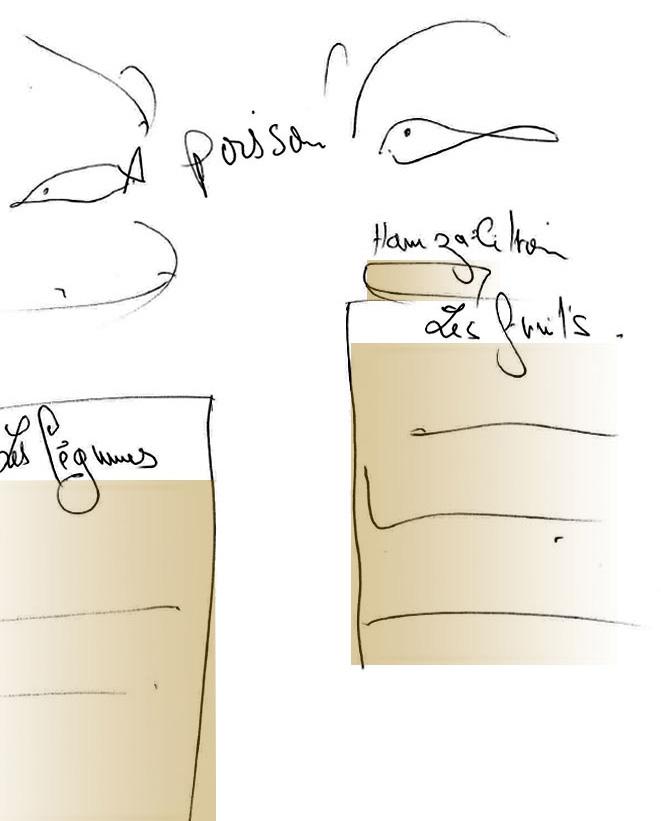
83
Carte mentale
•
Synthèse


Ces cartes mentales dessinées nous permettent de savoir comment l’usager du marché central , commerçants ou visiteurs , représente l’espace à partir de l’image qu’il a dans sa tête . Il en résulte donc des dessins plus ou moins précis et imagés , qui donnent une bonne indication de la façon dont cet espace est ressenti . Tout ce processus à pour objectif de tracer les lignes droites dans le projet architectural . Pour synthétiser , on décèle trois éléments importants parmi les cinq éléments d’analyse de kevin lynch qui sont :l'itinéraire , les repères et les limites.
Figure 87 : L'objectif du carte mentale . Source : schéma personnel
Les représentations spatiales
1 2 3
Repère 1 : l'élèment central





Repère 2 : La porte d'entrée
Repère 3 : Le marché des poissons
Représentation du marché à travers la position personnelle
La notion du parcours dans le marché
La forme rectangulaire répétée : les enquêtés retracent la forme réelle du marché
Figure 88 : Schéma de synthèse . Source : schéma personnel
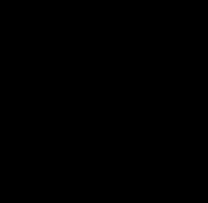
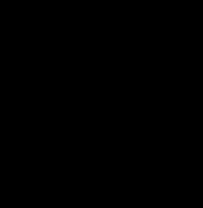
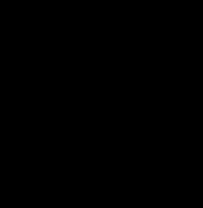
84
III.3.3.

Chapitre III: Le marché central , des imaginaires
Les entretiens semi-directifs
L’entretien semi-directif est une technique de collecte de données qui contribue au développement de connaissances. Pour obtenir ces données , l’entretien se compose d’une série d’interrogations ouvertes . Durant cet entretien , nous poserons trois questions complémentaires :
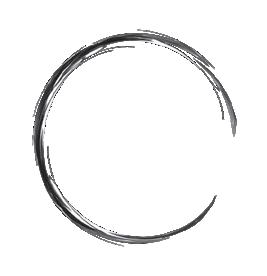
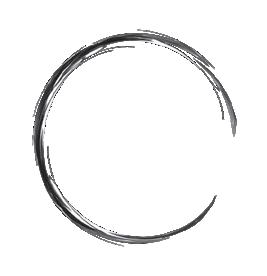
Pouvez vous me parlez du Marché central ?
Quels sont les éléments que vous appréciez dans le marché central ?
Selon vous , quels sont les changements qu’il faut apporter pour améliorer le Marché central ?

On prendra un échantillon comme exemple pour marquer l’étape de l’entretien Enquêté Sexe Age catégorie professionnelle E1 Homme 30 Vendeur du citron
Le Marché Central est un endroit mémorable, mon père m'accompagnait au marché depuis que je suis enfant. Ce lieu fait partie de notre mémoire collective. De plus, compte tenu de sa valeur historique, le marché attire de nombreux touristes. Afin d'améliorer cet espace, je pense qu'il faut trouver des solutions pour les vendeurs de rue et mieux entretenir le marché.
85
Figure 89 : Stand du citron . Source : prise personnelle
86
axes
E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 Totaux des thèmes 3 5 6 6 4 1 5 2 Totaux des axes
32
thématique :
Les
thématiques Dimension concrète Lieu de travail Panoplie des produits Manque de stationnement Problème de pollution Marché des poissons Problème de couverture Mal organisation Insécurité
thématiques
Les thèmes Les entretiens • Tableau
87 Chapitre III: Le marché central , des imaginaires Dimension abstraite Dimension sociale Insécurité Espace souvenir Espace de mémoire collective un Vécu Lieu historique Lieu repère Espace sentimental habitude Polysociabilité Problème des marchands ambulants 2 2 1 3 3 3 2 1 3 5 15 8 Figure 90 : Les fréquences des thèmes . Source : Tableau personnel Potentiel Inconvénient
•
Analyse thémathique des entretiens :
Figure 91 : Les dimensions de l'espace . Source : schéma personnel
Le tableau thématique développé et la catégorisation des thématiques selon trois dimensions (concrète, abstraite et sociale) permettent d'appréhender un ensemble d'interactions entre un espace et ses usagers. Cette analyse permet de déterminer la façon dont le marché est perçu, habité et pratiqué. Identifier ces différentes dimensions nous permet de mieux comprendre les besoins de chaque usager et d'essayer de les traduire spatialement.
Il s'avère que la dimension concrète est la plus importante : cette dimension se réfère à l'espace physique, se référant aux propriétés matérielles. Par conséquent, nous parlons de dimensions spatiales et physiques.
Dimension concrète
Figure 92 : Les sous thémes de la dimension concrête . Source : schéma personnel
T1 : Lieu de travail T2:Panoplie de produits : Manque de stationnement : Problème de pollution : Manque d'entretien : Marché de poissons :Problème de couverture : Mal organisation : Insécurité
l’évocation des thèmes sous la catégorie de la dimension abstraite a montré que le marché central est au-delà d’un espace physique et matériel . Cette dimension nous ramène à l’existence de l’imaginaire collectif.

88
Dimension concrète
Dimension abstraite Dimensionsociale
Dimension abstraite
Chapitre III: Le marché central , des imaginaires
T10 : Espace souvenir
T11 : Espace de mémoire collective
T12 : Un vécu
T13 : Lieu historique
T14 : Lieu repère
T15 : Espace sentimental
T16: Habitude
Figure 93 : Les sous thémes de la dimension abstraite. Source : schéma personnel
La notion de l’espace se complexifie par l’introduction d’un élément qui ne renvoie pas directement à la dimension spatiale : c’est la dimension sociale.En sciences sociales, il est difficile de dire que l'espace est purement physique. Les usagers, par leur consommation d'espace, participent à la production de ses propriétés, qui le modifient en fonction des besoins qu'il doit satisfaire.
T17 : Polysociabilité
Dimension sociale
T18 : Problème des marchands ambulants
Figure 94 : Les sous thémes de la dimension sociale. Source : schéma personnel
A retenir
Imaginaire collectif Espace physique
Dimension abstraite


Dimension concrête
Dimension sociale

Figure 95 : Les dimensions de l'espace . Source : schéma personnel
Interactions sociales
89
Valoriser l’imagibilité et l’illisibilité du marché central pour renforcer l’appropriation du marché central par ses propres usagers
• Classification des thèmes :
Le tableau obtenu montre les différents thèmes issus des entretiens semi-directifs, mais la fréquence varie d'un thème à l'autre. Par conséquent, ils peuvent être classés en fonction de leur importance et de leur domination. Les catégories sont les suivantes :
valoriser le marché central dans sa dimension imaginaire collectif
Renforcer ce concept d'habitude, rendre le marché central de plus en plus intégré dans la vie quotidienne
Figure 96 : Classification des thèmes . Source : schéma personnel
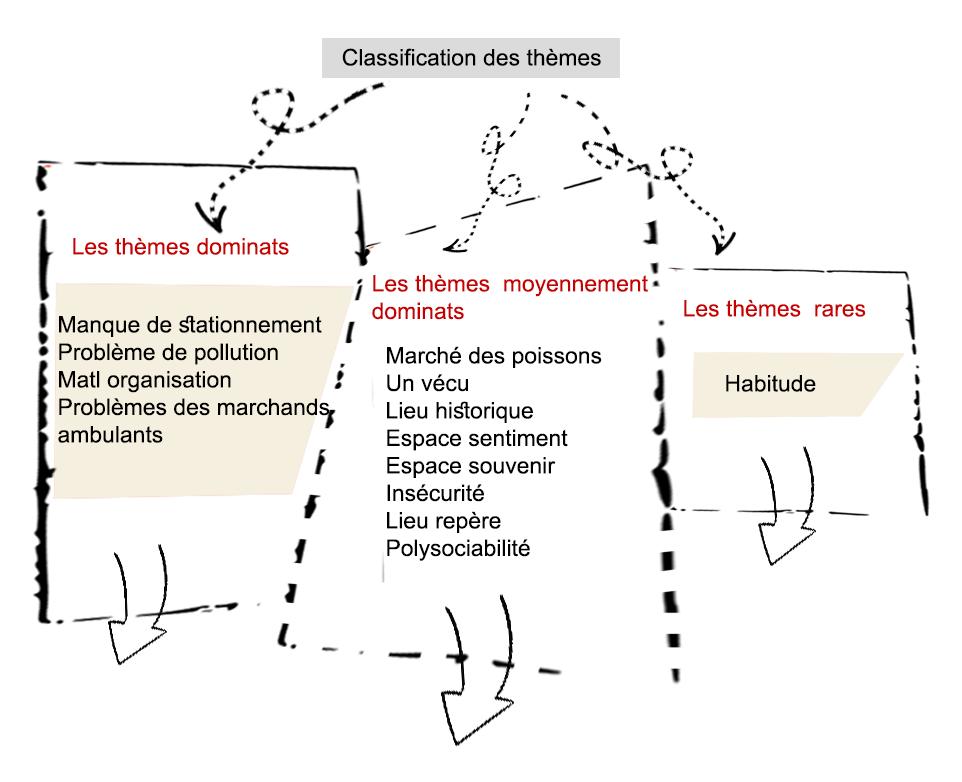
90
Chapitre III: Le marché central , des imaginaires
Conslusion :
• Confrontation des résultats des deux techniques : Carte mentale et entretiens semi-directifs
Thèmes communs Thèmes spécifiques
Cartes mentales
- Marché des poissons -Lieu de travail
- le volume central -la porte d'entrée -les limites -les tinéraires
Entretiens semidirectifs
-Panoplie des produits -Manque de stationnement -Problème de pollution -Problème de couverture -Mal organisation -Insécurité
Figure 97 : Confrontation des deux techniques . Source : tableau personnel
La quête des imaginaires à travers les deux techniques de l'enquête qualitative (carte mentale et entretiens semi-directifs) constitue des éléments d’une lecture socio-spatiale du marché qui met en exergue l’interaction entre les dimensions concrète, sociale et abstraite de l’espace.
En addition aux investigations contextuelles sur site, nous explorons l’imaginaire comme outil opératoire afin de trouver des solutions pour la mise à jour de ce marché. C’est une concrétisation spatiale des rapports des usagers avec cet espace commercial.
91
chapitre IV vers un renouveau du marché central via les imaginaires

Les questions posées dans les derniers chapitres ont pour objectif d'opérer une lecture socio-spatiale de notre contexte. Ce chapitre vise donc à trouver une réponse architecturale à la problématique posée, passant de la recherche à la concrétisation.
Afin de pouvoir mettre à jour le marché central de la Tunisie, il est indispensable d'étudier la fonction évolutive du marché à l’échelle mondiale . Dans la première phase, nous analyserons des interventions conçues pour des contextes ou des usages similaires. Ces références seront combinées avec l’interrogation de l’imaginaire collectif pour proposer un plan d'action qui sera adopté dans la deuxième phase de ce chapitre.

introduction
Les imaginaires pour une révision du Marché Central de Tunis
IV.1.
L'espace commercial , autrement
IV.1.1. le marché , l'icône de la ville : Cas du marché Santa Caterina , Barcelone
ARCHITECTE: ENRIC MIRALLES, BENEDETTA TAGLIABUE ANNÉE: 1997-2005
• Implantation
Le marché de Santa Caterina est situé dans le centre historique de Barcelone. Il fait partie d'un tissu urbain ancien dense parallèle à un autre tissu plus récent où se situe la zone touristique incluant le port de plaisance. Le marché est situé dans l'un des quartiers les plus centraux de la ville, au cœur du quartier de Ribeira.

• Choix de la référence
Nous avons choisi de travailler sur le marché de Santa Caterina à Barcelone en raison des similitudes en termes d'insertion urbaine avec le marché central en Tunisie, tous les deux occupant un îlot dans un tissu urbain dense. Grâce à ce projet emblématique, tout le quartier a retrouvé un nouveau souffle en tant que destination touristique internationale.
Figure 98 : Situation du marché Santa Caterina . Source : Pinterest
1848

2005 Les nefs de l'ancienne église
• Garder en mémoire le passé tout en réintégrant le lieu dans l'avenir
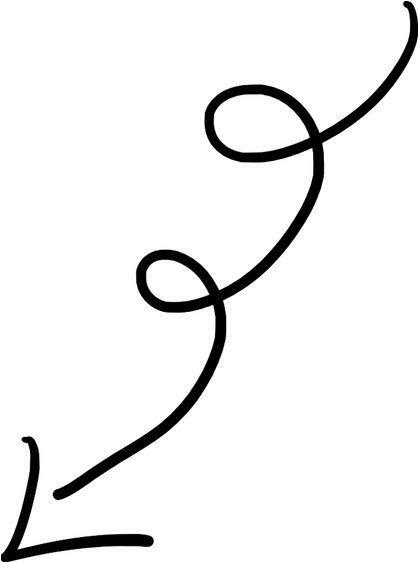


95
Chapitre IV : Vers un renouveau du marché central via les imaginaires
La
Le site actuellement occupé par le marché est l'église et le couvent de Santa Caterina, qui ont été détruits dans l'incendie du couvent en juillet 1835, et la municipalité a décidé de construire un marché à l'endroit où il a été laissé. La superposition de différents moments présente diverses possibilités. L'idéologie directrice du projet est de réaliser un mariage obligatoire basé sur une vision de la modernité qui reflète la volonté de la ville de se souvenir du passé et de l'histoire, tout en intégrant le lieu dans le futur. Le choix des architectes a été de conserver l'ancien mur du périmètre du marché en y ajoutant une toiture ondulée qui dépasse le périmètre du premier bâtiment. Les ondulations de cette toiture sont imprimées à partir des trois nefs qui existaient auparavant dans l'église. couverture du marché
nouvelle
Figure 99 : l'évolution du marché Santa Caterina . Source : www.fr.wikiarquitectura.com
Figure 100 : Vue aéerienne du marché . Source : www.fr.wikiarquitectura.com avec modification
Le nouveau marché, dont le but est d'établir un dialogue entre l'ancien et le nouveau bâti, va encore plus loin et transforme cette empreinte en une immense toile colorée, un spectacle pour les voisins, ou une nappe sur laquelle placer les plats d'un repas fraîchement cuisiné.


L’essence de ce projet est basé sur la conception de la toiture , la partie de la métaphore d’une vaste mer colorée par des souvenirs de fruits et légumes.
Le marché prolonge un immense toit ondulant de pièces de céramique rappelant une nature morte végétale.
Les stalles sont des éléments autoportants situés sous la structure de bois et d’acier qui supportent le tout.

Figure 101 : La toiture du marché . Source : www. fr.wikiarquitectura.com


Figure 103 : Lestructure du marché
Figure 102 : Le dialogue ancien nouveau . Source : www.fr.wikiarquitectura.com
Caterina . Source : www.fr.wikiarquitectura.com
96
Santa
l'entrée principale est marquée par une arcade surélevée par rapport aux autres
•
Intégration urbaine
Ce marché a transcendé son rôle premier d'achat et de vente et est devenu un élément d'affirmation de l'identité de la ville et de l'histoire de la ville . Grâce à ce projet emblématique, tout le centre-ville a retrouvé un nouveau souffle en tant que destination touristique internationale. Le marché est conçu pour faire partie de la zone urbaine. Il dispose de plusieurs entrées sur quatres façades.

Au niveau de l’accès principale , un large trottoir est aménagé avec des bancs publics , des terrasses aménagées , appartenant aux cafés situés au niveau de la galerie du marché. Cet aménagement simple et efficace garantit l'ouverture du marché et sa connexion avec la ville.

l'aménagement

Chapitre IV : Vers un renouveau du marché central via les imaginaires
urbain : l'ouverture du marché et sa connexion avec la ville.
Figure 104 : La façade du marché . Source : www.fr.wikiarquitectura.com avec modification
• Au delà du commerçe
Le marché de Santa Caterina transcende sa fonction première d'espace commercial pour devenir un pôle de rencontre urbain et un lieu d'échange social. À l'intérieur du marché, il y a des zones de consommation et de dégustation, un supermarché, la zone du musée des ruines découvertes pendant les travaux (couvent de Santa Caterina) et des logements sociaux pour personnes âgées.
Figure 105 : Le disppatching fonctionnel du marché Santa Caterina . Source : www.fr.wikiarquitectura.com

98
Aire du marché Supermarché Parking Habitation Bar Restaurants Espace muséal Plan RDC Coupe A-A Façade Sud Ouest
Les différentes fonctions du marché sont réparties sur trois niveaux différents ; deux sous-sols sont réservés au stationnement, il y a un espace pour la collecte pneumatique des déchets, le premier étage est principalement utilisé pour les fonctions commerciales, il se compose d'un espace ouvert dédié avec pour les étals des marchands qui sont organisés sous formes des îlots .


99
Chapitre IV : Vers un renouveau du marché central via les imaginaires
Figure 106 : L'espace muséal . Source : www.google.com
Figure 107 : L'aménagement intérieur . Source : google
Figure 108 : L'intérieur du marché . Source :www. Archdaily.com
IV.1.2. le marché , l'hybride fonctionnel : Cas des Halles de Secrétan , Paris
ARCHITECTE: Patrick Mauger ANNÉE: 2015

•
Présentation
Rénovation des Halles de Secrétan : renaissance d'un art de vivre local. le marché couvert de Secrétan était devenu un objet symbole dans le quartier. Après un siècle de sa construction, cette halle de style Baltard a été inscrite à l'Inventaire des monuments Historiques et a aujourd'hui été restaurée et réhabilitée. Il a retrouvé son ancienne occupation et est devenu le nouveau centre du 19e arrondissement.

• Choix de la référence
Ce projet est choisi dans un essaie de penser l’espace commercial non seulement en tant qu'un lieu d’échange commercial , mais en tant qu'un lieu polyvalent dédié à d’autres types d'échanges. En effet , avec l’évolution des modes de vie et des besoins des usagers, l'espace commercial , aujourd'hui , est perçu comme un espace public destiné au rencontre d'où la nécessité d’introduire de multiple fonctions et de moderniser le commerce proposé.
Figure 109 : Les halles de Secrétan . Source : www.Archdaily.com
• l'ouverture sur la rue
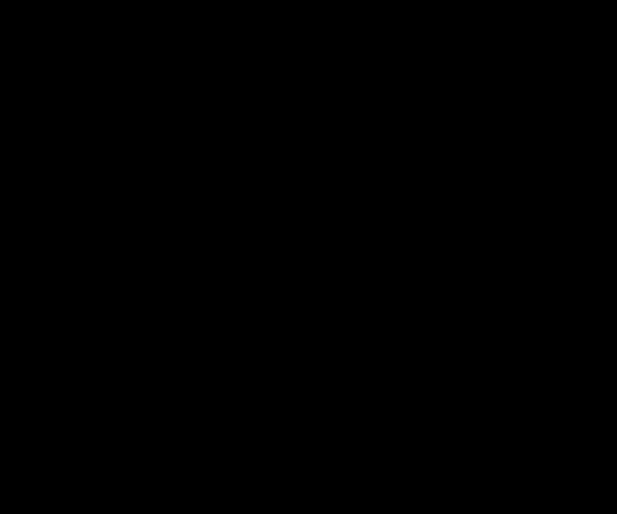
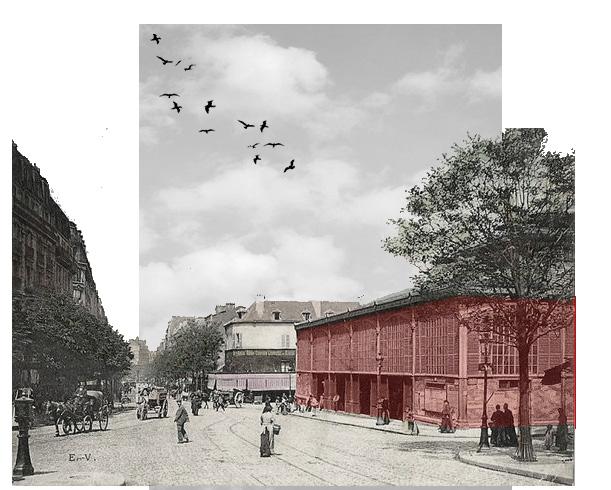
A l'extérieur, le marché s'ouvre largement sur la rue, où les murs en maçonnerie sont remplacés par une façade entièrement vitrée. Les abords sont traités comme de larges trottoires adaptées à la déambulation et à l'intégration des commerces, permettant à l'environnement commercial de se prolonger au-delà du bâtiment.

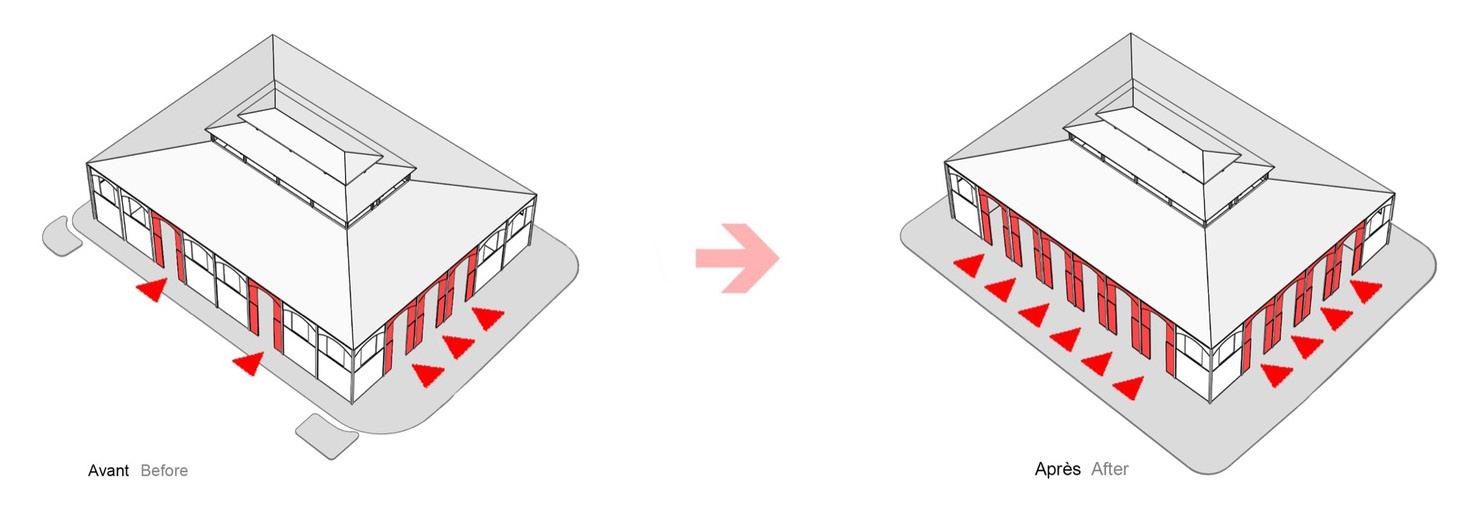
101
Chapitre IV : Vers un renouveau du marché central via les imaginaires
Figure 110 : l'ouverture sur la rue . Source : www.Archdaily.com avec modification personelle
Avant Après
•
la polyvalence du marché
L'espace intérieur a été réorganisé et un sous-sol creusé pour y installer plusieurs salles de fitness. La partie centrale du rez-de-chaussée est occupée par un magasin d'alimentation, redonnant ainsi au bâtiment sa fonction initiale. Au niveau mezzanine, un centre récréatif municipal a ouvert ses portes aux enfants et aux familles.
Salle de sport Boutiques Ludothèque Marché
Figure 111 : Programme fonctionnel . Source : www.Archdaily.com

Le marché de Secrétan offre un espace polyvalent qui combine plusieurs fonctions et propose une façon différente de moderniser le commerce traditionnel . Avec le vente et l’achat comme fonction principale , le marché représente un espace multifonctionnel qui abrite plusieurs fonctions pour répondre aux besoins des résidents du quartier.
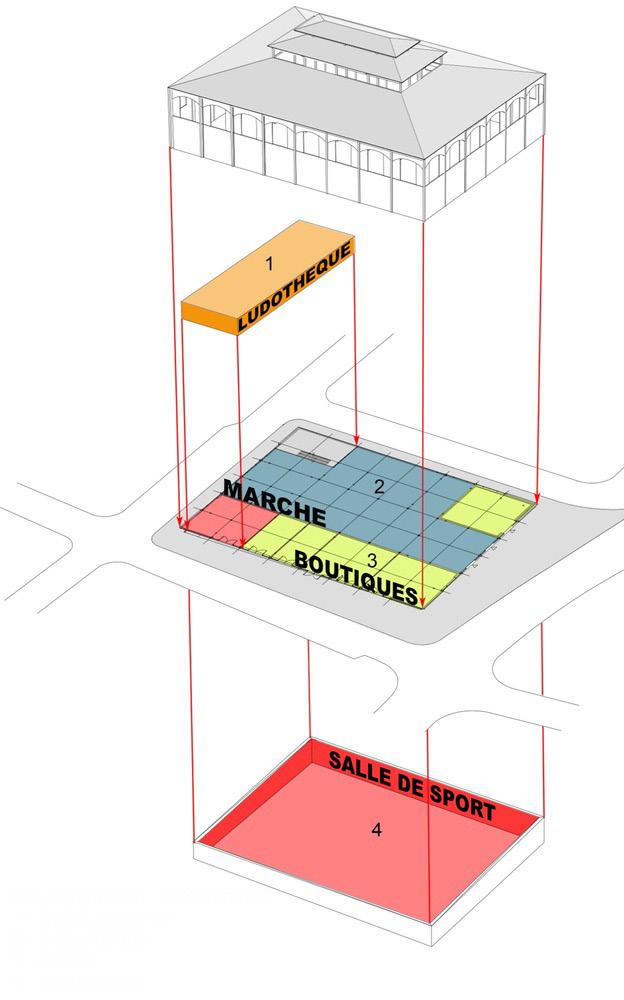
102
IV.1.3. le marché , l'urbanité via une mise en scène Cas du MarketHal , Rotterdam
ARCHITECTES : MVRDV

ANNÉE: 2014
• Implantation
Le Rotterdam Market Hall, le premier marché couvert des PaysBas, est ancré dans le lieu historique de Binnemotte. Le tissu urbain où se situe le marché est contraint par une rivière à partir de laquelle une rue se prolonge pour relier tout le quartier au marché. La proximité du port de pêche est la base du choix du site pour faciliter l'approvisionnement du poisson. À côté du marché se trouve la gare de Blaak et le plus grand marché hebdomadaire en plein air de Rotterdam, situé sur la place en face du marché. Le bâtiment est situé sur la route principale et fait face à l'un des bâtiments les plus populaires de Rotterdam. En fait, nous pouvons dire que le projet a un emplacement stratégique d'importance économique et sociale.
• Choix de la référence
Outre la fonction primordiale du marché de vente et d’achat, le marché représente un espace de plaisir et de détente. Malgré la grandeur d’échelle de marché par rapport au marché central de Tunis , nous avons choisi de l’étudier parce qu'il représente un exemple très précis de l’image d’un marché et d’un lieu de sociabilité abritant un spectacle vivant très riche à travers l’urbanité et la mise en scène existante dans ce marché.
Chapitre IV : Vers un renouveau du marché central via les imaginaires Figure 112 :
Markethall Rotterdam . Source :
www.Archdaily.com
Figure 113 : la situation du marché MarketHall . Source : google earth avec modification personnelle



• le caractère monumental

La conception du marché est monumentale. Il ressemble à une immense porte monumentale vers la ville. Le projet mesure 40 mètres de haut, soit quatre fois la taille des bâtiments environnants. Les immeubles d'appartements combinés aux marchés de produits frais, aux magasins d'alimentation, aux restaurants, aux supermarchés et aux parkings souterrains ne se trouvent nulle part ailleurs dans le monde.
Figure 114 : le marché , un monument dans la ville . Source : www.archdaily.com avec modification personnelle

104
Market Hall tissu historique
le marché hebdomadaire Rivière Rotte La gare de Blaak
Figure 115 : l'intéraction des deux marchés . Source : google earth avec modification personnelle

• le générateur urbain :
MarketHall a une énorme contribution à l'économie urbaine , ce marché a fait une impulsion importante pour son environnement. MarketHall, avec son marché quotidien de produits frais, ses boutiques et ses appartements, crée une connexion dans le quartier qui atteindra une nouvelle centralité.
Une fois le marché terminé, la ville de Rotterdam a commencé à rénover la place pour la rendre plus attrayante même les jours où le marché n'est pas ouvert.
La rénovation comprend lemarché extérieur, avec un accès au marché parfaitement connecté à l'entrée du MarketHall, permettant au public d'entrer et de sortir facilement du bâtiment et de créer des incitations entre les deux marchés, intérieur et extérieur. .
• le caractère ouvert :
Grâce à la continuité visuelle par la transparence des deux façades, le projet n'a plus de barrières physiques. Les architectes sont revenus sur une structure innovante composée de câbles de tension. Cette structure ressemble à la surface d'une raquette de tennis, qui résiste à la flexion afin de rendre ces façades aussi transparentes et légères que possible.
Figure 116 : la transparence . Source : www. archdaily.com avec modification personnelle
Pour garder le volume aussi transparente que possible, une façade en treillis câblé a été choisie, ce qui nécessite peu d'éléments constructifs. Grâce à cette merveille d'ingénierie, l'œuvre d'art intérieure est visible de l'extérieur, sa forme et sa couleur invitant le public à entrer dans le bâtiment.

105 Chapitre IV : Vers un renouveau
via
du marché central
les imaginaires
accées principale
Figure 118 :Plan 1er étage . Source : www.archdaily.com avec modification personnelle

• la mise en scène
La multitude des accessibilités de ce marché met en évidence le concept d'ouverture et de continuité entre le projet et sa zone urbaine, ce qui en fait un noyau attractif qui attire facilement les visiteurs de toutes les directions. Le marché est accessible par ses 4 façades, l'entrée principale : sur deux façades transparentes, et par le passage du milieu à travers les autres façades des restaurants. Ces derniers sont considérés comme des éléments de transition entre l'intérieur et l'extérieur
L'arche du marché forme une place couverte ; son intérieur coloré et son hauteur important font de la halle un spectacle unique. La façade intérieure représente un écran coloré : une fresque colorée contrastée avec la simplicité du volume extérieur en pierre grise. De l'extérieur, cette murale massive invite les gens à essayer de découvrir le spectacle unique du marché.
L'arche du marché forme une place couverte ; son intérieur coloré et son hauteur important font de la halle un spectacle unique. La façade intérieure représente un écran coloré : une fresque colorée contrastante avec la simplicité du volume extérieur en pierre grise. De l'extérieur, cette murale massive invite les gens à essayer de découvrir le spectacle unique du marché
Figure 117 : l'intérieure de la halle du marché . Source : www.archdaily.com avec modification personnelle

106
accées à travers les restaurants
Chapitre IV : Vers un renouveau du marché central via les imaginaires

La halle est composée de 22 stands, qui sont différents les uns aux autres .
Ce qui rend cette halle différente et impressionnante est la mezzanine sur les toits des différents stands.
Ces niveaux de mezzanine sont utilisés comme espaces de potager ou espaces de repos . Cette configuration spatiale nous donne l'opportunité d'assister à la scène du marché tout en profitant de l’espace de repos ou de consommation . la halle du marché de Rotterdam va au-delà de sa fonction économique pour s'inscrire également dans une démarche durable et confirme surtout que le marché est un lieu de sociabilité, de rencontre et d’échange. Figure
119 : les stands dans le marché . Source : www.archdaily.com
IV.1.4. Synthèse
• l’évolutivité au niveau de la fonction









Les marchés aujourd’hui ont connu une certaine métamorphose vers les commerces modernes , y compris le besoin de sociabilité. De nouvelles fonctions qui sont en train de se greffer par rapport à la fonction initiale de vente et d’achat. L'espace commercial évolue en fonction des besoins urbains et spatiaux, les enjeux fonctionnels, et les rapports sociaux qui en découlent, ce qui en fait un lieu hautement social. C'est un symbole de convivialité sociale et aide à développer l'interaction et les liens sociaux. Le marché est un élément essentiel de la ville, a un rôle déterminant dans la dynamique de la ville et est considéré comme le cœur de la vie urbaine. Lieu d'animation commerciale et de mixité fonctionnelle, il favorise la socialisation et l'urbanisation.
Figure 120 : les aspects d'un marché.Source: schéma personnel
Figure 121 : la fonction évolutive des marchés . Source : collage personnel
108
Epiceries Poissoniiers Boucheries charcuteries Fruits et légumes Habitation Espace de repos et de rencontre Espaces potagers des espaces de consommations Parking Fleuristes Boulangerie Ludothèques Salle de sport Boutiques Les fonctions initiales
Les nouvelles fonctions
Le marché
bâtiment

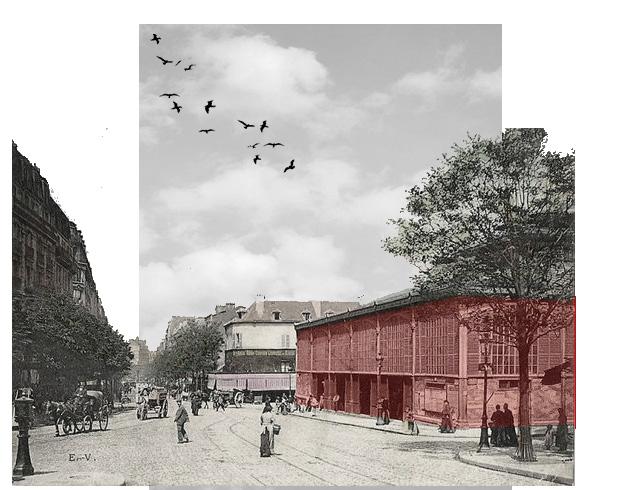

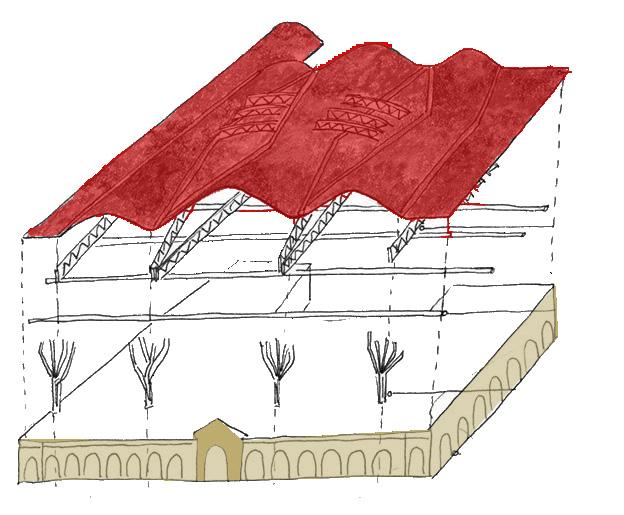
109
Chapitre
IV : Vers un renouveau du
marché central via les imaginaires
• Quand le marché est un support d'ancien
Figure 122 : l'addition sur un bâtiment ancien . Source : schéma personnel
Figure 123 : Le mariage ancien nouveau . Source : schéma personnel
Halles de Secrétan La nouvelle toiture Addition : Conserver l'ancien avec l'addition de nouveaux élèments Différenciation de matériaux entre le nouveau et l'ancien L'ancien enveloppe de l'église: l'ancien bâtiment *Façade entièrement vitrée *Murs rideaux à ossature métalliques *Portes coulissantes Murs maçonnés une rencontre harmonieuse du passé et du présent :le nouveau est au service de l’ancien : Il le met en valeur et le protège
Marché Santa Caterina
IV.2. Projetation des concepts



IV.2.1. La quête de l'imaginaire collectif
La quête de l’imaginaire collectif à travers l'enquête qualitative réalisée sur terrain ( voir la démarche et la synthèse de cette enquête dans le chapitre précédent) sert à mieux comprendre les attentes et besoins des usagers. Les résultats seront interprétés comme des outils aidant à la conception.

le marché des poissons : L'espace catalyseur, il devient l'espace phare du Marché Central
Les enquêtés sollicitent l'intégration de plusieurs espaces de consommation et convivialité
110
Garder la vente saisonnière dans l'élèment central
Figure 124 : Les résultats de l'enquête qualitative . Source : schéma personnel
Les espaces existants
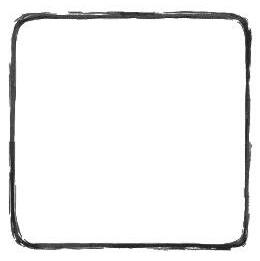
IV.2.2. Le programme fonctionnel
A partir de l'analyse référentielle, et au regard des constats dégagés à travers la lecture socio-spatiale effectuée, nous tentons de définir le programme fonctionnel. L'idée principale est de conserver la fonctionnalité initiale et d'injecter des fonctionnalités supplémentaires pour donner de la polyvalence et mettre à jour ce marché. Cette mixité fonctionnelle vise à renforcer et à valoriser d’avantage le les traditions commerciales au sein du marché central tout en donnant un nouveau regard sur l’appropriation de l’espace.

Le marché central
Injection de nouvelles fonctions
Halle des poissons
Etalage des fruits et des légumes
Aire de décharge
Galerie des volailles et épiceries
Boutiques
Galerie des bouchers
Pépinière Administration


Espaces de consommation
Cafés
Espace de repos
Espace de vente des produits du terroir
Station de dégustations culinaires
Vente des plantes médicinales
Serre verticale Parking
Figure 125 :Le programme fonctionnel . Source : schéma personnel
111
Chapitre IV : Vers un renouveau du marché central via les imaginaires
IV.3. Stratégie d'intervention
Pour aboutir à l’image du projet, nous allons essayer de catégoriser les concepts selon trois objectifs différents : -Des concepts seront liés à la spécificité de la zone d’étude et son potentiel.
- Des concepts seront liés aux résultats tirés de la quête de l’imaginaire collectif .
-Des concepts seront choisis en se basant sur l’analyse des références.
Ces choix conceptuels seront un appui pour le développement de la réponse architecturale.
les concepts et objectifs
1 2 3 4 5 6
une rencontre harmonieuse du passé et du présent :le nouveau est au service de l’ancien : Il le met en valeur et le protège
la signalétique architecturale et le repère dans la ville l’ouverture du marché et sa connexion avec la ville l’aménagement urbain autour du marché la mixité fonctionnelle
l’urbanité par mise en scène : l’espace doit présenter des ambiances diversifiés en terme de d’aménagement et d’organisation fonctionnelle
Figure 126 :Les concepts d'intervention . Source : schéma personnel
IV.3.1. Délimitation de la zone d'intervention
Dans un souci de cohérence, nous avons jugé nécessaire de considérer un aménagement d’ensemble qui intègre le marché central et son environnement immédiat.
Notre intervention est à une échelle urbatecturale: elle concerne essentiellement l'îlot qui intègre le marché avec les quatres voies autour du bâtiment.
112
1 :Marché Central
2 :Rue d'Allemagne
5
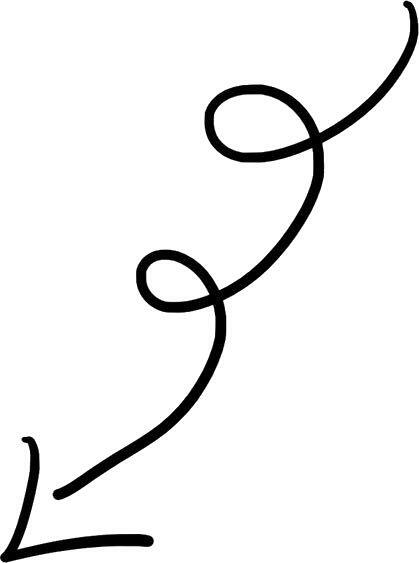
2 3 4
3 : Rue du Danemark
1
4 : Rue Charles de Gaulles
5: Rue d'Espagne
Intervention Urbatecturale
Figure 127 :La zone d'intervention urbatecturale . Source : schéma personnel
IV.3.2. Le plan d'action

• A l'échelle Urbaine 1- Une démarche de piétionnisation

Vu l'hyper saturation de cette zone , il est primordial de la faire congestionner en éliminant le flux véhiculaire et de créer un autre scénario pour l'accès des voitures. Les 2 rues : Rue Charles de gaulles et Rue d’Espagne seront des rues piétonnes avec un élargissement des trottoirs.
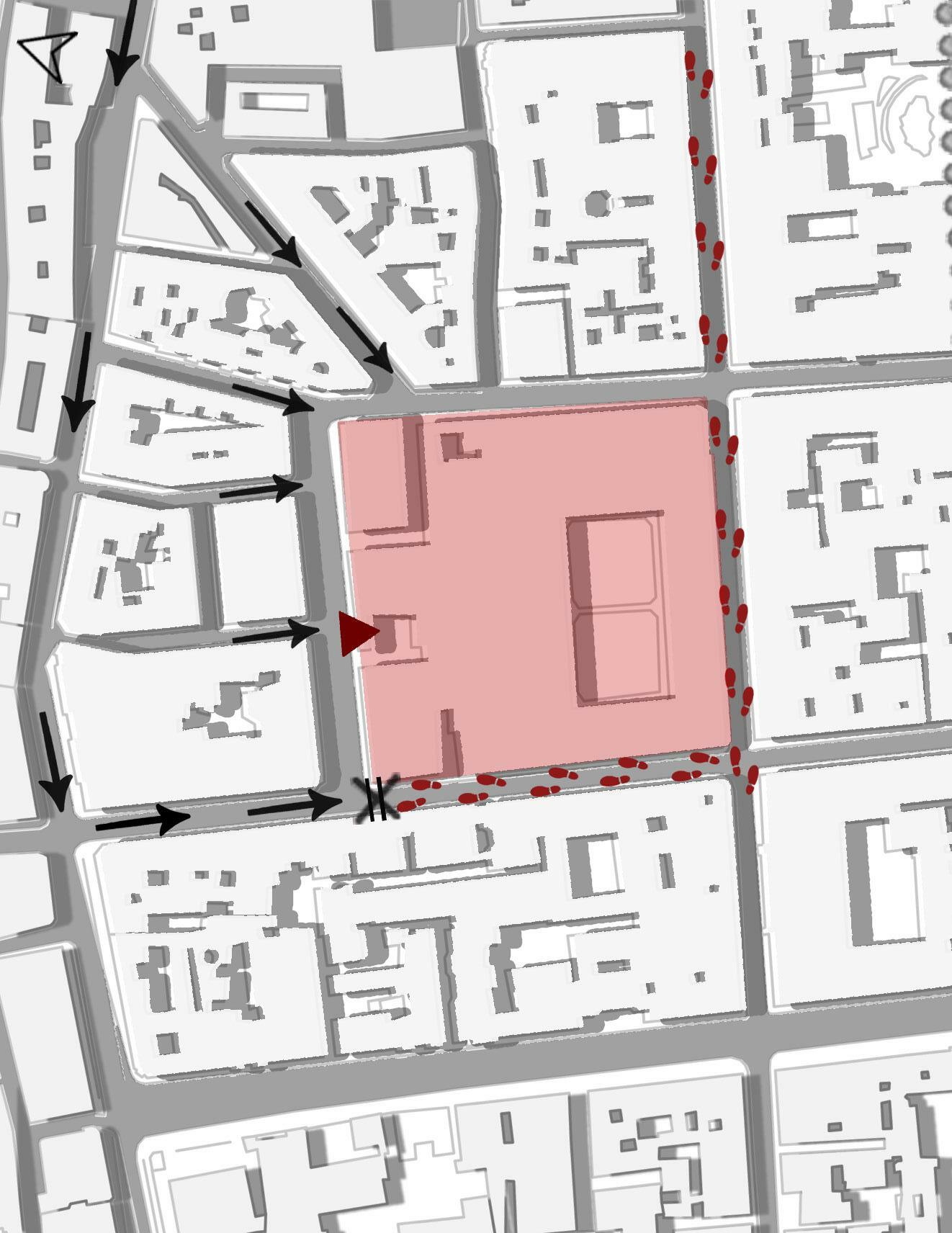
Flux véhiculaire

Flux piéton
Figure 128 :La démarche de piétonnisation . Source : schéma personnel
113 Chapitre IV : Vers
renouveau
via les
un
du marché central
imaginaires
2- Création des abris pour les marchands informels
Rue d'Espagne
Figure 129 :Création des abris pour les marchands informels . Source : schéma personnel Selon le tableau thématique effectué dans l'enquête , l'existence des marchands informels aux alentours du marché central constitue un problème majeur. Il faut donc absorber ce phénomène et construire des abris dans les rues pour abriter ces commerçants . L’organisation de ce type d’activité permettra l'organisation du flux piéton .

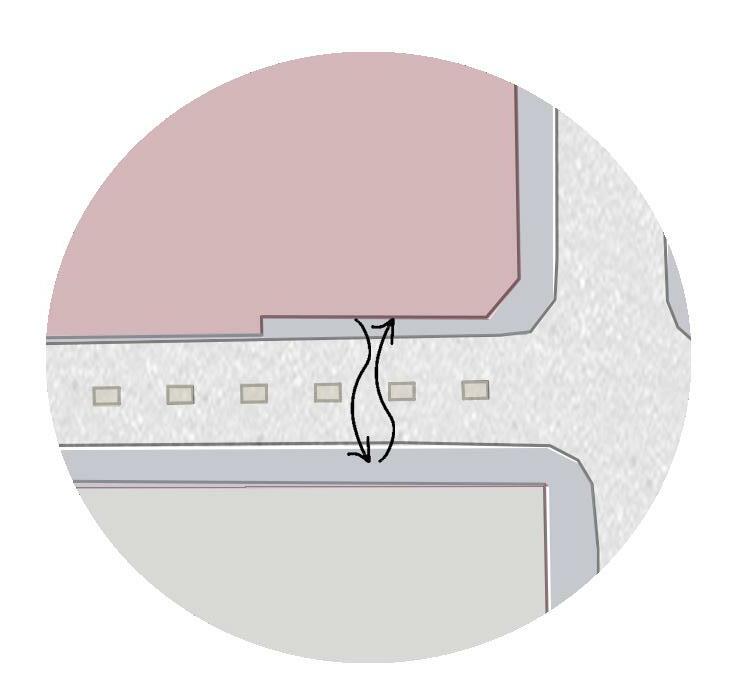

114
Rue Charles de Gaulles
IV : Vers un renouveau du marché central via les imaginaires
• A l'échelle architecturale
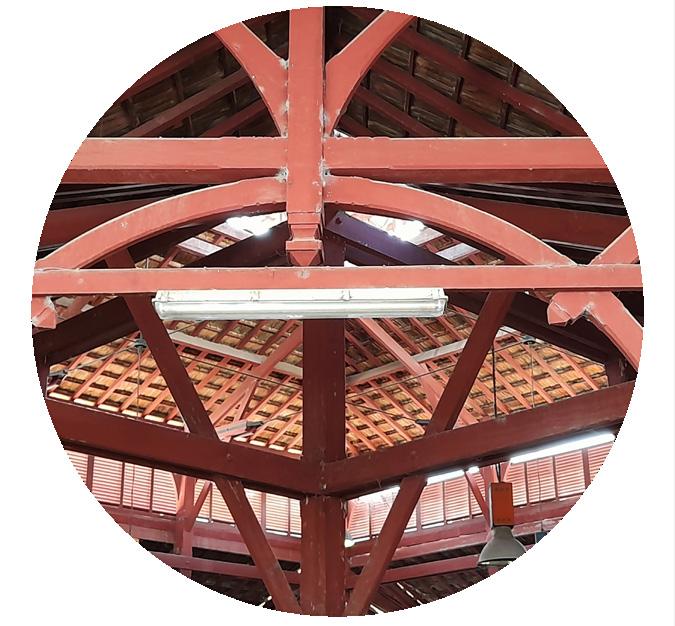
1- les détails architecturaux à conserver
Le marché central de Tunis , qui date de l’époque coloniale, porte un caractère identitaire et ceci grâce aux multiples morpho dynamiques qu’il a subi. Nous avons choisi de conserver ce caractère à travers la conservation des galeries marchandes, les boutiques qui donnent sur la rue et les halles de fruits en charpente. La conservation de ces détails architecturaux sert à garder une trace de l’histoire du marché central qui est fort présent dans la mémoire collective.

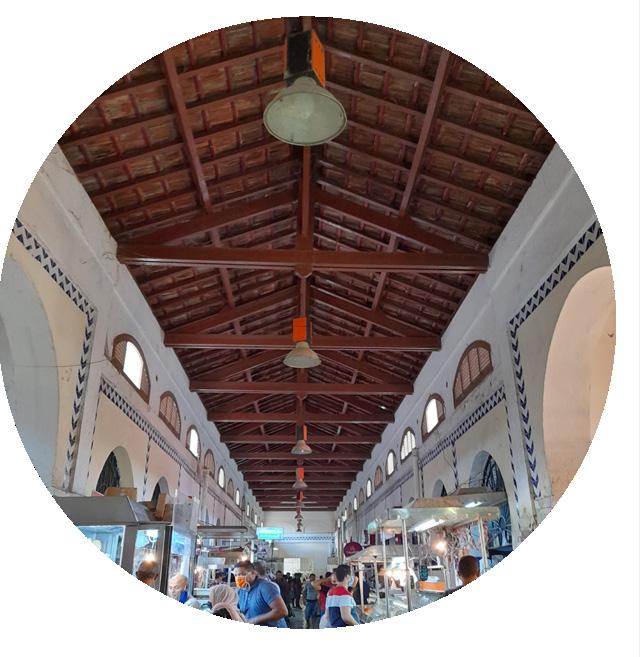
la Halle des fruits
Les galeries marchandes
Les elèments à conserver
Les elèments à changer
Figure 130 :le plan d'intervention . Source : schéma personnel
La structure de la Halle des fruits
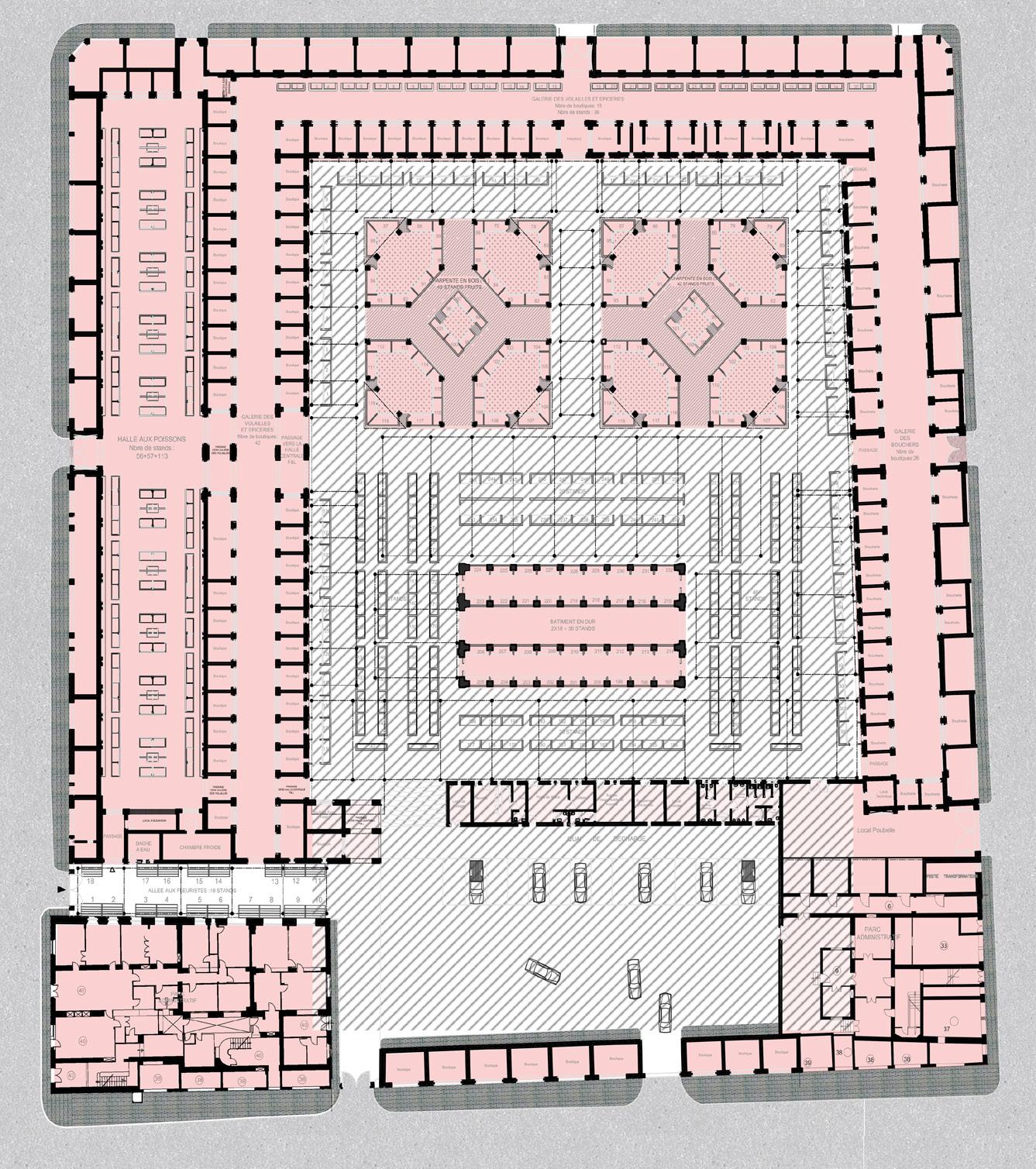
115
Chapitre
Variante 1
2- Penser l'image du projet


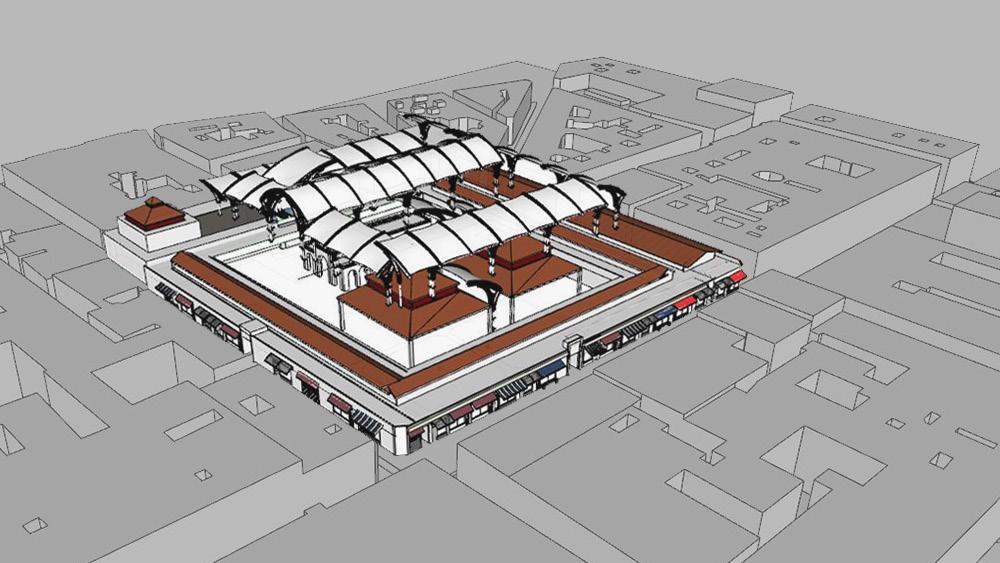
L'état actuel du marché
Enlever la toiture conçue par l’ASM suite aux problèmes remarqués dans l’analyse sur site et par la quête de l’imaginaire collectif.
Ajouter une couverture ondulée en bois , cette toiture va créer un contraste avec l'environnement immédiat du marché. Le bâtiment donc devient un repère urbain.
Limite : la couverture ajoutée est trop imposante par rapport au marché .
Figure 131 :la genèse de la première variante . Source : schéma personnel

116
L'état actuel du marché
Figure 132 :la genèse de la deuxième variante . Source : schéma personnel
Enlever la toiture conçue par l’ASM suite aux problèmes remarqués dans l’analyse sur site et par la quête de l’imaginaire collectif.
Addition d’une toiture avec des ouvertures zénithales .
Ces appuis du lumière vont mettre en valeur les éléments architecturaux conservées.


Ajouter un parking en étage dans le volume qui donne sur la Rue du Danemark
Injection de nouvelles fonctions outre que la commerce dans les volumes imbriqués .
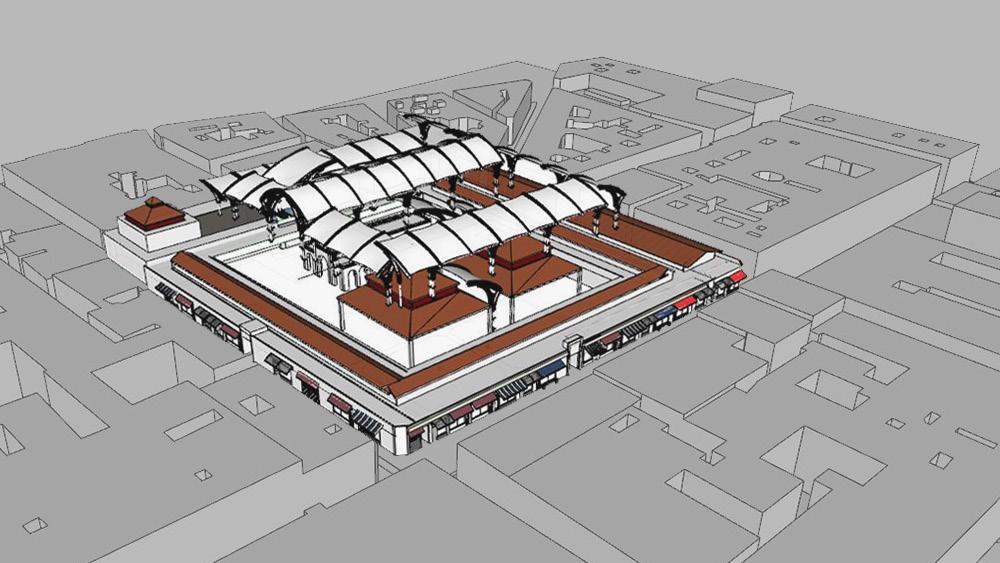

117 Chapitre IV : Vers
renouveau
via les
un
du marché central
imaginaires Variante 2
IV.4. Le projet

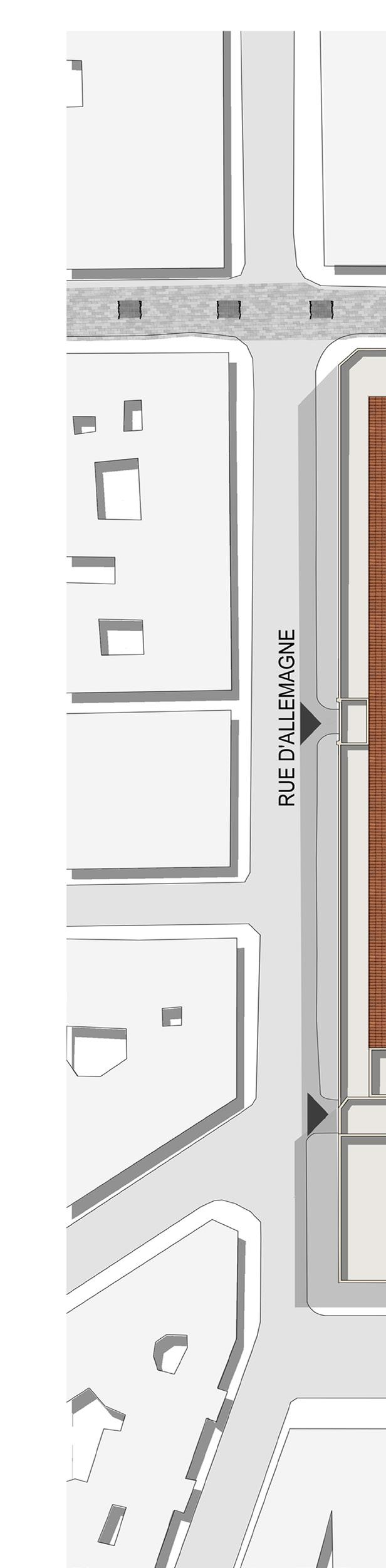
• A l'échelle
Urbaine
Création des abris pour les marchands informels
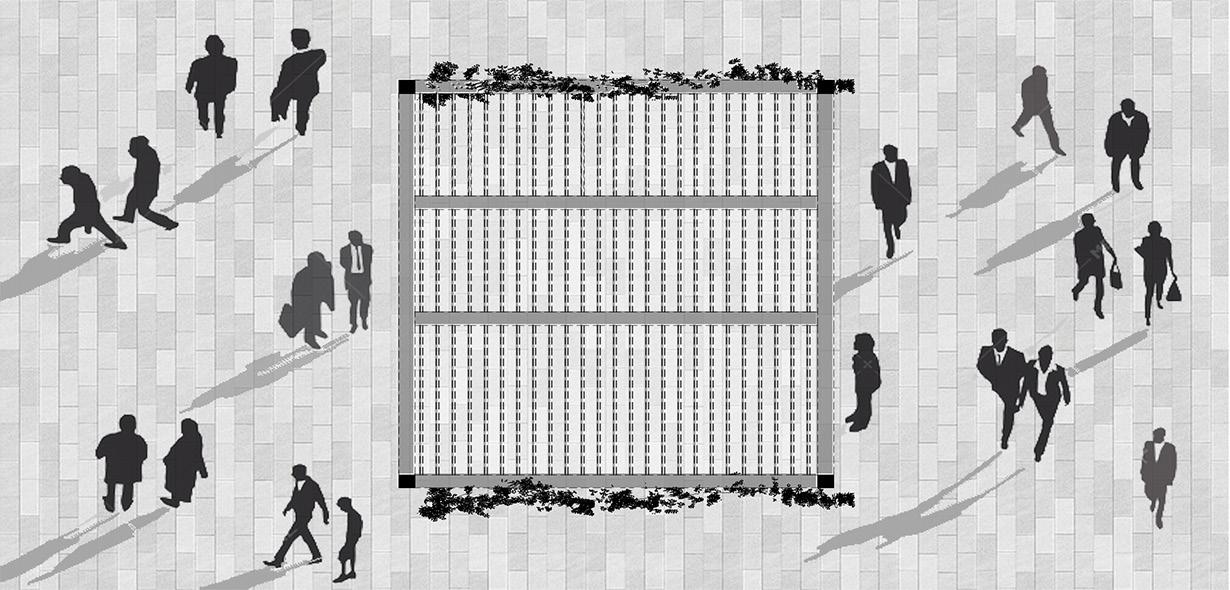
118
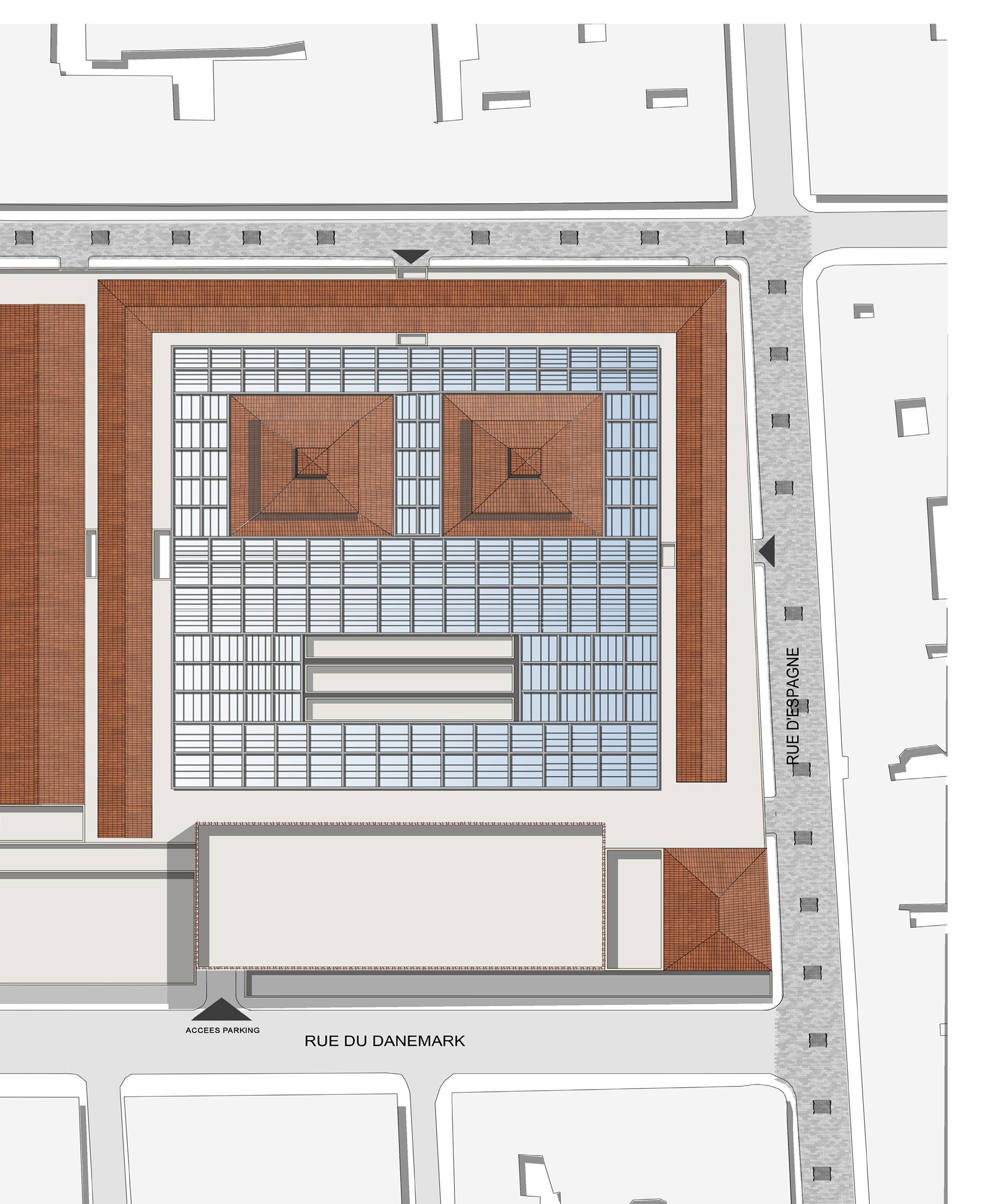

119
PLAN MASSE
Chapitre IV : Vers un renouveau du marché central via les imaginaires
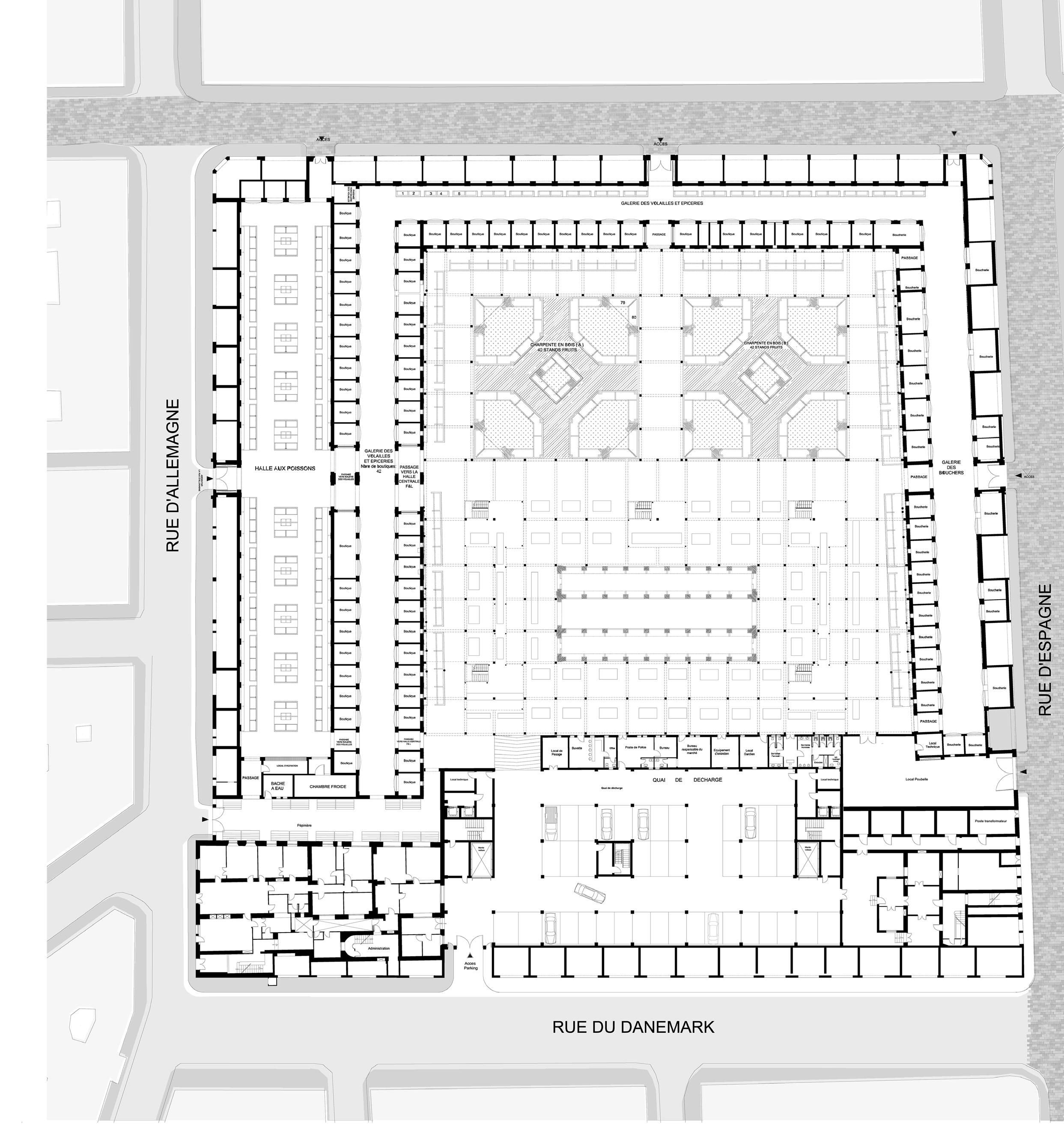
120
PLAN RDC
• A l'échelle architecturale
COUPE A-A
Détails d'un Stand



COUPE B-B FACADE SUR LA RUE CHARLES DE GAULLES
RDC: activité commerçiale
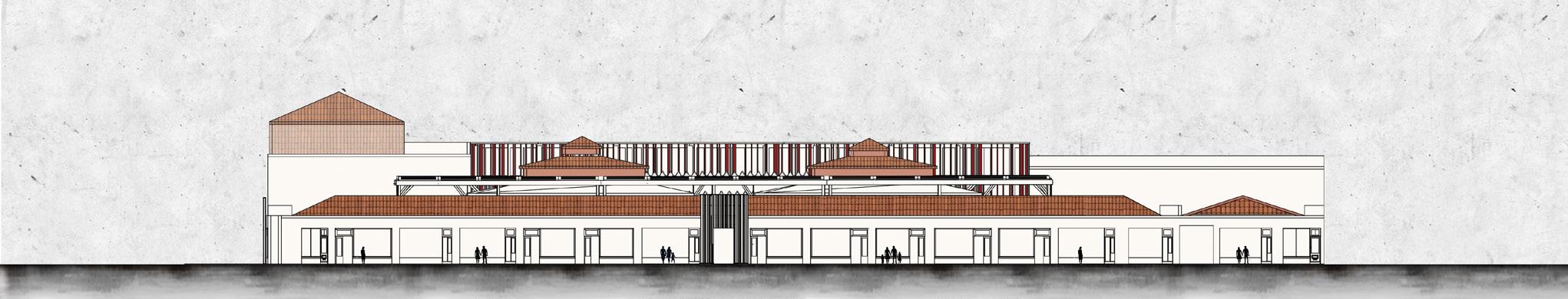
121
Chapitre IV : Vers un renouveau du marché central via les imaginaires
ETAGE: espace de repos/ conommation

Coupe sur un module d'un stand donnant sur la halle des fruits
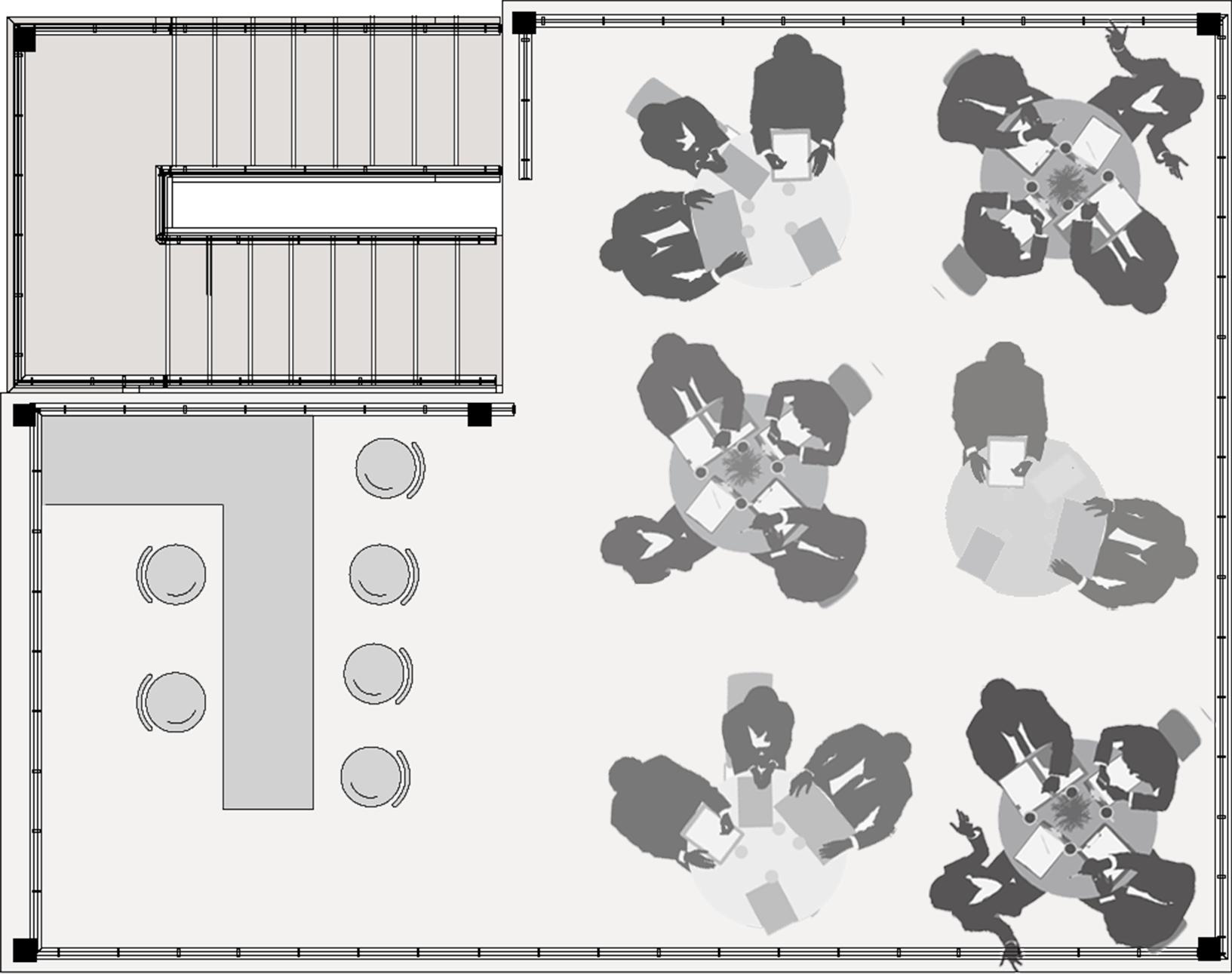
122


123
Chapitre IV : Vers un renouveau du marché central via les imaginaires


124


125
Chapitre IV : Vers un renouveau du marché central via les imaginaires
126
Conclusion générale :
Ce mémoire est une réflexion sur comment agir sur un bâtiment existant via les imaginaires et orienter les regards vers une approche socio-spatiale dans l’intervention architecturale.
Le marché central de Tunis est un espace commercial très présent dans la mémoire collective. La métamorphose que le marché a subi au fil du temps constitue sa richesse architecturale , sociale et économique.
Afin de creuser dans la mémoire collective et de comprendre les pratiques sociales de cet espace, la quête de l’imaginaire collectif à travers une enquête qualitative est un outil opératoire.
Suite aux diverses mutations socio-urbaines relatives à son contexte immédiat,des dysfonctionnements se sont produits à plusieurs niveaux. Nous avons opté pour faire le renouveau du marché suivant une traduction des représentations de l’imaginaire en des configurations spatiales.
D'où , élaborer un nouveau regard sur l’appropriation de l’espace. Cette intervention permet non seulement de donner une nouvelle âme au marché, mais de redynamiser la zone urbaine également.
127 Chapitre IV : Vers un
via les
renouveau du marché central
imaginaires
Annexes
Le parking projeté par l'ASM
Le plan du marché
128
bibliographie
Ouvrages consultés
Jean-Jacques Wunenburger,L'imaginaire, 2003
L’enfant, la maison et l’école, amel Hammami Montassar, Tunis 2018
Karim ben Yedder, Le Foundouk al-ghalla de Tunis : marché central (18911956), Paris 2016
Kevin Lynch ,L’image de la cité , 1998
Mémoires et thèses
Laurence Lemouzy, L’imaginaire dans l’action publique territoriale, Université Paris-Panthéon 2017.
Cyrine Hamouda, le marché central de Monastir Espace conçu vc espace vécu, ENAU 2019.
Emna Ammar, le métissage dans l’architecture arabisante, le marché central de Sfax, ENAU 2020.
Sourour Boukattaya,le marché muncipal de Hammem-Lif, un lieu urbain un espace d’échange, ENAU 2021.
Recherche webographique
Maycène Gorai, Souk Erbaa Jerba: Un lieu holistique, ENAU 2020. https://www.webdo.tn/2017/11/02/coeur-vieux-tunis-europeen-entre-avenuede-france-rue-ditalie/ http://www.misk.art/lire/jules-ferry-gambetta-avenue-de-londres-que-sontdevenues-les-vieilles-rues-de-tunis/ https://www.frac-centre.fr/collection-art-architecture/friedman-yona/villespatiale/ https://fr.wikipedia.org/wiki/Perception/Perception_de_l'espace/ https://fr.wikiarquitectura.com/marche-santa-catarina/ https://www.archdaily.com//secretan-covered-market-architecture-patrick/ https://archello.com/project/markthal-rotterdam https://www.cairn.info/l-imaginaire-/ https://www.amc-archi.com/article/yona-friedman/ https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/oeuvre/ https://www.cairn.info/l-imaginaire-collectif/ https://journals.openedition.org/norois/
129 Les
de
imaginaires pour un renouveau du Marché Central
Tunis
table des figures
Figure1: le marché central... Ce fut un effet . Source : Collage personnel.....................................10
Figure2: l'imaginaire , un outil opératoire . Source : Collage personnel.................................16
Figure3 : les facultés de connaissance d' Aristote . Source : auteur.............................................18
Figure 4 : l'imagination à partir de l'esprit. Source : auteur...........................................................18
Figure 5 : l’imagination entre connaissance et sensibilité . Source : collage personnel............19
Figure 6 : La différence entre l'imagination et l'imaginaire. Source : Schéma Personnel..........20
Figure 7 : Les formes de l'imaginaire. Source : Collage Personnel..............................................21
Figure 8 : la philosophie Bachelardienne ,source : Schéma personnel................................22
Figure 9 : L’imaginaire, un ensemble d’images hétéroclites. ,source : Collage personnel ..22
Figure10: L’imaginaire, un ensemble de productions mentales. Source:Schéma personnel...................................................... ......23
Figure 11:l’Homme , la fabrique de l’imaginaire Source:Collage personnel ...........................24
Figure 12 : Du concret à l’imaginaire Source : Schéma personnel.............................................24
Figure 13 :L’imaginaire personnel, un réservoir d’images. Source :Collage personnel...........25
Figure 14 : La présence de l'Homme via l'imaginaire. Source : Schéma personnel...................26
Figure 15 : La ville spatiale . Source :www.centrepompidou.fr............................................26
Figure 16 : Image d'étude de la ville spatiale . Source : www.centrepompidou.fr....................27
Figure 17 : Dessin : Encre et collage sur papier . Source : www.centrepompidou.fr..............27
Figure 18 : Maquette de la ville spatiale . Source : www.centrepompidou.f..................................27
Figure 19 : L'imaginaire collectif . Source : schéma personnel...................................................28
Figure 20 : L'imaginaire, un arrière plan de la société . Source : schéma personnel.................29
Figure 21 : Interaction espace-individu . Source : schéma personnel.........................................30
Figure 22 : les strates histpriques du marché , source : collage personnel....................................32
Figure 23 : Quelques exemples des représentations spatiales . Source : https://journals.
openedition.org..................................................................................................................33
Figure 24 : les strates histpriques du marché , source : collage personnel....................................34
Figure 25 : l’évolution de la ville de Tunis , source : webo.tn interprété par auteur.....................36
Figure 26 : la situation du marché central. Source: schéma personnel.......................................37
Figure 27 : les rues pendant la colonisation . source : photos :Archive nationale de Tunis (ANT) avec un collage personnel...................................................................................................37
Figure 28 : Quelques étapes de la transformation du marché central à travers le temps. Source : photos:Archive nationale de Tunis (ANT) avec un collage personnel....................................38
Figure 29 :Prolongement de la Rue d'Allemagne source : auteur..............................................39
Figure 30 :La création de la Rue du Danemark source : auteur....................................................39
Figure31:La transformation des rues avoisinantes du marché ; source : auteur.......................39
Figure 32 :Fondouk El-ghalla , source : collage personnel........................................................40
130
Les imaginaires pour un renouveau du Marché Central de Tunis
Figure 33 :le marché central à l’époque coloniale ,source :cartepostale.com.........................42
Figure 34 :Marché aux poissons à l’époque coloniale ,source : www.picclick.fr.....................43
Figure 35 :la cour du marché 1869 ,source : www.picclick.fr..............................................43
Figure 36 :Vue aérienne du marché central à l’époque coloniale.Source: www.picclick.fr..43
Figure 37 :l'intérieur du marché ,source : www.picclick.fr...................................................44
Figure 38 :Marché aux légumes ,source : www.picclick.fr..................................................44
Figure 39 :Une ambiance dans le marché ,source : www.picclick.fr...................................44
Figure 40 :la réhabilitation du Marché Central par l'ASM ,source : Schéma personnel...........47
Figure 41 :Axe de synthèse ,Source : schéma personnel.........................................................48
Figure 42 :la présence du marché dans l'imaginaire collectif ,Source : schéma personnel...49
Figure 43 :une scène dans le marché central ,source : collage personnel..................................50
Figure 44 : Entre le concept et le contexte. Source : schéma personnel......................................52
Figure 45 : Protocole d'analyse contextuelle. Source : schéma personnel................................53
Figure 46 :Figure : Situation et délimitation du périmètre d'étude .Source :PAU.....................54
Figure 47 : Les voiries . Source : schéma personnel.................................................................57
Figure 48 : Le Flux urbain . Source : schéma personnel.............................................................59
Figure 49 : Le stationnement . Source : schéma personnel.......................................................60
Figure 50 : Rapport plein vide. Source : schéma personnel......................................................61
Figure 51 : Le maillage urbain . Source : schéma personnel......................................................61
Figure 52 : Le perçu urbain . Source : schéma personnel...........................................................63
Figure 53 : Le vécu urbain . Source : schéma personnel............................................................65
Figure 54 : Accessibilité du Marché Central . Source : schéma personnel..................................66
Figure 55 : la fluidité du Marché Central . Source : schéma personnel.........................................67
Figure 56 : le plan du marché central ; échelle : 1/500 . Source : ASM..............................69
Figure 57 :Façade extérieure Rue Charles de Gaulles ; échelle : 1/500 . Source : ASM avec modification personnelle....................................................................................................70
Figure 58 :Façade extérieure Rue d'Espagne ; échelle : 1/500 . Source : ASM avec modification personnelle........................................................................................................................70
Figure 59 :Façade extérieure Rue d'Allemagne ; échelle : 1/500 . Source : ASM avec modification personnelle....................................................................................................70
Figure 60 :Façade extérieure Rue de Danemark ; échelle : 1/500 . Source :ASM avec modification personnelle.....................................................................................................................70
Figure 61 :le processus de l'enquête Source : schéma personnel............................................74
Figure 62 : Tableau des commerçants enquêtés . Source : schéma personnel..........................75
Figure 63 : Tableau des commerçants enquêtés . Source : schéma personnel..........................76
Figure 64 : Carte mentale du commerçant E1 . Source : schéma personnel................................76
Figure 65 : Carte mentale du commerçant E2 . Source : schéma personnel...........................77
Figure 66 : Carte mentale du commerçant E3 . Source : schéma personnel ..........................77
Figure 67 : Carte mentale du commerçant E4 . Source : schéma personnel................................78
131
Figure 68 : Carte mentale du commerçant E5 . Source : schéma personnel................................78
Figure 69 : Carte mentale du commerçant E6 . Source : schéma personnel................................79
Figure 70 : Carte mentale du commerçant E7 . Source : schéma personnel................................79
Figure 71 : Carte mentale du visiteur E8 . Source : schéma personnel........................................80
Figure 72 : Carte mentale du visiteur E9 . Source : schéma personnel........................................80
Figure 73 : Carte mentale du visiteur E10 . Source : schéma personnel......................................80
Figure 74 : Les cinq éléments types de la carte mentale : schéma personnel.............................81
Figure 75 : Le volume central . Source : schéma personnel.......................................................82
Figure 76 : La porte d'entrée , un repère. Source : schéma personnel.........................................83
Figure 77 : Le marché des poissons , un repère. Source : schéma personnel.............................83
Figure 78 : Les stands , une limite . Source : schéma personnel..................................................84
Figure 79 : La limite des stands dans les champs visuels des enquêtés . Source : schéma personnel...................................................... .....85
Figure 80 : Le parcours dans le marché . Source : schéma personnel.........................................85
Figure 81 : L'objectif de la carte mentale . Source : schéma personnel........................................86
Figure 82 : Schéma de synthèse . Source : schéma personnel..................................................87
Figure 83 : Stand du citron . Source : prise personnelle.............................................................87
Figure 84 : Les fréquences des thèmes . Source : Tableau personnel........................................89
Figure 85 : Les dimensions de l'espace . Source : schéma personnel........................................90
Figure 86 : Les sous thèmes de la dimension concrète . Source : schéma personnel..............90
Figure 87 : Les dimensions de l'espace . Source : schéma personnel........................................90
Figure 88 : Les sous thèmes de la dimension abstraite. Source : schéma personnel..............91
Figure 89 : Les sous thèmes de la dimension sociale. Source : schéma personnel.................91
Figure 90 : La classification des thèmes . Source : schéma personnel........................................92
Figure 91 : Classification des thèmes . Source : schéma personnel...........................................92
Figure 92 : Confrontation des deux techniques . Source : tableau personnel.............................93
Figure 93 : Situation du marché Santa Caterina . Source : Pinterest..........................................96
Figure 94 : l'évolution du marché Santa Caterina . Source : www.fr.wikiarquitectura.com..97
Figure 95 : Vue aérienne du marché.Source:www.fr.wikiarquitectura.com avec modification....................................................................................................................97
Figure 96 : La toiture du marché . Source : www. fr.wikiarquitectura.com..........................98
Figure 97 : Le dialogue ancien nouveau . Source : www.fr.wikiarquitectura.com...................98
Figure 98: La structure du marché Santa Caterina . Source :www.fr.wikiarquitectura.com ......................................................................................................................................98
Figure 99 : La façade du marché . Source : www.fr.wikiarquitectura.com avec modification..................................................................................................................99
Figure 100 : Le dispatching fonctionnel du marché Santa Caterina . Source : www. fr.wikiarquitectura.com....................................................................................................100
132
Les imaginaires pour un renouveau du Marché Central de Tunis
Figure 101 : L'espace muséal . Source : www.google.com...............................................101
Figure 102 : L'aménagement intérieur . Source : google.com...........................................101
Figure 103 : L'intérieur du marché . Source :www. Archdaily.com.....................................102
Figure 104 : Les halles de Secrétan . Source : www.Archdaily.com..................................102
Figure105:l'ouverture sur la rue.Source : www.Archdaily.com avec modification personelle......................................................................................................................103
Figure 106 : Programme fonctionnel . Source : www.Archdaily.com.................................104
Figure 107 : Markethall Rotterdam . Source : www.Archdaily.com....................................105
Figure 108 : la situation du marché MarketHall . Source : google earth avec modifi cation personnelle.......................................................................................................................106
Figure 109 : le marché , un monument dans la ville . Source : www.archdaily.com avec modifi cation personnelle..................................................................................................106
Figure 110 : l'interaction des deux marchés . Source : google earth avec modifi cation personnelle.......................................................................................................................107
Figure 111:la transparence . Source : www. archdaily.com avec modification personnelle.....................................................................................................................107
Figure 112 : l'intérieure de la halle du marché . Source : www.archdaily.com avec modifi cation personnelle....................................................................................................................108
Figure 113 :Plan 1er étage . Source : www.archdaily.com avec modification personnelle .........108
Figure 114 : les stands dans le marché . Source : www.archdaily.com..............................109
Figure 115 : les aspects d'un marché.Source: schéma personnel............................................110
Figure 116 : la fonction évolutive des marchés . Source : collage personnel...............................110
Figure 117 : l'addition sur un bâtiment ancien . Source : schéma personnel................................111
Figure 118 : Le mariage ancien nouveau . Source : schéma personnel......................................111
Figure 119 : Les résultats de l'enquête qualitative . Source : schéma personnel.......................112
Figure 120:Le programme fonctionnel . Source : schéma personnel.......................................113
Figure 121 :Les concepts d'intervention . Source : schéma personnel.....................................114
Figure 122 :La zone d'intervention urbatecturale . Source : schéma personnel........................115
Figure 123 :La démarche de piétonnisation . Source : schéma personnel.................................115
Figure 124 :Création des abris pour les marchands informels .Source:schéma personnel..........................................................................................................................116
Figure 125 :le plan d'intervention . Source : schéma personnel................................................117
Figure 126 :la genèse de la première variante . Source : schéma personnel...............................118
Figure 127 :la genèse de la deuxième variante . Source : schéma personnel.............................119
Figure 128 :Esquisse de la façade Rue Charles de gaulles . Source : schéma personnel.....120
Figure 129 :les stands . Source : schéma personnel...............................................................120
133
Chapitre I :l'imaginaire , un concept opératoire Introduction .....................................................................................................................................17
I.1 L'imaginaire,une constrcution transdisciplinaire....................................................................................18 I.1.1 L'imagination....................................................................................................................................18 -L'imagination:une faculté de connaissance................................................................................18 -Le schématisme: pratique d'imagination....................................................................................19 I.1.2 De l'imagination à l'imaginaire.........................................................................................................20 -L'imaginaire:un ensemble d'images...........................................................................................22 -Les fonctions et les valeurs de l'imaginaire................................................................................23 I.2 L'imaginaire,une source de création...................................................................................................24 I.2.1 L'imaginaire indivduel.....................................................................................................................24 -L'homme, la fabrique des imaginaires........................................................................................24 -L'imaginaire,sourde de création architecturale....... .....26 -La ville imaginaire................................................................................................................26 I.2.2 L'imaginaire collecitf........................................................................................................................28 -L'imaginaire collectif , une doxa..................................................................................................28 I.3 L'imaginaire et les représentations spatiales.......................................................................................................30 I.3.1 La représentation comme un processus........................................................................................30 I.3.2 Les cartes mentales.......................................................................................................................32 - Etude d'exemple..........................................................................................................................32 Conslusion..................................................................................................................................................33
Chapitre II :la morpho-dynamique du marché central Introduction........................................................ .............35
II.1 La mutation au coeur de centre ville de Tunis..................................................................................36 II.1.1 Naissance de la ville européenne..........................................................................................................36 - Tunis, la capitale coloniale...........................................................................................................36 - Le marché central de Tunis,une interface....................................................................................37
134
table de matières Dédicaces...................................................... .....................v Remerciements.................................................. ................vi Résumé......................................................... ....................vii Sommaire....................................................... ...................8 Introduction générale........................................................................................................................10 1- Contexte et motivation ...................................................................................................11 2- Problématique................................................................................................................12 3- Méthodologie...................................................................................................................14
III.1.2 L'environnement immédiat du marché central.............................................................................38
II.2 De la marge de la médina vers le centre ville ..................................................................................40
II.2.1 Pourquoi le nom du "Foundouk-al-ghalla".........................................................................................40 II.2.2 L'emplacement du "Foundouk-al-ghalla"..............................................................................................41 - A l'époque précoloniale...............................................................................................................41 - A l'époque coloniale.....................................................................................................................42 II.3 Foundouk al-ghalla : une nouvelle ère..............................................................................................44 II.3.1 Le nouveau siège du Foundouk.............................................................................................................44 II.3.2 Réhabilitation du marché central par l'ASM........................................................................................45 Conslusion..................................................... ..............................49
135
Les imaginaires pour un renouveau du Marché Central de Tunis
-
-La
urbaine........................................................................................................58 -Stationnement....................................................................................................................60 -L'insertion urbaine..............................................................................................................61 -Le
urbain...................................................................................................................62 -Le
urbain.......................................................................................................................64
-Les
graphiques....................................................................................................68 -L'organisation
-
strcuturelle..........................................................................................................70 -Limites
problèmes............................................................................................................71
collectif...................................................................................................72 -L'enquête
situ..................................................................................................................72 -Population enquêtée...........................................................................................................73
Les cartes mentales............................................................................................................74 -Les représentations spatiales.............................................................................................74 -Interprétation
analyse......................................................................................................79 1- Les repères...............................................................................................................80 i)Le volume central....................................................................................................80
Chapitre III :le marché central,des imaginaires Introduction...................................................................................................................................51 III.1. Construction d'un protocole d'analyse..........................................................................................52 III.1.1 L'imaginaire collectif,quels perspectifs?...............................................................................52 III.1.2 L'imaginaire,une boîte à outils conceptuels............................................................................53 III.2. Le marché central,un vécu.......................................................................................................54 III.2.1 A l'échelle urbaine.................................................................................................................54 - Délimitation du périmètre d'étude......................................................................................54
Voiries................................................................................................................................56
dynamique
perçu
vécu
III.2.2 A l'échelle du bâtiment.........................................................................................................66
élèments
fonctionelle...................................................................................................69
La mixité
et
III.3. La quête des imaginaires.......................................................................................................72 III.3.1 Interroger l'imaginaire
in
III.3.2
et
ii)La porte d'entrée....................................................................................80 iii) Le marché des poissons.......................................................................81 2- Les limites......................................................................................................82 3- Les intinéraires...................................................................................................83 -Synthèse.................................................................................................................84
III.3.3 Les entretiens semi-directifs.................................................................................85 - Tableau thématique................................................................................................86 - Analyse thématique des entretiens.........................................................................88 -Classification des thèmes.......................................................................................90 Conclusion.......................................................................................................................91
Chapitre IV: Vers un renouveau du marché via l'imaginaire Introduction....................................................................................................................................93
IV.1. L'espace commercial,autrement............................................................................................94 IV.1.1 le marché,l'îcone de la ville......................................................................................................94 -Garder en mémoire le passé tout en réintégrant le lieu dans l'avenir...................................95 - Intégration urbaine...............................................................................................................97 - Au delà du commerçe..........................................................................................................98 IV.1.2 Le marché,l'hybride fonctionnel.......................................................................................100 -L'ouverture sur la rue..........................................................................................................102 -La polyvalence du marché..................................................................................................102 IV.1.3 Le marché,l'urbanité via une mise en scène....................................................................103 -Le caractère monumental..................................................................................................104 -Le génèrateur urbain..........................................................................................................105 -Le caractère ouvert............................................................................................................105 -La mise en scène...............................................................................................................106 IV.1.4 Synthèse...........................................................................................................................108
IV.2. Projetation des concepts.....................................................................................................110 IV.2.1 La quête de l'imaginaire collectif.......................................................................................110 IV.2.2 Le programme fonctionnel..................................................................................................111 IV.3 Stratégie d'intervention........................................................................................................112 IV.3.1 Délimitation de la zone d'intervention...............................................................................112 IV.3.2 Le plan d'action................................................................................................................113 - A l'échelle urbaine..............................................................................................................113 - A l'échelle architecturale.....................................................................................................115 Conslusion générale..................................................................................................................119
136
Les imaginaires pour un renouveau du Marché Central de Tunis
Annexe.........................................................................................................................120
Bibliographie.................................................. .121
Table des figures.............................................................................................................122
Table de matières..........................................................................................................126
137
138

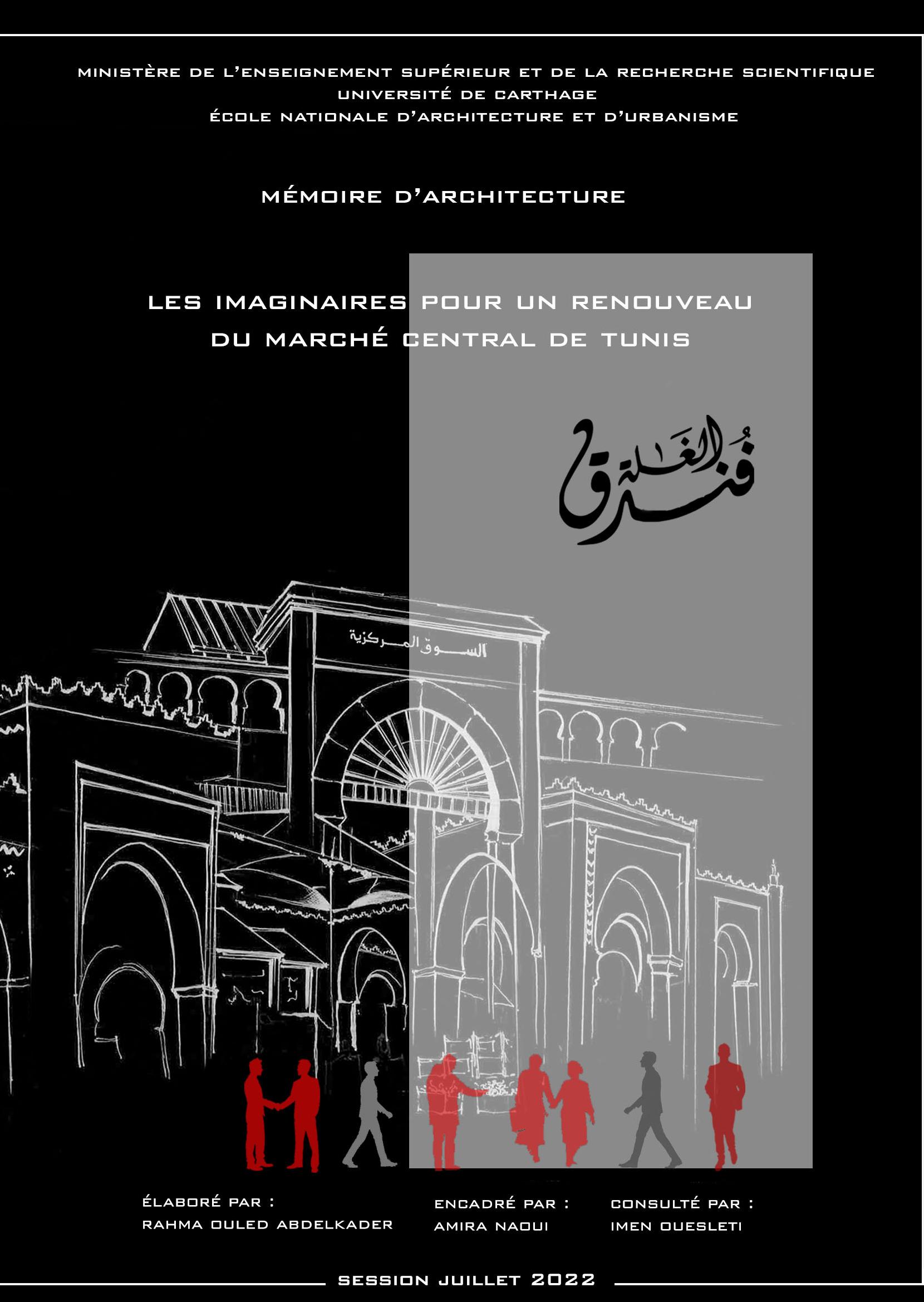










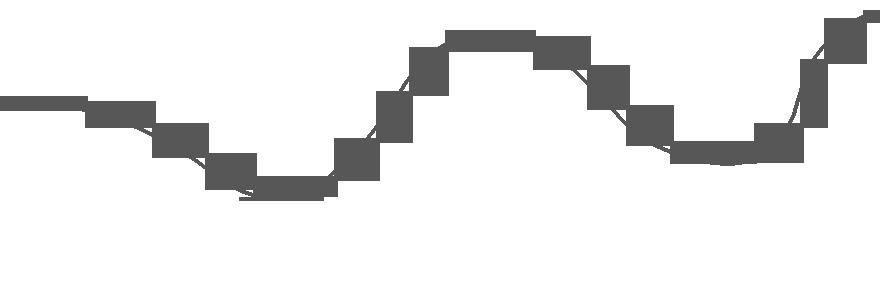


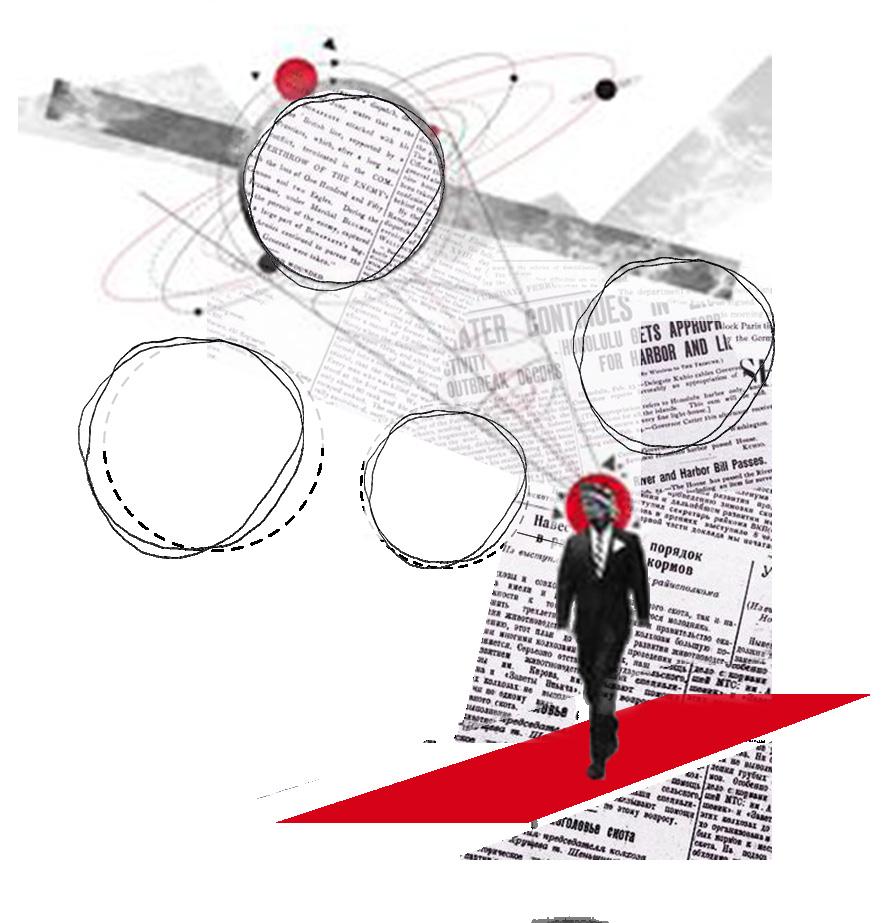
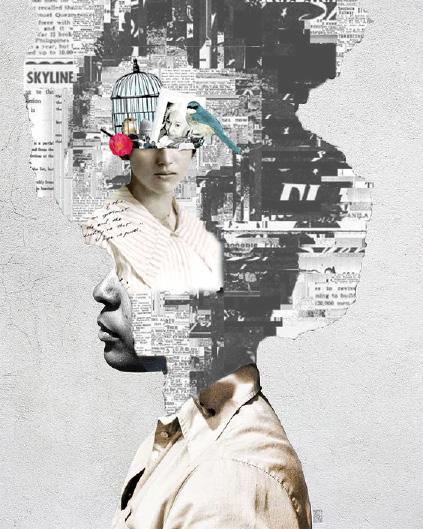




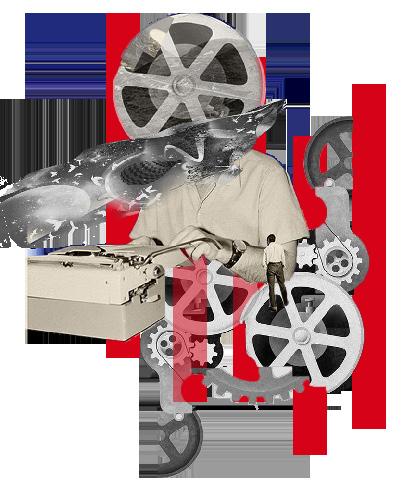
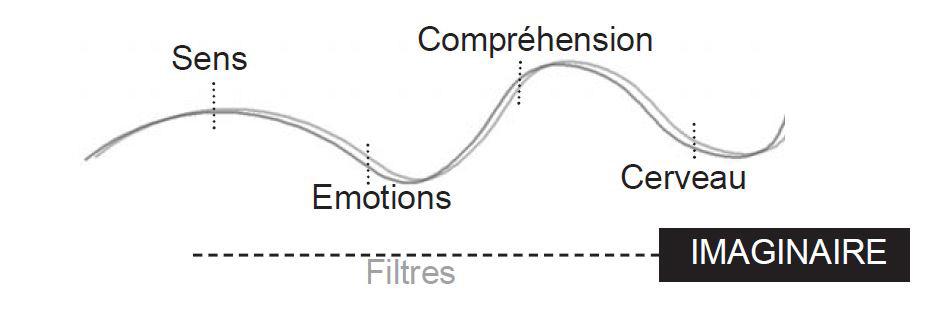
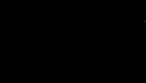
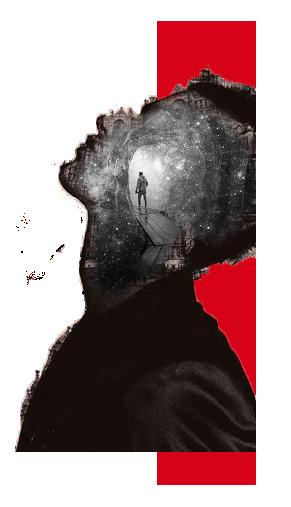





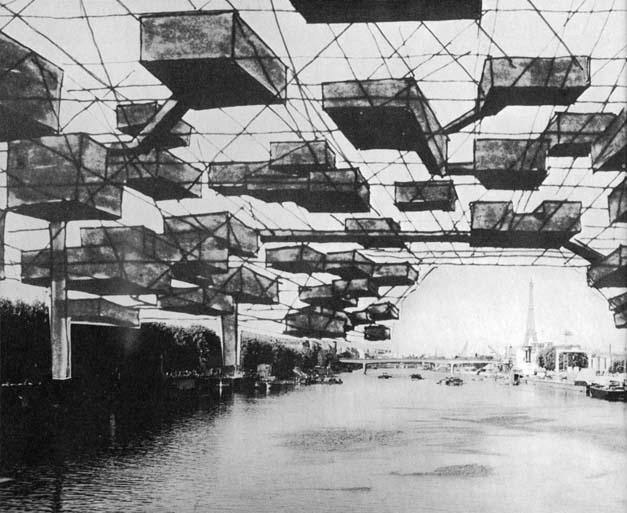
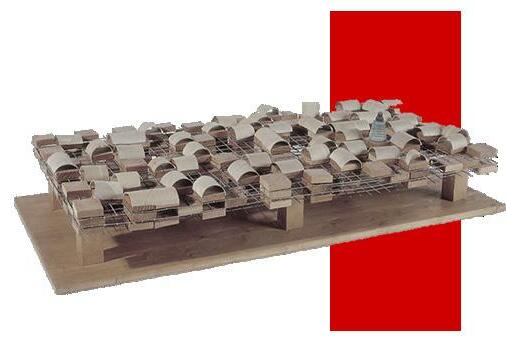
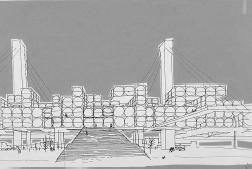
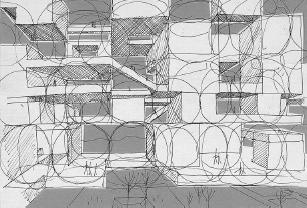





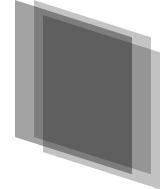







 Figure 24 : les strates histpriques du marché , source : collage personnel
Figure 24 : les strates histpriques du marché , source : collage personnel
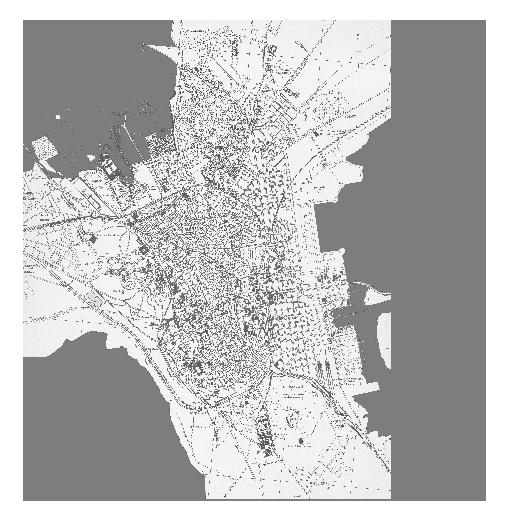















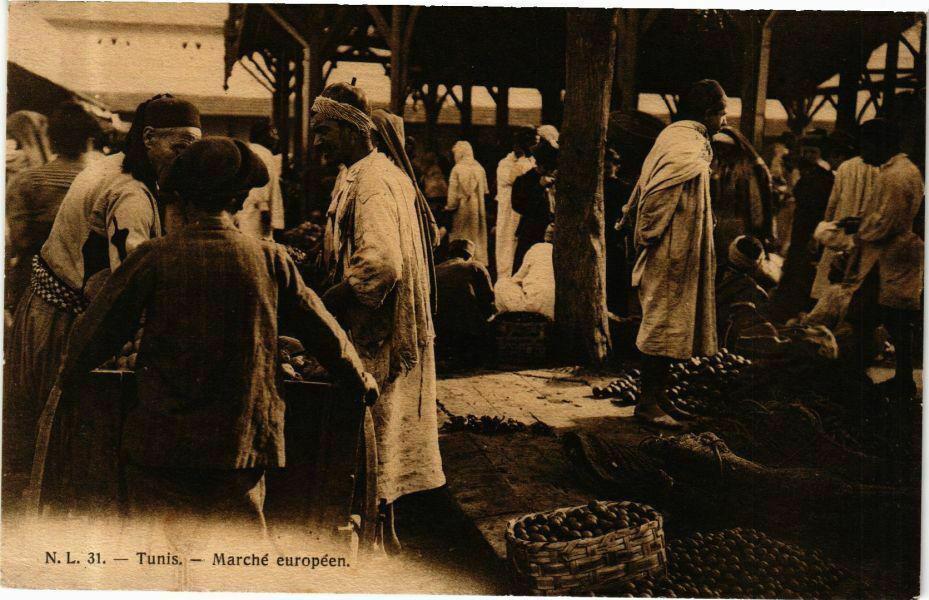

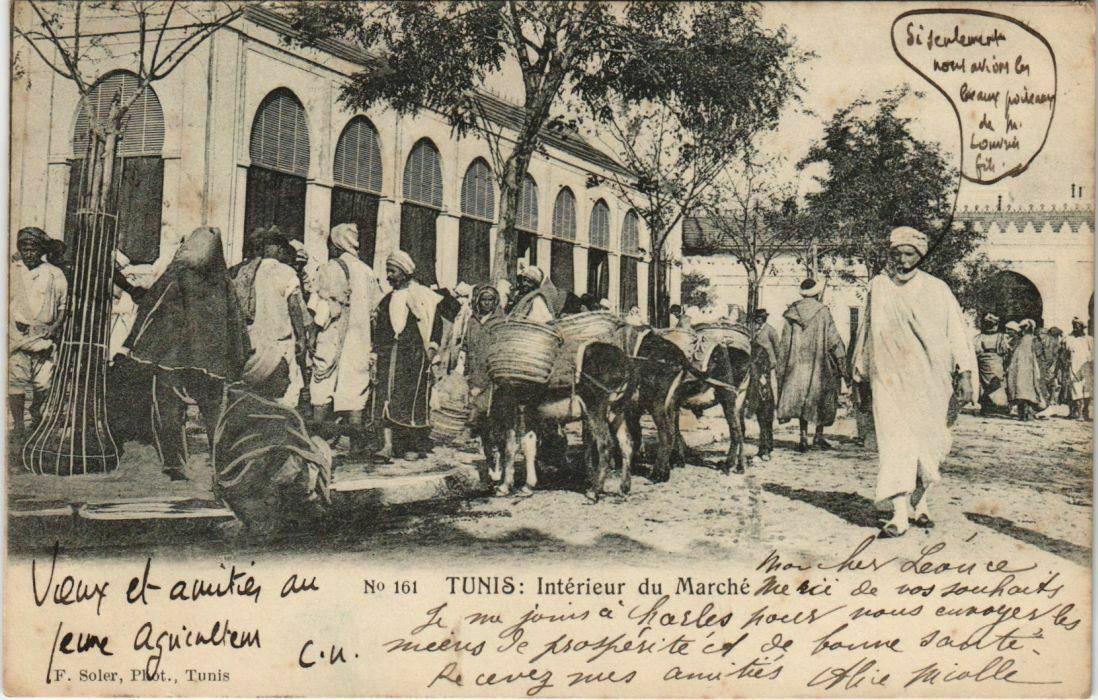









 Figure 41 :Axe de synthèse ,Source : schéma personnel
Figure 41 :Axe de synthèse ,Source : schéma personnel


 Figure 43 :une scéne dans le marché central ,source : collage personnel
Figure 43 :une scéne dans le marché central ,source : collage personnel