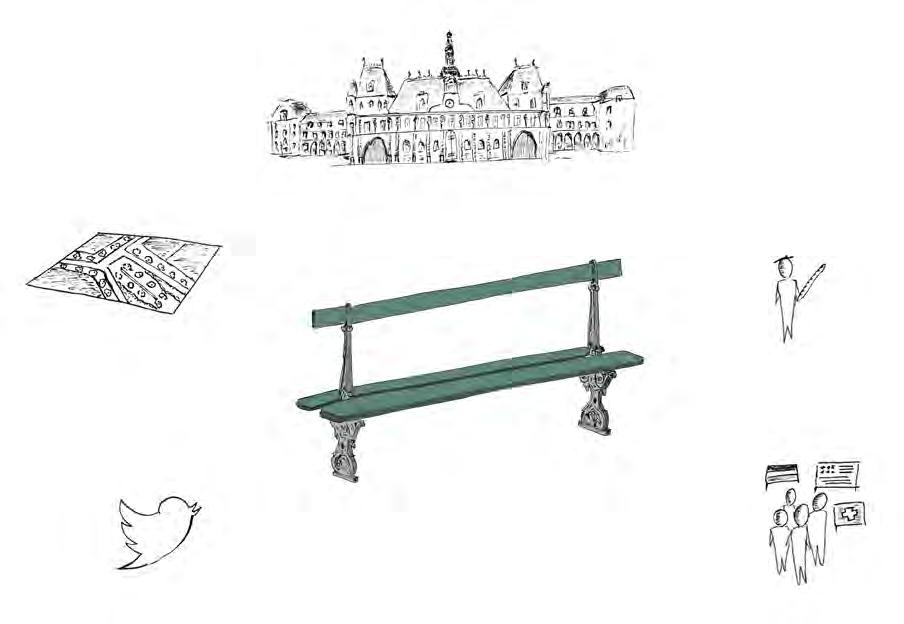
9 minute read
Introduction
Le banc parisien a fait l’objet d’une médiatisation depuis quelques années par son choix et par son insertion dans l’espace public en fonction du modèle. Il semble être le prétexte pour certains de s’attaquer à la politique d’urbanisme parisienne. Nous avons pu le constater depuis déjà quelques années par les vives réactions des membres du collectif #saccageparis1 sur Twitter. Sous couvert de pseudonymes, les internautes s’expriment le plus souvent de façon virulente. Cela contribue à une certaine émulation qui tend à amplifier des phénomènes que toute ville connait au quotidien avec les aléas des travaux et des mésusages.
L’événement qui a provoqué le plus grand émoi auprès de #saccageparis a été le constat des dégradations des bancs en bois dits bancs « mikado » installés depuis 2013 sur la place de la République. Ces bancs ont initialement été dessinés dans le cadre de l’opération « Paris Plages », cette même année. Leurs indignations face au changement laissent apparaître une volonté de figer dans le temps le mobilier urbain historique du Second Empire. Parmi ce mobilier, nous distinguons le banc vert parisien. Le modèle original a été conçu par l’architecte Gabriel Davioud (1824-1881) dans la deuxième partie du XIXème siècle sous l’égide de Georges-Eugène Haussmann alors préfet de Paris.
Les arts ont promu le banc Davioud comme un élément distinctif de la capitale. Ses représentations aussi bien dans la peinture de la fin du XIXème siècle et du début du XXème siècle, par le simple fait de sa présence, évoque Paris dans l’imaginaire de tout un chacun. A cette époque, la ville est un spectacle. Les peintures l’associent le plus souvent à d’autres éléments de mobilier urbain que sont la colonne Morris, les clôtures et les grilles d’arbres. En outre, la photographie de scènes de vie autour du banc Davioud, par l’appropriation de son usage participe à développer cet imaginaire. A ce propos, le domaine de la chanson n’a pas manqué de reprendre cette vie quotidienne où la ville de l’amour s’exprime. On le retrouve dans la chanson Les amoureux des bancs publics de Georges Brassens. Enfin, la riche filmographie offre aux spectateurs depuis des décennies une vision de Paris où le banc joue une place prépondérante. Ce banc vert sapin ne passe pas inaperçu, il devient lui-même un acteur aux côtés des artistes, un élément incontournable de la Ville Lumière.
Tandis que Haussmann qualifiait le banc d’« accessoire » dans les projets des promenades plantées d’Alphand, nous constatons que 160 ans plus tard il devient l’épicentre d’un enjeu beaucoup plus large que la simple assise. Il ne déchaîne pas des passions uniquement parmi les usagers mais pose aussi des questions sur la politique d’aménagement face à l’évolution des usages de l’espace public et en relation avec les enjeux climatiques. La place de la voiture s’amoindrit au profit des zones piétonnes et des pistes cyclables. Le paysage urbain se transforme, les places deviennent des lieux de promenades et de rencontres où le végétal prend de l’ampleur.
Qu’en est-il alors de l’assise qui devient un élément central au regard des espaces libérés ? Le banc Davioud, témoin du passé, doit-il faire place à une nouvelle interprétation de l’espace public où le banc du Second Empire n’aurait plus sa place ? Entre patrimonialisation et contemporanéité, il convient de s’interroger si le banc Davioud reste un symbole figeant Paris dans l’époque haussmannienne ou alors s’il est moteur d’un nouveau dynamisme assurant un lien entre le passé et le Paris des prochaines décennies.
Anne Hidalgo, maire de Paris depuis 2014, apporte déjà quelques éléments de réponses dans l’avant-propos du Manifeste pour la Beauté où elle écrit que la capitale n’est pas une ville-musée tout en précisant que ces nouveaux paysages vont « se conjuguer » avec le patrimoine parisien2 . Emmanuel Grégoire, son premier adjoint chargé de l’Urbanisme, de l’Architecture, du Grand Paris et des relations avec les arrondissements, reprend cette thématique où il explique comment la ville d’aujourd’hui va pouvoir composer avec cette « grammaire commune » historique pour bâtir la ville de demain3
Pour mieux comprendre la démarche urbanistique actuelle, nous avons souhaité reprendre l’historique liant la Ville de Paris et le banc. Nous nous attarderons sur de nombreux exemples de projets réalisés au fil des mandatures d’Anne Hidalgo (2014-2020 et depuis 2020) dans lesquels le banc Davioud est un élément prépondérant que cela soit par son absence ou par sa présence. Afin de construire notre argumentation, nous avons réalisé neuf entretiens auprès des services techniques et des hautes instances administratives de la Ville de Paris ainsi qu’auprès d’acteurs privés (architectes, paysagistes concepteurs, internautes). En complément, notre arpentage des rues de Paris et des places nous a permis de réaliser des photographies, des croquis et des plans pour étayer notre propos et comprendre les visions de chacun des protagonistes.
Paysagistes/architectes
Réseaux sociaux
Interactions entre acteurs privés et acteurs publics, (© Pierre Médecin).
2 Mairie de Paris, Paris Manifeste pour la Beauté, Paris, Mairie de Paris, 2022, p. 3.
3 Ibid., p. 5.
Parisiens
Touristes
Le panel interrogé apparaît des plus représentatifs avec une diversité d’opinions. Bien que cela soit sans incidence sur le travail de recherche, par souci d’apporter un éclairage supplémentaire, nous avons sollicité également d’autres concepteurs concernés par les aménagements cités dans le présent mémoire afin de recueillir leurs points de vue, leurs visions aussi bien sur leurs projets que plus généralement sur la place du banc Davioud dans l’espace public, ainsi que la relation concepteur/maître d’ouvrage. Malheureusement, ces personnes n’ont pas donné suite à nos demandes.
Les entretiens se sont déroulés soit dans le bureau des intéressés, soit téléphoniquement ou en visioconférence. Dans la suite du mémoire, certains propos seront cités directement depuis la source, d’autres seront reformulés tout en adhérant aussi scrupuleusement que possible au discours des personnes interviewées. Néanmoins, certaines interprétations pourront être faites au regard d’idées sous-jacentes mais également par rapport à la formation et au parcours professionnel de la personne. Quand cela est le cas, dans la mesure du possible, nous l’avons signalé. Nos échanges n’ont pas fait l’objet de demandes de relecture.
Initialement, les entretiens étaient préparés selon une liste de six questions listées en annexe. Nos connaissances s’enrichissant entretien après entretien, de nouvelles questions plus ciblées sont venues améliorer le modèle de recherche prévu à l’origine. Par conséquent, la liste n’est devenue qu’une base de travail et la liste des personnes interrogées s’est enrichie. Entre nos lectures, nos rencontres et nos visites de terrain, il nous est apparu primordial de pouvoir apporter toute l’exactitude requise par rapport aux constats et aux interrogations soulevés.
Les personnes interviewées seront présentées dans cette méthodologie par rapport à leur parcours de formation et à leur poste actuel.
Sarah Ananou, ingénieure de la Ville de Paris (2014) et architecte HMONP (2022) au Service des Aménagements et des Grands Projets (SAGP) de la Direction de la Voirie et des Déplacements (DVD) de la Ville de Paris, en poste à la Mairie de Paris depuis 2019. Entretien réalisé le 20 mars 2023.
Emma Blanc, paysagiste DPLG (2001), Agence Emma Blanc Paysage. Entretien réalisé le 24 février 2023.
Jean-Christophe Choblet, scénographe, urbaniste (1995), au SAGP de la DVD de la Ville de Paris en poste à la Mairie de Paris depuis 2014. Entretien réalisé le 8 mars 2023.
Juliette Floc’h, architecte HMONP (2021) au SAGP de la DVD de la Ville de Paris, en poste à la Mairie de Paris depuis 2019. Entretien réalisé le 20 mars 2013.
Mathieu Gonthier, paysagiste DPLG (2007), Agence Wagon Landscaping. Entretien réalisé le 9 février 2023.
Bernard Landau, architecte DPLG (1974), architecte-voyer honoraire de la Ville de Paris, en poste à la Mairie de Paris entre 1983 et 2014 Entretien réalisé le 3 décembre 2022
Benjamin Le Masson, architecte DPLG (1991), architecte-voyer en chef au SAGP de la DVD de la Ville de Paris, en poste à la Mairie de Paris depuis 1995.
Entretien réalisé le 10 février 2023.
Lily Munson, Normalienne, diplômée de Sciences Politiques, directrice de cabinet adjointe du premier adjoint de Paris en charge de l’urbanisme, de l’architecture, du Grand Paris, des relations avec les arrondissements et de la transformation des politiques publiques, en poste à la Mairie de Paris depuis 2018.
Entretien réalisé le 15 février 2023.
David Rykner, ingénieur agronome (1985) et diplômé de l’École du Louvre (1987), fondateur du site La Tribune de l’Art. Entretien réalisé le 10 février 2023.
Antoine Santiard, architecte EPFL (2001), Agence h2o. Entretien réalisé le 6 mars 2023.
Michèle Zaoui, architecte DESA (1987), conseillère architecture et espace public au Cabinet de la maire de Paris, en poste à la Mairie de Paris depuis 2010.
Entretien réalisé le 13 février 2023.
Les agences n’ayant pas donné suite à nos sollicitations sont :
- Agence Jean-Michel Wilmotte (architecte) : designer du banc des Champs-Élysées
- Agence Franklin Azzi (architecte) : designer du banc Mikado
- Agence TVK (architecte) et l’architecte paysagiste Martha Schwartz : concepteurs de la place de la République
- Coloco : agence de paysagistes concepteurs de la place de la Nation
Au terme des entretiens, des thèmes communs ont été identifiés et seront confortés par l’apport d’un corpus de sources bibliographiques.
Ce travail s’organise en trois parties. Après avoir rappelé l’histoire du banc depuis son origine antique et sa présence initiale dans les jardins, dans un premier temps nous présenterons comment, par le réaménagement des rues de Paris et par la création des promenades au cours des siècles, le mobilier urbain a été installé sur les voies. Puis, nous poursuivrons par l’histoire contemporaine tout en nous appuyant sur le fait que le banc Davioud est devenu un marqueur de la capitale. À ce titre, au regard des discussions avec les personnes interrogées, nous aborderons l’organisation administrative des instances parisiennes depuis les années 1970 dans le choix et la gestion du mobilier urbain appliqué au banc Davioud. Enfin, nous nous attacherons à analyser comment ce banc est intégré à l’espace public à travers de nombreux exemples d’aménagements. Par ce biais, nous envisagerons le rôle du concepteur et sa relation avec la Ville de Paris pour le choix et l’intégration de l’assise où le banc Davioud occupe une place primordiale.




