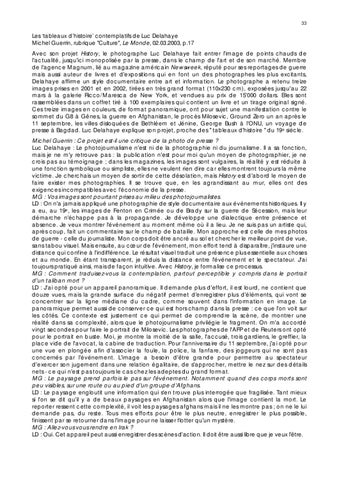33
Les ‘tableaux d’histoire’ contemplatifs de Luc Delahaye Michel Guerrin, rubrique "Culture", Le Monde, 02.03.2003, p.17 Avec son projet History, le photographe Luc Delahaye fait entrer l'image de points chauds de l'actualité, jusqu'ici monopolisée par la presse, dans le champ de l'art et de son marché. Membre de l'agence Magnum, lié au magazine américain Newsweek, réputé pour ses reportages de guerre mais aussi auteur de livres et d'expositions qui en font un des photographes les plus excitants, Delahaye affirme un style documentaire entre art et information. Le photographe a retenu treize images prises en 2001 et en 2002, tirées en très grand format (110x230 cm), exposées jusqu'au 22 mars à la galerie Ricco/Maresca de New York, et vendues au prix de 15'000 dollars. Elles sont rassemblées dans un coffret tiré à 100 exemplaires qui contient un livre et un tirage original signé. Ces treize images en couleurs, de format panoramique, ont pour sujet une manifestation contre le sommet du G8 à Gênes, la guerre en Afghanistan, le procès Milosevic, Ground Zero un an après le 11 septembre, les villes disloquées de Bethléem et Jénine, George Bush à l'ONU, un voyage de presse à Bagdad. Luc Delahaye explique son projet, proche des " tableaux d'histoire " du 19e siècle. Michel Guerrin : Ce projet est-il une critique de la photo de presse ? Luc Delahaye : Le photojournalisme n'est ni de la photographie ni du journalisme. Il a sa fonction, mais je ne m'y retrouve pas : la publication n'est pour moi qu'un moyen de photographier, je ne crois pas au témoignage ; dans les magazines, les images sont vulgaires, la réalité y est réduite à une fonction symbolique ou simpliste, elles ne veulent rien dire car elles montrent toujours la même victime. Je cherchais un moyen de sortir de cette désolation, mais History est d'abord le moyen de faire exister mes photographies. Il se trouve que, en les agrandissant au mur, elles ont des exigences incompatibles avec l'économie de la presse. MG : Vos images sont pourtant prises au milieu des photojournalistes. LD : On n'a jamais appliqué une photographie de style documentaire aux événements historiques. Il y a eu, au 19e, les images de Fenton en Crimée ou de Brady sur la guerre de Sécession, mais leur démarche n'échappe pas à la propagande. Je développe une dialectique entre présence et absence. Je veux montrer l'événement au moment même où il a lieu. Je ne suis pas un artiste qui, après coup, fait un commentaire sur le champ de bataille. Mon approche est celle de mes photos de guerre - celle du journaliste. Mon corps doit être ancré au sol et chercher le meilleur point de vue, sans tabou visuel. Mais ensuite, au cœur de l'événement, mon effort tend à disparaître, j'instaure une distance qui confine à l'indifférence. Le résultat visuel traduit une présence plus essentielle aux choses et au monde. En étant transparent, je réduis la distance entre l'événement et le spectateur. J'ai toujours pratiqué ainsi, mais de façon intuitive. Avec History, je formalise ce processus. MG : Comment traduisez-vous la contemplation, partout perceptible y compris dans le portrait d'un taliban mort ? LD : J'ai opté pour un appareil panoramique. Il demande plus d'effort, il est lourd, ne contient que douze vues, mais la grande surface du négatif permet d'enregistrer plus d'éléments, qui vont se concentrer sur la ligne médiane du cadre, comme souvent dans l'information en image. Le panoramique permet aussi de conserver ce qui est hors champ dans la presse : ce que l'on voit sur les côtés. Ce contexte est justement ce qui permet de comprendre la scène, de montrer une réalité dans sa complexité, alors que le photojournalisme privilégie le fragment. On m'a accordé vingt secondes pour faire le portrait de Milosevic. Les photographes de l'AFP et de Reuters ont opté pour le portrait en buste. Moi, je montre la moitié de la salle, l'accusé, trois gardiens, le greffier, la place vide de l'avocat, la cabine de traduction. Pour l'anniversaire du 11 septembre, j'ai opté pour une vue en plongée afin d'associer la foule, la police, la fanfare, des joggeurs qui ne sont pas concernés par l'événement. L'image a besoin d'être grande pour permettre au spectateur d'exercer son jugement dans une relation égalitaire, de s'approcher, mettre le nez sur des détails nets - ce qui n'est pas toujours le cas chez les adeptes du grand format. MG : Le paysage prend parfois le pas sur l'événement. Notamment quand des corps morts sont peu visibles, sur une route ou au pied d'un groupe d'Afghans. LD : Le paysage engloutit une information qui s'en trouve plus interrogée que fragilisée. Tant mieux si l'on se dit qu'il y a de beaux paysages en Afghanistan alors que l'image contient la mort. Le reporter ressent cette complexité, il voit les paysages afghans mais il ne les montre pas ; on ne le lui demande pas, du reste. Tous mes efforts pour être le plus neutre, enregistrer le plus possible, finissent par se retourner dans l'image pour ne laisser flotter qu'un mystère. MG : Allez-vous vous rendre en Irak ? LD : Oui. Cet appareil peut aussi enregistrer des scènes d'action. Il doit être aussi libre que je veux l'être.