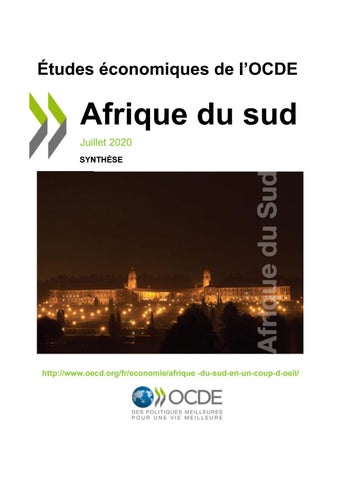2 minute read
Les services communaux de l’eau sont inefficaces
60 |
Les services communaux de l’eau sont inefficaces
Les communes sont chargées de la distribution de l’eau aux ménages et à la plupart des entreprises, ainsi que de l’assainissement. Elles représentent 27 % des prélèvements. Quarante et un pour cent du volume distribué n’est pas facturé, payé ou effectivement livré. Cinquante-six pour cent des stations d’épuration des eaux usées et 44 % des usines de potabilisation sont en mauvais état ou dans un état critique, ce qui contribue à la pollution (Department Water and Sanitation, 2018). Cependant, dans certains cas, les services de l’eau sont excellents. Par exemple, la commune de eThekwini a reçu le Prix international de l’eau de Stockholm en 2014. Atteindre une performance satisfaisante est l’un des principaux objectifs du plan national sur l’eau et l’assainissement.
Les outils d’analyse comparative permettent de mettre en évidence les problèmes d’inefficience et les meilleures pratiques. L’Afrique du Sud en utilise déjà. Cependant, ils portent surtout sur les procédures (collecte de données, par exemple) ou sur les moyens (comme les compétences techniques), et non sur les coûts ou les performances environnementales. Au Royaume-Uni, les entreprises du secteur de l’eau et de l’assainissement fournissent au régulateur économique des indicateurs de coût et d’impact sur l’environnement. Les Indicateurs de performance des compagnies des eaux (IBNet) de la Banque mondiale sont un outil d’analyse comparative à l’échelle internationale qui fournit des repères (OECD, 2011). La mise en place d’un organisme de régulation mériterait peut-être d’être étudiée, pour assurer une régulation plus cohérente et de meilleure qualité des services de l’eau assurés par les communes (OECD, 2013a).
Tableau 1.14. Recommandations passées concernant l’atténuation du changement climatique et la croissance verte
Recommandations des études antérieures
Dans le cadre de la conception des politiques de lutte contre le changement climatique, privilégier des instruments généraux et simples à mettre en œuvre, dont l’impact sur les capacités administratives est limité, tels qu’une taxe carbone simple. Réduire les subventions implicites et explicites à la consommation d’énergie et de charbon, et utiliser d’autres instruments, tels que des prestations monétaires ou des bons d’approvisionnement, pour protéger les pauvres. Les tarifs de l’électricité devraient pouvoir augmenter encore pour couvrir intégralement les coûts d’investissement. Il conviendrait de renégocier les contrats accordant des tarifs favorables aux industriels qui utilisent beaucoup d’électricité. Accélérer l’attribution des permis d’utilisation de l’eau et veiller à ce que les redevances sur l’eau reflètent les coûts d’approvisionnement et la rareté de la ressource. Établir une tarification adéquate des externalités environnementales, notamment les émissions de carbone, et des ressources rares, en particulier l’eau.
Mesures prises depuis l’Étude de juillet 2017
Une taxe carbone a été instaurée en 2019.
Les remboursements du prélèvement sur le gazole dont bénéficie le secteur de l’électricité sont réduits depuis avril 2016. Le budget de 2017 proposait un réexamen de l’exonération de la TVA sur les carburants en consultation avec les parties prenantes. Le NERSA a approuvé une hausse annuelle moyenne des prix de 9.4 % en 2016-17 et de 2.2 % en 2017-18.
La procédure de demande de permis d’utilisation de l’eau a été rationalisée pour accélérer les attributions.
Un prélèvement sur les pneumatiques est mis en œuvre depuis le 1er février 2017, au titre des externalités de l’élimination de ces produits.
ÉTUDES ÉCONOMIQUES DE L’OCDE : AFRIQUE DU SUD 2020 © OCDE 2021