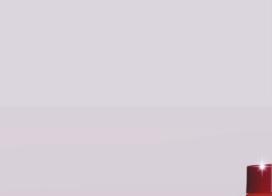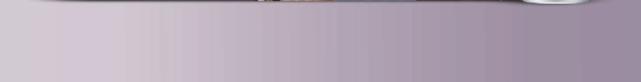16 minute read
Énergie
La nouvelle chance de la géothermie
Cette technique de production d’électricité à partir d’une eau réchauffée à 3000 mètres de profondeur a déjà connu deux échecs, à Bâle et à Saint-Gall. Une troisième tentative a débuté à Lavey-les-Bains (VD).
Texte: Laurent Nicolet
C’ était une sorte de «no man’s land» le long du Rhône, entre les Bains de Lavey et la cascade vertigineuse de la Pissechèvre, où l’on ne risquait guère jusqu’ici de croiser que quelques reptiles et batraciens. Mais les lieux sont désormais plus agités, avec des baraquements et une tour de forage, active depuis janvier dernier, pour le troisième projet de géothermie profonde que connaît la Suisse, après les deux échecs retentissants de Bâle et Saint-Gall, en raison de mini-tremblements de terre (lire entretien p. 27). Le projet de Lavey est piloté par la société anonyme AGEPP SA (Alpine Geothermal Power Production) sous forme de partenariat privé-public, comptant parmi ses actionnaires Cesla, SI-REN, EOS Holding, Holdigaz, Romande Énergie et les communes de LaveyMorcles (VD) et Saint-Maurice (VS).
Levée des oppositions Il faut remonter à 2004 pour en trouver l’origine: «Le but, explique Jean-François Pilet, directeur d’AGEPP, était d’abord de fournir de l’eau aux Bains de Lavey en complément du puits existant. De fil en aiguille, c’est devenu un projet visant à produire de l’électricité.» Quelques oppositions ont fait traîner les choses, d’abord de la part de la société des Bains elle-même qui craignait que l’eau qui lui est fournie soit troublée. «Aujourd’hui toutes les dispositions ont été prises. La probabilité que de la boue arrive jusque dans les Bains est à peu près aussi grande que d’avoir un avion décollant de Bex (VD) qui s’écrase sur la tour de forage.» Opposition également de la part du canton voisin du Valais pour des questions de pérennité de la ressource géothermique intercantonale, aujourd’hui réglées par une convention. À noter qu’il n’y a eu en revanche aucune opposition de la part des organisations environnementales: «Nous avons discuté assez tôt avec elles, explique Jean-Marc Lavanchy, du bureau CSD Ingénieurs, l’hydrogéologue qui conseille le projet, nous avons dû faire des travaux d’aménagement, déplacer les reptiles en reconstituant des habitats. Nous avons dû compenser aussi le défrichement.»
Si tout va bien, de l’électricité pourrait être produite à Lavey dès fin 2023, début 2024.
Risques écartés L’hydrogéologue écarte d’emblée les scénarios catastrophes de Bâle et


Baraquements et tour de forage ont été installés dans une zone déserte le long du Rhône.
Saint-Gall: «Ce sont des environnements et des techniques différents. À Bâle, il fallait fracturer des roches très peu perméables pour créer un échange d’eau. Ici, nous sommes dans un aquifère naturel. L’eau s’est infiltrée progressivement en profondeur jusqu’à 3000 mètres, où la température est d’environ 115 °C et ensuite elle remonte assez rapidement dans la vallée du Rhône. Pas besoin donc de créer une fracturation supplémentaire, on va simplement prélever plus profondément ce qui est déjà prélevé aujourd’hui pour les Bains. C’est une exploitation avec un seul forage, contrairement au concept de Bâle et Saint-Gall, on ne réinjecte pas d’eau, car la qualité de l’eau est suffisante pour être rejetée au Rhône.»
À Saint-Gall, c’est une poche de gaz qui a fini par faire capoter le projet. Un risque que là aussi Jean-Marc Lavanchy écarte: «En principe, on ne doit pas rencontrer de gaz parce qu’on va rester dans le même aquifère hydrothermal que celui qui est exploité actuellement et qui n’en contient pas. Mais la géologie a des incertitudes et le projet est prévu pour tous les cas de figure, y compris la rencontre inopinée de gaz. Nous avons même installé une torchère au bout du chantier.» «Si vraiment on tombait sur une poche de gaz, complète Jean-François Pilet, on aurait la possibilité, par la loi sur les ressources naturelles du sous-sol, de l’exploiter.»

Une première en milieu alpin De l’électricité, en tout cas, pourrait être produite à Lavey dès fin 2023, début 2024. «Nous avons prévu pour le forage d’avancer de 2 mètres par heure pour atteindre une première cible vers 2500 mètres. Là on va effectuer des tests pour savoir si le débit et la température sont suffisants pour la production d’électricité, à savoir 40 litres par seconde et 115 °C. Si ce n’est pas le cas, le forage sera alors approfondi jusqu’à la deuxième cible, à 3000 mètres. Cela va prendre globalement entre 140 et 200 jours.» Ne restera plus alors qu’à construire sur place une centrale qui transformera cette chaleur en électricité.
Il s’agirait d’une première qui pourrait faire des émules, expliquent les deux hommes: «C’est ce qui a intéressé l’Office fédéral de l’énergie (OFEN): il n’y a jamais eu de projet de géothermie profonde en Suisse dans un milieu alpin. Si ce modèle marche, il peut être reproduit dans la vallée, du Rhône, dans la vallée du Rhin ou ailleurs dans les Alpes.» Par ailleurs,

d’autres projets sont sur le point de voir le jour, ressemblant davantage à ceux de Bâle ou Saint-Gall, impliquant pour certains de la fracturation. Notamment un dans le Jura, mais avec une technologie bien plus avancée que celle qui était utilisée à Bâle. «Si cela marche, la société qui pilote ce projet pourrait en développer d’autres, en deux ou trois endroits.» On prospecte également dans les cantons de Genève et Fribourg. Le projet de géothermie profonde qui va démarrer à Vinzel (VD) se rapproche, lui, davantage de celui de Lavey: «Il s’agit aussi d’un projet hydrothermal, explique JeanMarc Lavanchy, avec un aquifère qui coule naturellement, sauf que là-bas, il n’y a pas d’exutoire en surface, l’eau s’écoule sous le lac. Ils vont devoir faire un doublet, à savoir un forage de production et un forage de réinjection, la qualité de l’eau ne permet pas de la rejeter à la surface.» À noter que c’est la foreuse présente à Lavey qui sera utilisée et que le forage débutera dès qu’elle sera libérée.
Schéma d’une centrale géothermique classique. À Lavey, un seul forage est nécessaire.
Alternative au nucléaire Encore balbutiante, la géothermie profonde est évidemment appelée à jouer son rôle dans Stratégie 2050, le projet de transition énergétique de la Confédération après la sortie du nucléaire. «Bien sûr, explique Jean-François Pilet, la stratégie de la Confédération prévoit une production d’électricité à base de géothermie de 4,5 térawattheures, 1000 fois plus théoriquement que ce que nous produirons à Lavey. Mais c’est un prototype qui montrera la faisabilité de tels projets et qui pourrait en entraîner d’autres plus importants.» MM
«Il ne faut pas avoir peur de la géothermie»
Jon Mosar, professeur de géologie à l’Université de Fribourg.
Jon Mosar, qu’est-ce qui distingue la géothermie profonde des autres types de géothermie? Dans la géothermie de surface ou de moyenne profondeur, des échangeurs de chaleur alimentent des maisons individuelles ou de plus grands bâtiments. En moyenne profondeur, l’eau chaude est utilisée, par exemple dans un système de chauffage à distance. On valorise la chaleur en tant que telle. La géothermie profonde va aussi chercher cette ressource qu’est la chaleur, mais surtout pour produire de l’électricité. L’eau doit être à plus de 100 °C, idéalement 120 °C. On peut ainsi utiliser la vapeur d’eau pour produire de l’électricité. On trouve ces températures à partir de 4 ou 5 km de profondeur. Comment cela fonctionne-t-il concrètement? La ressource, c’est la chaleur, et le vecteur qui la transporte, c’est l’eau. Idéalement, comme à Lavey, on trouve de l’eau avec un débit suffisant pour pouvoir créer un échange avec la surface. Malheureusement, ce n’est pas toujours le cas. Il faut alors injecter de l’eau, ce qui en soi n’est pas un problème, mais il faut qu’elle circule en profondeur pour capter la chaleur. S’il n’existe pas déjà de la porosité ou des petites fractures connectées pour que l’eau puisse circuler, on doit alors créer cette fracturation. Soit en faisant de l’hydrofracturation, c’est-à-dire en créant de nouvelles petites fractures par injection d’eau à haute pression. Soit en faisant de la stimulation, en réactivant d’anciennes fractures, ce qui nécessite d’injecter de l’eau avec moins de pression. Pourquoi les deux premiers essais de géothermie profonde à Bâle et SaintGall ont-ils été des échecs? Les deux cas sont un peu différents. À Bâle, on a injecté de l’eau qui a déstabilisé un système de failles préexistant, ce qui a provoqué un petit tremblement de terre de magnitude 3,5. Cela a fait un gros bruit dans la ville. Le projet s’est arrêté, car les gens n’en voulaient plus. À Saint-Gall, le problème a été une arrivée de gaz, qu’il a fallu pallier en injectant de la boue lourde, pour éviter un accident. Cette boue a déstabilisé les failles préexistantes, ce qui a créé un tremblement de terre de magnitude 3,6. La population, là, était d’accord pour la poursuite du projet. Mais après un nouvel essai de pompage, qui a également provoqué des tremblements de terre, les responsables du projet ont préféré renoncer au vu des incertitudes. À vous entendre, on pourrait croire que cette technologie n’est pas vraiment maîtrisée… Non, c’est une fausse idée. Il ne faut pas avoir peur de la géothermie. La technologie n’est pas en cause. Elle est très au point et maîtrisée. Les pétroliers pratiquent depuis plus de soixante ans l’hydrofracturation. Le problème qui peut survenir, c’est par exemple une arrivée de gaz, mais cela se produit lorsque le puits de forage d’accès aux couches géologiques n’a pas été fait avec toutes les précautions nécessaires. En Suisse, le sous-sol appartient à l’État, les lois sont assez strictes, et on ne peut vraiment pas faire ce que l’on veut, donc ce genre de situation est plutôt peu probable. Ce qui s’est passé à Bâle et Saint-Gall, c’est surtout la faute à pas de chance. Quels sont les principaux avantages de cette technologie? C’est de produire de l’électricité en bande passante, c’est-à-dire quand on veut. La ressource est là, il fait chaud sous terre, à raison de 30 °C supplémentaires par kilomètre. Il s’agit juste de bien connaître les structures géologiques présentes dans le sous-sol avant d’entamer le forage – ce que permettent les campagnes sismiques 3D qui fonctionnent un peu comme une échographie du sous-sol. On envoie des ondes qui traversent la roche et on calcule le temps que met une onde à remonter. Ce n’est pas une technique invasive et c’est fait en peu de temps. L’analyse des données permet par la suite de proposer un modèle géologique détaillé.
Le cauchemar des plantes d’intérieur
Si votre ficus, votre yucca ou votre bananier attire une nuée d’hôtes volants, cela n’augure hélas rien de bon. Il est attaqué par des nuisibles, dont l’un des plus fréquents est la sciaride. Et c’est durant l’hiver que ces moucherons sont le plus agressifs.

Texte: Yvette Hettinger
L’air sec dégagé par les radiateurs incite souvent à arroser excessivement les plantes d’intérieur. Or, un terreau constamment humide est un paradis pour les sciarides. Elles vont y déposer leurs œufs et libérer des larves qui vont se nourrir des radicelles.
Identifier l’infestation Lorsqu’une plante ne pousse pas ou très peu, c’est déjà un premier indice de la présence de nuisibles. Si des petites mouches de 1 à 2 mm volettent autour de la plante, la présence de sciarides est quasiment avérée. Les nuées d’insectes s’envolent surtout lorsqu’on arrose la plante ou qu’on manipule son pot. Souvent, les larves sont déjà présentes dans le terreau lorsqu’on détecte l’infestation. Premiers soins Il faut immédiatement mettre la plante attaquée à l’écart des autres végétaux, car les sciarides passent très vite d’un hôte à l’autre. Cesser d’arroser jusqu’à ce que la motte de racines soit sèche. Pour vérifier le niveau d’humidité, plonger un doigt dans le terreau aussi près que possible des racines. Si de la terre humide reste accrochée au doigt, c’est que les racines ne sont pas encore tout à fait sèches. Comme les larves de sciarides aiment les milieux humides, le dessèchement ne pourra que les décimer. Il faut toutefois noter que la plupart des plantes s’accommodent bien d’une sécheresse passagère, mais à vous de vous renseigner pour en être sûr. Insérer des pièges jaunes collants dans le pot. Les moucherons sont attirés par la couleur jaune et y restent collés. Leur cycle de reproduction est ainsi interrompu. Il existe des pièges collants bio et ceux-ci peuvent aussi être utilisés à titre préventif. Protéger les plantes encore saines en les emballant dans un collant. Insérer la plante par le bas dans la jambe du collant et faire un nœud au-dessus du pot. Cette astuce permet de tenir les sciarides à distance durant quelques semaines. Recommandé par des experts
Des ennemis bénéfiques: les acariens ou les nématodes, par exemple, se régalent de sciarides. On peut les commander en ligne. N’ayez crainte, vous ne devrez pas manipuler des asticots. Les acariens sont livrés dans un peu de substrat qu’il faudra verser sur le terreau. Les nématodes sont fournis dans une poudre que vous délayerez dans l’eau d’arrosage. Une solution biologique simple. Autre remède biologique: l’Antisciarides de Migros-Bio Garden. Ce concentré est composé de spores bactériennes et s’utilise également avec l’eau d’arrosage. Les nuisibles absorbent les spores qui s’attaquent à leur intestin et les tuent. Prudence avec les remèdes maison
Huile d’arbre à thé: à proscrire! Elle pourrait endommager les racines. Piquer des allumettes dans le terreau: efficace seulement si leur tête en soufre n’a pas été brûlée. Piquer de l’ail (entier ou haché) à la surface du pot: son efficacité est insignifiante, et il dégage surtout une odeur pénétrante. Saupoudrer du marc de café: cela pourrait avoir une certaine efficacité, mais seulement si le marc est complètement sec, à défaut, des moisissures se développeront.

Les sciarides sont des petites mouches qui pondent leurs larves dans les plantes d’appartement. D’où viennent exactement les sciarides?
En été, les moucherons pénètrent par une fenêtre ouverte afin de s’installer confortablement dans la première plante venue. Ils proviennent d’une autre plante d’intérieur, qui est déjà peut-être en train de dépérir, surveillez-la! Vous avez recyclé un terreau déjà utilisé. Mieux vaut miser sur un terreau pour plantes d’intérieur tout frais. Il arrive parfois que les moucherons parviennent à déposer leurs œufs dans un terreau emballé et stocké pour la vente. En cas de doute, placer le sac de terreau à l’extérieur afin qu’il gèle. Les sciarides meurent au bout de quelques jours de températures négatives. Autre cas de figure: la présence de sciarides dans le pot à l’achat de la plante. Comme les végétaux exposés en magasin se trouvent à proximité des terreaux, ils ont probablement migré de l’un à l’autre.

Autres méthodes
Recouvrir la surface du pot avec du sable siliceux sur environ 1 cm d’épaisseur. Le terreau est ainsi protégé des incursions de sciarides désireuses de déposer leurs œufs. Acheter des plantes carnivores, par exemple, la grassette commune (Pinguicula vulgaris). Son fonctionnement est similaire à celui du piège collant dans la mesure où elle capture les sciarides à l’aide de ses feuilles couvertes d’un duvet collant. Verser du café (dilué avec la même proportion d’eau) dans le pot. La caféine détruit les larves. En cas d’infestation répétée, passer à l’hydroculture et utiliser comme substrat de l’argile expansée ou bien des granulés Seramis. Bon à savoir
Les sciarides sont inoffensives pour l’homme. Si leurs larves peuvent sérieusement endommager votre plante préférée en mangeant ses racines, elle n’en mourra pas pour autant, à moins que la plante soit petite et délicate, par exemple des semis que vous avez plantés. La plupart des substrats sont vendus sans tourbe et c’est tant mieux. Mais n’oublions pas qu’un terreau exempt de tourbe attirera plus les sciarides qu’un terreau qui en contient. On conseillera donc un terreau dit léger (vendu uniquement en magasin, pas en ligne). C’est une bonne alternative au substrat avec tourbe et il entrave le cycle de reproduction des sciarides. MM




Pas toujours facile d’y voir clair parmi la quantité de labels qui existent. Qui connaît exactement la différence entre Demeter et bio? Demeter est le plus ancien label biologique international et repose sur les directives les plus strictes. On le doit à l’anthroposophe Rudolf Steiner qui, dans les années 1920, a été sollicité par des agriculteurs pour des recommandations d’utilisation pratiques. C’est à partir de là que se sont développées les directives pour l’agriculture biodynamique en vigueur aujourd’hui.
L’aspect principal de l’agriculture biodynamique est la notion de cycle. Dans ce processus, le sol joue un rôle central: les êtres humains le renforcent avec des préparations biodynamiques, tandis que les animaux, en particulier les ruminants, contribuent à sa fertilité avec leur fumier. De plus, grâce à la diversité de la rotation des cultures (en plantant des légumineuses par exemple), les végétaux n’épuisent pas le sol.
Priorité est aussi accordée au bien-être des animaux: ils ne sont pas considérés comme de simples animaux de rente qui fournissent du lait, des œufs ou de la viande, mais comme une partie de

Dans les fermes Demeter, les vaches peuvent garder leurs cornes et les monocultures sont évitées grâce à l’assolement varié.
l’organisme de la ferme, dans l’idée du cycle. Chez Demeter, l’élevage respectueux des animaux occupe une place centrale. Des directives strictes garantissent leur intégrité: elles interdisent de couper leurs cornes, leur queue ou leur bec et assurent qu’ils disposent d’un accès régulier à l’extérieur et soient nourris avec une part importante d’aliments produits par la ferme elle-même. Toutes les fermes Demeter suisses respectent aussi la norme Bourgeon bio.
Migros élargit constamment son offre de produits Demeter, et ce, bien au-delà des légumes de saison. On trouve désormais du pain, du lait, des yogourts, des œufs, des boissons et même des aliments pour bébés portant le label Demeter. En Suisse, à la fin 2020, 398 agriculteurs étaient certifiés Demeter pour une surface de plus de 7000 hectares. MM
3 1 2
20%*
*de rabaissur tout l’assortiment Demeter, valable du 1er au 7 mars.
4 5 6
1 Pommes Demeter en vrac, Fr. 5.50 le kg au lieu de Fr. 6.90 2 Pain aux 5 céréales Demeter, 300 g, Fr. 3.15 au lieu Fr. 3.95 3 Cœurs d’artichauts Demeter, 280 g, Fr. 5.40 au lieu de Fr. 6.80 4 Citron Demeter, Fr. -.50 la pièce au lieu de Fr. –.65 5 Tomates en grappe Demeter, 300 g, Fr.2.55 au lieu de Fr. 3.20 6 Œufs Demeter, 53+, 6 pces, Fr. 5.30 au lieu de Fr. 6.65.