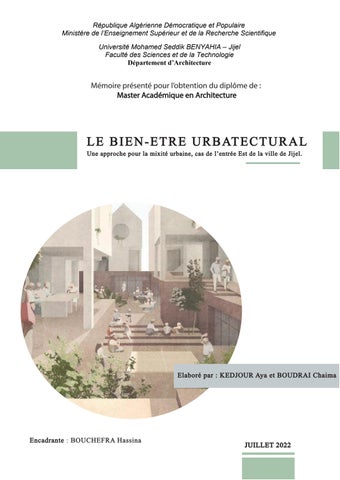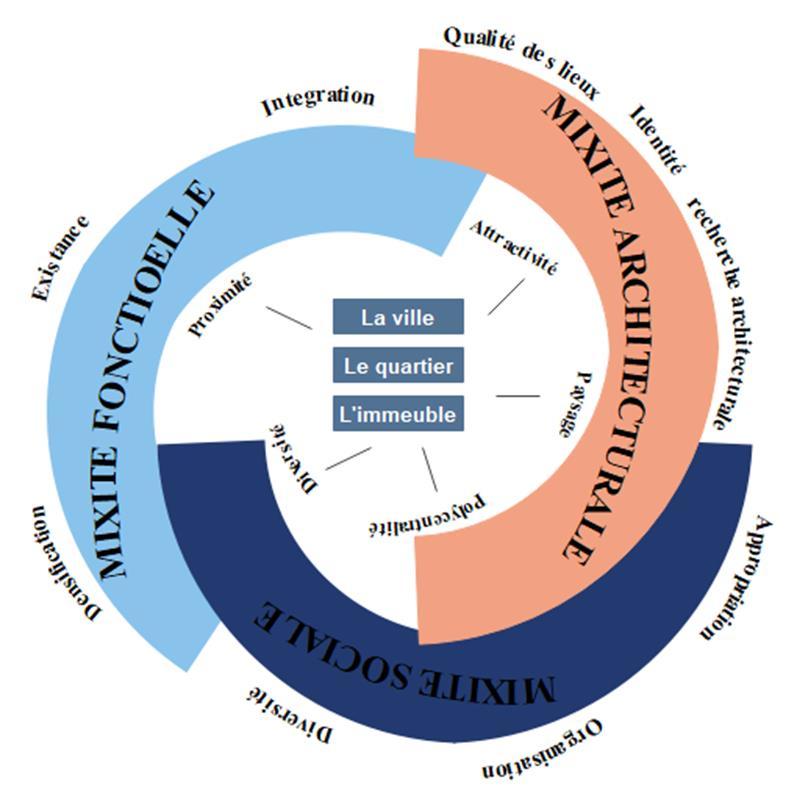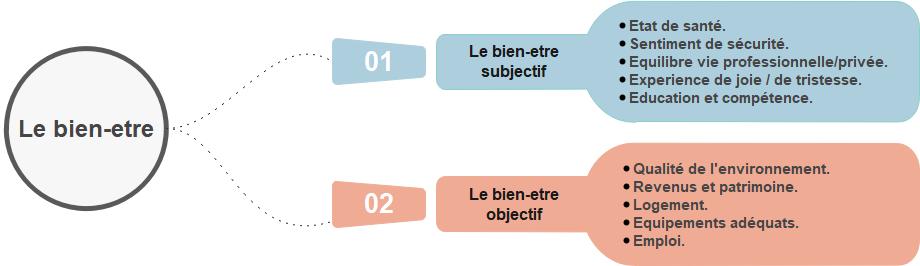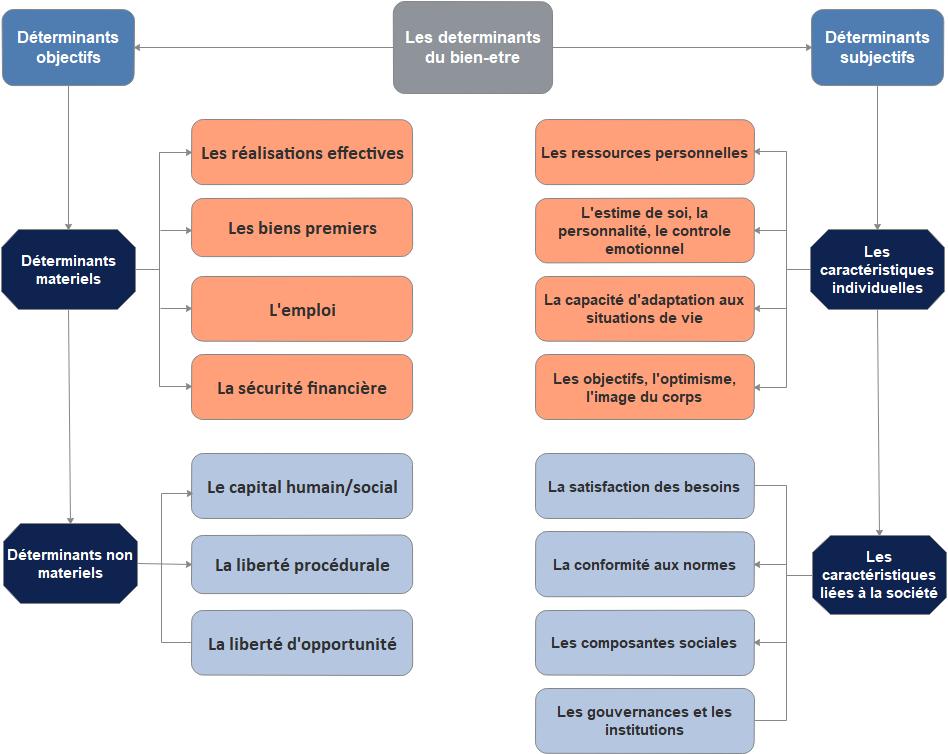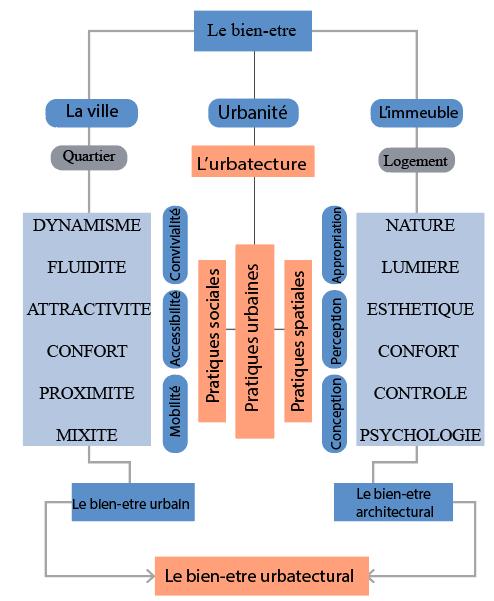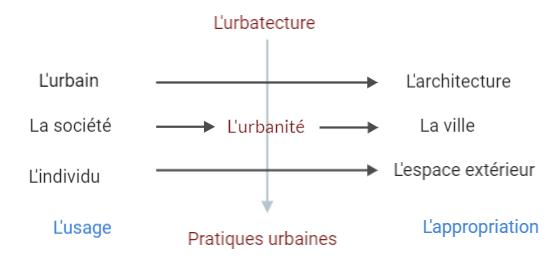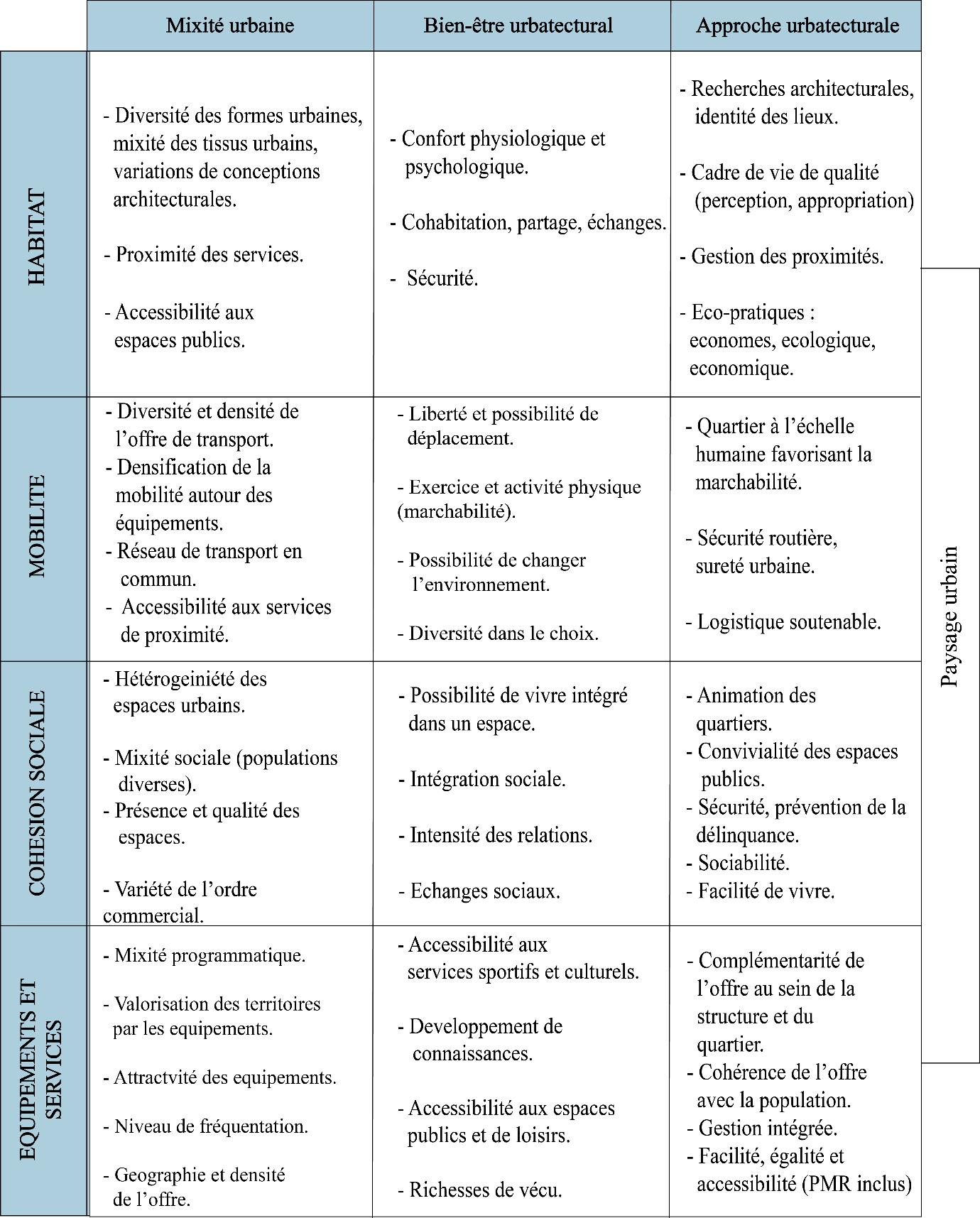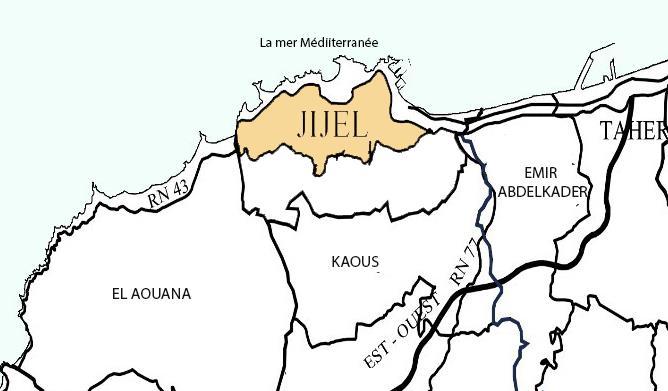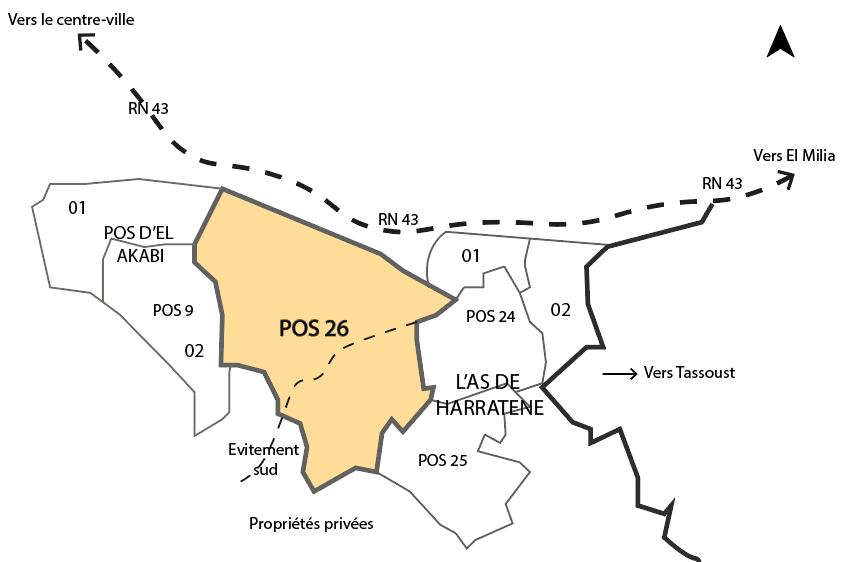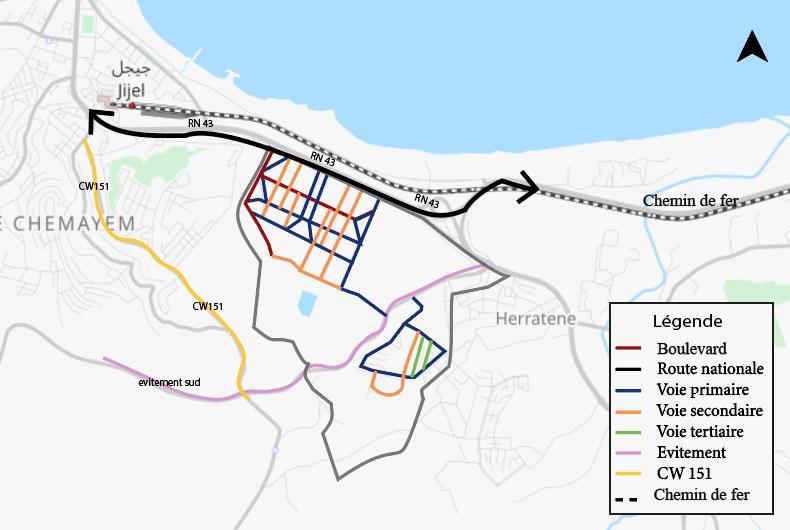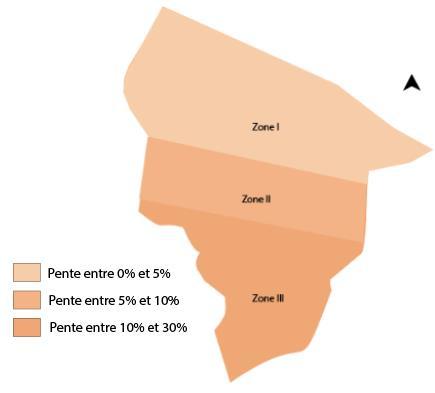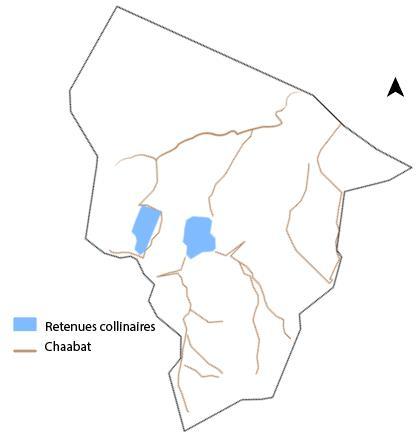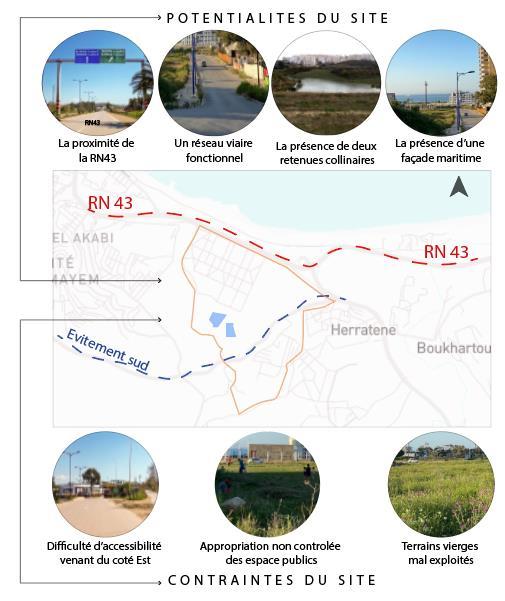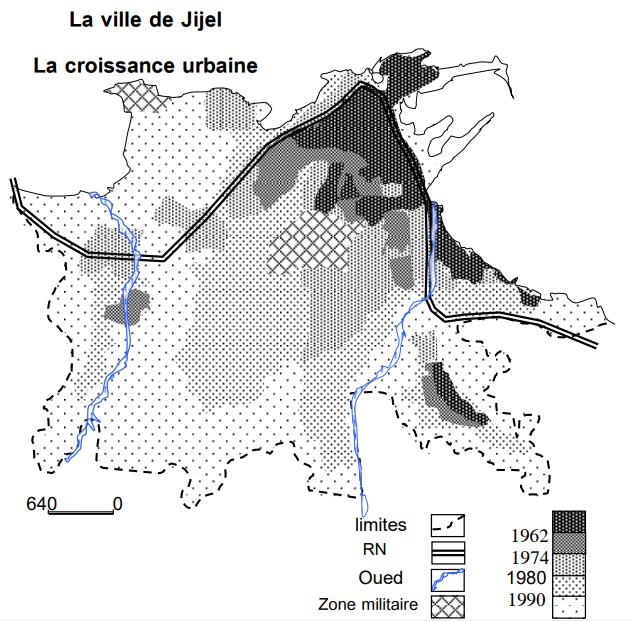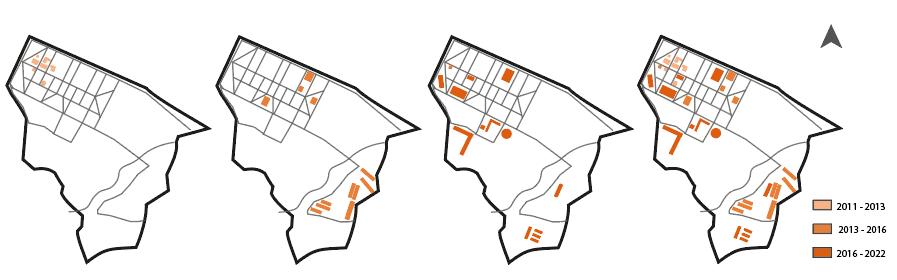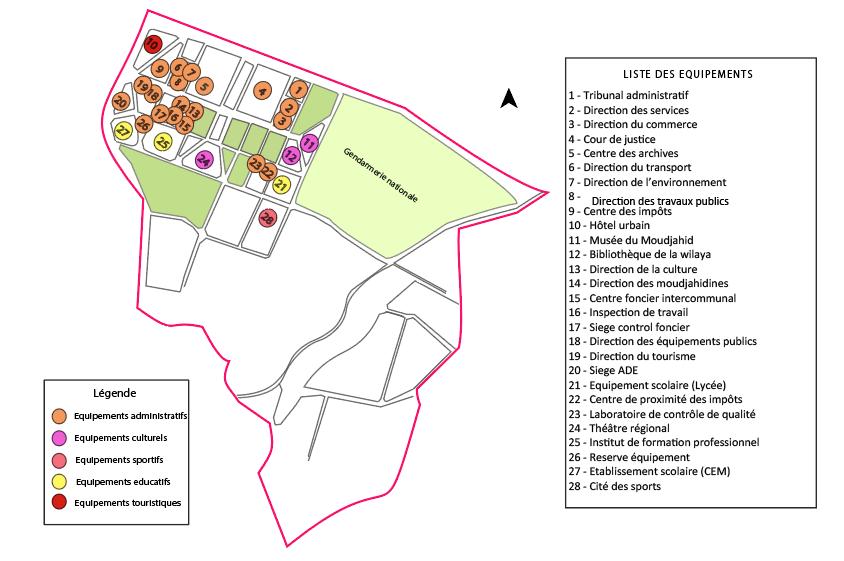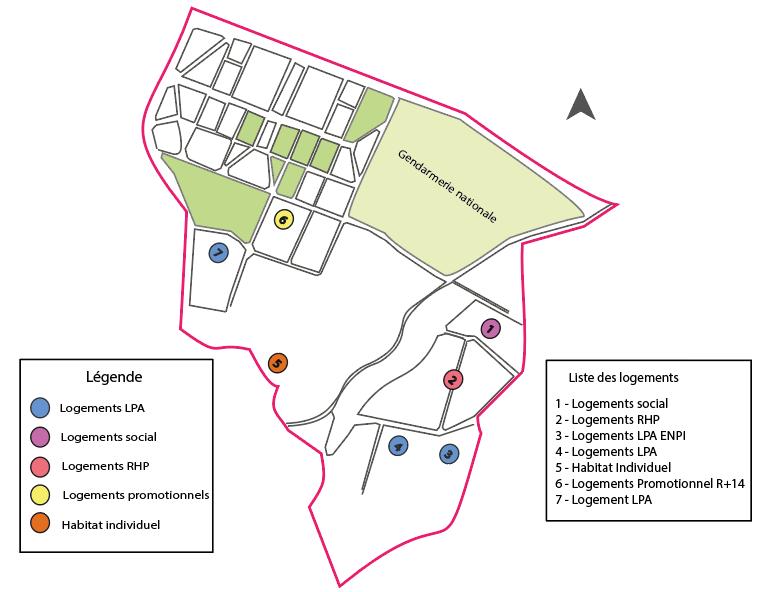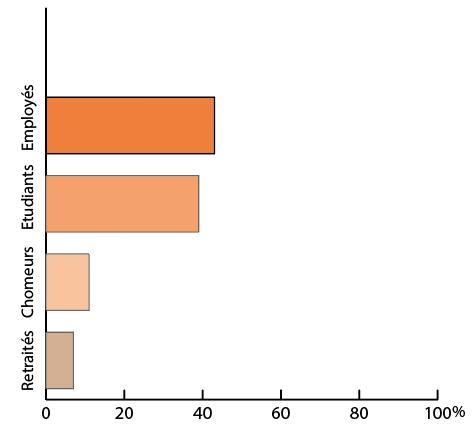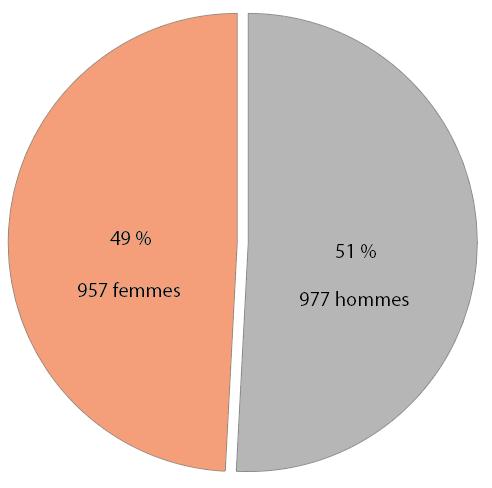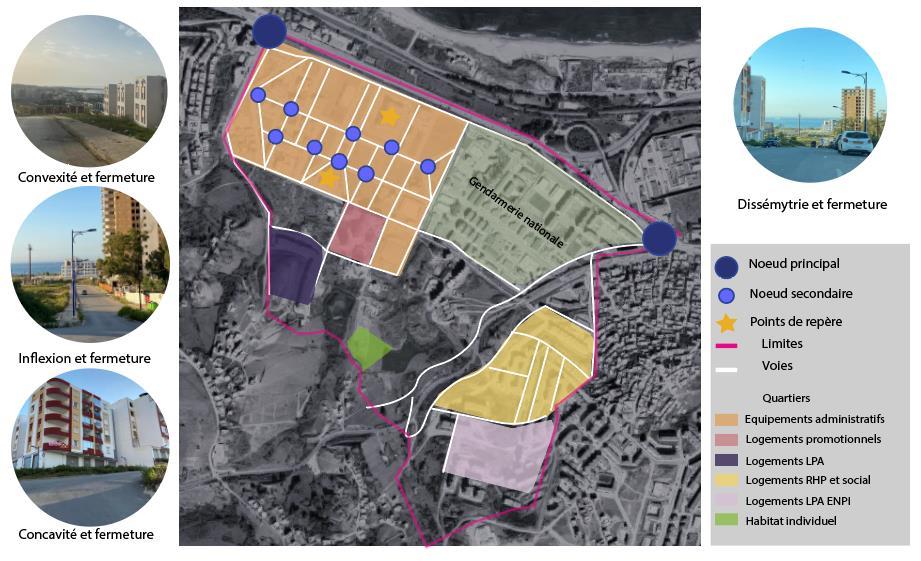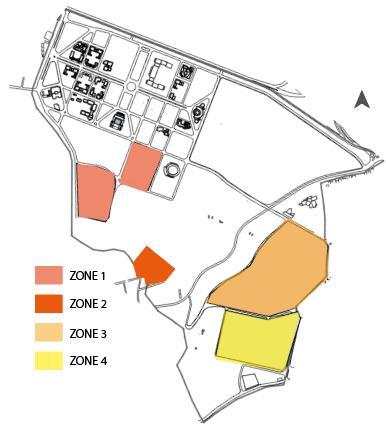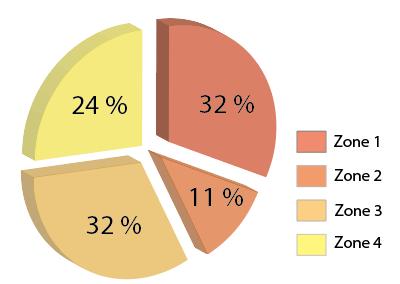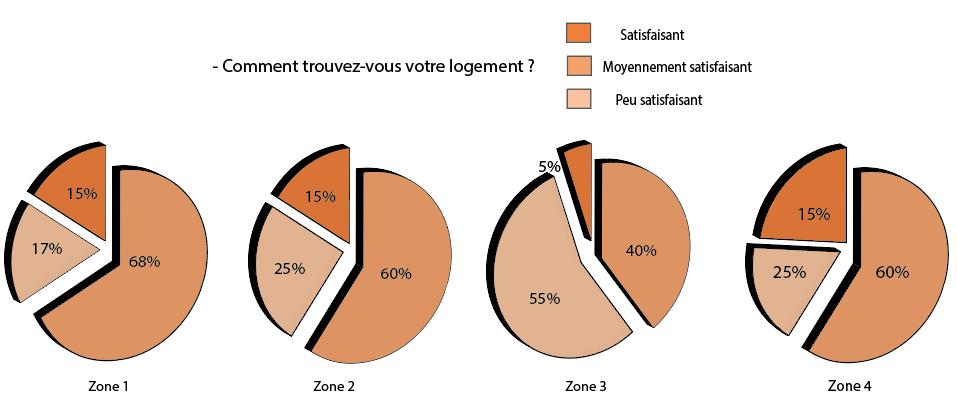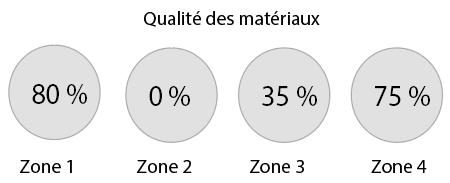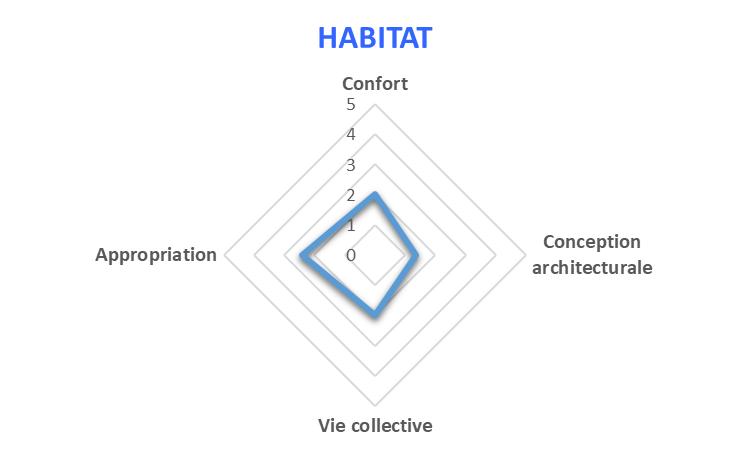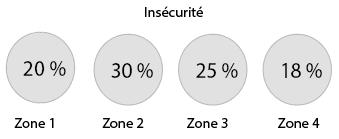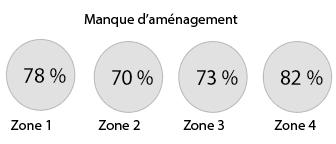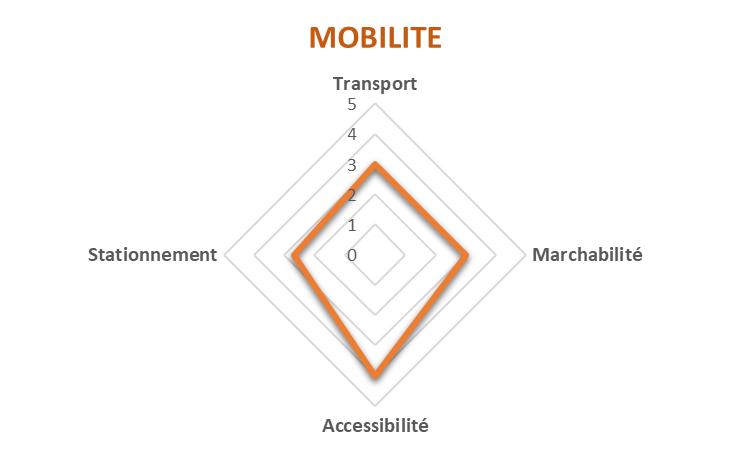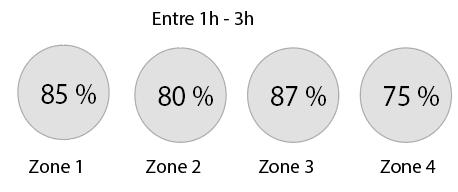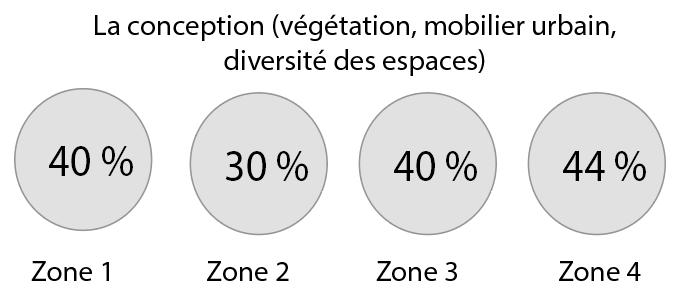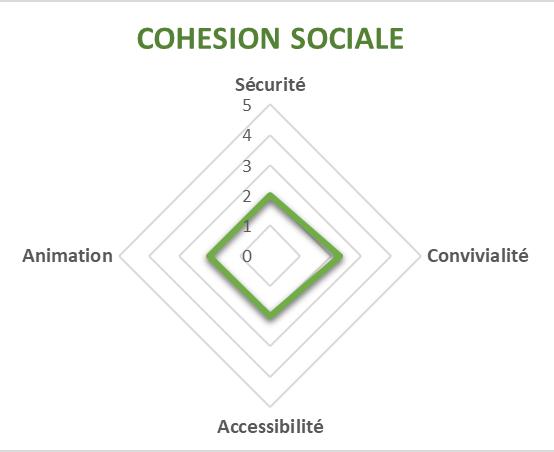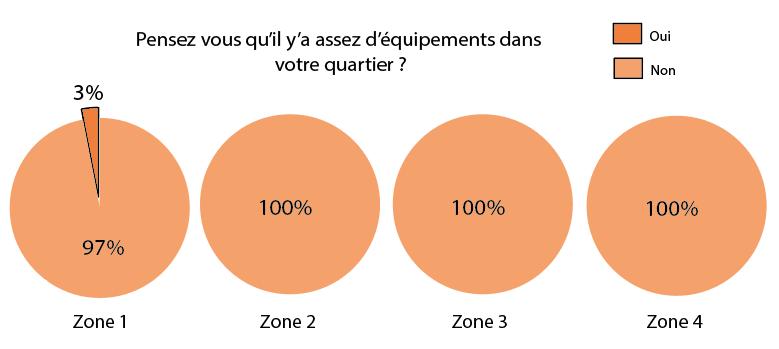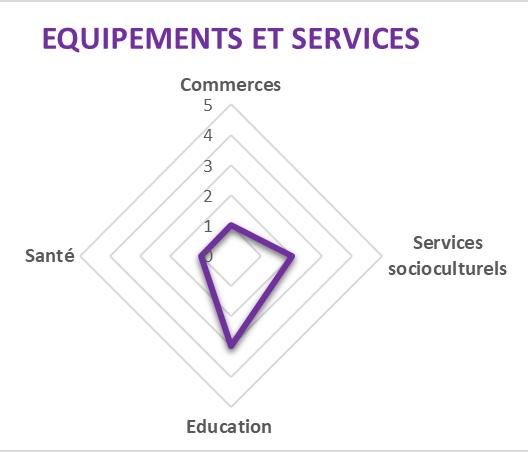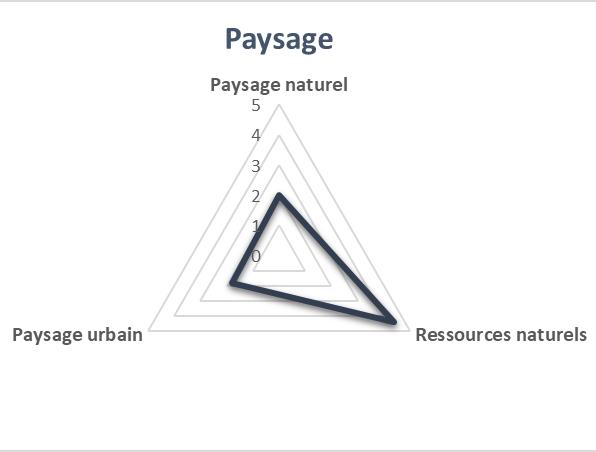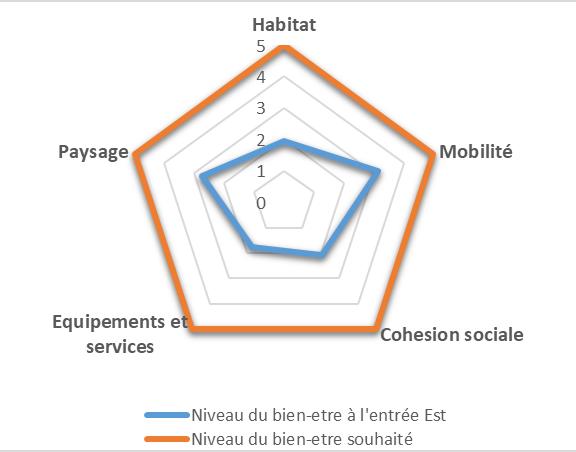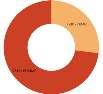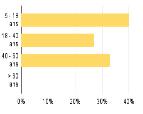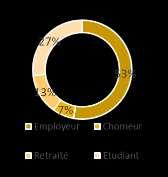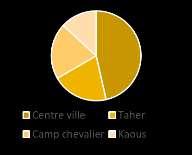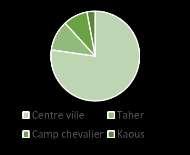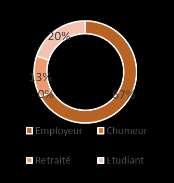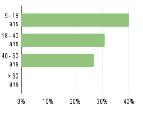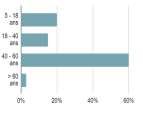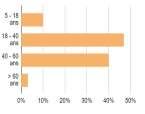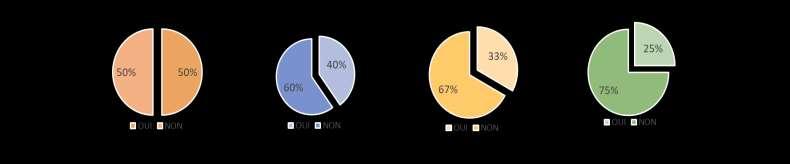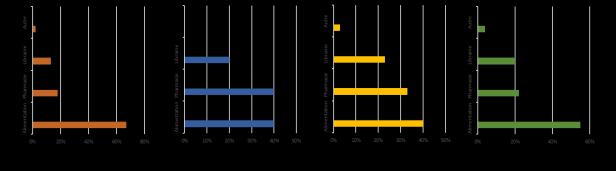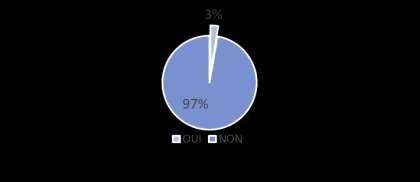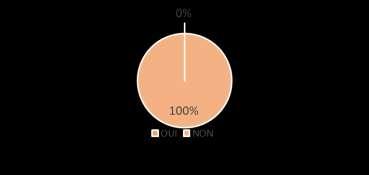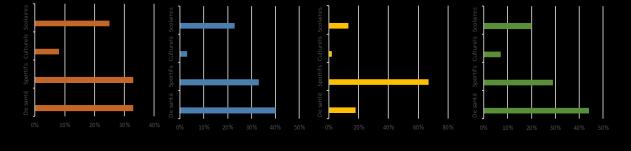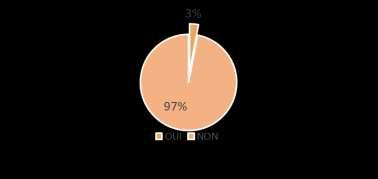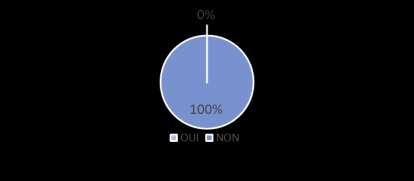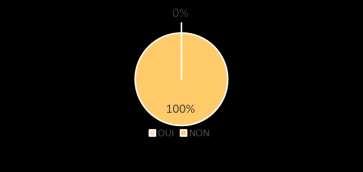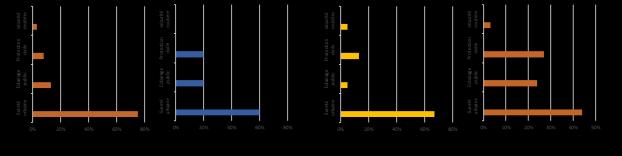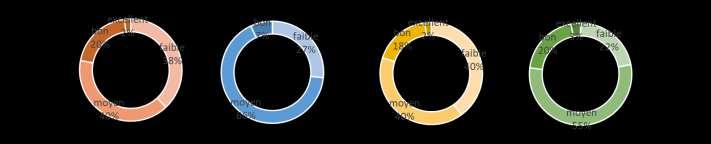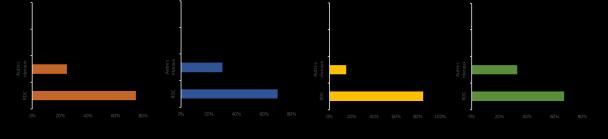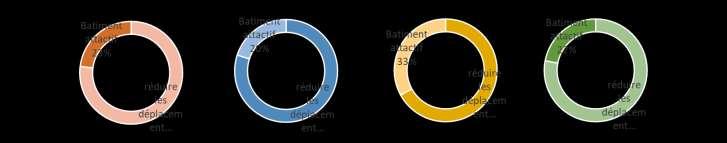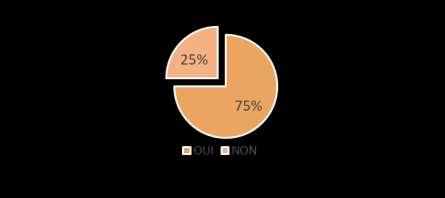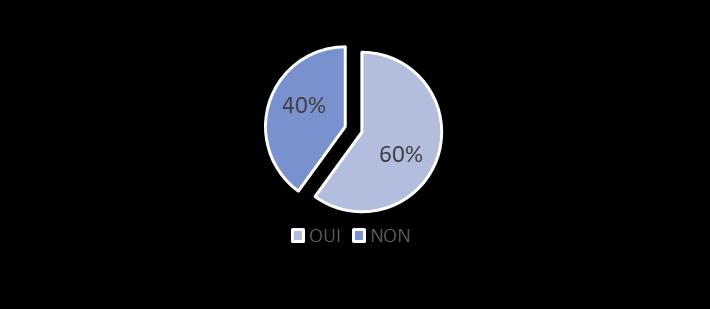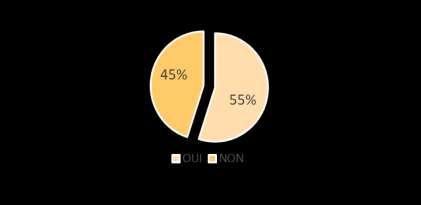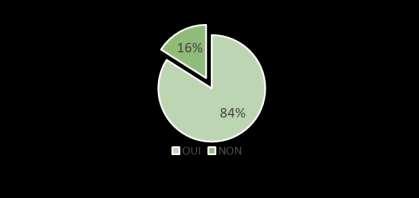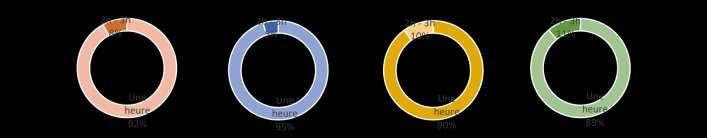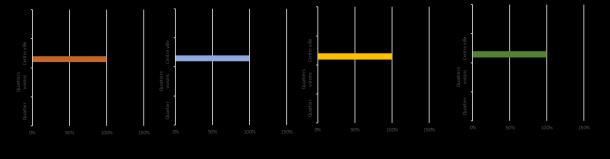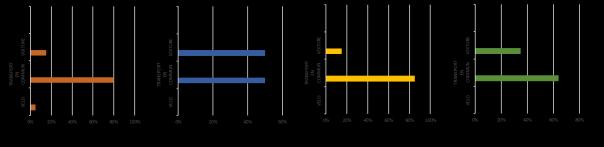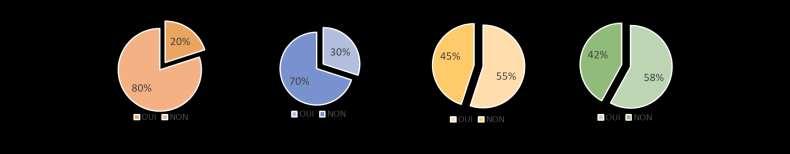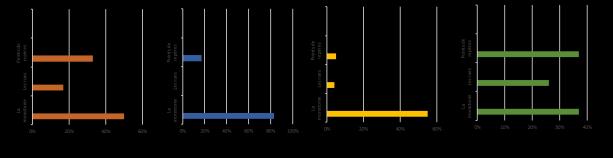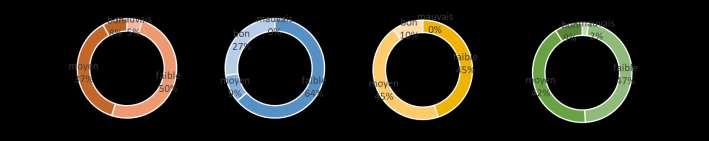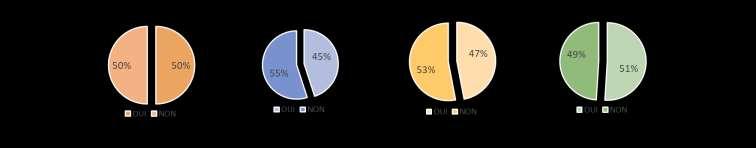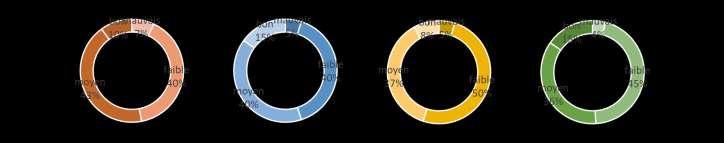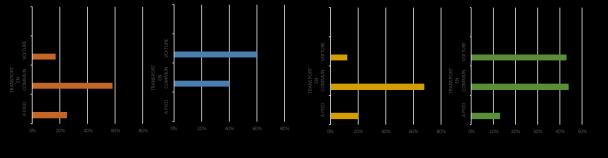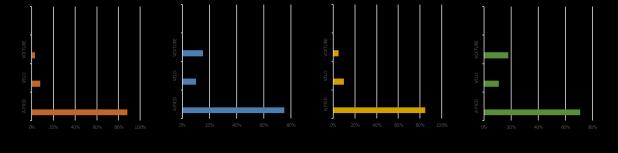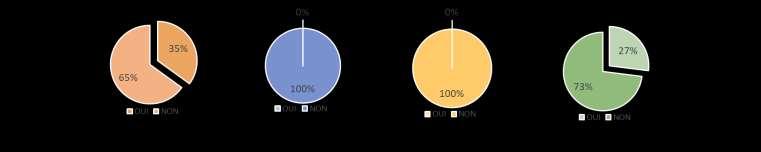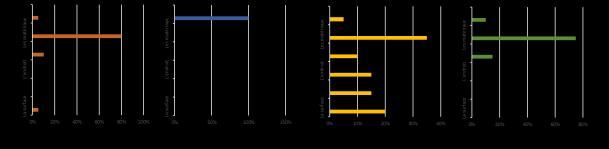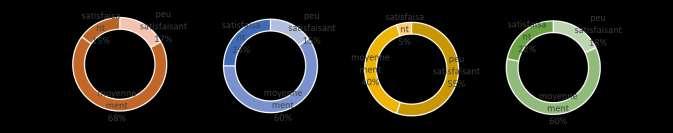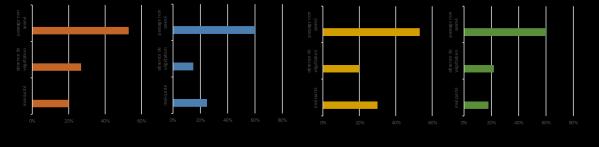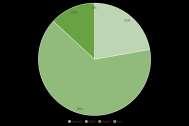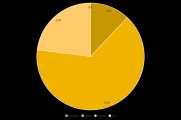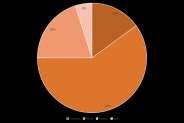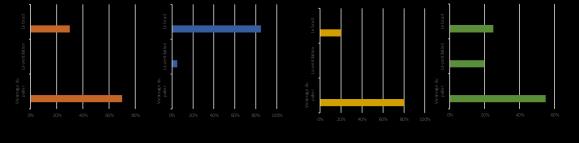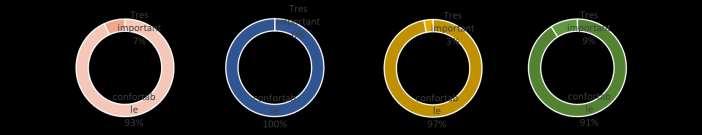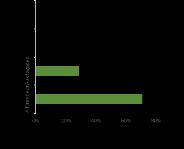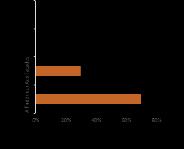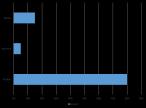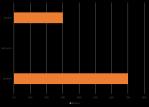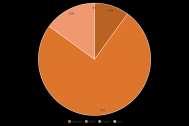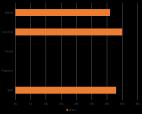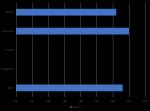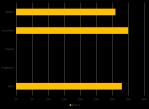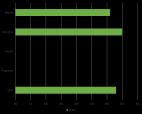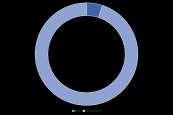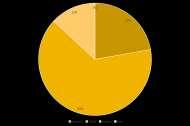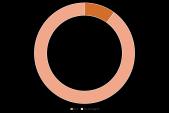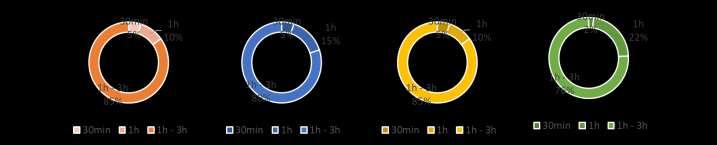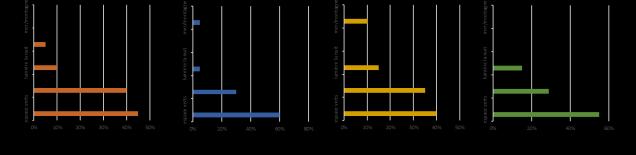République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université Mohamed Seddik BENYAHIA – Jijel
Faculté des Sciences et de la Technologie
Département d’Architecture
Mémoire présenté pour l’obtention du diplôme de : Master Académique en Architecture
LE BIEN-ETRE URBATECTURAL
Une approche pour la mixité urbaine, cas de l’entrée Est de la ville de Jijel.

Encadrante : BOUCHEFRA Hassina
Elaboré par : KEDJOUR Aya et BOUDRAI Chaima
JUILLET 2022
REMERCIEMENTS
Nous tenons avant toute chose a exprimé nos sincères reconnaissances et gratitudes envers Dieu le Tout Puissant de nous avoir donné la force, l’ambition et le courage de concrétiser ce travail de recherche.
Nos remerciements s’adressent en premier lieu à notre encadrante de mémoire, madame BOUCHEFRA.H pour son soutien inconditionnel, sa patience et sa disponibilité tout au long de la réalisation de ce travail.
Nous tenons à remercier en second lieu, madame HADEF.H notre encadrante de projet pour ses conseils et sa disponibilité.
Nous remercions en dernier lieu, l’ensemble des membres de jury ; Mesdames
BOUKETTA.S, KIHAL. H et Monsieur SAFRI.S d’avoir accepté d’examiner et de concourir à l’accomplissement de ce modeste travail de recherche ainsi que leur apport et leurs efforts au cours de ces années d’études.
DEDICACES
A NOS PARENTS.
TABLE DES MATIERES i Liste des figures vi Liste des figures. vii Listes des tableaux………………………………………………………………………………..viii Sigles et abréviations……………………………………………………………………………....ix Introduction générale………………………………………………………………...………..… 1 Préambule …………………………………………………………………………………….…... 1 Problématique. ……………………...….… 3 Objectifs ………………………………………………………………………………………….. 4 Méthodologie de recherche ………………………………………………………………………. 5 Structure du mémoire ………………. 6 PARTIE I : CONTEXTE ET CADRE THEORIQUE CHAPITRE I : La mixité urbaine: mixité des fonctions et des usages pour mieux réussir la ville. Introduction 7 I.Définitions et sous-champs……………………………………………………...……….. 7 I.1 La mixité : fusion de toutes les choses 7 I.2 La mixité urbaine : une lutte contre la sectorisation de l’espace……………………… 8 I.3 Origine et genèse de la mixité urbaine : de la charte d’Athènes à la charte d’Aalborg.. 8 II. Les dimensions de la mixité urbaine : ses différentes formes……………………..………9 II.1 La mixité sociale : un outil de vivre ensemble …………………………………….……10 II.2 La mixité fonctionnelle : sortir du zonage des territoires 11 II.3 La mixité architecturale : un moyen pour éviter la monotonie spatiale………………… 11 III. Les conditions de la mixité urbaine…………………………………………………..…… 12 III.1La densité urbaine : Une notion clé pour la mixité urbaine 12 III.2La proximité urbaine : Un antidote de l’éloignement……………………………………13 III.3La polycentralité urbaine : Un centre unique ne suffisant plus 13 III.4 La mobilité urbaine : Un territoire facilement accessible à pied……………...……….14 III.5Le paysage urbain : Un miroir de la mixité urbaine 14 IV. La mise en œuvre de la politique de la mixité urbaine………………………………..…..15 IV.1En Europe ………………………………………………………………………………..15 IV.1.1 Mécanismes de la mixité urbaine en France…………………………… 16 IV.2 La problématique de la mixité urbaine en Algérie……………………………..………18 IV-2-1 La politique des ZHUN 19
TABLE DES MATIERES ii IV.2.2 L’émergence du développement durable …………19 VI.2.3 La politique de la ville et le renouvellement urbain ……………………...………20 Conclusion …………21 CHAPITRE II : Le bien être urbatecturel : Une approche à deux échelles pour bien vivre la ville Introduction 22 I. Le bien-être …………………………………………………………………...……………22 I.1 Le bien-être : Une notion à multiples facettes …………………22 I.1.1 Le bien-être subjectif………………………………………...……………………23 I.1.2 Le bien-être objectif ………………………………………………………………23 I.2 Les dimensions du bien-être ………24 I.2.1 Le bien-être physique…………………………………………………..…………24 I.2.2 Le bien-être social 24 I.2.3 Le bien-être émotionnel …………………………………………………...……...25 I.2.4 Le bien-être spirituel ……………………………………………………………...25 I.2.5 Le bien-être mental 25 I.2.6 Le bien-être environnemental …………………………………………………….25 I.3 Les déterminants du bien-être 25 I.4 Perception spatiale du bien-être ……………………………………………………..…26 II. Le bien-être architectural : Concevoir pour le bien-être………………………………27 II.1 Influence de l’espace architectural sur l’être humain ……………28 II.2 Les vecteurs du bien-être architectural ………………………………………………...28 II.2.1 La lumière 28 II.2.2 La nature ……………………………………………………………….………...28 II.2.3 Le confort 29 II.2.4 Le contrôle 29 II.2.5 L’esthétique …………………………………………………………….………..29 II.2.6 La psychologie 29 III. Le bien-être urbain : mieux vivre en ville…………………………….……………….30 III.1 Initiatives pour un meilleur bien-être en ville 31 III.1.1 Le concept ville-santé …………………………………….…………………….31 III.1.2 Le bien-être comme pilier du développement durable …………………………31 III.2 Les vecteurs du bien-être urbain 32 III.2.1 Le dynamisme ………………………………………………………………….32
PARTIE II : PARTIE OPERATIONNELLE
TABLE DES MATIERES iii III.2.2 Le confort 32 III.2.3 La fluidité ……………………………………………………………………….33 III.2.4 L’attractivité 33 III.2.5 La proximité ……………………………………………………………..……...33 III.2.6 La mixité 33 IV. Le bien-être urbatectural : une approche, deux échelles ……………………………. 34 IV.1 L’urbatecture : Entre ville et architecture …………………………………………….34 IV.2 Le bien-être architectural et le bien-être urbain 35 IV.3 L’urbatecture et le bien-être, une alliance stratégique à reconquérir ………………...36 IV.4 Pourquoi la mixité urbaine ? 36 IV.4.1 L’habitat ……………………………………………………………..…………..39 IV.4.2 La mobilité ………………………………………………………..…………….39 IV.4.3 La cohésion sociale 39 IV.4.4 Les équipements, les services et les activités économiques …………………….40 Conclusion 40
EVALUATION DU BIEN ETRE URBATECTUREL A L’ENTREE EST DE LA VILLE DE JIJEL CHAPITRE III : Cadre général de l’étude Introduction 41 I. Etablissement d’un diagnostic préliminaire de l’aire d’étude………………………….41 I.1 L’entrée Est de la ville de Jijel : Un site à potentialités remarquables 42 I.1.1 Présentation de l’aire d’étude : Situation stratégique caractérisée par une bonne accessibilité ………………………………………………………………..…………42 I.1.2 Milieu physique : Site favorable à l’urbanisation 43 a) Relief ………………………………………………………………..……………43 b) Hydrographie 44 c) Climatologie …………………………..………………………………………..…44 I.2 L’Entrée Est : Nouvelle extension de la ville de Jijel ……………………….…………45 I.2.1 Période précoloniale 45 I.2.2 Période coloniale …………………………………………………….……………45 I.2.3 Période postcoloniale 46 a) De 1962-1974 ……………………………………………………………..……....46
TABLE DES MATIERES iv b) De 1974-1988 46 c) De 1988-1998 ……………………………………………………………………..46 d) De 1998-2008 47 e) De 2009 jusqu’à ce jour …………………………………………………………..48 I.3 La zone mixte : Nouvelle configuration spatiale 49 I.3.1 Composantes spatiales 49 a) Typologie du bâti ………………………………………………………………....49 b) Espace public 50 I.3.2 Population et emplois……………………………………………………………...51 I.3.3 Paysage urbain 51 II. Les indicateurs de l’évaluation du bien-être urbatectural ……………………………..54 II.1 Les techniques utilisées ……………………………………………………………… 54 II.1.1 L’observation 54 II.1.2 Enquête par questionnaire ………………………………………………………...54 a) Elaboration des questions 54 b) Taille de l’échantillon ……………………………………………………………. 55 c) Zonage …………………………………………………………………..………...55 II.1.3 L’Interview (entretien) 56 II.2 Les méthodes appliquées …………………………………………….………………56 II.2.1 L’analyse multicritères (AMC) 56 a) Indicateurs ciblés …………………………………………………..……………...56 b) Coefficients de pondération ………………………………………………………59 II.2.2 L’analyse qualitative FFOM ……………………… 59 Conclusion …………………………………………………………………………….…………..59 CHAPITRE IV : Lectures et interprétation des résultats Introduction ……………………………………………………………………………………….60 I. Evaluation quantitative du bien-être urbatectural à l’entrée Est ………...……………. 60 I.1 L’habitat 60 I.1.1 Résultats du questionnaire …………………………………….…………………..60 I.1.2 Analyse architecturale de l’habitat 61 I.1.3 Analyse multicritères de l’habitat ……………………………….………………..62 I.2 La mobilité ……………………………………………………………..……………...63 I.2.1 Résultats du questionnaire 63 I.2.2 Analyse multicritères de la mobilité ………………………………………………63
TABLE DES MATIERES v I.3 La cohésion sociale 64 I.3.1 Résultats du questionnaire ………………………………………………………..64 I.3.2 Analyse multicritères de la cohésion sociale 65 I.4 Les services et les équipements ……………………………………..…………………66 I.4.1 Résultats du questionnaire 66 I.4.2 Analyse architecturale des équipements 66 I.4.3 Analyse sensorielle ……………………………………………………………….67 I.4.4 Analyse multicritères des services et équipements 69 I.5 Le paysage ………………………………………………………………………….…..70 I.5.1 Lecture de la façade urbaine 70 I.5.1 Analyse multicritères du paysage ……………………..…………………………..70 II. Analyse qualitative FFOM ……………………………...………………………………..72 Conclusion 74 Conclusion générale ……………………………………………………………………………..75 Annexes Résumé Abstract صخلم
Liste des figures
vi
Figure 1 : Le lien entre les échelles, les conditions et les dimensions de la mixité urbaine…15 Figure 2 : Plan de masse du quartier de Bonne ……………………………………………...17 Figure 3 : Mixité urbaine dans le quartier de Bonne 17 Figure 4 : La mixité architecturale à Bonne 18 Figure 5 : Traitement architectural des façades à Bonne 18 Figure 6 : Espaces publics à Bonne ………………………………………………………….18 Figure 7 : Parc urbain à Bonne ……………………………………………………………...18 Figure 8 : Les approches du bien-être………………………………………………………..24 Figure 9 : Les déterminants du bien-être ……………………………………………………26 Figure 10 : Les vecteurs du bien-être urbatectural …………………………………………..35 Figure 11 : La relation mixité urbaine - Bien-être 37 Figure 12 : L’approche urbatectural 38 Figure 13 : La Joia Meridia 39 Figure 14: The Low Line ……………………………………………………………………39 Figure 15 : Les berges du Rhône, Lyon ……………………………………………………..40 Figure 16: The High line …………………………………………………………………….40 Figure 17 : Situation et limites de la commune de Jijel …………………………………….41 Figure 18 : Situation de l'aire d'étude ………………………………………………………..42 Figure 19 : Limites du POS 26 42 Figure 20 : Accessibilité du site 43 Figure 21 : Carte géotechnique du site 43 Figure 22 : Ressources hydrographiques 44 Figure 23 : Potentialités et contraintes du site de l'entrée Est ……………………………….45 Figure 24 : Croissance urbaine de la ville de Jijel après l'indépendance ……………………47 Figure 25 : Sens d'extensions de la ville de Jijel …………………………………………….47 Figure 26 : Évolution diachronique de l’Entrée Est 48 Figure 27 : Entrée Est :Carte des équipements 49 Figure 28 : Entrée Est : Typologie d’habitat 50 Figure 29 : Entrée Est : Espaces publics …………………………………………………….50 Figure 30 : Tranche d'âges de la population de l'entrée Est………………………………….51 Figure 31 : Répartition de la population de l'entrée Est par sexe ……………………………51 Figure 32 : Diagramme des fonctions des habitants ………………………………………...51 Figure 33 : Les éléments du paysage urbain à l’entrée Est 52 Figure 34 : Entrée Est : Zones homogènes .55 Figure 35 : Pourcentage de la population interrogée dans chaque zone de l’entrée Est 56 Figure 36 : résultats de la question liée à la qualité de logement 60 Figure 37 : Pourcentage des personnes insatisfaits par rapport à la qualité des matériaux dans les différentes zones ………………………………………………………………………….61 Figure 38 : Diagramme radar de l'habitat …………………………………………………...62 Figure 39 : pourcentage des résultats liés au manque d’aménagements appropriés…………63
vii Figure 40 : pourcentage des résultats liés à l'insécurité 63 Figure 41 : Diagramme radar de la mobilité 64 Figure 42 : Pourcentage des résultats relatives à la composante de la cohésion sociale …………………………………………………………………………………………64 Figure 43 : Pourcentage des résultats liés à la conception de l’espace public ………..……..64 Figure 44 : Etat de profil des performances relatives à la composante de la cohésion sociale 65 Figure 45 : Pourcentage de personnes satisfaites du nombre des équipements 66 Figure 46 : Résultats de l’analyse sensorielle .……..………………………………………..68 Figure 47 : Etat de profil des performances relatives à la composante des équipements et services ……………………………………………………………………………………….69 Figure 48 : Façade urbaine de l’entrée Est ……….……………………………..…………...70 Figure 49 : Etat de profil des performances relatives à la composante du paysage 71 Figure 50 : Etat de profil des performances au bien être urbatectural à l’entrée Est 71
viii Liste des tableaux Tableau 1 : la mise en œuvre de la mixité urbaine en France: l’agglomération Nantaise……….17 Tableau 2 : les critères et les indicateurs de l’évaluation du bien être urbatectural à l’entrée Est de la ville de Jijel……………………………………………………………………………………..57 Tableau 3 : Analyse des façades de l’habitat …………………...…………………………..…....61 Tableau 4 : Evaluation du bien être urbatectural de la composante Habitat……………………...62 Tableau 5 : Evaluation du bien être urbatectural de la composante Mobilité…………………….63 Tableau 6 : Analyse des façades des équipements ………………………………..……………...65 Tableau 7 : Grille de l’analyse sensorielle ……... 66 Tableau 8 : Résultats de l’analyse sensorielle .. 68 Tableau 9: Evaluation du bien être urbatectural de la composante Services et Equipements……69 Tableau 10: Evaluation du bien être urbatectural de la composante paysage…………………….70 Tableau 11 : Matrice FFOM: Classement des facteurs endogènes et exogènes………………….72
Liste des abréviations
CTRL : Centre national des ressources textuelles et lexicales.
INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques
PACE : Plan air climat énergie
SDER : Schéma de développement de l’espace régional
CREBOC : Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions
ZHUN : Zones d’habitat urbain nouvelles
LOV : Loi d’orientation pour la ville
SRU : Loi de solidarité et de renouvellement urbain
SCOT : Schéma de cohérence territoriale
PLU : Plan local d’urbanisme
OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques
INEE : Inter-agency Network for Education in Emergencies
OppChoVec : Opportunités, choix et vécu
ESCAPAT : bien-Etre, Spatial, CArto, PArticipaTif
OMS : L'Organisation mondiale de la Santé
PDAU : Plan directeur d’aménagement et d’urbanisme
POS : Plan d'Occupation des Sols
ACL : Agglomération Chef-lieu
AMC : Analyse multicritères
FFOM : Forces, faiblesses, opportunités et menaces
ix
INTRODUCTION GENERALE
Préambule :
« De l'habitat a la planète en passant par la ville, notre relation à l'environnement conditionne nos perceptions, nos évaluations et nos comportements et surtout détermine notre bien-être quotidien »
Gabriel Moser et Karine Weiss, 2003.
À partir du XIXe siècle, et pour répondre aux logiques et aux exigences de la révolution industrielle, plusieurs aspects de la vie en ville se sont radicalement modifiés ; les nouveaux modes de production et de consommation, les progrès technologiques, les crises économiques et sociales connues par les villes ont tous contribué à l’apparition d’une organisation sociale et économique particulière et donc, la production de nouvelles configurations spatiales.
Au début, les changements apportés au système urbain et les transformations successives de son fonctionnement ont produit un désordre urbain dû principalement à l’inadéquation entre l’offre fournie par la ville et la demande diversifiée de la population urbaine en perpétuelle croissance. L’industrialisation a donc engendré une forte accélération de l'urbanisation, provoquant un étalement urbain majeur et sans précédent, et une standardisation des procédés de production, produisant par conséquent, une uniformisation des formes urbaines.
L'incapacitédesvillesindustriellesàapporterdesréponsesauxproblématiquessoulevées a poussé les urbanistes et les planificateurs à repenser les théories de la production de l’espace, et de proposer des alternatives pour atténuer les pressions exécrées sur la ville industrielle ; au début du XXe siècle, les idées de modernisme ont commencé à faire surface dans l’urbanisme, les explorations ont donné naissance à l’urbanisme moderne basé sur le principe du zoning, ce principe, théorisé dans la charte d’Athènes, avait comme objectif principal la promotion du bien-être de l’habitant par la proposition d’une organisation urbaine nouvelle caractérisée par une juxtaposition des espaces destinés à accueillir les principales fonctions de la ville (travailler, habiter, circuler et se divertir).
La vision fonctionnaliste du modernisme n’a pas beaucoup résisté face aux évolutions de la société moderne, ce qui a généré des problèmes dans les villes contemporaines, notamment l’étalement urbain, la perte de la qualité et de l’identité territoriale et la fragmentation urbaine et sociale. La ville contemporaine devient donc une ville qui répond uniquement aux besoins fonctionnels de l’homme, mais ne constitue plus un lieu de vie pour lui.
INTRODUCTION GENERALE 1
Face à ces constats, le principe de zonage a été remis en cause et des alternatives pour soulager les maux de la ville contemporaine ont été émergées. La charte d’Aalborg est apparue comme une critique de la charte d’Athènes et du mouvement moderne qui ont produit une ruptureflagranteentrel’hommeetsonespacedevie ;cettecharteaprésenté lanotiondemixité urbaine qui consiste à favoriser une pluralité des fonctions dans le même espace et la création des liens sociaux entre les citoyens comme réponse urbanistique et architecturale pour un cadre de vie fonctionnel et plus réussi
Aujourd’hui, le monde est changé, les villes ont également changé d’apparence, de composition, d’ambitions et de mode de vie, nous ne pouvons plus penser les villes du XXIe siècle avec les principes du XXe siècle Face aux considérations actuelles, la satisfaction des besoins de l’homme ne se limite plus à l’aménagement d’un espace de vie fonctionnel, elle dépasse la proposition d’un espace de vie pour vivre ensemble pour atteindre l’idée de concevoir un cadre de vie de qualité : appropriable et agréable.
Dans un contexte de centration sur l’homme, le bien-être architectural est apparu comme un concept suite à des réflexions qui s’intéressent à l’impact que porte l’espace architectural sur l’homme. Bien que la façon dont nous percevons cet espace et dont notre cerveau réagi peut varier d’une personne à une autre et peut provoquer des effets différents, il a été scientifiquement prouvé que l’environnement architectural influence nos processus cérébraux, et par conséquent, peut générer un sentiment de stress, de crainte ou de bien-être.
Le bien-être urbain quant à lui est apparu dans le but de proposer une nouvelle manière de vivre la ville contemporaine en se basant sur des études sur l’espace conçu. Dans cette logique, ils ont déduit que la qualité d’un espace dépend des représentations formées chez les individus dont le bien-être ressenti et découlent de ses composantes matérielles et immatérielles et leur agencement dans cet espace.
En effet, la ville est l’affaire de tous, elle se présente aujourd’hui comme un organisme complexe qui doit être appréhendé et saisi par une approche pluridisciplinaire, cette approche qui englobe les divers aspects de la vie en ville: économiques, sociales et environnementaux, et qui vise principalement la compréhension de la complexité des réalités urbaines, la maitrise de la dépendance réciproque et l’interaction constante entre les différentes composantes de l’espace urbain, et enfin, l’amélioration et le renforcement des liens existants entre l’homme et son espace de vie.
INTRODUCTION GENERALE 2
Cette relation entre l'homme et son environnement a donné naissance à de nombreuses initiatives visant à assurer une qualité de vie aux citadins. Nous parlons ainsi de la ville-santé qui est une notion qui met en place des mesures pour créer des environnements agréables et promouvoir davantage la santé. Dans le même concept et à une échelle plus petite, la neuroarchitecture utilise des instruments de la neurobiologie, pour mesurer la manière dont notre corps réagit à certains stimuli architecturaux, dans l’objectif de concevoir des espaces de vie appropriables en tenant compte les émotions provoquées par l’espace architectural
Problématique
Les phénomènes urbains qu’ont subis les villes algériennes depuis l’indépendance ont engendré de multiples conséquences sur l’espace urbain, qui se sont traduites par la banalisation des espaces de vie, la monofonctionnalité des secteurs urbains, la pauvreté des compositions urbaines et architecturales, et la prolifération de l’habitat malsain, et ce, malgré les stratégies de développement urbain mises en œuvre pour surmonter les lacunes des pratiques antérieures de la planification urbaine.
La prise en conscience tardive de cette crise multidimensionnelle a conduit les acteurs de la planification urbaine à adopter de nouvelles voies dans leur stratégie d’intervention. La mixité urbaine est apparue dans une démarche d’urgence comme un outil pour remédier aux problèmes soulevés dans les villes algériennes, et pour assurer une qualité de vie agréable aux citoyens. Néanmoins, il en a résulté une répartition déséquilibrée des fonctions, et une incompatibilité des espaces conçus avec les besoins et les souhaits des habitants
La manière de voir et de concevoir la ville en Algérie, est encore souvent réduite seulement à l’aspect quantitatif de la planification, la perception des espaces produits par les différentes politiques urbaines semble toujours loin d’être acquise même dans des zones nouvellement aménagées.
Dans ce contexte, la ville de Jijel présente un exemple à réfléchir. Face à l’étude de son évolution urbaine depuis des années, nous avons constaté des conséquences néfastes qui ont défiguré son image, causée par une forte croissance démographique et une forte demande de logement.
L’entrée Est de la ville, objet de notre étude, se veut une nouvelle extension de la ville de Jijel caractérisée par une nouvelle configuration spatiale, et ayant pour objectif principal la création d’une zone mixte à l’échelle fonctionnelle, architecturale et sociale, et la proposition d’une image moderne et futuriste à l’entrée de la ville.
INTRODUCTION GENERALE 3
Aujourd’hui, ce nouveau pôle administratif et résidentiel souffre de plusieurs déficits malgré les nombreux potentiels dont il dispose, à savoir : une répartition déséquilibrée des équipements, une absence remarquable des liens d’appartenance et un manque observé de la créativité aussi bien à l’échelle architecturale qu’urbaine, tout cela, a fait de cette entrée une zone mixte que fonctionnellement, dans laquelle l’habitant s’y trouve écrasé et mal à l’aise
Le couple mixité urbaine / bien-être urbatectural constitue le cœur de notre problématique. A travers notre recherche, nous allons essayer de saisir cette relation imbriquée et de mettre l’accent sur les résultats de cette alliance stratégique, les réflexions sur ce sujet nous mènent à poser la question suivante :
• Que manque-il aux espaces mixtes pour devenir des espaces de bien-être ?
D’autres questions complémentaires peuvent être soulevées :
• Pouvons-nous contribuer à la mise en œuvre d’une mixité urbaine tout en s’appuyant sur la notion du bien-être ?
• Comment réfléchir le bien-être à une échelle urbatecturale pour améliorer l’expérience vécue par les habitants d’une zone mixte ?
• En quoi les vecteurs du bien-être urbatectural peuvent-ils contribuer à offrir une expérience adaptée aux besoins des habitants de l’entrée Est ?
Objectifs
Ce travail a pour objectifs d’apporter plus de clarté sur les points suivants :
• Découvrir le rapport qui pourrait exister entre l’architecture, l’urbain et le bienêtre.
• Définir l’impact de la relation mixité urbaine et bien-être urbatectural sur la ville.
• Etablir une nouvelle démarche de concevoir la ville en se basant sur les notions de la mixité urbaine et du bien-être.
• Evaluer le bien-être urbatectural à l’entrée Est de la ville de Jijel afin de proposer des recommandations qui peuvent être mis en place pour l’améliorer à l’avenir.
INTRODUCTION GENERALE 4
Hypothèses
Afin de répondre aux questionnements soulignés dans la problématique, nous pensons que les hypothèses suivantes peuvent valider la finalité de notre recherche :
✓ Créer un cadre de vie agréable en mettant en œuvre les vecteurs du bien-être urbatectural sans forcément compter sur la mixité urbaine pour y-aboutir.
✓ La mise en place d’une approche urbatecturale combinant la mixité urbaine et le bien-être pour améliorer la qualité de vie des habitants.
✓ Réfléchir le bien-être à une échelle urbaine, en combinant les vecteurs du bien-être urbain et les conditions de la mixité urbaine pourrait améliorer la qualité du paysage urbain de l’entrée Est.
Méthodologie de recherche
Pour atteindre les objectifs cités plus haut, nous allons suivre la démarche méthodologique suivante :
Dans un premier temps, l’approche théorique qui est une phase exploratoire, se basant sur un état de l’art exhaustif, une recherche bibliographique (ouvrages, mémoires, revues) et électronique (articles et documentaires…) relatif à la mixité urbaine et ses différentes échelles et conditions, mais aussi au bien-être à une échelle urbatecturale pour enfin exposer la relation qui existe entre les deux notions.
Dans un deuxième temps, l’approche opérationnelle, qui consiste en l’établissement d’un diagnostic de l’entrée Est en matière de bien-être. Pour étayer ce diagnostic et évaluer le niveau du bien-être à l’entrée Est nous avons choisis l’analyse multicritères (AMC), cette dernière est précédée par une observation directe en premier lieu afin d’établir un diagnostic préliminaire de l’aire d’étude. En deuxième lieu, nous avons opté à une enquête, qui fait l’objet de deux parties : unepremièreenquêtesous formed’unquestionnaire,destinéeauxhabitants del’entrée Est, afin d’identifier les éléments jugés potentiellement constitutifs du bien-être. La deuxième partie de l’enquête sera sous forme d’une interview adressée aux employés des directions qui se trouvent à l’entrée Est, afin de dégager les critères et les indicateurs liés à la dimension architecturale.
En dernier lieu, nous allons établir un diagnostic stratégique basé sur l’analyse multicritère et l’analyse FFOM Ce qui va nous aider à établir une synthèse et une conclusion en rapport à nos hypothèses de recherche, et de présenter des recommandations qui pourraient conduire à un lieu adéquat pour répondre aux besoins des habitants.
INTRODUCTION GENERALE 5
Structure du mémoire
Ce mémoire fait l’objet de deux parties dont chacune comporte deux chapitres. Elles sont précédées par une introduction générale qui est le fil conducteur de ce mémoire étant donné qu’elle explicite le problème de la recherche, les hypothèses et les objectifs de l’étude, suivies d’une conclusion générale.
La partie théorique est relative à l’état de l’art et elle est constituée de deux chapitres, le premier chapitre aborde les définitions relatives à la mixité urbaine, son histoire, ses échelles, ses conditions et sa mise en œuvre en Europe et en Algérie. Le second chapitre porte un regard sur le concept du bien-être à l’échelle architecturale et à l’échelle urbaine et son interaction avec la mixité urbaine.
La partie opérationnelle est constituée quant à elle de deux chapitres. Le troisième chapitre consiste en la présentation du cas d’étude ainsi que les différentes méthodes et techniques d’investigation utilisées. Le quatrième chapitre présente l’ensemble des résultats et interprétations obtenus.
INTRODUCTION GENERALE 6
PARTIE I : CONTEXTE ET CADRE THEORIQUE
CHAPITRE I :
LA MIXITE URBAINE:
MIXITE DES FONCTIONS ET DES USAGES
POUR MIEUX REUSSIR LA VILLE
Introduction
« C’est un grand agrément que la diversité. Nous sommes bien comme nous sommes : Donnez le même esprit aux hommes, vous ôtez tout le sel de la société. L’ennui naquit un jour de l’uniformité ». Antoine Houdar de la Motte, 1719.
Il est évident que la définition d'un urbanisme bien pensé n'est pas un urbanisme séparatif basé sur le principe du zonage qui était une source de maux urbains et sociaux de la ville contemporaine. La forte consommation foncière,la ségrégation socio-spatiale,la fragmentation urbaine, les inégalités environnementales, l’éloignement des lieux de résidence et d’emploi ainsi que la pollution résultante de l’usage excessif des automobiles, sont tous les résultats de cette théorie désormais considérée caduque et dépassée
La notion de la mixité urbaine est devenue donc, l’un des grands enjeux de notre époque, elle est aujourd’hui érigée comme un mécanisme utile pour atteindre les objectifs principaux de développement durable et une condition fondamentale pour mettre en œuvre les projets de renouvellement urbain ; La mixité fonctionnelle, sociale et spatiale semble être un impératif fondamental de la réussite de la vie en ville.
Ce chapitre vise à mettre en perspective le concept de la mixité urbaine dans ses trois dimensions, son origine, ses conditions et ses échelles ainsi que sa mise en œuvre à la fois à l’échelle internationale et nationale.
I. Définitions et sous-champs
I.1 La mixité : fusion de toutes les choses
Le terme de la mixité est polysémique, donc pour mieux comprendre toutes ses complexités et d'en donner une définition approfondie. Il est important de jeter un coup d'œil aux diverses sources littéraires.
Etymologiquement, le terme de la mixité est issu du verbe latin misceo, qui signifie mélanger. Et d’après le dictionnaire de la Toupie la mixité se définit comme : « le caractère de ce qui est mixte, de ce qui est composé de choses de natures différentes ou de personnes des deux sexes ». (La Toupie, 2021).
Le dictionnaire l’internaute la définit aussi comme : « un mélange de tout ce qui peut être différent, par extension. Cohabitation entre personnes de religions, de races, de pays, de catégories sociaux-professionnelles différentes par exemple ». (L’internaute, 2021).
CHAPITRE I : La
7
mixité urbaine : mixité des fonctions et des usages pour mieux réussir la ville
Selon le centre national des ressources textuelles et lexicales la mixité est « La réunion de personnes, de collectivités, d'origines, de formations ou de catégories différentes. » (Le CNRTL)
I.2 La mixité urbaine : une lutte contre la sectorisation de l’espace
Jean-Philippe Antoni décrit la mixité urbaine dans son Lexique de la ville comme étant « une diversité de l’espace urbain, de l’occupation du sol à la répartition des fonctions et à la composition sociale des quartiers » (Antoni, J.2009).
En effet, la mixité urbaine désigne une action, celle de mixer, de mélanger, que préconisent les pouvoirs publics à travers les politiques d’habitat et d’urbanisme. Si le terme mixité est récent, l’idée du mélange dans la ville l’est moins et semble presque intrinsèque à la pensée urbanistique. Cette notion de mixité a progressivement remplacé celle de diversité beaucoup plus ancienne (1160), qui se définit comme l’hétérogénéité, le pluralisme, la variété, et s’oppose à la ressemblance, à la monotonie ; En aménagement urbain, ce concept de diversité est considéré comme un principe d'équilibre et une condition de l'unité de l'harmonie sociale.
(Lelevrier Christine)
À cet égard, la mixité urbaine est un antidote du zonage monofonctionnel, elle représente une répartition équilibrée de fonctions urbaines : activités résidentielles et socio-économiques (bureaux, commerces, institutions, services publics, jardins, etc.), dont les habitants ont besoin dans leur quartier et leurs ilots sans la nécessité d’utiliser les automobiles.
I.3 Origine et genèse de la mixité urbaine : de la charte d’Athènes à la charte d’Aalborg
La mixité urbaine est apparue comme remède aux problèmes issus du principe du zonage qui était né aux États-Unis au début du XXe siècle, et ce, pour répondre aux soucis liés à la croissance urbaine vécus par les villes après la révolution industrielle, par la suite ce principe a été adopté par les architectes modernes du monde entier comme un dispositif de planification et d’aménagement des espaces urbains.
Decefait,ces nouvelles constatations ont conduitleCorbusier lorsdelaCharted'Athènes à formuler des nouvelles bases de l’urbanisme, celles de l’urbanisme fonctionnaliste : (habiter, travailler, circuler et se divertir) qui étaient traduites dans les différents secteurs de la ville.
La vision fonctionnaliste du modernisme vise à créer des zones exclusivement dédiées à l’habitation et d’autres aux bureaux etc. En conséquence elle a conduit au développement des villes sans précision ni contrôle, ce qui a ensuite entrainé plusieurs problèmes dans les villes
CHAPITRE
8
I : La mixité urbaine : mixité des fonctions et des usages pour mieux réussir la ville
contemporaines notamment : la fragmentation urbaine qui détruit l'unité et l'homogénéité que les villes avaient auparavant, la ségrégation sociale qui se traduit par des inégalités entre les populations, l’isolement des différentes fonctions humaines et le besoin constant d’utiliser les véhicules qui sont la cause majeure d’émissions de gaz et de pollution environnementale, la monocentralité et la marginalisation des périphéries, l’appauvrissement du paysage urbain et la négligence du patrimoine culturel. Cependant, le manque de mixité dans cette période n'est pas seulement dû au zonage, mais aussi à des choix individuels de localisation qui tendent à regrouper certaines classes sociales ou certains types d'activités.
En réaction à la Charte d’Athènes, à l'urbanisme fonctionnaliste des années soixante et à l’évolution urbaine contemporaine, la charte d’Aalborg a été signée par les participants à la Conférence européenne sur les villes durables, qui s'est tenue à Aalborg, au Danemark, le 27 mai 1994, et qui se présente sous forme d'une charte anti-athénienne, Emelianoff précise que la charte d’Aalborg : « est un texte de référence pour un urbanisme « durable ». Elle ouvre la voie à une nouvelle génération de politiques urbaines, moins sectorielles, qui tentent d’intégrer les impacts du développement sur l’environnement à court, moyen et long terme, compris dans une dimension écologique et sociale » (Emelianoff, 2001) En effet, la charte est basée sur cinq principes contrastés de la Charte d’Athènes qui sont : la valorisation de la dimension patrimoniale (l’existant est pris en considération dans le développement de nouveaux projets d’urbanisme et d’architecture),la réduction de la mobilité restreinte (une voie pour plusieurs modesdetransport),l’insertiondubâtidansunenvironnementmultidimensionnel(l’intégration spatiale et sociale), la favorisation de l’urbanisme participatif et la promotion de la notion de la mixité urbaine ; Le dernier principe de cette charte a mis l’accent sur la nécessité de faire coexister sur un même territoire les différentes fonctions qui composent la ville.
Pour conclure, nous pouvons dire que le potentiel évolutif d’un espace urbain tient largement à sa versatilité et à sa complexité ; En effet, les espaces monofonctionnels et mono sociaux sont plus fragiles face aux évolutions de la société et de la vie contemporaine, tandis que les espaces multifonctionnels et multisociaux possèdent de meilleures capacités de reconversion et d’adaptation aux changements.
II. Les dimensions de la mixité urbaine : ses différentes formes
La mixité urbaine est devenue un concept central en urbanisme. Les multiples dimensions qui créent cette mixité urbaine se résument souvent en trois grandes typologies : la mixité sociale, fonctionnelle et architecturale.
CHAPITRE I : La
9
mixité urbaine : mixité des fonctions et des usages pour mieux réussir la ville
II.1 La mixité sociale : un outil de vivre ensemble
La mixité est définie selon Gérard Baudin comme : « le caractère propre à un mélange d’éléments hétérogènes ou différents ».Cettedéfinitionpermettrait doncde considérerlamixité sociale comme « la coprésence ou la cohabitation en un même lieu de personnes ou de groupes différents socialement, culturellement ou encore de nationalités différentes ». (Baudin, G.2001).
Dans cette optique, Armand Colin révèle que ; « la mixité sociale est l’objectif d’une politique sociale visant, par l’élaboration des programmes de logement notamment, à faire coexister différentes classes sociales au sein d’une même unité urbaine » (Armand, C, 2003).
La notion de la mixité est très ancienne, elle avait déjà inspiré de nombreuses utopies urbaines au 19e siècle et au début du 20e siècle en Europe. Alors que la mixité sociale est très récente dans son acceptation actuelle, c’est au cours des années 1960 que la mixité sociale est devenue populaire parmi les décideurs politiques en charge de la planification des complexes de logements collectifs dans certaines zones en bordure des villes européennes. Dans de nombreux cas, la mixité sociale n’a pas été atteinte. Depuis les années 1980, la mixité sociale s'est affirmée comme un objectif de plus en plus central des "nouvelles politiques urbaines". (Halal, I.2007).Elle est considérée commeunesolutionàdenombreuxproblèmes, notamment : la ségrégation, l’exclusion, la discrimination, la distinction (ethniques, résidentielle, religieuse, raciale, etc.), le communautarisme, et la création des quartiers défavorisés (zones sensibles, quartiers interdits et ghettos). Le principe de la mixité sociale s’applique à différentes échelles elle peut se dérouler au niveau des quartiers et des ilots mais aussi au niveau des bâtiments.
En outre, Il arrive que le concept de la mixité sociale soit aussi appelé la mixité de la population. Divers critères permettent de différencier les populations : les origines, la composition de famille ou les situations sociales, la distinction hommes/femmes, la distinction par âge et les catégories socioprofessionnelles (données de l’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)).
Pour résumer les définitions susmentionnées, promouvoir la mixité sociale, c’est donc fournir un habitat diversifié qui satisfait aux besoins des habitants, favoriser les lieux d’échanges et de rencontres, mêler les populations d’origines et de milieux sociaux divers et offrir les opportunités de contact entre des personnes de différentes générations dans un même espace de vie
CHAPITRE I : La mixité
réussir la ville 10
urbaine : mixité des fonctions et des usages pour mieux
II.2 La mixité fonctionnelle : sortir du zonage des territoires
Selon le dictionnaire Lagazette, la mixité fonctionnelle désigne : « la pluralité des fonctions économiques, culturelles, sociales, transports…etc. sur un même espace : quartier, lotissement ou immeuble ». (Lagazette ,2022).
Du point de vue de Chantal Aïra-Crouan : « Les préoccupations autour de la mobilité et du développement durable rendent indispensable la mixité fonctionnelle et urbaine. Elle a le pouvoir de soigner les maux de nos villes qui ont eu tendance à se développer trop vite et de façon peu optimale ». (Chantal, C.2021).
Par conséquent, afin de promouvoir la mixité fonctionnelle, il est nécessaire d'élaborer une grande variété de fonctions : administration, commerce, politique, loisirs, culte, culture, santé et services publics et sociaux. Néanmoins, l’adoption de cette notion ne signifie pas seulement la diversité des fonctions, elle demande également une bonne organisation et une forte interrelation entre les différents secteurs. La mixité fonctionnelle permettra de favoriser l'existence des équipements attrayants dans la zone aménagée, d’encourager la présence des activités attractives (marchés, foires, fêtes, divers événements) et de créer des espaces publics et de rencontre de qualité.
En outre, Les discussions sur la mixité des fonctions urbaines devraient être axées sur la structure de l'agglomération (niveau régional) ; sur la morphologie urbaine (niveau local) et jusqu'à l’échelle de l’immeuble. Sur le plan local, le tissu urbain apparaît à un niveau de détail qui permet de percevoir les rues, la taille des ilots, les bâtiments tandis qu’au niveau régional nous ne pouvons percevoir la forme urbaine que de façon plus générale.
Pour conclure, le but de cette notion est de maîtriser la consommation spatiale, et de maintenir les qualités architecturales et urbanistiques : la bonne division des espaces, la flexibilité de la circulation horizontale et verticale, l’adéquation des services de proximité, l’accessibilité aux lieux d’emploi, aux équipements et aux espaces verts, l'encouragement du développement des commerces et des restaurants au niveau du rez-de-chaussée et l’évitement de la présence envahissante de véhicules automobiles …etc. tout en diffusant les attentes diversifiées des populations et leur mixité sociale.
II.3 La mixité architecturale : un moyen pour éviter la monotonie spatiale
La mixité architecturale est une dimension de la mixité urbaine qui consiste à regrouper plusieurs fonctions au sein d'un même immeuble (affecter certains étages aux services et activités commerciales, d’autres aux bureaux et d’autres aux logements...etc.)
CHAPITRE I : La mixité
:
la
11
urbaine
mixité des fonctions et des usages pour mieux réussir
ville
Cette mixité des fonctions permet de créer une synergie entre les occupants et les fonctions occupées par l'immeuble, faisant de ce dernier un pôle d'attraction très important en termes d'investissement en particulier pour un usage commercial qui bénéficie de la contribution du logement. La dynamique créée par l'interaction entre les fonctions (résidentielcommercial, commercial-bureau et inversement) contribue non seulement à l'animation du bâtiment, mais aussi du site.
La notion de la mixité architecturale n’est pas uniquement représentée par le regroupement de nombreuses fonctions dans un seul immeuble, mais vise également à diversifier les logements collectif, individuel et intermédiaire et les différentes étapes de la chaîne de l’habitat (location, accès et investissement), varier aussi les formes, les couleurs, les textures et les matériaux des divers bâtiments
En effet, le concept de la mixité architecturale n’a pas qu’un seul impact sur l'attractivité et le dynamisme des espaces urbains, il influe également la façon dont les bâtiments sont construits, développant la créativité et l'innovation architecturales, notamment dans la production urbaine.
En guise de conclusion, Les trois mixités sont totalement différentes, la première c’est pour mêler les différents types de population et créer des lieux d’échanges et de rencontres, la deuxième concerne le mélange des fonctions urbaines à l’échelle du quartier, de l’ilot et de l’immeubleetladernièreapourobjectifdecombinerdiverses fonctionsensembledanslemême bâtiment. Mais elles sont aussi complémentaires, quand l'une de ces trois dimensions disparaît, il n'existe plus de mixité urbaine.
III. Les conditions de la mixité urbaine
L'injonction de la mixité urbaine n'indique jamais comment elle devrait être évaluée ou mesurée. Mais il faut remplir certaines conditions pour créer un district urbain mixte, à savoir :
III.1 La densité urbaine : Une notion clé pour la mixité urbaine
Lorsque nous parlons de densité urbaine, nous parlons habituellement de densité démographique, c'est-à-dire le nombre de personnes par kilomètre carré. Elle porte en priorité sur l’habitat car il s’agit de la principale préoccupation des habitants et ne se limite pas à un objectif quantitatif, c’est l'offre qualitative qui détermine le succès de la densification. Construire davantage de logements est aussi une possibilité de construire mieux en intégrant les enjeux et les besoins des habitants : typologies diversifiées (superficie des logements,
CHAPITRE I : La
12
mixité urbaine : mixité des fonctions et des usages pour mieux réussir la ville
occupation/inoccupation), modes de financement, gestion des factures énergétiques, amélioration des parcours résidentiels et de la mobilité, facilité d'accès à des services urbains.
Donc, la densité peut ainsi accroître la mixité sociale et rééquilibrer certains territoires par l’augmentation de l’offre de logements sociaux, elle favorise également la mixité fonctionnelle par la recherche d'un équilibre entre logements, emplois, commerces et équipements et tout cela permet d’assurer le bien-être des usagers.
III.2 La proximité urbaine : Un antidote de l’éloignement
L'expression « proximité » désigne le voisinage dans l’espace, une accessibilité facile aux diverses fonctions commerciales, culturelles, éducatives …etc.
Le zonage estime que les quatre activités de la vie des individus (habiter, travailler, circuler et se récréer) doivent être séparées pour optimiser l’organisation de la ville. Ce modèle urbain a été critiqué pour ses inconvénients qui sont : une augmentation des distances pour se déplacer entre les fonctions, un usage systématique de l'automobile dans un contexte où les prix du pétrole augmentent, des zones résidentielles inanimées la journée et des zones d'activités videslanuit créent des problèmes d'insécurité,et pourréglerses lacunes laplanificationurbaine redécouvre la notion de l’urbanisme de proximité, qui est un urbanisme à courte distance qui promeut la marche et le vélo, réaffirme le sentiment d'une bonne cohabitation et permet également de faire vivre les quartiers à n’importe quelle heure de la journée, et à tout moment de la semaine.
Donc pour répondre aux objectifs de la mixité urbaine, il est nécessaire de tenir compte la notion de proximité
III.3 La polycentralité urbaine : Un centre unique ne suffisant plus Lévy et Lussault, caractérise le centre urbain comme étant « un espace de densité, de diversité maximale et de couplage le plus intense entre celle-ci et celle-là » (Lévy & Lussault ,2003) Le terme de polycentralité doit être vu comme un dérivé de la centralité, c'est-à-dire le fait qu’il y ait plusieurs centralités au sein d’une même agglomération et donc plusieurs centres ayant des fonctions différentes, il est apparu en réaction aux problèmes de la monocentralité ; La marginalisation des périphéries était la cause principale de l’éloignement des diverses fonctions, les habitants se trouvaient obligés de se déplacer de leurs quartiers pour répondre à leurs besoins quotidiens.
Cette notion ne permet non seulement de renforcer la mixité fonctionnelle mais aussi la mixité sociale et architecturale ; La création de plusieurs centres nécessite la construction de
CHAPITRE I
La
13
:
mixité urbaine : mixité des fonctions et des usages pour mieux réussir la ville
nombreux bâtiments et espace publics ce qui contribue à la diversité des façades et des silhouettes urbaines, offrant plus de postes de travail, créant des lieux de rencontre et d’échanges et mêlant la population.
III.4 La mobilité urbaine : Un territoire facilement accessible à pied
La mobilité urbaine désigne la circulation des personnes à l'intérieur d'une ville, elle met l’accent donc sur une zone urbaine limitée et ne porte pas sur la mobilité interurbaine ou rurale, tous les moyens de transport en supposant que les limites de la ville soient dépassées sont ainsi exclus de cette notion La mobilité urbaine se concentre sur le flux de déplacements au cœur d'une même ville, et inclut les trajets quotidiens et récurrents des résidents, que ce soit pour le travail, les courses ou les loisirs
Le PACE (Plan Air Climat Energie ,2014) considère que: « L’un des principes d’aménagement du territoire favorisant la mobilité soutenable est (...) de favoriser la mixité des fonctions », tandisquele SDER(Schémadedéveloppementdel’espace régional) préconise de renforcer la structure des villes et villages en y favorisant la mixité des activités économiques, des logements et des équipements culturels de proximité ; ou encore de réduire la longueur des déplacements, et pour ce faire il faut « freiner la dispersion des fonctions par leur regroupement dans les centres urbains et les noyaux d’habitat, et rapprocher les unes des autres les fonctions complémentaires » (SDER,1999).
Le concept du transport urbain exige que la zone doit être restreinte, elle doit contenir les diverses fonctions urbaines dont la population a besoin, il vise principalement la réduction de la congestion, l’offre d’un stationnement plus aisé, la fluidité du réseau routier et la diminution de la pollution atmosphérique.
III.5 Le paysage urbain : Un miroir de la mixité urbaine
Selon Samuel Leturcq (1999), le paysage peut être défini, très simplement, comme la vision qu’un individu peut avoir d’un environnement particulier. Ce peut être un paysage rural, mais aussi un paysage urbain, un paysage de champs ouverts ou un paysage de bocage, des champs ou une forêt. Le paysage urbain est un environnement bâti qui offre aux gens des espaces de vie qui évoquent un fort sentiment d'appartenance, d'intégration et d'identité, tout en respectant et en valorisant le patrimoine urbanistique, architectural, naturel et culturel.
La diversité des volumes, des styles de façades, l’utilisation de différents matériaux, couleurs, textures, ambiances et la présence de la végétation sont des critères qui doivent être mises en place, permettront de fournir une bonne qualité paysagère de l’espace urbain et celle-
CHAPITRE
14
I : La mixité urbaine : mixité des fonctions et des usages pour mieux réussir la ville
ci est en elle-même un reflet de la mixité urbaine qui rendre l’environnement dans lequel les individus se trouvent plus agréable.
(Source : Travail d’auteurs)
IV.La mise en œuvre de la politique de la mixité urbaine
Les valeurs de la mixité urbaine doivent être valorisées pour que les problèmes de ségrégation urbaine et de fragmentation sociale ne s’aggravent plus, pour ce faire, des mécanismes d’amélioration des conditions de vie urbaine ont été intégrés dans les différentes stratégies de développement, mis en œuvre par les nouvelles pratiques de la politique urbaine, sociale et publique tant à l’échelle nationale qu’internationale.
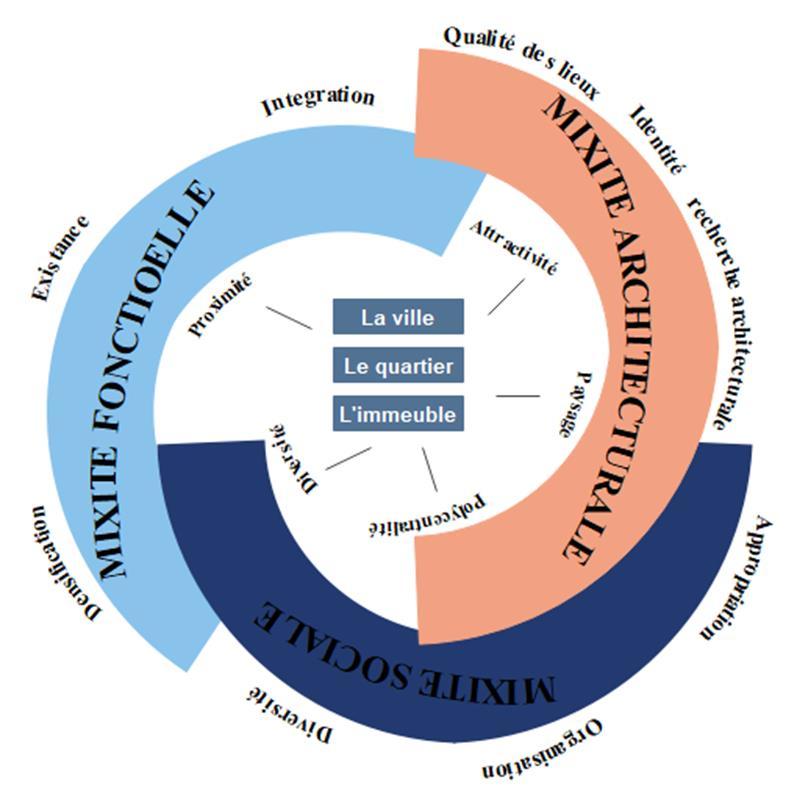
IV.1 En Europe
La politique de la mixité urbaine est l’une des plus importantes politiques européennes, jusqu’aux années quatre-vingt, la mixité urbaine, malgré son usage constant, n’était pas encore une question politique mais, une question technique, c’est après cette date que la notion a alors
CHAPITRE I
La
la
15
:
mixité urbaine : mixité des fonctions et des usages pour mieux réussir
ville
Figure 1 : Le lien entre les échelles, les conditions et les dimensions de la mixité urbaine
pris une nouvelle dimension et qu’elle s’est imposée comme un enjeu politique sociale et environnementale.
Les cadres de planification urbaine en Europe ont changé vers un urbanisme basé sur le développement durable depuis la conférence des nations unies sur l’environnement et le développement en 1992 à Rio de Janeiro, au cours de laquelle de nombreuses préoccupations et enjeux ont été soulevées (protéger la biodiversité, diminuer les gaz à effet de serre et réduire les inégalités sociales …). Et la mixité urbaine a été largement reconnue comme un mécanisme utile pour atteindre les objectifs de développement durable.
Le développement durable est étroitement lié à la politique de renouvellement urbain, il considère la mixité urbaine comme un enjeu politique social et environnemental et présente le renouvellement urbain comme étant un outil de mise en œuvre de la mixité urbaine , en visant principalementlerenforcementdelasolidaritégéographique,l’amélioration dufonctionnement des quartiers et de la qualité des espaces publics, la diversification de l'habitat et des services et l’assurance de la cohésion sociale.
En effet, la politique urbaine européenne, en mettant en œuvre la mixité urbaine vise à améliorer la qualité de la vie urbaine en (ré) créant des paysages urbains européens compacts avec des mélanges intégrés d'installations résidentielles, commerciales, d’équipements publics et des espaces d’échanges.
IV.1.1 Mécanismes de la mixité urbaine en France
La problématique de la mixité urbaine dans la villeest désormais tellement répandue dans la société française. Depuis les années 1990, le concept de diversité de l’habitat a été promu et il est devenu l'un des principaux instruments de la politique gouvernementale. Il s’agit de la nouvelle étiquette des politiques urbaines.
Afin de réussir l'introduction du principe de la mixité urbaine dans la démarche de la planificationetaménagementdesterritoiresfrançais,plusieursloisetoutilsontétémisenplace. Nous mentionnons :
- La loi d’orientation pour la ville (LOV), (13 Juillet 1991)
- La Loi de Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU), (13 décembre 2000).
- Le schéma de cohérence territoriale (SCOT), (13 décembre 2000).
- Le plan local d’urbanisme(PLU), (13 décembre 2000) qui a remplacé le plan d’occupation des sols (POS).
16
CHAPITRE I : La mixité urbaine : mixité des fonctions et des usages pour mieux réussir la ville
CHAPITRE I : La mixité urbaine : mixité des fonctions et des usages pour mieux réussir la ville
Tableau 1 : la mise en œuvre de la mixité urbaine en France: l’agglomération Nantaise (source : Centre de Recherche pour l’Etude et l’Observation des Conditions (CREDOC), 2007).

Référentiel cadre normatif Égalité – Référentiel démocratique Développement durable
Problèmes à résoudre
Objectifs
Instruments
- Inégalités sociales et écarts de développement entre les territoires.
- Risques de violences urbaines
- Satisfaction des besoins des habitants
- Lutte contre le chômage.
- Retour dans le droit commun.
- Cohésion sociale.
- Discrimination positive territoriale sous forme d’exonérations de charges pour les entreprises
- Implantation d’équipements et d’activités dans les quartiers d’habitats sociaux
-Pollution atmosphérique
- Réduction des besoins de déplacements
- Limitation de la voiture individuelleau profitdesmodesde déplacement doux
-Densificationetmixitédelaville
- Amélioration de l’offre des transports collectifs
Territoires visés
Lois
- Quartiers de la géographie prioritaire
- Pacte de Relance de la Ville 1996.
- Loi Borloo 2003.
-Ensembledelaville,si cen’est de l’agglomération
-Loi SRU 2000.
Pour illustrer les mécanismes mis en place par la politique de la ville en France notammentencequi concernelamiseenœuvrede lamixité urbaine, nous avons choisi leprojet du quartier de Bonne, qui est un projet de renouvellement, de reconversion et de réinsertion : Le quartier de Bonne est l’un des premiers éco quartiers en France crée par l'agence d'Architectes AKTIS ARCHITECTURE pour remplacer une ancienne zone militaire d'environ 8 hectares au centre de Grenoble. Les actions et les interventions menues par l’État en matière de la mixité urbaine dans ce quartier sont :
• Une bonne mixité fonctionnelle et ce, dû à la présence de l'ensemble des fonctions nécessaires : un espace commercial de 15000 m², une école, une piscine communale, des logements, unhôtel et unespace cultural seregroupent autourdes espaces verts(unedisposition contraire à la stratégie du zoning urbain)

17
Figure 2 : Plan de masse du quartier de Bonne (Source : https:// besustainable.brussels)
Figure 3 : Mixité urbaine dans le quartier de Bonne (Source : Travail d’auteurs)
CHAPITRE I : La mixité urbaine : mixité des fonctions et des usages pour mieux réussir la ville



• Une mise en œuvre de la mixité architecturale par la diversité du traitement architectural des différentes façades (rythme, disposition, taille…) et l'utilisation de plusieurs matériaux et différentes couleurs et tout ça pour créer un paysage animé.

• Une affirmation de la mixité sociale par la création des places publics, des espaces verts et de loisirs pour renforcer la rencontre entre les habitants et la communication entre les différentes tranches d'Age (adultes, Jeunes, enfants).
IV.2 La problématique de la mixité urbaine en Algérie : L'urbanisme algérien a évolué au fil des années ; Plusieurs politiques ont été adoptées et des méthodes d'aménagement urbain ont été mises en place depuis l'indépendance jusqu'à présent. Nous évoquons dans cette partie les principaux tournants de la politique urbaine, tout en essayant d’exposer les formes d’émergence du concept de la mixité urbaine dans le discours politique algérien, ainsi que les évolutions successives des mécanismes de sa mise
;
18
en œuvre, à savoir
Figure 4 : La mixité architecturale à Bonne (Source :http://rp.urbanisme.equipement.go uv.fr/puca/)
Figure 5 : Traitement architectural des façades à Bonne (Source : http://rp.urbanisme.equipement.gouv.fr/puca/)
Figure 6 : Espaces publics à Bonne (Source : http://rp.urbanisme.equipement.gouv.fr/puca/)
Figure 7 : Parc urbain à Bonne (Source : http://rp.urbanisme.equipement.gouv.fr/puca/)
IV.2.1 La politique des ZHUN :
A partir des années 1970, la crise du logement a été considérablement exacerbée par la croissance démographique, l'exode rural vers les villes et l'industrialisation, incitant les dirigeants algériens à adopter un urbanisme fonctionnaliste.
Une étude réalisée par ‘’Farida Naceur et Abdellah’’ sur les zones d’habitat urbain nouvelles enAlgériemontrequel’urbanisme«fonctionnaliste» apermis detrouverrapidement des solutions à travers des processus de standardisation et de préfabrication ; Cela a conduit à l’émergencedeszonesd’habitaturbainnouvelles«Z.H.U.N»danslesvillesalgériennes (Farhi & Naceur, 2003).
En effet, les « Z.H.U.N » ont été le moteur de l’urbanisation , elles se caractérisaient par une construction rapide à faible coût, répondant à la forte demande de logements par une extension verticale et une occupation foncière minimale libérant des espaces extérieurs sans aménagement et logeant lapopulation demanièrestandardsans offrirun cadredeviedequalité, ce qui apporte une pollution visuelle, une dégradation des qualités architecturales (des façades pauvres et une architecture répétitive et monotone),des espaces verts inexistants ainsi que des contraintes quotidiennes d'inconfort et d'incommodité pour les habitants. Ces désagréments se manifestent sous plusieurs formes : l’absence de contact, l’isolement, l’anonymat renforcé par le manque de lieux de regroupement. Les Z.H.U.N sont quasiment dépendantes du centre-ville ; les résidents doivent s'y déplacer et utiliser les automobiles pour subvenir à leurs besoins quotidiens.
Cette période a été marquée donc, par une urbanisation quantitative monofonctionnelle, la mixité urbaine n’était pas encore un enjeu politique mais plutôt un enjeu technique.
IV.2.2 L’émergence du développement durable
A partir des années 2000, l’Algérie s’est lancée dans une nouvelle réflexion relative à la mise en œuvre d’une politique durable et plurisectorielle
La loi 01-20 du 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable aétépromulguée, ellea mis enplaceunensemble dedispositifset instruments d’aménagements et de développement dans le but de créer un rééquilibrage des principales composantes du territoire national, d’assurer la cohésion spatiale et sociale des villes, de renforcer l’attractivité des territoires et des espaces urbains, et donc de proposer aux habitants un cadre de vie de qualité sain, et durable.
CHAPITRE I : La mixité urbaine : mixité des fonctions et des
pour mieux réussir la ville 19
usages
VI.2.3 La politique de la ville et le renouvellement urbain
En 2006, La promulgation de la loi d’orientation de la ville (la loi 06-06) a donné naissance à une véritable politique de la ville caractérisée par une approche exhaustive des programmes, développée selon un processus concerté et coordonné, qui propose un projet de ville multidimensionnel, multisectoriel et multilatéral et qui met en avant les principes de déconcentration et décentralisation, de gestion de la proximité et de réduction des inégalités sociales et des écarts de développement entre les territoires
En fait, le passage de la rénovation urbaine (action classique d’intervention) au renouvellement urbain issu de la nouvelle politique urbaine a également joué un rôle majeur dans la mise en œuvre de la mixité urbaine en Algérie, le renouvellement urbain est lié avec le développement durable, ils forment ensemble un remède aux problèmes sociaux, économiques, environnementaux et urbanistiques ; Leurs objectifs visent principalement de sortir du développement monofonctionnel ,de renforcer la mixité fonctionnelle, sociale et architecturale, de réduire l'étalement urbain ,de maitriser la croissance urbaine, de diminuer les besoins de déplacements, de protéger l’environnement global, et d’améliorer la réalité urbaine
L’adoption des principes de développement durable en Algérie a permis le recours à une urbanisation qualitative polyfonctionnelle, la recherche de la qualité urbaine a conduit à considérer la mixité urbaine comme un enjeu à la fois politique social et environnemental.
Pour conclure, La mixité urbaine et sociale en Algérie est née d’un état d’urgence non planifié, qui a conduit à la création de quartiers mixtes sans pour autant assurer le bien-être des habitants
Pour réussir la mise en œuvre du concept de la mixité urbaine, nous devons prendre en considération d’autres dimensions : la troisième dimension (mixité verticale) qui permet d'organiserlesactivitésverticalementsurlamême parcelle,etlaquatrièmedimension (échelle temporelle) qui veille sur l’application des interventions proposées à court, moyens et long terme. La mixité urbaine doit être liée à une planification à long terme, dans le but d’accueillir de nouvelles populations, de maintenir les activités économiques et de planifier la réalisation d’équipements publics ; À l’échelle de l’action opérationnelle (le quartier, le secteur…), elle débouche sur des projets d’aménagements mixtes à moyen terme et au niveau de l’ilot et de la parcelle, elle se traduit par des projets à court terme.
CHAPITRE I : La mixité urbaine : mixité des fonctions et des usages pour mieux réussir la ville 20
CHAPITRE I :
mixité urbaine : mixité des fonctions et des usages pour mieux réussir la ville
Conclusion
La mixité urbaine constitue aujourd’hui un outil primordial de planification urbaine, elle se présente comme un référentiel pour les politiques publiques urbaines de lutte contre la ségrégation sociale et la scolarisation spatiale et fonctionnelle, et de réussite de la vie urbaine tant à l’échelle de la ville qu’à l’échelle d’ilot et même encore qu’à l’échelle d’immeuble.
Les idées de fusion, de diversification et de coexistence ont été adoptés principalement pour remédier aux lacunes constatées dans le système urbain, dans de but de pouvoir garantir une transformation harmonieuse des lieux résidentiels, de présenter une offre diversifiée des services urbains, de concevoir des espaces de solidarité urbaine, et donc d’assurer une accessibilité facile et équitable de tous les habitants aux différentes fonctions urbaines
A cet effet, la mixité urbaine est généralement liée à trois dimensions : fonctionnelle, sociale et architecturale, elle ne peut trouver son sens qu’à travers l’étude des problématiques qui s’articulent autour de : la relation habitat / emplois, le lien habitant /espace de vie ou encore l’interaction qui existe entre le mode de vie et la qualité du cadre de vie des citoyens.
21
La
CHAPITRE II :
LE BIEN-ÊTRE URBATECTURAL:
UNE APPROCHE A DEUX ECHELLES POUR
BIEN VIVRE LA VILLE
Chapitre II : Le bien-être urbatectural : une approche à deux échelles pour bien vivre la ville
Introduction
« Le bien-être d’un individu est une combinaison subtile entre ses aspirations et ce que lui offre son espace de vie sachant que ce dernier influence ses aspirations » Bourdeau-Lepage, 2019.
De tout temps, la principale préoccupation de l’homme a toujours été comment satisfaire ses besoins et ses désirs afin de vivre une vie épanouissante. Selon la pyramide des besoins de Maslow une fois ses besoins physiologiques sont satisfaits, la nature humaine tend à se tourner vers des besoins plus subjectifs comme le bien-être.
Bien que la notion du bien-être soit difficile à appréhender elle occupe une place de plus en plus importante dans l’architecture et l’urbanisme et devient un véritable enjeu des pouvoirs publics, et ce, depuis l’émergence du concept de développement durable où la mixité urbaine est introduite comme un mécanisme utile pour atteindre les objectifs de durabilité urbaine et améliorer la qualité de vie des habitants. Cependant, la façon dont la mixité urbaine améliore la qualité de la vie urbaine et leur assure le bien-être est mal comprise.
Dans notre recherche, le bien-être qui nous intéresse est une combinaison entre le bienêtre que l`individu a à voir avec lui-même et son expérience personnelle et le bien-être fondé sur un ensemble d`éléments constitutifs que le territoire offre à ses habitants.
Dans ce chapitre, nous allons présenter la notion du bien-être dans une lecture générale en premier lieu avant de l’aborder dans des échelles plus spécifiques et les assimiler au final.
I. Le bien-être
I.1 Le bien-être : Une notion à multiples facettes
« Le bien-être est une notion bien plus vaste que la qualité de vie ou la satisfaction du client. Il est basé sur une compréhension holistique des besoins et des capacités de l'homme. Le bien-être est insaisissable, hautement subjectif et constitue le bien le plus précieux de l'humanité » Bill Thomas (2004).
Le bien-être est un concept relatif et multidimensionnel avec des mesures complexes. C’est un concept qui s’appréhende de différentes manières, et même au sein d’une discipline les chercheurs peuvent l’aborder et le définir de diverses façons. Selon les définitions les plus courantes, le bien-être se veut être une aisance matérielle qui permet une existence agréable.
22
Chapitre II : Le bien-être urbatectural : une approche à deux échelles pour bien vivre la ville
Étymologiquement, le terme bien-être est composé de l’adverbe bien et du verbe être. Le dictionnaire Larousse le définit comme étant un état agréable résultant de la satisfaction des besoins du corps et du calme de l’esprit, autrement dit éprouver une sensation de bienêtre.
Les penseurs de l’Antiquité à savoir Aristote et certains philosophes de la Grèce antique l’ont décrit comme une manière d’être, un état de l’âme, une forme de bien agir, et même comme une finalité de toute action. D’autres l’ont confondu avec d’autres notions à savoir le plaisir et le bonheur comme Platon qui pensait que le bien-être signifie la maximisation des plaisirs.
Du point de vue physique, le bien-être est la résultante d’une bonne santé physiologique, et du point de vue psychologique, le bien-être signifie l’absence de troubles mentaux.
La notion du bien-être est donc très subjective et difficile à appréhender, elle était le sujet de nombreux débats et recherches, quant à sa définition, les recherches qui ont été menées sur ce concept distinguent deux approches principales du bien-être : l'une subjective et l’autre objective.
I.1.1 Le bien-être subjectif
Ed Diener (1984, 1998, 2006) définit le concept de bien-être subjectif comme étant une prédominance dans l'expérience consciente d'un individu, d'évaluations cognitives et émotionnelles positives par rapport à la perception d'expériences négatives ou désagréables.
D’après lui il existe trois composantes qui constituent un état de bien-être subjectif :
● Le bien-être hédonique : auto perception d’autonomie, compétence, but dans la vie, locus de contrôle, c’est-à-dire les dimensions et événements sur lesquels on pense avoir le contrôle ;
●Les états positifs et négatifs : expériences de joie, de bonheur, de fierté et d’anxiété, de tristesse, de douleurs ;
● L’évaluation de la vie : satisfaction au travail, sentiment de sécurité.
Le bien-être subjectif est donc une combinaison d’un sentiment de bonheur et de satisfaction à l’égard de la vie qui diffère d’un individu à un autre.
I.1.2 Le bien-être objectif
Contrairement à l’approche du bien-être subjectif, le bien-être objectif est associé à la notion de prospérité, d'abondance, de développement et de richesse (Breda & Goyvaerts, 1999). L'idée de prospérité symbolise principalement les aspects matériels de la vie. Le concept de bien-être objectif est défini comme « avoir des ressources suffisantes pour atteindre des conditions de vie satisfaisantes selon ses propres préférences ».
23
Chapitre II : Le bien-être urbatectural : une approche à deux échelles pour bien vivre la ville
Le bien-être objectif peut renvoyer à des concepts différents tels que le bien-être matériel (Sirgy, 2012), le bien-être sociétal (Easterlin, 2000) ou encore le capital social (Helliwell et Putnam, 2004).
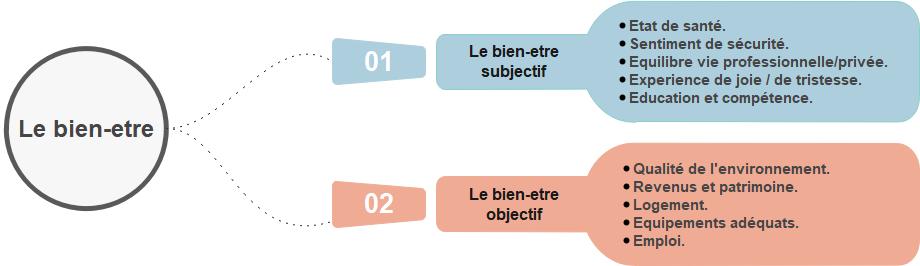
Nous concluons donc que ces définitions et ces approches mettent en évidence le fait que le bien-être est mieux compris comme un concept à multiples facettes que nous pouvons définir de manière subjective et objective.
I.2 Les dimensions du bien-être
Les recherches menées sur le bien-être ont montré que cette notion possède essentiellement six dimensions qui sont :
I.2.1 Le bien-être physique
Le bien-être physique est défini selon l’INEE (Inter-agency Network for Education in Emergencies) comme étant la capacité à participer à des activités physiques et à effectuer des fonctions sociales qui ne se sont pas gênées par des limitations physiques, par le fait de subir une douleur physique et par des indicateurs biologiques de santé.
En d’autres termes, le bien-être physique consiste à bien manger, faire des exercices régulièrement et être en forme avec soi-même et avec son entourage.
1.2.2 Le bien-être social
L’INEE définit le bien-être social comme un état d'aboutissement dans lequel les besoins humains élémentaires sont satisfaits et dans lequel les personnes sont capables de coexister pacifiquement dans des communautés proposant des opportunités de développement. Il s'agit donc de la relation de l’individu avec les autres et de la qualité de la communication avec eux.
24
Figure 8 : Les approches du bien-être. (Source : L’Organisation de coopération et de développement économique, 2013, adapté par les auteures)
Chapitre II : Le bien-être urbatectural : une approche à deux échelles pour bien vivre la ville
I.2.3 Le bien-être émotionnel
Le bien-être émotionnel est la capacité de l’individu à comprendre, à assimiler ses émotions et à contrôler son anxiété. Il s’agit donc de trouver un équilibre entre les émotions positives et négatives.
I.2.4 Le bien-être spirituel
Cette dimension varie d'une personne à l'autre, elle consiste à trouver un sens et un but à la vie. Ellison (1983) définit le bien-être spirituel comme l’affirmation de la vie en relation avec Dieu, avec soi-même, avec la communauté et avec l’entourage, autrement dit, c’est de vivre en harmonie avec notre environnement en intégrant nos croyances et nos valeurs.
I.2.5 Le bien-être mental
Le bien-être mental dans son ensemble est un état de satisfaction dans divers domaines de la vie, y compris les relations, le travail et la société. Il dépend de ce que nous pensons, ressentons et comment nous gérons les bons et les mauvais moments de notre vie quotidienne.
Cette dimension est également liée aux facteurs externes, à savoir les bâtiments dans lesquels nous vivons. Les couleurs, la lumière, les textures, les formes des constructions sont des éléments qui peuvent avoir des répercussions profondes sur notre humeur et notre bienêtre mental.
I.2.6 Le bien-être environnemental
« La santé et la productivité humaines sont grandement affectées par les bâtiments dans lesquels nous habitons. Notre santé physique et notre bien-être sont étroitement liés à la qualité des environnements dans lesquels nous passons notre temps. » (MCLENNAN ; 2004).
L'environnement urbain est une création totalement humaine. En plus de s'adapter à son environnement naturel, l'homme crée aussi son propre espace de vie. L'intérêt de cette création est de répondre aux besoins et aux attentes de la population, en leur assurant une meilleure qualité de vie et de confort dans les espaces extérieurs.
I.3 Les déterminants du bien-être
La notion du bien-être est influencée par de nombreux éléments appelés déterminants. Nous regroupons ces déterminants en deux grandes catégories :
● Les déterminants objectifs : cette catégorie renvoie à l’ensemble des composantes de conditions de vie matérielles et immatérielles qui peuvent générer un sentiment de bienêtre chez l’ensemble de la population.
● Les déterminants subjectifs : cette deuxième catégorie tient en compte l’évaluation subjective que chacun porte de sa vie ou de la société à laquelle il appartient, c’est-à-dire une évaluation personnelle et incontestée d’un sentiment de bien-être.
25
Chapitre II : Le bien-être urbatectural : une approche à deux échelles pour bien vivre la ville
I.4 Perception spatiale du bien-être
La perception représente l’ensemble des mécanismes et des processus par lesquels l’organisme prend connaissance du monde et de son environnement sur la base des informations élaborées par ses sens (Le Grand Dictionnaire de la psychologie Larousse, 2002). La perception de l’espace quant à elle, est un processus de filtrage successif du réel, qui conduit à passer d’une réalité objective à une perception subjective d’un espace (A. Bailly, 1977).
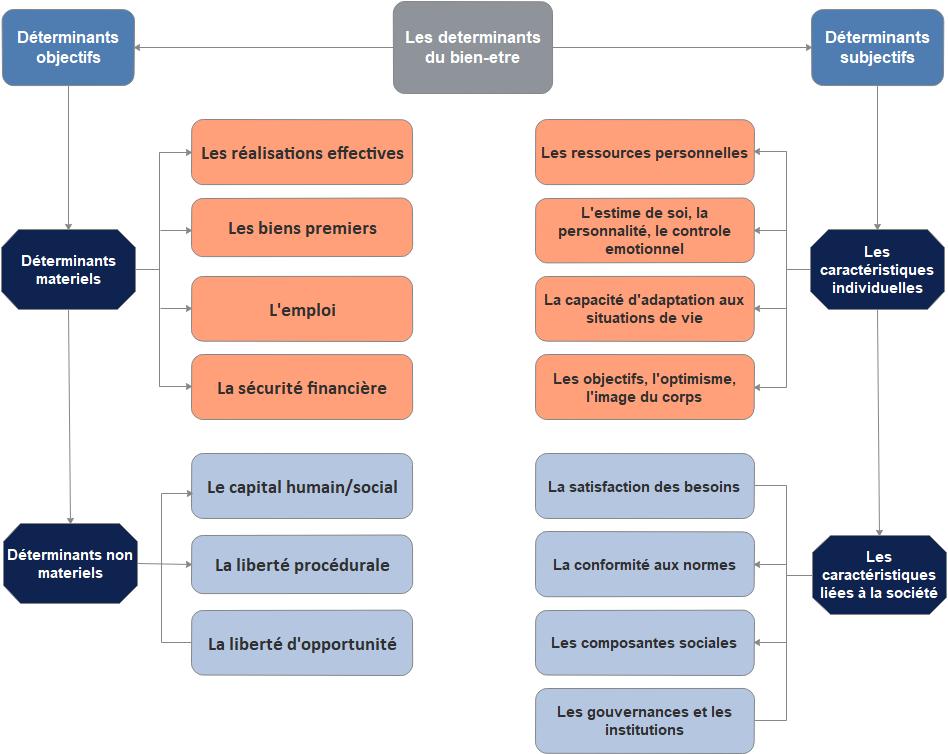
L’espace est une notion très vaste, c’est pourquoi avant de parler de la relation hommeespace nous devons tout d’abord décrire les trois dimensions de l’espace que les géographes ont introduit. L'espace s'appréhende en trois temps :
● L'espace de vie que Ph. Gervais-Lambony définit comme l’espace où s’inscrivent la vie quotidienne et l'univers relationnel des citadins, et M. Lussault comme l'espace des pratiques spatiales, ou l’environnement extérieur.
26
Figure 9 : Les déterminants du bien-être (Source : Tite Voltaire SOUPENE, 2011 modifié par auteures)
Chapitre II : Le bien-être urbatectural : une approche à deux échelles pour bien vivre la ville
● L’espace vécu qui représente la relation subjective que tissent les habitants avec leurs lieux de vie. Sa connaissance passe par la prise en compte de leurs pratiques, leurs représentations, c'est-à-dire de leur perception-appréciation, et leurs imaginaires.
● L’espace perçu qui se constitue par la perception de l'espace de vie et l’espace vécu. Et c'est cet espace qui définit la relation avec l'altérité en créant ainsi une cohésion, une continuité comme il peut générer une coupure.
La problématique du bien-être repose souvent sur des paramètres objectifs, cependant, elle renvoie implicitement aux notions d’appartenance et d’appropriation qui sont des paramètres subjectifs. De nombreuses études se sont intéressées aux relations et aux interrelations entre l’individu et son espace. Ils ont finalement conclu qu’il existe un lien étroit entre la qualité de l’espace et la satisfaction perçue par les habitants. L’homme, par ses capacités visuelles, capte l’information que l’espace lui envoie, l’analyse et la comprend. La compréhension de l’espace dans lequel il se trouve et la capacité à pouvoir s’y projeter permet à l’utilisateur de s’approprier l’espace à sa manière. Cette appropriation va générer en revanche un sentiment de bien-être.
Un espace de bien-être est donc un espace dans lequel on retrouve un croisement entre les composantes objectives de cet espace et les composantes individuelles et subjectives de celui-ci.
C'est pourquoi le concept clé retenu dans notre recherche est celui de l’appréciation subjective fondée sur la perception individuelle des individus. Pour saisir cette appréciation, plusieurs indicateurs liés à la satisfaction ont été identifiés, notamment les caractéristiques, les désirs et les aspirations personnelles ainsi que les sentiments particuliers et la capacité d'adaptation. Il s'agirait donc d'identifier ses indicateurs, que nous évoquerons par la suite dans ce chapitre et qui permettront à l'individu de se sentir mieux et de se projeter dans l'espace conçu.
II. Le bien-être architectural : Concevoir pour le bien-être
Plusieurs études se sont intéressées aux interactions de l’espace architectural avec l’être humain. L’un des premiers architectes à s’être intéressé à la problématique d’humaniser l’espace architectural en donnant une meilleure qualité spatiale à celui-ci a été Alvar Aalto « Humaniser l'architecture revient à l'améliorer et exige un fonctionnalisme dépassant de beaucoup le seul domaine technique. On ne peut y parvenir que par des méthodes architecturales - en mettant en œuvre et en combinant différents phénomènes techniques afin d'offrir à l’homme la vie la plus harmonieuse possible. » (Alvar Aalto, la table blanche et autres textes, 2012).
27
Chapitre II : Le bien-être urbatectural : une approche à deux échelles pour bien vivre la ville
Dans les années cinquante, une collaboration est faite entre l’architecte Louis Kahn et le médecin Jonas Salk pour construire un établissement de recherche capable de stimuler la créativité des scientifiques. Cette collaboration a prouvé que la conception architecturale agit sur les pensées, les humeurs et les comportements des scientifiques et donc sur leur bien-être.
A partir des années quatre-vingt-dix, les chercheurs ont commencé à s'intéresser aux interactions de l’espace architectural avec le bien-être humain. La neuro-architecture est l'une des études qui s'intéressent à la façon dont notre corps et notre cerveau réagissent à l'architecture. D'après cette étude, l'espace architectural affecte fortement la dimension physique ainsi que psychique de l'être humain et donc son bien-être
II.1 Influence de l’espace architectural sur l’être humain
D’après plusieurs études l’impact des espaces architecturaux sur les personnes qui les utilisent est énorme. Les matériaux de construction, la lumière, la ventilation et la disposition spatiale peuvent tous affecter le bien-être mental et physique des habitants.
Nous prenons comme exemple une maison écologique, réalisée à partir de matériaux naturels, et bien orientée afin de profiter le plus possible de la lumière naturelle. Cette maison n’aura forcément pas le même impact qu’une maison construite comme une barre, hors échelle et sans âme.
La prise en considération de ce qu’un espace architectural peut nous faire ressentir est donc cruciale. Autrement dit, une architecture génératrice de bien-être est, comme dirait Melanie Dodd, 2020 « non pas à quoi elle ressemble, mais comment nous la ressentons, à travers la façon dont elle nous permet d'agir, de nous comporter, de penser et de réfléchir ».
II.2 Les vecteurs du bien-être architectural
Il existe une multitude de vecteurs qui peuvent être sélectionnés pour assurer le bienêtre architectural, nous allons les synthétiser en six vecteurs :
II.2.1 La lumière
La lumière est l'un des besoins humains les plus fondamentaux. Son impact significatif sur le bien-être humain est bien prouvé par les recherches et les données. La lumière doit donc être appréhendée comme un matériau dans la conception des projets architecturaux en vue d’aboutir à un projet porteur du bien-être.
II.2.2 La nature
La biophilie est la connexion qu’à l’architecture avec la nature. Les recherches menées sur cette approche ont montré que vivre dans un espace où on y intègre des éléments qui évoquent la nature (Terrasses végétalisées, espaces potagers, percées visuelles sur des
28
Chapitre II : Le bien-être urbatectural : une approche à deux échelles pour bien vivre la ville
espaces... Etc.) ou simplement avoir une vue sur la végétation participe à procurer un sentiment de bien-être aux occupants de cet espace.
II.2.3 Le confort
Le confort est défini comme étant l’ensemble de commodités produisant un bien-être. C’est une notion directement liée à la création d'espaces de bien-être physique et mental. Il joue un rôle essentiel en aidant l’utilisateur à se détendre et à se sentir calme et en sécurité.
Il existe plusieurs facteurs qui déterminent le confort dans un bâtiment : la température, l’humidité, la vitesse du vent, les dimensions des fenêtres, les couleurs des façades et les types de matériaux. Ces facteurs ne sont pas indépendants, ils agissent simultanément, il est donc extrêmement important que les architectes s'engagent à créer des espaces architecturaux confortables afin d’assurer le bien-être des habitants.
II.2.4 Le contrôle
D’après la psychologie, nous nous sentons plus satisfaits et plus heureux si nous croyons que nous avons plus de contrôle sur les choses qui nous entourent. Cela s’applique aussi sur les espaces dans lesquels nous habitons, c’est pourquoi dans la conception de tout bâtiment, il est primordial de s'assurer que ses utilisateurs se sentent maîtres de leur espace afin qu’ils puissent l’adapter à leurs besoins spécifiques.
II.2.5 L’esthétique
Bien que la beauté soit subjective et définie par l’évaluation et la perception de l’observateur. Cependant, certaines règles peuvent être suivies afin de procurer une architecture visuellement plus agréable et génératrice de bien-être, nous parlons des formes, des couleurs et des textures. L'importance de l'esthétique réside donc dans le fait que cette dernière influence positivement notre humeur, elle peut nous aider à nous sentir à l'aise et en sécurité.
II.2.6 La psychologie
Notre humeur est généralement influencée par les choses que nous percevons dont les bâtiments. En effet l’architecture peut affecter positivement ou négativement notre humeur, c'est pourquoi les concepteurs doivent tenir compte de la façon dont un bâtiment nous fait nous sentir. Cela peut être réalisé par de très petits gestes, par exemple : l’entrée d’un bâtiment est un élément qui crée souvent la première impression d’un bâtiment. Une mauvaise entrée peut être difficile et peut rendre le bâtiment peu attrayant contrairement à une entrée réussie, qui peut créer un sentiment d'appartenance chez les usagers, se traduisant par un sentiment de bien-être.
29
Chapitre II : Le bien-être urbatectural : une approche à deux échelles pour bien vivre la ville
III. Le bien-être urbain : mieux vivre en ville
Depuis quelques années, les travaux portant sur les relations ville et bien-être se sont multipliés, et ce, afin de comprendre comment une disposition urbaine pourrait affecter le bien-être de l’être humain. Ces travaux ont montré que les architectes et les urbanistes sont armés d’un potentiel pour concilier la relation Homme-Environnement en planifiant des villes où les citadins peuvent s’y sentir mieux.
Cependant, malgré les nombreuses recherches et études portant sur cette problématique, l’application de cette notion dans les projets urbains devient vite une tâche problématique parce qu’il s’agit d’une notion multidimensionnelle qui n’est pas entièrement comprise. Dans ce cadre, plusieurs chercheurs ont tenté de définir cette notion de diverses manières dont le géographe suisse Antoine Bailly, 1977, qui dans son ouvrage intitulé La géographie du bien-être définit le bien-être dans un territoire comme étant « le résultat des relations entre l’Homme, la société et le milieu, entre le Moi et l’extérieur, entre l’individu et le groupe (…) entre le mythe subjectif et le monde externe, entre les traits visibles et invisibles de la société »
Contrairement à Bailly qui aborde le bien-être comme synonyme de qualité de vie, le géographe André-Frédéric Hoyaux pense qu’il s’agit de deux notions distinctes, l'une fondée sur des critères scientifiques objectifs, l'autre subjective et dépendante de l'expérience personnelle. Pour lui, le bien-être découle de sa subjectivation par l’habitant contrairement à la qualité de vie qui relève d’une objectivation des conditions par un collectif.
Bourdeau-Lepage, chercheuse en géographie, va plus loin en produisant un indice de bien-être combinant l’approche objective et subjective. Elle développe des outils qui permettront de réaliser un diagnostic du bien-être dans l’intention de déterminer les éléments potentiellement constitutifs du bien-être en milieu urbain en essayant de répondre aux besoins de chacun. Son approche introduit dans son ouvrage : Évaluer le bien-être sur un territoire (2020) lie la subjectivité de l’individu et les éléments objectifs du territoire et se base sur quatre outils qui sont :
● OppChoVec : Outil permettant d’évaluer le bien-être sur un territoire de manière purement théorique sans consulter les habitants.
● TELL_ME : Outil composé d'un jeu de cartes qui permet de connaître les éléments jugés comme les plus importants pour le bien-être des individus d’un territoire.
● MAQUETTE-FOYER : Elle permet d’identifier et hiérarchiser les éléments matériels et immatériels de bien-être essentiels à l’échelle du foyer.
● ESCAPAT : C’est un outil qui se base sur les expériences et le vécu des habitants et leur permet de se projeter dans un territoire.
30
Chapitre II : Le bien-être urbatectural : une approche à deux échelles pour bien vivre la ville
III.1 Initiatives pour un meilleur bien-être en ville
La relation ville-bien-être a fait l’objet de plusieurs travaux de recherches. Ces derniers avaient pour but de comprendre comment nous pouvons apporter du bien-être aux citadins à travers la disposition urbaine. Dans ce cadre, plusieurs initiatives ont été tentées dont deux que nous présenterons ci-dessous :
III.1.1 Le concept ville-santé
Afin d’agir sur les déterminants de la santé et promouvoir le bien-être en ville, le bureau européen de l’OMS a créé le programme des Villes-Santé qui est un programme lancé par le bureau de l’OMS lors de l’élaboration de la Charte d’Ottawa, en 1986 première conférence internationale pour la promotion de la santé, visant « d’offrir des biens et des services plus sûrs et plus sains, des services publics qui favorisent davantage la santé et des environnements plus propres et plus agréables ».
Hancock et Duhl, (1988) définissent la ville-santé comme « une ville qui crée et améliore continuellement les environnements physiques et sociaux et qui développe les ressources de la collectivité, permettant ainsi aux individus de s'entraider dans l'accomplissement de l'ensemble des fonctions inhérentes à la vie et permettant ceux-ci de développer au maximum leur potentiel personnel. »
Les mesures évoquées par les membres du réseau Villes-Santé OMS afin d’améliorer le bien-être en ville sont résumées comme suit :
● Promouvoir l’activité physique par l’aménagement d’espaces attractifs, de parcs et de jardins de proximité ainsi que des aménagements piétonniers et cyclables.
● Améliorer la qualité de l’environnement extérieur par une conception réfléchie des constructions et des espaces publics, intégrant des systèmes de transports et des équipements urbains.
● Agir en faveur de la santé de tous et réduire les inégalités en considérant les impacts positifs et négatifs des projets urbains sur les individus et en encourageant la participation citoyenne.
III.1.2 Le bien-être comme pilier du développement durable
Une ville durable est selon Graham Haughton et Colin Hunter, 1994 une ville dans laquelle les habitants et les activités économiques s'efforcent continuellement d'améliorer leur environnement naturel, bâti et culturel au niveau du voisinage et au niveau régional, tout en travaillant de manière à défendre toujours l'objectif d'un développement durable global. Promouvoir le bien-être des citadins est l’une des conditions essentielles dans l’aménagement des villes dites durables.
31
Chapitre II : Le bien-être urbatectural : une approche à deux échelles pour bien vivre la ville
III.2 Les vecteurs du bien-être urbain
Les recherches menées sur le bien-être en ville ont permis d'identifier des vecteurs qui peuvent avoir un impact sur les populations. Nous allons les présenter dans ce qui suit :
III.2.1 Le dynamisme
Si le dynamisme peut en effet générer des problèmes considérables, voire énormes en termes de pauvreté, d'environnement et d'équipements inadaptés (donc de mal-être), il est également vecteur de créativité et donc de solutions innovantes qui peuvent améliorer le bienêtre urbain.
En effet, une ville dynamique est une ville qui déploie une attractivité essentiellement économique ; Le commerce, le rayonnement culturel, et le développement des connaissances peuvent à leur tour aussi amplifier le dynamisme des espaces urbains, selon Arthur Loyd, 2021 une ville dynamique peut se définir particulièrement selon quatre indicateurs :
● Les performances économiques : la production et consommation locales, emploi public, santé humaine et action sociale, tourisme,… etc ;
● La santé du secteur tertiaire : la capacité d'accueil pour les entreprises et la santé des marchés tertiaires ;
● Le capital humain : l'alchimie entre démographie, présence de talents, potentiel d'innovation et l’ouverture à l'international ;
● La qualité de vie : le cadre environnemental, les aménités culturelles, la sécurité, …etc.
III.2.2 Le confort
Bien que le confort et la qualité de vie soient des notions subjectives qui correspondent à des attentes culturelles et d’ambiances d'une population particulière dans un contexte déterminé, il existe plusieurs outils qui peuvent s’appliquer à un espace extérieur afin de maximiser le confort des occupants. Kevin Lynch dans sa théorie sur l’imagibilité aborde comment rendre les espaces extérieurs d’une ville plus agréables pour les habitants. Il définit l’imagibilité comme suit : « C’est, pour un objet physique, la qualité grâce à laquelle il a de grandes chances de provoquer une forte image chez n’importe quel observateur. C’est cette forme, cette couleur, ou cette disposition, qui facilitent la création d’images mentales de l’environnement vivement identifiées, puissamment structurées et d’une grande utilité. »
(LYNCH 1976 ; 11). Pour LYNCH, les objets qu’on retrouve dans un espace extérieur doivent toujours être constitués d'éléments distincts clairement liés les uns aux autres. Les points de repère ainsi créés sont plus puissants s'ils sont visibles de loin. Ces objets donneront donc une forte identité, une structure solide, un rythme et une signification aux lieux ce qui peut aider à rendre un environnement donné plus viable et donc porteur de bien-être.
32
Chapitre II : Le bien-être urbatectural : une approche à deux échelles pour bien vivre la ville
III.2.3 La fluidité
Depuis l’apparition de la notion du développement durable, la mise en place d’une mobilité dite durable qui se repose sur un système de transport permettant aux habitants de satisfaire leurs besoins d’accès d’une manière équitable représente désormais un enjeu politique et social pour les gouvernances. De plus, sous l’effet du progrès technologique et l’apparition des nouvelles technologies de communication, la question de l’efficacité des déplacements en ville ne se pose plus en termes de distance, mais plutôt en terme de coût, de qualité et de temps parcourus ce qui nécessite l’intégration des modes diversifiés de mobilité à diverses échelles dans les projets urbains.
La fluidité des moyens de mobilité est donc l’un des vecteurs qui doivent être présent en ville afin d’améliorer la qualité de vie des habitants et d’assurer leur bien-être, et ce, non seulement au sein de la ville elle-même, mais aussi aux échelles territoriales et extraterritoriales (l’international).
III.2.4 L’attractivité
Un territoire attractif qu’il s’agit d’une ville ou d’un quartier est défini d’après Amartya Sen (2000) selon deux capacités : la capacité d’être (liberté de se nourrir, de se vêtir, de se loger, d’être en mesure d’échapper aux maladies évitables etc.) et la capacité d’agir (liberté de se déplacer, d’accéder à l’éducation, d’accéder au marché du travail, de bénéficier de loisirs ou de participer à la vie sociale et politique etc.). De là on peut dire que l’attractivité est la liberté de l’individu de mener une activité donnée, et ce, en fonction des ressources dont il dispose. Cette attractivité doit donc être gérée et maîtrisée afin de produire à tous les individus qui vivent dans des villes différentes une meilleure qualité de vie.
III.2.5 La proximité
La mixité des lieux et des activités est une caractéristique unique de la ville. Mais celles-ci n'atteignent leur plénitude que si toutes les aménités urbaines sont regroupées dans des zones urbaines accessibles rapidement par les habitants, c'est-à-dire dans une zone accessible par tous les moyens de déplacement en moins de 10 minutes. Cette facilité se trouve principalement dans les zones urbaines les plus compactes où la proximité des lieux de vie (logement et travail) et des commodités (commerces, équipements, services) est maximale. Cette proximité, outre qu’elle maximise les échanges sociaux de toute nature et donc la cohésion sociale, elle facilite la vie quotidienne.
III.2.6 La mixité
La population urbaine est mixte par définition elle est issue de parcours différents, de vécus multiples, de références culturelles multiples et de catégories sociales différentes. Cette
33
Chapitre II : Le bien-être urbatectural : une approche à deux échelles pour bien vivre la ville
différenciation nécessite une offre urbaine adaptée aux besoins de chacun et doit proposer le panel le plus large et le plus dynamique d’activités, de logements, de mobilités de nature à stimuler de façon optimale sa population.
IV. Le bien-être urbatectural : une approche, deux échelles
En appréhendant le concept de bien-être à l’échelle architecturale et urbaine, nous concluons que l’expérience vécue par l’individu se présente comme aller-retour entre la ville et le bâtiment. C’est pourquoi, afin d’assurer le bien-être des citadins, nous devons associer le bien-être architectural et urbain. Cela nous a amenés à ce concept qui est : le bien-être urbatectural.
IV.1 L’urbatecture : Entre ville et architecture
« L'urbanisme s'occupe de l'espace extérieur. L'architecture s'occupe de l'espace intérieur. La nouvelle architecture est fondée sur un nouveau rapport entre l'espace intérieur et l'espace extérieur. La forme contribuera à suivre la formation si l'architecte et le client savent que la fonction de l'architecture et l'urbanisme doit être rétablie comme l'expression tridimensionnelle du comportement humain. » J. Bakema, La recherche de l'identité à travers l'espace et le temps dans l’architecture d'aujourd'hui, 1975.
L’urbatecture est un mot combinant l'architecture et l'urbanisme. C'est un nouveau terme traitant la dimension architecturale et urbaine comme une approche visant à lier ces deux échelles en raison de la divergence de ces deux domaines. Ceci est fondé sur la réconciliation de divers aspects communs de chaque domaine dans un système unifié.
La notion urbatecture a été inventée en 1971 par l'architecte et l'historien italien, Bruno Zevi dans son étude du projet Biaggio Rossetti pour la Ferrare. Dans son livre Apprendre à voir la ville, il définit l'urbatecture comme étant " un mixte d'architecture et d'urbanisme né d'une obligation factuelle pour le concepteur de bâtiments, devoir penser l'organisation de la ville accueillant ces dernières fautes que quiconque s'acquitte de cette tâche à sa place. "
Christian Portzamparc a également été convaincu de l’importance de cette échelle intermédiaire entre celle du bâtiment et celle de la ville dans son projet "architecturer la ville" dans lequel il définit les éléments urbains à l'intérieur de l'opération. Il développe ainsi son concept appelé îlot ouvert, qui se caractérise par la diversité des usages et des constructions. Il combine l’architecture et l’urbanisme afin de concevoir la ville comme une œuvre d’art et s'intéresse autant à la forme et au style de la ville qu’à la ville en elle-même.
34
Chapitre II : Le bien-être urbatectural : une approche à deux échelles pour bien vivre la ville
Dans la mesure où chacun a sa propre expérience avec et dans la ville nous ne pouvons pas aborder la notion de l’urbatecture sans parler de l’urbanité définie en tant que « qualité de l’espace à supporter une vie collective de partage, de pouvoir et de vivre ensemble en ville » (Dorra BOUSSAADA, 2011). En d’autres termes c’est la qualité des pratiques urbaines (sociales et spatiales) agissant sur l’urbatecture.
IV.2 Le bien-être architectural et le bien-être urbain
Ce qui fait la ville ce n’est pas juste des constructions, des rues et des espaces publics, c’est la combinaison de tous ses éléments. C’est pourquoi il est nécessaire afin d’assurer le bien-être des habitants en ville de repenser cette notion sur les deux échelles.
Ce qui nous a amené à combiner ces deux échelles, c’est le lien étroit qui existe entre les déterminants du bien-être urbain et ceux du bien-être architectural.
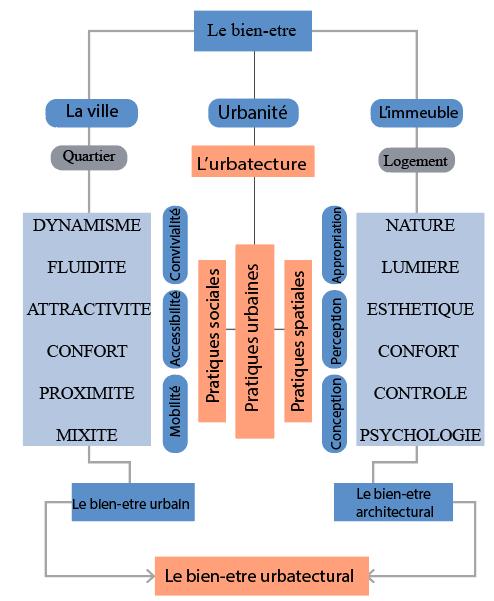
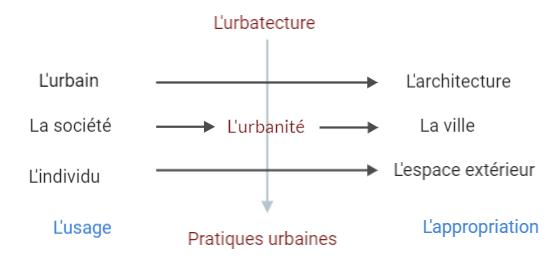
35
Figure 10 : Les vecteurs du bien-être urbatectural (Source : Travail d’auteurs)
Chapitre II : Le bien-être urbatectural : une approche à deux échelles pour bien vivre la ville
IV.3 L’urbatecture et le bien-être, une alliance stratégique à reconquérir
L’architecture et l’urbanisme sont les bases de la création de notre milieu de vie. En partant de cette logique, il semble évident que l’architecture et l’urbanisme sont directement liés à notre état de bien-être. Il faut donc, afin d’améliorer le bien-être des citadins en ville d’explorer l’expérience sensorielle pour que leur cadre de vie soit plus plaisant et plus agréable.
Cette expérience sensorielle du citadin est forgée par une série de filtres de perception, propres au contexte historique donné et à la matérialité spécifique de la ville : la forme urbaine, mais aussi le sexe du citadin, son âge, son appartenance sociale, sa situation économique et son activité professionnelle, ses origines géographiques, culturelles, politiques et ethniques, etc.
IV.4 Pourquoi la mixité urbaine ?
Les villes dans leur organisation sont constituées d'un certain nombre de fonctions simples qui, combinées forment un ensemble complexe qui a plus de sens que des fonctions isolées. Le mélange et le chevauchement, même lorsqu'ils sont appliqués à plus de quatre fonctions de base, peuvent conduire à des résultats similaires à ceux obtenus en utilisant la méthode du zoning. C’est pourquoi il ne suffit pas d'intégrer un ensemble de fonctions dans une structure complexe, de les juxtaposer ou de les superposer pour assurer le bien-être des citadins.
La relation entre la mixité urbaine et le bien-être est une hypothèse récurrente dans la politique de mixité. Cependant, la façon dont la mixité améliore la qualité de la vie et assure le bien-être est mal comprise. L’objectif de notre recherche était de montrer l’importance de la prise en compte des vecteurs de bien-être, dans la réflexion urbatecturale.
36
Chapitre II : Le bien-être urbatectural : une approche à deux échelles pour bien vivre la ville
MIXITE URBAINE
Fonctionnelle Sociale Architecturale
Diversification non Organisation
Intégration Existence CONFORT Appropriation Diversité Identité Qualité des lieux
Qualité Architecturale
Dynamisme Fluidité Attractivité CONFORT Diversité Mixité
Contrôle Nature Lumière Esthétique Psychologie
Architectural
HABITAT MOBILITE EQUIPEMENT
S SERVICES
COHESION SOCIALE
Urbain
LE BIEN ETRE URBATECTURAL
Figure 11 : La relation mixité urbaine - Bien-être (Source : Travail d’auteurs)
37
Chapitre II : Le bien-être urbatectural ; une approche à deux échelles pour bien vivre la ville
À partir de cette matière, nous allons dégager une série de principes et de démarches à appliquer, et ce, en les regroupant en quatre catégories : Habitat, mobilité, cohésion sociale et équipements, services et activités économiques :
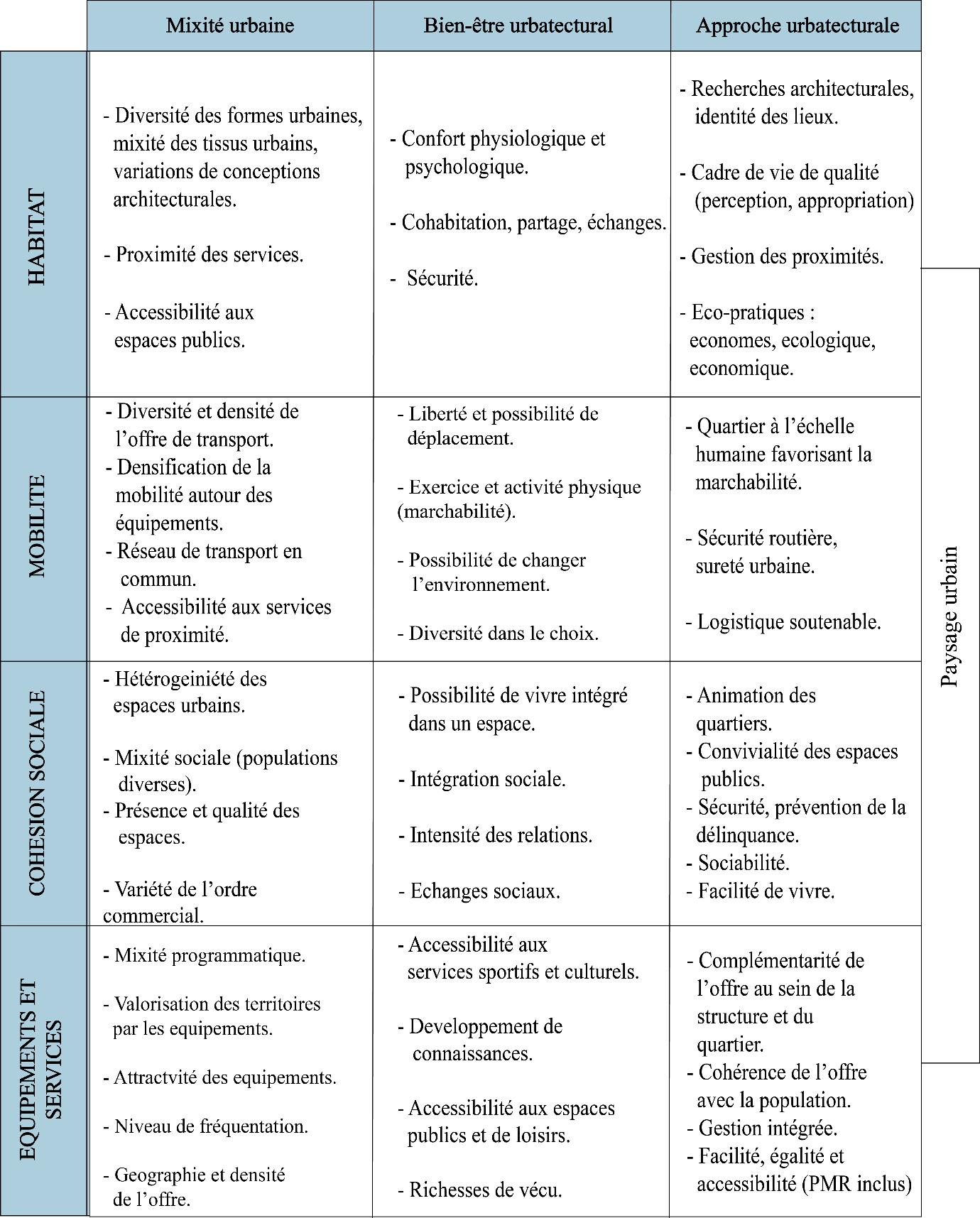
38
Figure 12 : L’approche urbatecturale (Source : Travail d’auteurs)
Chapitre II : Le bien-être urbatectural : une approche à deux échelles pour bien vivre la ville
IV.4.1 L’habitat
Le logement peut créer des inégalités environnementales et sociales importantes. Ces inégalités ont d’énormes conséquences sur le bien-être des citadins et concernent la configuration du logement, la pollution et l’environnement extérieur. C’est pourquoi il est important de prendre en compte ces paramètres afin de permettre l'accès à un logement convenable aux habitants.
• A Nice, la Joia Meridia est un Éco-quartier dans lequel les concepteurs ont créé des ouvertures sur des places publiques végétales ce qui a participé à procurer le bienêtre aux occupants.

IV.4.2 La mobilité
La mobilité est reliée à l’activité physique c’est pourquoi, afin d’améliorer le bien-être urbatectural il faut faciliter les conditions de mobilité des habitants en favorisant l’usage des modes actifs (vélo et marche à pied) et en réduisant les distances parcourues quotidiennement.
• A New York, Low Line est le premier parc souterrain au monde construit dans une ancienne station de Tramway abandonnée pour favoriser la marchabilité des usagers.

IV.4.3 La cohésion sociale
Le manque de liens sociaux et de cohésion est l’un des causes principales du stress social. Pour lutter contre ce stress il faut aménager les espaces publics de façon à rapprocher les gens et de favoriser la création des liens sociaux.
39
Figure 14: The Low Line (Source: www.dezeen.com)
Figure 13 : La Joia Meridia (Source : www.batiactu.com)
Chapitre II : Le bien-être urbatectural : une approche à deux échelles pour bien vivre la ville
• Les bords de fleuve à Lyon offrent des ambiances variées aux usagers en prenant en considération la qualité de l’espace public qui peut changer l’image qu’un passant peut avoir de son contexte.

IV.4.4 Les équipements, les services et les activités économiques
Pour une bonne accessibilité aux équipements, aux services et aux activités économiques il faut s’assurer que l’offre de services et équipements disponibles est en adéquation avec les besoins de toute la population, y compris les personnes à mobilité réduite.
• La High Line est un parc urbain créé par l’architecte James Corner pour les promenades mais aussi pour accueillir des installations et des spectacles temporaires accessible à tout.

Conclusion
Après l’étude de la notion du bien-être et de ses vecteurs en architecture et en urbanisme séparément nous pouvons conclure que l’homme vit sa ville à travers les bâtiments qu’elle offre mais aussi à travers les espaces d’échanges et de circulation qui forment l’espace public. L’expérience vécue par l'individu en ville est donc un va et vient entre l'urbain et l'architecture : c'est pourquoi le bien-être doit être réfléchi à une échelle urbatecturale.
L’interrelation qui existe entre la mixité urbaine et le bien-être nous a permis de dégager un ensemble des démarches à prendre en compte, l’approche combinant les vecteurs du bienêtre urbatectural et les conditions de la mixité urbaine peut vraiment aider à contribuer un cadre de vie de qualité en ville.
40
Figure 15 : Les berges du Rhône, Lyon (Source : www.lyon.fr)
Figure 16: The High line (Source: www.world-architects.com)
PARTIE II : PARTIE OPERATIONNELLE
L’EVALUATION DU BIEN ETRE URBATECTURAL A L’ENTREE EST DE LA VILLE DE JIJEL
CHAPITRE III : CADRE GENERAL DE L’ETUDE
Introduction
Après avoir abordé dans les chapitres précédents les deux notions de mixité urbaine et du bien-être urbatectural, il est question de vérifier les acquis théoriques sur terrain. Cette partie opérationnelle a pour but d’affirmer les hypothèses de notre recherche, pour cela nous avons utilisé des méthodes diverses d’investigation vu la complexité de la thématique du bienêtre.
Ce chapitre est consacré à la présentation du cadre général de notre analyse : cas d’étude ainsi que les méthodes de travail suivies et les techniques de recherche employées.
Une observation est menée sur le site en premier lieu, dans le but d’établir un diagnostic préliminaire de l’aire d’étude en collectant des données qualitatives et quantitatives afin de déterminer les atouts et les faiblesses de notre site en matière de bien-être dans une zone dite mixte : la zone de l’entrée Est de la ville de Jijel.
Afin d’enrichir notre lecture, les différentes observations (directe et méthodique) ont été suivies par une enquête ( par questionnaire et interviews) visant l’identification des éléments matériels et immatériels jugés comme les plus importants pour le bien-être des habitants , et la détermination des indicateurs qui vont nous permettre par la suite d’évaluer quantitativement (Méthode AMC) et qualitativement (Méthode FFOM) le degré du bien être urbatectural dans la zone étudiée selon plusieurs critères
I. Etablissement d’un diagnostic préliminaire de l’aire d’étude
Jijel est une ville côtière de la Méditerranée et le chef-lieu de la wilaya du même nom. Elle se situe à l'Est de la Kabylie et à environ 314 km d'Alger
La commune de Jijel est délimitée au Nord par la mer Méditerranée, au Sud par la commune de Kaous, à l'Ouest par la commune de l'Aouana et à l'est par la commune de l'Emir Abdelkader
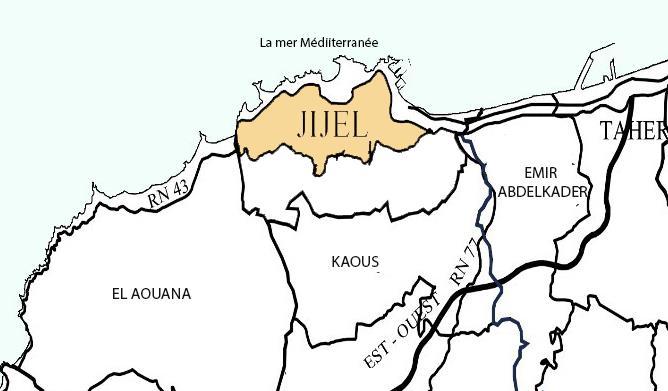
CHAPITRE III : Cadre général de l’étude 41
Figure 17 : Situation et limites de la commune de Jijel (Source : Révision du PDAU de Jijel, 2020)
Elle est constituée par le chef-lieu de commune Jijel (ville de Jijel) et trois agglomérations secondaires : Ouled Bounar, HARRATENE et le 3eme kilomètre.
I.1 L’entrée Est de la ville de Jijel : Un site à potentialités remarquables Notre périmètre d’étude est situé à l’Est de la ville de Jijel, au côté Sud de la route nationale RN43. Il est considéré comme une entrée de la ville et couvre tout le POS 26 du groupement urbain Jijel.
I.1.1 Présentation de l’aire d’étude : Situation stratégique caractérisée par une bonne accessibilité
Le POS 26 est situé sur une plaine à l’entrée Est de la ville de JIJEL à environ 10 km de centre-ville. Il s’étend sur une superficie de 153,56ha et représente la nouvelle extension de la ville de Jijel.
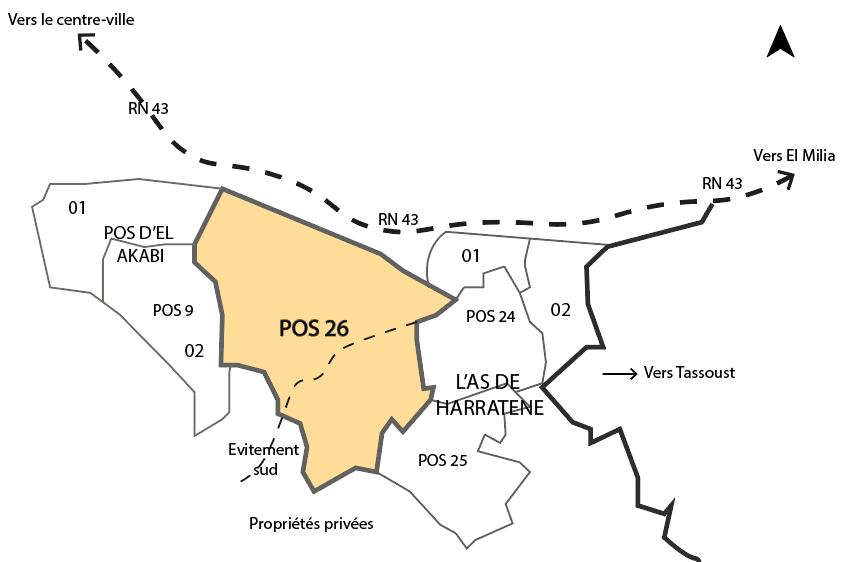
Il est limité : Au nord par la route nationale 43, au Sud par des propriétés privées des consorts Aouka, Abedelaziz, Mekhlouf, à l’Est par l’agglomération secondaire de Harratene et à l’Ouest par le POS de El Akabi.

CHAPITRE III : Cadre général de l’étude 42
Figure 18 : Situation de l'aire d'étude (Source : OpenStreetMap illustrée par Auteurs)
Figure 19 : Limites du POS 26. (Source : POS 26, 2017, illustré par les auteurs)
L’entrée Est est accessible par deux voies principales : la route nationale 43 qui est une voie de circulation structurante et l’évitement sud qui traverse le site et le divise en deux zones.
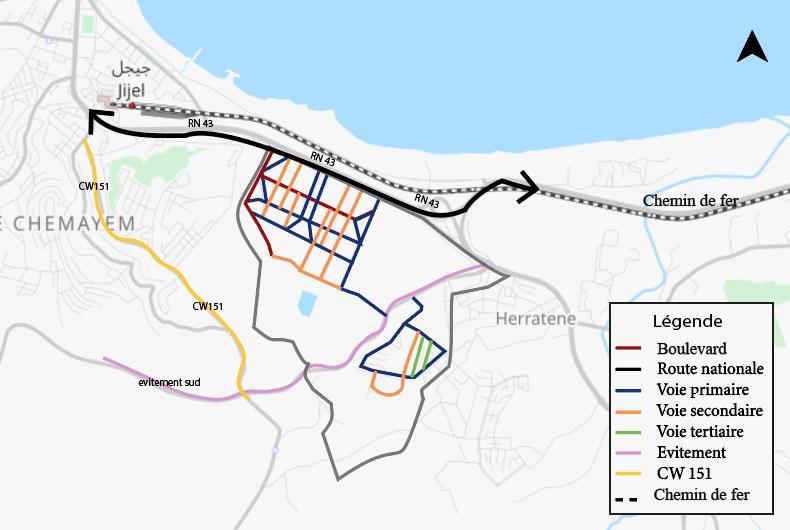
Le site de l’entrée Est est desservi par un boulevard principal qui se trouve dans la partie Nord-Ouest, perpendiculaire à un noyau de convergence central composé de deux voies de circulation principales allongé de l’Est à l’Ouest parallèlement à la RN 43
Le site présente deux catégories de trames, une trame régulière orthogonale dans la partie nord ainsi qu’une trame irrégulière dans le reste du site.
I.1.2 Milieu physique : Site favorable à l’urbanisation
L’analyse du milieu physique est une étape nécessaire, elle va nous permettre de prendre connaissance des caractéristiques générales de notre aire d’étude et ce, à travers la lecture des différentes données naturelles.
a) Le relief
En se basant sur l’étude géotechnique de notre site nous avons conclu que sa topographie est sub-plane au niveau de la plaine (dans la partie Nord), elle augmente progressivement vers le sud. Nous pouvons donc distinguer trois zones géotechniques :
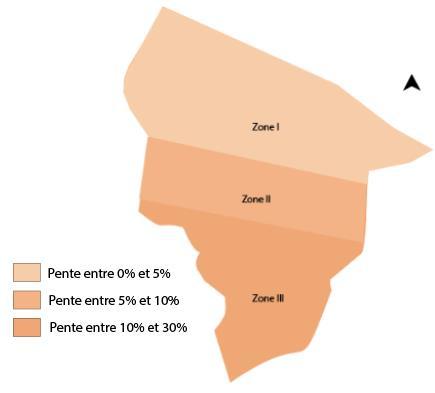
CHAPITRE III : Cadre général de l’étude 43
Figure 20 : Accessibilité du site (Source : Travail d’auteurs)
Figure 21 : Carte géotechnique du site (Source : Levé topographique du POS, modifié par auteurs)
a) Zone I : Elle occupe la partie haute du site, ce sont des terrains non exposés a aucun risque naturel (pentes entre 0% et 5%).
b) Zone II : Elle occupe le milieu du plateau (pentes entre 5% et 10%).
c) Zone III : Elle occupe la partie basse du site (pentes entre 10% et 30%).
b) L’hydrographie
Le site de l’entrée Est est traversé du Sud au Nord par de nombreux talwegs ou chaabat, qui sont parfois profondes. Nous remarquons aussi la présence de deux retenues collinaires situées au sud de notre site dans les chemins des chaabats.
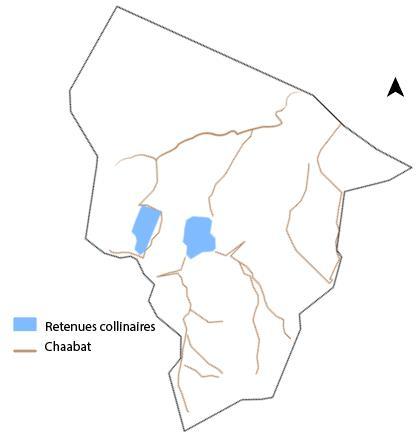
c) Climatologie
Le POS 26 partage le même climat que la ville de Jijel, de ce fait il dispose d’un climat méditerranéen ; avec un hiver pluvieux et froid et un été chaud et humide.
Précipitations : Faisant partie de l’une des régions les plus arrosées d’Algérie, la ville reçoit des précipitations importantes de l’ordre de 800 à 1000 mm/an, où les mois de décembre et janvier sont les plus pluvieux et les mois de juillet et aout les plus secs.
Températures : D’après les données de la station, le minimum est observé au mois de janvier. Il est de 8.3 C°. Le maximum est observé au mois d’Aout et dépasse les 30 C°.
Vents dominants : Les vents dominants sont de direction Nord-Ouest et Nord
Est, tandis que les vents provenant du sud sont les plus faibles
CHAPITRE III : Cadre général de l’étude 44
–
Figure 22 : Ressources hydrographiques (Source : POS26, 2017, modifié par auteurs)
I.2 L’Entrée Est : Nouvelle extension de la ville de Jijel
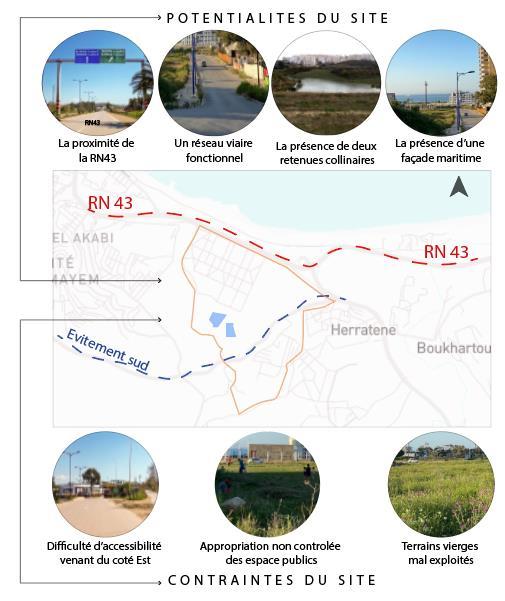
Connue pour sa position stratégique, sa richesse naturelle et son climat méditerranéen, la ville de Jijel était le carrefour de plusieurs civilisations au cours des siècles. Selon les historiens, l'évolution urbaine de la ville de Jijel peut être divisée en trois périodes principales : précoloniale, coloniale et postcoloniale.
I.2.1 Période précoloniale
La ville a été fondée par les Phéniciens, il y a environ 2000 ans. Durant cette période, l'occupation était limitée à une très petite zone. Les romains se sont par la suite installés dans la ville après la défaite de Jugurtha face aux Romains et leur occupation s'étendait sur l'emplacement de la ville actuelle dans la partie qui borde la mer
CHAPITRE III : Cadre général de l’étude 45
Figure 23 : Potentialités et contraintes du site de l'entrée Est (Source : Travail d’auteurs)
Les Byzantins ont été le prolongement de l’occupation Romaine ils ont donc élargi la ville vers le sud et ont dotés la ville de nouvelles murailles et des tourelles.
Vers 650, de nombreuses dynasties arabo-berbères ont pris le pouvoir, ils ont conservé le rempart romano-byzantin et ont construit des édifices de cultes et ce, avant l’arrivée des turques qui ont occupés l’ancienne enceinte et ont mis en place des structures d'échange et de rencontre, place, marché, mosquée.
I.2.2 Période coloniale
En 1830, avec l’arrivée des français suite à une série d'affrontement, l'attention des envahisseurs se porta sur la ville qui était dans un état de vétusté avancée. En 1856, la ville de Jijel a été totalement détruite suite à une violente secousse suivie d'un raz-de-marée. Les français, après la catastrophe, ne trouve de la vieille ville, qu'un rocher couvert de décombres ils l’ont utilisé pour la reconstruction de la Citadelle. Ils ont élaboré le premier plan de nouvelle ville, fournissant un nouveau tracé urbain de forme triangulaire épousant la forme de la plaine, avec des rues droites et des ilots disposés en échiquier.
Jijel est restée une petite ville pendant toute la durée de la colonisation française.
I.2.3 Période postcoloniale
a) De 1962-1974 : La ville a été marquée par l’occupation des biens vacants des colons, le manque d’infrastructures et l’exode rural durant cette période, mais aussi par une forte croissance démographique qui a causé une densification (extension vers le sud) des quartiers de Village Moussa, la Crète, et le Faubourg ainsi que l’apparition de nouveaux secteurs d’habitat illicite : Ayouf et El Akabi.
b) De 1974-1988 : Jijel a bénéficié durant cette période du statut de chef-lieu de la wilaya ce qui l’a fait sortir de son sommeil. Elle a donc connu une évolution accélérée causée par une forte demande de logement et la présence des disponibilités foncières. Elle a été dotée d’un plan d’urbanisme directeur PUD, et des ZHUN (3 ZHUNs) qui ont répondu partiellement aux besoins de la population. En matière de logement et d'équipement, la mise en œuvre du programme ZHUN a nécessité l'expropriation de terrains appartenant à des particuliers ce qui a causé l’émergence des constructions illicites.
c) De 1988-1998 : La wilaya de Jijel a comme toutes le reste du pays connu une crise sécuritaire marquée par la migration interne vers la ville de Jijel, ce qui a causé l’apparition des bidonvilles et des constructions illicites dans les cités d’Ayouf Est et Ouest, Rabta, El Haddada, Ouled Aissa, M’kasseb, et El Akabi. Rabta ,3eme Km, 40 Ha.
CHAPITRE III : Cadre général de l’étude 46
d) De 1998-2008 : durant cette période la ville a eu recours à deux types d’extension : Le premier consiste en une série d’opérations de densification qui s’est caractérisée par l’occupation des poches urbaines vides et l’injection des équipements d’accompagnement, Le deuxième type d’extension (extension discontinue) a donné apparition à des nouveaux pôles d’urbanisation : Le plateau Mezghitane à l’Ouest et la ferme pilote Adouane à l’Est de la ville.
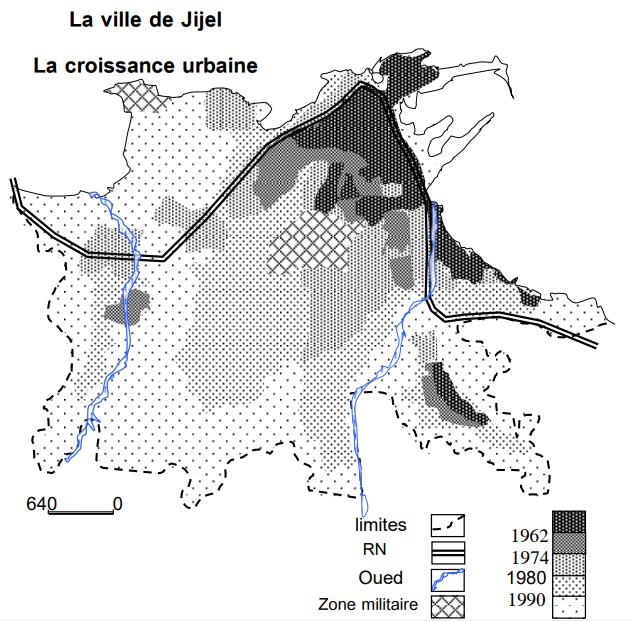
La ville est passée donc du mode d’extension polaire (autour du noyau colonial) à un nouveau mode linéaire (le long de la RN 43).
Les disponibilités foncières que disposent les nouvelles extensions ont contribué à la formation du groupement urbain Jijel.

CHAPITRE III : Cadre général de l’étude 47
Figure 25 : sens d'extensions de la ville de Jijel (Source : Google Earth, modifié par auteurs)
Figure 24 : Croissance urbaine de la ville de Jijel après l'indépendance (Source : PDAU de Jijel)
e) De 2009 jusqu’à ce jour : cette période a connu la mise en place des différents programmes d’habitat et d’équipement projetés par les divers plans d’occupation des sols récemment étudiés.
En 2009, la Direction de l’Urbanisme et de la Construction de la Wilaya de Jijel a chargé le bureau d’études GRAPHIC d’élaborer une révision du POS entrée Est, le POS avait pour objectif de :
Développer une stratégie urbaine structurée par la promotion d’équipements publics d’envergure.
De par sa situation, Donner un visage moderne et futuriste au chef-lieu de la wilaya.
Prévoir une liaison directe des différents aménagements déjà opérés, rattachant l’ancien périmètre urbain du chef-lieu avec celui de l’agglomération de Harratene
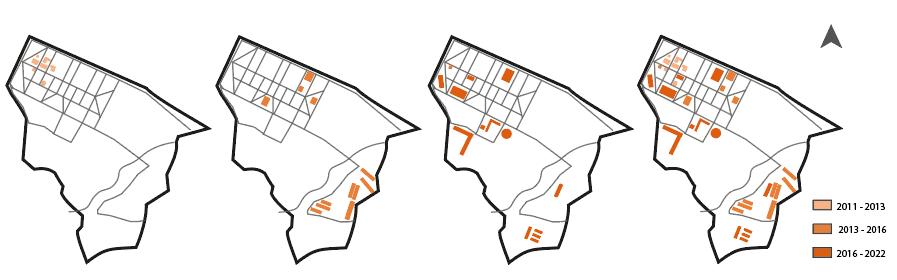
- De 2011 à 2013 : les travaux de la réalisation du POS ont débuté en mettant en place le tracé viaire en premier, la construction de quelques équipements a été achevée : Centre des archives, centre des impôts, direction du tourisme.
- De 2013 à 2016 : Les travaux de construction des équipements administratifs (tribunal de justice, direction des domaines) ainsi que ceux des logements RHP et social était en cours et ce jusqu’à l’année 2016.
- De 2016 à 2022 : Le tracé viaire a été finalisé permettant une bonne circulation à l’intérieure du POS et une bonne accessibilité à tous les équipements et les logements réalisés.
Le site abrite aujourd’hui des sièges des directions de l’administration locale de Jijel et va abriter au futur 3054 logements dont 1754 promotionnels.
CHAPITRE III : Cadre général de l’étude 48
Figure 26 : Évolution diachronique de l’Entrée Est (Source : Google Earth, Travail d’auteurs)
I.3 La zone mixte : Nouvelle configuration spatiale
L’entrée Est de la ville de Jijel est une nouvelle extension destinée à contenir des équipements à caractère administratif ainsi que des logements collectifs ce qui fait d’elle une zone mixte. Nous allons dans ce qui suit essayer d’analyser ses différentes caractéristiques afin d’en synthétiser les lacunes de cette intervention en matière de mixité urbaine.
I.3.1 Composantes spatiales
a) Typologie du bâti :
Nous pouvons diviser le site de l’entrée Est en deux zones différentes :
Zone 1 : Elle se situe dans la partie Nord du site, occupe presque la moitié du site et se caractérise par une dominance d’équipements d’intérêt public qui recouvrent différentes activités (administrative, culturelle et éducative) dont la plupart sont des administrations représentant 70% de la totalité du POS. En revanche nous avons remarqué une absence totale de l’activité commerciale malgré les opportunités que le site possède
Zone 2 : Elle occupe la partie qui reste du site et se caractérise par la dominance de l’habitat collectif de différents types (social, RHP, LPA et promotionnel) implantés dans des terrains accidentés et séparément dans différentes parties de la zone 2
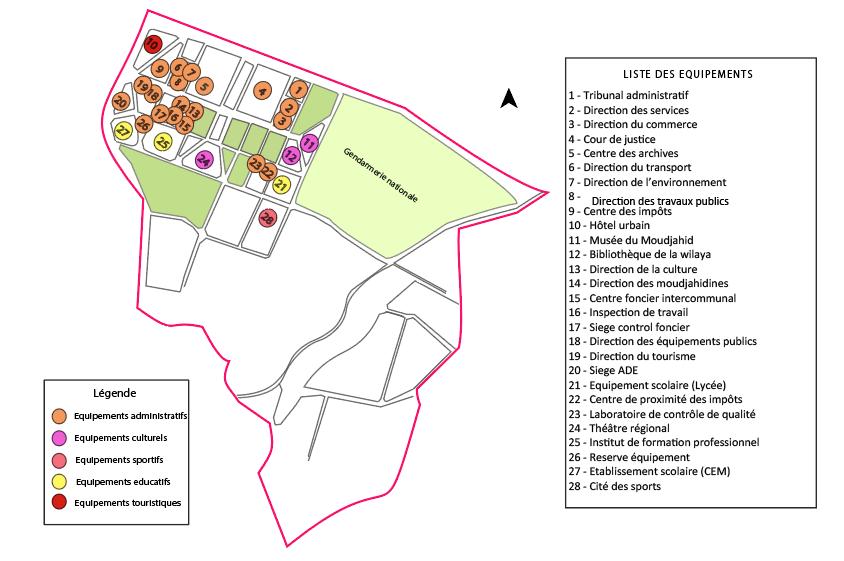
CHAPITRE III : Cadre général de l’étude 49
Figure 27 : Entrée Est : Carte des équipements (Source : Travail d’auteurs)
b) Espace public
L’analyse de l’espace public à l’entrée Est nous a permis de constater qu’il existe un manque de planification des espaces publics pour les habitants. La présence de terrains vierges dans le site à pousser les gens à s’improviser et à s’approprier l’espace public selon leurs besoins ce qui a causé des appropriations non contrôlée et communes chez les habitants (l’activité sportive, la détente...etc.)

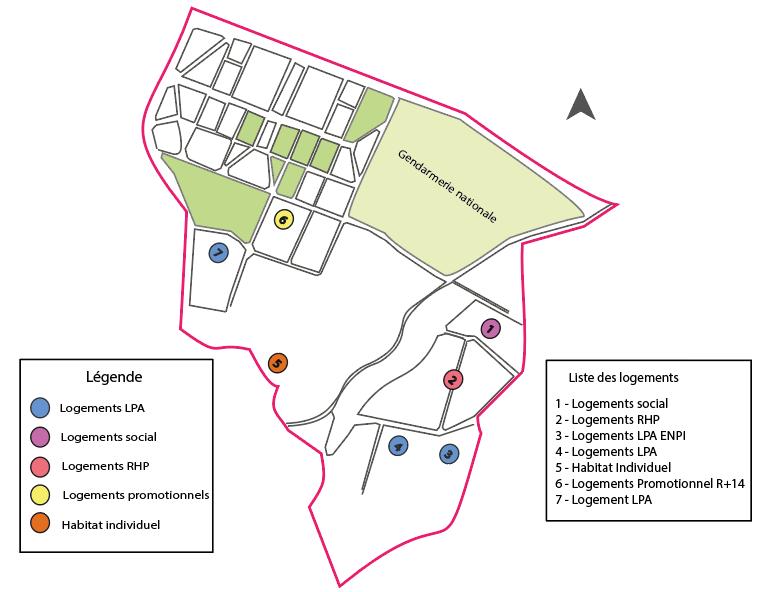
CHAPITRE III : Cadre général de l’étude 50
Figure 28 : Entrée Est : Typologie d’habitat (Source : Travail d’auteurs)
Figure 29 : Entrée Est : Espaces publics (Source : Travail d’auteurs)
I.3.2 Population et emplois
Les données que nous présenterons ci-après sont celles du pré-recensement de décembre 2021 relevées auprès de la commune suite à la préparation du recensement général de la population et de l’habitat (R.G.P.H) 2022. Le nombre total de la population recensée est de 1934 habitants
L’entrée Est représente un faible pourcentage de 1% de la population totale de la commune de Jijel (173403hab) Cette population se caractérise par un taux de jeunesse très marqué.
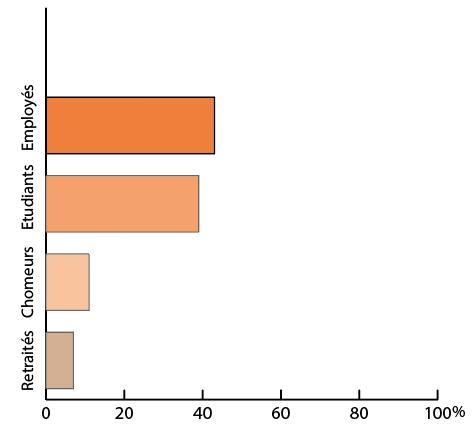
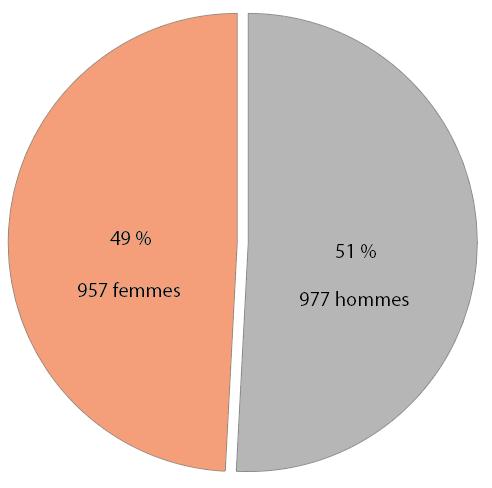
La population active est évaluée à 905 personnes, avec 693 d’employés et 212 de chômeurs. Le taux de chômage enregistré est 11%.

I.3.3 Paysage urbain
Selon Antoine Bailly, le paysage urbain est différent suivant le type d’approche. Nous avons donc choisi l’approche de Kevin Lynch qui à suggérer de grouper les caractéristiques du paysage urbain en cinq éléments :
CHAPITRE III : Cadre général de l’étude 51
Figure 31 : Répartition de la population de l'entrée Est par sexe (Source : RGPH)
Figure 30 : Tranche d'âges de la population de l'entrée Est (Source : RGPH)
Figure 32 : Diagramme des fonctions des habitants (Source : Questionnaire et RGPH)
Les voies : Notre site se caractérise par un réseau viaire hiérarchisé desservi par des voies primaires, secondaires et tertiaires ainsi qu’un boulevard permettant la liaison entre les différents ilots.
Les limites : Le site possède des limites linéaires qui sont la route nationale 43 au nord et une voie primaire à l’ouest. Au sud et à l’Est nous retrouvons des barrières administratives (limites du POS).
Les quartiers : Nous avons limité les zones de notre site selon la typologie du bâti ce qui nous a permis de dégager 6 quartiers :
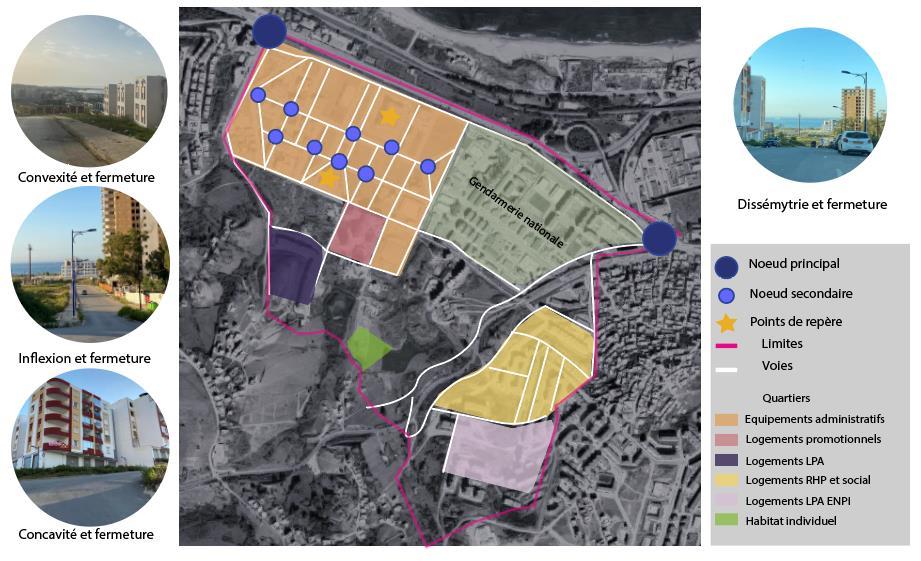
Quartier 1 : composé de 28 équipements à caractère administratifs.
Quartier 2 : composé de 590 logements promotionnels (tours r+14).
Quartier 3 : composé de 214 logements promotionnels aidés.
Quartier 4 : composé de 300 logements social et de 1000 logements RHP (résorption de l'habitat précaire)
Quartier 5 : composé de 240 logements publics promotionnels et de 190 logements promotionnels aidés.
Quartier 6 : 11 habitations individuelles.
Les nœuds : Le site est caractérisé par la présence de deux nœuds principaux à l’extérieur de ses limites. Quant aux nœuds secondaires, la partie nord de notre site est caractérisée par un maillage régulier de voies, c'est pourquoi nous retrouvons plusieurs nœuds représentant des intersections entre ses voies.
CHAPITRE III : Cadre général de l’étude 52
Figure 33 : Les éléments du paysage urbain à l’entrée Est (Source : Travail d’auteurs)
Les points de repères : Notre aire d’étude se trouve dans une zone nouvellement urbanisée et toujours en cours d’urbanisation. Il n’existe donc pas beaucoup de points de repères qui permettent aux usagers de se positionner durant leurs parcours. Les deux points de repères que nous avons jugés majeurs de notre site sont : Le tribunal de justice et le théâtre régional.
Synthèse de la lecture :
Nous avons constaté à partir de notre lecture que l'entrée Est de la ville de Jijel est mixte fonctionnellement, mais d'une manière qui ne dessert pas ses habitants, car elle manque cruellement d'activités commerciales, sanitaires, mais aussi de divertissements.
Quant à la mixité architecturale, elle se caractérise par une standardisation au niveau des équipements, mais aussi des logements collectifs qui ont la même forme, le même traitement des façades et l’utilisation des mêmes couleurs, ce qui a conduit à la création d'un paysage urbain inanimé.
D’un point de vue social, le citoyen à notre aire d’étude se trouve dans un lieu qui manque des espaces qui jouent un rôle dans son épanouissement et qui permettent le rapprochement des citoyens à savoir : les espaces de rencontres et les aires de jeux ce qui a entraîné une barrière entre les différents habitants.
Cependant, ces paradoxes n'excluent pas que l'entrée Est de la ville de Jijel fut un lieu très privilégié pour améliorer la mixité urbaine et offrir le bien-être a ses habitants, en raison du taux faible de la densité urbaine et de sa disposition de diverses ressources naturelles représentées par la mer, la végétation et les retenues collinaires qui peuvent être exploités s’ils sont parfaitement intégrés afin de créer une expérience qui apportera le bien-être aux habitants. En effet l'origine géographique différente contribuera aussi à renforcer les liens sociaux entre eux.
En comparant les deux exemples analysés en Europe et en Algérie nous pouvons conclure que la mixité urbaine a été appliquée sur le long terme à l’échelle fonctionnelle, architecturale ainsi que sociale dans le quartier de Bonne à Grenoble, contrairement à notre cas d'étude, où elle n'a été mise en œuvre qu'à l’échelle fonctionnelle et sur le court terme.
CHAPITRE III : Cadre général de l’étude 53
II. Les indicateurs de l’évaluation du bien-être urbatectural
Comme nous l’avons déjà mentionné auparavant, afin d’évaluer le bien-être urbatectural dans notre périmètre d’étude nous allons utiliser la méthode d’analyse stratégique : quantitative et qualitative qui requiert l’emploi de critères et des indicateurs. Pour ce faire, nous devons faire recours aux méthodes et techniques suivantes qui vont nous permettre de choisir les critères et les indicateurs les plus adéquats
II.1 Les techniques utilisées
II.1.1 L’observation
Elle consiste à l’observation visuelle, l’examen des comportements des citoyens, des ambiances urbaines, des pratiques socio-spatiales. Cette méthode nous a permis dans un premier lieu d’analyser la mixité urbaine et donc d’établir un état des lieux, l’observation directe et méthodique vont nous aider en deuxième lieu d’en tirer une synthèse préliminaire du degré du bien être urbatectural (avant de consulter les occupants du site : habitants et employés).
II.1.2 Enquête par questionnaire
Le questionnaire est une recherche sur terrain basée sur une série de questions ciblées conçues pour recueillir des informations sur des faits tels que les préférences qui jouent un rôle dans la composition du bien-être d'un individu. Il s'agit d'une méthode de collecte de données qui donne accès à des informations qu’on ne peut obtenir autrement. L'avantage de cette méthode est que les données collectées sont faciles à quantifier.
a) L’élaboration des questions
Nous avons divisé notre questionnaire en 5 rubriques afin qu’il se déroule harmonieusement en allant du général au particulier : Informations générales, habitat, mobilité, cohésion sociale et équipements, services et activités économiques. Chaque rubrique se compose de deux types de questions :
Question visant des données quantitatives : Elle sert à collecter des données brutes sur les éléments constitutifs du bien-être en interrogeant les habitants.
Question visant des données qualitatives : Elle s'appuie sur les impressions et les opinions des habitants et leur expérience en matière de bien-être dans le périmètre d’étude en prenant en compte la variabilité des préférences des individus.
La distribution du questionnaire a été directe (main à main), au niveau de l’entrée Est dans 4 zones différentes.
CHAPITRE III : Cadre général de l’étude 54
b) Taille de l’échantillon
La taille de l’échantillon est estimée par la formule simplifiée ‘Yamane’ (1973) suivante : N
n = 1+N x e2
Dont, n : est la taille de l’échantillon, N : est le nombre de la population totale, e : est le niveau de précision en (%).
Pour calculer la taille de notre échantillon, nous avons pris le niveau de précision e = 7% et le niveau de confiance de 93%. La population de l’entrée Est est de 1934 habitants donc :
1934
n = = 185 personnes
1 + 1934 x (0.07) ²
En sommes, pour notre enquête nous avons pris pour une population de 1934 habitants, un échantillon de 185 personnes.
c) Zonage
Afin de mieux comprendre les caractéristiques de notre aire d’étude, nous avons décidé de le diviser en 4 zones homogènes. Cette classification est basée sur la typologie de l’habitat présent sur site.
Les questionnaires sont répartis en fonction de la densité des zones d’habitat.
Zone 1: composée de logements promotionnels et de promotionnels aidés.
Zone 2 : composé d’habitat individuel.
Zone 3 : composée de logements social et de logements RHP (résorption de l'habitat précaire).
Zone 4 : composée de logements publics promotionnels et de logements promotionnels aidés.
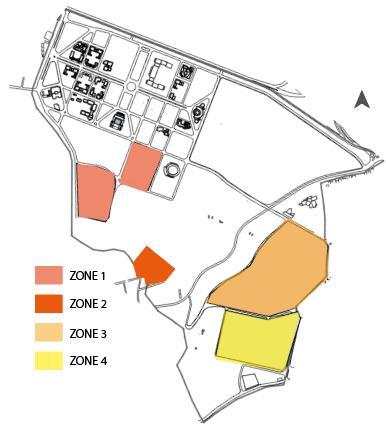
CHAPITRE III : Cadre général de l’étude 55
Figure 34 : Entrée Est : Zones homogènes (Source : Travail d’auteurs)
Le nombre de questionnaires distribués aux habitants est basé sur la densité de la population dans chaque zone.
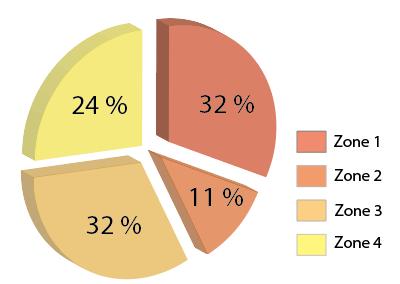
II.1.3 L’interview (entretien)
L’entretien est une méthode de recueil d’informations qui consiste en des entretiens oraux, individuels ou de groupes, avec plusieurs personnes sélectionnées soigneusement, afin d’obtenir des informations sur des faits ou des représentations, dont on analyse le degré de pertinence, de validité et de fiabilité déterminé en regard des objectifs du recueil d’informations.
Nous avons opté pour l’entretien directif pour interroger un échantillon de 10 employés de différentes directions de l’entrée Est afin d’évaluer le bien-être architectural dans les espaces de travail en se basant sur leurs expériences sensorielles.
II.2 Les méthodes appliquées
II.2.1 L’analyse multicritères (AMC)
L'analyse multicritères est un outil d'aide à la décision pour résoudre des problèmes complexes, incluant des aspects qualitatifs et/ou quantitatifs dans un processus de prise de décision. Elle est basée sur un ensemble cohérent de critères et de mesures pour aider à concevoir, justifier et transformer les préférences dans le processus de prise de décision.
Dans notre travail de recherche, nous avons opter pour cette méthode, et ce, en classant les indicateurs selon des critères constitutifs du bien-être, en se basant sur les vecteurs du bien-être urbatectural abordés dans la partie théorique (chapitre 02), ainsi que les résultats des deux enquêtes établies afin de pouvoir évaluer le bien-être urbatectural au sein de l’entrée Est.
a) Indicateurs ciblés :
La grille proposée couvre 19 critères et 35 indicateurs organisés en cinq domaines suivant ; Habitat, mobilité, cohésion sociale, équipements et services et paysage.
CHAPITRE III : Cadre général de l’étude 56
Figure 35 : Pourcentage de la population interrogée dans chaque zone de l’entrée Est ( Source : Travail d’auteurs)
Tableau 2 : les critères et les indicateurs de l’évaluation du bien être urbatectural à l’entrée Est de la ville de Jijel (Source : Travail d’auteurs)
Composante Critères Indicateurs Type de l’indicateur Source de l’information Indice privilégié
Confort - Bruit
- Nature Qualitatif Qualitatif Questionnaire Observation
HABITAT (Dimension architecturale)
Conception (architecture)
Vie collective
- Façades
- Matériaux
- Aménagement
- Sécurité (espace extérieur : escalier, l’entrée, espace de jeux ….).
- Intimité,
Appropriation
MOBILITE (Dimension fonctionnelle)
- Facilité de vive
Transport - Accessibilité
- Sécurité
Marchabilité - Sécurité
Accessibilité (circulation)
Stationnement (aménagement)
Sécurité
COHESION
SOCIALE (Dimension sociale)
Convivialité (espace public)
Accessibilité aux services
Qualitatif Qualitatif Observation Questionnaire
Qualitatif Qualitatif Observation Questionnaire
Qualitatif Qualitatif Questionnaire Questionnaire
Quantitatif Qualitatif Questionnaire Questionnaire
Qualitatif Interview
- Connectivité (intégration) Qualitatif Questionnaire
- Aménagement
- Sécurité
- Sécurité des biens et des personnes, prévention de la délinquance, ….
- Diversité,
- Aménagement qualité d’aménagement (ambiances lumineuses et sonores, densité des jardins, interactions sociales
- Existence des espaces publics
- Mixité programmatique au sein du même immeuble
- Diversité des services (favorise les changements et la confrontation sociale)
Qualitatif Qualitatif Observation Questionnaire
Qualitatif Questionnaire
Qualitatif Qualitatif
Bien-être physique Bien être psychologique
ARCHITECTURAL
Quantitatif
Quantitatif
Qualitatif
Questionnaire Observation Observation
Questionnaire Questionnaire
Fluidité Sécurité Aménagement
Sécurité
Diversité proximité
CHAPITRE III : Cadre général de l’étude 57
Animation - Diversité des activités sociales et récréatives
- Qualité de vie (jardin animé, façade animé ….)
Commerces - Existence (marché de première nécessité)
- Diversité
Qualitatif
Qualitatif
Quantitatif Qualitatif
SERVICES ET EQUIPEMENT (Dimension économique)
Services socioculturels
- Présence des équipements de proximité
- Qualité des services
éducation - Accessibilité aux établissements scolaires (tous les niveaux)
Interview Observation
Questionnaire Questionnaire
Quantitatif Qualitatif Interview Observation
Qualitatif interview
Santé - Accessibilité aux établissements de santé Qualitatif interview
Nature (paysage naturel)
- Qualité visuelle intéressante et cohérente
- Aménagement paysager
PAYSAGE (Dimension paysagère)
Ressources naturelle
- Accessibilité aux espaces naturels
- Présence de l’eau : la Mer, les fleuves, les lacs
- La végétation : forêts, parc ….
Paysage urbain - la qualité architecturale du cadre bâti
- L’identité de l’espace ;
Qualitatif Qualitatif Qualitatif
Qualitatif Qualitatif
Observation Observation Interview
Observation observation
Qualitatif Qualitatif Observation Observation
Dynamisme Diversité
Accessibilité
Attractivité Perception
CHAPITRE III : Cadre général de l’étude 58
b) Coefficients de pondération
Chaque domaine est décomposé en plusieurs critères qui sont traduit en un nombre déterminé d’indicateurs. Ces derniers sont notés suivant un barème de notation équilibré, de l’échelle de 5, préalablement défini par nous-mêmes. Chaque critère sera évalué en lui affectant un coefficient de pondération sensé refléter son poids par rapport aux autres critères.
II.2.2 L’analyse qualitative FFOM :
La matrice FFOM (Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces) est un outil stratégique appliqué à un territoire et permettant de dégager une stratégie sur la base de la définition des forces et des faiblesses, des opportunités et des menaces. Cette matrice permet d’avoir une approche globale, de visualiser l’ensemble des éléments, y compris prospectifs, pouvant influencer la résolution d’une problématique, en confrontant les points positifs à exploiter ainsi que les points négatifs à minimiser ou éviter. L’avantage de cette matrice est qu’elle soit adaptable en fonction des besoins et est facilement appropriable.
Cette méthode va nous permettre de qualifier les forces et les faiblesses de l’entrée Est afin de dégager des pistes d’amélioration du bien-être urbatectural.
Conclusion
En guise de conclusion nous pouvons dire que les techniques ainsi que les méthodes utilisées nous ont aussi permis de construire une grille d’évaluation composée de critère et d’indicateurs, mais aussi de choisir les coefficients des indicateurs en fonction du poids de chaque composante et ce, en partant de l’habitat considérée comme la composante la plus importante de l’espace urbain suivie de la mobilité, la cohésion sociale, les équipements et les services et enfin le paysage qui se présente comme le lieu privilégié de la pratique de l’urbanité.
A travers les enquêtes effectuées nous avons constaté que certains indices sont plus privilégiés que d’autres, à savoir la sécurité, l’accessibilité, le confort et l’aménagement. La majorité de la population s’intéresse avant tout à la qualité du logement et des espaces publics de la manière dont s’y rendre en toute sécurité.
CHAPITRE III : Cadre général de l’étude 59
CHAPITRE IV : LECTURE ET INTERPRETATION DES RESULTATS
Introduction
Dans le cadre de l’évaluation du bien-être urbatectural à l’entrée Est de la ville de Jijel, et afin de trouver des réponses aux questions posées dans notre problématique, nous allons présenter dans ce chapitre la grille de lecture et la synthèse d’analyse élaborées à partir de l’évaluation quantitative et qualitative des indicateurs des différentes composantes de notre cas d’étude. Les données récoltées seront interprétées et synthétisées sous forme des graphes (Analyse AMC) et une matrice (Analyse FFOM).
I. Evaluation quantitative du bien-être urbatectural à l’entrée Est
Nous allons synthétiser le niveau de bien-être de chaque composante dans ce qui suit :
I.1 L’habitat
I.1.1 Résultats du questionnaire
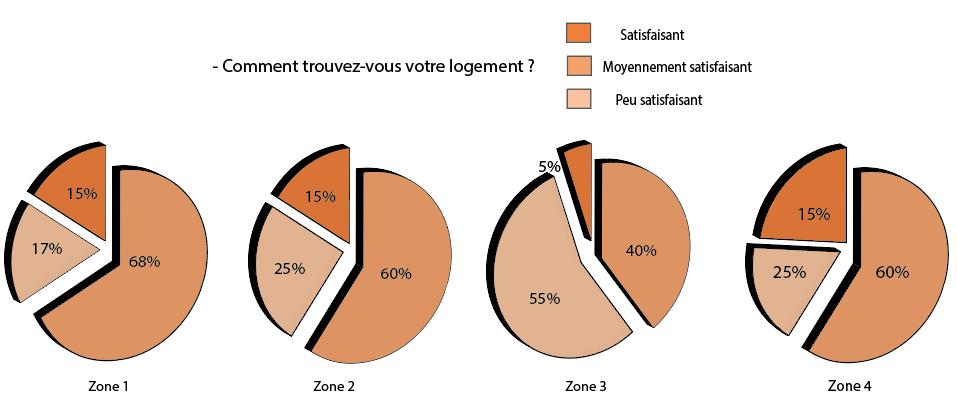
La première question qui nous a permis de choisir les indicateurs liés aux critères de la conception architecturale ainsi que le confort s’est porté sur la satisfaction des habitants sur la qualité de leur logement.
A partir des graphiques suivants, nous constatons que la satisfaction des habitants vis-à-vis la qualité de leur logement est moyenne et varie entre 55% et 68% dans les quatre zones.
Cette question nous à amener à leur posé une autre question sur les causes de cette insatisfaction. Entre la qualité des matériaux, la façade, l’isolation, l’esthétique de la construction et les aménagements extérieurs les avis étaient mitigés, cependant la qualité des matériaux l’emporte dans les 3 zones où on retrouve des logements collectifs avec des pourcentages qui varient entre 75% et 80%.
Chapitre IV : Lecture et interprétation des résultats 60
Figure 36 : Résultats de la question liée à la qualité de logement (Source : Questionnaire)
La majorité des personnes qui ne sont pas satisfaites vis-à-vis la qualité des matériaux de construction habitent dans des logements promotionnels qui sont censés de garantir une meilleure qualité par rapport aux logements sociaux, cependant nous avons constaté qu’ils souffrent du même problème.
I.1.2 Analyse architecturale de l’habitat :
Tableau 3 : Analyse des façades de l’habitat (Source : Auteures)
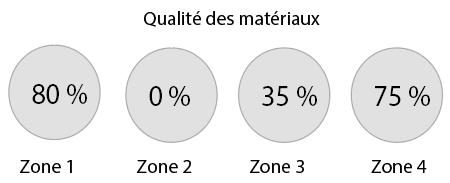
Façade Catégorie de bâtiment Aspect et forme générale Matériaux et couleurs
- Façade simple à étage répétitif
Habitat collectif promotionnel
R+14
Zone 1
Habitat collectif promotionnel
R+14
Zone 1
- Standardisation des formes géométriques.
- Dominance du plein par rapport au vide.
- Traitement des façades par le principe d’alignement des ouvertures et la régularité de rythme contribuant à une sorte de répétition dans le paysage urbain.
- Balcons filants sur toute la longueur de la façade
- Formation d’un rythme qui se répète verticalement.
- Utilisation du béton et du verre comme matériaux.
- Utilisation de deux couleurs qui sont le jaune et le blanc.
Logements promotionnels aidés LPA



R + 5
Zone 1
- Façade en longueur avec un rythme d’ouvertures.
- Fenêtres de forme rectangulaire.
- Présence de balcons individuels sur toute la longueur de la façade
- Réservation des RDC pour les locaux commerciaux
- Utilisation du béton et du verre comme matériaux.
- Utilisation de deux couleurs qui sont le jaune et le blanc.
- Utilisation du béton et comme matériaux
- Utilisation de plusieurs couleurs non homogènes (Blanc, rouge, jaune et gris)
Chapitre IV : Lecture et interprétation des résultats 61
Figure 37 : Pourcentage des personnes insatisfaits par rapport à la qualité des matériaux dans les différentes zones (Source : Questionnaire)
3
-Façade symétrique, très simple qui se caractérise par une dominance du plein par rapport au vide.
- Fenêtres de forme rectangulaire.
- Utilisation du béton comme matériaux

- Utilisation de deux couleurs qui sont le gris et le blanc
A travers l’analyse architecturale des logements nous avons remarqué une standardisation au niveau des façades cela est dû à l’utilisation des mêmes matériaux de construction, des mêmes couleurs et des mêmes formes.
I.1.3 Analyse multicritères de l’habitat
Tableau 4 : Evaluation du bien-être urbatectural de la composante Habitat (Source : Auteurs)
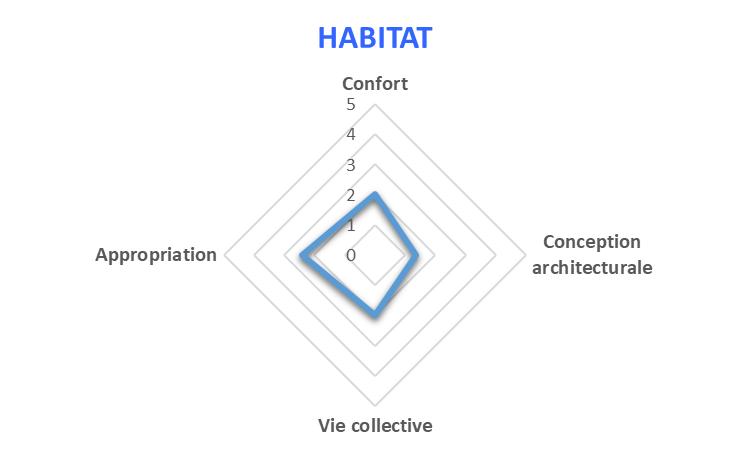
Etat de profil des performances relatives à la composante de l’habitat
• Les indicateurs relatifs au « confort » et à « la conception architecturale » affichent des valeurs faibles surtout au niveau du bruit (bruit extérieur et voisinage de palier) et des matériaux de construction utilisées.
• Quant aux indicateurs relatifs à « La vie collective » la sécurité des espaces extérieurs se trouve dans un intervalle moyen
Chapitre IV : Lecture et interprétation des résultats 62
Logements RHP R+4
Zone
Note attribuée par composante Indicateurs critères Coefficient Note attribuée note obtenue par critère Note par indicateur HABITAT 1.95/5 Confort -Bruit -Nature 2 2 1 3 2 6 2 Conception (architecture) -Façades -Matériaux 3 5 2 1 6 5 1.37 Vie collective -Aménagement -Sécurité (espace extérieur, escalier, l’entrée, espace de jeux ….) 2 3 2 2 4 6 2 Appropriation -Intimité, -- Facilité de vive 2 3 3 2 6 6 2.4
Figure 38 : Diagramme radar de l'habitat (Source : Auteurs)
contrairement à l’aménagement qui se trouve dans un intervalle très faible.
• Le critère de « l’appropriation » aurait pu atteindre une valeur moyenne et ce dû à l’indicateur de la facilité de vivre qui se trouve dans un intervalle moyen, mais l’intimité est faible dans le site.
• Aucun critère n’a atteint une valeur optimale
I.2 La mobilité
I.2.1 Résultats du questionnaire
Nous avons essayé à travers la question sur les déplacements des enquêtés à l’intérieur du quartier de dégager les raisons qui leurs laissent qualifier ses déplacements de faible ou moyen. Ceci nous à amener à deux raisons qui sont : le manque d’aménagement avec un pourcentage très élevé qui varie entre 70% et 82% suivi en seconde position par l’insécurité avec des pourcentages qui varie entre 18% et 30%. Bien que les avis se sont divergé sur l’insécurité dans leur quartier cela laisse à penser que chacun sa propre perception.
Nous constatons donc que le site est mal aménagé et inspirent l’insécurité pour certains dû à l’absence de la sureté urbaine, c’est pourquoi nous avons choisis ces indicateurs
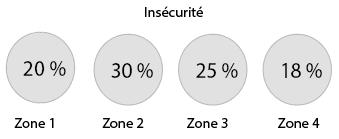
I.2.2 Analyse multicritères de la mobilité
Tableau 5 : Evaluation du bien-être urbatectural de la composante Mobilité (Source : Auteurs)
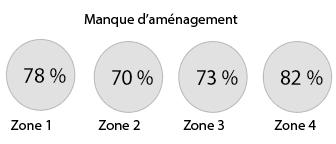
Chapitre IV : Lecture et interprétation des résultats 63
Note attribuée par composante Indicateurs critères Coefficient Note attribuée note obtenue par critère Note par indicateur MOBILITE 3.16/5 Transport - Accessibilité - Sécurité 1 2 3 3 3 6 3 Marchabilité - Sécurité 3 3 9 3 Accessibilité (circulation) - Connectivité (intégration) 1 4 4 4 Stationnement (aménagement) - Aménagement - Sécurité 1 2 2 3 2 6 2.66
Figure 39 : pourcentage des résultats liés au manque d’aménagements appropriés (Source : Questionnaire)
Figure 40 : pourcentage des résultats liés à l’insécurité ( Source : Questionnaire)
Etat de profil des performances relatives à la composante de la mobilité :
• Tous les critères relatifs à la mobilité affichent des résultats de valeur moyenne.
• Les deux indicateurs relatifs au transport (accessibilité et sécurité) affichent un résultat satisfaisant dû à l’accessibilité facile et le positionnement stratégique de notre site.
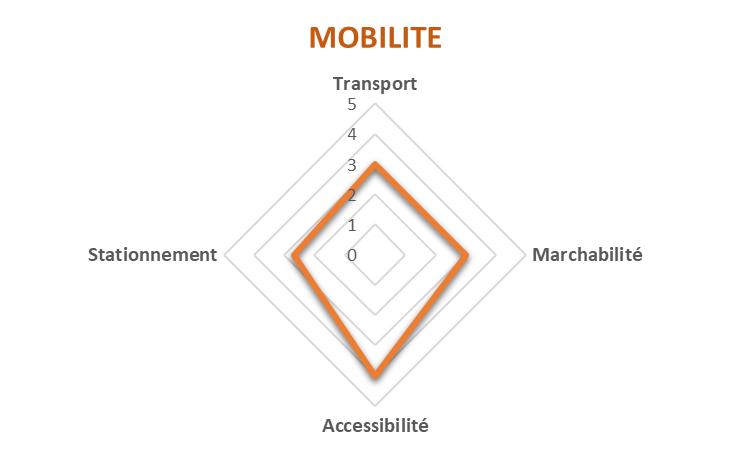
• L’indicateur de la marchabilité relatif au critère de la sécurité affiche une valeur moyenne dû à l’absence d’une sureté urbaine.
• Le critère du stationnement a une valeur moyenne (présence des aires de stationnement).
I.3 La cohésion sociale
I.3.1 Résultats du questionnaire
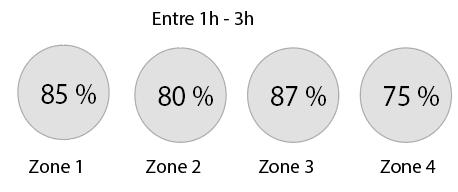
Nous avons tenté de connaitre l’importance des espaces publics pour les habitants en leur demandant combien de temps, ils y passent. Les résultats obtenus permettent de conclure que le pourcentage des personnes qui passent entre 1 heure et 3 heures est plus élevé et varie entre 75% et 87% ce qui montre l’importance de la présence des espaces publics pour la population.
En essayant de dégager les éléments qui laisseraient les habitants mieux apprécier un espace public entre son emplacement, sa conception, sa sécurité et son rôle. La majorité estime qu’une bonne conception de l’espace public leur donnerait envie d’y rester et de l’approprier.
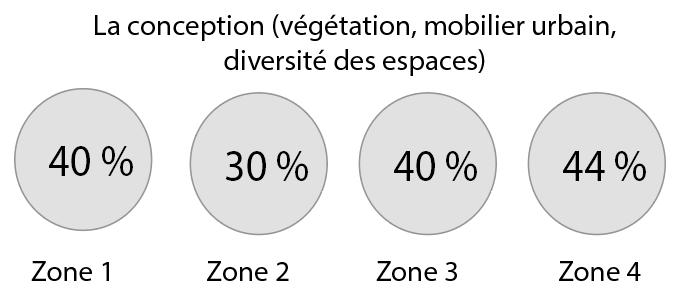
Chapitre IV : Lecture et interprétation des résultats 64
Figure 41 : Diagramme radar de la mobilité
Figure 42 : Pourcentage des résultats liés au temps qu’ils passent dans les espaces publics (Source : Questionnaire)
Figure 43 : Pourcentage des résultats liés à la conception de l’espace public (Source : Questionnaire)
I.3.2 Analyse multicritères de la cohésion sociale
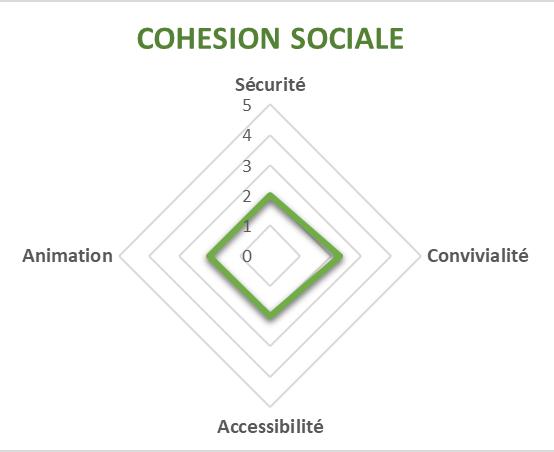
Tableau 6 : Evaluation du bien-être urbatectural de la composante Cohésion sociale (Source : Auteurs)
Etat de profil des performances relatives à la composante de la cohésion sociale :
• Le critère de la sécurité se trouve dans un intervalle moyen mais il nécessite d’être amélioré.
• Les deux indicateurs relatifs à la convivialité (diversité et aménagement de qualité) affichent des valeurs faibles contrairement au troisième indicateur (existence des espaces public) qui affiche une valeur moyenne.
• La mixité programmatique au sein du même immeuble et la diversité des services affichent des valeurs au-dessous de la moyenne (l’absence de plusieurs équipements et services nécessaires à la vie quotidienne des habitants).
•Le dernier critère qui est l’animation n’atteint pas une valeur optimale (espace inanimé).
Chapitre IV : Lecture et interprétation des résultats 65
Note attribuée par composante Indicateurs critères Coefficient Note attribuée note obtenue par critère Note par indicateur COHESION SOCIALE 2.08/5 Sécurité - Sécurité des biens et des personnes 3 2 6 2 Convivialité (espace public) - Diversité - Aménagement (ambiances lumineuses et sonores, densité des jardins, interactions sociales) - Existence des espaces publics 2 2 2 2 2 3 4 4 6 2.33 Accessibilité aux services - Mixité programmatique au sein du même immeuble - Diversité des services 2 2 2 2 4 4 2 Animation - Diversité des activités sociales et récréatives - Qualité de vie (jardin animé, façade animé ….) 2 3 2 2 4 6 2
Figure 44 : Etat de profil des performances relatives à la composante de la cohésion sociale (Source : Auteurs)
I.4 Les services et les équipements
I.4.1 Résultats du questionnaire
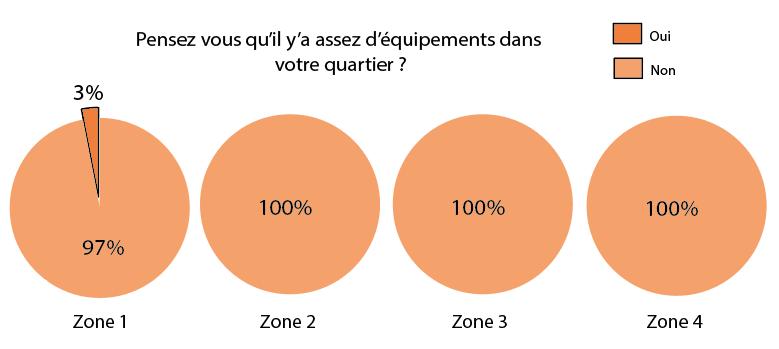
Nous avons voulu connaitre à partir de cette question si les habitants de l’entrée Est souffrent d’un manque des équipements nécessaires à la vie quotidienne. Les résultats nous ont montré que tous les habitants souffrent d’un manque criant des équipements à l’exception les habitants de la zone une où nous retrouvons un magasin d’alimentation générale, mais ce n’est pas du tout suffisant.
Bien que les deux tiers de la zone soient occupés par des équipements, nous constatons un manque important des équipements scolaires, sportifs et surtout sanitaires.
Figure
I.4.2 Analyse architecturale des
Tableau 6 : Analyse des façades des équipements ( Source :Auteurs)
Façade Catégorie de bâtiment


Equipement administratif
R+4
Equipement administratif
R+3
Aspect et forme générale Matériaux et couleurs
Façade dissymétrique avec Marquage de l’entrée principale par l’utilisation de murs rideaux en hauteur avec des grandes fenêtres rectangulaires.
L’utilisation du béton et du verre comme matériaux.
L’utilisation de deux couleurs qui sont le gris et le blanc.
Façade qui se caractérise par un jeu de volume et l’utilisation de plusieurs formes géométriques avec la dominance du vide par rapport au plein.
L’utilisation du béton et du verre comme matériaux.
L’utilisation de plusieurs couleurs blanc, orange et vert pour le vitrage.
Chapitre IV : Lecture et interprétation des résultats 66
45 : Pourcentage de personnes satisfaites du nombre des équipements ( Source : Questionnaire)
équipements
Equipement administratif
R+4
Façade monumentale marquée par sa symétrie selon l’axe de l’entrée principale.


La présence de plusieurs marches qui marquent l’entrée principale ayant comme objectif de montré la puissance judiciaire.
L’utilisation des formes géométriques simples.
L’utilisation de grandes ouvertures en longueurs et un jeu de plein et de vide pour symboliser la transparence.
L’utilisation du béton et du verre comme matériaux.
L’utilisation de deux couleurs qui sont le bleu et le blanc.
Equipement administratif
R+4
Façade dissymétrique qui se caractérise par un mélange de formes courbées et de formes rectilignes.
Le volume cylindrique représente l’élément emblématique.
L’utilisation du béton et du verre comme matériaux.
L’utilisation de deux couleurs qui sont le noir et le blanc.
A travers l’analyse des différentes façades, nous constatons qu’il existe une standardisation dans les formes utilisées ainsi que les matériaux et les couleurs utilisés, ceci a contribué à une sorte de répétition et de monotonie dans le paysage urbain.
I.4.3 Analyse sensorielle
Pour dégager les critères et les indicateurs liés à la dimension architecturale, nous avons opté pour un entretien réalisé auprès des employés de l’entrée Est, et ce, pour deux principales raisons :
Les équipements présentent la fonction la plus dominante dans notre site.
Les employés passent plus de 8h chaque jour au niveau de leurs bureaux.
Nous avons recueilli les points de vue de 10 personnes de 10 différentes administrations afin de découvrir comment leur perception sensorielle agie parallèlement aux atmosphères des espaces dans lesquels ils passent leur journée.
Au lieu de procéder à une analyse philosophique et théorique, nous avons opté pour une grille qui ciblait des réactions précises afin d’évaluer leur réceptivité vis-à-vis les espaces architecturaux qui les entourent et recueillir un maximum d’informations.
Chapitre IV : Lecture et interprétation des résultats 67
Tableau 7 : Grille de l’analyse de l’expérience sensorielle (source : Auteures) Expériences

Sensations
Espace lumineux Espace sombre
Espace large Espace étroit
Expérience visuelle
Expérience olfactive
Expérience auditive
Expérience tactile
• Résultats de l’entretien :
Vue dégagée Vue restreinte
Bonne odeur Mauvaise odeur
Espace calme Espace bruyant
Confort sonore Inconfort sonore
Matériaux doux Matériaux rugueux
Texture plaisante Texture désagréable
Les résultats présentés dans les graphiques suivants nous ont permis de conclure que la plupart des employés apprécient les espaces en matière de luminosité, de vue dégagée (90% et 70%) ainsi qu’une absence de mauvaise odeur ce qui nous a amené a jugé leurs expériences visuelle et olfactive comme bonne. Contrairement à l’expérience auditive et tactile où on a enregistré des valeurs très basses en matière de confort sonore et de calme (0% et 20%) ainsi que la texture des matériaux (désagréable et rugueux).
Chapitre IV : Lecture et interprétation des résultats 68
Figure 46 : Résultats de l’analyse sensorielle (Source : entretien)
I.4.4 Analyse multicritères des services et équipements
Tableau 8 : Evaluation du bien-être urbatectural de la composante Services et Equipement ( Source :Auteurs)
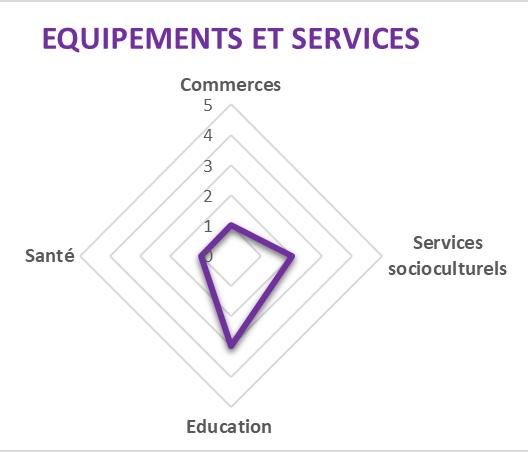
Note attribuée par composante Indicateurs critères Coefficient
attribuée
Etat de profil des performances relatives à la composante des équipements et services :
• Les indicateurs relatifs aux commerces (existence et diversité) et à la santé (accessibilité aux établissement de santé) se trouvent dans un intervalle très faible et ce dû à l’insuffisance d’activités commerciales et des équipements de santé.
• Les indicateurs relatifs aux services socioculturels (présence des équipements de proximité et qualité des services) sont tous les deux faibles.
• Le critère relatif à l’éducation est d’une valeur moyenne dû à la présence des équipements scolaires dans le site (CEM, lycée).
Chapitre IV : Lecture et interprétation des résultats 69
Note
note obtenue
critère Note par indicateur SERVICES ET EQUIPEMENT 1.75/5 Commerces - Existence (marché de première nécessité) - Diversité 5 3 1 1 5 3 1 Services socioculturels - Présence des équipements de proximité - Qualité des services 2 3 2 2 4 6 2 éducation - Accessibilité aux établissements scolaires (tous les niveaux) 3 3 9 3 Santé - Accessibilité aux établissements de santé 3 1 3 1
par
Figure 47 : Etat de profil des performances relatives à la composante des équipements et services ( Source :Auteures)
I.5 Le paysage
I.5.1 Lecture de la façade urbaine
A travers la lecture de la façade urbaine nous avons remarqué une standardisation du bâti dans les formes géométriques utilisés ainsi que les matériaux et les couleurs ce qui a contribué à une sorte de répétition et de monotonie dans le paysage urbain
Figure 48 : Façade urbaine de l’entrée Est (Source : Auteures)
I.5.1
Analyse multicritères du paysage

Tableau 9 : Evaluation du bien-être urbatectural de la composante paysage (Source : Auteurs)
Note par indicateur Nature (paysage naturel)
- Qualité visuelle intéressante et cohérente - Aménagement paysager - Accessibilité aux espaces naturels
2 3 2
2 2 2
4 6 4
2 Ressources naturelle
- Présence de l’eau : la Mer, les fleuves, les lacs - La végétation : forêts, parc ….
2 3
5 4
10 12
4.4 Paysage urbain

- La qualité architecturale du cadre bâti - L’identité de l’espace
4 1
2 1
8 1 1.8
Chapitre IV : Lecture et interprétation des résultats 70
Note attribuée par composante Indicateurs critères Coefficient Note attribuée note obtenue par critère PAYSAGE 2.73/5
Etat de profil des performances relatives à la composante du paysage :
• Les trois indicateurs du paysage naturel (qualité visuelle, aménagement paysager et accessibilité aux espaces naturels) se trouvent dans un intervalle faible
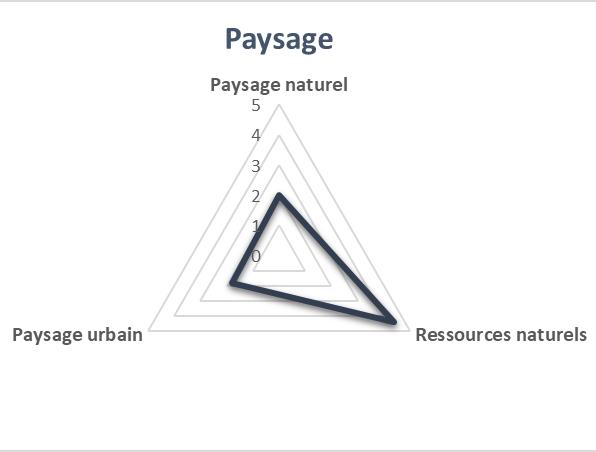
• Un seul critère a atteint une valeur optimale qui est les ressources naturelles et ce dû à la présence des retenues collinaires mais aussi d’une vue sur la mer.
• Les indicateurs relatifs au paysage urbain affichent : une valeur faible de la qualité architecturale et du cadre bâti (monotonie des façades, aspect architectural pauvre .) et une valeur très faible de l’identité de l’espace (urbanisation récente du site).
Profil général d'évaluation du bien-être à l’entrée Est
Suite l’évaluation de chaque composante individuellement nous avons réalisé un profil général qui regroupe toutes les composantes. Nous constatons qu’il existe deux composantes qui nécessitent une mise à niveau urgente ; l'habitat et les services et équipements qui ont enregistrés des valeurs très basses malgré la présence de l’habitat promotionnel et d’une mixité des fonctions.
Bien que la composante de la mobilité soit la meilleure parmi toutes les composantes dû à la présence d’un réseau viaire fonctionnel mais elle n'a pas encore atteint le résultat escompté, elle doit également être améliorée.
La composante du paysage urbain suit la composante de la mobilité dans le classement en raison de la présence de plusieurs ressources naturelles qui peuvent être exploitées pour assurer le bien-être de la population.
La composante de la cohésion sociale a enregistré des valeurs moyennes malgré l’absence des espaces de rencontres et de jeux suite à l’appropriation non contrôlée des terrains vierges présents dans le site, ce qui nécessite également son amélioration.
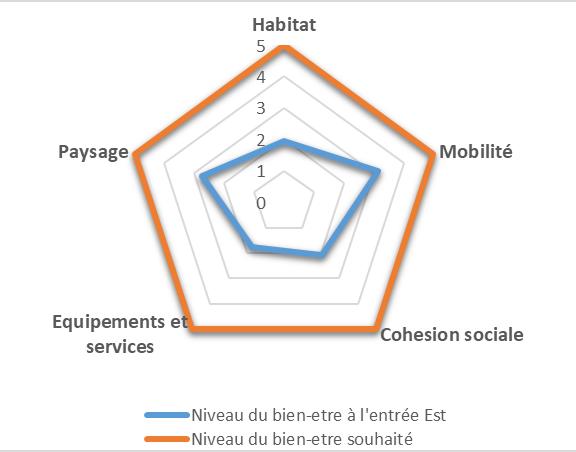
Chapitre IV : Lecture et interprétation des résultats 71
Figure 49 : Etat de profil des performances relatives à la composante du paysage (source : Auteures)
Figure 50 : Etat de profil des performances au bien être urbatectural à l’entrée Est ( source :Auteures)
II. Analyse qualitative FFOM
Les données présentées dans le tableau ci-dessous sont l’interprétation des différentes caractéristiques du site d’étude. Avec l’entrée Est (site : facteurs endogènes) et la ville de Jijel (environnement : facteurs exogènes).
Tableau 10 :Matrice FFOM: Classement des facteurs endogènes et exogènes (Source : Auteurs)
Facteurs
Endogènes Forces Faiblesses
• Emplacement stratégique à l’entrée de la ville.
• Réseau viaire fonctionnel et bien structuré permettant la circulation au niveau du site.
• Accessibilité bonne grâce à la présence de deux voies importantes et structurantes (RN43 et l’évitement sud).
• Circulation adéquate au sein du site grâce aux trames viaires.
• Présence d’une façade maritime offrant des vues dégagées sur la mer.
• Manque d’espaces verts et de rencontres dans les quartiers résidentiels.
• Appropriation des espaces publics non contrôlée.
• Mauvaise qualité des espaces publics
• Présence de nuisances sonores liées au bruit de circulation
• Mauvaise exploitation des retenues collinaires présentes dans le site.
• Paysage naturel menacé par l’urbanisation.
Entrée Est
• Possibilité d’exploitation des retenues collinaires pour mettre en valeur le paysage naturel.
• Opportunité paysagère remarquable grâce à sa situation (entouré par des espaces naturels de diverse qualité)
• Disponibilité des ressources naturelles.
• Population jeune dominante
• Taux élevé de la population active
• Origines géographiques diverse.
• Faible densité urbaine.
• Population prévisionnelle 18045 habitants
• Niveau d’instruction élevé
• Absence de la délinquance et de comportements qui peuvent nuire à la sécurité et la tranquillité des citoyens.
• Nouvelle centralité urbaine
• Dynamique urbaine et fonctionnelle
• Impression de monotonie due à la répétitivité des bâtiments et de la pauvreté des compositions architecturales (Standardisation et banalisation des façades)
• Façade urbaine non homogène en matière de gabarit et de couleurs donnant une mauvaise image à l’entrée Est de la ville.
• Forme bâtie visuellement inintéressante qui ne s’harmonise pas avec l’environnement immédiat.
• Manque de repères et difficulté d’orientation.
• Manque d’attractivité et des points d’appels.
• Rues piétons sans façades ouvertes, sans activités.
• Dominance de l’habitat collectif.
• Dominance des équipements administratifs.
• Discontinuité entre l’espace bâti et non
Chapitre IV : Lecture et interprétation des résultats 72
Entrée Est
• Présence d’une mainte de fonctions.
• Typologie d’habitat variée.
• Présence des vides urbains qui peuvent être exploités.
• Potentiel foncier offrant de grandes valeurs urbanistiques à valoriser
• Existence d’équipements d’une aire d’influence régionale.
• Projet d’avenir promoteur.
bâti.
• Absence d’une offre commerciale appropriée pour desservir la population.
• Absence des infrastructures sanitaires.
• Zoning et séparation des fonctions
• Absence d’un fonctionnement dynamique et économique dû à l’inexistence d’activités commerciales.
• Fort attachement au centre-ville.
Facteurs Exogènes Opportunités Menaces
• Urbanisation polycentrique.
• Compacité des tissus urbains.
• Continuité spatiale, visuelle et fonctionnelle.
• Offre diversifiée des services urbains.
• Desserte spatiale planifiée à l’extérieur du centre-ville : (Pôle Mezghitane, Pôle entrée Est)
• Diversité de l’offre de transport suburbain.
• Etalement urbain au détriment des terrains agricoles (Manque de disponibilités foncières).
• Mode de transport public collectif inapproprié et non diversifié.
• Mauvaise exploitation des potentialités du paysage naturel et urbain.
• Espaces libres mal exploités.
la ville de Jijel
• Accessibilité en voie d’amélioration grâce à l’achèvement des travaux de dédoublement de voie Jijel – Constantine, Jijel – Bejaia et la bretelle vers autoroute Est- Ouest ainsi que la réalisation aérogares capacité de 250000 passagers.
• Disponibilité des ressources naturelles Proximité des 02 deux ports de pêche et de plaisance (Ziama Mansouria, El Aouana).
• Proximité d’un parc animalier.
• Proximité du port Djendjen.
• Proximité de deux gares multimodale.
• Proximité d’aéroport prochainement reclassé en aéroport international.
• Qualité environnementale acceptable ; pollution atmosphérique, physique ou sonore…etc.
• Inégalités socio spatiales dans certaines zones.
• L’inefficacité de l’action public (bonnes initiatives / mauvaise concrétisation des projets).
• Logique sectorielle de programmation
• Manque de plateformes de communication et d’implication citoyenne dans la prise de décision et la programmation des interventions
• Inadéquation des outils de planification spatiale se trouvant en décalage par rapport au contexte (bien être urbain, bien être architectural et bien-être urbatectural).
Chapitre IV : Lecture et interprétation des résultats 73
Synthèse de la lecture
• La ville de Jijel a des opportunités nombreuses qui peuvent être exploitées accompagnés aux potentialités de l’entrée Est pour améliorer le bien-être urbatectural du site. (Complémentarité des deux environnements).
• Le site se caractérise par une bonne accessibilité, une mixité des fonctions urbaines, et une présence d'éléments paysagers et naturels qui font de lui un lieu attractif et dynamique. Mais l’incapacité d’exploiter ses atouts a conduit à la création de plusieurs lacunes qui à leur tour ont entrainé une diminution de la qualité du de vie. (Mauvaise exploitation des opportunités et des forces des deux périmètres)
• Le manque d'activités commerciales entraînant ainsi une dépendance au centreville et une nécessité conséquente de se déplacer pour des courses quotidiennes. (Dépendance de l’entrée Est à la ville de Jijel)
• La mauvaise perception de l'espace bâti a engendré une faible appropriation des espaces construits et la formation d’une image négative chez la population occupant du site (habitants, employés et visiteurs). (Manque d’identité, de créativité et de symbolisation des lieux)
• La non-considération des atouts considérables de l’entrée Est ont fait d’elle un site faible en matière de bien-être, le rattrapage des lacunes peut se faire en exploitant outre les potentialités du site les opportunités de la ville. (Possibilité d’une intégration sociale, spatiale et fonctionnelle)
Conclusion
À travers l’observation, le questionnaire, l'enquête, l'analyse multicritères et l'analyse FFOM nous avons constaté que le degré du bien-être urbatectural est très bas malgré le fait que l'entrée Est soit fonctionnellement mixte et offre de nombreuses possibilités pour créer un cadre de vie de qualité
Les résultats obtenus grâce à la matrice FFOM montrent que l'entrée Est de la ville de Jijel possède de nombreux potentiels qui lui permettent d'améliorer la mixité urbaine et de favoriser le bien-être urbatectural des différents occupants. En effet, les faiblesses de notre cas d'étude résident dans le manque des activités commerciales, sanitaires et des espaces publics qui sont bien mis en évidence dans l'AMC et qui se sont ensuite confirmés dans la grille FFOM. Il existe d'autres facteurs qui ont contribué au manque de bien-être urbatectural et qui ont été représentés dans le paysage urbain inanimé, les matériaux de construction de mauvaise qualité, la banalisation et la monotonie des façades
Cependant, tout ce qui précède peut-être corriger, les opportunités de l'entrée Est doivent être exploitées par l'aménagement des espaces publics qui joueront un rôle important dans le renforcement des liens sociaux entre les résidents, la création et la diversification des activités de proximité dont les habitants ont besoin, l’exploitation de la façade maritime et les retenues collinaires pour améliorer la qualité du paysage urbain.
Chapitre IV : Lecture et interprétation des résultats 74
Conclusion générale
Notre travail de recherche avait comme objectif de saisir la relation qui existe entre la mixité urbaine et le bien-être urbatectural avec une volonté de mettre en avant les résultats de cette coalition, la recherche s’est articulée particulièrement autour de la problématique de la qualité de vie dans les villes contemporaines : Comment vivre ensemble une vie agréable ?
Nous avons soulevé au début de ce travail, que la configuration spatiale des zones mixtes ne permettait de satisfaire que les besoins fonctionnels de l'homme, négligeant ainsi le bien-être de celui-ci. Notre contribution scientifique a mis l’accent sur l’entrée Est de la ville de Jijel, qui souffre aujourd’hui de plusieurs déficits en dépit des multiples potentialités à sa disposition.
En première partie, notre recherche s’est portée sur la mixité urbaine qui présente aujourd’hui un instrument indispensable de la planification urbaine. Elle se décline en trois dimensions : fonctionnelle, sociale et architecturale et s’applique à différentes échelles : la ville, le quartier et l’immeuble. Mais il convient de tenir en compte ses conditions à savoir la densité, la proximité, la polycentralité, la mobilité et le paysage afin de donner une structure urbaine et architecturale cohérente à la ville.
En deuxième partie, nous nous sommes intéressés à la notion du bien-être afin de mettre en place une approche urbatecturale en se basant sur le lien qui existe entre le bien-être et la mixité urbaine. En quête vers cette approche, nous avons abordé cette notion à travers deux différentes échelles : architecturale et urbaine en mettant l’accent sur ses vecteurs avant de les combiner à une échelle commune urbatecturale. Nous avons ainsi pu identifier toute une série de démarches à prendre en compte pour assurer un cadre de vie de qualité.
Notre hypothèse consistait à mettre en évidence une approche urbatecturale combinant la mixité urbaine et le bien-être pour améliorer la qualité de vie des habitants. C’est pourquoi nous avons consacré la troisième partie à un diagnostic préliminaire de notre cas d’étude qui est l’entrée Est de la ville de Jijel en faisant ressortir les potentialités et les contraintes de ce site, mais aussi les indicateurs de bien-être jugés comme les plus importantes pour les habitants. A cet égard une enquête par questionnaire et par interview a été menée auprès des différents usagers, ce qui nous a permis de dégager un ensemble d’indicateurs classés selon différents critères pour évaluer le niveau de bien-être.
En dernière partie, nous avons fait appel à l’analyse multicritères ainsi que l’analyse
CONCLUSION GENERALE 75
FFOM afin de démontrer que malgré le fait que l’entrée Est soit mixte mais cette planification a produit un déséquilibre spatial de la qualité de vie, et a entrainé une dégradation de son image donnant ainsi une sensation de mal-être à ses usagers.
Nous pouvons néanmoins déduire que les résultats obtenus à travers cette évaluation nous ont permis de confirmer notre hypothèse de recherche qui est : que la mixité urbaine seule ne suffit pas à créer un cadre de vie de qualité, la mise en place des mécanismes favorisant le bien être à une échelle urbatecturale (urbaine et architecturale) est nécessaire pour mener à bien la réussite des politiques publiques qui se trouvent aujourd’hui en décalage par rapport à ce contexte.
Compte tenu des conclusions précédentes, les quelques recommandations suivantes nous paressent nécessaires pour valoriser les atouts que dispose notre site, et donc pour améliorer la qualité de vie de ses habitants :
Promouvoir un tissu urbain alternatif échappant à la vision classique de la typologie d’habitat : collectif et individuel ;
Permettre l’accès à un logement plus convenable aux habitants en matière de conception, matériaux et implantation ;
Penser réellement à la mixité urbaine au-delà de l’échelle urbaine, mais plutôt essayer d’assurer la coexistence et la cohabitation à l’échelle de l’ilot et à celle de l’immeuble ;
Développer les services urbains, notamment le commerce, facteur clé pour redynamiser la zone et pour assurer plus d’attractivité, d’animation et d’autonomie au site ;
Améliorer la qualité des espaces publics afin de favoriser :
• La marchabilité par la création d’une promenade urbaine diversifiée et intéressante ;
• L’interaction sociale par la création des espaces publics qui devront proposer de meilleurs liens sociaux entre les usagers ;
Améliorer le paysage urbain à travers la qualité des aménagements, la végétation ; les façades des bâtiments et le type des activités existantes, en prenant en compte :
• Les repères urbains pour une meilleure lisibilité des espaces.
• Les proportions et les dimensions afin de créer des espaces à l’échelle humaine.
CONCLUSION GENERALE 76
• Les pratiques sociales et spatiales des habitants pour assurer une meilleure perception des espaces
• Le sentiment de sécurité des usagers en facilitant l’orientation
Mettre en places des mécanismes conduisant à une participation réelle des habitants dans la prise des décisions relatives à leur cadre de vie, l’information, la consultation des propositions des instruments d’urbanisme ne suffisent pas pour s’assurer de la satisfaction des habitants envers les projets envisagés, la concertation et l’implication des usagers est indispensable pour arriver à proposer un espace urbain de qualité ,et pour concevoir un espace de vie appropriable .
Revoir la manière de faire et concevoir la ville, par l’intégration du contexte du bien être urbain et architectural dans les dispositifs réglementaires actuels.
Pour finir, cette recherche a pour ambition de mettre en lumière les notions de « la mixité urbaine » et « le bien-être urbatectural » ainsi que la relation entre eux, afin de mener à bien leur application lors des décisions futures. Des recherches plus poussées seraient nécessaires pour mieux valider ces résultats et mener à bien leur application.
CONCLUSION GENERALE 77
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
- Aicher, J. (1998). Designing Healthy Cities, Malabar Fl, Krieger Publishing. [En ligne] Available at : http://journals.openedition.org/critiquedart/8250
- Bailly, A. (1984). La géographie des représentations : espaces perçus, espaces vécus, dans Antoine Bailly, Les concepts de la géographie humaine, Paris. [En ligne] Available at : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01337096/document
- Bailly, A. Géographie du bien-être, 2014, Paris : Anthropos-Economica, 152 pages.
- Baudin,G. (2001).La mixité sociale : une utopie urbaine et urbanistique, In CREHU, Les utopies de la ville, séminaire, p. 2. [En linge] Avaible at : http:// halshs.archivesouvertes.fr/docs/00/10/14/42/PDF/mixite.utopie
- Becue, V., & TELLER, J. (s.d.). Comment concevoir un quartier « multifonction » pour promouvoir un développement urbain durable ? [En linge] avaible at :
https://www.unil.ch/ouvdd/files/live/sites/ouvdd/files/shared/Colloque%202005/Communica tions/A)%20Ecologie%20urbaine/A4/V.%20Becue%20et%20J.%20Teller.pdf.
- BOUAZIZ S. (2019), Bien-être urbatectural ; réflexion sur un quartier de bien-être au Lac 3 de Tunis, Mémoire de master, École Nationale d'Architecture et d'Urbanisme de Tunis [En ligne]
Available at : https://issuu.com/salem.bouaziz/docs/m_moire_salem_bouaziz
- Bouchair, A., Boussaid, T. (2017). L’efficacité énergétique dans la conception d’un quartier à haute mixité urbaine (Cas de la cité Géric Ain Smara – Constantine), Université l’Arbi Ben Mhidi–Oum El Bouaghi, mémoire de master.
- Bouhelouf, Y. 2014. L’attractivité urbaine au service de la revitalisation du centre ancien de Jijel. Mémoire EPAU 2014.
- BOURDEAU-LEPAGE L. (2020), Evaluer le bien-être sur un territoire. Comprendre pour agir sur les facteurs d’attractivité territoriaux, Editions VAA, Conseil, 87 pages, [En ligne]
Available at : https://www.psdr-ra.fr/BOITE-A-OUTILS/Bien-etreet-attractivite-territoriale
- Breda, J., & K, G. (1999). La mesure générale du bien-etre Esquisse d’une approche quantitative. Avaible at :
https://bdspehesp.inist.fr/vibad/index.php?action=getRecordDetail&idt=192206
- Channon, B. (2018). Happy by Design: A Guide to Architecture and Mental Wellbeing
- Charlot-valadieu et outrequin. (2012). Concevoir et évaluer un projet d’éco quartier, Edition Le Moniteur.
- Constanty, V., Darley, A., Jarousseau, E., Zunino, G., & Guigou, B (2011). La mixité fonctionnelle : un objectif à définir et négocier au cas par cas.
- Cyria, E. (2004). L’urbanisme durable en Europe : à quel prix ? [En ligne] Available at : http://www.cairn.info/revue-ecologie-et-politique1-2004-2-page-21.htm
2
- Delaleu, A. (2020). Mixité urbaine : le concept fétiche de la ZAC Tartempion ? [En ligne] Available at : https://chroniques-architecture.com/la-mixite-urbaine-un-concept-fetiche/
- Di Méo Guy. De l'espace subjectif à l'espace objectif : l'itinéraire du labyrinthe. In : Espace géographique, tome 19-20, n°4, 1990. pp. 359-373. [En ligne] Available at : www.persee.fr/doc/spgeo_0046-2497_1990_num_19_4_3020
- Diener, E. (1984, 1998, 2006). Subjective well-being. Avaible at : http://labs.psychology.illinois.edu/~ediener/Documents/Diener_1984.pdf
- Emelianoff, C. (1999). La ville durable, un modèle émergent : géoscopie du réseau européen des villes durables (Porto, Strasbourg, Gdansk), thèse de doctorat en géographie, université d’Orléans.
- Emelianoff, C. (2001). La ville renouvelée L’approche de la ville renouvelée vise la reconquêteurbaine, laréhabilitation écologiqueet socialedu bâti ancien, par îlots ouquartiers. [En ligne] Available at : https://base.d-p-h.info/fr/fiches/dph/fiche-dph-8466.html
- Farhi,A.,&Naceur, F. (2003). Les zones d’habitat urbain nouvelles en Algérie: inadaptabilité spatiale et malaises sociaux. Cas de Batna. [En ligne] Available at: https://insaniyat.revues.org/6944
- Francis Beaucire, X. D. (2014). Mixité. Diversité, intégration, proximité. [En ligne] Available at : http://www.citego.org/bdf_fiche-document-126_fr.html
- Gaston Bachelard (1957) LA POÉTIQUE DE L’ESPACE. Paris : Les Presses universitaires de France, 3e édition, 1961, 215 pp. Première édition, 1957. Collection : Bibliothèque de philosophie contemporaine.
- Genestier, Philippe. « La mixité : mot d'ordre, vœu pieux ou simple argument ? », Espaces et sociétés, [En ligne] Available at : https://www.cairn.info/revue-espaces-et-societes-2010-1page-21.htm
- Gérardin, H., & Poirot, J. (2010). L’attractivité des territoires un concept multidimensionnel.
- GINTRAND, F. (2020). De la charte d’Athènes : concept de fonction urbaine et zonage. [En ligne] Available at : https://chroniques-architecture.com/de-la-charte-dathenes-concept-defonction-urbaine-et-zonage/
- Guérin, D. (2013). Analyse des représentations de la Nature et de la Technique dans le secteur de l’énergie en France et au Royaume-Uni : étude et comparaison symbolique des relations de l'Homme à son environnement dans l'énergie nucléaire et dans l'énergie renouvelable. [En ligne] Available at : https://www.semanticscholar.org/paper/Analyse-
desrepr%C3%A9sentations-de-la-Nature-et-de-la-%3A
Gu%C3%A9rin/14330f09878bb9862859b6064bc7819c6321921e
3
- Guigou, B., Mangeney, C., Delaporte, C., & Hervouët, M. (2009). La mixité fonctionnelle dans les quartiers en rénovation urbaine, Tome1. Île de France: IAU.
- Guilleux,C.(2021).Ensembledans laville : mixitésociale, ségrégation et entre-soi. [Enligne]
Available at : https://calenda.org/848175?formatage=
- Hallal, I. (2007). La mixité urbaine dans les quartiers d’habitat contemporains (Cas de Ayouf
- Hancock, T., & Duhl, L. (1988). Promoting health in the urban context. WHO Healthy Cities Papers, 1. [En ligne] Available at :
https://www.academia.edu/5948380/Designing_Healthy_Cities_prescriptions_principles_an d_practice
https://www.euro.who.int/ data/assets/pdf_file/0013/101650/E87743.pdf
https://www.millenaire3.com/ressources/Mobilite-residentielle-et-mixite-urbaine-lesconditions-d-une-politique-equitable interculturelle. Psychologie. Conservatoire national des arts et métiers - CNAM, 2014. Français. [En ligne] Available at : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01674155/document
- Jeanne LEVENARD, Promotion d’unurbanismefavorableà la santé : comment mieux utiliser les contrats locaux de santé pour une meilleure prise en compte des déterminants de santé liés à l’environnement au niveau des territoires. Mémoire de Mastère spécialisé ingénierie et management des risques en santé environnement travail EHESP 2015.
- Joanne Vajda, « Alvar Aalto, La Table blanche et autres textes », Critique d’art [En ligne], Toutes les notes de lecture en ligne, Kansas : Ecotone Publishing Company.
- kecita, M., Bouchmel, A. (2019). La mixité urbaine au service des aménagements durables (Cas de Harratene), Université Mohamed Seddik Benyahia, Jijel, mémoire de master.
- Kevin Lynch, « l'image de la cité » édité par Dunod - 09 janvier 1998.
- KIRSZBAUM, T. (2012). MOBILITÉ RÉSIDENTIELLE ET MIXITÉ URBAINE : LES CONDITIONS D’UNE POLITIQUE ÉQUITABLE. [En ligne] Available at :
- KRICHEN Ayoub, Vers une approche de bien-être à Sfax, réapproprier le délaissé industriel ‘Magasin blé’. Mémoire de master, École Nationale d'Architecture et d'Urbanisme de Tunis [En ligne] Available at : https://issuu.com/ayoubkrichen/docs/combinepdf
- L’intégrationdudéveloppement durabledans lesprojets dequartier : le cas delavilled’Hanoï. Architecture, aménagement de l’espace. Université Toulouse le Mirail - Toulouse II, 2012. [En ligne] Available at: https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00845569/document
- L’INTERNAUTE DICTIONNAIRE FRANCAIS (2022). Avaible at : https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/mixite/
4
- Lacaze,J., Emelianoff,C., Galland,J., Manesse,J., Navarre.F., et Thérèse.S, (2009). Dictionnaire de l’aménagement du territoire, Etat des lieux et prospective, sous la direction de Serge Wachter, Edition Belin, Paris.
- Lakhdar Hamina, Y., & Abbas, L. (2015). Évolution des instruments de planification spatiale et de gestion urbaine en Algérie. Cinq Continents. [En ligne] Available at : https://nbnresolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-453552
- Laurent Sovet. Bien-être subjectif et indécision vocationnelle : une comparaison
- LE GOFF Erwan, SéCHET Raymonde, « Les villes-santé et le développement durable : convergence, concurrence ou écran ? », L'Information géographique, 2011/2 (Vol. 75), p. 99-
- Leturcq Samuel, « Le paysage : introduction », Hypothèses, [En ligne] Available at : https://www.cairn.info/revue-hypotheses-1999-1-page-71.htm
- LINE Agathe (2021), DÉVELOPPEMENT DU QUARTIER MIXTE : Le défi du quartier hospitalier Charles-Nicolle de Rouen, Mémoire de master, Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Nantes [En ligne] Available at https://issuu.com/agatheline/docs/line_agathe_-_m_moire_-_s09
- Lise, B.-L. (2020). Evaluer le bien-etre sur un territoire. Comprendre pour agir sur les facteurs d'attractivité territoriaux. Lyon: Editions VAA. [En ligne] Available at : https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02428935/document
- Loyd, A. Le Baromètre Attractivité des Métropoles françaises & résilience des territoires 2021. [En ligne] Available at : https://www.arthur-loyd-tours.com/parutions/barometrearthur-loyd-2021-l-appel-des-regions
- Matthieu Pichon, « Espace vécu, perceptions, cartes mentales : l’émergence d’un intérêt pour les représentations symboliques dans la géographie française (1966-1985) », Bulletin de l’association de géographes français [En ligne], 92-1 | 2015, mis en ligne le 22 janvier 2018, consulté le 22 mai 2022. [En ligne] Available at: http://journals.openedition.org/bagf/502 ; DOI : https://doi.org/10.4000/bagf.502
- McLennan, J. (2004). The Philosophy of Sustainable Design: The Future of Architecture (p. 4).
- Ménard, F. (2015). Mixité fonctionnelle versus zoning : de nouveaux enjeux ? (2011-2015). [En ligne] Available at http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/mixite-fonctionnelle-versuszoning-de-nouveaux-a430.html
Papier 1395.
- Perron Zoé, B. J. (2019). Les approches du bien-être. Un champ de recherche multidimensionnel. [En ligne] Available at : https://www.persee.fr/doc/caf_24314501_2019_num_131_1_3349
5
- Planification urbaine et mixité sociale : les servitudes de logements locatifs, une nouvelle étape en droit de l’urbanisme. (2008). [En ligne] Available at :
https://www.anil.org/documentation-experte/analyses-juridiques-jurisprudence/analysesjuridiques/analyses-juridiques-2008/planification-urbaine-et-mixite-sociale-les-servitudesde-logements-locatifs-une-nouvelle-etape-en-droit-de-lurbanisme/#:~:text=L'obj
- Rica, U. &. (2017). Et si on parlait de densité urbaine ? [En ligne] Available at :
https://www.demainlaville.com/parlaitdedensiteurbaine/#:~:text=Quand%20on%20parle%2 0de%20densit%C3%A9%20uraine%2C%20on%20parle%20g%C3%A9n%C3%A9ralement
- Roy, C. (2018). L’impact de la pratique physique sur le bien-être d’individus en situation de vulnérabilité : l’évolution du niveau de satisfaction de vie et du niveau d’estime de soi chez le public bénéficiaire du DIPS. Sciences de l’Homme et Société. [En ligne] Available at : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01895511/document
- Sahbi, K. (2017). Le renouvellement urbain durable (Cas du centre ville de la ville de Oum El Bouaghi), Université l’Arbi Ben Mhidi–Oum El Bouaghi, mémoire de master.
- Soufiane BOUKARTA, Projet urbain et retour du sujet ? la stabilité en question. Mémoire Institut d'aménagement régional AIX-Marseille III - Master 2 2009.
- Thomas Boudon, Quentin Mourier, Jean-Pierre Le Dantec, Bien vivre la ville - Et si la ville favorisait la santé et le bien-être ? 2016.
- Thomas, B. (2004). What Are Old People For? Vanderwyk & Burnham.
- Tite Voltaire SOUPENE, Mesures objectives et subjectives du bien-être : une étude comparative entre la Martinique et la république Centrafricaine. Mémoire Institut Aimé Césaire -Faculté de droit et d'économie - Master 2 - Gestion des entreprises et des institutions 2011.
- Toupictionnaire (2022). Avaible at :
https://www.toupie.org/Dictionnaire/Mixite_sociale.htm#:~:text=D%C3%A9finition%20de %20la%20mixit%C3%A9%20sociale,Ex%20%3A%20une%20classe%20mixte.
- Tovet Diener (2013), Bien-êtresubjectif. Collection derecherche Écoledes sciences sociales.
- Voisin, J.-P. (2021). Pour un urbanisme durable. Available at:
https://www.aurm.org/uploads/media/f1d9ef198ac573156b46409538b78bdb.pdf
6
ANNEXES
RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
UNIVERSITÉ DE JIJEL
DÉPARTEMENT D’ARCHITECTURE
Ce questionnaire s’inscrit dans le cadre de préparation du mémoire de fin d’études de master 2 en Architecture sur : LE BIEN-ETRE URBATECTURAL ; UNE APPROCHE POUR LA MIXITE
URBAINE : CAS DE L’ENTREE EST DE LA VILLE DE JIJEL.
On vous informe que :
Ce questionnaire est adressé pour les habitants de l’entrée Est
Nousvousremercionsdebienvouloirparticiperàcetteenquête.L’aboutissement de cetravail dépend de votre aide et coopération. Nous espérons avoir des réponses claires et authentiques.
Informations générales
1. Quel est votre sexe ?
□ Homme
□ Femme
2. Quel est votre âge ?
□ 0 à 5ans
□ 5 à 18 ans
□ 18 à 30 ans
□ 30 à 60 ans
□ Plus de 60 ans
3. Quel est votre niveau d’instruction ? □ Primaire □ Moyen □ Secondaire □ Universitaire
□ Autre
4. Quel votre origine géographique ? …….
5. Depuis quand y habitez-vous ? ……
6. Combien avez-vous d’enfants ? …….
7. Quel est votre fonction ?
□ Cadre
□ Employeur
□ Chômeur
□ Retraité □ Etudiant
8. Quel est votre lieu de travail ?
EQUIPEMENT, SERVICES ET ACTIVITES ECONOMIQUES
9. Pensez-vous qu’il y’a assez des équipements dans votre quartier ?
□ Oui
□ Non Si, c’est non : D’après vous quelles sont les équipements qui manquent ?
□ Equipements de santé
□ Equipements sportifs
□ Equipements culturels
□ Equipements scolaires
10. Pensez-vous qu’il y’a assez des activités commerciales dans votre quartier ?
□ Oui
□ Non Si, c’est non : D’après vous quelles sont les activités commerciales qui manquent ?
11. Le chemin de l’école est-il sécuritaire pour vos enfants ?
□ Oui
□ Non
12. Sentez-vous en sécurité dans votre quartier ?
□ Oui □ Non
13. Selon vous, quel est le niveau de sécurité dans votre quartier ?
□ Faible
□ Moyen
□ Bon
□ Excellent
S’il n’est pas sécurisé, quelles sont les causes ?
□ L’absence de la sûreté urbaine
□ L’éclairage public
□ La protection civile
□ La sécurité routière
14. Vous parait-il nécessaire d’avoir autres activités au sein de votre construction en plus de la fonction résidentielle ?
□ Oui
□ Non Si Oui, pourquoi ?
□ Pour réduire le besoin de se déplacer
□ Pour rendre le bâtiment convivial et attractif
15. Quel est l’endroit idéal de ces activités ?
□ Uniquement au réez-de-chaussés
□ Aux différents niveaux de l’immeuble
16. Est-ce que vous arrivez à se repérer facilement dans votre quartier ?
□ Oui
□ Non
Si, c’est Non, qu’est-ce que vous empêche de se repérer ?
□ La monotonie des bâtiments
□ Les rues sont conçues de la même façon
□ Il n’y a pas de points de repères
□ Autre MOBILITE
17. Où déplacez-vous pour faire vos courses quotidiennement (alimentaires, ménager...) ?
□ Dans le quartier
□ Quartiers voisins
□ Centre-ville
18. Quel est votre moyen de déplacement pour ces courses ?
□ A pied
□ Vélo
□ Transport en commun
□ Voiture
19. Combien de temps prenez-vous pour aller faire vos courses ?
□ 5 - 10 min
□ Une heure
□ Deux - trois heures
20. Par quel moyen vous vous déplacez (travail ou école / formation) ?
□ A pied
□ Vélo
□ Transport en commun
□ Voiture
21. Quelles sont vos habitudes pour vos déplacements dans le quartier ?
□ A pied
□ Vélo
□ Transport en commun
□ Voiture
22. Comment qualifier vous le déplacement à l’intérieur de votre quartier ?
□ Mauvais
□ Faible
□ Moyen
□ Bon
□ Excellent
S’il n’est pas bon pourquoi
□ L'insécurité
□ Manque des aménagements appropriés
□ L’état des voies et des trottoirs
23. Est-ce que la sécurité des déplacements vous semble suffisante ?
□ Oui
□ Non Pourquoi ? …………..
24. Comment qualifier-vous l’état des pistes piétonnes au sein de votre quartier ?
□ Mauvais
□ Faible
□ Moyen
□ Bon
□ Excellent
S’il n’est pas bon pourquoi ?
□ L'insécurité
□ L’absence de la végétation
□ Paysage non animé
25. Comment jugez-vous le nombre de places de stationnement dans votre quartier ?
□ Pas du tout suffisant
□ Pas suffisant
□ Peu suffisant
□ Suffisant
□ Très suffisant
26. Comment qualifier vous les places de stationnement dans votre quartier ?
□ Mauvais
□ Faible
□ Moyen
□ Bon
□ Excellent S’il n’est pas bon pourquoi
□ Emplacement
□ Sécurité
□ Aménagement
□ Accessibilité
□ Autre
HABITAT
27. Type de bâtiment : ………, nombre de logement dans le bâtiment : Nombre de niveaux : …………………. ; nombre de pièces :………
28. Comment trouvez-vous votre logement ?
□ Insatisfaisant
□ Peu satisfaisant
□ Moyennement satisfaisant
□ Satisfaisant
□ Très satisfaisant
Si, ce n’est pas satisfaisant, qu’est-ce que vous dérange le plus dans votre logement ?
□ La surface
□ L'orientation
□ L'endroit
□ La division des espaces
□ La qualité des matériaux utilisés
□ L'isolation (température, bruit, humidité)
□ L'esthétique de la construction et des aménagements extérieurs
29. Avez-vous procédé des modifications au niveau de logement et des façades ?
□ Oui
□ Non
Si, c’est Oui, est ce que c’est :
□ À l’intérieur de votre logement
□ À l’extérieur (au niveau des façades)
30. Quel genre de modification avez-vous effectué ?
……………
31. Pour quelle raison avez-vous fait ces modifications ?
□ Sécurité
□ Inconfort
□ Privacité
□ Autre
32. Comment juger vous la manière dont vous vous déplacez de l’intérieur de votre logement à l’espace public ?
□ Brutale
□ Peu brutale
□ Douce
33. L’accès de votre logement à la lumière naturelle est-il :
□ Insuffisant
□ Confortable
□ Très important
34. Etes-vous gêné par des nuisances sonores
□ Non c’est confortable
□ Voisinage de palier
□ La ventilation
□ Bruit (extérieur ou intérieur
35. Comment jugez- vous l’environnement immédiat de votre logement ?
□ L’aspect esthétique des constructions
□ La propreté
□ La qualité de l’air (pollution)
□ La tranquillité (bruit, nuisances sonores)
COHESION SOCIALE
36. En général, quelle est la raison principale pour laquelle vous vous rendez aux espaces publics de votre quartier ?
□ S'asseoir pour lire, se reposer, observer le décor urbain
□ Discuter avec des amis
□ Faire du sport
□ Jouer avec les enfants
□ Prendre une pause, manger, boire...
37. Combien de temps restez-vous à l’espace public
□ 30 min
□ Une heure
□ Plus d'une heure
38. En général, avec qui vous venez aux espaces publics de votre quartier ?
□ Seul
□ Accompagné
Si vous êtes accompagnés spécifiez avec qui
□ Vos amis
□ Votre conjoint(e)
□ Vos enfants
39. Lorsque vous êtes aux espaces publics de votre quartier, que ressentez-vous ?
□ Inconfort
□ Bien-être
□ Neutre
40. Comment qualifiez- vous l’espace extérieur de votre quartier ?
□ Mauvais
□ Faible
□ Moyen
□ Bon
□ Excellent
41. Quels sont les éléments que vous considérez nuisibles aux paysages du quartier ?
□ Manque ou absence d'espaces verts
□ Manque ou absence du mobilier urbain
□ Manque ou absence de la lumière la nuit
□ Hauteur des constructions
□ Manque ou absence de vue sur mer/montagne
□ Autre
42. Que ce qui vous ferez mieux apprécier un espace public ?
□ Son emplacement stratégique
□ Sa conception (aménagement de l’espace, mobilier urbain, végétation...)
□ Avoir un sentiment de sécurité
□ Le rôle attribué à cet espace (espace de jeu, marche, détente...)
Quel est votre sexe?



GÉNÉRALES


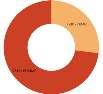
Profil d’enquête
Quel est votre âge ?
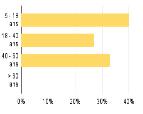
Quel est votre niveau d’instruction ?
Quelle est votre fonction ?

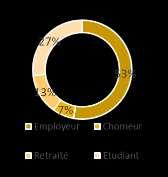
Quelle est votre origine géographique ?


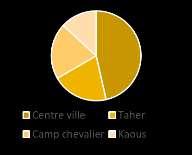
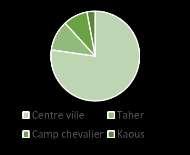


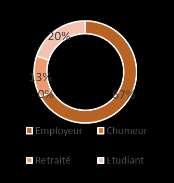
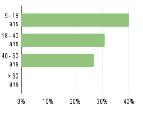
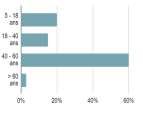
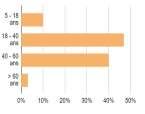

ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4
COMPOSANTE
INFORMATIONS
Pensez vous qu’il y’a assez d’équipements dans votre quartier ?
Quels sont les équipements qui manquent ?
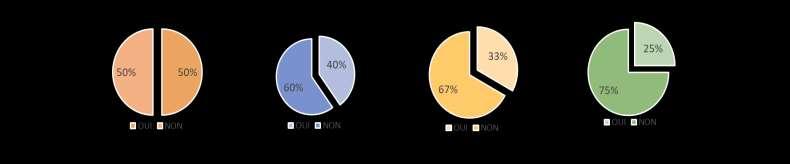
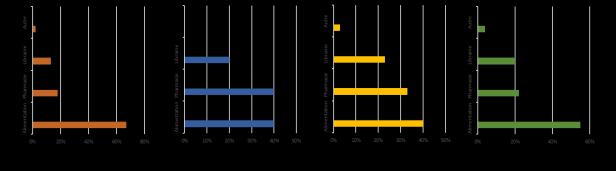
Pensez vous qu’il y’a assez d’activités commerciales dans votre quartier ?
Quels sont les activités qui manquent ?


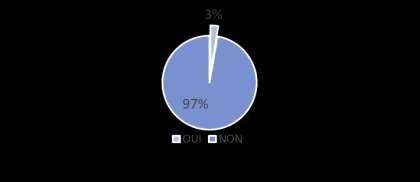
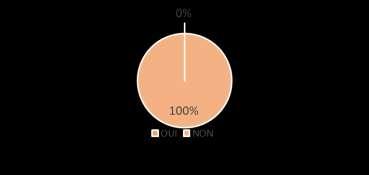
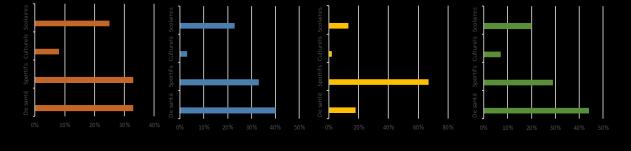
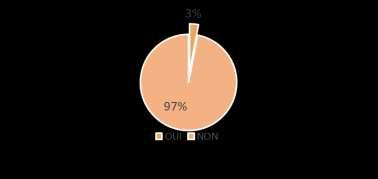
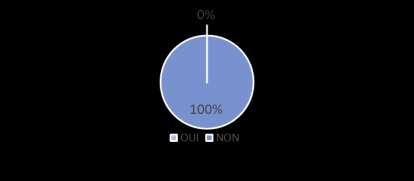
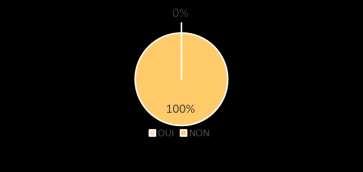
Le chemin de l’école est-il sécurisé pour les enfants ?

ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4
COMPOSANTE
EQUIPEMENTS, SERVICES ET ACTIVITÉS COMMERCIALES
Quel est le niveau de sécurité dans votre quartier ?
Quelles sont les causes ?
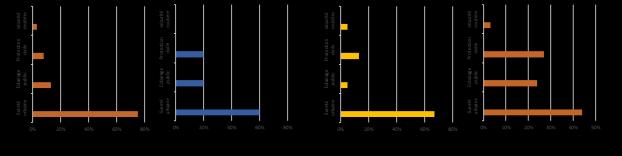
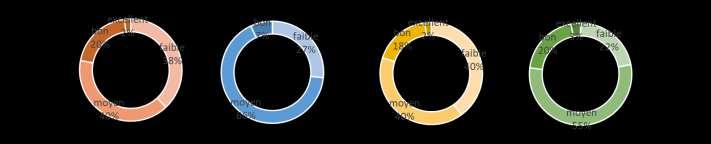
Vous parait-il nécessaire d’avoir d’autres activités au sein de votre immeuble ?
Pourquoi ?
Quel est l’endroit idéal de ses activités ?
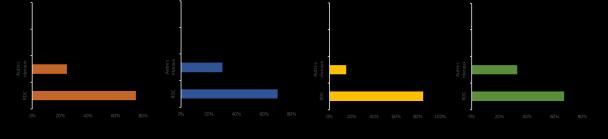
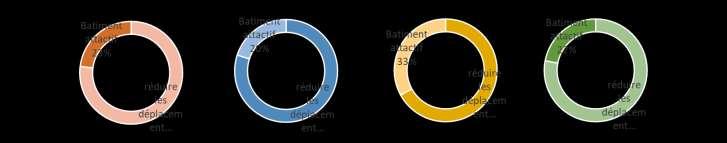
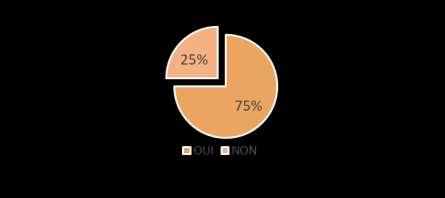
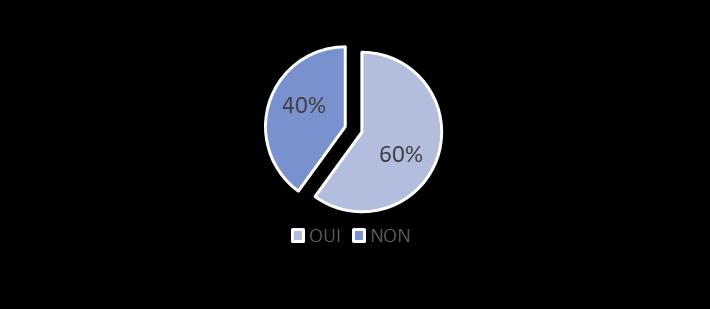
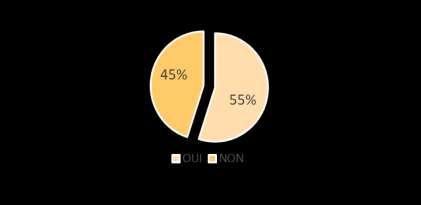
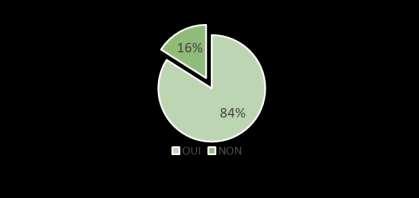
ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4
COMPOSANTE
ET
EQUIPEMENTS, SERVICES
ACTIVITÉS COMMERCIALES
Quelles sont les causes ?
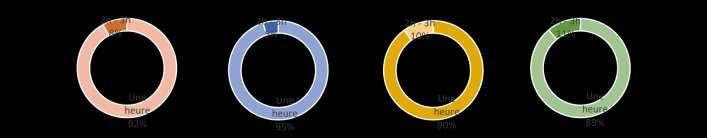
COMPOSANTE
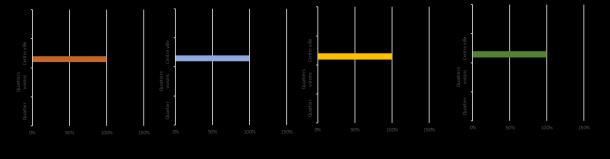
Où déplacez-vous pour faire vos courses quotidiennement (alimentaires, ménager...) ?
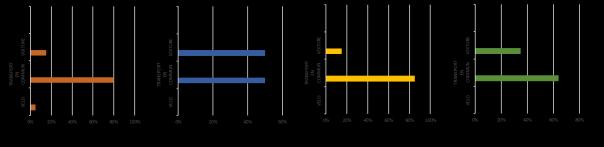
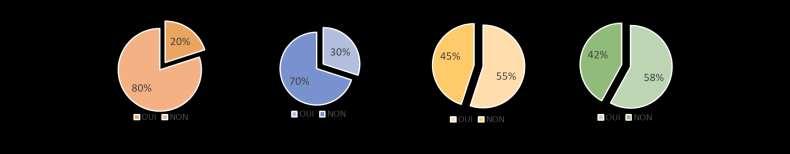
Quel est votre moyen de déplacement pour ces courses ?
Combien de temps pensez-vous pour aller faire vos courses ?
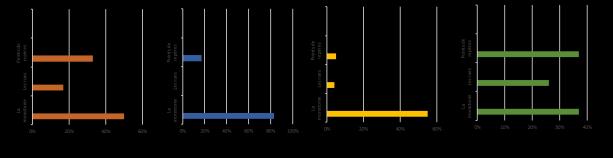
Est ce que vous arriver a vous repérez dans
?
le quartier
ZONE 1
ZONE 2
ZONE 3
ZONE 4
MOBILITE
Par quel moyen vous vous déplacez (travail ou école / formation) ?
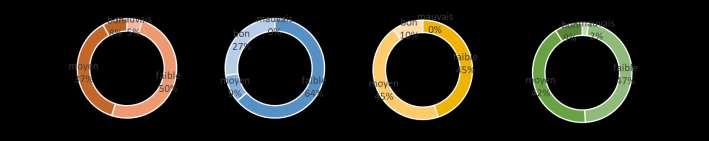
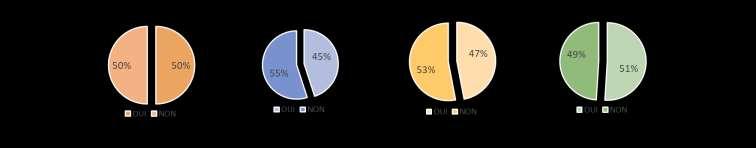
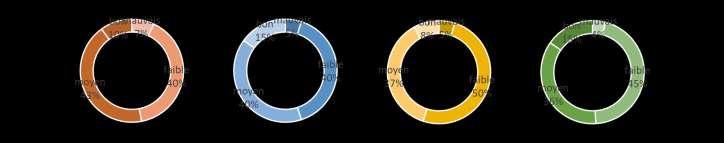
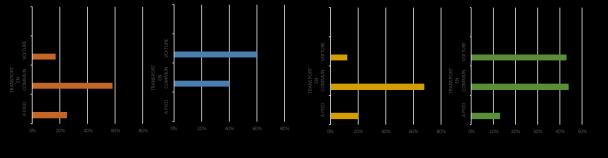
Quelles sont vos habitudes pour vos déplacements dans le quartier ?
Comment qualifier vous le déplacement à l’intérieur de votre quartier ?
Est-ce que la sécurité des déplacements vous semble suffisante ?
Comment qualifier-vous l’état des pistes piétonnes au sein de votre quartier ?
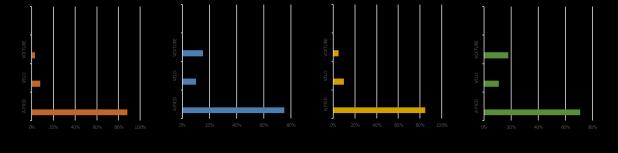
ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4
COMPOSANTE MOBILITE
COMPOSANTE HABITAT
Comment qualifier vous les places de stationnement dans votre quartier ?
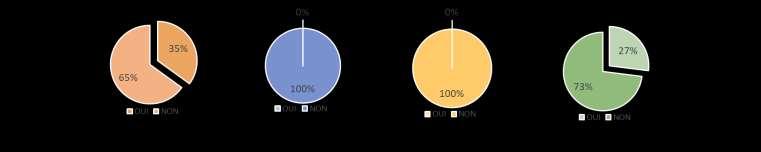
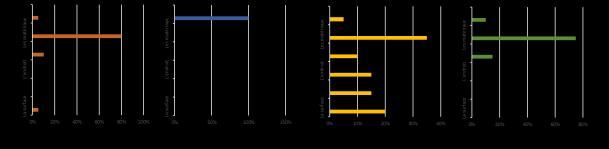
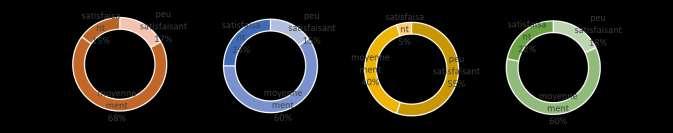
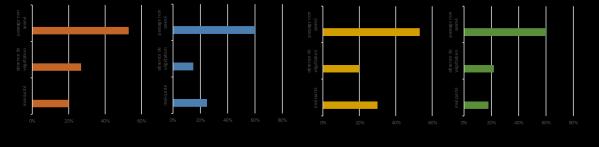
S’il n’est pas bon pourquoi ?
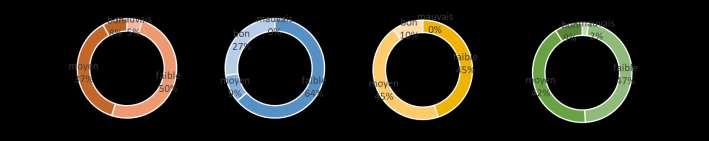
Comment trouvez-vous votre logement ?
Pourquoi ?
Avez-vous procédé des modifications au niveau de logement et des façades ?
MOBILITE
ZONE 1
ZONE 2
ZONE 3
ZONE 4
Où avez-vous effectuez ces modifications ?
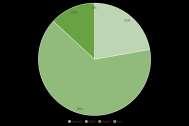
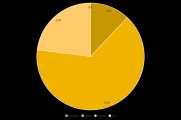

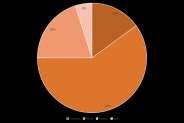
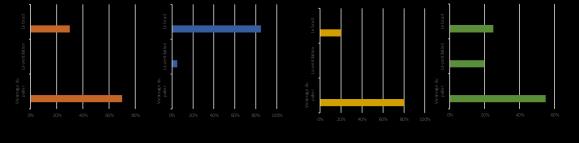
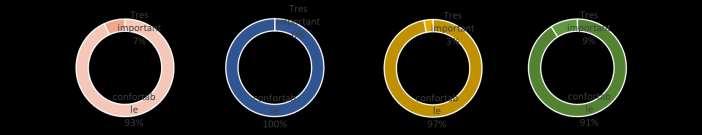

Comment juger vous la manièredont vous vous déplacez de l’intérieurde votre logement à l’espacepublic?
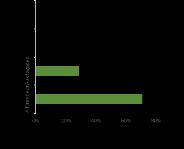
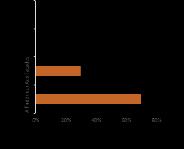
L’accès de votre logement à la lumière naturelle est-il :
Etes-vous gêné par des nuisances sonores
Comment jugez- vous l’environnement immédiat de votre logement ?
ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4
/ /
COMPOSANTE
HABITAT
En général, quelleest la raison principalepour laquellevous vous rendez aux espaces publics de votre quartier?
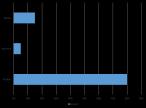
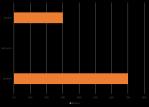
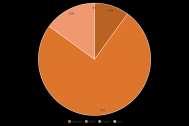

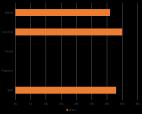
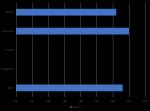
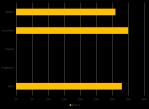
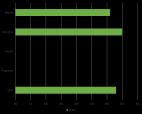
Combien de temps restez-vous à l’espace public ?



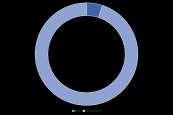
En général, avec qui vous venez aux espaces publics de votre quartier ?
Lorsque vous êtes aux espaces publics de votre quartier, que ressentez-vous ?
Comment qualifiez- vous l’espace extérieur de votre quartier ?

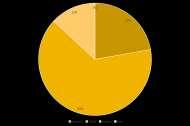
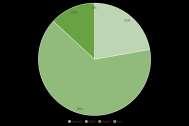
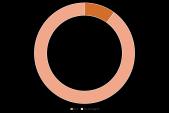
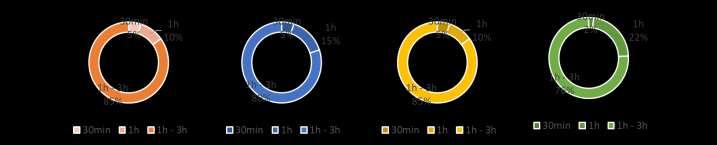
ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4
COMPOSANTE COHESION
SOCIALE
Quels sont les éléments que vous considérez nuisibles aux paysages du quartier ?

Que ce qui vous ferez mieux apprécier un espace public ?
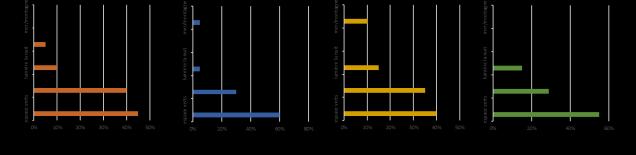
Dans le contexte actuel d’une urbanisation mondiale rapide et de transformations spectaculaires des villes, offrir une meilleure qualité de vie pour les habitants devient une question de plus en plus cruciale pour les décideurs. La mixité urbaine a été mise à profit pour répondre aux exigences des populations au niveau fonctionnel, architectural et social. Cependant, cette approche restrictive de mixité n’a réellement répondu qu’à des besoins fonctionnels, conduisant à la formation des espaces incompatibles avec les besoins actuels de la société, et négligeant ainsi l’importance de créer des espaces où les citoyens se sentent à l'aise et satisfaits de leur environnement.
Cette recherche vise à présenter un aperçu sur la manière d'atteindre un "équilibre entre l'homme et son environnement" en plaçant le bien-être au premier plan de la conception et la formation des espaces mixtes. Le bien-être urbatectural particulièrement ne peut être dissocié de la problématique de la mixité urbaine, il contribue à sa mise en œuvre et représente aujourd’hui le moyen le plus adéquat pour offrir une meilleure qualité de vie aux citoyens
L’objectif de ce travail est de mettre en lumière la relation imbriquée qui existe entre la mixité urbaine et le bien-être urbatectural, à travers l’évaluation du bien être urbatectural au niveau de l’entré Est de la ville de Jijel, par le biais d’un ensemble des indicateurs et critères choisis suite à une lecture approfondie des conditions de la mixité urbaine et des vecteurs du bien-être.
Afin de mener à bien notre travail, nous avons utilisé de différentes méthodes : l’observation directe, l’enquête par questionnaire et par entretien, l’analyse multicritères et l’analyse FFOM. Ces méthodes nous ont permis de relever les potentialités qui permettront d'améliorer la mixité urbaine et de favoriser le bien-être urbatectural.
Mots clés :
Mixité urbaine, Mixité fonctionnelle, Mixité architecturale, Mixité sociale, Bien-être, Urbatecture, Bien-être urbatectural , Qualité de vie.
Résumé
In the current context of rapid global urbanization and dramatic urban transformations, providing a better quality of life for residents is becoming an increasingly crucial issue for decision makers. Urban mixing has been used to meet the functional, architectural and social demands of the population. However, this diversity approach has only really addressed functional needs, leading to the formation of spaces that are incompatible with society's current needs, and thus neglecting the importance of creating spaces where citizens feel comfortable and satisfied with their environment.
This research aims to present an overview on how to achieve a "balance between people and their environment" by placing well-being at the forefront of the design and formation of mixed spaces. Especially the urban welfare cannot be dissociated from the problem of urban mixing, it contributes to its implementation and represents today the most adequate way to offer a better quality of life to citizens.
The objective of this work is to highlight the intertwined relationship between urban diversity and urban well-being, through the evaluation of Urba-tecture well-being at the level of the eastern entrance of the city of Jijel, through a set of indicators and criteria chosen after a thorough reading of the conditions of urban diversity and the vectors of well-being.
In order to carry out our work, we used different methods: direct observation, survey by questionnaire and interview, multi-criteria analysis and SWOT analysis. These methods allowed us to identify the potentialities that will allow us to improve the urban mix and to promote Urba-tecture well-being.
Key words :
Urban diversity, Functional diversity, Architectural diversity, Social diversity, Wellbeing, Urba-tecture, Urban well-being, Quality of life.
Abstract
:صخلم يف قايسلا يلاحلا رضحتلل يملاعلا عيرسلا تلاوحتلاو ةيكيتاماردلا ندملل ، حبصأ ريفوت ةيعون ةايح لضفأ ناكسلل ةيضق ةمساح لكشب ديازتم .نييسايسلل مت مادختسا عونتلا يرضحلا ةيبلتل تابلطتم ناكسلا ىلع تايوتسملا ةيفيظولا ةيرامعملاو .ةيعامتجلااو عمو كلذ ، نإف اذه جهنلا ديقملا عونتلل يرضحلا دق باجتسا لعفلاب تاجايتحلال ةيفيظولا طقف ، امم ىدأ ىلإ نيوكت تاحاسم ريغ ةقفاوتم عم تاجايتحلاا ةيلاحلا عمتجملل ، يلاتلابو لامهإ ةيمهأ قلخ تاحاسم رعشي اهيف نونطاوملا ةحارلاب اضرلاو نع .مهطيحم فدهي اذه ثحبلا ىلإ ميدقت ةرظن ةبقاث لوح ةيفيك قيقحت نزاوتلا" نيب ناسنلإا "هتئيبو نم للاخ عضو ةيهافرلا يف ةمدقم ميمصت ليكشتو تاحاسملا ةطلتخملا لا نكمي لصف ةيهافرلا ةيرضحلا ةيرامعملا ىلع هجو صوصخلا نع ةيضق عونتلا يرضحلا ؛ يهف مهاست يف اهذيفنت لثمتو مويلا بسنأ لئاسولا ميدقتل ةيعون ةايح لضفأ .ناكسلل فدهلا نم اذه لمعلا وه طيلست ءوضلا ىلع ةقلاعلا ةلخادتملا ةدوجوملا نيب عونتلا يرضحلا ةيهافرلاو ةيرضحلا ةيرامعملا ، نم للاخ اهمييقت دنع لخدملا يقرشلا ةنيدمل لجيج نع، قيرط ةعومجم نم تارشؤملا ريياعملاو ةراتخملا ةجتانلا نع ةءارقلا ةقمعتملا فورظل عونتلا .يرضحلا نم لجأ ذيفنت ،انلمع انمدختسا اقرط :ةفلتخم ةبقارملا ةرشابملا ، حسملاو نع قيرط نايبتسلاا ةلباقملاو ، ليلحتلاو ددعتم ريياعملا .يعابرلا ليلحتلاو تحمس انل هذه بيلاسلأا ديدحتب تاناكملإا يتلا نم اهنأش نيسحت عونتلا يرضحلا .ةيهافرلا زيزعتو تاملكلا :ةيحاتفملا عونتلا ،يرضحلا عونتلا ،يفيظولا عونتلا يرامعملا ، عونتلا يعامتجلاا ، ةيهافرلا ، رضحتلا ، ةيهافرلا ةيرضحلا ةيرامعملا ، ةدوج ةايحلا