

NOUS NE SOMMES PROTÉGÉS QUE SI NOUS SOMMES TOUS PROTÉGÉS
Novavax est déterminée à épauler les pharmaciens pour qu’ils puissent aider leurs clients
Chez Novavax, notre technologie vaccinale associe l’innovation à l’expérience pour répondre aux besoins des pharmaciens :

EN METTANT À PROFIT une plateforme bien connue et établie pour créer des vaccins
EN UTILISANT un adjuvant exclusif avec cette plateforme, dans le but de contribuer à améliorer la réponse immunitaire
EN METTANT AU POINT des vaccins faciles à transporter et à entreposer

Novavax reconnaît le rôle essentiel que jouent les pharmaciens pour aider à protéger les clients.
Apprenez-en plus sur la science associée à nos vaccins en utilisant le code QR à gauche, ou en consultant notre site à l’adresse https://ca.knowourvax.com/fr

Donnez-nous votre avis sur Québec Pharmacie






De TP À pharmacien ?
« Lao-Tseu l’a dit, il faut trouver la voie ! (…) Je vais d’abord vous couper la tête ! » Certains auront reconnu cette célèbre citation tirée de l’album Les aventures de Tintin - Le lotus bleu. Cette phrase est prononcée par un jeune homme (rendu fou par une drogue) qui veut convaincre le héros de suivre « la bonne voie », en commençant par le décapiter, ce qui ne l’enchante pas vraiment.
Où s’en va-t-il avec ça ? En fait, c’est à cela que j’ai pensé en lisant les réactions sur les réseaux sociaux – que je qualifierais de passionnées et émotives – à l’article intitulé « Techniciens en pharmacie : des étudiants ont plusieurs questions sur leur futur métier » et plus précisément sur l’éventuelle possibilité de réfléchir à un parcours dit « passerelle » pour permettre aux étudiants du DEC d’intégrer le doctorat de premier cycle en pharmacie (Pharm. D.)1
D’aucuns crient à l’injustice, et même à la « dévalorisation » du diplôme de pharmacien, d’autres y voient une perte de bons bras droits qui voudront devenir pharmaciens…
Je vois les choses tellement différemment ! D’abord, un parcours passerelle n’est pas la carte « chance » du Monopoly. Le DEC en lui-même n’est déjà pas une promenade de santé. Probablement que certains ATP qui pensaient pouvoir faire la reconnaissance des acquis les mains dans les poches déchantent actuellement. Ensuite, j’imagine que le niveau de sélection sera élevé pour accéder à cette éventuelle passerelle et, finalement, les étudiants devront, tout comme vous tous, avoir le niveau de compétences et réussir leurs examens pour devenir pharmaciens.
Regardons cela sous un autre angle, combien d’entre nous sont allés faire autre chose : biologie, chimie, ou autre bac, maîtrise parfois doctorat, avant de soumettre (de nouveau) leur candidature en pharmacie ? Ne pensez-vous pas que rester dans le domaine pharmaceutique et acquérir des connaissances sur le médicament et son circuit aurait été plus valorisable que vos cours sur l’écologie marine ou vos capacités à lire une RMN (1H) ?
Mais, ma première pensée est allée à l’attraction que peut représenter un programme de TP. On veut attirer de bons éléments, on veut des gens passionnés, comme nous, qui trouvent leur voie dans le monde de la pharmacie. Parmi les 2000 personnes qui souhaitent entrer au Pharm. D. chaque année, il est certain que beaucoup des « non sélectionnés » ont le potentiel de devenir pharmaciens. Mais, si on coupe d’emblée non pas leur tête, mais l’éventualité d’un parcours « passerelle » et donc la possibilité d’une évolution vers la profession de pharmacien, seront-ils aussi attirés par le programme ? Il est clair que, pour beaucoup, la

Christophe Augé, pharmacien, M. Sc., Ph. D., FOPQ Rédacteur en chef adjoint
« D’aucuns crient à l’injustice, et même à la « dévalorisation » du diplôme de pharmacien, d’autres y voient une perte de bons bras droits qui voudront devenir pharmaciens…
réponse est non, et s’ils n’arrivent pas à entrer en pharmacie, ils se retrouveront dans d’autres milieux et seront totalement perdus pour nous.
Quand j’étais jeune, mes parents, comme probablement les vôtres, ou en tout cas une large majorité de parents, nous prodiguaient ce conseil judicieux que je répéterai à mes enfants : « Ne te ferme pas de portes. » Là, nous sommes de l’autre côté, alors utilisons ce conseil : laissons une porte ouverte. Même si elle est loin, même si elle est dure à pousser, une porte ouverte, c’est de l’espoir et de la motivation. On récoltera ainsi les meilleurs fruits possibles du diplôme de TP et si certains sont tellement bons qu’ils enchaîneront vers un Pharm. D. (on parlera probablement d’une poignée par année), cela en fera d’excellents pharmaciens à n’en pas douter (encore des gains pour la profession). En bref, si un jour cette passerelle se crée, je n’y vois que du positif, cela ne nous retirera rien, cela ne fera qu’enrichir nos milieux de travail des meilleurs éléments possible.
AVIS DE NOMINATION
L’équipe de Québec Pharmacie est heureuse d’annoncer la nomination d’Alice Collin à titre de rédactrice en chef adjointe de la publication.

Responsable de la chronique Les pages bleues depuis 2020, Alice Collin s’est aussi occupée de la chronique À votre service sans ordonnance de 2018 à 2022.
Depuis 2021, elle est spécialiste de contenu du programme de Reconnaissance de Acquis et des Compétences, techniques en pharmacie, du Collège Rosemont. Elle a une responsabilité similaire au Collège Gérald-Godin depuis 2022.
Elle est pharmacienne depuis 2003 après avoir complété ses études de premier cycle en pharmacie à l’Université Catholique de Louvain-la-Neuve, en Belgique. Elle détient également des diplômes de deuxième cycle en développement du médicament, en cosmétologie et en dermatologie.
À son arrivée au Québec en 2005, elle a travaillé pendant quelques années dans l’industrie avant d’exercer la pharmacie en milieu communautaire et en groupe de médecine de famille.
RESPONSABLE DE CETTE CHRONIQUE
Colchicine et amiodarone : une interaction à surveiller

Objectifs d’apprentissage
1. Connaître les grandes lignes directrices sur le traitement de la péricardite.
2. Comprendre la pharmacologie de la colchicine.
3. Gérer les interactions principales avec la colchicine.
Généralités sur la péricardite aiguë
La péricardite aiguë est une inflammation du péricarde et une des formes les plus fréquentes de maladies péricardiques. Elle peut être associée à un épanchement péricardique pouvant mener à une tamponnade entraînant des troubles du remplissage avec une atteinte hémodynamique. Sa forme aiguë peut être associée à certaines maladies systémiques, comme les maladies auto-immunes, ou être isolée1.
Dans les pays développés, les virus sont les principaux agents étiologiques (virus Coxsackie, adénovirus, virus Epstein-Barr, parvovirus B19, etc.) de la forme isolée. L’étiologie exacte est rarement trouvée. Certains médicaments (ex. : méthyldopa, minoxidil, cyclophosphamide, phénytoïne, hydralazine, doxorubicine, acide
RÉDACTION
Jihane Lazrac , Pharm. D., Pharmacie
François Lalande et Thomas Weil, Pharm. D., M. Sc. Pharmacologie appliquée, Pharmacie François Lalande
RÉVISION
Julien Quang Le Van B. Pharm., M. Sc., B.C.C.P., Institut de cardiologie de Montréal
Texte original : 22 novembre 2022
Texte final : 5 janvier 2023
Les auteurs et le réviseur ne déclarent aucun conflit d’intérêts liés à la rédaction de cet article.
5-aminosalicylique, pénicilline) peuvent aussi causer une péricardite, mais c’est rare. Dans la majorité des cas, elle est idiopathique ou virale2
Le diagnostic est posé lorsqu’il y a présence d’au moins deux des quatre signes cliniques suivants : douleur thoracique, frottement péricardique, certains changements à l’ECG associé (sous-décalage du segment PR ou élévation du segment ST dans toutes les dérivations de l’ECG) et présence d’un épanchement péricardique2. Pour approfondir ses connaissances sur la péricardite, on peut se référer aux lignes directrices européennes de 2015 ou à certains articles cités dans la bibliographie1-3
Traitement de la péricardite
CAS CLINIQUE
Monsieur P, 75 ans, sort de l’hôpital aujourd’hui. Sa conjointe nous apporte son ordonnance de sortie. Son mari ne prenait aucun médicament avant. Il a été hospitalisé durant 10 jours pour une péricardite aiguë accompagnée d’une fibrillation auriculaire. Selon sa conjointe, il aurait fait un petit infarctus, mais le diagnostic serait incertain. Le patient est fumeur. Son ordonnance comprend le traitement suivant :
n Colchicine 0,6 mg BID durant 3 mois
n Acide acétylsalicylique 650 mg QID durant 2 semaines, puis diminuer de 650 mg par jour toutes les 2 semaines
Les objectifs du traitement de la péricardite aiguë impliquent le soulagement de la douleur du patient afin qu’il maintienne sa qualité de vie, la réduction de l’inflammation, et la prévention des récurrences de la péricardite et de ses complications2 . Ainsi, mis à part le fait de régler la cause identifiable de la péricardite lorsque possible, le traitement principal repose sur la présence d’un AINS incluant l’aspirine, combiné à de la colchicine. Un traitement adéquat est nécessaire pour éviter le haut taux de récurrence estimé à environ 30 % dans les 18 premiers mois suivant le premier épisode de péricardite11.
n Pantoprazole 40 mg DIE
n Rosuvastatine 20 mg DIE
n Ézétimibe 10 mg DIE
n Apixaban 5 mg BID
n Bisoprolol 5 mg DIE
n Amiodarone 200 mg DIE
n Calcium — Vitamine D 500 mg/400 unités DIE
n Acétaminophène 500 mg 1 à 2 comprimés QID PRN
n Périndopril 4 mg DIE
n Furosémide 40 mg BID
n Mélatonine 3 mg DIE HS
n Nitro-Spray 0,4 mg par dose — 1 dose S/L PRN
Au Dossier santé Québec (DSQ), vous trouvez les résultats récents suivants : créatinine 145 µmol/l (DFG ajusté 40 ml/min — niveau de base), K+ = 4,1 mmol/l, CT = 8,6 mmol/l, C-LDL = 5,3 mmol/l, Hb = 140 g/l.
Avec les AINS/aspirine, on veut atteindre une résolution des symptômes en 72 heures et une rémission de la péricardite en 7 jours. Comme mesure non pharmacologique, il faut conseiller au patient de ne pas faire d’exercice jusqu’à la résolution des symptômes.
S’il y a une contre-indication relative ou absolue aux AINS autre que l’aspirine (par exemple, si une condition cardiaque telle qu’un antécédent récent d’infarctus du myocarde, une insuffisance cardiaque, une insuffisance rénale ou autre), l’AINS sera remplacé par l’aspirine1,2
L’utilisation de corticostéroïdes, comme la prednisone, n’est pas recommandée en traitement de première ligne des péricardites aiguës d’étiologie virale ou idiopathique puisqu’ils augmentent significativement le risque de récurrence. On devrait seulement les utiliser en ajout aux AINS/aspirine lorsqu’il y a des contre-indications aux agents de première ligne ou lorsqu’il y a une réponse incomplète aux AINS/aspirine et lorsque les causes infectieuses ont été éliminées.
Le tableau I reprend les différentes options de traitements ainsi que les dosages et les ajustements de la colchicine.
Selon l’évaluation du risque gastro-intestinal, l’ajout d’un inhibiteur de la pompe à protons (IPP) peut être considéré. La prise de calcium et de vitamine D peut également être indiquée en présence d’un traitement impliquant de la prednisone à long terme afin de réduire les risques d’ostéoporose.
Pharmacologie de la colchicine
La colchicine est un alcaloïde extrait d’une plante, le colchique, qui agit comme « poison du fuseau ». Son mécanisme d’action repose sur l’inhibition de la polymérisation des microtubules prévenant ainsi l’activation et la migration des neutrophiles. Elle freine aussi la prolifération des neutrophiles, mais également de toutes les cellules à division rapide (effet cytotoxique)5
La colchicine est utilisée en ajout aux AINS/aspirine afin d’accélérer la résolution des symptômes et pour diminuer le risque de récurrence de la péricardite.
En raison de l’effet de la colchicine sur la prolifération cellulaire, un surdosage peut conduire à une toxicité digestive (les premiers symptômes d’une intoxication sont les nausées, les vomissements, les diarrhées pouvant mener à une gastro-entérite hémorragique), une toxicité hématologique (neutropénie, anémie, aplasie) et une
I OPTIONS DE TRAITEMENTS DE LA PÉRICARDITE AIGUË ET AJUSTEMENTS2,4
CLASSE DE MÉDICAMENTS ET DURÉE SUGGÉRÉE
AINS étudiés pour la péricardite
x 3 à 4 semaines au total (1 à 2 semaines à pleine dose, puis sevrage)
Colchicine x 12 semaines
DOSES USUELLES
n AAS (2000 mg à 4000 mg/j)
ex. : 650 mg q6h
n Ibuprofène (1200 mg à 2400 mg/j)
ex. : 600 mg q6h
n Indométacine (75 mg à 150 mg/j) (Éviter si problème cardiaque ou rénal)
ex. : 25 mg q6h
ex. : 0,6 mg BID
AJUSTEMENTS
Corticostéroïdes x 12 semaines minimalement (suggérés si contre-indication aux AINS ou si récidive de la péricardite ou si péricardite secondaire à maladie auto-immune)
n Si <70 kg : 0,6 mg DIE
n Si >70 ans : réduire dose de 50 %
n Si intolérance colchicine : réduire dose de moitié
n Selon ClCr : 35-50 ml/min 0,6 mg DIE 10—34 m/min 0,6 mg Q2-3J <10 ml/min Éviter si possible
n Si présence de médicaments concomitants (voir interaction amiodarone)
Prednisone 0,2 mg à 0,5 mg/kg/jour Aucun
toxicité musculaire (rhabdomyolyse). La mort peut survenir par insuffisance respiratoire liée à une paralysie musculaire. Les doses toxiques sont assez faibles, des décès avec des doses de 7 mg ont été rapportés. Les cas de toxicité mortelle ont toutefois beaucoup diminué. En effet, il faut se rappeler qu’avant 2010, une seule étude randomisée contrôlée avec placebo avait exploré l’utilisation de la colchicine, contre les crises de gouttes. Dans cette étude de 1987, le régime posologique était de 2 comprimés de 0,5 mg, suivis de 1 comprimé toutes les 2 heures, jusqu’au soulagement de la douleur ou jusqu’à l’atteinte de toxicité marquée (telle que la diarrhée, les nausées ou les vomissements). On pensait, à l’époque, que l’atteinte de toxicité était associée à l’atteinte d’efficacité analgésique. C’est pourquoi on donnait de la colchicine jusqu’à l’atteinte de toxicité marquée.
Dans cette étude, les patients ont reçu une dose moyenne de 6,7 mg de colchicine. La colchicine a démontré une supériorité statistique comparativement au placébo >
n Fumeur (stade précontemplation)
n Plaintes : rien à signaler
n Sortie d’hôpital pour péricardite aiguë compliquée d’une FA
n Possible infarctus du myocarde, mais diagnostic incertain
Homme 75 ans, retraité
Poids : 72 kg
Taille : 170 cm
IMC : 24,9
Antécédents médicaux :
n Rien à signaler
Laboratoires pertinents :
n Créatinine : 145 µmol/l
n DFG ajusté 40 ml/min — niveau de base
n K+ = 4,1 mmol/l
n CT = 8,6 mmol/l, C-LDL = 5.3 mmol/l
n Hb = 140 g/l
Signes vitaux :
n TA : 132/90 mm Hg
n FC : 72 bpm
Liste des médicaments (cf. présentation du cas)
n Dose de colchicine non adaptée au DFG ajustée
n Interaction notable entre amiodarone et colchicine
dans la réduction de la douleur dans les 48 premières heures, mais 100 % des patients ayant reçu de la colchicine au moment de la réponse clinique ont eu la diarrhée6. Jusqu’en 2010, les hautes doses de colchicine telles que celles évaluées dans cette étude de 1987 étaient communément prescrites malgré le haut rapport de risquesbénéfices6
Certaines interactions médicamenteuses augmentent le risque de surdosage7. Notons qu’un patient qui prend de la colchicine régulièrement et qui a des symptômes de problèmes digestifs devrait voir sa dose ajustée à la baisse, quelle que soit la raison pour laquelle il la prend. Cela pour prévenir une apparition de toxicité4
La distribution de la colchicine est large et le médicament tend à s’accumuler en cas de toxicité (VD passant de 2-12 l/kg à 21 l/kg)5
1. Gérer l’interaction colchicine-amiodarone en adaptant la conduite chez une personne avec faible DFG ajusté : refus service colchicine après discussion avec le cardiologue.
2. Surveillance de l’efficacité du traitement et du risque de récurrence de péricardite à chaque étape du sevrage.
3. Discuter avec le patient des mesures non pharmacologiques afin de réduire les risques cardiovasculaires (amélioration du profil lipidique).
n Diète DASH.
n Cessation tabagique.
La colchicine est métabolisée par le CYP3A4 et est un substrat de la P-gp. La P-gp réduit l’absorption intestinale de la colchicine et le CYP3A4 contribue à l’effet de premier passage hépatique (BD = 25-50 %). Le risque de toxicité est accru en association avec des inhibiteurs de ces enzymes et des cas létaux ont été rapportés dans la littérature scientifique. Bien que la majorité de l’élimination soit hépatique, de 10 % à 20 % du médicament se retrouve sous forme inchangée dans les urines, d’où un risque d’accumulation en cas d’insuffisance rénale chronique (IRC). La colchicine est donc un médicament à marge thérapeutique étroite qui nécessite une vigilance accrue en présence d’interactions et d’IRC5,7
Notons que les ajustements fournis sont associés avec la ClCr. En pratique, il est possible de comparer le DFGe et la ClCr d’un patient et de choisir la mesure qui permet le traitement le plus sécuritaire étant donné la nature des médicaments à marge thérapeutique étroite8.
Interactions à surveiller Comme mentionné plus haut, les inhibiteurs du CYP3A4 peuvent
entraîner une augmentation de la toxicité de la colchicine (inhibiteurs de la protéase du VIH, clarithromycine, itraconazole, vérapamil, diltiazem, etc.). La monographie recommande d’éviter cette association chez les patients ayant une IRC ou une insuffisance hépatique, et de réduire la dose chez les autres patients. Des cas de toxicité neuromusculaire ont été rapportés avec ces associations. Des décès ont même été rapportés en association avec la clarithromycine5,7,9
OPINION PHARMACEUTIQUE
Bonjour Dr, Comme discuté, dans le cadre du cas de Monsieur P, il est contre-indiqué d’associer la colchicine à l’amiodarone chez les patients avec une insuffisance rénale (DFG 40 ml/min). Le patient sera donc traité en monothérapie avec de l’aspirine. Un suivi plus serré des symptômes de récidive de péricardite sera donc recommandé. En toute collaboration, La pharmacienne
De la même façon, l’association avec les inhibiteurs de la P-gp est à éviter (ex. : amiodarone, vérapamil, cyclosporine, digoxine) sachant que l’AUC peut augmenter de 100 % à 300 %. Encore une fois, les doses peuvent être réduites en l’absence d’IRC ou d’insuffisance hépatique, mais leur association est contre-indiquée dans le cas contraire10. Il est même recommandé de tenir compte des inhibiteurs utilisés dans les 14 jours précédents. Dans le cas du patient de notre cas clinique, la longue demi-vie de l’amiodarone entraîne cette interaction pendant plusieurs semaines même en cas d’arrêt. L’association colchicine-amiodarone est donc contre-indiquée chez le patient en raison de son DFG à 40 ml/min. Si le patient avait eu une fonction rénale normale, l’ajustement recommandé aurait généralement été compris entre 50 % et 75 % de réduction9 n
ACTES PHARMACEUTIQUES FACTURABLES
Actes facturables « prise en charge après une hospitalisation….PH » et « opinion pharmaceutique : empêcher interaction… WX »
Références
1. Imazio M, Gaita F, LeWinter M. Evaluation and Treatment of Pericarditis: A Systematic Review. JAMA. 2015;314(14):1498-1506.
2. Adler Y, Charron P, Imazio M, et coll. 2015 ESC Guidelines for the diagnosis and management of pericardial diseases: The Task Force for the Diagnosis and Management of Pericardial Diseases of the European Society of Cardiology (ESC)Endorsed by: The European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). Eur Heart J. 2015;36(42):2921-2964.
3. Chiabrando JG, Bonaventura A, Vecchié A, et coll. Management of Acute and Recurrent Pericarditis: JACC Stateof-the-Art Review. J Am Coll Cardiol. 2020;75(1):76-92.
4. Imazio M, Brucato A, Trinchero R, Spodick D, Adler Y. Individualized therapy for pericarditis. Expert Rev Cardiovasc Ther. 2009;7(8):965-975.
5. Finkelstein Y, Aks SE, Hutson JR, et coll. Colchicine poisoning: the dark side of an ancient drug. Clin Toxicol Phila Pa. 2010;48(5):407-414.
6. Ahern MJ, Reid C, Gordon TP, McCredie M, Brooks PM, Jones M. Does colchicine work? The results of the first controlled study in acute gout. Aust N Z J Med. 1987;17(3):301-304.
7. Colchicine — Monographie de l’APhC — CPS en ligne — Révision du 22 avril 2020. Accessed November 22, 2022. www-e-therapeutics-ca.acces.bibl.ulaval.ca/search?lang=fr#m131200n00091
8. Nyman HA, Dowling TC, Hudson JQ, Peter WLS, Joy MS, Nolin TD. Comparative evaluation of the CockcroftGault Equation and the Modification of Diet in Renal Disease (MDRD) study equation for drug dosing: an opinion of the Nephrology Practice and Research Network of the American College of Clinical Pharmacy. Pharmacotherapy. 2011;31(11):1130-1144.
9. Şen S, Karahan E, Büyükulaş C, Polat YO, Üresin AY. Colchicine for cardiovascular therapy: A drug interaction perspective and a safety meta-analysis. Anatol J Cardiol. 2021;25(11):753-761.
10. LexicompMD Drug Interactions—Colchicine/P-glycoprotein/ABCB1 Inhibitors. Accessed November 22, 2022. www.uptodate.com/drug-interactions/?source=responsive_home#di-document
11. Adler Y, Charron P, Imazio M, Badano L, Barón-Esquivias G, Bogaert J, Brucato A, et coll. 2015 ESC Guidelines for the diagnosis and management of pericardial diseases: The Task Force for the Diagnosis and Management of Pericardial Diseases of the European Society of Cardiology (ESC)Endorsed by: The European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). Eur Heart J. 2015 Nov 7;36(42):2921-2964. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7539677/pdf/ehv318.pdf
Les références en gras indiquent au lecteur les références principales de l’article, telles que choisies par les auteurs.
Répondez aux questions
QUESTIONS DE FORMATION CONTINUE (QUESTIONS 1 À 3)
Colchicine et amiodarone : une interaction à surveiller
1. Quel pourcentage de réduction des doses de colchicine suggère-t-on en présence de l’amiodarone chez un patient atteint de péricardite aiguë, mais sans insuffisance rénale ?
n 5-10 %
n 10—25 %
n 25—50 %
n 50-75 %
2. En cas d’insuffisance rénale ou d’antécédent cardiaque, tous les AINS à haute dose, incluant l’aspirine, sont contre-indiqués.

n Vrai
n Faux
3. Madame G, 75 ans, prend de la colchicine 0,6 mg DIE post-myocardite. Elle consulte son médecin qui lui diagnostique une bronchite. Il lui prescrit de la clarithromycine 500 mg BID x 7 jours.
n Si le DFG de la patiente est normal, l’association est possible pour quelques jours sans ajustement, en surveillant la toxicité digestive.
n En cas de DFG réduit (< 50 ml/min), la dose de colchicine devrait être réduite de 50 %.
n En cas de DFG réduit (< 50 ml/min), la clarithromycine devrait être évitée et le médecin contacté pour une solution de rechange.
n L’interaction clarithromycine-colchicine est assez théorique et il n’y a pas de rapport de cas de toxicité dans la littérature scientifique.
Ordre des pharmaciens du Québec
OPQ : 10941

JANVIER 2023 • Suivez cette formation à eCortex.ca
Objectifs d’apprentissage
Après avoir suivi cette formation continue, les participants devraient :
1. Connaître la prévalence de l’hypoglycémie chez les Canadiens atteints de diabète de type 1 et de type 2 et traités à l’insuline
2. Connaître la différence entre l’hypoglycémie légère, modérée et grave
3. Être à l’aise pour demander aux patients atteints de diabète s’ils présentent des épisodes d’hypoglycémie
4. Savoir quelle quantité de glucides est utilisée pour traiter l’hypoglycémie et connaître les deux options pour le glucagon
5. Être en mesure de proposer des options pour prévenir de futurs épisodes d’hypoglycémie
Instructions
1. Après avoir lu attentivement cette leçon, lisez les questions de test. Répondez en ligne à eCortex.ca.
2. Une note d’au moins 70 % est nécessaire pour réussir cette leçon (5 bonnes réponses sur 6).
3. Remplissez le formulaire de commentaires pour cette leçon sur eCortex.ca.
DÉCLARATION
Les auteurs et réviseurs experts de cette leçon de FC ont chacun déclaré n’avoir aucun conflit d’intérêts réel ou potentiel avec le commanditaire.
Dans le présent document, les mots de genre masculin appliqués aux personnes désignent les hommes et les femmes.
SUIVEZ CETTE FORMATION À :
Le rôle du pharmacien dans l’hypoglycémie chez les patients atteints de diabète et traités à l’insuline basale
Par Esmond Wong, RPh, CDE, APA
tels que la prise alimentaire et l’activité physique.
L’hypoglycémie induite par les médicaments est à la fois un obstacle au contrôle glycémique chez les personnes atteintes de diabète, ainsi qu’une opportunité pour les pharmaciens d’aider les patients et de réduire les coûts de santé. L’hypoglycémie telle que définie par les directives de pratique clinique de Diabète Canada est 1) le développement de symptômes autonomes ou neuroglycopéniques; 2) un faible taux de glucose plasmatique (< 4,0 mmol/L pour les personnes atteintes de diabète et traitées à l’insuline ou avec un sécrétagogue de l’insuline); et 3) des symptômes en réaction à l’administration de glucides.(1) Chez les personnes atteintes de diabète, l’hypoglycémie est un effet secondaire induit par les médicaments qui est également affecté par d’autres facteurs
L’étude mondiale sur l’outil d’évaluation de l’hypoglycémie (HAT) a fait participer 27 000 personnes atteintes de diabète et traitées à l’insuline dans le monde pour étudier les taux réels d’hypoglycémie.(2) La cohorte canadienne a réuni 498 Canadiens et a découvert que sur une période de prospection de quatre semaines, 95,2 % des personnes souffrant de diabète de type 1 et 64,2 % des personnes souffrant de diabète de type 2 (traitées à l’insuline) avaient souffert d’un épisode d’hypoglycémie. La cohorte canadienne de l’étude HAT a découvert que l’hypoglycémie était associée à un absentéisme plus élevé au travail, à une utilisation supérieure des soins de santé et à une crainte déclarée plus forte de l’hypoglycémie.
La physiopathologie de l’hypoglycémie

La source d’énergie principale du cerveau est le glucose. Seulement quatre grammes de glucose (moins d’une cuillère à thé) sont dissous dans le sang d’un être humain moyen de 70 kg. Les cellules β fonctionnelles sont capables de réagir à des fluctuations du glucose en sécrétant plus ou moins l’insuline et ce, en quelques secondes. Ceci maintient la glycémie dans une fourchette très serrée, qui est équilibrée de façon délicate
Leçon commanditée par un financement à visée éducative de Novo Nordisk Canada
par les cellules β fonctionnelles.(3)
La chute des niveaux de glycémie en dessous de 4,7 mmol/L entraînera l’élimination de la sécrétion d’insuline. En dessous de 3,8 mmol/L, le corps commencera à sécréter des hormones contre-régulatrices telles que le glucagon et l’adrénaline qui s’opposent à l’action de l’insuline pour augmenter le taux de sucre.(4) Le glucagon peut causer des nausées et des vomissements. L’adrénaline peut causer de l’anxiété, de la transpiration, des tremblements et des palpitations (pensez à la réaction de lutte ou de fuite). Ceux-ci sont classés comme symptômes autonomes. En dessous de 2,8 mmol/L, le cerveau commence à manquer de glucose et des symptômes neuroglycopéniques apparaissent, tels que la confusion, les difficultés de concentration et les difficultés à parler.(1)
On parle de pseudo-hypoglycémie lorsqu’une personne souffre de symptômes d’hypoglycémie mais que sa glycémie est au-dessus de 4 mmol/L. Ceci se produit chez les personnes qui ont un contrôle glycémique faible depuis longtemps, si bien que leur corps est acclimaté à des taux de glycémie élevés. Une fois que leur glycémie revient à un niveau normal, leur corps interprète parfois mal la glycémie normale comme de l’hypoglycémie.(5) Une perte de reconnaissance de l’hypoglycémie a lieu après des épisodes fréquents d’hypoglycémie et lorsque le corps perd les symptômes autonomes. Ceci fait que les premiers symptômes de l’hypoglycémie, deviennent la confusion ou la perte de connaissance.(1) Il s’agit d’une situation dangereuse car la personne peut ne pas réagir (ou être incapable de réagir) de façon appropriée à l’hypoglycémie. Certaines personnes sont plus enclines à l’hypoglycémie que d’autres. Les personnes âgées présentent un risque plus élevé, en particulier si elles souffrent d’un déficit cognitif grave. L’inconscience de l’hypoglycémie, la longue durée d’une thérapie à l’insuline, une insuffisance rénale, une faible littératie en matière de santé et l’insécurité alimentaire sont également des facteurs de risque d’hypoglycémie.(1) Pour les adultes qui sont inconscient de l’hypoglycémie, il est suggéré qu’ils soient formés à la façon d’éviter d’autres épisodes d’hypoglycémie, qu’ils aient des objectifs glycémiques moins exigeants pendant trois mois si besoin, qu’ils augmentent la fréquence du contrôle ou utilisent un appareil de contrôle de la glycémie en continu.(1)
TABLEAU 1 Types d’hypoglycémie
Les directives de pratique clinique de Diabète Canada classent l’hypoglycémie en différentes catégories selon la gravité des symptômes :(1)
Hypoglycémie légère En présence de symptômes autonomes et si la personne peut encore s’administrer elle-même le traitement
Hypoglycémie modérée En présence de symptômes autonomes et neuroglycopéniques, si la personne peut encore s'administrer elle-même le traitement
Hypoglycémie grave Si la personne a besoin de l’aide d’une autre personne. La personne peut être inconsciente et la glycémie est généralement en dessous de 2,8 mmol/L. Hypoglycémie nocturne Hypoglycémie qui se produit lorsque la personne dort, avec des symptômes incluant des cauchemars, des rêves étranges et des réveils au milieu de la nuit.
Adaptation à partir des directives 2018 de Diabète Canada(1)
Les insulines basales de prochaine (seconde) génération et leur rôle dans la prévention de l’hypoglycémie
L’insuline est une protéine active dans sa forme monomère. Un monomère d’insuline peut être rapidement absorbé par une cellule pour faciliter l’absorption de glucose du sang dans la cellule. Les monomères sont rapidement dégradés en quelques minutes par des enzymes du sang en acides aminés qui n’interagissent pas avec le récepteur d’insuline. Cependant, un monomère d’insuline peut se combiner avec cinq autres monomères d’insuline pour former un hexamère. Les hexamères résistent à la dégradation par les enzymes et ne sont pas facilement absorbés par les cellules. Une insuline basale idéale formera des hexamères stables qui se dissocient en monomères à un rythme régulier avec peu de variation et sans pic d’activité sur une période d’au moins 24 heures.(6,7)
Les insulines basales de seconde génération qui comprennent l’insuline dégludec et l’insuline glargine U300 utilisent de nouveaux mécanismes pour créer une durée d’action plus longue qui entraîne une plus faible incidence d’hypoglycémie que les analogues d’insuline basale de première génération tels que l’insuline glargine U100 et l’insuline détémir. L’insuline dégludec utilise un nouveau mécanisme de résorption distale avec du phénol, du zinc et une structure analogue d’insuline qui forme des chaînes d’hexamères. Ces chaînes d’hexamères sont stables et se dissocient en monomères à un rythme régulier, entraînant moins de variation d’un jour à l’autre et un profil d’action plus plat. Le dégludec a une durée d’action de 42 heures.(5,6) L’insuline glargine U300 utilise un mécanisme d’action différent de l’insuline dégludec. En concentrant le glargine, des conglomérats compacts d’insuline se forment. L’absorption est
ralentie car la surface des conglomérats sur lesquels l’absorption peut avoir lieu est réduite et la distance entre la surface du conglomérat et les capillaires.(8)
Les études ont démontré la valeur des insulines basales de seconde génération par rapport à celles de première génération. Une étude a comparé le glargine U300 au glargine U100 chez les personnes atteintes de diabète de type 2 à l’aide de médicaments antihyperglycémiques oraux sur une période de 12 mois. Les chercheurs ont découvert que les personnes traitées au glargine U300 avaient une réduction des risques relative de 37 % de souffrir d’hypoglycémie nocturne ou d’hypoglycémie grave par rapport au glargine U100.(9)
L’essai DEVOTE a comparé l’insuline dégludec à l’insuline glargine U100 avec un résultat principal mesurantles événements cardiovasculairse majeurs (décès dû à des causes cardiovasculaires, infarctus du myocarde non mortel ou AVC non mortel) et un résultat secondaire mesurant les hypoglycémies graves. L’étude a découvert que l’insuline dégludec et l’insuline glargine U100 avaient des taux similaires d’événements cardiovasculaires majeurs. Toutefois, le taux d’hypoglycémie grave était bien inférieur dans le groupe de l’insuline dégludec. Le taux d’hypoglycémie grave était de 3,70 événements par années-patients dans le groupe d’insuline dégludec et 6,2 événements pour 100 années-patients dans le groupe d’insuline glargine U100. Ceci malgré la réduction d’HbA1c similaire dans les deux groupes.(10)
L’étude BRIGHT était un essai comparatif entre l’insuline dégludec et l’insuline glargine U300 chez 929 patients souffrant de diabète de type 2 naïfs d’insuline. Le critère d’évaluation principal était un changement d’HbA1c avec des taux d’hypoglycémie comme critère d’évaluation de sécurité. Les
participants étaient randomisés 1 à 1 pour recevoir de l’insuline dégludec ou de l’insuline glargine U300 que le patient s’administrait lui-même. Le critère d’évaluation principal a montré des réductions comparables d’HbA1c. La moyenne d’HbA1c du groupe attribué à l’insuline dégludec était de 8,7 %, passant à 7 % à la fin de l’étude. La moyenne d’HbA1c du groupe attribué à l’insuline glargine U300 était de 8,6 %, passant à 7 % à la fin de l’étude. Les chercheurs ont conclu que la réduction d’HbA1c était comparable pour les deux insulines. L’incidence de l’hypoglycémie confirmée (à toute heure de la journée (24 h)) était comparable pour les deux insulines, 66,5 % pour l’insuline glargine U300 et 69 % pour l’insuline dégludec. L’incidence de l’hypoglycémie nocturne était également comparable pour les deux insulines, 28,6 % pour l’insuline glargine U300 et 28,8 pour l’insuline dégludec.(11)
Le rôle du pharmacien dans le dépistage de l’hypoglycémie
Il existe plusieurs interventions que les pharmaciens peuvent effectuer pour réduire le fardeau de l’hypoglycémie pour les patients. Le plus important consiste à demander aux patients atteints de diabète s’ils souffrent de symptômes d’hypoglycémie, en particulier s’ils utilisent des sulfonylurées (SU) et/ou de l’insuline. La question peut être simple, par exemple : « Bonjour M. Smith, je remarque que vous êtes sous insuline A et/ou comprimé B (sulfonylurée), ces médicaments peuvent causer des glycémies trop basses qui peuvent entraîner des étourdissements, des faiblesses, des tremblements ou de la transpiration. Avez-vous expérimenter de l’un de ces symptômes? » Une alternative pourrait être : « Bonjour M. Smith, je remarque que vous êtes sous insuline X et/ou comprimé Z (sulfonylurée), ces médicaments peuvent causer des glycémies trop basses. Avez-vous remarqué si l’une de vos valeurs de glycémie était inférieure à 4 mmol/L récemment? »
Il n’y a aucun moyen officiel de dépister l’hypoglycémie mentionné dans les directives de pratique clinique de Diabète Canada, les pharmaciens sont donc encouragés à personnaliser leur approche et être cohérents sur le fait d’interroger les patients sous insuline et/ou SU. La cohorte canadienne de l’étude HAT a découvert que la majorité des patients sous insuline souffraient d’hypoglycémie sur une période de
quatre semaines, donc la majorité de vos patients sous insuline et/ou SU souffrent probablement d’hypoglycémie.(2)
Nouvelles technologies
La nouvelle technologie de contrôle de la glycémie peut aider les patients et les pharmaciens à détecter l’hypoglycémie. En 2021, il y a eu une mise à jour de la section Contrôle de la glycémie des directives de pratique clinique de Diabète Canada avec de nouvelles définitions. Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour en savoir plus.
Il existe aujourd’hui des moyens pour les pharmaciens de suivre à distance les taux de glycémie de leurs patients pour fournir des rétroactions en temps voulu sur les excursions glycémiques. Les pharmaciens peuvent créer un compte professionnel de santé sur des sites Web tels que LibreView (https:// www.libreview.com/), Dexcom Clarity (https://clarity.dexcom.com/professional/) ou Guardian CareLink (https:// carelink.medtronic.com/login). Une fois le compte configuré, les patients qui utilisent une application sur un téléphone intelligent peuvent charger leurs données et les transmettre au professionnel de santé en temps réel. Le pharmacien peut alors examiner les données du patient en ligne. Il peut chercher les jours où le patient a eu des excursions glycémiques et examiner ce qu’il s’est passé ce jour-là avec le patient pour déterminer les raisons des excursions.
Les pharmaciens peuvent encourager les patients à enregistrer leur activité physique, leur alimentation, leurs maladies, l’insuline/les médicaments manqués ou les événements imprévus dans l’application pour qu’ils puissent voir l’impact de ces événements sur leur glycémie. Il est important pour les patients de comprendre 1) les raisons pour lesquelles ces événements font augmenter ou diminuer leur glycémie et 2) que la glycémie fluctuera parfois normalement d’elle-même. En faisant comprendre aux patients les causes des fluctuations, les pharmaciens peuvent leur permettre de prendre le contrôle de leur glycémie au lieu d’être un spectateur
impuissant. Le site Web professionnel permettra également le tri des patients pour déterminer ceux qui souffrent d’hypoglycémie.
Une étude a randomisé des adultes souffrant de diabète de type 2 mal contrôlé et traités à l’insuline basale, à une surveillance continue du glucose en temps réel ou à une surveillance de la glycémie capillaire. Ils ont découvert que le bras de surveillance continue du glucose en temps réel avait des niveaux d’HbA1c bien inférieurs à huit mois. Moins de temps était également passé à des niveaux de glycémie inférieurs à 3,9 mmol/L.(13)
Le rôle du pharmacien dans le traitement de l’hypoglycémie
Une fois que vous avez identifié que le patient souffrait d’hypoglycémie, il est important de parler des raisons et du traitement de l’hypoglycémie. Parlez simplement. Par exemple, vous pouvez commencer par expliquer que le cerveau a besoin de glucose comme un ordinateur a besoin d’électricité. Tout comme un ordinateur fonctionne de façon sous-optimale lorsqu’il n’est pas suffisamment alimenté en électricité, votre cerveau peut souffrir de confusion, de difficultés d’expression ou de concentration lorsqu’il ne reçoit pas suffisamment de glucose du sang. Pour traiter l’hypoglycémie, les directives de pratique clinique de Diabète Canada suggèrent qu’il faut 15 g de glucose (ou un glucide similaire à action rapide). Ceci produit une augmentation de la glycémie d’environ 2,1 mmol/L en 20 minutes, offrant un soulagement adéquat des symptômes chez la plupart des personnes. Certains exemples de glucides à action rapide comprennent une cuillère à soupe (15 g) de sucre, une cuillère à soupe de miel, 4 comprimés de glucose Dex-4, 6 bonbons Lifesaver ou 150 ml de jus ou de soda.(1) N’oubliez pas que les glucides doivent être facilement digérés pour être « à action rapide ». Les aliments comme le gâteau au chocolat, la crème glacée et les fruits peuvent avoir un goût sucré mais contenir des quantités importantes de graisse ou de fibres qui ralentissent la digestion des glucides.(14) Lors d’un
TABLEAU 2 Nouveaux termes pour la surveillance du glucose
événement hypoglycémique, le traitement rapide est une priorité. Pour les patients souffrant d’hypoglycémie grave qui perdent connaissance, le glucagon est le traitement privilégié.(1)
Il existe aujourd’hui deux modes d’administration différents du glucagon disponibles au Canada. Le glucagon à injecter nécessite une reconstitution en mélangeant le glucagon en poudre avec un diluant avant l’injection sous-cutanée. (15) Le glucagon nasal peut être administré par voie intranasale sans mélange requis.(16) Une étude a montré que les participants prenant du glucagon par voie sous-cutanée par rapport à la voie nasale ont trouvé que le glucagon nasal était plus facile à utiliser, plus facile à préparer, inspirait davantage confiance et globalement, était plus satisfaisant que le glucagon par voie sous-cutanée.(17)
Certaines astuces pratiques comprennent le conseil aux patients sur la date d’expiration du glucagon, veiller à ce qu’ils aient des renouvellement disponibles à leur dossier et qu’ils entreposent le glucagon correctement.
Le rôle du pharmacien dans la prévention de l’hypoglycémie
Pour gérer et prévenir l’hypoglycémie, il est utile de voir s’il existe des facteurs explicatifs répétitifs. Si l’événement hypoglycémique était un événement unique qui s’est produit après qu’un patient a manqué un repas ou après un exercice imprévu, renforcez l’importance des repas réguliers et suggérez d’avoir des comprimés de glucose (l’erreur courante des patients consiste à prendre un seul comprimé de Dex-4 pour le traitement, ce qui représente environ 4 grammes de glucides; rappelez-leur qu’on parle de Dex 4 car 4 comprimés font une dose de 15 grammes de glucides à action rapide). Ils peuvent également avoir du glucagon sur eux ou un substitut de repas spécifique pour le
Le rôle du pharmacien dans l’hypoglycémie chez les patients atteints de diabète et traités à l’insuline basale
diabète, par exemple Glucerna ou Boost Diabetic. Pour en savoir plus et voir de superbes illustrations, vous pouvez leur conseiller de consulter le manuel du patient de Diabète Canada qui se trouve à : https://guidelines.diabetes. ca/docs/patient-resources/hypoglycemia-low-blood-sugar-in-adults.pdf
En cas de présence de facteurs explicatifs de glycémies basses, l’annexe 5 des directives de pratique clinique 2018 de Diabète Canada offre un excellent aperçu des insulines à ajuster selon le schéma de valeurs glycémiques basses. Certaines sulfonylurées et insulines ont une incidence d’hypoglycémie inférieure à d’autres. Le glyburide présente un risque modéré d’hypoglycémie, alors que le gliclazide présente un risque minime/modéré d’hypoglycémie. Selon les directives, le gliclazide est préféré au glyburide en raison du risque moindre d’hypoglycémie, d’événements cardiovasculaires et de mortalité. Si vous avez des droits de prescription dans votre province, il s’agit d’un changement qui se justifie et s’explique facilement aux patients. Si vous devez envoyer un télécopie à au prescripteur pour apporter la modification, il est alors judicieux d’inclure la suggestion des directives pour montrer votre justification. Tel qu’indiqué auparavant, les analogues d’insuline basale plus récents (insuline dégludec et insuline glargine U300) ont une incidence d’hypoglycémie plus faible que les analogues d’insuline de première génération.(18)
Par le passé, il était plus fastidieux de détecter une hypoglycémie nocturne. Demander aux patients de mettre une alarme pour se réveiller sur plusieurs nuits pour se piquer le doigt était parfois difficile. Les patients étaient réticents ou oubliaient de faire l’essai au milieu de la nuit pour détecter l’hypoglycémie nocturne. La surveillance continue du glucose par balayage intermittent et en
temps réel offre une excellente alternative à la surveillance de la glycémie capillaire la nuit. Alors que ces capteurs peuvent être onéreux, vous pouvez communiquer avec le représentant de la compagnie pour qu’il vous fournisse un échantillon ou suggérer de communiquer avec son assureur pour vérifier la couverture. Les capteurs détecteront et enregistreront toutes les instances d’hypoglycémie nocturne au courant de la nuit. Certains capteurs permettent au patient de programmer des alarmes si sa glycémie chute en dessous d’un certain niveau. Si votre patient souffre d’hypoglycémie nocturne, vous pouvez réduire son insuline basale, passer à un analogue d’insuline basale de nouvelle génération qui est associé à une fréquence inférieure d’hypoglycémie de nuit ou changer ses sulfonylurées.
Les pharmaciens jouent un rôle majeur dans le dépistage, la prévention et le traitement de l’hypoglycémie chez les patients atteints de diabète. Ce faisant, ils peuvent avoir un impact positif sur la vie de ces patients. Une étude réalisée à l’université d’Alberta a montré que l’intervention des pharmaciens chez des adultes mal contrôlés souffrant de diabète de type 2 dans les pharmacies communautaires de l’Alberta révélait une réduction importante d’HbA1c de 1,8 %.(19) Les pharmaciens sont encouragés à voir la gestion de l’hypoglycémie comme un moyen d’améliorer les résultats thérapeutiques pour les patients, de démontrer la valeur des pharmaciens et d’encourager leur propre développement professionnel.
Les références sont en ligne à eCortex.ca.
Trouvez et répondez aux questions de cette leçon de FC à eCortex.ca.
Recherche à l’aide du titre entier ou partiel de la formation
À PROPOS DE L’AUTEUR
Esmond Wong est pharmacien clinique et travaille dans le domaine du diabète. Il a un baccalauréat ès sciences en pharmacie de l’université d’Alberta (2006) et est devenu éducateur spécialisé en diabète certifié et a obtenu une autorisation de prescription additionnelle en 2011. Dans son cabinet, il prescrit/ ajuste/renouvelle les médicaments et l’insuline, réalise les dépistages, envoie ses patients faire des analyses en
laboratoire et aide à fixer des objectifs de mode de vie avec ses patients. Son site Web www.cdestudycourse.com a aidé plus de 1 500 professionnels de santé au Canada à devenir éducateurs spécialisés en diabète certifiés.
RÉVISION SCIENTIFIQUE
Toutes les leçons sont révisées par des pharmaciens afin d’en assurer l’exactitude et la validité, ainsi que la pertinence pour la pratique pharmaceutique.
Directrice des projets de FC : Rosalind Stefanac
Concepteur graphique :
Shawn Samson
Cette leçon est publiée par EnsembleIQ, 20, avenue Eglinton Ouest, bureau 1800, Toronto (Ontario) M4R 1K8.
Tél. : 1 877 687-7321
Téléc. : 1 888 889-9522
Information sur la FC : ecortex@professionsante.ca.
Ce document ne peut être reproduit, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite de l’éditeur.
COLLABORATEURS Le rôle du pharmacien dans l’hypoglycémie chez les patients atteints de diabète et traités à l’insuline basale
les pages bleues
RESPONSABLE DE CETTE CHRONIQUE
La fibrose pulmonaire idiopathique
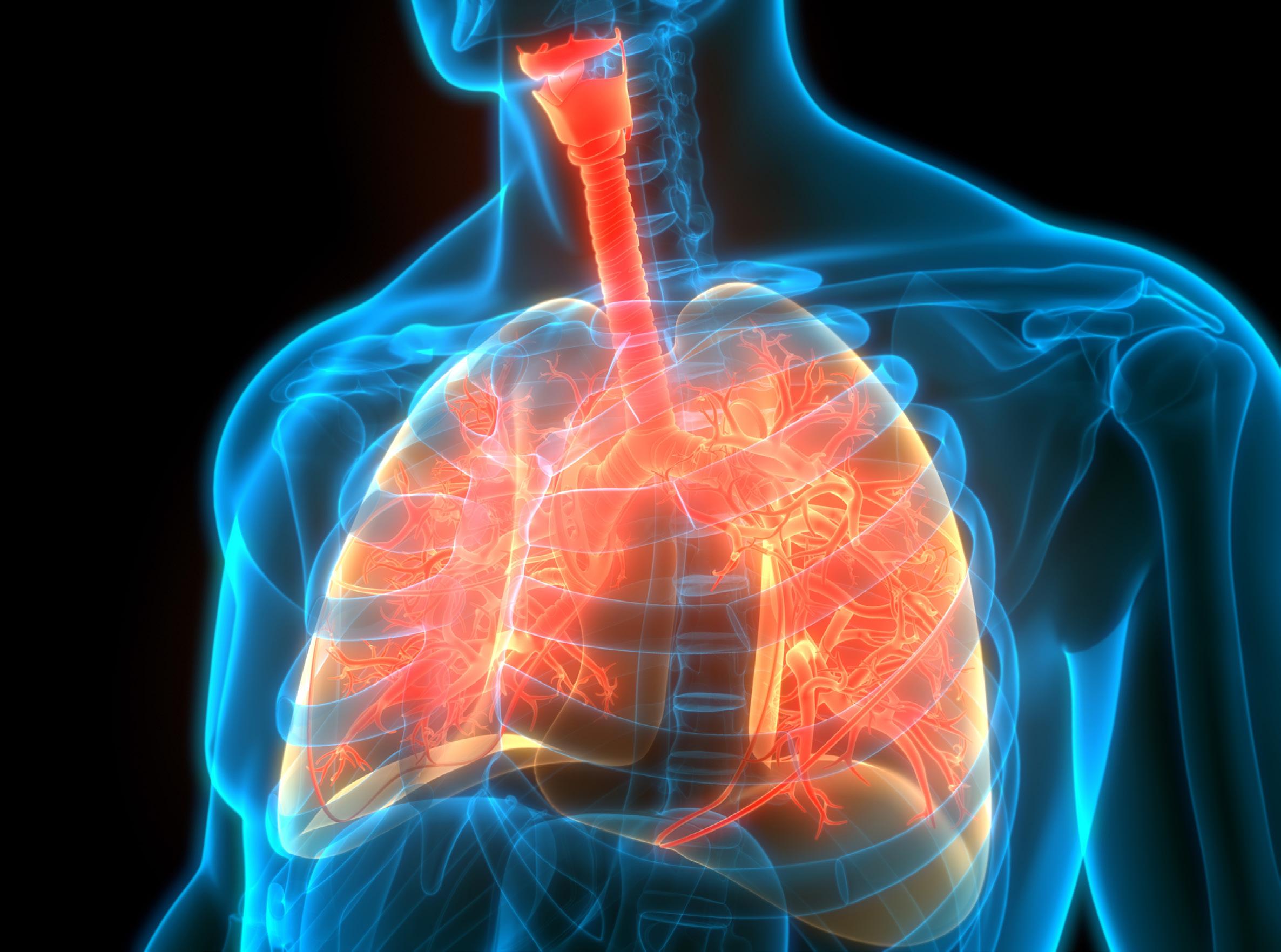
Objectifs d’apprentissage
1. Informer le pharmacien de la physiopathologie et de la présentation clinique de la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI).
2. Comprendre l’approche de traitement pharmacologique et non pharmacologique de la FPI.
3. Outiller le pharmacien sur les suivis recommandés des traitements antifibrotiques.
Résumé
La fibrose pulmonaire idiopathique est une maladie rare, mais dont la prévalence est considérable au Canada. La maladie est incurable et présente un mauvais pronostic en plus d’avoir un impact important sur la qualité de vie des personnes atteintes. Les traitements antifibrotiques disponibles présentent un profil d’effets indésirables complexe nécessitant un suivi rapproché. L’utilisation de ces traitements est appelée à augmenter alors que ces molécules sont également étudiées dans d’autres types de fibroses. Cet article vise à outiller le pharmacien pour comprendre la maladie et accompagner les patients prenant des médicaments antifibrotiques.
RÉDACTION
Antoine LeBrun, Pharm D., M. Sc., CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal
RÉVISION
Marianne Lévesque, M. D., FRCPC, Pneumologue, CIUSSS du Nord-de-l’Îlede-Montréal, Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal
Texte original : 24 septembre 2022
Texte final : 16 décembre 2022
L’auteur ne déclare aucun conflit d’intérêts lié à la rédaction de cet article. La réviseure a reçu des honoraires de conférence de GlaxoSmithKline et de Boehringer Ingelheim.
Introduction1
Les pneumopathies interstitielles sont un groupe hétérogène de maladies caractérisées par de l’inflammation ou de la fibrose du tissu interstitiel pulmonaire. La fibrose est la transformation du tissu pulmonaire sain en tissu cicatriciel. Le terme « fibrose pulmonaire » est couramment employé pour désigner une pneumopathie interstitielle lorsque la fibrose est l’élément prédominant d’une de ces maladies. Certaines pathologies ou expositions environnementales et certains médicaments sont des causes identifiables de pneumopathie interstitielle (voir tableau I ). Lorsqu’il n’y a aucune cause sous-jacente présente, la maladie est qualifiée de pneumopathie interstitielle idiopathique. Ces pneumopathies sont ensuite classifiées selon des caractéristiques radiologiques et histologiques. Parmi celles-ci, la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI) est la plus fréquente.
I LISTE NON EXHAUSTIVE DES PNEUMOPATHIES INTERSTITIELLES1
Pneumopathie interstitielle associée à des maladies auto-immunes
Pneumonie d’hypersensibilité
Pneumoconiose
Pneumopathie interstitielle médicamenteuse
Pneumopathie interstitielle associée aux maladies granulomateuses
Pneumopathie interstitielle idiopathique
n Polyarthrite rhumatoïde
n Sclérodermie
n Myopathie inflammatoire
n Exposition aux oiseaux
n Exposition aux moisissures
n Silicose
n Amiantose
n Anthracose (charbon)
Généralités
La FPI est une maladie rare, mais l’Amérique du Nord fait partie des régions où elle est le plus fréquemment rencontrée2 . La prévalence de la maladie au Canada est d’environ 40 personnes atteintes/100 0003. Le Québec est la province du Canada avec la plus haute prévalence3. La FPI affecte rarement des patients de moins de 50 ans et se déclare le plus souvent entre l’âge de 60 ans et 80 ans4. La maladie touche de façon prédominante les hommes, dans une proportion d’environ deux hommes pour une femme5
n Nitrofurantoïne
n Méthotrexate
n Chimiothérapie (ex. : bléomycine)
n Sarcoïdose
n Fibrose pulmonaire idiopathique
n Pneumopathie interstitielle non spécifique idiopathique
n Pneumonie organisée cryptogénique
La FPI est une condition médicale qui se développe de façon insidieuse et dont les symptômes progressent sur plusieurs années. Les principaux symptômes sont la dyspnée à l’effort, la toux sèche chronique et la fatigue6 De l’hippocratisme digital est parfois présent. Ces symptômes non spécifiques sont communs à plusieurs autres maladies cardiopulmonaires fréquentes. Les symptômes peuvent être légers en début de maladie et s’accentuer après quelques années. Pour ces raisons, il n’est pas rare que jusqu’à cinq années s’écoulent entre l’apparition initiale et le diagnostic7
Il arrive qu’une pneumopathie interstitielle soit suspectée cliniquement, mais elle doit être confirmée par des tests d’imagerie. Le type et la cause de la pneumopathie interstitielle sont ensuite recherchés. Pour qu’un diagnostic de FPI soit possible, les causes connues de pneumopathies interstitielles (ex. : maladies auto-immunes, expositions environnementales) doivent être exclues. La FPI montre un aspect radiologique de pneumopathie interstitielle commune (PIC) ou usual interstitial pneumonia (UIP) au scanneur thoracique. La PIC est entre autres caractérisée par la présence de lésions en rayon de miel et de bronchectasies de traction. Le diagnostic peut être posé sans investigation additionnelle si un patron radiologique de PIC ou PIC probable est présent8. Lorsque les résultats d’imagerie ne sont pas concluants, une biopsie pulmonaire est parfois réalisée. Dans ce cas, la combinaison de
l’apparence radiologique et de l’aspect histopathologique révélé par la biopsie est utilisée pour poser un diagnostic8
Par sa nature de maladie fibrosante irréversible touchant des patients déjà âgés, la FPI ne génère pas un bon pronostic. En l’absence de traitement, la survie médiane suivant le diagnostic est de deux à cinq ans9. L’évolution naturelle de la maladie est cependant variable entre les patients et n’est pas nécessairement prévisible. La figure II montre différentes trajectoires cliniques observées. Certains patients conservent une fonction pulmonaire relativement stable, alors que d’autres voient leur fonction pulmonaire régresser à des vitesses variables. Des périodes de dégradation respiratoire aiguë, appelées exacerbations, peuvent accélérer le déclin pulmonaire progressif. Environ 10 % des patients atteints de FPI subissent une exacerbation dans une année6. Ces exacerbations sont un marqueur de mauvais pronostic10
Le suivi de la maladie est réalisé à l’aide des symptômes du patient, du scanneur thoracique et des tests de fonction respiratoire11. Parmi ces tests, la mesure de la capacité vitale forcée (CVF), soit le volume d’air maximal pouvant être expiré à la suite d’une inspiration profonde, est un élément important du suivi. Cet indicateur permet de quantifier la perte de compliance pulmonaire causée par la fibrose12 . Un adulte de plus de 60 ans en santé subit un déclin annuel de sa CVF de 30 ml à 60 ml13. Le déclin annuel observé chez les patients atteints de FPI ne recevant pas de traitement peut aller de 200 ml à 400 ml14,15. Une variation de la CVF peut également être exprimée en pourcentage absolu de la valeur prédite. Une diminution annuelle est grande lorsqu’elle dépasse 5 % et est très élevée si elle dépasse 10 %. Le déclin annuel moyen mesuré chez les patients atteints de FPI ne recevant pas de traitement est de l’ordre de 5 % à 7 %14,15. Une autre mesure représentative de la gravité de la FPI est la capacité de diffusion du monoxyde de carbone (DLCO). Cet indicateur mesure la capacité de diffusion des gaz entre les alvéoles et l’hémoglobine à travers l’épithélium alvéolaire et l’endothélium des capillaires16. La fibrose pulmonaire réduit la capacité d’échange gazeux. La DLCO est corrélée à l’atteinte pulmonaire observée radiologiquement et est associée à la capacité d’exercice des patients pouvant être mesurée par des tests de marche12
Physiopathologie 6,17
II
La réparation tissulaire à la suite d’une lésion est un phénomène physiologique essentiel. Des fibroblastes migrent vers le site lésé, sécrètent de la matrice extracellulaire afin de combler l’espace vacant et laissent derrière eux une cicatrice18 Dans certaines circonstances pathologiques, ce processus normal persiste et s’amplifie de façon disproportionnée. La FPI est conceptualisée comme une dérégulation du processus de réparation des cellules épithéliales alvéolaires causant un remodelage tissulaire suffisamment important pour empêcher son fonctionnement6,17
La pathogenèse de la FPI implique l’interaction complexe entre des facteurs génétiques prédisposants, des expositions environnementales et une accélération des changements biologiques associés au vieillissement6
Plusieurs études ont identifié des mutations génétiques associées à la FPI, et jusqu’à 30 %des patients seraient porteur de ces mutations19. Les principaux variants génétiques responsables de FPI familiale affectent la fonction de maintenance des télomères (ex. : transcriptase inverse de la télomérase). Ces mutations causent une réduction de la longueur des télomères, notamment observable sur les cellules épithéliales alvéolaires de type 2 qui jouent un rôle dans le renouvellement de l’épithélium alvéolaire.
Un autre polymorphisme génétique fréquent est un variant du gène encodant la mucine 5B (MUC5B)19. La MUC5B est impliquée dans la clairance mucociliaire et la défense de l’hôte aux poumons. La présence de cette mutation altère ainsi des mécanismes de protection des alvéoles.
CAS CLINIQUE 1/2
Monsieur CR, 78 ans, se plaint d’essoufflements qui progressent depuis plusieurs mois. Ses symptômes étaient légers initialement, mais il remarque qu’il doit maintenant reprendre son souffle quand il marche jusqu’au dépanneur à côté de la maison. Il marchait cette distance sans problème l’an dernier. Depuis quelques semaines, il trouve qu’il tousse plus souvent sans avoir de sécrétions et il est plus fatigué. Il a pris un sirop contre la toux sans amélioration. Après lui avoir fait une radiographie pulmonaire, son médecin de famille le dirige vers un pneumologue. Il passe un scan des poumons qui montre des lésions en rayons de miel. Le pneumologue lui annonce un diagnostic de fibrose pulmonaire idiopathique et lui explique l’évolution de la maladie. Il lui propose de commencer un traitement dans les prochaines semaines parmi deux options possibles, en lui remettant un dépliant d’information. Monsieur CR se demande quel traitement choisir et s’inquiète au sujet de la quantité d’effets indésirables. Il passe chercher ses prescriptions habituelles à la pharmacie et vous demande votre avis. Il est connu pour de l’hypertension, de la fibrillation auriculaire - pour laquelle il prend de l’apixaban - et de l’arthrose aux genoux. Il n’a jamais fumé et prend deux verres de vin tous les jours.
Des expositions environnementales entraînant un dommage répété aux cellules épithéliales alvéolaires sont identifiées comme étant un facteur de risque de FPI. Le tabagisme est le facteur de risque le mieux documenté20. Le mécanisme de contribution de la fumée de cigarette au développement de la FPI demeure incertain. Une hypothèse est que le stress oxydatif induit par la fumée du tabac causerait une blessure de l’épithélium. L’exposition au bétail, à la poussière de bois, de métal ou de pierre est un autre facteur de risque17.
L’âge avancé est un facteur de risque important de FPI. Des changements cellulaires et moléculaires associés au vieillissement sont observés de façon exagérée ou prématurée chez les patients atteints de FPI. Ces changements sont entre autres observés dans les cellules épithéliales alvéolaires de type 2. Elles présentent des modifications associées au vieillissement comme l’instabilité génomique, la dégradation des télomères et la dysfonction mitochondriale21.
Le recrutement, l’activation et la prolifération de fibroblastes et de myofibroblastes sont des éléments physiopathologiques centraux de la FPI6,17. Lorsque les cellules épithéliales alvéolaires subissent un dommage tissulaire, elles sécrètent plusieurs cytokines et facteurs de croissance, incluant le facteur de croissance transformant (TGF ) bêta-1 et le facteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGF )17. Ces médiateurs favorisent la différenciation des fibroblastes pulmonaires en myofibroblastes. Ces cellules sont responsables de la production de matrice extracellulaire, un composé rigide entre autres constitué de collagène. Dans le processus normal de cicatrisation, les myofibroblastes sont détruits lorsque le dommage tissulaire est comblé. En présence d’une FPI, les myofibroblastes résistent au processus d’apoptose et persistent dans les alvéoles en sécrétant de façon prolongée la matrice extracellulaire. Son accumulation dans l’interstice pulmonaire entraîne une déformation de l’architecture alvéolaire. La composition de la matrice extracellulaire est altérée lors d’une FPI et présente une rigidité plus importante. Par un mécanisme non élucidé, cette matrice extracellulaire stimule à son tour l’activité des myofibroblastes. Une boucle de rétroaction positive entre les myofibroblastes et la matrice extracellulaire s’enclenche, accélérant le développement de fibrose17
Principes et objectifs de traitement8,11
La FPI est une maladie progressive, irréversible et incurable. Les objectifs de traitement peuvent varier selon le stade de la maladie. En phase initiale, l’objectif thérapeutique est de ralentir le déclin de la fonction pulmonaire et ainsi retarder l’insuffisance respiratoire terminale. La diminution du risque d’exacerbations aiguës est également souhaitée. Si la maladie devient plus symptomatique, l’amélioration de la qualité de vie et de la capacité fonctionnelle sera visée.
Lorsque la maladie progresse davantage, les soins palliatifs peuvent faire partie de l’approche thérapeutique. L’approche palliative n’est pas limitée à la phase terminale, mais peut être commencée plus tôt afin de soulager la dyspnée réfractaire et la toux. La transplantation pulmonaire peut être une avenue thérapeutique pour les patients plus jeunes et ne présentant pas de comorbidités importantes. La FPI a été la principale indication de greffe pulmonaire réalisée au Canada de 2006 à 201522
Approches non pharmacologiques
Cessation tabagique
Le tabagisme est un facteur de risque établi de FPI et pourrait augmenter de 60 % le risque de développer la maladie20. La cessation tabagique est un élément important dans la prise en charge des patients recevant un diagnostic de FPI. L’arrêt tabagique pourrait ralentir la progression de la maladie et est une condition essentielle pour recevoir de l’oxygénothérapie à domicile. Le pharmacien a un rôle à jouer pour accompagner le patient dans son arrêt tabagique.
Réadaptation pulmonaire
La réadaptation pulmonaire est un programme d’exercice physique structuré et encadré par une équipe multidisciplinaire (pneumologue, kinésiologue, inhalothérapeute). Les exercices réalisés visent à améliorer les fonctions musculaire, cardiovasculaire et respiratoire. Selon les conditions du programme, la réadaptation peut avoir lieu à domicile ou dans un centre dédié. Les études menées auprès de patients atteints de FPI montrent que ces programmes peuvent augmenter la tolérance à l’effort, diminuer la dyspnée et améliorer la qualité de vie23.
Oxygénothérapie
La progression de la maladie entraîne éventuellement une insuffisance respiratoire hypoxémique. Dans un premier temps, il est fréquent qu’une désaturation soit uniquement observée lors des efforts physiques. De l’oxygénothérapie de déambulation est alors administrée chez ces patients. Ce type d’oxygénothérapie peut être requis pour permettre la participation à un programme de réadaptation pulmonaire. Par la suite, une supplémentation en oxygène à long terme est indiquée chez les patients dont le gaz artériel au repos montre une pression partielle d’oxygène (PaO2) inférieure ou égale à 55 mm de Hg, ou une PaO2 inférieure à 60 mm de Hg chez les patients présentant de l’hypertension pulmonaire ou une insuffisance cardiaque droite.24
Vaccination
Aucune étude spécifique n’a été menée sur la vaccination des patients atteints de FPI. Les recommandations du Programme d’immunisation du Québec (PIQ) pour les patients atteints de maladies chroniques s’appliquent toutefois à cette population. Le vaccin polysaccharidique contre le pneumocoque (Pneumovax-23MD) et la vaccination annuelle contre l’influenza sont donc requis25. Le vaccin conjugué contre le pneumocoque (Prevnar-13MD ou Prevnar-20MD) n’est pas indiqué, selon le PIQ, sauf si ces patients sont immunosupprimés25. Le pronostic des patients présentant une FPI est moins bon en cas d’infection par le virus SARS-CoV-226
Le maintien d’une vaccination à jour contre la COVID-19 est donc primordial 25
Traitements
Les hypothèses physiopathologiques initiales sur la maladie laissaient penser que le point de départ du processus fibrotique était de nature inflammatoire. Par conséquent, l’immunodépression et la corticothérapie ont été l’approche historiquement utilisée pour traiter la FPI. L’étude randomisée contrôlée PANTHER 27, réalisée en 2012, a montré qu’une thérapie à base de prednisolone et d’azathioprine augmentait la mortalité, le risque d’exacerbations aiguës et d’effets indésirables. Les résultats de cette étude ont mené à l’arrêt du recours à l’immunodépression dans le traitement de la FPI. Les anticoagulants ainsi que les médicaments utilisés en hypertension pulmonaire (ex. : bosentan, sildénafil) ont été évalués en FPI et ne se sont pas révélés efficaces dans les études cliniques28.
SUIVI ET SURVEILLANCE DE LA THÉRAPIE 40,44
TRAITEMENT RÉGIME POSOLOGIQUE
Nintédanib Dose usuelle : 150 mg BID
Dose réduite si intolérance : 100 mg BID
Prise avec de la nourriture
Pirfénidone Dose usuelle :
1 capsule ou comprimé (267 mg) TID x 7 jours, puis
2 capsules ou comprimés (534 mg) TID x 7 jours, puis
3 capsules ou comprimés (801 mg) TID
1 comprimé de 801 mg est disponible lorsque la dose maximale est bien tolérée.
Après une interruption de traitement, reprendre à la dose de départ.
Prise avec de la nourriture
EFFETS INDÉSIRABLES SUIVI
n Diarrhées (très fréquent)
n Nausées, douleur abdominale
n Hépatotoxicité
n Hypertension
n Risque de saignement
n Diarrhées, nausées et dyspepsie
n Hépatotoxicité
n Étourdissements
n Éruptions cutanées
n Fréquence des diarrhées et prise adéquate du lopéramide si nécessaire
n Poids
n Bilan hépatique
n Tension artérielle
n Gravité des nausées et capacité de s’alimenter
n Apparition d’une réaction cutanée
n Bilan hépatique
Traitement antifibrotique
Une meilleure compréhension de la maladie a permis de cibler l’élément central de la physiopathologie de la FPI, c’est-à-dire l’accumulation anormale de fibrose causée par l’activation des fibroblastes. Les médicaments indiqués dans le traitement de la FPI, le nintédanib et la pirfénidone, se nomment antifibrotiques.
L’objectif thérapeutique des antifibrotiques est de ralentir le déclin de la fonction pulmonaire. La fonction pulmonaire perdue ne peut pas être retrouvée. Il n’est également pas attendu que la prise du traitement entraîne une diminution des symptômes de toux ou de dyspnée.
Les experts recommandent généralement que le traitement soit amorcé au moment du diagnostic de FPI. Lorsque le diagnostic est posé et que la fonction pulmonaire est
normale, les patients souhaitent parfois une période d’observation de la maladie avant l’initiation du traitement, par crainte des effets indésirables11. Les données indiquent cependant que le déclin de la fonction pulmonaire surviendra inévitablement et au même rythme chez ces patients29. Les patients avec une FPI grave, définie comme une capacité vitale forcée (CVF) de moins de 50 % ou une capacité de diffusion du monoxyde de carbone (DLCO) de moins de 30 %, n’étaient pas inclus dans les études cliniques14,15,30. Des études observationnelles donnent à penser qu’un ralentissement du déclin de la fonction pulmonaire serait quand même observé dans cette population. Le bénéfice d’un traitement à ce stade avancé de la maladie est incertain et est évalué au cas par cas31-33
Les lignes directrices internationales de 2022 ne font pas de recommandation sur l’utilisation préférentielle d’un antifibrotique par rapport à un autre. En effet, aucune étude d’envergure n’a établi de différence d’efficacité entre le nintédanib et la pirfénidone. Le choix entre les deux molécules repose donc sur les préférences du patient par rapport aux différents profils d’effets indésirables et aux régimes posologiques8. Les effets indésirables de chaque antifibrotique sont résumés dans l’encadré Suivi et surveillance de la thérapie
Le traitement antifibrotique est généralement poursuivi à long terme, tant qu’il est bien toléré, même si les études cliniques n’ont duré que 12 mois. Des données observationnelles indiquent que le bénéfice des traitements est maintenu sur des périodes de plusieurs années34,35. La Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) émet comme critère de remboursement du traitement que la CVF ne doit pas avoir diminué de plus de 10 % de la valeur prédite sur une période de 12 mois36 Les patients présentant une telle diminution de la CVF verraient peut-être tout de même un bénéfice à poursuivre le traitement pour limiter la vitesse du déclin, mais cela demeure incertain11
Nintédanib (OfevMD)
Le nintédanib est un inhibiteur de tyrosine kinase ciblant les récepteurs du facteur de croissance de l’endothélium vasculaire (VEGF), du facteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGF) et du facteur de croissance des fibroblastes (FGF)37 Initialement, le nintédanib a été développé comme traitement ciblé contre le cancer. Il a par la suite été reconnu que son mécanisme d’action visait des cytokines impliquées dans la physiopathologie de la FPI. L’inhibition des différents facteurs de croissance réduit la migration des fibroblastes, leur différenciation en myofibroblastes et la sécrétion de matrice extracellulaire qui en résulte37
Deux études randomisées contrôlées, INPULSIS-1 et INPULSIS-214, ont évalué le nintédanib en comparaison avec un placébo auprès de patients avec un diagnostic de FPI, sur une période de 52 semaines (voir le tableau III à la page 26). Les patients avec une CVF de moins de 50 % étaient exclus. Le déclin de la CVF a été réduit de 110 ml/an avec le traitement en comparaison avec le placébo. Dans l’analyse combinée des deux études, une diminution statistiquement significative de 30 % des exacerbations aiguës suspectées ou confirmées a été observée. Les résultats indiquent une tendance non significative de diminution de la mortalité (rapport de risque : 0,70 [0,43 - 1,12]). Les patients ayant participé aux études INPULSIS ont poursuivi la prise de nintédanib et ont été suivis sur une période allant de 16 à 68 mois34. L’efficacité du traitement sur le ralentissement du déclin de la fonction pulmonaire était maintenue.
L’effet indésirable le plus courant du nintédanib est la diarrhée. Dans les études de commercialisation, jusqu’à 60 % des patients avaient de la diarrhée. En raison de cette toxicité, 10 % des patients ont dû réduire leur dose, et 5 % des patients ont dû interrompre complètement le traitement14. La dose usuelle et la dose réduite en cas d’intolérance est détaillée dans l’encadré Suivi et surveillance de la thérapie . La diarrhée doit être traitée par la prise de lopéramide au besoin afin de permettre la poursuite du traitement. L’objectif est d’obtenir moins de quatre selles par jour et que les diarrhées n’aient pas de répercussion sur la vie quotidienne du patient38. Si cet objectif n’est pas atteint malgré la >
prise de lopéramide, une réduction de dose ou un arrêt temporaire du traitement est requis. La gestion des diarrhées est un élément important des conseils devant être remis au patient (voir Conseils aux patients et aux patientes ).
La nausée, les vomissements, la douleur abdominale et la perte d’appétit sont d’autres effets indésirables gastro-intestinaux possibles. Le poids doit être vérifié périodiquement afin de détecter une perte pondérale.
CONSEILS AUX PATIENTS ET PATIENTES 40,44
Généralités
n La FPI est une maladie qui progresse avec le temps. Les médicaments antifibrotiques ne guérissent pas la maladie, mais permettent de ralentir sa progression. Il est normal que vous ne vous sentiez pas mieux en prenant le traitement.
n La cessation tabagique est primordiale pour ralentir la progression de la maladie, éviter l’aggravation d’une maladie pulmonaire obstructive chronique concomitante et assurer l’efficacité des traitements.
n En raison de l’atteinte pulmonaire, il est important de maintenir une vaccination à jour contre les infections respiratoires, comme le pneumocoque, l’influenza et la COVID-19.
Traitements pharmacologiques
Pour la prise de nintédanib :
n Le médicament doit être pris deux fois par jour avec de la nourriture.
n Les diarrhées sont fréquentes avec le traitement. Des médicaments contre la diarrhée peuvent être nécessaires et il faut contacter votre professionnel de la santé si les diarrhées sont trop fréquentes.
n Il est possible que votre appétit soit diminué. Il faut surveiller si une perte de poids importante survient.
n Votre tension artérielle devrait être mesurée périodiquement pendant le traitement pour détecter une hypertension artérielle.
n Des prises de sang doivent être faites pour s’assurer que le traitement ne cause pas de toxicité au foie. Votre consommation d’alcool devrait être limitée aux recommandations d’Éduc’alcool.
Pour la prise de pirfénidone :
n Le médicament doit être pris trois fois par jour avec de la nourriture.
n Pour éviter des réactions cutanées, il faut limiter son exposition au soleil, particulièrement entre 10 h et 15 h, et appliquer de l’écran solaire si c’est le cas.
n Il est possible d’avoir de la nausée, des diarrhées et des étourdissements avec le traitement.
n Des prises de sang doivent être faites pour s’assurer que le traitement ne cause pas de toxicité au foie. Votre consommation d’alcool devrait être limitée aux recommandations d’Éduc’alcool.
Des cas d’hépatotoxicité, grave dans certains cas, ont été observés en postcommercialisation du nintédanib. Le bilan hépatique (ALT, AST et bilirubine) devrait être surveillé chaque mois durant trois mois, puis tous les trois mois ensuite39,40. Le risque d’hépatotoxicité est plus élevé au début du traitement.
Les inhibiteurs de tyrosine kinase ayant un effet sur le VEGF, comme le nintédanib, induisent une vasoconstriction artérielle, ce qui peut causer de l’hypertension41. La tension artérielle doit être mesurée périodiquement pendant le traitement. Les patients hypertendus devraient être plus attentifs à une variation de leur tension.
Le nintédanib peut augmenter le risque de saignement. Une faible augmentation des hémorragies a été observée dans les études cliniques et il s’agit d’un effet indésirable connu avec d’autres inhibiteurs du VEGF14. Pour cette raison, le nintédanib devrait être utilisé avec prudence chez les patients prenant des anticoagulants ou une double thérapie antiplaquettaire40. Une faible augmentation du risque de perforation gastro-intestinale (<1 %) a été observée dans les études cliniques. Le nintédanib ne possède pas de propriétés immunodépressives et n’est pas associé à un risque accru d’infections.
Le nintédanib est un substrat de la glycoprotéine P (P-GP) et est métabolisé de façon moindre par le cytochrome P450 3A4 (CYP3A4). Les inhibiteurs (ex. : posaconazole, érythromycine) et les inducteurs puissants (ex. : rifampicine, carbamazépine) de la P-GP et du CYP3A4 devraient faire l’objet d’un suivi étroit40
Pirfénidone (EsbrietMD)
Le facteur de croissance transformant (TGF) bêta-1 est libéré par les cellules alvéolaires épithéliales en réponse à un dommage. Cette cytokine stimule plusieurs processus impliqués dans la physiopathologie de la FPI, comme la prolifération des fibroblastes, la différenciation des myofibroblastes et la sécrétion de matrice
extracellulaire. La pirfénidone exerce son action antifibrotique en diminuant l’effet du TGF bêta-1. Le mécanisme moléculaire de cette inhibition demeure imprécis42
Plusieurs études cliniques ont évalué la pirfénidone sur la FPI. Le programme d’étude CAPACITY comportait deux études randomisées contrôlées évaluant l’efficacité de la pirfénidone comparée à un placébo, sur une période de 72 semaines30. L’étude CAPACITY-1 a montré un déclin de la CVF, exprimé en pourcentage de la valeur prédite, de 8,0 % avec la pirfénidone à dose de 2403 mg par jour comparée à 12,4 % pour le placébo (p = 0,001). La diminution du déclin de la CVF observée dans l’étude CAPACITY-1 ne s’est pas répétée dans l’étude CAPACITY-2. Le déclin de la CVF était de 9,0 % avec la pirfénidone et de 9,6 % avec le placébo (p = 0,501). En raison de ces résultats mitigés, les agences d’approbation réglementaire ont requis qu’une étude additionnelle soit réalisée.
C’est ainsi que l’essai randomisé contrôlé ASCEND15 a été réalisé. Cet essai a étudié la pirfénidone comparée à un placébo chez des patients atteints de FPI légère à modérée, sur une période de 52 semaines (voir tableau III ). Le déclin de la CVF a été réduit de 193 ml chez les patients recevant le traitement en comparaison avec ceux du groupe contrôle. Une tendance non statistiquement significative de diminution de la mortalité a été observée (rapport de risque : 0,55 [0,26 - 1,15]). Les résultats de l’étude ASCEND ont permis de confirmer l’efficacité de la pirfénidone. Les patients ayant reçu la pirfénidone dans les études cliniques et qui ont poursuivi le traitement à long terme ont été suivis sur une durée médiane de 2,4 ans35 Ces études de suivi indiquent que le ralentissement du déclin de la CVF se maintient dans le temps.
Les effets indésirables de la pirfénidone sont principalement gastro-intestinaux : nausées, vomissements, dyspepsie et diarrhées. Puisque ce sont des effets dosesdépendants, le schéma posologique prévoit une augmentation graduelle des doses en début de traitement. Les doses recommandées de pirfénidone sont détaillées dans l’encadré Suivi et surveillance de la thérapie . La prise au moment du repas ou d’une collation est requise pour améliorer la tolérance. Des inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) et des prokinétiques, comme le métoclopramide, peuvent être tentés pour limiter certains effets gastro-intestinaux43
La pirfénidone est un médicament photosensibilisant pouvant causer des éruptions cutanées. Les patients peuvent prévenir ces toxicités en limitant leur exposition au soleil et en appliquant un écran solaire avec un facteur de protection solaire de 5044 Pour des érythèmes plus importants, l’utilisation de corticostéroïdes topiques et une réduction de dose ou l’arrêt temporaire du traitement peuvent être requis45. Les recommandations sur la protection solaire doivent faire partie du conseil au patient (voir Conseils aux patients et aux patientes ).
Une perturbation asymptomatique du bilan hépatique peut survenir pendant le traitement et des cas d’hépatotoxicité grave ont été associés à la pirfénidone46
Le fabricant recommande un suivi mensuel du bilan hépatique durant 6 mois puis tous les 3 mois par la suite44. Des étourdissements et de la fatigue peuvent être associés au traitement de pirfénidone. La prise avec de la nourriture réduit les pics de concentrations atteints, ce qui diminue la fréquence des étourdissements44
La pirfénidone a un métabolisme hépatique principalement effectué par le cytochrome P450 (CYP) 1A2 et dans une moindre mesure par les CYP 2C9, 2C19 et 2D6. L’utilisation concomitante d’inhibiteurs puissants du CYP1A2 (ex. : fluvoxamine) est contre-indiquée. Une diminution de dose de pirfénidone est requise en cas de prise concomitante avec la ciprofloxacine, un inhibiteur modéré du CYP1A2. Il faut éviter l’administration simultanée d’un inhibiteur du CYP1A2 et d’inhibiteurs des voies métaboliques secondaires de la pirfénidone tels que l’oméprazole, l’amiodarone ou le bupropion44
Le tabagisme induit la synthèse d’enzymes hépatiques de façon marquée pour le CYP1A247. Chez un patient qui fume, la clairance de la pirfénidone sera augmentée, ce qui cause une diminution de l’exposition au traitement44. Il faut donc éviter de
fumer la cigarette. Les inducteurs pharmacologiques du CYP1A2 (ex. : phénytoïne) et du CYP2C9 (ex. : rifampicine, carbamazépine) doivent également être évités.
Traitement de l’hyperacidité gastrique
L’hyperacidité gastrique est fréquemment présente chez les patients atteints de FPI, accompagnée ou non de symptômes de reflux gastro-œsophagien (RGO)48
III RÉSUMÉ DES ÉTUDES PRINCIPALES EN FPI14,15
TOTAL DE 555 PATIENTS
Inclusion
n Diagnostic confirmé de FPI
n Âge : 40 à 80 ans
n CVF de 50 % à 70 %
n DLCO 30 % à 90 %
n Capacité > 150 m au test de marche de 6 minutes
Exclusion
n Tests spirométriques compatibles avec une MPOC ou un asthme concomitants
n Tabagisme actif
n DFGe moins que 30 ml/min
INPULSIS 1 ET 2 (2014) TOTAL DE 1066 PATIENTS
Inclusion
n Diagnostic confirmé de FPI dans les 5 dernières années
n Âge > 40 ans
n CVF > 50 %
n DLCO 30 % à 79 %
Exclusion
n Tests spirométriques compatibles avec une MPOC ou un asthme concomitants
n Anticoagulation ou double thérapie antiplaquettaire
Intervention
Pirfénidone 2403 mg par jour durant 52 semaines
Comparateur Placébo
Objectif primaire
n Variation de la CVF : -235 ml (pirfénidone) vs -428 m (placébo). Différence de 193 ml (p < 0,001)
Objectifs secondaires
n Exacerbations aiguës : non rapportées
n Mortalité toute cause : 4 % (pirfénidone) vs 7,2 % (placébo). HR 0,55 (0,26-1,15).
Effets indésirables
n Augmentation des éruptions cutanées, nausées, vomissements, dyspepsie, perte de poids, fatigue et étourdissements dans le groupe pirfénidone.
Intervention
Nintédanib 150 mg BID durant 52 semaines
Comparateur Placébo
Objectif primaire
Variation de la CVF
n INPULSIS-1 : -115 ml (nintédanib) vs -240 ml (placébo). Différence de 125 ml (p < 0,001)
n INPULSIS-2 : -114 ml (nintédanib) vs -207 ml (placébo). Différence de 94 ml (p < 0,001)
Objectifs secondaires*
n Exacerbations aiguës : 4,9 % (nintédanib) vs 7,6 % (placébo). HR : 0,64 (0,39-1,05).
n Mortalité toute cause : 5,5 % (nintédanib) vs 7,8 % (placébo). HR 0,70 (0,43-1,12).
Effets indésirables
n Augmentation des diarrhées, des nausées, des vomissements et de la perte de poids dans le groupe nintédanib.
Le développement d’une hernie hiatale, une condition médicale prédisposant au RGO, est également plus fréquent8. L’hyperacidité gastrique est un facteur de risque d’aspiration de petites quantités du contenu gastrique. Ces événements appelés microaspirations sont associés à un risque de pneumonite. L’hypothèse émise est que ce mécanisme pourrait contribuer à la dégradation de la fonction pulmonaire en FPI.
Une étude rétrospective a rapporté que les traitements antiacides étaient associés à une diminution de mortalité dans une population de patients atteints de FPI49. Basées sur ces données, des lignes directrices antérieures28 ont suggéré qu’un traitement pour augmenter le pH gastrique (ex. : IPP) pourrait être employé pour améliorer la fonction pulmonaire. Les IPP étaient donc régulièrement utilisés d’emblée chez les patients atteints de FPI, sans égard à la présence de symptômes de RGO. De nouvelles études remettent en cause cette pratique. Les lignes directrices internationales les plus récentes8 recommandent de ne pas donner de traitement antiacide pour améliorer la condition respiratoire en l’absence de symptômes de RGO.
Traitement de l’hypertension pulmonaire
L’hypertension pulmonaire est une comorbidité fréquemment rencontrée chez les patients atteints de FPI lorsque la maladie progresse. L’hypoxémie résultant de la fibrose du parenchyme pulmonaire entraîne une vasoconstriction des vaisseaux artériels pulmonaires. La pression de l’artère pulmonaire augmente alors, ce qui exerce une charge accrue sur le ventricule droit du cœur. À long terme, une insuffisance cardiaque droite, avec de l’œdème des membres inférieurs et de la dyspnée, peut se développer50. Une restriction hydrosodée est recommandée et un traitement de soutien avec des diurétiques (ex. : furosémide) est offert pour diminuer les symptômes de surcharge volémique. La présence d’hypertension pulmonaire est dépistée au moyen d’une échocardiographie transthoracique11. La prise en charge de cette comorbidité s’effectue dans des centres spécialisés dans le traitement de l’hypertension pulmonaire.
Traitement de l’exacerbation aiguë
Une exacerbation est définie comme une dégradation respiratoire aiguë présente depuis moins de 1 mois10
CAS CLINIQUE 2/2
Après discussion avec vous et avec son pneumologue, le patient décide de commencer le traitement avec la pirfénidone. Puisqu’il reçoit déjà un traitement anticoagulant avec de l’apixaban, le risque augmenté de saignement associé au nintédanib rend cette molécule moins attrayante. Le patient n’est pas dérangé par la prise de pirfénidone trois fois par jour. Il ne s’expose pas beaucoup au soleil et applique déjà régulièrement de l’écran solaire. Vous vérifiez son registre vaccinal qui est à jour. Vous recommandez au patient de ne prendre de l’alcool que quelques jours par semaine pour limiter le risque d’hépatotoxicité au cours du traitement. Vous prévoyez avec lui un suivi de sa tolérance gastro-intestinale et de ses étourdissements dans une semaine. Vous vous assurez que des bilans sanguins sont prévus pour suivre le bilan hépatique.
L’exacerbation peut être causée par une infection virale ou bactérienne, un médicament, l’inhalation de particules toxiques, une chirurgie thoracique ou ne pas avoir de cause apparente (idiopathique). Il n’est pas certain que l’exacerbation représente une accélération du processus de fibrose de la maladie ou un dommage aigu surajouté. Le symptôme principal est une majoration de la dyspnée qui peut être accompagnée d’une insuffisance respiratoire hypoxémique. Le scanneur thoracique montre un aspect de verre dépoli bilatéral et permet d’exclure d’autres diagnostics de détérioration respiratoire (ex. : pneumonie bactérienne, embolie pulmonaire, etc.). Le pronostic est généralement mauvais, avec un taux de mortalité atteignant jusqu’à 50 % à 3 mois51
Bien qu’aucune étude clinique n’ait évalué leur efficacité, les corticostéroïdes systémiques sont fréquemment utilisés dans le traitement des exacerbations aiguës. Leur utilisation repose sur l’hypothèse qu’un processus inflammatoire est présent dans ce contexte52 . De la prednisone à dose d’environ 1 mg/kg est utilisée, puis la dose est diminuée sur une période de quelques semaines11. Il convient de rappeler que les corticostéroïdes n’ont pas de rôle dans le traitement usuel de la FPI. Une prophylaxie d’infection opportuniste à Pneumocystis jirovecii avec du triméthoprime-sulfaméthoxazole devrait être administrée en raison des hautes doses de corticostéroïdes utilisées11. La prise de suppléments de calcium et de vitamine D est recommandée en prévention de l’ostéoporose induite par les
corticostéroïdes. Un bisphosphonate doit être considéré, selon les facteurs de risque de fracture, lorsque la durée de la corticothérapie dépasse 3 mois53
Certains experts recommandaient d’ajouter aux corticostéroïdes un traitement immunodépresseur, comme la cyclophosphamide. La cyclophosphamide est un agent alkylant utilisé dans le traitement de plusieurs maladies rhumatologiques et autres pneumopathies interstitielles auto-immunes. Une étude randomisée contrôlée54, réalisée en 2022, a évalué l’efficacité de cet agent en exacerbation aiguë de FPI. Une augmentation de la mortalité a été observée avec le traitement de cyclophosphamide. L’immunodépression n’est donc pas recommandée dans cette situation.
Indications des antifibrotiques dans d’autres pathologies
Puisque la FPI est une pneumopathie interstitielle fréquente, les études initiales avec des antifibrotiques ont principalement porté sur cette maladie. L’efficacité des antifibrotiques est également évaluée pour d’autres indications.
La sclérodermie est une maladie chronique entraînant une fibrose diffuse pouvant affecter une multitude d’organes. La pneumopathie interstitielle est une atteinte fréquente qui contribue beaucoup à la morbidité de la sclérodermie. L’étude randomisée contrôlée SENSCIS55 a évalué le nintédanib, comparé à un placébo, auprès de patients atteints de fibrose pulmonaire associée à la sclérodermie affectant au moins 10 % des poumons. Le traitement a réduit le déclin de la CVF de 44 % par rapport au placébo, ce qui correspond à une réduction absolue de 41 ml/an. L’efficacité relative du traitement est comparable à celle observée en FPI, mais se traduit par un bénéfice absolu moins marqué. Cette différence est expliquée par la progression généralement moins rapide de la fibrose associée à la sclérodermie.
Le nintédanib a également été étudié dans les pneumopathies interstitielles avec un phénotype de fibrose pulmonaire progressive (FPP). La FPP décrit une pneumopathie interstitielle, autre que la FPI, qui démontre une dégradation rapide des symptômes, de l’atteinte radiologique et/ou des tests de fonction respiratoire.
Une définition de la FFP est proposée dans les lignes directrices internationales de 2022 et repose sur la présence de deux des trois critères suivants, sur une période d’un an, sans cause apparente8 :
n Détérioration des symptômes respiratoires
n Détérioration physiologique, soit une diminution absolue de la CVF d’au moins 5 % ou une diminution absolue de la DLCO d’au moins 10 % sur une période d’un an
n Détérioration radiologique
Plusieurs causes de pneumopathies interstitielles peuvent résulter en une évolution clinique qui sera qualifiée de FPP. Les diagnostics les plus fréquents sont la pneumopathie d’hypersensibilité, les pneumopathies interstitielles associées à la polyarthrite rhumatoïde et à la sclérodermie, et la pneumopathie interstitielle non spécifique idiopathique.
L’étude randomisée contrôlée INBUILD56 a évalué le nintédanib comparé au placébo auprès de patients avec une FPP affectant au moins 10 % des poumons. Le traitement permet une diminution du déclin de la CVF de 107 ml/an. Le bénéfice montré dans cette population est comparable à celui observé dans les études de nintédanib chez des patients atteints de FPI.
Conclusion
En conclusion, la FPI est une maladie insidieuse et progressive, ayant un taux de mortalité élevé. Les traitements antifibrotiques disponibles permettent de ralentir la
progression de la maladie. Afin que ces traitements soient commencés, il faut que la maladie soit reconnue. Un diagnostic précoce est donc essentiel.
Le pharmacien peut jouer un rôle important dans l’accompagnement des patients qui prennent ces thérapies pouvant être mal tolérées. Le suivi des effets indésirables et l’administration des thérapies de soutien adéquates peuvent diminuer le nombre d’abandons du traitement.
La FPI est encore un domaine actif de recherche et d’autres médicaments sont à l’étude57. Ils représentent un espoir de freiner encore davantage la progression de cette maladie. n
Références
1. Travis WD, Costabel U, Hansell DM, King TE, Lynch DA, Nicholson AG, et al. An Official American Thoracic Society/European Respiratory Society Statement: Update of the International Multidisciplinary Classification of the Idiopathic Interstitial Pneumonias. Am J Respir Crit Care Med. 15 sept. 2013;188(6):733- 48.
2. Hutchinson J, Fogarty A, Hubbard R, McKeever T. Global incidence and mortality of idiopathic pulmonary fibrosis: a systematic review. Eur Respir J. sept. 2015;46(3):795-806.
3. Hopkins RB, Burke N, Fell C, Dion G, Kolb M. Epidemiology and survival of idiopathic pulmonary fibrosis from national data in Canada. Eur Respir J. juil. 2016;48(1):187-95.
4. Raghu G, Chen SY, Yeh WS, Maroni B, Li Q, Lee YC, et al. Idiopathic pulmonary fibrosis in US Medicare beneficiaries aged 65 years and older: incidence, prevalence, and survival, 2001–11. Lancet Respir Med. juil. 2014;2(7):566 -72.
5. Jo HE, Glaspole I, Grainge C, Goh N, Hopkins PMA, Moodley Y, et al. Baseline characteristics of idiopathic pulmonary fibrosis: analysis from the Australian Idiopathic Pulmonary Fibrosis Registry. Eur Respir J. fév. 2017;49(2):1601592.
6. Richeldi L, Collard HR, Jones MG. Idiopathic pulmonary fibrosis. The Lancet. mai 2017;389(10082):1941-52. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673617308668
7. Hewson T, McKeever TM, Gibson JE, Navaratnam V, Hubbard RB, Hutchinson JP. Timing of onset of symptoms in people with idiopathic pulmonary fibrosis. Thorax. juil. 2018;73(7):683-5.
8. Raghu G, Remy-Jardin M, Richeldi L, Thomson CC, Inoue Y, Johkoh T, et al. Idiopathic Pulmonary Fibrosis (an Update) and Progressive Pulmonary Fibrosis in Adults: An Official ATS/ERS/JRS/ALAT Clinical Practice Guideline. Am J Respir Crit Care Med. 1er mai 2022;205(9):e18 - 47. https://www.atsjournals.org/doi/10.1164/rccm.202202-0399ST
9. Nathan SD, Shlobin OA, Weir N, Ahmad S, Kaldjob JM, Battle E, et al. Long-term course and prognosis of idiopathic pulmonary fibrosis in the new millennium. Chest. juil. 2011;140(1):221-9.
10. Collard HR, Ryerson CJ, Corte TJ, Jenkins G, Kondoh Y, Lederer DJ, et al. Acute Exacerbation of Idiopathic Pulmonary Fibrosis. An International Working Group Report. Am J Respir Crit Care Med. 1er août 2016;194(3):265-75.
11. Cottin V, Bonniaud P, Cadranel J, Crestani B, Jouneau S, Marchand-Adam S, et al. Recommandations pratiques pour le diagnostic et la prise en charge de la fibrose pulmonaire idiopathique – Actualisation 2021. Version intégrale. Rev Mal Respir. sept. 2022;39(7):e35 -106. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0761842522000353
12. de Picciotto C, Bonay M. Les explorations fonctionnelles respiratoires dans le bilan et le suivi des pneumopathies interstitielles diffuses : quels examens pratiquer ? MISE AU POINT. :6. https://www.edimark.fr/Front/frontpost/getfiles/24308.pdf
13. Luoto J, Pihlsgård M, Wollmer P, Elmståhl S. Relative and absolute lung function change in a general population aged 60–102 years. Eur Respir J. mars 2019;53(3):1701812.
14. Richeldi L, du Bois RM, Raghu G, Azuma A, Brown KK, Costabel U, et al. Efficacy and Safety of Nintedanib in Idiopathic Pulmonary Fibrosis. N Engl J Med. 29 mai 2014;370(22):2071-82.
15. King TE, Bradford WZ, Castro-Bernardini S, Fagan EA, Glaspole I, Glassberg MK, et al. A Phase 3 Trial of Pirfenidone in Patients with Idiopathic Pulmonary Fibrosis. N Engl J Med. 29 mai 2014;370(22):2083-92.
16. Wood KL. Mesure des échanges gazeux. Merk Manual [Internet]. avr 2022; Disponible sur : https://www.merckmanuals.com/fr-ca/professional/troubles-pulmonaires/%C3%A9preuves-fonctionnellesrespiratoires-efr/mesure-des-%C3%A9changes-gazeux
17. Martinez FJ, Collard HR, Pardo A, Raghu G, Richeldi L, Selman M, et al. Idiopathic pulmonary fibrosis. Nat Rev Dis Primer. 21 déc. 2017;3(1):17074. https://www.nature.com/articles/nrdp201774
18. Crestani B. Mécanismes physipathologiques de la fibrose pulmonaire idiopathique [Internet]. Académie nationale de médecine; 2010. Disponible sur : https://www.academie-medecine.fr/mecanismes-physipathologiques-de-lafibrose-pulmonaire-idiopathique/
19. Fingerlin TE, Murphy E, Zhang W, Peljto AL, Brown KK, Steele MP, et al. Genome-wide association study identifies multiple susceptibility loci for pulmonary fibrosis. Nat Genet. juin 2013;45(6):613-20.
20. Oh CK, Murray LA, Molfino NA. Smoking and Idiopathic Pulmonary Fibrosis. Pulm Med. 2012;2012:1-13.
21. Selman M, Pardo A. Revealing the Pathogenic and Aging-related Mechanisms of the Enigmatic Idiopathic Pulmonary Fibrosis. An Integral Model. Am J Respir Crit Care Med. 15 mai 2014;189(10):1161-72.
Les références en gras indiquent au lecteur les références principales de l’article, telles que choisies par l’auteur.
22. Institut canadien d’information sur la santé. Traitement du stade terminal de l’insuffisance organique au Canada : Registre canadien des insuffisances et des transplantations d’organes, 2006 à 2015 — tableaux de données, transplantations pulmonaires [Internet]. 2017. Disponible sur : https://www.cihi.ca/sites/default/files/document/lung_transplant_section_v0.1_fr_2017.xlsx
23. Dowman L, Hill CJ, May A, Holland AE. Pulmonary rehabilitation for interstitial lung disease. Cochrane Airways Group, éditeur. Cochrane Database Syst Rev [Internet]. 1 févr 2021 [cité 11 sept 2022];2021(2). Disponible sur : http://doi.wiley.com/10.1002/14651858.CD006322.pub4
24. Jacobs SS, Krishnan JA, Lederer DJ, Ghazipura M, Hossain T, Tan AYM, et al. Home Oxygen Therapy for Adults with Chronic Lung Disease. An Official American Thoracic Society Clinical Practice Guideline. Am J Respir Crit Care Med. 15 nov. 2020;202(10):e121- 41.
25. MSSS. Programme d’immunisation du Québec (PIQ) [Internet]. 2009. Disponible sur : https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/protocole-d-immunisation-du-quebec-piq/#introduction
26. Esposito AJ, Menon AA, Ghosh AJ, Putman RK, Fredenburgh LE, El-Chemaly SY, et al. Increased Odds of Death for Patients with Interstitial Lung Disease and COVID-19: A Case-Control Study. Am J Respir Crit Care Med. 15 déc. 2020;202(12):1710 -3.
27. The Idiopathic Pulmonary Fibrosis Clinical Research Network. Prednisone, Azathioprine, and N -Acetylcysteine for Pulmonary Fibrosis. N Engl J Med. 24 mai 2012;366(21):1968-77.
28. Raghu G, Rochwerg B, Zhang Y, Garcia CAC, Azuma A, Behr J, et al. An Official ATS/ERS/JRS/ALAT Clinical Practice Guideline: Treatment of Idiopathic Pulmonary Fibrosis. An Update of the 2011 Clinical Practice Guideline. Am J Respir Crit Care Med. 15 juil. 2015;192(2):e3-19.
29. Albera C, Costabel U, Fagan EA, Glassberg MK, Gorina E, Lancaster L, et al. Efficacy of pirfenidone in patients with idiopathic pulmonary fibrosis with more preserved lung function. Eur Respir J. sept. 2016;48(3):843-51.
30. Noble PW, Albera C, Bradford WZ, Costabel U, Glassberg MK, Kardatzke D, et al. Pirfenidone in patients with idiopathic pulmonary fibrosis (CAPACITY): two randomised trials. The Lancet. mai 2011;377(9779):1760 -9.
31. Abe M, Tsushima K, Sakayori M, Suzuki K, Ikari J, Terada J, et al. Utility of nintedanib for severe idiopathic pulmonary fibrosis: a single-center retrospective study. Drug Des Devel Ther. oct. 2018;Volume 12:3369-75.
32. Wuyts WA, Kolb M, Stowasser S, Stansen W, Huggins JT, Raghu G. First Data on Efficacy and Safety of Nintedanib in Patients with Idiopathic Pulmonary Fibrosis and Forced Vital Capacity of ≤50 % of Predicted Value. Lung. oct. 2016;194(5):739- 43.
33. Chung MP, Park MS, Oh IJ, Lee HB, Kim YW, Park JS, et al. Safety and Efficacy of Pirfenidone in Advanced Idiopathic Pulmonary Fibrosis: A Nationwide Post-Marketing Surveillance Study in Korean Patients. Adv Ther. mai 2020;37(5):2303-16.
34. Crestani B, Huggins JT, Kaye M, Costabel U, Glaspole I, Ogura T, et al. Long-term safety and tolerability of nintedanib in patients with idiopathic pulmonary fibrosis: results from the open-label extension study, INPULSIS-ON. Lancet Respir Med. jan. 2019;7(1):60 -8.
35. Costabel U, Albera C, Lancaster LH, Lin CY, Hormel P, Hulter HN, et al. An Open-Label Study of the Long-Term Safety of Pirfenidone in Patients with Idiopathic Pulmonary Fibrosis (RECAP). Respiration. 2017;94(5):408-15.
36. RAMQ. Liste des médicaments [Internet]. 2022. Disponible sur : https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/a-propos/liste-medicaments
37. Wollin L, Wex E, Pautsch A, Schnapp G, Hostettler KE, Stowasser S, et al. Mode of action of nintedanib in the treatment of idiopathic pulmonary fibrosis. Eur Respir J. mai 2015;45(5):1434- 45.
38. Corte T, Bonella F, Crestani B, Demedts MG, Richeldi L, Coeck C, et al. Safety, tolerability and appropriate use of nintedanib in idiopathic pulmonary fibrosis. Respir Res. déc. 2015;16(1):116.
39. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. LiverTox - Nintedanib [Internet]. 2017. Disponible sur: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK548135/
40. Boehringer Ingelheim (Canada). Monographie de produit - Ofev [Internet]. 2020. Disponible sur : https://www.boehringer-ingelheim.ca/sites/ca/files/ofevpmfr.pdf
41. Moore DC, Kientzel MM, Fasan A. Hypertension Caused by VEGF-Signaling Pathway Inhibitors. 2017;7(4):3.
42. Ruwanpura SM, Thomas BJ, Bardin PG. Pirfenidone: Molecular Mechanisms and Potential Clinical Applications in Lung Disease. Am J Respir Cell Mol Biol. avr. 2020;62(4):413-22.
43. Rahaghi FF, Safdar Z, Brown AW, de Andrade JA, Flaherty KR, Kaner RJ, et al. Expert consensus on the management of adverse events and prescribing practices associated with the treatment of patients taking pirfenidone for idiopathic pulmonary fibrosis: a Delphi consensus study. BMC Pulm Med. déc. 2020;20(1):191.
44. Hoffmann-La Roche. Monographie de produit - Esbriet [Internet]. 2021. Disponible sur : https://www.rochecanada.com/PMs_Fr/Esbriet/Esbriet_PM_F.pdf
45. Lancaster LH, de Andrade JA, Zibrak JD, Padilla ML, Albera C, Nathan SD, et al. Pirfenidone safety and adverse event management in idiopathic pulmonary fibrosis. Eur Respir Rev. 31 déc. 2017;26(146):170057.
46. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. LiverTox - Pirfenidone [Internet]. 2020. Disponible sur : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK548769/
47. Hukkanen J, Jacob III P, Peng M, Dempsey D, Benowitz NL. Effect of nicotine on cytochrome P450 1A2 activity: Letter to the Editors. Br J Clin Pharmacol. nov. 2011;72(5):836 -8.
48. Tobin RW, Pope CE, Pellegrini CA, Emond MJ, Sillery J, Raghu G. Increased prevalence of gastroesophageal reflux in patients with idiopathic pulmonary fibrosis. Am J Respir Crit Care Med. déc. 1998;158(6):1804-8.
49. Lee JS, Ryu JH, Elicker BM, Lydell CP, Jones KD, Wolters PJ, et al. Gastroesophageal Reflux Therapy Is Associated with Longer Survival in Patients with Idiopathic Pulmonary Fibrosis. Am J Respir Crit Care Med. 15 déc. 2011;184(12):1390 - 4.
50. Rajagopal K, Bryant AJ, Sahay S, Wareing N, Zhou Y, Pandit LM, et al. Idiopathic pulmonary fibrosis and pulmonary hypertension: Heracles meets the Hydra. Br J Pharmacol. janv 2021;178(1):172-86.
51. Kishaba T, Tamaki H, Shimaoka Y, Fukuyama H, Yamashiro S. Staging of acute exacerbation in patients with idiopathic pulmonary fibrosis. Lung. fév. 2014;192(1):141-9.
52. Juarez MM, Chan AL, Norris AG, Morrissey BM, Albertson TE. Acute exacerbation of idiopathic pulmonary fibrosis-a review of current and novel pharmacotherapies. J Thorac Dis. mars 2015;7(3):499-519.
53. Buckley L, Guyatt G, Fink HA, Cannon M, Grossman J, Hansen KE, et al. 2017 American College of Rheumatology Guideline for the Prevention and Treatment of Glucocorticoid-Induced Osteoporosis: ACR GUIDELINE FOR GLUCOCORTICOID-INDUCED OSTEOPOROSIS PREVENTION AND TREATMENT. Arthritis Rheumatol. août 2017;69(8):1521-37.
54. Naccache JM, Jouneau S, Didier M, Borie R, Cachanado M, Bourdin A, et al. Cyclophosphamide added to glucocorticoids in acute exacerbation of idiopathic pulmonary fibrosis (EXAFIP): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet Respir Med. jan. 2022;10(1):26 -34.
55. Distler O, Highland KB, Gahlemann M, Azuma A, Fischer A, Mayes MD, et al. Nintedanib for Systemic Sclerosis-Associated Interstitial Lung Disease. N Engl J Med. 27 juin 2019;380(26):2518-28.
56. Flaherty KR, Wells AU, Cottin V, Devaraj A, Walsh SLF, Inoue Y, et al. Nintedanib in Progressive Fibrosing Interstitial Lung Diseases. N Engl J Med. 31 oct. 2019;381(18):1718-27.
57. Richeldi L, Azuma A, Cottin V, Hesslinger C, Stowasser S, Valenzuela C, et al. Trial of a Preferential Phosphodiesterase 4B Inhibitor for Idiopathic Pulmonary Fibrosis. N Engl J Med. 9 juin 2022;386(23):2178-87.
58. Association pulmonaire du Québec. Fibrose pulmonaire [Internet]. 2022. Disponible sur : https://poumonquebec.ca/maladies/fibrose-pulmonaire/
Répondez
Période d’accréditation valide 1er février 2023 au 29 février 2024
Donne : 2 h 30 N° d’accréditation : 10989
QUESTIONS DE FORMATION CONTINUE (QUESTIONS 4 À 10)
La fibrose pulmonaire idiopathique

4. Parmi les énoncés suivants, lequel est FAUX ?
n La FPI survient surtout chez des patients âgés de 60 à 80 ans et touche principalement les hommes.
n L’objectif de traitement en FPI est d’améliorer la fonction pulmonaire mesurée par la capacité vitale forcée (CVF).
n Les principaux symptômes de FPI sont la dyspnée, la toux sèche et la fatigue.
n Les symptômes de FPI se manifestent graduellement, ce qui entraîne des délais avant le diagnostic.
5. Parmi les énoncés suivants, lequel n’est pas un bon conseil à donner à un patient atteint de FPI ?
n La cessation tabagique est primordiale pour limiter la progression de la maladie et assurer l’efficacité des traitements.
n Les patients doivent s’assurer de recevoir les vaccins contre l’influenza, la COVID-19 et le pneumocoque.
n Les patients devraient demeurer physiquement actifs et participer à un programme de réadaptation pulmonaire s’ils sont admissibles.
n La diminution des symptômes des patients devrait être perceptible de deux à trois semaines après le début d’un traitement antifibrotique.
6. Parmi les effets indésirables suivants, lequel n’est PAS associé au nintédanib ?
n Diarrhées
n Anorexie
n Éruptions cutanées et photosensibilité
n Hypertension artérielle
7. Au sujet des exacerbations aiguës de FPI, lequel des énoncés est VRAI ?
n Il n’y a pas d’élément précipitant pouvant causer une exacerbation aiguë, il s’agit toujours d’un événement idiopathique.
n Les immunodépresseurs, comme la cyclophosphamide, sont indiqués dans le traitement des exacerbations.
n Les corticostéroïdes à dose élevée sont utilisés dans le traitement des exacerbations.
n La survenue d’une exacerbation aiguë n’a pas d’impact sur le pronostic des patients.
8. Au sujet des traitements utilisés en FPI, lequel de ces énoncés est VRAI ?
n Tous les patients atteints de FPI devraient recevoir un inhibiteur de la pompe à protons (IPP) afin de réduire le risque de micro-aspiration.
n Les traitements antifibrotiques ne doivent pas être utilisés plus d’un an, car l’efficacité du traitement après cette période n’est pas connue.
n Le nintédanib cause fréquemment de la diarrhée qui peut nécessiter la prise de lopéramide, la diminution de la dose ou l’arrêt du traitement.
n La pirfénidone doit être prise à jeun afin de limiter les effets indésirables, comme les étourdissements.
9. Dans quel type de fibrose le nintédanib ne possède PAS d’indication ?
n Fibrose pulmonaire idiopathique
n Fibrose pulmonaire associée à la sclérodermie
n Fibrose pulmonaire avec un phénotype progressif
n Fibrose pulmonaire causée par la COVID-19
10. Parmi les énoncés suivants concernant la pirfénidone, lesquels sont VRAIS ?
A) Le bénéfice de la pirfénidone n’est pas clairement établi chez les patients avec une FPI grave définie par une CVF de moins de 50 %;
B) Une augmentation de la dose de pirfénidone est requise avec la prise de ciprofloxacine;
C) Un suivi du bilan hépatique est requis afin de détecter le développement d’hépatotoxicité;
D) L’exposition importante aux rayons du soleil augmente le risque de réaction cutanée pendant le traitement.
n A et B
n B et C
n A, C et D
n Toutes ces réponses
aux questions en vous rendant sur ·cca
eCortex.ca
eCortex.ca met à votre disposition une multitude de cours de formation continue susceptibles d’enrichir vos connaissances sur des sujets cliniques pertinents et répondant aux besoins spécifiques des pharmaciens et ATP.
La dermatite atopique. Nouveaux traitements pour la prise en charge de vos patients atteints de dermatite atopique modérée à grave


Auteurs : Michael Boivin, Dan Tam Vu et Melinda Gooderham

Commanditée par AbbVie
Utilisation des probiotiques en vente libre dans le traitement du syndrome du côlon irritable (SCI) en fonction des sous-types : revue clinique

Auteure : Dragana SkokovicSunjic, RPh, B. Sc. Pharm., NCMP

Commanditée par Bio-K Plus International Inc.
Forum de santé en gynécologie destiné aux pharmaciens
Auteurs : Jamie Kroft, M.D., FRCSC et Kerry Roberts, pharmacienne
Commanditée par AbbVie
Demander, éduquer et planifier – La prise en charge de l’obésité dans la pratique pharmaceutique
Auteur : Michael Boivin, RPh, CDE
Commanditée par Novo Nordisk Canada.
Hidradénite suppurée : se libérer des préjugés pour faciliter le parcours du patient
Auteurs : Michael Boivin, BSc. Pharm; Ravina Sanghera-Grewal, BSc. Pharm, Pharm D; Parbeer Grewal, MD, FRCPC.
Commanditée par AbbVie
Les techniciens en pharmacie font une différence dans les stratégies de désaccoutumance du tabac

Auteure : Leslie Phillips, B. Pharm., Pharm. D.
Commanditée par Teva
GRATUIT ! SUIVEZ CETTE FORMATION SUR
CONSULTEZ PLUS DE 500 LIGNES DIRECTRICES
/repertoire-lignes-directrices
intervenir
RESPONSABLE DE CETTE CHRONIQUE
Rôles et retombées de l’activité du pharmacien dans la prise en charge de patients suivis en hémato-oncologie
Objectifs d’apprentissage
1. Connaître les données de la documentation pharmaceutique recensant les rôles du pharmacien et les retombées de ses activités en hémato-oncologie, en établissement de santé.

2. Encourager les pharmaciens à se mettre en action afin d’explorer de nouveaux modèles de pratique et de types d’intervention.
Introduction
La Société canadienne du cancer précise que « le cancer est causé par un changement ou un dommage à un ou plusieurs gènes. Ces mutations peuvent nous être transmises par nos parents; elles peuvent aussi résulter de l’exposition à des substances carcinogènes ou du processus de vieillissement naturel »1
RÉDACTION
Duc Tâm Bui, candidat au Pharm. D., Clémence Delafoy, candidate au Pharm. D., et Amélie Monnier, candidate au Pharm. D., assistants de recherche, Unité de recherche en pratique pharmaceutique, CHU Sainte-Justine, Montréal, Québec, Canada
RÉVISION
Jean-François Bussières, B. Pharm., M. Sc., MBA, FOPQ, FCSHP
Texte original : 17 juin 2021
Texte final : 9 janvier 2023
Les auteurs et le réviseur scientifique ne déclarent aucun conflit d’intérêts lié à la rédaction de cet article.
DESCRIPTION DE L’ÉTUDE
Titre de l’article
Impact of clinical pharmacy in oncology and hematology centers: A systematic review.
Auteurs
Oliveira CS, Silva MP, Miranda ÍKSPB, Calumby RT, de Araújo-Calumby RF
Référence
J Oncol Pharm Practice 2021; 27(3) : 679–692. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33302824/
Objectifs
Identifier et commenter les preuves entourant les rôles et les retombées de l’activité des pharmaciens dans le traitement de patients atteints de cancers hématologiques.
Description de l’étude
n La recherche bibliographique a permis de recenser 745 articles; de ces articles, 17 ont été retenus selon les critères d’inclusion et d’exclusion, puis analysés.
n Ces articles portaient sur un total de 4771 patients âgés de 0,6 à 63,9 ans, de pays différents : États-Unis (n = 5), Canada (n = 3), Espagne (n = 2), France (n = 2), Singapour (n = 1), Taiwan (n = 1), Maroc (n = 1), Finlande (n = 1) et Brésil (n = 1).
n Tous les patients étaient atteints de cancers hématologiques, principalement des leucémies myéloïdes chroniques et des lymphomes, avec une durée moyenne de suivi de 15,3 mois. Tous les patients ont bénéficié d’interventions pharmacothérapeutiques de l’équipe pharmaceutique.
n La majorité des études étaient prospectives (9/17).
n Les études retenues comportaient différentes méthodologies : analyses qualitatives et descriptives (n = 8), études d’évaluation de l’impact (n = 6), études de cohorte (n = 2) et études transversales (n = 1).
n Toutes les interventions pharmaceutiques ont été effectuées dans des centres de soins en hémato-oncologie.
n Toutes les études retenues ont considéré l’identification des erreurs liées à l’utilisation des médicaments et l’impact des interventions sur la santé des patients comme résultat clinique principal. Trois études ont évalué des retombées humaines (c’est-à-dire adhésion et connaissance) découlant des interventions pharmaceutiques et deux études ont évalué l’impact économique de celles-ci.
Méthode
n La recherche a été réalisée selon la méthodologie de PICO (Population, Intervention, Comparison, Outcome).
n Les chercheurs ont effectué leur recherche dans les bases de données PROSPERO (il s’agit d’un registre international de revues systématiques du National Institute for Health Research) et Cochrane. Par la suite, une recherche plus poussée a été réalisée dans Pubmed/Medline, Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences (LILACS) et Google Scholar.
n Dans la stratégie de recherche, on a utilisé la combinaison de termes relatifs à l’hémato-oncologie et de termes relatifs aux soins pharmaceutiques.
n Tous les articles ont été revus par trois chercheurs indépendants afin de s’assurer de la cohérence de la recherche.
n Principaux critères d’inclusion :
n Études publiées entre juillet 1999 et mai 2020
n Études écrites en anglais, en espagnol ou en portugais
n Articles de recherche originaux (documentation primaire)
n Études évaluant un service de pharmacien dans un centre d’hémato-oncologie
n Études ayant comme population à l’étude des patients atteints de cancers hématologiques
n Principaux critères d’exclusion :
n Études comportant des méthodes non appropriées ou évaluation de l’impact et/ou analyse statistique
n Études portant sur d’autres cancers que les cancers hématologiques
n Études de cas et revues de littérature scientifique
Depuis quelques décennies, le traitement du cancer est basé sur le type de cancer et son emplacement. Toutefois, avec tous les progrès obtenus en génétique, les nouvelles approches thérapeutiques se fondent davantage sur une approche individualisée qui tient compte du profil génétique de chaque patient. Ainsi, on passe progressivement d’une pharmacothérapie traditionnelle à une pharmacothérapie dite de précision. Dans un rapport publié conjointement par la Société canadienne du cancer, l’Agence de santé publique du Canada et Statistique Canada, on a noté qu’au 1er janvier 2018, « près de 1 574 000 personnes au Canada avaient reçu un diagnostic de cancer au cours des 25 années précédentes et étaient encore en vie à cette date. (…) Le cancer de la prostate et le cancer colorectal représentaient près de la moitié (48,5 % ou 823 440 cas) de tous les cancers prévalents depuis 25 ans. (…) Les autres diagnostics courants incluaient le mélanome de la peau (5,5 % soit 93 890 cas), le cancer de la thyroïde (5,0 % ou 84 760 cas), le cancer de la vessie (4,6 % ou 77 735 cas), le lymphome non hodgkinien (4,5 % ou 77 245 cas), le cancer de l’utérus (4,4 % soit 74 955 cas) et le cancer du poumon (4,1 % ou 68 785 cas) »2 . Au Québec, la Fondation québécoise du Québec estimait l’incidence du cancer à 158 nouveaux cas par jour en 20213
Jacolin et coll. ont noté que plus de 50 % des dépenses de médicaments en établissement de santé étaient associées au traitement de patients en oncologie alors que ceux-ci représentent une proportion très limitée des activités hospitalières4 Clavet et coll. ont observé que « 1 % des plus grands utilisateurs de soins publics de santé représentait un peu plus du quart (26,5 %) des dépenses publiques de soins de santé en 2016 »5.
En pratique pharmaceutique, le soin des patients atteints de cancer implique autant les pharmaciens hospitaliers que communautaires. Compte tenu du vieillissement de la population, de la survie accrue des patients atteints de cancer et du nombre croissant d’options thérapeutiques utilisées dans le traitement des cancers, le pharmacien doit s’intéresser aux preuves entourant ses rôles et leurs retombées en oncologie.
Dans cet article, nous abordons la revue systématique d’Oliveira et coll., qui recense les meilleures données relatives aux rôles et retombées de l’activité du pharmacien dans la prise en charge de patients suivis en hémato-oncologie.
Que retenir de cette étude ? (Y compris les limites et la validité externe)
Cette revue systématique met en évidence l’impact du pharmacien hospitalier dans la prise en charge de patients atteints de cancers hématologiques. De façon générale, elle respecte les bonnes pratiques de réalisation d’un tel type de revue.
En dépit de la présence soutenue du pharmacien en oncologie depuis quelques décennies, incluant dans la prise en charge de cancers hématologiques, cette revue systématique met en évidence un nombre relativement limité d’articles publiés sur le sujet (n = 17) et des preuves variées et hétérogènes de son impact.
Il faut noter quelques autres revues systématiques portant aussi sur l’impact du pharmacien en oncologie qui ont été également publiées, notamment celle de Herledan et coll. sur la réconciliation médicamenteuse en oncologie en 20206, celle de Maleki et coll. sur les soins pharmaceutiques en oncologie ambulatoire en 20197, et celle de Segal et coll. en 20198
Liens avec la pratique
En 2016, le ministère de la Santé et des Services sociaux, en collaboration avec l’Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec (APES) et le Comité d’évaluation de la pratique des soins pharmaceutiques (CEPSP), a publié des recommandations sur le rôle du pharmacien en oncologie dans les établissements de santé (85 pages)9. Ce guide comporte 29 recommandations spécifiques réparties dans les 5 axes de la pratique pharmaceutique (soins, services, enseignement, recherche, gestion et affaires professionnelles).
Par exemple, 10 des 29 recommandations portent sur les soins pharmaceutiques. Ainsi, le CEPSP recommande que le pharmacien en oncologie :
1. « procède à une collecte de renseignements auprès de tous les patients recevant un médicament anticancéreux;
2. réalise une histoire pharmacothérapeutique de tous les patients recevant un médicament anticancéreux dans son établissement. Celle-ci doit être minimalement réalisée au commencement ainsi qu’à tout changement de protocole de traitement;
PRINCIPAUX CONSTATS
Interventions
On a évalué plusieurs interventions pharmaceutiques dans les études incluses :
n Identification de problèmes liés aux médicaments :
n Prescription de médicaments
n Ajustement de doses de médicaments
n Prophylaxie contre les infections
n Supplémentation en électrolytes
n Substitution de médicaments
n Surveillance de la thérapie.
Le plus souvent, ces interventions ciblaient des agents antiinfectieux et, plus rarement, les agents antinéoplasiques.
n Adhésion au traitement et enseignement aux patients
n Suivi de résultats thérapeutiques
Principaux résultats
Interventions des pharmaciens sur les problèmes liés aux médicaments
n Soins pharmaceutiques incluant les éléments suivants :
n Surveillance de la sécurité dans l’utilisation des médicaments
n Évaluation et gestion des interactions médicamenteuses
n Utilisation de facteurs de stimulation des granulocytes pour la prévention de la neutropénie fébrile
n Utilisation d’antiémétiques prophylactiques
n Prévention de la lyse tumorale
n Suivi thérapeutique de médicaments à forte dose (ex. : méthotrexate)
n Suivi de perfusion contrôlée de certains médicaments (ex. : rituximab)
n Utilisation de thérapies alternatives et complémentaires
n Les problèmes liés aux médicaments des patients ont été relevés et évalués dans les 17 études.
n Au total, les évaluations menées par les pharmaciens ont permis de réaliser plus de 3000 interventions thérapeutiques et de relever environ 1500 problèmes liés aux médicaments.
n Cinq articles avaient pour intervention principale l’optimisation et l’administration des médicaments (ex. : ajustement de doses, prescription de médicaments, prophylaxie contre les infections, supplémentation en électrolytes, substitution de médicaments et surveillance thérapeutique).
n L’étude de Farias et coll. a démontré que la détection et la prévention des problèmes liés aux médicaments a augmenté de 106,5 % depuis l’implantation de soins pharmaceutiques.
n L’étude de Delpeuch et coll. a mentionné que la présence d’un pharmacien dans l’équipe d’hémato-oncologie avait permis de réaliser des interventions pour 12,6 % des ordonnances de patients adultes hospitalisés pour un cancer.
n L’étude de Defoe et coll. a démontré une augmentation significative du nombre de bilans comparatifs des médicaments (400 %), d’enseignement aux patients et à leurs familles pour favoriser l’adhésion au traitement (132 %) et d’évaluations de l’adhésion (122 %).
3. rencontre tout patient recevant une thérapie anticancéreuse, idéalement avant le début du traitement ainsi que lors de tout changement de protocole de traitement, pour un enseignement et des conseils individualisés quant à sa thérapie anticancéreuse;
4. conçoive un plan de surveillance globale de la thérapie médicamenteuse, le mette en application et en établisse les indicateurs de suivi pour tous les patients recevant un médicament anticancéreux dans son établissement;
5. assure le suivi requis de la médication anticancéreuse, notamment en ce qui a trait à l’apparition des effets indésirables, ou s’assure qu’un collègue ou un autre professionnel l’a pris en charge;
6. recoure aux analyses de laboratoire et aux paramètres cliniques appropriés pour effectuer la surveillance globale de la thérapie anticancéreuse;
7. entreprenne des traitements médicamenteux qui concernent, entre autres, la thérapie de soutien, ou ajuste des ordonnances de thérapies anticancéreuses, de façon à individualiser le traitement;
Impact du pharmacien sur l’adhésion au traitement
n La mise en place de soins pharmaceutiques dans les cliniques d’hémato-oncologie a contribué à la promotion de l’adhésion thérapeutique. Les conseils pharmaceutiques portaient notamment sur les modes d’utilisation des agents thérapeutiques, la prévention et la prise en charge d’effets indésirables attendus (ex. : signes, symptômes et dangers associés à la survenue de thrombose).
n L’étude de Valgus et coll. a montré que les pharmaciens ont réalisé 63 interventions d’enseignement chez 89 patients, dont plus de la moitié étaient directement liées à l’usage d’antiémétiques, à la résolution d’erreurs de calcul de dosage et à l’ajustement de traitements pour le contrôle de la douleur.
n L’étude de Lam et coll. a montré que les pharmaciens favorisaient l’adhésion à l’imatinib chez 88,6 % des patients atteints de leucémie myéloïde chronique, en créant une relation de confiance avec le patient et son entourage à travers l’élaboration d’un plan de traitement.
n L’étude de Ribes et coll. a montré une augmentation significative de l’adhésion des patients à leurs traitements anticancéreux par voie orale à la suite des interventions pharmaceutiques. De plus, le degré de satisfaction des patients par rapport à l’implantation du programme de soins pharmaceutiques était de 81,1 %.
Impact économique des interventions pharmaceutiques
n L’étude de Gregori et coll. a montré que l’intervention des pharmaciens apportait un bénéfice net de 223 021 euros par année, notamment par des interventions de type déprescription ou par remplacement par un médicament moins coûteux, par l’ajout ou le remplacement de médicaments ou par la révision du schéma d’immunothérapie ou de chimiothérapie.
n L’étude de Chen et coll. a montré que l’intervention des pharmaciens réduisait le temps moyen d’hospitalisation des patients (de 19,27 jours à 16,69 jours), ce qui a contribué à réduire les coûts d’hospitalisation.
Conclusion des auteurs
La présence d’un pharmacien clinicien contribue de manière significative à la prise en charge des patients traités pour des cancers hématologiques. Cette prise en charge est améliorée notamment par l’optimisation de l’efficacité des traitements pharmacothérapeutiques, la réduction du coût des traitements, la réduction du temps d’hospitalisation, l’augmentation de la sécurité de l’utilisation des médicaments et la qualité de vie du patient.
8. consigne au dossier du patient les soins pharmaceutiques prodigués, à toutes les étapes de leur prestation;
9. rencontre tout patient avant la première dispensation d’une thérapie anticancéreuse administrée par voie orale;
10. s’assure que le patient hospitalisé recevant une thérapie anticancéreuse ait accès aux mêmes soins et services pharmaceutiques, et avec autant d’intensité, que les patients traités en clinique ambulatoire d’hémato-oncologie ».
Notons que ces recommandations reposent notamment sur un ratio de temps pharmacien/patient traité.
Ce guide est le premier d’une série de guides à être publiée par l’APES et autres parties prenantes en 2016. Il établit les bases de la pratique pharmaceutique dans un programme de soins. Il a été rédigé en tenant compte des besoins des clientèles, des données probantes publiées (incluant des articles, des revues de littérature scientifique ou des revues systématiques comme celles discutées dans cette chronique), et du recul en matière de soins pharmaceutiques au Québec.
Avec l’entrée en vigueur des projets de loi 41 (en 2015) et 31 (en 2021), le pharmacien en oncologie peut contribuer, plus que jamais, à des soins de santé optimaux et sécuritaires. Toutefois, cela n’est possible que dans la mesure où des ressources suffisantes sont octroyées, tant en milieu hospitalier que communautaire.
Dans la plus récente enquête canadienne sur la pratique pharmaceutique en 20202021, on note que 78 % des chefs de départements de pharmacie ont un programme de soins en oncologie. Parmi ces répondants, on note la présence de pharmaciens québécois exerçant au chevet des patients et prodiguant des soins pharmaceutiques à raison de 97 % des cas en ambulatoire et 41 % en hospitalisation10.
En 2023, les pharmaciens exerçant en oncologie font face à différents enjeux (ex. : émergence de pharmacies spécialisées ayant le monopole de la distribution de certains médicaments et exigeant la complétion de différents formulaires pour que le produit soit accessible; nécessité de mise à jour de la circulaire 2000-028 (Responsabilités des établissements en regard de la chimiothérapie contre le cancer); continuité du parcours de soins entre l’hôpital et le milieu communautaire; évolution rapide des connaissances et nouveaux produits; prix des nouvelles thérapies; accès aux données de pharmacogénétiques pour assurer le bon choix et la prévention des effets indésirables, etc.).
Que faire ?
n Définir une offre de soins complète et conforme au sein de son département de pharmacie ou en milieu communautaire afin d’offrir à tous les patients une offre cohérente à partir d’une équipe de pharmaciens/assistants techniques en pharmacie.
n Prioriser les activités et les interventions pharmaceutiques les plus utiles.
n S’assurer d’obtenir les ressources humaines et financières requises pour une pratique pharmaceutique sécuritaire.
n Documenter ses interventions pharmaceutiques.
Cet article est le dernier de la chronique Intervenir. En 1993, Jean-François Bussières a créé la chronique «D’une page à l’autre » au sein de Québec Pharmacie afin d’exposer le lectorat à l’analyse critique de la littérature scientifique. Après quelques années, la chronique s’est orientée sur l’analyse d’articles portant sur les rôles et retombées du pharmacien. En 2017, « D’une page à l’autre » a cédé sa place à la chronique « Intervenir », dans la foulée des travaux de l’Unité de recherche en pratique pharmaceutique (URPP) du CHU Sainte-Justine et de sa plateforme Impactpharmacie.org, mise en place depuis 2013.
Après toutes ces années, il est temps de renouveler la formule. Nous vous convions à notre blogue hebdomadaire mettant en valeur les plus récentes publications indexées portant sur les rôles et retombées du pharmacien (Impactpharmacie.net). Et nous nous retrouverons peut-être également à discuter du rôle du pharmacien dans Profession Santé. Merci à nos lecteurs et surtout à tous ces pharmaciens qui soignent des patients au quotidien. n
Références
1. Société canadienne du cancer. Médecine de précision. [En ligne] https://cancer.ca/fr/research/understanding-cancerresearch/precision-medicine#:~:text=La%20m%C3%A9decine%20de%20pr%C3%A9cision%2C%20 qu,g%C3%A9n%C3%A9tique%20et%20mol%C3%A9culaire%20du%20cancer (site visité le 9 janvier 2023).
2. Government of Canada. Canadian cancer statistics. A 2022 special report on cancer prevalence. [En ligne] (site visité le 9 janvier 2023).
3. Fondation québécoise du cancer. Faits et statistiques sur le cancer. Novembre 2021. [En ligne] https://fqc.qc.ca/fr/information/le-cancer/statistiques (site visité le 9 janvier 2023).
4. Jacolin C, Lebel D, Bussières JF. Êtes-vous prêts à intégrer le financement à l’activité en pharmacie hospitalière ? Pharmactuel 2022; 55 (2) : 80-83.
5. Clavet NJ, Fonseca R, Michaud PC, Navaux J. Portrait des grands utilisateurs de soins publics au Québec. Chaire de recherche sur les enjeux économiques intergénérationnels. N. 2022-03. [En ligne] https://creei.ca/wp-content/uploads/2022/05/note-analyse-2022-3.pdf (site visité le 9 janvier 2023).
6. Herledan C, Baudouin A, Larbre V, Gahbiche A, Dufay E, Alquier I, Ranchon F, Rioufol C. Clinical and economic impact of medication reconciliation in cancer patients: a systematic review. Support Care Cancer 2020;28(8): 3557-3569.
7. Maleki S, Alexander M, Fua T, Liu C, Rischin D, Lingaratnam S. A systematic review of the impact of outpatient clinical pharmacy services on medication-related outcomes in patients receiving anticancer therapies. J Oncol Pharm Pract 2019;25(1):130-139.
8. Segal EM, Bates J, Fleszar SL, Holle LM, Kennerly-Shah J, Rockey M, Jeffers KD. Demonstrating the value of the oncology pharmacist within the healthcare team. J Oncol Pharm Pract. 2019 Dec;25(8):1945-1967.
9. Ministère de la Santé et des Services sociaux. Recommandations sur le rôle du pharmacien en oncologie dans les établissements de santé. 2016. [en ligne] www.apesquebec.org/sites/default/files/publications/ouvrages_ specialises/20160000-role-pharm_onco.pdf (site visité le 9 janvier 2023).
10. Bussières JF, Bonnici A, Tanguay C. Perspective québécoise et canadienne de la pratique pharmaceutique en établissement de santé pour 2020-2021. Pharmactuel 2022; 55(3) : 183-230.
Les références en gras indiquent au lecteur les références principales de l’article, telles que choisies par les auteurs.
Répondez aux questions en
Période d’accréditation valide
1er février 2023 au 29 février 2024
Donne : 2 h 30
N° d’accréditation : 10989
QUESTIONS DE FORMATION CONTINUE (QUESTIONS 11 À 12)
Rôles et retombées de l’activité du pharmacien dans la prise en charge de patients suivis en hémato-oncologie
11. Parmi les énoncés suivants sur la revue systématique d’Oliveira et coll., lequel est FAUX ?
n L’évaluation de la pharmacothérapie réalisée par les pharmaciens a engendré plus de 3000 interventions thérapeutiques et l’identification d’environ 1500 problèmes liés aux médicaments.
n Les principales interventions du pharmacien ont consisté à optimiser l’administration médicamenteuse : ajustement des doses, prescription de médicaments, supplémentation en électrolytes, substitution médicamenteuse et surveillance thérapeutique.
n L’intégration d’un pharmacien clinicien dans le département d’hémato-oncologie a engendré des interventions bénéfiques pour garantir la sécurité de l’usage des médicaments pour 12,6 % des prescriptions adultes.
n Le pharmacien a aidé à améliorer l’adhésion au traitement de 48,6 % chez les patients atteints de leucémie myéloïde chronique ayant reçu de l’imatinib.
n Le temps moyen d’hospitalisation est passé de 19,27 à 16,69 jours après l’implantation de la pharmacie clinique dans l’unité d’hémato-oncologie.
12. Parmi les énoncés suivants sur la revue systématique d’Oliveira et coll., lequel est FAUX ?
n Le rôle du pharmacien clinicien en hématooncologie consiste avant tout à évaluer et à ajuster une prescription médicamenteuse sans nécessairement tenir compte de la qualité de vie du patient.

n Les études sélectionnées décrivent l’impact des activités du pharmacien clinicien en hémato-oncologie, mais aussi les retombées économiques des interventions pharmaceutiques.
n Des thérapies alternatives, comme l’usage de plantes médicinales, peuvent être proposées par le pharmacien dans la gestion des effets indésirables causés par la chimiothérapie.
n Les problèmes liés aux médicaments constituent l’indicateur principal des retombées de la pratique pharmaceutique.
n Les interventions pharmaceutiques d’enseignement aux patients permettent une meilleure compréhension de la maladie et donc une meilleure adhésion aux traitements.
CP 83621, Montréal , QC H2J 4E9
1 877 687-7321 n téléc. 1 888 889-9522 n www.professionsante.ca
GESTION DE MARQUE
PREMIÈRE VICE-PRÉSIDENTE, CANADA, GROUPE SANTÉ
Donna Kerry n 416 786-6315 n dkerry@ensembleiq.com
ÉDITORIAL
RÉDACTEUR EN CHEF
Christophe Augé, pharmacien, M. Sc., Ph. D. RÉDACTRICE EN CHEF ADJOINTE Alice Collin, B. Pharm, DESS, M. Sc. DIRECTEUR DE LA RÉDACTION
Christian Leduc n cleduc@ensembleiq.com
RÉDACTRICE EN CHEF ADJOINTE, VOLET INTÉGRATION WEB
Anne Hébert ahebert@emsenbleiq.com
COLLABORATEURS
Jean-François Bussières, B. Pharm. M. Sc., MBA, FOPQ, FCSHP Clémence Delafoy, candidate au Pharm. D. Jihane Lazrac, Pharm. D. Antoine Lebrun, Pharm. D., M. Sc. Julien Quang Le Van, B. Pharm., M. Sc. Marianne Lévesque, M. D., FRCPC Amélie Monnier, candidate au Pharm. D. Duc Tâm Bui, candidat au Pharm. D. Thomas Weil, Pharm. D., M. Sc.
COMITÉ DE RÉDACTION À VOS SOINS
Christophe Augé, pharmacien, M. Sc., Ph. D. PLACE AUX QUESTIONS Sandra Bélanger, B. Pharm. Geneviève Tirman, B. Pharm., diplôme de 2e cycle en pharmacie communautaire
À VOTRE SERVICE SANS ORDONNANCE
Alice Collin, B. Pharm, DESS, M. Sc. LES PAGES BLEUES Alice Collin, B. Pharm., DESS, M. Sc. AVEZ-VOUS ENTENDU PARLER DE… Mathieu Tremblay, Pharm. D., Ph. D. INTERVENIR
Jean-François Bussières, B. Pharm., M. Sc., MBA
VENTES ET PUBLICITÉS
DIRECTEURS DE COMPTES
Norman Cook n 647 290-3967 n ncook@ensembleiq.com
Scott Tweed n 416 230-4315 n stweed@ensembleiq.com
Nancy Dumont n 514 557-6660 n ndumont@ensembleiq.com
DIRECTEUR DE LA MARQUE, PHARMACY U
Martin Rissin n 416 508-4884 n mrissin@ensembleiq.com
COORDONNATRICE, VENTES ET ÉDITORIAL
Sylvie Graveson n 514 805-0634 n sgraveson@ensembleiq.com
CONCEPTION/PRODUCTION/MARKETING
DIRECTRICE, CRÉATION
Nancy Peterman npeterman@ensembleiq.com
DIRECTEUR ARTISTIQUE
Dino Peressini n dperessini@ensembleiq.com
GESTIONNAIRE DE LA PRODUCTION
Lisette Pronovost lpronovost@ensembleiq.com
GESTIONNAIRE DE MARKETING
Nicola Tidbury n ntidbury@ensembleiq.com
SERVICE DES ABONNEMENTS
Questions relatives à l'abonnement contact@professioncante.ca
DIRIGEANT(E)S
PRÉSIDENTE ET CHEFFE DE LA DIRECTION
Jennifer Litterick
PREMIÈRE DIRECTRICE, FINANCES
Jane Volland
PREMIÈRE DIRECTRICE, RESSOURCES HUMAINES
Ann Jadown
VICE-PRÉSIDENT EXÉCUTIF, CONTENU ET COMMUNICATIONS
Joe Territo CHEF DES OPÉRATIONS
Derek Estey
POUR NOUS LIRE EN LIGNE
Québec Pharmacie se trouve sur le site sécurisé ProfessionSante.ca (inscription gratuite). Site accessible aux étudiants en médecine et en pharmacie, ainsi qu’aux résidents.
Québec Pharmacie est diffusée 6 fois l’an par EnsembleIQ. Toutes les annonces de produits pharmaceutiques sur ordonnance ont été approuvées par le Conseil consultatif de publicité pharmaceutique. Le contenu du magazine ©2023 par Stagnito Partners Canada Inc. ne peut pas être reproduit sans autorisation. Québec Pharmacie reçoit de temps à autre des commentaires et des documents (y compris des lettres à l’éditeur) non sollicités.
Québec Pharmacie, ses sociétés affiliées et cessionnaires peuvent utiliser, reproduire, publier, rééditer, distribuer, garder et archiver ces soumissions, en tout ou en partie, sous quelque forme ou sur quelque support que ce soit, sans aucune rémunération de quelque nature. Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Québec, Bibliothèque nationale du Canada ISSN 0826-9874.

