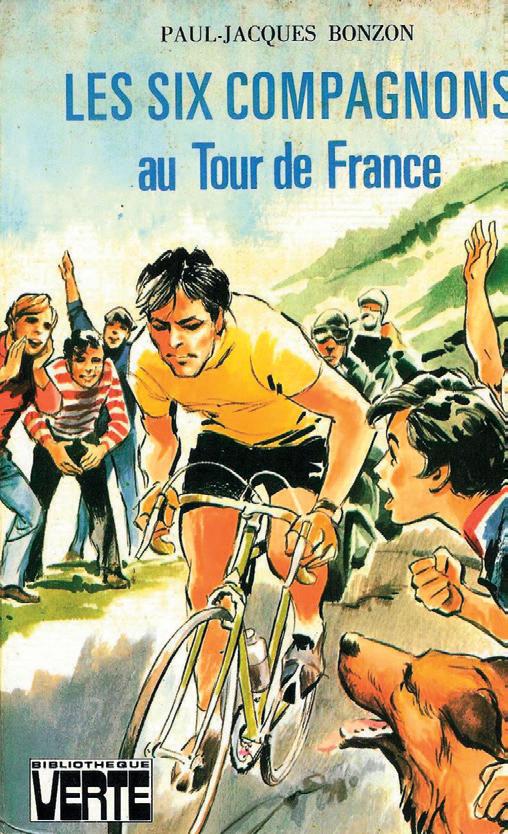
8 minute read
Histoire de la Littérature sportive
par Thomas Bauer
- Les Six compagnons au Tour de France par Paul-Jacques Bonzon - Bibliothèque verte - Nicolas Bergère par Tristan Bernard - Paru en 1911 aux Ed. Ollendorff - Couverture de la réédition de 1923 - Quinze rounds, histoire d’un combat par Henry Decoin Ed. Flammarion
Advertisement
Introduction
Qu’ils soient dramaturges, poètes ou romanciers, les écrivains ont toujours accompagné le phénomène sportif et participé à la construction d’un genre singulier. « Littérature sportive », « littérature à thème sportif », « littérature du sport », bien des formules ont été utilisées pour identifier cette tendance qui s’est dessinée à la Belle Époque et qui connaît, grâce au souffle olympique de 1924, un dynamisme sans précédent ; une tendance qui a traversé les décennies et trouve aujourd’hui de nouvelles perspectives. Toutefois, poser la question des relations entre sport et littérature, au regard de son histoire et sa diversité, ne va pas de soi. Sans doute est-ce lié à l’étiquette même de « littérature sportive » qui, comme celle d’ « écrivain sportif », pose problème en raison de son caractère polysémique. Au regard de la pluralité des sources d’informations, on se rend vite compte qu’il n’existe pas « une » histoire mais bien « des » histoires de la littérature sportive : celle des grands textes sportifs qui ont fait date, celle des auteurs qui ont inscrit leur nom dans l’histoire, celle des genres littéraires, celle des maisons d’édition ou encore celle des disciplines ou thématiques qui lui ont été associées. Sans vouloir entrer dans le détail, et afin de proposer une chronologie générique, nous proposons de dresser ici une histoire « institutionnelle » qui, selon nous, se découpe en cinq grandes périodes.
Chanter la modernité sportive (fin XIXe - 1918)
Une première période, qui constitue d’une certaine manière le point de départ, est celle de la Belle Époque. En effet, à l’heure où le sport se développe en France (turf, cyclisme, automobile, aéronautique, canotage, boxe), et en réaction contre le romantisme, plusieurs écrivains commencent à chanter les joies du loisir sportif, du spectacle athlétique ou encore de la modernité futuriste incarnée par la vitesse mécanique. Ainsi trouve-t-on un passage mémorable sur la boxe dans “L’Homme qui rit” de Victor Hugo (1869) ou celui sur le canotage du côté de Bezons dans “Une partie de Campagne” de Maupassant (1881). Par ailleurs, maints feuilletons paraissent dans la presse spécialisée sous la plume des premiers auteurs qui structurent le champ: Pierre Giffard, Henri Desgrange,
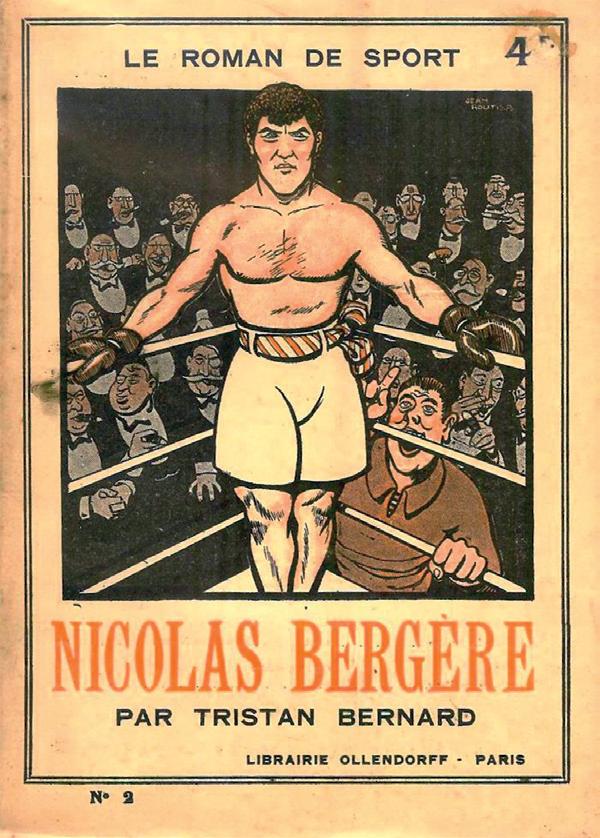
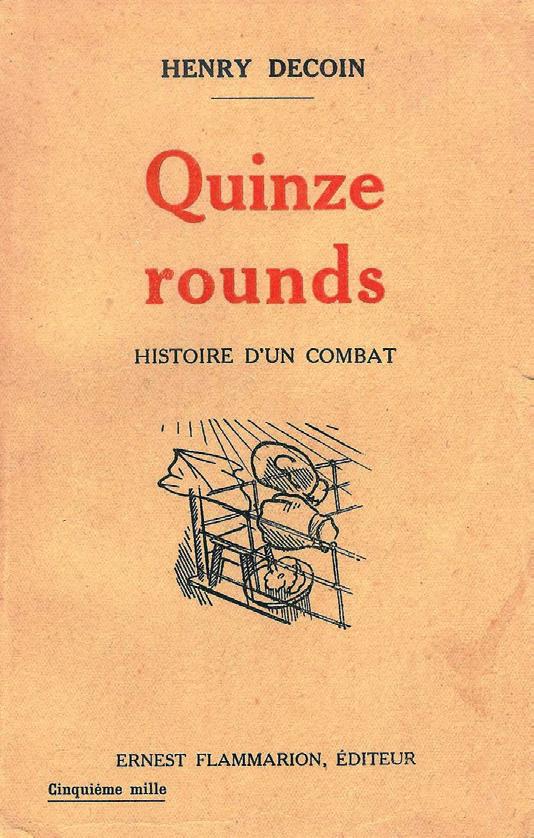
- Les Six compagnons au Tour de France par Paul-Jacques Bonzon - Bibliothèque verte - Nicolas Bergère par Tristan Bernard - Paru en 1911 aux Ed. Ollendorff - Couverture de la réédition de 1923 - Quinze rounds, histoire d’un combat par Henry Decoin Ed. Flammarion CHAPITRES
- Chanter la modernité sportive (fin XIXe - 1918) - L’âge d’or de la littérature sportive (1918 - 1939) - Dans le creux de la vague (1939 - 1979) - Un nouveau souffle (1979 - 1998) - La (re)connaissance (1998 à nos jours)
Louis Baudry de Saunier, Tristan Bernard, Maurice Leblanc, J. Rosny aîné ou encore Pierre Souvestre et Marcel Allain – ces deux derniers, qui font paraître “Le Rour” dans les colonnes du quotidien sportif “L’Auto” entre le 11 janvier et le 31 mars 1909, deviendront célèbres en inventant quelques mois plus tard un personnage mythique : Fantômas.
Une deuxième période, laquelle est réellement faste, commence avec la Grande Guerre et les traumatismes qu’elle génère ; une guerre déloyale, chimique, industrielle et inhumaine qui fragilise toute une génération de jeunes gens tant dans leur corps que dans leur moi profond. Aussi, pour raviver la flamme des camaraderies sportives lycéennes et retrouver la solidarité éprouvée dans les tranchées ou sur les aérodromes, le sport apparaît comme un remède à des auteurs comme Marcel Berger, Jean Bernier, Alexandre Arnoux ou Pierre Drieu la Rochelle. De là naît le Plume-Palette-Club qui deviendra, le 17 juillet 1931, l’Association des Écrivains Sportifs (AES) ; soulignons l’enthousiasme et l’engagement de Tristan Bernard, tout à la fois auteur prolixe et arbitre de boxe, cruciverbiste patenté et directeur du vélodrome Buffalo, dans cette affaire. Il faut dire que Paris, capitale mondiale de la culture, s’ouvre à de nouveaux concours d’art et de littérature avec l’avènement des Jeux olympiques de 1924, ce qui permet au sport de devenir un sujet d’actualité pour les maisons d’édition (Gallimard, Fayard, Ferenczi), et toute une kyrielle d’auteurs, tant les grands écrivains (Montherlant, Giraudoux), les modernes (Soupault, Morand, Cocteau, Géo-Charles) que les populaires (Henri Decoin, Maurice Landay).
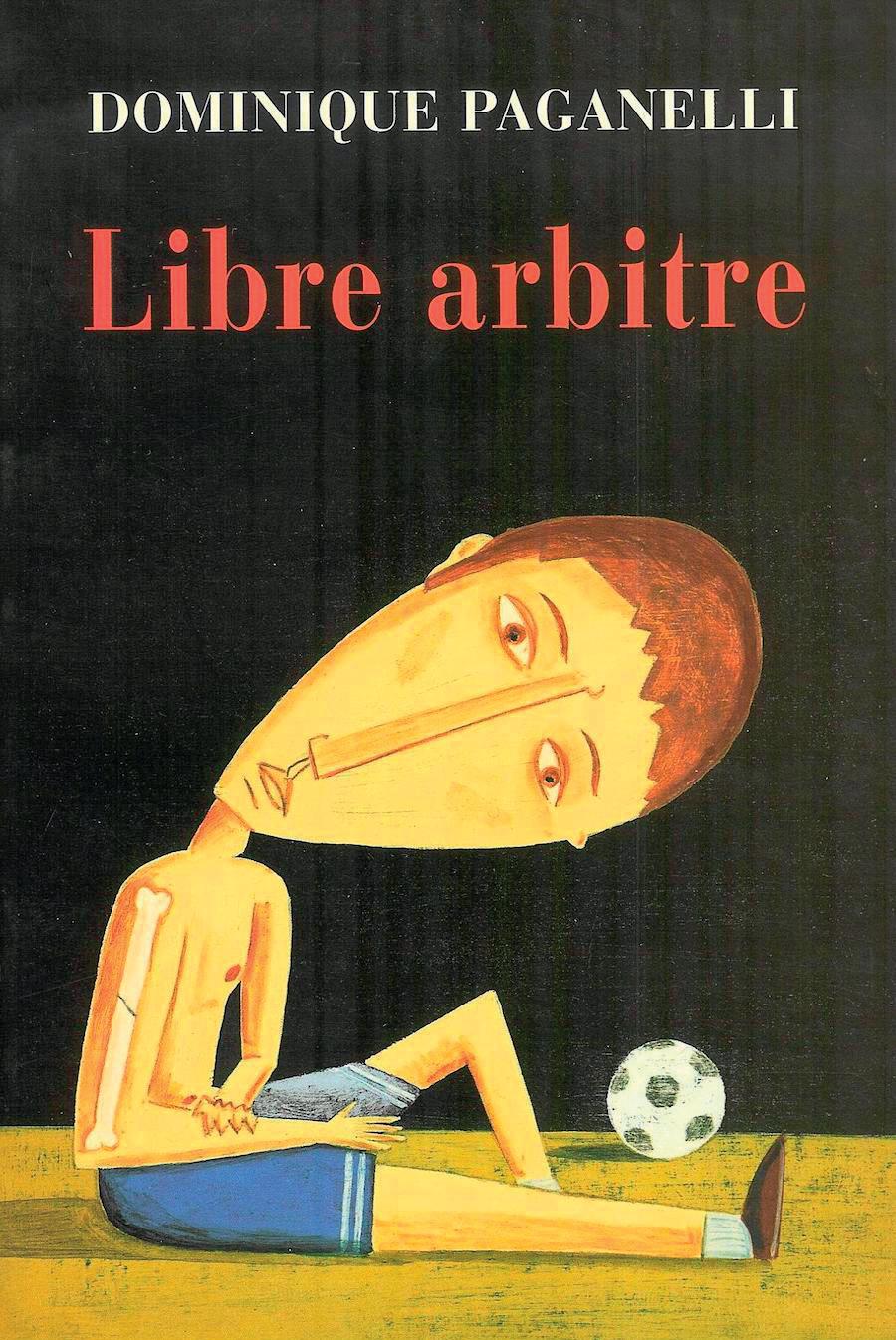
2ème Semestre 2021 Rapidement, une série de textes de qualité font couler beaucoup d’encre dans la presse : “Les Olympiques” d’Henry de Montherlant, “5 000” de Dominique Braga, “Histoire de quinze hommes” de Marcel Berger, “La Malédiction de l’ovale” d’Alexandre Arnoux, ou encore “Tête de mêlée” de Jean Bernier. Tous ces écrivains mettent un point d’honneur pour défendre « l’Idée Sportive » – selon la formule d’Henri Decoin – jusque-là trop souvent combattue par les intellectuels.
Dans le creux de la vague (1939 - 1979)
Une troisième période, plus mitigée en matière de production et de diffusion, couvre les Trente Glorieuses. En effet, Pierre Charreton pointe du doigt cette décadence de la littérature sportive, tous genres confondus, à partir de la Libération. L’objet serait-il à nouveau mal perçu par les intellectuels français ? Tout porte à la croire en effet. Bien que le régime de Vichy valorise un temps la culture sportive avec la création de prix littéraires, ne seraitce que pour promouvoir le culte du corps auprès de la jeunesse et ainsi contribuer à une certaine idéologie du régime (citons par exemple le recueil de poèmes de Paul Souchon, “Les Chants du stade”, officiellement préfacé en 1943 par le Colonel Pascot), les années qui suivent sonnent, non pas le glas, mais la fin de l’euphorie. Les créations artistiques diminuent et le sport ne semble plus, du moins sur le plan littéraire, être réellement porteur. Il faut dire que la critique se tourne peu à peu vers la post-modernité et les prémices du Nouveau roman, avec un intérêt grandissant pour l’esthétique du fragment. Si certains tentent de poursuivre leur idéal, tant bien que mal, tel Marcel Berger qui dirige en 1948 “Les plus belles histoires du sport” (avec Henri Chabrol, Pierre Mac Orlan, Roger Vercel, Paul Vialar, etc.), d’autres, de réels francs-tireurs, parviennent à tirer leur épingle du jeu : Georges Magnane, Gilbert Prouteau, Jacques Perret, Yves Gibeau et Antoine Blondin.

Les Hommes forts de Georges Magnane - 1942
Un nouveau souffle (1979 - 1998)
Une quatrième période, celle du rebond, démarre à la fin des années 1970. Dans la même veine humaine, intelligible, esthétique que Montherlant à son époque, PierreLouis Rey apporte un nouveau souffle avec son essai littéraire intitulé “Football. Vérité et poésie” (1979) ; il y fait l’éloge d’un sport aux règles curieuses où le pied constitue une « pièce maîtresse ». Cette nouvelle impulsion résulte Georges Magnane: la plume et le sport - sous la dir. de Thomas Bauer

également de la publication, en 1980, du recueil de nouvelles “Les Héroïques” de Guy Lagorce (prix Goncourt de la nouvelle et prix Cazes) ; ce dernier est d’ailleurs reçu dans l’émission radiophonique de Jacques Chancel et dans celle télévisée de Bernard Pivot. Il faut d’ailleurs saluer ici le rôle primordial de passeur joué par Bernard Pivot qui permet à plusieurs écrivains de promouvoir le sujet sportif : Georges Haldas (“La Légende du football”, 1981), Louis Nucera (“Mes rayons de soleil”, 1987), Georges Londeix (“Football”, 1995)... Sans doute est-ce en partie pourquoi la revue littéraire “Gulliver” fait paraître en 1991 un numéro intitulé « Écrire le sport » dans lequel ses contributeurs interrogent, face à la montée spectaculaire du sport dans la société post-moderne, les enjeux de ce phénomène désormais planétaire. En 1996, la revue “Europe” lui emboîte le pas avec son numéro spécial « Sport & Littérature ». Quant aux travaux académiques, dans le

Anthologie de la Littérature sportive Parution en 2006
prolongement de la thèse de Pierre Charreton publié en partie en 1985, ce sont deux passionnés, Henri le Targat et Jean-Claude Lyleire, qui établissent et publient une “Anthologie de la littérature du sport” (1988).
La (re)connaissance (1998 à nos jours)
Une dernière période, prolifique, commence en 1998, lorsque la France accueille et remporte la coupe de monde de football. Avec cette victoire qui soulève toute une nation, un changement dans les mentalités s’opère : les intellectuels entrent à nouveau en jeu, officiellement et durablement. Si l’anthologie “Plumes et crampons” de Benoît Heimermann et Patrice Delbourg (1998) siffle le coup d’envoi, plusieurs « grands » noms de la littérature investissent la question, tels que Jean Echenoz, Jean-Philippe Toussaint et Jean Hatzfeld. Toute une génération, décomplexée, creuse le sillon en se focalisant sur des événements mythiques, des gestes légendaires, des histoires personnelles ou des biofictions : Pierre-Louis Basse, Lola Lafon, Ollivier Pourriol, Olivier Haralambon, Vincent Duluc, Bernard Chambaz, Cécile Coulon, Elie Robert-Nicoud, et bien d’autres – à cette liste s’ajoutent quelques polareux et bédéistes. L’émulation collective devient si contagieuse qu’elle se partage entre une petite constellation d’acteurs enthousiastes : des journalistes (revues “Desports” et “Bordel”), des membres des jurys de prix littéraires (le grand prix Sport & Littérature de l’AES, le prix Sport Scriptum, le prix Jules Rimet), des directeurs de collection (Acte Sud, Stock), des universitaires (colloques « Écrire le sport » en 2001, « Tour de France et littérature » en 2013, « Georges Magnane : la plume et le sport » en 2014, « Littérature et sport » en 2017) et des organisateurs de salons (Salon du livre de sport, Cultursport, Les Foulées littéraires, Salon du livre de Chaumont, etc.).
Conclusion
La littérature sportive a ainsi traversé les derniers siècles, du XIXe au XXIe, en accompagnant l’évolution du phénomène sportif. L’Association des Écrivains Sportifs, qui vient de fêter ses 90 ans d’existence sur le lieu même de sa naissance à l’hôtel de Massa (Société des Gens de Lettres de France), en a été une observatrice privilégiée. Espérons qu’elle puisse encore longtemps promouvoir, par sa dimension culturelle et éducative, l’idéal olympique.
Thomas Bauer









