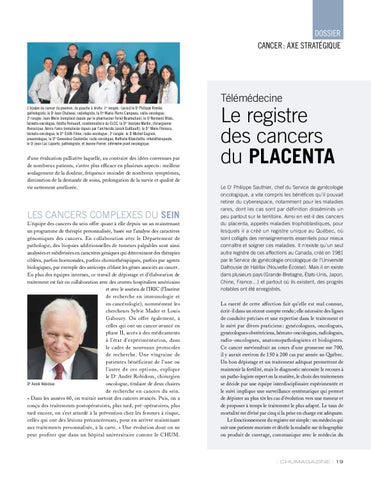Dossier CANCER : AXE STRATÉGIQUE
Télémédecine L’équipe du cancer du poumon, de gauche à droite, 1 rangée : (assis) le D Philippe Roméo, pathologiste, le Dr Jean Chalaoui, radiologiste, la Dre Marie-Pierre Campeau, radio-oncologue ; 2e rangée : Jean Morin (remplacé depuis par le pharmacien Feriel Boumedian), le Dr Normand Blais, hémato-oncologue, Odette Perreault, coordonnatrice du CLCC, la Dre Jocelyne Martin, chirurgienne thoracique, Amira Fares (remplacée depuis par l’archiviste Janick Guilbault), la Dre Marie Florescu, hémato-oncologue, la Dre Édith Filion, radio-oncologue ; 3e rangée : le Dr Michel Gagnon, pneumologue, la Dre Geneviève Coulombe, radio-oncologue, Nathalie Blanchette, inhalothérapeute, le Dr Jean-Luc Laporte, pathologiste, et Jeanne Poirier, infirmière pivot oncologique. re
r
d’une évaluation palliative laquelle, au contraire des idées convenues par de nombreux patients, s’avère plus efficace en plusieurs aspects : meilleur soulagement de la douleur, fréquence moindre de nombreux symptômes, diminution de la demande de soins, prolongation de la survie et qualité de vie nettement améliorée.
Les cancers complexes du SEIN L’équipe des cancers du sein offre quant à elle depuis un an maintenant un programme de thérapie personnalisée, basée sur l’analyse des caractères génomiques des cancers. En collaboration avec le Département de pathologie, des biopsies additionnelles de tumeurs palpables sont ainsi analysées et subdivisées en caractères géniques qui déterminent des thérapies ciblées, parfois hormonales, parfois chimiothérapiques, parfois par agents biologiques, par exemple des anticorps ciblant les gènes associés au cancer. En plus des équipes internes, ce travail de dépistage et d’élaboration de traitement est fait en collaboration avec des centres hospitaliers américains et avec le soutien de l’IRIC (l’Institut de recherche en immunologie et en cancérologie), nommément les chercheurs Sylvie Mader et Louis Gaboury. On offre également, à celles qui ont un cancer avancé en phase II, accès à des médicaments à l’état d’expérimentation, dans le cadre de nouveaux protocoles de recherche. Une vingtaine de patientes bénéficient de l’une ou l’autre de ces options, explique le Dr André Robidoux, chirurgien Dre André Robidoux oncologue, titulaire de deux chaires de recherche en cancers du sein. « Dans les années 60, on traitait surtout des cancers avancés. Puis, on a conçu des traitements postopératoires, plus tard, pré-opératoires, plus tard encore, on s’est attardé à la prévention chez les femmes à risque, celles qui ont des lésions précancéreuses, pour en arriver maintenant aux traitements personnalisés, à la carte. » Une évolution dont on ne peut profiter que dans un hôpital universitaire comme le CHUM.
Le registre des cancers du placenta Le Dr Philippe Sauthier, chef du Service de gynécologie oncologique, a vite compris les bénéfices qu’il pouvait retirer du cyberespace, notamment pour les maladies rares, dont les cas sont par définition disséminés un peu partout sur le territoire. Ainsi en est-il des cancers du placenta, appelés maladies trophoblastiques, pour lesquels il a créé un registre unique au Québec, où sont colligés des renseignements essentiels pour mieux connaître et soigner ces maladies. Il n’existe qu’un seul autre registre de ces affections au Canada, créé en 1981 par le Service de gynécologie oncologique de l’Université Dalhousie de Halifax (Nouvelle-Écosse). Mais il en existe dans plusieurs pays (Grande-Bretagne, États-Unis, Japon, Chine, France…) et partout où ils existent, des progrès notables ont été enregistrés. La rareté de cette affection fait qu’elle est mal connue, écrit-il dans un récent compte rendu ; elle nécessite des lignes de conduite précises et une expertise dans le traitement et le suivi par divers praticiens : gynécologues, oncologues, gynécologues obstétriciens, hémato-oncologues, radiologues, radio-oncologues, anatomopathologistes et biologistes. Ce cancer surviendrait au cours d'une grossesse sur 700, il y aurait environ de 150 à 200 cas par année au Québec. Un bon dépistage et un traitement adéquat permettent de maintenir la fertilité, mais le diagnostic nécessite le recours à un patho-logiste expert en la matière, le choix des traitements se décide par une équipe interdisciplinaire expérimentée et le suivi implique une surveillance systématique qui permet de dépister au plus tôt les cas d’évolution vers une tumeur et de proposer à temps le traitement le plus adapté. Le taux de mortalité est divisé par cinq si la prise en charge est adéquate. Le fonctionnement du registre est simple : un médecin qui suit une patiente enceinte et décèle la maladie sur échographie ou produit de curetage, communique avec le médecin du
| CHUMAGAZINE | 19