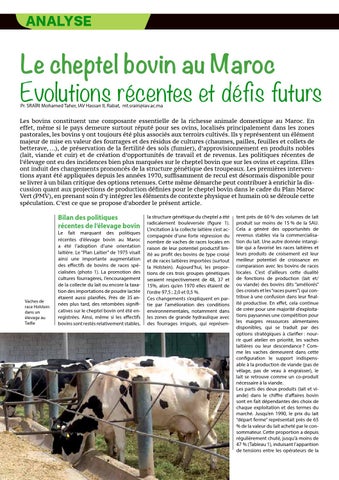ANALYSE
Le cheptel bovin au Maroc Evolutions récentes et défis futurs Pr. SRAÏRI Mohamed Taher, IAV Hassan II, Rabat, mt.srairi@iav.ac.ma
Les bovins constituent une composante essentielle de la richesse animale domestique au Maroc. En effet, même si le pays demeure surtout réputé pour ses ovins, localisés principalement dans les zones pastorales, les bovins y ont toujours été plus associés aux terroirs cultivés. Ils y représentent un élément majeur de mise en valeur des fourrages et des résidus de cultures (chaumes, pailles, feuilles et collets de betterave, …), de préservation de la fertilité des sols (fumier), d’approvisionnement en produits nobles (lait, viande et cuir) et de création d’opportunités de travail et de revenus. Les politiques récentes de l’élevage ont eu des incidences bien plus marquées sur le cheptel bovin que sur les ovins et caprins. Elles ont induit des changements prononcés de la structure génétique des troupeaux. Les premières interventions ayant été appliquées depuis les années 1970, suffisamment de recul est désormais disponible pour se livrer à un bilan critique des options retenues. Cette même démarche peut contribuer à enrichir la discussion quant aux projections de production définies pour le cheptel bovin dans le cadre du Plan Maroc Vert (PMV), en prenant soin d’y intégrer les éléments de contexte physique et humain où se déroule cette spéculation. C’est ce que se propose d’aborder le présent article.
Bilan des politiques récentes de l’élevage bovin
Vaches de race Holstein dans un élevage au Tadla
Le fait marquant des politiques récentes d’élevage bovin au Maroc a été l’adoption d’une orientation laitière. Le “Plan Laitier” de 1975 visait ainsi une importante augmentation des effectifs de bovins de races spécialisées (photo 1). La promotion des cultures fourragères, l’encouragement de la collecte du lait ou encore la taxation des importations de poudre lactée étaient aussi planifiés. Près de 35 années plus tard, des retombées significatives sur le cheptel bovin ont été enregistrées. Ainsi, même si les effectifs bovins sont restés relativement stables,
38
Agriculture du Maghreb N° 85/ 2015
la structure génétique du cheptel a été radicalement bouleversée (figure 1). L’incitation à la collecte laitière s’est accompagnée d’une forte régression du nombre de vaches de races locales en raison de leur potentiel productif limité au profit des bovins de type croisé et de races laitières importées (surtout la Holstein). Aujourd’hui, les proportions de ces trois groupes génétiques seraient respectivement de 48, 37 et 15%, alors qu’en 1970 elles étaient de l’ordre 97,5 ; 2,0 et 0,5 %. Ces changements s’expliquent en partie par l’amélioration des conditions environnementales, notamment dans les zones de grande hydraulique avec des fourrages irrigués, qui représen-
tent près de 60 % des volumes de lait produit sur moins de 15 % de la SAU. Cela a généré des opportunités de revenus stables via la commercialisation du lait. Une autre donnée intangible qui a favorisé les races laitières et leurs produits de croisement est leur meilleur potentiel de croissance en comparaison avec les bovins de races locales. C’est d’ailleurs cette dualité de fonctions de production (lait et/ ou viande) des bovins dits “améliorés” (les croisés et les “races pures”) qui contribue à une confusion dans leur finalité productive. En effet, cela continue de créer pour une majorité d’exploitations paysannes une compétition pour les maigres ressources alimentaires disponibles, qui se traduit par des options stratégiques à clarifier : nourrir quel atelier en priorité, les vaches laitières ou leur descendance ? Comme les vaches demeurent dans cette configuration le support indispensable à la production de viande (pas de vêlage, pas de veau à engraisser), le lait se retrouve comme un co-produit nécessaire à la viande. Les parts des deux produits (lait et viande) dans le chiffre d’affaires bovin sont en fait dépendantes des choix de chaque exploitation et des termes du marché. Jusqu’en 1990, le prix du lait “départ ferme” représentait près de 65 % de la valeur du lait acheté par le consommateur. Cette proportion a depuis régulièrement chuté, jusqu’à moins de 47 % (Tableau 1), induisant l’apparition de tensions entre les opérateurs de la