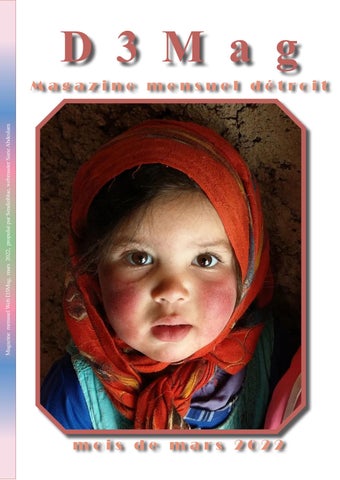1 minute read
Coin lecture ���������������������������������������������������������������������������
from D3Mag, mars 2022
by DouniaNews
Les essais nucléaires et la réparation des préjudices qui y sont associés demeurent des questions encore brûlantes dans plusieurs pays occidentaux. Si le gouvernement du Royaume-Uni a adopté une attitude d’indifférence hostile, avec la complicité du pouvoir australien, qui a régulièrement débouté les victimes de leurs demandes d’indemnisation, les États-Unis, quant à eux, ont pris des mesures compensatoires certes mais insuffisantes. La France, autre puissance nucléaire, se trouve pour sa part dans une position intermédiaire. Les 210 essais nucléaires réalisés entre 1960 et 1996 ont pourtant eu des conséquences à la fois sanitaires et environnementales, longtemps niées par l’État français pour diverses raisons.
Dans ce contexte, l’ouvrage de Chakib Abdessalam, suscite donc un légitime intérêt au regard de la question victimale. Depuis 1996, les démarches de multiples civils et militaires concernés par les retombées des essais atmosphériques polynésiens ont fini par aboutir à la loi Morin n° 2010-2 du 5 janvier 2010, qui prévoit une procédure d’indemnisation des victimes dont les souffrances et les pathologies peuvent être liées aux essais nucléaires français menés dans le Pacifique.
Advertisement
Indépendamment de cette démarche d’ouverture, un grand silence et des tabous entourent toujours les essais nucléaires conduits dans le Sahara au cours des années 1960. Dans son ouvrage, Chakib Abdessalam souligne, à juste titre, que tout un travail mémoriel reste encore à entreprendre. Notons aussi que «la poursuite du travail conjoint concernant les lieux des essais nucléaires en Algérie et leurs conséquences ainsi que la pose de mines aux frontières» a été clairement préconisé par l’historien Benjamin Stora dans son récent rapport remis le 20 janvier 2021 au Président Macron. Une section consacrée à ces essais nucléaires en pourrait être le premier jalon.