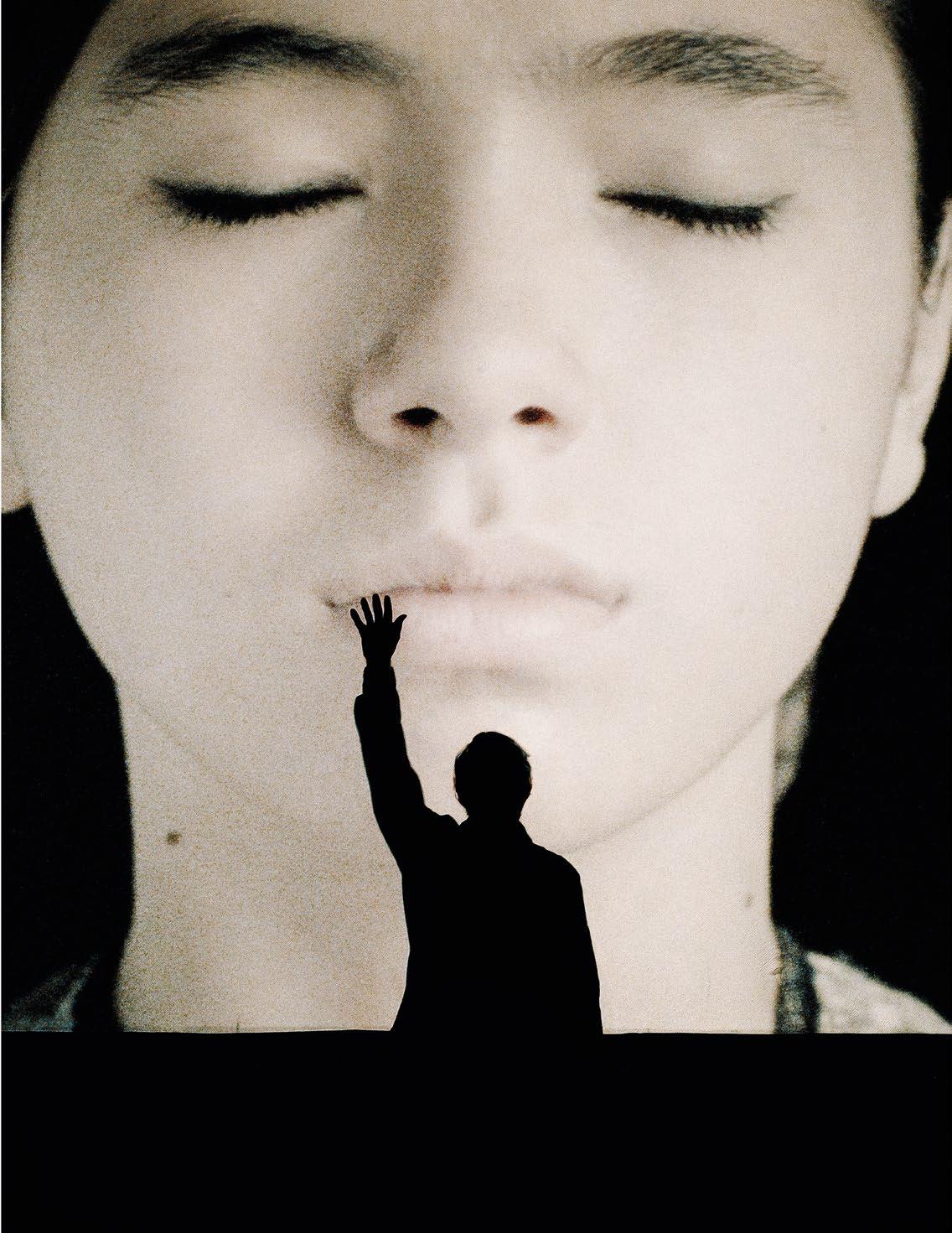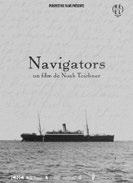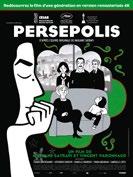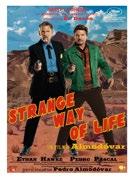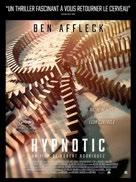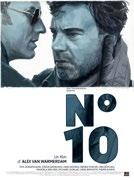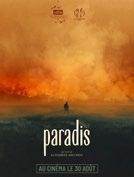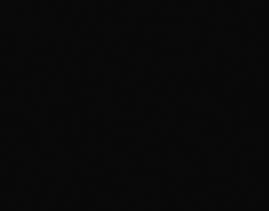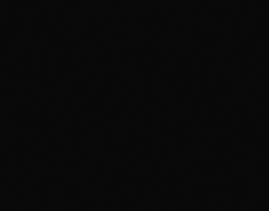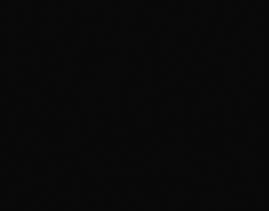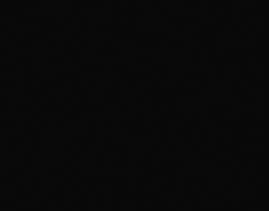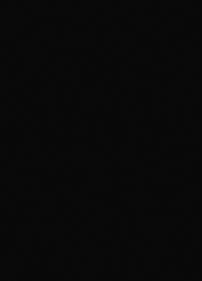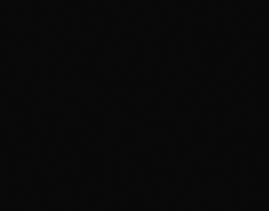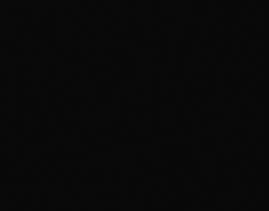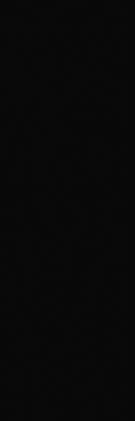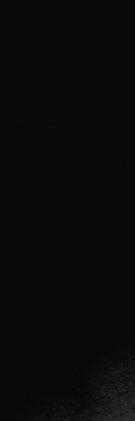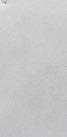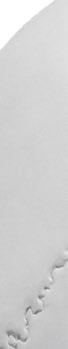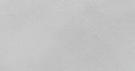Notre dossier de l’été : les meilleures scènes de soirées, entretien en club avec Patric Chiha, l’œil de spécialistes…
Journal cinéphile, défricheur et engagé, par > no 199 / été 2023 / GRATUIT



SANDRA HÜLLER
L’actrice allemande aux rôles dantesques nous a révélé toute son humanité p. 28


REALITY
Tina Satter remet en scène un interrogatoire du FBI dans un film édifiant p. 38
PORTFOLIO
Les meilleures expos cinéma des Rencontres de la photo d’Arles p. 44
QUENTIN DUPIEUX
Le cinéaste hyperactif sort un film-surprise, Yannick p. 40

TROÏKA BBC FILM PRÉSENTE UNE PRODUCTION VIXENS FRAKAS PRODUCTIONS KASBAH FILMS AICHA TEBBAE ABDELLAH EL HAJJOUJI AVEC LA PARTICIPATION DE ANTOINE REINARTZ LES
NE PLEURENT PAS UN FILM DE FYZAL BOULIFA AU CINÉMA LE 26 JUILLET
DAMNÉS


UN FILM DE JUSTINE TRIET LES FILMS PELLÉAS ET LES FILMS DE PIERRE PRÉSENTENT Photo Justine Triet • Design : Benjamin Seznec TROÏKA
ANTOINE
SAMUEL THEIS JEHNNY BETH SAADIA BENTAÏEB CAMILLE RUTHERFORD ANNE ROTGER SOPHIE FILLIÈRES AU CINÉMA LE 23 AOÛT
SWANN
ARLAUD
REINARTZ SANDRA HULLER
EN BREF

P. 4 INFOS GRAPHIQUES – LE NUCLÉAIRE AU CINÉMA
P. 8 FLASH-BACK – WALL-E

P. 12 LES NOUVEAUX – GARANCE KIM & MAXENCE STAMATIADIS

TROISCOULEURS
éditeur MK2 + — 55, rue Traversière, Paris XIIe — tél. 01 44 67 30 00 — gratuit directeur de la publication : elisha.karmitz@mk2.com | directrice de la rédaction : juliette.reitzer@mk2.com | rédactrice en chef : time.zoppe@mk2.com | rédacteurs : lea. andre-sarreau@mk2.com, quentin.grosset@mk2.com, josephine.leroy@mk2.com | directrice artistique : Ines Ferhat | graphiste : Albin Guyot | secrétaire de rédaction : Claire Breton | renfort correction : Marie-Aquilina El Hachem | stagiaire : Chloé Blanckaert | ont collaboré à ce numéro : Margaux Baralon, Julien Bécourt, Lily Bloom, Xanaé Bove, Tristan Brossat, Thomas Choury, Renan Cros, Julien Dupuy, David Ezan, Anaëlle Imbert, Corentin Lê, Damien Leblanc, Copélia Mainardi, Belinda Mathieu, Thomas Messias, Wilfried Paris, Michaël Patin, Laura Pertuy, Perrine Quennesson, Bernard Quiriny, Cécile Rosevaigue, Félix Tardieu, Hanneli Victoire & Célestin et Miléna, Anselmo et Gaïa | photographes : Cha Gonzalez, Ines Ferhat, Julien Liénard, Philippe Quaisse | illustratrice : Sun Bai | publicité | directrice commerciale : stephanie.laroque@mk2.com | cheffe de publicité cinéma et marques : manon.lefeuvre@ mk2.com | responsable culture, médias et partenariats : alison.pouzergues@mk2.com | cheffe de projet culture et médias : claire.defrance@mk2.com
Photographie de couverture : Cha Gonzalez pour TROISCOULEURS
Imprimé en France par SIB imprimerie — 47, bd de la Liane — 62200 Boulogne-sur-Mer

TROISCOULEURS est distribué dans le réseau ProPress Conseil ac@propress.fr
ÉDITO
Le sens de la fête. C’est ce qu’une partie de la population a cherché avec acharnement, et parfois retrouvé fugacement, dès le début de la pandémie et depuis sa récession, pour lutter contre la morosité ambiante. Au point que l’expression est devenue galvaudée. Surtout, est-elle appropriée ? La fête n’estelle pas justement vouée à nous brouiller les sens, à nous déboussoler, à nous perdre ? En découvrant La Bête dans la jungle de Patric Chiha en février dernier au Festival de Berlin, on a enfin vu, pour la première fois sur tout un film, ce qui constitue selon nous la fête : la suspension du temps, l’artifice, le goût du spectaculaire, les mouvements du corps parfois harmonieux, parfois bêtes, impensés, sur


P.
des rythmes répétitifs, speed ou lancinants, qui n’ont d’autres visées que de nous mettre en transe. Le film se déroule pendant vingtcinq ans dans une seule boîte de nuit, sans vraiment faire vieillir ses héros vampiriques, joués par les incandescents Anaïs Demoustier et Tom Mercier. À la Berlinale, on découvrait un autre film de fête furieuse, le bien nommé After d’Anthony Lapia, plongé pour moitié dans un club vénère en sous-sol, où les corps et les âmes vibrent à l’unisson et tentent de se connecter grâce au chaos de la teuf. Les deux œuvres sont traversées de questions sur le sens – ou le non-sens – de la fête, sur ce qu’elle peut révéler des époques et de notre rapport au temps. On y a vu plus qu’un hasard, et ça nous a donné envie de nous plonger dans le phénomène. On a emmené Patric Chiha à La Station – Gare des Mines, hot spot des soirées electro situé Porte d’Aubervilliers, pour l’interviewer dans la fête, lors d’une soirée post-Pride. Pride qui en a scan-
dalisé certain(e)s cette année, qui la considéraient comme moins festive, l’Inter-LGBT ayant décidé, dans une démarche autoproclamée « éco-responsable », d’interdire les chars – on atteste que ça n’a pourtant pas empêché les gens de danser et les slogans militants de fuser. En interrogeant des artistes, des journalistes et une anthropologue pour notre dossier, la réalité qu’on soupçonnait a fini par se faire jour : la fête, outre ses vertus libératrices et cinématographiques (lire notre décryptage p. 22), se fait aussi parfois furieusement politique. Un espace de résistance aux carcans qu’impose la société sur les corps et les mœurs ou aux injonctions de productivité libéraliste – même si pas encore toujours égalitaire. La fête, au moins comme un moyen d’explorer tous les sens.
été 2023 – no 199 03 Sommaire TIMÉ ZOPPÉ © 2018
TROISCOULEURS — ISSN 1633-2083 / dépôt légal quatrième trimestre 2006 Toute reproduction, même partielle, de textes, photos et illustrations publiés par mk2 + est interdite sans l’accord de l’auteur et de l’éditeur — Magazine gratuit. Ne pas jeter sur la voie publique.
P. 74 SPECTACLES – NOS TEMPS FORTS D’AVIGNON
P. 76 EXPO – APRÈS L’ÉCLIPSE
CINÉMA CULTURE
P. 16 EN COUVERTURE – DANS LA FÊTE
28 L’ENTRETIEN FACE CAMÉRA – SANDRA HÜLLER
P. 34 ENTRETIEN – MARIE AMACHOUKELI POUR ÀMAGLORIA
P. 36 MOTS-CROISÉS – BEN WHISHAW
P. 52 CINEMASCOPE : LES SORTIES DU 19 JUILLET AU 30 AOÛT
P. 78 PAGE JEUX
Partant d’un documentaire sur les retombées des bombardements atomiques de Hiroshima et de Nagasaki sur la population japonaise et évoluant vers la fiction, Alain Resnais, à partir d’un scénario de Marguerite Duras, raconte une histoire d’amour impossible entre deux traumatisés de la guerre. Tout en opposition, entre Éros et Thanatos, parole et silence, Orient et Occident, jusque dans son titre oxymorique, le film (sorti en 1959) raconte le poids du souvenir et l’incommunicabilité. « Tu n’as rien vu à Hiroshima », répète-t-il sans cesse. Nous, on a vu un chef-d’œuvre.

CHANT
Infos graphiques
DANGER RADIATION
Alors qu’Oppenheimer, le biopic très attendu de Christopher Nolan sur le « papa de la bombe A », sort le 19 juillet, et que le volet énergie du plan France 2030 prévoit de relancer le nucléaire, on vous propose un tour d’horizon de ce sujet houleux, qui met le septième art en fusion.

HIROSHIMA MON AMOUR INTO ET E YTINR
À quoi servent les sous-marins nucléaires ?

À entretenir l’équilibre de la terreur. Selon cette doctrine datant de la guerre froide, l’utilisation de l’arme atomique par l’un des deux belligérants provoquerait à coup sûr la destruction des deux camps. Un équilibre précaire – et franchement dangereux –toujours d’actualité. Mais que se passe-t-il quand un ordre de frappe est envoyé par erreur ? C’est à cette question, tout à fait inquiétante et déjà évoquée dans Docteur Folamour (1964) de Stanley Kubrick, que répond le film haletant d’Antonin Baudry sorti en 2019.
RADIOACTIVE
Avant Oppenheimer, le cinéma avait déjà consacré un biopic à une figure antérieure importante de la radioactivité (celle qui a inventé le mot, d’ailleurs) : Marie Curie. Le long métrage de Marjane Satrapi, sorti en 2020, retrace le parcours de la Polonaise Maria Skłodowska, naturalisée française, et de ses recherches avec son époux, Pierre, autour du radium, du polonium et de la structure de l’atome. Comme quoi, toute découverte peut mener à du mauvais (la bombe) comme à du bon (la radiothérapie et la radiologie)… en fonction de qui l’a entre les mains.

GODZILLA

Passer au nucléaire pour éviter le recours à l’énergie fossile, pourquoi pas. Mais que fait-on des tonnes de déchets qui peuvent mettre plusieurs milliers d’années à se décomposer et à devenir inoffensifs ? Les stocker sous terre et interdire à quiconque d’y accéder ? À partir de cette question, le documentaire Into Eternity (2011) de Michael Madsen nous embarque dans un tourbillon de réflexions de plus en plus abyssales. Jusqu’à nous laisser en PLS sur notre siège. Tout simplement le 2001 : l’odyssée de l’espace du documentaire.
Doublement touchés par la bombe atomique (issue du projet Manhattan, dont le directeur scientifique était Robert Oppenheimer) en 1945, les Japonais en ont gardé un traumatisme vivace qui s’est notamment incarné en une créature devenue mythique, Godzilla, dans le film de 1954 d’Ishirō Honda. Dans l’imaginaire nippon, ce kaijū serait un monstre sousmarin réveillé et irradié par des essais nucléaires qui ravagent Tokyo. Il est réapparu une trentaine de fois au cinéma et est même devenu un héros. Une bonne manière de conjurer son trauma.
En bref no 199 – été 2023
04
EN BREF
PERRINE QUENNESSON
LE
Oppenheimer
KRISTEN STEWART
« It’s really fucking stupid. » L’actrice et réalisatrice américaine Kristen Stewart tease très efficacement son projet de stoner movie – soit un film qui tourne essentiellement autour du cannabis. Ou plus exactement une « stoner girl comedy » (« comédie de filles défoncées »), comme elle le précise dans le magazine culte Interview (où elle échange avec l’actrice, humoriste et scénariste Rachel Sennott) Au scénario, Stewart collabore avec sa fiancée, Dylan Meyer, également coscénariste de Moxie (2021), teen movie déjanté et féministe réalisé par la géniale Amy Poehler.
GUSTAVE KERVERN
Retour en France avec le réalisateur grolandais qui, après avoir sorti l’an dernier En même temps, coréalisé avec son comparse Benoît Delépine, tourne en solo son prochain film dans le Pasde-Calais, avec Yolande Moreau, Pierre Richard, Laure Calamy et Jonathan Cohen. Interrogé par La Voix du Nord, Frédéric Alexandre, l’assistant réalisateur, précise que le film racontera « l’histoire d’une femme […] qui décide de se venger de son passé ». On est déjà familiers du savoir-faire fantasque de Kervern, alors on sait que ça peut partir loin. Très loin.
BRADLEY COOPER
La dernière fois qu’on l’a vu, c’était dans Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson (2022), où il était formidable de bizarrerie. Comme on le trouve particulièrement fort en comédie, on attend de découvrir son troisième long en tant que réalisateur (après A Star is Born, sorti en 2018, et Maestro, diffusé cette année sur Netflix) : une comédie noire coécrite avec son ami Will Arnett (vu dans la série loufoque Arrested Development et entendu dans la série d’animation culte BoJack Horseman, dans laquelle il prête sa voix grave à un héros à quatre pattes aussi pathétique que touchant). On aime bien cette combinaison artistique.

JEAN-CHRISTOPHE MEURISSE
Après avoir rendu les spectateurs fous, hilares ou circonspects avec sa comédie détraquée Oranges sanguines (2021), le cinéaste, metteur en scène et fondateur de la troupe Les Chiens de Navarre mijote un nouveau long, pour le moment intitulé Les Pistolets en plastique. La tout aussi trash Blanche Gardin sera de la partie. Curieux, on a déniché quelques indices à travers les annonces de casting – apparemment, il y aura du rock, des ados imberbes ou encore des grands blonds. « Merci d’indiquer dans l’objet du mail “routier” ou “danois” », précise une des annonces. Ça pose tout de suite l’ambiance.

En bref été 2023 – no 199 05 AYOUB ELAID ABDELLATIF MASSTOURI BARNEY PRODUCTION PRÉSENTE UN FILM DE KAMAL LAZRAQ
MEUTES UN POLAR
INCROYABLE
© 2023 BARNEY PRODUCTION MONT FLEURI PRODUCTION BELUGA TREE ACTUELLEMENT AU CINEMA ADVITAMDISTRIBUTION #LESMEUTES
LES
D UNE
INTENSITE L’HUMANITÉ
LEROY Ça tourne
JOSÉPHINE
La sextape
Depuis l’annonce du tournage de Barbie de Greta Gerwig, je guette chaque teaser avec un appétit que je n’avais pas connu depuis le confinement. Fan inconditionnelle de la réalisatrice de Frances Ha, je n’ai pas immédiatement trouvé cette fébrilité suspecte. Pourtant, c’est devenu une obsession.

Je n’ai jamais été une Barbie girl. Pour tout dire, Barbie m’avait même toujours un peu agacée, et Ken encore plus. Alors, pourquoi ? Bien sûr, la campagne promotionnelle est un teasing de haut vol. Le film réunit deux des stars les plus sexy et décontractées de la décennie, Margot Robbie et Ryan Gosling (même si ce dernier a subi une

campagne de dénigrement improbable sous le hashtag NotMyKen). Mais cela ne suffit pas. En quelques semaines, j’ai réalisé que nous étions nombreux à piétiner en guettant des nouvelles du film. Lorsque mon papy footeux de 94 ans m’a demandé avec curiosité si je l’avais vu, lui qui n’a jamais joué à la Barbie et connaît encore moins Greta Gerwig, j’ai compris que le phénomène dépassait totalement ma tendance adolescente à l’idolâtrie. Nous avons tous collectivement besoin du film Barbie. Aller le voir est devenu une perspective d’aventure collective festive, comme si le film pouvait nous sauver, nous sauver de nousmêmes, des débats idéologiques dans lesquels on est empêtrés. Car Barbie (que nous n’avons pas pu voir au moment de préparer ce numéro) s’annonce comme un blockbuster post-MeToo féministe et follement ludique, un grand bol d’air rose dans un climat général pesant. Quel que soit notre âge, qu’on aime Barbie ou qu’on la déteste, on a envie de la suivre, en Crocs, en talons hauts, en patins à roulettes jaune fluo…
Greta Gerwig semble réveiller l’ADN de Barbie, un brin sulfureux et furieusement moderne, ensuite éclipsé par les débats sur sa silhouette, sa blondeur et son hypersexualisation. En 1959, Barbie était une révolution, une poupée qui disait aux petites filles qu’il y avait d’autres destins que la maternité, qu’elles pouvaient être cosmonautes, chirurgiennes, profs de gym ou présidentes. Le film Barbie est un objet de désir collectif, car il incarne, comme Le Magicien d’Oz avant lui, une espérance dans un futur joyeux, dans lequel de méchants bonshommes ne parviendront pas à faire rentrer Barbie dans sa boîte.

Barbie de Greta Gerwig, Warner Bros. (1 h 54), sortie le 19 juillet
POURVOTRE
À chaque jour ou presque, sa bonne action cinéphile. Grâce à nos conseils, enjolivez le quotidien de ces personnes qui font de votre vie un vrai film (à sketchs).
COUSIN, qui a un coup
VOSDEUX

POTES, avec qui vous partezau e
VOTRE MÈRE,
an cienne


caissière d
Avant, il avait une tonne d’idées. Maintenant, il s’avachit et parle avec un ton languissant – ce qui fait un peu flipper ses parents, qui vous appellent à la rescousse. (R)éveillez son intérêt avec le roman graphique Tati et le film sans fin, qui rend un hommage coloré et joyeux à l’univers rocambolesque de Jacques Tati (Jour de fête, 1949 ; Mon oncle, 1958). Un cinéaste qui, tout en faisant mine de réaliser de gentilles comédies innocentes, avait toujours des observations lucides sur la société.
Tati et le film sans fin d’Olivier Supiot et Arnaud Le Gouëfflec (Glénat, 136 p., 22 € 50)


Deux ans que vous préparez ce voyage. Il vous manque juste une chose : une séance ciné spéciale Mexique. En film d’ouverture, on vous propose Trois amigos ! (1987), un pastiche savoureux de John Landis (Les Blues Brothers) dans lequel un couple de Mexicains du début du xxe siècle découvre un western muet porté par trois cowboys, auxquels ils font appel pour sauver leur village, sous la coupe d’un dangereux bandit. Ça va vous laisser sans voix.
Trois amigos ! de John Landis, en Blu-ray (Carlotta, 15 €)
Vous connaissez peu cette période de la vie de votre mère, qui semble nostalgique de ces après-midi passées derrière le guichet à discuter cinéma avec des inconnus. Le beau livre de Jean-François Chaput devrait lui donner envie de se raconter. Entre 1982 et 1992, ce photographe français a capturé des cinémas parisiens (Le Far-West, L’Eden…) qui, pour beaucoup, n’existent plus – il a aussi rencontré des caissières, des ouvreuses, des projectionnistes… et en a tiré de sacrés témoignages.

En bref no 199 – été 2023 JOSÉPHINE LEROY À offrir
LILY BLOOM
UNE BARBIE NOMMÉE DÉSIR 06
© 2022 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved Émopitch
Paris cinés. 1982-1992, des cinémas disparaissent de Jean-François Chaput (Snoeck, 264 p., 35 €)
deblues
BARBIE DE GRETA GERWIG (SORTIE LE 19 JUILLET) : BARBIE (MARGOT ROBBIE) QUITTE L’UNIVERS PARFAIT DE BARBIELAND POUR PARTIR À LA DÉCOUVERTE DU MONDE RÉEL, ACCOMPAGNÉE DE KEN (RYAN GOSLING).
Petit écran SÉRIE
Cette captivante fiction belge revient sur les « tueries du Brabant », soit divers crimes qui ont fait vingt-huit morts il y a quarante ans en Belgique. À l’enquête policière, la série préfère la fresque politique et intime, explorant avec délicatesse les meurtrissures de trois jeunes pour révéler celles d’un pays entier.

C’est un épisode historique passé un peu sous les radars en France. Entre 1982 et 1985, une série d’attaques violentes a plongé la Belgique dans la peur et le deuil. Ces crimes et braquages, surnommés « tueries du Brabant », ont laissé derrière eux vingt-huit morts, une quarantaine de blessés et un épais mystère, les coupables n’ayant jamais été retrouvés. Ils servent de toile de fond et de catalyseur à la série 1985, grosse production du Plat Pays diffusée sur Canal+. Mais il ne s’agit pas là d’une enquête policière, encore moins d’un documentaire. Pour aborder un sujet toujours brûlant (la justice s’affairait encore en janvier dernier autour d’une nouvelle piste), le scénariste Willem Wallyn passe par le prisme de trois personnages fictifs : Vicky, jeune rebelle, animatrice sur une radio pirate ; son frère, Franky, taiseux mal dans sa peau, et son meilleur ami, Marc. Les deux garçons intègrent la gendarmerie tandis que Vicky se lance dans des études de droit. Très vite, Marc et Franky découvrent que les forces de l’ordre sont surtout celles du désordre, gangrenées par la corruption et les affaires louches. Vicky, elle, suit des idéaux de gauche et se retrouve en manifestation de l’autre côté de la barrière, face à son frère et à son ami… 1985 se fait à la fois fresque sociale et politique, suivant les soubresauts d’une Belgique très proche de nous, et portrait intime d’une génération en proie au doute. « Tu trouves aussi que tout part en couilles ? Comme si tu n’avais aucune emprise sur rien ? » demande Franky à Marc dans une scène magnifique, à la résonance terriblement actuelle. C’est lorsqu’elle montre la jeunesse et ses illusions qui s’effritent à l’épreuve de la réalité que la série donne son meilleur.

“
L’OBS
En bref été 2023 – no 199 CRÉDITS NON CONTRACTUELS. © 2022 MICKEY AND MINA LLC. TOUS DROITS RÉSERVÉS. LE 16 AOÛT AU CINÉMA ★★★★★
“UN FILM BRILLANT”
THE GUARDIAN
“ SYDNEY SWEENEY : ÉPOUSTOUFLANTE”
LA FORME, LE FOND : TOUT EST CAPTIVANT ”
LE FILM
SCÉNARISTE N’AURAIT PU INVENTER ” SO FILM 07
BARALON sur Canal+
CINEMATEASER “
QU’AUCUN
MARGAUX
1985
Flash-back
WALL-E
Quinze ans après sa sortie, le prophétique film de sciencefiction de Pixar fascine toujours. À commencer par Pascale Ferran, qui a souvent déclaré dans la presse qu’il s’agissait de son film préféré des années 2000. La cinéaste, qui a coécrit le film d’animation La Tortue rouge en 2016, nous parle de son amour pour Wall-E.
Sorti en France le 30 juillet 2008, Wall-E connut, en matière d’entrées, un succès inférieur à celui du précédent Pixar, Ratatouille, mais l’ampleur créative du film d’Andrew Stanton, dans lequel un petit robot nettoyeur est le dernier individu présent sur Terre sept cents ans après que l’humanité a déserté la planète, frappa les esprits. Ce droïde solitaire, qui a développé une personnalité sensible, voit débouler une « robote », EVE, dont il tombe amoureux, au point de la suivre dans l’espace. « Wall-E est un joyau esthétique à la mise en scène sidérante », témoigne
Règle de trois Un film dans lequel vous pourriez passer 3 jours ?
Mon voisin Totoro de Hayao Miyazaki (1988). Avec mes enfants, je le regarde en boucle en ce moment. Il y a quelque chose de très doux dans ce film, qui est très attirant. J’adorerais pouvoir me balader dans cette forêt.

3 cinéastes pour qui vous pourriez
Pascale Ferran. « Je suis fascinée par la puissance d’incarnation des personnages de ce monde en ruine après une apocalypse écologique. Le film était très visionnaire, à la fois au sujet des questions climatiques et de cette inversion des polarités qui fait que celui en qui il y a les dernières traces d’humanité active est Wall-E, ce robot fonctionnant à l’énergie solaire, tandis que les humains constituent de leur côté une peuplade apathique de gens qui n’ont plus de corps et vivent dans un paradis artificiel à se gaver d’images sur des écrans, et de confiseries. » L’aspect politique de ce récit d’anticipation n’est plus à démontrer. Mais, pour la cinéaste, la beauté de cette œuvre d’animation vient aussi de sa façon de s’inscrire dans l’histoire du cinéma. « Le film relie des temps artistiques différents. Il traite du futur de l’humanité avec les techniques les plus avant-gardistes de son époque, mais il convoque des émotions héritées du cinéma muet. Tout cela produit sur moi une vraie déflagration émotionnelle. » Une déflagration qui fait désormais écho à l’urgence climatique, et qui n’a pas fini de nous toucher.
DAMIEN LEBLANC
Illustration : Sun Bai pour TROISCOULEURS
Le musicien electro autodidacte, qui a explosé il y a dix ans avec l’EP Bye Bye Macadam, vient de dévoiler L(oo)ping, album best of mêlant sonorités symphoniques et électroniques, enregistré avec des musiciens de l’Orchestre national de Lyon. Rone, qui a d’abord étudié le ciné à la Sorbonne Nouvelle, s’est prêté au jeu de notre questionnaire cinéphile.
Michel Gondry, un réalisateur que j’adore. Il a commencé en réalisant des clips, mais son passage au format long avec Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) est une réussite dingue. On a travaillé ensemble sur la pochette de mon 5e album, Mirapolis (2017), mais ça serait un rêve de faire de la musique sur ses images. Sofia Coppola, parce que la musique occupe une place très importante dans ses films, et c’est très inspirant pour un musicien. Et Lukas Dhont. J’ai découvert Girl (2018) par hasard en me trompant de salle, et je me suis pris une grosse claque.

Vos 3 B.O. préférées ?
Celle d’Ascenseur pour l’échafaud de Louis Malle (1958), composée par Miles Davis en une nuit, devant le film qui était projeté dans une salle de cinéma. C’est fou que ça se soit cristallisé dans le temps comme ça. Pour moi, c’est presque un modèle, cette manière de travailler : visionner des images et se laisser porter. Sinon, la bande originale de Jóhann Jóhannsson pour Premier contact de Denis Villeneuve (2016), avec son mélange passionnant de textures organique et électronique. Et puis, bien sûr, Ennio Morricone, et en particulier celle du film Mon nom est Personne de Tonino Valerii (1973). L’exemple parfait du génie de ce compositeur : des musiques hyper accessibles, mais aussi très profondes, à la fois angoissantes et drôles.
En bref 08 no 199 – été 2023
composer sans négocier ?
PROPOS RECUEILLIS PAR CHLOÉ BLANCKAERT
RONE
L(oo)ping de Rone (InFiné)
© Cha Gonzalez
Ça ne m’est jamais arrivé, mais, après un concert, je suis généralement un peu vidé donc un film facile, marrant, devant lequel je pourrais m’endormir. Comme Monty Python. Le sens de la vie de Terry Jones et Terry Gilliam (1983).
3



Jean Cocteau : j’adore sa philosophie, sa manière de parler de l’art et de la vie. Agnès Varda ensuite : je la trouve très sympathique, et ça serait très tentant d’échanger avec elle. Et puis, bien sûr, Stanley Kubrick, pour prendre une grande leçon du maestro. C’est dingue le nombre de chefs-d’œuvre qu’il a faits. Je l’interrogerais directement sur ses choix de musiques, comme il a beaucoup utilisé de morceaux déjà existants ou alors de musiques classiques comme dans 2001 : l’odyssée de l’espace (1968). Je lui demanderais aussi avec quels compositeurs d’aujourd’hui il aurait envie de travailler.
3 films pour trouver l’inspiration ?

Des films que j’ai vus enfant et adolescent. Dreams d’Akira Kurosawa (1990). Un film très particulier entre rêve et cauchemar, avec des petites saynètes et beaucoup de choses étranges, qui laissent songeur. Tous les matins du monde d’Alain Corneau (1991). Un bon détonateur pour moi, qui en dit beaucoup sur le pouvoir que peut avoir la musique pour aider à vivre, avec cette rencontre de deux musiciens d’univers différents. Et puis À bout de souffle de Jean-Luc Godard (1960) pour son côté complètement libre.
3 personnages de films qui vous ressemblent ?
Harry Potter peut-être. Je ne peux pas y échapper ; c’est à cause de mes lunettes rondes. On me dit souvent que j’ai aussi un côté Monsieur Hulot, le personnage créé et interprété par Jacques Tati. Ou Charlie Chaplin, pour le côté burlesque. Ça doit être parce que je manque d’équilibre.
En bref 09 été 2023 – no 199 REZO PRODUCTIONS PRÉSENTE TROPIC UN FILM DE EDOUARD SALIER AVEC PABLO COBO LOUIS PERES MARTA NIETO MUSIQUE ORIGINALE SEBASTIAN PHOTO FRANÇOIS PEYRANNE. CONCEPTION MIDNIGHT MARAUDER & ES LE 2 AOÛT AU CINÉMA scénario MAURICIO CARRASCO adaptation dialogues MAURICIO CARRASCO et EDOUARD SALIER avec MARVIN DUBART ALANE DELHAYE VICTOR ROBERT directeur de la photographie MATHIEU PLAINFOSSÉ décors PASCAL LE GUELLEC son THOMAS GASTINEL SÉVERIN FAVRIAU ÉMELINE ALDEGUER STÉPHANE THIÉBAUT premier assistant réalisation ALEXIS CHELLI direction de production FRANÇOIS LAMOTTE montage JULIEN PERRIN costumes ELISE BOUQUET et REEM KUZAYLI casting FLORIE CARBONNE et MARLÈNE SEROUR production JEAN-MICHEL REY et NINON CHAPUIS une production REZO PRODUCTIONS en coproduction avec DIGITAL DISTRICT GAUTAMA PICTANOVO BNP PARIBAS PICTURES avec le soutien du CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L’IMAGE ANIMÉE de PICTANOVO avec le soutien de LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE et en partenariat avec LE CNC de LA RÉGION GRAND EST et de MULHOUSE ALSACE AGGLOMÉRATION (RÉSEAU PLATO) en partenariat avec LE CENTRE DU CINÉMA ET DE L’IMAGE ANIMÉE en collaboration avec LE BUREAU D’ACCUEIL DES TOURNAGES / AGENCE CULTURELLE GRAND EST et LA MISSION CINÉMA DE MULHOUSE ALSACE AGGLOMÉRATION ’EMERGENCE de LA PROCIREP de L’ANGOA de LA SACEM en association avec CINÉCAP 5 avec le soutien de CANAL+ CINÉ+ avec la participation de PULSAR CONTENT REZO FILMS distribution REZO FILMS
Matt Reeves
"Unfilmenvoûtant etbouleversantquiemprunte magnifiquementaugenre."
cinéastes, vivants ou morts, avec qui vous rêveriez d’échanger ?
Le film à regarder à 3 heures du matin, après un concert ?
Scène culte AFFREUX, SALES ET MÉCHANTS
D’ETTORE SCOLA (1976)
Entassé avec sa famille dans un taudis du bidonville de Monte Ciocci, à Rome, le patriarche Giacinto Mazzatella (Nino Manfredi) passe ses jours à boire et ses nuits à veiller sur son butin – une somme d’un million de lires touchée après avoir perdu un œil dans un accident de travail. L’abominable chefd’œuvre d’Ettore Scola revient en salles, avec sa rage et son amertume intactes.
LA SCÈNE
Giacinto prend la fuite in extremis après s’être fait empoisonner par les siens au cours d’un banquet de baptême –cinq cents grammes de mort-aux-rats dans les maccheroni alla pugliese On le retrouve couché sur une plage de fin du monde, les jambes coincées dans son vélo. Une vague balaie son visage et le réveille. Incapable de se lever, il pédale pathétiquement dans le vide. Dans un dernier réflexe de survie, Giacinto remplit sa pompe à vélo d’eau de mer, l’ingurgite, se frappe le ventre et dégueule son plat de pâtes. Sa vengeance sera (évidemment) terrible.



En bref 10 no 199 – été 2023
L’ANALYSE DE SCÈNE







Affreux, sales et méchants. Mais aussi voleurs, fainéants, avares, envieux, alcooliques, dépravés, violents, violeurs, et, sans trop les pousser, meurtriers. Peint à l’acide par Ettore Scola, ce portrait d’une famille du quart-monde italien est un précipité ricanant, coléreux et jusqu’au-boutiste des vices de l’humanité. Si la séquence du banquet constitue l’acmé de ce jeu de massacre, la scène qui suit, rythmée seulement par le ressac et les régurgitations de Giacinto, est peut-être celle qui résume le mieux le propos du film. Alternant les angles et les échelles de plans, le montage nous fait passer, en quelques minutes, du détachement nauséeux de l’observateur à une implication physique totale. C’est sur nous, spectateurs, que le méchant patriarche vomit (un zoom sidérant s’en assure), et c’est nous qui sommes invités, pour ne pas dire contraints, à vomir avec lui. La merde éclabousse, nous dit Scola, et cette horreur sociale, toute grotesque qu’elle soit, n’est pas un corps étranger, mais la part commune de nos sociétés modernes. En sauvant Giacinto, le réalisateur enfonce son clou nihiliste : dans la misère, le plus insoutenable, c’est qu’elle est increvable.

la jungle
En bref 11 été 2023 – no 199 ANAÏS DEMOUSTIER TOM MERCIER BÉATRICE DALLE PATRIC CHIHA UN FILM DE CHARLOTTE VINCENT ET KATIA KHAZAK PRÉSENTENT le 16 août au cinéma la fête jusqu’au bout de la vie. envoûtant et poétique. télérama labête
dans
MICHAËL PATIN
Affreux, sales et méchants d’Ettore Scola, Carlotta Films (1 h 55), ressortie le 26 juillet
LES NOUVEAUX
En deux courts métrages très doux (Ville éternelle, Bruits de souvenirs), placés sous le signe de la rencontre salvatrice et de la réparation intérieure, la jeune réalisatrice entame une œuvre subtile sur l’altérité.
« J’aime savoir à qui je m’adresse au-delà de l’enveloppe physique », prévient Garance Kim, 27 ans, rire franc et regard comme un uppercut. Faire mentir les apparences, c’est un talent légué par sa mère, assistante sociale et cinéphile vorace, qui lui a fait découvrir la filmo de David Lynch à 5 ans. Ses deux premiers courts, qui explorent la possibilité de « ressentir ensemble, de trouver un langage commun », s’offrent comme des utopies affectives. Chacun y laisse affleurer, sous l’humour, un insatiable besoin de consolation. Dans son roman-photo, Bruits de souvenirs, présenté au festival Côté court de Pantin, Garance Kim traduit en images organiques les sensations sonores d’un jeune homme avant qu’il devienne aveugle ; dans

Max Max Max Max St St St St St
Ville éternelle, coécrit avec son complice Martin Jauvat, se dessinent les retrouvailles miraculeuses de deux ex-camarades de lycée à un arrêt de bus. Comme l’héroïne qu’elle campe dans ce road movie urbain, Garance Kim a la bougeotte. Cette randonneuse assidue ( « Marcher, c’est découvrir des tranches de vie, s’ancrer. C’est une autre temporalité, où tu as le temps de penser ») est toujours en partance. Débarquée en licence de cinéma à Paris-I puis à Paris-VIII, elle enchaîne vite par des stages en tant qu’assistante réalisatrice. Aujourd’hui, elle sillonne le 93 grâce aux associations Côté court et Cinémas 93 pour présenter ses films dans des centres scolaires, la transmission chevillée au corps. Avant de tourner, à la rentrée, un court métrage coécrit avec Théo Costa-Marini, sur un couple qui rompt en plein week-end familial : « On veut questionner ce moment où l’on prend conscience que les parents ne sont pas que des parents, ont une vie intime. Et comment ce qu’ils t’ont inculqué façonne ta vie personnelle par des schémas. »
Pas très à l’aise à l’idée d’être pris en photo, Maxence Stamatiadis nous a envoyé cet autoportrait. Au ChampsÉlysées Film Festival en juin, il présentait Rue Philippe Ferrières, un moyen métrage fort, dans lequel il use justement d’avatars pour accompagner la parole autour des violences policières.
On rejoint Maxence un matin, et il angoisse un peu. Le soir même, des proches de Philippe Ferrières, mort en 2019 à Drancy après une clé d’étranglement pratiquée par un policier, seront présents à la projection de son film. Utiliser des avatars de style anime pour incarner leur récit tragique aurait pu virer au décalage indécent. Mais, au contraire, leurs voix s’articulent avec densité, trouvent ici une caisse de résonance, comme si ces masques rudimentaires permettaient de saisir ce qui sourd de leurs silences. « J’ai pensé à ces ados qui se créent des bonshommes sur l’appli Gacha Life. Beaucoup s’en
En bref 12 no 199 – été 2023
LÉA ANDRÉ-SARREAU
2 1
Photographie : Julien Liénard pour TROISCOULEURS
ence ence ence ence tamatiadis tamatiadis tamatiadis tamatiadis tamatiadis
servent pour exprimer la violence scolaire, comme un moyen de raconter l’inexprimable. » Dans ce jeu trouble sur l’incarnation, Philippe Ferrières est le seul dont on peut identifier le visage. Le cinéaste lutte contre l’effacement posthume, en évitant l’héroïsation aveugle. « Le cinéma, pour moi, permet de convoquer les disparus. » Le deuil était déjà au centre d’Au jour d’aujourd’hui, un long de science-fiction lo-fi et déviante dans lequel il reprenait les rushs amassés sur ses grands-parents, chez qui plus jeune il passait tous ses week-ends face à une route nationale entre Pantin et Bondy. Après la mort de son grand-père, et avec la complicité de sa grand-mère, il imaginait qu’une I.A. ayant mal digéré les écrits nihilistes du défunt permettait sa résurrection en tueur sanguinaire.

« Ma grand-mère, c’est la star de tous mes films. La manière que j’ai de jouer avec le réel me vient d’elle : quand elle parle, elle est en roue libre. » C’est ce qu’il y a de plus émouvant dans le cinéma de Maxence Stamatiadis : composer avec l’imaginaire de celles et ceux qu’il filme en l’investissant d’une technologie pleine de fulgurances, de bugs et d’étrangeté.

 QUENTIN GROSSET
QUENTIN GROSSET
En bref 13 été 2023 – no 199
Tout doux liste
MAGIC! [FILM]
Qui voudrait vivre dans un monde sans magie ? Certainement pas Maxie, 10 ans, déterminée à aider une fée égarée à retrouver le chemin de son monde, dans cette drôle de fable en 3D, colorée et inventive. • CHLOÉ
BLANCKAERT
Magic! de Caroline Origer (KMBO, 1 h 29), sortie le 2 août, dès 3 ans
L’interview de…
Aïe, Elias a cassé la tablette de ses parents ! Mais son animal de compagnie est là pour l’aider à échapper à une punition terrible. Miléna, Anselmo et Gaïa, en classe de CM1, ont rencontré Titiou Lecoq, l’autrice de cette histoire. Bien connue pour ses essais féministes, elle a concocté pour les enfants un manuel bien plus drôle que les devoirs de vacances : Comment apprendre à manipuler ses parents en 1 semaine !
Miléna : Qu’est-ce qui t’a donné l’idée d’écrire ce livre ?
Ma vocation est née à 8 ans : je voulais écrire des histoires pour des enfants de mon âge. Et puis je suis devenue adulte, et j’ai écrit des livres pour les adultes. Quand j’ai eu des enfants, je me suis rappelé que mon idée de départ était d’écrire pour eux.
Titiou LecoQ
LES AS DE LA JUNGLE 2. OPÉRATION TOUR DU MONDE [FILM]
Dignes héritiers des personnages de Madagascar ou de L’Âge de glace, les As embarquent pour une nouvelle aventure en 3D pleine d’humour et de rebondissements, avec comme objectif la préservation de la forêt. • C. B.


Les As de la jungle 2. Opération tour du monde de Laurent Bru, Yannick Moulin et Benoit Somville (SND, 1 h 28), sortie le 16 août, dès 6 ans
Anselmo : Pourquoi faut-il apprendre à manipuler ses parents ?
Il faut comprendre leur manière de fonctionner pour que ça se passe mieux à la maison. Parfois, les parents sont bizarres. Par exemple, ils envoient leur enfant au lit sous prétexte qu’il a l’air fatigué, alors qu’eux n’arrêtent pas de dire qu’ils sont exténués, mais ils ne se couchent pas tôt !
A. : De qui t’es-tu inspirée pour raconter cette histoire ?
De moi, en tant que parent, mais j’ai aussi pensé à moi, petite fille, et au sentiment d’injustice que j’éprouvais parfois. Dans
mon livre, il n’y a pas que des blagues ; je souhaitais aussi que l’on ressente quelque chose de plus profond.
Gaïa : Ce que tu as écrit, tu voulais le dire à tes parents ?
Oui, mais je n’ai pas osé.
A. : Pourquoi les parents étaient-ils plus sévères avant ?
Ma mère n’avait même pas besoin d’être sévère : elle faisait une tête qui me tétanisait et me culpabilisait instantanément.
A. : Alors tu te tenais à carreau ? Oui ; et pour ne pas éprouver cette sensation horrible de culpabilité, petite, je faisais très peu, voire pas assez, de bêtises !
A. : Et tes enfants, ils te manipulent ? Ils sont assez forts ! Quand on est parent, on peut être très en colère contre ses enfants et se calmer d’un coup en les regardant faire « leur petite tête ».
A. : Est-ce que Chattemoche existe ? À votre avis ?
G. : Oui, elle existe dans le livre. Jolie réponse ! Au départ, le personnage s’appelait Chatmoche, mais il y avait trop de garçons dans mon histoire. Dans les dessins
La critique de Célestin, 9 ans et demi
Rien n’arrêtera Daisy, adorable quokka bien décidée à devenir terrifiante pour remporter la Coupe du monde de la peur, dans ce conte d’aventures animé célébrant la ténacité et l’individualité. • C. B.
Le Rêve de Daisy de Ricard Cussó (Alba Films, 1 h 28), sortie le 30 août, dès 6 ans


Et toujours chez mk2
SÉANCES BOUT’CHOU ET JUNIOR [CINÉMA]
Des séances d’une durée adaptée, avec un volume sonore faible et sans pub, pour les enfants de 2 à 4 ans (Bout’Chou) et à partir de 5 ans (Junior).

samedis et dimanches matin dans les salles mk2, toute la programmation sur mk2.com
DÉTECTIVECONAN.
LE SOUS-MARIN NOIR
animés Disney, le personnage rigolo qui accompagne le héros ou l’héroïne est toujours masculin ; j’avais envie de faire l’inverse.

M. : Pourquoi Elias, le petit garçon, comprend Chattemoche et pas ses parents ?
Ils ont un lien particulier, ils ont grandi ensemble – même si elle grandit beaucoup plus vite que lui et considère qu’il est un peu lent.
A. : Qu’est-ce que tu aimes dans ton métier d’autrice ?
Déjà, je me lève quand je veux. Ensuite, je peux travailler de chez moi en pyjama. Et surtout inventer des histoires ! Petite, c’est ce que je faisais avec mes amies dans la cour.
A. : Aimerais-tu remonter le temps et redevenir enfant ?
Non, et encore moins adolescente. Je fais le travail dont je rêvais à 8 ans : c’est mieux de vivre cette vie que de la rêver.
Comment apprendre à manipuler ses parents en 1 semaine ! de Titiou Lecoq, (Nathan, 96 p., 9,95 €), dès 9 ans
PROPOS RECUEILLIS PAR MILÉNA ANSELMO ET GAÏA (AVEC CÉCILE ROSEVAIGUE)
Photographie : Ines Ferhat pour TROISCOULEURS
« Conan est un adulte qui a été en secret rétréci à cause d’une pilule et qui est donc devenu un enfant détective. Il y a des inconvénients à être un enfant détective. Par exemple, si un tueur en série se cache dans une salle qui projette un film interdit aux moins de 18 ans, l’enfant détective ne peut pas rentrer. Mais il y a plus d’avantages. Un enfant est plus fin qu’un adulte, donc il peut rentrer dans des petits tuyaux pour poursuivre les méchants. Tu peux aussi très bien cacher ton identité, parce que les grands ne te croient jamais. Ce que j’adore aussi, c’est que le héros a plein d’idées !
Il n’est pas comme un grand
qui dirait : “Bon, on va choper les méchants.” Lui, il ne gagne pas par la force de frappe, il fait des plans ! Le seul truc que j’aime pas dans le film, c’est que Conan est amoureux de sa copine, qui connaît son secret. J’aime pas les histoires d’amour au cinéma, ça me gêne. C’est un moment juste pour eux deux, c’est un truc d’intimité et je devrais pas voir ça. »
Détective Conan. Le sous-marin noir de Yuzuru Tachikawa, Eurozoom (1 h 49), sortie le 2 août, dès 8 ans
PROPOS RECUEILLIS
PAR JULIEN DUPUY
14 no 199 – été 2023 En bref > La page des enfants
LE RÊVE DE DAISY [FILM]
SORTIE LE 2 AOÛT
Detective
© 2023 Gōshō Aoyama /
Conan Production Committee
LE 26 JUILLET AU CINÉMA























































































Les lumières dans tous les sens, les silhouettes qui ondulent autour de soi, la musique jusqu’au ras de la tête… Le club est peut-être le lieu le plus cinématographique qui soit. Pourtant, jamais avant La Bête dans la jungle de Patric Chiha, découvert à la Berlinale en février, on y avait plongé si radicalement, pendant tout un film. Comme dans une vraie fête, quand le temps s’arrête.
À Berlin, on découvrait aussi After d’Anthony Lapia, beau premier long qui se déroule pour moitié dans un club techno, et les deux films nous ont autant galvanisés que nos soirées depuis le déconfinement. On saisit l’occasion de ce numéro estival et de la sortie du film de Patric Chiha, le 16 août, pour consacrer un dossier à la fête, cet endroit de liberté et de lâcher-prise qui sait aussi se faire politique.




DOSSIER COORDONNÉ PAR TIMÉ ZOPPÉ
Photographie : Cha Gonzalez pour TROISCOULEURS
PATRIC CHIHA

Dans Domaine (2010), Patric Chiha filmait déjà des scènes de club spleenétiques et sensuelles. Son nouveau film, La Bête dans la jungle, se passe entièrement en boîte de nuit, de 1979 à 2004. May et John (Anaïs Demoustier et Tom Mercier) regardent les gens danser et les époques filer, attendant un événement mystérieux. On a donné rendez-vous au cinéaste autrichien dans une soirée queer à La Station – Gare des Mines pour l’interviewer au milieu de la frénésie techno.
En boîte de nuit, May et John attendent quelque chose de plus grand qu’eux. Cette position d’être aux aguets, d’espérer la fulgurance, ce ne serait pas aussi la tienne en tant que cinéaste ?
Si le désir de réaliser un film à partir de la nouvelle de Henry James [La Bête dans la jungle, 1903, ndlr] m’est tombé dessus, c’est aussi parce que ce texte me parle de cinéma. Évidemment, j’ai pensé à nous, cinéastes, spectateurs, qui attendons quelque chose sur grand écran qui nous dépasserait, nous montrerait la vie autrement, nous permettrait d’atteindre un absolu. Bizarrement, moi-même, en tant que cinéaste, de film en film, j’ai l’impression d’être devenu de plus en plus spectateur. Je suis « aux aguets », comme c’est dit dans le roman, je fais attention aux surprises, à tout ce qui transcende le programme.
Il y a quelque chose d’absurde, au sens existentiel, dans cette attente sans objet. Je crois que c’est lié à une certaine littérature, qui m’a occupé, autrichienne, d’Europe de l’Est. La Bête dans la jungle a très peu à voir avec Thomas Bernhard [écrivain autrichien,
auteur de Béton ou Le Naufragé, ndlr], mais c’était l’un des écrivains les plus importants pour moi quand j’étais jeune. Dans une interview, il dit, je crois : « Si je vois de loin, derrière une colline, apparaître le contour d’une histoire, je l’abats. » Je suppose que cette façon de raconter, avec des scénarios très minimaux, en essayant de saisir des états un peu bruts, je l’ai apprise de lui.
Dans la nouvelle, May et John se rencontrent dans une grande propriété nommée Weatherend. Ici, ils se rencontrent dans La Boîte sans nom. Ne pas nommer, j’ai l’impression que c’est essentiel dans ton désir de cinéma.
Mon désir d’images vient du fait d’observer quelqu’un, un état, une relation, une situation, que je ne peux réduire à des mots. Le cinéma ne serait-il pas une autre manière d’éprouver, de comprendre le monde ? Parfois les critiques, le public, s’énervent en se demandant : « Mais qu’est-ce qu’il a voulu dire ? » Je le dis très sincèrement : je ne sais pas. Ça n’exclut pas que les films nous disent quelque chose. Quand je tombe sur quelque chose de mystérieux, de rugueux,


j’ai le sentiment qu’avec la caméra je peux tourner autour.
Tu penses que l’attente que vivent May et John est partagée par beaucoup de clubbeurs ?
La Bête dans la jungle est une nouvelle qui me préoccupe depuis une dizaine d’années. J’ai longtemps réfléchi à ce que je pouvais en faire. L’idée du club s’est imposée – j’ai compris que c’était l’un des espaces où nous pouvions expérimenter ce que vivent John et May. L’espoir de vivre plus, corrélé à ce sentiment de perte, de tristesse du temps perdu. Dans les grandes soirées que j’ai pu vivre en club, j’ai souvent atteint cette extase très forte avant que la mélancolie s’ensuive. Qu’a été ce temps ? C’est comme si on n’arrivait pas à l’attraper.
Pour le philosophe Florian Gaité (Tout à danser s’épuise), la danse en club ou en rave vise un au-delà de la fatigue. Pour lui, nos corps échappent alors au fonctionnalisme de nos sociétés néolibérales. Qu’en penses-tu ? Pour moi, le club a toujours été un lieu politique. J’ai été un jeune gay en club : je sen-
Cinéma
18 no 199 – été 2023 €
tais que j’allais pouvoir vivre ici, sans devoir remplir une fonction ni me conformer à une identité. Un « au-delà de la fatigue », c’est ce que nous cherchons parce qu’en société

bien qu’ils étaient de mauvais modèles… Je suis moi-même allé en boîte très jeune, parce que j’ai toujours été grand, avec une voix grave. On me laissait facilement entrer. Je me
campée par Béatrice Dalle, ndlr]. C’est une personne très importante pour moi. Ma première soirée gay, c’était avec elle. Elle avait dû comprendre qu’au fond c’était tout ce dont je rêvais. La boîte s’appelait l’U4, tout le monde était habillé en noir, c’était plus érotique, sensuel. Pour être sincère, j’ai un souvenir du jeu entre hommes dans les toilettes. C’est là que j’ai pris conscience de l’importance des toilettes dans un club.
C’est-à-dire ?
La scène de club préférée de
PATRIC CHIHA
nous sommes fatigués de devoir produire du discours, de devoir être solides. Mon film représente des gens qui ne produisent rien, qui perdent leur temps. Moi-même, en tant que metteur en scène, je perds du temps sur un plateau – puis quelque chose advient. Je ne dirige pas un film.
Tu te souviens de ta première fois en boîte de nuit ?
J’allais déjà en boîte à travers mes parents. Ils m’ont eu très jeunes, à 18 ans, et ils sortaient beaucoup. Avant de m’endormir, je m’imaginais ce qu’ils allaient vivre. Il y avait déjà ce fantasme : quel est ce lieu où les adultes font des choses secrètes ? Très tôt, j’ai été attiré par cela. Ça embêtait ma mère, elle voyait
souviens de l’Arena, un lieu en bordure de Vienne qui ressemble beaucoup à La Station – ça m’émeut beaucoup quand je sors ici, car j’y retrouve le même béton, la même géographie du son. J’ai fait ma première soirée techno là-bas, vers 1992-1993. La techno existait déjà, mais elle n’était pas arrivée jusqu’à nous. On ne comprenait pas la musique, mais notre corps la comprenait. Le corps a adoré. Je me rappelle : on tournait trop. Cette façon de tournoyer sur nous-mêmes, ça nous semblait beau mais pas harmonieux. J’avais aussi une tante, plus jeune que ma mère, qui m’a sans doute inspiré Domaine [ce premier long de Patric Chiha sorti en 2010 raconte le lien fort entre un jeune de 17 ans et une mathématicienne d’une quarantaine d’années
C’était le lieu du désir. J’ai été pris d’une grande excitation. Il y avait beaucoup de lieux de drague gay à l’extérieur, mais ils étaient toujours cachés. Évidemment la boîte était fermée, mais tout à coup j’entrais dans un monde où le sexe n’était plus caché, c’était même montré !
Dans les boîtes de nuit, on ne se sent pas vieillir. Les lumières effacent nos rides, l’intensité de la musique nous plonge dans un présent perpétuel. Comment as-tu fait pour donner cette impression dans le film ? Je sais ce que je ne voulais pas faire : un film de reconstitution. Beaucoup de films en boîte ont un côté musée Grévin, tout le monde a l’air en cire. Là, ce n’est pas un film historique. Mon espoir, c’est qu’on sente ce temps de l’intérieur. Je savais que je n’allais pas surmaquiller les acteurs pour les vieillir. On joue avec les lumières, les états, la musique. J’adore quand le personnage de May
« Dans D’est de Chantal Akerman, une scène de club me bouleverse. Un thé dansant en Russie filmé en plan large et fixe : une grande salle de danse richement décorée, une chanteuse à gauche, et, au milieu de la piste, des couples qui dansent, dont un déchaîné. La chanteuse est un peu lasse, comme si elle avait chanté toute la nuit. Sommes-nous à minuit ? à midi ? On ne le sait pas. Des talons frappent le sol, des jupes tournent, et les jambes de cet homme si passionné n’arrêtent pas de bondir… et ainsi il dit à sa partenaire tout son amour. Le film date de 1993. La Russie post-Union soviétique, au passé glorieux et à l’avenir incertain, semble s’être perdue dans l’espace et le temps. Reste l’amour. »

« Le club, c'est l’espoir de vivre plus, lié à la tristesse du temps perdu. »
19 été 2023 – no 199
comprend qu’elle a 40 ans. Tout à coup, son corps change, elle n’a plus le même port de tête. L’art que j’aime, c’est celui qui se pose des questions sur le temps. Ici, c’est l’euphorie de la jeunesse perpétuelle, la possibilité d’échapper au temps. Mais le paradoxe, c’est que le seul moment qui ne s’inscrit plus dans le temps, c’est la mort. Et la mort rôde toujours dans les soirées.
ralenti que sur le poids des corps. Je me suis inspiré de la sculpture du Bernin, L’Extase de sainte Thérèse. C’est sans doute pour cela que les personnages ont souvent la bouche entrouverte [l’expression de cette sculpture du xviie siècle a beaucoup été interprétée comme un signe d’extase sexuelle, notamment par le psychanalyste Jacques Lacan, ndlr]. J’adore les gens qui
Il y a toujours un côté frime en boîte de nuit, ce que tu avais bien capté dans ton documentaire Brothers of the Night, dans lequel tu filmais des travailleurs du sexe crâner avec leurs tenues incandescentes… J’ai un grand faible pour les gens qui friment, les menteurs, les gens qui jouent. Je suis très sensible à la fiction dans la vie. Ce sont peutêtre mes documentaires qui m’ont fait aimer absolument les acteurs. Pour La Bête dans la jungle, Anaïs Demoustier et moi avons beaucoup travaillé là-dessus, sur la surexpressivité, voire le surjeu. Anaïs Demoustier est une actrice extraordinaire.


Tu te souviens d’une nuit où, pour toi, le temps s’est arrêté ?
sentiment redéfinit le réel. Tu sais, on me dit souvent : « C’est radical, ton film. » C’est un mot dont je ne sais pas quoi faire. Récemment, une amie, Karine Durance [qui est aussi l’attachée de presse du film, ndlr] m’a dit qu’étymologiquement « radical » voulait dire « retourner à la racine. » Et La Bête dans la jungle a beaucoup à voir avec cette nudité, cette essence du sentiment, hors du temps, hors de l’espace.
La Bête dans la jungle de Patric Chiha, Les Films du Losange (1 h 43), sortie le 16 août
Avec sa grande cape noire, la physio jouée par Béatrice Dalle a justement l’air d’un ange de la mort.
Sur le plateau, on riait beaucoup parce qu’on sentait que ce personnage était un symbole – mais personne ne pouvait dire de quoi ! C’était l’un des seuls costumes qui était déjà là au scénario. C’était très beau de retravailler avec Béatrice Dalle après Domaine. J’aime dans le film comme elle glisse des sourires, une sensualité, une forme de cruauté, une innocence aussi.
Dans les personnes qu’elle laisse entrer dans La Boîte sans nom, impossible de déceler un fil, quelque chose qui les relierait. Ça, c’était très important. Parce qu’elle n’est pas une flic. Béatrice, je lui ai dit : « Tu ne surveilles pas, tu ne refuses pas, tu invites juste les plus tarés. » Les physios, au fond, c’est déjà des DJ. Alors évidemment c’est désagréable de ne pas entrer. Moi, j’ai été beaucoup refoulé. Je l’ai même été d’une boîte gay où ils m’ont dit : « Non, c’est vraiment que les gays ici. » J’ai insisté : « Mais je suis gay ! » Comme les DJ, les physios doivent sentir, créer une atmosphère. Si je réfléchis à l’une de mes plus belles soirées, c’était à Bruxelles, quand j’ai étudié le cinéma à l’INSAS. C’était une période où je sortais énormément. Bruxelles a changé aujourd’hui, mais à l’époque c’était assez pauvre, pas cher. Il y avait une mixité sociale, c’était la grande beauté – c’est difficile à trouver à Paris, où on se ressemble beaucoup dans les clubs. Là, il n’y avait pas de videurs. Personne ne surveillait qui entrait, donc des gens n’allaient pas avec l’endroit, mais se révélaient finalement très surprenants…
Dans tes longs métrages, tu filmes la danse en club en jouant des ralentis. Il y a là l’idée de vouloir retenir ce que la nuit tend à accélérer ?
Ce ne sont jamais des ralentis caméra ! Les rythmes sont ceux des corps. Dans Domaine, les chorégraphies étaient conçues par Gisèle Vienne [metteuse en scène franco-autrichienne, autrice de Kindertotenlieder ou de L’Étang, ndlr]. Et dans Si c’était de l’amour je la filme au travail, pendant les répétitions de sa pièce Crowd [dans laquelle elle recréait l’ambiance des raves des années 1980-1990 en faisant parfois bouger ses danseurs et danseuses de manière très ralentie, ndlr]. Dans La Bête dans la jungle, on a moins travaillé sur le
ne sont pas dans le rythme. Moi, je danse plutôt lentement, trop lentement je trouve. Au fond, on danse pour soi-même. Sur le plateau, ce qu’il y a de plus difficile, c’est de tourner sans la musique qui sera finalement dans le film. Tous les rythmes sont réinventés.
Dans La Bête dans la jungle, il y a presque une sociologie de la fête qui se dessine au travers des looks, des danses qui changent à mesure que les décennies filent.
On a énormément travaillé ça à travers des recherches, des lectures. On ne voulait pas déguiser les acteurs, patiner les murs, mais plutôt croire en certains signes, des mouvements disco, techno, des vêtements colorés, plus sombres. Je ne voulais pas d’une fausse véracité, mais bien incarner le temps. J’ai fait plusieurs cahiers : sur l’évolution des costumes, des poses, de la musique, de la lumière. J’ai une version du scénario uniquement composée d’indications sur la lumière. L’idée était toujours : de quoi nous souvenons-nous ? Que nous reste-t-il de cette année-là ?
On a l’impression que, dans ce passage du temps, on passe de l’éclat, du faste et de la couleur à quelque chose de plus froid, plus blanc et minimaliste.

Je vois bien que j’aime bien travailler sur la disparition. C’est l’idée d’enlever, dans l’espoir qu’à la fin ça se charge d’autre chose.
Tu représentes justement la période du VIH-sida en la figurant par un club désert, entièrement bleu. Comment est née cette image très forte ?
J’ai perdu des amis dans les années 1990.
À l’été 1991, j’étais en stage à Londres. Je rencontrais des hommes. C’était quelques mois avant la mort de Freddie Mercury, en novembre. Un ami à moi est mort en septembre. Je suis parti à Vienne ensuite, et un cinéma projetait Blue de Derek Jarman [sorti en 1993, composé d’un monochrome bleu et d’une série de monologues d’amis de Jarman, qui esquissent son portrait, ndlr] Jarman [qui a été diagnostiqué séropositif en 1986, ndlr] a fait ce film alors que sa vision, qu’il perdait peu à peu, devenait de plus en plus bleue. Ce film m’a beaucoup marqué, il est très lié à ces moments. Pour moi, c’est sûr que cette scène de club devait être bleue, un bleu Klein, pas encore le bleu techno, qui est plus métallique.
Un des sentiments qui transforment la perception du temps, c’est l’amour, c’est de tomber amoureux très fort. Ça transforme aussi l’espace. Les distances ne sont plus les mêmes quand on rentre la nuit avec quelqu’un dont on est amoureux, les chemins ne sont plus ceux qu’on connaît. La temporalité change, tout devient volatile, indéfinissable. C’est incroyable comment le
Merci à La Station – Gare des Mines et à la soirée Spectrum Waves
PROPOS RECUEILLIS PAR QUENTIN GROSSET
Photographie : Cha Gonzalez pour TROISCOULEURS
Anaïs Demoustier (au centre) et Sophie Demeyer (à droite)
1
Tom Mercier et Anaïs Demoustier 2 3
Cinéma > En couverture
« En club, j’adore les gens qui ne sont pas dans le rythme. »
no 199 – été 2023



Lilies films présente un film de Marie AMACHOUKELI Louise Mauroy-Panzani Ilça Moreno Zego Arnaud Rebotini AU CINÉMA LE 30 AOÛT UN SUBLIME DUO D’ACTRICES INCANDESCENT SO FILM LE RÉCIT TENDRE ET DÉCHIRANT D’UN AMOUR INFINI LES INROCKS ABNARA GOMES VARELA FREDY GOMES TAVARES DOMINGOS BORGES ALMEIDA SCÉNARIO MARIE AMACHOUKELI RÉALISATION DE L’ANIMATION MARIE AMACHOUKELI & PIERRE-EMMANUEL LYET CASTING FRANCE CHRISTEL BARAS CASTING CAP-VERT SOLANGE DE CASTRO FERNANDES COACH LAURE ROUSSEL IMAGE INÈS TABARIN MONTAGE SUZANA PEDRO MUSIQUE FANNY MARTIN SON YOLANDE DECARSIN FANNY MARTIN DANIEL SOBRINO UNE PRODUCTION LILIES FILMS AVEC LE SOUTIEN DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L’IMAGE ANIMÉE AVEC LE SOUTIEN DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE AVEC LA PARTICIPATION DE CANAL+ CINÉ+ TV5MONDE EN ASSOCIATION AVEC ARTE COFINOVA 18 ET CINÉCAP 6 AVEC LA PARTICIPATION DE LA PROCIREP PRODUCTION DÉLÉGUÉE BÉNÉDICTE COUVREUR DISTRIBUTION FRANCE PYRAMIDE DISTRIBUTION VENTES INTERNATIONALES PYRAMIDE INTERNATIONAL
Le cinéma a toujours filmé la fête. Peut-être parce qu’il vient de là, des cris des fêtes foraines et de la musique des bals populaires. De la danse serpentine de Loïe Fuller captée par les opérateurs Lumière jusqu’au voguing furieux du Climax de Gaspar Noé en passant par les boîtes de jazz clandestines du Hollywood de la prohibition, les corps, la danse, la transe, la musique et tout ce que peut cacher la nuit traversent l’histoire du cinéma.
Art forain, le cinéma a très tôt trouvé dans la fête un moyen de filmer du spectacle. Des corps qui dansent, qui s’enivrent et s’amusent, voilà le sujet de quelques vues Lumière. La virtuosité des danseuses de cabaret qui font tourner leurs robes, quelques instants d’un bal populaire en Espagne, une farandole dans une fête paysanne, tout est prétexte à simplement filmer la fête pour ce qu’elle est, le rapprochement joyeux des corps. Même chose de l’autre côté de l’Atlan tique avec Edison qui, lui, n’hésite pas à mettre en scène ces rapprochements dans des petits films où les danseurs s’enlacent et finissent même par se bécoter. Quelques secondes de fête dont la fiction va ensuite allégrement s’emparer. Le bal, la boîte et bien plus tard le club deviennent des lieux où spectacle et récit cohabitent dans une longue tradition de films de fêtards – des personnages lambda que la nuit soudain révèle.

SOUS LES PROJECTEURS
Studio 54 de Mark Christopher (1999)

© D. R.
La Fièvre du samedi soir de John Badham (1978)
© D. R.
Paris is Burning de Jennie Livingstone (1991)
© D. R.
Millenium Mambo de Hou Hsiao-hsien (2001)
© D. R.
The Rocky Horror Picture Show de Jim Sharman (1976)
© D. R.
La Boum de Claude Pinoteau (1980)

© D. R.
La scène de club préférée de
ROBIN CAMPILLO réalisateur
« Dans Twin Peaks. Fire Walk With Me (1992) de David Lynch, Laura Palmer emmène son amie Donna dans un bar assez grotesque, avec des cow-boys et des jeunes femmes à moitié dénudées. La scène rappelle cette impression d’être sonnés dans une fête, mais à un degré cauchemardesque. On est à la limite de l’hypnose, il y a cette musique dans les graves et ces voix très lointaines. Laura observe sa copine, qui est droguée et commence à être abusée par un homme. Il y a à la fois quelque chose de terrifiant et de l’ordre du fantastique. On est dans l’esprit de Laura qui essaye d’échapper à son quotidien et entre dans un autre cauchemar. »
Ainsi, Tony Manero, jeune immigré italoaméricain paumé, vit en 1978 La Fièvre du samedi soir et se transforme en légende du disco au déhanchement cultissime. Un rôle physique qui révèle John Travolta en pur corps de cinéma, comme plus tard Kevin Bacon et les soirées rock clandestines de Footloose (1984) ou, de manière burlesque, Will Ferrell dans Une nuit au Roxbury (1999). Pour ces personnages, la fête devient un

lieu d’accomplissement de soi, une façon de se mettre en scène, d’occuper enfin la place. Rituel de passage dans le cinéma pour ado ( La Boum, SuperGrave ), la soirée incarne quelque chose de la vie en mieux. Elle est un moment décisif pour devenir soi. Comme pour le personnage de Margot Robbie s’enivrant des folies de la soirée dans la longue scène d’ouverture de Babylon de Damien Chazelle, la fête est un moyen d’exister. C’est la it girl des années 1920, Clara Bow, dont Chazelle s’inspire ici ouvertement, qui donne le ton à Hollywood. Par exemple, dans Les Endiablées (1931), elle incarne sous la caméra de Dorothy Arzner une étudiante provocante qui préfère la fête aux études. Un an avant, dans Les Nouvelles Vierges, c’était Joan Crawford qui se faisait un nom en jouant une jeune femme libre, qui s’épanouit dans la danse et l’alcool. Il y a aussi cette héroïne du Lit d’Or de Cecil B. DeMille (1925) qui, bien qu’au bord de la banqueroute, décide d’organiser un immense bal dans lequel les convives, habillés de sucre, finissent, enivrés, par se manger. Des films muets ou tout juste parlants qui célèbrent, à grand renfort de champagne et de swing, l’art de la fête dantesque, moralement discutable, mais qui touchent au cœur de la vie. Si la
censure contraint ce cinéma à Hollywood à partir des années 1930, la sensualité et la vitalité de la fête reviendront sur les écrans avec la Nouvelle Vague, ce cinéma de chair. Brigitte Bardot suant sur les rythmes cubains d’ Et Dieu… créa la femme (1956), Anna Karina qui danse un rock seule dans un bar dans Vivre sa vie (1962), et plus tard le déhanchement so eighties de Pascale Ogier sur les sons synthétiques d’Elli et Jacno dans la longue scène de soirée des Nuits de la pleine lune (1984), sont autant de moments de cinéma inoubliables au cours desquels la fête libère les corps.
Paradoxalement, cette sensualité crée aussi une tension. Comme si, par l’énergie des corps, la boîte de nuit ou la soirée devenait un espace incontrôlable. Si Abdellatif Kechiche avec son Mektoub My Love. Intermezzo (2019, inédit en salles) pousse le procédé de manière littérale, transformant le film en une interminable litanie harassante et assourdissante, Gaspar Noé, dans Climax (2018), tend vers le film d’horreur. Les corps élastiques, qui virevoltent, s’emboîtent et se chevauchent sur les volutes electro de Marc Cerrone, basculent dans une transe monstrueuse, jusqu’à la folie. La boîte de nuit ouvre la porte du cinéma de genre par une décharge de violence.
Cinéma > En couverture
22 no 199 – été 2023 1 1 2 2 3 4 5 6
Film d’horreur donc, mais aussi home invasion dans Eastern Boys de Robin Campillo (2013), dans lequel un homme assiste au saccage de son appartement par une foule qui débarque chez lui lors d’une fête clandestine ; film catastrophe avec Projet X (2012), dans lequel un ado voit sa maison submergée par une foule incontrôlable ; film d’action avec la saga John Wick, ou les films pop de Seijun Suzuki, dans lesquels la boîte de nuit devient le lieu d’affrontements violents et de gunfight s au milieu des clubbeurs ; polar mafieux sous les néons dans La Nuit nous appartient de James Gray (2007). La fête élève les corps ou les meurtrit.
« JE » EST UN AUTRE
Parfois, elle les transforme aussi. Lieu de tous les possibles, la fête est une machine à fiction. Les personnages s’y créent une identité, en transgressant bien souvent les barrières et les normes sociales, comme Cendrillon chez Disney vivant, le temps d’un bal, son rêve de princesse. Ce cliché de la rencontre impossible que la nuit permet est un archétype de la fête depuis Roméo et Juliette jusqu’à West Side Story, en passant par le légendaire Dirty Dancing. Le Studio 54, célèbre club new-yorkais des années 1970, en a fait sa légende. Ce dernier est raconté dans un film du même nom de 1998 dans lequel Ryan Phillippe, jeune naïf, se réinventait en go-go dancer, tout de paillettes vêtu. Stars de l’époque, prostituées, mafieux, quidam : tout le monde

se mélange. Cette utopie sociale de la nuit est avant tout un théâtre, un « lieu pour voir et être vu », comme le décrivit Roland Barthes, fasciné par le Palace parisien et sa faune. Un carnaval dans lequel les époques se chevauchent et les identités fluctuent. Comme dans cette hilarante scène de bal masqué à la fin de La Panthère rose (1964), dans laquelle Blake Edwards orchestre la course-poursuite entre un chevalier, un zèbre, deux gorilles et une femme habillée en matador. Le monde devient flou. Film punk et camp, The Rocky Horror Picture Show (1976) invite le spectateur à une immense fête queer rock, dans laquelle les rôles et les genres s’inversent. La figure du drag, créature autofictionnelle qui incarne la fête, devient alors l’émissaire de ce monde des possibles comme dans le récent Trois nuits par semaine (2022).
Mais la fête est aussi un refuge. Ainsi, les clubs gay et lesbiens au cinéma apparaissent très vite comme des lieux de vie politique. Sur les volutes electro de Bronski Beats, les héros engagés de 120 battements par minute (2017) libèrent leur corps du regard de la société et s’aiment à ciel ouvert. Magnifiquement, Robin Campillo filme au ralenti des bras, des jambes, des regards : des êtres devenus un corps social, une force en mouvement. Cette force est au cœur de Paris is Burning (1991), puissant documentaire sur la communauté ballroom qui, comme la série Pose ensuite, présente la fête et la danse comme un manifeste. Ou comme cette chanteuse punk sur la scène du club lesbien de Simone Barbès ou la Vertu (1980), qui scande son « nanamec » comme un slogan et entraîne la foule avec elle. Mais ces espaces de liberté sont

fragiles, cibles de toutes les menaces. Récemment, le remake de la série Queer as Folk s’est emparé de la tragédie d’Orlando – boîte de nuit gay cible d’une fusillade en 2016 – pour en raconter l’impact sur la communauté LGBTQ. Plus qu’un lieu pour danser, les clubs sont des poches de résistance que le fascisme craint. C’est ce que racontait déjà Bob Fosse dans Cabaret (1972) : un monde en soi, une utopie joyeuse, qui ne voit pas, dans l’Allemagne des années 1930, arriver la « bête ». Grande œuvre à la beauté expressionniste, Cabaret regarde la fête pour sa beauté folle, mais aussi pour son aveuglement.

FIN DE PARTY
Car que se passe-t-il quand les lumières se rallument ? En 1960, La dolce vita de Federico Fellini ouvre une brèche mélancolique dans la fête. Portrait d’un chroniqueur mondain désabusé, le film virevolte de soirée en soirée pour mieux en raconter la vacuité. Le vide d’un monde trop plein dans lequel Anita Ekberg semble terrifiée à l’idée que les rires s’arrêtent. Cette forme d’ennui, cet épuisement de tout, trace le portrait d’une damnation. Film à la sensua-
lité troublante, Millenium Mambo (2001) finit ainsi par enfermer son héroïne dans les flashs et les néons de la boîte dans laquelle elle travaille. Le temps semble se dissoudre. Bertrand Bonello filme, lui, son Saint Laurent (2014) comme un vampire, créature nocturne assise sur les banquettes des plus célèbres clubs de Paris, à observer les danseurs. Des scènes à la beauté noire, dans lesquelles la fête devient fantasme de création, recherche de la beauté et violence du temps qui passe. « Je voudrais dormir », dit Saint Laurent, Nosferatu épuisé, au début du film. Dans les recoins sombres des boîtes, la fête abrite des êtres inquiétants qui recherchent la vie éternelle, comme Catherine Deneuve et Davie Bowie dans Les Prédateurs (1983). La fête avale puis dégueule les êtres, comme le héros torturé de Trainspotting (1996) qui, soudain, au milieu des beats de Blondie, semble pris d’une épiphanie. La fête est un pansement, le pire et le meilleur de l’existence. Elle ne peut durer qu’un temps. Mais ce temps-là est inoubliable.


En couverture <----- Cinéma
23 été 2023 – no 199 3 4 5 6
RENAN CROS
organisateur de soirées, journalistes spécialistes de la nuit… des figures liées à la fête nous ont transmis leur expertise pour mieux comprendre les démons de minuit.
Notre dossier sur la fête se poursuit sur troiscouleurs.fr
SIMON CLAIR EMMANUELLE LALLEMENT MC DANSE POUR LE CLIMAT
Ex-rédacteur en chef de Trax, magazine nuit et musiques électroniques brusquement arrêté en juin après 26 ans d’existence, Simon Clair coréalise avec Corentin Coëplet Auto-Tune. De Cher à PNL, le Photoshop de la voix, une série documentaire diffusée sur Arte. • Q. G.
Est-ce que la culture rave te semble aussi prégnante depuis son avènement dans les années 1980-1990 ?
Les raves et les free parties, ça a existé encore plus pendant le Covid, parce qu’il n’y avait que ça. J’ai l’impression que c’est devenu une esthétique majoritaire. Par exemple, l’artiste Eloi vient de sortir son nouveau clip pour le morceau « On fait du rock » Pour qu’elle ait un côté subversif en disant qu’elle revient au rock, c’est bien que la culture rave à laquelle elle se rattache est devenue une base pour sa génération. Ce revival irrigue l’art, le cinéma, la mode depuis une dizaine d’années.
Avec quel héritage as-tu dû composer en arrivant chez Trax comme rédacteur en chef, il y a quatre ans ?
Quand je suis arrivé, c’était un peu le magazine officiel de la musique électronique. Il fallait défendre cette culture-là, quitte à parfois s’y enfermer un peu. Chacun a sa vision là-dessus, mais, moi, l’idée de défendre un patrimoine, ça me donne l’impression qu’on va devenir comme les papys rockeurs… Ce qu’on a essayé de faire, c’est plutôt de garder l’esprit lié à la culture électronique, avec des valeurs comme l’inclusivité, la bienveillance, l’émancipation par la fête et la nuit, et de prendre ça comme une grille de lecture appliquée à ce qui sort aujourd’hui.

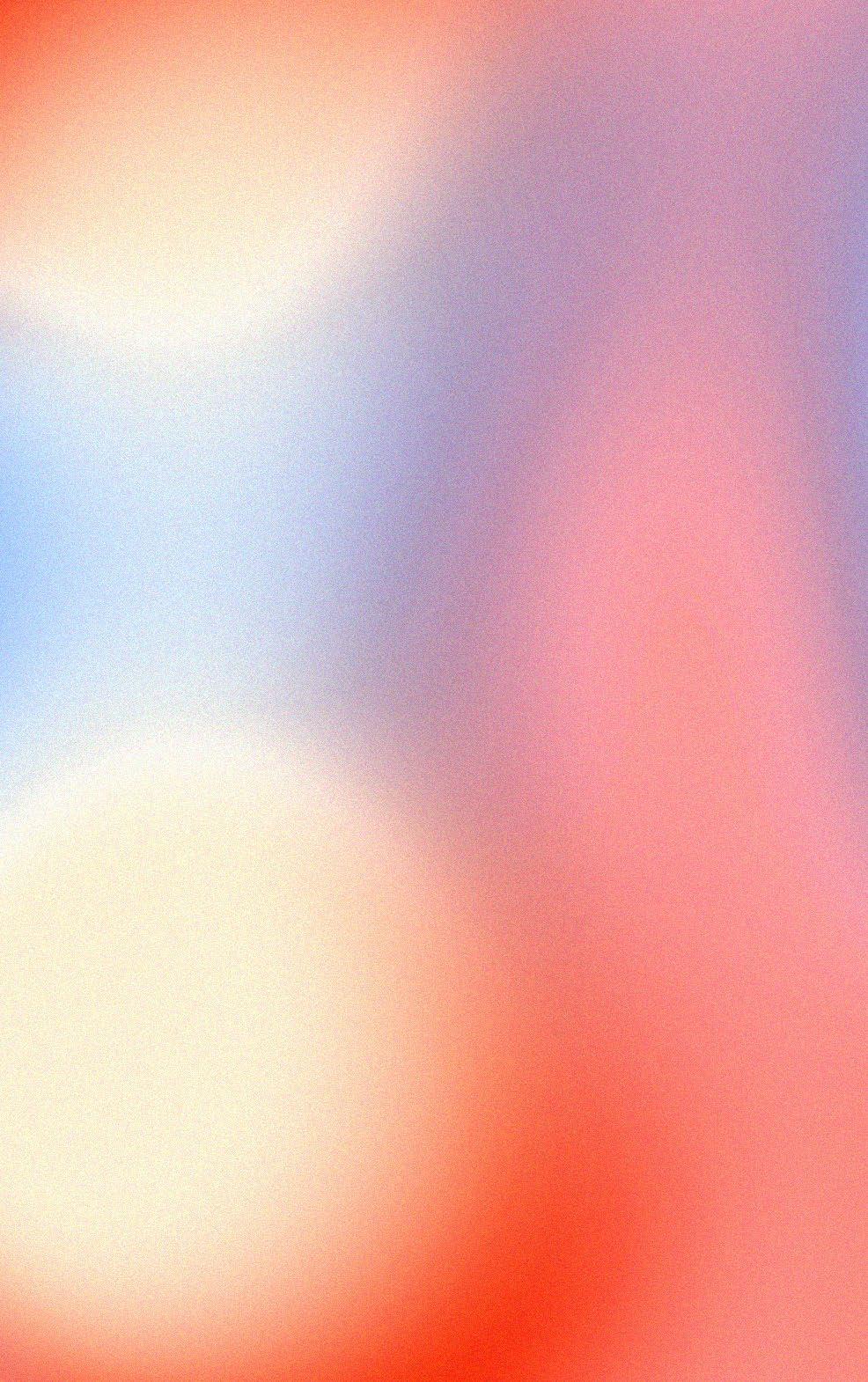
La scène de club préférée de
JENNIFER CARDINI
DJ et productrice
« Au début de Basic Instinct [Paul Verhoeven, 1992, ndlr], il y a cette scène dans un club légendaire de New York, le Limelight, qui était en pleine heure de gloire. La première soirée où je suis allée, dans le sud de la France, s’appelait justement Limelight. DJ Mozart avait apporté le concept des soirées fetish au Studio Circus, à Cannes. Dans cette scène, il y a le morceau electro « Blue » de LaTour, et « Rave the Rhythm » de Channel X, un tube des raves des années 1990. C’est ce qui m’a inspiré le son que je mixe encore aujourd’hui, un mélange d’EBM et de new beat. C’est pour moi la scène de club la plus réussie : elle est actuelle, mais aussi dans son époque. Ils dansent mal, mais comme dans toutes les scènes de club, parce qu’ils sont trop selfconscious. »
Tu as mis en couv des artistes qui n’auraient jamais été dans Trax avant, comme Jul. En quoi ça te semblait important ?
De 2010 à 2015, il y a eu la vague de la trap, ce rap qui vient d’Atlanta. Elle s’est composée dans les clubs, pour les clubs. Pas les clubs à l’européenne, classe moyenne blanche, musique electro. C’étaient plutôt des clubs de strip-tease avec un public afro-américain dans les quartiers pourris d’Atlanta. Là, les gens se sont dit : « Ah, on peut mettre du rap en club ? » Maintenant, tout le monde utilise le mot « banger » pour un son que tu lâches en club et qui fait tout péter. Ça vient de là. Cette évolution fait qu’aujourd’hui, si tu parles de la nuit, les rappeurs ont leur mot à dire. Les guerres de chapelle d’il y a quinze ou vingt ans – « Si tu écoutes de l’electro tu ne peux pas écouter du rap » –, c’est fini, c’est même un peu boomeur. Dans l’équipe de Trax, on écoutait de la techno pointue, mais on écoutait aussi tous Jul. Depuis quelques années, les rappeurs vont aussi vers une esthétique cyberpunk, digitale, qui raccorde bien aussi avec une culture électronique…
Anthropologue et professeure des universités à Paris-VIII, elle a dirigé « Éclats de fête » pour la revue Socio-anthropologie (Éditions de la Sorbonne, 2018) et est intervenue dans les médias en tant que spécialiste de la fête à l’issue de la première année de Covid-19. • T. Z. Comment avez-vous vu évoluer le rapport à la fête depuis le Covid-19 ?
Sous ce pseudo se cache Mathilde Caillard, une militante écolo de 25 ans, membre du collectif Alternatiba Paris, qui s’est rendue célèbre sur les réseaux, en mars dernier, en postant une vidéo devenue virale, dans laquelle elle danse sur de la techno en pleine manif contre la réforme des retraites.• J. L.


Sur les réseaux, vos vidéos suscitent nombre de réactions, parfois négatives et violentes. Qu’est-ce que ça révèle de la société, d’après vous ?
Ce qui a principalement dérangé, c’est que je suis une femme qui utilise son corps pour porter un message politique. Je décide d’extraire mon corps du rôle « passif » auquel il est habituellement cantonné en tant que corps féminin. Ensuite, je l’extrais de son rôle de « force de travail », dans l’ordre capitaliste, pour effectuer un acte non marchand. On m’a aussi accusée de desservir la cause. Ces personnes ignorent l’histoire des luttes, le fait qu’on dansait sur de l’accordéon dans les usines lors du Front populaire, ou la performance « El violador eres tú » du collectif féministe Las Tesis, au Chili [popularisée en 2019, lors de manifestations contre les violences faites aux femmes, ndlr]. Ces fesses tristes n’ont toujours pas compris qu’on lutte contre l’oppression, mais pas contre la vie, la joie, le fait d’être ensemble.
Votre scène de fête préférée au cinéma ?
Celle de la Pride dans 120 battements par minute de Robin Campillo. La caméra enveloppe ces corps militants, tendres et puissants. En toile de fond, il y a la maladie. C’est souvent dans les pires moments de détresse que nous sommes le plus touchés par la solidarité d’autrui. Cela provoque une joie sincère, presque une forme d’euphorie.
Votre club favori ?
C’était La Base [bar associatif parisien, fermé en 2022, ndlr]. Depuis, je me sens un peu orpheline. J’ai pas mal traîné au Social Club il y a quelques années. Ou à La Station – Gare des Mines, pour son ambiance berlinoise.
Le rapport à la fête me semble encore plus politique qu’avant. Pendant la pandémie, on a vu des discours de désapprobation de la fête. Elle pouvait aussi être perçue comme un moyen de résistance dans cet univers contraint socialement. Cela reste conditionné par la lutte des classes sociales. Ont encore été pointées du doigt les personnes soumises à des inégalités territoriales. On fustigeait par exemple les barbecues dans les banlieues, alors que dans les beaux quartiers parisiens les fêtes pouvaient se faire de manière discrète mais fastueuse. Je constate aussi une plus forte intrication entre la manifestation et la fête. Après les confinements, certaines fêtes ont été traitées comme des manifestations, avec des répressions policières similaires.
Certains mouvements, particulièrement LGBTQ, utilisent la fête comme un outil de militantisme…

La fête a été extrêmement importante pour la reconnaissance des communautés, notamment dans l’espace public, avec toutes les Marches des fiertés. L’autre aspect, c’est le clubbing. Des gens comme la DJ Barbara Butch rassemblent des communautés dans des soirées célébrant l’inclusivité. Mais le clubbing, c’est aussi l’univers de la distinction sociale. Est-ce qu’un jeune de Saint-Denis peut entrer dans n’importe quel club à Paris ? Non.
Le club est-il perçu aujourd’hui comme un lieu de reconnexion à l’autre, ou plutôt d’anonymat, d’oubli de soi ?
Le clubbing rassemble des gens autour de rendez-vous qui servent à retrouver du « même » – même lieu, même type de musique, même communauté. En même temps, la nuit permet d’être différent, de s’habiller, de se maquiller, de se travestir. De parler à quelqu’un qui ne fait pas partie de notre milieu social, ou bien d’être seulement spectateur. Ça rejoint le cinéma : quand on regarde des scènes de club, ça peut nous mettre dans la même position que quelqu’un qui participe à une fête en tant que spectateur. Comme dans cette scène d’Eastern Boys de Robin Campillo : le héros organise une fête et il est pris dans une sorte de piège, ses invités commencent à le dépouiller. Il voit partir son canapé, ses tableaux et il ne sait pas comment se comporter.
no 199 – été 2023 Cinéma En couverture
© Basile Mesré-Barjon
PAS D’INVITÉS
PAS DE FÊTES
PAS D’ANIMAUX
PAS D’ENFANTS

ANTI-SQUAT
LOUISE BOURGOIN
KAZAK PRODUCTIONS PRÉSENTE
NICOLAS SILHOL UN FILM DE D'APRÈS PHOTOS JULIEN PANIÉ © 2022 KAZAK PRODUCTIONS VISA D’EXPLOITATION N°151.829 AU CINÉMA LE 6 SEPTEMBRE
Court métrage
CLUB FANTÔME
Présenté cet été au festival Silhouette, le sublime court métrage Pacific Club de Valentin Noujaïm ressuscite avec mélancolie un club souterrain de la Défense qui, dans les années 1980, faisait figure de refuge pour les personnes arabes refoulées ailleurs.
En 1985, Azedine avait 17 ans. Les weekends, il s’habillait d’un col roulé, d’Adidas Tobacco, et portait une main de Fatma. Et il sortait au Pacific Club, où l’on dansait la soul et le raï sous une tour de la Défense. Une trentaine d’années plus tard, le cinéaste Valentin Noujaïm le rencontre lors d’un démé nagement. « Azedine m’a demandé où je sortais, si c’était compliqué pour moi en tant qu’Arabe de sortir à Paris. Je lui ai répondu que parfois les vigiles étaient un peu cons, mais que je n’avais pas de problème pour rentrer en boîte. Il a commencé à me raconter que lui, quand il était jeune, il ne pouvait sortir nulle part, que le Pacific Club était le seul endroit où il pouvait aller.

J’étais étonné qu’il se projette en moi : on ne vient pas du même milieu social, il est hétéro et je suis gay. Pourtant, il avait vraiment envie de transmettre cette histoire. »
Filmant Azedine revenir à la Défense, lieu de business impersonnel, le réalisateur part à la recherche de l’esprit du club englouti sous les buildings. Il le ressuscite par une danse solennelle, imaginant une silhouette au sol qui s’élève dans le parking où logeait autrefois le Pacific. Aussi par des animations 3D, dont le minimalisme gracieux évoque des traces fantomatiques qui se détachent d’une nuit abstraite. Elles donnent corps au récit ému d’Azedine, percé d’évocations du racisme, de la persécution policière, du VIHsida, de la drogue. Cette mémoire occultée dont Noujaïm se fait le subtil passeur dit alors tout ce qu’en réaction, la nuit, les clubs peuvent apporter d’émancipation et d’épanouissement. • QUENTIN GROSSET

> Festival Silhouette, du 25 août au 2 septembre, au parc de la Butte du chapeau rouge
ROMARIC GOUALI REBEKA WARRIOR
Grâce à La Darude et La Tchoin, deux collectifs qu’il a cocréés, le R&B, l’euro-dance et la trance des années 2000 font leur retour en soirée. Également DJ sous le pseudo Kwamē, ce Parisien, la trentaine, réenchante nos nuits, avec juste ce qu’il faut de nostalgie. • J. L.

Qu’est-ce qu’il y a de commun entre La Darude, qui est dans une veine de pure trance, et La Tchoin, plus queer, girly ?

C’est l’idée de créer des soirées appart en club, de mettre le public au centre, pour qu’il se sente le plus à l’aise possible. Ça fait partie de notre identité. Ça se sent dans la direction artistique aussi. C’est très coloré – on insiste pour que les gens viennent habillés comme ça –, et je pense que dans le paysage parisien ça apporte quelque chose. Parce qu’on est habitués aux soirées très dark, berlinoises, et je crois que ça joue sur l’humeur du public.
Tu as senti une évolution de la fête parisienne ces dernières années ?
Depuis le déconfinement, vachement ! Avant, tu venais à une soirée pour voir un DJ mixer. Il n’y avait pas vraiment de distinction entre une soirée club et un concert. Tu te mettais devant le DJ et tu restais là pour l’écouter. Maintenant, les clubs mettent en avant les collectifs, le line-up va passer un peu plus au second plan. Nous, on travaille pas mal avec La Machine du Moulin Rouge, le Trabendo – mon club préféré actuellement, il a un sound system de malade. L’esthétique des collectifs, comme La Créole [un collectif multiculturel et inclusif qui diffuse dans ses soirées un mélange de musiques afro, latino, caribéennes, et de house, ndlr], est aussi plus forte.
Qu’est-ce que la nuit permet de révéler ?
Par rapport à notre société codifiée – surtout par le taf –, ça permet de révéler son vrai soi. C’est comme si tu étais Clark Kent le jour, et que le soir tu revêtais une cape et devenais Superman. La nuit, c’est avoir le moins de limites possible – hormis celles du respect des autres et de soi-même.
> Retrouvez cet été le collectif La Darude à l’Insane Festival, puis à Béton Le Havre
FLORIAN BARDOU
Journaliste à Libération, Florian Bardou invite des personnalités vivant pour et par la nuit dans sa chronique hebdo « C’est reparty ». Il s’inspire aussi du clubbing queer dans son magnétique recueil de poésie Les garçons, la nuit, s’envolent (Lunatique, 2023). • Q. G.

Comment as-tu imaginé la rubrique nuit « C’est reparty » que tu tiens dans Libé ?
J’ai un pied dans ce monde – pas les deux, j’alterne entre des moments de fascination et des moments de répulsion, j’ai besoin de me reposer puis d’y revenir. Depuis la fin du Covid, j’y suis beaucoup revenu et j’ai eu un déclic. Ce n’est pas un sujet journalistique tellement traité en presse généraliste. Pourtant, ça charrie un nombre important de réflexions autour du corps, de la sexualité, de la danse, des rapports économiques, des addictions, de l’architecture… Je ne voulais pas faire la même chose qu’Éric Dahan, qui dans sa chronique « Nuits blanches » dans Libé racontait ses sorties nocturnes dans les années 1990. Mon idée, c’était de donner la parole, une fois par semaine, aux gens qui vivent la nuit ou en vivent. Et de raconter cette nuit à travers des bribes de récits, des objets, des lieux, des musiques…
Tu approches aussi la nuit en tant que poète. Tu cherches à retrouver des états fugaces, des ambiances, des émotions ?
La fête étant une partie de ma vie, c’était forcément une matière de laquelle je sentais que je pouvais tirer des instants extrêmement poétiques. Je fonctionne par instantanés, par sensations, émotions. J’essaye de saisir des moments vécus et de les retransmettre, dans leur côté à la fois intemporel et très ancré. C’est une matière très riche, car elle est pétrie d’imaginaire. La nuit, c’est la marge, les souterrains, des constructions fantasmatiques.
Tu as aussi performé ta poésie, nu, en club. Quel souvenir tu en as ?
J’ai performé dans une soirée gay, Mustang, et au club queer L’Œil, à l’invitation de l’association Nu2. Ce que je trouve intéressant, c’est d’amener de la poésie dans un espace qui n’est pas dévolu à ça. D’essayer aussi de montrer aux personnes qui fréquentent ces lieux qu’on peut tirer autre chose de ces moments de vie qui se consument et se consomment, un acte créatif. Ça crée un instant de parenthèse dans la fête. Peut-être que ça peut susciter une autre manière de la vivre. C’est intéressant : qu’est-ce qu’on sème dans les têtes ? Quels rapports cela va-t-il créer à la danse, au partage, pour certains à la défonce, à la séduction ?
Figure de l’electro avec ses groupes Mansfield.TYA, Sexy Sushi et Kompromat, elle était présidente du jury formats courts du Champs-Élysées Film Festival fin juin et signe la B.O. de Paula d’Angela Ottobah (lire p. 58). • C. B.
Quelle place occupe la nuit dans votre vie ?
Toute la place. Autant pour fréquenter des gens que pour la musique, les sorties ou les créatures de la nuit. Les activités nocturnes sont centrées sur l’humain, la musique, la fête, les émotions plutôt que sur le travail et la consommation. Cette population de la nuit, dont je fais partie, ce sont des gens qu’on croise parce qu’on sort dans les mêmes clubs, mais on n’a pas leur numéro. Ça va à l’encontre d’un type de relation très normé, c’est ça qui me plaît.
Quels sont vos endroits favoris pour faire la fête à Paris ?
Je ne vais quand même pas vous donner tous mes spots ! Je fréquente beaucoup les bars de quartier, pour retrouver les copains en début de soirée. Les salles de concerts, évidemment : ma préférée, à Paris, c’est La Station. Elle est un peu roots, il y a des libertés qu’on ne retrouve pas dans certaines autres salles.
Quel est votre plus beau souvenir d’une nuit où le temps s’est arrêté ?
La nuit, on recrée des moments d’éternité. C’est un peu mystique et méta. Le temps s’arrête forcément, avec les amis, la musique, la transe… Si le temps ne s’arrête pas, c’est que c’est raté. Souvent, le temps reprend quand on voit les premières lumières du soleil. Tout le monde se met à crier, comme des vampires : « Au secours, baissez les rideaux ! »
Quels films vous donnent envie de faire la fête ?
Tous les films d’Alexis Langlois ! Ils sont weird, fous, queer, extravagants. Pour le coup, on y trouve vraiment des créatures avec tous les visages possibles et inimaginables. C’est ça qui m’excite le plus dans le fait de sortir.
26 no 199 – été 2023
Cinéma > En couverture
Retrouvez la playlist concoctée par la rédac pour teufer tout l’été (prendre en photo ce QR Code depuis la page de recherche sur l’application Spotify)
© D. R.
© Nadine Fraczkowski
UN FILM DE CHRISTIAN PETZOLD




UNE PRODUCTION SCHRAMM FILM KOERNER WEBER KAISER EN COPRODUCTION AVEC LA ZDF ARTE “LE CIEL ROUGE” AVEC THOMAS SCHUBERT PAULA BEER LANGSTON UIBEL ENNO TREBS MATTHIAS BRANDT SCÉNARIO CHRISTIAN PETZOLD IMAGES HANS FROMM BVK MONTAGE BETTINA BÖHLER DÉCORS K.D. GRUBER COSTUMES KATHARINA OST CASTING SIMONE BÄR SON ANDREAS MÜCKE-NIESYTKA SOUND DESIGN DOMINIK SCHLEIER MAREK FORREITER BETTINA BÖHLER MIXAGE LARS GINZEL ADRIAN BAUMEISTER MAQUILLAGE HANNAH FISCHLEDER GAFFER CHRISTOPH DEHMEL ASSISTANTE RÉALISATEUR IRES JUNG DIRECTRICE DE PRODUCTION DORISSA BERNINGER RÉDACTION CAROLINE VON SENDEN CLAUDIA TRONNIER SIMON OFENLOCH PRODUCTEURS FLORIAN KOERNER VON GUSTORF MICHAEL WEBER ANTON KAISER RÉALISÉ PAR CHRISTIAN PETZOLD AVEC LE SOUTIEN DE MEDIENBOARD BERLIN-BRANDENBURG MV FILMFÖRDERUNG DIE BEAUFTRAGTE DER BUNDESREGIERUNG FÜR KULTUR UND MEDIEN FILMFÖRDERUNGSANSTALT DEUTSCHER FILMFÖRDERFONDS VENTES INTERNATIONALES THE MATCH FACTORY DISTRIBUTION FRANCE LES FILMS DU LOSANGE DISTRIBUTION SOUTENUE PAR GERMAN FILMS

CRÉATION X LES FILMS DU LOSANGE PRÉSENTE
AU CINÉMA LE
6 SEPTEMBRE
DOMPTER LA PEUR
SANDRA HÜLLER

L’actrice allemande crevait l’écran dans deux films primés à Cannes cette année, dont la Palme d’or Anatomie d’une chute de Justine Triet. Très rare dans les médias, elle nous a accordé un entretien profond, au cours duquel elle revient sur son parcours, le sentiment diffus de culpabilité qui l’habite et son besoin de s’éloigner, de temps à autre, des lumières du cinéma.
Elle nous a bouleversés dans Anatomie d’une chute (en salles le 23 août), dans lequel elle incarne une écrivaine qui attire toute l’attention après la mort de son compagnon dans des circonstances troubles. Elle nous a aussi sciés dans le glaçant La Zone d’intérêt de Jonathan Glazer (Grand Prix du jury à Cannes), qui s’inspire d’une histoire vraie et raconte le quotidien d’un commandant des camps d’Auschwitz-Birkenau et de sa famille – dont la sortie est prévue pour janvier 2024. Par téléphone, mi-juin, on a échangé longuement avec l’actrice.
Vous sortez de Cannes avec deux films dont l’un a remporté la Palme d’or et l’autre, le Grand Prix. Qu’avez-vous ressenti le soir de la remise des prix ?
J’étais très heureuse. Et très détendue, parce que tout se passait comme j’espérais. J’étais ravie que les deux films obtiennent la reconnaissance qu’ils méritaient et que notre travail soit apprécié.
Vous avez joué dans des films allemands, autrichiens, américains, britanniques et fran-
çais. Cette carrière internationale, c’est un choix ou un hasard ?
Je suis reconnaissante de faire autant de projets à l’étranger, mais je n’ai jamais planifié ma carrière dans ce sens. Je dépends des fantasmes des autres. C’est le point de départ de tout projet, et ce n’est pas vraiment
Justine Triet a écrit le rôle de l’héroïne d’Anatomie d’une chute pour vous. Qu’est-ce qu’il y a de commun entre votre personnage et vous, hormis le prénom ?
Une seule chose, je crois : elle ressent vivement les choses qui se passent autour d’elle. Je ne sais pas si on a d’autres choses en com-
quelque chose qui est en mon pouvoir. Et quand on me propose un rôle, beaucoup de critères entrent en jeu. Il faut que je puisse voyager, m’éloigner de ma famille. Que j’aie la force, la disponibilité, le temps et l’envie de le faire – d’autant que j’aime bien travailler à la maison.
mun, mais je la comprends profondément. J’aurais aimé être aussi précise qu’elle dans le langage. Il y a tellement de choses que j’admire chez elle et que j’aurais aimé avoir.
La vie intime de votre personnage, sa sexualité, est scannée, analysée dans un tribunal.
Cinéma > L’entretien face caméra
28 no 199 – été 2023
« Je n’aime pas jouer des personnages que je comprends trop vite. »
Le fait qu’elle soit une femme libre joue en sa défaveur. Comment comprenez-vous cette animosité ?
L’avocat général [campé par Antoine Reinartz, ndlr] est très cruel : il veut retourner les gens contre elle. Peut-être parce que c’est une femme. Ou peut-être parce qu’il veut gagner, ce qui est naturel. Le film joue tout le temps avec nos sentiments. Parfois on se sent proche d’elle, parfois elle nous dégoûte. Certains pensent qu’elle ment, d’autres qu’elle n’est pas fiable parce qu’elle est bisexuelle. Il y a tellement de jugement dans ce monde sur les personnes qui font des choses qu’on ne comprend pas parce qu’on n’y a pas été confronté dans notre vie. Il faudrait poser cette question aux spectateurs, parce que, moi, je l’aime tout le temps. Elle a ses contradictions, elle fait des choses qui n’ont pas toujours de sens. En même temps, je fais pareil. Vous aussi, probablement. On ne peut pas toujours expliquer nos actions, et on fait tout le temps des erreurs. Mais, pour moi, elle est vraie, elle est humaine.
Par rapport à sa maternité, votre personnage est intéressant parce qu’il est à la fois protecteur, doux et fort – des caractéristiques qu’on n’attribue pas toujours aux mères dans la fiction.
Je crois que Sandra veut donner à tout le monde, y compris à son fils, la liberté qu’elle veut avoir pour elle-même. Pour tout dire, j’aime vraiment sa manière d’éduquer son enfant. Elle veut le protéger, mais en même temps le laisser vivre sa propre expérience, sans le juger.
Et vous, dans quelle configuration familiale avez-vous grandi ?
Mes parents se sont mariés très jeunes, et ils m’ont eue très vite [elle est née en 1978 à Sulh, dans l’est de l’Allemagne, ndlr], ainsi que mon frère. C’était une famille traditionnelle de la RDA [l’ancienne République démocratique allemande, séparée de la République fédérale allemande avant la ré-
unification du pays en 1990, ndlr]. Ma mère travaillait [ses deux parents étaient éducateurs, ndlr], donc de ce point de vue il y avait une sorte d’égalité, mais je ne suis pas sûre qu’il y ait eu une égalité à la maison, avec les tâches ménagères et les soins, il faut que je leur pose la question.
C’est la deuxième fois que vous collaborez avec Justine Triet après Sibyl, sorti en 2019, dans lequel vous jouiez une réalisatrice sous tension. Quelle méthode de travail avez-vous développée ?
Je ne peux pas vraiment l’expliquer, je peux juste décrire ce que je ressens : travailler sur ses films est plus inspirant que beaucoup d’autres films que j’ai pu faire. Je me suis sentie en sécurité, en confiance. Comme s’il n’y avait pas vraiment de hiérarchie. Bien sûr, c’est la boss, mais elle n’utilise jamais sa position pour imposer quelque chose à qui que ce soit. La beauté de ce travail, c’est qu’on essaie de faire avancer les choses ensemble. J’ai rencontré des cinéastes – hommes ou femmes, peu importe – qui avaient un plan, mais ne tenaient pas compte de la fantaisie ou de la personnalité des acteurs. Ce n’est pas ce que fait Justine. Elle travaille avec tous ceux qui sont présents dans la pièce. Tout le monde peut avoir une opinion, tout le monde a son mot à dire, tout le monde peut vraiment collaborer. Et, pour moi, c’est la forme de travail la plus libératrice. J’aime vraiment, vraiment ça.
Vous avez été révélée au public français avec le génial Toni Erdmann de Maren Ade (2016), dans lequel votre liberté de jeu a crevé l’écran. Dans le film, le père de votre personnage, en découvrant son mode de vie capitaliste, lui demande :
« Es-tu humaine ? »
(Elle rit.)
C’est une question qui traverse votre filmographie. Vos personnages sont souvent jugés à tort ou à raison sur leur manque
d’empathie. Vous vous sentez attirée par ce type de rôles ?
Pas particulièrement. J’aime les personnages avec lesquels je peux passer du temps à comprendre pourquoi ils sont ce qu’ils sont. Et je n’aime pas jouer des personnages que je peux comprendre dès la première page du scénario – et qui ne ressemblent à personne que je connais. Je ne sais pas… J’ai un petit sentiment de culpabilité, c’est peut-être pour ça que je choisis des personnages qui doivent tout le temps s’expliquer.
La Zone d’intérêt a suscité beaucoup de réactions à Cannes. Vous jouez des scènes très dérangeantes, comme celle dans laquelle votre personnage choisit un manteau de fourrure dans une valise confisquée d’un train de déportés. Qu’est-ce qui vous a décidée à faire le film ?
C’est arrivé étape par étape. Je n’ai pas tout de suite tout su du projet. J’ai reçu deux pages d’une scène de couple que je devais préparer pour le casting. Personne ne m’a dit de quoi il s’agissait, qui allait le réaliser, et en plus j’avais déjà un film de prévu aux dates indiquées du tournage. Je me suis dit : « Je ne sais pas, je peux essayer… Mais je ne suis pas sûre que ce soit pour moi. » Dès que j’ai confirmé ma venue au casting, on m’a informé que le film raconterait l’histoire de la famille Höss [Rudolf Höss, officier allemand de la SS, était commandant des camps de concentration et d’extermination d’AuschwitzBirkenau de mai 1940 à décembre 1943, puis de mai à septembre 1944. Avec sa famille, il vivait dans une vaste villa jouxtant les camps. Le film montre cette vie de famille, ndlr]. L’idée m’a dégoûtée, je n’avais pas envie de vivre ce genre de choses dans ma vie, mais, en même temps, j’ai appris à ce moment-là que ce serait Jonathan Glazer qui réaliserait le film. J’adorais son travail et je l’admirais tellement que ça a créé un conflit en moi. Évidemment, j’avais envie de travailler avec lui, mais j’avais un vrai problème avec le personnage. Je ne comprenais pas pourquoi il voulait raconter cette histoire depuis cette
SANDRA HÜLLER
EN 5 DATES
1978
Naissance à Suhl, une petite ville de l’est de l’Allemagne située près de la forêt de Thuringe, qu’elle quitte vers ses 18 ans pour aller vivre à Berlin, où elle étudie à l’École supérieure d’art dramatique Ernst-Busch, de 1996 à 2000, avant d’intégrer plusieurs troupes à Iéna, à Munich et en Suisse.
2006
À 28 ans, elle débute au cinéma avec Requiem de Hans-Christian Schmid. À l’aise avec les partitions complexes, elle joue une jeune femme épileptique, à qui un prêtre fait croire qu’elle est possédée par un démon. Elle remporte cette année-là l’Ours d’argent de la meilleure actrice à la Berlinale.
2016
Personne n’avait anticipé la secousse comique mondiale Toni Erdmann de Maren Ade, présenté en Compétition à Cannes. Hüller y campe avec une nervosité géniale une femme d’affaires ambitieuse, perturbée par l’arrivée de son père fantasque. Une révélation immédiate, indélébile.

2019
Cette année-là, l’actrice allemande joue dans deux productions françaises, en incarnant une réalisatrice sur les nerfs dans Sibyl de Justine Triet (qui écrira le rôle d’Anatomie d’une chute pour elle) et une employée d’agence spatiale empathique dans Proxima d’Alice Winocour.
2023
Retour en force à Cannes pour la discrète actrice, qui nous a procuré la sensation d’un double uppercut avec ses rôles chez Justine Triet et Jonathan Glazer, pour lesquels elle n’a reçu aucun prix d’interprétation – mais comme elle n’en manque pas, on peut se dire qu’elle a de quoi se consoler.
L’entretien face caméra < Cinéma
29 été 2023 – no 199
perspective. On a beaucoup discuté sur la manière dont on travaillerait ensemble, on a essayé de trouver un moyen de raconter cette histoire sans recréer quelque chose qu’on avait déjà vu ou qu’on détesterait.
Hedwige, votre personnage, semble sensible et normale quand il s’agit de sa famille, mais elle est dans un déni monstrueux en ce qui concerne la tragédie vécue par les Juifs. Comment entre-t-on dans un rôle pareil et en sort-on ?
rentrée dans le rôle. Au départ, j’avais une approche très technique. Ensuite, tout mon langage corporel s’est mis à changer. J’imaginais quelqu’un qui avait travaillé dur toute sa vie, avait porté cinq ou six enfants – je ne suis plus sûre, c’est dire à quel point je sais peu de choses sur elle. À l’époque, les femmes prenaient très peu soin de leur corps après avoir donné naissance. Notre rapport à notre corps a beaucoup changé. Et, avec l’aide de l’incroyable Malgorzata Karpiuk [la costumière du film, ndlr] et de
carne Rudolf Höss, ndlr] et moi. Il ne fallait pas qu’on désespère parce que tourner un tel film éveillait une sorte de culpabilité qui traverse les générations.
Vous avez débuté au théâtre. Quels auteurs vous touchent ? Quand j’ai commencé, j’étais intéressée par tout. Toutes les pièces que je lisais, je les aimais, parce que j’avais tellement soif d’apprendre cet art, d’explorer l’esprit des écrivains. J’ai toujours été très fan de Heinrich von Kleist [écrivain, dramaturge, essayiste prussien du xviiie siècle, qui est notamment l’auteur de La Marquise d’O…, ndlr]. Bien sûr, j’adore Shakespeare, mais j’aime aussi beaucoup Thomas Brasch [écrivain, poète et cinéaste allemand, qui a notamment réalisé Les Anges de fer en 1982, ndlr].
Dans une interview pour Libération, en 2016, vous racontiez, en évoquant ces débuts sur les planches, que vous pensiez qu’il fallait « souffrir et éprouver de grandes émotions » et que vous ne saviez pas vous « protéger ».
même temps, je n’ai pas vraiment d’influence là-dessus. Mais au niveau professionnel, je suis juste curieuse de ce qui va arriver. Peutêtre qu’il ne se passera rien, et que je vais revenir là où j’ai commencé.
Vu d’ici, on a l’impression que des acteurs comme vous, Paula Beer ou Franz Rogowski, participez à une revitalisation du cinéma outre-Rhin. Comment percevez-vous le cinéma allemand contemporain ?

C’était dur ; on a tourné à Auschwitz, tout près des zones où travaillaient les Allemands responsables de cette catastrophe. Ça a été une expérience très inhabituelle pour moi. Je ne suis pas complètement
Waldemar Pokromski [le chef-maquilleur, ndlr] , qui a réalisé des coiffures folles, c’était plus facile d’entrer dans cette réalité. Puis il y a aussi eu un vrai travail émotionnel entre Christian [Christian Friedel, qui in-
Ça sonne vraiment bête, mais j’espère rester en bonne santé pour longtemps, pour expérimenter le même genre de miracle que j’ai vécu récemment, professionnellement et ailleurs. Et j’ai envie d’élever ma fille de sorte qu’elle se sente en sécurité toute seule. Et, en
(Elle rit.) Comme un docteur qui envoie des chocs électriques à un patient ? Je ne me lève pas le matin en me disant que je veux faire revivre le cinéma allemand. Je crois qu’on a de la chance de participer à des productions internationales qui inspirent les productions allemandes. Mais en fait… je pense que le cinéma allemand est très vivant. Il a un langage unique, qui n’est pas comparable à celui du cinéma français. Ce qui est dangereux, c’est quand on essaie d’être quelqu’un d’autre. Quand des cinéastes allemands essaient de faire des films à l’américaine ou à la française, c’est nul. L’idée, c’est vraiment de trouver sa propre voix, sa personnalité. Ça sonne un peu cheesy, mais vous voyez ce que je veux dire ? Il ne faut pas reproduire ce qu’on a vu, même si on l’a aimé. Je sens vraiment que le cinéma allemand se redéfinit, avec des cinéastes comme Sonja Heiss [qui a
Cinéma > L’entretien face caméra
© Les Films Pelléas –Les Films de Pierre Anatomie
no 199 – été 2023 30
« J’ai besoin de beaucoup de temps pour être à nouveau en paix avec moi-même. »
d’une chute de Justine Triet (2023)
signé When Will It
Be Again Like
It Never Was Before, présenté cette année à la Berlinale dans la sélection Generation, ndlr] et évidemment Angela Schanelec [repartie de la Berlinale 2019 avec l’Ours d’argent de la meilleure réalisation pour son film J’étais à la maison, mais…, ndlr].

Justine Triet nous a confié que vous choisissiez avec soin vos projets, et que vous teniez aussi à vous évader du cinéma, à vous ménager d’autres espaces.
On s’habitue beaucoup à l’attention que les autres nous portent, à l’illusion d’être important, au fait que les gens nous disent que ce qu’on fait est génial, qu’on est des V.I.P., bla-bla-bla… Mais c’est quelque chose qui n’a rien à voir avec la vie. C’est juste une étiquette, une projection. Et je ressens vraiment la nécessité de revenir à ma vie privée, à ma vie normale. Pour ma fille aussi, parce qu’elle n’a pas choisi ma carrière. C’est moi qui l’ai choisie. Et elle a le droit de vivre une vie qui n’est pas affectée par mon travail. Et parce que je me connecte très facilement aux gens, j’ai besoin de beaucoup de temps pour être seule, me « recalibrer », être à nouveau en paix avec moi-même.
Vous avez sorti le génial mini-album Be Your Own Prince en 2020, dans lequel vous jouez de la guitare, et dont vous avez écrit les paroles et composé la musique. Oui, j’ai toujours joué de la musique, mais jusqu’ici je n’avais jamais appris d’instrument. Donc j’avais l’impression de faire semblant, comme je ne savais pas lire les notes. Il y a eu une période dans ma vie au cours de laquelle j’enregistrais beaucoup de chansons, juste pour moi. Sur scène ou en plateau, quand je chantais, les gens me demandaient toujours si je ne voulais pas faire un album. Je disais : « Oui, oui, peut-être un jour… » Et un jour, je me suis rendu compte : « En fait, j’ai un album. Il faut juste que je le mette au monde. » C’est ce que j’ai fait, avec Daniel Freitag [un chanteur et compositeur allemand, ndlr]. On l’a mis sur le marché, puis plus besoin d’y penser.
J’ai lu dans un article qui date de quelques années que vous tiriez à l’arc et au pistolet dans votre temps libre. C’est toujours le cas ? Qu’est-ce que ça vous procure comme sensation ?
Je me suis intéressée à toute sorte de choses depuis. Je fais du cheval, du piano… Mais je sais toujours très bien tirer ! Et, dès que je me retrouve à une fête avec des fusils et des fleurs ou des ours en peluche, je le fais. Je ne sais pas comment expliquer ce qui m’attire là-dedans. Je crois que c’est parce que ça me met dans une forme de méditation – alors qu’en fait c’est juste une arme que j’ai entre les mains, ce n’est pas si beau que ça. Mais ce que j’apprécie beaucoup, c’est d’être concentrée sur un but.
Anatomie d’une chute de Justine Triet, Le Pacte (2 h 40), sortie le 23 août
PROPOS RECUEILLIS PAR JOSÉPHINE
LEROY

L’entretien face caméra < Cinéma PIERFRANCESCO FAVINO KASIA SMUTNIAK BÉRÉNICE BEJO LAURA MORANTE NANNI MORETTI LES FILMS DES TOURNELLES, ORANGE STUDIO, FANDANGO ET RAI CINEMA PRÉSENTENT UN FILM DE FRANCESCA ARCHIBUGI LE SUCCÈS DE L’ANNÉE EN ITALIE AFFICHE © JEFF MAUNOURY POUR METANOÏA CRÉDITS NON CONTRACD’APRÈS LE ROMAN DE SANDRO VERONESI (Ed. Grasset) AVEC SERGIO ALBELLI ALESSANDRO TEDESCHI BENEDETTA PORCAROLI MASSIMO CECCHERINI FOTINI PELUSO FRANCESCO CENTORAME PIETRO RAGUSA VALERIA CAVALLI ET AVEC NANNI MORETTI ÉCRIT PAR LAURA PAOLUCCI FRANCESCO PICCOLO FRANCESCA ARCHIBUGI D’APRÈS LE ROMAN DE SANDRO VERONESI “LE COLIBRI” (ÉDITIONS GRASSET) ASSISTANTE MISE EN SCÈNE ELISABETTA BONI CASTING ANTONIO ROTUNDI COSTUMES LINA NERLI TAVIANI DÉCORS ALESSANDRO VANNUCCI MONTAGE ESMERALDA CALABRIA MUSIQUE ORIGINALE BATTISTA LENA IMAGE LUCA BIGAZZI DIRECTEUR DE PRODUCTION LUIGI LAGRASTA PRODUCTEUR EXÉCUTIF IVAN FIORINI UNE COPRODUCTION ITALO-FRANÇAISE FANDANGO AVEC RAI CINEMA LES FILMS DES TOURNELLES ORANGE STUDIO COPRODUIT PAR ANNE-DOMINIQUE TOUSSAINT PRODUIT PAR DOMENICO PROCACCI RÉALISÉ PAR FRANCESCA ARCHIBUGI AVEC LE SOUTIEN DE LA RÉGION DU LATIUM “PASSIONNANT, ÉMOUVANT, JUSTE...” LIRE MAGAZINE AU CINÉMA LE 2 AOÛT
31 été 2023 – no 199
ANATOMIE D’UNE PRODUCTION
MARIE-ANGE LUCIANI
Derrière la belle réussite artistique d ’Anatomie d’une chute se trouve aussi la productrice Marie-Ange Luciani, en association avec David Thion. Rencontre avec cette quadragénaire enthousiaste et engagée qui affiche de grandes ambitions pour le film de Justine Triet – et pour le cinéma français.
Productrice depuis 2010, Marie-Ange Luciani a marqué les esprits avec 120 battements par minute, Grand Prix du jury 2017 à Cannes. Le soir des César 2018, alors que le drame de Robin Campillo venait d’être sacré meilleur film, la jeune femme prononça un discours puissant qui saluait la révolution MeToo, vue comme une promesse d’avenir. Cinq ans plus tard, la voici productrice de la troisième Palme d’or de l’histoire décernée à une réalisatrice, Anatomie d’une chute. « Juste après Sibyl, auquel je m’étais associée de manière financière, Justine Triet m’a proposé de produire son prochain film en codélégation avec David Thion. Elle hésitait entre deux projets : un film autour d’une journaliste enquêtant sur une communauté et un autre impliquant un chalet, une mère avec un enfant malvoyant, un chien et un procès. » C’est cette deuxième idée qui est mise en chantier. « Le film traite du couple et elle l’a écrit en couple, avec Arthur Harari. L'idée d’avoir un duo de producteurs en face correspondait bien à l’énergie du projet. Justine nous a dit très tôt que le

film serait long, elle pensait même au départ à une série. On lui a donné carte blanche pour un film de cinéma au format singulier, et on a été très honnête sur ce point avec nos partenaires financiers. » Marie-Ange Luciani, aussi productrice du récent L’Île rouge, loue les qualités de Justine Triet. « Elle est très participative et démocrate. Elle aime prendre, écouter, discuter l’avis des autres, et à la fin bien sûr c’est elle qui tranche. Elle nous a demandé du temps de tournage pour s’offrir ça, un nombre de prises important, un travail intense avec ses comédiens. » Après la Palme obtenue à Cannes et le discours prononcé par Justine Triet, la productrice valide tout : « David et moi avions lu en amont le discours. On est totalement en accord avec les propos de Justine, qui s’est préoccupée des générations futures en martelant qu’elle est l’enfant de l’exception culturelle et qu’elle aimerait qu’on donne la même chance aux cinéastes de demain. Tout cela est très cohérent : ce film est une affaire collective, et Justine n'est pas déconnectée du monde dans lequel elle
vit, au contraire, ses films sont traversés, percutés par les grandes questions qui agitent notre société. » Marie-Ange se projette jusqu’aux Oscar : « Anatomie d’une chute est un parfait candidat pour l’Oscar du meilleur film étranger. Le sujet, les thèmes sont éminemment contemporains : la redéfinition des rapports hommes/femmes, l’ausculation du fonctionnement du couple, la tribune contre le tribunal. Il y a aussi son bilinguisme qui aide, et surtout la belle vente américaine à Neon, distributeur de Parasite. » La suite est par ailleurs déjà en place pour l’enthousiaste productrice : entre Langue étrangère, film de Claire Burger en postproduction, le nouveau Léa Mysius (adapté du roman Histoires de la nuit de Laurent Mauvignier et en coproduction avec Jean-Louis Livi) ou le prochain Robin Campillo en cours d’écriture, l’avenir s’annonce foisonnant.
Cinéma > Portrait
LEBLANC
DAMIEN
32 no 199 – été 2023
« Anatomie d’une chute est une affaire collective. »
L’ARCHIVE DE… JUSTINE TRIET
Au cœur d’Anatomie d’une chute, la fascinante Palme d’or de Justine Triet, il y a Snoop (de son vrai nom Messi), qui a gagné la Palm Dog, prix qui récompense chaque année la meilleure performance canine parmi les films cannois. Mais c’est d’un autre chien que la cinéaste nous a parlé lorsqu’on lui a demandé de nous envoyer une photo personnelle importante dans son œuvre. Voici donc Bilou.
« Cette photographie a été faite probablement quelques années avant ma naissance, dans les années 1970, par mon père. Ce chien de berger, Bilou, était d’une intelligence rare. Il avait la particularité de vouloir faire circuler les voitures comme des moutons, ce qui n’était pas simple à Paris. Il avait dû être un très bon chien de berger, mais il s’était retrouvé à la S.P.A., puis avait été récupéré par mon père. Nous vivions à côté du métro Pernety, et Bilou prenait le métro seul. Un jour, ma mère, qui le trouvait rarement affamé, l’a suivi, et s’est rendu compte qu’il prenait le métro, attendait que personne ne puisse le repérer pour se faufiler juste avant que les portes ne se ferment, et sortait une station plus tard, à Plaisance. De là, il sortait et se faisait tous les couscous de la rue de l’Ouest. On lui donnait les restes.
“Ah ! te voilà, toi !” De là, il savait revenir en reprenant le métro. La photo est faite avec une pellicule infrarouge, de nuit, ce qui lui donne une présence singulière. Il est photographié comme un être qui regarde l’objectif activement. C’est le portrait d’un être, et non un faire-valoir de l’homme. C’est une photographie que j’ai mise dans chacun de mes films. Elle est toujours accrochée au mur, avec d’autres images que je choisis avec soin. C’est une sorte de porte-bonheur. »

Cinéma
PROPOS RECUEILLIS PAR JULIETTE REITZER
été 2023 – no 199 33
SE FORGER
MARIE AMACHOUKELI

En 2014, elle avait remporté la Caméra d’or pour Party Girl, beau récit sur une sexagénaire fêtarde, coréalisé avec Samuel Theis et Claire Burger. Dans son premier long réalisé en solo, àma Gloria, Marie Amachoukeli raconte avec finesse et tendresse le déchirement vécu par une fillette de 5 ans et demi lorsque sa nounou adorée, Gloria, doit retourner au CapVert s’occuper de ses propres
enfants. Après la projection cannoise, en ouverture de la Semaine de la critique, elle s’est livrée à nous à propos de filiation et de transmission.
Qu’y a-t-il de personnel dans cette histoire ? J’ai été élevée jusqu’à mes 7 ans par une femme, Lorinda. Elle m’a donné de l’amour et une éducation. Un jour, cette femme m’a annoncé qu’elle retournait dans son pays, le Portugal, dans sa famille, pour mener la vie qu’elle aurait dû mener à l’origine. Comme j’avais grandi dans son regard et dans ses bras, je n’ai pas compris. Mon monde s’est écroulé. J’ai voulu me retourner sur ce qui s’était passé en moi ce jour-là. Raconter les adieux entre une petite et sa nounou, ce qu’il y avait derrière un départ comme celui-ci, les questions que ça sous-entendait.
Dans le film, on ne sait pas grand-chose sur les adultes, ni dans quoi travaille le père de
Cléo, joué par le musicien Arnaud Rebotini, ni qui gardait les enfants de Gloria quand elle-même gardait Cléo en France… Gloria est partie du Cap-Vert en laissant ses trois enfants à sa mère pour gagner sa vie en tant que nounou. Lorsque la mère de Gloria décède, elle doit rentrer s’occuper de ses propres enfants. C’est quelque chose qui arrive très souvent au Cap-Vert, les femmes – car c’est quand même souvent une histoire de femmes – partent à l’étranger, plutôt en Occident ou dans les pays riches, s’occuper des enfants des autres, et laissent les leurs aux oncles, tantes, mères, restés sur place.
On pense évidemment à Ponette de Jacques Doillon (1996), à propos d’une fillette de 4 ans confrontée à la mort soudaine de sa mère, en particulier quand Gloria annonce à Cléo la mort de sa propre mère, qui déclenche son retour au Cap-Vert. Vous situez le film dans cette filiation ?
Ce film s’inscrit dans la filiation de pas mal d’autres. Il se trouve que Jacques Doillon a été mon prof à la Fémis. J’ai découvert Ponette et
les rushs du film dans son cours. J’avais été très marquée par le jeu de la petite [Victoire Thivisol, lauréate du prix d’interprétation féminine à la Mostra de Venise pour son rôle alors qu’elle avait 5 ans, ndlr]. Ça a été un modèle pour moi, d’acting en tout cas. Il y a un hommage très clair adressé à Ponette à un moment. Je pense aussi à Cría Cuervos… [de Carlos Saura, 1976, ndlr] dans la mélancolie, dans le regard de la petite. Mais le film vraiment matriciel pour àma Gloria, c’est Mary Poppins [de Robert Stevenson, 1965, ndlr]. C’est le premier film que j’ai vu au cinéma : j’ai découvert la joie, à 5 ans et demi, dans cette salle de la place de Clichy. J’étais hystéro. Mary Poppins, c’est l’histoire d’une nounou, et ça mélange des moments de fiction et d’animation [comme àma Gloria, ndlr]. En tant que gamine, j’avais une jubilation folle à l’idée qu’il y avait un autre monde et qu’on pouvait passer de l’un à l’autre, que c’était trop cool. Et puis, en grandissant, j’ai compris qu’il n’existait pas, cet autre monde. Il faut le fabriquer, ça coûte cher, et c’est un peu long. Mais j’ai fini par réussir à le faire !
Cinéma > Entretien © D. R. no 199 – été 2023 34
Votre toute jeune actrice, Louise MauroyPanzani, est une grande découverte ; elle joue des sentiments très forts. Où l’avezvous dénichée ?
Je n’ai pas un storytelling à la Ponette, je ne peux pas dire : « On a sillonné la France, on a vu quatre mille enfants et, dans le fin fond de l’Auvergne, on a trouvé une super petite. » Ça ne s’est pas du tout passé comme ça. En fait, Louise, c’est quasiment la première enfant que j’ai rencontrée. Ma directrice de casting est allée en face du bureau dans un parc, elle a vu Loulou en train de se bagarrer avec son frère, et elle s’est dit : « Ah ! elle a un petit caractère, celle-là ! Peut-être que… » Elle l’a ramenée au casting. Les parents étaient très méfiants au début et se sont révélés géniaux après : on n’aurait pas pu faire le film sans leur complicité bienveillante et intelligente. Donc elle a déboulé au casting, et, quand
quelqu’un de très drôle, et elle a fini par devenir la marraine de Louise. C’était assez émouvant : juste avant de venir à Cannes, on était au baptême. Sur le tournage, il fallait déjà entretenir le côté ludique parce qu’en fait, tourner avec un enfant, c’est dur, tu n’as que six heures de tournage max par jour, maquillage compris. T’as pas intérêt à déconner avec ça. Et puis ça a duré cinq semaines, c’était une course de fond. La grande question, c’était comment faire pour que Louise tienne ? Ce qui a été compliqué pour elle, c’était de comprendre qu’on ne tournait pas dans l’ordre. Ça, pour une enfant, c’est bizarre. Elle a fini par comprendre, quand on la remettait en situation et qu’elle faisait un effort de projection par l’imaginaire ; elle arrivait alors à se mettre dans un état. Et puis c’est une enfant qui a une grande écoute, une grande empathie.

ressentir ça. Il y a eu le choix de cette hauteur de caméra et de cette vision du monde. Ma monteuse et moi, on a inventé un format assez resserré qui permet, pour le spectateur, au hors-champ d’exister. À l’image, on voit des visages en gros plan, mais c’est pour mieux faire vivre le hors-champ ou l’invisible. Pareil pour le Cap-Vert : la grande question, c’était comment filmer ce pays en évitant une forme d’exotisme ; c’était un truc qui me stressait beaucoup. Revient l’idée du format : en fait, on ne montre pas, on suggère ; on ne fait pas voir, on laisse deviner. Donc c’est toi qui te fais ta représentation du CapVert. On ne peut pas dire que ce film soit un documentaire sur le pays…
Votre père, l’artiste français d’origine géorgienne Goudji, est orfèvre. Qu’est-ce que vos parents vous ont transmis ?
L’amour du cinéma ?
je l’ai vue, je ne peux pas t’expliquer. Je voyais à la fois une petite fille, un tout petit truc trop mignon de 5 ans et demi, et en même temps un physique qui n’était pas celui de l’enfant lisse, « parfait », et qui n’avait pas non plus le tic des personnages de films d’auteur, genre l’enfant sauvage. Elle avait une forme de normalité, et en même temps j’avais l’impression qu’elle avait 10 000 ans de plus que moi et qu’elle allait m’apprendre plein de trucs. On lui a ensuite fait rencontrer Ilça [Moreno, qui joue Gloria, ndlr], et, comme ça marchait bien entre elles, on a compris qu’on avait trouvé notre duo.
Comment l’avez-vous dirigée ?
Elle a lu le scénario avec sa mère : elle était d’accord avec l’histoire, on avait son consentement. J’ai demandé à mon amie d’enfance, Laure Roussel, de la coacher, car j’ai hyper confiance en elle. C’est
J’ai l’impression que c’est la qualité des grands comédiens, même s’ils ont 5 ans et demi. Quand elle joue les scènes, elle est vraiment attentive.
Au début de la séance du film, votre productrice Bénédicte Couvreur, qui produit aussi notamment les films de Céline Sciamma, a évoqué la question du point de vue en disant que vous y aviez été particulièrement attentives en fabriquant le film. Comment y avez-vous réfléchi ?
On a beaucoup parlé. On s’est d’abord dit que, comme l’héroïne avait 5 ans et demi, il fallait être à sa hauteur, retranscrire son point de vue à travers la mise en scène, à commencer par les sentiments. Pour moi, l’enfance, c’est la première fois de tout, tout est intense. T’es bouleversé, t’as jamais vécu ça ; l’amour que tu portes, il est fou. Tu n’as pas appris la distance, ni la mesure, ni à te contenir. Il fallait faire
Alors, on ne peut pas dire qu’on est sur une famille de cinéphiles. Par contre, mes parents sont très attachés aux arts plastiques. J’ai grandi dans un atelier d’orfèvre, près d’une forge. Mes journées, c’était donc le marteau, le métal et la forge – d’ailleurs, hier, pour la présentation du film, je portais des bijoux que j’avais faits moi-même, j’étais trop fière. J’ai vécu au rythme de l’atelier. Je n’ai jamais vu mon père prendre des vacances ou un weekend ni rentrer avant 21 h. Ce qu’il m’a transmis, c’est qu’il faut fabriquer, aller au bout, et que c’est en forgeant qu’on devient forgeron, littéralement. Il m’a aussi transmis la passion de faire émerger des formes. Pour lui, chaque pièce doit être originale, unique, c’est pour ça qu’il faut les faire à la main. Il m’a transmis ça, l’obsession de l’objet unique.
àma Gloria de Marie Amachoukeli, Pyramide (1 h 24), sortie le 30 août
PROPOS RECUEILLIS PAR TIMÉ ZOPPÉ
Photographie : Julien Liénard pour TROISCOULEURS

Entretien < Cinéma
35 été 2023 – no 199
« Dans l’enfance, tout est intense, bouleversant. »
MOTS-CROISÉS
« C’est assez rare de tomber sur des cinéastes qui réalisent un travail aussi personnel qu’Ira. Je sens quelque chose d’authentique dans ses films. Il n’a pas cette façon de penser très américaine, du genre “que faut-il retenir d’une œuvre ?”. Si les films étaient seulement réductibles à un message, s’il suffisait de lire un slogan pour les comprendre, pourquoi aller les voir ? Le cinéma doit ouvrir à des choses auxquelles on peut réfléchir, qu’on peut expérimenter. »

« Brillante étoile, que n’ai-je ta constance ? »
Todd Haynes, dans la rubrique « Queer Gaze », sur le site de TROISCOULEURS, avril 2023

« J’ai vu Mary Poppins à 3 ans. Il n’y a bien sûr rien d’ouvertement queer dedans… et, en même temps, peutêtre que c’est totalement queer. »
« Je savais que Todd Hayes aimait beaucoup ce film [Ben Whishaw a joué dans sa suite, Le Retour de Mary Poppins, en 2018, ndlr], mais je n’en ai jamais parlé avec lui. Pour moi aussi, ça a été le premier film. Mon père avait dû l’enregistrer en VHS. Je connaissais chaque moment, chaque chanson sur le bout des doigts. Je serais intéressé de demander à Todd pourquoi il le voit comme un film queer – parce que je suis vraiment d’accord avec lui. Mary Poppins semble inoffensive ; c’est une nounou, une profession pas forcément valorisée par la société. Mais elle est aussi complètement révolutionnaire, c’est une sorcière ! On ne peut pas la définir, elle est juste magique. Elle change le monde et ce que je préfère, c’est qu’elle ne s’explique jamais, elle est impénétrable et indépendante. »

Invité du Champs-Élysées
Film Festival en juin dernier, le magnétique acteur britannique y présentait Passages d’Ira Sachs (sorti le 28 juin), dans lequel il incarne avec finesse et fragilité un homme dont le compagnon se détache peu à peu pour aller vers une femme. L’occasion d’arpenter avec lui son parcours à travers des citations de poètes écorchés qu’il a incarnés (John Keats, Bob Dylan) ou d’artistes qui comptent pour lui (Ann Carson, Elizabeth Harrower).
William Shakespeare, Hamlet, vers 1600

« Cette phrase est géniale. Quand Hamlet la lance, c’est simple, en prose, ce n’est pas un pentamètre iambique [type de vers le plus fréquemment utilisé dans la poésie anglaise, composé de cinq syllabes, avec une atone suivie d’une accentuée, ndlr]. Et pourtant, on pourrait y penser à l’infini. Je m’en souviens quand j’ai besoin de me sortir d’une situation compliquée. Comme ça, je me convaincs que, si je suis dans la merde, c’est mon esprit surmené qui me plonge dedans… Hamlet, c’est important dans ma vie. C’est le rôle qui m’a fait connaître [il l’a joué à Londres en 2004 pour la Royal Shakespeare Company ; il était alors l’acteur le plus jeune – 23 ans – à avoir campé le rôle, ndlr]. J’avais l’impression de tout comprendre de ce type. Je savais que la pièce avait été écrite il y a quatre cents ans, mais je m’en sentais très proche. À travers Hamlet, j’ai parlé en tant que jeune vivant en Angleterre au début des années 2000. Maintenant que j’ai vieilli, je n’aurais plus la même intimité avec ce texte. »

« John Keats est très lié pour moi à Bright Star de Jane Campion [dans ce film sorti en 2010, Ben Whishaw incarnait le poète britannique, ndlr]. J’avais 27 ans. Je pourrais parler de Keats indéfiniment. Il est mort à 25 ans, et tout ce qu’il a accompli il l’a fait en l’espace de cinq ans. C’était quelqu’un d’ouvert aux doutes, au mystère, à l’incertitude aussi. Je suppose que c’est une qualité, de s’abandonner à l’inconnu. C’était l’espace poétique qu’il savait habiter. Cette citation évoque pour moi sa nature d’enfant rebelle, intranquille. »
Elizabeth Harrower, Un certain monde (Rivages, 2014)
« Le patriarcat doit être démoli : c’est un système fucked up aussi pour les hommes. Je suis conscient que je n’ai pas les attributs d’une masculinité classique, mais je suis à un stade de ma vie où je ne pense pas à ça. Je ressens une certaine liberté, je ne me soucie pas de la façon dont on me définit. »
« J’ai rencontré Elizabeth Harrower en Australie [légende de la littérature australienne, elle est morte en 2020, ndlr]. Je voulais adapter l’un de ses livres, The Long Prospect [roman psychologique publié en 1958, ndlr], ce qui n’a pas encore pu se faire. Il y a quelque chose dans ce livre qui m’obsède… J’ai besoin de faire ce film. Quoi qu’il en soit, elle était géniale. C’est l’une des rares personnes que j’ai rencontrées qui m’a fait me sentir comme un petit bébé. C’était pourtant l’artiste la plus gentille du monde. Son analyse des relations abusives, des dynamiques de pouvoir, sa façon d’approcher les tyrans, les psychopathes, leurs victimes, la manière dont les uns et les autres sont liés dans une sorte de danse hideuse, c’est extraordinaire. Cette citation est probablement prononcée par l’une de ses héroïnes, que j’imagine attirée, impuissante, par un homme narcissique. Elizabeth Harrower était intéressée par ça : pourquoi va-t-on parfois vers l’autodestruction ? »


36 no 199 – été 2023 Cinéma
BEN WHISHAW
« J’ai été attirée par l’étrangeté de son esprit, comme un psychiatre pourrait être séduit par un cas intéressant. »
Miriam Toews, Ce qu’elles disent (Buchet/ Chastel, 2019)
PROPOS RECUEILLIS PAR QUENTIN GROSSET
« Rien n’est en soi bon ou mauvais, à part si la pensée le rend tel. »
« Tous mes films sont des confrontations avec moimême. »
Ira
Sachs, entretien dans TROISCOULEURS, no 198, juin 2023
John Keats, « Le Dernier Sonnet » dans Poésies (Émile-Paul Frères, 1919)
« Le temps guérira nos cœurs meurtris, dit-elle. Notre but est d’assurer notre liberté et notre sécurité, et ce sont les hommes qui nous empêchent de l’atteindre. »
© Tomo Brejc
© D. R.
© D. R.
© D. R.
© D. R.
2017
© D. R.
© Metropolitan FilmExport
« Parfois, les acteurs arrivent sur le plateau et ils ont déjà tout prévu pour leur jeu. Ils ne veulent pas le détricoter, ils veulent juste qu’on les filme comme s’ils étaient seuls dans la scène. Ça me dérange beaucoup. »

« Je pense que les acteurs ont besoin d’une structure – mais, à l’intérieur de celle-ci, tout est improvisation. On ne sait jamais ce que l’acteur en face va faire, comment il ressent les choses, comment il comprend son personnage. Il faut être ouvert à tout. Jane Campion – qui a changé ma vie, ce n’est pas exagéré de dire ça – m’a beaucoup appris à ce sujet. Quand on est jeune acteur, on se prépare énormément à la maison, avant les auditions. Puis on apprend à lâcher la bride, à se mettre à nu, à devenir plus disponible au moment présent. Mais c’est difficile, parce qu’on s’est créé comme des défenses, des garde-fous. Il faut quelqu’un comme Jane pour vous dire : “Si tu veux que ton personnage soit vivant, laisse tomber tout ce que tu avais prévu en répétant devant ton miroir. Car personne ne veut voir ça.” Quand j’arrivais sur le plateau, j’étais terrifié. Enfin, non, pas terrifié, plutôt dans un état de nervosité et de curiosité. »



« Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais je crois que je le sens. J’aime les mots. Chaque fois qu’on me demande de lire de la poésie, je vois ça comme un grand privilège. Je pense que le langage est très dévalorisé aujourd’hui. Comme s’il était juste transactionnel. Alors qu’il peut tout à fait être lié à l’incantation, aux sortilèges, à la prière, toutes ces choses qui font le mystère du monde. Certains textes d’Anne me dépassent, mais je les aime quand même, je les ressens. Pour moi, c’est ça, la poésie, en fait. »

37 été 2023 – no 199 Cinéma 26 JUILLET
« Les mots nomment le monde. Les verbes activent les mots. Les adjectifs viennent d’ailleurs. »
Anne Carson, Autobiographie du rouge (L’Arche, 2020)
Jane Campion, entretien dans The Guardian, novembre 2021
© D. R.
© Peter Smith
AFFAIRE SENSIBLE
TINA SATTER

La cinéaste américaine captive avec son premier long métrage, Reality, thriller politique en trompel’œil qui chorégraphie la retranscription de l’interrogatoire par le FBI que Reality Winner, jeune femme de 25 ans, ancienne militaire, traductrice pour une entreprise sous contrat avec l’armée, a subi à son domicile. La réalisatrice nous parle de ce fascinant true crime (lire p. 63), qui se désintéresse de la culpabilité de son héroïne pour mieux disséquer les insidieux rapports de force genrés.
Vous avez d’abord adapté l’histoire de Reality Winner en pièce de théâtre. Pourquoi l’avoir portée à l’écran ?
La genèse du projet, c’est la découverte de ce script de l’interrogatoire par le FBI [le film respecte scrupuleusement la retranscription écrite de cet échange, enregistré par le FBI lors de la perquisition du domicile de Reality Winner, ndlr]. Ce document m’a fait l’effet d’une secousse. Dès la première page, on saisissait son aspect théâtral. Y étaient mentionnés les noms des « participants », comme s’il s’agissait des personnages d’une pièce : Reality, les deux agents du FBI, et un mystérieux « inconnu »… J’ai eu le sentiment de m’introduire dans un thriller, avec cet instinct qu’il fallait le transformer en matériau filmé. Mais comme je n’avais jamais réalisé de film, je l’ai d’abord monté en pièce à off-Broadway [Is This a Room a été un énorme succès en 2019, ndlr].
Il paraît que vous n’avez jamais écouté l’enregistrement original, mais seulement lu la retranscription. Ce matériau était tellement captivant que les mots se suffisaient à eux-mêmes. J’ai préféré laisser le champ libre à mon imagination. Cette jeune femme plongée au cœur d’un
scandale géopolitique est au centre du récit, et en même temps, elle ne comprend pas ce qui se passe : elle est vulnérable, surprise. Que se passe-t-il quand des inconnus investissent votre maison, pénètrent dans votre espace d’intimité ? À quel point c’est bizarre de voir quelqu’un entrer dans votre cuisine, votre salle de bain ? Il fallait scruter tous les détails de cette étrangeté. C’était aussi une façon d’esquisser une biographie implicite de Reality Winner, de faire entrer dans le cadre des éléments de sa vie impossibles à convoquer directement par la narration. Comme le script ne nous donne à comprendre que ses mots, la caméra, elle, devait faire comprendre ce qu’il y a d’implicite entre eux. La transcription écrite offrait une superbe occasion de scénographier l’intérieur de sa maison, avec tous ces détails incroyables de sa vie présents ce jour-là – son chien, son chat, ses journaux intimes, ses armes, ses photos…
Le film cultive un art du suspense avec quasiment rien – un huis clos, peu de personnages, des dialogues souvent banals. Comment avez-vous fait naître cette tension ?
Elle réside dans l’ascenseur émotionnel que ressent Reality, les sensations à huis clos qui l’ont traversée. Ça me fascinait de m’imaginer
comment, progressivement, elle comprenait ce pour quoi le FBI était là et se demandait si elle devait rester, obéir, etc. ; de traquer sa trajectoire intérieure et de trouver les bons emplacements de caméra pour lui donner un peu de subjectivité dans cet espace claustrophobe. Il fallait que le spectateur ressente lui aussi cet étau qui se resserre. Qu’il saisisse ce que c’est d’être une jeune femme qui doit rester dans un espace clos avec des hommes. Ces moments très forts devaient aussi créer une compassion chez le spectateur.
La première partie prend le contre-pied du film d’investigation : le rythme est indolent, Reality rentre du supermarché, c’est une après-midi ensoleillée dans une banlieue rassurante…
Ce point de départ me fascinait : la banalité de cette journée d’Augusta, en Géorgie, de cette maison témoin qu’elle loue. Je voulais montrer l’arrivée du FBI comme un basculement de cette existence morne vers la terreur. Car Reality, après ce moment, ne rentrera plus jamais vraiment chez elle… J’aime que le malaise surgisse d’un cadre normal, avec une tension sous-jacente. Je voulais aller à l’encontre de ce qu’on attend du thriller. J’aime beaucoup les films de Sofia Coppola,
38 no 199 – été 2023 Cinéma > Interview
« J’aime que le malaise surgisse d’un cadre normal. »
© David Goddard
qui sont traversés par des espaces féminins, émotionnels, logés dans la banlieue. Ils m’ont inspirée pour ce film. Chez cette réalisatrice, il y a une douceur, un côté implicite, comme un battement de cœur féminin que j’ai cherché à reproduire ici.

En même temps, Reality a des attributs souvent considérés comme masculins, qui menacent peut-être inconsciemment les agents du FBI.
Oui, c’est une ancienne militaire, très musclée, qui porte des armes et fait du sport de façon intensive. Elle a beaucoup en commun avec ces flics : elle partage leur jargon, elle est capable de parler sécurité… Elle a presque quelque chose de la butch [une personne de genre féminin qui adopte une apparence et un comportement socialement connotés comme masculins, ndlr], tout en étant girly – son arme est rose par exemple.
Quelles questions de mise en scène se sont posées pour filmer le small talk de la première partie ?
Je me suis mise dans la tête du personnage : d’un côté, elle pressent ce qui va se passer. De l’autre, elle doit être dans la performance et se dire : « OK, on va parler de sport pendant un petit moment. » Il fallait qu’elle se persuade un peu elle-même de la véracité de cette comédie. Sydney Sweeney a donné corps à cette performance, avec ses gestes tout en retenue, cette façon de poursuivre une conversation que tu pourrais presque avoir pendant un barbecue. Elle brasse du vide, parle de la pluie et du beau temps, mais son corps se met en alerte. C’est comme des choses discordantes qui s’entrechoquent.
J’adore cette idée qu’autour il se passe des trucs déments, que tout fout le camp, mais
que quand on se concentre sur le langage, tout est banal.
L’opacité du personnage de Reality repose sur l’actrice Sydney Sweeney, vue notamment dans les séries Euphoria et The White Lotus. Son jeu est à la fois naïf et très décidé, sarcastique et obéissant. Comment avez-vous travaillé ces contradictions avec votre actrice ?
C’est un personnage sauvage, et en même très docile, car c’est une soldate. On en a beaucoup parlé avec Sydney. Le choix de cette actrice était une évidence : elle a un art de la nuance, de l’ajustement. Sydney et Reality ont des parcours différents, mais elles partagent une même expérience de l’adversité, un passage à l’âge adulte précoce : elles évoluent dans des sphères professionnelles spécifiques, où se faire une place coûte cher, où il est difficile de s’imposer en restant soimême. Sydney a lutté pour devenir actrice, imposer sa singularité malgré l’image qu’on lui collait à la peau.
Le film semble emprunter les codes du film d’horreur paranoïaque lorsque l’héroïne consent presque à se faire séquestrer. C’est un genre auquel vous avez pensé ?
Pas beaucoup. Ma grande référence, c’est Michael Haneke. Ses films se déroulent dans un milieu social complètement différent, car très bourgeois. Mais je me suis inspirée de son cinéma qui est rempli d’espaces domestiques envahis. Chez lui, il y a une notion de sécurité qui est menacée, un usage très pervers des téléphones portables… C’est une angoisse qui vous prend au ventre par des petites choses, plutôt que de vous attaquer frontalement par l’évidence de l’horreur.
Vous utilisez plusieurs effets de postproduction et de montage (les personnages sont soudain effacés de l’image quelques secondes, des sons distordus viennent perturber la narration). Que vouliez-vous exprimer ici ?
C’était d’abord pour respecter l’étrangeté de la transcription. À la lecture, certains motsclés concernant des informations classées secret défense ont été censurés. En postproduction, l’idée était d’évoquer une situation de rapport de force. Le film parle d’une femme qu’on veut faire taire. Alors on s’est dit : « Pourquoi ne pas faire disparaître nos acteurs ? » On a trouvé l’idée puissante. Ensuite, il a fallu peaufiner le travail sur le son et les bruits pour maintenir l’attention des spectateurs. Ces glitches [des sauts sonores qui agissent comme des bugs et empêchent le spectateur d’entendre l’intégralité des dialogues, ndlr] forment une expérience à part entière. C’est une façon de faire sentir que la parole autour de cette affaire est censurée.
À mesure que le film avance, il creuse une forme d’oppression latente : celle exercée par des hommes de pouvoir sur cette femme. Avez-vous senti cette dynamique dès la lecture de la transcription ?
Oui, dès le premier « bonjour » de la transcription. C’est sans doute une projection de ma part, mais je me suis tout de suite imaginé que deux étrangers toquaient à ma porte… N’importe quelle femme comprendra instantanément cette frayeur. Cette question de genre s’est donc imposée de façon très claire. Les enquêteurs ont ses clés de voiture, son téléphone portable ; ils la cloisonnent dans un espace fermé. Il n’y a aucune femme pendant l’interrogatoire, jusqu’au moment où elle est fouillée à la fin.
Pensez-vous que Reality aurait écopé d’une peine de 5 ans, la peine la plus lourde jamais infligée à un lanceur d’alerte, si elle n’avait pas été une femme ?
La question est insoluble. Il y a beaucoup de facteurs d’explication à cette lourde peine. Je suis hantée par cette vidéo d’archive que nous avons insérée à la fin du film, dans laquelle deux hommes présentent le bulletin d’information sur l’arrestation de Reality : on y décèle clairement une persécution médiatique. La presse a utilisé ses journaux intimes, notamment en reprenant cette phrase qu’elle y avait écrite : « L’Amérique est la pire chose au monde. » Cette déclaration a été retournée contre elle. À ce que je sache, personne n’a fouillé ni divulgué les journaux intimes d’Edward Snowden. La presse a épinglé Reality comme une dangereuse criminelle – c’est une femme, donc une menace. Certains sous-entendaient qu’elle pourrait être une terroriste, parce qu’elle parlait le farsi, le dari et le pachto. On se demandait : « Pourquoi une femme qui gagne tant d’argent habite-t-elle dans une maison si modeste ? » Le sexisme s’insinue partout, et je vois là-dedans une misogynie implicite. C’est en tout cas une question de pouvoir – et bien sûr, l’accès aux postes de pouvoir est intrinsèquement lié au genre.
Reality de Tina Satter, Metropolitan FilmExport (1 h 22), sortie le 16 août
39 été 2023 – no 199 Interview < Cinéma
PROPOS RECUEILLIS PAR LÉA ANDRÉ-SARREAU
DUPIEUX À POIL
QUENTIN DUPIEUX

Avec Yannick, film-surprise dont l’existence a été soigneusement tenue secrète, Quentin Dupieux signe une passionnante comédie noire, dans laquelle un spectateur interrompt une mauvaise pièce de boulevard – intitulée Le Cocu – pour reprendre le spectacle en main. Le cinéaste nous parle de ce récit dépouillé, personnel et quasi réaliste qui tranche avec le reste de sa filmographie.
Comment est née l’envie de tourner votre nouveau film, Yannick ?
Elle est née l’année dernière à Cannes, après la projection de mon film Fumer fait tousser. Quand on est le créateur d’un film, le plaisir se dilue au fur et à mesure des visionnages. Et si cette projection cannoise était un super moment avec toute la distribution, moi, je m’ennuyais profondément, car je connaissais le film par cœur. Mais, lors du sketch dans lequel Blanche Gardin broie son neveu dans une machine – portion du film dans laquelle joue aussi Raphaël Quenard –, je me suis dit qu’il se passait un truc spécial. Et j’ai eu envie d’écrire pour Raphaël, acteur que je commence à bien connaître et que j’avais invité dans Mandibules avant qu’on commence à le voir partout. Je lui ai proposé de faire un film ensemble, un truc gratuit, entre nous. J’ai écrit le scénario assez vite dans la foulée. Blanche Gardin et Pio Marmaï ont rejoint le projet, et on a tourné très vite. Bon, Yannick a quand même été produit un peu dans les règles et pas de façon totalement pirate.
À l’origine, vouliez-vous faire un film pirate ?
Oui, je voulais faire autrement, en dehors des rails classiques de production. Je fais un film par an, avec une préparation sur plusieurs mois et une forme de confort. Là, j’avais envie de revenir à mes premières amours, c’est-àdire au film impossible. J’ai toujours au fond de moi ce truc qui brûle, ce goût du film qui ne devrait pas exister. Yannick est comme une sortie de route dans ma filmographie, c’est un objet à part. Le paradoxe étant que c’est concret comme cinéma, c’est une situation qui pourrait vraiment exister. Contrairement à mes derniers films avec une mouche géante [Mandibules, ndlr] ou un couloir temporel à la cave [Incroyable mais vrai, ndlr].
Comment avez-vous réussi à garder secrets la préparation et le tournage du film ?
On a caché ce film, car, déjà, on ne voulait pas qu’il perturbe le bon déroulement de la préparation de Daaaaaali ! [film sur la figure du peintre Salvador Dalí, que Quentin Dupieux a tourné en hiver dernier et qui sortira en 2024, ndlr]. Je ne voulais pas faire peur aux partenaires financiers en leur disant que
j’allais réaliser un autre film juste avant. On a donc gardé Yannick en dehors des radars, aussi pour le plaisir de faire une surprise au public.
Yannick est un personnage inquiétant, qui interrompt une pièce de théâtre avec un discours quasi poujadiste. Mais sa demande d’un spectacle de meilleure qualité s’avère au fond plutôt cohérente.
Il y a un truc marrant dans la gêne que crée l’interruption d’une représentation théâtrale. Parce que ça ne se fait pas. Yannick est un peu l’équivalent d’un relou sur Twitter, qui prendrait la parole dans la vraie vie. Ces gens que tout emmerde et qui déchargent leur frustration sur le web ne sont pas forcément des sociopathes en vrai. Et c’était intéressant d’imaginer que ce type n’est pas juste un haineux qui veut perturber une représentation ; il a un discours et il déroule une pensée. Et il a un vécu qui fait qu’il n’est franchement pas si con. Ce personnage me parle beaucoup pour ça : son discours remet en question la soirée de tout le monde. Comme j’ai écrit le rôle pour Raphaël Quenard, dont j’aime le
40 no 199 – été 2023
Cinéma > Entretien
« J’ai toujours au fond de moi ce goût du film qui ne devrait pas exister. »
phrasé, j’avais sa voix en tête en écrivant. C’était amusant de faire parler un spectateur, car ça n’arrive jamais.
Avez-vous tenu au réalisme du film en enlevant volontairement tout ce qui aurait pu être trop absurde ?
J’ai tellement fait de films qui reposent sur des principes absurdes avec des pirouettes et des jeux temporels que ça devenait soudain surprenant d’en réaliser un dans lequel il n’y avait pas tout ça. J’avais envie d’être un peu à poil, sans effets, pour explorer cet enjeu du temps réel, qui est une zone hyper dangereuse au cinéma. Il y a à peine deux ou trois ellipses dans le film, c’est rarissime. Il n’y a pas d’artifices, et le rythme des dialogues a lui aussi un aspect réaliste.
Ce réalisme engendre aussi progressivement une vraie émotion. Comme c’est de plus en plus le cas dans vos films.


Quand je tournais en anglais [Rubber, Wrong, Wrong Cops et une partie de Réalité, ndlr], je m’intéressais surtout à des sensations de cinéma, de montage, de musique. J’adorais bosser avec les comédiens, mais je ne m’attachais pas aux personnages. Depuis mon retour en France [avec Au Poste !, sorti en 2018, ndlr], je m’y intéresse davantage. On pourrait dire que Mandibules est le film le plus débile de la décennie, mais, si tu remplaces la mouche par un chien, ça devient un récit touchant. Avec Incroyable mais vrai, j’embrouille le truc avec un concept fantastique, mais c’est l’histoire d’une femme qui veut rajeunir et d’un mec perturbé par son boulot : un film social sur un couple. Yannick, qui est, au fond, mon film le plus normal et avec le moins d’artifices, a lui un angle « anti-fabriqué » et « anti-cinéma » qui fait que les comédiens vont en effet créer une émotion.
Après ce film, qui prend en compte une forme de souffrance contemporaine, pensez-vous aller un jour vers un cinéma ancré dans l’actualité, avec un point de vue politique ?
Alors, politiquement, je ne pense rien, déjà. Il y a des artistes qui s’en chargent et qui sont parfaits. Mais, comme tout le monde, je vois les infos, je reçois tous les pépins de l’époque, ils viennent à moi. Je ne vis pas dans une bulle, donc, quelque part, ça ressort de manière détournée, exactement comme dans Yannick. Et il n’est pas impossible que je trouve un autre ressort à un moment donné dans mon cinéma, pour parler davantage de notre époque. Dans Fumer fait tousser, il y avait plein d’échos à l’actualité, mais de manière tellement gadget que personne à la fin n’avait emmagasiné ces informations.
Allez-vous continuer sur le même rythme créatif ? Après Yannick et Daaaaaali !, que nous réservez-vous ?
Le prochain film est déjà écrit et sera a priori en anglais. C’est un peu plus gros que d’habitude, et ce sera encore un truc nouveau dans ma filmographie. Si on n’essaie pas de se renouveler, on s’ennuie.
SOUS LE TAPIS
PROPOS RECUEILLIS PAR

Entretien < Cinéma
©Photo FLORENT DRILLON
19 JUILLET AU CINÉMA
LE
“Un grand premier film entre rires et larmes”LE PARISIEN
HHH PREMIÈRE
DAMIEN LEBLANC
Yannick de Quentin Dupieux, Diaphana, sortie le 2 août
Photographie : Julien Liénard pour TROISCOULEURS
Avec
témérité, Claude Chabrol s’est emparé d’un projet inachevé d’Henri-Georges
L’ENFER, DE CLOUZOTÀCHABROL

Clouzot, un film noir centré sur la jalousie masculine. La version de Chabrol, sortie en 1994, est visible sur mk2 Curiosity cet été, ce qui nous a donné envie de croiser les visions de ces cinéastes de génie, et de voir ce qu’il en reste aujourd’hui.

Dans les studios de Boulogne, 1964. Sous des spots si puissants qu’ils en deviennent aveuglants, Romy Schneider ne peut plus résister : après avoir donné à la caméra aussi longtemps qu’elle le pouvait un regard frondeur, séducteur, elle cligne des yeux, les plisse. Puis les rouvre. À d’autres moments, on la voit enduite d’huile, recouverte de paillettes, enfermée dans un cercueil de verre, placée sous des couleurs phosphorescentes (du vert, du rose…). Elle accepte docilement tout ce que lui demande le grand cinéaste tourmenté Henri-Georges Clouzot (Les Diaboliques, 1955 ; La Vérité, 1960), qui planche alors sur L’Enfer, un film à l’ambition démesurée. Les images du film, aussi sublimes que démentes, proviennent du documentaire
L’Enfer d’Henri-Georges Clouzot de Serge Bromberg et Ruxandra Medrea (2009) – les
réalisateurs ont retrouvé cent quatre-vingtcinq boîtes de bobines, treize heures de pellicule, introuvables depuis des décennies –, qui ressuscitait ce projet en or massif (selon le chef-opérateur William Lubtchansky, Clouzot aurait eu droit à un budget illimité, offert par les responsables de la légendaire société de production américaine Columbia, impressionnés par les premiers tests). Ces essais ont eu lieu avant un tournage catastrophique, qui a épuisé toute l’équipe, assommée par les revirements incessants de Clouzot, alors grandement influencé par les jeux d’optique hallucinatoires de l’op art. Au bout de quatre jours seulement, Serge Reggiani, qui devait jouer le rôle masculin principal, claque la porte, en prétextant avoir contracté la maladie de Malte (en réalité, une belle dépression). Romy tient le coup, mais c’est Clouzot lui-même qui chancelle : il est victime d’un infarctus après trois semaines de tournage. Le projet faramineux finit à la poubelle. Mais, au début des années 1990, le producteur Marin Karmitz – fondateur de mk2, société qui édite ce magazine –, qui vient de récupérer les droits du film de Clouzot, propose à Claude Chabrol, dont il a produit les films Poulet au vinaigre (1985) ou Madame Bovary (1991), et qu’il sait friand de films noirs, d’adapter le scénario de L’Enfer. Ce que le cinéaste accepte. Qu’a-t-il gardé ? De quoi s’est-il délesté ? En somme, comment a-t-il évité la malédiction ?
CLOUZOT VS CHABROL
Le scénario de L’Enfer nous emmène dans les tréfonds de la jalousie d’un homme (Marcel chez Clouzot, interprété par Reggiani ; Paul chez Chabrol, interprété par François Cluzet), qui tombe amoureux d’une femme d’une grande beauté (Odette chez Clouzot, jouée par Romy Schneider ; Nelly chez Chabrol, jouée par Emmanuelle Béart). Ils se marient, ont un enfant et tiennent une auberge de plus en plus populaire, car située dans une région prisée (près du viaduc de Garabit, dans le Cantal, chez Clouzot ; dans la ville de Castelnaudary, en Occitanie, chez Chabrol).
Les premiers temps du mariage sont idylliques – nul besoin de s’y appesantir, ce que traduisent les ellipses et les dézooms intempestifs de Chabrol. Avant que le mari, insomniaque, ne commence à voir en sa femme une séductrice, prête à briser l’équilibre de leur mariage – il est alors assailli de visions irrationnelles. Clouzot imaginait un traitement particulier pour son film : une partie « réalité », en noir et blanc, et une partie qui retranscrit les délires schizo de Marcel, en couleurs. L’idée est de créer un espace de « non-sécurité visuelle », comme le qualifie Joël Stein, engagé pour les effets lumière (propos rapportés du documentaire de Bromberg et Medrea). Fasciné par la musique electro-acoustique, Clouzot veut aussi mettre la création sonore en avant, en multipliant les manipulations de voix. Hormis un suivi assez scrupuleux des répliques, des éléments de l’intrigue, et quelques clins d’œil (la présence au casting des deux films de l’acteur Mario David, par exemple), Chabrol a retiré du scénario de Clouzot toute sa dimension psychédélique, amenant le récit vers quelque chose de plus naturaliste, populaire, accessible (ce qui lui donne un petit côté « téléfilm du dimanche soir »). Dans sa version, le cinéaste de la Nouvelle Vague joue avec une étonnante légèreté sur des panoramiques, des travellings énergiques (les courses de Paul pour rattraper et surveiller sa femme, qui fait du ski nautique avec un autre), des plans d’extérieur qui se

42 no 199 – été 2023 Cinéma > Histoires du cinéma
© D. R. © Jérémie Nassif
Romy Schneider dans L’Enfer d’Henri-Georges Clouzot
François Cluzet et Emmanuelle Béart dans L’Enfer de Claude Chabrol (1994)
ie N a s s i f
Emmanuelle
BéartdansL’EnferdeClaude Chabrol(1994) ©Jérém
laissent grignoter par des plans d’intérieur, des perspectives… Cette démarche de simplification donne l’impression qu’il a pris des précautions pour se prémunir de la malédiction. Ce qui, semble-t-il, est aussi passé par une communication avec l’au-delà : « J’étais un peu inquiet parce que, les trois premiers jours de tournage, il a fait un temps de cochon […]. J’ai vraiment eu peur que Georges [Henri-Georges Clouzot, ndlr], de là-haut, nous envoie des hallebardes. Mais finalement […] il a compris que je n’étais pas du tout plein de mauvaise volonté à son égard », expliquait-il sur le plateau d’Apostrophes, en 1994. Reste que les deux projets ont un noyau dur commun : l’étude poussée d’une jalousie masculine dangereuse qui nous parle toujours aujourd’hui.
UNE HISTOIRE SANS FIN

« Le départ de ce film est une histoire d’insomnie. J’ai eu une idée : explorer cette espèce de malaise anxieux qui me prend chaque nuit et m’empêche de dormir », avait confié Clouzot à la télévision, avant le début du tournage de son film (extrait montré dans le documentaire de Bromberg et Medrea). La force de L’Enfer tient en grande partie à son caractère introspectif – si Clouzot ne se filme pas lui-même, il s’étudie intensément, plus que jamais auparavant. La matrice de L’Enfer est là, dans le pli des visions troubles d’un homme qui n’arrive pas à fermer l’œil. Ce dernier pallie cette impuissance (camouflée dans le film par une peur profonde d’être trompé, donc « démasculinisé ») en se remplissant l’esprit d’images mentales délirantes. Mais, ce qui frappe le plus dans le scénario, c’est sa manière de faire évoluer le regard que le spectateur porte sur Odette/Nelly, qui passe de lolita aguicheuse, avec ses décolletés et autres cachecœurs, à victime, sans l’ombre d’un doute (une réalité présente depuis le début, mais étouffée par le regard du personnage masculin). En creux, le scénario documente les étapes qui mènent au féminicide (en l’occurrence, le féminicide conjugal), si répandu dans la société qu’il dépasse le cadre individuel. À la fin de son film, éreintant, Chabrol en remet une couche, affichant sur un carton ces mots tranchants : « Sans fin. » Presque soixante ans après l’abandon de Clouzot, et trente ans après la sortie du Chabrol, on ne peut qu’arriver au constat que l’enfer est bien là, et le paradis bien loin.
SORTIE LE 30 AOÛT


43 été 2023 – no 199 Histoires du cinéma < Cinéma
JOSÉPHINE LEROY
L’Enfer de Claude Chabrol, à voir sur mk2 Curiosity
ARLES, EN MODE CINÉMA
Chaque été, aux Rencontres d’Arles, une flopée d’expositions photographiques se déploient sur une vingtaine de lieux. Bonne nouvelle pour les cinéphiles que nous sommes : la cinquante-quatrième édition, qui se poursuit jusqu’au 24 septembre, met à l’honneur les multiples croisements entre photographie et cinéma. On peut ainsi s’émerveiller devant les clichés réalisés par de grands cinéastes comme Agnès Varda ou Wim Wenders, ou plonger dans les archives émouvantes dont s’est inspiré Sébastien Lifshitz pour tourner son documentaire Casa Susanna, diffusé sur Arte jusqu’en octobre. On peut aussi admirer les images vibrantes de Gregory Crewdson, qu’on jurerait tirées d’un film, et visiter les plateaux des tournages de Jacques Rivette, Georges Franju ou François Truffaut grâce aux photographies prises par Pierre Zucca… Morceaux choisis.
DEUX FOIS VARDA
Agnès Varda, Filets de pêche à la Pointe courte, 1953 (Avec l’aimable autorisation de la Succession Agnès Varda)

Agnès Varda, Jouteurs à Sète, 1952 (Avec l’aimable autorisation de la Succession Agnès Varda / Collection Rosalie Varda)
Agnès Varda, Mains complices. Koo et Hans Ulrich, 2019 (Avec l’aimable autorisation de la Succession Agnès Varda)
Agnès Varda, Stylo sur note Post-it, 2018 (Avec l’aimable autorisation de la Succession Agnès Varda / Hans Ulrich Obrist)
Deux expos arlésiennes mettent à l’honneur la cinéaste, photographe et plasticienne Agnès Varda, l’une des pionnières de la Nouvelle Vague. L’exposition « La Pointe courte, des photographies au film » dévoile ses images de Sète, ville à laquelle elle vouait un attachement particulier. On peut notamment y voir des photos du quartier populaire de l’étang de Thau, où sera tourné son premier film, en 1954, des planches-contacts lui ayant servi de support et d’inspiration pour passer à la réalisation. Une seconde exposition part des archives de Hans Ulrich Obrist, historien et critique d’art, qui a introduit Varda dans le milieu de l’art contemporain. Cette sélection de documents s’attarde donc sur une dimension moins connue de l’œuvre de Varda, sa vie d’artiste visuelle : affiches, montages, citations griffonnées sur un Post-it, croquis de Hans Ulrich Obrist…
Cinéma > Portfolio
1 3 4 2 1
44 no 199 – été 2023
COPÉLIA MAINARDI



Portfolio < Cinéma 4 2 3 45 été 2023 – no 199
L’AMI POLAROID
Wim Wenders, L’Ami américain en personne (Avec l’aimable autorisation de l’artiste / Fondation Wim Wenders)

6

5 no 199 – été 2023 46
7 Cinéma > Portfolio
Wim Wenders, Dans l’abîme sous la rivière Elbe (Avec l’aimable autorisation de l’artiste / Fondation Wim Wenders) 5
Dans l’exposition « Mes amis Polaroid », le cinéaste allemand Wim Wenders raconte combien ce précieux appareil photo instantané l’accompagnait durant ses tournages, en était la mémoire, permettant d’assurer la continuité du script à travers les différentes scènes. Lieux, acteurs, répétitions, les prises finissaient épinglées au mur du bureau de production, détaille-t-il. Jusqu’à investir le scénario lui-même. Dans son film L’Ami américain, sorti en 1977, le héros joué par Dennis Hopper se sert d’un Polaroid. Objectif braqué sur lui, il réalise à l’aveugle une série d’autoportraits… Bien avant l’ère du selfie.
LA FABRIQUE DES IMAGES
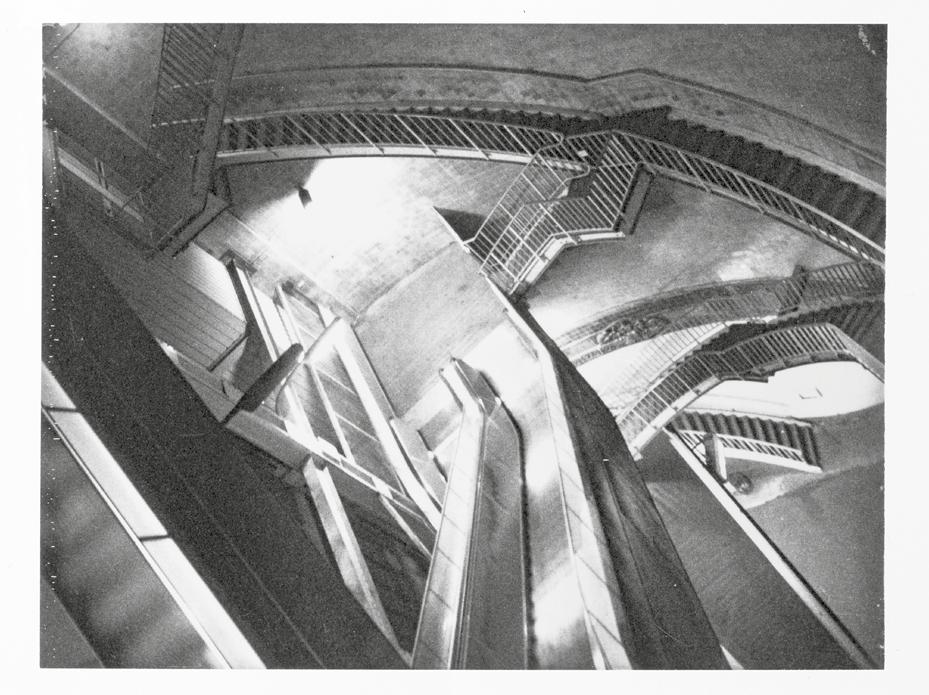
Pedro Costa, Caderno Casa de lava (Photos de Pedro Costa et du film de Georges Franju Les Yeux sans visage [1960])
Bertrand Mandico, Deux bombes accueillent l’homme, 2014 (Avec l’aimable autorisation de l’artiste)
Découper et assembler images, timbres, cartes postales, dessins, coupures de presse… Le scrapbooking, pratique de collage au croisement de l’album photo, du journal intime et du cahier d’inspirations, offre de multiples possibilités créatives. De nombreux cinéastes s’y sont essayés : Derek Jarman, Jim Jarmusch, Chris Marker, Pedro Costa, Stanley Kubrick, Bertrand Mandico… L’exposition « Scrapbooks, dans l’imaginaire des cinéastes » rassemble certaines de ces œuvres fascinantes. Un voyage dans l’autofiction et dans les coulisses de la création, où le cinéma se lit partout en creux, et qu’on prolonge avec délice grâce à un beau livre publié pour l’occasion.


> Scrapbooks. Dans l’imaginaire des cinéastes de Matthieu Orléan (Delpire & co, 232 p., 49 €)


7 8 8 Portfolio < Cinéma 47 été 2023 – no 199
CINÉMA
6
AU
LE 2 AOÛT
EN LIEU SÛR
Anonyme, Susanna à côté de l’enseigne Casa Susanna, 1964-1968
(Collection Art Gallery of Ontario, Toronto.
Grâce aux généreux dons de Martha LA McCain, 2015. © AGO)
Anonyme, Photo Shoot avec Lili, Wilma, et des ami·e·s, Casa Susanna, 1964-1967

(Collection Art Gallery of Ontario, Toronto.
Grâce aux généreux dons de Martha LA McCain, 2015. © AGO)
COMME AU CINÉMA
C’est une collection amateure de plus de trois cents photographies découverte par deux antiquaires en 2004 qui dévoile l’histoire inédite d’une communauté de travestis, dans l’Amérique des années 19501960. Des pères de famille ordinaires de la classe moyenne blanche américaine se réunissaient en secret à la « Casa Susanna » pour se travestir en femmes au foyer tout aussi respectables. Soixante ans plus tard, le réalisateur Sébastien Lifshitz a retrouvé deux membres de cette communauté clandestine, Kate et Diana, qui racontent devant la caméra combien ce lieu d’affranchissement a changé leur vie. Cachée dans un havre montagneux de l’État de New York, ce domaine était l’endroit safe où ce réseau clandestin (premier réseau transgenre de l’histoire queer de l’Amérique !) pouvait échapper au climat puritain de l’époque. L’exposition du même nom révèle combien la photo y tenait lieu de rituel, permettant la construction d’une identité de genre à la fois personnelle et collective.



11 12
9
9
10 10
Gregory Crewdson, Starkfield Lane, 20182019 (Avec l’aimable autorisation de l’artiste) Gregory Crewdson, Morningside Home for Women, 2021-2022 (Avec l’aimable autorisation de l’artiste)
11 12 Cinéma > Portfolio no 199 – été 2023 48
Casa Susanna de Sébastien Lifshitz, à voir sur arte.tv
Trente ans déjà que Gregory Crewdson s’emploie à brosser le portrait d’une Amérique sans gloire, celle de classes moyennes aspirant à un american dream qui tourne à vide. L’exposition « Eveningside » est le résultat de dix ans de travail. Lumières pâles, rues désertées, ambiances crépusculaires : ses images oniriques, sublimes, déploient une puissance narrative très cinématographique. Deux séries, « Cathedral of the Pines » et « An Eclipse of Moths », permettent une percée dans l’intimité de l’artiste : il y photographie des lieux liés à sa vie et à celle de sa famille.























49 été 2023 – no 199 Portfolio < Cinéma
INSTANTANÉS DE TOURNAGES
Pierre Zucca, Judex de Georges Franju, 1963 (Avec l’aimable autorisation de la Succession
Pierre Zucca)
Pierre Zucca, Out 1 de Jacques Rivette, 1970 (Avec l’aimable autorisation de la Succession

Pierre Zucca)
Comment réhabiliter la photographie de plateau, grande absente des histoires de la photo et du cinéma ? S’il n’est pas simple de traduire la durée et le mouvement d’un plan en une image, cette pratique demeure un objet de référence artistique et un support de diffusion de la culture essentiel. L’exposition « Théâtre optique » rend hommage à ce genre photographique méconnu, « image matière » à la croisée de la science et de la publicité, retouchée par les agences de presse avant de devenir photo d’exploitation. Le photographe Pierre Zucca s’intéresse ici aux débuts de la photo, ramenant la pose longue sur le devant de la scène, et compose des tableaux qui suspendent le récit des films en question – ceux de Jacques Rivette, de Jean Eustache, de François Truffaut…

50 no 199 – été 2023
13 13 14
14 Cinéma > Portfolio



TABO TABO FILMS et BANDE À PART FILMS présentent un film de Frédéric MERMOUD Suzanne JOUANNET Marie COLOMB Maud WYLER PHOTO ©2023 JEAN-CLAUDE LOTHER AFFICHE ©2023 PYRAMIDE, LOUISE MATAS au cinéma le 9 août
Grande
Film Festival MARILYNE CANTO LORENZO LEFEBVRE CYRIL METZGER ALEXANDRE DESROUSSEAUX ANTOINE CHAPPEY SCÉNARIO ANTON LIKIERNIK FRÉDÉRIC MERMOUD ET SALVATORE LISTA IMAGE TRISTAN TORTUYAUX MONTAGE SARAH ANDERSON MUSIQUE ORIGINALE AUDREY ISMAËL SON BALTHASAR JUCKER, ÉTIENNE CURCHOD ÈRE ASSISTANTE RÉALISATEUR SOPHIE DAVIN CASTING OKINAWA GUERARD, VALÉRIE TRAJANOVSKI DIRECTION DE PRODUCTION DAMIEN GRÉGOIRE DÉCORS PASCALINE PITIOT COSTUMES ALICE CAMBOURNAC CHARGÉE DE DÉVELOPPEMENT JESSICA ROSSELET UN FILM PRODUIT PAR VÉRONIQUE ZERDOUN, JEAN-STÉPHANE BRON ET LIONEL BAIER UNE COPRODUCTION FRANCO SUISSE TABO TABO FILMS, BANDE À PART FILMS ET AUVERGNE-RHÔNE-ALPES CINÉMA EN ASSOCIATION AVEC PYRAMIDE AVEC LE SOUTIEN DE CANAL+ AVEC LA PARTICIPATION DE CINÉ+ AVEC LA PARTICIPATION DE TV5MONDE AVEC LA PARTICIPATION DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES EN PARTENARIAT AVEC LE CNC EN ASSOCIATION AVEC COFIMAGE 34, CINEVENTURE 8, INDÉFILMS 11 DÉVELOPPÉ AVEC LE SOUTIEN DE LA PROCIREP, PICTANOVO ET LA RÉGION GRAND EST AVEC LE SOUTIEN DE L’OFFICE FÉDÉRAL DE LA CULTURE (OFC ET DE CINÉFOROM ET LA LOTERIE ROMANDE EN COPRODUCTION AVEC LA RTS RADIO TÉLÉVISION SUISSE AVEC LE SOUTIEN DE SUCCÈS PASSAGE ANTENNE SRG SSR AVEC L’AIDE DE SUISSIMAGE ET LA PARTICIPATION DE FRENETIC FILMS DISTRIBUTION FRANCE PYRAMIDE DISTRIBUTION VENTES INTERNATIONALES PYRAMIDE INTERNATIONAL
Piazza
Locarno
« la Naissance d’une vocation, le récit d’une ascension »
Jérôme Garcin - L’OBS HHHH
LE GUIDE DES SORTIES CINÉMA PAR
STRANGE WAY OF LIFE
« Cela pourrait être ma réponse à Brokeback Mountain », a déclaré Pedro Almodóvar au média américain IndieWire à propos de ce court métrage en langue anglaise, produit par la maison Saint Laurent. Le cinéaste madrilène s’empare de la mythologie américaine pour tordre le western, lui insufflant sa folie et ses sentiments exacerbés.
Qu’aurait donné Le Secret de Brokeback Mountain (2006), l’un des premiers et plus forts succès mainstream à thématique gay du cinéma, s’il avait été tourné par Pedro Almodóvar – un temps pressenti pour le réaliser à la place d’Ang Lee ? Strange Way of Life ne nous donnera qu’un début de réponse. Même si le film est court, qu’on a l’impression que tout pourrait commencer là où il se termine, il permet au cinéaste pas mal d’espièglerie et d’excentricité. La première d’entre elles, c’est de tirer le western vers le mélo : profiter des grands espaces américains pour les investir de sentiments intenses et fous. Pedro Pascal y joue un cowboy sur le retour : il a traversé le désert pour retrouver son ancien amant devenu shérif, joué par Ethan Hawke. Vingt-cinq
ans plus tôt, ils étaient tous deux tueurs à gages, mais la vie les a séparés. Et leurs retrouvailles ne sont pas faciles : le shérif est à la recherche du fils de son ancien boyfriend secret, mis en cause dans un crime… Bien sûr, un des grands plaisirs est de voir Pedro Pascal et Ethan Hawke, les deux daddies sexy du moment, jouer avec l’image du cowboy viril et taciturne, soudain teintée de romantisme transi. Les voir ensemble se laisser gagner par leur passion dévorante nous satisfait déjà pleinement – même si, pour être honnêtes, on aurait aimé que ce soit un peu plus chaud. Mais la vraie réussite du film, c’est de se rendre compte à quel point, même sur la forme courte, l’inventivité d’Almodóvar est intarissable lorsqu’il s’agit de nous régaler
d’images déjà indélébiles, parce qu’aussi excessives qu’éperdues. De Strange Way of Life, on retiendra donc ce plan d’un cowboy au regard affolant se livrant à un fado langoureux en play-back au tout début du film, et surtout ce flash-back, une scène de prébaise incroyable dans laquelle un tonneau de vieille vinasse se déverse sur les amants trempés d’amour.
Strange Way of Life de Pedro Almodóvar, Pathé (31 min), sortie le 16 août

52 Cinéma > Sorties du 19 juillet au 30 août no 199 – été 2023
SORTIE LE 16 AOÛT
QUENTIN GROSSET
SOLAIRE
Anna Castillo

“ LE PORTRAIT
Un film de Jaime Rosales D’UNE JEUNE FEMME
D’AUJOURD’HUI ” TÉLÉRAMA
Dans l’audacieux premier documentaire de Justine Harbonnier, Caiti Lord donne de la voix et offre une nouvelle représentation de l’Amérique. Une œuvre salvatrice, qui faisait partie des bijoux sélectionnés à l’ACID à Cannes cette année.

Au milieu des paysages désertiques de Madrid, ancienne ville fantôme du sud-ouest des États-Unis, se trouve Caiti, 30 ans, serveuse dans un bar et animatrice d’une radio locale, qui peine à joindre les deux bouts. Étouffée par le poids du quotidien, les dettes à rembourser et l’ambiance morose de l’Amérique de Donald Trump, elle rêve de vivre de sa musique… Avec Caiti Blues, Justine Harbonnier réinvente l’écriture documentaire en s’immergeant dans l’intimité de son sujet, la résiliente Caiti Lord à la voix puissante. Se rapprochant d’une mise en scène de fiction, la réalisatrice construit
CAITI BLUES
SORTIE LE 19 JUILLET
un écrin sur mesure pour sa protagoniste, la laissant évoluer dans son quotidien sans jamais la faire interagir avec la caméra. Seuls de doux moments de débordement de joie (une proposition de date, l’obtention d’une audition) viendront rappeler le côté documentaire du long métrage, offrant une preuve touchante de la complicité qui lie les deux femmes. Au-delà du simple portrait d’une jeune adulte désabusée par le rêve américain, c’est un hommage aux pouvoirs salvateurs de l’art que propose Justine Harbonnier, en plaçant la musique (composée et interprétée par Caiti Lord elle-même) au cœur du récit. Les paroles des chansons découpent ainsi le film en chapitres, naviguant entre différents moments de la vie de Caiti et soulignant son évolution : de ses rêves d’enfance, représentés par des vidéos d’ar-
chives familiales, à sa bataille contre l’alcool, contée en musique. Passant de Hollywood à Hollyweird, Justine Harbonnier porte à l’écran la représentation d’une contreculture à travers l’histoire de son héroïne, qui se réenchante dans une Amérique de la marge. Un tableau qui trouve son apogée dans un hommage musical au Rocky Horror Picture Show, comédie horrifique des années 1970 devenue culte, avec une reprise électrique de « Sweet Transvestite ». Sublime.
Caiti Blues de Justine Harbonnier, Shellac (1 h 24), sortie le 19 juillet
CHLOÉ BLANCKAERT
Caiti se réinvente dans une Amérique de la marge.
Trois questions
Quand avez-vous eu l’idée de filmer Caiti ?
Je l’ai rencontrée en 2013. En l’entendant chanter pour la première fois, ça m’a tout de suite inspirée. Trois ans plus tard, en pleine période sombre après l’élection de Donald Trump, je suis retournée la voir dans l’idée de la filmer pour voir comment le politique pouvait transparaître dans l’intime.
Comment s’est déroulé le tournage du documentaire ?
J’ai filmé Caiti quatre fois entre 2017 et 2020. La narration repose sur des événements du quotidien, mais les choses étaient assez planifiées. Quand on tournait, on savait qu’il pouvait se passer quelque chose. Il y a aussi eu un travail de remise en scène, pour
À JUSTINE HARBONNIER
provoquer certaines choses que j’avais vues mais que je n’avais pas pu filmer.
Pourquoi avoir fait le choix d’une forme documentaire plus libre ?
Je voulais accéder à l’intimité de Caiti de manière sincère, autrement que par l’interview face caméra. Grâce à sa musique et à ses chroniques radio, elle livre ses pensées d’une manière très cinématographique. Il y a bien quelques moments où elle interagit directement avec la caméra, mais c’est toujours à son initiative.
54 Cinéma > Sorties du 19 juillet au 30 août no 199 – été 2023
LES OMBRES PERSANES
SORTIE LE 19 JUILLET
L’Iranien Mani Haghighi (Pig, Valley of Stars) met entre parenthèses le ressort satirique et provocateur de son cinéma pour livrer un pur thriller mental reprenant habilement à son compte le motif on ne peut plus cinégénique du doppelgänger.

Alors que le dernier long métrage de Mani Haghighi, Pig (2018), singeait malicieusement un système de censure – dont le réalisateur fera d’ailleurs lui-même les frais lorsque, à l’automne 2022, il sera privé de son passeport alors qu’il devait se rendre à un festival de cinéma à Londres pour y présenter son film –, la scène inaugurale de son nouveau long, filmant une pluie ininterrompue qui s’abat sur Téhéran, installe d’emblée une atmosphère inquiétante à la lisière du fantastique. Une scène déroutante en guise de
note d’intention, dans laquelle la caméra, furtive, se faufile entre des voitures prises dans un embouteillage monstre et se rapproche de véhicules abritant des silhouettes masquées par la pluie battante, avant de jeter finalement son dévolu sur le visage éreinté de Farzaneh (Taraneh Alidoosti). À travers le pare-brise, elle croit reconnaître son mari, Jalal (Navid Mohammadzadeh, qui donnait déjà magistralement la réplique à l’actrice dans Leila et ses frères de Saeed Roustaee en 2022), et décide de suivre ce double mystérieux dont la femme se révèle être, quant à elle, la copie conforme de Farzaneh… Lorgnant plutôt du côté d’Enemy de Denis Villeneuve (2013) que d’Us de Jordan Peele (2019), le film brouille les identités et instille l’incertitude, voire la paranoïa, en multipliant les clairs-obscurs, en filmant sous tous ses angles la cage d’escalier de l’immeuble où réside cet autre couple – pour ne pas dire ce « couple d’autres » –, accentuant ainsi le vertige des symétries. Les combines pour faire coexister les doubles dans le même cadre ne sont pas d’une originalité folle, mais n’en demeurent pas moins efficaces, d’autant qu’Alidoosti et Mohammadzadeh s’emploient
à sauter d’un personnage à l’autre par de subtiles variations, brouillant les cartes à mesure que la peur et le désir s’invitent dans l’équation. La frontière entre les identités ne tiendra alors plus qu’à un tissu de signes que le spectateur s’amusera à démêler. Adepte du mélange des genres et de l’autodérision, Mani Haghighi opte en fin de compte pour un style plus épuré, tout en se maintenant dans cet entre-deux ténu entre onirisme et réalisme psychologique. Troublant.
Les Ombres persanes de Mani Haghighi, Diaphana (1 h 47), sortie le 19 juillet
FÉLIX TARDIEU
55 Sorties du 19 juillet au 30 août <---- Cinéma été 2023 – no 199
Le film brouille les identités et instille l’incertitude, la paranoïa, en multipliant les clairs-obscurs.
RENDEZ-VOUS À TOKYO
SORTIE LE 26 JUILLET
Au cœur de Rendez-vous à Tokyo, il y a une date : le 26 juillet, jour de l’anniversaire de Teruo (Sosuke Ikematsu, attendrissant), jeune danseur dont les rêves sont brutalement brisés par un accident. C’est aussi la date de sa rencontre avec Yo (merveilleuse Sairi Itoh), jeune chauffeuse de taxi qui voue un culte au personnage de Winona Ryder dans le

film Night on Earth de Jim Jarmusch (1991), qui pourrait bien être son alter ego. C’est également un 26 juillet qu’ils se sont dit leur premier « Je t’aime », que Teruo a pensé à la demander en mariage, puis qu’ils se sont séparés… Pour raconter cette histoire d’amour vouée à l’échec, le réalisateur japonais opte pour un parti pris audacieux : une narration à rebours, retraçant l’histoire de ce couple, de leur rupture à leur rencontre. En capturant leur journée du 26 juillet, sept années de suite, le cinéaste dynamise le genre trop convenu de la comédie romantique et esquisse un tableau humaniste et tendre dans lequel il s’amuse à glisser des indicateurs discrets du temps qui passe. Dans la veine de Julie (en 12 chapitres) de Joachim Trier (2021), Rendez-vous à Tokyo est un hommage vibrant à l’amour et à ce qu’il nous reste une fois les sentiments disparus. Le remède parfait pour guérir toutes nos peines de cœur.
LES MEUTES
Suivant les péripéties d’un père et d’un fils qui cherchent à sauver leur peau le temps d’une nuit dans les faubourgs de Casablanca, le premier long métrage de Kamal Lazraq, présenté à Cannes en sélection Un certain regard, impressionne par son grisant mariage de noirceur criminelle et d’humour absurde.
À la manière des plus grands films noirs, Les Meutes démarre dans l’univers des combats de chiens à Casablanca, où la brutalité de la pègre nocturne et la sécheresse de visages patibulaires se détachant dans l’obscurité frappent immédiatement l’attention. À la suite de la mort de son chien, un gangster local charge un quinqua et son fils de kidnapper un homme, mais la mission tourne mal. C’est, pour ces deux petits délinquants sans le sou, le début d’un engrenage qui les forcera à parcourir durant une longue nuit les bas-fonds de Casablanca pour
tenter de survivre… Si la trame peut évoquer le cinéma des frères Coen (Sang pour sang, Fargo), cette virée trouve sa propre identité grâce à un sidérant sens du tragique mâtiné d’absurdité mystique. Porté par des acteurs marocains non professionnels, le film s’ancre dans un réalisme social qui lui permet de déployer ensuite un récit à la lisière de l’hallucination, dans lequel la superstition engendre chez les protagonistes une crainte d’être maudits pour leurs actes. Insistant sur la manière dont le père prend constamment de mauvaises décisions auxquelles son fils accepte de se plier par respect, cette fable sur la difficulté à s’affranchir des poids sociétaux fascine jusqu’au bout par sa vision tranchante et ironique des déterminismes criminels et existentiels.


56 Cinéma > Sorties du 19 juillet au 30 août no 199 – été 2023
Véritable ode aux sentiments amoureux, qui galvanisent autant qu’ils déçoivent, le nouveau film de Daigo Matsui est une sublime fresque impressionniste, dévoilant des morceaux de vie de deux protagonistes incarnés par des interprètes époustouflants.
Cette virée trouve son identité grâce à un sidérant sens du tragique.
SORTIE LE 19 JUILLET
DAMIEN LEBLANC
Les Meutes de Kamal Lazraq, Ad Vitam (1 h 34), sortie le 19 juillet
Rendez-vous à Tokyo de Daigo Matsui, Art House (1 h 55), sortie le 26 juillet
CHLOÉ BLANCKAERT
DE NOS JOURS…
SORTIE LE 19 JUILLET
Hong Sang-soo poursuit le raffinement progressif de son œuvre en tirant vers un quotidien toujours plus dénudé à travers la mise en abyme autobiographique de son couple.
L’autobiographie est une part intégrante du cinéma de Hong Sang-soo : on ne compte plus les nombreux personnages de réalisateurs – ou assimilés : poètes, romanciers, acteurs, universitaires – inspirés de la vie du cinéaste sud-coréen, moins de ses événements saillants que de son quotidien, de ses humeurs, de sa condition d’artiste. Longtemps, cette veine n’a pourtant pas constitué la matière principale des films. Elle faisait partie des différentes strates dimensionnelles – au même titre que la fiction cinématographique, le rêve, le passé, le

futur – qui troublent régulièrement les perceptions du vrai ou du faux. Pour autant, De nos jours… assume plus directement la mise en scène de soi et prolonge le geste entamé dans La Romancière, le Film et le Heureux Hasard, son film sorti en février dernier, qui se concluait par une somptueuse séquence déclarative aux faux airs de demande en mariage. Après les grands émois de l’hiver, voici donc la routine estivale. De nos jours… alterne deux scènes de la vie domestique. D’une part, Sangwon (Kim Min-hee), hébergée par une amie, a abandonné sa carrière d’actrice pour se consacrer à des études d’architecture. Elle reçoit la visite de sa cousine, qui compte lui demander quelques conseils pour devenir comédienne à son tour.

D’autre part, un vieux poète nommé Hong (Ki Joo-bong) – lui-même étonné par « sa popularité nouvelle auprès des jeunes », tel qu’un malicieux intertitre nous l’indique – accueille une aspirante documentariste et un acteur en forma-
tion, également venus lui quémander quelques conseils. Le lien entre les deux histoires se matérialise par touches discrètes, à la façon d’un jeu de piste, à travers des parallélismes au montage ou au détour de petites confidences qui s’échappent des dialogues. Car Sangwon et M. Hong partagent plusieurs points communs en apparence anecdotiques : un goût pour la sieste, un autre pour la sauce pimentée. Mais, plus précisément, c’est leur rencontre antérieure qui semble avoir bouleversé Sangwon, au point de remettre en question son métier d’actrice. L’aveu fait à sa cousine résonne étrangement : jouer au cinéma, ce n’est pas imiter ou mettre un masque mais, au contraire, se montrer à nu, se confondre avec le personnage. Le monologue de Sangwon ressemble à s’y méprendre à une théorie de l’acteur chez Hong Sang-soo : refuser l’illusion, ne pas distinguer le réel de la fiction, tout ramener à une même banalité des choses. De nos jours… prend donc ouvertement la forme d’une chronique apaisée du couple que forme à la ville le cinéaste et Kim Minh-hee. Ils semblent même, dorénavant, faire salon et semer derrière eux – non sans autodérision – aphorismes heureux et petites épiphanies ordinaires : un chat égaré qui revient à la maison, une possible rencontre amoureuse qui sonne comme une passation.
De nos jours… de Hong Sang-soo, Capricci Films (1 h 24), sortie le 19 juillet

SEBASTIAN
DANCING BY NIGHT
NOUVEAU SINGLE DISPONIBLE
57 Sorties du 19 juillet au 30 août <---- Cinéma été 2023 – no 199
THOMAS CHOURY
LES DAMNÉS NE PLEURENT PAS
SORTIE LE 26 JUILLET
Présenté au dernier Festival de Venise, le second long métrage de Fyzal Boulifa (Lynn + Lucy, 2019) épouse la trajectoire de deux laisséspour-compte. Une fresque qui embrasse l’expression du corps et réfléchit à un autre modèle familial.

C’est en nomades que Selim et sa mère habitent le Maroc, leur terre de naissance, perpétuellement chassés des lieux où ils voudraient s’implanter et disposer de leurs maigres possessions. Méprisés pour l’allure qu’ils arborent et la relation fusionnelle qu’ils entretiennent, ils fuient pour Tanger, où Selim
décroche un travail dans un riad tenu par un Français. S’installe entre les deux hommes un lien trouble. Dès la scène d’ouverture, les plans sur les bijoux et caftans du duo d’égarés, le scintillement de l’or et des étoffes, en disent long sur leur orgueil et leur fierté, éléments qui donnent son élan mélodramatique au film. Le cinéaste observe la honte courir sur les personnages, s’emparer de leurs corps et les arracher à la liberté qui les caractérisait jusqu’alors, loin du modèle patriarcal en place. Avec la densité d’un roman naturaliste, Les damnés ne pleurent pas se donne entier à la fatalité de son titre, sous la photographie charnelle de Caroline Champetier. Dans la pesanteur qu’il donne aux mots de ceux qui n’ont rien et dans l’attention avec laquelle il filme des corps qui se veulent affranchis, Fyzal Boulifa déploie un cinéma queer hanté par un monde qui se meurt, comme lancé vers de plus grandes amours.

Seule avec son père, une gamine de 11 ans débarque pour l’été dans une maison isolée, avant de comprendre que la menace n’est pas où elle le croit. Porté par un duo puissant (Finnegan Oldfield et la douée Aline Helan Boudon), ce film aux images tantôt concrètes tantôt symboliques dépeint une terrible relation d’emprise.
« La maison Kinder » : c’est comme ça que Paula décrit la bâtisse de rêve, en bord de lac, que son père leur a dénichée pour les grandes vacances. Mais les jours s’écoulent, le temps se dilate, et ce lieu si accueillant se mue peu à peu en prison bas de gamme. Pour la pré-ado, le mois de septembre sera différent des précédents : désormais, maison et école se résumeront à ce domicile de plus en plus sinistre. Plusieurs fois récompensée
pour son scénario, Angela Ottobah décrit la vampirisation progressive d’une jeune fille par un père qui entend être son seul horizon. Celui-ci fait littéralement sauter les cloisons de sa chambre sous prétexte de mieux veiller sur elle, bâtissant une bulle d’autant plus inquiétante qu’elle se veut bienveillante. Tout respire l’intelligence dans Paula : la mise en scène n’explicitant que ce qui doit l’être, la façon dont l’évolution des décors raconte le délabrement intérieur des personnages, mais aussi l’interprétation du tandem Aline Helan Boudon-Finnegan Oldfield, sans cesse sur le fil du rasoir. Parfois d’une grande douceur, le film d’Angela Ottobah est pourtant d’une immense violence, racontant avec finesse une relation intrafamiliale des plus destructrices.

58 Cinéma > Sorties du 19 juillet au 30 août no 199 – été 2023
La maison de vacances se mue peu à peu en prison.
PAULA
SORTIE LE 19 JUILLET
THOMAS MESSIAS
Paula d’Angela Ottobah, Arizona (1 h 38), sortie le 19 juillet
Les damnés ne pleurent pas de Fyzal Boulifa, New Story (1 h 51), sortie le 26 juillet 2023
LAURA PERTUY
THE FIRST SLAM DUNK

En transposant sur grand écran son propre manga – devenu culte au Japon –, Takehiko Inoue propose une immersion physique et lyrique dans le suspense d’une finale du championnat interlycées de basket-ball, montrée quasiment en temps réel.
La prouesse de The First Slam Dunk découle d’un choix narratif audacieux. En restreignant la quasi-intégralité du long métrage au temps unique du match en question, Takehiko Inoue inverse la logique dramatique réservée aux films de sport. La vie en dehors du stade est reléguée au second
SUR LA BRANCHE
Après le remarqué La fête est finie (2017), qui narrait la tentative de deux extoxicos de s’intégrer dans la société, Marie Garel-Weiss filme à nouveau avec son style unique l’odyssée de personnages perchés, au bord de la chute. Sa fantaisie et son empathie font mouche.


Mimi (étonnante Daphné Patakia), tout juste sortie de HP et en recherche d’emploi, atterrit dans un cabinet d’avocats en déroute dirigé par un couple en implosion (les épatants Benoît Poelvoorde et Agnès Jaoui). Contre toute attente, elle réussit à gagner la confiance de Paul, l’homme de loi en crise de foi. Plus fou : à la suite d’un quiproquo, Mimi le persuade de plaider l’innocence d’un jeune homme accusé d’arnaque, alors que l’avocat lui-même est en voie d’être rayé du barreau – sur le point, donc, de basculer
à son tour hors de la normalité. Avec cette certitude déconcertante des illuminés, Mimi va l’entraîner dans des aventures loufoques, plaidant au passage sa propre cause : « S’il vous plaît, ne me laissez pas toute seule, je suis de très mauvaise compagnie avec moimême. » Un postulat drolatique qui pourrait résumer ce film en équilibre fragile entre le vraisemblable et l’affabulation. L’exercice de funambule affleure dans de savoureux dialogues : « En théorie on ne peut pas, mais dans le réel on va le faire. » Un parti pris littéralement adopté par l’intrépide cinéaste et sa chef-opératrice, Jeanne Lapoirie, qui sait mettre en lumière l’héroïne même quand elle s’aveugle. À l’arrivée, un périple insolemment insolite, à l’instar de Mimi.
plan pour ne surgir que par flashs et dramatiser ce qui importe vraiment : l’action sur le parquet. L’enjeu premier de l’animation est alors de reproduire avec fidélité la gestuelle du basket. Pour autant, ce réalisme s’intéresse moins au jeu en tant que tel qu’à la performance. Les petites spécificités du match sont gommées au profit du rendu sensoriel : la brutalité des chocs, la beauté d’une passe, la surprise d’une feinte. Ce lyrisme sportif tend même vers une forme d’abstraction : ce qui est extérieur au parquet est insonorisé, renforçant l’impression d’évoluer dans un espace irréel. Le travail d’Inoue a donc plus à voir avec l’identité profonde du basket. Se rapprocher du temps réel lui permet de jouer sur l’étrange plasticité qui le caractérise : les secondes s’étirent ou se contractent, les mouvements s’accélèrent puis se figent ; le sport est ramené à son principe d’élévation et de suspension.
59 Sorties du 19 juillet au 30 août <---- Cinéma été 2023 – no 199
SORTIE LE 26 JUILLET
SORTIE LE 26 JUILLET
Ce film est un périple insolemment insolite, comme le personnage de Mimi.
The First Slam Dunk de Takehiko Inoue, Wild Bunch (2 h 04), sortie le 26 juillet
THOMAS CHOURY
Sur la branche de Marie Garel-Weiss, Pyramide (1 h 31), sortie le 26 juillet
XANAÉ BOVE
NINJA TURTLES. TEENAGE YEARS
SORTIE LE 9 AOÛT
Dans cette version animée, les Tortues Ninja s’offrent une nouvelle jeunesse drôlement survoltée. Le résultat est un divertissement ambitieux à l’esthétique soignée, qui ne tombe jamais dans la surenchère.
Et si l’animation était l’avenir des franchises ? Après Spider-Man et deux excellents volets animés ( New Generation , en 2018, et Across the Spider-Verse, fin mai), Ninja Turtles. Teenage Years prouve une nouvelle fois que les super-héros fatigués en live action peuvent reprendre des couleurs avec des dessins. On retrouve nos célèbres tortues, Raphael, Donatello, Leonardo et Michelan-
ON DIRAIT LA PLANÈTE MARS
SORTIE LE 2 AOÛT
Cinq astronautes viennent d’arriver sur Mars. Dans le même temps, leurs sosies psychologiques sont chargés de recréer la mission spatiale sur la terre ferme. Une comédie québécoise qui transforme une situation absurde en un sommet de mélancolie.

Ça ressemble à un jeu de cour de récré : cinq adultes font semblant d’être sur Mars à la demande d’une agence spatiale souhaitant observer leurs comportements et interactions – et ainsi anticiper ce qui risque de se produire dans le cadre de la véritable mission, qui se déroule simultanément. Ces cinq-là ne sont ni acteurs ni astronautes, mais on leur demande d’être tout ça à la fois : une situation absurde, mais traitée avec grand sérieux par Stéphane Lafleur (Tu dors Nicole, 2014). Loin des thrillers conceptuels sur fond
d’expérience sociologique (de L’Expérience, en 2001, à La Vague, en 2008), le cinéaste québécois exploite à merveille le potentiel de cette situation décalée et riche en spleen. Ses personnages ne connaissent que les inconvénients du voyage martien : esseulés, surveillés en permanence, les voilà tenus de respecter des protocoles exaspérants… Ce qui n’empêche pas la situation de leur monter à la tête – il faut les voir tenter de gagner du galon. Plus proche du cinéma d’Aki Kaurismäki que du film de SF, On dirait la planète Mars rappelle aussi Proxima d’Alice Winocour, sorti en 2019 (où Eva Green jouait une vraie astronaute) par sa façon de mêler l’infini et l’intime, la conquête spatiale et la charge mentale. Des thèmes qu’il déploie avec autant de mélancolie que de drôlerie.
On dirait la planète Mars de Stéphane Lafleur, UFO (1 h 44), sortie le 2 août

THOMAS MESSIAS
gelo, à l’âge difficile de l’adolescence. Elles ne rêvent que de sortir de leurs égouts, mais leur père adoptif, Splinter, méfiant à l’égard des humains, les en empêche.
Jusqu’à ce qu’April O’Neil, apprentie journaliste, leur donne la clé du succès : pour se faire accepter par les humains, elles doivent devenir des héroïnes. Ninja Turtles.
Teenage Years cumule les bonnes idées, à commencer par un efficace mélange d’humour et d’action et une animation pleine de textures. La grande réussite du film réalisé par Jeff Rowe (l’excellent Les Mitchell contre les machines en 2021) est d’embrasser sans réserve le caractère adolescent des personnages. Leur appétit de découverte s’aiguise d’ailleurs en regardant La Folle Journée de Ferris Bueller, ode à la jeunesse décomplexée. Et il est attachant de les voir se débattre pour trouver leur place dans un vaste monde biberonné à la pop culture.

60 Cinéma > Sorties du 19 juillet au 30 août no 199 – été 2023
Le cinéaste exploite à merveille cette situation décalée et riche en spleen.
Ninja Turtles. Teenage Years de Jeff Rowe, Paramount Pictures, sortie le 9 août
MARGAUX BARALON
24 HEURES À NEW YORK
SORTIE LE 9 AOÛT
Ce premier long du réalisateur serbo-chilien Vuk LungulovKlotz explore avec délicatesse la déambulation new-yorkaise d’un jeune homme trans vers les retrouvailles avec son père, entre questionnements existentiels et rencontres avec des fantômes du passé.
Feña, jeune homme trans new-yorkais (très justement incarné par Lio Mehiel), doit aller chercher son père chilien à l’aéroport, qu’il n’a pas vu depuis sa transition et qui refuse toujours de l’appeler par son nouveau prénom. Si le pitch semble s’accorder avec le traitement encore doloriste des films sur
QUAND LES VAGUES SE RETIRENT
SORTIE LE 16 AOÛT
Lav Diaz (La Saison du diable, 2018) porte un regard noir et désespéré sur l’essor des violences fascistes aux Philippines avec ce thriller blafard et vénéneux dans lequel deux anciens flics, sombrant peu à peu dans la folie, cherchent à s’entretuer.

D’un côté : Hermes, un enquêteur ultraviolent retranché sur l’île de son enfance après avoir été mis au ban des forces de l’ordre à cause d’une santé déclinante. De l’autre : Primo, un ripou dégénéré tout juste sorti de prison qui, sujet à des crises de démence, humilie et agresse quiconque aurait la malchance de croiser son chemin. Deux antagonistes et anciens coéquipiers auxquels le film accorde, par le recours au montage alterné, autant de place dans le récit, avant une ultime confrontation à l’issue de laquelle le sang finira par couler. Le schéma est bien

connu des cinéphiles amateurs de thrillers policiers et mafieux, mais dans les mains du cinéaste philippin, lauréat du Lion d’or en 2016 pour La Femme qui est partie, cette ossature familière accouche d’un film déliquescent bien plus proche du cinéma ténébreux et sibyllin de F. J. Ossang que d’un face-à-face opératique signé Michael Mann. Dans un noir et blanc très contrasté dans lequel la mer s’apparente à du mazout et la fumée des égouts à des nuages de vapeurs toxiques, les corps dansent et se contorsionnent, bouffis par la haine ou déformés par la maladie. Fidèle à lui-même, Lav Diaz signe un film qui parvient à envoûter en bout de course, à la tombée de la nuit.
Quand les vagues se retirent de Lav Diaz, Épicentre Film (3 h 07), sortie le 16 août CORENTIN
les personnes trans, le développement de 24 heures à New York se fait plus fin. Virée mélancolique dans les rues ensoleillées de New York, ce doux premier long retrace, le temps d’une journée, la balade semée d’embûches, parfois comiques, de Feña, au cours de laquelle il va rencontrer des personnages écrits avec nuances. On assiste par exemple à ses retrouvailles à la fois maladroites, tendres et pleines de rancune avec son ex-petit ami, qu’il n’a pas vu depuis plus d’un an. Sont aussi présents ses colocs queer, dont l’activiste transgenre Jari Jones en guest-star, ou encore sa petite sœur, irritante comme toute ado blasée, qui fait subtilement comprendre à Feña que, même si leur mère l’a rejeté, ellemême le considère bien comme son grand frère. Plein de délicatesse mais aussi d’humour sans tomber dans la mièvrerie, ce film expose le dilemme de toute personne queer : fuir ou s’adapter.

61 Sorties du 19 juillet au 30 août <---- Cinéma été 2023 – no 199
Un film déliquescent proche du cinéma ténébreux et sibyllin de F. J. Ossang.
24 heures à New York de Vuk Lungulov-Klotz, Dulac (1 h 22), sortie le 9 août
HANNELI VICTOIRE
LÊ
KASABA
En Turquie, des enfants s’émerveillent de la nature et observent, inquiets, les adultes ressasser leur amertume. Superbe premier long de Nuri Bilge Ceylan, inédit en France, Kasaba (1997) contenait déjà tout ce qui fait la beauté et la mélancolie de son cinéma.
Durant l’hiver, les enfants d’un petit village turc suivent leurs cours dans le joyeux tumulte d’une salle de classe. L’été suivant, la jeune Hulya et son frère Ali explorent une forêt autour d’un cimetière. À la nuit tombée, leur famille endeuillée se regroupe autour d’un feu de camp pour converser sur les aléas de la vie… Dans son premier long métrage,
Nuri Bilge Ceylan fait déjà dialoguer les deux pôles de son cinéma prolixe et contemplatif. D’un côté, les éléments naturels (le vent, le feuillage, les animaux) percent chaque scène ; de l’autre, le moindre dialogue est l’occasion de philosopher sur la tragédie que constitue le rêve désespéré d’une extraction de la ruralité. Une œuvre tantôt prosaïque, tantôt spirituelle germe dans ce film ouvert aux quatre vents. Dans une scène, une suite de gros plans sur les visages abîmés de la famille de Hulya fait respirer une longue conversation en forme de règlement de comptes entre deux cousins rivaux. Le premier est parti étudier à la ville puis à l’étranger ; le second n’a toujours pas trouvé sa voie après avoir effectué son service militaire. La grande force du cinéma de Ceylan est de rendre compte de ce déchirement par les moyens d’une mise en scène bicéphale, à la fois rigide et d’une grande souplesse.
VERA
À partir de la vie de l’actrice
italienne Vera Gemma, les cinéastes Tizza Covi et Rainer Frimmel (L’Éclat du jour, Mister universo) fantasment une fiction espiègle sur la condition de nepo-baby dans le cinéma.
On ne connaissait pas la fantasque Vera Gemma, mais elle est une figure du cinéma italien (elle a joué dans des films de Dario Argento) dont le talent a été occulté, confisqué par des hommes. En premier lieu, par son père acteur, la star Giuliano Gemma, connu pour ses westerns spaghetti. Tizza Covi et Rainer Frimmel, dans leur variation fantasmée sur la vie de Vera, montrent à quel point elle est toujours ramenée à lui, quoi qu’elle fasse. Une scène du film la présente d’ailleurs en train de dialoguer avec son amie Asia Argento (fille de Dario Argento), qui joue elle aussi son propre rôle,

dans laquelle les deux actrices parlent de leur position paradoxale, tout à la fois privilégiée et dans l’ombre de leurs pères. Les cinéastes figurent Vera Gemma à l’aube de la cinquantaine, alors qu’elle est de moins en moins sollicitée par le cinéma et qu’elle doit se réinventer. Leur démarche ressemble alors un peu à celle de Rebecca Zlotowski dans Une fille facile (2019), dans lequel la cinéaste, s’inspirant de la figure de Zahia Dehar, dynamitait les clichés sexistes sur l’hyperféminité. Avec malice, Vera Gemma fait mentir tout ce que les hommes voient en elle, cette supposée superficialité, et emmène le film là où on ne l’attendait pas, sur le terrain du film social, dans une exploration des quartiers pauvres de Rome.

Vera de Tizza Covi et Rainer Frimmel, Les Films de l’Atalante (1 h 55), sortie le 23 août
 QUENTIN GROSSET
QUENTIN GROSSET
62 Cinéma > Sorties du 19 juillet au 30 août no 199 – été 2023
SORTIE LE 23 AOÛT
SORTIE LE 16 AOÛT
Kasaba de Nuri Bilge Ceylan, Memento (1 h 24), sortie le 16 août CORENTIN LÊ
Vera fait mentir tout ce que les hommes voient en elle et emmène le film là où on ne l’attendait pas.
Transposant la retranscription réelle de l’interrogatoire, à son domicile et par le FBI, de Reality Winner, jeune Américaine condamnée en 2018 au titre de l’Espionage Act, ce film fascinant oscille entre thriller psychologique, true crime et étude très contemporaine sur le genre.

Le 3 juin 2017, Reality a 25 ans quand, de retour après quelques courses, elle trouve deux agents du FBI devant sa porte. C’est là que démarre l’enregistrement à partir duquel la dramaturge et cinéaste américaine Tina Satter (lire p. 38) a créé d’abord une pièce, Is This a Room, succès off-Broadway en 2020, puis ce film captivant, présenté à la dernière Berlinale. Les agents vérifient l’identité de la jeune femme et, tandis que leurs collègues fouillent la maison, commencent à l’extérieur un interrogatoire in-
REALITY
SORTIE LE 16 AOÛT
formel (on y parle CrossFit, animaux, mais aussi du CV atypique de Reality : linguiste cryptologue, elle travaille comme traductrice pour une société sous contrat avec l’armée).
Alors que les dialogues suivent, au bafouillement près, les retranscriptions de l’enregistrement, la caméra vient gratter du côté des non-dits, scrutant là un regard qui panique, ici une crispation de la bouche, mettant en place un étrange jeu du chat et de la souris. La souris étant soupçonnée d’avoir fait fuiter des documents militaires à la presse. Un des agents demande alors à la jeune femme si elle préfère poursuivre l’interrogatoire dans les locaux du FBI ou chez elle. Bizarrement, elle opte pour la seconde option : elle dispose justement d’une pièce vide à l’arrière de la maison, où elle ne va jamais. Cet élément devient le formidable ressort dramatique de la seconde partie du film, la cinéaste investissant cette étrange pièce abandonnée comme une représentation de l’espace mental de Reality. La mise en scène plonge dans la psyché de la jeune femme, jouant d’effets de distorsion à mesure que Reality (géniale Sydney Sweeney) est forcée de se confronter à elle-même, jusqu’à l’ef-
fondrement. C’est aussi dans cette pièce aux airs de « chambre à soi » que s’articule un discours extrêmement fin sur les rapports de genre – les échanges sont parsemés de flottements, regards et sous-entendus misogynes. Pour prendre toute la mesure de la charge politique du film, il faut alors se rappeler que Reality Winner a été la première personne condamnée en application de l’Espionage Act sous le mandat de Donald Trump, écopant d’une peine de cinq ans de prison, soit la plus longue jamais imposée à un lanceur d’alerte.
Reality de Tina Satter, Metropolitan FilmExport (1 h 22), sortie le 16 août JULIETTE REITZER
63 Sorties du 19 juillet au 30 août <---- Cinéma été 2023 – no 199
La mise en scène plonge dans la psyché de la jeune femme, jouant d’effets de distorsion.
YAMABUKI
SORTIE LE 2 AOÛT
Jouant des contrastes, le Japonais Juichiro Yamasaki sonde les profondeurs de l’âme humaine pour tenter d’en saisir toutes les subtilités. Un récit poétique doux-amer dans lequel les destinées des personnages s’entremêlent.
À Maniwa, ville minière de l’ouest du Japon, poussent des yamabuki. Ces petites fleurs jaunes, délicates, qui fleurissent en montagne, donnent leur nom au troisième film de Juichiro Yamasaki et à son personnage principal, une jeune étudiante traversée par de vives contradictions. Née de la rencontre de deux parents issus d’univers opposés (une mère correspondante de guerre indépen-
LA BEAUTÉ DU GESTE
SORTIE LE 30 AOÛT
À Tokyo, une jeune boxeuse atteinte de surdité tente de devenir professionnelle, mais son club est menacé de fermeture. Shō Miyake transpose les principes moteurs de la boxe, entre dégagements et absorptions, dans un film à la fois sensible et incisif.

Jeune boxeuse en passe de passer pro, Keiko travaille encore comme femme de ménage et vit une existence plutôt solitaire. En cause : sa surdité, qu’elle compense par sa vigueur sur le ring, sur lequel elle excelle. Si son quotidien est déjà une bataille en soi, il se retrouve menacé par la fermeture imminente de son club… À l’échelle des films de boxe, La Beauté du geste se rapproche de Million Dollar Baby, dans lequel la résilience d’un personnage esseulé s’exprimait déjà au gré de quelques uppercuts bien placés. Si le
film de Shō Miyake n’a pas la même ampleur que celui de Clint Eastwood, il s’épanouit justement dans un cadre et une intrigue tous deux resserrés. Qu’importe que la trajectoire de Keiko soit vite négociée : tout se joue ici dans le découpage, d’une grande rigueur, des scènes d’entraînement et de combat. La surdité du personnage convie Miyake à miser sur ce que peuvent figurer les mouvements d’un corps en lutte, dont la moindre esquive relève autant d’une stratégie d’évitement que d’une reconfiguration complète des enjeux d’un combat sans cesse relancé. Il en va de même pour l’existence de Keiko, à la fois fuyante et toujours en mouvement : la beauté de son geste tient aussi au dynamisme de sa position, sur le ring et à l’extérieur.
La Beauté du geste de Shō Miyake, Art House (1 h 39), sortie le 30 août

dante et un père policier au service de l’autorité en place), Yamabuki prend part à des manifestations silencieuses pour défendre la paix dans le monde. Au même moment, dans la ville, Chang-su, ancien cavalier olympique reconverti en ouvrier dans une carrière, est soumis de manière imprédictible et violente aux aléas de son destin. Les vies de ces deux individus, tiraillés entre leurs aspirations et la réalité, se croiseront malgré eux… Puisant dans les préoccupations japonaises contemporaines (la construction des infrastructures pour les J. O. de 2020) et dans des considérations plus universelles (l’engagement pacifique de la jeunesse), le nouveau long métrage de Yamasaki mêle réalisme et onirisme avec une grande habileté. En superposant les récits et les temporalités, le cinéaste brosse le portrait de l’insaisissable condition humaine : à la fois douce et cruelle, comme les yamabuki et leur sol rocailleux.

64 Cinéma > Sorties du 19 juillet au 30 août no 199 – été 2023
Tout se joue ici dans le découpage des scènes d’entraînement et de combat.
Yamabuki de Yamasaki Juichiro, Survivance (1 h 37), sortie le 2 août
CHLOÉ BLANCKAERT
CORENTIN LÊ
FERMER YEUX LES
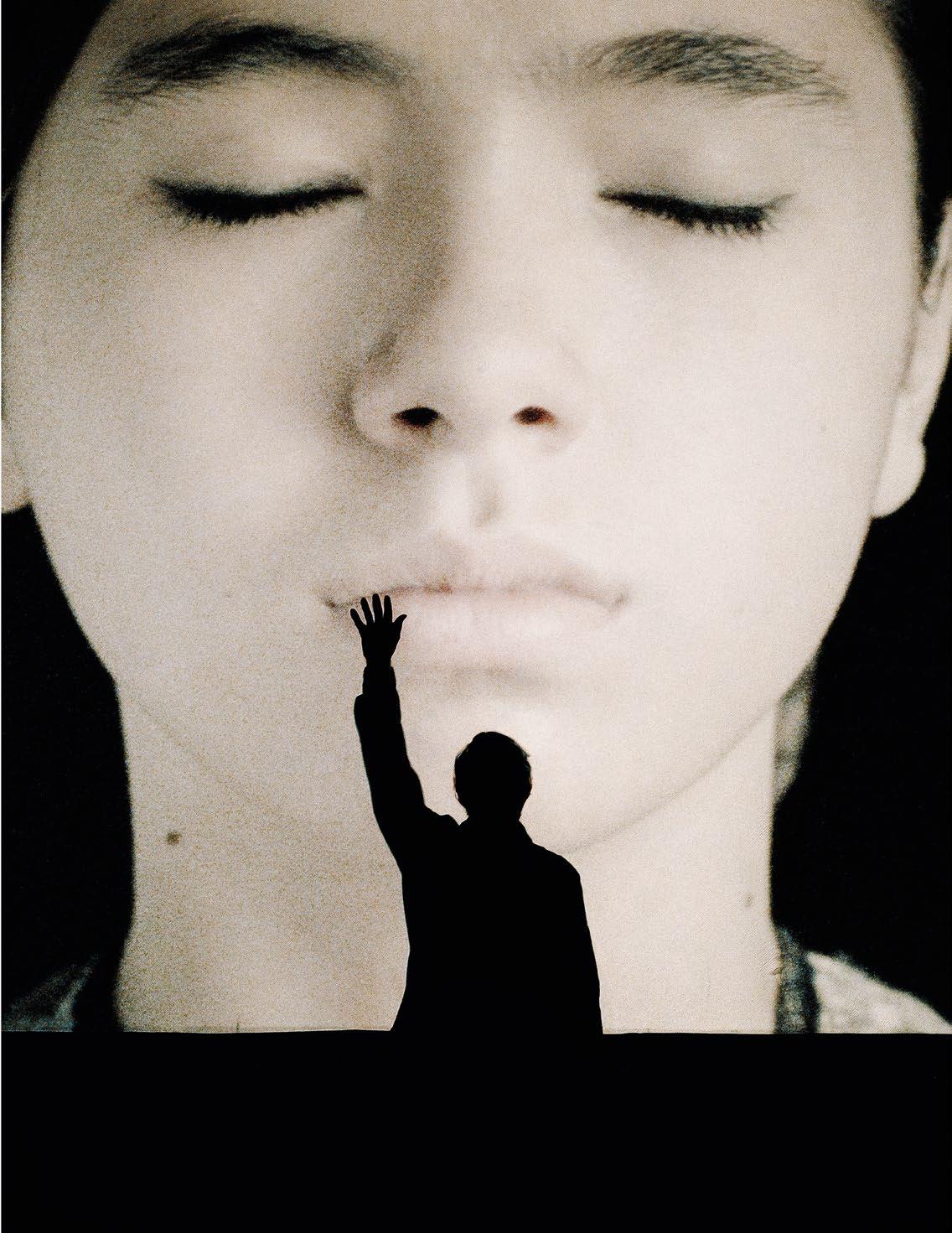
UN FILM DE VÍCTOR ERICE
le monde Mentions légales non contractuelles AU CINÉMA LE 16 AOÛT
CHEF D’ŒUVRE !
FERMER LES YEUX
SORTIE LE 16 AOÛT
Événement cinéphile du dernier Festival de Cannes, Fermer les yeux, de l’Espagnol Víctor Erice, est seulement son quatrième long métrage en cinquante ans. Et l’un de ses plus bouleversants, où il se fond dans le personnagemiroir d’un vieux cinéaste mélancolique.

Événement dernier Fermer l’Espagnol est long métrage ans. l’un bouleversants, fond miroir cinéaste mélancolique.
Il y a encore peu, on ne l’aurait pas cru. Le très discret Víctor Erice, 83 ans, réalisateur de films rares, dont son premier chef-d’œuvre L’Esprit de la ruche (1977), revient au cinéma. C’est qu’il surgit d’entre les morts, trente ans après Le Songe de la lumière (1992) et autant d’années au cours desquelles on l’avait enseveli au panthéon du cinéma espagnol. Dans son nouveau film, il nous conte justement une histoire de fantômes. En l’occurrence celle d’un acteur, Julio, mystérieusement disparu en
plein tournage, tandis que le personnage qu’il jouait devait s’envoler en Chine. Vingt ans plus tard, personne ne l’a retrouvé ; pas même le réalisateur, Miguel, qui dirigeait alors son ami et qui s’apprête à raconter ses souvenirs lors d’un programme télévisé. L’occasion pour lui de se replonger dans l’affaire, mais aussi de braver son renoncement au cinéma – le même dont a souffert Erice, aux nombreux projets avortés. De ce
nues les reliques d’un paradis perdu, auront ainsi un impact décisif sur la réalité de Julio. C’est ce que montrait Erice dans L’Esprit de la ruche, où une fillette tombait nez à nez avec le Frankenstein qui l’avait fascinée dans dans le film de 1932. Celle-ci était incarnée par l’actrice Ana Torrent, et le film fit d’elle une enfant star. Cinquante ans plus tard, on la retrouve, vieillie, dans le rôle de la fille de Julio. Et si la pellicule peut bien fixer le
Affronter la vieillesse : c’est toute l’idée du film.
pur dispositif mémoriel, le cinéaste tire un film ample non seulement par sa durée – presque trois heures –, mais aussi par une mise en scène qui prend le temps, avec une singulière langueur. Car c’est bien de temps qu’il s’agit là : celui qu’on a perdu et qu’on voudrait rattraper s’oppose curieusement à celui qu’on a fixé sur pellicule. Les dernières images filmées par Miguel, deve-
temps, Erice réfute la nostalgie facile. Il faut briser les reliques, affronter la vieillesse et peut-être la mort ; c’est toute l’idée du film, dans lequel Miguel/Víctor Erice revient paradoxalement au cinéma pour mieux lui dire adieu ; et dans lequel on s’observe lors d’intenses scènes de retrouvailles, qui sonnent à chaque fois comme les dernières avant de baisser le rideau… ou de fermer les yeux.
Fermer les yeux de Víctor Erice, Haut et Court (2 h 49), sortie le 16 août
66 Cinéma > Sorties du 19 juillet au 30 août no 199 – été 2023
DAVID EZAN

CALENDRIER DES SORTIES
JUILLET 19
Barbie de Greta Gerwig
Warner Bros. (1 h 54)
À Barbieland, vous êtes un être parfait dans un monde parfait. Sauf si vous êtes en crise existentielle, ou si vous êtes Ken.
Les Ombres persanes de Mani Haghighi Diaphana (1 h 47)
À Téhéran, un homme et une femme découvrent par hasard qu’un autre couple leur ressemble trait pour trait…

Blanquita de Fernando Guzzoni

ASC (1 h 34)
Témoin-clé d’un scandale sexuel impliquant des politiciens chiliens, Blanca, 18 ans, se retrouve poussée au centre de l’attention médiatique par le prêtre qui dirige le foyer dans lequel elle vit.
Caiti Blues de Justine Harbonnier Shellac (1 h 24)

Caiti Lord s’est exilée dans une ville fantôme du Nouveau-Mexique. Elle a une voix magnifique, qu’elle compte utiliser pour faire autre chose que vendre des cocktails.
De nos jours… de Hong Sang-soo Capricci Films (1 h 24)

Deux conversations en alternance à Séoul : une ancienne actrice est sollicitée par une débutante tandis qu’un vieux poète reçoit un admirateur.
Les Meutes de Kamal Lazraq
Oppenheimer de Christopher Nolan
Universal Pictures (3 h)
Le nouveau film de Christopher Nolan à propos de l’univers palpitant de l’homme complexe qui a mis en jeu la vie du monde entier pour mieux le sauver.


Paula d’Angela Ottobah Arizona (1 h 38)
Paula a 11 ans. Son père lui fait une surprise : ils vont passer l’été dans la maison de ses rêves, au bord d’un lac. Mais l’automne approche et ils ne rentrent toujours pas.


Sous le tapis de Camille Japy Paname (1 h 37)
Odile se prépare à fêter son anniversaire. Alors que ses enfants et petits-enfants sont en route pour la soirée, Jean, son mari, décède brutalement, et elle cache le cadavre…
Les damnés ne pleurent pas de Fyzal Boulifa
New Story (1 h 51)
Fatima-Zahra traîne son fils de 17 ans de ville en ville, fuyant les scandales qui éclatent sur sa route. Quand il découvre la vérité sur leur passé, elle lui promet un nouveau départ.
Les Déguns 2 de Cyrille Droux et Claude Zidi Jr. Apollo Films (1 h 28)



Après un premier échec cuisant dans l’univers de la télé-réalité, Karim et Nono décident de se lancer dans le rap.
The First Slam Dunk de Takehiko Inoue

Wild Bunch (2 h 04)
Le meneur de jeu de Shohoku, Ryota Miyagi, joue toujours intelligemment et à la vitesse de l’éclair, contournant ses adversaires tout en gardant son sang-froid.
Juniors
d’Hugo P. Thomas
Ad Vitam (1 h 34)
JUILLET 26
The Jokers / Les Bookmakers (1 h 35) Dans les faubourgs populaires de Casablanca, un père et son fils enchaînent les petits trafics pour la pègre locale. Un soir, ils sont chargés de kidnapper un homme.


Jordan, 14 ans, s’ennuie dans son village. Quand sa console rend l’âme, il simule une maladie et monte une cagnotte en ligne pour s’en racheter une.
Navigators de Noah Teichner
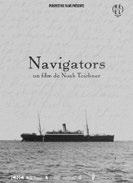
Perspective Films (1 h 25)
Décembre 1919. Les États-Unis expulsent 249 anarchistes sur un paquebot qui deviendra quelques années plus tard le décor d’un film de Buster Keaton.
Affreux, sales et méchants

d’Ettore Scola
Carlotta Films (1 h 55) lire p. 10

Dans un bidonville romain, Giacinto règne en tyran sur sa famille et passe ses journées à boire en attendant les gains des vols des siens. En secret, on prépare son assassinat.
La Main de Danny Philippou et Michael Philippou
SND (1 h 35)
Lorsqu’un groupe d’amis découvre comment conjurer les esprits à l’aide d’une mystérieuse main hantée, ils deviennent accros à ce nouveau frisson.
68 Cinéma > Sorties du 19 juillet au 30 août no 199 – été 2023
lire
lire p. 55
p. 4
lire p. 56
lire p. 54
lire p. 57
lire p. 58
lire p. 59
lire p. 58
lire p. 6
Le Manoir hanté de Justin Simien
Walt Disney (2 h 02)
L’histoire d’une mère et de son fils qui engagent une équipe de supposés experts pour les aider à chasser les spectres qui hantent leur maison.
Persepolis de Marjane Satrapi StudioCanal (1 h 35)
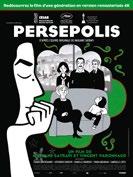
Sortie en 2007, cette adaptation de la célèbre bande dessinée, portrait de la société iranienne vue par une jeune fille et sa famille de Téhéran, est de retour en salles.

Rendez-vous à Tokyo de Daigo Matsui

Art House (1 h 55)
Les 26 juillet se suivent et ne se ressemblent pas… C’est le jour où ils se sont rencontrés, où ils se sont aimés, où ils se sont séparés.
Sabotage de Daniel Goldhaber

Tandem (1 h 44)
Face à l’urgence écologique, un groupe d’activistes se fixe une mission périlleuse : saboter un pipeline qui achemine du pétrole dans tous les États-Unis.
Sur la branche de Marie Garel-Weiss Pyramide (1 h 31)


lire p. 59
Mimi a presque 30 ans et rêve toujours à ce qu’elle pourrait faire quand elle sera grande. Elle fait la connaissance de Paul, un avocat sur la touche.
Un hiver en été de Lætitia Masson Jour2fête (1 h 50)
Dix personnages sont surpris par un froid glacial en plein été : des rencontres, de la solitude, de l’espoir, de la peur, de l’amour, une chanson, la lutte des classes – et des rêves.
La Vache qui chantait le futur de Francisca Alegría Nour Films (1 h 38)

Cecilia doit vite revenir à la ferme familiale où vivent son père et son frère, dans le sud du Chili : des vaches sont frappées d’un mal mortel, et sa mère, décédée, réapparaît.
*5 des ingrédients de nos glaces sont issus du commerce équitable Fairtrade. Pour plus d’informations : info.fairtrade.net

69 Sorties du 19 juillet au 30 août <---- Cinéma
été 2023 – no 199
lire p. 56
Unilever France –RCS Nanterre 552 119 216TBN #10658 • © Ben & Jerry’s Homemade Holdings, Inc, 2010 –Cows © Woody Jackson 1997
Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
AOÛT
Suro de Mikel Gurrea Tamasa (1 h 56)
Elena et Ivan quittent Barcelone pour s’installer à la campagne, où ils reprennent une plantation de chênes-lièges. Malgré leurs idéaux, ils doivent faire face à la dure réalité.
Animalia de Sofia Alaoui Ad Vitam (1 h 30)

Itto, jeune Marocaine d’origine modeste, s’est adaptée à l’opulence de sa bellefamille, chez qui elle vit. Mais des événements surnaturels plongent le pays dans l’état d’urgence.
Toto 2 Classe
Les Blagues de
verte de Pascal Bourdiaux SND (1 h 25)

Toto et ses camarades sont de retour, direction la campagne pour une classe verte ! L’occasion parfaite pour inventer de nouvelles blagues et vivre de folles aventures.

Le Colibri de Francesca Archibugi Paname (2 h 06)
La vie de Marco Carrera, surnommé « le Colibri » : une existence faite d’amour absolu, de pertes et de coïncidences.
Détective Conan

Le sous-marin noir d’Yuzuru Tachikawa
Eurozoom (1 h 49)
Sur l’île de Hachijojima, des ingénieurs sont réunis pour une opération au sein d’une installation permettant de relier les caméras de sécurité des polices du monde entier.
En eaux (très) troubles de Ben Wheatley
Warner Bros. (1 h 56)

Ce deuxième opus plonge le spectateur dans des eaux toujours plus profondes, où grouillent de redoutables mégalodons, et bien plus…

Magic! de Caroline Origer KMBO (1 h 19)
lire p. 14
Il existe un monde magique dans lequel vivent de drôles de fées qui, la nuit venue, déposent des cadeaux chez les humains. L’une d’elles, Violetta, se retrouve coincée sur Terre.
On dirait la planète Mars de Stéphane Lafleur UFO (1 h 44)
Les Tournesols sauvages de Jaime Rosales Condor (1 h 46)

À Barcelone, Julia, 22 ans, élève seule ses deux enfants et rêve d’émancipation. Comme un tournesol suivant la lumière, elle part chercher le soleil sous d’autres horizons.
Tropic d’Édouard Salier Rezo Films (1 h 50)



Deux jumeaux font partie d’un programme militaire formant les meilleurs astronautes de demain. Mais l’un d’eux est contaminé par un résidu toxique qui le transforme physiquement et mentalement…
Yamabuki d’Yamasaki Juichiro Survivance (1 h 37)

Maniwa, ville minière de l’ouest du Japon. Chang-su, ancien cavalier de l’équipe de Corée du Sud, endetté, travaille dans une carrière. Yamabuki, lycéenne, manifeste de manière silencieuse à un carrefour.
Yannick de Quentin Dupieux Diaphana (1 h 07)

En pleine représentation du Cocu, une très mauvaise pièce de boulevard, Yannick se lève et interrompt le spectacle pour reprendre la soirée en main…
AOÛT
lire p. 60
La première mission sur Mars est en péril. Alors des anonymes choisis pour leurs profils psychologiques identiques à ceux des astronautes sont réunis dans une base en plein désert.

24 heures à New York de Vuk Lungulov-Klotz Dulac (1 h 22)

lire p. 61
Feña est un jeune homme trans qui vit à New York. Son père chilien, son ex-petit ami et sa demi-sœur refont surface dans sa vie. Il va devoir réinventer ces anciennes relations.
Les Avantages de voyager en train d’Aritz Moreno Damned (1 h 43)

Helga, éditrice madrilène, vient de faire interner son mari. Elle fait la connaissance du Dr Angel Sanagustín, qui lui fait part de ses expériences les plus fascinantes et sordides.
Gran turismo de Neill Blomkamp
Sony Pictures (2 h 15)
Un adolescent participe à une série de compétitions automobiles en vue de devenir un pilote de course professionnel.
Ninja Turtles
Teenage Years de Jeff Rowe


Paramount Pictures (1 h 35)

lire p. 60
Après des années loin du monde des humains, les frères Tortues entreprennent de gagner le cœur des New-Yorkais et d’être acceptés comme des adolescents normaux.
Un coup de maître de Rémi Bezançon Zinc Film (1 h 35)
Galeriste, Arthur représente Renzo, peintre en pleine crise existentielle. Ils sont amis depuis toujours, mais Renzo sombre peu à peu dans une radicalité qui le rend ingérable.
La Voie royale de Frédéric Mermoud Pyramide (1 h 49)
Sophie est une lycéenne brillante. Encouragée par son professeur de mathématiques, elle quitte la ferme familiale pour suivre une classe préparatoire scientifique.
Zone(s) de turbulence

de Hafsteinn Gunnar Sigurðsson Rezo Films (1 h 37)
Sarah est phobique de l’avion. Pour sauver sa nouvelle relation amoureuse, elle doit apprendre à lâcher prise – quitte à endurer un vol follement imprévisible vers l’Islande…
70 Cinéma > Sorties du 19 juillet au 30 août no 199 – été 2023
02
lire p. 64
lire p. 40
lire p. 14
09
AOÛT 16

Les As de la jungle 2 Opération tour du monde de L. Bru, Y. Moulin et B. Somville SND (1 h 28)

lire p. 14
Qui appelle-t-on à la rescousse quand un mystérieux super-vilain recouvre la jungle d’une mousse rose qui explose au contact de l’eau ? Les As de la jungle !
La Bête dans la jungle de Patric Chiha (1 h 43)
Les Films du Losange lire p. 18
Pendant vingt-cinq ans, dans un club, un homme et une femme guettent ensemble un événement mystérieux. L’histoire du disco à la techno ; l’histoire d’un amour, d’une obsession.


Fermer les yeux de Víctor Erice
Haut et Court (2 h 49)
lire p. 66
Un acteur célèbre disparaît pendant un tournage. Vingt-deux ans plus tard, une émission de télévision consacre une soirée à cette affaire.
Kasaba de Nuri Bilge Ceylan


Memento (1 h 22) lire p. 62
Turquie, un petit village dans les années 1970. Deux enfants se frottent à la complexité du monde adulte… Le premier long métrage, inédit en salles, du réalisateur.
Quand les vagues se retirent de Lav Diaz
Épicentre Films (3 h 07)

lire p. 61
L’un des meilleurs enquêteurs des Philippines souffre de la campagne meurtrière anti-drogue menée par son institution. Pour guérir, il devra affronter ses propres démons.
Reality de Tina Satter

lire p. 38 et 63
Metropolitan FilmExport (1 h 22)
Le 3 juin 2017, Reality Winner, 25 ans, est interrogée par le FBI chez elle. Chaque dialogue du film est tiré de l’authentique transcription de cet interrogatoire.
71 Sorties du 19 juillet au 30 août <---- Cinéma
été 2023 – no 199
Seconde jeunesse de Gianni Di Gregorio Le Pacte (1 h 37)
Astolfo, professeur à la retraite, doit quitter son appartement romain, expulsé par la propriétaire. Désargenté, il décide de retourner au village de ses ancêtres.
Strange Way of Life de Pedro Almodóvar Pathé (31 min)
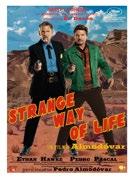
Silva traverse le désert à cheval pour retrouver Jake, désormais shérif, qu’il a connu vingt-cinq ans plus tôt lorsqu’ils étaient tueurs à gages.
AOÛT
Anatomie d’une chute de Justine Triet

Le Pacte (2 h 30)

lire p. 28 et 32
Sandra, Samuel et leur fils malvoyant de 11 ans vivent loin de tout, à la montagne. Un jour, Samuel est retrouvé mort. Une enquête pour mort suspecte est ouverte.
La Guerre des dieux de Ji Zhao
KMBO (2 h 07)
Jadis considéré comme un dieu puissant, Yang Jian a été réduit à la condition de tueur à gages déchu. Sa vie bascule quand une femme énigmatique lui propose une mission.
Hypnotic de Robert Rodriguez
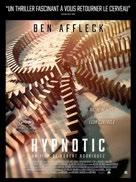
SND (1 h 33)
Déterminé à retrouver sa fille, le détective Danny Rourke poursuit des criminels qui hypnotisent des innocents pour qu’ils commettent des crimes contre leur volonté.

Infiltrée de Justin Lerner

L’Atelier (2 h 05)
Quand sa sœur disparaît, Sarita suspecte immédiatement le petit ami de celle-ci, qui fait partie d’un dangereux gang. Elle sera prête à tout pour découvrir la vérité.

Ma vie est un défi de Stephan Rytz
Jupiter Films (1 h 24)
Ex-golfeur professionnel, Yves Auberson est atteint de la maladie de Parkinson depuis l’âge de 35 ans. Elle touche aujourd’hui toujours plus de jeunes patients.
Retribution de Nimród Antal StudioCanal (1 h 30)

Alors qu’il conduit ses enfants à l’école, un homme d’affaires découvre qu’un inconnu a placé une bombe dans sa voiture. Il doit exécuter une série d’actions, sinon la bombe explosera.
Vera de Tizza Covi et Rainer Frimmel
Les Films de l’Atalante (1 h 55)

Vera, actrice blond platine au chapeau de cowboy, mène difficilement sa carrière dans l’ombre de son père, Giuliano Gemma, icône du cinéma italien des années 1960.

La Beauté du geste de Shō Miyake
Art House (1 h 39)

Keiko, une boxeuse sourde vivant dans les faubourgs de Tokyo, décide d’arrêter sa carrière alors que celle-ci commence à décoller.
No 10
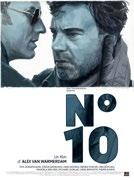
d’Alex Van Warmerdam Ed (1 h 40)
Günter, trouvé dans les bois en Allemagne à l’âge de 4 ans, mène quarante ans plus tard une vie normale, jusqu’à ce qu’un homme sur un pont lui chuchote un mot étrange.
Paradis d’Alexander Abaturov
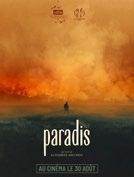
Jour2fête (1 h 28)
À l’été 2021, une vague de chaleur et une sécheresse exceptionnelle provoquent des incendies géants qui ravageront 19 millions d’hectares dans le nord-est de la Sibérie.
Le Rêve de Daisy de Ricard Cussó Alba Films (1 h 28)


Dans la cité sanctuaire, où tous les animaux vivent en harmonie, Daisy, une petite quokka, veut réaliser son rêve le plus cher : gagner la Coupe du monde de la peur.

Alam de Firas Khoury JHR Films (1 h 40)

Tamer, un lycéen palestinien vivant en Israël, voit sa vie bouleversée par l’arrivée de Maysaa. Pour la séduire, il accepte de participer à une mystérieuse opération.
Pyramide (1 h 24)
Cléo, 6 ans, adore Gloria, sa nounou, qui l’élève depuis sa naissance. Gloria doit retourner au Cap-Vert, et Cléo lui demande de tenir une promesse : la revoir au plus vite.
Banel & Adama de Ramata-Toulaye Sy Tandem (1 h 27)

Banel et Adama s’aiment. Mais là où ils vivent, dans un village éloigné du nord du Sénégal, il n’y a pas de place pour les passions, et encore moins pour le chaos.
Sages-femmes de Léa Fehner
Geko Films (1 h 38)
Lors de leur premier poste dans une maternité publique, Louise et Sofia, deux jeunes sages-femmes, se heurtent aux cadences folles d’un service au bord de l’explosion.
Super bourrés

Zinc Film (1 h 19)
Alors qu’ils cherchent de l’alcool pour une fête, Janus et Sam, deux lycéens, découvrent une étrange machine dans la cave du père de Janus.
72 Cinéma > Sorties du 19 juillet au 30 août no 199 – été 2023
Synopsis officiels
AOÛT 30
de Bastien Milheau
àma Gloria de Marie Amachoukeli
lire p. 62
lire p. 52
lire p. 34
lire p. 64
lire p. 14
23







































CULTURE
Dirigé pour la première année par le metteur en scène portugais Tiago Rodrigues, le festival d’Avignon prend des chemins de traverse. Notre sélection de spectacles exhorte à se balader hors des sentiers battus et à déplacer le regard. Elle invite à déambuler, en intérieur ou dans la nature, au son d’une steel guitar ou du chant des cigales. Elle questionne les identités, en traçant des voies d’émancipation pour les corps racisés, colonisés, exotisés. Elle fait entendre des voix féministes et transcende les normes de genre. Focus sur six spectacles et autant de pas de côté.

PAYSAGES
PARTAGÉS, STEFAN
KAEGI ET CAROLINE BARNEAUD
LE FESTIVAL D’AVIGNON HORS DES SENTIERS BATTUS
Et si le paysage devenait théâtre ? Créé sur les hauteurs de Lausanne et remonté à Pujaut, dans la garrigue, Paysages partagés est l’ambitieux projet de Stefan Kaegi et Caroline Barneaud. Le cofondateur de la compagnie berlinoise Rimini Protokoll, qui multiplie les pas de côté formels, et la curatrice ont convié des artistes internationaux à investir le paysage pour créer sept pièces, qui mobilisent le public pour sept heures de déambulation à l’extérieur. Écho à des questionnements pressants sur l’habitat et sur notre relation à ce que l’on nomme communément la « nature », cette pièce exhorte à changer de perspective en permanence : tour à tour passagers d’un drone en réalité virtuelle avec Begüm Erciyas et Daniel Kötter, projetés dans des sensations animales avec Sofia Dias et Vítor Roriz ou contemplateurs d’une nature omnisciente qui pérore avec El Conde de Torrefiel.

G.R.O.O.V.E., BINTOU DEMBÉLÉ

L’une des pionnières du hip-hop en France, Bintou Dembélé façonne depuis plusieurs années des spectacles qui mettent sur un pied d’égalité chorégraphie, voix et musique. Après avoir cocréé avec Clément Cogitore Les Indes galantes en 2017, réécriture de l’opéra-ballet du compositeur baroque Jean-Philippe Rameau, elle reprend les mêmes questionnements dans G.R.O.O.V.E., une performance déambulatoire. Danseurs et danseuses de krump et de voguing investissent les espaces de l’Opéra Grand Avignon, dans lesquels résonnent le chant de Célia Kameni et les riffs de la steel guitar de Charles Amblard. Façon de concrétiser la recherche de la chorégraphe autour d’une danse « marronne », en écho aux groupes de personnes noires esclavagisées qui retrouvaient la liberté pour fonder des sociétés autonomes, cette pièce s’affirme comme un acte de résistance et d’émancipation.
ÉCRIRESAVIE,
D’APRÈS L’ŒUVRE DE VIRGINIA WOOLF, PAULINE BAYLE
Après son succès d’Illusions perdues, dans une version épurée du roman, et ses précédentes adaptations, Iliade et Odyssée, la metteuse en scène Pauline Bayle s’entiche d’un autre mastodonte de la littérature : Virginia Woolf. Inspirée par le roman Les Vagues (1931), qui suit le parcours et l’évolution des relations d’un groupe d’amis de l’enfance à l’âge adulte, elle déploie un récit d’apprentissage, l’une de ses marottes. Avec comme défi de traduire et de donner corps, sur un plateau de théâtre, au stream of consciousness de Woolf, narration singulière qui traduit un monologue intérieur, elle promet de déployer la densité et la complexité de ces personnages. La pièce fait aussi écho à d’autres pans de l’œuvre de Woolf, comme une de ces réflexions, toujours aussi actuelle : comment écrire quand il n’y a pas de futur ?
74 Culture no 199 – été 2023
© Christophe Raynaud de Lage © Léonard Rossi
© Simon Gosselin
Rimini Protokoll, Théâtre Vidy-Lausanne
THE ROMEO, TRAJAL HARRELL
Il s’est fait connaître en explorant les liens entre danse savante post-moderne et voguing : l’Américain Trajal Harrell, virtuose d’une danse hyper émotionnelle, prend d’assaut la Cour d’honneur cet été. Le directeur du Schauspielhaus Zürich Dance Ensemble, compagnie dont il est artiste associé depuis 2019, y fait vibrer The Romeo, sa nouvelle création, dans laquelle il fait du célèbre personnage tragique shakespearien un archétype chorégraphique. Sur scène aux côtés de plus d’une dizaine d’interprètes, il déploie des gestes qui traversent une multitude de mondes et d’histoires : des paysages bucoliques des Alpes aux côtes agitées du Japon, en passant par la steppe d’Amérique du Nord. S’affirme une danse qui catalyse les tragédies de chacun, à la fois particulières et universelles, qui dépasse l’origine, le genre et les générations.
CARTE NOIRE NOMMÉEDÉSIR, RÉBECCA CHAILLON

MARGUERITE : LE FEU, ÉMILIE MONNET
Artiste à l’œuvre pluridisciplinaire, Émilie Monnet prend à bras le corps les questions d’identité, de langage et d’héritage à travers installations, performance et théâtre. Montréalaise d’origine anichinabée (ensemble de nations autochtones d’Amérique du Nord) et française, elle œuvre pour trouver des ponts entre les communautés autochtones du Québec et le reste du monde. Marguerite : le feu s’inscrit dans un triptyque avec l’installation performative Marguerite : la pierre et le podcast Marguerite : la traversée, dans lesquels elle met en scène sa rencontre avec Marguerite Duplessis, autochtone esclavagisée et première personne à demander justice devant le tribunal de Québec. Dans un ensemble qui mêle poésie, interviews, langue et chants autochtones, elle fait surgir sur le plateau une période coloniale violente. Un hommage à cette résistance, belle manière de réactiver la mémoire.
Performeuse intense et engagée, Rébecca Chaillon met en scène des pièces dans lesquelles le corps est au centre, soutenues par une scénographie désordonnée. Avec Carte noire nommée désir, elle réunit huit artistes noires sur scène pour un spectacle loufoque qui défonce les clichés racistes et sexistes pour mieux charrier essentialisation, exotisation et instrumentalisation des corps. Dans un ensemble carnavalesque et libérateur, les comédiennes font sonner une satire aussi grinçante que jouissive, qui prend la forme d’une danse exotique façon Joséphine Baker sur « Try to Remember », titre emblématique de la pub pour le café Carte Noire, ou encore d’un dîner scatophile qui se moque de la grande bourgeoisie. Rébecca Chaillon et ses acolytes n’hésitent pas à prendre de l’espace dans une chaleur sororale touchante, avec la complicité d’un public de femmes noires installées à côté d’elles sur la scène.



75 Culture été 2023 – no 199
77e édition du festival d’Avignon, du 5 au 25 juillet
BELINDA MATHIEU
© Christophe Raynaud de Lage
© Vincent Zobler
© Scott Benesiinaabandan
photo de répétition, Trajal Harrell, 2023
SÉLECTION CULTURE
Expos

APRÈS L’ÉCLIPSE TACITA DEAN

Gagnez des places en suivant TROISCOULEURS sur Facebook et Instagram
En résonance avec l’exposition « Après l’orage », l’artiste américaine Tacita Dean matérialise la mémoire enfermée dans les éléments, comme des tracés dans la roche, un glacier monumental dessiné à la craie ou des photographies de pruniers japonais en fleur.

Un film en 35 mm cartographie les souvenirs de l’artiste à l’aune des lieux qu’elle a sillonnées. • J. B.
> « Geography Biography », jusqu’au 18 septembre, à la Bourse de Commerce – Pinault Collection
NAPLES À PARIS PHILIPPE STARCK

De Paris à Marseille, cette exposition rassemble une communauté de digital natives, où culture du métissage, histoires de famille et mémoire coloniale sont revisitées à travers le prisme d’Internet, des mangas ou du jeu vidéo. Les années passant, un fossé s’est creusé entre la sphère de l’art contemporain et les diasporas issues de l’immigration et des quartiers populaires. C’était compter sans la clairvoyance de l’association Artagon, qui accompagne la création émergente depuis 2014. Leurs fondateurs, Anna Labouze & Keimis Henni, vont puiser dans les circuits parallèles de l’art et les (contre-)cultures minoritaires afin d’y détecter les talents de demain. Si certaines œuvres regroupées dans « Après l’éclipse » sont empreintes d’une forme de naïveté, on s’enchante devant les films de Rayane Mcirdi et Valentin Noujaïm (lire p. 26), les installations-performances de Ndayé Kouagou – des textes diffusés en

vidéo ou performés en live – ou les frénétiques chorégraphies de coupé-décalé de Christelle Oyiri, alias Crystallmess. Ces jeunes artistes s’émancipent des codes de la culture dominante pour proposer une relecture utopique du mode de vie communautaire et des artefacts pop qui ont bercé leur jeunesse. Animé par des questions sociales et par les rapports de domination qui opèrent dans notre société, Valentin Noujaïm filme des contes politiques et fantastiques en multipliant les formats (vidéo numérique, Super 8, found footage ), tandis que Rayane Mcirdi s’attache à recueillir des témoignages intimes de ses proches ou d’habitants des cités d’Asnières, la ville où il a grandi. Elles et ils se projettent dans un avenir commun, où l’utopie afrofuturiste aurait supplanté la stigmatisation raciale. • J. B. > jusqu’au 22 octobre, aux Magasins généraux (Pantin)
Dans une volonté de rapprochement des deux musées, le Louvre expose trente-trois des plus grands chefs-d’œuvre du Capodimonte. Les maîtres Raphaël et MichelAnge y dialoguent en majesté avec Titien et le Greco, tandis que les innombrables orfèvreries en porcelaine témoignent de l’âge d’or du royaume de Naples. Napoli amore mio ! • J. B.
> jusqu’au 8 janvier 2024 au Louvre
Livres
L’AUTRE
Classique du thriller psychologique, L’Autre a été adapté par Robert Mulligan en 1972. Deux jumeaux d’une douzaine d’années passent l’été dans la ferme familiale. L’un est adorable, l’autre est un diable. Une variation sur le dédoublement de personnalité, à (re)découvrir dans une nouvelle traduction. • Bernard Quiriny > de Thomas Tryon (Les Éditions du Typhon, 364 p., 23 €)
On ne présente plus la superstar du design qui suit ici les traces d’Alfred Jarry, le père de la pataphysique, pour retracer le Paris des objets mystérieux, insolites ou fantasmagoriques. Dévoilant une facette méconnue, Philippe Starck nous invite à embarquer dans « une navigation terrestre sur les étendues de l’imaginaire ». • J. B.
> « Paris est pataphysique », jusqu’au 27 août au musée Carnavalet – histoire de Paris
LES ASPERGES ET L’IMMORTALITÉ DE L’ÂME
Quasi inconnu en France, Achille Campanile est un monument de la littérature comique en Italie, célèbre pour ses scénarios, romans et chroniques. Voici une trentaine de récits brefs à l’humour loufoque et saugrenu, qui font de lui une sorte de cousin transalpin de Pierre Dac ou d’Alphonse Allais. • B. Q.
> d’Achille Campanile (L’Arbre vengeur, 328 p., 19 €)
Autre classique du roman d’angoisse, paru en 1957 et adapté au cinéma par Otto Preminger, Bunny Lake a disparu met en scène une mère à la recherche de sa fillette dans un New York labyrinthique et oppressant. Ambiance hitchcockienne, motifs fantastiques : un bon thriller psychopathologique pour vous refroidir cet été. • B. Q.
> d’Evelyn Piper (Denoël, 256 p., 21 €)
Dans les photographies cinégéniques de Harry Gruyaert, le temps semble suspendu au mouvement. Couleurs et lumières, architectures urbaines et figures humaines se répondent dans des compositions prises sur le vif. Des scènes de rue saisies dans sa Belgique natale, mais aussi au Maroc, en Égypte, en Inde, en Russie ou au Japon : le « sens des lieux » transparaît dans ces espaces transitoires. • Julien Bécourt
> « La Part des choses », jusqu’au 24 septembre au Bal
Envie d’histoires brèves à siroter au bord de l’eau cet été, entre deux baignades ? Essayez ce recueil de nouvelles de Mathieu Lestrohan, dont l’humour résigné et le comique de situation font mouche. La première nous emmène à Las Vegas, ce qui est sexy. Avec un héros nommé Edmond, ce qui l’est moins… • B. Q.
> de Mathieu Lestrohan (Le Dilettante, 190 p., 17 €)

76 Culture no 199 – été 2023
HARRY GRUYAERT
DISPARU
BUNNY LAKE A
WELCOME TO FABULOUS QUIMPER NEVADA
© Harry Gruyaert / Magnum Photos
© Zine Andrieu
Irlande, comté de Kerry, 1983
Francesco Mazzola, dit le Parmesan, Portrait de jeune femme appelée Antea, vers 1535
Dessin original de Philippe Starck, 2023. Sur une photographie attribuée à Albert Brichaut, Un train dans la rue. Accident en gare Montparnasse, 1895.
Tacita Dean, The Wreck of Hope, 2022
© Luciano Romano © Paris Musées / musée Carnavalet –histoire de Paris
© Courtesy de l’artiste, Marian Goodman Gallery et Frith Street Gallery / Photo : Fredrik Nilsen Studio
Spectacles
MADAME ARTHUR
SUMMER CAMP [CABARET]
ONE SONG [PERFORMANCE]
CHATTOLOGIE [THÉÂTRE]
15 FILMS GRATUITS TOUT L’ÉTÉ

Les créatures du cabaret Madame Arthur se transforment en monitrices de colo à l’occasion d’un programme estival extravagant et queer. Armées de leur humour décapant et de voix qui ont de quoi rendre jaloux, elles investissent les hits de la chanson française dans un drag show fou et audacieux. • Belinda Mathieu > jusqu’au 26 août au Divan du Monde

Performance sportive ou concert ? One Song est probablement un peu des deux. Lancé dans un rythme infernal, un groupe d’une dizaine de performeurs répète inlassablement la même chanson, en faisant des abdos ou du violon sur une poutre. Un rituel envoûtant, qui permet à la metteuse en scène Miet Warlop de nous donner sa version de l’histoire du théâtre. • B. M.
> du 12 septembre au 1er octobre au Théâtre du Rond-Point
La comédienne Alice Bié reprend le rôle de Klaire fait Grr dans un stand-up sur les règles qui a déjà fait ses preuves. Coécrit avec Louise Mey, ce spectacle entre la conférence et le seul-en-scène décortique tous les mythes et tabous autour des menstruations avec humour. Créée en 2017, cette pièce féministe n’a pas pris une ride. • B. M. > jusqu’au 25 août à la Comédie des 3 bornes

Pour passer quatre belles semaines estivales, mk2 Curiosity a vu les choses en grand en proposant gratuitement un best of de quinze films savoureux, à visionner à l’envi. Longs métrages, pépites curieuses, documentaires immanquables… On vous laisse découvrir cette sélection surprise.
> du 20 juillet au 17 août, sur mk2curiosity.com, gratuit
ANOHNI AND THE JOHNSONS
Illustré par un portrait de la militante des droits LGBTQ Marsha P. Johnson, ce nouvel album d’Anohni est produit par Jimmy Hogarth (Amy Winehouse, Tina Turner) et s’inspire de la musique soul américaine la plus émotionnelle (Marvin Gaye), le chant à fleur de peau de l’artiste mêlant inextricablement l’intime et le politique. • Wilfried Paris
> My Back Was a Bridge for You to Cross (Rough Trade Records)
JIM O’ROURKE
Jim O’Rourke sort de son exil japonais avec une B.O. nimbant les vastes paysages nord-américains d’inquiétants glissandos électroniques. Figure influente du rock indépendant américain dans les années 1990-2000 (il a produit certains des meilleurs albums de Smog, Joanna Newsom, Stereolab ou Wilco, a été membre de Gastr del Sol, Loose Fur ou Sonic Youth) et expérimentateur de musique electro-acoustique de haut vol (collaborant notamment avec Derek Bailey, Henry Kaiser, Christian Fennesz et Peter Rehberg), Jim O’Rourke a toujours flirté avec le cinéma. Sa fameuse trilogie d’albums pop, Bad Timing, Eureka et Insignificance, est intitulée d’après des films de Nicolas Roeg ; il a participé à la musique de Grizzly Man de Werner Herzog, à celle – réalisée par sa compagne Eiko Ishibashi – de l’acclamé Drive My Car de Ryusuke Hamaguchi et il a signé les B.O. d’une flopée de films indépendants, dont ceux du réalisateur Kyle Armstrong, qui l’a de nou-
THE FOLK IMPLOSION
PJ HARVEY Son
En 1995, Kids, le premier long métrage de Larry Clark, marqua autant les esprits pour sa description crue des désirs et excès d’adolescents new-yorkais en pleine épidémie de sida que pour la B.O. de Lou Barlow et John Davis, objet grunge pop lo-fi joyeusement iconoclaste (samplant Erik Satie ou les Silver Apples), dont la dissonance douce-amère n’a pas vieilli. • W. P.
> Kids (original motion picture soundtrack), réédition (Domino Records)
veau sollicité pour Hands That Bind, film d’épouvante pas encore sorti en France. D’un premier abord « classique » (piano, contrebasse, violons, percussions) assez inattendu (O’Rourke ne produit quasiment plus que de la musique électronique expérimentale depuis son installation au Japon au début des années 2000), la partition créée pour ce drame gothique situé dans les prairies de l’Ouest canadien dissout une musique folk pastorale, primitive et contemplative, dans de sombres glacis menant vers des abstractions electro-acoustiques. L’ensemble crée une atmosphère à la fois familière et inquiétante, à la tonalité sans cesse changeante, capturant idéalement l’ambiance de ce western teinté de fantastique, dans lequel la précarité paysanne fait glisser ses protagonistes vers la paranoïa. Une B.O. qui se tient toute seule, comme un album à part entière dans une passionnante discographie. • W. P.
> Hands That Bind (original motion picture soundtrack) (Drag City)
D’une voix haute, tremblante de vulnérabilité, PJ Harvey surprend dès les premières notes de ce nouvel album intimiste (batterie, guitare, John Parish et Flood en seuls complices), dans lequel de ses mélodies mémorables affleurent peurs d’enfant, colères de femme, deuil et renaissance. On la croit perdue, on finit par la retrouver. • W. P.
> I Inside the Old Year Dying (Partisan Records)
Concert
DE LA SOUL AND GUESTS

RENDEZ-VOUS AVEC PATRIC CHIHA
À l’occasion de la sortie en salles le 16 août de l’envoûtant La Bête dans la jungle (lire p. 18), rencontre avec le réalisateur autrichien. Un oiseau de nuit dont vous pourrez découvrir plusieurs des films gratuitement.
> du 10 au 24 août, sur mk2curiosity.com, gratuit

LET’S DANCE !
Le festival Jazz à la Villette invite ces légendes du hip-hop américain, inventeurs avec 3 Feet High and Rising, leur premier album, publié en 1989, d’un rap cool, ludique et érudit (samplant aussi bien James Brown que The Turtles ou Steely Dan). Ils présenteront leur répertoire en format live band. • W. P.


> le 30 août, à la Philharmonie de Paris
à 20 h
Pour être en forme à la rentrée, les journalistes et programmateurs de mk2 ont concocté une programmation propice au twerk sur canapé. Les Parapluies de Cherbourg, Tirez sur le pianiste, Cuba Feliz… Des soirées endiablées en perspective.
> du 17 au 31 août, sur mk2curiosity.com

77 Culture été 2023 – no 199
© Teresa Suárez / Madame Arthur
© Michiel Devijver
© mk2 © Cha Gonzalez © D.R.
Herbes flottantes de Yasujirō Ozu (1959)
Patric Chiha
Cuba Feliz de Karim Dridi (2000)
© Sébastien Monachon
Page jeux Page jeux
les différences les mots croisés ciné


Ce mois-ci, pour la sortie de La Bête dans la jungle de Patric Chiha (au cinéma le 16 août, lire p. 20), on vous propose une grille à faire avant d’aller guincher (on a décidé que ça se disait encore) en club.
• PAR ANAËLLE IMBERT – © LES MOTS, LA MUSE
HORIZONTALEMENT 1. Aiguillon d’abeille. Elle coupe avec les dents. 2. Administrées. Femelle du paon. 3. Chrome. Espèce disparue. Fait un petit kilomètre. 4. Il est de l’autre côté du détroit de Gibraltar. Usurière. 5. Drame psychologique de Gaspar Noé avec Sofia Boutella et Romain Guillermic. Puissant algorithme. Avances sans but précis. 6. Tels des Émirats. En tête de train. Lettres à écrire. 7. Elle ne pèse pas lourd. 8. Derrière la caméra pour le film Simone Barbès ou la Vertu. Poisson et café. 9. Parti délaissé. Son prochain. 10. Elles rythment la période estivale. Apéritif. 11. Amuse-bouche. Il fait s’affronter deux rivaux. 12. Teen movie déjanté de Harmony Korine. 13. Chef-lieu de Normandie. Poisson au corps aplati. 14. Jeux de séduction. Il prône la liberté des mœurs. Il relève ce qui est plat. 15. Ambassadeur du pape. 16. Comédie de Blake Edwards sortie en salles en 1969. Rangea. 17. Enterra la hache de guerre. Verbal. 18. Grand club à Milan. Joindrons nos forces. 19. Une sorte d’avoir. 20. Ajoutés à son royaume. 21. Avoir à plusieurs. On l’a sur le dos. 22. Exige beaucoup du service. Sait se faire entendre. 23. Recueil de bons mots. Chaleurs dans la campagne. 24. Consommée pour du liquide. Fait un article.

VERTICALEMENT A. Pièce d’eau. B. Roulement de tambour. C. Dépeindra. Arbres décoratifs. C’est la France. Il est forcément sélectif ! Cela vaut de l’or. D. Fixa ensemble. Il a sa clef. Commence à hennir. Couverture du quotidien. E. N’est pas sans portée. Film musical de 1972 réalisé par Bob Fosse. Tirent leur force. Se risqua. F. Déséquilibré. Détester au plus haut point. Précurseur du polar. Animal têtu. G. Sujet personnel. Bertrand Bonello fut aux manettes de ce biopic sorti en 2014. H. Point bariolé. Juste ici. Paire de cannes. Existera. Le premier d’une longue série. I. Fait d’inhaler des vapeurs pour se soigner. Gigatonne. Fait usage. J. Office de tourisme. C’est du plomb ! Il a du coffre ! K. Rapporte du blé. Serait très pressant. Qui ont plusieurs lignes de front. L. Il aspire à devenir une étoile. Finit évanoui. À travers. Un endroit où décompresser. M. Alcool japonais. Son film, 120 battements par minute, a reçu le Grand Prix du Festival de Cannes 2017. Pousse sur les plantes. N. Vit avec la comtesse. Mot d’enfant. Bon pour accord. Sans valeur. O. Dans l’air du temps. Cinéaste à qui l’on doit Les Nuits de la pleine lune. Planète rouge. Il est personnel et réfléchi. P. Supportée avec patience. Membre supérieur. Q. Qui a perdu les eaux. Le plus vaste des continents. R. Mis au monde. Do usé. Sacrément préféré !
les différences les différences
À
Les solutions ici :
À gauche, une image du film Barbie de Greta Gerwig (au cinéma le 19 juillet, lire p. 6).
droite, la même, à sept différences près.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 no 199 – été 2023 78 © 2022 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved
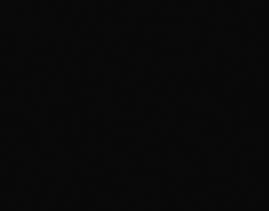

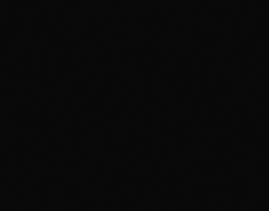
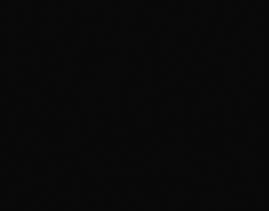
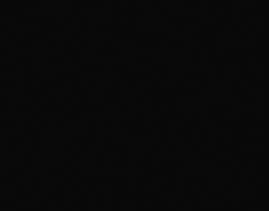
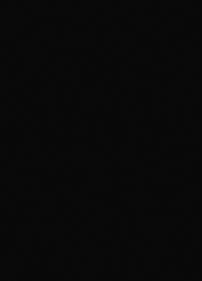
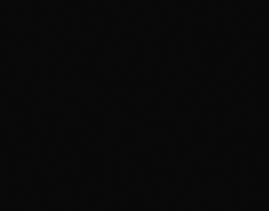



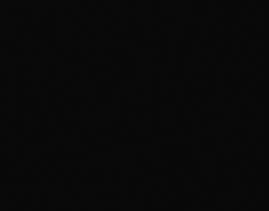

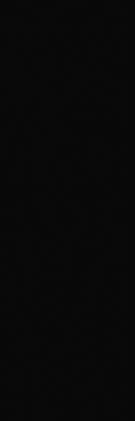




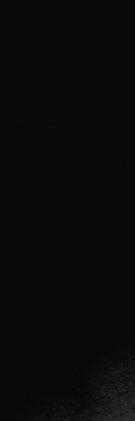












































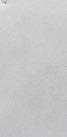









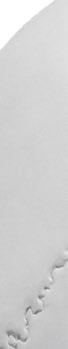



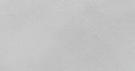






























été 2023 – n EXPOSITION 8 JUIN — 5 NOVEMBRE 2023 Ron Mueck, Mass 2016-17 , dimensions variables, National Gallery of Victoria, Melbourne, Felton Bequest, 2018. © Ron Mueck. Photo : Tom Ross.
UNE SÉRIE C+

EN CE MOMENT SEULEMENT SUR

© 2022 Peacock/Universal Content Productions LLC. All Rights Reserved













































 QUENTIN GROSSET
QUENTIN GROSSET




















































































































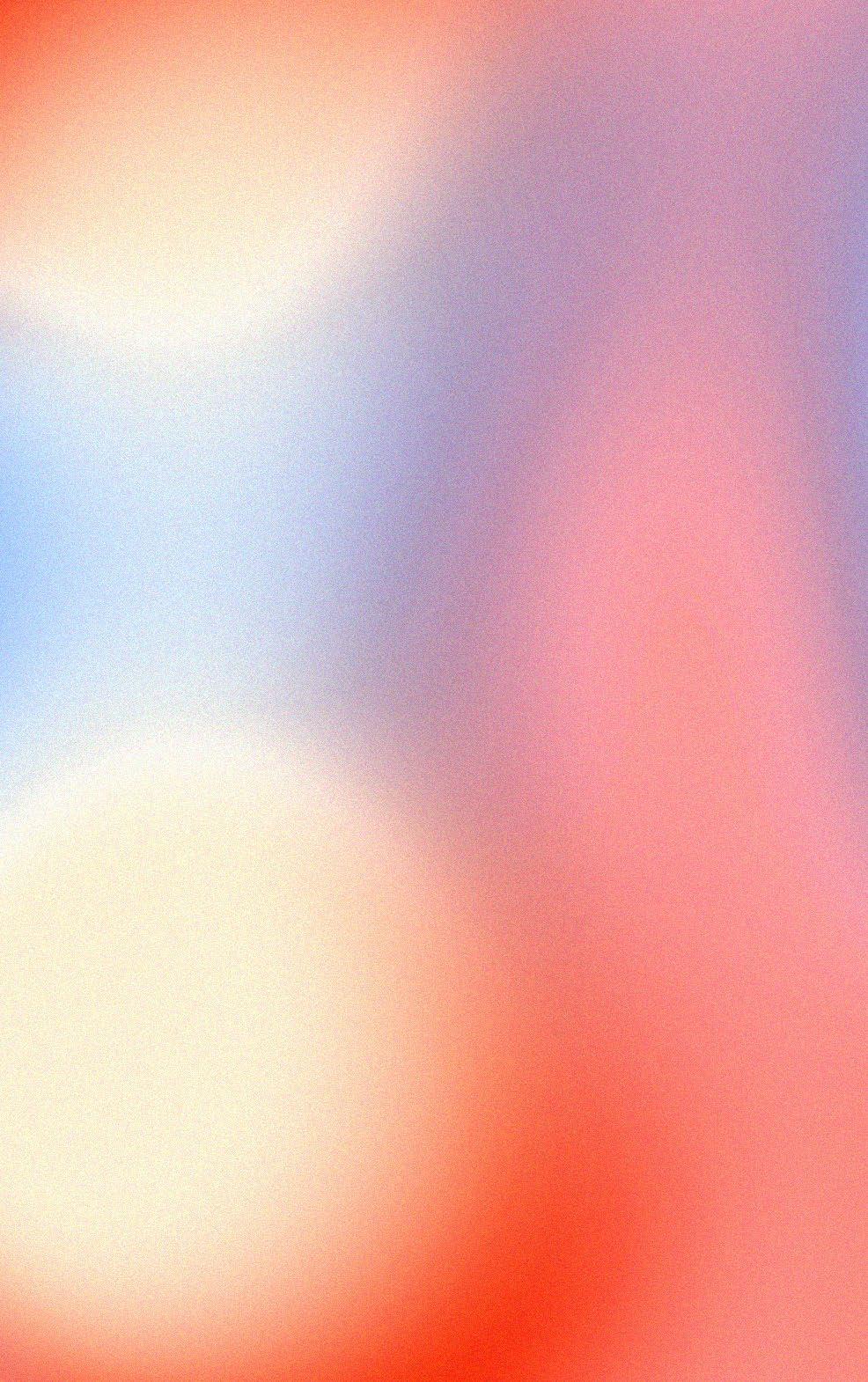













































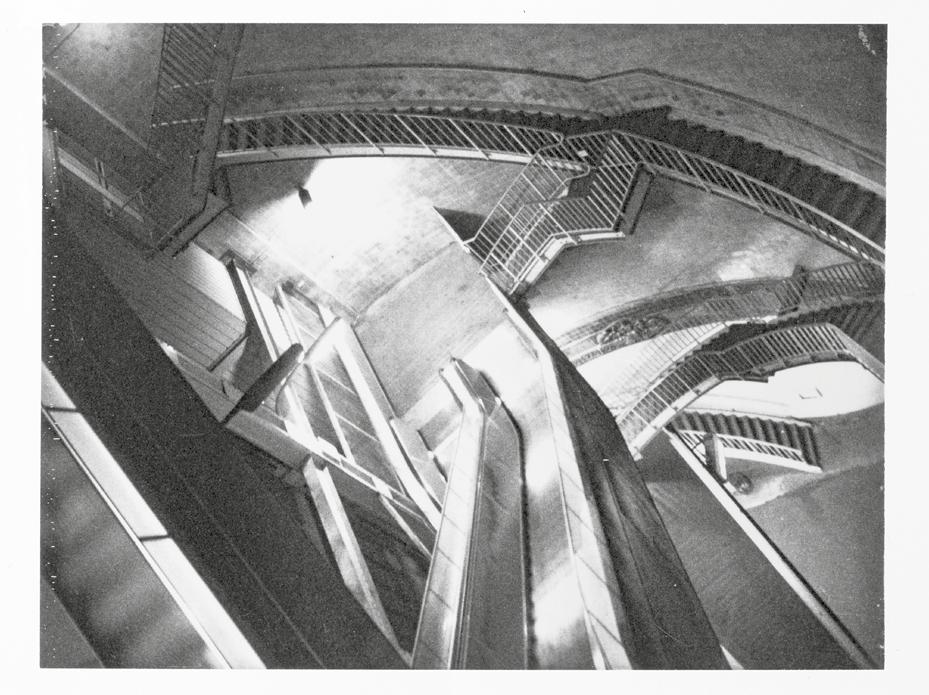



























































 QUENTIN GROSSET
QUENTIN GROSSET