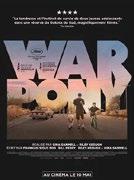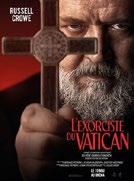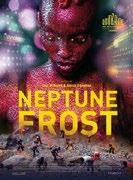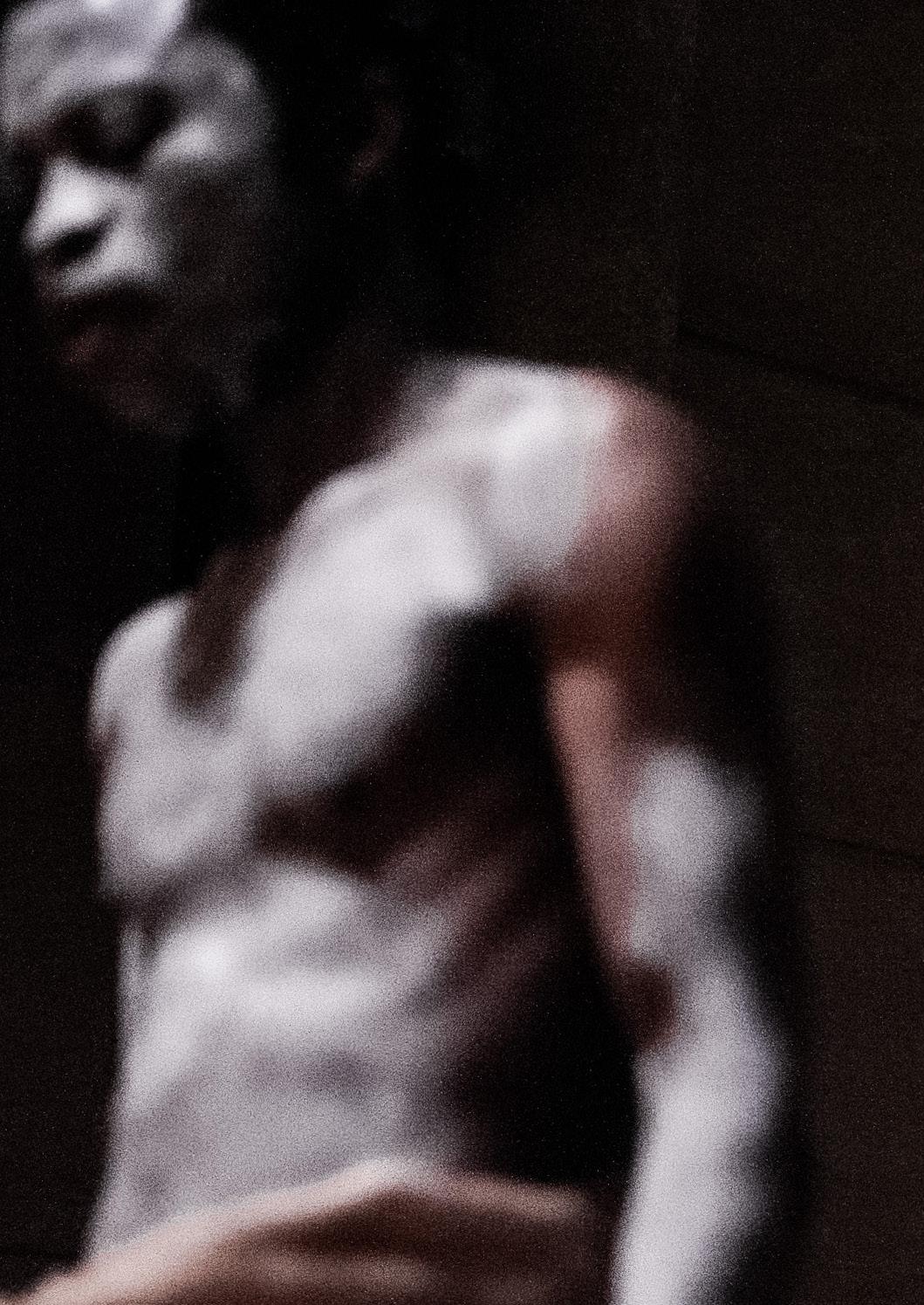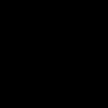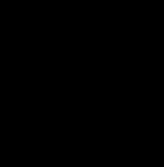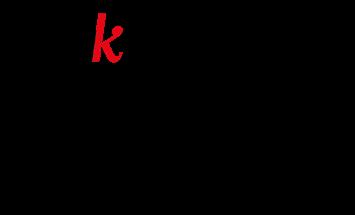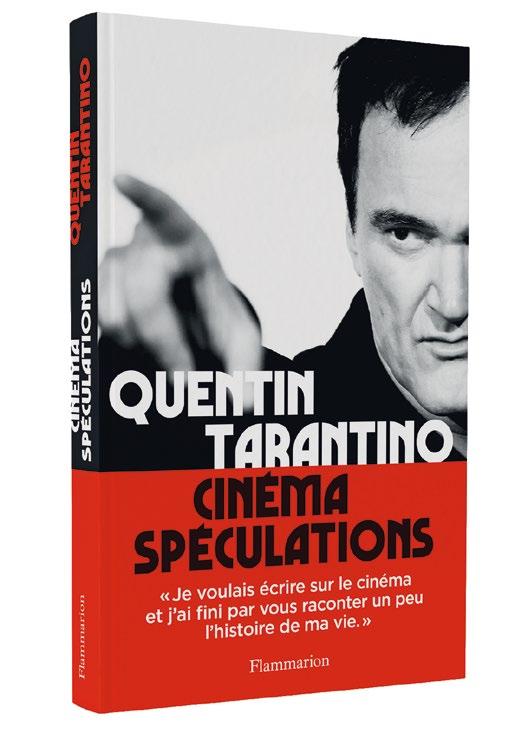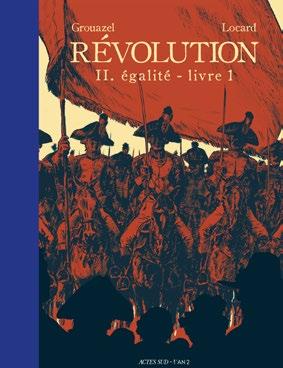VALÉRIE DONZELLI
passe l’époque au peigne fin avec le cruel et subtil L’Amour et les Forêts
cinéphile, défricheur et engagé, par > no 197 / mai 2023 / GRATUIT

ROBIN CAMPILLO
« J’ai fait L’Îlerougepour balayer ma nostalgie de Madagascar, pour la brûler » p. 26
CANNES 2023
Notre top 25 des films qui vont raviver la flamme du cinéma p. 34
GARANCE MARILLIER


L’ultra physique actrice
française donne tout en star du foot dans Marinette p. 42
MK2 INSTITUT
La militante Camille Étienne nous incite à un soulèvement écologique p. 88

Journal
UN FILM DE JEANNE ASLAN & PAUL SAINTILLAN “IMPOSSIBLE DE NE PAS FONDRE DEVANT CE FILM” TÉLÉRAMA CÉLESTE BRUNNQUELL QUENTIN DOLMAIRE HAÏKU FILMS AU CINÉMA LE 14 JUIN PRIX D’INTERPRÉTATION MASCULINE GRAND PRIX NEW DIRECTORS PRIX DE LA CRITIQUE ET DU PUBLIC
VIRGINIE EFIRA

MELVIL POUPAUD
ET LES FORETS L’AMOUR
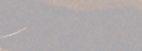
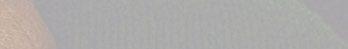
UN FILM DE VALÉRIE DONZELLI
AVEC LA PARTICIPATION DE DOMINIQUE REYMOND ROMANE BOHRINGER ET VIRGINIE LEDOYEN
SCÉNARIO ADAPTATION ET DIALOGUES VALÉRIE DONZELLI ET AUDREY DIWAN D’APRÈS LE ROMAN DE ÉRIC REINHARDT « L’AMOUR ET LES FORÊTS » PUBLIÉ AUX ÉDITIONS GALLIMARD
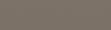













MUSIQUE ORIGINALE GABRIEL YARED



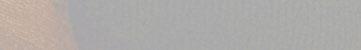



LE 24 MAI AU CINÉMA



CRÉDITS
© 2023 RECTANGLE PRODUCTIONS FRANCE 2 CINÉMA LES FILMS DE FRANÇOISE
NON CONTRACTUELS
EN BREF

P. 4 L’ENTRETIEN DU MOIS – PHILIPPE AZOURY À PROPOS D’EUSTACHE
P. 10 RÈGLE DE TROIS – JENNIFER PADJEMI

P. 14 LES NOUVEAUX – IRIS CHASSAIGNE & ZENO GRATON
TROISCOULEURS
éditeur MK2 + — 55, rue Traversière, Paris XII e — tél. 01 44 67 30 00 — gratuit directeur de la publication : elisha.karmitz@mk2.com | directrice de la rédaction : juliette.reitzer@mk2.com | rédactrice en chef : time.zoppe@mk2.com | rédacteurs : lea.andre-sarreau@mk2.com, quentin.grosset@mk2. com, josephine.leroy@mk2.com | directrice artistique : Anna Parraguette | graphiste : Ines Ferhat | secrétaires de rédaction : Claire Breton, Vincent Tarrière | renfort correction : Marie-Aquilina El Hachem | stagiaire : Clémence Dubrana Rolin | ont collaboré à ce numéro : Margaux Baralon, Julien Bécourt, Lily Bloom, Xanaé Bove, Tristan Brossat, Thomas Choury, Marilou Duponchel, Julien Dupuy, Yann François, Claude Garcia, Éléonore Houée, Anaëlle Imbert, Corentin Lê, Damien Leblanc, Copélia Mainardi, Belinda Mathieu, Jérôme Momcilovic, Wilfried Paris, Michaël Patin, Raphaëlle Pireyre, Perrine Quennesson, Bernard Quiriny, Cécile Rosevaigue, Hanneli Victoire & Célestin et Adèle | photographes : Julien Liénard, Paloma Pineda, Marie Rouge | illustratrice : Sun Bai | publicité | directrice commerciale : stephanie. laroque@mk2.com | cheffe de publicité cinéma et marques : manon.lefeuvre@mk2.com | responsable culture, médias et partenariats : alison.pouzergues@mk2.com | cheffe de projet culture et médias : claire.defrance@mk2.com
Photographie de couverture : Marie Rouge pour TROISCOULEURS
Imprimé en France par SIB imprimerie — 47, bd de la Liane — 62200 Boulogne-sur-Mer

TROISCOULEURS est distribué dans le réseau ProPress Conseil ac@propress.fr
ÉDITO
Se souder. Dès son deuxième long métrage, le succès surprise La guerre est déclarée en 2011, qui mettait en scène le combat mené avec son compagnon d’alors, l’acteur Jérémie Elkaïm, contre la tumeur diagnostiquée à leur jeune enfant, Valérie Donzelli a fait de ce verbe le nerf de son œuvre. Se souder, c’était même le pitch de son film suivant, Main dans la main (2012), dans lequel elle faisait jouer à Valérie Lemercier, en duo avec Jérémie Elkaïm, un couple incapable de se décoller physiquement. Fusion amoureuse toujours, cette fois entre un frère et une sœur, dans le film d’époque Marguerite et Julien (2015). Mais depuis le virage Notre dame (2019), irrésistible comédie
P. 18 EN COUVERTURE – VALÉRIE DONZELLI, CINÉASTE DANS LE VENT

P. 26 ENTRETIEN – ROBIN CAMPILLO, RETOUR À L’ÎLEROUGE
P. 34 CANNES 2023 – LES 25 FILMS QUI VONT RAVIVER LA FLAMME DU CINÉMA
P. 48 MOTS-CROISÉS – TODD HAYNES


P. 58 CINEMASCOPE : LES SORTIES DU 10 MAI AU 7 JUIN

CINÉMA CULTURE
P. 78 SPECTACLE – MARION SIÉFERT, RÉALITÉ AUGMENTÉE

P. 80 SON – LUCIE ANTUNES
dans laquelle elle campait une architecte débordée menant un projet de réaménagement du parvis de la célèbre cathédrale parisienne (qui a brûlé quelques mois après le tournage), il a moins été question, dans son cinéma, de soutien dans le couple que de collaboration avec d’autres proches, ami(e)s, collègues, parents, voire inconnu(e)s, pour tisser un maillage à toute épreuve. Elle nous avait pourtant dit en interview avoir écrit le film avant #MeToo, mais la révolution était déjà à l’œuvre : la cinéaste sentait déjà qu’elle pouvait saisir des enjeux propres à l’époque. Dans son nouveau long, L’Amour et les Forêts, l’héroïne (Virginie Efira) doit carrément apprendre à se forger une cotte de mailles contre le couple lui-même, très lentement empoisonné par la toxicité de son compagnon (Melvil Poupaud). En entretien, la cinéaste n’a cessé de citer les personnes avec lesquelles elle a collaboré à la fabri-
cation de ce film puissamment moderne et libérateur, soulignant que bâtir une œuvre requiert effort collectif, communication, entraide et vision commune. Sélectionné en last minute à Cannes première (autrement dit, en sélection officielle, mais pas en Compétition), L’Amour et les Forêts fait pour nous figure d’exemple autant dans la manière de concevoir une œuvre que dans la façon dont Valérie Donzelli et son équipe ont su explorer un sujet d’actualité particulièrement délicat. C’est évidemment loin d’être le seul film attrayant de cette 76e édition du Festival – on s’épanche sur nos attentes dans un dossier spécial –, mais c’est à nos yeux l’un de ceux qui représentent le plus brillamment tout ce qu’on voudrait que le cinéma porte à présent.
TIMÉ ZOPPÉ 03
Sommaire
© 2018 TROISCOULEURS — ISSN 1633-2083 / dépôt légal quatrième trimestre 2006 Toute reproduction, même partielle, de textes, photos et illustrations publiés par mk2 + est interdite sans l’accord de l’auteur et de l’éditeur — Magazine gratuit. Ne pas jeter sur la voie publique.
+ UN CAHIER MK2 INSTITUT DE 12 PAGES EN FIN DE MAGAZINE
P. 84 PAGE JEUX
mai 2023 – no 197
Bernadette Lafont, interprète de La Maman et la Putain 1973) de Jean Eustache, parlait du film comme d’« un texte de feu ». Alors que tous les films du cinéaste écorché ressortent en salles (lire p. 73), l’écrivain, critique et scénariste Philippe Azoury y répond par un texte tout aussi vertigineux et enflammé, Jean Eustache. Un amour plus grand… Il s’interroge sur ce que cette œuvre qui le hante peut nous dire aujourd’hui – et dépasse le sujet Eustache pour proposer une redéfinition de l’amour, débarrassé du narcissisme. Rencontre.
Vous avez fini d’écrire votre livre hier et vous répondez déjà à nos questions. Vous êtes habitué à cette urgence ?
Le pire, c’était pour mon livre À Werner Schroeter, qui n’avait pas peur de la mort [Capricci, 2010, ndlr]. Emmanuel Burdeau, mon éditeur, m’avait dit le vendredi : « Ça part lundi chez l’imprimeur. » Je commence à le relire et je me dis : « C’est nul, en fait. » Je lui ai dit que j’allais le réécrire entièrement, pendant tout le week-end. Je lui ai renvoyé un nouveau livre le lundi, à 6 heures du mat’, et à 7 h 30 il m’a dit : « Ouais, c’est mille fois mieux. » Pendant un moment, j’ai pensé que c’était une mauvaise habitude de presse. Mais Joseph Ghosn [actuel directeur adjoint de Madame Figaro, avec lequel Philippe Azoury a écrit un livre, The Velvet Underground, Actes Sud, 2016, ndlr] m’a fait remarquer que je réécrivais toujours tout deux, trois fois.

Ce titre, Jean Eustache. Un amour si grand…, vous l’avez aussi trouvé il y a peu. Je voulais condenser le bouquin avec une phrase. En décembre, j’ai passé un oral au Centre national du livre pour avoir une aide. Dans le jury, il y avait Nathalie Richard [actrice-phare de Jacques Rivette et de Bertrand Mandico, ndlr], et j’avais l’impression qu’en me regardant elle me disait : « Je l’ai, ta formule, mais je ne te la donnerai pas. » Ensuite, chez un disquaire génial, j’ai trouvé un vinyle très rare de Ghédalia Tazartès [artiste affilié à la musique concrète, disparu en 2021, ndlr], je n’en avais jamais eu entre les mains. Je l’achète et l’écoute un samedi à 17 heures en travaillant sur le livre – est-ce que c’était le moment de mettre de
la musique expérimentale ? Je ne sais pas. Je retourne la pochette et je vois le titre de ce morceau : « Un amour si grand qu’il nie son objet ». En faisant quelques recherches, je découvre que Tazartès a été très longtemps le compagnon de Nathalie Richard…
La formule synthétise ce passage du livre consacré au célèbre monologue du personnage de Veronika dans La Maman et la Putain. « Veronika propose une chose simple : aller chercher l’amour en oubliant un peu de soi chez quelqu’un qui ne ramènerait pas tout à soi… » Je vais te faire toute la chronologie. Il y a cinq ans, j’avais déjà écrit un livre sur Eustache. Mais je l’ai détruit. C’était très complaisant, empreint de mythologie – sur les années 1970, sur La Coupole, sur Le Select, où il traînait… Ces cinq dernières années, beaucoup de choses ont changé dans la société, que le terme « #MeToo » ne recouvre pas entièrement, et ça a transformé le livre. D’un ouvrage sur le cinéma d’Eustache, c’est devenu un livre sur ce que dit Veronika. Depuis que j’ai vu La Maman et la Putain, à 16 ans, je n’ai jamais été complètement au point sur ce qu’elle disait. Ça m’a soulagé d’entendre un entretien de Françoise Lebrun sur France Culture qui date de 1985. Elle qui joue Veronika dans le film dit à quel point ce monologue est pétri de contradictions. L’interprétation que j’en donne, c’est qu’elle plaide pour un abandon du narcissisme. Elle voudrait aimer quelqu’un, mais que cet amour soit un espace commun, où la possession n’entrerait plus en jeu. Je ne sais pas si c’est possible, mais il faut y croire.
Comment vous est-il apparu que Veronika était le personnage principal de La Maman et la Putain, mais aussi de votre livre ?
Pendant vint-cinq ans, on a vu les films d’Eustache dans des copies dégueu, sous le manteau. Maintenant qu’ils sortent en salles, il faut savoir les écouter. Et surtout l’écouter elle, ce qu’elle a à dire. Récemment, j’étais en after à Berlin, et je regardais les gens autour de moi, tous genres confondus, entre 20 et 30 ans. Je me demandais : « Ce que Veronika dit, est-ce que ça a encore un sens ? » C’est devenu l’obsession du livre, le centre absolu. Qu’est-ce qu’elle a à dire ? Depuis cinq ans, il s’est non seulement passé beaucoup de choses autour des genres et des sexualités, mais j’ai aussi rencontré la psychanalyse, la parole de Jacques Lacan. C’est ce qui m’a orienté sur cette histoire de narcissisme. Ce monologue, vous le comprenez, aujourd’hui ?
Toujours pas. Il y a une idée qui m’est venue avant-hier soir. À partir du moment où Eustache filme le monologue de Veronika, il y a chez lui une défiance terrible par rapport à la parole, à sa puissance, à sa vérité. Il faut le prendre comme un texte, un texte que Françoise Lebrun joue. Le monologue a été prélevé dans la réalité d’une façon scandaleuse [soit Eustache, qui était hypermnésique, s’est souvenu de ce que lui avait dit la femme qui lui a inspiré le personnage de Veronika, Marinka Matuszewski, soit il l’avait enregistrée à son insu, ndlr]. Depuis cinquante ans, on parle donc à Lebrun d’un monologue qui n’est pas le sien. Marinka Matuszewski disparaît avec Françoise Lebrun. Personne ne se demande ce qu’elle est devenue. Elle
no 197 – mai 2023 04 Cinéma > L’entretien du mois
a été filmée dans la voix d’une autre. Il y a comme une opération de transfert psychanalytique, ou de magie noire, de transsubstantiation.
Vous posez justement Eustache en grand cinéaste du rituel, notamment avec son documentaire La Rosière de Pessac (1968), dans lequel il revient filmer une cérémonie folklorique dans sa commune natale, Pessac.
Pour moi, il revient un peu la queue entre les jambes. Ça fait alors dix ans qu’il est parti. Sa position de neutralité, c’est celle de quelqu’un qui ne sait pas où se mettre. Où est sa place ? C’est une question permanente dans son cinéma.
En parlant de son passé d’ouvrier SNCF devenu cinéaste, vous faites un parallèle entre Jean Eustache et l’écrivaine Annie Ernaux, nobelisée l’an dernier. Qu’auraient-ils eu à se dire ?
La question qu’ils posent, c’est : qu’est-ce que la mémoire humiliée ? Une fiction qui serait collective. Les films n’appartiennent pas à leurs cinéastes. Il y a une part d’intelligence collective qui se joue là, qui les
Vous réaffirmez Eustache en minoritaire, en subalterne, alors que, pour beaucoup, il est ce dandy de SaintGermain-des-Prés. Pourquoi était-ce important pour vous ?
J’ai découvert les films d’Eustache quand j’étais à Sète, dont je suis originaire. C’était très fort pour moi : dans Le Père Noël a les yeux bleus (1967), il filmait Narbonne, ses décos de Noël, ses platanes, les fins d’après-midi étranges. Je suis resté à Sète jusqu’à 24 ans, mais dès mes 9 ans j’ai voulu me casser. Et, pourtant, le peu de désir de réalisation que j’ai pu avoir à un moment donné, c’était de filmer là où j’avais grandi. C’est intéressant : pourquoi, ce qui t’a fait tellement de mal, c’est ça que tu as envie de filmer ? Ce n’est jamais réglé. Eustache revient pour régler des comptes, dire qu’il y a un secret ici, entre tels platanes, à telle heure, au moment où apparaît cette lumière.
Dans son court métrage Les Mauvaises Fréquentations (1964), Jean Eustache se moquait d’un texte critique de JeanLouis Comolli intitulé « Vivre le film ». Quel rapport avez-vous avec cette idée ?
tendu les mêmes choses. Tu ne le comprends qu’en fonction de ce que tu vis au présent.
Cette question du temps au cinéma semble vous travailler. Pourquoi ça vous touche tant ?
dépasse. La grande humilité d’Eustache, c’est de laisser rentrer des choses qui l’intriguent, l’interrogent. Son œuvre n’est pas le fruit de ce qu’il a pensé, elle est celui de ce contre quoi il se cogne.
C’est toute la question de son film Une sale histoire (1977) : qu’est-ce qu’il y a derrière ce trou par lequel les voyeurs viennent mater dans les toilettes des femmes ?
C’est sidérant : il n’y a rien à voir. Tout plan est un détail et mène à un trou. Quand tu as tout interrogé, que tu n’y arrives plus, tu tombes sur le trou.
Cette question de vivre les films, je la relie surtout à L’Homme ordinaire du cinéma de Jean-Louis Schefer [Gallimard, 1980, ndlr]. Ça résout presque la question dont on parlait tout à l’heure : les films sont plus intelligents que leurs auteurs. Je ne veux pas séparer l’homme de l’artiste, mais je veux bien séparer les œuvres des auteurs. L’intuition lumineuse de Schefer, c’est que les films en savent plus long sur nous. Je suis regardé par les films d’Eustache. Le grand mystère de La Maman et la Putain – je ne sais plus à combien de visionnages j’en suis –, c’est que je n’y ai jamais en-
Je crois que je n’aime profondément que les cinéastes qui ne font pas de reconstitution, qui ont du mal à les faire, qui les ratent. Ou qui filment le ratage, le raté. Je cite cette phrase de Louis Jouvet dans le bouquin : « Au théâtre, on joue ; au cinéma, on a joué. » On vient embaumer un instant présent. Ce temps embaumé, il redevient présent à la projection. Pendant quinze ans, j’ai été archiviste à la Cinémathèque française, notamment sur les films nitrate 19051915. On passait nos journées à réanimer des mondes ! On avait des blouses blanches et, comme c’était du muet, on passait beaucoup de techno. C’était vers la fin des années 1990, quand Schefer a sorti un deuxième bouquin sur le cinéma, Du monde et du mouvement des images [Gallimard, 1997, ndlr]. Il parlait d’une roue du temps que tu peux détraquer. Nous, on le savait plus que les autres, parce que les films muets ne sont pas à vingt-quatre images par seconde – le temps de la reconstitution la plus correcte. Ces boîtes de films nitrate n’avaient jamais été rouvertes : on avait des sortes de pics à glace pour arriver à faire sauter la rouille. C’était une matière vivante, les images étaient bouffées par des champignons. C’est vrai que je m’aperçois qu’avoir travaillé tant d’années entouré de films qui étaient comme des boîtes à oubli… Je pense qu’il y a un secret du cinéma qui réside dans ce défilement du temps.

Rétrospective Jean Eustache Rétrospective, treize films, Les Films du Losange, sortie le 7 juin • Jean Eustache. Un amour plus grand… de Philippe Azoury (Capricci, 160 p., 17 €), sortie le 23 juin
PROPOS RECUEILLIS PAR QUENTIN GROSSET





mai 2023 – no 197 05 L’entretien du mois < Cinéma
« L’œuvre d’Eustache est le fruit de ce contre quoi il se cogne. »
Photographie : Marie Rouge pour TROISCOULEURS
ETTOUJOURS LEPOING LEVÉ
Infos graphiques
CANNES Scandales
Viser la lune, on ne sait pas, mais invectiver une salle comble lors de la cérémonie de clôture du Festival de Cannes de 1987, ça ne lui a pas fait peur, à Maurice. Alors qu’il monte sur scène pour recevoir sa Palme d’or pour Sous le soleil de Satan, qui lui a été décernée à l’unanimité par le jury, Pialat est accueilli par des sifflets et des huées. Sans flancher, le cinéaste se place tranquillement devant les micros et déclare « Et si vous ne m’aimez pas, je peux vous dire que je ne vous aime pas non plus », avant de lever le poing. Culte.
RÉCONCILIATION DIFFICILE
« Nous tendions un miroir aux gens et ils n’ont pas aimé se voir dedans », s’est défendu Philippe Noiret peu de temps après la (très) houleuse projection cannoise de La Grande Bouffe de Marco Ferreri, en 1973. Provocations, sifflets, dégoût voire carrément malaise : les films-chocs ont aussi fait l’histoire de Cannes. À l’occasion de la ressortie du désormais classique de Ferreri (le 24 mai) et de la 76e édition du Festival, du 16 au 27 mai, on vous propose un petit tour des scandales de la Croisette. Oh là là !

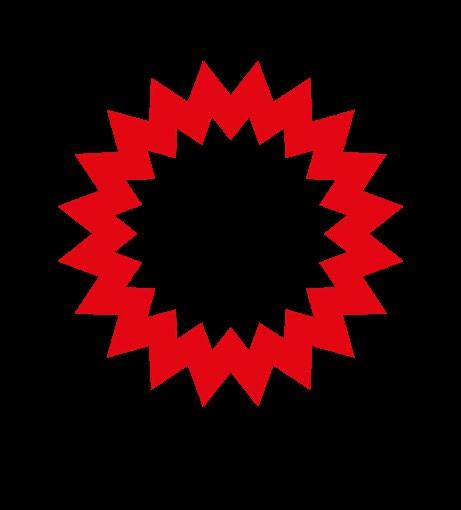
En 1960, ce sont les montagnes russes pour la modernité transalpine. D’un côté, La dolce vita de Federico Fellini provoque la colère des instances religieuses et est accusé de tous les maux : désinvolture, décadence, néant, brûlot vulgaire (rayer les mentions inutiles). De l’autre, L’avventura de Michelangelo Antonioni est sifflé, hué et moqué pendant sa projection, les spectateurs rejetant en bloc son abstraction et son rythme lent. Pour finir, les deux films ont respectivement remporté une Palme d’or et un Prix du jury. #HatersGonnaHate.




HOT (WHEELS) D’OR EN BREF

Quoi ? Nuit et brouillard, le film pédagogique, essentiel, de trente-deux minutes d’Alain Resnais a fait scandale ? Eh bien oui. L’annonce de sa sélection, pour le Festival de Cannes 1956, crée la polémique. On accuse le film de salir la réconciliation franco-allemande et, à travers un furtif plan d’un gendarme français au camp d’internement de Pithiviers, de pointer la responsabilité de la France dans la Shoah. Les patriotes n’aiment pas. L’ambassade d’Allemagne non plus. Le film sera finalement projeté à Cannes, mais hors Compétition. Et, ironie de l’histoire, c’est Jacques-Yves Cousteau et Louis Malle qui décrocheront la Palme, avec… Le Monde du silence.
SALEANNÉE POURINGRID
En 1973, la présidente du jury Ingrid Bergman passe un mauvais moment avec les œuvres françaises en Compétition, qu’elle considère comme « sordides » et « vulgaires ». Les films en question ? La Grande Bouffe, donc, et La Maman et la Putain. Alors que la ressortie du grand-œuvre de Jean Eustache a récemment cartonné (lire p. 73), l’enthousiasme n’était pas le même lors de sa présentation sur la Croisette. Le réalisateur a dû quitter la salle, Gilles Jacob, alors critique, le taxait de « film merdique », et son collègue Jean-Louis Bory déclarait que « Jean-Pierre Léaud joue faux et reste faux ». Le jury, lui, a aimé : Grand prix.
Le sexe et les voitures, les festivaliers de Cannes les aiment bien, mais séparément. Tout a commencé en 1996 quand Crash de David Cronenberg débarque sur la Croisette. Horreur ! Malheur ! La ribouldingue à côté des accidents de la route, ça ne passe pas du tout. Nausées et huées sont au programme, mais Francis Ford Coppola n’en a cure et lui remet le Prix spécial du jury. Rebelote en 2021 avec Titane de Julia Ducournau. Une femme qui couche avec une voiture (et qui, bon, tue des gens également), ça provoque des cris d’orfraie. Mais aussi une Palme d’or.
PERRINE

En bref no 197 – mai 2023 06
QUENNESSON
COUP DOUBLE POUR L’ITALIE
Ça tourne

CLINT EASTWOOD
À 92 ans, Clint Eastwood en a encore dans le ventre. L’acteur-réalisateur au regard froncé prépare un film – son dernier, d’après le site américain DiscussingFilm. L’histoire d’un juré mobilisé dans un procès pour meurtre qui comprend qu’il a peutêtre causé la mort de la victime – on reconnaît bien là le goût d’Eastwood pour les personnages ambigus, qui se retrouvent au pied du mur. Il se murmure aussi que Nicholas Hoult et Toni Collette, qui s’étaient déjà croisés dans Pour un garçon de Paul et Chris Weitz il y a plus de vingt ans, figureront au casting.
AUDE LÉA RAPIN
Après Les héros ne meurent jamais (2019), beau film mystique qui prenait place en Bosnie, avec Adèle Haenel en tête d’affiche, la cinéaste a fait appel à une autre Adèle (Exarchopoulos) pour son prochain film, Planète B, tourné entre SaintRaphaël, Grenoble et Lyon, qui laisse augurer une dystopie audacieuse. Le pitch : « Par une nuit au cœur d’une révolte qui fait rage dans tout le pays, subitement une poignée d’activistes disparaît. Parmi eux, se trouve Julia Bombarth, 30 ans. Elle se réveille dans un monde totalement inconnu : Planète B. » Bien elliptique, tout ça.




JACQUES AUDIARD
On a un peu de mal à le croire, mais il semblerait que le réalisateur prépare une comédie musicale avec Selena Gomez (oui, vous avez bien lu) et Zoe Saldaña. On ne tombe pas non plus des nues, vu le désir de renouvellement du cinéaste – dernière preuve en date, son récit polyphonique et sentimental Les Olympiades, sorti en 2021. Il ne faut cependant pas s’attendre à un récit mièvre et romantique pour ce prochain opus qui, sous couvert d’envolées chantantes et dansantes, dissimule un sale trafic de drogues. On savait bien qu’il y avait un loup.







LES FRÈRES BOUKHERMA
Les frangins les plus en vue du jeune cinéma français vont adapter Leurs enfants après eux, le très beau roman de Nicolas Mathieu paru en 2018 – et inspiré de l’enfance et de l’adolescence de l’auteur dans les années 1990. Après les Pyrénées (Teddy) et les Landes (L’Année du requin), les Boukherma vont donc planter leur caméra pleine d’empathie dans les zones périurbaines de la Lorraine – et on se demande bien comment ils vont s’acclimater. Au casting : Gilles Lellouche.









HOUDA BENYAMINA
« Un film de cape et d’épée au féminin. » C’est en ces termes que Cineuropa a décrit Toutes pour une de Houda Benyamina, qui s’est faite discrète depuis son brûlant Divines, sorti en 2016. Seules infos grappillées dans les annonces de casting qui circulent : l’intrigue se déroulera au xviie siècle et l’actrice Lou de Laâge fait partie de la distribution.

En bref mai 2023 – no 197 07
JOSÉPHINE LEROY
La sextape
LE MANQUE DE DÉSIR EST-IL PLUS VISIBLE AU SOLEIL ?
© Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx

Sorti en mars, le dernier film de Sophie Letourneur, Voyages en Italie, nous emporte en Sicile pour une variation autour de la conjugalité et du désir, en écho au classique de Rossellini.

Le couple que Sophie Letourneur forme à l’écran avec Philippe Katerine tente de raviver la flamme de leur passion avec une escapade romantique au soleil. Ils se hâtent de cocher toutes les cases de l’amour fou version Instagram, mais le désir est absent. Le titre, bien sûr, évoque le souvenir lointain du film de Roberto Rossellini – à une lettre près. Les deux films suivent les aventures de couples dont la relation révèle sa distance en terres de romantisme idéalisé et de fantômes. Sur l’affiche de Voyages en Italie, Philippe Katerine, en bord de cadre, photographie avec nonchalance Sophie Letourneur, placée au centre de
l’image. Vêtue d’une robe noire, elle pose en s’ennuyant ferme devant une statue d’Icare couché sur le flanc, un peu ridicule. Sophie ignore superbement le zizi en bronze oxydé de la statue. Derrière elle, des ruines. En gros et en rouge, le titre, comme une injonction au bonheur, qui surplombe cette scène de la vie conjugale ordinaire. Cette affiche dialogue avec une image du film de Rossellini, et qui aurait pu en être l’affiche. Rossellini filme Ingrid Bergman – son épouse –, en noir elle aussi, écrasée par un décor antique de musée, levant les yeux vers une statue d’Hercule qui occupe une grande partie du cadre. Dans un double mouvement, la statue, dont le sexe, invisible pour les spectateurs, est offert à la seule vue de l’actrice, lui cache, au centre du cadre, les fruits volés au jardin des Hespérides qu’elle tient dans sa main. Un homme, une femme, une statue : deux variations autour du mythe de la chute, deux images sous-tendues par un couple réel. Rossellini et Bergman dans l’une, Letourneur et ses souvenirs de voyage rejoués dans l’autre. L’ab-

sence de désir est nue au soleil, alors que restet-il ? Faut-il rompre ou combattre ? Quelle est la nature du lien qui nous unit après des années ? Chez Letourneur, on se bat avec les mots. Et ce sont eux qui permettent de finir cul nu après une nuit d’amour débridé. Pas la quête d’extraordinaire, ni celle de saisir le souvenir parfait, iPhone en main, symptomatique de notre époque, non : les mots échangés, parfois rabâchés, dans une tentative d’aller vers l’autre et ainsi de sublimer la chute. La beauté de la conjugalité se situe exactement là, dans ce combat héroïque désespéré contre l’érosion du désir. Le film de Rossellini se terminait d’ailleurs par le surgissement d’un « Je t’aime » inattendu. En dialoguant dans l’intimité du lit conjugal, les personnages de Letourneur deviennent des héros modernes qui revisitent leur propre mythologie pour se désirer.
MARINETTE DE VIRGINIE VERRIER (SORTIE LE 7 JUIN) : PLUS INTÉRESSÉE PAR LE FOOT QUE PAR LES ÉTUDES DÈS SON PLUS JEUNE ÂGE, MARINETTE PICHON DEVIENT LA PREMIÈRE FOOTBALLEUSE FRANÇAISE STAR.

À chaque jour ou presque, sa bonne action cinéphile. Grâce à nos conseils, enjolivez le quotidien de ces personnes qui font de votre vie un vrai film (à sketchs).


POURVOTREPETITE
SŒUR, qui écrit
despoèmesdark
Votre petite sœur traverse sa crise d’ado avec créativité : elle rédige chaque jour sur son blog Sad4Life des textes noirs mais étonnamment matures. Pour la sortir de sa tanière, invitez-la à l’expo immersive « Tim Burton, le labyrinthe ». Imaginée à partir de l’œuvre goth du cinéaste américain (L’Étrange Noël de M. Jack, Charlie et la chocolaterie), elle propose près de trois cents itinéraires différents, et une centaine d’œuvres originales du réalisateur.
« Tim Burton, le labyrinthe », du 19 mai au 20 août à l’Espace Chapiteaux, La Villette

POURVOTRE CRUSH, un Américain àParis
POUR VOTREGRAND-PÈRE,
Gagnez des places en suivant TROISCOULEURS sur Facebook et Instagram
incon solable

Ça aurait pu être le début d’une rom com : de passage avec son groupe de musique dans la capitale, il a décidé de tout plaquer pour vivre ici. Vous l’avez rencontré à une soirée et ça a été le coup de foudre. Pour vérifier la réciprocité de votre amour, conviez-le à la géniale programmation « Portrait de Los Angeles ». Films (Billy Wilder, David Lynch, Melvin Van Peebles), rencontres, expo, projet immersif autour de Marilyn Monroe… Tout est mis en œuvre pour percer le mystère qui entoure le berceau de Hollywood.
« Portrait de Los Angeles », jusqu’au 6 juillet au Forum des images
Il a accidentellement figuré dans À bout de souffle (1960), film qui a lancé la carrière du réalisateur franco-suisse, figure de la Nouvelle Vague. Depuis, il lui voue un culte. Mais il a le moral en berne depuis sa mort, survenue en 2022. Offrez-lui la réédition de la biographie passionnante de l’historien et critique de cinéma Antoine de Baecque, qui revient sur le parcours turbulent de JLG, de ses premières œuvres à son ultime geste expérimental et lyrique (Le Livre d’image, 2018).

En bref no 197 – mai 2023 08
À offrir
JOSÉPHINE LEROY
LILY BLOOM
lamortde Godard
depuis
Godard. Biographie définitive d’Antoine de Baecque (Grasset, 960 p., 39 €)
Émopitch
SILO Petit écran SÉRIE
“UNE VIBRANTE LEÇON D’HUMANITÉ”
Psychologies
Dans cette haletante fiction postapocalyptique, une mécanicienne surdouée enquête sur un silo qui abrite les dix mille derniers survivants de l’espèce humaine. Servie par une esthétique rétrofuturiste soignée, la série est aussi une dissection précise des inégalités et des rapports de pouvoir par temps de crise.

Après Severance, qui explorait la violence du monde du travail, et Hello Tomorrow!, satire grinçante du quotidien d’un VRP, la plateforme Apple TV+ creuse encore le sillon de la sciencefiction rétrofuturiste. La série Silo juxtapose, elle aussi, une esthétique vintage – en l’occurrence, les teintes marron vert rappellent les désastres esthétiques des années 1970 – et une intrigue située dans un futur proche. Adaptée de romans publiés par Hugh Howey à partir de 2011, Silo imagine la vie des dix mille derniers êtres humains sur Terre. Ou plutôt dessous, puisqu’ils vivent dans le silo du titre, immense construction enfouie. La seule image du monde extérieur, totalement dévasté, est fournie par une caméra. Toute personne contrainte à sortir du silo ou qui en exprime la volonté est condamnée à mourir étouffée juste après avoir nettoyé ladite caméra. Forcément, quelque chose ne tourne pas rond dans ces immenses escaliers en colimaçon. Un shérif, sa femme et une mécanicienne surdouée, Juliette, vont tour à tour tenter de percer son mystère. Là où Severance et Hello Tomorrow! arrosaient le capitalisme forcené de vitriol, Silo reprend des ingrédients classiques de la science-fiction post-apocalyptique en s’intéressant de plus près aux obsessions sécuritaires et à la tentation de l’autoritarisme lorsque le monde s’écroule, mais aussi à l’importance de la mémoire et de la transmission. En dix épisodes haletants, la série parvient à la fois à embrasser efficacement la grammaire sérielle et à se réserver des pas de côté, tant dans sa construction que dans l’écriture de ses personnages, plus originaux qu’ils y paraissent au premier abord. Elle doit aussi beaucoup à son actrice principale, la Suédoise Rebecca Ferguson, tout en puissance élégante.
disponible sur Apple TV+

En bref mai 2023 – no 197 09
MARGAUX BARALON
Flash-back
FURYO

Projeté en mai 1983 au Festival de Cannes puis sorti en France début juin, Furyo se déroule en 1942 dans un camp de prisonniers sur l’île de java où le détenu anglais Jack Celliers (David Bowie) va perturber la discipline de fer imposée par le commandant japonais du lieu, le capitaine Yonoi (Ryūichi Sakamoto, aussi compositeur de la musique du film). « Une part de la fascination vient du face-à-face entre Bowie et Sakamoto, dirigé par un Nagisa Ōshima qui transformait une fresque historique à grand spectacle en film intimiste à la dimension homosexuelle évidente », confie Thierry Jousse, auteur du Dictionnaire enchanté de la musique au cinéma (Marest Éditeur, 2022). « S’ajoute à ce côté transgressif la musique obsédante de Sakamoto et le morceau “Merry Christmas, Mr. Lawrence”, ritournelle électronique qui a fait le tour du monde. C’était la première B. O.
Règle
JENNIFER PADJEMI
de Sakamoto, même s’il était déjà célèbre avec son groupe Yellow Magic Orchestra. Le thème de Furyo a un aspect enfantin, il tournoie sur lui-même et reste gravé dans les têtes. » En habillant de cette envoûtante mélodie synthétique un récit situé pendant la Seconde Guerre mondiale, le musicien réussissait un coup de maître. « J’avais rencontré Sakamoto dans les années 1990 et j’étais frappé de voir à quel point il était cinéphile. Il m’avait demandé comment était le dernier film de Godard. Cet amour du cinéma lui permettait de parfaitement comprendre quel effet pouvait produire l’alliance d’une musique et d’une image. Le thème de Furyo fonctionne encore aujourd’hui, car sa texture sensuelle n’a pas la froideur de la plupart des sons electro de l’époque. Ce morceau est martial, mais aussi très nostalgique. » Décédé le 28 mars dernier, Sakamoto avait composé d’autres musiques de films, comme Le Dernier Empereur de Bernardo Bertolucci, qui lui valut un Oscar en 1988. Mais la mélodie de Furyo, indissociable des plans de David Bowie transpirant dans l’enfer masochiste de Java, reste son chef-d’œuvre.
DAMIEN LEBLANC
Illustration : Sun Bai pour TROISCOULEURS
Elle traque les images féministes et inclusives de la culture pop, susceptibles de désamorcer les clichés. La journaliste publie Selfie. Comment le capitalisme contrôle nos corps, un essai passionnant sur les injonctions de l’industrie de la beauté. Avec un éclectisme salvateur, Jennifer Padjemi a répondu à notre questionnaire cinéphile.

Selfie. Comment le capitalisme contrôle nos corps de Jennifer Padjemi (Stock, 320 p., 20,90 €)
Issa Dee dans la série Insecure [cocréée par Issa Rae, qui incarne l’héroïne, et Larry Wilmore, ndlr], une femme noire un peu maladroite. Cette caractéristique devient une force au fur et à mesure des épisodes, et la transforme en femme sûre de ses choix et de son être entier, sans qu’elle oublie sa vulnérabilité. Jodie Landon dans le show MTV des années 1990 Daria [amie intello et très politisée de l’héroïne, ndlr]. J’aurais aussi pu choisir Daria elle-même, l’héroïne de la série, pour son cynisme légendaire, mais je choisis Jodie qui aime la mode, être coquette, peut paraître froide au premier abord mais qui est en réalité très accessible, tout en n’ayant pas peur de dire ce qu’elle ressent, ni de savoir ce qu’elle veut. Sam Fox, l’héroïne de Better Things [série cocréée par Pamela Adlon, qui incarne aussi le rôle principal, et Louis C.K., ndlr] Elle est tout ce que j’aime chez les gens naturellement cool, c’est une femme et une mère incroyable. Et puis elle est hilarante – parfois malgré elle. Je ne sais pas si je lui ressemble, mais je pense partager avec elle ce côté hédoniste.
En général, je me force à regarder les films au moins quinze minutes. Mais il m’a été très difficile de tenir devant Sharp Stick, le dernier long métrage de Lena Dunham [sorti directement en V.o.D. en mars 2023, ndlr].
3 couples de cinéma qui renouvellent les rapports hommes-femmes ?
En bref 10 no 197 – mai 2023
Ceux de Crooklyn de Spike Lee, d’Away We Go de Sam Mendes et d’ Obvious Child de Gillian Robespierre.
Quarante ans après sa sortie, le drame de guerre de Nagisa Ōshima fascine toujours, en grande partie grâce à sa célèbre musique, créée par le récemment disparu Ryūichi Sakamoto.
de trois
3 personnages de fiction qui vous ressemblent ?
Un film que vous n’avez pas pu regarder plus de 3 minutes ?
PROPOS RECUEILLIS PAR LÉA ANDRÉ-SARREAU
© Wendy Huynh
3 scènes

La scène de la danse dans Frances Ha [de Noah Baumbach, 2013, ndlr], quand Frances court dans la rue. La scène de cabaret dans Shame [de Steve McQueen, 2011, ndlr], quand Sissy chante New York, New York. Toutes les scènes de Before Sunrise, Before Sunset et Before Midnight [de Richard Linklater, sortis respectivement en 1995, 2005 et 2017, ndlr], ma trilogie préférée au monde.
3 héroïnes
Cristina Yang dans la série Grey’s Anatomy Elle ne lâche jamais l’affaire. Je ne m’identifie pas du tout à elle sur la question de la maternité – elle ne veut pas d’enfant –, mais son jusqu’au-boutisme et sa passion m’inspirent. Pour les mêmes raisons, Samantha Jones dans la série Sex and the City. C’est une femme qui ne rentre pas dans les clous parce qu’elle se connaît par cœur ; elle n’acceptera jamais de se conformer à la société ou aux hommes. Elle se choisit elle, car elle s’aime avant tout, ce qui devrait être la base. Elle Woods dans La Revanche d’une blonde [de Robert Luketic, avec Reese Witherspoon, sorti en 2001, ndlr], parce qu’il n’y a rien de mieux que de s’affranchir du regard des autres quand ces derniers ont décidé que vous êtes une moins que rien et que vous allez leur prouver, ou à vous-même, l’inverse. J’aime aussi l’ironie subtile qui traverse le film.
The Lost Daughter [de Maggie Gyllenhaal, 2021, ndlr], pour comprendre les relations mère-enfant, la maternité, le désir et ce que c’est qu’être une femme à qui on ne laisse pas trop le choix. Mustang [de Deniz Gamze Ergüven, 2015, ndlr], pour appréhender la sororité dans son sens le plus littéral. La Couleur pourpre [de Steven Spielberg, 1986, ndlr], pour comprendre les violences subies par les femmes noires. Le film comprend beaucoup de maladresses, mais il a contribué à alimenter la discussion sur ce sujet.

En bref 11 mai 2023 – no 197 CURIOSA FILMS PRÉSENTE LE 14 JUIN AU CINÉMA STARS NOON AT UN FILM DE CLAIRE DENIS JOE ALWYN MARGARET QUALLEY DIRECTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE ÉRIC GAUTIER DÉCORS ARNAUD DE MOLÉRON COSTUMES SHREWSBURY PREMIER ASSISTANT RÉALISATEUR MARTIN PROANO SON JEAN-PAUL MUGEL NATHALIE VIDAL THOMAS DESJONQUÈRES MONTAGE GUY LECORNE MUSIQUE ORIGINALE TINDERSTICKS CASTING CARMEN CUBA DES HAMILTON RÉGIE MARK “TELLO” HEADLEY TOMÁS CORTÉS DIRECTRICE DE POSTPRODUCTION EUGÉNIE DEPLUS DIRECTEURS DE PRODUCTION OLIVIER HÉLIE VALÉRIE FARTHOUAT PRODUCTEURS EXECUTIFS CHRISTINE DE JEKEL OLIVIER GAURIAT PITUKA ORTEGA HEILBRON MARCELA HEILBRON PRODUCTEURS ASSOCIÉS ÉMILIEN BIGNON VINCENT MARAVAL BRAHIM CHIOUA EVA DIEDERIX PRODUIT PAR OLIVIER DELBOSC UNE COPRODUCTION CURIOSA FILMS ARTE FRANCE CINEMA AD VITAM AVEC LA PARTICIPATION DE CANAL+ ARTE FRANCE CINÉ+ DISTRIBUTION AD VITAM VENTES INTERNATIONALES GOODFELLAS SCÉNARIO CLAIRE DENIS ET LÉA MYSIUS ADAPTATION ANDREW LITVACK D APRÈS LE ROMAN “DES ÉTOILES À MIDI” DE DENIS JOHNSON BENNY SAFDIE DANNY
© 2022 CURIOSA FILMS – ARTE FRANCE CINÉMA AD VITAM ADVITAMDISTRIBUTION #STARSATNOON
RAMIREZ ET AVEC JOHN C. REILLY
anticonformistes qui vous inspirent ?
3 films de la pop culture pour s’initier au féminisme ?
de film que vous auriez aimé vivre ?
Scène
culte TETSUO DE SHINYA TSUKAMOTO (1989)

Un homme (Tomorowo Taguchi) et une femme (Kei Fujiwara) renversent en voiture un marginal fétichiste du métal, et prennent la fuite.

Rapidement, l’homme est victime de mutations physiques terrifiantes : une tige d’acier perce sa joue, des tuyaux sortent de ses pieds… Sommet fou furieux du cinéma cyberpunk japonais, Tetsuo est de retour en salles (avec trois autres sommets de Tsukamoto, Tetsuo. Boddy Hammer, Tokyo Fist et Bullet Ballet), pour le pire donc pour le meilleur.
LA SCÈNE
L’homme apporte le déjeuner à la femme dans une poêle brûlante et lui tend une bouchée. Elle fait crisser la fourchette contre ses dents. Chaque mastication produit des bruits d’explosions. Il lui présente une saucisse qu’elle lèche langoureusement avant de l’avaler. Désorienté, tremblant, il se jette dans ses bras.

L’homme: « Ne me quitte jamais… tu m’entends ? »
Tout à coup, il est projeté en arrière et tombe au sol. Un sifflement se fait entendre.
La femme: « Que se passe-t-il ? »
Une sorte de foreuse électrique, rouillée et terrifiante, transperce la table. C’est le sexe de l’homme qui vient de se transformer.
En bref 12 no 197 – mai 2023
L’ANALYSE DE SCÈNE
« Aussi surréaliste et étrange qu’ Eraserhead [de David Lynch, ndlr] et aussi intense qu’un arrachage de dent sans anesthésie », pouvait-on lire dans The Washington Post à la sortie de Tetsuo. Une description pertinente du premier long métrage de Shinya Tsukamoto, expérience extrême tournée en 16 mm et en noir et blanc, dans laquelle la chair et le métal fusionnent sans limite. L’inventivité artisanale de la forme, un mélange d’images live, de vidéo et d’animation en stop motion, est telle qu’elle ne laisse que peu de champ à l’interprétation. Serait-ce une critique du devenir machinique de l’homme ? Un portrait de Tokyo en monstre industriel détruisant ses habitants ? Il n’est sans doute pas anodin que cette « séquence de repas », qui précipite l’affreuse mutation, suive une scène de sexe avorté. Dans Tetsuo , c’est bien le désir (réprimé) qui est la force créatrice (et dévastatrice) capable de modifier littéralement les corps, de les remodeler à l’image de ses fétiches détraqués (le métal, matière inhumaine par excellence).
Sous la science-fiction rageuse gronde aussi un film sensuel qui donne à voir, et surtout à ressentir, l’indicible circulation entre douleur et plaisir. Ça fait du bien là où ça fait mal.
Shinya Tsukamoto [en 4 films], rétrospective (Carlotta), le 17 mai
•
Shinya Tsukamoto [en 10 films], coffret Blu-ray (Carlotta), le 16 mai
MICHAËL PATIN
RENDEZ-VOUS DÈS LE 2 JUIN !
Concerts à la Basilique de Saint-Denis


& à la Légion d’honneur

ANDRIS NELSONS , Mahler Chamber Orchestra • GREGORY PORTER , Orchestre national d’Île-de-France, FIONA MONBET •
PATRICIA KOPATCHINSKAJA , membres du Chœur de Radio France, musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Radio France pour un concert sur notre éveil collectif face aux enjeux écologiques à venir •
JEANINE DE BIQUE , Concerto Köln • LEONARDO GARCÍA ALARCÓN , Cappella Mediterranea • TRIO SŌRA •
BRYN TERFEL , Carlos Núñez, Orchestre National de Bretagne • MARIE-LAURE GARNIER , Célia Oneto Bensaid •
LEA DESANDRE , Ensemble Jupiter/THOMAS DUNFORD • BENJAMIN APPL , James Baillieu • Julie Roset, Stanislas de Barbeyrac, Nahuel Di Pierro, JULIEN CHAUVIN , Concert de la Loge, Chœur de chambre de Namur du 2 au 27 juin 2023. Programme complet sur festival-saint-denis.com
PROFITEZ DU PASS MOINS DE 28 ANS ! 3 concerts au choix pour 40€ plusd’informationsau0148130607.

En bref 13 mai 2023 – no 197
Licence entrepreneur de spectacles No 2 PLATESV-R-2020-005271, No 3 PLATESV-R-2020-005367 • Visuel 2023 Hartland Villa • Réalisation graphique Festival de Saint-Denis
LES NOUVEAUX
Double actualité pour la jeune et prometteuse cinéaste française. Elle présente à Cannes, à la Semaine de la critique, Stranger, court métrage coréalisé avec la chanteuse et actrice Jehnny Beth, et elle sera en juin au festival Côté court pour son poétique Swan dans le centre.
En seulement trois courts, Iris Chassaigne, 30 ans, a déjà imprimé son regard sur la carte du cinéma français. On déambule dans ses films comme on arpenterait les paysages d’un territoire peuplé d’âmes solitaires, de lieux de passage où flotterait un parfum d’érotisme queer. C’est une aire d’autoroute dans Les Gens qui roulent la nuit, c’est un centre commercial dans Swan dans le centre, présenté à la Semaine de la critique l’an passé. Dans ce film, une jeune commerciale vient sonder les habitus des clientes et clients d’un temple de la consommation. Au bout du téléphone, d’une voix posée et discrètement hésitante, la cinéaste raconte : « C’est cet endroit d’inconfort qui me plaît. Cela permet des


rencontres inattendues et étranges. Les toilettes des centres commerciaux peuvent être des espaces de cruising pour les mecs gay. J’avais envie de déplacer ça avec une histoire de femmes lesbiennes, ce sont des espaces qui existent peu pour elles. » Enfant, Iris passe une grande partie de son temps dans des avions et des aéroports pour cause de père voyageur, élément sans nul doute déterminant dans cette envie de « parler de personnages étranges qui se sentent étrangers au monde, qui ont un sentiment d’être un peu inadaptés ». Plus tard, ado, c’est auprès d’Alain Guiraudie (en particulier du film Ce vieux rêve qui bouge) et de Chantal Akerman (« la longue scène de sexe de Je, tu, il, elle était une référence pour Swan… ») qu’elle trouve une maison, cette fois-ci de cinéma. Son dernier court métrage en date, le beau Stranger, projeté cette année à la Semaine de la critique, est un film sous forme de fable musicale noctambule avec Jehnny Beth et Agathe Rousselle, « l’histoire d’un retour à la vie » née de la rencontre de deux solitudes – la marge toujours au centre.
Après deux courts remarqués, le jeune réalisateur belge, juré de la Queer Palm à Cannes cette année, signe son premier long, Le Paradis, histoire d’amour entre deux jeunes hommes dans un centre de détention pour mineurs délinquants. Une ode à la liberté.
C’est de son histoire familiale que Le Paradis est né : à l’adolescence, le cousin de Zeno Graton a été placé dans un centre de détention pour mineurs. « De cet événement est née une prise de conscience des dysfonctionnements du système », raconte le cinéaste, calmement. Avec Le Paradis (lire p. 64), le réalisateur de 32 ans continue son travail autour de la masculinité (entamé dans Jay parmi les hommes, son dernier court métrage en date), et propose des variations aux récits en vigueur. Lui-même a souvent éprouvé un sentiment « d’enfermement dans le genre ». Il souhaitait en retour montrer des personnages libres et fiers, jamais victimes, « capables d’une tendresse et d’une solidarité qui devient résistance contre l’insti-

En bref 14 no 197 – mai 2023
MARILOU DUPONCHEL
1
Photographie : Julien Liénard pour TROISCOULEURS
2
tution ». Le résultat : au-delà de la romance gay et du récit de coming out, un film romanesque sur la puissance du sentiment amoureux, qui bouleverse tout. Né à Bruxelles, où il a grandi dans une famille ayant des origines tunisiennes, Zeno Graton est diplômé de l’INSAS en direction photo. Un parcours qui explique son attention à l’image : lyrique, esthétisée, constamment retravaillée. « L’idée était de tendre vers un réalisme magique, insuffler du poétique à rebours du naturalisme qui prime souvent dans les films sur la détention », explique-t-il. À la source de son inspiration : le poète soufi Rûmî, et Jean Genet dont les écrits sur l’homoérotisme en prison l’ont durablement influencé. Aujourd’hui, il entend poursuivre sur cette ligne de critique politique des institutions. « Difficile de faire autrement : on parle d’où on vient, et mon corps queer tunisien est éminemment politique. »







COPÉLIA MAINARDI



En bref 15 mai 2023 – no 197
AU CINÉMA
UN FILM DE ARMEL HOSTIOU ( LE VRAI)
LE 7 JUIN
« UNE MISSION JOYEUSEMENT IMPOSSIBLE »
LE POLYESTER
« UN DOCUMENTAIRE PALPITANT DANS LA CAPITALE CONGOLAISE »
SIGHT AND SOUND
Photographie : Julien Liénard pour TROISCOULEURS
Le Paradis de Zeno Graton, Rezo Films (1 h 23), sortie le 10 mai
Tout doux liste
L’ARBRE À VŒUX [FILM]
« À vouloir trop avoir, l’on perd tout. » C’est ce que Kerry, une jeune opossum, expérimente en cueillant la dernière fleur de l’arbre à vœux, bouleversant alors l’écosystème de sa ville… Ce film aux couleurs pop et à l’humour bien dosé suit ainsi l’attachant personnage, prêt à tout pour faire de nouveau régner l’harmo -

L’interview
Marinette, c’est le titre du film consacré à Marinette Pichon, immense championne et première footballeuse française star, née en 1975. Adèle, 16 ans, a interviewé Virginie Verrier, la réalisatrice de ce biopic porté par Garance Marillier (lire p. 42).
Comment vous est venue l’idée d’écrire ce film ?
J’avais très envie de parler de sport dans mon deuxième film [après À 2 heures de Paris, sorti en 2018, ndlr]. Et j’adore les biopics ! J’ai mené mon enquête, à la recherche d’une femme dont le parcours sportif et personnel pouvait faire l’objet d’un film. Je m’étais fixée comme période entre la fin du xixe siècle et notre époque. Sans surprise, on trouve beaucoup moins d’ouvrages sur les femmes que sur les hommes. Je me suis rendu compte qu’il n’y avait eu aucun biopic de sportive en France, et même aucun réalisé par une femme dans le monde.
Et pourquoi, finalement, Marinette Pichon ?
LA PETITE SIRÈNE [FILM]
Après La Belle et la Bête, Aladdin et Mulan, La Petite Sirène a aussi droit à sa version en prise de vue réelle, toujours par les studios Disney. L’actrice et chanteuse américaine Halle Bailey incarne Ariel, la sirène rebelle qui tombe amoureuse d’un humain, dans cette adaptation du conte de H. C. Andersen. • C. D. R.
La Petite Sirène de Rob Marshall (Walt Disney, 2 h 15), sortie le 24 mai dès 6 ans

Un ami m’a dit, sans même connaître le sujet sur lequel je travaillais : « Marinette Pichon sort son autobiographie [Ne jamais rien lâcher, First Éditions, 2018, ndlr], c’est ton prochain film ! » Je l’ai lue d’une traite et j’ai enchaîné par un déjeuner avec Marinette, qui a immédiatement accepté que j’adapte ce livre. Elle a même ajouté : « C’est toi et personne d’autre ! »
Aviez-vous entendu parler d’elle avant ?
Non, à l’époque il n’y avait pas les réseaux sociaux. Son parcours et ses succès aux États-Unis, personne n’en parlait. C’était la meilleure buteuse du championnat. Là-bas,
il y avait une véritable « Marinette mania », on pouvait même manger des burgers à son nom ! En France, on n’a rien vu de tout ça. Aujourd’hui encore, les footballeuses françaises ont beaucoup moins de moyens que leurs homologues masculins. Il faudrait qu’elles soient considérées, qu’elles aient des bons salaires pour qu’elles puissent véritablement se consacrer au foot comme les hommes. Il faudrait tout simplement que ce soit équitable.
Les gens ont-ils tout de suite adhéré à votre projet ?
Au tout début, j’ai vu un ou deux producteurs qui m’ont dit : « Le foot féminin, c’est chiant ; et, en plus, l’héroïne est lesbienne. »
J’ai décidé de produire le film seule pour ne pas m’encombrer de ce style de rendezvous. J’ai lancé les opérations de financements et, quand j’ai rencontré les diffuseurs comme France Télévision ou Canal+, ils ont très bien réagi et m’ont suivie.
Avez-vous tout de suite pensé à Garance Marillier pour interpréter l’héroïne ?
Je savais que ce ne serait pas facile de trouver une « actrice footballeuse ». Je suivais Garance Marillier sur les réseaux sociaux, comme d’autres actrices que j’aime bien. Pendant le confinement, alors que j’étais en phase d’écriture, elle a publié
une vidéo où elle racontait qu’elle jouait au foot dans l’équipe du Gadji FC. Je me suis dit : « Toi, dès que le scénario est terminé, tu es la première à le recevoir. » Elle a été emballée, et sur le tournage elle était aux anges. On a tourné dans des stades gigantesques. Elle a pu allier ses deux passions, le foot et la comédie.
Marinette Pichon avait-elle un droit de regard sur le film ?
Je l’avais prévenue que ce ne serait pas une reconstitution, que c’était mon regard sur son histoire et que, une fois écrit, je leur lirai le scénario, à elle et sa femme. Le scénario est parfois un outil assez brut, une suite de séquences, avec les dialogues mais sans les intentions. J’avais envie de lui expliquer ce qu’il y avait derrière les mots, ce que j’allais faire ressortir comme émotions. On a pris quatre heures, et à la fin elle m’a dit : « Allez, tu peux partir en tournage. »
Marinette de Virginie Verrier, The Jokers / Les Bookmakers (1 h 35), sortie le 7 juin, dès 13 ans
PROPOS RECUEILLIS PAR ADÈLE (AVEC CÉCILE ROSEVAIGUE)
Illustration : Ines Ferhat pour TROISCOULEURS
PARFAIT·E [LIVRE]
Personne n’est parfait, nous rabâche-t-on. Et si nous l’étions toutes et tous ? C’est ce que suggère le petit manifeste Parfait·e, qui met à mal les injonctions genrées. À l’aide d’exemples concrets et d’explications historiques, ce livre aux illustrations colorées propose différents outils pour faire barrage aux stéréotypes. • C. D. R.
Parfait·e d’Émilie Chazerand et Alice Dussutour (La ville brûle, 96 p., 16 €), dès 9 ans

Et toujours chez mk2
SÉANCES BOUT’CHOU ET JUNIOR [CINÉMA]
Des séances d’une durée adaptée, avec un volume sonore faible et sans pub, pour les enfants de 2 à 4 ans (Bout’Chou) et à partir de 5 ans (Junior).
samedis et dimanches matin dans les salles mk2, toute la programmation sur mk2.com
La critique de Célestin, 9 ans MARCEL
LE COQUILLAGE
(AVECSESCHAUSSURES)
SORTIE LE 14 JUIN
« C’est l’histoire de Marcel, un coquillage qui a des pieds et un œil et qui vit avec sa mémé. Son histoire est très triste : il a perdu toute sa communauté de petits personnages qui ont des pieds. Il veut les retrouver. Je qualifierais Marcel de mignon, grâce à sa façon d’être et aussi sa taille. Les petites choses sont toujours mignonnes. D’ailleurs, je trouve souvent des petites choses qui ont l’air vivantes, des cailloux par exemple – en regardant bien, on voit qu’ils ont comme une tête ! Mais il faut être un enfant pour voir ça. Je pense que c’est un enfant qui a dit au réalisateur de Marcel que ce coquillage avait un visage. Ce qui est différent, dans ce
film, c’est que les personnages d’animation sont dans un univers humain, et il n’y a rien de magique à part Marcel et sa mémé, qui sont intégrés dans la société. J’aimerais bien avoir la taille de Marcel : le jardin serait au moins deux fois plus grand. On pourrait se perdre dedans ! Notre monde, pour un tout-petit comme Marcel, c’est comme un pays imaginaire. »


Marcel le coquillage (avec ses chaussures) de Dean Fleischer Camp, L’Atelier (1 h 30), sortie le 14 juin dès 13 ans
PROPOS RECUEILLIS PAR JULIEN DUPUY
16 no 197 – mai 2023
En bref > La page des enfants
VVERRIER IRG I NIE 16 ANS PAR A DELE
Elle peut tout faire. Lui, c’est juste Ken.

Bande originale disponible sur Bande originale disponible sur
#BarbieLeFilm Au cinéma le 19 juillet

VALÉRIE DONZELLI
DANS LE VENT
Au fil de son œuvre, on attend toujours de savoir ce qu’elle va dire de l’époque. Dans L’Amour et les Forêts, Valérie Donzelli s’aventure dans le genre du neo-noir avec une aisance impressionnante pour décrire comment l’étau se resserre autour de Blanche (Virginie Efira), piégée par la toxicité insoupçonnée de son mari (Melvil Poupaud). Entre scènes d’évasion bucoliques et ambiance carcérale, l’actrice et réalisatrice se saisit d’un sujet de société brûlant sans lisser son style. On l’a rencontrée dans un café du XIVe, où elle est arrivée comme une flèche, quelques jours avant la présentation de son magnifique film à Cannes première.
L’Amour et les Forêts, adaptation du roman éponyme d’Éric Reinhardt (Gallimard, 2014), a été ajouté à la dernière minute à la sélection officielle de Cannes. Comment avezvous accueilli la nouvelle ?
J’étais très contente parce que, comme il était question de sortir le film en même temps, il y avait toute une temporalité qui était difficile à gérer.
Votre cinéma est presque né à Cannes. Vous y aviez présenté votre court métrage Il fait beau dans la plus belle ville du monde, en 2008.
Oui, et je suis passée presque partout : la Quinzaine pour mon premier court métrage, la Semaine de la critique avec La guerre est déclarée en 2011, et enfin en Compétition officielle avec Marguerite et Julien en 2015. Et j’ai été présidente du jury de la Semaine en 2016 – alors que j’étais enceinte. Je crois que Cannes c’est toujours une belle maternité pour accoucher.
Votre nouveau film est sérieux, mais vous préservez par endroits la fantaisie de votre cinéma, d’abord à travers les noms de vos personnages – les jumelles Rose et Blanche Renard, Grégoire Lamoureux –, toujours très imagés, mais aussi dans votre mise en scène, qui apporte de la vie, une pigmentation à un récit très sombre. Vous imaginez vos films comme des toiles à peindre ? Mais complètement. Je viens d’une famille d’artistes : mon grand-père est peintre [Dante Donzelli, ndlr], et son père [Duilio Donzelli, l’arrière-grand-père de Valérie Donzelli, ndlr] l’était aussi – c’était un Italien qui avait fait

mai 2023 – no 197 En couverture <----- Cinéma
19
PROPOS RECUEILLIS PAR JOSÉPHINE LEROY Photographie : Marie Rouge pour TROISCOULEURS
les Beaux-Arts à Rome. Mon grand-père m’a toujours appris à construire des choses avec sensibilité [Valérie Donzelli a elle-même fait des études d’architecture, ndlr]. Je ne voulais pas limiter L’Amour et les Forêts à son sujet : je voulais qu’on ressente les choses de l’intérieur, qu’on soit dans la tête de cette femme, qu’on se figure cette toile d’araignée qui se tisse autour d’elle. Je voulais que le film soit extravagant, expérimental dans son dispositif. J’avais dit à Laurent Gabiot, mon chef opérateur, qu’il fallait qu’on s’autorise tout. On a tout fait en direct : les jeux avec les filtres, les optiques… On avait notre petite malle à outils et on se disait : « Et si on mettait l’objectif ici ? Si on ajoutait un filtre violet là ? »
On ressent cette envie d’expérimentation dans votre façon d’osciller entre différents genres. Comme cette scène de comédie musicale où Blanche et Grégoire se mettent à chanter dans la voiture – une parenthèse idyllique, presque naïve, avant la bascule et l’enfermement. Comment ces incises vous viennent-elles en tête ?
C’est très intuitif. Comme la scène où Melvil Poupaud chante « Du bout des lèvres » de Barbara, qui n’était pas écrite dans le scénario. C’était un moment magique du tournage, on a tout tourné en direct. Pour le morceau que les deux personnages chantent dans la voiture, j’avais écrit les paroles, et Gabriel Yared [le compositeur de la musique du film,
qui a obtenu un Oscar pour la B.O. du Patient anglais en 1997, ndlr] a trouvé la mélodie. On a enregistré la chanson très vite à Paris, on a mis une petite maquette dans le camion pour aller sur le tournage. On l’a ensuite réenregistrée à Paris, et c’est au montage que je me suis dit qu’il fallait qu’elle commence a cappella, car c’est une scène où Grégoire tente d’amadouer Blanche. Sur ce film, tout était à la limite, comme ça. Quand je fais des films, je les laisse vivre le plus longtemps possible, je n’aime pas les enfermer. Ensuite, au montage, je requestionne tout, tout le temps. Ce qui est assez épuisant pour Pauline Gaillard [sa monteuse, ndlr]. Mais elle me connaît bien, maintenant [les deux femmes ont collaboré sur tous les longs métrages de Valérie Donzelli, ndlr]. Et puis elle peut aussi agir sur moi comme un garde-fou !
On sent beaucoup l’influence d’Alfred Hitchcock, notamment dans le décor de la maison de Metz achetée par le couple après avoir déménagé de Normandie – déracinement qui scelle le début de l’emprise de Grégoire sur Blanche –, avec son papier peint à la fois fleuri et sombre, ou cette coiffeuse que vous filmez à plusieurs reprises. Vous revendiquez cette référence ?
Bien sûr. Lui et Éric Rohmer : j’avais envie que le film glisse de Rohmer à Hitchcock – toutes proportions gardées, je ne prétends être ni l’un ni l’autre. Qu’on passe de quelque chose
de léger vers une forme plus précise de mise en scène au scalpel. J’ai revu pas mal de films de Hitchcock, dont Pas de printemps pour Marnie. C’est extrêmement brillant, parce que c’est très simple. Rien n’est ostentatoire. Aucun plan n’est en trop. Tippi Hedren [héroïne de plusieurs films de Hitchcock, dont Pas de printemps pour Marnie, ndlr], c’était vraiment la référence pour Virginie Efira. Elles se ressemblent, je trouve : elles ont des visages
Ce qui est beau, dans le film, c’est que Blanche parvient à se sortir du tunnel. Ça a été vraiment l’axe d’écriture, avec Audrey Diwan [réalisatrice, à qui l’on doit notamment L’Événement, Lion d’or à Venise en 2021, qui cosigne ici le scénario, ndlr]. On a imaginé plusieurs scénarios possibles pour finalement être sûres d’une chose : il fallait qu’elle s’en sorte par elle-même, et que ce ne soit pas quelqu’un qui l’aide.

parfaits, rien qui dépasse. Pour le décor, je savais qu’il me fallait un endroit central. Quand je suis entrée la première fois dans la maison, c’était un taudis, une maison de faits divers. Avec Gaëlle Usandivaras, ma chef déco, on s’est dit la même chose : on a adoré le fait qu’il n’y ait aucune cloison, que ce soit une espèce d’arène, avec des estrades, des barreaux, qu’on puisse se perdre dans les affres de cette bâtisse.
Toutes vos héroïnes – Blanche y compris, qui se passionne pour les romans – ont un pied dans la réalité, un autre dans la fiction. Vous êtes pareille ?
C’est totalement inconscient, mais oui, moi-même, j’ai un pied dans la réalité, un autre dans la fiction, tout le temps. Et ça me joue des tours en permanence dans la vie. Parce que, quand je vis une situation, je projette des choses. C’est parfois des
20 no 197 – mai 2023 1 Cinéma > En couverture
« J’ai déjà parlé de la violence, mais là elle est au premier plan. »
films que je me fais dans ma tête, et qui peuvent m’empêcher de voir la réalité. Et en même temps je suis quelqu’un de très ancrée dans le réel : j’ai trois enfants, je travaille tout le temps, je me démène avec le matériel – comme n’importe qui, quoi. Là, je le conscientise en parlant avec vous, mais quand j’écris je ne me dis pas : « C’est moi. »
Ce trouble entre réalité et fiction rappelle les très belles scènes où Blanche s’évade dans la forêt : elles reviennent par flashs dans un ordre non chronologique, sont déréglées par la mise au point… Comment les avez-vous imaginées ?



Je voulais qu’on se demande : « Est-ce que ça a eu lieu ? Est-ce qu’elle s’évade vraiment ? Est-ce que ce n’est pas que dans sa tête ? » Et puis, le fait que ce soit un personnage littéraire [Blanche est professeure de français, ndlr], qui se noie dans ses livres, s’échappe par la lecture, ça en fait une femme romanesque. Quand elle part comme ça vivre son aventure, il y a cette impression qu’on est dans sa tête. Dans toutes les scènes de sexe du film, on passe entre le chaud, le froid, la peur, la jouissance, la douceur… C’est la première fois que je filme des scènes d’amour comme ça, d’ailleurs.

Pourquoi ?
Parce que c’est très difficile. Et puis je pense que ce n’était pas le sujet de mes films.
Est-ce que ce n’est pas aussi dû à une évolution de votre cinéma, qui était jusqu’ici très référencé Nouvelle Vague ?
On sent moins cet héritage dans L’Amour et les Forêts.

Oui, là, c’est un film un peu plus sérieux. J’avais envie de ça. Enfin, je crois

LES PLUS GRANDES MUSIQUES DE FILMS
ENNIO MORRICONE ET LE CINÉMA ITALIEN -

DIMANCHE 04/06/2023


DERNIÈRES PLACES DISPONIBLES
Le Parrain, Il était une fois dans l’Ouest, Le Clan des Siciliens, Le Guépard ...


même que c’était un besoin. Je n’aime pas faire tout le temps la même chose. Ça ne m’intéresse pas de faire cent cinquante fois La Reine des pommes [son premier long métrage, sorti en 2010, ndlr]. C’est un peu comme l’architecture : c’est un immeuble que je construis. Les éléments s’imbriquent les uns avec les autres et prennent une certaine forme. Un peu comme un grand tableau, que je n’ai pas encore fini. Là, ce que j’ai aimé, c’est aller trifouiller dans la violence. Je trouve ça intéressant. J’ai déjà parlé de la violence dans mes films, mais là elle est au premier plan.
Vous détaillez très bien les mécanismes de l’emprise dans le film, comment un homme en vient à enfermer sa compagne, à la tracer. Vous vous êtes beaucoup documentée sur le sujet ?
Non, pas beaucoup. Ce sont des choses que j’ai observées autour de moi, et des choses que j’ai pu vivre aussi. C’est quelque chose d’assez fréquent, qui existe dans tous les milieux, tous les domaines – professionnel, amical, amoureux… Quand j’ai lu le roman d’Éric Reinhardt, j’ai trouvé des résonances avec ma vie. C’était comme une réponse à mes questionnements. Je suis quelqu’un qui n’aime pas beaucoup les rapports de force. J’ai pu prendre sur moi, vouloir satisfaire l’autre par peur de ne pas être aimée… Ça a fait de moi une sorte de proie idéale pour ce genre de trucs. Il y a des gens qui savent profiter de cette situation pour instaurer un rapport de domination. Mais je crois que je suis arrivée à un moment où j’arrive à regarder ça avec le recul nécessaire, la bonne distance.
Sans s’appesantir dessus, le film raconte aussi les failles narcissiques qui se sont
nichées chez cet homme violent quand il était plus jeune. Ça vous semble important d’essayer de comprendre l’origine de la violence ?
Bien sûr. Quand on est dans un rapport d’emprise, de domination, c’est qu’en fait on ne va pas bien. On n’arrive pas à investir sur soi, alors on investit l’autre. Il y a un côté vampire. Je lisais ce matin un article horrifiant de Libération sur le meurtre d’une petite fille de 5 ans par un ado. L’article commence par raconter que l’ado était agressif, puis il remonte dans le temps, et on se rend compte qu’il avait été abusé… Donc, oui, c’est important d’essayer de comprendre, mais sans enlever à la victime son statut, sans justifier cette violence. C’est ça qui est très délicat.

Dans vos deux dernières œuvres – ce film, mais aussi la série chorale Nona et ses filles, sur une famille ébranlée par la grossesse de la matriarche, à 70 ans –, les femmes s’entraident, forment un cercle sécurisant. Vous sentez une évolution de la société sur cet aspect ? La sororité, la solidarité entre les femmes, c’est quelque chose que je trouve hyper fort, hyper puissant, et qui me bouleverse au quotidien. Hier, je prenais le métro, je rentrais de vacances avec mes enfants. On avait des valises, la rame était bondée. Et là, un type rentre et bouscule tout le monde. Un gros con quoi, il n’y a pas d’autre mot. Et je vois une jeune femme de 20 ans qui me dit : « Allez-y, asseyez-vous. » On s’est regardées, le mec est parti, et on s’est dit : « Wouah… » On était atterrées. Mais ce qui était beau, c’est qu’elle avait un œil sur moi, et que moi j’avais un œil sur elle. On sentait que, s’il y avait un problème, on pouvait compter l’une sur l’autre. Ça, ce sont des
PROCHAIN RENDEZ-VOUS

Direction Broadway avec un concert exceptionnel dédié aux plus grands succès des comédies musicales -

SAMEDI 25/11/2023

21 mai 2023 – no 197 © iStockRCS Paris 794 136 630 -
En couverture <----- Cinéma
2
choses qu’on ne voyait pas avant. Il y a un truc qui m’a toujours révoltée, c’est qu’on fasse passer l’amitié féminine pour de la rivalité. Il y a toujours eu des films sur l’amitié entre hommes. Je pense à Vincent, François, Paul et les autres. J’adore Claude Sautet, j’ai grandi avec, mais, quand on regarde ses
Vous avez eu un parti pris surprenant avec Nona et ses filles, en imaginant ce personnage de femme enceinte à un âge mûr – un pur impensable.
C’était une façon pour moi de repousser les limites. Aujourd’hui, on accepte tout juste que les femmes soient enceintes à 40 ans.
films aujourd’hui, on est interloqués quand même. Je veux dire, c’est la virilité entre mecs, un film de braguettes où ils discutent devant un gigot. Quand j’ai fait Nona et ses filles, j’avais justement envie de raconter que les femmes s’aiment. J’avais envie de dire : « Arrêtez ! Moi, j’aime les femmes. »
Mais, si on poussait le bouchon plus loin, d’abord est-ce que les femmes auraient envie d’avoir un enfant ? C’est un superpouvoir, mais en même temps le corps se transforme, on a des chutes hormonales…
C’est un cauchemar. Ça demande une abnégation dingue qu’aucun homme n’est
capable de faire. Les hommes, quand ils font des enfants à 70 ans, ils sont dans leur toute-puissance. C’est même une façon de se dire qu’ils ne sont pas impuissants. Pour les femmes, l’impuissance, c’est la stérilité : à partir du moment où elles n’ont plus d’enfants, on considère qu’elles ne servent plus à rien. Mais ce n’est pas parce qu’on est stériles qu’on ne sert plus à rien. On a inventé le Viagra pour les hommes, alors que les femmes, au fond, elles s’en foutent. On sait bien que les femmes peuvent prendre leur plaisir autrement qu’avec « Penetrator » – mais bon, ça, c’est un autre sujet. La question d’être enceinte en tout cas ne concerne que les femmes. Les préservatifs, c’est encore les femmes qui disent de les mettre. La contraception, c’est toujours la question des femmes. Et donc à un moment donné, quand on a 70 ans, on se dit : « Bah merde, moi, je vais enfin être libérée de cette question. » Et bing ! C’est là que Nona tombe enceinte. C’est vraiment pas de bol.
Miou-Miou dans Nona et ses filles, Marie Rivière dans L’Amour et les Forêts… Vous
invitez dans votre univers des actrices qui ont symbolisé, de manières différentes, une grande liberté dans le cinéma français des années 1970-1980, et qui sont maintenant plutôt invisibilisées ou réduites à des clichés. Qu’est-ce qu’elles incarnent, pour vous ?
Miou-Miou, quand elle a fait Les Valseuses, c’était complètement fou, dans la représentation. D’ailleurs, elle a été décriée, parce qu’on disait qu’on la voyait tout le temps à poil. Mais, pour moi, ça a toujours été une femme ultra politique, une vraie femme indépendante. Donc je trouvais ça crédible qu’elle joue cette directrice du planning familial. Pour Marie Rivière, pendant le confinement, j’ai revu les films de Rohmer, et j’ai redécouvert Marie Rivière, qui a un charme irrésistible. C’est un phénomène aussi. Je trouvais intéressant qu’elle soit la mère de ces jumelles [dans le roman comme dans le film, l’héroïne a une jumelle, qui lui renvoie l’image d’une vie qu’elle aurait pu avoir, ndlr]. Et je la trouve magnifique dans le film : elle a une forme d’ingénuité et en même temps elle est belle. J’adore cette

22 no 197 – mai 2023 Cinéma > En couverture 3
« Tippi Hedren, c’était vraiment la référence pour Virginie Efira. »
SEULS LES SECRETS SURVIVENT







DÉS LE 25 MAI SEULEMENT SUR

UNE SÉRIE
© Showtime Networks Inc. All rights reserved.
femme. Elle est débridée, elle passe du coq à l’âne. Elle est très libre, en fait. C’est génial d’avoir cette fraîcheur-là à cet âge-là.
On a l’impression que les sujets d’actualité vous rattrapent souvent. Ça nous a frappé lors de la sortie de Notre dame, en décembre 2019, soit quelques mois après qu’il y a eu l’incendie…
peur de sortir un film qui a trop d’écho, que ça soûle tout le monde. Là, pour mon prochain film, je suis en train d’écrire sur la psychiatrie. Je suis tombée sur un article du Monde qui parle exactement de ce sujet. J’avoue que je suis toujours très surprise d’être aussi connectée à l’actualité. Je ne sais pas, je dois être un peu sorcière !

L’Amour
Filmographie
LES FILMS DE SA VIE
« Si on regarde tous mes films dans l’ordre chronologique, on peut lire ma vie », nous a confié la réalisatrice. On l’a prise au mot.
IL FAIT BEAU DANS LA PLUS BELLE VILLE DU MONDE (2008)
Dans ce court truffaldien, Valérie Donzelli joue Adèle, une jeune femme qui entame une correspondance avec un chanteur, tout en lui cachant sa grossesse. Avant une rencontre I.R.L. inévitable…
LA REINE DES POMMES (2009)

Adèle (alter ego de la cinéaste) vient de se faire larguer et couche avec des hommes pour panser ses plaies. Un premier long métrage fantaisiste et féministe – alliage-clé chez Donzelli.
LA GUERRE EST DÉCLARÉE (2011)

Inspiré du vécu de la réalisatrice et de son ex Jérémie Elkaïm (qui incarnent des persos nommés Juliette et Roméo), ce film bouleversant raconte comment des parents font face à la maladie de leur enfant.

MAIN DANS LA MAIN (2012)


Par un phénomène inexplicable, la directrice de l’Opéra-Garnier (Valérie Lemercier) se retrouve aimantée à l’employé d’un miroitier de province (Elkaïm)… Un film à la fois dansant et perché.
MARGUERITE & JULIEN (2015)

L’histoire d’amour folle et dérangeante entre une sœur (Anaïs Demoustier) et son frère (Elkaïm), enfants du seigneur de Tourlaville… Avec ce conte moderne, la cinéaste explose les codes.
NOTRE DAME (2019)
Maud (Donzelli), architecte, jongle entre sa famille recomposée, un projet de réaménagement de Notre-Dame et le retour d’un ex (Pierre Deladonchamps)… Une rom com drôle et maline.

NONA ET SES FILLES (SÉRIE, 2021)
À 70 ans, Nona (Miou-Miou), directrice du planning familial, tombe enceinte – son entourage, lui, tombe des nues… Une série absurde mais aussi très politique, qui interroge nos tabous. • J. L.

24 no 197 – mai 2023 Cinéma > En couverture
et les Forêts de Valérie Donzelli, Diaphana (1 h 45), sortie le 24 mai
1 2 3 5 4
Virginie Efira et Melvil Poupaud dans L’Amour et les Forêts (2023) © Rectangle Productions / France 2 Cinéma / Les Films de Françoise / Photographe : Christine Tamalet Miou-Miou et Valérie Donzelli dans Nona et ses filles (2021) © Manuel Moutier
Ah bah ça, oui, toujours. C’est fou. Là, c’est pareil. À partir du moment où j’ai commencé à écrire, de plus en plus de choses ont commencé à sortir. J’ai toujours cette 4 5
LE PRINCIPAL

WHY NOT PRODUCTIONS PRÉSENTE ROSCHDY
MOREAU
CHENOUGA
INSOUPÇONNABLE
INTOUCHABLE
ZEM MARINA HANDS DE LA COMÉDIE FRANÇAISE YOLANDE
UN FILM DE CHAD
IRRÉPROCHABLE ?
?
?
PHOTOS © MALGOSIA ABRAMOWSKA AU CINÉMA LE 10 MAI
ROUGE PROFOND
Nouveau film de Robin Campillo après le triomphal 120 battements par minute, L’Île rouge suit l’éclosion sensorielle d’un petit garçon vivant en 1971 les dernières illusions du colonialisme français sur une base militaire à Madagascar. Le cinéaste, qui s’inspire ici de ses souvenirs d’enfance, signe une magnifique fresque réflexive et engagée. Rencontre.
L’Île rouge est un film très personnel basé sur vos propres souvenirs d’enfance à Mada gascar. Le succès de votre précédent film, 120 battements par minute, Grand Prix à Cannes en 2017 puis César
du meilleur film en 2018, a-t-il agi comme un déclic libérateur ?
Après Eastern Boys [son deuxième long métrage en tant que réalisateur, sorti en 2014, ndlr], j’avais un projet de film d’anticipation – que j’ai toujours. Il y a, pour beaucoup de cinéastes, ce fameux film qu’on repousse sans cesse car on fait d’autres films à la place. Pour moi, tout part d’émotions et de moments où je me dis tout à coup que je tiens un sujet. Quand j’ai repensé à mes années à Act Up [association de lutte contre le sida où militait Robin Campillo dans les années 1990, ndlr], ça a déclenché 120 battements par minute. Act Up et Madagascar sont deux sujets liés à ma vie, qui sont vite devenus incandescents dans ma tête. Il fallait absolument que je fasse ces deux films. Ce sont des moments charnière de ma vie, mais aussi de leur époque. Car réaliser ce film sur Madagascar, c’est parler du passage des années 1960 aux années 1970 ; c’est ce virage-là, et la fin des Trente Glorieuses. Madagascar, c’était le colonialisme français qui se réinventait sous couvert d’indépendance du pays [si l’indépendance malgache fut proclamée en 1960, la France exerça jusqu’en 1972 une domination sur l’administration du
pays, ndlr]. C’est ce qu’on appelle la « présence française », qui est un terme presque médiumnique, comme si on était des fantômes. Et le film sur Act Up, c’était sur le passage des années 1980, où les personnes gay subissaient l’épidémie du sida dans la stupeur, aux années 1990 où on passait à un « nous » collectif et où on décidait de combattre cette épidémie.
Le point de départ de L’Île rouge vient donc de sensations liées à votre enfance de fils de militaire dans l’armée de l’air ?
C’est vraiment un film sur la prise de conscience d’un enfant qui pressent à quel point la réalité est un théâtre. Et l’objet de la pièce serait le bonheur. J’avais raconté à ma productrice Marie-Ange Luciani et à Gilles Marchand, qui m’a aidé sur le scénario, cette histoire toute bête : à la fin de nos deux années vécues à Madagascar, alors que j’avais 8 ans, je suis sorti sur la base militaire, la nuit, habillé en Fantômette [héroïne d’une série de romans français pour la jeunesse publiée à partir de 1961, ndlr].

Alors, il ne s’est absolument pas passé ce qu’on voit finalement dans le film, car j’ai juste parcouru trois blocs et j’avais tellement peur que je suis rentré. Mais cette scène de
l’enfant dans la nuit était primordiale pour le projet. Il s’agit de revisiter les lieux qui sont habituellement animés du théâtre du bonheur et dont on voit qu’ils sont déjà vidés et dépeuplés, comme après un départ. J’ai donc essayé, comme dans 120 battements par minute, de partir d’éléments réels et d’anecdotes précises pour construire et repenser l’architecture de tout cela. Je pense beaucoup au cinéma comme une architecture : comment on coulisse, comment on dispose une pièce principale, un couloir, dans quelle pièce on arrive… Avec L’Île rouge, je voulais quasiment retrouver la logique de rêve, qui me permettait, quand j’étais enfant, de passer d’une chose à l’autre et d’envisager le monde. Dans l’inconscient colonial, il y a la question de l’Arcadie, c’està-dire le pays utopique où tout serait en abondance. Mais où on oublie chaque fois qu’il y avait des gens avant nous à qui appartenait ce pays. Car, en vérité, tous les paradis perdus ont été des paradis volés.
Pour cela, vous usez d’une structure narrative relativement complexe. On suit plusieurs familles à travers le regard d’un enfant, et on assiste aussi à l’amenuisement de la présence française à Madagascar à
26 no 197 – mai 2023 Cinéma > Entretien
ROBIN CAMPILLO
« Dans l’inconscient colonial, il y a la question du pays utopique où tout serait en abondance. »
travers des bribes d’informations retranscrites oralement.
À un moment, je me disais que les brumes de mon souvenir étaient exactement comme les brumes que l’enfant du film essaie de dissiper pour tenter de comprendre la réalité qui l’entoure. Il y a d’un côté la conscience qui naît chez ce garçon [nommé Thomas dans le film, et joué par Charlie Vauselle, ndlr], et d’un autre côté ma conscience d’adulte qui revient sur cette époque. Je m’intéresse aux relations souterraines entre les personnages, mais observées de loin en loin. Je voulais que les informations et les sensations arrivent à l’esprit du public comme elles m’arrivaient à l’esprit quand j’étais enfant. À cet âge, l’attention est parasitée par plein de choses, et la narration devait prendre en compte ce parasitage. Le film est comme une lutte des imaginaires, le petit Thomas est pris entre différentes images dont on ne sait pas si elles sont toutes réelles.

Il y a notamment une scène d’exorcisme dont j’ignore moi-même le statut. Car le film travaille sur les ouï-dire. On entend les adultes parler de quelque chose et on se demande si c’est réel. Dans l’écriture et jusqu’au montage, ça a été un travail de dentelle. Moi, je pense qu’il vaut mieux perdre le spectateur que trop le prendre par la main. La fiction, c’est aussi ce désir d’entrer dans l’image parce qu’on ne la comprend pas complètement. Je trouve assez fascinant qu’on soit parfois désorienté au cinéma. Moi, dans la réalité, je suis très souvent désorienté.
Au-delà de l’écriture, quels ont été les grands principes de mise en scène ? Elle s’avère d’une grande sensualité, comme lors d’une séquence de danse vue à travers la vitre d’une porte.
J’ai beaucoup cherché sur le tournage. Je voulais de la fluidité et de la sensualité.
Je ne voulais pas qu’on soit trop près des corps ni tout le temps à fleur de peau. Et c’est beaucoup passé par la question de la lumière et des cadres avec Jeanne Lapoirie [chef opératrice qui a aussi travaillé avec André Téchiné, François Ozon ou Catherine Corsini, ndlr]. On a assez vite choisi le format 1,37:1 lors des premiers essais. On n’avait jamais remis en question le format Scope, avec Jeanne, mais sur ce film j’avais besoin de plus de verticales et de plus de ciel. Les plans de la sortie d’église, par exemple, ne seraient pas du tout les mêmes en Scope. Ce format 1,37:1 produit un décalage, on voit que l’image n’est pas complètement carrée. Je ne suis pas le premier cinéaste à revenir à des formats plus ou moins carrés, et je crois qu’il y a là une envie de revenir à une esthétique qui serait proche du cinéma des débuts. Plus l’image est resserrée, plus on a une impression pic-
turale. Je songeais aussi probablement au cinéma de Josef von Sternberg [réalisateur notamment de Morocco, film de 1931 avec Marlene Dietrich, ndlr]. On pourrait dire, au fond, que c’est un peu le pire de l’exotisme au cinéma, mais je voulais rejouer en partie cela avec les lumières. On a aussi été intéressés par des transformations naturelles de l’image en cherchant dans la nature des éléments qui permettraient de faire artificiel. Et cette scène de danse dont vous parlez commence par un plan flou avec des gens qu’on ne devine même pas, à travers du verre. J’aime qu’on découvre d’un coup la main du gamin qui caresse cette surface, presque comme s’il touchait l’écran d’un téléviseur. L’idée est aussi que le spectateur rentre à ce moment-là dans la tête de l’enfant, comme il rentre ensuite dans la tête du mari jaloux. Le cinéma est un art de la mutation, de la métamorphose, avec des
27 mai 2023 – no 197 Entretien < Cinéma
© Gilles Marchand
personnages qui se révèlent généralement ne pas être ce qu’on imaginait au départ. Vous montrez aussi des relations de couples assez dysfonctionnelles, notamment entre les parents de Thomas, joués par Quim Gutiérrez et Nadia Tereszkiewicz. Le but était de filmer la corruption du monde adulte ?
J’ai en effet le sentiment que la cellule familiale est une des structures les plus aléatoires de la société, en tout cas du point de vue de l’enfant. Il faut également savoir qu’à l’époque un couple se choisissait très vite et avait rapidement des enfants. Je filme donc ces gens dans leur bonheur, mais aussi comme une somme de solitudes. Les groupes humains me semblent toujours assez suspects, en réalité. D’ailleurs, au début, je voulais appeler le film Vazaha, ce qui signifie « les Blancs », « les Français » en malagasy [autonyme malgache,
ndlr]. En étant ainsi désignés comme une catégorie humaine, on devenait d’une certaine façon étrangers à nous-mêmes. Et, au niveau des couples, je voulais montrer à quel point ces adultes pouvaient surjouer leurs personnages. Sur ce plan-là, je trouve formidable le couple Guedj, joué par Sophie Guillemin et David Serero ; ils ont tout le temps l’air d’être en train de présenter une émission pour enfants. Et la jalousie du père de Thomas me paraît un peu fausse aussi, comme si cet homme voyait là un passage obligé. Car ce que l’enfant pressent dans le film, c’est que la réalité qui l’entoure n’est en fait pas légitime, l’ordre établi des choses n’est pas légitime. Ce qui se passe entre les adultes, de même que ce qui se passe entre ces adultes blancs et la population malagasy, est factice et truqué. Je pense souvent à la nouvelle de Philip K. Dick « Le Père truqué ». Et je me rends compte au-

jourd’hui que ma vie a pendant longtemps été dirigée, comme celle de mes parents et de mes frères, par une géostratégie de la France qui voulait une place dans l’océan Indien et qui ne voulait pas la céder à l’U.R.S.S. – ce qui s’est pourtant passé par la suite. Notre raison d’être à Madagascar était fausse, comme un montage. On était à deux doigts du mensonge. Et dans la scène où le père met une gifle à son fils, il semble hors jeu et va trop loin. Car on comprend que lui aussi est comme un enfant vis-à-vis de l’armée. Lui non plus n’a pas son mot à dire.
Tout est donc question d’émancipation et d’indépendance à trouver face à cet ordre établi ?
Tout à fait. La chanson que j’ai mise à la fin du film, « Veloma », du groupe Mahaleo, qui est la chanson de la révolution malgache et
qui a été un succès énorme, parle de ça. Si on veut que les choses bougent, il faut sortir de l’enfance et lui dire adieu. Mais ce n’est pas pour passer dans l’âge adulte, c’est pour passer dans la jeunesse, être un jeune homme et une jeune femme car « le monde est plaisir », disent les paroles. C’est la remise en cause de l’ordre établi et des choses qui allaient de soi, comme le fait que, pour les Malgagasy, à l’époque, ça allait de soi de faire des études pour finalement ne pas être autre chose qu’infirmier et infirmière. On était comme une espèce de colonie de vacances, en réalité. Le colonialisme, la colonie de vacances… il y a dans les deux cas une forme d’inconscience de ce qu’on est et de ce qu’on fait. Alors mon père avait sans doute plus de conscience, car il conduisait des avions et formait des militaires malgaches, il y avait de la stratégie militaire. Mais il ne
Cinéma > Entretien
28 no 197 – mai 2023
© Gilles Marchand
nous disait jamais ce qu’il faisait. Et, dans ce surjeu du couple, il y a l’idée que le mariage est une fiction et une alliance. L’illusion de cet ordre établi ne fonctionne que si on est tout le temps en migration et qu’on ne revient pas sur le territoire français. Tout ce monde vivait dans un rêve colonial, qui est en fait un rêve de ne pas s’établir. Et ça vous coupe du réel. C’est pourquoi tant de couples se déchiraient dès qu’il était question de rentrer soudain en France et de quitter l’illusion. On naviguait à vue. Alors il y avait peut-être de la beauté là-dedans, mais c’était au prix d’une oppression. Et à Madagascar, comme dans toutes les autres colonies, au prix de massacres passés.
Vous confiez le rôle de la mère à Nadia Tereszkiewicz, actrice de plus en plus en vue.
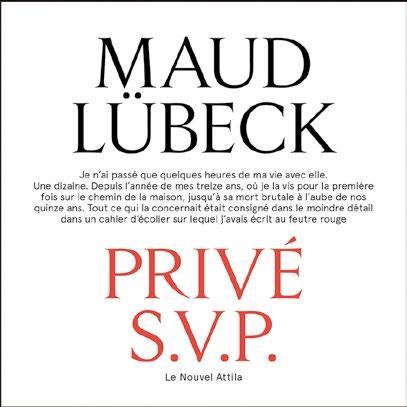
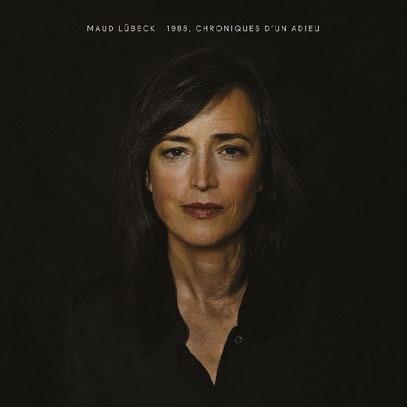
Oui, Nadia est plus jeune que ne l’était ma mère à l’époque. Ma mère avait 33 ans et était déjà mère de trois enfants. Mais, au fond, le but n’est pas de reproduire dans le film ce qu’étaient mes parents. Les comédiens étaient assez autonomes, je n’avais pas envie de trop les prendre par la main. Je ne vois d’ailleurs ni beaucoup mon père ni beaucoup ma mère dans le film. Certains souvenirs sont inventés, on invente ce qu’on veut avec la fiction. Pour moi, le plus important était d’essayer de comprendre au fur et à mesure comment fonctionne ce couple, comment il évolue, se métamorphose, se dévoile et se démasque. On est quand même dans des régions où les gens avaient des uniformes, où les femmes avaient des tenues, où des rôles étaient joués.


À un moment, le personnage du général dit, à propos de la fin de l’influence fran-

çaise dans la région : « On ne va pas réécrire l’histoire. » Mais le film propose précisément de déplacer le point de vue sur cette histoire coloniale. Avez-vous lu des livres sur le sujet pour préparer le film ?
Je suis assez fasciné par Claude Simon [écrivain français né à Madagascar en 1913 et décédé en 2005 à Paris, ndlr], qui raconte des campagnes militaires et des guerres du point de vue du bruit du verre qu’on pose sur la table, et qui montre comment la grande histoire est
révolution, j’étais assez déprimé, comme toute ma famille. Madagascar était restée paradisiaque dans ma tête, aussi parce qu’on se racontait que ce n’était pas une colonie comme le Maroc ou l’Algérie [où la famille de Robin Campillo a aussi vécu juste avant Madagascar, ndlr], donc on avait moins mauvaise conscience. Mais, les années passant, j’ai senti qu’on n’était tout simplement pas à notre place. Et les personnages du film ne sont pas à leur place, ils vivent une vie factice. J’ai fait ce film
tout à coup parasitée par ces détails. Moi, j’entendais dire des Malagasy que ça se passait très bien avec eux, qu’ils étaient « gentils », qu’on était très bien acceptés, mais que, tout à coup, certains devenaient méchants. C’est tout simplement ce qu’on appelle une révolution. Et, à la fin du film, je montre la révolution malgache de 1972, qui s’est passée après notre départ, mais que j’ai fait coïncider, dans le récit, avec la présence de cette famille. Je voulais montrer comment Miangaly [incarnée par Amely Rakotoarimalala, ndlr] est happée par ce mouvement de révolution. Quand on fait une révolution, il n’y a pas que des militants, mais aussi des gens qui prennent le train en route. Quand je suis rentré de Madagascar, un an avant la
pour balayer ma nostalgie, pour la brûler. Et, pour la brûler, il fallait qu’il y ait ce changement assez brutal à la fin du film. On s’est intéressé à des gens pendant une heure et demie et on les oublie. On prend une photo d’eux et on passe à autre chose. Madagascar est une colonisation qui a été un peu oubliée, c’est comme un chaînon manquant. C’était du postcolonialisme, semblable à la Françafrique. Le colonialisme a toujours tenté de se survivre à lui-même. Et dans la société actuelle il continue de fonctionner ou de créer des biais, de changer la perception qu’on a des gens et des différences.
Parmi les partis pris forts du film, il y a en effet le changement narratif des vingt
Entretien < Cinéma
29 mai 2023 – no 197 © Memento
« J’ai fait ce film pour balayer ma nostalgie, pour la brûler. »
Distribution
Cinéma > Entretien
dernières minutes, doublé de la métaphore du personnage de Fantômette. La sortie du gamin en Fantômette, c’est aussi parce qu’il découvre les coulisses du paradis perdu, les coulisses du colonialisme. Et il a besoin de mettre un autre costume pour déchiffrer cette réalité. Je voulais effectivement qu’on passe d’un seul coup à de la politique plus dure à la fin, avec des discours qui désignent explicitement tout ce qu’on a vu pendant une heure trente. C’est comme si on voyait tout à coup les « tréteaux » de ce roman familial et de cette illusion. Ce qui m’intéresse, c’est que la fiction démonte les fictions, c’est-à-dire les ordres établis, les institutions, les conventions… Dans ce lieu où on était relativement libres, où on se mêlait aux Malagasy, il y avait malgré tout une brutalité, qui venait d’une violence coloniale très forte, celle de 1947 [année où une insurrection malgache débuta sur l’île, qui avait alors le statut
de colonie française, avant une répression par l’armée française qui fit des dizaines de milliers de morts, ndlr].
Une violence qu’on retrouve à un niveau différent dans certaines des séquences avec Fantômette, que vous disséminez tout au long du film.
Toutes les scènes avec Fantômette renvoient au petit Thomas un imaginaire de la France qui est en réalité faux. Pendant six mois, on a cherché des décors naturels pour ces séquences, mais en fait rien ne ressemblait à ça. Et je me suis souvenu que la France, pour moi, était un exotisme quand j’étais enfant.
C’était totalement fantasmé, une tranche d’imaginaire parmi les autres. Ce gamin se projette dans une vision de la France que j’ai été obligé de reconstituer en maquettes. J’ai repensé à ces programmes de l’O.R.T.F. où des gens ont des masques, tout comme les
adultes du film qui portent aussi masques et costumes. Fantômette est d’ailleurs un personnage qui n’a pas de parents, et sa volonté de clandestinité fait écho à celle de Thomas. Il faut être clandestin pour observer des choses qu’on vous demande de ne pas voir.
Le film n’a pas été sélectionné au Festival de Cannes, alors qu’il avait été soumis au comité de sélection. Comment expliquer cette absence, alors que 120 battements par minute avait reçu le Grand Prix cannois en 2017 et frôlé la Palme d’or ? Je crois simplement qu’un choix a été fait par le Festival. Moi, je fais avec ce qu’on me donne : j’étais très content d’être à Cannes avec 120 battements par minutes, car un tel film n’aurait jamais rencontré le public qu’il a rencontré s’il n’avait pas été à Cannes. Je me fiche d’avoir un prix à titre personnel, mais, pour L’Île rouge, cela fait un peu mal vis-à-vis

de Madagascar. On a un petit réseau, avec des techniciens de Madagascar qui nous ont aidés à faire le film. Des gens sur place essaient de se battre pour relancer la production locale, et c’est quand je me suis aperçu qu’il fallait que je leur apprenne que le film ne serait pas à Cannes que je me suis dit que c’était un peu dur. Et puis Madagascar, c’est une page d’histoire française, et s’il y a un endroit où il aurait pu y avoir un coup de projecteur sur ce sujet, c’est dans un festival en France. Après, ni Les Revenants ni Eastern Boys n’ont été à Cannes, donc au fond l’anomalie c’était 120 battements… Je suis en tout cas très content du film. Le projet a été compliqué, aussi à cause de la pandémie, et a demandé beaucoup d’efforts. Je suis maintenant impatient que le public le découvre. Je ne me plains pas, c’est un tel privilège de faire des films. Et c’est déjà énorme que L’Île rouge sorte au cinéma.
L’Île rouge de Robin Campillo, Memento, sortie le 31 mai PROPOS RECUEILLIS PAR DAMIEN LEBLANC
Photographie : Julien Liénard pour TROISCOULEURS
30 no 197 – mai 2023
© Gilles Marchand











































HISTOIR JOBY HAROLD SCÉNARIO JOBY HAROLD ET DARNELL METAYER & JOSH PETERS ET ERICH HOEBER & JON HOEBER RÉALISÉ STEVEN CAPLE JR. DE DE PAR @ParamountPicturesFrance /ParamountPicturesFrance @ParamountFr #Transformers #RiseOfTheBeasts Transformers-lefilm.fr @Transformers.LeFilm
L’ARCHIVE DE… ROBIN CAMPILLO
Dans L’Île rouge, Robin Campillo s’appuie sur ses souvenirs d’enfance dans une base militaire à Madagascar pour livrer un grand film politique et sensoriel. Le cinéaste nous a confié cette photo de lui, prise à la fin des années 1960 et reproduite à l’identique dans une séquence du film. Il la commente généreusement.

« J’ai habité à Madagascar de 1969 à 1971, juste avant la période qu’on voit dans le film. Et il y avait ce sentiment étrange qu’on était loin de la France mais qu’en même temps il fallait absolument s’y rattacher. Donc ce Noël était à la fois très français et très militaire. On voyait atterrir le Noratlas, un avion qui a beaucoup suivi la colonisation française, notamment en Afrique du Nord. Et le Père Noël sortait de cet avion, ce qui est quand même une idée curieuse. Il y avait tout le temps là-bas un côté enchanteur qui se mélangeait avec un côté martial. Et moi je voyais bien que le Père Noël était en fait un militaire, et que toute cette réalité qui se voulait rassurante, joyeuse et festive était toujours entachée d’un mystère.
Je suis né au Maroc en 1962 et j’ai habité dans plusieurs anciennes colonies : le Maroc, l’Algérie après l’indépendance, puis Madagascar. Et cette volonté de se rattacher à la France était perceptible partout où on allait avec ma famille. Il faut aussi savoir qu’un petit garçon pouvait avoir deux sortes de cadeaux à Noël : soit une tenue de cow-boy, soit un Concorde électrique. Le Concorde, ça symbolisait évidemment la gloire de la France. Et moi je n’ai pas eu ce Concorde électrique, et j’en ai été très malheureux. Si je fais cette tête sur la photo, c’est parce que je suis mécontent de mon cadeau. On sent également sur mon visage une inquiétude. Je voulais bien jouer le jeu de ce Noël, qu’on voit d’ailleurs dans une
séquence du film, mais je trouvais bizarre qu’un adulte se déguise ainsi et prenne une voix grave. D’autant que je ressentais à Madagascar un décalage permanent et que j’étais un peu paumé. J’étais certes assez joyeux là-bas, mais j’avais toujours l’impression que les gens surjouaient le bonheur ; un bonheur français, un bonheur d’expatriés. Cette base militaire était comme un village gaulois, il y avait un cinéma, des stades, des piscines, deux restaurants pour les officiers et les sous-officiers. Ce simulacre de France était incroyable. »
32 no 197 – mai 2023 Cinéma > L’archive
PROPOS RECUEILLIS PAR DAMIEN LEBLANC
© Robin Campillo

WHY NOT PRODUCTIONS PRÉSENTE
BENJAMIN LAVERNHE PIERRE RICHARD MELVIL POUPAUD PASCAL GREGGORY LE 16 MAI AU CINÉMA MAÏWENN johnny depp UN FILM DE MAÏWENN
BARRY JEANNE du
les 25 films de Cannes qui vont raviver la flamme du cinéma

Todd Haynes, Jonathan Glazer, Justine Triet, Katell Quillévéré, Wang Bing… Nos cœurs ont bondi à l’annonce de la sélection officielle de la 76e édition par Thierry Frémaux et Iris Knobloch. On craignait un festival d’habitués et de pitchs ronronnants, et nous voilà face à une certaine dose d’audace et d’inattendu – le constat vaut d’ailleurs pour toutes les sélections. Ajoutons que le jury de la Compétition officielle est présidé par le trublion suédois Ruben Östlund (détenteur de deux Palmes d’or, dont une l’an dernier pour Sans filtre), ce qui nous fait dire que, cette année, il faudra vraiment s’attendre à toutes les surprises. Retrouvez notre couverture quotidienne du Festival du 16 au 27 mai sur troiscouleurs.fr.
Dossier coordonné par Juliette Reitzer et Timé Zoppé, avec Léa André-Sarreau, Quentin Grosset et Joséphine Leroy
Simple comme

Sylvain de Monia Chokri
Sélection officielle – Un certain regard
Anatomie d’une chute de Justine Triet

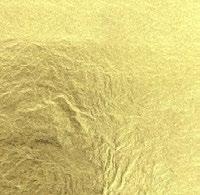


Sélection officielle – Compétition
Des héroïnes complexes prises dans des dédales psychologiques. Voilà à quoi nous a habitués Justine Triet, de retour en Compétition quatre ans après Sybil avec ce film coécrit avec Arthur Harari, réalisateur du subjuguant Onoda. Un thriller qui nous plongera dans le parcours d’une femme faisant l’objet d’une enquête à la suite de la mort de son mari : le détective soupçonne d’abord un accident ou un suicide et finit par croire qu’il s’agit d’un meurtre. Le témoin-clé s’avère être le fils aveugle du couple, qui fait face à un dilemme moral… Au casting : Swann Arlaud, Sandra Hüller, Antoine Reinartz et Jehnny Beth – une belle ribambelle de comédiens, dont la réalisatrice pourrait révéler la folie douce.


May December de Todd Haynes

Sélection officielle – Compétition








C’est LE projet qu’on attend depuis des années. Après son portrait du Velvet (sobrement intitulé The Velvet Underground), présenté hors Compétition à Cannes en 2021, le grand Todd Haynes (lire p. 48) revient en Compétition avec ce drame sur une actrice (Julianne Moore) dont la vie familiale est perturbée par le biopic en gestation sur sa vie et sa rencontre avec l’actrice qui s’apprête à l’incarner (Natalie Portman). Le tout mêlé à l’histoire du couple qu’elle forme avec son mari, de 23 ans son cadet, qui avait fait des années plus tôt la une des tabloïds. Un méli-mélo qui s’annonce passionnant et vertigineux – comme toujours avec le réalisateur de Carol (2016).
« J’avais envie d’écrire un vrai film d’amour. Je trouve qu’il y en a peu, peut-être parce qu’on est dans une époque cynique », nous avait confié, à la sortie de Babysitter (2022), la réalisatrice québécoise, à propos de son projet alors en tournage. Présenté quatre ans après que La Femme de mon frère a reçu le Prix coup de cœur du jury Un certain regard, Simple comme Sylvain raconte l’histoire d’une quadragénaire aisée (Magalie Lépine-Blondeau) bouleversée par sa rencontre avec un entrepreneur issu d’un milieu modeste (Pierre-Yves Cardinal, vu dans Tom à la ferme de Xavier Dolan). On compte sur la pétillante cinéaste pour faire chavirer nos petits cœurs sensibles.
Àma Gloria
de Marie Amachoukeli
Semaine de la critique – Séance spéciale
C’est une habituée de Cannes, avec son court C’est gratuit pour les filles (coréalisé avec Claire Burger) à la Semaine de la critique en 2009, et surtout avec Party Girl (coréalisé avec Samuel Theis et Claire Burger), Caméra d’or en 2014. Marie Amachoukeli revient cette fois en solo en ouverture de la Semaine avec ce film sur l’enfance qui s’annonce intense. Àma Gloria raconte l’histoire de Cléo, tout juste 6 ans, qui aime follement sa nounou, Gloria. Mais celle-ci doit retourner au Cap-Vert auprès de ses enfants. Cléo lui demande de tenir une promesse : la revoir au plus vite. Gloria l’invite à venir, dans sa famille et sur son île, passer un dernier été ensemble. Préparez les mouchoirs.
34
Cinéma > 76e Festival de Cannes
© D. R.
© Pyramide
© Fred Gervais no 197 – mai 2023
Films
© Les Films Pelléas / Les Films de Pierre
Asteroid

City
de
Wes Anderson
Sélection officielle – Compétition
Après The French Dispatch (2021) et Moonrise Kingdom (2012), tous deux repartis bredouilles, Wes Anderson retente sa chance en Compétition avec cette comédie rétro qui plonge dans la petite ville fictive d’Asteroid City, en plein désert américain, durant les fifties, tandis qu’une convention scientifique de jeunes astronomes et cadets de l'espace fait face à de mystérieux événements qui vont chambouler le monde. À l’affiche : Jason Schwartzman, Scarlett Johans son, Tom Hanks, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Ed Norton, Adrien Brody, Liev Schreiber, Steve Carell, Willem Dafoe et Margot Robbie… On s’arrête là, le casting est aussi alléchant qu’interminable.

Jeunesse (le printemps) de
Wang Bing

Sélection officielle – Compétition
Le réalisateur chinois, grand portraitiste de son pays et de ses mutations socioéconomiques, nous a habitués à de longues fresques documentaires (À la folie, Les Âmes mortes). Tout indique qu’il en va de même de ce docu fleuve de trois heures trente dont l’action se situe à Zhili, à 150 kilomètres de Shanghai. Dans cette cité dédiée à la confection textile, les jeunes de 20 ans affluent de régions rurales et travaillent sans relâche pour pouvoir un jour élever un enfant, s’acheter une maison ou monter leur propre atelier. On pressent la fresque hypnotique et édifiante. Doublé gagnant cette année pour Wang Bing, qui présente aussi en Séance spéciale le plus modeste et arty Man in Black.

Le Livre des solutions
de Michel Gondry Quinzaine des cinéastes


Plutôt rare sur la Croisette – la dernière fois qu’il est venu, c’était en 2012, à la Quinzaine déjà, pour The We and the I, sur l’été brûlant de lycéens dans le Bronx –, le cinéaste français présente Le Livre des solutions, un projet très personnel tourné dans les Cévennes gardoises, où il a des attaches familiales. Pierre Niney y campe un réalisateur cherchant à vaincre les démons qui nuisent à sa créativité. Un sujet hautement méta pour un cinéaste à la fois cinéphile et très tourné vers l’obsession de la page blanche. Ce savant mélange est offert assorti d’un casting délicieux : Blanche Gardin, Camille Rutherford, Vincent Elbaz et Françoise Lebrun.

État limite
 de Nicolas Peduzzi ACID
de Nicolas Peduzzi ACID
La Chimère
d’Alice
Rohrwacher
Sélection officielle – Compétition


Après Heureux comme Lazzaro, fable surréaliste dans une Italie hantée par la brutalité de l’exode rural postfasciste (présenté en Compète en 2018), la réalisatrice toscane retrouve sa place en Compétition avec La Chimère. L’histoire, dans les années 1980, d’un chasseur de vestiges étrusques revenu sur le littoral de la mer Tyrrhénienne pour pratiquer son activité illégale avec des bandits, et qui ressent le vide laissé par le souvenir de son amour perdu. On compte sur la réalisatrice des Merveilles (en Compète en 2014) pour explorer avec poésie les frontières entre réalité et fantasme, et les histoires qu’on se raconte à soi-même pour survivre à la disparition d’un être cher.
Nicolas Peduzzi nous avait soufflés en 2021 avec Ghost Song, traversée orageuse de Houston, entre documentaire et fiction, suivant les itinéraires de deux musiciens. On espère retrouver son ampleur et son lyrisme avec un projet pour le moins différent : le cinéaste s’aventure un peu plus près de nous, à l’hôpital public Beaujon de Clichy. Il y filme le service de psychiatrie, où il ne reste plus qu’un seul psychiatre, le docteur Jamal Abdel-Kader. Celui-ci résiste, malgré le peu de moyens alloués et l’injonction à la productivité qui gagne aujourd’hui les lieux de soins. Sûr qu’on peut compter sur Peduzzi pour aller poser sa caméra là où ça fait mal.
Acide de Just Philippot







Sélection officielle – Séance de minuit
On se réjouit de retrouver le jeune Français Just Philippot, qui nous avait totalement subjugués en 2020 avec La Nuée (Semaine de la critique), film de genre et thriller agricole de haute tenue dans lequel un nuage de sauterelles tueuses menaçait une éleveuse mère célibataire en plein burn-out. Il débarque en Séance spéciale avec Acide, prolongation de l’un de ses propres courts métrages sur une catastrophe climatique – des nuages de pluies acides qui s’abattent sur la France – avec Laetitia Dosch et Guillaume Canet. Quelque chose nous dit que cet exode apocalyptique devrait ramener un vent de conscience écolo sur cette sélection officielle.

Le Règne animal de Thomas


Cailley
Sélection officielle – Un certain regard
Après le très prometteur Les Combattants (Quinzaine des réalisateurs, 2014), le Français Thomas Cailley revient à Cannes avec un long très attendu porté par Adèle Exarchopoulos, Romain Duris et Paul Kircher (révélé dans Le Lycéen de Christophe Honoré en 2022). L’histoire se situe « dans un monde en proie à une vague de mutations qui transforment peu à peu certains humains en animaux ». Un homme fait tout pour sauver sa femme, touchée par ce mal mystérieux, et embarque son fils de 16 ans dans une quête. Quand on lui a demandé de nous en dire plus en entretien, Adèle Exarchopoulos nous a parlé d’un « scénario complètement fou ». Cannes n’est pas prêt pour cette secousse.

Un prince de Pierre Creton
Quinzaine des cinéastes
Dans son coin, au pays de Caux, Pierre Creton fabrique une filmographie singulière, empathique mais pas mièvre (Va, Toto ! 2017 ; Le Bel Été, 2019), qui brouille les pistes entre documentaire et fiction. Celui qui est aussi ouvrier agricole et plasticien donne à voir, de façon très poétique, un monde complètement invisibilisé – le sien. Dans Un prince, il raconte l’histoire de Pierre-Joseph, de son adolescence, passée dans un centre de formation pour devenir jardinier, à sa rencontre avec le propriétaire d’un étrange château, des années plus tard. On se laissera volontiers surprendre par ce nouvel objet, qu’on devine déjà beau bizarre.
35 mai 2023 – no 197
76e Festival de Cannes < Cinéma
© Les
© The Jokers /
Bookmakers © Pathé © 2023 Nord-Ouest Films / StudioCanal / France 2 Cinéma / Artémis Productions © D. R. © 2022
© Ad Vitam
Alchimistes
©
House on Fire / Gladys Glover / CS Production
Les
Pop. 87 Productions LLC
Portraits fantômes de Kleber Mendonça Filho
Sélection officielle – Séance spéciale

Le Procès Goldman


de Cédric Kahn
Quinzaine des cinéastes
Kahn à Cannes, ça sonne déjà comme une évidence. Mais ce qui donne véritablement sa place en sélection à l’acteur-cinéaste, c’est sa manière de tirer le portrait intense d’outsiders, d’écorchés (Roberto Succo, en Compétition en 2001, ou La Prière, 2018). Il revient cette année avec un biopic consacré à Pierre Goldman, demi-frère de Jean-Jacques, certes, mais surtout militant d’extrême gauche, condamné à perpétuité en décembre 1972 pour des braquages à mains armées ayant entraîné la mort de deux pharmaciennes. Un procès qui le rendra célèbre, autant auprès de la gauche intellectuelle qu’auprès des médias (à cause de ses esclandres). Avant sa triste fin : sa mort par assassinat en 1979.


Conann

de Bertrand Mandico
Quinzaine des cinéastes
Après son long métrage tortueux et gluant




After Blue (Paradis sale) (2021), Bertrand Mandico revient avec une variation qui s’annonce excessive, féministe et romantique sur le célèbre personnage viril et musculeux de Conan le Barbare, imaginé par Robert E. Howard et autrefois incarné au cinéma par Arnold Schwarzenegger. En 2020, le cinéaste nous en parlait ainsi : « Dans mon projet, Conan est fille(s) et femme(s), et elles évolueront dans un monde au féminin […] Il y aura six Conan, autant qu’il y a de périodes dans sa vie. Chaque nouvelle Conan viendra tuer la précédente car, pour moi, le comble de la barbarie, c’est de tuer sa jeunesse. » Tout un programme.
Prix du jury à Cannes en 2019 pour Bacurau, fable dystopique sanglante sur la mort d’une emblématique matriarche de 94 ans, Carmelita, dans un village fictif et isolé au cœur du sertão, le réalisateur brésilien est sélectionné cette fois en Séance spéciale avec ce documentaire sur le centre-ville de Recife. Ville natale de Kleber Mendonça Filho, l’agglomération du Nordeste brésilien était déjà au cœur des Bruits de Recife (2014), son premier long métrage, remarqué, sur le quotidien d'un quartier perturbé par l'arrivée d'une société de sécurité, et d’Aquarius (2016), sublime chronique de la vie d’une irréductible sexagénaire qui avait été sélectionnée en Compétition.
Killers of the Flower Moon
de Martin Scorsese
Sélection officielle – hors Compétition

Le cinéaste revient sur la Croisette avec un thriller produit par Apple, coécrit avec Eric Roth. Ce western porté par un casting de choc (Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Brendan Fraser, Lily Gladstone), se déroule dans les années 1920 en Oklahoma et retrace une suite de meurtres commis par l’éleveur William Hale et ses neveux afin de s’approprier les terres des Osage sur lesquelles ont été découvertes des sources de pétrole. Une série d’actes ignobles, connue aujourd’hui sous le nom de « règne de la terreur »… Retour en force pour Scorsese, qui n’avait pas été en sélection officielle depuis The Last Waltz, présenté à Cannes Classics en 2005.

Hypnotic de Robert Rodriguez
Sélection officielle – Séance de minuit
Un chouïa plus discret que son acolyte Quentin Tarantino (ils ont, entre autres folles collaborations, cosigné le diptyque Grindhouse en 2007), Robert Rodriguez avait déjà enflammé la Croisette en 2005 avec son culte Sin City, sa bande de criminels, de ripoux et de femmes fatales. À l’image de ses héros noctambules, le cinéaste, scénariste et musicien américain débarque cette année en Séance de minuit pour raconter l’histoire d’un détective (Ben Affleck) qui enquête sur une série de braquages et se retrouve pris dans une « affaire impliquant sa fille disparue et un programme secret du gouvernement ». On espère que ni Didier Raoult ni Francis Lalanne ne sont au scénario.
Le Temps
d’aimer
de Katell Quillévéré
Sélection officielle – Cannes première

Après Un poison violent (Quinzaine des réalisateurs, 2010) et Suzanne (Semaine de la critique, 2013), Katell Quillévéré fait une percée en sélection officielle. Le Temps d’aimer suit la rencontre, en 1947, de Madeleine (Anaïs Demoustier), serveuse d’un hôtel-restaurant et mère d’un petit garçon, et François (Vincent Lacoste), un étudiant riche et cultivé. L’un et l’autre se cachent un secret qui tardera à être révélé… L’alchimie entre Anaïs Demoustier et Vincent Lacoste n’est plus à prouver – ils se sont donné la réplique dans Deux fils de Félix Moati et Fumer fait tousser de Quentin Dupieux –, et on mise sur le talent de la réalisatrice pour observer les dangers de la passion.


Les Filles d’Olfa
de Kaouther Ben Hania Sélection officielle – Compétition
L’Autre Laurens





 de Claude Schmitz
de Claude Schmitz
Quinzaine des cinéastes

On a adoré son moyen métrage en forme de chronique noire Braquer Poitiers (2019) et en février dernier Lucie perd son cheval, film de chevalerie au féminin. Ce n’est pas le pitch intriguant de son nouveau projet qui fera redescendre la hype. « Le détective privé Gabriel Laurens, spécialisé dans les affaires conjugales, voit sa vie chamboulée lorsque débarque chez lui sa nièce Jade. La jeune fille a des doutes sur la mort accidentelle de son père et lui demande de mener l’enquête. » On pressent une sorte d’inspecteur Gadget weirdo campé par l’excellent Olivier Rabourdin, et un crime que l’on devine prétexte à une fine étude de mœurs. Bref, c’est un grand oui.
Résolument féministe, le cinéma de Kaouther Ben Hania parvient toujours à surprendre. Dans la comédie Le Challat de Tunis (ACID, 2014) ou le thriller La Belle et la Meute (Un certain regard, 2017), la cinéaste tunisienne faisait prendre au spectateur des chemins de traverse. Ce nouveau cru, qui lui ouvre pour la première fois les portes de la Compétition, part de la tragédie d’une mère dont les deux filles aînées disparaissent soudainement. La réalisatrice convoque alors des actrices professionnelles et met en place un dispositif de cinéma hors du commun afin de lever le voile sur cette histoire. Autant dire qu’on est très intrigués par ce pitch étonnant.

no 197 – mai 2023
Cinéma > 76e Festival de Cannes 36 © Ketchup Entertainment © Wrong Men / Chevaldeuxtrois © Tanit Films © Wilson Carneiro da Cunha © UFO Distribution © Ad Vitam © Paramount Pictures © Les Films du Bélier / les Films Pelléas / Gaumont / Photographe : Roger Arpajou
The Zone of Interest
de Jonathan Glazer


Sélection officielle – Compétition
Le Britannique Jonathan Glazer est aussi rare que précieux. En plus de vingt ans, il n’a réalisé que quatre films – et, c’est bien simple, ce sont tous des chefs-d’œuvre. Aucun d’eux – ni Under the Skin (2014), avec Scarlett Johansson en fascinante alien se découvrant des émotions humaines, ni Birth (2004), mélo dérangeant sur le deuil – n’a pourtant été présenté à Cannes. L’injustice est désormais réparée : The Zone of Interest suit un officier SS qui s’éprend de la femme du commandant de son camp durant la Seconde Guerre mondiale. Alors que leur idylle secrète commence, le mari éconduit soupçonne sa femme et la fait suivre. La démente actrice Sandra Hüller (Toni Erdmann) est de la partie.
Firebrand



de Karim Aïnouz
Sélection officielle – Compétition
Après son sulfureux ovni Madame Satã (sélectionné à Un certain regard en 2002) et La Vie invisible d’Eurídice Gusmão (prix Un certain regard à Cannes en 2019), mélo sur les désillusions conjugales de deux sœurs à Rio de Janeiro, le réalisateur brésilien concourt pour la première fois pour la Palme d’or avec un drame historique sur Catherine Parr, la sixième et dernière épouse du roi d’Angleterre et d’Irlande Henry VIII – et l’une des seules à lui avoir survécu. Tout ça promet du sang, de la rivalité et des intrigues de couloir cruelles, le tout nimbé dans une photographie soignée et incarné par les troublants Alicia Vikander et Jude Law.
Kubi
de Takeshi Kitano


Sélection officielle – Cannes première
Le grand Takeshi Kitano n’était pas venu au Festival de Cannes en sélection officielle depuis Outrage (2010). Treize ans après, le revoilà à Cannes première avec l’adaptation d’un de ses livres éponyme. Ce qui est annoncé comme possiblement son dernier film sera une épopée historique située en 1582 : dans un temple de Kyoto, le seigneur de guerre Oda Nobunaga a été assassiné. Un général Araki Murashige qu’on soupçonne déloyal est capturé juste avant l’assassinat. Oda Nobunaga voulait lui briser le cou… Avec cette histoire de politique et de coups bas sanglants, Takeshi Kitano, qu’on disait trop assagi, aurait-il retrouvé sa fibre sale gosse ?
Occupied City
de Steve McQueen
Sélection officielle – Séance spéciale

Le réalisateur britannique doué et engagé Steve McQueen, venu présenter Hunger à Cannes en 2008, montrera en Séance spéciale son premier documentaire, adapté du livre Atlas van een bezette stad. Amsterdam 1940-1945 écrit par sa femme, l’historienne Bianca Stigter. L’ouvrage se penche sur la Seconde Guerre mondiale à Amsterdam, auscultant comment ses marques et souvenirs conditionnent encore aujourd’hui la vie de ses habitants – dont fait partie Stigter. Ce n’est pas la première fois que le couple travaille ensemble : Stigter était la productrice associée de 12 Years a Slave (2014) et des Veuves (2018) réalisés
par McQueen
Club Zéro
de Jessica Hausner




Sélection officielle – Compétition





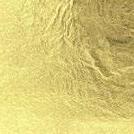





Après Little Joe, présenté en Compète en 2019, l’Autrichienne Jessica Hausner continue son ascension fulgurante avec un deuxième film en langue anglaise. L’Australo-Polonaise Mia Wasikowska y campe le rôle d’une enseignante dans un lycée privé qui lance un cours de nutrition avec un concept innovant, bousculant les habitudes alimentaires. Sans que cela éveille les soupçons des professeurs et des parents, certains élèves tombent sous son emprise et intègrent le cercle très fermé du mystérieux Club Zéro. Sidse Babett Knudsen, Amir El-Masry, Elsa Zylberstein et Mathieu Demy complètent le casting de ce thriller psychologique que l’on devine vénéneux et délicieusement formaliste.
Retransmission en direct de la cérémonie d’ouverture du 76e Festival de Cannes, le 16 mai au mk2 Odéon (côté St Germain), au mk2 Nation et au mk2 Bibliothèque à 19 h, suivie de la projection du film d’ouverture du Festival, Jeanne du Barry de Maïwenn, à 20 h
To read the english version of this article, scan this QR Code :

8 mars 18 juin 2023

NÉO- ROMANTIQUES
Un moment oublié de l’art moderne
1926-1972

mai 2023 – no 197
© Raleigh, North Carolina Museum of Art
76e Festival de Cannes < Cinéma 37
La 76e édition en chiffres
5 cinéastes en Compétition officielle ont déjà reçu au moins une fois la Palme d’or : Nuri Bilge Ceylan, Hirokazu Kore-eda, Ken Loach, Nanni Moretti et Wim Wenders. Du lourd, donc.




7 films réalisés par des femmes en Compétition officielle. La présence des réalisatrices s’élève à 33 % avec 7 films sur 21, quand la moyenne tourne depuis 10 ans autour des 16 %.
2 documentaires sont en Compétition officielle, Les Filles d’Olfa de Kaouther Ben Ania et Jeunesse de Wang Bing – il n’y avait pas eu de docu dans cette catégorie depuis 2004 avec Mondovino et Fahrenheit 9/11. Un hasard après le sacre de Toute la beauté et le sang versé de Laura Poitras à la Mostra de Venise et de Sur l’Adamant de Nicolas

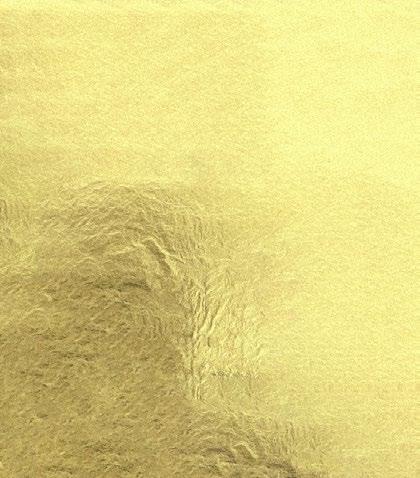
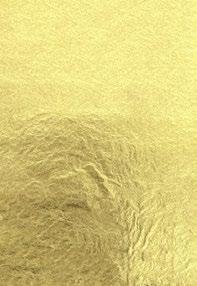

65 ans d’âge moyen pour les réalisateurs briguant la Palme, 52 ans pour les réalisatrices. Le collectif 50/50 note la corrélation entre la hausse de la représentativité féminine et le rajeunissement de la Compète.
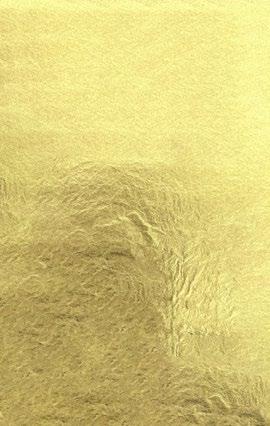
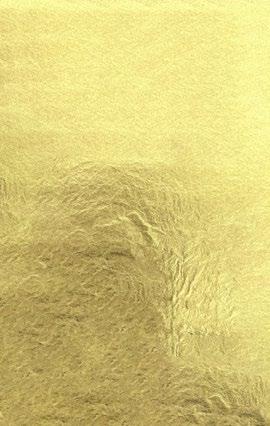
1 seul premier long métrage en Compétition, Banel & Adama de Ramata-Toulaye Sy, jeune cinéaste française d’origine sénégalaise diplômée de La Fémis en 2015, à l’origine du court métrage Astel (2021).
5 premiers films excitants
Banel & Adama
de Ramata-Toulaye Sy
Sélection officielle – Compétition
Cette jeune réalisatrice diplômée de La Fémis débarque directement en Compète avec son premier long sur un tout jeune couple mis à rude épreuve par les conventions de son village sénégalais.
How to Have Sex
de Molly Manning Walker




Un certain regard

Trois amies en vacances à Majorque s’adonnent à un rite de passage typiquement britannique : perdre leur virginité dans des fêtes orgiaques. On tient peut-être Spring Breakers anglais.
Tiger Stripes
d’Amanda Nell Eu
Semaine de la critique
Une semaine de révolte
On compte bien braquer notre longue-vue sur la dé fricheuse Semaine de la critique, avec ses premiers et seconds longs métrages en compétition. Sa déléguée générale, Ava Cahen (qui l’an dernier a révélé les pépites de Charlotte Wells et About Kim Sohee de July Jung), nous a teasé un cru plein de luttes. « Levante de Lillah Halla est un film queer et contemporain qui oppose au conservatisme qui ronge la société brésilienne une vision sororale et rassembleuse. La Jordanie fait son entrée à la Semaine avec Inshallah a Boy d’Amjad Al Rasheed, portrait d’une femme active veuve qui lutte pour ses droits dans une société patriarcale qui lui impose surtout des devoirs. » Les films de genre d’Amanda Nell Eu et Sleep de Jason Yu parlent respec tivement de rébellion adolescente en Malaisie ( movie fantastique, quelque part entre Ducournau et Tropical Malady d’Apichatpong Weerase thakul ») et de remise en question du modèle familial en Corée du Sud (« une comédie dramatique horrifique sur le couple, avant et après arrivée du premier enfant, dans la veine du cinéma de Bong Joon-ho. ») Bonne nouvelle : les sept films en compète ont un distributeur et seront donc projetés en salles en France. • Timé Zoppé
Un festival de mauvais esprits, voilà ce qu’on veut. Et c’est ce que semblent proposer quelques courts auxquels on sera très attentifs. D’abord, Julia Kowalski, qu’on avait découverte avec son coming-of-age ténébreux Crache-Cœur en 2015, nous revient avec J’ai vu le visage du diable (Quinzaine des cinéastes), film d’exorcisme dont l’action se situe en Pologne, produit par Yann Gonzalez, qui promet déjà de nous posséder. Autre film-rituel très attendu, Boléro (Semaine de la critique) de Nans Laborde-Jourdàa (dont on avait adoré Léo la nuit), dans lequel le retour d’un danseur dans ses Pyrénées natales va se muer en immense procession. Quant à Mathilde Chavanne, avec Pleure pas Gabriel (Semaine de la critique) – au sujet de la peine d’un jeune homme –, elle nous propose le retour de Dimitri Doré, dont l’interprétation d’un ado meurtrier dans nous hante encore. En plus de la tristesse, nous délivrera-t-elle du mal ? • Quentin Grosset


Dans la Malaisie rurale, une ado voit son corps muer de façon inquiétante (en tigre, comme le suggère le titre ?), alors qu’une crise d’hystérie collective frappe les collégiennes… Grrr !!!
Le Ravissement
Kaltenbäck
Semaine de la critique
On est ravis de retrouver Hafsia Herzi, ici dans la peau d’une sagefemme débordée qui s’occupe de l’enfant de sa meilleure amie, jusqu’à s’enfoncer dans un mensonge inextricable.
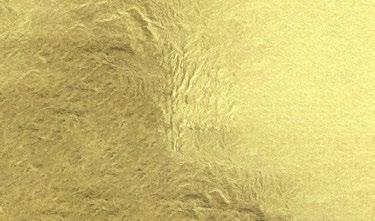
Vincent doit mourir
de Stephan Castang
Semaine de la critique
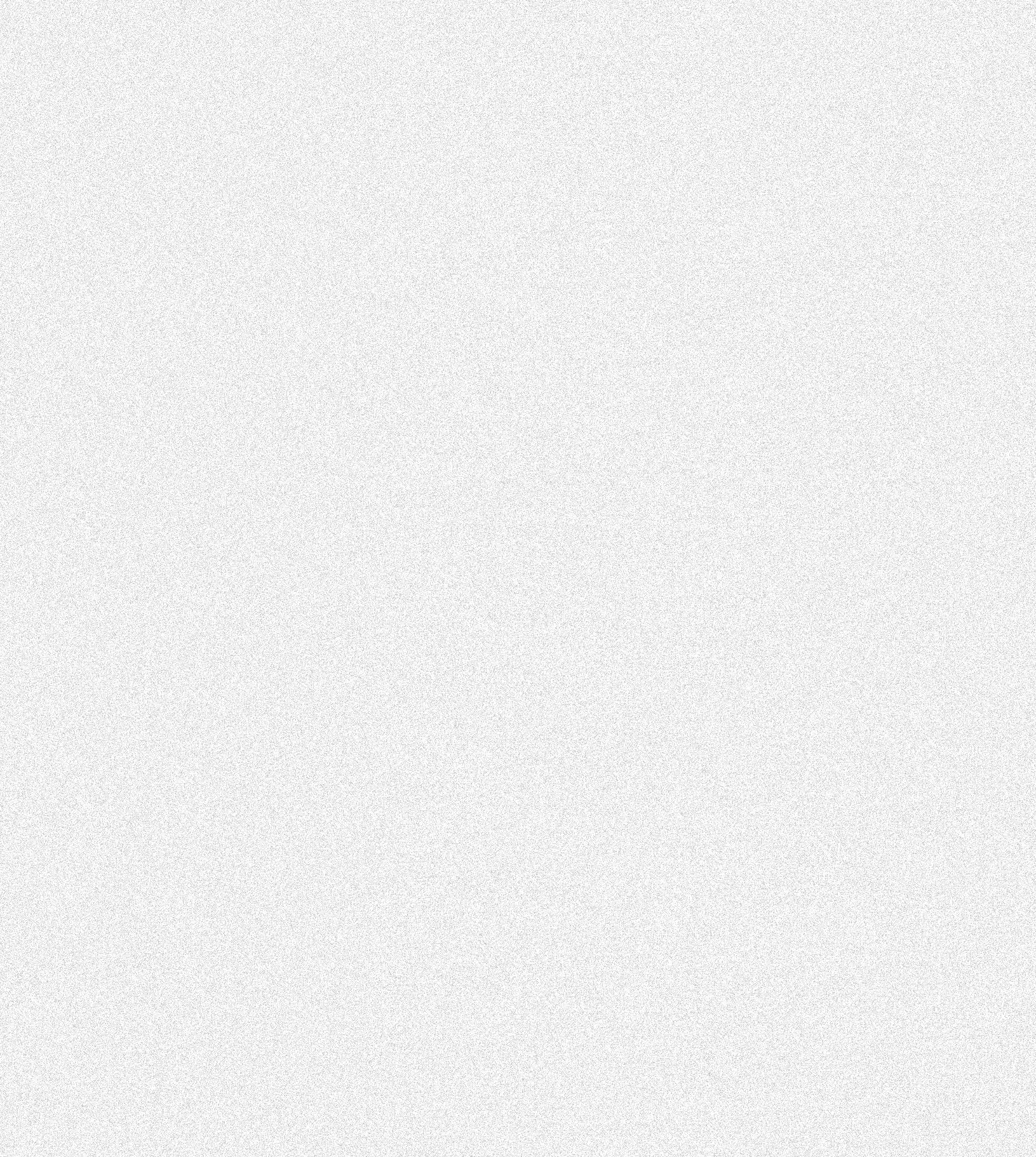
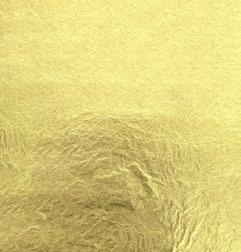
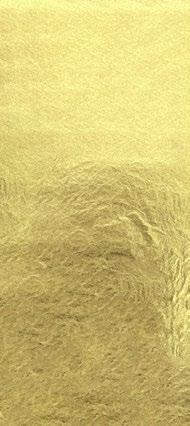
Notre chouchou Karim Leklou, poursuivi par des inconnus qui veulent le tuer sans raison ?
On s’insurge, mais on a hâte de découvrir ce que cache ce pitch mystérieux et parano.
5
7
65
2
© Les Films du Losange
d’Iris
Gros plan sur…
Courts métrages
Un festival possédé
38 Cinéma > 76e Festival de Cannes no 197 – mai 2023
Change ton feed
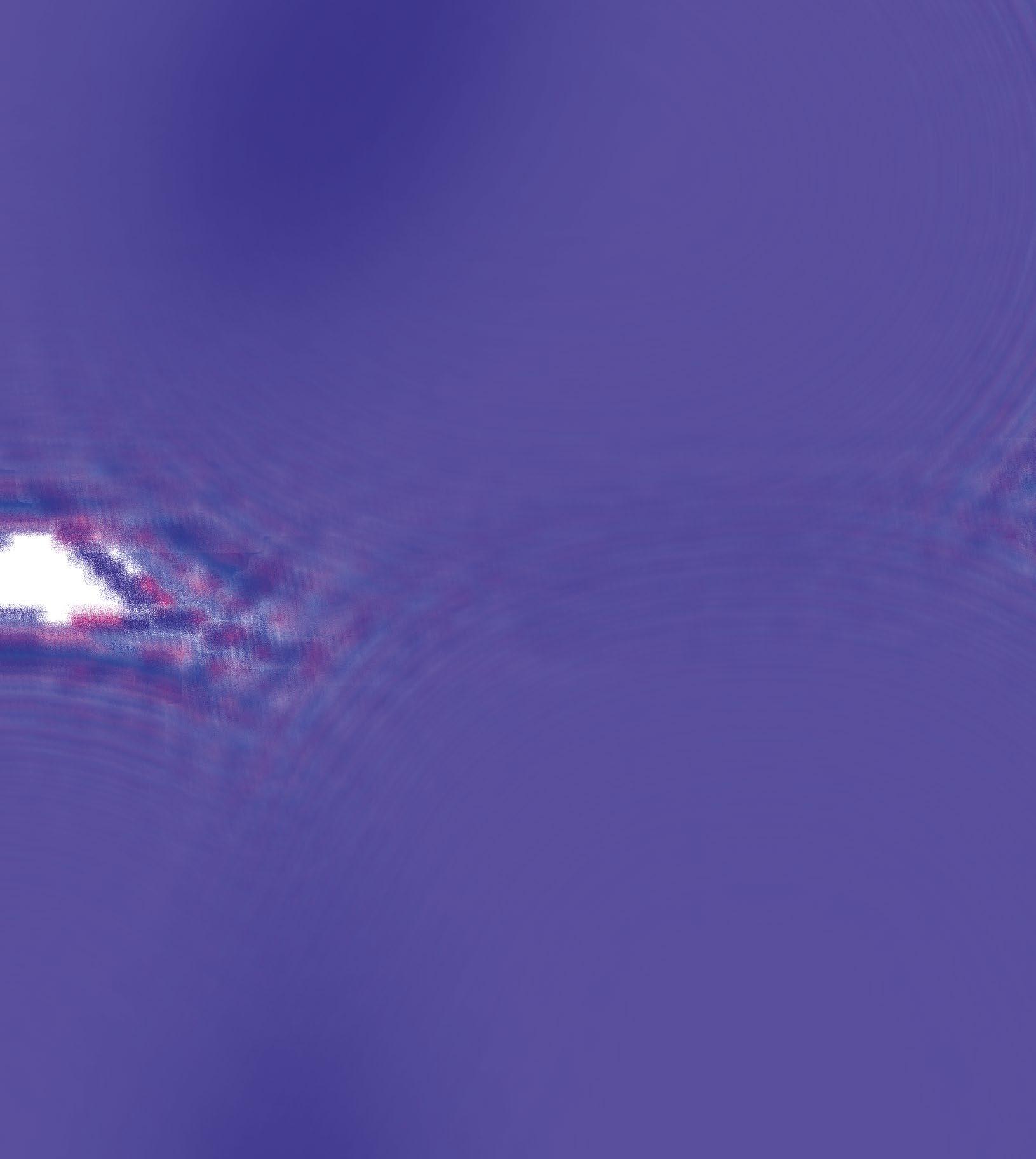
Enfin une app vidéo avec un algo qui vous veut du bien


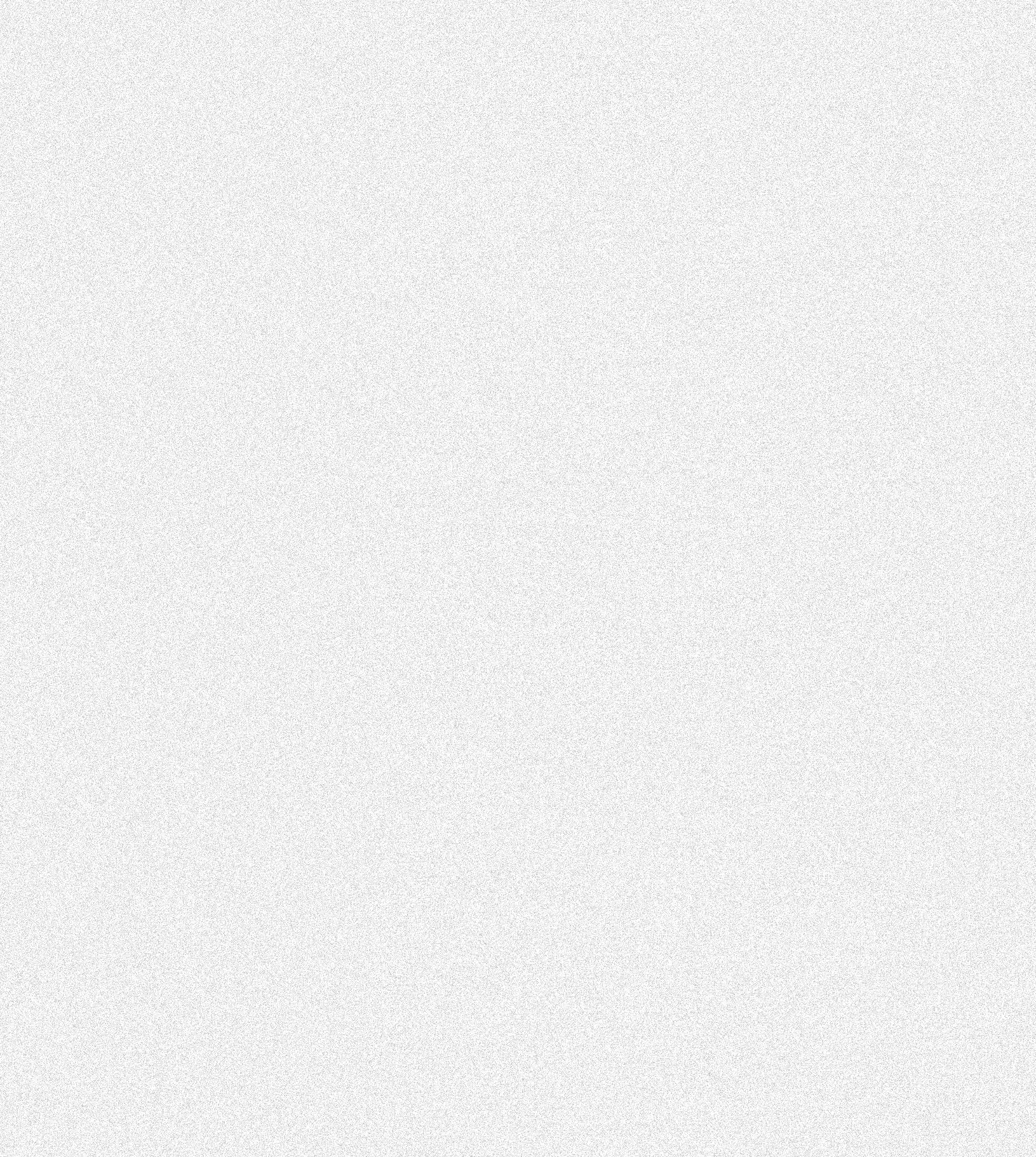
ENFANT DE LA SALLE
JULIEN REJL

Fraîchement nommé à la tête de la Quinzaine des cinéastes, l’une des sections parallèles du Festival de Cannes, créée en 1969, il a fait ses griffes pendant plus de dix ans dans la société de production et maison d’édition Capricci, où il était chargé de la distribution et des acquisitions – il a accompagné Hong Sangsoo, Albert Serra ou JeanCharles Hue. Ce sens du défrichage éclaire les vingt longs métrages qu’il a choisi de montrer cette année. Rencontre.
Il paraît que vous et votre comité avez visionné près de quatre mille films. Pas trop fatigués par ces sessions intensives ? Si, bien sûr. C’est un marathon passionnant, mais épuisant.
Dans les thèmes et les points de vue choisis, les genres abordés, qu’est-ce qui ressort de saillant ?
On a été très surpris de voir que plusieurs films embrassent la religion. Surtout, c’était assez étonnant de voir des hommes parler d’une virilité qui ne va plus de soi. Agra de l’Indien Kanu Behl donne l’image d’une société patriarcale pourrie. Le Pakistanais Zarrar Kahn montre dans In Flames les effets sur un homme d’une forme de figure surmoïque qui l’encombre dans sa vie sexuelle, sous forme de phénomènes hallucinatoires.
La Quinzaine a été créée dans la foulée de Mai 68, dans un élan progressiste, encouragé par une partie de la Nouvelle Vague. Cette édition 2023, qui prend place dans un contexte social explosif, va-t-elle préserver cet ADN ?
La Quinzaine appartient à la SRF [la Société des réalisateurs de films, créée en 1968,
ndlr], une association politique de cinéastes qui milite pour différents combats, notamment au sein de l’industrie cinématographique. Elle a été créée en 1969, et PierreHenri Deleau en a été le premier délégué général pendant une trentaine d’années. Il était politique dans sa manière de sélectionner. Il y a eu une ouverture, non seulement à des territoires jusque-là peu représentés, mais surtout dans la façon de prospecter. Je me reconnais totalement dans cette volonté de rompre avec un discours dominant, de privilégier ce qui passe par la mise en scène, ce qui explose les codes. En choisissant six premiers longs, quatre deuxièmes longs – donc plus de la moitié de la sélection –, on fait entrer un cinéma qui jusque-là était passé sous les radars.
On retrouve tout de même Hong Sangsoo, Manoel de Oliveira, Michel Gondry… Qu’est-ce qui vous a poussé à sélectionner leurs films et au contraire à écarter d’autres habitués ?
Je m’inscris dans un contexte : un festival qui a un certain nombre d’années, et qui privilégie le casting de films qui ont besoin d’un écho. Mais parmi les cinéastes
confirmés, je me suis positionné sur les films que je trouvais réussis. Ceux que j’aimais moins, je ne voulais pas les mettre en valeur de manière démesurée. J’ai pris des films auxquels je croyais. On a Hong Sang-soo [qui présente en clôture In Our Day, ndlr], qui fait du cinéma dans son coin avec trois francs six sous, et qui pourtant arrive à sortir quelque chose de poétique. Il y a Michel Gondry, qui dans Le Livre des solutions pose la question de trouver sa place dans le monde contemporain. Ce sont des gestes libres, audacieux, qui n’ont en plus pas la prétention de vouloir faire « grand-œuvre ».
La Quinzaine des réalisateurs devient cette année la Quinzaine des cinéastes. Qu’est-ce qui a motivé ce changement de nom ?
C’est la SRF qui a pris cette décision quand je suis arrivé, mais ça correspondait au projet que j’avais. Cette idée est je pense venue d’un désir d’inclusivité, ce qui rejoint ma politique d’absence de quotas : je considère tout cinéaste comme un individu avec son langage propre. Les quotas, c’est une façon très américaine de voir les choses. Ça veut
40 no 197 – mai 2023
Cinéma > 76e Festival de Cannes
« Je me reconnais totalement dans cette volonté de rompre avec un discours dominant. »
1 2
Mambar Pierrette de Rosine Mbakam © D. R. The Feeling That the Time for Doing Something Has Passed de Joanna Arnow © D. R.
dire qu’on ne considère pas les œuvres pour ce qu’elles sont.
Mais on ne peut pas ignorer que, toutes sélections cannoises confondues, il y a une grande majorité d’hommes derrière la caméra. Comment expliquez-vous ce blocage ?
Cette année, à la Quinzaine, nous comptons cinq longs métrages réalisés par des femmes, contre quatorze réalisés par des hommes et un coréalisé par une femme et un homme. La proportion de femmes est un peu plus élevée pour les courts, avec quatre films réalisés par une femme, contre six par des hommes. On peut donc s’attendre à ce que la courbe s’inverse. Car si ça commence à bouger dans le court métrage, ça veut dire qu’il est possible qu’à l’avenir ça augmente aussi dans le long métrage. Maintenant, sur ce blocage, en discutant avec des membres de mon comité de sélection qui sont très impliqués sur cette question de parité, on s’est dit que les cinéastes femmes se disent peutêtre qu’elles ont moins de chance. C’est une hypothèse parmi d’autres. Et, si c’est ça, j’espère que nos choix – dont celui de présenter plusieurs premiers films réalisés par des femmes [ The Feeling That the Time for Doing Something Has Passed de l’Américaine Joanna Arnow, Blackbird Blackbird Blackberry de la Géorgienne Elene Naveriani ou Mambar Pierrette de la Belgo-Camerounaise Rosine Mbakam, ndlr] –, mais aussi les sujets que les films abordent, enverront un signal fort pour que plus personne ne s’autocensure.

Votre comité joue le jeu de la parité. Il y a même un peu plus de femmes que d’hommes, quatre contre trois. Pour le coup, la question de la parité était ici un véritable enjeu, parce que si je considère qu’il ne faut pas de quotas
dans les films sélectionnés, je pense en revanche que c’est la multiplicité des regards dans un comité qui crée une diversité dans la sélection. Il me semblait important d’équilibrer. J’ai aussi fait en sorte qu’il y ait des métiers différents représentés : d’anciens programmateurs de festivals, des critiques, des gens qui travaillent en salles… Le fait de voir les films à un endroit différent de la chaîne a suscité des discussions pas forcément faciles, mais c’est ce que je recherchais.
Vous avez changé les règles d’éligibilité. Comment, concrètement ?

L’idée, c’est de dire qu’un long métrage – surtout français – est éligible à condition qu’il s’inscrive dans la chronologie des médias [une règle qui autorise la diffusion des films après leur exploitation dans les salles, ndlr]. Ce qu’on défend avant tout, c’est le film en salles. On demande que même les films sans distributeur recherchent un partenaire à l’issue du Festival. Évidemment, je ne vais pas contrôler, mais j’ai envie d’envoyer le signal que la Quinzaine n’est pas juste une vitrine. L’idée, c’est qu’on donne la possibilité de rencontrer des professionnels pour que les films puissent ensuite être montrés en salles.




Vous êtes sorti diplômé du département « exploitation » de La Fémis en 2009, puis vous avez été chargé de la distribution et de l’acquisition chez Capricci. Être Délégué général de la Quinzaine vous permet-il de défendre la salle ?

Bien sûr. Je suis un enfant de la salle. Je n’écarte pas d’autres possibilités de découvrir un film, mais il y a un vrai enjeu à ce que la question de la découverte collective des films et du débat soit maintenue. Et puis, avec la crise récente, l’exploitation a beaucoup souffert. Il y a eu un recul de la fréquentation, en même temps qu’une polarisation sur certains
titres. Ça pose un défi : celui de redonner à la Quinzaine un vrai label.

On sait peu de choses sur vous. Où et dans quel milieu avez-vous grandi ? Je suis né au début des années 1980, dans une banlieue pavillonnaire du nord de la France, entre Hénin-Beaumont et Douai. Je viens d’un milieu ouvrier très populaire, dans une famille pas vraiment cinéphile, si ce n’est mon père qui regardait des westerns, notamment ceux de John Ford. Là où on vivait, il n’y avait quasiment pas de cinéma art et essai. Les multiplexes sont arrivés à la fin des années 1990, et il y avait un vidéo-club près de chez moi. J’ai découvert grâce à ça le cinéma de genre américain des années 1980-1990. Et j’ai lu très tôt de la critique. Mais, quand je suis arrivé à Paris en 2002 après une prépa, je suis parti faire, pour des raisons sans doute liées à ma condition sociale d’origine, une grande école de commerce, ce qui était pour moi l’enfer. En parallèle, j’ai fait des études de philo, et j’ai découvert la psychanalyse. J’ai commencé à travailler dans d’autres secteurs, parce que je n’avais pas un rond. J’ai appris l’existence d’un concours à La Fémis pour être distributeur-exploitant, alors que je n’avais jamais eu la velléité de devenir l’un ou l’autre. Je l’ai eu, et à partir de là j’ai saisi les opportunités qui se sont présentées.
En dehors de la Quinzaine, vous supervisez un projet d’intégrale des films de Chantal Akerman, dont le chef-d’œuvre
Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles a été élu meilleur film de tous les temps par la revue Sight and Sound. En quoi est-elle une cinéaste emblématique de la Quinzaine ?
Jeanne Dielman… a été découvert à la Quinzaine, tout comme Golden Eighties [comédie musicale d’Akerman, sortie en 1986, ndlr] et d’autres. Chantal Akerman est pour moi une cinéaste fondamentalement « Quinzaine » parce que c’est l’une des plus grandes cinéastes du cinéma moderne tel que l’ont articulé en premier chef Jean-Luc Godard et Jean-Marie Straub.
Quels sont les grands chantiers qui s’annoncent pour la Quinzaine ces prochaines années ?
Il y a le défi du nombre de films qui nous arrivent. Il va falloir trouver des solutions. Et ma grande ambition, c’est de présenter dans le monde entier ma sélection. Montrer que la Quinzaine est une famille de cinéastes cinéphiles où chacun peut présenter des œuvres singulières, en dehors de toute considération liée au marché.
Un mot pour qualifier cette édition 2023 ?

Ce que j’aimerais, c’est qu’on arrête de dire que c’est une sélection radicale. Pour moi, ce sont des films généreux, libres, poétiques.
Photographie : Julien Liénard pour TROISCOULEURS
41 mai 2023 – no 197 Pays invité, la Belgique Thème, le climat 2 - 4 JUIN 2023 hors cinéma et alentours CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU
76e Festival de Cannes < Cinéma
PROPOS RECUEILLIS PAR JOSEPHINE LEROY
1 2
ESPRIT DE CORPS
GARANCE MARILLIER
On l’a découverte en jeune cannibale dans Grave de Julia Ducournau, en 2017, alors qu’elle n’avait que 18 ans. Depuis, l’actrice a soigneusement évité l’omniprésence, préférant des apparitions rares mais singulières. Dans Marinette, biopic de la footballeuse Marinette Pichon, elle s’attaque pour la première fois au cinéma grand public. Mais garde la même façon physique de se jeter à corps perdu dans un rôle.
La veille, malade, elle nous a fait faux bond. « Je ne savais pas que cela existait encore, les intoxications alimentaires », dit-elle en s’excusant, le jour J. Être trahie par son corps ne doit pas arriver si souvent à Garance Marillier, qui en a fait son outil de travail. Comme toutes les actrices, serait-on tenté de penser. Mais, chez elle, c’est un peu plus que cela. Le jeu passe par les tripes avant le cerveau. « Ce qui m’intéresse, c’est comment on transforme le corps. Que ce soit pour incarner un personnage d’époque, ou pour Marinette, où j’ai dû faire de la muscu pendant six mois. » Dans ce biopic réalisé par Virginie Verrier (lire p. 16), la comédienne incarne Marinette Pichon, première star féminine du football français et la meilleure buteuse des Bleues jusqu’en 2020. Une fille d’ouvrier, sauvée de son père violent par l’abnégation de sa mère et par l’amour du ballon rond. Garance Marillier n’est pas fille d’ouvrier mais, lorsqu’elle ne mouille pas le maillot devant la caméra, elle transpire en short et en crampons avec son équipe féminine, le Gadji FC. Cela ne l’a pas dispensée d’un entraînement « hyper intense ». Payant, puisque la comédienne n’a eu aucune doublure. Reste que, le premier jour du tournage, quand elle s’est « retrouvée avec cent cinquante figurantes que Virginie était allée
chercher en première division féminine », elle a eu l’impression d’être « une imposture ». « Il n’y avait aucun répit. J’avais rendez-vous à 7 heures du matin pour m’échauffer avant de faire et refaire les scènes. Quand on prenait une semaine de repos, en réalité on tournait des scènes familiales très compliquées. C’était toujours intense, soit physiquement, soit émotionnellement. J’ai travaillé dur. »
EN ATTAQUE
C’est une constante chez elle. Garance Marillier comprend que c’est indispensable à 12 ans, sur son premier tournage. Sa mère tombe sur une annonce pour caster un garçon manqué avec de la repartie, et pense immédiatement à sa fille. L’adolescente « en jogging et en gros sweat » se retrouve face à une femme de près de deux mètres, « super belle », qui lui demande d’improviser un clash de cour d’école. « Elle m’attaquait sur mon physique. Je n’avais aucun recul, je prenais tout pour moi. Au deuxième rendez-vous, je lui demande où est la réalisatrice. Et là elle se tape des barres. » La géante magnifique, c’est Julia Ducournau. La cinéaste veut raconter l’histoire d’une petite fille qui devient
femme en se débarrassant littéralement de sa peau d’enfant. Ce court métrage, Junior, est déjà, dix ans avant son Titane palmé d’or à Cannes, une histoire de monstre qui se révèle. Ducournau a beau protéger son actrice débutante, Marillier garde un souvenir éprouvant du tournage. « J’ai tout fait à l’instinct. Pour une scène, j’avais une sorte de transe dans des toilettes. J’ai mis toute une nuit à me sortir de ça, j’avais des spasmes. J’ai compris que je ne pouvais pas continuer comme ça. Si je veux jouer des choses fortes qui me transcendent, il faut que je puisse me sortir de cet état quand on coupe la caméra. J’ai décidé de prendre des cours de théâtre. » Sans surprise, la method acting façon Actors Studio, avec des acteurs qui restent dans leur personnage pendant des mois, « c’est pas [s]on délire ». Pour Marillier, la technique permet de s’apprivoiser sans se brider. « Justement, on peut être sereine et explorer plus de choses parce qu’on sait qu’on maîtrise, explique cette grande admiratrice d’Isabelle Huppert. Il y a toujours des fois où des émotions inimaginables nous submergent. Mais je sais où je vais, ça ne part pas dans tous les sens. » Julia Ducournau, qui la dirige une deuxième fois en 2012 dans le téléfilm Mange, la prévient d’ailleurs avant de

42 no 197 – mai 2023
Cinéma > Portrait
« J’ai toujours pris cher physiquement sur les tournages. »
lui proposer le rôle principal de Grave : « Tu ne me refais pas le truc des toilettes. » Pour incarner Justine, étudiante vétérinaire végétarienne qui prend goût à la chair humaine après avoir mangé de la viande, il lui faut façonner ce corps frêle. Lui donner une allure adolescente au début, plus féminine à la fin. Dans le film, il sera malmené, gratté jusqu’au sang, frappé, mordu. Garance Marillier s’en amuse presque. « J’ai toujours pris cher physiquement sur les tournages. Je n’ai jamais le blues à la fin, parce que j’ai seulement envie de dormir trois mois non-stop. » Impossible avec Grave, sorti en 2017, alors qu’elle prépare le bac. Le film connaît un succès mondial, et il faut cumuler la promotion et les études. La dernière ligne droite d’une scolarité parfois douloureuse pour cette hyperactive qui sait déjà qu’elle veut se consacrer au cinéma.
DÉFI SUR DÉFI
Il faudra attendre deux ans pour la revoir. Dans Pompéi d’Anna Falguères et John Shank, elle fait tourner la tête d’Aliocha Schneider quasiment sans parler, juste en étant là, brindille en jean baskets aux grands yeux noirs. Puis encore deux ans avant de la retrouver en prostituée dans Madame Claude de Sylvie Verheyde. Ce corps, auquel Garance Marillier « en demande tellement », se prête à un nouvel exercice : revêtir un porte-jarretelles et danser lascivement. « Cela me mettait face à quelque chose qui me faisait peur. Mais c’est pour ça que je fais ce métier, pour ce moment où tu sors de ta zone d’intimité. » Grave lui a ouvert les portes des États-Unis, où elle a joué dans Warning d’Agata Alexander, un film de science-fiction inédit en France. Marinette Pichon, première footballeuse française à faire carrière outre-Atlantique, a découvert en 2002 l’exigence des entraînements au sein de l’équipe de Philadelphie. Près de vingt ans plus tard, Garance Marillier a connu la même chose en tant qu’actrice. « Ce n’est pas la même musique, pas le même rythme. Tu as l’impression de réapprendre à marcher. » À 25 ans, Marinette est son premier projet grand public. Même si un biopic sur une footballeuse lesbienne n’a pas été facile à financer. « Ça aurait été plus simple de faire un biopic sur Zidane. » Même pour elle. « Les femmes dans le foot sont invisibilisées, il y a peu de matière à partir de laquelle construire un personnage. » Parmi ses prochains défis, refaire du théâtre, encore quelque chose qui lui « faisait peur », jusqu’à ce qu’elle foule les planches pour la première fois, en janvier dernier, dans une adaptation de l’essai Sorcières de Mona Chollet. Et faire évoluer le Gadji FC. Mais pas question d’augmenter à tout prix la cadence des tournages. « Je veux choisir mes rôles pour de bonnes raisons. Défendre des personnages et des récits différents. » Et, bien sûr, « muscler [s]on jeu ».

43 mai 2023 – no 197
MARGAUX BARALON
Portrait < Cinéma
Marinette de Virginie Verrier, The Jokers / Les Bookmakers (1 h 35), sortie le 7 juin
Photographie : Paloma Pineda pour TROISCOULEURS
EN CHŒURS
AGNÈS JAOUI
Toujours aussi subtile et sensible, l’actrice, scénariste, metteuse en scène et cinéaste semble se livrer à un vertigineux exercice d’autofiction dans Le Cours de la vie de Frédéric Sojcher où elle incarne une scénariste reconnue qui vient donner une master class dans une école de cinéma. Devant et derrière le pupitre, tout semble résonner avec le parcours d’Agnès Jaoui. Ce qui nous a donné envie de creuser la manière dont cette grande figure du cinéma français s’est construite.

Qu’est-ce qui vous a plu à la lecture du scénario du Cours de la vie ?
Ce qui m’a frappée, c’est que c’est un film qui ne ressemble à aucun autre. Il y a une

mise en valeur du travail d’écriture et de la tradition du cinéma français qu’on met assez peu en avant depuis la Nouvelle Vague. J’aime la manière dont mon personnage raconte une histoire, et comment celle-ci finit par en raconter une autre.

Tout un dispositif est mis en place pour la master class de Noémie, votre personnage : plusieurs caméras cernent son visage, ses émotions. Comment avez-vous vécu le tournage de ces séquences de mise à nu, qui prennent aussi la forme d’une mise en abyme ?
La première fois, ça m’a semblé bizarre. D’autant plus que je devais dire des tonnes de textes devant des gens que je ne connaissais pas. Mais finalement, comme je fais du théâtre et du chant, ça s’est bien passé. Il y avait de vrais étudiants de l’ENSAV [l’École nationale supérieure d’audiovisuel, à Toulouse, ndlr] et des acteurs professionnels. Tous m’ont gentiment dit qu’ils avaient appris des choses pendant ces séances. J’étais comme entourée de bienveillance.
Pour vous avoir vue donner une vraie master class il y a quelques années à Paris, j’ai l’impression que cet exercice de transmission vous plaît beaucoup. Est-ce le cas ?
Oui, c’est vrai que j’aime bien ça. Après, je ne pourrais pas faire ça tout le temps. Parler en permanence de soi, c’est un peu
épuisant ! Mais j’aime bien parler à des plus jeunes, essayer de transmettre. Et puis j’aime aussi discuter avec des gens qui travaillent le scénario. Ça fait du bien d’avoir un dialogue avec des personnes qui parlent la même langue que vous. C’est un travail assez solitaire que d’être scénariste et, quand on se retrouve à plusieurs pour en parler – chose qui est assez rare –, c’est toujours super instructif.
Gilles Deleuze, Paul Schrader… Noémie cite aux élèves plusieurs grands auteurs, philosophes ou scénaristes. Y a-t-il des lectures qui ont changé des choses dans votre manière d’écrire ?
Je me réfère très peu à la théorie. Je vais éventuellement penser à ce que je connais le mieux, comme les premiers films de Woody Allen. Avec Jean-Pierre Bacri [disparu en 2021, il a été son compagnon de 1987 à 2012, et ils ont longtemps formé un tandem indissociable à l’écriture et à la mise en scène de pièces de théâtre et de films, ndlr], à force d’observer des scènes, on a essayé de recréer quelque chose de cet ordre-là. Souvent on aimait bien, comme Woody Allen, faire en sorte que dans la première scène il y ait l’enjeu de tout ce qui va se passer après. Je pense à La Rose pourpre du Caire [sortie en 1985, cette comédie fantastique se déroule dans les années 1930 et raconte l’histoire d’une femme malheureuse
en ménage qui, alors qu’elle est au cinéma, se fait entraîner par le héros du film hors de l’écran, où elle vit des aventures extraordinaires, ndlr]. Il y a la première scène, où Mia Farrow est fascinée par l’affiche d’un film qui va sortir. Elle est folle de bonheur. Mais, d’un coup, une lettre se décroche du fronton de la salle de cinéma, et elle manque de se la prendre sur la tête.
Dans Le Cours de la vie, il y a un effet miroir entre votre personnage, qui fait face à son passé – le directeur de l’école, incarné par Jonathan Zaccaï, est son ex – et Agathe, une élève en train de déterminer son futur en même temps qu’elle expérimente le triangle amoureux. Quels points communs la jeune Agnès Jaoui aurait-elle pu avoir avec Agathe ?

(Elle réfléchit un moment.) Ses doutes, son envie de vivre intensément l’amour – ou les amours possibles.
Revenons à votre histoire. Vos parents, Juifs d’origine tunisienne qui se sont installés en France après l’indépendance en 1956, ont fait entre-temps un crochet en Israël, où ils ont vécu dans un kibboutz, une exploitation agricole collective. Vous y avez passé plusieurs étés. Quelles traces en avez-vous gardées ?
Ça m’a évidemment marquée, car mes vacances ne ressemblaient pas à celles des
44 no 197 – mai 2023
Cinéma > L’interview transmission
© Tabo Tabo Films / Sombrero Films
© Tabo Tabo Films / Sombrero Films
© Ad Vitam
autres. En même temps, j’ai surtout le souvenir d’avoir passé beaucoup de temps avec mon frère [Laurent Jaoui, également scénariste et réalisateur, ndlr], puisqu’on était les deux seuls à parler français. Les parents nous laissaient et faisaient leur vie. J’ai un souvenir extrêmement fort de nature, de soleil et d’aiguilles de pin.
Le kibboutz, c’est aussi le lieu d’une utopie collective, en même temps que l’expérience concrète de la vie en communauté. Dans votre œuvre, il y a quelque chose de très choral. D’après vous, c’est lié ?
Le kibboutz, c’était différent de ce qu’on pouvait vivre à Paris. J’ai des souvenirs assez curieux : on était tous habillés un peu pareil, on avait des shorts bleus… [Elle réfléchit, ndlr]. C’est marrant, peut-être qu’effectivement, d’une certaine manière, ça m’a donné un sens du collectif. Je vais y réfléchir !
Qu’est-ce que vos parents vous ont transmis de plus fort ?

L’idée que tout était possible, que je pourrais faire tout ce que je voudrais [à 15 ans, Agnès Jaoui a été l’une des premières filles à intégrer le prestigieux lycée Henri-IV à Paris, devenu mixte en 1978, ndlr]. Je pense que ça tient de leur personnalité, mais aussi aux années 1970 : à l’époque, on avait l’impression qu’il y avait une grande liberté. On disait : « Plus jamais la guerre, plus jamais le racisme, plus jamais l’antisémitisme. » Ça me semblait possible – peut-être parce que j’étais une enfant, c’est très probable [elle est née en 1964, ndlr]. Cette époque marquait aussi pour moi la découverte de la psychothérapie [sa mère, Gyza Jaoui, était psychothérapeute, spécialiste de l’analyse transactionnelle, qui promeut les thérapies de groupe, ndlr], des groupes de parole, du collectif… C’était une époque joyeuse et insouciante, il y avait le plein-emploi, mes parents vivaient plein d’expériences – libération sexuelle, libération de la parole, de la femme… C’était une sorte de parenthèse enchantée, qui a été le titre d’un film d’ailleurs [de Michel Spinosa, sorti en 2000, qui raconte cette période en imaginant la rencontre de cinq jeunes gens sur la Côte d’Azur, en 1969, ndlr].
Ça s’est manifesté comment, dans leur éducation ?
Indépendamment du contexte général, mes parents comme individus avaient un amour de la vie, que j’ai senti très fort. Ça paraît bête, mais il y a vachement de parents qui ne disent pas à leur enfant qu’ils les aiment. L’amour compte énormément. C’est quelque chose qui à mon avis n’est pas très français. Même dans l’Éducation nationale, on dit toujours aux élèves : « peut mieux faire » ; « c’est pas assez ». Pfff… Je trouve que c’est un principe d’éducation assez con.
Vous êtes entrée en 1984 à l’école du Théâtre des Amandiers, cofondée par Patrice Chéreau et Pierre Romans, qui vient de refaire parler d’elle avec le film autobiographique Les Amandiers de Valeria Bruni Tedechi, sorti en novembre dernier et qui en brosse un portrait à la fois passionné et rude, brutal. Vous en gardez un souvenir similaire ?
Ça a été un souvenir plutôt affreux, douloureux en tout cas. On ne pouvait pas
45 mai 2023 – no 197 AU CINÉMA LE 14 JUIN L’interview transmission < Cinéma
être libres, ni indépendants. On était liés à la pensée d’un seul être [Patrice Chéreau, ndlr]. Je n’ai pas été aimée, et je pense que c’est compliqué d’aimer quelqu’un qui vous déteste. Après, les gens en ont un souvenir différent… Mais c’est vrai qu’il y avait aussi beaucoup de drogue qui circulait à cette époque ; et puis, évidemment, l’arrivée du sida, qui a rajouté quelque chose de très mortifère, et qu’on s’est tous pris dans la gueule, avec un sentiment de terreur que vous pouvez imaginer. Ce qui m’a libérée de cette expérience, c’est d’abord moi-même. Pourtant, Dieu sait que je n’étais pas fière, et que j’étais pleine de doutes. Et que j’étais prête à faire beaucoup de choses pour vivre de ce métier. Mais pas à être maltraitée. Et puis il y a eu, bien évidemment, la rencontre avec Jean-Pierre Bacri, quand on a fait la pièce de Jean-Michel Ribes [sa mise en scène de L’Anniversaire de Harold Pinter en 1987, ndlr], qui m’a beaucoup aidée.
Alain Resnais, qui vous surnommait les « Jabac » avec Jean-Pierre Bacri, est une autre figure importante dans votre parcours : vous avez écrit sa comédie Smoking / No Smoking, pour laquelle vous avez remporté le César du meilleur scénario original en 1994. Idem pour On connaît la chanson, quatre ans plus tard. Qu’est-ce que Resnais vous a apporté ?
C’est drôle que vous en parliez juste après les Amandiers. Il m’a appris, justement, qu’on pouvait être un grand homme de théâtre et de cinéma et en même temps un être délicieux, respectueux. C’était quelqu’un de très poli, aimable et aimant. Il m’a apporté quelque chose de très sécurisant. J’aimais sa manière de créer son univers, d’obtenir des autres tout ce qu’il voulait, mais avec la plus grande des gentillesses. Ma rencontre avec lui a été un moment béni.
L’amour, la gentillesse, la sécurité sont des mots qui reviennent beaucoup dans vos réponses. Est-ce qu’écrire ça a été une
manière de vous protéger de la violence autour de vous ?
Oui, ça m’a beaucoup consolée. C’est une aide très grande que de pouvoir consigner quelque part ce qui me pèse ou ce qui m’interroge.
Vous vous êtes souvent engagée pour la cause féministe. Vous faites d’ailleurs partie du collectif 50/50. En préparant l’entretien, on s’est souvenu d’un dialogue dans Cuisine et dépendances entre votre personnage et une autre femme à propos du slut-shaming vestimentaire, qui paraît très moderne aujourd’hui. Comment cette lutte s’est-elle ancrée en vous ?
Vous me faites un plaisir infini, parce que ça n’est pas forcément le sujet principal, mais je pense qu’effectivement il y a du féminisme dans Cuisine et dépendances [adaptation au cinéma, sortie en 1993 et signée Philippe Muyl, de la pièce de théâtre éponyme écrite par Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, ndlr], comme dans Un air de famille [adaptation au cinéma, sortie en 1996 et signée Cédric Klapisch, de la pièce éponyme d’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, ndlr]. Dans tous mes films, il y a du féminisme. Alors évidemment, pas avec une banderole, mais ça m’a toujours tenu à cœur. Et j’ai l’impression qu’il y a des tas de gens qui ne s’en sont pas rendu compte. Ça me touche que vous, jeune femme, l’ayez noté. D’abord, ma mère était une féministe des années 1970, qui a connu une époque sans pilule, où le patriarcat était très prononcé. Vers l’âge de 20-22 ans, j’ai lu beaucoup de livres féministes. S’il y a bien un endroit où le féminisme n’est pas mis en avant, c’est le milieu que j’ai choisi. Et jusqu’à il n’y a pas si longtemps, lorsque je parlais avec des jeunes de féminisme, on me regardait comme si c’était un vieux mot ringard des années 1970. Comme si aujourd’hui il n’y avait plus de problème. Garçons comme filles, ils étaient dans le déni de la persistance du patriarcat. Donc je suis quand même heureuse de voir qu’au-delà

de #MeToo il y a une véritable révolte qui remet en cause tout ça.
Vous sentez que quelque chose est en train de bouger dans la jeunesse ? La jeunesse s’est complètement rebellée, je le vois à travers le parcours de ma fille, qui a 20 ans. Je suis ravie de voir que les jeunes filles n’ont pas envie de se laisser faire. Mais mon féminisme a toujours été ouvert aux hommes. Je n’ai pas du tout envie d’opposer les hommes et les femmes, je pense que chacun a du féminin et du masculin en soi. Je suis dans l’idée qu’il faut réhabiliter le féminin, y compris pour les hommes – ils ont le droit, aussi, de s’occuper des enfants à la maison, et que ce soit bien vu. Je voudrais surtout que ce qui est associé au féminin soit rehaussé, revalorisé. J’aimerais que les hommes se rendent compte que, s’ils perdent des choses avec les privilèges – moi aussi j’aurais bien aimé rentrer à la maison et mettre les pieds sous la table, et que quelqu’un s’occupe des enfants –, ils en gagnent aussi avec le féminisme : le droit de pleurer, le droit d’être faible. Je trouve ça en tout cas hyper passionnant.
Dans l’émission belge HEP Taxi !, diffusée en mars, vous avez dit : « Je ne comprends pas pourquoi on la casse comme ça, notre jeunesse. » Qu’est-ce que vous vouliez dire ?
Il n’y a pas que la jeunesse que l’on casse. Vous allez sûrement trouver ça con mais, à
force de tout le temps répéter à quel point ça va mal ou ça va aller mal dans les médias, on en oublie toutes les belles choses qui se font à côté. Il faut qu’on soit un peu constructifs sur certaines choses, y compris sur des sujets comme la fin du monde, les catastrophes écologiques [Agnès Jaoui a fait partie des signataires de la retentissante tribune contre le réchauffement climatique intitulée « Le plus grand défi de l’histoire de l’humanité » publiée en 2018 dans les colonnes du Monde à la suite de la démission du ministre de l’écologie de l’époque, Nicolas Hulot, ndlr] ou l’immigration [en 2006, elle avait signé une pétition du Réseau éducation sans frontières, en défense des élèves sans-papiers, ndlr]. Il y a aussi des gens qui trouvent des solutions, des endroits où l’immigration se passe bien, la couche d’ozone qui s’est reconstituée… Ça me tue qu’on soit tout le temps en train de présenter le tableau le plus noir possible du monde. Après, on s’étonne que les jeunes, les gens en général, soient révoltés, alors qu’avec tout ce qu’on nous raconte ça semble juste normal. Et puis la jeunesse a été abandonnée pendant le Covid, le déconfinement a été difficile. Là aussi, je trouve qu’on a une responsabilité envers eux.
On parle beaucoup des hommes de votre vie. Quelles sont les femmes qui ont compté dans votre parcours ?
Ça a d’abord été Colette, Barbara, Jane Austen. Sont arrivées plus tard Carine Tar-



46 no 197 – mai 2023
Cinéma > L’interview transmission
« Je suis dans l’idée qu’il faut réhabiliter le féminin, y compris pour les hommes. »
© Henri Manuel
© D. R © D. R
© D. R.
LE 24 MAI AU CINÉMA

ÁLVARO MORTE DE LA CASA DE PAPEL
 © George Seguin
© George Seguin
MOTS-CROISÉS
« Je ne sais jamais trop où j’habite, mais, dans ce genre de moments, j’ai cette révélation : “Mais oui, en transit, c’est là que je dois vivre.” »
« J’aime beaucoup que Kelly [sa meilleure amie, ndlr] dise ça, et en l’écoutant j’aime penser à ses deux derniers longs métrages [First Cow, 2019, et Showing Up, 2022, ndlr]. J’ai fait découvrir Portland à Kelly quand j’y ai emménagé. Portland est devenu le sujet de ses films. Ce sentiment d’être en transit, c’est un thème fort de sa filmographie. Et puis il y a First Cow [le film raconte l’histoire de deux aventuriers en Oregon au début du xixe siècle, ndlr], qui parle de se construire un foyer. Kelly a réalisé ce film quand elle s’est installée à Portland. »
TODD HAYNES

Son nouveau film, May December, est en Compétition à Cannes au moment où le Centre Pompidou lui consacre une rétrospective intégrale.

Pionnier du New Queer Cinema, auteur de mélodrames post-modernes (Loin du paradis), de biopics musicaux détraqués (Velvet Goldmine, I’m Not There), de films d’amour tempétueux (Carol) et de films d’enquête ravageurs (Dark Waters), l’Américain Todd Haynes a toujours porté la contre-culture en étendard pour mieux la réinventer. On a soumis à cet artiste polymorphe des citations qui résonnent avec sa part la plus wild.
« Todd Haynes. Rétrospective intégrale » , du 10 au 29 mai au Centre Pompidou
•
May December de Todd Haynes (prochainement)
PROPOS RECUEILLIS PAR QUENTIN GROSSET
« Cette citation m’évoque la voix de Karen Carpenter [chanteuse américaine des années 1970 dans le groupe pop The Carpen ters, ndlr]. Avant même qu’on ne sache qui se cache derrière et quelle souffrance elle porte, elle semble d’une maturité étonnante. Quand je l’entends, je ne peux pas m’empêcher de penser à son corps, ce corps que Karen a cherché toute sa vie à contrôler, avec lequel elle était en lutte [elle souffrait d’anorexie, ce que raconte Todd Haynes dans son film sorti en 1987, Superstar. A Karen Carpenter Story, ndlr]. Je pense que cette sophistication, qu’on peut presque appeler sa prétention vocale – ce pour quoi elle a été critiquée à l’époque –, a entraîné des interrogations du style “que peut-elle savoir, elle, si jeune, de la souffrance ?” Plus tard, tout le monde a su qu’elle en savait bien quelque chose. D’une certaine manière, mon film Superstar a généré des questionnements similaires : “quelle est la sincérité de ce film ?” Ma méthode – utiliser des poupées pour raconter son histoire – a fait douter [Todd Haynes raconte sa vie avec des poupées Barbie. La société Mattel, comme la famille Carpenter, a tout fait pour empêcher la sortie du film, qui reste inédit en salles, ndlr]. Mais mon intention, mon espoir, c’était bien cette tentative de lui offrir une rédemption. »

« She says, “Hey, babe / Take a walk on the wild side”. »
Ce courage de s’abandonner, de plonger, de chercher l’inspiration, je voudrais ne jamais le perdre. J’aime la façon dont cette chanson, qui est très présente dans Velvet Goldmine, nous permet d’imaginer Lou Reed et David Bowie marchant ensemble dans le wild side [la chanson fantasme la vie de plusieurs figures contre-culturelles new-yorkaises, ndlr].

Le critique musical Lester Bangs dit que le Velvet Underground marque la naissance de la musique moderne. Et, pour moi, accepter , et assumer que c’est aussi un
« La fragmentation de mes récits, leur nature militante, ça venait de cette envie de faire quelque chose de nouveau, de différent, en réponse à la crise du VIH-sida. »
« C’est un beau ré - sumé des attitudes stylistiques du New Queer Cinema [mouvement de cinéma ayant émergé au début des années 1990 auquel Todd Haynes a été affilié avec des films comme Poison, ndlr]. On faisait tous des films très différents, mais ce qui nous unissait c’était ce désir de changer le langage des films qui parlaient d’homosexualité – sur le fait d’être outsider, sur la stigmatisation, sur la criminalité. Nous étions un groupe de cinéastes activistes, qui décidions de nous pencher sur ce qui avait éveillé notre sentiment d’être exclus, tout en essayant de surmonter une crise majeure de santé publique. Nous, les artistes queer de l’époque, ne voulions pas renoncer à une relation oppositionnelle avec le monde. »
« Les hommes doués d’une folle imagination doivent avoir en retour cette grande faculté poétique : nier notre univers et ses valeurs, afin d’agir sur lui avec une aisance souveraine. »
« C’est le premier film qui montre que le langage n’est pas fiable, qu’il faut se méfier de l’acte même de raconter des histoires. Il y aura toujours un ensemble d’histoires différentes à l’intérieur de chacune d’entre elles, avec des voix, des opinions opposées. Créer un portrait kaléidoscopique, c’est la seule façon de raconter profondément une vie. »


« La vie de Jean Genet est très intéressante : il a découvert sa voix poétique en prison [il a été incarcéré pour la première fois à l’âge de 15 ans, ndlr], puis a vu son travail reconnu par les milieux intellectuels des années 1940, ce qui lui a permis de s’émanciper de son statut de criminel. D’une certaine manière, il a bien eu cette “aisance souveraine” à s’élever de sa position. Il est entré dans un monde où il a joué ce rôle d’outsider et il n’a jamais voulu se sentir pleinement intégré dans la société. Pour moi, il reste un exemple que je ne pourrai jamais égaler. En tant qu’artiste, je veux aussi renverser les systèmes de valeurs et de pensée de toutes les façons possibles. »

48 no 197 – mai 2023 Cinéma
Gregg Araki, interview dans TROISCOULEURS no 196, avril 2023
Jean Genet, Notre-Dame(1943)
« Rainy days and Mondays always get me down. »
The Carpenters, « Rainy Days and Mondays » (1971)
Kelly Reichardt, interview sur le site de TROISCOULEURS, 20 septembre 2021
« Je ne pense pas qu’aucun mot puisse expliquer la vie d’un homme. »
Lou Reed, « Walk on the Wild Side » (1972)
© 2017 Metropolitan FilmExport
© Harald Krichel
© Georges Biard
© D. R.
© D. R.
© Hans Koechler
« Ce ne sont pas les sentiments heureux de l’enfance que je vais chercher. C’est plutôt cette façon de sentir, dès le plus jeune âge, qu’il existe un système à l’intérieur duquel il faut trouver un moyen de survivre. Dottie Gets Spanked [1993, ndlr] est certainement le plus autobiographique de tous mes films [ce court métrage raconte comment un enfant de 6 ans devient obnubilé par une émission de télé, le Dottie Show, ndlr]. L’obsession de ce garçon pour une star du petit écran déclenche chez lui un processus créatif, mais fait naître la méfiance de ses parents. L’enfant saisit la notion de honte, et cela devient un outil très important pour survivre. À la fin, il plie soigneusement un dessin de Dottie qu’il vient de faire et qui a suscité tant de réactions chez ses parents, qui semblent voir dans son intérêt pour Dottie une fascination pour la fessée [que reçoit le personnage de Dottie, ndlr]. Le garçon plie son dessin et l’enterre dans le jardin. Pas pour l’oublier, plutôt pour y revenir quand il aura les ressources nécessaires pour s’y confronter à nouveau. »


« Le sentiment d’être projeté hors de l’espace correspond à la déstabilisation que provoque l’amour. On imagine souvent l’amour comme une relation entre un sujet et un objet. Le sujet est cette personne “jetée hors de l’espace” parce qu’elle éprouve un sentiment d’insécurité, elle ne sait pas ce que la personne “objet” ressent pour elle. Cette partition entre sujet et objet, c’est vraiment le mode narratif de Carol. J’observe comment cette dynamique de pouvoir change entre Carol et Thérèse. On lit la relation des deux côtés de la ligne de démarcation. J’ai moi-même été du côté “objet”, mais je ne pense pas qu’on puisse vivre toute sa vie dans ce genre d’amour. »

49 mai 2023 – no 197 Cinéma
« “Quelle étrange fille vous êtes.
— Pourquoi ?
— Jetée hors de l’espace”, a dit Carol. »
Patricia Highsmith, Carol (1952)
« Créer, c’est toujours parler de l’enfance. »
Jean Genet, « Une rencontre avec Jean Genet par Rüdiger Wischenbart et Layla Shahid Barrada » , Revue d’études palestiniennes, no 21, automne 1986
© D. R.
© Hans Koechler
ELLE CONNAÎT LA CHANSON
JEANNE BALIBAR
Depuis trente ans, elle envoûte le cinéma d’auteur français de sa voix suave. En juin, Jeanne Balibar fait une apparition décadente dans Le Processus de paix d’Ilan Klipper et signe un troisième album fougueux, D’ici là tout l’été. Loin de l’image intello qui lui colle à la peau, la plus musicienne des comédiennes nous a parlé de son goût sportif pour le jeu et le débat.

Dans Le Processus de paix d’Ilan Klipper, vous jouez une femme libérée des normes conjugales qui va au bout de ses désirs.
Vous lui ressemblez ?
Non. (Rires.) D’abord, ce personnage est une apparition. On observe son comportement, mais on n’a jamais accès à ses convictions profondes, ses positions. On ne sait pas grand-chose d’elle, si ce n’est qu’elle a une manière de parler très centrée sur la sexualité, au détriment, disons, des convenances. Ce n’est pas du tout mon cas. En plus, cette façon de s’exprimer estelle réellement libérée, et libératrice ? Je n’en suis pas sûre. Ce personnage est dans une surconsommation sexuelle, voit l’érotisme comme une pratique, sinon de prédation, d’absorption extrêmement rapide des échanges. Il n’y a aucun jugement de valeur là-dedans, mais ce n’est pas ma façon de vivre les relations humaines. J’ai joué un
personnage aux antipodes de ma personnalité, c’est ce qui était jubilatoire.
« Ça me déprime que l’on renvoie les gens à leurs parents », avez-vous déclaré en 2012 à Libération. Pourtant, dans la construction de votre engagement, on ne peut pas s’empêcher de penser à votre père, Étienne Balibar, professeur émérite de l’université ParisNanterre et spécialiste de Karl Marx.
J’ai été élevée dans une famille de gauche, avec des parents assez militants, placés du côté des droits des travailleurs, des migrants, des femmes. Leurs engagements ont construit ma vision. J’adhère à leur perception de ce que sont la justice sociale et la vertu citoyenne : l’égalité devant l’accès aux choses communes, l’éducation, la nature, la santé. Je place ces valeurs-là au-dessus de tout, il n’y a rien de plus beau. Mais je ne suis pas militante comme mes parents – je
n’appartiens à aucun parti ni groupe. Ce sont des convictions citoyennes.
Votre implication dans Act Up, auprès des sans-papiers, une tribune lancée à votre initiative qui fustigeait l’inaction culturelle du gouvernement après le Covid, en 2020… Vous vous vivez comme quelqu’un de révolté ?
Dans mon parcours de citoyenne, d’être humain, oui. Pas d’actrice. Ce sont deux choses différentes. Je ne comprendrai jamais qu’il y ait des gens qui puissent désirer le malheur des autres. Vouloir faire payer aux gens, aux travailleurs ordinaires, les comptes publics, plutôt que de taxer les grandes fortunes et les entreprises, je ne comprends pas comment c’est humainement possible. Ne pas chercher à s’occuper de tous, ça me dépasse, je ne saisis pas la logique. Je proteste. Alors forcément, dans mon rapport
50 no 197 – mai 2023
Cinéma > L’entretien face caméra
© Pascale Arnaud
au monde, vous trouverez de la colère et de l’inquiétude.
Votre trajectoire est pleine de bifurcations : de votre rêve de devenir danseuse à Normal Sup, de l’agrégation d’histoire au cours Florent…

En fait, c’est un puzzle, un kaléidoscope. Je m’aperçois que je fais comme un escargot : des parcours de travers. D’ailleurs je suis très lente à construire. Par exemple, depuis six mois, j’ai repris la danse à haute dose, après trente-cinq
qui faisaient le film ont refusé d’attendre la fin de ma grossesse. Olivier Ducastel et Jacques Martineau m’ont ensuite volé mon travail. [Ils avaient été embauchés avec l’assentiment de Jeanne Balibar pour coécrire et réaliser le film, dans lequel Jeanne Balibar et Mathieu Amalric devaient tenir les rôles-titres. Le film est finalement sorti en 1998, avec Virginie Ledoyen et Mathieu Demy en têtes d’affiche. Jeanne Balibar n’est pas créditée en tant que scénariste au générique, ndlr.] J’ai mis très longtemps à comprendre ce qu’il s’était passé. C’est
construisait ses récits autour de deux éléments qui semblent vous parler : des personnages féminins fantasques, et l’amour des mots. Quel souvenir gardez-vous de lui ?
ans d’arrêt, pour le film d’Anne Fontaine Boléro dans lequel je joue le personnage d’Ida Rubinstein, la danseuse étoile des ballets russes et la commanditaire du Boléro de Maurice Ravel. Je travaille aussi sur une chorégraphie avec une jeune danseuse de l’Opéra, pour le premier clip de mon nouvel album. Il y a aussi la musique. Même quand je ne chantais pas, tout le monde me disait que j’étais l’actrice la plus musicale de ma génération, dans ma manière de parler. J’ai pu penser à un moment que tout cela était éclaté. Sauf que l’ensemble fait sens. Malheureusement, les journées n’ont que vingt-quatre heures… Et, comme je disais à une amie l’autre jour, j’ai toujours voulu vivre dans une comédie musicale. Comme beaucoup de gens.
Laquelle ?
Je dirais Tous en scène de Vincente Minnelli.
Dans une interview à Paris Match, vous dites avoir coécrit le scénario de la comédie musicale Jeanne et le garçon formidable, dans laquelle vous deviez jouer. Vous n’apparaissez finalement pas au générique de ce film réalisé par Olivier Ducastel et Jacques Martineau. Que s’est-il passé ?
C’est un film que j’ai écrit très jeune, en 1997. Je n’avais pas rédigé les dialogues, mais j’avais inventé une grande partie de l’histoire originale, sa matière. Ça parlait d’une fille qui tombait amoureuse d’un garçon qui avait le sida. J’ignorais qu’il fallait que je dépose le scénario à mon nom, pour protéger la propriété de mon travail… Juste avant le tournage, je suis tombée enceinte. J’ignorais deux autres choses à cette époque. D’abord, qu’il faut mentir aux assurances lorsqu’elles vous demandent si vous êtes enceinte – car, si c’est le cas, elles refusent de vous assurer. Ensuite, qu’une femme n’est pas tenue de déclarer sa grossesse à son employeur. J’étais devenue non assurable, et les gens
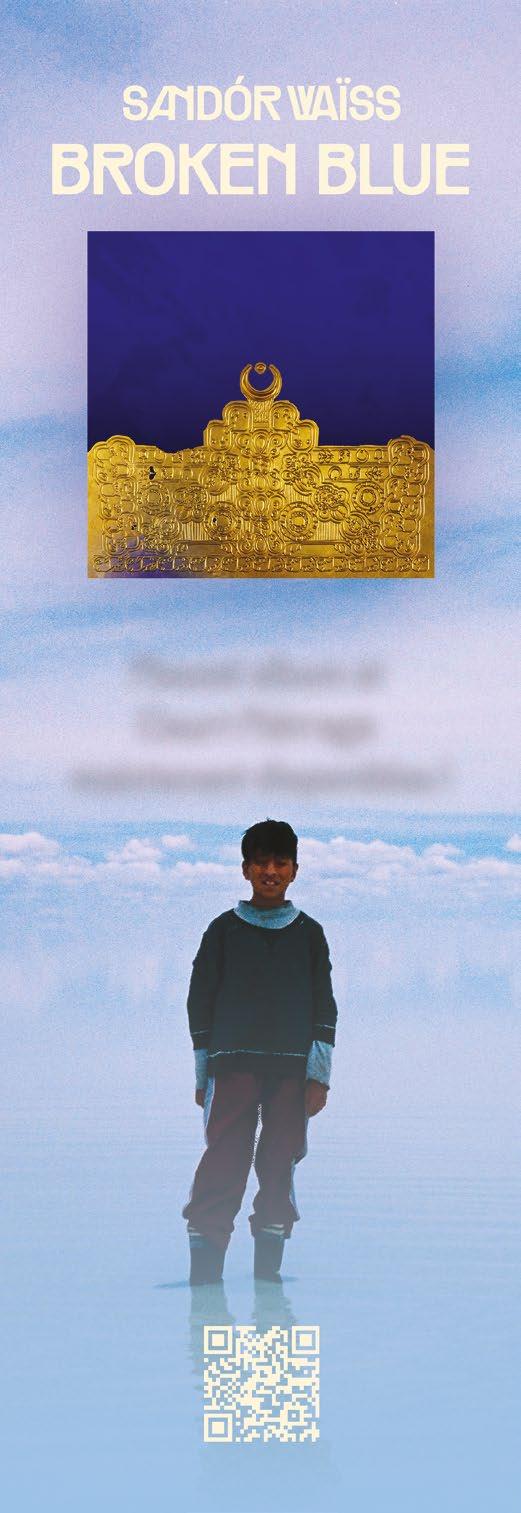
une histoire surprenante car elle raconte comment, en 1997, une jeune femme éduquée, venant d’un milieu militant, pouvait encore tout ignorer de ses droits de femme. On les apprend souvent à ses dépens, dans la violence.
Votre jeu est très physique : au théâtre, vous restiez douze heures sur scène pour Le Soulier de satin mis en scène par Olivier Py (2003) et, dans Barbara de Mathieu Amalric (2017), vous adoptiez les gestes de la chanteuse avec quelque chose de terrien.
À ma grande surprise, j’ai un côté athlète. J’ai fait beaucoup de spectacles très longs, notamment pendant les dix ans où j’ai travaillé avec Frank Castorf [metteur en scène allemand, avec qui Jeanne Balibar a collaboré sur La Dame aux camélias et Bajazet, ndlr]. C’était franchement physique. Je pense même avoir travaillé les plus petits muscles possibles, car j’ai fait deux spectacles en français et huit spectacles en allemand à cette époque – et les muscles de la bouche qui s’activent ne sont pas les mêmes pour parler allemand et pour parler français. Sinon, je déteste tous les sports – à part le ski, parce que ça glisse, ça vole, ça danse. Mais je m’aperçois bizarrement que j’ai un rapport sportif à mon métier. Sportif au sens du mouvement, car je déteste la notion de performance.
Vous pensez que la performance empêche la sincérité ?
L’art n’est pas fait pour en imposer. Et le concept de performance d’acteur contient cette idée. Au contraire, l’art doit ouvrir à des mystères, des doutes, des océans de fragilités. Ce qui ne signifie pas ne pas avoir de compétences. Car c’est une compétence de savoir ouvrir des océans de fragilité.
Vous avez tourné deux fois avec Jacques Rivette (Va savoir, Ne touchez pas à la hache), un réalisateur qui
Jacques Rivette a été une rencontre cruciale. Après avoir fait Va savoir en 2001 [Jeanne Balibar y interprète une comédienne de retour à Paris après avoir quitté son compagnon pour vivre en Italie, ndlr], je me souviens m’être dit : « Maintenant je peux arrêter. Si ça s’arrête, ce n’est pas grave. » J’avais la certitude d’avoir accompli ce pour quoi j’avais choisi ce métier. Évidemment, je n’ai pas eu envie d’arrêter après. Chez Rivette, tout dans le dispositif de tournage correspondait à ce que j’aimais. La légèreté, la minutie du processus de création. Il prenait la vie, les personnages, le monde présent, la fiction et la littérature très au sérieux. Mais, lui, il ne se prenait pas au sérieux. En même temps, il était très décidé. Il était là où il avait toujours voulu être. Cette sorte de centrage sur soimême m’a impressionnée, puis m’a aidée dans l’existence. Jacques Rivette donnait à ses acteurs beaucoup de responsabilités dans le film. Une responsabilité qui consistait à laisser parler des choses subtiles. Il existait, sinon une coécriture, une forme de collaboration très forte. J’ai retrouvé ça plus tard avec Mathieu Amalric, Jean-Claude Biette, Frank Castorf.
On a souvent fait planer sur vous l’ombre de figures imposantes : une diction durassienne, une parenté avec Barbara, Bernadette Lafont et Gena Rowlands… Ça vous a empêché d’être vous-même ?
La comparaison m’honore, mais c’est surtout parce que ce sont des figures nourricières. Or, ce que l’on mange, ça se voit. Selon que vous mangez toute la journée de la choucroute, ou uniquement de la salade, les autres ne percevront pas la même chose… C’est pareil avec l’art. Ceci dit, mon actrice préférée de tous les temps, c’est Shirley MacLaine, justement parce qu’elle est encore plus fragile que toutes ces femmes-là. Et qu’en même temps sa force émotionnelle n’a aucun équivalent.

Et Delphine Seyrig dans tout ça ?
J’ai fait un spectacle en partie dédié à Delphine Seyrig [Les Historiennes, seule en scène créée en 2022 qui juxtapose les trajectoires politiques de Delphine Seyrig, Violette Nozière et Páscoa, ndlr], dont j’admire les combats et qui joue un rôle important dans ma vie. Quand j’étais petite, j’avais un disque des Quatre Saisons de Vivaldi dont elle était la récitante – j’ai failli dire la « réticente ». (Rires.) Une des choses que j’aime chez elle est justement sa réticence à un certain nombre de clichés, de facilités. Je me dis souvent que ce n’est pas le cinéma d’auteur qui m’a amenée à Delphine Seyrig, mais que c’est Delphine Seyrig, saisie à travers ce disque et cette voix, ce rapport à la musique, qui m’a amenée à tout le reste. J’ai sa voix dans l’oreille, pour toujours.
Chez Jeanne Labrune (Ça ira mieux demain), Bruno Podalydès (Dieu seul me
51 mai 2023 – no 197
L’entretien face caméra < Cinéma
« L’art n’est pas fait pour en imposer. Au contraire, il doit ouvrir à des mystères, des doutes. »
voit. Versailles-Chantiers), Arnaud Desplechin (Comment je me suis disputé… Ma vie sexuelle), vous avez souvent joué des femmes inquiètes. Comment expliquez-vous ce tropisme pour le tourment ?
Le tourment est la chose la plus facile, pour moi, à avouer. C’est une réalité, inscrite dans ma nature. Bien sûr, ce n’est qu’une de mes facettes possibles, parmi d’autres. Mais c’est celle que j’ai le moins de difficulté à mettre en avant. C’est donc aussi une facilité et une protection, contrairement à ce que l’on pourrait penser… J’ai du mal à montrer mon côté heureux, en fait.
Dans le clip de votre nouveau single, « June Bilobar », vous vous mettez en scène dans la peau d’un alter ego loufoque. La musique vous permet-elle de laisser parler les différentes voix en vous ?
Oui. Tout le monde est plusieurs à l’intérieur non ? Un disque de treize titres, c’est treize histoires que l’on raconte. Ça permet de faire exister, en un seul geste, plus de profondeur qu’un seul travail très concentré que représente un film. Je me souviens qu’avec
Philippe Katerine [Jeanne Balibar a partagé la vie du chanteur pendant plusieurs années, et chanté sur son titre « J’aime tes fesses », ndlr] on avait fabriqué des petits objets vidéo, jamais mis en circulation, qui s’appelaient Orange et poire, et que j’avais enregistré des chansons avec mon ordinateur. C’est vraiment à ce moment-là que j’ai exploré cet aspect-là de mon désir.
Dans le titre « Cet homme qui pleure », vous évoquez la façon dont le système patriarcal impose des injonctions douloureuses aux hommes. « Quand il t’explique la vie c’est qu’il panique / Ça dure, ça dure des heures / T’en peux plus de faire les chœurs / De faire genre, genre j’fais comme ma mère. » Comment cette phrase éclaire-telle votre féminisme ?
C’est peut-être un peu naïf, mais je pense que les dominants, ceux qui écrasent les autres, il faut les soigner. Les ultrariches qui détruisent la planète et réduisent des millions de gens à la misère pour pouvoir profiter de sommes dont ils ne feront jamais rien, ce sont des fous qu’il faut mettre

à l’hôpital psychiatrique. Enfermés dans leur système de domination, les hommes sont tout aussi victimes que les femmes. C’est un problème de santé publique. Il faudrait les soigner. Ils vont mal – ils mangent trop, parlent trop d’eux, n’arrivent pas écouter, sont angoissés à l’idée de perdre leur position. J’ai envie de leur dire : « Calmez-vous, ça va bien se passer. »
En 2018, au moment de recevoir le César de la meilleure actrice pour Barbara, vous déclariez : « Comme elle est douce l’occasion de se dire les unes aux autres […] en quelle haute estime, malgré nos différences et malgré nos concurrences, nous nous tenons toutes. » La sororité est-elle le nerf de la guerre du combat féministe ?
Le nerf de la guerre, c’est l’économie, l’argent. Mais la douceur, c’est très important. La considération mutuelle, le sol où prendre pied pour fabriquer de la solidarité… Les femmes ont beaucoup été montées les unes contre les autres selon ce principe universel : diviser pour mieux régner. C’est un phénomène de société terrible.
On pense à Brigitte Fontaine et à Lio en écoutant votre album. Ce sont des références pour vous ?
Je les aime beaucoup. Il y a quelque chose dans la musique pop, notamment dans les compositions de Cléa Vincent [co-compositrice de l’album avec Jeanne Balibar, ndlr] qui autorise ce mélange un peu paradoxal entre des choses crues et une légèreté dans l’expression. Ça tombe bien, j’aime les choses paradoxales.
Le Processus de paix d’Ilan Klipper, Le Pacte (1 h 32), sortie le 7 juin
•
D’ici là tout l’été de Jeanne Balibar (Midnight Special), sortie le 9 juin
PROPOS RECUEILLIS PAR LÉA ANDRÉ-SARREAU

52 no 197 – mai 2023
Cinéma > L’entretien face caméra
« J’ai la voix de Delphine Seyrig dans l’oreille, pour toujours. »
Barbara de Mathieu Amalric (2017) © Waiting for Cinéma / Photographe: Roger Arpajou
MELISSA BARRERA PAUL MESCAL
Nommé aux Oscars®














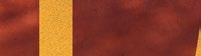


















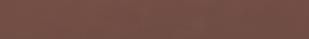








ROSSY DE PALMA
un film de BENJAMIN MILLEPIED





SCÉNARIO, ADAPTATION ET DIALOGUES DE ALEXANDER DINELARIS ET LOÏC BARRÈRE & BENJAMIN MILLEPIED



DE BENJAMIN MILLEPIED & LOÏC BARRÈRE
Le 14 aujuin cinéma

DIMITRI RASSAM PRÉSENTE
UN
MUSIQUE ORIGINALE DE NICHOLAS
PHOTO: BEN KING ADAPTATION AFFICHE © 2022 CHAPTER TF1 STUDIO FRANCE CINEMA CREATE NSW AND CARMEN FILM HOLDINGS PTY LTD
D’APRÈS
SCÉNARIO
BRITELL
HAUTE SAISON
KŌJI FUKADA
Pour sa cinquième édition, le festival Les Saisons Hanabi présente sept films japonais en avant-première dans les salles françaises, parmi lesquels Love Life de Kōji Fukada (en salles le 7 juin). Invité d’honneur du festival, le cinéaste évoque avec nous la diversité du cinéma japonais contemporain ainsi que la fabrication de son dernier film, drame familial à la beauté discrète dans lequel un ex-mari malentendant vient former la pointe d’un émouvant triangle amoureux.

Vous êtes l’invité d’honneur de cette édition des Saisons Hanabi (lire p. 82). Qu’est-ce que cela vous fait, d’être désormais considéré en France comme l’un des chefs de file du cinéma japonais contemporain ?
Chef de file, je ne sais pas, c’est peut-être exagéré ! Je suis un quadra, et le fait d’être mis en avant tient sans doute à une question de timing. J’ai atteint l’âge où on commence à être davantage mis sur le devant de la scène. Cette invitation me permet de présenter Love Life en France, tout en accompagnant des cinéastes de ma génération.
Quel regard portez-vous sur eux ?
Des cinéastes comme Shō Miyake ou Kei Ishikawa ont des univers très forts, avec des styles assez prononcés. Je pense que les spectateurs apprécieront de découvrir, à travers leurs films [respectivement La Beauté du geste, l’histoire d’une jeune boxeuse évoluant dans les faubourgs de Tokyo, et A Man, celle d’une femme qui engage un avocat pour enquêter sur son mari disparu qui lui cachait sa véritable identité, ndlr], toute la diversité du cinéma japonais contemporain. Je trouve d’ailleurs très salutaire que la sélection ne tombe pas dans le piège de l’exotisme,
puisque les films présentés ne correspondent pas du tout aux clichés occidentaux sur la culture japonaise.
Le festival se clôturera avec la projection de La Comédie humaine (2008), l’un de vos premiers longs métrages, encore inédit en France, dans lequel trois histoires s’entremêlent. Comment le considérez-vous au regard de la suite de votre carrière ?
C’est un film que j’ai réalisé en totale indépendance, dans une économie extrêmement restreinte. On a tourné avec une équipe réduite, composée de mes amis et des gens qui m’ont soutenu dès le départ. Je dirais aujourd’hui que c’est le film qui représente peutêtre le mieux mon cinéma d’un point de vue personnel. Cela tient justement du fait que j’ai pu avoir une liberté absolue : ne pas avoir de compte à rendre permet de s’approcher au plus près de ce que l’on a voulu faire.
Depuis Hospitalité, qui vous a fait connaître en France en 2011, vous avez énormément tourné. Comment tenez-vous la cadence ?
J’ai eu beaucoup de chance. J’ai été très bien entouré, avec des équipes très motivées. Par ailleurs, je ne me rendais pas compte que je
tournais beaucoup, parce que, dans la tradition du cinéma japonais, tourner un film par an n’a rien d’exceptionnel. Les cinéastes japonais que j’admire, comme Yasujirō Ozu ou Kinuyo Tanaka, ont tourné énormément de films, parfois dans des laps de temps très courts. Le système de production japonais encourage cela, puisque lorsque l’on ne tourne pas on n’est tout simplement pas payés ! Ce n’est que depuis que je voyage à l’étranger que j’ai pris conscience que ce rythme était soutenu. Aujourd’hui, je crois être arrivé à un point où je ne sais plus si c’est une bonne chose. Peut-être que je ralentirai la cadence à l’avenir. Pour l’heure, j’écris un nouveau film. Je séjourne en ce moment au nord de la préfecture d’Okayama, une province assez reculée. Je suis dans une toute petite ville. C’est la première fois que je travaille comme ça, en immersion, pour m’imprégner vraiment de la ville, pour savoir comment les gens y vivent.
Quel est le point de départ de Love Life ? Ce film est inspiré d’une chanson de variété japonaise d’Akiko Yano, une chanteuse, autrice et compositrice que j’aime beaucoup. Le titre du film est tiré d’un morceau que
54 no 197 – mai 2023
Cinéma > Interview
« Dans la tradition du cinéma japonais, tourner un film par an n’a rien d’exceptionnel. »
j’ai découvert quand j’avais 20 ans et qui m’a bouleversé. Akiko Yano n’est pas quelqu’un qui cherche le succès. Elle est connue, mais c’est une musicienne d’une très grande exigence. Ses fans sont des puristes. J’espère que le film sera l’occasion, pour le public français, de la découvrir.



Au départ, les personnages sont plongés dans le déni. Ils n’arrivent plus à communiquer, et c’est une situation qui revient souvent dans vos films. Est-ce un problème auquel vous avez déjà été confronté ?
Je pense avoir vécu une vie ordinaire, donc je ne dirais pas que cela vient de mon expérience personnelle. C’est plus lié à une conception que j’ai de la vie, où je considère que tout reste incertain, qu’il ne peut y avoir de constante. Cela tient peut-être aussi au contexte dans lequel j’ai grandi. Dans les années 1990, de forts tremblements de terre ont bouleversé le pays. C’est l’époque de l’attentat au gaz sarin dans le métro de Tokyo, et une période où de nombreux crimes ont été perpétrés par des collégiens. Grandir dans ce climat a sûrement contribué à insuffler une part d’imprévu et d’inattendu dans mes fictions, qui peuvent avoir l’air ordinaires.
Le film s’ouvre sur un grave accident. Comment avez-vous abordé la mise en scène d’un tel drame ?

Sans trop en dévoiler, je dirais que l’objectif était de ne pas rendre perceptible l’imminence du drame. Cela rejoint ce que je viens d’expliquer : je voulais montrer que dans la vie l’inattendu nous guette et peut surgir à tout moment. J’avais envie que le spectateur soit surpris par ce type d’événement dramatique, qui fait pourtant partie intégrante de notre quotidien.
La surdité de Park implique pour les autres héros de le regarder en face pour lui parler. Comment avez-vous écrit ce personnage malentendant, central dans le récit ?
Si j’ai eu l’idée du film il y a longtemps, je n’ai pas tout de suite pensé à en faire un personnage malentendant. Ce n’est que lorsque j’ai réécrit le scénario, en 2018, que je me suis demandé si je ne pouvais pas ajouter un élément dramatique, avec l’idée de faire parler aux deux anciens époux un langage que le nouveau mari ne pourrait pas comprendre. À ce moment, je venais de participer, en tant qu’intervenant, à un festival à Tokyo avec des sourds et malentendants. Pour la première fois, j’ai été en contact avec la langue des signes. Je pensais jusqu’à présent qu’il ne s’agissait que d’une langue fabriquée pour compenser un handicap. Il n’en est rien. C’est une langue à part entière, et surtout qui remplit l’espace. Elle m’a semblé très cinématographique, et elle pousse les personnages à se regarder dans les yeux. Plutôt que de se demander pourquoi avoir convoqué un personnage malentendant, il faudrait presque m’interroger sur les raisons qui ont fait qu’il n’y en avait pas dans mon cinéma auparavant.
Rencontre avec Kōji Fukada puis projection de son dernier film, Love Life, au mk2 Bibliothèque, à 18 h
• Les Saisons Hanabi printemps 2023, du 7 au 13 juin, 7 films japonais en avant-première Plus d’informations sur mk2.com
55 mai 2023 – no 197
Interview < Cinéma
PROPOS RECUEILLIS PAR CORENTIN LÊ
PETITE MAISON PRODUCTION PRÉSENT
LE COURANT D’AIR
Comme le diable, le cinéma se loge dans les détails. Geste inattendu d’un acteur, couleur d’un décor, drapé d’une jupe sous l’effet du vent : chaque mois, de film en film, nous partons en quête de ces événements minuscules qui sont autant de brèches où s’engouffre l’émotion du spectateur. Ce mois-ci : une entrée fracassante dans Seinfeld de Jerry Seinfeld et Larry David (1989-1998).
Subitement la porte s’ouvre en grand, giflée par un invraisemblable courant d’air : Kramer est entré, son grand corps ahuri craché au milieu de la pièce comme on tomberait du lit, tout étourdi par sa vitesse, sauvé de la chute in extremis par des dons de funambule et un matelas de rires enregistrés (en fait, non : des vrais rires, puisqu’on tournait la série en public). Ce n’est pas le vent qui l’a poussé. La bourrasque, c’est lui. Avant
d’être un personnage, Kramer est d’abord cette onde, cette étrange turbulence sinuant le long de murs invisibles dressés autour de lui en labyrinthe. À la fois pantin disloqué (son côté Charlie Chaplin) et fusée téméraire (son côté Buster Keaton), mais surtout grand, étrangement grand (son côté James Stewart, qui mesurait lui aussi un mètre quatre-vingtonze), corps à allure de périlleux échafaudage, perpétuellement au bord de tomber de lui-même. Sous les traits de Cosmo Kramer, Michael Richards, acteur surdoué dont Seinfeld contient toute l’œuvre (dix ans à être génial, 178 épisodes à franchir chaque fois différemment la même porte), occupe cette zone où le génie des burlesques rejoint celui des danseurs. Gene Kelly, Fred Astaire, eux aussi, jouaient toujours à la lisière de la chute. Kramer, comme eux, ne tombe pas, et pour ne pas tomber il rebondit sur la chute elle-même. Autant qu’un homme, une vague : en lui tout ondule, au premier rang de quoi ses cheveux aberrants, cette touffe serpentine coiffée par un courant électrique (son côté fiancée de Frankenstein), et à partir de là le corps tout entier, glissé dans des vêtements toujours suffisamment amples, pantalons à pinces, chemises cubaines (son côté Gary Cooper), pour onduler tout son saoul et défier continuellement la chute, même si parfois, tout de même, il tombe.
Enfin, au bout de ses jambes sans repos, et en toute circonstance : chaussettes blanches, mocassins noirs (son côté Michael Jackson). Il arrive qu’on soit grand par la seule faute des jambes, ou à l’inverse, du tronc. Kramer, lui, a de grandes jambes droites et un grand tronc droit, formant autour de la taille les deux côtés d’une pliure, si bien que, paradoxalement, le corps ondule en raison de sa raideur. Vieille loi burlesque : ou bien le tronc démarre plus vite que les jambes, ou bien
sur YouTube, réparti en une vingtaine de volumes, un montage réunissant l’intégralité de ces entrées, par ordre chronologique : Kramer y est un Sisyphe plongé dans un absurde enfer de portes, que son élan de départ suffit à ouvrir toutes. Le détail qui fait le prix de toutes ces apparitions sur le seuil de l’appartement de Seinfeld, c’est précisément cet élan, pour la raison que rien ne l’explique. Quel est ce monde d’où il surgit chaque fois et qui le pousse si fort à travers
Cen’est pas le vent qui a poussé Kramer. La bourrasque, c’est lui.
c’est elles qui sont en avance, et par effet de vitesse acquise ces spasmes dessinent des courbes, font naître un swing onctueux. Mais parmi toutes les acrobaties sans cause de Cosmo Kramer, aucune n’éblouit comme ce passage de porte, puisé par la sitcom dans le théâtre de boulevard mais élevé ici au rang de prouesse athlétique. On trouve
la porte de Jerry ? Dans cet angle mort, il y a le secret de Cosmo Kramer – le plus beau des hors-champ.




56 no 197 – mai 2023 Cinéma > Microscope
JÉRÔME MOMCILOVIC
© D. R. © D. R. © D. R. © D. R.
18 MAI RENCONTRE ROSS HALFIN MK2 BIBLIOTHÈQUE
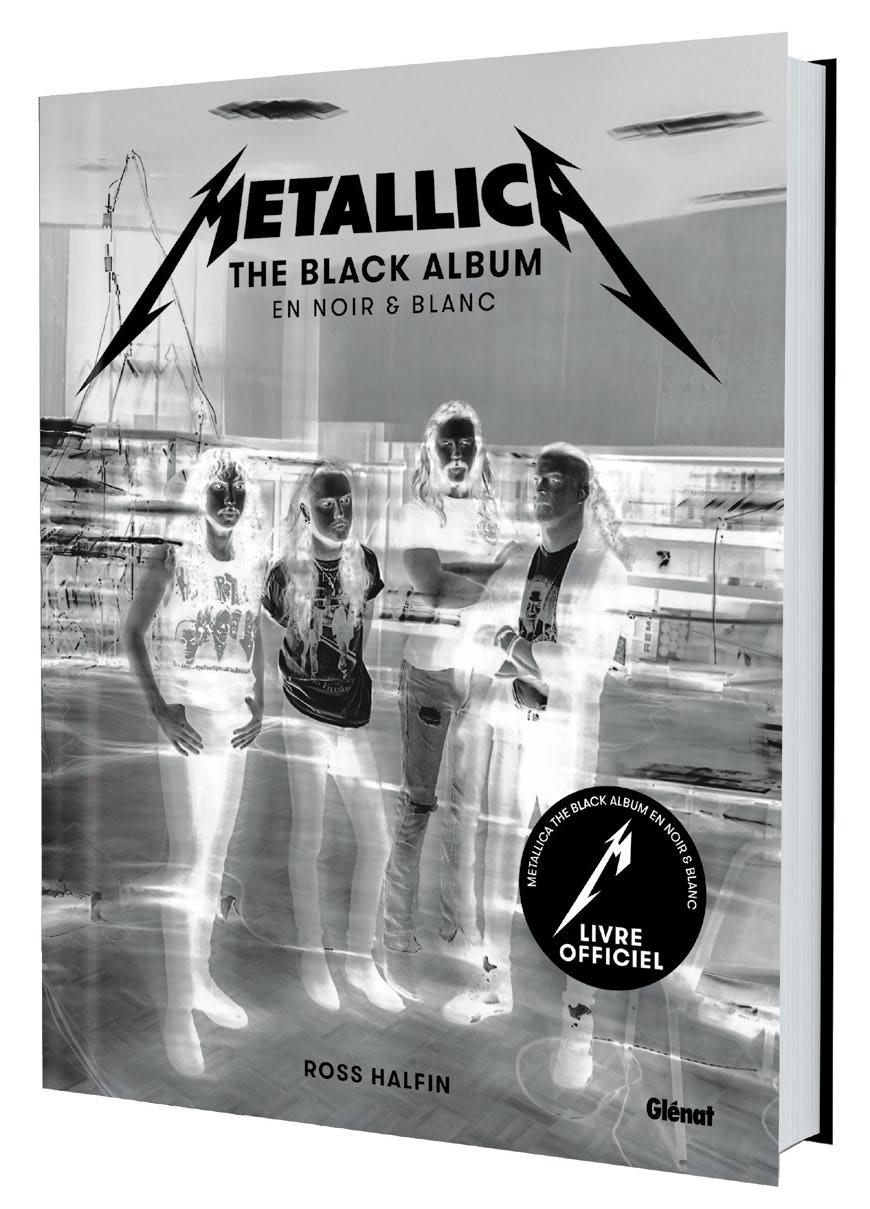

LE GUIDE DES SORTIES CINÉMA PAR

Pour son dixième long métrage, Bruno Podalydès orchestre une comédie chorale mélancolique et aigre-douce autour d’une agence immobilière et de ses clients. Et dessine l’émouvante valse des rêves, angoisses affectives et fantasmes secrets de sa galerie de personnages.
WAHOU !
Cinéaste animé par un esprit de troupe, Bruno Podalydès trouve avec ce dixième film un dispositif qui sied joliment à sa vision fantaisiste, pince-sans-rire et légèrement désabusée de la société française. Il suit ici deux conseillers immobiliers de l’agence Wahou !, Catherine (Karin Viard) et Oracio (Bruno Podalydès lui-même) qui enchaînent à l’aide d’un stagiaire (Victor Lefebvre) les visites de deux biens : une grande maison bourgeoise avec jardin (dont le couple de vendeurs est incarné par Sabine Azéma et Eddy Mitchell) et un petit appartement moderne situé en plein « triangle d’or » de Bougival. Au fil des rencontres avec des acheteurs potentiels se déploient des protagonistes aux projets et aux caractères variés. On croisera un groupe
d’amis (mené par Agnès Jaoui, lire p. 44) qui rêvaient de s’installer ensemble dans une grande demeure, mais qui vont vite déchanter, un couple de jeunes gens chapeautés par un beau-père tatillon (Roschdy Zem), une épouse en quête de sensations fortes (Isabelle Candelier) entravée par un mari austère et coincé (Patrick Ligardes), un client taciturne (Denis Podalydès)… Derrière le procédé quasi théâtral, Podalydès réussit une comédie harmonieuse sur le besoin viscéral d’attachement et d’amour. Le réalisateur, désormais sexagénaire, se rapproche ainsi plus que jamais de l’ultime période cinématographique d’Alain Resnais, modèle absolu avec qui il avait travaillé plusieurs fois. Audelà du tandem Sabine Azéma-Agnès Jaoui
(qui rappelle On connaît la chanson) ou de la boucle narrative et champêtre qui évoque Smoking /No Smoking, ce traité sur la manière dont le passage du temps affecte les sentiments et les rapports sociaux sonne comme un vibrant hommage au réalisateur de Cœurs. Et c’est au manque affectif des agents immobiliers eux-mêmes que ce tendre film s’intéresse en dernier lieu.
Wahou ! de Bruno Podalydès, UGC, sortie le 7 juin
58 Cinéma > Sorties du 10 mai au 7 juin no 197 – mai 2023
SORTIE LE 7 JUIN
DAMIEN LEBLANC
PAR












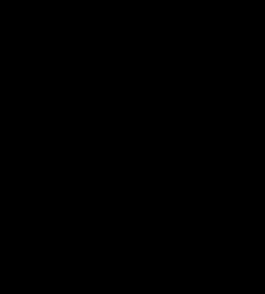
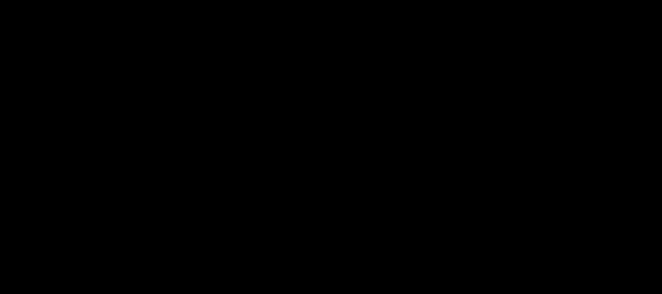
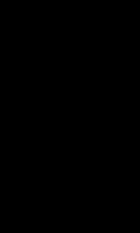
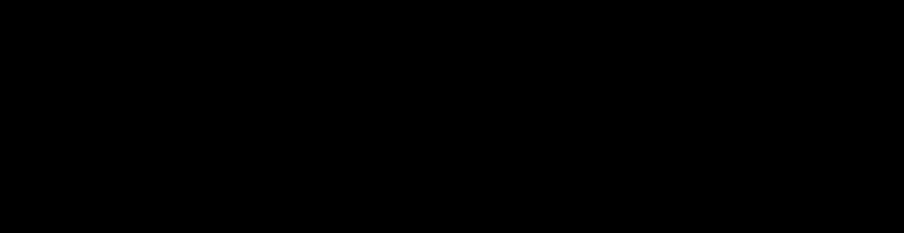
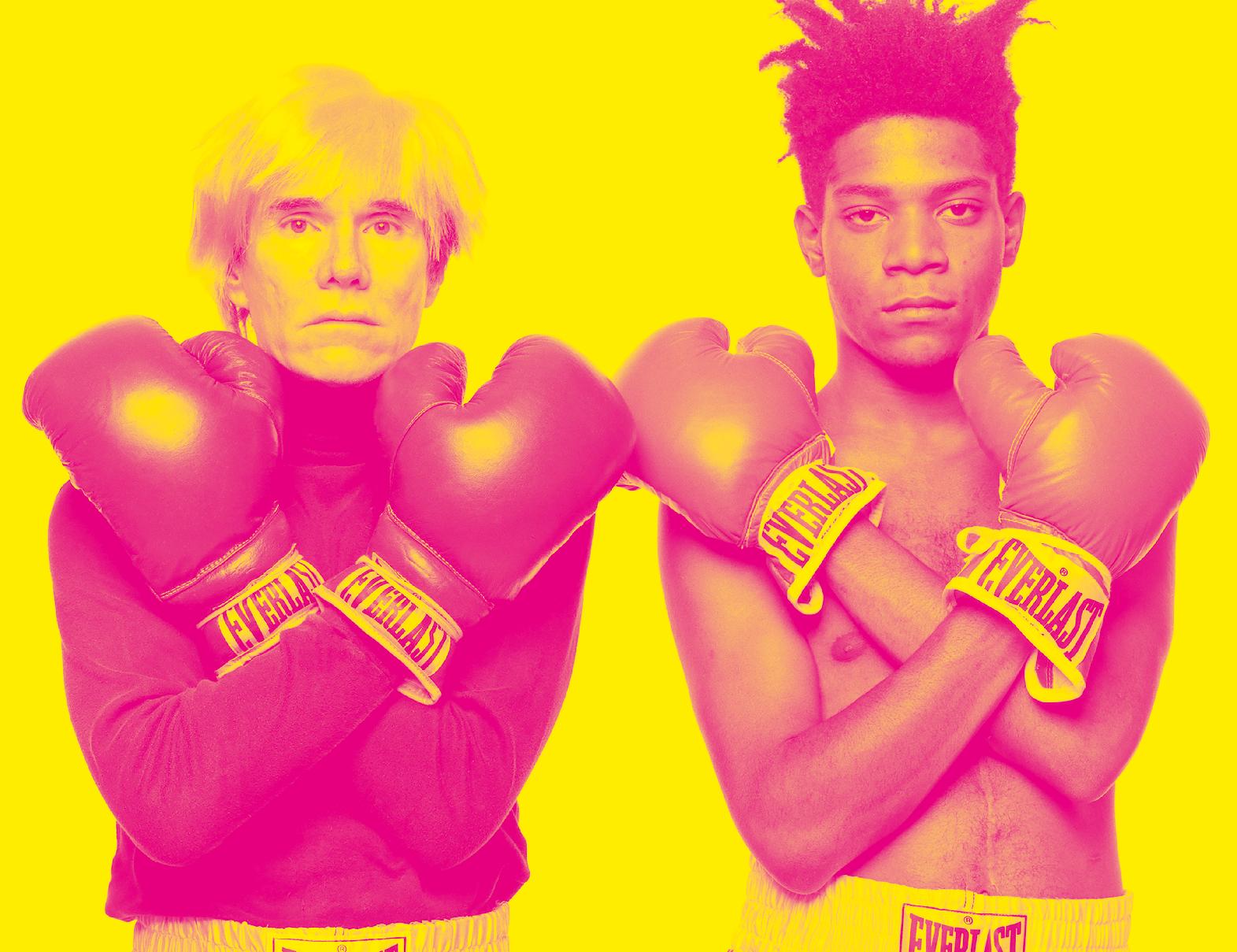
Utilisant la technique du deepfake, Alexandre Sokourov fait se croiser Adolf Hitler, Joseph Staline, Benito Mussolini et Winston Churchill au purgatoire après la Seconde Guerre mondiale. Plastiquement incroyable, Fairytale revisite avec autant de noirceur que d’humour la psyché de ces figures historiques.
Ils pensaient tous avoir leur place légitime au paradis. Devant une immense porte dans une grotte aux allures de cathédrale (qui évoque la dernière partie dantesque de The House That Jack Built de Lars von Trier) et après avoir croisé un Jésus pas au top, chacun se présente à Dieu dans son plus prestigieux costume de guerre ; et se voit claquer la porte au nez. Voilà nos quatre « héros » condamnés à errer dans les limbes,
à ressasser et à comploter inlassablement, oubliant régulièrement que la guerre est finie et, surtout, qu’ils sont déjà tous morts. Habitué à triturer les figures historiques (Hitler, déjà, dans Moloch en 1999 ; Vladimir Ilitch Lénine dans Taurus en 2001 ; l’empereur Hirohito dans Le Soleil en 2006), Alexandre Sokourov va plus loin que jamais dans Fairytale. À commencer par l’audace et l’ironie de son titre (« conte de fées ») et les détournements de certaines des figures les plus honnies de l’histoire qu’il se permet. Alors qu’il croit encore pouvoir parvenir à régner sur le monde entier, Hitler se retrouve ainsi sur le trône (comprendre : les W.-C.) et passe son temps à ressasser ses regrets, qu’il tourne comme des défis de gamins (« J’aurais dû brûler Londres… J’aurais pu le faire, hein ! »). Ce ton n’empêche pas le cinéaste russe de donner ampleur et gravité à son projet, dès la première image : les décors, entièrement composés numériquement, sont aussi somptueux que terrifiants. Ils forment, avec la technique, similaire au deep-fake, de mise en mouvement des archives, un tout des plus dérangeants. Un peu comme si La Classe américaine de Michel Hazanavicius fusion-
nait avec L’Enfer de Dante. Le vertige tient aussi au curieux dédoublement qui semble s’opérer à répétition sur les quatre hommes. Ainsi, Churchill s’adresse aussi bien à Staline qu’aux deux puis trois doubles de lui-même, qu’il appelle « mes frères ». Le film semble alors creuser encore plus l’idée de l’entresoi dégénérescent, de la même manière que les quatre hommes patinent en répétant les mêmes idées. Par ce passage au purgatoire, ces figures intimidantes, terrifiantes, se muent à nouveau en simples mortels.

Fairytale d’Alexandre Sokourov, Les Films de l’Atalante (1 h 18), sortie le 10 mai
TIMÉ ZOPPÉ
60 Cinéma > Sorties du 10 mai au 7 juin no 197 – mai 2023
SORTIE LE 10 MAI
FAIRYTALE
Un peu comme si La Classe américaine d’Hazanavicius fusionnait avec L’Enfer de Dante.
Qu’est-ce qu’on fait quand on s’aime et qu’on peut plus se blairer ?
Le processus de Paix
juin

Création Laurent Pons / TROÏKA
Camille Chamoux
CINÉFRANCE STUDIOS présente
7
Damien Bonnard Un film de Ilan Klipper
LE PRINCIPAL
SORTIE LE 10 MAI
Principal adjoint d’un collège dans la région de Mulhouse, Sabri (Roschdy Zem) s’apprête à être promu principal d’un autre établissement. Mais le fragile équilibre de sa vie familiale – il est père divorcé et doit veiller sur un frère en détresse sociale – et les relations tendues qu’il entretient avec certains collè-

gues le mettent dans un état de stress qui va le pousser à commettre une grave faute professionnelle. Troisième long métrage de Chad Chenouga, cette chronique sociétale se focalise sur un protagoniste incarnant la méritocratie au sein de l’Éducation nationale et qui se trouve quelque peu dépassé par le poids de ses responsabilités. Dans la peau de cet antihéros rigide, Roschdy Zem, qui ne cesse de gagner en épaisseur depuis son César du meilleur acteur en 2020, est de tous les plans et joue parfaitement la partition d’un homme qui a bien du mal à se détendre (en témoigne le moment où il part en thalassothérapie avec sa supérieure incarnée par Yolande Moreau). La mise en scène se met ici au service du comédien, comme si ce dernier avait atteint le statut de star à l’ancienne, tel l’Alain Delon des années 1970 ou le Denzel Washington des années 1990, dont la performance vaut à elle seule le détour.
Réalisé par un talentueux tandem féminin, War Pony suit deux laissés-pourcompte du rêve américain.
Un premier film indépendant foudroyant sur des têtes brûlées trop cramées pour que les gouvernements s’intéressent à eux, et une Caméra d’or plus que méritée à Cannes 2022.

Gina Gammell (d’abord productrice) et Riley Keough (vue et aimée dans Under The Silver Lake, The Girlfriend Experience) ont coécrit ce récit d’apprentissage avec deux Amérindiens, Bill Reddy et Franklin Sioux Bob. Elles ont ensuite filmé les descendants d’une tribu lakota sur leurs terres, dans la réserve de Pine Ridge, dans le Dakota du Sud. Le titre du film évoque des animaux doux obligés de partir en guerre, à l’instar des héros, de
jeunes gens encore purs et innocents malgré la violence et les galères permanentes. Un oxymore qui sied bien à cette fiction aux connotations documentaires – par son écriture, sa caméra à l’épaule, son âpreté – et aux vraies échappées lyriques – la beauté d’âme des Lakota, l’image récurrente du bison qui vient les hanter. Cet animal totem des tribus indiennes semble symboliser leur rêve de liberté sans cesse entravé par une réalité impitoyable. Ainsi Bill, 23 ans, et Matho, 12 ans, cherchent à tout prix à échapper au deal, aux plans louches et à l’hostilité de la société. Les deux garçons et leur entourage cabossé sont mis en scène avec une empathie et une intelligence rares.

62 Cinéma > Sorties du 10 mai au 7 juin no 197 – mai 2023
Roschdy Zem se donne pleinement dans le rôle d’un principal adjoint en attente d’une promotion, par ailleurs père austère, fébrile et tourmenté. L’acteur porte ce drame politico-social qui ausculte la méritocratie au sein de l’Éducation nationale.
Bill et Matho cherchent
à tout prix à échapper au deal, aux plans louches et à l’hostilité de la société.
WAR PONY
SORTIE LE 10 MAI
XANAÉ BOVE
War Pony de Gina Gammell et Riley Keough, Les Films du Losange (1 h 54), sortie le 10 mai
Le Principal de Chad Chenouga, Le Pacte (1 h 22), sortie le 10 mai
DAMIEN LEBLANC
JEAN EUSTACHE
Après La Maman et la putain tous les films de “ Une œuvre intense et moderne. ”
AU CINÉMA À PARTIR DU 7 JUIN

EN VERSIONS RESTAURÉES 4K

 Photo du film MES PETITES AMOUREUSES © Pierre Zucca - Collection Christophel
Photo du film MES PETITES AMOUREUSES © Pierre Zucca - Collection Christophel
— LE MONDE LES FILMS DU LOSANGE présente
NEPTUNE FROST
SORTIE LE 10 MAI
Révélé par le film Slam de Marc Levin (Caméra d’or en 1998), le poète, musicien et acteur américain Saul Williams réalise ici son premier long métrage en compagnie de l’actrice, dramaturge et réalisatrice française d’origine rwandaise Anisia Uzeyman. Neptune Frost raconte la rencontre amoureuse
entre Matalusa, un mineur échappé d’une mine de coltan au Burundi, et Neptune, un·e hackeur·se intersexe fuyant les violences sexuelles. Dans une dictature policière et technologique, ils organisent avec un groupe de hackeurs la revanche du continent africain sur les pouvoirs oppresseurs (le colonialisme, les GAFAM, les puissants corrompus), grâce à une reconfiguration magique – spiritualiste – des réseaux virtuels. Avec sa structure éclatée et son esthétique cyberpunk bricolée recyclant les déchets électroniques en d’étonnants décors, Neptune Frost développe les thématiques des chansons de Saul Williams (« Matalusa » est la version africaine de « Martyr Loser King », un titre inspiré par Martin Luther King), fusionnant modernité et traditions pour dénoncer la violence de l’industrie extractive, défendre le droit à la différence, et connecter les rythmes de tous les révoltés dans une même quête de bonheur.
LE PARADIS
SORTIE LE 10 MAI
Loin des clichés du film carcéral, Le Paradis est un premier long métrage sensuel et libre, porté par deux jeunes interprètes magnétiques (Khalil Gharbia et Julien de Saint Jean) dont les personnages vivent une histoire d’amour intense.


Curieux titre pour un film qui se déroule exclusivement dans un centre de détention pour mineurs. Joe (Khalil Gharbia, découvert dans Peter von Kant de François Ozon) y vit depuis plusieurs mois et espère une libération prochaine accordée par la juge. Dans cet environnement complètement barricadé, il noue une relation amoureuse avec un autre adolescent, nouvellement arrivé, William (hypnotisant Julien de Saint Jean)… Pour son premier long métrage, Zeno Graton (lire p. 14) déroule la métaphore de l’enfermement en variant les
échelles pour filmer les grillages et clôtures qui maintiennent ces garçons en-dehors du monde. Mais, loin de tomber dans la facilité et les stéréotypes – il n’est jamais question d’homophobie de la part des camarades ou de l’équipe pénitentiaire –, le cinéaste belge tente de faire tomber ces cloisons. Comme lorsque les personnages communiquent à travers le mur très fin qui sépare leur chambre ou quand ils s’échangent des baisers derrière la salle commune. À l’instar des héros d’Un chant d’amour de Jean Genet (1950), grande source d’inspiration ici, Joe et William créent leur propre espace de liberté à l’abri des regards, un territoire paradisiaque et pleinement occupé.

64 Cinéma > Sorties du 10 mai au 7 juin no 197 – mai 2023
Avec Neptune Frost, Saul Williams et Anisia Uzeyman réalisent une comédie musicale afrofuturiste et onirique, greffant leurs questionnements queer et post-coloniaux à cette dystopie cyberpunk aux pays des mines de coltan.
À l’instar des héros d’ Un chant d’amour de Genet, Joe et William créent leur propre espace de liberté.
ÉLÉONORE HOUÉE
Le Paradis de Zeno Graton, Rezo Films (1 h 23), sortie le 10 mai
Neptune Frost de Saul Williams et Anisia Uzeyman, Damned (1 h 45), sortie le 10 mai
WILFRIED PARIS

THE WILD ONE
Qui connaît aujourd’hui le nom de Jack Garfein ?
The Wild One fait le portrait du cinéaste né en 1930 qui a laissé deux films arrachés à la censure des studios hollywoodiens avant d’enseigner la comédie aux plus grands acteurs.
Tessa Louise-Salomé a exhumé soixantequinze ans d’archives pour réaliser ce portrait dont le titre définit le caractère indomptable de Garfein, tout en synthétisant les noms de ses deux films, The Strange One (1957) et Something Wild (1961). Le documentaire prend le parti de contourner le récit chronologique
OMAR LA FRAISE
SORTIE LE 24 MAI
Reda Kateb et Benoît Magimel forment un duo irrésistible de gangsters branques dans ce film survitaminé d’Elias Belkeddar (auteur du court Un jour de mariage et scénariste d’Athena de Romain Gavras), sélectionné en Séance de minuit à Cannes, qui affirme son côté bourrin pour mieux le mettre à distance.



Ah çà ! ça roule des mécaniques, dans Omar la Fraise. On emploie volontairement cette expression délicieusement vintage pour dire à quel point Omar (Reda Kateb) et Roger (Benoît Magimel) font figure de fossiles dans la société actuelle. Le premier, débarqué en Algérie, parce que sinon il se serait fait coffrer en France, se la joue Scarface en exhibant ses petits muscles à
n’importe quelle occasion et en faisant des moues pincées-yeux froncés bien tartes. Le second, qui l’a suivi par amitié (et certainement parce qu’il n’avait rien à faire de sa vie, de toute façon), est incarné par un Magimel des grands jours, costume blanc et lunettes fumées, comme pour prolonger son rôle de baratineur à côté de la plaque dans Pacifiction. Tourment sur les îles d’Albert Serra. Alors qu’ils tentent de se remettre dans des combines de malfrats de pacotille pour se refaire – Omar se retrouve, on ne sait par quel miracle, à la tête d’une usine –, Elias Belkeddar leur donne une verve tarantinesque : ce sont des gangsters déliquescents, qui s’agitent dans un monde qu’ils ne comprennent plus et tentent de s’en sortir avec ce qui leur reste, une sorte de bagou viril assez pathétique – mais très drôle.
· CLAUDE GARCIA
Omar se la joue Scarface en exhibant ses petits muscles à n’importe
et d’entremêler la douleur de cet adolescent, né en Tchécoslovaquie et prisonnier à Auschwitz, avec son combat de cinéaste rebelle au sein du système hollywoodien verrouillé par la censure. Porté par un dispositif de projection qui installe les témoins au cœur de monumentales images d’archives, The Wild One fait de la biographie du réalisateur oublié une variation sur le motif de la violence au xxe siècle. L’homme que Henry Miller qualifiait d’« aussi tenace qu’un bulldog » a exploré le racisme et le viol dans ses fictions. Dans un récit épique narré par la voix de Willem Dafoe, on apprend comment il devint honni par le système avant de rejoindre Lee Strasberg, le gourou de la méthode Actors Studio, pour devenir coach des plus grands acteurs, et notamment d’Irène Jacob. L’actrice raconte avec émotion comment elle a travaillé avec lui son rôle dans la bouleversante trilogie Trois couleurs de Krzysztof Kieślowski.
66 Cinéma > Sorties du 10 mai au 7 juin no 197 – mai 2023
SORTIE LE 10 MAI
quelle occasion.
Omar la Fraise d’Elias Belkeddar, StudioCanal, sortie le 24 mai
The Wild One de Tessa Louise-Salomé, New Story, sortie le 10 mai
RAPHAËLLE PIREYRE
INLAND EMPIRE
RESSORTIE LE 31 MAI
Il est peu dire qu’Inland Empire a de quoi tourmenter. S’il prolonge Mulholland Drive, sorti six ans auparavant, reprenant nombre de lieux (Los Angeles, Hollywood) et de thèmes (l’envers du décor de l’industrie cinématographique, le parcours tumultueux d’une actrice), il rompt radicalement avec son côté glamour. La proposition stylistique neuve – par l’utilisation d’une image numé-

rique pauvre et d’un colossal grand-angle, déformant les perspectives et les visages –est poussée à une telle outrance qu’elle fait d’ Inland Empire un film proprement effrayant. Trois heures sidérantes pendant lesquelles le motif lynchien par excellence – la monstruosité – s’empare de la matière même du film. Comme si les altérations humaines chéries dans le cinéma de Lynch (Eraserhead, Elephant Man) s’étaient progressivement autonomisées au fil des films. Ici, c’est le geste même de réalisation qui s’avère contaminé. On assiste à une attaque en règle contre l’image, constamment dégradée, lacérée, produisant une difformité telle qu’elle n’est plus qu’un empire de signes abstraits. Que dire de la séquence lumineuse finale, véritable accalmie audiovisuelle ? Peutêtre que c’est la solution de l’énigme : ce film nous apprendrait à dompter l’effroi, pour ne plus jamais avoir peur.
SUBLIME
Premier long métrage du cinéaste argentin Mariano Biasin, Sublime, présenté dans la sélection Generation de la Berlinale 2022, s’offre comme un coming-of-age lumineux, apaisé et salvateur.


Que peuvent bien nous raconter de nouveau les récits adolescents qui fleurissent un peu partout, au cinéma, en littérature et ailleurs ? Sublime de Mariano Biasin, comme d’autres avant lui, expose les questions liées à l’adolescence, et particulièrement celles que se pose Manuel, 16 ans, appareil dentaire de rigueur et bassiste dans un groupe de rock. Tout dans son quotidien, situé quelque part dans une charmante ville côtière d’Argentine, se déroule avec limpidité et harmonie jusqu’à ce que ses désirs viennent chahuter cette vie un peu trop sage et policée. Manuel, en couple
avec une fille, se met à éprouver des sentiments nouveaux pour son meilleur ami, Felipe. Que nous raconte d’inédit Sublime sur cette irruption du désir ? Le film se livre tout entier à l’observation de la négociation de son jeune protagoniste avec cette donnée nouvelle, ce dernier ne rencontrant aucun autre obstacle que ceux qu’il s’invente. C’est ce choix de la bienveillance qui rend Sublime juste et sans doute aussi contemporain, captant quelque chose d’une nouvelle génération moins embarrassée par les questions de genre et de sexualité que par le simple changement de nature d’une relation amicale devenue amoureuse.
67 Sorties du 10 mai au 7 juin <---- Cinéma mai 2023 – no 197
SORTIE LE 17 MAI
MARILOU DUPONCHEL
Sorti en France en 2007, Inland Empire est le dernier long métrage en date de David Lynch. Ce film-monstre inoubliable, qui marque un tournant vers une œuvre encore plus expérimentale et plastique, ressort en salles.
Sublime de Mariano Biasin, Outplay Films (1 h 40), sortie le 17 mai
Inland Empire de David Lynch, Potemkine Films (2 h 52), ressortie le 31 mai
THOMAS CHOURY
Manuel, en couple avec une fille, se met à éprouver des sentiments nouveaux pour son meilleur ami, Felipe.
DERNIÈRE NUIT À MILAN
Polar d’une intensité rare, Dernière nuit à Milan est aussi une fable morale édifiante qui offre à Pierfrancesco Favino l’un de ses plus beaux rôles, tout en défiant les lois d’une longue lignée de films noir italiens.

Milan a longtemps été le royaume du poli-ziottesco, ces polars italiens qui, de la fin des années 1960 au début des années 1980, furent les exutoires d’un pays bouleversé par les années de plomb. Le cinéaste italien Andrea Di Stefano se place donc dans la lignée de ces films réjouissants et sulfureux, en situant l’éprouvante dernière nuit de service du policier Amore dans la capitale de
CAMILA SORTIRA CE SOIR
SORTIE LE 7 JUIN
La réalisatrice argentine Inés Barrionueva brosse le portrait sensible et délicat d’une adolescente qui lutte pour s’émanciper au sein d’une société argentine encore marquée par le poids des traditions. Un film d’une grande beauté, qui insuffle un espoir bienvenu.


Ce printemps est décidément fertile en productions sur l’adolescence réussies : après Petites, El agua ou encore Kokon, Camila sortira ce soir est encore un bel exemple. À 17 ans, Camila assume ses idées déjà bien affirmées sans se soucier du qu’en-dira-t-on, ce qui n’est pas sans poser problème dans le lycée privé traditionaliste qu’elle intègre après un déménagement précipité à Buenos Aires. Elle y interrompt un cours de religion, refuse d’abandonner des accessoires vestimentaires qui définissent son identité, débat frontalement avec l’autorité – maternelle ou institutionnelle – et questionne
son orientation sexuelle, découvrant le désir dans sa complexité. Sans compromis, Camila manœuvre pour exister… La réalisatrice argentine Inés Barrionuevo filme avec finesse et douceur cette jeunesse portègne actuelle qui refuse de subir le poids d’une société toujours très conservatrice. Sans faire de son héroïne le porte-étendard d’un militantisme féministe encore en germe, son film accompagne sans juger, suggère sans imposer. En cette période d’éclosion où tout est à la fois permis et interdit, Camila et ses camarades tâtonnent parfois, trébuchent souvent, mais finissent par triompher de toute la force de convictions spontanées. Les nouvelles générations peuvent être fières de ce portrait tout en subtilité : dans la caméra d’Inés Barrionueva, « l’âge ingrat » ne l’est finalement pas tant que ça.
Camila sortira ce soir d’Inés Barrionuevo, Outplay Films (1 h 43), sortie le 7 juin
la Lombardie. Seulement voilà : contrairement aux flics vengeurs et aux anarchistes sanguinaires qui ont fait les grandes heures du poliziottesco, Amore est un pacifiste forcené (il n’aurait jamais utilisé une arme de sa carrière) qui voit ses principes éprouvés quand il convoie illégalement une pochette de diamants. La tension de Dernière nuit à Milan est donc d’autant plus imparable qu’elle est double. Amore doit en effet s’extirper d’une souricière, tout en résistant à la tentation de la violence. Porté par un Pierfrancesco Favino fabuleux dans un personnage à la fois effacé et magnétique, Dernière nuit à Milan concilie, comme Amore, ce qui semble incompatible : Di Stefano nous offre à la fois un film social engagé (le salaire misérable des policiers est l’une des sous-intrigues du film), un polar haletant et une fable morale d’une équité proprement bouleversante.
68 Cinéma > Sorties du 10 mai au 7 juin no 197 – mai 2023
SORTIE LE 7 JUIN
Camila assume ses idées déjà bien affirmées sans se soucier du qu’en-dira-t-on.
Dernière nuit à Milan d’Andrea Di Stefano, Universal Pictures (2 h 05), sortie le 7 juin
JULIEN
DUPUY
COPÉLIA MAINARDI
SICK OF MYSELF
Avec ce deuxième long métrage délicieusement provoc qui s’acoquine avec le body horror, le Norvégien Kristoffer Borgli (DRIB, 2017) s’amuse du narcissisme de notre époque, à travers l’histoire d’un couple toxique, prêt à tout pour se faire remarquer.


Signe (géniale Kristine Kujath Thorp, repérée dans Ninjababy d’Yngvild Sve Flikke, sorti en 2021) et Thomas vivent à Oslo. Lui, artiste, commence à se faire un nom dans le milieu de l’art contemporain ; elle l’accompagne, mais commence à jalouser l’attention qu’on porte à son cher et tendre (jouer les simples doublures ou la compagne en retrait, très

peu pour elle). Progressivement, Signe se laisse aller à une spirale de mensonges : pour que les spotlights se tournent enfin vers elle, elle a l’idée de s’inventer une maladie rare. En réalité, elle se shoote à un médicament dangereux, vendu sur le dark web, qui a pour effet de la détruire physiquement… Avec cette comédie noire acerbe, où le rire et l’effroi se combinent magistralement, le cinéaste Kristoffer Borgli pousse les curseurs loin. Il fabrique des antihéros imbuvables, obsédés par leur image, et aspire le spectateur dans ce jeu de miroirs narcissique. Il se joue du vrai et du faux, notamment grâce à des regards caméra malaisants ; ou à des projections mentales qui, alternant storytelling et expériences réellement vécues, détraquent le récit. Sans concession, il nous oblige à regarder ce qui tache – parfois littéralement : les fringues crades de Signe, puis son visage massacré sont autant d’éléments qui viennent salir le décorum propret de la société norvégienne. Autour de ce couple affreux, sale et méchant, le réalisateur par-
vient surtout à traquer les phénomènes flippants produits par cette société de l’ostentatoire. Car, si Signe et Thomas peuvent s’autoriser à aller jusque-là, c’est qu’ils ont saisi les codes qui permettent aux quidams d’exister, pendant un temps au moins. Le fameux quart d’heure de célébrité warholien n’est possible que parce qu’il existe des structures médiatiques pour le soutenir, et c’est là que le film, au-delà d’une simple mais vaine posture provocatrice, devient politique : il montre une agence de communication qui, sous couvert d’inclusivité, est profondément raciste et validiste ; une presse avide de récits sensationnalistes, qui ne s’occupe même plus de vérifier l’authenticité des informations ; un monde de l’art fermé, aristocratique, obsédé par les phénomènes de mode du marketing… La créature que devient Signe, aussi fascinante que repoussante (on la verrait d’ailleurs bien s’aventurer dans le cinéma de David Cronenberg), n’est pas qu’un phénomène de foire : elle est le résultat ultime, la conséquence directe d’une société normative qui se drape derrière une fausse éthique. Après avoir vu le film, on comprend pourquoi des cinéastes aussi radicaux que John Waters (le trajet chaotique de Divine dans Female Trouble, sorti en 1974, rappelle d’ailleurs celui de Signe) et Ari Aster, qui en ont fait l’éloge, l’ont tant aimé – on est même tentés de penser que Borgli sera leur digne successeur nordique.
69 Sorties du 10 mai au 7 juin <---- Cinéma mai 2023 – no 197
SORTIE LE 31 MAI
Sick of Myself de Kristoffer Borgli, Tandem (1 h 37), sortie le 31 mai
JOSÉPHINE LEROY
À travers les explorations sexuelles d’une étudiante en droit qui s’essaie au BDSM, la Brésilienne Júlia Murat analyse brillamment les enjeux liés aux oppressions. Elle met en scène une actrice intense, Sol Miranda, et un triangle amoureux avec une grande douceur. Léopard d’or l’été dernier à Locarno.
Au Brésil, Simone, la vingtaine, est étudiante en droit le jour et camgirl la nuit. Deux mondes a priori bien séparés qu’elle concilie pourtant autour d’un problème qui la prend aux tripes : les violences faites aux femmes et aux Noirs. Alors que, dans ses cours, les débats entre profs et étudiants se crispent autour du rôle de la loi dans l’atténuation ou l’aggravation des oppressions, on sent que se produit chez Simone une véritable libération quand elle allume sa webcam le

RÈGLE 34
SORTIE LE 7 JUIN
soir et qu’elle répond aux demandes osées de clients anonymes. Vaste question que celle de la violence et de la contrainte qui peuvent anéantir des individus ou bien leur donner un plaisir intense – les deux étant bien souvent entremêlés. Suivant un montage parallèle et une construction binaire pendant un moment (les cours de droit d’un côté, les explorations sexuelles de plus en plus intenses et borderline de l’autre), le film montre, d’abord de manière un peu rigide, ce double mouvement autour de la violence. Jusqu’à ce qu’adviennent des rapprochements et des jeux sexuels entre Simone, sa partenaire de self-défense et son coloc queer. Cette fluidité, dépeinte avec une douceur et une simplicité confondantes, allège le côté démonstratif du récit. Tout comme la performance de Sol Miranda, actrice à la carrure démente, qui se prête corps et âme au projet pour lui donner chair et équilibrer les envolées théoriques. La bonne idée de la réalisatrice est justement d’avoir fait du personnage de Simone un être plus corporel que bavard quand il s’agit de communiquer à propos de ses propres rouages. On comprend ainsi ses intentions et ses désirs
au travers de ses gestes, contrôlés ou non, qui parfois la surprennent en même temps que nous. Cru dans certaines images mais sans aucune gratuité, Règle 34 montre avec beaucoup d’empathie une héroïne qui tente d’apprendre à jouer avec les règles, y parvient dans certains cas, pas dans d’autres. C’est cette non-linéarité de parcours qui, peut-être, touche et intéresse le plus en nous permettant d’appréhender les intrications et les fluctuations si diablement complexes, entre ordre et chaos, douceur et violence, désir et oppression.
Règle 34 de Júlia Murat, Wayna Pitch (1 h 40), sortie le 7 juin
TIMÉ ZOPPÉ
70 Cinéma > Sorties du 10 mai au 7 juin no 197 – mai 2023
Sol Miranda, actrice à la carrure démente, se prête corps et âme au projet.

17 → 26 MAI ET RETROUVEZ LA SÉLECTION PRÈS DE CHEZ VOUS DU 7 AU 18 JUIN
LE VRAI DU FAUX
SORTIE LE 7 JUIN
Un beau jour, Armel Hostiou découvre qu’il existe un deuxième profil Facebook à son nom, avec des photos de lui, et dont l’auteur organise des castings factices à Kinshasa. Il se rend alors en République démocratique du Congo pour retrouver son double et faire fermer le faux compte. Cette arnaque fondée sur une usurpation d’identité devient le point de départ du
quatrième long métrage du cinéaste. Inspecteur Gadget perdu dans les rues de Kinshasa, le Français, aidé par deux artistes rencontrés sur place, joue avec les codes de la comédie policière pour mettre la main sur l’usurpateur. Un marabout finit par lui donner la clé : il faut qu’il accepte d’être lui-même le double. Le vrai usurpateur devient alors le sujet d’un faux film qui déploie des ramifications de questionnements sur la dette du colonialisme, le miroir aux alouettes du numérique et la domination économique systémique qu’exercent les hommes sur les femmes.
À travers le regard candide d’un étranger perdu, le portrait de cette ville tentaculaire recèle aussi une réflexion sur le cinéma. En traquant le mensonge, Le Vrai du faux dévoile une vérité, celle d’une jeunesse prête aux sacrifices et aux compromissions pour le rêve d’un changement de vie.
MY LOVE AFFAIR WITH MARRIAGE
SORTIE LE 7 JUIN
Mention du jury à Annecy en 2022, ce coming-of-age d’animation narre l’histoire d’une étudiante rebelle de l’Est soviétique qui se confronte à ses idéaux d’amour et de mariage. Un film pédagogique et plein d’imagination.


Zelma, jeune fille lettonne née dans l’exU.R.S.S., en est persuadée depuis qu’elle est petite : plus tard, elle devra se marier. Les figures féminines qui l’entourent, notamment sa mère, lui ont bien fait comprendre que ce destin matrimonial attend toutes les femmes respectables. Dans son imaginaire foisonnant, elle s’est armée d’une chorale de trois sirènes mythologiques pour embrasser ce rôle d’épouse, mais, en grandissant, les signes d’une résistance au patriarcat se développent de plus en plus… Comme dans
son précédent long métrage, Rocks in My Pockets, dans lequel la réalisatrice raconte les rouages de la dépression dans sa famille, Signe Baumane s’inspire largement de son enfance, et tente de s’analyser à travers sa construction sociale et sa génétique. Ainsi, les réactions de Zelma vis-à-vis des hommes (amour, colère, rejet…) se comprennent à l’aune d’explications neurologiques données par le personnage de Biologie autour d’une carte mentale de l’adolescente. Pari étonnant mais gagnant pour ce film à l’animation originale (les protagonistes cartoonesques aux yeux écarquillés sont placés dans des décors en carton), qui en fait un manifeste féministe à la fois singulier et profondément universel.
My Love Affair With Marriage de Signe Baumane, Tamasa (1 h 48), sortie le 7 juin
ÉLÉONORE HOUÉE
Zelma s’est armée d’une chorale de trois sirènes
mythologiques pour embrasser ce rôle d’épouse.

72 Cinéma > Sorties du 10 mai au 7 juin no 197 – mai 2023
Dans Le Vrai du faux, le cinéaste français Armel Hostiou documente le voyage qui l’a mené à Kinshasa, en République démocratique du Congo, sur les traces d’un homme qui se fait passer pour lui.
Le Vrai du faux d’Armel Hostiou, Météore Films (1 h 22), sortie le 7 juin
RAPHAËLLE PIREYRE
RÉTROSPECTIVE JEAN EUSTACHE

Après la (re)découverte sur grand écran de son chef-d’œuvre légendaire La Maman et la Putain l’an dernier, treize films de Jean Eustache (fictions, courts métrages, documentaires, essais) ressortent en salles en copies restaurées.
L’événement que représente cette rétrospective tant attendue permet enfin d’appréhender l’intégralité de l’œuvre aussi brève qu’unique de Jean Eustache (lire p. 4). Et cela ne rend que plus éclatante la cohérence poétique qui la traverse de part en part. Une sentence claque, au milieu de Mes petites amoureuses (1974) : « Tu veux faire le malin, mais tu seras comme nous, toujours un pauv’ type. » Elle est d’autant plus
marquante qu’elle surgit presque par effraction dans la bouche de Maurice Pialat – cinéaste camarade, si proche dans ses manières et ses exigences –, venu, le temps d’une scène, faire la leçon au héros incarné par Martin Loeb, alter ego fictionnel du jeune Eustache. Les figures de « pauv’ types », de combinards, de flambeurs, de goujats, de vicelards peuplent son œuvre et ne cessent de se faire écho. Les péroraisons d’Alexandre dans La Maman et la Putain (1972) sont aussi vaines et désenchantées que la drague dominicale piteuse des deux amis des Mauvaises fréquentations (1967), que les confidences perverses et irrécupérables de Jean-Noël Picq et Michael Lonsdale dans Une sale histoire (1977) ou que la bonhomie morale des discours du maire de Pessac, présidant les fêtes anachroniques de la rosière dans La Rosière de Pessac (1969). Ces divers éclats de médiocrité masculine, montrés sans complaisance, sont peutêtre autant d’autoportraits tristes. Dans les mondes d’Eustache, tout repose sur
le langage, diffracté en une multitude de registres contradictoires dispersés à travers les films. La parole blanche et raréfiée raidit Le Père Noël a les yeux bleus (1967) ou Mes petites amoureuses (1974). Les verbiages cuistres portent les films parisiens, mais se vidangent dans des logorrhées intimes qui s’apparentent à des libérations. Le dispositif dépouillé de Numéro zéro (1971) est un écrin pour les mots inouïs d’Odette Robert, la grand-mère du cinéaste, refaisant avec droiture et malice le roman de sa vie trop ordinaire. Les puissances mêlées du récit et du sexe se troublent et se déglutissent dans les longues tirades célèbres de La Maman et la Putain ou d’Une sale histoire, transformées en coulis sonore, visqueux et cru. L’amour est littéralement un vomi incandescent. L’obscénité est ailleurs, dans les langages officiels et cérémoniels, dans les mots du pouvoir : la graphologue d’« Offre d’emploi » (1982), segment de la série télévisée Contes modernes, expédie ses absurdes conclusions psychologiques pour cataloguer les candidats. À cette violente inconséquence, Eustache oppose le rire : les dissociations de sens, qui s’opèrent aussi bien dans la description ivre du Jardin des délices de Jérôme Bosch (1980) que dans son ultime court métrage, Les Photos d’Alix (1980), sonnent comme une hilarante revanche des ratés.


73 Sorties du 10 mai au 7 juin <---- Cinéma mai 2023 – no 197 IRVING PENN, COMME DES GARÇONS PRINTEMPS-ÉTÉ 1997, COLLECTION BODY MEETS DRESS, DRESS MEETS BODY », VOGUE PARIS AVRIL 1997 MANNEQUIN CHRISTINA KRUSE © THE IRVING PENN FOUNDATION CONDÉ NAST— CONCEPTION GRAPHIQUE OFICINA AU PALAIS GALLIERA DU 7 MARS AU 16 JUILLET 2023 * 1997 BIG-BANG DE LA MODE #EXPO1997 10, AVENUE PIERRE 1ER DE SERBIE 75116 PARIS RÉSERVATION CONSEILLÉE SUR 1997 FASHION BIG
BANG
7 JUIN
SORTIE
Rétrospective Jean Eustache Treize films, Les Films du Losange, sortie le 7 juin
THOMAS CHOURY
CALENDRIER DES SORTIES
Hawaï de Mélissa Drigeard

Warner Bros. (1 h 44)


Hawaï. 13 janvier 2018. 8 h 07. Fausse alerte au missile balistique. Persuadés qu’ils vont mourir, des amis venus passer là leurs vacances se disent tout ce qu’ils n’ont jamais osé s’avouer.
War Pony de Gina Gammell et Riley Keough
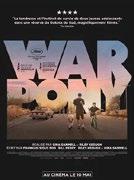
Les Films du Losange (1 h 54)



lire p. 62
Dans le Dakota du Sud, Bill, 23 ans, cherche à joindre les deux bouts tandis que Matho, 12 ans, est impatient de devenir un homme. Tous deux tentent de tracer leur propre voie.
99 Moons de Jan Gassmann
La Vingt-Cinquième Heure (1 h 51)
Tout oppose Bigna et Frank. Pourtant, leurs vies entrent en collision et s’unissent, entre attraction sexuelle et désir de liberté, déclenchant une histoire d’amour qui s’égrène sur 99 lunes.

Le Cours de la vie de Frédéric Sojcher
Jour2fête (1 h 30)
Noémie retrouve son amour de jeunesse, un directeur d’école de cinéma. À travers une master class, elle apprend à Vincent et ses élèves qu’écrire un scénario c’est vivre passionnément.
L’Exorciste du Vatican de Julius Avery
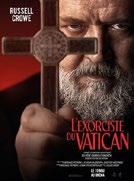
Sony Pictures (1 h 43)
Le père Gabriele Amorth, exorciste en chef du Vatican, enquête après la découverte d’un garçon possédé. Ses investigations le mèneront à dévoiler une conspiration séculaire.
Fairytale
d’Alexandre Sokourov
Les Films de l’Atalante (1 h 18)

Depuis quelque temps, on entend des voix dans la nuit, des fragments de questions, des gémissements… de millions de voix. Cette nuit, les tréfonds du ciel se sont ouverts…
La Fille d’Albino Rodrigue de Christine Dory ARP Sélection (1. h 33)
Rosemay, 16 ans, vit en famille d’accueil et ne rejoint sa famille biologique que pour les vacances. Un jour, son père n’est pas là pour l’accueillir comme prévu, et semble s’être évaporé.
Neptune Frost de Saul Williams et Anisia Uzeyman Damned (1 h 45)
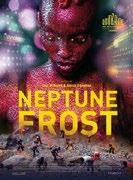
Évoluant dans une société autoritariste où la technologie règne en maître, Matalusa rencontre Neptune, un·e hackeur·se intersexe. De leur union va naître une insurrection virtuelle et surpuissante.
On a eu la journée bonsoir de Narimane Mari
La Traverse (1 h 01)
Mourir est une aventure, la dernière, et nous l’avons vécue. Mais ce projet de film est comme un futur. Michel s’y est impliqué jusqu’au bout, et je l’entends me dire : « Il n’y a pas de bout. »

Le Paradis de Zeno Graton

Rezo Films (1 h 23)

Joe, 17 ans, est sur le point de sortir d’un centre fermé pour mineurs délinquants. Mais l’arrivée d’un nouveau jeune, William, va remettre en question son désir de liberté.
Le Principal de Chad Chenouga

Le Pacte (1 h 22)
Sabri Lahlali, principal adjoint d’un collège de quartier, est prêt à tout pour que son fils, sur le point de passer le brevet, ait le dossier scolaire idéal.
Sakra La légende des demi-dieux de Donnie Yen Eurozoom (2 h 10)
Royaume de Chine, xe siècle. Deux clans s’affrontent : les Song et les Khitan. Accusé à tort d’avoir tué un chef de son propre clan, Qiao Feng est banni. Il doit alors prouver son innocence.
The Wild One de Tessa Louise-Salomé

New Story (1 h 34)
Jack Garfein a vécu plusieurs vies. The Wild One nous fait découvrir la vision d’un homme dont la vie entière fut tournée vers l’idée que la création artistique est un acte de survie.
Jeanne du Barry de Maïwenn
Le Pacte (N. C.)
Jeanne Vaubernier, avide de s’élever socialement, séduit le comte du Barry. Il la présente au roi Louis XV qui en tombe amoureux. Mais personne ne veut d’une fille des rues à la cour.
L’Arbre à vœux de Ricard Cussó Alba Films (1 h 30)
Les animaux vivent en harmonie dans la Cité Sanctuaire, protégée par un arbre à vœux sacré. Jusqu’au jour où Kerry met en péril la paix qui y régnait et doit alors réparer ses erreurs.
74 no 197 – mai 2023 Cinéma > Sorties du 10 mai au 7 juin
MAI 10
MAI
MAI 16
17
lire p. 64 lire p. 60 lire p. 44 lire p. 14 et 64 lire p. 62 lire p. 16 lire p. 66
Fast & Furious X de Louis Leterrier
Universal Pictures (2 h 21)

Après bien des missions, Dom Toretto et sa famille ont su distancer tous les adversaires qui ont croisé leur route. Ils sont aujourd’hui face à leur ennemi le plus terrifiant et le plus intime.
L’Homme debout de Florence Vignon Orange Studio (1 h 26)

Pour décrocher un CDI dans l’entreprise de papier peint qui vient de l’engager, Clémence Alpharo doit pousser Henri Giffard vers une retraite anticipée. Mais cette mission se révèle difficile.
Ramona fait son cinéma d’Andrea Bagney UFO (1 h 20)

De retour à Madrid avec son petit-ami, Nico, Ramona veut tenter sa chance comme actrice. La veille d’une première audition, elle fait une rencontre pleine de promesses.
Sublime de Mariano Biasin
Outplay Films (1 h 40)
Manuel, 16 ans, est un adolescent argentin comme les autres. Mais sa vie se complique lorsqu’il commence à ressentir quelque chose de spécial pour son meilleur ami Felipe.

Shinya Tsukamoto [en 4 films]
Rétrospective, quatre films

Carlotta
Depuis la fin des années 1980, le réalisateur
Shinya Tsukamoto s’est imposé comme l’un des maîtres du cinéma transgressif nippon avec des œuvres radicales et nerveuses.

MAI 24
L’Amour et les Forêts de Valérie Donzelli Diaphana (1 h 45)

Blanche rencontre Grégoire. Tous deux s’attachent très vite et déménagent ensemble. Mais Grégoire se révèle possessif et dangereux, isolant peu à peu Blanche des siens.
Les Chevaliers du zodiaque de Tomasz Bagiński Sony Pictures (1 h 52)

Un adolescent aux pouvoirs insoupçonnés est propulsé dans un autre monde. S’il veut survivre, il devra affronter son destin et tout sacrifier pour prendre place parmi les Chevaliers du zodiaque.
Faces cachées de Joe Lawlor et Christine Molloy Destiny Films (1 h 40)

Rose décide de contacter Ellen, sa mère biologique, et actrice à succès, qu’elle n’a pas connue. Réticente, cette dernière finit par révéler un secret qu’elle a caché pendant plus de vingt ans.

La Grande Bouffe de Marco Ferreri Tamasa (2 h 05)
Quatre amis gourmets et gourmants s’enferment tout un week-end à la campagne et organisent une « bouffe » gigantesque.

La maleta de Jorge Dorado KMBO (1 h 48)

Mario travaille dans un bureau d’objets trouvés. Un jour, il trouve dans une valise des vêtements et des ossements d’enfants. Il décide de mener ses propres recherches, au péril de sa vie.
L’Odeur du vent de Hadi Mohaghegh Bodega Films (1 h 30)

Dans une maison isolée en Iran, un homme et son fils alité attendent qu’un électricien répare leur transformateur en panne. La recherche de la pièce manquante est synonyme d’aventure.
Omar la Fraise d’Elias Belkeddar StudioCanal (N. C.)
Après avoir régné sur le milieu du banditisme français, Omar la Fraise et son acolyte Roger doivent accepter un nouveau mode de vie alors qu’ils sont habitués à la débauche et à la violence.
La Petite Sirène de Rob Marshall Walt Disney (2 h 15)

Ariel, fille du roi Triton, est une jeune sirène fougueuse et aventurière. Mais, alors qu’il est interdit aux sirènes d’interagir avec les humains, elle tombe amoureuse du prince Éric.

75 Sorties du 10 mai au 7 juin <---- Cinéma Paris est pataphysique. 29 mars –27 août 2023 Philippe Starck #ExpoStarck Réservation conseillée sur www.carnavalet.paris.fr Photographie : Yann Deret Design graphique : Atelier Pierre Pierre
lire p. 66
lire p. 12
lire p. 18
lire p. 67
lire p. 6
2023 – no 197
lire p. 16
mai
MAI
Aux masques citoyennes de Florent Lacaze

Daisy Day Films (1 h 38)


Printemps 2020. La population est confinée. Un patron de P.M.E. recrute 250 couturières pour fabriquer les masques qui libéreront sa région. Mais tout n’est pas gagné d’avance.
Le Croque-Mitaine de Rob Savage
Walt Disney (N. C.)
Sadie et Sawyer, encore sous le choc de la mort de leur mère, ne trouvent pas de soutien auprès de leur père, thérapeute. Un jour, un patient se présente à l’improviste…
L’Île rouge de Robin Campillo

Memento (N. C.)
Début des années 1970, sur une base de l’armée française à Madagascar, les militaires et leurs familles vivent les dernières illusions du colonialisme.
L’Improbable Voyage d’Harold Fry de Hettie MacDonald

Wild Bunch (1 h 48)
Tout juste retraité, Harold Fry mène une vie maussade aux côtés de sa femme, Maureen. Lorsqu’il apprend qu’une amie est mourante, il entame un périple de 700 kilomètres à pied pour lui donner une lettre.
Inland Empire de David Lynch


Potemkine Films (2 h 52)
Nous voici plongés dans une histoire de mystère, l’énigme d’un monde au cœur des mondes, le secret d’une femme en proie à l’amour et aux tourments…
Lynch/Oz
d’Alexandre O. Philippe Potemkine Films (1 h 48)


Alexandre O. Philippe a invité six critiques et cinéastes américains et leur a donné carte blanche pour explorer leur propre théorie sur la relation entre Lynch et Oz.
Mon père et moi de Laura Terruso Metropolitan FilmExport (1 h 29)
Encouragé par sa fiancée, Sebastian invite son père, modeste coiffeur italo-américain, à faire la connaissance de sa très riche et excentrique belle-famille. Un véritable choc des cultures.
Renfield de Chris McKay Universal Pictures (1 h 33)


Après des siècles de servitude, Renfield est enfin prêt à s’affranchir de son maître, Dracula. À la seule condition qu’il arrive à mettre un terme à la dépendance mutuelle qui les unit.

Sick of Myself

de Kristoffer Borgli Tandem (1 h 37)
Signe, qui se croit supérieure, feint une maladie rare pour attirer l’attention. Le mensonge fonctionne si bien qu’elle finit par être prise à son propre jeu.
Sparta d’Ulrich Seidl Damned (1 h 39)

La quarantaine passée, Ewald cherche un nouveau départ dans l’arrière-pays roumain. Face à la méfiance des villageois, il est obligé d’affronter une vérité qu’il a longtemps refoulée.
Spider-Man
Across the Spider-Verse de J. Dos Santos, K. Powers et J. Thompson Sony Pictures (N. C.)

Après avoir retrouvé Gwen Stacy, SpiderMan est catapulté à travers le multivers, où il rencontre des spider-héros chargés d’en protéger l’existence. Mais tout ne se passe pas comme prévu.
Dernière nuit à Milan

d’Andrea Di Stefano
Universal Pictures (2 h 05)
Le policier Franco Amore effectue sa dernière nuit de service. Mais elle sera plus longue et plus éprouvante qu’il ne l’imagine et mettra en danger tout ce qui compte à ses yeux.
Des mains en or d’Isabelle Mergault Zinc Film (N. C.)
Philippe, célèbre écrivain, souffre d’un mal de dos chronique. Par chance, il rencontre Martha, une guérisseuse qui atténue ses douleurs. Une amitié étonnante se noue alors entre eux.
L’Île
d’Anca Damian Eurozoom (1 h 25)
Robinson, médecin, vit sur une île méditerranéenne qui est envahie de migrants, d’O.N.G. et de gardes. Il rencontre alors des gens extraordinaires et affronte l’absurdité de la vie.
Love Again. Un peu, beaucoup, passionnément de Jim Strouse


Sony Pictures (N. C.)
Après la mort de son fiancé, Mira envoie des textos romantiques à l’ancien numéro de celui-ci, réattribué à Rob. Journaliste, ce dernier est captivé par ses confessions et veut la rencontrer.
Low-Tech d’Adrien Bellay Jour2fête (N. C.)
À l’heure où nos sociétés misent sur la surenchère technologique, certains choisissent au contraire de s’investir dans une dynamique qui prône la sobriété : la low-tech.
Marinette de Virginie Verrier

Camila sortira ce soir d’Inés María Barrionuevo Outplay Films (1 h 43)
Pour aider sa grand-mère malade, Camila quitte son lycée public et sa ville pour une institution privée traditionaliste à Buenos Aires. Elle y rencontre Clara, une camarade qui cache un secret.

lire p. 16 et 42
The Jokers / Les Bookmakers (1 h 35) Élevée par une mère courageuse qui doit faire face à un mari violent, Marinette Pichon souhaite devenir joueuse de foot professionnelle. Elle part aux U.S.A. pour suivre son rêve.
My Love Affair With Marriage de
Signe Baumane Tamasa (1 h 48)
lire p. 72
Zelma a toujours été persuadée que l’amour résoudrait tous ses problèmes. Mais à mesure qu’elle grandit, plus elle essaie de rentrer dans le moule, plus son corps entre en résistance…
76 no 197 – mai 2023 Cinéma > Sorties du 10 mai au 7 juin
31 JUIN 07
lire p. 69
lire p. 68
lire p. 26
lire p. 67
lire p. 68
Le Processus de paix
d’Ilan Klipper
Le Pacte (1 h 32)
lire p. 50
Quand on s’aime mais qu’on ne se supporte plus, qu’est-ce qu’on fait ? Pour ne pas se séparer, Marie et Simon établissent la « charte universelle des droits du couple ».
Règle 34 de Júlia Murat

Wayna Pitch (1 h 40)
lire p. 70
Le jour, Simone est étudiante en droit, engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes. La nuit, elle est camgirl, explorant ses fantasmes masochistes.
Rétrospective Jean Eustache

Rétrospective, dix films
Les Films du Losange


lire p. 4 et 73
Rétrospective intégrale de l’œuvre de Jean Eustache : treize films restaurés en 4K, dont la plupart n’étaient plus visibles.

Transformers

Rise of the Beasts de Steven Caple Jr.
Paramount Pictures (N. C.)
Ce nouveau volet se déroule au cœur des années 1990 et nous emmène aux quatre coins du globe.
Le Vrai du faux d’Armel Hostiou

Météore Films (1 h 22)
lire p. 72
Je découvre que j’ai un second profil Facebook : un faux Armel Hostiou, avec de vraies photos de moi. Face à l’impossibilité de clôturer ce compte, je pars à la recherche de mon double…
Wahou ! de Bruno Podalydès UGC (N. C.)
lire p. 58
Catherine et Oracio, conseillers immobiliers, ont pour but de provoquer un coup de cœur chez les acheteurs potentiels, leur faisant oublier les défauts des biens visités.
77 Sorties du 10 mai au 7 juin <---- Cinéma mai 2023 – no 197 Laissez-vous guider
mk2curiosity.com Canine, Yórgos Lánthimos © 2009 BOO PRODUCTIONS ΕΛΛΗΝΙΚΟ KENTPO KINHMATOΓPAΦOY ΓIΩPΓOΣ
Devenez membre du club ciné en ligne de mk2
Synopsis officiels
CULTURE
MARION SIÉFERT RÉALITÉ
AUGMENTÉE
carrière : Le Grand Sommeil. Un solo dans lequel la détonante comédienne Helena de Laurens jouait en intermittence son rôle
Elle poursuit depuis ses expérimentations scéniques, souvent colonisées par des réflexions sur le numérique, mais aussi sur
Remarquée pour Le Grand Sommeil, sa pièce dérangeante sur un spectacle avorté avec une enfant, en 2018, et pour le solo _jeanne_dark_, diffusé en live sur Instagram en 2020, tous deux portés par la démente Helena de Laurens, Marion Siéfert met en scène dans sa nouvelle pièce, Daddy, l’emprise d’une ado immergée dans le métavers. Portrait d’une jeune metteuse en scène qui ose jouer avec le numérique, les références cinéphiles et la distorsion de la réalité pour dépeindre la jeunesse contemporaine.


Affable mais pas très bavarde, Marion Siéfert ne s’étale pas pour parler de son travail. Installée dans le café lumineux du théâtre de La Commune à Aubervilliers, elle s’interrompt régulièrement pour saluer celles et ceux qui entrent. Artiste associée à ce lieu, la trentenaire aux longs cheveux châtains a ici ses petites habitudes. C’est d’ailleurs dans cette salle qu’on découvrait, en 2018, le hit qui a lancé sa
et celui d’une enfant, en esquissant des grimaces dérangeantes en kilt et col roulé rouge. Une performance encore jouée récemment à Paris, à la frontière avec la danse, qui tranche avec la forme attendue du théâtre. Marion Siéfert fait justement un peu figure d’outsider dans le milieu. Recalée du conservatoire municipal d’Orléans (la ville où elle a grandi), l’aspirante comédienne s’envole à Berlin pour poursuivre des études de littérature allemande. Celle qui s’essayait enfant à la conception de films et de spectacles trouve sa voie à travers des formes théâtrales plus expérimentales, à l’instar du collectif féministe germanique She She Pop ou de la compagnie anglaise Forced Entertainment, qui se plaisent à jouer avec le dispositif théâtral. Elle montait une première pièce en 2016, 2 ou 3 choses que je sais de vous, dans laquelle elle dressait le portrait des spectateurs et des spectatrices présents à partir d’infos disponibles sur leur profil Facebook.


l’enfance et l’adolescence. Étrangement, la metteuse en scène s’en défend : l’enfance n’est pas son « cheval de bataille ».
JEUNESSE EXPOSÉE
Pourtant, Le Grand Sommeil était hanté par Jeanne, une enfant de 10 ans qui habitait les grimaces d’Helena de Laurens. La comédienne y incarnait la petite cousine de Marion Siéfert pour raconter le projet avorté de collaboration avec cette enfant, rendu impossible par le manque de moyens de production. Avec le même casting, dans _jeanne_dark_ ( 2020), elle mettait en scène Jeanne, ado de 16 ans – originaire d’une famille catholique de la banlieue pavillonnaire d’Orléans, comme Marion Siéfert – moquée par ses camarades à cause de sa virginité. Elle explosait
en live sur Instagram, où le spectacle était diffusé en même temps qu’il était joué sur scène Comme pour ces deux projets très remarqués, elle a aussi injecté dans sa dernière pièce, Daddy, sa propre expérience d’enfant et d’ado. Avec six comédiens, (sa plus grosse production jusqu’ici), elle raconte comment Mara, 13 ans, tombe sous l’emprise d’un homme bien plus âgé, Julien, 27 ans, rencontré par le biais d’un jeu vidéo en ligne. Le schéma des violences se dessine petit à petit lorsqu’il la convainc de la sponsoriser en tant que « daddy » dans un tout nouveau jeu du métavers. Dans cette dystopie sur le voyeurisme et la pédocriminalité, les jeunes joueuses et leurs parrains capitalisent sur leurs talents pour offrir leur image au monde, toujours avide de nouveauté. Si Siéfert n’a pas vécu cette histoire, elle s’est toutefois replongée dans ses souvenirs d’ado pour créer le personnage de Mara : « Je me souviens qu’à 13 ans j’avais cette envie très forte de grandir, de me rapprocher du monde des adultes, de vivre des choses de grands. Je me souviens aussi de l’importance de ce regard pour obtenir de la reconnaissance, et de cette envie de plaire à des hommes plus âgés pour se valoriser. Pour Daddy, je me suis fondée sur ma propre expérience, que j’ai croisée avec des récits d’agressions sexuelles que j’ai collectés », raconte la metteuse en scène.
L’enfance et l’adolescence n’ont donc rien de joli, de lisse ou d’idéalisé chez Marion Siéfert. Avec Daddy, le sujet est encore moins regardable, puisqu’elle s’attaque aux violences sexuelles sur mineur, en pointant l’hypersexualisation marchande du corps des jeunes femmes. Si les adultes détournent souvent les yeux, la jeunesse, elle, saisit l’importance qu’il y a à regarder
78 Culture no 197 – mai 2023
La prédation sur les réseaux est un sujet qui touche beaucoup la jeune génération.
Spectacle
© Matthieu Bareyre
© Matthieu Bareyre
2 ou 3 choses que je sais de vous
2 ou 3 choses que je sais de vous
© Renaud Monfourny
© Renaud Monfourny Daddy Daddy
celles-ci en face. « J’ai été assez surprise, lors des auditions pour le rôle de Mara, que les adolescentes soient très partantes pour porter ces sujets. La plupart me disait qu’elles vivaient en permanence la sexualisation et la prédation sur les réseaux sociaux, que c’était important pour elles d’en parler. Je pense que ce sujet touche énormément cette génération », précise Siéfert. Pour incarner l’ado victime, elle a choisi une jeune interprète non professionnelle, Lila Houel, 16 ans. Un souci de vraisemblance, mais pas seulement : « Quand Stanley Kubrick a fait Lolita , Hollywood lui a imposé, pour des questions de censure, que l’actrice n’ait pas 13, mais 17 ans, et qu’elle fasse plus femme. Cela a eu l’inverse de l’effet escompté, en donnant l’impression au public qu’elle n’était pas si jeune que ça. Comme nous sommes baignées dans une multitude d’images de femmes très jeunes hypersexualisées par la pub, cette sexualisation nous semble normale. »
REPRÉSENTER L’INNOMMABLE
Pour représenter la jeunesse contemporaine, elle mobilise au fil de ses spectacles le numérique, les réseaux sociaux et le jeu vidéo. Dans _jeanne_dark_, Helena de Laurens jouait avec les filtres Instagram et les angles d’un smartphone pour distordre son visage, ce qui modifiait son jeu et troublait, par cette proximité inhabituelle, sa relation avec le public. Dans Daddy, le numérique ouvre aussi de nouveaux terrains d’expérimentation, démultipliant les possibilités du théâtre puisque la vraisemblance n’est plus de mise dans cet univers virtuel. Une myriade de références au cinéma (la faute à son coauteur, le cinéaste Matthieu Bareyre) et au rap font se croiser les générations, que ce soit des citations de La La Land de Damien Chazelle et du Dracula de Francis Ford Coppola ou des références à la saga Avatar de James Cameron et à Marilyn Monroe. L’accumulation d’images finit par révéler les clichés et permet de pointer la banalisation de la culture du viol qui traverse la fiction. Alors qu’on sort de notre entrevue avec Marion Siéfert avec l’impression de ne pas avoir pu totalement la cerner, on comprend qu’il va falloir plonger et replonger dans son œuvre pour mieux la saisir, en filigrane, à travers ce que son travail révèle du monde contemporain.
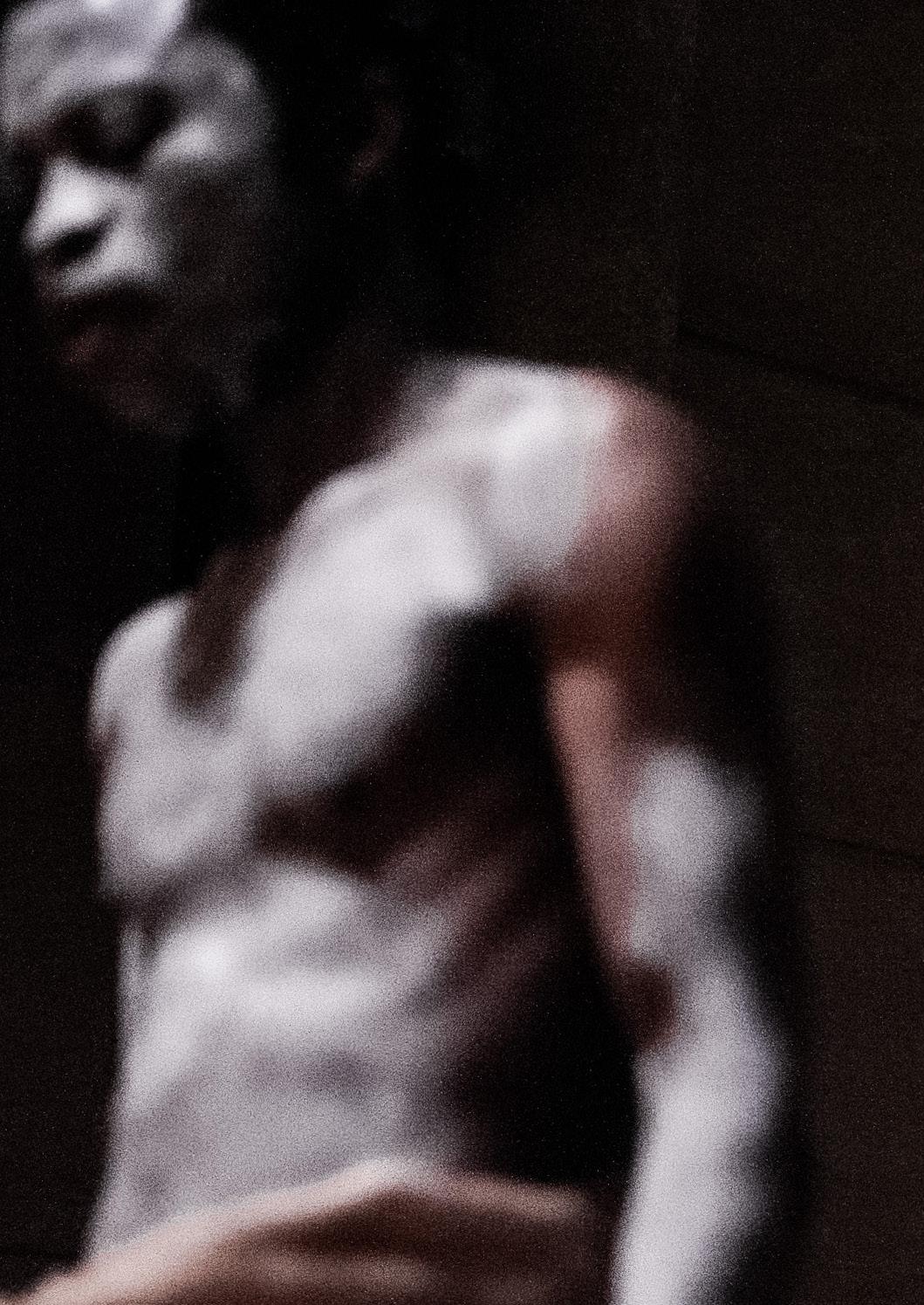
79 Culture mai 2023 – no 197 chaillot danse 14 → 17 juin Faustin Linyekula Mamu Tshi Portrait pour Amandine Faustin Linyekula My body, my archive theatre-chaillot.fr © Benjamin Mengelle zoo, designers graphiques
• BELINDA MATHIEU
Daddy de Marion Siéfert, jusqu’au 26 mai à l’OdéonThéâtre de l’Europe (3 h 30)
SÉLECTION CULTURE
NÉO-ROMANTIQUES. UN MOMENT OUBLIÉ DE L’ART MODERNE 1926-1972
En 1926, en réaction à l’abstraction moderniste, un groupe d’artistes en marge, baptisé « néo-romantiques », se propose de réhabiliter l’art figuratif. Signées Pavel Tchelitchew, Eugène et Léonide Berman, Christian Bérard ou Thérèse Debains, ces toiles dressent des ponts fascinants entre imagerie surréaliste et délires visionnaires. • Julien Bécourt > jusqu’au 18 juin au musée Marmottan Monet

MARIE LOSIER
En attendant ses biopics de la diva electropunk Peaches et du légendaire groupe The Residents, Marie Losier rassemble dans cette exposition les portraits filmés ou dessinés de musiciens hors norme issus de son entourage. Elle témoigne de la vivacité d’une fratrie underground qu’elle côtoie depuis trois décennies. • J. B.


Expos Son
ALI CHERRI
Après avoir signé le documentaire Le Barrage (sorti en salles en mars), le plasticien et réalisateur libanais revient à son exploration d’une archéologie fantasque dans laquelle la sculpture antique converge avec la taxidermie. Herbier, paravents, ossements, troncs d’arbres et oiseau empaillé forment la toile de fond de cette scénographie hybride. • J. B.

> « Ceux qui nous regardent », jusqu’au 17 juin à La Traverse – Centre d’art contemporain d’Alfortville
Livres
DES FEMMES ET DU STYLE LE PLUS GROS JEU
Envie de flamber à Vegas ? Suivez Al Alvarez sur les traces des meilleurs joueurs du monde, dans un classique de la littérature sur le poker. On double les blindes… Découvert en français avec Nourrir la bête, son reportage sur l’escalade, le journaliste Al Alvarez était aussi amateur de poker. En 1981, le New Yorker l’envoie aux World Series of Poker de Las Vegas. Il en a tiré cette enquête littéraire qui est à la fois une description de la ville, une sociologie des joueurs, une histoire du poker professionnel et une réflexion sur les splendeurs et dangers du jeu de haut niveau. Inutile de s’y connaître pour dévorer ce livre devenu un classique, même si quelques notions de base ne sont pas inutiles pour s’y retrouver dans le jargon et les variantes, Stud à cinq cartes, Hold’em, Seven High-Low, Lowball Ace-to-Five et autres Deuce-to-Seven. Le plus étonnant dans ce récit plein de démesure, ce sont les passages sur le rapport des joueurs à l’argent. Pour eux, les dollars ne sont qu’un outil abstrait – miser des sommes énormes ne leur fait ni chaud ni froid. Le style imagé d’Alvarez fait écho à l’art de la formule des joueurs qu’il interviewe, prodigues en bons mots, devises et conseils frappés au coin du bon sens. Un exemple ? « Il faut rester réaliste pour réussir. Si vous ne savez pas juger votre niveau de jeu par rapport aux autres, vous n’avez aucune chance. » L’auteur de cette phrase, Mickey Appleman, n’a pas gagné à Vegas en 1981, mais ses gains cumulés en tournoi frôlent aujourd’hui les 1,8 million de dollars. Il faut croire qu’il sait de quoi il parle ! • Bernard Quiriny > d’Al Alvarez, traduit de l’anglais par Jérôme Schmidt (Métailié, 208 p., 20 €)
LUCIE ANTUNES
Elle siffle la fin des jours sombres et bat le rappel du printemps avec Carnaval, extatique album de réveil, de fête et de guérison.
On a d’abord découvert la percussionniste virtuose sur scène, accompagnant Moodoïd, Aquaserge, Susheela Raman ou Yuksek ; avant de la retrouver jonglant entre batterie, vibraphone, marimba, glockenspiel, cloche tubulaire et ondes Martenot sur Sergeï (2019), un premier album solo libérateur qui fusionnait joyeusement percussions classiques et ambiances électroniques. Revoilà Lucie Antunes (nous) sonnant les cloches d’un Carnaval annonçant la renaissance de la nature et des corps, comme un souffle trop longtemps retenu (par la pandémie, notamment). Coréalisé avec sa sœur de cœur Léonie Pernet, cet ensemble de batteries, de percussions, de basses et de beats électroniques, de nappes synthétiques et de mantras vocaux (façon Meredith Monk ou Laurie Anderson)
Si le concept du female gaze s’est taillé une belle place dans nos imaginaires esthétiques ces dernières années, avec Des femmes et du style, on découvre le feminist gaze. L’essai détaille la particularité stylistique de textes féministes, romans, essais ou pamphlets. Une plongée littéraire érudite et savoureuse. • Hanneli Victoire. > d’Azélie Fayolle (Divergence, 23 p., 16 €)
LADERNIÈRE ÉCHAPPÉE
Dans ce premier roman, une jeune fille au cœur brisé entraîne sa grand-mère en fin de vie dans une grande fuite en avant, sous forme de road trip envers et contre tous. Dans un style fluide et vif, l’autrice dépeint avec sensibilité la relation unique qui lie les deux femmes. • H. V.
> de Léa Frédeval (Philippe Rey, 206 p, 19 €)
MÉTACURES
À la fois dévorante et emplie de lumière, la poésie de Douce Dibongo se déploie dans un recueil au style tranché. Mettant l’expérience queer et noire au cœur de son projet, l’autrice propose un puissant livre de guérison et de refuge. • H. V.
> de Douce Dibongo (Blast, 104 p., 12 €)

EMAHOY TSEGEMARIAM GEBRU
délivre ses effets bienfaisants en compositions concises mais savantes (Steve Reich rôde) à visées ostensiblement transcendantes. L’affirmation de la vie s’élance vers les grandes hauteurs tonales (« Vivant·e·s Part. I »), dans des tintinnabuli affectueux (« Faites vous des bisous ») ou des développements hyperboliques (« Mais » – signifiant « plus » en portugais), pour des polyrythmies inclusives (« Vous êtes parfait·e·s ») où la décoction hallucinogène (« Yagé ») est le souffle retrouvé, dans la danse ou l’enfantement, pour enfin sortir de soi, par la voix et la transe. Le mot « carnaval » lui-même devient motif rythmique, rauque et roulant comme un mantra chamanique, performatif, réveillant les anciens sur les rythmes d’aujourd’hui. Entre boîte à musique de nuit et transe sous un soleil ardent, un vrai rituel pour les jours à venir. • Wilfried Paris > Carnaval de Lucie Antunes (Cry Baby / InFiné)
Des pièces pour piano mélancoliques, nourries de jazz mélodieux, de poésie impressionniste (Claude Debussy, Erik Satie), de musique liturgique de l’Église copte éthiopienne et de musiques traditionnelles, voilà le miraculeux idiome musical inventé par cette compositrice éthiopienne dans les années 1960. Retrouvez son inimitable phrasé dans ces rares archives. • W. P.
> Jerusalem d’Emahoy Tsege-Mariam Gebru (Mississippi)

80 Culture no 197 – mai 2023
Gagnez des places en suivant TROISCOULEURS sur Facebook et Instagram
> « Excesso Chamalo », du 10 juin au 29 juillet à la galerie Anne Barrault
Pavel Tchelitchew, Nu, 1926
Collection de Georgy et Tatiana Khatsenkov © Maxime Melnikov
© Emahoy Tsege Mariam Music Publishing, Inc © Marine
© Rachael Woodson 2023
Keller Lucie Antunes
© Courtesy de l’artiste et galerie Anne Barrault
Réalisé par une toute petite équipe, Tchia se présente comme un conte enfantin inspiré de la culture calédonienne, au cœur d’un décor insulaire aux couleurs paradisiaques. Porté par une héroïne aux pouvoirs aussi badass que son charisme, le jeu abrite en réalité une odyssée épique, digne des plus grands jeux d’aventure. • Yann François










> (Kepler Interactive | PC, PS4, PS5)



Spectacles
La réussite d’un remake tient souvent à sa capacité à démontrer que son modèle originel avait déjà tout d’un classique indémodable. En 2005, Resident Evil 4 révolutionnait le jeu d’horreur en même temps que sa propre saga. En 2023, il n’a rien perdu de sa hargne ni de son sens du tempo, impeccable de bout en bout. • Y. F.

> (Capcom | PC, PS4, PS5, Xbox Series)




MÉDÉE [THÉÂTRE]




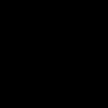
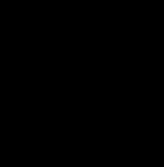



JUNE EVENTS [DANSE ]





















Médée
Jeune metteuse en scène qui a le vent en poupe, Lisaboa Houbrechts étonne grâce à sa patte pluridisciplinaire où se croisent théâtre, opéra et arts plastiques. Pour la Comédie-Française, la Flamande adapte Médée, l’infanticide sorcière mythique, qu’elle promet de teinter de son style haut en couleur. • Belinda Mathieu
> Médée de Lisaboa Houbrechts, du 12 mai au 24 juillet à la Comédie–Française
OHAD NAHARIN [DANSE]

Nina Santes nous invite dans un salon de beauté aux airs horrifiques avec Peeling Back, Julien Andujar enquête sur la disparition de sa sœur dans le cabaret délirant Tatiana, tandis qu’Aina Alegre déploie des paysages cosmiques dans l’hypnotique THIS IS NOT (an act of love & resistance). Un condensé excitant d’artistes émergents se dévoilent au festival June Events. • B. M.
> du 30 mai au 17 juin à l’Atelier de Paris
Le chorégraphe de Tel-Aviv fait de nouveau exploser la gestuelle viscérale des interprètes de la Batsheva Dance Company. Dans MOMO, leur dernière pièce, ils et elles font résonner la brutalité sensuelle enivrante de leur écriture, en faisant cohabiter deux chorégraphies sur le plateau. • B. M.
> MOMO de la Batsheva Dance Company, du 24 mai au 3 juin à la Villette (1 h)

Rares sont les jeux qui affrontent le réel et sa gravité (le deuil familial) avec une écriture aussi mature que moderne. Plus rares encore sont ceux qui le font sans tomber dans le pathos. The Wreck est de ceux-là : son histoire ne nous ménage pas, elle nous bouscule même parfois violemment, mais elle marque à vie • Y. F.
> (The Pixel Hunt | PC, PS4, PS5, Xbox Series, Switch)












Concert
Sigur Rós revient à Paris, avec le London Contemporary Orchestra, dévoiler les titres de son très attendu huitième album. Les concerts du trio islandais, entre cérémonies post-rock et liturgies contemporaines, sont réputés être d’inoubliables maelströms de mélodies, de textures et d’émotions. Immanquable. • W. P.-
> le 3 juillet à la Philharmonie de Paris à 20 h























81 Culture mai 2023 – no 197 29 JUIN 8 JUILLET FES TI VAL SIGUR RÓS & LONDON CONTEMPORARY ORCHESTRALOUS AND THE YAKUZASAMPA THE GREATJOSÉ GONZÁLEZ JOUE “VENEER”OBONGJAYARAWIR LEON & AMALA DIANOR, GRÉGOIRE KORGNOWINTERPOL PERFORMING “ANTICS” BEN HOWARDNOVEMBER ULTRATHYLACINE & L’ORCHESTRE NATIONAL D'ÎLE-DE-FRANCEKEVIN MORBYPANDA BEAR & SONIC BOOMJEHNNY BETHHIGH SEASON (CHLOÉ & BEN SHEMIE) Conception graphique Hartland Villa ILicences R-2022-004254, R-2022-003944, R-2021-013751,R-2021-013749
Adaptation Lisaboa Houbrechts comedie-francaise.fr Paris 12 mai > 24 juil Traduction Florence Dupont Dramaturgie Simon Hatab Scénographie Anna Rizza Lumières Musique originale Niels Van Heertum Son Jeroen Kenens Travail chorégraphique Tijen Lawton Maquillages Céline Regnard Serge Bagdassarian Bakary Sangaré Suliane Brahim Anna Cervinka Élissa Alloula Séphora Pondi Léa Lopez Les comédiennes Yasmine Haller Ipek Kinay d’après Euripide
Jeux vidéo
RESIDENT EVIL 4 TCHIA THE WRECK
SIGUR RÓS
Tatiana de Julien Andujar
© Vincent
Curutchet
© Ascaf
© Hörður
Óttarsson
Chaque semaine, une sélection de films en streaming sur mk2curiosity.com

LE FESTIVAL DE CANNES SUR MK2 CURIOSITY
Pour son premier Festival de Cannes, la nouvelle version de la plateforme vidéo de mk2 voit les choses en grand avec une programmation événement autour des plus grands films des éditions passées. Avec toujours trois films gratuits par semaine et plein de surprises curieuses et décalées.
CINÉMAS
QUINZAINE DES CINÉASTES
Dans la foulée de Cannes, le mk2 Beaubourg reprend la Quinzaine des cinéastes. On y découvrira le mood de la nouvelle équipe de sélection menée par Julien Rejl (lire p. 40). L’occasion de découvrir les nouveaux films de Bertrand Mandico, de Michel Gondry ou de Hong Sang-soo.
> du 7 au 14 juin au mk2 Beaubourg
Conférences, débats et cinéma clubs
MUSIQUE CLASSIQUE ? CHICHE !
« Et si la musique classique était plus actuelle que jamais ? » Un cycle de conférences animées par Marina Chiche et ses invités, pour penser la musique classique à la lumière des enjeux de société.
> tous les jeudis du 25 mai au 29 juin au mk2 Odéon (côté st Germain) à 20 h
Pour ses premiers pas sur la Croisette, mk2 Curiosity nouvelle formule s’est fait tout beau. Dès le 11 mai, c’est parti pour trois semaines 100 % Cannes, avec des sélections imaginées par les journalistes et les programmateurs de mk2, dont une collection des plus beaux films de l’histoire du Festival. Vous découvrirez que Cannes s’est toujours engagé en faveur des cinéastes censurés, en accueillant des films interdits dans leur pays d’origine. Vous pourrez visionner Le Goût de la cerise (1997) d’Abbas Kiarostami, censuré par le régime iranien et récompensé de la Palme d’or, Travail au noir (1983) du Polonais exilé Jerzy Skolimowski, ou encore L’Oiseau d’argile (2002) de Tareque Masud, interdit au Bangladesh et en Inde.

Avant-premières, cycles, jeune public
LES SAISONS HANABI
Le distributeur Hanabi, spécialisé dans le cinéma japonais, prend ses quartiers au mk2 Bibliothèque pour projeter sept films en avant-première dans les salles françaises – parmi lesquels Love Life, le nouveau film de Kōji Fukada (lire p. 54), invité d’honneur du festival.
> du 7 au 14 juin au mk2 Bibliothèque
> Rencontre avec Kōji Fukada puis projection de son dernier film en avant-première, Love Life, au mk2 Bibliothèque, à 18 h
GOUVERNER POUR TOUS, ESTCE GOUVERNER AVEC TOUS ?
« Avons-nous tous notre place dans notre modèle de gouvernance actuelle ? » Une rencontre précédée d’une projection du documentaire Commune commune, suivie d’une discussion avec la coréalistarice Sarah Jacquet, et Mathieu Rivat.
> le 5 juin au mk2 Quai de Loire à 20 h
Retrouvez toute la programmation de mk2 Curiosity ici :




Mk2 Curiosity met ainsi en avant le Cannes engagé, à travers d’autres films révoltés, dont House Arrest (2021), charge contre la corruption et le totalitarisme qui gangrène la Russie. Un film présenté à Cannes et invisible depuis, à découvrir en exclusivité. Cet engagement s’est concrétisé après les événements de Mai 68 par la création de la Quinzaine des réalisateurs – devenue en 2022 la Quinzaine des cinéastes (lire p. 40 l’interview de Julien Rejl, nouveau délégué de la Quinzaine) –, section parallèle du Festival donnant à voir un autre cinéma, dont mk2 Curiosity vous a extrait le meilleur. • Tristan Brossat > du 11 mai au 1er juin sur mk2curiosity.com, gratuit
CÔTÉ COURT
La prochaine édition du festival Côté court aura lieu du 7 au 17 juin à Pantin. Le mk2 Quai de Seine reprend une sélection de sa section Panorama ainsi que son palmarès, tandis que la plateforme mk2 Curiosity diffusera aussi un pan de sa programmation.
> séance Panorama le 13 juin au mk2 Quai de Seine à 20 h
> séance palmarès le 19 juin au mk2 Quai de Seine à 20 h
Retrouvez toute la programmation des cinémas mk2 ici :
HEDDA : ITINERAIRE D’UNE FEMME LIBRE
« Que faut-il sacrifier dans une vie de femme artiste ? » Une rencontre avec Aurore Fattier, metteuse en scène, Hélène Frappat et Geneviève Fraisse, en partenariat avec l’Odéon-Théâtre de l’Europe, pour réfléchir au statut et au rôle des femmes artistes.
> le 5 juin au mk2 Odéon à 20 h
Retrouvez toute la programmation de mk2 Institut ici :


82 no 197 – mai 2023 Les actus mk2
Pornomelancholia de Manuel Abramovich
Le Goût de la cerise d’Abbas Kiarostami (1997) © mk2





LA CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE À PARIS 7—12 JUIN 2023 CINÉMAS LA BALEINE & LES VARIÉTÉS À MARSEILLE 2—6 JUIN 2023 30 MAI—3 JUIN 2023 CINÉMATHÈQUE DE CORSE EN CORSE Sélection courts métrages 25—31 MAI 2023 FESTIVALSCOPE.COM EN LIGNE Les films de la 62e édition en avant-première www.semainedelacritique.com Tout sur #SDLC2023
PAGE JEUX
LES MOTS CROISÉS par Anaëlle Imber t - ©Les Mots, la Muse
les mots croisés ciné
Ce mois-ci, en attendant la sortie de Barbie de Greta Gerwig (en juillet), on vous propose une grille en l’honneur des poupées, des sirènes et de toutes les figures de l’hyperféminité les plus décadentes du cinéma.


LES MOTS par Anaëlle Imber t
HORIZONTALEMENT 1. Soutenus par une colonne. Cuit au four. 2. Dépanne. Bas de gamme. Quatre à Rome. 3. Amas de sang coagulé. Portés sur le suspect 4 Projetée. Créatures de l’eau hostiles apparaissant dans la saga Harry Potter. 5. Vont avec elles. Protège les majeurs. N’a plus l’air renfermé. 6. Qui n’est pas dedans. Reliquats. 7. Do usé. 8. Évaluer la capacité. Prostituée familière. 9. Dépôts de caisses. Test pour les fortes têtes. 10. À quel endroit ? Avec lui, tout devient possible ! Espèce disparue. 11. Film musical fantastique de Rob Marshall, en salles le 24 mai. 12. Mouvements désarçonnants. Espèce. 13. Elle crée le contact. Obtint. Déchet organique. 14. Chanteuse et actrice américaine qui incarne Ariel dans la version live action de La Petite Sirène. Coupe court. 15. Bombe à vaporiser. Test Covid-19. 16. Finissent en caïds. Dialecte chinois. Allègre. 17. Tout va bien ! Poisson d’eau douce. Technétium. 18. Elle incarne l’une des poupées éponymes dans Barbie (à l’affiche dès juillet). 19. Venu au monde. 20. A en main. 21. Les enfants y jouent au sable. Transpira à grosses gouttes. 22. Fête de fin d’année. Argile antique. 23. Poussé fort. Fleur royale. 24. Ça coule de source. Artère menant droit au chœur.

VERTICALEMENT A. Cette chose-là. B. Radium. C’est tout comme C. Fleur à la boutonnière. Autrement fou. L’ogre l’aime fraîche. Cela est mieux. D. Film de Ron Howard de 1984 dans lequel le personnage de Tom Hanks tombe amoureux d’une sirène (Daryl Hannah). Interpréta. Juste ici. Préjudice, souvent grand. C’est une belle fille. E. Prises au galon. Article contracté. Se reposa longuement (se). Couleur de robe équine. F. Planche au parquet. Avoir par le passé. Fait un article. Pieu. G. Il a le cœur chaud Derrière la caméra pour le tournage de la production américano-britannique Barbie. Sur le bout de la langue H. Possessif. Deux ôtées de seize. En bref, c’est pareil. Faisons la tête. I. Garderas sa place. Ils font de longues journées. J. Façon de rire. Une partie des seniors. K. Celui-là. Brillante avocate bimbo campée par Reese Witherspoon dans La Revanche d’une blonde (2001). L. Mettre la juste part. Qui ne manque rien. Fait un avoir. M. Une grande invention. Détint. Donne de la fièvre. Police ayant du caractère. Répulsif à vampires. N. Surnom de la bande de lycéennes populaires dans le film Lolita malgré moi (2005). Test cutané. Tissu léger. O. Titre de transport. Terme d’exclusion. Assistante maternelle. Pronom P. Matières de défenses. Avança sans but. Q. Sorties d’enceinte. Les tiennes R. Abréviation papale. Inventées.
• PAR ANAËLLE IMBERT – © LES MOTS, LA MUSE
les différences
Les solutions ici :
À gauche, une image du film La Petite Sirène de Rob Marshall (au cinéma le 24 mai, lire p. 16). À droite, la même, à sept différences près.
© Walt Disney no 197 – mai 2023 84
Découvrez dans les salles mk2 nos conférences, débats et cinéma clubs



Ce que je cherche dans la parole, c’est la
réponse de l’autre. »
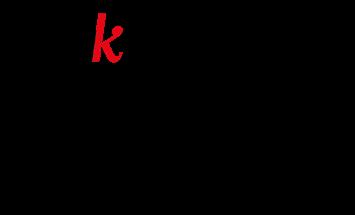
Jacques Lacan, Écrits, 1966
> no 07 / mai 2023 / gratuit magazine



Clément
Viktorovitch

Autoportrait du politologue en deux images et un objet
Camille Étienne
Crise climatique, comment sortir de l’impuissance ?

SÉLECTION LIVRES
Les meilleurs essais du printemps
«
DÉCOUVREZ L’HOTEL PARADISO UN CINÉMA DANS CHAQUE CHAMBRE mk2hotelparadiso.com
ENTRETIEN Marina Chiche
Violoniste, musicologue, femme de radio et autrice, Marina Chiche est invitée ce mois-ci par mk2 Institut pour une série de six conférences sur la musique classique en résonance avec d’autres disciplines (philosophie, neurosciences, cinéma…). À cette occasion, cette passionnée se livre sur son parcours et sur la richesse de son art, dont elle ne cesse d’élargir les frontières. Rencontre.
Vous croisez, à mk2 Institut, la musique avec la philosophie, les neurosciences, le cinéma, la politique… Comment expliquez-vous cette attention portée à l’interdisciplinarité ?
rapport à la musique, j’ai pris conscience que je ne voulais pas renoncer à continuer d’apprendre, et ce dans plein de domaines. J’étais attirée aussi bien par les matières scientifiques que littéraires, par l’histoire, par les langues, ou encore par les sciences politiques. En fait, j’aurais aimé trouver un cadre pour poursuivre, en plus des classes de violon, des études générales : une université idéale à l’image de la Castalie [province pédagogique imaginaire et ordre culturel, ndlr] du Jeu des perles de verre de Hermann Hesse – un de mes livres fétiches. Dans un premier temps, j’ai poursuivi, en parallèle du Conservatoire, une licence de littérature germanique par correspondance. Quand je suis allée me perfectionner à Vienne auprès d’un professeur russe très réputé, je m’entraînais de manière extrêmement intensive, huit à dix heures de violon par jour, mais, quand je ne jouais pas du violon, j’allais dans les bibliothèques que je dévalisais. Je dévorais des livres de littérature, d’histoire ou de philosophie. Il y avait quelque chose de très absolutiste, de presque monacal qui me comblait à l’époque ! Mais j’ai compris plus
d’être partie prenante de la société. C’est ainsi que je suis revenue au Conservatoire de Paris pour un nouveau cycle d’études, cette fois en histoire de la musique, en analyse et surtout en esthétique musicale : une discipline qui croise les savoirs, qui permet de réfléchir à partir de la musique aux autres arts et au monde.
C’est aussi une nouvelle façon de raconter l’histoire de ces musiciennes qui vous a animée…
Oui. Mon livre a eu pour vocation de combler les « silences » des historiographes et de donner à ces musiciennes de talent une juste place au panthéon de la musique !
La notion d’interdisciplinarité fait partie de mon ADN. Cela s’est d’ailleurs manifesté assez vite lors de mes études. À mon entrée au Conservatoire supérieur de Paris (CNSMDP) en violon à 16 ans, juste après mon bac, audelà de l’évidence qui s’imposait à moi par
tard que cette façon d’aborder la musique et les connaissances, de manière très solitaire – je ne suis pas soliste pour rien ! –, enfermée dans une tour d’ivoire, ne répondait pas à mon besoin de transmission, de contact et aussi à mon besoin de vivre dans le monde,
Vous avez publié, en 2021, Musiciennes de légende. De l’ombre à la lumière (First Éditions), en hommage aux femmes musiciennes interprètes des xixe et xxe siècles que l’histoire a laissées trop longtemps dans l’ombre. Racontez-nous ce projet. Ce projet a commencé en 2019 quand France Musique m’a confié la production d’une série d’été autour de la grande violoniste française Ginette Neveu [1919-1949, ndlr] dont on fêtait alors le centième anniversaire de la naissance. C’est en travaillant sur sa biographie que je me suis demandé quelles femmes avaient mené des carrières de solistes avant elle. Là où j’étais persuadée de ne trouver qu’une poignée de pionnières, j’ai en fait découvert une multitude de femmes, toutes plus exceptionnelles les unes que les autres. Je me suis alors demandé pourquoi, alors qu’elles avaient fait des carrières admirables, elles n’avaient pas été inscrites dans l’histoire. J’ai aussi découvert tous les obstacles que les femmes en général ont rencontrés pour accéder à l’enseignement supérieur et à la professionnalisation : une histoire du féminisme dont on ne m’avait jamais parlé !
Votre enquête sur ces femmes vous a-telle aidée à conforter la femme violoniste que vous êtes ?
Absolument. Et puis aussi, disons-le, #MeToo est passé par là, et ça a été une grosse prise de conscience pour moi : une bombe à fragmentation. J’ai relu mon histoire à l’aune de ce phénomène, et je me suis vraiment interrogée sur ce que j’avais subi, évité et aussi observé – alors même que je n’avais pas mis de mots dessus. Par exemple, des chefs d’orchestre en charge de programmation que j’avais évités ou dont j’avais dû repousser les avances, plus ou moins subtilement ; le fait que j’avais été régulièrement la seule femme programmée dans certains festivals de musique de chambre qui ressemblaient à des « boys’ club ». J’ai aussi remarqué que je n’avais jusqu’alors jamais joué sous la direction d’une cheffe d’orchestre et presque jamais joué d’œuvres de compositrices – heureusement cela a changé ! J’ai repensé à quelques interviews surréalistes, ou à certains commentaires, en apparence élogieux, qui évoquaient avec étonnement ma « puissance sonore » – comme si mon gabarit de jeune femme était en contradiction avec la sonorité que je produisais. Ou encore le fait qu’un cri-

no 07 – mai 2023 II mk2 Institut
« Je revendique qu’on puisse vibrer au stade comme à l’opéra ou au concert ! »
© Laurence Laborie
tique musical qualifiait un de mes disques de « joli », là où ce qualificatif n’aurait pas été employé pour parler du travail de mes collègues masculins. Un sexisme ordinaire, au fond, que j’avais l’habitude d’encaisser. Cela a été un sacré cheminement pour moi, surtout que je venais de loin. Ma construction consciente s’était faite jusque-là au-delà du genre – je me suis toujours perçue comme violoniste et non comme femme violoniste. Mais il est arrivé un moment où je n’ai pu faire l’économie de ce qui m’était renvoyé et surtout de ce qui était collectivement renvoyé aux femmes musiciennes depuis des siècles, le pire étant qu’une grande part de ces choses était intériorisée et transmise comme « normale » !
Où en sont les femmes interprètes du xxie siècle ?

Bien sûr, les choses ont beaucoup bougé, les orchestres se sont féminisés. Pour les cheffes d’orchestre et pour les femmes solistes, il y a quelques têtes d’affiche très programmées, mais la vigilance reste de mise. Il reste beaucoup de chemin à parcourir, notamment pour la programmation d’œuvres de compositrices, mais pas seulement. Audelà des chiffres et parfois des effets d’affichage, ce qui m’attriste, c’est que je n’ai pas la sensation que le paradigme change, que les stéréotypes perdent réellement de leur force dans les imaginaires collectifs. Concrètement, il est temps que les politiques interviennent de manière volontariste et que les instances publiques refusent de soutenir des programmations qui passent à côté du sujet. Il y a encore trop de programmations où les femmes font figure d’exception. On voit même encore passer – en 2023 – des programmations 100 % masculines, ce qui ne serait toléré dans aucun autre secteur.
Vous êtes, on le sait, marseillaise et grande amatrice du ballon rond. On vous a déjà entendue comparer les footballeurs et les musiciens. Qu’ont-ils en commun ?
Musiciens et sportifs partagent beaucoup : la question de la vocation, on commence parfois très jeune et on est amené à suivre des voies d’exigence et de sélection. Et puis il y a la virtuosité, le dépassement de la limite : un au-delà du geste. Il y a aussi le moment d’expérience partagée, lors d’un match ou d’un concert, qui peut être magique. Au fond, je revendique qu’on puisse vibrer au stade comme à l’opéra ou au concert, il n’y a aucune contradiction !
« Musique classique ? Chiche ! »
La violoniste Marina Chiche anime un cycle hebdomadaire de rencontres autour de la musique classique tous les jeudis, du 25 mai au 29 juin, au mk2 Odéon (côté St Germain), à 20 h
tarif : 15 € | étudiant, demandeur d’emploi : 9 € | − 26 ans : 5,90 € | carte UGC/mk2 illimité à présenter en caisse : 9 €
• PROPOS RECUEILLIS PAR MARGUERITE PATOIR-THERY
mai 2023 – no 07 Cinéma | Rétrospective | Masterclasse | Rencontres | Livre 10 – 29 mai 2023 Centre Pompidou Todd
Chimères
En partenariat média avec En partenariat avec Carol de Todd Haynes © Courtesy of Number 9 Films Ltd Photography of Wilson Webb © Centre Pompidou Conception graphique direction de la communication et du numérique, 2023 En présence du cinéaste, de Cate Blanchett, de Natalie Portman et de nombreux invités III mk2 Institut
Haynes
américaines
ENTRETIEN Camille Étienne

Dans Pour un soulèvement écologique. Dépasser notre impuissance collective, la militante écologiste Camille Étienne montre comment nos gouvernants et les multinationales climaticides se rendent délibérément coupables de la « destruction du vivant ». Convaincue qu’un soulèvement citoyen est nécessaire mais surtout possible, elle nous appelle, avec fougue, à « renouer avec notre puissance ».
Vous critiquez ce que vous appelez le « mythe du déclic » concernant le fait de passer à l’action pour lutter contre la crise écologique. Pourquoi ?
On me pose souvent cette question du déclic, avec l’idée qu’il serait toujours possible de reconstituer, a posteriori, des instants clés de notre histoire ayant mené à notre engagement. Pourtant, il faut faire le deuil de ce grand soir, de ce supposé moment où tout
gagées, à les percevoir comme touchées par la grâce. Ce qui, par ricochet, peut pousser un certain nombre de gens à se dire : « C’est super, les personnes qui s’engagent, mais passer à l’action, ça n’est pas pour moi. » En fait, un tel mythe est souvent quelque chose qui excuse et qui permet l’inaction dans le sens où l’on va attendre ce fameux déclic pour se mettre en mouvement. Or, à partir du moment où l’on est vivant sur une planète dont les conditions de vie sont menacées par tout un système économique et politique, tout le monde a la légitimité pour s’engager.
Vous affirmez que « l’impuissance est un choix politique qui ne nous bénéficie pas »
Que voulez-vous dire par là ? On se sent impuissants, c’est normal, mais cette impuissance est choisie et orchestrée par des gouvernements qui maintiennent sciemment la route qui nous mène droit dans le mur. De la même manière que le travail des féministes sur le patriarcat permet de prendre conscience des chaînes invisibles qui nous entravent, j’ai voulu montrer que l’impuissance n’est pas un état de fait mais une construction sociale. Voilà pourquoi je refuse de parler d’inaction climatique : il s’agit plutôt d’une action délibérée de destruction du vivant de la part de nos politiques. On leur a toujours trouvé des excuses : ils ne seraient pas assez au courant de la situation, la tâche à accom-
vingt-quatre heures de clouer les avions au sol, au nom d’une urgence qu’il jugeait plus grande. Agir est donc possible, et ne pas le faire relève d’un choix et d’un manque de volonté politique. D’autant que cette organisation de la société, capitaliste et extractiviste, ne profite qu’à quelques-uns, tout en affectant particulièrement les personnes les plus pauvres. Il y a ainsi une double injustice, climatique et sociale : ceux qui sont statistiquement les plus responsables du dérèglement climatique sont ceux qui sont les plus protégés des problèmes dont ils sont la cause. En France, la moitié du taux d’émissions de CO2 est due aux 10 % des personnes les plus riches. Ça n’a aucun sens ! Pourtant, ce ne sont pas elles qui vivent près d’échangeurs routiers ultra pollués ou qui doivent quitter leur pays en tant que réfugiés climatiques.
est très important de le revendiquer comme tel : on nous vend la peur comme quelque chose qui crée de l’apathie et qui tétanise, alors qu’elle est en fait une émotion vitale qui nous protège. Si une voiture me fonce dessus et que je n’ai pas peur d’elle, je risque de me faire écraser ! Si j’ai peur, en revanche, je vais tenter de sauver ma peau. Reconnaître que l’on a peur, ce qui est un sentiment sain dans un monde malade, permet de transformer collectivement cette émotion en outil d’action politique.
deviendrait clair. Déjà parce que cela ne correspond pas à la réalité, mais aussi parce que ce « mythe du déclic » est dangereux. Celui-ci peut conduire à idéaliser les personnes en-
plir serait trop grande, etc. Pourtant, on a bien vu, à l’occasion de la crise du Covid, qu’ils étaient aptes à prendre des décisions extrêmement fortes. L’État a été capable en
Vous louez la notion de peur, féconde selon vous en ce qu’elle est « à la genèse des révolutions ». De quelle manière ? Il est important de réhabiliter la peur dans l’espace public. Du fait d’une lecture patriarcale du sujet, la peur est souvent associée, de façon négative, à la vulnérabilité. Il s’agirait ainsi plutôt d’être rationnel et de ne pas trop parler aux émotions. Pourtant, c’est précisément ça qui est inquiétant : le fait que les personnes décisionnaires ne soient pas émues d’être en train de condamner des espèces entières, et potentiellement les générations futures. On a tous peur de ce qui se passe en ce moment et de ce qui arrivera plus tard. Ne pas le reconnaître, c’est reléguer cette émotion à une chose qui ne serait qu’intime, alors que la peur est précisément un sentiment politique. Il
Vous écrivez que vous avez souvent l’impression de vivre dans le film Don’t Look Up. Déni cosmique (Adam Mckay, 2021)… Pourriez-vous préciser votre pensée ? Par plusieurs aspects, ce film n’est à mon sens pas tout à fait juste, mais je me rappelle très bien le passage où le personnage incarné par Jennifer Lawrence, invité sur un plateau de télé, alerte sur le fait que la planète est sur le point d’être détruite. En face d’elle, les animateurs dédramatisent la situation. Je me suis dit : « Mais c’est ce que je vis constamment ! » À la télévision, on nous place face à des personnes ou à des journalistes qui essaient de nous challenger, d’exprimer une vision contraire à la nôtre. Comme si l’urgence climatique était une opinion ! Le tout en nous demandant de ne pas trop apeurer la population, ce qui est très grave.
Comment le soulèvement écologique que vous appelez de vos vœux pourrait-il advenir ?
C’est une question à laquelle je n’ai pas de réponse. Mon livre n’est pas programmatique : le soulèvement est quelque chose
no 07 – mai 2023 IV mk2 Institut
« L’impuissance n’est pas un état de fait mais une construction sociale. »
© Manon Cha
qui doit être vécu et discuté démocratiquement, et pas décidé dans des livres. Ce que j’ai voulu faire, en revanche, c’est faire gagner du temps à un certain nombre de personnes. Je raconte en cent soixante pages mon parcours personnel, mais surtout je présente les penseurs et les idées auxquels j’ai mis des années à avoir accès, et qui m’ont permis de sortir de mon impuissance. À travers ce court livre, je souhaite montrer qu’il est nécessaire et possible de se soulever, que ce soulèvement appartient à tout le monde et que nous avons encore une possibilité d’action. J’espère ainsi donner envie aux personnes qui me liront de renouer avec leur puissance. Pas une puissance qui écrase, pas celle des puissants d’aujourd’hui, mais une puissance qui nous réalise et qui nous permet d’accomplir notre être. En fait, un soulèvement peut à la fois être intime et politique. Et c’est ce qu’il y a de très beau là-dedans : une société qui se soulève renvoie à une nouvelle manière de voir le monde, qui passe par une indignation nécessaire et vitale. À partir du moment où l’on voit le monde à travers ce prisme-là, à nous de nous demander quels talents, quelles énergies et quels privilèges l’on pourra mettre au service de ce soulèvement-là.






Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé, le 28 mars, engager la dissolution du mouvement écologiste des Soulèvements de la Terre, le tout dans un contexte de répression du mouvement social. Qu’est-ce que cela vous inspire ?
J’ai récemment signé une tribune intitulée « Nous sommes les Soulèvements de la Terre », qui explique que l’on ne peut pas dissoudre un mouvement : comme le dit le texte, un mouvement est par définition quelque chose de « multiple et vivant ». Quand bien même Gérald Darmanin voudrait le dissoudre – ce qu’il ne pourra pas légalement faire de toute façon –, on repousserait partout ailleurs. Cela dit, cette criminalisation du mouvement écologiste montre qu’ils ne nous laisseront pas nous soulever gentiment. Cela met donc en lumière le fait que l’on va avoir besoin d’être rejoints par un maximum de personnes. C’est de cette manière que l’ordre établi n’aura pas d’autre choix que de céder.




« Camille Étienne, militante écologiste. » Rencontre modérée par Olivier Pascal-Moussellard (Télérama), suivie d’une signature le 23 mai au mk2 Bibliothèque à 20 h tarif : 15 € | étudiant, demandeur d’emploi : 9 € | − 26 ans : 5,90 € | carte UGC/mk2 illimité à présenter en caisse : 9 € | séance avec livre : 19 €








• Pour un soulèvement écologique. Dépasser notre impuissance collective de Camille Étienne, (Seuil, 176 p., 18 €)
• PROPOS RECUEILLIS PAR AMÉLIE QUENTEL

















Wajdi Mouawad
10 mai – 4 juin


spectacle en français et en libanais surtitré en français
Anaïs Allais Benbouali
23 mai – 18 juin




Emma Dante
8 – 28 juin
deux spectacles en napolitain surtitrés en français

mai 2023 – no 07
V mk2 Institut
AUTOPORTRAIT
Clément Viktorovitch
Politologue, chroniqueur, spécialiste de la rhétorique, Clément Viktorovitch s’attache à analyser les discours politiques qui rythment notre quotidien. Invité chez mk2 Institut pour un cycle de conférences, il nous apprend comment convaincre, raconter, et résister à la tromperie en décryptant les différents types d’argumentation. À cette occasion, il se livre ici en mots et en images sur les objets et événements marquants de son parcours.
1 MA PREMIÈRE GUITARE ÉLECTRIQUE

« Ma première guitare électrique : une Vigier Expert de 2003, fabriquée en France, à quelques kilomètres de Paris. J’avais travaillé tout un été pour me l’offrir. Une folie, me disait-on, démesurée pour le débutant que j’étais. Mais, à la seconde où, après avoir fait mes gammes sur une guitare acoustique, j’avais posé les doigts sur l’électrique d’un ami, ma conviction était arrêtée : c’était l’instrument auquel je voulais me consacrer. Dix-neuf ans plus tard, cette Vigier ne m’a toujours pas quitté. Elle a pris la poussière, parfois. Nous nous sommes fâchés, de temps en temps. D’autres guitares l’ont rejointe, mieux adaptées à ce qu’est devenu mon jeu. Mais c’est elle qui continue de symboliser l’importance inaltérable que revêt la musique dans ma vie, et mes efforts modestes pour tenter de produire, un jour peut-être, quelques notes qui en soient dignes. »
« La rhétorique en partage. »
Le politologue Clément Viktorovitch anime un cycle hebdomadaire autour de la rhétorique tous les jeudis, du 11 mai au 29 juin, au mk2 Bibliothèque à 20 h tarif : 15 € | étudiant, demandeur d’emploi : 9 € | − 26 ans : 5,90 € | carte UGC/ mk2 illimité à présenter en caisse : 9 € |
• PROPOS RECUEILLIS PAR

no 07 – mai 2023
MARGUERITE PATOIR-THERY
VI
© Clément Viktorovitch
mk2 Institut
© Bénédicte Roscot
2 MANIFS CONTRE LE CPE
« Les manifestations étudiantes contre le contrat première embauche, en 2006. À l’époque, je préparais une maîtrise d’histoire du haut Moyen Âge occidental et, comme une grande partie de la jeunesse, j’étais vent debout contre cette réforme du président Jacques Chirac. Tous les mercredis, je suivais avidement les questions au gouvernement, qui étaient l’occasion de voir le mouvement social être repris et discuté à l’Assemblée. C’est à ce moment-là que je l’ai compris : ma véritable passion n’était pas pour le droit ecclésiastique du vi e siècle, mais pour les discours politiques contemporains. L’année suivante, je m’inscrivais en master recherche à Sciences Po. Dans la foulée, je commençais une thèse consacrée à la délibération parlementaire, étudiais en parallèle la rhétorique et la négociation, et commençais ainsi le travail auquel, aujourd’hui encore, je consacre ma vie. »
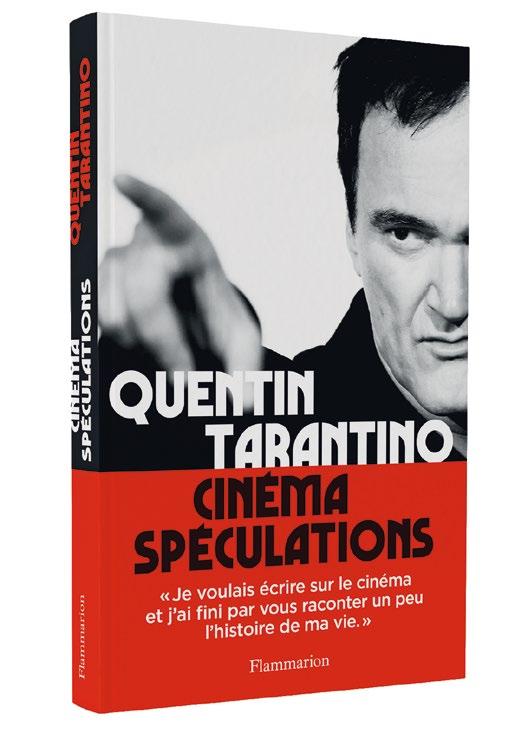

L’ANIME JAPONAIS NARUTO

« C’est tardivement, pendant l’écriture de ma thèse, que j’ai découvert Naruto, le manga culte de Masashi Kishimoto. Après les longues journées en bibliothèque, je n’avais plus qu’une envie : quitter l’atmosphère pesante des salles de lecture pour retrouver les aventures bondissantes du ninja de Konoha. Au fil des années, je suis tombé sous le charme de cette fable consacrée à l’amitié,
au rejet et à la rédemption. Depuis tout petit, je n’ai jamais cessé d’évoluer entre cultures classiques, savantes et populaires, dévorant les œuvres sans discrimination. Cette période de ma vie, entre sciences sociales et escapades au Pays du Feu, en est très représentative. Quant à la scène représentée ici, elle correspond à mon moment préféré du récit. Les lecteurs de Naruto la reconnaîtront immédiatement. Les autres n’auront plus qu’à dévorer les soixante-douze tomes du manga, ou les sept cent vingt épisodes de l’anime, pour en découvrir l’époustouflante puissance narrative ! »

mai 2023 – no 07
« Un livre drôle, érudit, d’une culture infinie. »
Nicolas Demorand, France Inter
3
© D. R.
VII
Manifestation anti-CPE à Paris le 18 mars 2006 entre la place Denfert-Rochereau et la place de la Nation
mk2 Institut
© Traroth
SÉLECTION LIVRES
Tous les mois, mk2 Institut sélectionne des essais faisant l’actualité du monde des idées. Des recommandations de lecture sur des questions essentielles, qui animent nos sociétés et parfois les divisent.

COMPTER POUR PERSONNE
Comment prendre en compte nos « absents », et dès lors repenser la notion même de « personne » ? Que faire des personnes disparues dont la mort n’est pour autant pas certaine ? Comment considérer les individus frappés d’indignité et réduits au statut de personnes moindres ? Dans cet ouvrage du philosophe canadien Daniel Heller-Roazen, l’ordre politique et le statut de l’individu se constituent par ce qui en trouble l’identité et la plénitude. L’auteur y mène une enquête à la croisée des époques et des registres sur les divers statuts accordés aux non-personnes, divisées en trois catégories : personnes absentes, personnes moindres et ex-personnes. Du colonel Chabert aux âmes mortes de Nicolas Gogol, l’auteur rend aux absents le mérite d’introduire une fragilité essentielle dans le décompte de ceux qui composent la communauté humaine.

HISTOIRE
NATURELLE DU SILENCE
Qu’est-ce que le silence ? Est-ce vraiment une absence de tout ? En écoutant plus attentivement, le silence semble bien ne pas être celui que l’on croit. Jérôme Sueur, écoacousticien au Musée national d’histoire naturelle, se livre au gré des pages à une réflexion incarnée et sensible du silence auquel il entend rendre sa pleine substance. Le silence n’est pas un vide, il est plus complexe, dense et pluriel qu’une partition. Cette étude des silences du monde animal et de l’écologie permet de penser une nouvelle approche du bruit en creux. Une lecture qui nous invite à la découverte du silence et à un renversement de paradigme : écoutons le prétendu vide, plutôt que de rechercher le prétendu plein.

LES CHOSES SÉRIEUSES
Les premières amours sont des choses sérieuses : les filles s’y transforment en femmes et les garçons en hommes. Lors de ce parcours de métamorphoses semé d’enjeux et d’embûches, les attentes incertaines des jeunes se constituent bien souvent dans les cadres que sont les normes de genre. À partir de trois terrains d’observation que sont les cités d’habitat social de Seine-Saint-Denis, les beaux quartiers parisiens des XVIe et XVIIe arrondissements, ainsi que le monde rural des petits villages de la Sarthe, la sociologue spécialiste des relations amoureuses restitue les conduites quotidiennes, encore loin d’être bouleversées par les libérations féminines et queer. Une étude incarnée et sensible sur les enjeux liés au passage des adolescents dans les amours débutantes, du collège à l’entrée dans l’âge adulte.
RÉVOLUTION.
T. II. ÉGALITÉ
Le 28 février 1791, une émeute populaire éclate, et les « chevaliers du poignard » se pressent à Versailles pour protéger le roi – ou peut-être l’aider à fuir ? C’est dans cette agitation générale que s’ouvre le deuxième volet de la trilogie Révolution : Paris fulmine, et les députés tentent d’en contenir l’ébullition tout en travaillant à l’élaboration de la première Constitution française. Après le succès du premier tome de cette bande dessinée, récompensé notamment par le Fauve d’or à Angoulême, les deux auteurs nous emmènent sur les traces de personnages tantôt familiers tantôt inconnus, et nous livrent cette superbe fresque documentée, chronique inédite d’une période charnière de l’histoire de France. Une plongée passionnante dans le tumulte de la Révolution française.
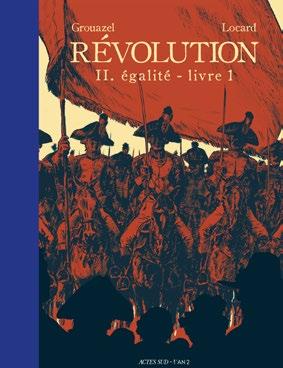
no 07 – mai 2023 VIII
de Daniel Heller-Roazen (La Découverte, 300 p., 25 €)
de Jérôme Sueur (Actes Sud, 272 p., 22 €)
de Florent Grouazel et Younn Locard (Actes Sud, 312 p., 28 €)
mk2 Institut
d’Isabelle Clair (Seuil, 400 p. 21,50 €)
• UNE SÉLECTION DE JOSÉPHINE DUMOULIN ET GUY WALTER
TOUS NOTÉS !

L’avènement du web « participatif » s’est accompagné d’une habitude nouvelle : évaluer à tout prix. Face à la diversification de l’offre en ligne, étoiles, likes et avis sont devenus déterminants dans la manière de faire nos choix. La démocratisation de tels outils a fait entrer la société dans une ère nouvelle : celle où les êtres humains et les choses s’estiment à l’aune d’indicateurs divers. Les relations humaines ainsi que les habitudes de vie s’en trouvent bouleversées, jusqu’à ce qui semble être l’effacement des valeurs morales au profit de valeurs techniques. Pierre Bentata, professeur d’éco nomie, nous incite dans cet essai à reprendre le contrôle de la situation, en s’interrogeant sur les raisons qui nous poussent à noter : cesser d’évaluer, ce serait peut-être cesser de se juger soi-même, et désarçonner ainsi une culture de la haine ? de Pierre Bentata (Éditions de l’Observatoire, 202 p., 19 €)


ÉLOGE DES VERTUS MINUSCULES




« Essayer encore. Rater encore. Rater mieux. »
Ce chemin décrit avec humour par Samuel Beckett est celui le long duquel nous emmène Marina van Zuylen au fil d’un récit personnel et émouvant, en compagnie de Marcel Proust, d’Anton Tchekhov et d’Emmanuel Levinas. C’est aux actions et pensées qui nous laissent moyennement satisfaits et que nous gardons souvent pour nous-mêmes que l’autrice fait la part belle, afin d’inciter chacun à ne pas se laisser aveugler et perdre par un désir de perfection. Ce charmant manifeste fait des vertus minuscules les forces introspectives qui nous obligent à poser un regard indulgent et nuancé sur nos défauts et nos qualités cachées. Ainsi ces vertus minuscules deviennent-elles des expériences révélatrices de la banalité, des sentiments venus se sédimenter en nous afin de constituer le sel de notre vie intérieure.
ENVIRONNEMENT TOXIQUE

La jeune Kate Beaton, tout juste diplômée d’une licence de sciences humaines à 21 ans, se voit contrainte de quitter sa NouvelleÉcosse natale pour rembourser son prêt étudiant : elle ira travailler à l’extraction de pétrole des sables bitumeux du nord de l’Alberta, à l’autre bout du Canada. C’est toutefois un environnement masculin hostile et sexiste que celle-ci trouve à son arrivée. Dans ce roman graphique plein d’humanité et d’humour, Kate Beaton s’interroge sur la violence à laquelle elle se trouve confrontée, qu’elle se traduise dans les relations sociales ou dans l’exploitation forcenée des ressources naturelles. Un témoignage complexe et sensible à la croisée des différents enjeux de prédation de notre monde.
ÊTRE SOI
Notre société contemporaine propose autant de modèles de réussite que sont les diplômes, le travail, la famille, le logement et les loisirs. Néanmoins, la somme de toutes ces réussites ne semble pourtant pas suffire au bonheur : une occasion pour le système économique prédateur qui est le nôtre de faire du bonheur un nouveau marché construit sur les détresses humaines et les bonnes intentions. Au cours de cet essai lumineux, Inès Weber suggère qu’une autre manière de penser est possible : en réalisant que nous sommes à la fois bien plus et bien moins que ce que nous avons spontanément conscience d’être. La psychologue signe ici son premier ouvrage, avec le dessein de nous faire métamorphoser notre horizon d’espérances en nous engageant dans cette aventure de la connaissance de soi.
de Kate Beaton (Casterman, 440 p., 29,95 €)

d’Inès Weber (Gallimard, 256 p., 21 €)


mai 2023 – no 07 mk2 Institut
IX
de Marina van Zuylen (Flammarion, 256 p., 20 €)
CE MOIS-CI CHEZ MK2 INSTITUT
—> JEUDI 11 MAI
CLÉMENT VIKTOROVITCH
– LA RHÉTORIQUE EN PARTAGE
« La rhétorique : un art de la manipulation ? »
> mk2 Bibliothèque à 20 h
—> SAMEDI 13 MAI
DERNIÈRES NOUVELLES DU COSMOS
AVEC CHRISTOPHE GALFARD
« La matière noire. »
> mk2 Bibliothèque à 11 h
HISTOIRE DE L’ART EN FAMILLE
« Les grandes découvertes de la couleur. »
> mk2 Gambetta à 11 h
HISTOIRE DU CINÉMA D’ANIMATION
« Quand les objets s’animent. »
> mk2 Parnasse à 11 h
—> DIMANCHE 14 MAI
DERNIÈRES NOUVELLES DU COSMOS
AVEC CHRISTOPHE GALFARD
« La matière noire. »
> mk2 Odéon (côté St Germain) à 11 h
VOTRE CERVEAU VOUS JOUE DES TOURS
AVEC ALBERT MOUKHEIBER
« Nos émotions sont-elles contrôlées par la raison ? »
> mk2 Bibliothèque à 11 h
JAPANIME MANIA
Le Conte de la princesse Kaguya.
> mk2 Bibliothèque à 14 h et 17 h
CULTISSIME
Harry Potter et l’Ordre du Phénix.
> mk2 Bibliothèque à 20 h
Harry Potter et le prince de sang mêlé.
> mk2 Odéon (côté St Michel) à 20 h
Harry Potter et les reliques de la mort. Part. II.
> mk2 Gambetta à 20 h
—> LUNDI 15 MAI
LUNDIS PHILO DE CHARLES PÉPIN
« Comment réussir à aller de l’avant ? »
> mk2 Odéon (côté St Germain) à 18 h 30
ACID POP
« Ghost Song de Nicolas Peduzzi : quand la rencontre humaine devient rencontre cinématographique. »
> mk2 Quai de Seine à 20 h
—> DIMANCHE 21 MAI
JAPANIME MANIA
Le Conte de la princesse Kaguya.
> mk2 Bibliothèque à 14 h et 17 h
CULTISSIME
Harry Potter et le prince de sang mêlé.
> mk2 Bibliothèque à 20 h
Harry Potter et les reliques de la mort. Part I.
> mk2 Odéon (côté St Michel) à 20 h
—> LUNDI 22 MAI
LUNDIS PHILO DE CHARLES PÉPIN
« “Je ne suis pas blessé, a un jour répondu Nadal, agacé. Je joue avec mes blessures, c’est différent.” Et si c’était la plus belle métaphore de la vie ? »
> mk2 Odéon (côté St Germain) à 18 h 30
SCIENCES SOCIALES ET CINÉMA Cold War de Pawel Pawlikowski.
> mk2 Bibliothèque à 19 h 45
—> JEUDI 25 MAI
CLÉMENT VIKTOROVITCH
– LA RHÉTORIQUE EN PARTAGE « Qu’est-ce qu’un bon argument ? »
> mk2 Bibliothèque à 20 h
MUSIQUE CLASSIQUE ? CHICHE !
« Musique classique et philosophie. »
> mk2 Odéon (côté St Germain) à 20 h
—> DIMANCHE 28 MAI
JAPANIME MANIA
Souvenirs de Marnie.
> mk2 Bibliothèque à 14 h et 16 h 30
CULTISSIME
Harry Potter et les reliques de la mort. Part I.
> mk2 Bibliothèque à 20 h
Harry Potter et les reliques de la mort. Part II.
> mk2 Odéon (côté St Michel) à 20 h
—> JEUDI 1er JUIN
CLÉMENT VIKTOROVITCH
– LA RHÉTORIQUE EN PARTAGE
« Peut-on convaincre sans émouvoir ? »
> mk2 Bibliothèque à 20 h
MUSIQUE CLASSIQUE ? CHICHE !
« Musique classique et neurosciences. »
> mk2 Odéon (côté St Germain) à 20 h
—> SAMEDI 3 JUIN
HISTOIRE DE L’ART EN FAMILLE
« À quoi pense-t-il ? Le Penseur de Rodin. »
> mk2 Gambetta à 11 h
—> DIMANCHE 4 JUIN
JAPANIME MANIA
Souvenirs de Marnie.
> mk2 Bibliothèque à 14 h et 16 h 30
CULTISSIME
Harry Potter et les reliques de la mort. Part II de David Yates.
> au mk2 Bibliothèque à 20 h
—> LUNDI 5 JUIN
LUNDIS PHILO DE CHARLES PÉPIN
« Et si nous retrouvions le sens de la nuance ? »
> mk2 Odéon (côté St Germain) à 18 h 30
HEDDA : ITINÉRAIRE D’UNE FEMME
LIBRE ?
Discussion avec la metteuse en scène Aurore Fattier, l’écrivaine Hélène Frappat et la philosophe Geneviève Fraisse.
> mk2 Odéon (côté St Germain) à 20 h
—> MERCREDI 7 JUIN
LES SAISONS HANABI
Rencontre avec Kōji Fukada, puis projection de son dernier film, Love Life (lire p. 54).
> mk2 Bibliothèque, à 18 h
LA QUINZAINE EN SALLE !
Projection de films de la Quinzaine des cinéastes.
> mk2 Beaubourg, à 20 h
—> JEUDI 8 JUIN
CLÉMENT VIKTOROVITCH
– LA RHÉTORIQUE EN PARTAGE
« Faut-il porter le costume pour inspirer confiance ? »
> mk2 Bibliothèque à 20 h
MUSIQUE CLASSIQUE ? CHICHE !
« Musique classique et humour. »
> mk2 Odéon (côté St Germain) à 20 h
LES SAISONS HANABI
Rendez-vous à Tokyo de Daigo Matsui.
> Plus d’informations sur mk2.com
—> VENDREDI 9 JUIN
LES SAISONS HANABI
La Beauté du geste de Shō Miyake.
> Plus d’informations sur mk2.com
—> SAMEDI 10 JUIN
CULTURE POP ET PSYCHIATRIE AVEC
LE DR JEAN-VICTOR BLANC
« Le chemsex : Keep The Lights On sur un fléau moderne. »
> mk2 Beaubourg à 11 h
DERNIÈRES NOUVELLES DU COSMOS
AVEC CHRISTOPHE GALFARD
« D’où vient la vie ? »
> mk2 Bibliothèque à 11 h
LES SAISONS HANABI
Coming Soon de Takayuki Hirao.
> Plus d’informations sur mk2.com
—> DIMANCHE 11 JUIN
DERNIÈRES NOUVELLES DU COSMOS
AVEC CHRISTOPHE GALFARD
« D’où vient la vie ? »
> mk2 Odéon (côté St Germain) à 11 h
LES SAISONS HANABI
A Man de Kei Ishikawa.
> Plus d’informations sur mk2.com

—> LUNDI 12 JUIN
LUNDIS PHILO DE CHARLES PÉPIN
« Qu’est-ce qui est vraiment sérieux ? »
> mk2 Odéon (côté St Germain) à 18 h 30
ACID POP
« Walden de Bojena Horackova : la concordance des temps, comment représenter plusieurs époques dans le même film ? »
> mk2 Quai de Seine à 20 h
LES SAISONS HANABI
Comme un lundi de Ryo Takebayashi. > Plus d’informations sur mk2.com
—> MARDI
13 JUIN
FESTIVAL CÔTÉ COURT DE PANTIN
Projection d’une sélection de films issus de la catégorie Panorama du festival Côté court. > mk2 Quai de Seine, à 20 h
LES SAISONS HANABI
La Comédie humaine de Kōji Fukada. > Plus d’informations sur mk2.com
Mk2 INSTITUT MAGAZINE
éditeur MK2 + — 55, rue Traversière, Paris XII e — tél. 01 44 67 30 00 — gratuit
directeur de la publication : elisha.karmitz@mk2.com | directeur de mk2 Institut : guy.walter@mk2.com | rédactrice en chef : joséphine.dumoulin@mk2.com | directrice artistique : Anna Parraguette | graphiste : Ines Ferhat | coordination éditoriale : juliette.reitzer@ mk2.com, etienne.rouillon@mk2.com | secrétaires de rédaction : Claire Breton, Vincent Tarrière | renfort
correction : Marie-Aquilina El hachem | stagiaires mk2 Institut : Jeanne Lefèvre, Marguerite Patoir-Thery | a collaboré à ce numéro : Amélie Quentel | publicité | directrice commerciale : stephanie.laroque@mk2. com | cheffe de publicité cinéma et marques : manon. lefeuvre@mk2.com | responsable culture, médias et partenariats : alison.pouzergues@mk2.com | cheffe de projet culture et médias : claire.defrance@mk2.com
Imprimé en France par SIB imprimerie — 47, bd de la Liane — 62200 Boulogne-sur-Mer
no 07 – mai 2023 X mk2 Institut
DÉCOUVREZ LE MAKING-OF DE CETTE AFFICHE



EN CE MOMENT SEULEMENT SUR

UNE CRÉATION ORIGINALE

UNE HISTOIRE DE SECONDES CHANEL.COM
PENELOPE CRUZ





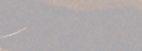







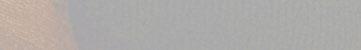











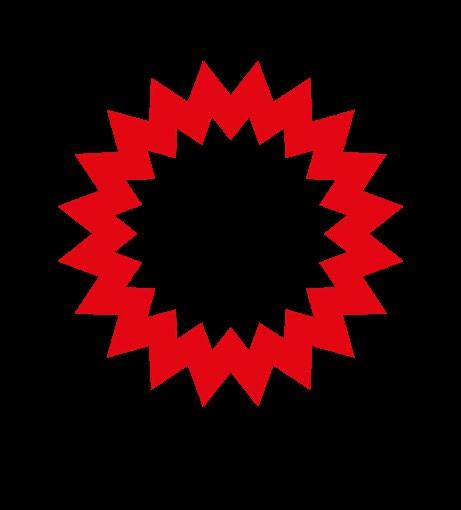





































































































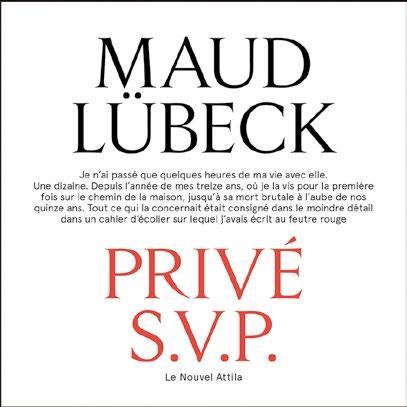
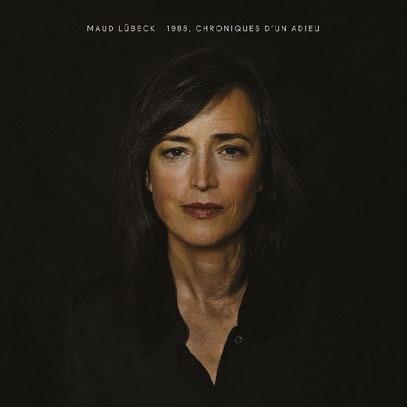




















































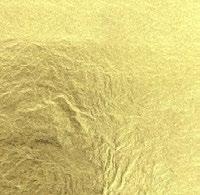


















 de Nicolas Peduzzi ACID
de Nicolas Peduzzi ACID































 de Claude Schmitz
de Claude Schmitz













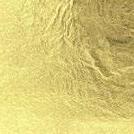













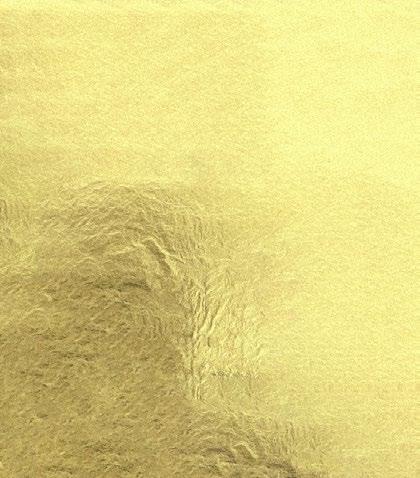
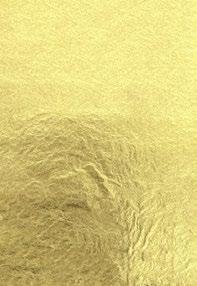

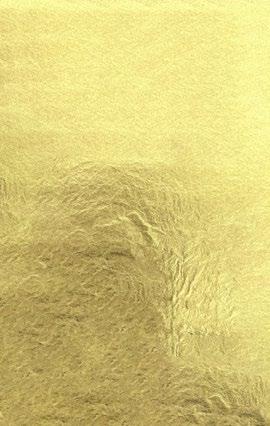





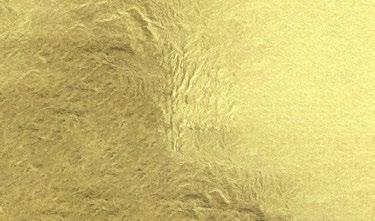
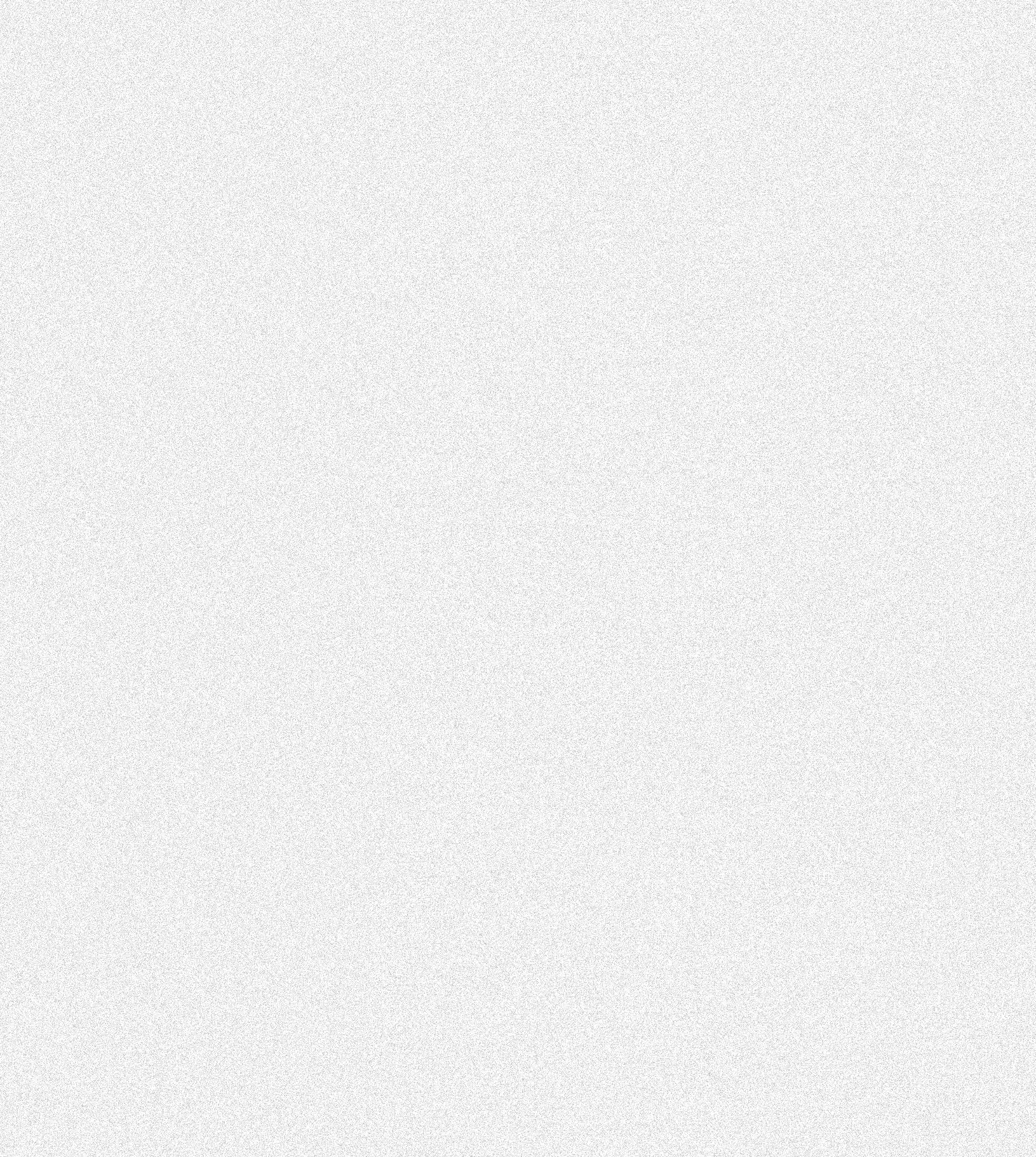
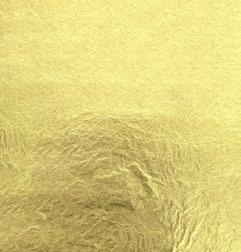
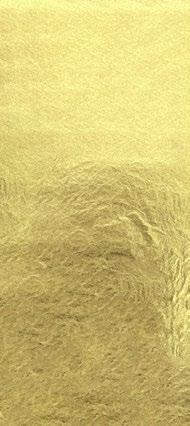
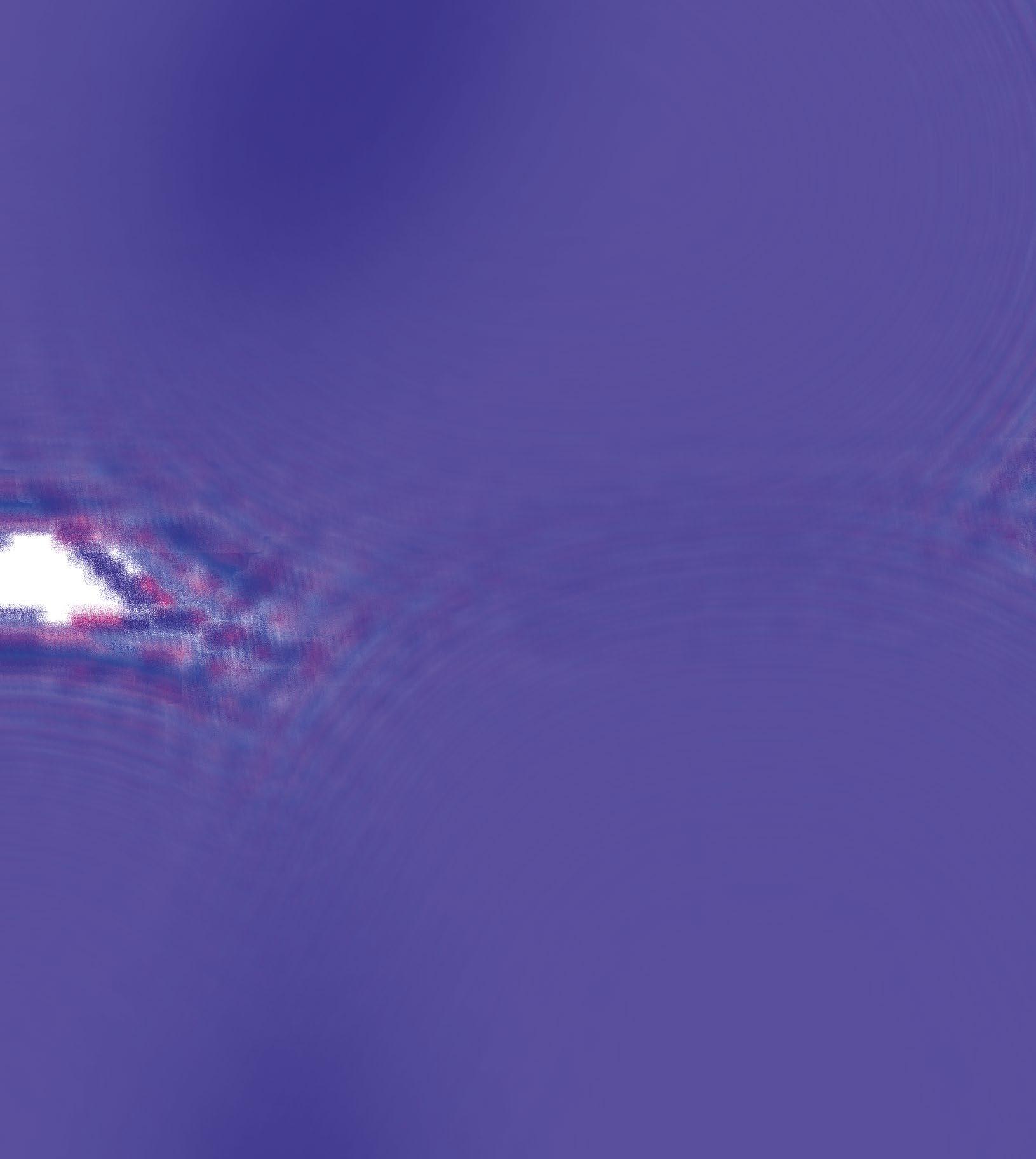
























 © George Seguin
© George Seguin












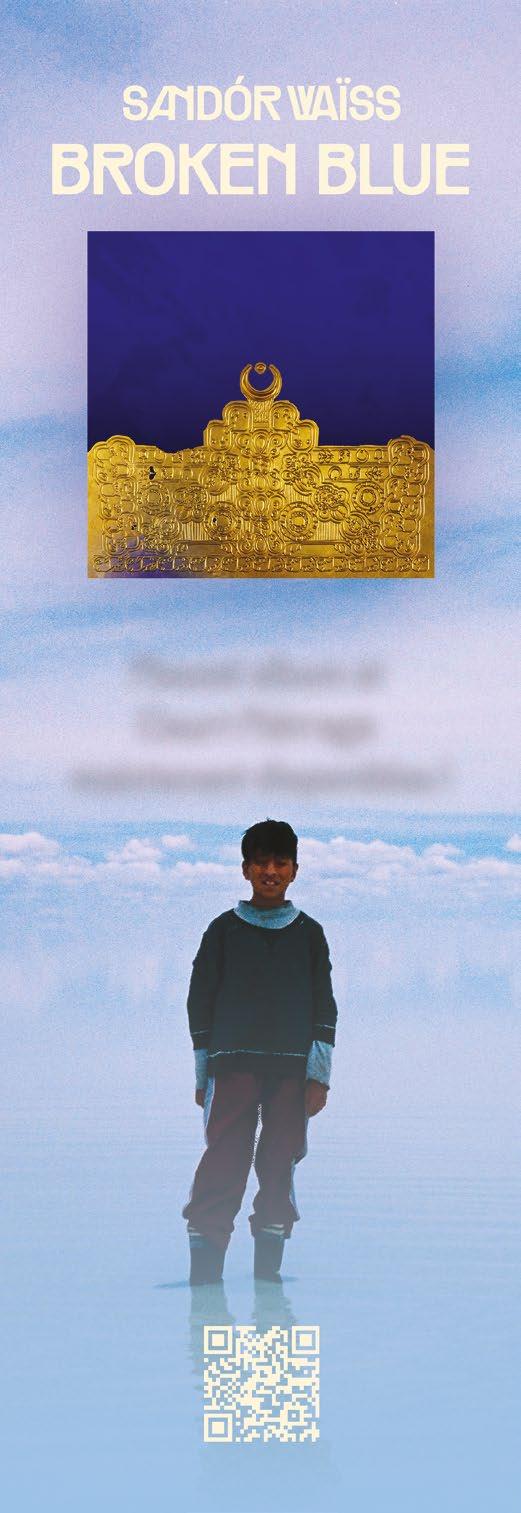

















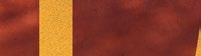


































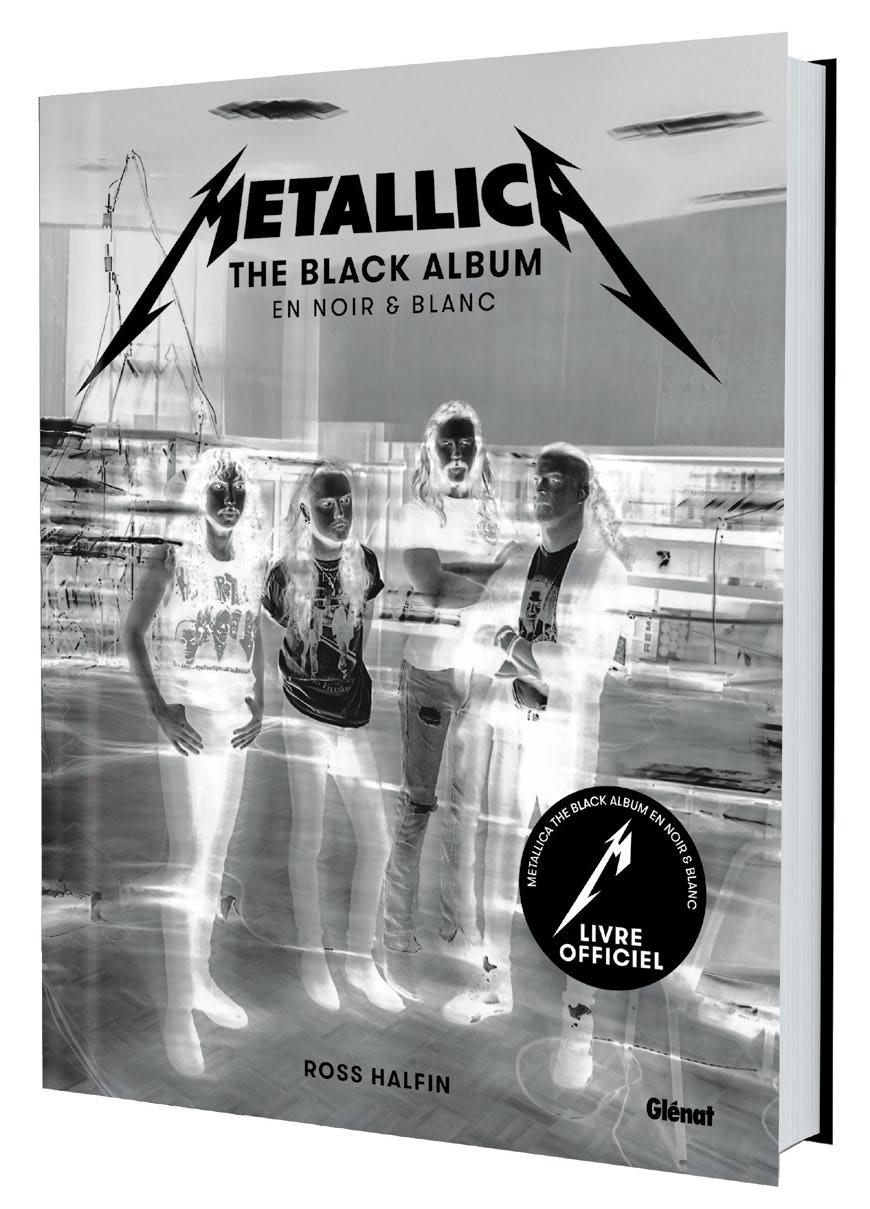



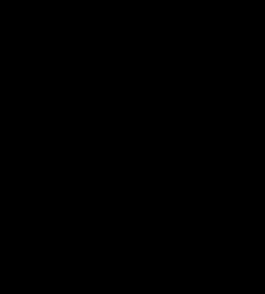
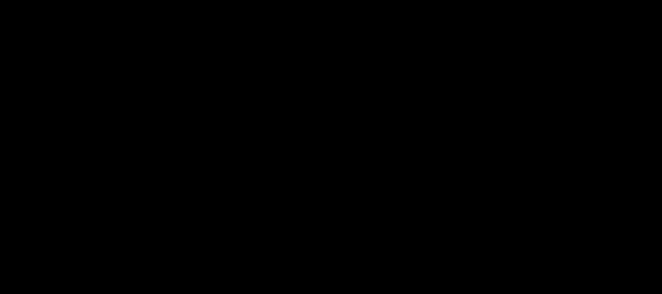
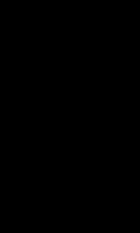
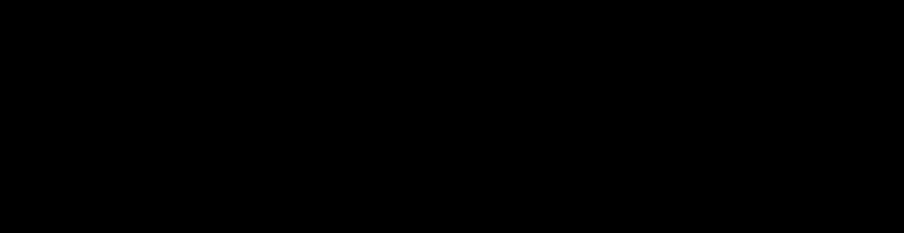
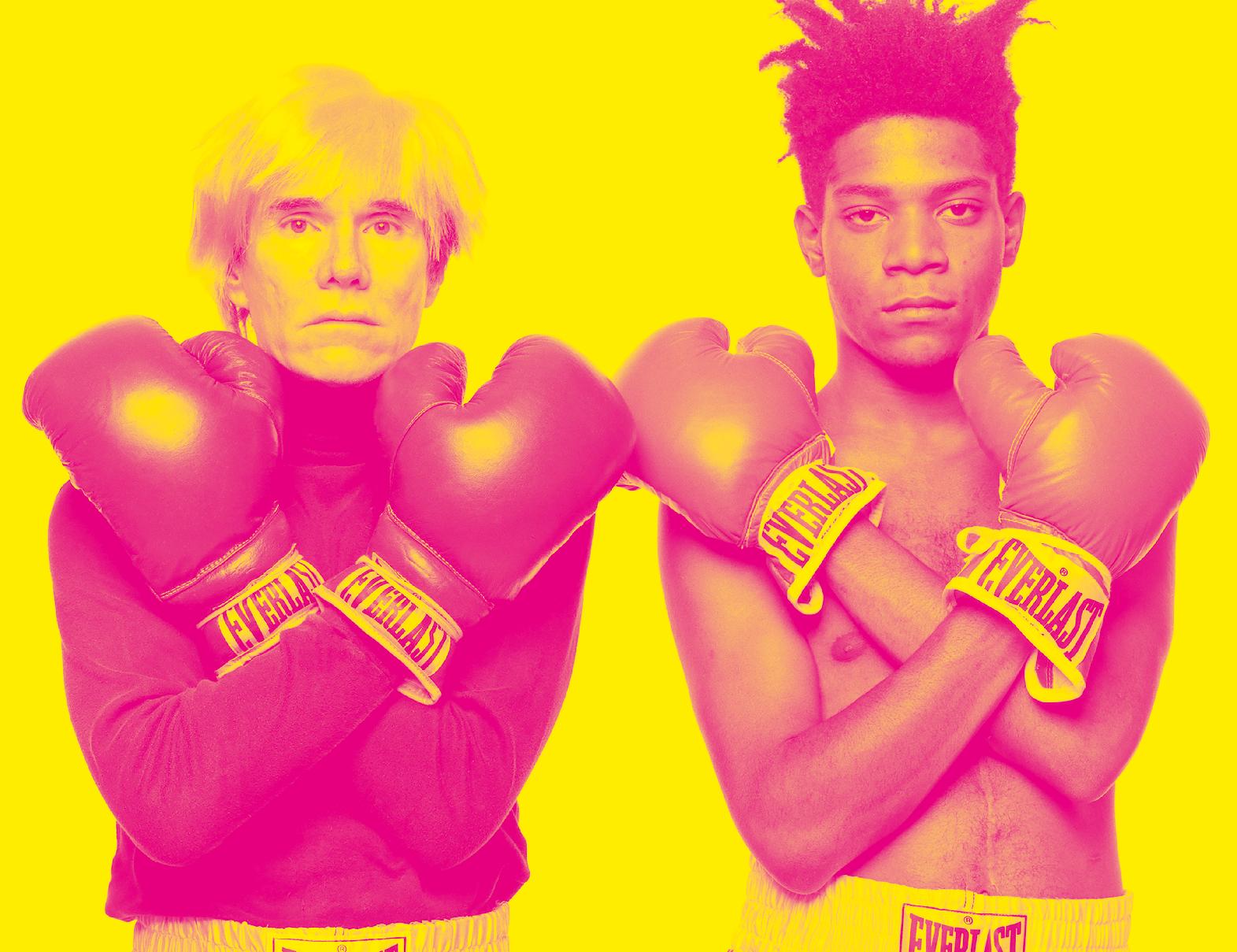







 Photo du film MES PETITES AMOUREUSES © Pierre Zucca - Collection Christophel
Photo du film MES PETITES AMOUREUSES © Pierre Zucca - Collection Christophel