ACÉRICULTURE

Aussi dans cette édition : Entrevues avec l’ACER et les PPAQ ..........................p.3 et 8
Travailleurs étrangers : FERME parle de ses services ...........................p.10
Tirer le maximum de ses liquidités dans le contexte économique actuel ................p.24
CULTIVER la
CULTIVER la réussite LA PROMOTION DE L’AGRICULTURE EN MONTÉRÉGIE ET AU CENTRE-DU-QUÉBEC

Une année importante pour l’industrie!

Jeudi 9 mars 2023 | Volume 48 | 2 e Numéro PP40051633
réussite

2Jeudi 9 mars 2023Gestion et Technologie Agricoles
LA PROMOTION DE L’AGRICULTURE EN MONTÉRÉGIE ET AU CENTRE-DU-QUÉBEC
ACÉRICULTURE
L’ACER analyse annuellement
quelque 300 000 barils
aussi effectuées sur la base de problématiques d’adultération ou de présence de plomb ou de certains contaminants dans le sirop, inspections qui ne sont pas systématiquement menées sur chaque baril », explique M. Lagacé.
RIVARD
Spécialisé en recherche et développement de même qu’en transfert technologique, le Centre ACER est aussi chargé de l’inspection et de la classification du sirop d’érable au Québec. À cet égard, l’organisation veille constamment à optimiser ses méthodes et ses pratiques visant à contrer les tentatives d’altération du sirop de certains producteurs. Alors que la saison bat son plein, Luc Lagacé, directeur, revient sur la mission du Centre ACER, qui célèbre son 25e anniversaire de fondation, et détaille les différents dossiers pour lesquels l’expertise de son équipe est mise à contribution.
« Le Centre ACER est né d’une volonté des acteurs de l’industrie, producteurs, transformateurs, équipementiers, et d’une décision du MAPAQ, rappelle M. Lagacé. Les recherches qui s’effectuaient au MAPAQ jusqu’alors ont été transférées au sein de différentes corporations, notamment l’IRDA et le CÉROM. Pour la production acéricole, ce fut l’ACER. Depuis, son mandat est demeuré le même : la recherche, le développement et le transfert technologique. Le Centre ACER compte également une division commerciale dédiée à l’inspection et au classement du sirop en vrac. »
Passez donc au laboratoire…
Et qu’en est-il justement de ce processus d’inspection? Quel est le type d’intervention que peut mener l’ACER? « Tous les barils de sirop livrés par les producteurs sont dûment inspectés. On parle annuellement de 300 000 barils qui sont ouverts et analysés. Si on parle des cas de falsification de produit, l’ACER répond aux demandes d’analyse liées à des plaintes reçues principalement par le MAPAQ et les PPAQ. Des inspections aléatoires sont
ÉDITEUR : Benoit Chartier

RÉDACTEUR EN CHEF : Martin Bourassa
ADJOINTE À LA RÉDACTION : Annie Blanchette
TEXTES ET COORDINATION : Yves Rivard
CONTRÔLEUR : Monique Laliberté
DIRECTEUR DU TIRAGE : Pierre Charbonneau
C’est un fait bien connu de l’industrie, certains producteurs tentent d’édulcorer leur production au moyen de sirops de riz, de maïs, de canne ou de betterave. Une manœuvre déplorable qui, au vu des techniques de détection scientifiques modernes, s’avère heureusement vaine.

« Le Centre analyse les ratios de carbones isotopiques et utilise un système de microplaques pour identifier les sucres provenant d’autres sources que l’érable », souligne M. Lagacé.
Formation et perfectionnement
Dans sa mission de transfert de savoir, le Centre ACER offre aussi plusieurs forma-
tions visant à l’optimisation des pratiques de l’industrie. « On offre, entre autres, des rencontres portant sur le respect de la Loi sur la gestion des rejets en érablière, qui évolue selon les nouvelles règles du ministère de l’Environnement, note M. Lagacé. Des outils et des formations sont toujours nécessaires. »
Pour rappel, il y a quelques années, le Centre ACER, en collaboration avec
Le Centre ACER, en bref
Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), avait mis au point un outil rapide et abordable permettant l’analyse d’échantillons : le SpectrAcer. « Qu’on appelle aussi la langue électronique », souligne avec humour M. Lagacé. En plus de détecter les cas d’adultération, le robot-testeur fournit trois diagnostics différents : « OK », « Bourgeon » ou « À classer ».
Au nombre des activités quotidiennes et saisonnières du Centre, on recense la recherche appliquée, le développement des meilleures connaissances et expertises pratiques et le transfert technologique. En vertu de sa mission, le Centre ACER doit également développer, transférer et rendre accessible, en collaboration avec ses partenaires, l’expertise scientifique et technologique dans le domaine acéricole afin de venir en aide le plus efficacement possible à tous les intervenants du secteur acéricole dans la résolution des différents problèmes rencontrés.
PUBLIÉ PAR:
DIRECTEUR DE LA PUBLICITÉ : Guillaume Bédard
DIRECTEUR DE LA PRODUCTION :
Alex Carrière
PUBLICITAIRES :
Louise Beauregard
Manon Brasseur
Luc Desrosiers
Miriam Houle
Isabelle St-Sauveur
TÉL. : 450 773-6028
TÉLÉCOPIEUR : 450 773-3115
WEB : www.dbc.ca
SITE
COURRIEL : admin@dbc.ca
Publié 12 fois par année par DBC Communications inc.
655, avenue Sainte-Anne, Saint-Hyacinthe, Québec J2S 5G4
Imprimé par Imprimerie
Transcontinental SENC division Transmag, 10807, rue Mirabeau, Ville d’Anjou Québec H1J 1T7.
Dépôt légal Bibliothèque nationale du Canada
Copyright® Tous droits réservés sur les textes et les photos.
Les articles sont la responsabilité exclusive des auteurs.
Prix d’abonnement : 1 an (taxes incluses)...............35 00$
Poste publication - convention : PP40051633
26 500 exemplaires distribués dans Le Courrier de Saint-Hyacinthe et par la poste aux producteurs agricoles dans les régions suivantes : Montérégie-Est
Montérégie-Ouest Centre-du-Québec
Gestion et Technologie AgricolesJeudi 9 mars 20233
Nous
Canada
périodiques,
relève de Patrimoine canadien. Merci de recycler ce journal. journalgta.ca Prochaine édition 6 avril 2023
reconnaissons l’appui financier du gouvernement du Canada par l’entremise du Fonds du
pour les
qui
Luc Lagacé, directeur du Centre ACER, capté en pleine période d’inspection de sirop d’érable. Photo : François Larivière I GTA.

4Jeudi 9 mars 2023Gestion et Technologie Agricoles

Gestion et Technologie AgricolesJeudi 9 mars 20235
Acériculture
Richard Godère, producteur d’or liquide
Au moment d’écrire ces lignes, plusieurs acériculteurs prédisent une année dans la moyenne côté production. C’est le cas de Richard Godère, copropriétaire de l’érablière Les Bois Riant, qui a pignon sur le 11e Rang, à Saint-Valérien-de-Milton. De cette forêt familiale, il exploite actuellement 11 000 entailles, dont 95 % de la production est destinée au vrac et 5 % à la vente au détail. Entrevue avec un producteur de sirop d’érable qui, à l’instar d’un personnage célèbre de bande dessinée, est tombé dedans quand il était petit.
« Mon père, André Godère, a acheté cette terre qui avait été coupée à blanc, mais pour laquelle on avait laissé 6 pouces et plus de souche. Il a payé le terrain de 60 arpents en vendant des lots de bois de chauffage tirés des restes et des têtes à 3 $ la corde. Il a donc travaillé fort, raconte M. Godère. En 1972, l’entaillage a débuté avec un lot d’environ 1000 arbres. Le plancher de la cabane était en terre battue et, chaque matin, il devait remettre l’évaporateur à niveau. La bonne vieille époque! »
Dès son jeune âge, Richard Godère s’implique beaucoup dans le processus et reprend progressivement les rênes de la production dans les années 80. L’entreprise croît annuellement et atteint un pic de 5000 entailles à la chaudière. « Notre terrain étant plat, à cette époque, il était très difficile de pouvoir installer de la tubulure. Il a fallu attendre 2009 pour qu’un certain système le permette. » Jusqu’en

2010, l’érablière offre également l’expérience de repas de cabane à sucre avec grand succès. Malheureusement, le manque de personnel viendra mettre un terme à cette activité fort prisée des familles québécoises.
L’or liquide... en vrac
Les trois dernières années, vécues sous le signe de la pandémie, se sont avérées particulièrement bonnes pour l’érablière, dont la production et la vente principale demeurent le sirop en vrac. « La vente au détail a été beaucoup plus forte. Peut-être de l’ordre de 25 à 30 %, détaille M. Godère. Les gens craignaient probablement le manque de certains produits et ont donc acheté plus en vue de stocker. » Toutefois, cette même période a exigé davantage de travail. Même en situation de pénurie de main-d’œuvre, l’entreprise a réussi à profiter d’une saison exceptionnelle et à relever le défi de la production en y mettant des centaines d’heures supplémentaires et en se limitant à la seule production du sirop. Pas de cornets, pas de sucre d’érable. M. Godère est d’avis que l’année 2023 devrait voir un retour à la normale.


Envisager l’après-COVID
Portant le regard vers l’avant, M. Godère prévoit une saison courte, mais suffisamment abondante. « Les opérations sont lancées depuis plusieurs jours. Les bouilloires chauffent à pleine vapeur. La moyenne régionale se chiffre entre 4 lbs et 4,5 lbs, et plusieurs acériculteurs en sont déjà à plus de 2 lbs. Comme on prédit des
périodes de froid en mars, cette moyenne devrait être facile à atteindre. 2023 devrait se qualifier en tant que saison rapide. Tout pourrait se terminer à la fin mars. »
Bien que l’entreprise tourne à plein régime et que les méthodes et les pratiques actuelles en assurent la pérennité, M. Godère considère deux systèmes visant la modernisation de l’érablière à moyen terme. « Bien que l’érablière se targue d’une production au feu de bois,
l’acquisition d’un poêle électrique pourrait s’avérer intéressante à plusieurs niveaux. De la même manière, la technologie de production Haut Brix mérite considération. Pour réduire les coûts associés à la transformation de la sève en sirop d’érable et augmenter l’efficacité globale du procédé, il est possible de concentrer la sève avant son entrée dans l’évaporateur, parfois jusqu’à 95 %. Ça fait toute la différence », conclut M. Godère.
6Jeudi 9 mars 2023Gestion et Technologie Agricoles
Richard Godère, posant fièrement devant l’évaporateur de l’érablière Les Bois Riant. Photo : François Larivière I GTA.
Yves RIVARD GTA

Gestion et Technologie AgricolesJeudi 9 mars 20237
Acériculture
Les PPAQ font le point sur les dossiers en cours
Yves RIVARD GTA
Les semaines, les mois passent, mais rien n’est toujours réglé dans le dossier de l’acériculture en forêt publique. Il y a quelques semaines, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) soulignaient que le gouvernement cherche à entretenir l’incertitude dans les régions et rappelaient que la filière acéricole attend toujours les orientations du ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) sur cette question. Joël Vaudeville, directeur des communications du regroupement, répond à nos questions alors que la saison bat son plein.
GTA : Comment peut-on résumer les années COVID-19 pour les producteurs?
Joël Vaudeville : Par ces mots : explosion de l’exportation, explosion des ventes. On vient de connaître deux années consécutives de hausse de l’exportation de plus de 20 %. Les PPAQ expliquent cette situation par la redécouverte du sirop d’érable, par la recrudescence des repas en cuisine. Actuellement, 85 % de la production québécoise est exportée. Sinon, la pandémie n’a pas freiné le développement de l’industrie alors qu’on recense 7,5 millions de nouvelles entailles pour 2021. De ce nombre, 5 millions sont déjà installées. Les producteurs ont jusqu’au 1er avril 2024 pour créer les deux millions restantes. C’est également au cours de la pandémie que la nouvelle assurance portant sur les précipitations excessives de la Financière agricole a été créée.

GTA : Ce qui nous amène à un autre dossier, celui de l’acériculture en forêt publique, qui traîne depuis longtemps et qui s’avère de première importance à plusieurs niveaux.
J.V.: Effectivement. Tout découle de la Stratégie de production du bois du gouvernement du Québec, annoncée en décembre 2020, qui ne disait mot sur l’acériculture. Ce qui revenait à dire que le potentiel acéricole hors forêt publique était menacé. À la suite de représentations auprès du gouvernement, le MRNF s’est engagé officiellement à déposer un Plan directeur, ce qui a été fait en mai 2022. Une consultation publique a été tenue en juillet 2022. Depuis, il y a eu des élections et une nouvelle ministre est en poste. Mais, à ce jour, le gouvernement n’a toujours pas fait connaître ce qu’il entend faire pour l’acériculture en forêt publique.
GTA : Tout se poursuit donc comme avant, rien n’est fait pour protéger les 200 000 hectares à potentiel acéricole du Québec face aux droits de coupe des entreprises forestières...
J.V.: Exactement. On attend un nouveau plan, car pour l’heure, tout est sous la juridiction des Plans d’aménagement forestier intégré tactiques (PAFIT), qui présentent les objectifs d’aménagement durable des forêts de chacune des unités d’aménagement ainsi que la stratégie retenue pour assurer le respect des possibilités forestières et atteindre ces objectifs. Mais ceux-ci ne déterminent rien pour la production acéricole. La ministre Maïté Blanchette-Vézina doit rendre public le Plan directeur pour le développement de l’acériculture en forêt publique qui est sur son bureau depuis plusieurs mois. En attendant, nous poursuivons les discussions productives à la table stratégique créée avec le MNRF sur diffé-
rents aspects de l’acériculture en forêt publique. Il y a urgence, car le Ministère se fait complice de certaines coupes de bois actuellement par son retard.
GTA : Quelles sont vos demandes prioritaires dans ce dossier?
J.V.: Elles sont au nombre de trois. La première : protéger 200 000 hectares, ce qui représente environ 36 millions d’entailles. C’est très raisonnable. On demande de protéger ces superficies sur les 60 prochaines années. En comparaison avec l’industrie du bois, cela ne représente que 6 % de leurs besoins d’approvisionnement en feuillus durs sur cinq ans. Préserver le potentiel acéricole n’empêchera pas de faire de la récolte de bois. Il faut simplement adapter nos types de coupes pour assurer la pérennité des érablières. La forêt publique, qui se chiffre actuellement à 20 % de l’ensemble des entailles en exploitation, devra atteindre 30 % sur les 60 prochaines années.
GTA : La seconde?
J.V.: Elle porte sur la norme d’entaillage. Actuellement, il est possible d’entailler un érable à partir du moment où son diamètre atteint 20 centimètres. Le MNRF a fait savoir qu’il compte porter le diamètre accepté à 24 centimètres. Ce qui, dans les faits, signifie le retrait de 1,8 million d’entailles en forêt publique. Nos experts ont pourtant démontré que la norme de 20 centimètres est sécuritaire pour l’érable. Les discussions se poursuivent, mais si le gouvernement s’entête, une clause de droits acquis sera demandée pour inclure ces 1,8 million d’entailles.
GTA : Et la troisième?
J.V.: Il est question des Tables locales de gestion intégrée des ressources et du territoire (TLGIRT), où tous les intervenants d’une région donnée se regroupent pour expliquer leurs enjeux. Actuellement, il existe un sous-comité où l’industrie forestière et le MNRF discutent en mode bilaté-
La filière acéricole
Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) représentent les intérêts de 13 300 acériculteurs et acéricultrices et de plus de 8000 entreprises acéricoles.
Le Québec assure en moyenne 72 % de la production mondiale de sirop d’érable et exporte dans une soixantaine de pays.
L’acériculture profite aussi à l’économie des régions. Quelque 12 583 emplois équivalent temps plein dépendent de cette activité. Elle contribue à la hauteur d’un milliard de dollars au PIB du Québec et du Canada et apporte des revenus de taxations de 235 M$.
ral de leurs dossiers. Les PPAQ aimeraient avoir le même canal de communication afin de délester la TLGIRT de nos dossiers, qui peuvent s’avérer complexes et moins intéressants pour le reste des participants.
TESTS ET VALEUR AJOUTÉE
GTA : Quelles sont les dernières nouvelles à propos du test Colori, qui vise à prévenir l’apparition de saveurs hors normes en matière de sirop d’érable?
J.V.: Ce projet pilote, lancé en 2017, est actuellement en phase de commercialisation. Quelques centaines de tests étaient disponibles pour la saison 2023, mais les stocks sont déjà écoulés… La reproduction débutera en vue de l’année 2024.
GTA : Seriez-vous victime de votre propre succès? Pourquoi une production aussi limitée?
J.V.: Nous avions un carnet de commandes. Puisque nous sommes toujours en mode préliminaire, nous ne voulions pas en produire trop. Mais, face à la grande demande, la prochaine production sera plus importante.
GTA : Sur le terrain, quels sont les commentaires par rapport à cet outil?
J.V.: Bien que le test ne soit pas obligatoire, les producteurs disent apprécier la valeur ajoutée que cela peut conférer à leur production.
GTA : Comment votre association sanctionne-t-elle les acériculteurs trouvés coupables d’adultération des produits?
J.V.: C’est tolérance zéro. Les PPAQ sont le gage de la qualité du sirop. Les consommateurs ont droit à un produit pur à 100 %. Les PPAQ bénéficient d’un département de la réglementation et compte sur des inspecteurs qui sillonnent les rangs du Québec pour s’assurer du respect des règles de la mise en marché collective et de la qualité du sirop.
GTA : Dans votre objectif de mise en marché et de valorisation du sirop, existe-t-il un volet faisant la promotion de l’écotourisme, de visites des installations, de l’expérience globale du consommateur, comme le font les vergers et vignobles, par exemple?
J.V.: Notre outil Érable d’ici vise à établir des liens entre le producteur et le consommateur. Toutefois, à la différence d’autres types de production, la valeur ajoutée d’avoir des clients sur le site de production est probablement moindre. Plusieurs érablières offrent des services de restauration sur place, mais il existe aussi plusieurs cabanes à sucre qui ne sont pas des érablières, qui achètent seulement les produits pour offrir des repas. Les consommateurs doivent faire la distinction.
8Jeudi 9 mars 2023Gestion et Technologie Agricoles
Joël Vaudeville, directeur des communications pour les Productrices et producteurs acéricoles du Québec (PPAQ), répond à nos questions. Photo : gracieuseté.

Gestion et Technologie AgricolesJeudi 9 mars 20239
Main-d’œuvre
étrangère FERME, votre partenaire au champ
Yves RIVARD GTA
Trop peu de gens le savent, mais c’est à l’organisme FERME Québec que l’on doit la venue des tout premiers travailleurs étrangers temporaires dans le milieu agricole. Pour être plus précis, depuis 1989, la Fondation des Entreprises en Recrutement de Main-d’œuvre agricole Étrangère (FERME) est le plus important partenaire en matière d’embauche à l’étranger pour la filière agroalimentaire. Grâce à son savoir-faire et aux liens durables qu’elle a su développer, FERME soutient les employeurs dans leurs démarches de recrutement. Survol de ses activités et services à la veille du lancement des activités printanières.

« FERME est active à l’échelle québécoise et dispose de deux points de service, soit à Montréal et à Québec », explique d’entrée de jeu Fernando Borja, directeur général. L’organisme a d’abord été créé en Ontario, en 1974, sous le nom de FARMS. Devant les besoins croissants de main-d’œuvre des agriculteurs, un projet pilote avait été lancé en 1966, projet qui visait des travailleurs issus de la Jamaïque. Au Québec, les différentes associations agricoles se sont regroupées en 1988 et FERME a été fondée. »
Et l’industrie ne s’en porte que mieux depuis. À preuve : l’an dernier, FERME a pourvu quelque 19 500 postes pour environ 2500 employeurs au sein des créneaux agricole et agroalimentaire québécois. Selon M. Borja, les services
de placement opèrent dans la continuité.
« 85 à 90 % des employés retournent annuellement chez le même employeur, c’est ce qui explique en grande partie le succès du programme. »
Mode... d’emploi
Le processus de demande de travailleurs étrangers comporte plusieurs étapes. « Tout employeur désirant faire une demande doit d’abord passer par le Centre d’emploi agricole (CEA) de sa région, qui prendra en charge toutes les formalités fédérales.
Une fois la demande approuvée par le Ministère, FERME reçoit la demande et en informe ses partenaires afin de préparer les travailleurs. Une fois les candidats sélectionnés, les arrangements visant l’arrivée des travailleurs à la ferme sont finalisés », explique M. Borja. Il ajoute qu’un employeur doit compter six mois entre la présentation de sa demande et l’arrivée de la main-d’œuvre.
Interrogé à savoir si une prestation de service peut ensuite se transformer en emploi permanent, Fernando Borja confirme. « Oui, cela arrive parfois, mais en général, ce n’est pas dans l’intérêt des travailleurs étrangers, soulève-t-il. La plupart des travailleurs ont des familles dans leur pays. Ils viennent ici gagner de l’argent en quelques mois et repartent profiter de cette somme qui s’avère importante une fois convertie en devises mexicaine ou guatémaltèque. » Selon lui, pour que cette situation devienne plus fréquente, un projet pilote devrait
être créé. Et s’il devait se solder par un succès, nul doute que les agriculteurs d’ici pourraient en bénéficier. Vivement une telle initiative!

10Jeudi 9 mars 2023Gestion et Technologie Agricoles
Fernando Borja, directeur général de FERME Québec. Photo : gracieuseté.
COLLECTIF EN FORMATION AGRICOLE DE LA MONTÉRÉGIE
La formation en acériculture utile et pratique
KARINA SALAZAR
Les producteurs acéricoles ont toujours le souci d’améliorer leurs pratiques et d’acquérir de nouvelles connaissances pour être en mesure de tirer profit de leurs installations.


La formation continue permet aux propriétaires d’érablières et à leurs employés d’aller plus loin dans leurs compétences. Les collectifs régionaux travaillent en collaboration avec les différentes maisons d’enseignement afin d’élaborer des programmes de formation répondant aux besoins des producteurs et ce dans chacune des régions du Québec.
Des sujets aussi variés que l’évaporation, l’entaillage, l’utilisation et calibration des instruments de mesure sont abordés lors des activités de formation axées sur les aspects pratiques et théoriques. Afin de s’assurer du transfert des connaissances certains cours se déroulent dans des érablières.
Les collectifs offrent également d’autres cours qui permettent aux participants d’en savoir plus sur les produits de l’érable. Comment les transformer, comment fabriquer des friandises et autres sucreries à partir des produits de l’érable. Bonne saison des sucres!
Vous souhaitez en savoir davantage, parfaire vos connaissances ou acquérir un savoir-faire qui vous permettra d’aller plus loin. Contactez le collectif régional de formation agricole de votre région.
RFA Montérégie : Karina Salazar
Téléphone : 450-454-5115 poste 6288
Courriel: rfamonteregie@upa.qc.ca


Gestion et Technologie AgricolesJeudi 9 mars 202311
Répondante en formation agricole
COLLECTIF EN FORMATION AGRICOLE CENTRE-DU-QUÉBEC
Formations en acériculture : de beaux ajouts
GUYLAINE MARTIN AGR. Répondante
L’offre de formations en acériculture en salle ou à l’érablière est bien garnie. Pour les participants pour qui la date et le lieu ne conviennent pas, la formule en ligne change tout!
Récemment, six formations de courte durée se sont ajoutées : Entaillage des érables en trois langues : français, anglais et en espagnol ; Transformation des produits de l’érable en deux langues : français et espagnol; et Êtes-vous sur votre Brix? en français.
Toutes de formations peuvent être faites à son rythme. Elles sont à un prix très abordable, 60 $ et moins. Débuter en acériculture est offerte en trois langues depuis quelques années.

Extra du Cégep de La Pocatière et le Centre d’études collégiales du Témiscouata lancent à nouveau, l’attestation d’études collégiales (AEC) Gestion et optimisation d’une entreprise acéricole du 15 mai 2023 au 15 mars 2025. Initialement offerte à distance à temps plein, elle sera cette fois proposée à temps partiel un à deux soirs par semaine, afin de s’adapter aux horaires atypiques des acériculteurs.
Le programme est composé d’une formation théorique en ligne de 8 semaines et une formation de 6 semaines au Centre de formation en acériculture de Pohénégamook.
Une partie pratique de 16 semaines sera réalisée en entreprise ou chez l’employeur avec un accompagnement de l’enseignant. Cette formation rend éligible à une prime à l’établissement de 20 000 $.

Et ce n’est pas tout! Certains formateurs proposent leur formation en ligne. Tout le monde doit être devant son ordinateur en même temps.
Pour plus d’information, consultez le catalogue des formations en agriculture sur le site U+, uplus.upa.qc.ca
12Jeudi 9 mars 2023Gestion et Technologie Agricoles
Le Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs propose son diplôme d’études professionnelle (DEP) en production acéricole selon un nouvelle formule. Photo : Producteurs et productrices acéricoles du Québec.
en formation agricole

Gestion et Technologie AgricolesJeudi 9 mars 202313
Amélioration des pratiques agroenvironnementales : 29 M$ pour la seconde cohorte
Le gouvernement du Québec annonce la deuxième période d’inscription à l’Initiative ministérielle de rétribution des pratiques agroenvironnementales, qui se déroulera jusqu’au 31 mars 2023.
Pour cette deuxième cohorte, l’Initiative a fait l’objet de deux modifications importantes. La première vise la reconnaissance de la formation continue des entreprises offerte par l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) en collaboration avec les partenaires du secteur. Le parcours de formation de l’ITAQ permettra aux entreprises de parfaire leurs connaissances en agroenvironnement et de bénéficier d’une rétribution spécifique pouvant atteindre 1500 $ par entreprise.
La seconde modification touche la reconnaissance des agriculteurs et des agricultrices leaders qui ont atteint un niveau avancé d’adoption des pratiques les plus novatrices en agroenvironnement. Ces personnes sont exemptées de la condition de croissance prévue à l’Initiative. Les deux nouvelles mesures sont rétroactives aux entreprises de la première cohorte. Rappelons que, à la suite du déploiement de la première cohorte de l’Initiative en février 2022, quelque 1850 entreprises s’y sont inscrites en un peu plus de 24 heures, réservant ainsi la totalité de l’enveloppe initiale de 56 M$ prévue sur quatre ans. Les résultats déclarés pour la première année
de participation de ces entreprises sont éloquents et témoignent de leur engagement pour une agriculture plus durable.

Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, André Lamontagne, a profité de l’occasion pour annoncer l’octroi d’une aide financière de 356 400 $ à l’Union des producteurs
agricoles (UPA) afin de mettre sur pied le projet Agir pour l’agriculture durable : 3 en 1.
Celui-ci vise à sensibiliser et à former les entreprises aux bonnes pratiques agroenvironnementales, notamment celles admissibles à l’Initiative. Les formations mises sur pied dans le cadre de ce projet seront également inscrites au parcours de formation continue en agroenvironnement.
Dans le cadre de l’Initiative, les pratiques admissibles sont les suivantes :
- Diversification des cultures;
- Protection des sols hors saison;
- Réduction de l’usage des herbicides;

- Utilisation de semences non traitées aux insecticides;
- Aménagements favorables à la biodiversité.
14Jeudi 9 mars 2023Gestion et Technologie Agricoles

Gestion et Technologie AgricolesJeudi 9 mars 202315
Programme d’emploi et de compétences des jeunes
La ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau, a annoncé un investissement d’environ 13 millions de dollars pour améliorer le Programme d’emploi et de compétences des jeunes (PECJ) et contribuer au soutien de quelque 1 200 emplois pour les jeunes dans le secteur agricole. Le Programme est maintenant ouvert et les intéressés peuvent envoyer une demande.
Le PECJ offre une subvention salariale aux employeurs du secteur qui embauchent des jeunes canadiens en finançant 50 % des salaires, jusqu’à un maximum de 14 000 $. Les employeurs qui embauchent des jeunes confrontés à des obstacles à l’emploi ont droit à une aide couvrant 80 % du coût des salaires et des avantages sociaux. Ils peuvent également avoir droit à une aide supplémentaire de 5 000 $ pour surmonter certains obstacles à l’emploi.
Voici la liste des jeunes confrontés à des obstacles à l’emploi :
• les jeunes autochtones;
• les jeunes ayant un handicap physique ou mental ou un trouble d’apprentissage;
• les jeunes racialisés (anciennement « membres de minorités visibles »)
• les nouveaux arrivants au Canada (c.-à-d. au pays depuis moins de 5 ans)
• les jeunes qui sont parents monoparentaux;
• les jeunes vivant dans un ménage à faible revenu;
• les décrocheurs du secondaire;
• les jeunes vivant dans des régions éloignées, nordiques ou accessibles seulement par voie aérienne;
• les jeunes vivant dans une communauté de langue officielle en situation minoritaire;
• les jeunes 2ELGBTQQIA+.
Le programme accepte les demandes jusqu’au 27 mars pour que leur projet soit pris en compte. Les demandes d’employeurs autochtones seront traitées en priorité pour l’année de programme 2023-2024.
Le formulaire à remplir se trouve sur la page Web du PECJ. Pour plus de renseignements : aafc.yesp-pecj.aac@canada.ca ou de téléphoner au 1-866-452-5558.

Ottawa appuie l’acquisition de technologies propres au Québec
De passage chez G.S.P.M. Distribution à Napierville, la ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau, a annoncé l’appui financier du fédéral à quatre nouveaux projets liés à l’adoption de technologies propres par des entreprises du secteur agricole au Québec.
Financés à la hauteur de 2,7 M$ dans le cadre du Programme des technologies propres en agriculture (TPA) - volet adoption, ces initiatives vont permettre aux producteurs d’accroître leur compétitivité et réduire leur empreinte carbone.
Les nouveaux projets sont les suivants :
• Entosystem de Drummondville obtient jusqu’à 2 M$ pour l’achat et l’installation de technologies et d’équipement écoénergétiques afin d’accroître l’efficacité de leur système de production d’engrais et d’aliments pour animaux à base d’insectes;
• La Ferme Belveau de Saint-Henri-deLévis reçoit jusqu’à 194 614 $ pour le remplacement d’un évaporateur à huile par un évaporateur à bois à rendement élevé qui servira à la production de sirop d’érable;
• La Ferme Delorme de Sainte-Brigided’Iberville reçoit jusqu’à 376 860 $ pour l’installation d’un nouveau séchoir à grains qui soutiendra la production de grandes cultures;
• La Ferme Macna S.E.N.C. de SaintFrançois-du-lac obtient jusqu’à 106 944 $ pour l’installation d’un système de ventilation écoénergétique et un système d’éclairage à DEL dans son étable laitière.
Ces nouveaux investissements portent à 18 le nombre de projets appuyés au Québec dans le cadre du Programme des TPA, pour un montant total de 6,7 M$. G.S.P.M. Distribution, qui produit des légumes-feuilles, fait partie des entreprises qui ont été soutenues l’an dernier dans le cadre du Programme.
La société a reçu 846 625 $ pour installer un système d’agriculture verticale hydroponique intérieur, qui permet une production maraîchère toute l’année. Des panneaux solaires ont remplacé l’huile comme source d’énergie et la gestion de l’eau a été améliorée par la collecte de l’eau de pluie.

16Jeudi 9 mars 2023Gestion et Technologie Agricoles
JUSQU’AU 27 MARS
De l’importance du drainage de surface
Yves RIVARD GTA
Tout agriculteur le confirmera : le drainage de surface réduit grandement les risques d’érosion du sol, améliore l’uniformité des semis et stimule la croissance des plants. Effectués de manière professionnelle certifiée, les travaux nécessaires permettent d’optimiser les activités quotidiennes et de mieux contrôler les impacts directs découlant de précipitations excessives. En gardant en tête que le drainage est un investissement, qui sera ajouté à l’évaluation du terrain, et non une dépense, voici quelques faits à considérer.


Suivant les fortes pluies du printemps et de l’automne de même que la fonte des neiges, il convient de mener un examen visuel du sol afin d’en identifier les zones érodées et dépressions, souvent plus importantes que la seule zone du champ inondée à la suite de précipitations. Leur taille doit être déterminée à partir d’un relevé topographique très détaillé, ce qui permettra en retour de livrer une analyse du plan de drainage précise apte à informer le choix des solutions possibles.
Un système de surface pour des résultats en profondeur
Ainsi, une dépression dite de taille limitée peut facilement être corrigée par des travaux de nivellement (superficie maximale de la dépression selon le relevé topographique : 0,5 ha, profondeur maximale : 5 à 10 cm), tout en gardant en mémoire que
lesdits travaux doivent être menés selon des méthodes et pratiques très précises, question d’éviter qu’un nivellement inadéquat n’agrandisse davantage la dépression. Ce qui se révélerait évidemment contre-productif.
Il est recommandé de s’assurer que la pente finale du sol soit d’au moins 0,15 %, soit de manière à empêcher l’accumulation d’eau au-dessus des anciennes dépressions. De la même manière, la terre arable doit demeurer en surface en tout temps.
À noter : il s’avère parfois nécessaire de mener des travaux correctifs au cours des années suivant les travaux de nivellement, et ce, dans l’objectif de contrer les irrégularités pouvant résulter du tassement du sol dans les premières années.
Cumul et calcul
Avant de contacter un professionnel du drainage agricole, il importe d’effectuer des calculs visant à évaluer les coûts liés à cet investissement en développement durable et les délais de récupération occasionnés par le gain de rentabilité qui en découle directement. Plusieurs formules et plans pourront vous être expliqués par les experts en la matière. Améliorer la qualité de l’environnement en diminuant l’érosion du sol et, du même coup, la qualité de l’eau dépasse le simple investissement en rentabilité (et en évitement de pertes) en préparant le terrain pour les générations à venir.
Gestion et Technologie AgricolesJeudi 9 mars 202317
POUR DES SOLS EN SANTÉ
Gain de rendement des érablières au cours des 20 dernières années au Québec
JEAN-PIERRE BELLEGARDE, conseiller en gestion de programme, Direction régionale du Centredu-Québec, ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
Au cours des 20 dernières années, le rendement des érablières au Québec a augmenté de près de 57 %. Devant cette augmentation, on peut se demander : mais pourquoi? Cela s’explique principalement par deux grands facteurs. Cependant, passons d’abord sous la loupe les données de rendement des dernières années.
Le graphique 1 présente le rendement annuel1 par entaille au Québec au cours des 20 dernières années. Pendant cette période, on observe une variabilité interannuelle. Celle-ci se manifeste depuis des décennies.

Toutefois, il y a un gain de rendement des érablières à long terme. En effet, le gain réalisé sur une période de 20 ans est de 1,20 livre par entaille. Comme l’illustre le graphique 1, le rendement moyen des érablières était de 2,11 livres par entaille de 2003 à 2007; 2,18 livres par entaille de 2008 à 2012; 2,99 livres par entaille de 2013 à 2017; 3,31 livres par entaille de 2018 à 2022. Le gain de rendement a donc augmenté continuellement par période de cinq ans.
Le rendement d’une érablière est influencé par différents facteurs, notamment par :
• le type de système de récolte et son installation, le niveau et le maintien du vide à l’entaille2, l’entaillage3, l’assainissement de la tubulure et des chalumeaux, le nombre d’entailles par diamètre à hauteur de poitrine (DHP4) et le volume de bois compartimenté5 dans l’érable;
• les conditions climatiques variables d’une année à l’autre pendant la récolte, le positionnement géographique de l’érablière ainsi que le nombre, le volume et la gestion des coulées;
• la génétique des érables entaillés, le type de sol et le contrôle de sa fertilité par le chaulage;
• l’aménagement des érablières6 ainsi que le maintien d’une quantité minimale d’essences compagnes et d’essences d’érable avec un DHP optimal.
Principaux facteurs expliquant les gains de productivité des 20 dernières années
Les gains de rendement s’expliquent en partie par le transfert de connaissances. Au début des années 2000, un comité d’experts avait reçu le mandat d’élaborer un cahier de transfert technologique en acériculture (CTTA). Le document qui a été produit contenait les plus récentes connaissances en acériculture, en partant de la récolte de la sève d’érable jusqu’à la transformation finale des produits de l’érable. Le CTTA est devenu rapidement un document de référence pour les formateurs et les conseillers des clubs acéricoles, ce qui leur a permis d’offrir des conférences7 et de la formation8 aux
entreprises acéricoles et aux étudiants en acériculture. De plus, le Centre ACER, le MAPAQ, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ), les clubs d’encadrement technique, les équipementiers, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts, les ingénieurs forestiers et les agronomes s’impliquent dans la recherche et contribuent de façon continue au transfert de connaissances aux entreprises acéricoles.
En outre, il y a eu l’ajout d’un peu plus de 15 millions de nouvelles entailles de 2003 à 2022. Le nombre d’entailles9 est ainsi passé de 34 millions à près de 50 millions. Le graphique 1 montre d’ailleurs la moyenne mobile quinquennale10 des entailles exploitées et la moyenne mobile quinquennale du rendement au cours des 20 dernières années. Ces deux courbes suivent sensiblement la même tendance : le nombre d’entailles exploitées a augmenté de 46 % et le rendement, de 57 %. Cela permet d’émettre l’hypothèse que les gains de productivité sont aussi dus à l’ajout de nouvelles entailles. Dans les faits, ces 15 millions d’entailles n’avaient pour la plupart pas de zones compartimentées et elles ont été exploitées avec de la tubulure neuve. De plus, plusieurs producteurs et productrices acéricoles ont acquis une formation sur les plus récentes techniques de production et sur l’aménagement de leur érablière, ce qui leur a permis de maximiser le rendement des nouvelles entailles. Ces 15 millions de nouvelles entailles ont très certainement une productivité plus élevée que les 34 millions d’entailles fortement
compartimentées et exploitées depuis plusieurs décennies avec un système de récolte possiblement plus désuet.
Impacts des changements climatiques
À court terme, il est difficile d’évaluer les impacts des changements climatiques11 sur les gains de productivité des érablières sans avoir recours aux données climatiques de cette période. Les producteurs acéricoles doivent déjà s’adapter. Par exemple, avec les changements climatiques récents, les producteurs devancent de plus en plus leur date d’entaillage. Ils suivent de près les prévisions climatiques dès le mois de janvier afin de ne pas perdre de récolte en début de saison, laquelle est de plus en plus difficile à prévoir. Plusieurs facteurs liés aux changements climatiques peuvent avoir des effets sur la vigueur, la santé et la productivité des érablières, comme :
• les conditions climatiques futures12;
• les épidémies de ravageurs;
• les maladies;
• les espèces envahissantes.
Malgré les gains de productivité des 20 dernières années, il est difficile de prévoir quels seront les gains, ou peut-être les pertes, de rendement des érablières pour les prochaines décennies avec les changements climatiques.
Quoiqu’il en soit, ces données démontrent l’importance de poursuivre le transfert de connaissances, de continuer les recherches en acériculture, d’intensifier l’aménagement des érablières et d’adapter les pratiques et les techniques de production en fonction des changements climatiques, afin d’assurer la productivité et la rentabilité des érablières à long terme.
1 - Enquêtes menées par Groupe AGÉCO de 2002 à 2022. Plus de 1 000 entreprises acéricoles ont répondu annuellement à un sondage dans le cadre de ces enquêtes.
2 - Plus le vide à l’entaille (étanchéité) est élevé, plus le rendement est élevé, soit 4 % à 8 % de rendement par pouce de mercure.
3- Diamètre, profondeur et répartition de l’entaille dans les zones de bois sain (zone non compartimentée), etc.
4 - Diamètre de l’érable à 1,30 mètre du sol.
5 - Volume de bois mort ne permettant pas le transport de la sève d’érable.
6 - Favorise le taux de croissance et la vigueur des érables tout en éliminant les arbres dépérissants.
7 - Journées acéricoles du MAPAQ, assemblée générale annuelle des PPAQ, assemblée générale annuelle du Centre ACER, Journées forestières, portes ouvertes des équipementiers, etc.
8 - Collectif en formation agricole (U+), Maison familiale rurale du Granit, CF en acériculture du Fleuve-et-des-Lacs, Centre de formation agricole Saint-Anselme, Cégep de La Pocatière, etc.
9 - Dossiers économiques des PPAQ.
10 - Période de cinq ans.
11 - Ouranos. Production de sirop d’érable face aux changements climatiques : perceptions des acériculteurs du Canada et des États-Unis, 2018.
12 - Sécheresses, chaleurs extrêmes, vents violents, accumulations de neige, verglas, périodes de gel-dégel, etc.

18Jeudi 9 mars 2023Gestion et Technologie Agricoles
Faire son inventaire de thuyas (cèdres) ou d’arbres de Noël au champ à l’aide d’un drone
sons, soit le printemps et l’automne. Le dispositif expérimental pour chaque site (sapins ou thuyas) était constitué de 20 blocs aléatoires. Chaque bloc comprenait cinq rangs de 5 arbres (25 arbres).
Lourde tâche pour les producteurs pépiniéristes, tenir les inventaires de thuyas ou sapins nécessite plusieurs jours de travail dans une seule saison de culture et utilise jusqu’à une dizaine d’employés dans un contexte de pénurie de maind’œuvre. De plus, l’incertitude liée à ces dénombrements occasionne des biais importants d’inventaire qui peuvent mener à des erreurs de commandes, provoquant l’insatisfaction des clients. L’IQDHO en collaboration avec GÉOGRID a réalisé un projet visant à développer une méthode d’assistance à l’inventaire par drone pour les cultures de thuyas et sapins.
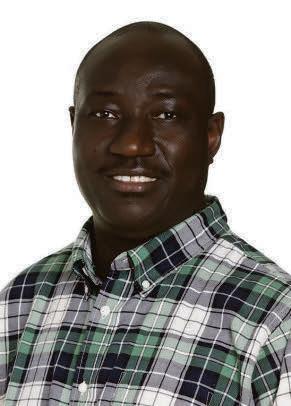
Le projet tenait dans une collecte manuelle (au sol) et par drone (trois altitudes de vol) des données (dénombrement des arbres, mesures de leur hauteur et de la densité du feuillage) dans les sapins et thuyas sur une période de deux ans (2021 et 2022). Six et huit sites d’un hectare par année ont été évalués respectivement dans les sapins et les thuyas. Chacune des années était subdivisée en deux sai-
En 2021, toutes les données ont été prises par le drone DJI Phantom 4 Pro (caméra optique à 20 mégapixels). Comme la technologie des drones évolue très rapidement, c’est le drone DJI Matrice 300 RTK (caméra optique à 45 mégapixels) qui a été utilisé pour l’enregistrement de toutes les données des deux productions en 2022.
Dans un premier temps, les paramètres de vol optimaux (bonne résolution et meilleur recouvrement des images) du drone pour l’estimation du dénombrement et de la hauteur des sapins et thuyas ont été évalués. Les conditions optimales de vol semblent être observées avec le drone DJI Matrice 300 RTK à 60 et 80 m d’altitude dans les thuyas et sapins respectivement.
Deuxièmement, l’algorithme d’analyse des images développé à partir des données recueillies a permis de mesurer la hauteur des arbres (sapins et thuyas) avec un niveau de précision élevé (+/- 2 cm) et de les dénombrer efficacement (moins de 5% d’erreur) à l’aide de la télédétection.
Troisièmement, l’estimation de la densité du feuillage des sapins et thuyas prévue au début du projet a été abandonnée après la saison 2021, car les données collectées par la caméra multispectrale
n’étaient pas exploitables. Toutefois, avec les avancées de la technologie cela pourrait être possible dans un avenir rapproché.
Enfin, selon nos analyses économiques, le coût de réalisation de cette nouvelle méthode est environ 3 à 5 fois moins élevé que celui de l’inventaire manuel. L’usage de cette méthodologie permettra donc d’augmenter la viabilité économique des entreprises en diminuant le nombre d’employés associé à l’inventaire. L’utilisation de la technologie des drones pour effectuer l’inventaire des thuyas et des sapins pourrait également permettre le diagnostic et la résolution d’autres problématiques (maladies, mauvaises herbes, fertilisation, irrigation, compaction des sols, etc.) en pépinière ornementale.
De nouveaux modèles de drones et de capteurs arrivent régulièrement sur le marché. Il serait donc nécessaire d’effectuer des tests préliminaires afin de trouver

les paramètres optimaux pour chaque modèle. D’après les données collectées (analyses non présentées) dans les thuyas en 2021 et 2022 dans un avantprojet (IQDHO) visant à évaluer la croissance moyenne annuelle des thuyas, il serait également possible d’utiliser la technologie des drones pour déterminer la croissance des arbres.
Ce Projet est financé par l’entremise du programme Innov’Action Agroalimentaire, en vertu du Partenariat canadien pour l’agriculture, entente conclue entre les gouvernements du Canada et du Québec.


Gestion et Technologie AgricolesJeudi 9 mars 202319 IQDHO
AUGUSTIN MOH, Ph. D., agr., Chargé de projets, IQDHO
ASREC : du nouveau pour la campagne d’adhésion printanière
Il y a du nouveau du côté de l’’Assurance récolte (ASREC). À vos calendriers! La campagne d’adhésion 2023 pour les protections printanières à l’assurance récolte est en cours. Des nouveautés ont été apportées afin d’offrir la protection la plus adaptée à votre réalité.
Le Programme d’assurance récolte (ASREC), c’est une protection pour vos récoltes contre les risques associés aux conditions climatiques et aux phénomènes naturels incontrôlables. C’est un outil de gestion des risques indispensable!
Dates de fin d’adhésion
- Pommes Plan B : 1er avril;
- Maïs sucré et pois verts de transformation : avant de commencer les semis et au plus tard le 24 juin;
- Haricots de transformation : avant de commencer les semis et au plus tard le 15 juillet;
- Brocolis, choux-fleurs et cornichons de transformation : dernière journée de semis ou de plantation;
- Toutes les autres cultures assurables : 30 avril.
Nouveautés pour 2023
Céréales, maïs-grain et protéagineuses
- Nouvelle option de prix unitaires de marché en régie conventionnelle
Un prix unitaire basé sur le prix de marché est maintenant offert pour l’avoine, le soya, le blé d’alimentation humaine et animale, le canola, l’épeautre, l’orge et le triticale.
- Admissibilité de l’autosemence pour les céréales produites en régie biologique
Dans le cadre d’un projet pilote, les producteurs de céréales biologiques pratiquant l’autosemence peuvent bénéficier d’une couverture d’assurance.
- Assurabilité du seigle au système individuel
Le seigle est désormais assurable à la protection Céréales, maïs-grain et protéagineuses offerte au système individuel.
Cultures émergentes – Quinoa et caméline
Le quinoa et la caméline sont désormais assurables à la protection Cultures émergentes offerte au système collectif.
Nouvelle option de garantie
Céréales, maïs-grain et protéagineuses, pommes et pommes de terre
L’option de garantie à 70 % avec abandon est maintenant offerte pour les céréales, maïs-grain et protéagineuses, pommes et pommes de terre (Pour les pommes, l’option de garantie à 70 % avec abandon et à 80 % avec abandon est offerte pour la qualité seulement).
Producteurs assurés à la protection Foin et pâturages

Une actualisation du calcul de la valeur de remplacement ainsi que de la grille Gel hivernal a été réalisée afin de mieux refléter votre réalité.
Dorénavant, les grilles d’indemnisation sont disponibles dans son site Internet.
Rendez-vous
FADQ : vers une agriculture 4.0 prospère et durable
La Financière agricole vous invite au « Rendez-vous FADQ : vers une agriculture 4.0 prospère et durable! » L’événement rassemblera l’ensemble des acteurs du secteur agricole. C’est l’occasion d’y consolider des liens, en plaçant au cœur des discussions l’innovation, la transformation numérique et l’agriculture de demain. Plus de 700 participants y ont pris part l’an dernier. La webconférence gratuite se tiendra le 29 mars, de 13 h 30 à 16 h 15.

Mot d'ouverture :
Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec.
Conférence :
Annie Royer, titulaire de la Chaire d'analyse de la politique agricole et de la mise en marché collective de l'Université Laval.
Producteurs invités :
• Virginie Lepage, de la Ferme Olofée (avoine), Saint-Félicien;
• Vincent Godin, d’Emblème Canneberge, Sainte-Eulalie;
• George Aczam, d’AquaVerti (cultures en serre), Montréal;
• Luc Veilleux, de la Ferme porcine L.V., Sainte-Marie;
Invité d'honneur
André Lamontagne, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec.
20Jeudi 9 mars 2023Gestion et Technologie Agricoles

Gestion et Technologie AgricolesJeudi 9 mars 202321
Ramassage et récupération de métaux à la ferme
 Yves RIVARD GTA
Yves RIVARD GTA
Les routes et les rangs de campagne sont souvent les endroits où l’on retrouve des tracteurs, des remorques, des clôtures et autres machineries et équipements ayant dépassé leur durée de vie utile. Pour différentes raisons, ces carcasses et squelettes décorent les champs et arrière-cours de fermes offrant certes des paysages pittoresques, mais qui se contentent de rouiller au lieu de connaître une seconde vie à travers le recyclage. Il importe d’agir.
Le recyclage des métaux, partie prenante de l’économie circulaire, s’inscrit dans la démarche globale de responsabilité sociale d’entreprise (RSE), qui repose sur l’idée qu’une entreprise devrait jouer un rôle positif dans la collectivité et tenir compte de l’impact environnemental et social de ses décisions.
Promue à tous les niveaux de la société, cette responsabilité permet de réduire l’impact environnemental qui, dans ce cas particulier, se révèle bien moindre que celui de l’extraction minière et d’usinage.
En plus de désencombrer votre ferme ou votre entreprise, le recyclage de métal permet de prévenir de nombreux problèmes environnementaux, notamment la pollution des sols et de l’atmosphère.
Le secteur agricole particulièrement visé


La plupart des experts acceptent une multitude de métaux selon différentes quanti-
tés : acier inoxydable, cuivre, tôle, fer, aluminium et fonte. Plusieurs autres types de produits sont également recueillis pour leurs composantes métalliques.
On pense, entre autres, aux barbecues, électroménagers, souffleuses, ton-
deuses, chauffe-eau, structures d’acier, ensembles de patio, plomberie, fils électriques, vélos et roues d’aluminium.
Il va sans dire que le secteur agricole, qui comporte de nombreuses possibilités en termes de camions, de machinerie
lourde et/ou agricole, constitue l’un des clients importants en matière de collecte et de recyclage.
Un expert reconnu saura vous informer des différentes possibilités liées à chaque type d’équipement.
22Jeudi 9 mars 2023Gestion et Technologie Agricoles
Les tendances en matière d’accueil et d’intégration des nouveaux employés

dans la salle de pause. N’oubliez pas de le prévenir de la date, de l’heure et du lieu de rencontre pour sa première journée.
L’accueil
Depuis quelque temps déjà, le sujet de la pénurie de main-d’œuvre est d’actualité. Les experts s’entendent pour dire que nous vivrons cette situation pendant environ 10 ans. Le Conseil du patronat du Québec dressait en avril 2021 un portrait préoccupant à la suite d’une étude1 réalisée auprès d’entreprises québécoises de différentes tailles. Selon les résultats, près de 50 % d’entre elles ont refusé des contrats par manque de main-d’œuvre. Le secteur de l’agroalimentaire ne fait pas exception.
Dans ce contexte, il est primordial d’adopter une posture proactive à l’égard du personnel en place pour le conserver, mais aussi de bien planifier l’arrivée et l’intégration des nouveaux employés pour faciliter cette étape et augmenter la probabilité de maintenir le lien d’emploi. Le processus peut se diviser en quatre grandes étapes : la préparation à l’accueil, l’accueil, l’intégration à la tâche ainsi que le suivi et l’évaluation. Voici quelques idées intéressantes à mettre en place pour organiser le tout.
La préparation à l’accueil Votre aspirant employé accepte votre offre? Bravo, mais tout n’est pas gagné. Votre candidat pourrait ne pas se présenter à la première journée de travail, son ancien employeur pourrait essayer de le retenir ou il pourrait avoir postulé à plus d’un endroit et vous serez alors en concurrence avec d’autres offres alléchantes. Il est donc important d’assurer la rétention préembauche en gardant le contact avec votre nouvel employé jusqu’à son entrée en fonction. Par exemple, si un évènement est prévu dans votre organisation, vous pouvez l’inviter pour qu’il se familiarise avec sa nouvelle équipe. Il sentira qu’il est désiré et attendu au sein de votre organisation, ce qui favorisera le développement d’un sentiment d’engagement et d’appartenance.
En parallèle, c’est la période pour planifier son arrivée en faisant l’annonce officielle auprès de l’équipe et en expliquant ses principaux mandats. C’est aussi le moment de préparer son bureau, son poste de travail ou son casier pour ses effets personnels, ainsi que de faire les demandes pour les accès, les codes et les logiciels nécessaires à son travail. Le dossier administratif pour la rémunération se prévoit également à cette étape.
Identifiez une personne-ressource qui agira comme mentor lors de l’entrainement à la tâche et planifiez une activité d’accueil lors de sa première journée pour briser la glace. Ce peut être, par exemple, un diner collectif ou une banderole de bienvenue accrochée dans son bureau ou
Nous y sommes, l’employé arrive au moment prévu. Évidemment, une personne de l’organisation, idéalement son gestionnaire ou une personne du service des ressources humaines, est là pour l’accueillir. C’est le moment de lui présenter la planification de son intégration, de lui expliquer les règles administratives et les directives ainsi que de discuter de l’accompagnement auquel il aura droit. Lors de cette première journée, il aura probablement plusieurs documents administratifs à remplir. L’organisation de son poste de travail devra sans doute être faite également. Les premières journées à un nouvel emploi sont souvent bien chargées de diverses informations à retenir. Prenez garde au « bourrage de crâne ». Afin d’éviter cela, prévoyez de fournir à l’employé des feuilles et un crayon pour la prise de notes et de lui remettre un guide du nouvel employé contenant les informations importantes ainsi que les marches à suivre.
De plus, une visite des lieux et la présentation des membres de l’équipe demeurent une priorité lors de cette journée. Finalement, soulignez l’arrivée de l’employé avec l’activité que vous avez prévue. Mais surtout, n’oubliez pas que vous êtes encore en « opération séduction ».
L’intégration à la tâche
Selon la complexité du poste occupé et l’expérience du travailleur, cette période peut être plus ou moins longue. Il faut organiser une rencontre avec la personneressource désignée comme mentor. Pendant cette rencontre, prévoyez un temps pour revoir les tâches, les responsabilités et les mandats de l’employé, mais aussi pour faire part de vos attentes en lien avec son travail. De son côté, l’employé
fonctionnement et les suivis à venir. Un des volets importants de cette étape est de bâtir une communication bidirectionnelle efficace afin que l’employé se sente suffisamment en confiance pour poser des questions.
Cette étape permet aussi de créer des liens avec les autres collègues de l’organisation, en plus de préparer la suite. Une bonne pratique à adopter serait également de le présenter auprès des fournisseurs, des conseillers et des intervenants qui gravitent autour de votre entreprise.
Le suivi et l’évaluation
Le plan d’intégration devrait prévoir des rencontres de suivi régulièrement dans les premières semaines. Elles permettent entre autres de faire le point sur la maitrise des dossiers, le besoin d’information supplémentaire et la lourdeur de la charge de travail. C’est le moment de prendre des nouvelles de l’employé, de le rassurer sur son cheminement, de reconnaitre son travail, d’adapter au besoin la charge de travail et, bien sûr, d’évaluer votre plan d’accueil et d’intégration pour le bonifier à la suite des commentaires reçus. Un employé qui ne reçoit pas de rétroaction pourrait penser qu’il est incompétent. La réussite de l’accueil et de l’intégration est une responsabilité conjointe entre le supérieur immédiat, le service des ressources humaines et les collègues déjà à l’emploi. Une intégration réussie est le premier pas vers une relation forte et durable. Vous manquez d’idées ou vous ne savez pas par où commencer? Plusieurs sites Internet suggèrent des procédures intéressantes. Vous trouverez notamment sur le site d’Entreprises Québec un exemple de marche à suivre pour l’accueil et l’intégration des nouveaux employés ainsi que des sites de référence en gestion des ressources humaines (www2.gouv.qc.ca/portail/quebec Ressources humaines / Boîte à outils en gestion des ressources humaines /
d’accueil et d’intégration des nouveaux employés peut augmenter le niveau de rétention de 82 % et leur productivité de 70 %. En sachant qu’il est plus dispendieux d’embaucher un employé que de garder ceux à l’emploi, avez-vous les moyens de vous passer de ce processus?
1 - La pénurie de main-d’œuvre, une catastrophe annoncée | Conseil du patronat du Québec (cpq.qc.ca) 2 - https://b2b-assets.glassdoor.com/the-true-cost-ofa-bad-hire.pdf
Sources :
• Lafrenière, Daniel. « L’importance du processus d’accueil et d’intégration », Les Affaires. [www.lesaffaires.com/ blogues/daniel-lafreniere/ limportance-du-processus-daccueilet-dintegration-/628819].
• Entreprises Québec. Accueil et l’intégration des nouveaux employés [https://www2.gouv.qc.ca/portail/quebec/ressourcesh?lang=fr&g=ressourcesh&sg=personnel&t=s&e=2074413 809:1509671184:291664427].
• Guilbert, Tom. « Savez-vous que les premières semaines au travail, d’un nouvel employé, auront un impact direct sur son niveau de rétention? », L’Union des producteurs agricoles [www.upa.qc.ca/citoyen/centre-descommunications/nouvelles/toutes-lesnouvelles/savez-vous-que-les-premie res-semaines-au-travail-dun-nouvelemploye-auront-un-impact-direct-surson-niveau-de-retention].
• Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale. En action pour la main-d’œuvre : marché du travail [www.mtess.gouv.qc.ca/grands-dossiers /action_maindoeuvre/marche/index.asp].
• Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail. Démarche d’intégration de vos nouveaux travailleurs [www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/

Gestion et Technologie AgricolesJeudi 9 mars 202323
L’accueil et l’intégration, c’est l’affaire de tout le monde! Photo : MAPAQ.
SANDRA DAGENAIS, T.P., conseillère en économie-gestion et en relève agricole, direction régionale du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
Comment bien planifier ses liquidités durant un cycle inflationniste et une période de perturbation de la chaîne d’approvisionnement
Effectuez un budget de trésorerie
Le budget de trésorerie demeure l’outil par excellence pour estimer toutes les rentrées et les sorties de fonds prévues au cours d’une période donnée. Ces prévisions vous permettront de connaître toutes les sommes que votre entreprise devrait encaisser sur la période prévisionnelle tout comme les montants qui devront être décaissés. Vous serez alors en mesure de prévoir les besoins de financement à court terme et, ainsi, de vous assurer que votre marge de crédit répond aux besoins de votre entreprise. Plusieurs outils sont à votre disposition, dont le calculateur de budget de trésorerie et de gestion accessible gratuitement sur le site Internet d’Agri-Réseau (www.agrireseau.net/economie-etgestion/documents/103648).
trouver beaucoup d’articles qui abordent cette question.
Identifiez et gérez le risque
Tout d’abord, pour gérer un risque, il faut savoir l’identifier. Les bonnes pratiques de gestion des risques suggèrent l’utilisation d’un outil de gestion des risques liés à la chaîne d’approvisionnement. Ce peut être une grille dans laquelle l’exploitant énumère les risques anticipés avec une probabilité d’occurrence (forte, moyenne, faible). Cet exercice permet d’avoir un aperçu des risques et d’y anticiper des solutions. La grille devrait être mise à jour régulièrement par les parties prenantes dans l’entreprise.
En conclusion, il n’existe pas de recette unique pour mieux gérer ses liquidités durant un cycle inflationniste et une période de perturbation d’approvisionnement. Toutefois, des pistes de solutions existent pour en atténuer l’impact. Parmi celles-ci, l’utilisation de différents outils de gestion des risques liés à l’approvisionnement, l’accompagnement par des professionnels, une bonne planification comprenant la revue du plan d’action ainsi qu’une bonne collaboration entre les entreprises, les fournisseurs, les créanciers et les clients demeurent des éléments essentiels.
L’inflation, la hausse des taux d’intérêt et les difficultés d’approvisionnement en intrants ont une incidence sur toutes les entreprises, en particulier celles qui sont en démarrage, celles qui n’ont pas beaucoup de capitaux propres et, naturellement, celles qui ont recours à du financement.

Voici donc quelques conseils afin de protéger votre entreprise contre la hausse du coût d’exploitation et les difficultés liées à la chaîne d’approvisionnement qui affligent les entreprises depuis plusieurs mois.
Contactez votre créancier
La première étape, et non la moindre, est de contacter votre prêteur. Ce dernier est un expert en financement et connaît toutes les astuces pour vous aider dans l’atteinte de vos résultats. Avisez-le des turbulences que connaît votre entreprise. N’attendez pas qu’il soit trop tard. Pour prévenir une crise des liquidités créée par la hausse des taux d’intérêt et l’augmentation du coût des intrants, votre directeur de compte est votre meilleur allié. Il vous proposera des solutions en fonction de la situation financière de votre entreprise. Afin de maintenir une excellente relation d’affaires avec votre créancier, il est important que vous ayez une confiance mutuelle et que vous fassiez preuve d’une grande franchise réciproque.
Soyez au fait de la santé financière de votre entreprise
N’attendez pas la fin de votre exercice financier pour dresser un constat. Votre conseiller en gestion, votre comptable ou votre fiscaliste pourra vous brosser un portrait clair et limpide de la santé financière de votre entreprise. Quels sont les capitaux propres de mon entreprise? Le fonds de roulement est-il suffisant en fonction du type d’entreprise que j’exploite? L’endettement est-il excessif ou supportable? Voilà quelques questions auxquelles votre conseiller en gestion pourra répondre. Il vous est également possible d’adhérer à un groupe-conseil agricole (GCA). Pour en savoir plus, visitez le www.agrireseau.net/documents/65701/.
Profitez de la situation pour mettre à jour votre plan d’affaires
Prenez le temps de réfléchir à votre modèle d’affaires. Il est peut-être temps d’arrêter la production de certains types d’aliments ou de produits, de négocier le prix d’intrants avec vos fournisseurs ou, pourquoi pas, de changer de fournisseur. Profitez de la situation pour calculer le coût de revient. Un produit vous coûte trop cher à produire? Modifiez la recette, augmentez le prix de vente, substituez un intrant moins cher à un autre plus cher. Vous êtes le gestionnaire, c’est vous qui devez prendre les bonnes décisions pour le bien de votre entreprise.
Des conseillers en gestion du Réseau Agriconseils Montérégie sont spécialisés dans le coût de revient. N’hésitez pas à les contacter au 450 774-6383, poste 7223.
Sécurisez et planifiez vos approvisionnements
Selon un sondage de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante réalisé en février 2022, 89 % des 4001 propriétaires de PME sondés à travers le Canada sont aux prises avec des défis de la chaîne d’approvisionnement et 39 % sont durement touchés par ce type de défis.
L’agriculture est l’un des secteurs les plus touchés : plus de 94 % des entreprises agricoles vivent cette réalité.
Toujours selon ce sondage, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ont trois principaux impacts sur les propriétaires :
• une augmentation du prix de leurs produits et services;
• des retards de livraison de leurs marchandises;
• une augmentation des coûts d’expédition.
De plus, 30 % de ces propriétaires ont vu leurs coûts d’exploitation augmenter de plus de 20 %.
Pour faire face à ces perturbations, vous pouvez explorer plusieurs pistes de solutions afin d’anticiper et de mieux gérer les risques qui en découlent. Une simple recherche sur Internet vous permettra de
Pistes proposées pour atténuer l’impact de la perturbation de l’approvisionnement
Certaines mesures peuvent être prises pour atténuer les perturbations et éviter des interruptions dans l’approvisionnement.
• Vérifiez les équipements utilisés dans la production. Cela vous permet d’anticiper les risques liés à l’arrêt des équipements spécialisés utilisés dans la fabrication des produits (bris d’équipements, arrêt des équipements pour la maintenance prolongée, etc.). Il est important d’établir un plan de contingence pour continuer la production dans ces situations.
• Négociez des contrats de prix à long terme avec vos fournisseurs et vos clients, quand cela est possible, afin d’atténuer la fluctuation et l’incertitude des prix.
• Faites des achats groupés avec d’autres transformateurs ou producteurs de votre région pour les intrants les plus difficiles à se procurer, par exemple des pots ou des bouteilles de bière d’un certain format ou de l’engrais azoté. Cette façon de faire vous donne un plus grand pouvoir de négociation et rend vos fournisseurs plus attentifs à vos besoins en matière de prix et de délais de livraison.
• Utilisez la technologie pour automatiser la gestion des approvisionnements et optimiser le processus des commandes.
• Assurez-vous d’avoir une liste de four-
Saviez-vous qu’il existe le Service de médiation en matière d’endettement agricole? Si vous pratiquez une agriculture commerciale et que vous n’êtes plus en mesure d’effectuer vos paiements à temps, il vous est possible de recourir aux services de consultation et de médiation gratuitement. Pour en savoir plus, rendez-vous à l’adresse suivante : www.agriculture. canada.ca/fr/programmes/service-mediation-matiere-dendettement-agricole.
Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter nos conseillers à la direction régionale :
Yves Simard, agronome, agroéconomiste, conseiller en économie, en gestion et en relève agricole : yves.simard@mapaq.gouv.qc.ca;
Abdel Ahraiba, ingénieur, conseiller en transformation alimentaire : abdel.ahraiba@mapaq.gouv.qc.ca.

Sources :
• Fédération canadienne de l’entreprise indépendante. Les PME et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement. [www.cfib-fcei.ca/fr/rapportsde-recherche/les-pme-et-lesperturbations-de-la-chainedapprovisionnement-infographie].
• Powell, Chris. « Risques liés à la chaîne d’approvisionnement : comment survivre aux innombrables perturbations », Financement agricole Canada. [www.fcc-fac.ca/fr/savoir/risqueschaine-dapprovisionnement.html].
• Deschênes, Denis. « Quel est le rôle de votre directeur de comptes dans le développement de votre entreprise? », Réseau d’Affaire Lanaudière.

24Jeudi 9 mars 2023Gestion et Technologie Agricoles
ABDEL AHRAIBA, ingénieur, conseiller en transformation alimentaire, Direction régionale de la Montérégie, ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
YVES SIMARD, agronome, agroéconomiste, conseiller en économie, en gestion et en relève agricole, Direction régionale de la Montérégie, ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
L’État des cultures présente ses nouveautés pour 2023
Êtes-vous familier avec l’État des cultures? Cette lettre hebdomadaire qui donne un aperçu de l’état des cultures à travers différentes régions du Québec?
En bref, l’objectif de l’état hebdomadaire des cultures est de recueillir chaque semaine de l’information quantitative et qualitative sur l’état des cultures de maïs, de soya et de blé dans les principales régions de production de ces grains au Québec.


Lancée en 2020, cette initiative aujourd’hui chapeautée par PGQ (Producteurs de grains du Québec), l’ACGQ (Association des Commerçants de Grains du Québec), le RVQ (Réseau végétal Québec) et VIA Pôle (VIA Pôle d’expertise en services-conseils agricoles) en collaboration avec Concertation Grains Québec vise à fournir tout au long de la saison au milieu agricole une

lecture la plus juste possible de la situation dans le champ, selon les régions.
Nouveautés
L’équipe n’a pas chômé cet hiver et annonce des nouveautés que voici :

- Le blé d’automne et de printemps seront désormais couverts par l’État des cultures;
- Toutes les régions agricoles du Québec seront couvertes par l’État des cultures.
Selon l’organisation, d’autres nouveautés seront dévoilées au cours des prochaines semaines.
En attendant, il est possible de s’inscrire à l’État des cultures, ce qui ne demande qu’une implication de moins d’une minute par semaine pour donner à tous un État des cultures représentatif. Aucune obligation, le tout pouvant se faire à votre convenance et selon vos disponibilités.
Gestion et Technologie AgricolesJeudi 9 mars 202325


26Jeudi 9 mars 2023Gestion et Technologie Agricoles

Gestion et Technologie AgricolesJeudi 9 mars 202327

28Jeudi 9 mars 2023Gestion et Technologie Agricoles

































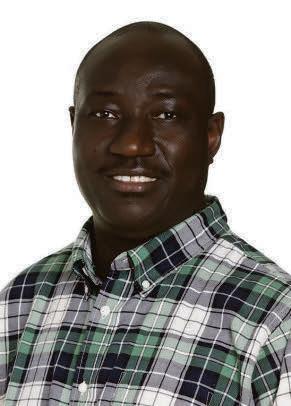






 Yves RIVARD GTA
Yves RIVARD GTA














