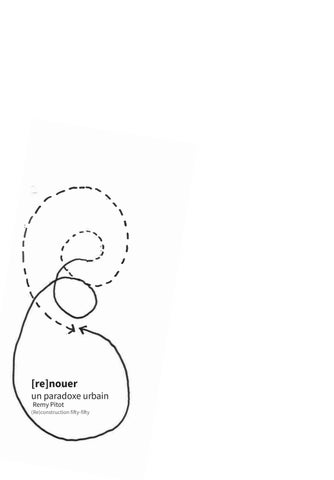[re]nouer Remy (Re)constructionPitot fifty-fifty un paradoxe urbain
2022juinPFEPitot,Remy
[re]nouer un paradoxe urbain Rapport de présentation PFE ENSA Nantes - (re)construction fifty-fifty Sous la direction de Louis Guedj et Matthieu Germond
4
Je tiens à remercier l’équipe enseignante de l’option (re) construction fifty-fifty, plus précisément Louis Guedj et Matthieu Germond, pour leurs suivis continus et leur implication tout au long du semestre, mais aussi aux intervenants de ce semestre - Vincent Benard, Nolwenn Le Tertre, Antoine Piffaut, Sébastien Radouan et Silene Habitat pour les choix des sites et le suivi.
5
Je tiens aussi à remercier le studio de projet 50|50 au complet, à travers nos moments de partages qui ont permis de nourrir et de faire évoluer le projet, et d’avoir facilité mon intégration dans cette nouvelle école.
Pour terminer, je tiens également à remercier ma famille et mes amis pour leur soutien constant pendant toutes ces années d’études.
Un remerciement particulier au groupe Pertuischaud, Yaelle Champreux, Ghita Elyassa et Nicolas Roger pour leur soutien constant, le partage, le travail d'équipe et la bonne ambiance.
Remerciements
464444301285
introductionremerciementspourquoiprésentationfifty|fiftydel’option (re)construction fifty-fifty mon parcours le quartier de Saint-NazairePertuischaud:ville portuaire en mutation un site témoin de l’histoire de l’après-guerre centralité et accessibilité un grand ensemble ancré au coeur du tissu pavillonnaire un espace vert vaste, mais non valorisé les entrées et les seuils les nouvelleslogementsdonnées démographiques du public a Entreproblématiquel'intimehabiterla cellule et habiter le logement entre le public et l'intime. une limite retravaillée des seuils requalifiés habiter le commun après-propos:conclusion une petite expérience personnelle médiagraphie sommaire
8
DeC’estnouveau.inconnu.quois’agit-il exactement? Qui est éligible aux logements sociaux? Comment y vit-on? Comment sont-ils pratiqués? Quels sont les enjeux? Tant de questions. Cela doit être en partie, une des raisons qui m’a poussé à choisir cette option. Le vivre ensemble à grande échelle. Cela peut paraître paradoxal pour un étudiant en 5e année d’architecture qui soutient son PFE sur une thématique si populaire, avec tant de questionnements liés à son devenir, mais qui sont des questions qui n'ont jamais été abordées au cours de mes études. C’est pour moi la possibilité de découvrir un autre univers. Certes, nous avons eu des cours d’histoire et étudié quelques logements populaires classiques tels que la Cité radieuse du Corbusier, ou le Haut du Lièvre de Bernard Zehrfuss, mais venant d’une île ou le concept du grand ensemble, voir même le concept du logement social est quasi inexistant, ça reste une vraie question pour moi. Les logements sociaux sont comme un idéal sur notre île. Il en existe, mais en faible quantité ce qui ne permet qu’à une minorité de la population d’y accéder. À l’île Maurice, les logements sociaux sont typiquement des petites maisons individuelles en duplex, construites et financées par de grands groupes privés. Cependant, ces logements sociaux ne sont pas à louer, il s'agit d'accession à la propriété abordable, car elle sont subventionnée par l'état. présentation de l’option (re)construction fifty-fifty
Les grands ensembles. Pour moi, c’est:
La réhabilitation des grands ensembles est un sujet important dans le paysage architectural contemporain. Les logements de la période de reconstruction d'après-guerre en France témoigent de l'ambition du progrès social, avec l'introduction de l'eau courante, de l'électricité et des sanitaires dans le logement. Il était important pour moi d'intégrer un studio de projet qui vise à la fois une réflexion juste, innovante et actuelle, mais aussi un moyen d'entrer dans le détail et approfondir mes connaissances à ce sujet avant d'entrer dans le monde du travail. 1 - introduction pourquoi fifty|fifty
Le but de cette option et de pouvoir analyser et comprendre des modèles d'habitat mis en place et les interroger dans leur environnent physique et social, de par leurs typologies, mais aussi de par leurs systèmes constructifs et techniques. Ceci se traduit alors par un diagnostic architectural, technique et social d'un ensemble de logements sociaux: Pertuischaud (en partenariat avec Silène Habitat). mon Commeparcoursmentionné, je viens de l'île Maurice et j'ai eu la chance de faire partie de la première promotion de L'ENSA Nantes-Mauritius en 2016. Cette école m'a permis d'avoir une expérience à l'échelle locale, mais aussi internationale - Madagascar et Tanzanie. Pendant mon parcours, j’ai souvent rattaché une dimension sociale forte à mes projets. Par exemple, à travers mon stage humanitaire en Tanzanie pour l'étude, la conception et la création d'un équipement de récupération d’eau dans un village isolé et aride, mais aussi à travers une intervention dans les bidonvilles de Antananarive a Madagascar. Deux exemples parmi plusieurs où les habitants étaient placés au coeur du projet. Travailler avec les gens, pour les gens. La réhabilitation ne reste pas anodine dans un nombre de cas. Elle m’a permis de questionner des enjeux importants d’aujourd’hui, mais aussi futurs, et d'aborder la question de l'économie circulaire et comprendre les devenirs de nos bâtiments face à la transition écologique, économique et politique. De plus, mon mémoire était fortement lié au social, en interrogeant et questionnant le rôle de la mémoire habitante dans la conception paracyclonique a l'île Maurice. Plus précisément, comment les mauriciens construisaient dans les années 1960, comment nous construisons aujourd’hui sur notre île, comment on se prépare et comment on rebondit après un événement cyclonique.
C’est peut-être pour cela que la question du logement social abordée par ce studio de projet m’interpelle. Quelle est la place de l’habitant dans ces ensembles, dans son environnant ? Quelles qualités offrent -ils. Comment partir de ces qualités afin d'améliorer le cadre de vie, aujourd’hui souvent dégradé et délaissé? Comment redonner une seconde vie à des constructions qui ont marqué le monde de l'architecture en France?
9
bâtiments préexistants après bom bâtimentsbardementsconstruits entre 1943 et bâtiments1967 construits après 1967 0 1000 Illustration 1 : évolution de Saint-Nazaire
Cette année, le projet de Fifty|Fifty explore le territoire de Saint-Nazaire, ville portuaire importante de France. Saint-Nazaire a été fortement marquée par l’histoire de la Seconde Guerre mondiale. La ville, ayant été partiellement détruite en 1942, se reconstruit et connaît alors un étalement urbain rapide et important (Illustration 1).
Le logement social collectif a permis l’accès au plus grand nombre à un logement de qualité. C’est une opportunité pour reconstruire vite et moins cher. Ces logements ont pour but d'offrir une société égalitaire avec la même cellule de base pour tous.
12
C’est en 1966 que les immeubles Pertuischaud ont été construits avec comme architecte en chef Noël Le Maresquier. En revanche les opérations ont été menées par les architectes Shoegel et Rivière.
2 - le quartier de Pertuischaud Saint-Nazaire : ville portuaire en mutation un site témoin de l’histoire de l’après-guerre
1mussee-hlm, 2022. Le temps des grands ensembles. Site internet: https://musee-hlm.fr/exhibit/96.
Après la Guerre de 39-45, la ville de Saint-Nazaire est ravagée à près de 85%. La construction de logements collectifs est utilisée comme réponse à la crise de logements, mais aussi utilisée comme moyen pour répondre à la nouvelle loi de 1948 de la Déclaration universelle des droits de “toutel’homme.personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer son bien-être et celui de sa famille, notamment par le logement”1
Les immeubles Pertuischaud s’installent à la place d’anciens baraquements, une ancienne cité provisoire pour loger les habitants sinistrés. Rapidement après sa construction en 1966, Pertuischaud loge les gendarmes (illustration 2). Ce n’est que quelques années plus tard que l’immeuble Pertuischaud devient un ensemble de logements sociaux.
13 > Illustration 2 : évolution du quartier Pertuischaudde de 1943 à 1970 baraquementsanciensbaraquementsanciensbaraquementsanciensaprès les bombardements 1942 de 1970 à aujourd’hui
J'ai eu l'opportunité de déambuler dans les petites ruelles autour de Pertuischaud. On réalise que le quartier possède de touts types de commerces nécessaires pour son bon fonctionnement à moins de 10 minutes à pied. On trouve un supermarché, une boulangerie, une boucherie, une pharmacie et un marché sur la place de l’église le jeudi (illustration 3). De plus, le grand parc paysager de Saint-Nazaire, le centre sportif, les écoles (primaires et secondaires) se trouvent à moins de 10 minutes à pied. C'est un site plutôt bien desservi. un grand ensemble ancré au coeur du tissu pavillonnaire
Le tissu pavillonnaire qui l'entoure montre une individualité et une diversité dans la lecture des façades. Ce sont majoritairement des 2Saint-Nazaire, 2020. Saint-Nazaire veut devenir la ville du vélo. Site internet: https://www.saintnazaire.fr/actus/ saint-nazaire-veut-devenir-la-ville-du-velo-19522.
En déambulant dans les petites ruelles autour du site et depuis la plage, on remarque que les immeubles Pertuischaud se laissent voir dans le paysage à de nombreuses reprises par sa hauteur plus importante de celles du quartier (illustration 4).
centralité et accessibilité
Les immeubles Pertuischaud se trouvent dans un quartier plutôt central, à proximité du centre-ville - à environ 2km - mais aussi de la plage - à environs 600m. Se situant à 250 mètres de l'avenue Francois Mitterand, cet axe majeur est une artère de la ville de Saint-Nazaire qui relie le centre-ville à la périphérie via le boulevard Sunderland. Grâce à l'arrêt de bus "Plaisance Berlioz" et aux pistes cyclables, il est possible, en moins de 20 minutes, de se rendre au centre-ville, à la gare , au centre hospitalier, aux facultés ou encore au centre commercial. J'ai pu expérimenter ce trajet lors d'une visite de site depuis la gare jusqu'à Pertuischaud à vélo. Un trajet de 15 minutes, confortable sur une voirie sécurisée et libre. C'était une balade plutôt agréable à travers le centre-ville traversant ensuite le grand parc paysagé de Saint-Nazaire. La ville de Saint-Nazaire encourage l'usage du vélo en ville par l'aménagement de piste cyclable, mais aussi par la mise en location de vélos électriques "vélycéo". En 2016, la ville de Saint-Nazaire a créé 60% de liaisons cyclables en plus, soit plus de 35 km de pistes cyclables.
14
"Le développement de l'usage quotidien du vélo est une priorité affichée par la ville et son agglomération depuis plusieurs années... Nous voulons faire de Saint-Nazaire la ville du vélo"2.
0 100 200 500 Illustration 3 : Carte de mobilité autour de Pertuischaud
15 Pertuischaud
Pistes LigneBandescyclablescyclablesdebus Pertuischaud
Isochrones
Centre commercial Centre hospitalierCampus universitaire 6 min
Arrêt
Chantiers
Centre commercial Centre hospitalierCampus universitaire 6 min 12
Arrêt
Centre-ville Gare de St-Nazaire de l Atlantique 12 min 6 min 12 min mobilités actives de bus avoisinant Lieux et équipements majeurs
Centre-ville Gare de St-Nazaire de l Atlantique min 6 min 12 min mobilités actives de bus avoisinant Lieux et équipements majeurs autour de Pertuischaud
Isochrones
Pistes LigneBandescyclablescyclablesdebus Mobilité
Chantiers
«BerliozPourcacher
la nuisance visuelle, on met beaucoup de végétation persistante devant notre maison » entretiens 3 - 32 rue Jean Bart.
On voit alors à travers ces paroles habitantes que les immeubles Pertuischaud dialogue peu avec leur environnent. Le traitement du sol est un outil qui permet de qualifier les espaces en fonction des usages.
constructions en R+1 avec des combles habités. Pertuischaud lui, s'oppose à cette lecture dans le quartier au niveau de la rue Léonard de Vinci et la rue Jean Bart (voir illustration 7 pour les rues). Premièrement, à travers son retrait important par apport à la route, deuxièmement à travers son échelle plutôt imposante par apport aux pavillons et pour terminer, par l’homogénéité, l'uniformisation et la répétition de façades qui s'oppose à celle de son voisinage. Cela engendre alors des questionnements par apport aux limites et aux seuils du bâtiment et permet de questionner le lien physique et social entre Pertuischaud et le quartier.
Pertuischaud a été construit en typologie d’équerre et de manivelle. Ces formes ont été choisies afin d'optimiser l'espace induit du découpage de la parcelle. Elle est construite suivant l'orientation type nord-sud, et estouest. Cette composition offre 167 logements répartis sur 6 barres. Celleci couvre une surface totale au sol de 3 308 m2 sur un site de 21 550 m2. Pertuischaud représente alors 15.3% de surface construite par apport à son espace minéral et non minéral. Cela représente un grand atout dans le développement de ce projet.
« Il y a 25 ans, nous avions des liens avec les habitants de Pertuischaud, notamment avec un homme qui avait son potager près de notre garage. À sa mort, c’est devenu un bac à sable pour les enfants. Puis, notre allée a été déviée vers les parkings lorsqu’une maison mitoyenne a été construite. Désormais, nous n’avons plus contact avec les habitants » — entretiens 2, 42 avenue Hector
16
Dans le cas de Pertuischaud, les zones destinées au stationnement se distinguent fortement en front de parcelle. Elles dominent au niveau des entrées et les voitures stationnées génèrent une limite formelle et visuelle, qui met à distance les riverains, et annihile les liens physiques et sociaux. L'effet de mise à distance est amplifié. C'est alors la raison pour laquelle les questions des abords, de limite et de transition entre la rue et Pertuischaud sont importantes. Elles sont un élément fondamental dans le développement du projet. un espace vert vaste, mais non valorisé
"Il y a comme une barrière entre les maisons de notre rue et les immeubles. C'est deux mondes" - entretien 1, 8 rue Léonard de Vinci.
17 Illustration 5 : Coeur d'îlot depuis la rue Jean Bart Illustration 6 : Vue plongeante jusqu'au coeur d'îlot Illustration 4 : Pertuischaud visible depuis les rues du quartier.
18 ETUDIANTVERSIONAUTODESKPRODUITD'UNL'AIDEAREALISE PRODUITAUTODESKVERSIONREALISEETUDIANTA L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK Illustration 7 : Plan de site de Pertuischaud Rue Pierre Loti Av.HectorBerlioz
ETUDIANTVERSIONAUTODESKPRODUITD'UNL'AIDEAREALISE
AUTODESK VERSION ETUDIANT Coupe A-A Bâtiment E
ETUDIANTVERSIONAUTODESKPRODUITD'UNL'AIDEAREALISE
PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT A A RueLéonarddeVinciRueJeanBart REALISEAL'AIDED'UNPRODUIT
19 REALISEAL'AIDED'UNPRODUITAUTODESK
Les immeubles Pertuischaud sont construits suivant un principe de standardisation et de gabarit proposé par l’architecte pour répondre aux besoins imminents de la ville. Il y a pour but la rapidité et la facilité de construction. Le principe est simple: un socle semi-enterré regroupant des caves et locaux à vélos/poussettes et une entrée centrée sur la cage d’escalier. Celle-ci dessert 2 logements par palier en R+3 ou R+4 (caves exclues) en fonction de la topographie. Cette composition constitue alors une unité (élévation nord). Ces unités sont mise côte à côte afin de former une barre de logement. À Pertuischaud, ces unités s’assemble soit en barre de deux unités, soit en barre de quatre unités.
Cette typologie d'immeubles engendre de grands espaces vides qui sont aujourd'hui sans usages définis et peu entretenus. Les espaces de jeux à l'ouest sont abandonnés et dégradés, mais on retrouve en revanche un coin barbecue et des balançoires en pneu au coeur d'îlot (espace végétalisé entre le bâtiment D,E,F) qui sont fréquemment utilisés par les habitants. De plus, les enfants s'approprient l'espace en jouant au ballon. C'est un espace plutôt vivant. les entrées et les seuils
Les entrées aux logements se trouvent sur les façades coté stationnements.
20
Le traitement de la matérialité au sol permet de délimiter les espaces en fonction de leurs usages. Au nord, on retrouve un sol imperméable pour les espaces de stationnements, contrairement à l'image de l'espace végétal du sud, plus agréable et calme (illustration 5,6,8).
Les grands espaces végétalisés (coeur d'îlot) se trouvent pincés entre les immeubles Pertuischaud et le tissu pavillonnaire au sud. Ce coeur d'îlot peut être accédé par deux entrées piétonnes, constituant axe de circulation, car fréquemment utilisée par les riverains pour rejoindre les commerces ou l'avenue Hector Berlioz, et par les enfants pour partir a l'école (illustration 8). Cette hiérarchisation d'espaces crée un lieu très agréable par la tranquillité qu'elle offre dans ce coeur d'îlot et qui est d'autant plus agréable par la bande végétale, agissant comme filtre (illustration 5, 6 et coupe AA.).
Rue Jean Bart Pavillons Coeur D'îlot
21 illustration 8: schéma de Pertuischaud et son l'espace végétalisé Pertuischaud Parking Rue Léonard de Vinci Pavillons élévation Nord Accès piétons Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3 BlocAccès4 au logement
Les grandes barres sont placées perpendiculairement à la pente. On note une différence d'altimétrie de 1,5 mètre entre deux niveaux sur le bâtiment E. Les entrées - une par unité - n'offrent pas de liaisons entre les seuils. Il y a en revanche, des emmarchements avant d'entrée dans le bâtiment et ceux-ci varient, étant d’une marche au point le plus haut et de 6 marches au point le plus bas du dénivelelé. Soit, près d'un mètre de différence entre le seuil du logement et son extérieur a certains points (élévation nord).
D'autre part, les caves représentent un grand atout pour les habitants. Chaque logement dispose d'une grande cave d'environs 12m2 pour ranger leurs effets personnels ou les vélos, car les espaces dédiés pour les vélos sont non sécurisés par le manque d'infrastructure. En de nombreuses occasions, les vélos se sont fait voler "Ah, mais j'ai aujourd'hui un vélo de la ville, tu sais le Vélycéo. Je l'utilise pour faire mes courses et tout. C'est très pratique. Il y a un GPS dedans, au moins je sais qu'il ne sera pas volé" entretient avec Joël Martin, habitant de Pertsuichaud Batiment E.
De plus, les accès aux logements se font uniquement depuis les zones de stationnement (illustration 8). Accéder au coeur d'îlot depuis le logement se traduit par le contournement des barres via les espaces de stationnement ou à travers les caves. Quant aux caves, elles sont très étroites et peu éclairées et peuvent présenter des problèmes d'insécurité pour les personnes seules ou les enfants qui les empruntent (illustration 9).
Les halls à Pertuischaud sont non existants. L'entrée se fait directement sur le palier des cages d'escalier, qui mesure 2mx1.5m (illustration 10,11). Les entrées ont un lien faible, voir non existant avec l'extérieur. Malgré cela, les entrées se distinguent depuis la route par leur grande porte vitrée, mais aussi par la typologie de fenêtres qui se distingue sur la façade (élévation nord). Ces fenêtres apportent une vraie qualité à cette circulation qui est bien éclairée et bien ventilée.
22
On remarque de plus que ces espaces sont souvent appropriés par les habitants en laissant des objets dans les halls ou sur les paliers. Le logement se prolonge alors en dehors de chez soi dans les espaces communs. On peut trouver des poussettes dans les halls, des trottinettes, des vélos, des décorations ou les chaussures des habitants sur les paliers devant les logements (illustration 11,12). les logements
23 13.5210.88-2.380.002.725.448.16-1.361.364.086.809.52 L 6.50L 6.56 illustration 10: les halls illustration 12: les paliers sont appropriés par les habitants illustration 11: unedanspoussettel'entrée illustration 9: le couloircavesdes illustration 13: Coupe B-B
Pour rappel, chaque palier de la cage d'escalier dessert uniquement 2 logements, avec l'exception du bloc 2 (élévation nord) où l'on retrouve des logements T2. Les paliers desservent alors 3 logements. La logique du plan se répète dans les typologies d'appartement des T2, T3, T4 (illustration 14). L'accès au logement depuis le palier se fait à travers un couloir central qui dessert toutes les pièces du logement individuellement. On retrouve les pièces humides en façade nord, et les pièces de jour en façade sud contrairement aux chambres qui sont réparties entre la façade nord et la façade sud.
24
En 1945 après la guerre, 400,000 immeubles ont été détruits et plus de 2 millions endommagés3. C'est alors en 1944 que le gouvernement provisoire de la République française doit s'atteler à une lourde tâche. Reconstruire les villes sinistrées dans l'urgence et résoudre la crise du logement au plus vite.
D'ailleurs, les appartements possèdent de nombreuses qualités. Ils ont tous une double orientation nord-sud et la surface de plancher respecte les normes actuelles. Ils sont donc relativement généreux en termes d'espace. De plus, les logements possèdent des w.c. séparés de la pièce d'eau. C'est un avantage surtout pour les familles nombreuses. Ces espaces sont en revanche ventilée mécaniquement comparer aux autres pièces du logement qui possède une ventilation et une lumière naturelle. La majorité des logements possède une loggia en façade sud. Un espace calme et agréable qui donne une vue plongeante en coeur d'îlot (illustration 15). De par sa petite taille de 1.1 mètre de large, c'est un espace difficile a meublé, et sert donc typiquement comme un espace de débarra. Cela crée alors une façade non habitée et non accueillante (illustration 16).
Les logements variant du T2 au T4 dans la barre E retrouvent la même logique qui est donc répétée à plusieurs reprises. La barre E contient quinze T2, quinze T3 et quinze T4 pour un total de 45 logements.
Cet agencement génère alors de petites pièces de vie individualisées à travers le logement, des espaces fracturés par le couloir central. Elle ne profite pas des espaces potentiels qui peuvent en être dégagés. La circulation (couloir central) représente en moyenne 9m2 du logement, qui est une équivalence à 13% de surface totale d'un T3. (illustration 14)
3La Croix, 2013. La construction de Logements de l'après-guerre a aujourd'hui. Site internet: Actualite/France/La-construction-de-logements-de-l-apres-guerre-a-aujourd-hui-2013-09-10-1011728.https://www.la-croix.com/
25 illustration 14: plan d'un T3 et T4 type. loggialoggia séjour séjour cuisinecuisine séchoirséchoir chambre 1 chambre 1 chambre 2chambre 2 chambre 3 wcwc SDBillustrationSDB 15: vue du coeur d'îlot depuis un appartement
6Delhay, S. 2019. Le logement : Un espace de liberté. Conférence à l'école spéciale d'architecture, Paris. 7Eleb, M., Simon, P. 2013. Entre confort, désir et normes. Le logement contemporain 1995-2012.Editions Mardaga.
“les recherches démographiques et sociologiques aujourd’hui indiquent une diversification très notable de la composition des ménages. L’importance des familles nucléaires diminue et celle des familles recomposées ou monoparentales augmente. La proportion des individus qui vivent seuls n’est pas négligeable" 4 "de plus en plus de personnes vivent seules, et la vie en couple semble en désaffections: depuis vingt ans, le couple cède du terrain"5
Les logements de types T2, T3, T4, peuvent être vus comme une typologie déclinants de la "famille type", présente dans les années 606.
4Masboungi, A. 2010. Bien habiter la ville. Edition le moniteur. 5Eleb, M., Simon, P. 2013. Entre confort, désir et normes. Le logement contemporain 1995-2012. Edition Mardaga.
Par exemple, une cellule familiale traditionnelle composée de parents avec des enfants, donc trois pièces à vivre, une chambre parentale, une chambre pour les enfants, et un séjour. Bien sûr, la cellule familiale est toujours présente dans notre société, mais elle est en déclin. L'INSEE indique notamment en 1982 que 83% des hommes et femmes de 35 ans et plus vivent en couple, contre 70% en 20057. On commence alors à s'apercevoir cette croissance d'individus vivant seul ou en cohabitations.
On retrouve aujourd'hui de plus en plus de famille monoparentale, ou de personne qui vivent seules, tels que des étudiants, des jeunes actifs, ou même des personnes âgées. Il y a donc, une forte demande pour des logements de plus petite taille (T1 et T2).
26
Suivant l'analyse de faisabilité de la Silene, celle-ci démontre une sousoccupation des cellules d'habitation au sein des immeubles Pertuischaud (illustration 20). On trouve un grand nombre de T3 et de T4 qui sont occupés par des personnes vivant seules, soit 50% d'occupation des T3 et environ 30% d'occupation des T4 . Les T2 et les T5 sont en revanche, très bien occupés. Cela indique qu'il y a une forte demande de T2 à QuandPertuischaud.ils'agit de concevoir un logement, il est important de s'intéresser aux évolutions sociales et aux nouveaux modes de vie qui en découlent.
Il a été aussi constater que les séchoirs sont mal occupés, car ils sont en mauvais état et non isolés. Se situant sur la façade nord, cette pièce est très froide en hiver et ne peut être utilisée correctement pour étendre les vêtements pour les sécher. Les séchoirs servent aujourd'hui principalement d'extension de cuisine, mais ce n'est pas un espace agréable pour les occupants (illustration 17), comme le confirme Joël Martin lors d'une visite chez lui. nouvelles données démographiques
27 illustration 16: les loggias mal occupées illustration 18: plan habité et les constats de logement a Pertuischaud
Ces nouveaux profils de ménages n'affaiblissent pas néanmoins les besoins familiaux et sociaux comme A. Masboungi (2010) indique dans un ouvrage: "il y a le concept de la famille d’entourage qui devient très répandu, qui se fonde sur les liens entre plusieurs foyers: relations, services et échanges entre les générations ou entre les membres d’une même fratrie. La recomposition des ménages créés un espace domestique original, animé surtout par la circulation et qui peut bénéficier de mixité sociale" 7 . Au contraire ces besoins demandent à être questionnés par apport à comment on habite le logement, aux nouveaux modes de vie et aux nouveaux besoins sociaux qui en déclinent. "il existe une tendance à valoriser de plus en plus la sociabilité entre pairs par apport au couple, à valoriser la solidarité dans une vie commune"8
8Masboungi, A. 2010. Bien habiter la ville. Edition le moniteur.
28
29 illustration 20: Phénomène de sous occupation des loge ments illustration 19: Table des surfaces des logements par typologie compositions des logements de la barre E de pertuischaud T2 T2A T3 T3A T4 44 47 67 65 74 PIECES T2 T2A T3 T3A T4 Séjour 15.2 14.7 15.97 15.75 15.75 Cuisine 8.9 9 9 9 9 SDB 2.9 3.5 4.5 4.5 4.5 W.C 1 1 1 Circulations 4 6.1 10.8 9.14 9.5 Séchoir 1.86 2.3 2.3 2.3 Chambre 1 11 10.5 11.2 11.2 10.3 Chambre 2 9.5 10.1 9 Chanbre 3 9 Totale 44 47 67 65 74 Logements occupés à pleine capcité ( en %)Phénomène de sous occupation des logements T2 100908070605040302010 T3 T4 T5 occupésLogementsàpleinecapcité(en%) logementsdesoccupationsousdePhénomène T2 102030405060708090100 T5T4T3
Comment passe-t-on du public à l’intime? Quelles sont les natures des espaces au sein du site, du cœur d’îlot, du logement et en front de parcelle à la hauteur des parkings ? Comment dialoguent-elles entre elles?
Pour répondre à cet enjeu, l’accessibilité à ses espaces doit être prise en compte, depuis les logements et depuis la route. Le parcours est alors, un élément important à considérer dans l’approche, qu'il soit horizontal ou vertical. Quelles sont les différentes manières d’entrer chez soi? Par quel Entreespace?habiter la cellule et habiter le logement.
Le travail d'analyse du site a permis de dévoiler un certain nombre de problématiques, mais aussi de qualité à l'échelle du logement, du bâtiment et du quartier. J'ai choisi d'intervenir sur le Batiment E pour la relation qu'il entretient avec ses proches abords, plus précisément en front de parcelle et au coeur d'îlot.
L'analyse porte une importance sur la qualité de vies des habitants et des liens que le bâtiment entretient avec son environnement et ses occupants. L’enjeu serait alors de questionner les méthodes à travers lesquelles nous pouvons renouer ces liens en développant des dispositifs articulant le bâtiment, son environnent et les habitant. Il s'agira aussi de développer des dispositifs architecturaux qui inciteraient la mixité sociale et intergénérationnelle au sein du logement.
Les façons d'habiter et la question du parcours sont des sujets qui orientent ma réflexion et le projet. Je me suis beaucoup appuyé sur les travaux, quelques fois expérimentaux de l'architecte Sophie Delhay, et ceux de Radu Vincentz. Ils s'appuient beaucoup sur les nouvelles manières d'habiter en collectif. Comme évoqué dans l'analyse sociale, la façon d'habiter le logement aujourd'hui n'est plus la même. Les relations entre le nucléaire des familles et des amis ont beaucoup changé. C'est pour cela que je me suis appuyé sur cette réflexion et le travail de ces architectes pour mieux comprendre en quoi les profils on changé, et 3 - du public a l'intime problématique
30
Comme dans de nombreux logements sociaux en France, il s'avère que le bâtiment dialogue très peu avec son espace urbain. Il est alors possible de questionner et critiquer le vide spatial et social que constituent ses grands espaces sans équipements qui sont générés dans les grands ensembles. Ces vides spatiaux peuvent être en revanche pensés comme atout dans la générosité des espaces extérieurs (qui représentent comme évoqués précédemment approximativement 85% de la superficie totale).
Une idée de T1, T2, T3, etc. qui correspond a des familles traditionnelles entre guillemets. De couples avec enfant par exemple.
Les projets revendiquent la dimension collective et sociale de l'immeuble.
"Le logement est issu d'une idée de la société qui dérive des années soixante.
Un exemple phare qui répond à ces questionnements est le projet du Machu Picchu, a l'île, ou LoPhy +, projet concours.
9Delhay, S. 2019. Le logement : Un espace de liberté. Conférence à l'école spéciale d'architecture, Paris. illustration 21: Rapport entre la voirie publique et les immeubles Pertuischaud
Aujourd’hui elle évolue, elle vieillit. Les générations sont plus larges. On en parle de 4 générations aujourd’hui. Les foyers se séparent, et se reforment, avec des parentalités complexes. Il y a donc des micros société qui se forme au niveau des foyers qui est de plus en plus complexes. Il faut donc requestionner les pratiques d'aujourd’hui"9
31 comment cela impact les manières d'habiter.
Au coeur du logement, il y a six espaces partagés en plein air. Ces grands espaces vides sont mis à disposition aux habitants afin qu'ils se les approprient. De plus, ces espaces sont connectés les uns aux autres ce qui constitue alors un parcours inédit depuis le rez-de-chaussée. Cette traversée du public a l'intime, et à travers ces espaces offre plus qu'un simple logement collectif. Au contraire, ils offrent des situations à vivre, partagées à l'échelle du foyer, mais aussi de la résidence et de la ville (Illustration 22 et 23).
32
33 illustration 22: plan des espaces communs du Machu Picchu de Sophie Delhay
34
35 illustration 23: Maison Radu, Radu Vincentz Architectes, Saint-Nazaire.
Si l'on considère la définition d'habiter, selon Christian Norberg-Schultz, "Habiter signifie quelque chose de plus qu'avoir un toit et un certain nombre de mètres carrés a sa disposition. D'abord, il signifie rencontrer d'autres êtres humains pour échanger des produits, des idées et des sentiments, c'est-à-dire pour expérimenter la vie comme une multitude de C'estpossibilités"10cettedimension,
"Le paysage s'apprécie par les parcours qui le traversent. Il est structuré par les modalités de passage d'un espace à un autre, d'un niveau à l'autre. Il se joue dans le dialogue qu’engage le projet avec ses limites. Bref, il est affaire de relation bien plus que d’affectation de fonction, fussent-elles des fonctions d’espaces verts" 11
Une nouvelle manière de vivre ensemble, d'habiter le logement, de créer des espaces pour permettre aux habitants de se les approprier pour améliorer leur cadre de vie. Il n’est pas question de venir figer des programmations, mais plutôt de travailler avec les habitants pour initier et croiser les intérêts et ainsi dégager des usages. entre le public et l'intime. une limite retravaillée
10Eleb, M., Simon, P. 2013. Entre confort, désir et normes. Le logement contemporain 1995-2012. Edition Mardaga. 11Blanchon-Caillot, B. 2007. Pratiques et compétences paysagistes dans les grands ensembles d’habitation, 1945-1975 Openeditionjournals.
Les premières intentions de projet proposent alors une requalification de ses espaces publics à travers des dispositifs d'associations végétales comme système de transition et de filtres au niveau des parkings. Il s'agit de travailler le passage de l'espace public vers l'espace privé, pour créer un nouveau dialogue entre eux. Pour cela, ce traitement paysager se complète à deux niveaux. Le premier, pour traiter la question des parkings en front de parcelle qui est une limite franche et visuelle, et deuxièmement par un traitement paysager plus imposant en pied d'immeuble. Ainsi, de générer une progression de filtre visuel entre la voirie et le pied Deuxièmement,d'immeuble.d'unepart
cette approche différente et inédite qui m'interpelle.
36
Une problématique importante relevée du diagnostic repose sur ses espaces extérieurs du coeur d'îlot ainsi que les parkings en front de parcelle qui dominent et se distinguent dans le paysage.
du bon fonctionnement actuel du coeur d'îlot, et d'autre de son appropriation ponctuelle et variée des habitants, l'enjeu serait alors de générer une transition agréable pour l'habitant d'un espace a l'autre (du parking, mais aussi du logement) en passant par le coeur d'îlot a l'artère piétonne de l'espace paysager. Une intention
37 illustration 24: schéma illustrant les liaisons entre les espaces.
12Moley, C. 2006. Les abords du chez-soi: en quête d'espace intermédiaire. Editions de la Villette. 13Brès, A., Mariolle, B. 1990. Projet de logement, projet de ville. éditions Experimentations. 14Moley, C. 2006. Les abords du chez-soi: en quête d'espace intermédiaire. Editions de la Villette.
38 qui se traduit notamment sur une échelle intermédiaire.
"son traitement est conçu par une succession de seuils du plus collectif au plus individuel assurant appropriation et privatisation successive de l'espace" 13
L'idée serait de singulariser son ancrage au sol en mettant le bâtiment à niveau du sol. Ceci se ferait alors à travers la surélévation d'une partie du bâtiment pour qu'il puissent y avoir un accès doux et poreux au niveau du sol au nord, comme au sud du bâtiment. De cette manière, la valorisation de l'espace végétal du coeur d'îlot et du front de parcelle est ainsi liée, et contribue à la notion du parcours de l'habitant d'un espace à l'autre de manière homogène.
“Je crois qu’il doit y avoir une grande porosité entre espace public et espace privé, et que l’architecture sera elle même quand elle aura évacué cette séparation qui la fait mourir... Offrir des limites à l'espace est nécessaire parce que cela permet l'appropriation de cet espace. La limite de la parcelle distingue de manière franche l'espace public de l'espace privé. Le sentiment d'appropriation de l'espace vient de ce qu'on peut en jouir librement parce que l’on contrôle cet espace ”12 des seuils requalifiés Comme constaté lors du diagnostic, on retrouve des tracés et des limites rigides, avec une utilisation de matériaux de nature lourde et non poreuse dans les espaces extérieurs. On remarque que les espaces ne dialoguent pas entre eux. De plus, par la topographie du site, les entrées aux paliers des cages d'escalier n'ont pas d'accroche au sol et donc, pas de liens entre le bâtiment et son environnent. Il serait alors envisageable de créer une nouvelle manière d'entrer chez soi par le moyen du parcours depuis son espace public jusqu'au logement. L'enjeu serait alors de résoudre cette problématique en articulant les seuils d'entrés à leur environnent et les logements (relations aux intentions de l'échelle urbaine).
"l'attente vis-à-vis des abords immédiats de son logement est marquée par la dualité: il voudrait y communiquer, mais par ailleurs y contrôler autrui ce qui impliquerait un espace qui puisse à la fois favoriser les contacts et tenir à distance, voire affirmer son domaine" 14
Prolonger l'espace public à travers le bâtiment est alors une opportunité d'adresser les entrées et le parcours à l'intérieur du bâtiment pour créer
La distribution de chauffage en plafond rayon nant a été supprimée au profit d’une distribution par radiateur, les installations d’origine n’offraient pas à FSM des garanties de pérennité satisfai santes (risque de gel des installations, présence de boue, absence d’entretien).
illustration 26: Schéma d'intentions du logement.
Au regard des problématiques de maintenance et dans un objectif d’optimisation de la chaufferie bois, le maître d’ouvrage n’a pas retenu l’installa tion de panneaux solaires initialement prévu et a préféré un renforcement de la chaufferie bois.
FSM a développé l’implantation d’une chaufferie bois, en lieu et place de la chaufferie existante (chaudière collective à condensation gaz + bois), qui assurera la production de chauffage et de l’eau sanitaire pour les 358 logements et les rez-dechaussée commerciaux.
Des radiateurs eau chaude horizontaux et verti caux dans le séjour ainsi que des sèche-serviettes dans les salles de bain ont été installés. Ils sont alimentés par un réseau cheminant en fauxplafond et cloisons type Placostil.
Systèmes et équipements
La ventilation des logements a été rénovée au profit d’une installation VMC hygroréglable type B. La consommation énergétique de 70 kwEP/m2.an est une consommation prévisionnelle issue de calculs. Le maître d’ouvrage envisage de suivre la consommation énergétique de chaque bâtiment pour s’assurer que les consommations réelles sont conformes aux prédictions. Étiquette de performance énergétique © FSM
39
– 16 –
illustration 25: Hall et RDC traversant de la FaisanderieVue traversante au Rez-de-chaussée © Sergio Grazia
habiter le commun
Un lieu de rencontre, d'attente, de pause, permettant de croiser les individus. Tout comme la requalification du RDC de La Faisanderie à Fontainebleau, où l'architecte propose de donner de la transparence au rez-de-chaussée, une entrée plus accueillante, une entrée ou on traverse le socle visuellement et physiquement (illustration 25).
16
L'intention est alors de créer un parcours depuis le rez-de-chaussée jusqu'au R+4 en créant des espaces de rencontre à plusieurs niveaux du logement. Comme évoquer plus haut, ces espaces sont créés pour faciliter et inciter les rencontres et l'appropriation de ses espaces par les habitants. L'intérêt n'est pas de figer leurs usages, mais de les présenter de manière à démontrer les potentialités qui peuvent en découler pour inviter les habitants à se les approprier, mais aussi la possibilité à ces espaces de muter en fonction des profils des foyers et de leurs centres d'intérêt. En revanche, l'accès aux logements ne se fait pas uniquement via le parcours. La possibilité aux habitants d'accéder aux logements de manière plus rapide verticalement à travers les cages d'escaliers reste "L’urbanitépossible. commence au coeur du logement, au centre du projet. C’est la façon donnée à chacun de vivre l’espace de ses jours et de ses nuits, tout en côtoyant l’autre de manière variée. C’est le système paradoxal de l’unique et du multiple, de la rencontre à l’isolement, du monumental aux quotidiens”
16Eleb-Vidal, M. 1988. Penser l'habité, le logement en question. Editions Pierre Mardaga.
15Hubert, B.J. et Roy, M. N.D. Constructed spaces: practice(s); context(s); implementations(s). Site internet: https:// hubert-roy.com/en/.
40
des halls lumineux, spacieux et visibles depuis les espaces publics.
Les hypothèses de projet développées jusqu'ici ont pour but de questionner le vivre ensemble et les manières d'habiter pour renouer les liens physiques et sociaux entre Pertuischaud et son environnent. Cette logique se traduit également par le biais du logement et de ses espaces communs. Tout comme à chacune des échelles, lorsque l'on passe le palier, une nouvelle typologie est nécessaire pour répondre aux besoins des habitants. La vie au sein du logement se rassemble typiquement autour d'une fonction. Souvent, autour du repas ou d'une activité. Ainsi, B.J. Hubert et M. Roy proposent de diviser les espaces dans les logements en fonction de deux types de sociabilité : le commun privé et le commun public15
illustration 27: plan d'un T2 d'économie d'espace16
42
17Eleb-Vidal, M. 1988. Penser l'habité, le logement en question. Editions Pierre Mardaga.
Les logements en revanche, ont pour idée d'être des cellules plus autonomes et privatives. L'intention est d'avoir des espaces qui suivent le même principe: la graduation entre l'intime, le privé et le commun, pour permettre aux habitants de s'isoler et préserver leur intimité si besoin tout en offrant un espace de rencontre convivial, ou l'on peut se rencontrer confortablement et passer de bons moments, en famille, entre membres de cohabitation, comme entre amis. Celle-ci, plus adapter au grand logement, les typologies des petits logements (entre T1 et T2) en revanche ne possède pas la même contrainte de l'isolement et du vivre ensemble au coeur du logement. Dans cette démarche, l'idée est de favoriser les pièces de vie pour les petits espaces (illustration 19)17.
43
44
Cette communauté est devenue pour nous, une famille.
Plusieurs décennies plus tard, nous constatons que les logements de Pertuishcaud se sont détériorés, que les espaces ne sont plus utilisés comme il a été originairement prévu et que les logements ne correspondent plus aux besoins d'aujourd'hui à plusieurs échelles.
après-propos: une petite expérience personnelle
Nous l'avions vue plus haut, que les ménages d'aujourd'hui sont plus variés que ceux des années 60. Les logements ont eux, pas évoluer. Il faut donc les adapter.
La première quelques années après avoir déménagé a l'étranger en 2008, où nous vivions dans une petite communauté de 15 à 20 familles. Nous étions excentrés des villes, de nos familles et de nos amis qu'on côtoyait régulièrement. Ma mère, avec certains membres de cette communauté ont alors décidé de créer des activités régulières dans différents lieux (salles communes mises à dispositions, nos garages, etc), tels que la danse, le yoga, des ateliers d'art pour se garder actifs.ives, mais aussi pour combler ce manque de lien social qui a commencé à se manifester.
L'architecte aujourd'hui fait face à la question du devenir de ses ensembles, les donner une seconde vie et les adapté aux nouveaux usages et demandes des habitants.
En référence au propos de Sophie Delhay par apport a la pratique des espaces partagés et de la nouvelle façon d'habiter le logement, je constate aujourd'hui avec un peu de recul que nous (moi-même, mais aussi mes parents) nous sommes approprié des espaces a deux reprises pour créer des activités au cours de ces 10 dernières années.
La seconde expérience s'est créée pendant la crise sanitaire durant laquelle nous avons requalifié certains espaces de notre immeuble en espace de rencontre pour nous côtoyer, faire du sport ou prendre l'apéro par exemple (illustration 28). L'escalier extérieur s'est reconverti en
Onconclusioncomprend désormais l'intérêt qu'ont apporté les grands ensembles en après-guerre. Construire des logements de qualité, rapidement et a prix minime pour loger les habitants et améliorer les conditions de vie.
Il y a eu plusieurs architectes qui on questionné et proposer de nouvelles façons d'habiter et de concevoir le logement comme celle proposer par Jean Nouvel ou Yves lion. L'enjeu est alors de proposer des espaces qui peuvent s'adapter aux nouvelles compositions familiales et aux nouveaux besoins des habitants. Il ne s'agit plus d'habiter la cellule, mais d'habiter le logement dans son ensemble.
45 espace de rencontre pour l'apéro, pour que nous puissions discuter avec les voisins depuis leur balcon en début de soirée, le petit espace vert et paysagé de l'immeuble comme espace de rencontre pour le barbecue les vendredis soir ou pour faire du sport. Une pratique qui continue aujourd'hui dans notre immeuble. Ces pratiques ont même pu évoluer comme indique mon petit frère qui occupe actuellement l'appartement. Il explique que notre séjour s'est transformé en espace de transition par les voisins. Ils entrent quotidiennement en sortant de leurs voitures pour discuter un moment ou prendre un verre avant de rejoindre la cage d'escalier pour accéder à leur foyer.
"le concept de la famille d’entourage qui devient très répandu, qui se fonde sur les liens entre plusieurs foyers: relations, services et échanges entre les générations ou entre les membres d’une même fratrie"18 illustration 28: schéma illustrant les liaisons entre les espaces. Espace de sport ou barbecue Espace de rencontre apéro 18Masboungi, A. 2010. Bien habiter la ville. Edition le moniteur.
Ces deux exemples personnels m'interroge dans les façons d'habiter et d'occuper les logements aujourd’hui.
Blanchon-Caillot, B. 2007. Les paysagistes français de 1945-1975. Openedition Blanchon-Caillot,journals.
B. 2007. Pratiques et compétences paysagistes dans les grands ensembles d’habitation, 1945-1975. Openeditionjournals. Brès, A., Mariolle, B. 1990. Projet de logement, projet de ville. Editions Experi Delhay,mentations.S.2019.
Le logement : Un espace de liberté. Conférence à l'école spéciale d'architecture, Paris. Eleb-Vidal, M. 1988. Penser l'habité, le logement en question. Editions Pierre Eleb,Mardaga.M., Simon, P. 2013. Entre confort, désir et normes. Le logement contemporain 1995-2012. Edition Mardaga. Ensa Lyon, 2006. Les espaces libres, atouts des grands ensembles. Sous la direction d'Hélène Hartzfield. Hubert, B.J. et Roy, M. N.D. Constructed spaces: practice(s); context(s); implémen tations(s). Site internet: https://hubert-roy.com/en/. La Croix, 2013. La construction de Logements de l'après-guerre a aujourd'hui. Site intenet: Masboungi,ments-de-l-apres-guerre-a-aujourd-hui-2013-09-10-1011728.https://www.la-croix.com/Actualite/France/La-construction-de-logeA.2010.
Bien habiter la ville. Edition le moniteur. Moley, C. 2006. Les abords du chez-soi: en quête d'espace intermédiaire. Editions de la Moley,Villette.C.1990.
Les extérieurs du logement. UNFOHLM. Mussée-hlm, 2022. Le temps des grands ensembles. Site internet: https://mu see-hlm.fr/exhibit/96. 4 - bibliographie
Rapport de présentation PFE ENSA Nantes - (re)constructionRemyfifty-fiftyPitot